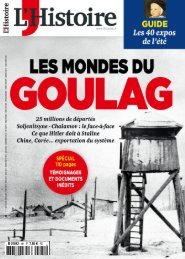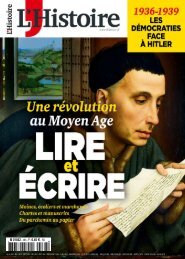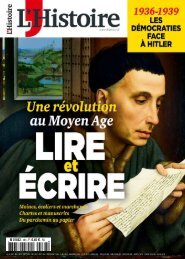La chute du Mur, et après ? - Magazine L'Histoire
1989 : les pays d’Europe de l’Est se libèrent les uns après les autres du communisme. Mais la transition démocratique n’est pas sans heurts. La thérapie économique de choc adoptée s’accompagne de forts taux de chômage. L’entrée dans l’Union européenne est lente à aboutir et les anciens citoyens de l’Est continuent parfois à se sentir méprisés. Aujourd’hui, en Hongrie et en Pologne, les dirigeants remettent en cause la démocratie libérale. Pas si facile de sortir du communisme. Avec Roman Krakovsky, Catherine Gousseff, Paul Gradvohl, Bernard Guetta, Nicolas Offenstadt.
1989 : les pays d’Europe de l’Est se libèrent les uns après les autres du communisme. Mais la transition démocratique n’est pas sans heurts.
La thérapie économique de choc adoptée s’accompagne de forts taux de chômage. L’entrée dans l’Union européenne est lente à aboutir et les anciens citoyens de l’Est continuent parfois à se sentir méprisés. Aujourd’hui, en Hongrie et en Pologne, les dirigeants remettent en cause la démocratie libérale. Pas si facile de sortir du communisme.
Avec Roman Krakovsky, Catherine Gousseff, Paul Gradvohl, Bernard Guetta, Nicolas Offenstadt.
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
33<br />
DR<br />
Trente ans après la <strong>chute</strong> <strong>du</strong><br />
communisme, les pays de l’Europe<br />
centrale <strong>et</strong> orientale sont<br />
en train de basculer vers des<br />
autoritarismes d’un type inédit<br />
: les « démocraties illibérales<br />
». <strong>La</strong> Pologne <strong>et</strong> la<br />
Hongrie sont les premières à s’engager sur ce<br />
chemin alors que ce sont elles qui, dans les<br />
années 1980, ont été les premières à rem<strong>et</strong>tre<br />
en question le système communiste. Les révolutions<br />
de 1989 ont-elles échoué à faire advenir<br />
un ordre social nouveau, fondé sur la<br />
démocratie <strong>et</strong> les libertés ?<br />
1989 : « année zéro » ?<br />
Les événements de 1989 constituent une<br />
« révolution » au sens où leurs conséquences<br />
furent irréversibles. Pour les contemporains<br />
cependant, ces changements s’inscrivaient<br />
dans la continuité des années précédentes. <strong>La</strong><br />
crise économique des années 1980 avait en<br />
eff<strong>et</strong> con<strong>du</strong>it les gouvernements communistes<br />
à s’ouvrir au changement. Au sein des partis,<br />
une jeune génération d’économistes s’était alors<br />
tournée vers le libéralisme. Inspirés de Milton<br />
Friedman <strong>et</strong> de l’école de Chicago 1 , Václav Klaus<br />
en Tchécoslovaquie ou Leszek Balcerowicz en<br />
Pologne œuvrèrent dans les années 1980, pour<br />
ré<strong>du</strong>ire l’ingérence de l’État dans l’économie.<br />
Certaines économies planifiées intro<strong>du</strong>isirent<br />
progressivement des mécanismes de marché.<br />
En Hongrie, le secteur privé se développa dès<br />
le début des années 1980 <strong>et</strong>, vers 1985, il représentait<br />
déjà 80 % <strong>du</strong> secteur des BTP, 60 % des<br />
services, 20 % de l’agriculture <strong>et</strong> 15 % de l’in<strong>du</strong>strie,<br />
générant près de 30 % <strong>du</strong> PNB. En 1987, le<br />
gouvernement renonça à garantir à chacun un<br />
emploi, entraînant l’apparition <strong>du</strong> chômage.<br />
Parallèlement, le pays s’ouvrait aux investissements<br />
étrangers. En Pologne, en 1989, le programme<br />
de réformes, élaboré avec l’aide des experts<br />
<strong>du</strong> Fonds monétaire international (FMI),<br />
amorça un processus de privatisation.<br />
D’autres pays, comme la Tchécoslovaquie, repoussèrent<br />
les réformes car leur situation économique,<br />
moins dégradée, le leur perm<strong>et</strong>tait. Mais<br />
la plupart n’eurent d’autre choix que de suivre les<br />
rec<strong>et</strong>tes libérales <strong>du</strong> « consensus de Washington »<br />
(FMI, Banque mondiale) <strong>et</strong> d’adopter une stricte<br />
discipline budgétaire ou d’autoriser l’entreprise<br />
privée afin de s’assurer le soutien des bailleurs occidentaux.<br />
A la fin des années 1980, dans le bloc<br />
de l’Est, l’économie de marché <strong>et</strong> la dérégulation<br />
s’imposèrent comme les seules alternatives au socialisme,<br />
devenu synonyme de pénuries <strong>et</strong> d’inefficacité.<br />
Le terrain était prêt pour que les « révolutions<br />
» de 1989 prennent des formes libérales.<br />
Le passage à la démocratie fut, lui aussi, un<br />
processus progressif. Dès les années 1980, l’opposition<br />
en Pologne <strong>et</strong> en Hongrie engage un dialogue<br />
avec le pouvoir. Malgré quelques résultats<br />
L’AUTEUR<br />
Maître de<br />
conférences<br />
à l’université<br />
de Genève,<br />
Roman Krakovsky<br />
a notamment publié<br />
L’Europe centrale <strong>et</strong><br />
orientale, de 1918<br />
à la <strong>chute</strong> <strong>du</strong> mur<br />
de Berlin (Armand<br />
Colin, 2017)<br />
<strong>et</strong> Le Populisme<br />
en Europe centrale<br />
<strong>et</strong> orientale. Un<br />
avertissement pour<br />
le monde ?<br />
(Fayard, 2019).<br />
Notes<br />
1. L’école de Chicago<br />
désigne un groupe<br />
d’économistes libéraux des<br />
années 1950, opposé à la<br />
théorie keynésienne, <strong>et</strong><br />
dont Milton Friedman est<br />
la figure emblématique.<br />
2. Terme intro<strong>du</strong>it par<br />
la sociologue polonaise<br />
Jadwiga Staniszkis dans<br />
Pologne. <strong>La</strong> révolution<br />
autolimitée, PUF, 1982.<br />
positifs, le gouvernement polonais ne parvint<br />
pas à assainir la situation économique. Une nouvelle<br />
hausse des prix de 110 %, en février 1988,<br />
provoque une hyperinflation <strong>et</strong> déclenche une<br />
vague de grèves pendant le printemps <strong>et</strong> l’été<br />
que la police ne parvient plus à maîtriser. Le Parti<br />
communiste continue à perdre massivement ses<br />
membres tandis que le syndicat indépendant<br />
Solidarnosc, fondé en 1980 par Lech Walesa <strong>et</strong><br />
interdit depuis l’état de siège de 1981, s’impose<br />
comme leader de l’opposition (cf. p. 37).<br />
Alors que Mikhaïl Gorbatchev m<strong>et</strong> en œuvre<br />
en URSS la perestroïka (cf. p. 42), refuser des réformes<br />
devient impossible. Pour apaiser le mécontentement<br />
populaire, le gouvernement fait<br />
appel à Lech Walesa afin de négocier avec les<br />
grévistes. Selon le ministre de l’Intérieur le général<br />
Czeslaw Kiszczak, l’objectif des négociations<br />
« de la table ronde », organisées entre février<br />
<strong>et</strong> avril 1989, est de trouver un accord afin<br />
de continuer à construire le « socialisme avec<br />
un visage démocratique <strong>et</strong> humain ». Ces pourparlers<br />
aboutissent à un compromis : la légalisation<br />
<strong>du</strong> syndicat Solidarnosc <strong>et</strong> l’organisation<br />
d’élections semi-libres, en juin 1989 : la totalité<br />
des sièges <strong>du</strong> Sénat (chambre haute) <strong>et</strong> 35 % des<br />
sièges au Sejm (Diète) sont remis au vote, avec,<br />
pour la première fois depuis 1947, des candidats<br />
non communistes, tandis que les postes de président,<br />
de Premier ministre <strong>et</strong> de chef de la police<br />
<strong>et</strong> de l’armée sont réservés aux communistes. <strong>La</strong><br />
participation est assez modérée – 62,7 % au premier<br />
tour <strong>et</strong> 25 % au second. Mais ce qui semblait<br />
être un bon arrangement pour le pouvoir<br />
s’avère un échec : malgré le contrôle des principaux<br />
médias <strong>et</strong> une liste électorale communiste<br />
composée de personnalités locales mais aussi de<br />
célébrités sportives <strong>et</strong> médiatiques, Solidarnosc<br />
remporte tous les sièges remis en jeu. Après c<strong>et</strong>te<br />
défaite humiliante, les communistes polonais<br />
ne sont plus en mesure de former un gouvernement.<br />
Le 24 août 1989, le chef de l’État Jaruzelski<br />
doit accepter le candidat de Solidarnosc Tadeusz<br />
Mazowiecki au poste de Premier ministre <strong>et</strong>, en<br />
décembre 1990, il démissionne ; Lech Walesa est<br />
élu lors d’élections libres le 9 décembre 1990. Au<br />
terme de c<strong>et</strong>te « révolution autolimitée » 2 , le communisme<br />
tombe sans violence.<br />
En Hongrie, c’est l’opposition à l’intérieur<br />
même <strong>du</strong> Parti qui con<strong>du</strong>it le pays vers la sortie<br />
<strong>du</strong> communisme. En 1986-1987, son aile libérale<br />
prépare un plan de réformes stipulant entre<br />
autres résolutions la liberté de la presse <strong>et</strong> la liberté<br />
d’opinion. Malgré les résistances de l’aile<br />
conservatrice <strong>du</strong> Parti, le plan est adopté par le<br />
Comité central en 1988 <strong>et</strong>, par la même occasion,<br />
le premier secrétaire <strong>du</strong> Parti, János Kádár,<br />
en place depuis 1956, vieux <strong>et</strong> physiquement<br />
diminué, est remplacé par le conservateur plus<br />
pragmatique Károly GrÓsz. Le nouveau gouvernement<br />
hongrois adopte alors un programme trisannuel<br />
de privatisation des entreprises<br />
L’HISTOIRE / N°464 / OCTOBRE 2019