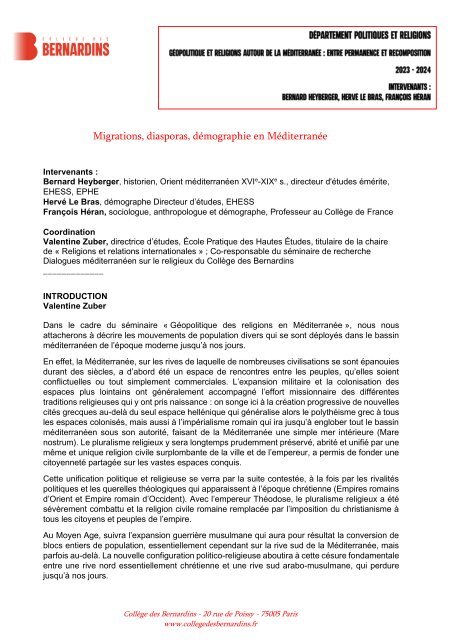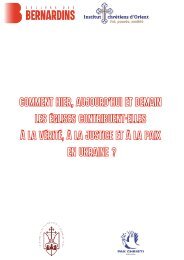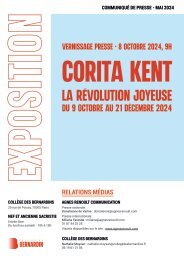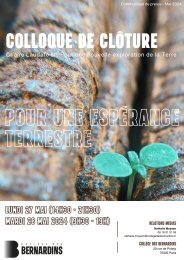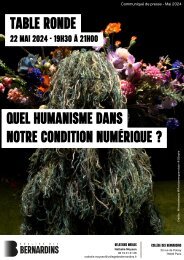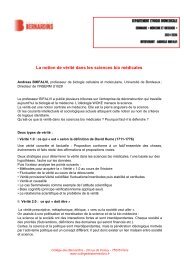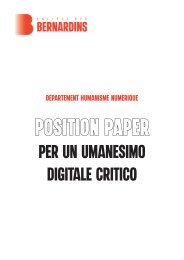2024_04_26_Géopolitique_CR-2
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Migrations, diasporas, démographie en Méditerranée<br />
Intervenants :<br />
Bernard Heyberger, historien, Orient méditerranéen XVI e -XIX e s., directeur d'études émérite,<br />
EHESS, EPHE<br />
Hervé Le Bras, démographe Directeur d’études, EHESS<br />
François Héran, sociologue, anthropologue et démographe, Professeur au Collège de France<br />
Coordination<br />
Valentine Zuber, directrice d’études, École Pratique des Hautes Études, titulaire de la chaire<br />
de « Religions et relations internationales » ; Co-responsable du séminaire de recherche<br />
Dialogues méditerranéen sur le religieux du Collège des Bernardins<br />
_____________<br />
INTRODUCTION<br />
Valentine Zuber<br />
Dans le cadre du séminaire « Géopolitique des religions en Méditerranée », nous nous<br />
attacherons à décrire les mouvements de population divers qui se sont déployés dans le bassin<br />
méditerranéen de l’époque moderne jusqu’à nos jours.<br />
En effet, la Méditerranée, sur les rives de laquelle de nombreuses civilisations se sont épanouies<br />
durant des siècles, a d’abord été un espace de rencontres entre les peuples, qu’elles soient<br />
conflictuelles ou tout simplement commerciales. L’expansion militaire et la colonisation des<br />
espaces plus lointains ont généralement accompagné l’effort missionnaire des différentes<br />
traditions religieuses qui y ont pris naissance : on songe ici à la création progressive de nouvelles<br />
cités grecques au-delà du seul espace hellénique qui généralise alors le polythéisme grec à tous<br />
les espaces colonisés, mais aussi à l’impérialisme romain qui ira jusqu’à englober tout le bassin<br />
méditerranéen sous son autorité, faisant de la Méditerranée une simple mer intérieure (Mare<br />
nostrum). Le pluralisme religieux y sera longtemps prudemment préservé, abrité et unifié par une<br />
même et unique religion civile surplombante de la ville et de l’empereur, a permis de fonder une<br />
citoyenneté partagée sur les vastes espaces conquis.<br />
Cette unification politique et religieuse se verra par la suite contestée, à la fois par les rivalités<br />
politiques et les querelles théologiques qui apparaissent à l’époque chrétienne (Empires romains<br />
d’Orient et Empire romain d’Occident). Avec l’empereur Théodose, le pluralisme religieux a été<br />
sévèrement combattu et la religion civile romaine remplacée par l’imposition du christianisme à<br />
tous les citoyens et peuples de l’empire.<br />
Au Moyen Age, suivra l’expansion guerrière musulmane qui aura pour résultat la conversion de<br />
blocs entiers de population, essentiellement cependant sur la rive sud de la Méditerranée, mais<br />
parfois au-delà. La nouvelle configuration politico-religieuse aboutira à cette césure fondamentale<br />
entre une rive nord essentiellement chrétienne et une rive sud arabo-musulmane, qui perdure<br />
jusqu’à nos jours.<br />
Collège des Bernardins - 20 rue de Poissy - 75005 Paris<br />
www.collegedesbernardins.fr
Elle explique la conflictualité antagoniste prenant une forme de conflit de civilisation à base<br />
religieuse. Elle a connu des épisodes d’expansion ou de retrait (côté musulman : arrêt des<br />
troupes sarrasines à Poitiers en 732, échec du siège de Vienne en 1683, côté chrétien : les<br />
différentes croisades en Terre sainte (XI e -XIII e siècles), la Reconquista espagnole qui aboutit à la<br />
fin du royaume musulman de Grenade en 1492…).<br />
Ces guerres n’ont cependant jamais vraiment empêché la continuité des échanges entre les<br />
différents espaces. Ceux-ci ont pris la forme de transfert de populations, mais aussi de relations<br />
commerciales qui ont fait la fortune de certains ports méditerranéens (dont les plus célèbres sont<br />
la cité État de Venise, ou Constantinople). Une sorte d’équilibre géopolitique s’est ainsi constitué<br />
permettant de substituer aux conflits armés des relations plus pacifiques prenant une forme<br />
essentiellement diplomatique et pacifiant des relations commerciales particulièrement<br />
fructueuses.<br />
A l’époque contemporaine, l’expansion coloniale des pays occidentaux a profondément bousculé<br />
l’espace géopolitique méditerranéen. Avec la mainmise européenne (politique militaire,<br />
économique) sur de vastes espaces relevant de l’Empire Ottoman, un nouveau cycle de conflits<br />
(entre le nord et le sud, mais aussi entre les colonisateurs eux-mêmes) a bouleversé les équilibres<br />
géopolitiques antérieurs. Ceux-ci prennent évidemment racine dans l’histoire brièvement<br />
résumée ici, mais relèvent tout autant dans des dynamiques démographiques et migratoires<br />
qu’elles ont contribué à engendrer. Le facteur religieux n’y est peut-être plus aussi intense que<br />
jadis, mais colore cependant les relations entretenues entre les différents espaces<br />
méditerranéens. Au début du XX e siècle, l’effondrement politique de l’Empire ottoman, qui avait<br />
permis de protéger d’une certaine manière les droits personnels des minorités religieuses non<br />
musulmanes le plus souvent résiduelles, a réenclenché des mouvements de migrations<br />
ethnoreligieuses à travers le bassin méditerranéen (comme l’émigration juive en Palestine qui<br />
s’est accélérée après la seconde guerre mondiale et la création de l’État d’Israël, ou celle,<br />
continue à fur et à mesure des durcissements politiques locaux, des communautés chrétiennes<br />
d’Orient vers Europe…). Enfin, la Méditerranée est actuellement traversée par de nombreux<br />
mouvements migratoires, de nature politiques ou économiques, qui convergent vers l’Europe<br />
depuis le sud de la Méditerranée, avec les drames humains que l’on connait quotidiennement.<br />
Ce séminaire tentera donc de faire le point sur les dynamiques démographiques et migratoires<br />
récentes ou présentes qui affectent toujours actuellement le bassin méditerranéen, en particulier<br />
lorsqu’elles sont tout ou parties motivées par le religieux. Un intérêt particulier sera enfin porté au<br />
phénomène de constitution de nombreuses diasporas hors de leur terreau d’origine, qui constitue<br />
l’une des spécificités de la modernité, à travers la pluralisation des espaces politiques modernes<br />
et la massification des échanges et des communications.<br />
LA MÉDITERRANÉE ENTRE AFRIQUE ET EUROPE : MIGRATIONS OBSERVÉES,<br />
<strong>CR</strong>AINTES, PROJETÉES<br />
Hervé Le Bras<br />
Il existe des caractères communs à la démographie des pays méditerranéens par rapport à leur<br />
arrière-pays continental, Europe et Afrique. En revanche, à part la traversée périlleuse de la<br />
Méditerranée, les origines des migrants varient beaucoup d’un pays à l’autre car elles reflètent leur<br />
passé, notamment colonial.<br />
Fécondité, activité féminine<br />
Les pays du sud de l’Europe ont en commun une faible fécondité, entre 1,25 et 1,35 enfant par<br />
femme, un âge élevé à la maternité et un taux d’activité féminine plus faible qu’au nord. Cela parait<br />
paradoxal : dans un pays donné, plus la fécondité est faible, plus l’âge moyen à l’ensemble des<br />
maternités devrait être faible puisqu’il manque des naissances de rang élevé. D’autre part, dans un<br />
pays donné, les femmes « au foyer » ont en moyenne plus d’enfants, donc les taux d’activité plus<br />
faibles devraient être en rapport avec une fécondité plus élevée. Pour ajouter au paradoxe, la famille<br />
Collège des Bernardins - 20 rue de Poissy - 75005 Paris<br />
www.collegedesbernardins.fr
a un rôle social plus important au sud de l’Europe qu’au centre et au nord, par exemple dans la<br />
recherche d’un premier emploi ou dans le soutien financier des parents à leurs enfants. La solution<br />
du paradoxe est assez simple : les femmes du sud de l’Europe veulent l’égalité, particulièrement<br />
l’égalité au travail à commencer par simplement un travail. Or, si elles commencent à fonder une<br />
famille, elles trouveront difficilement un travail, la pression familiale ne les aidant pas et même les<br />
poussant dans le rôle maternel. Elles retardent donc la conception du premier enfant jusqu’à ce<br />
qu’elles aient obtenu un emploi assez stable ou sa promesse assez certaine.<br />
Similairement, les pays du nord de l’Afrique ont une fécondité beaucoup plus faible que ceux du<br />
Sahel du golfe de Guinée et de l’Afrique centrale. La situation des femmes en est ici aussi la cause.<br />
Plus éduquées au nord et ayant un niveau de vie plus élevée, elles peuvent plus facilement limiter<br />
le nombre de leurs maternités.<br />
Migrations méditerranéennes<br />
La composition de l’immigration a peu de points communs de l’Ouest à l’Est de la Méditerranée et<br />
de même celle des demandeurs d’asile. Il faut donc procéder à une énumération. Commençons par<br />
l’Espagne. Les principales nationalités étrangères y sont dans l’ordre : Maroc (1,05 million),<br />
Colombie (0,72), Roumanie (0,54), Venezuela (0,52), Argentine (0,37). Passons à la France où dans<br />
l’ordre, les pays d’origine des immigrés sont : Algérie (0,85), Maroc (0,81), Portugal (0,61), Tunisie<br />
(0,30), Italie (0,29). L’Italie ensuite : Roumanie (1,08), Albanie (0,42), Maroc (0,42), Chine (0,31),<br />
Ukraine (0,24). La Grèce : Albanie (0,48), Bulgarie (0,076), Roumanie (0,<strong>04</strong>7), Pakistan (0,034),<br />
Géorgie (0,027). Deux autres pays méditerranéens plus modestes ont aussi une structure<br />
d’immigration différente, la Croatie et la Slovénie : pour la première, viennent en tête les Ukrainiens<br />
(9 600 personnes), les Bosniaques (5 700) et les Serbes (1700). Pour la seconde, les deux seules<br />
origines étrangères importantes sont la Bosnie (11 400) et l’Ukraine (6 200).<br />
Interviennent donc le passé colonial, la langue, la proximité géographique, la temporalité des<br />
migrations, notamment le retard pris par les pays des Balkans dans l’émigration.<br />
Les demandes d’asile qui sont soigneusement consignées par Eurostat sont encore plus diverses<br />
non seulement par pays, mais année après année parce que les demandeurs d’asile suivent<br />
attentivement les possibilités offertes dans chaque pays et leur évolution. En France les Albanais<br />
qui ont culminé à 11 400 demandes en 2017 sont retombés à 2 650 en 2023. En Italie aux mêmes<br />
dates, ils ont au contraire augmenté de 460 à 1 480. Les différences de destination des demandeurs<br />
d’un pays donné sont énormes. En 2023, les Turcs ont par exemple déposé 55 demandes en Italie,<br />
9795 en France, 55 en Espagne, 2 650 en Grèce, 170 en Croatie. La même année, on recense 60<br />
demandes d’asile d’Égyptiens en Espagne et 18 175 en Italie (850 en France, 2 160 en Grèce).<br />
MOBILITÉS ET MIGRATIONS ENTRE L'EMPIRE OTTOMAN ET L'EUROPE OCCIDENTALE,<br />
XVIE - XVIIIE SIÈCLE<br />
Bernard Heyberger<br />
L’historiographie de la Méditerranée à l’époque moderne oscille entre une insistance sur l’unité<br />
géographique et humaine de la mer intérieure, ou au contraire sur les différences et les<br />
affrontements entre les deux rives. Depuis quelques années, elle insiste de nouveau sur les<br />
échanges, les interactions et les connections. Dans une démarche de « micro-histoire à l’échelle<br />
globale », elle s’attache davantage à diversifier les espaces et les échelles pertinents d’observation,<br />
plutôt qu’à tenter une approche englobante de la Méditerranée. C’est en suivant des individus ou<br />
des groupes restreints se déplaçant ou agissant successivement dans des contextes différents que<br />
les historiens tentent de saisir les interactions entre des acteurs appartenant à des communautés<br />
politiques, religieuses et juridiques différentes, qui peuvent tirer profit des situations de paix aussi<br />
bien que de conflit.<br />
Parmi ces individus mobiles, les chrétiens sujets ottomans ont émergé ces dernières années. Le<br />
nombre de ceux qui ont voyagé en Europe occidentale, voire s’y sont définitivement installés,<br />
représente quelques milliers pour le XVIIe et XVIIIe siècle. Comme pour d’autres migrants, il faut<br />
tenter de les saisir avant leur départ pour comprendre la stratégie qu’ils suivent et les compétences<br />
qu’ils mettent en œuvre pendant leurs déplacements. Dans leur situation de départ, ces individus<br />
appartiennent à des communautés qui présentent une structure diasporique : la dispersion,<br />
l’hétérogénéité, leur confèrent déjà une expérience en matière de mobilité et d’échanges à distance.<br />
D’autre part, vivant dans un système politique et social conçu en dehors d’eux, dans le cadre du<br />
Collège des Bernardins - 20 rue de Poissy - 75005 Paris<br />
www.collegedesbernardins.fr
droit islamique, ils ont acquis un savoir-faire en matière de pluralisme confessionnel et institutionnel,<br />
qui va faciliter leur intégration dans des réseaux confessionnels, essentiellement catholiques. Ceuxci<br />
sont parfois aussi des réseaux académiques ou savants, et des réseaux marchands<br />
méditerranéens.<br />
Ils partent rarement à l’aventure, mais avec des lettres de recommandation obtenues auprès des<br />
« Francs », essentiellement des missionnaires catholiques installés au Levant. A leur arrivée en<br />
Europe, ils s’appuient sur des réseaux de connaissances et de parentèle, pour l’hébergement, le<br />
déplacement, et le recueil des précieuses informations nécessaires à la réussite de leur voyage ou<br />
de leur éventuelle carrière. Ils arguent généralement du fait qu’ils sont victimes de persécutions<br />
religieuses pour légitimer leur démarche, contribuant ainsi à entretenir la conflictualité entre<br />
« Chrétienté » et « Islam ». Leur grand nombre provoque des réactions de sauvegarde des États,<br />
avec des mesures de contrôle et de répression à leur égard, qui se mettent en place<br />
progressivement. L’espace méditerranéen s’avère un champ précoce d’expérience des systèmes<br />
de régulation de l’itinérance et de contrôle des gens de passage, à travers des procédures de<br />
contrôle sanitaire (lazarets) et d’identification des personnes (passeports, patentes, sauf-conduits).<br />
Collège des Bernardins - 20 rue de Poissy - 75005 Paris<br />
www.collegedesbernardins.fr