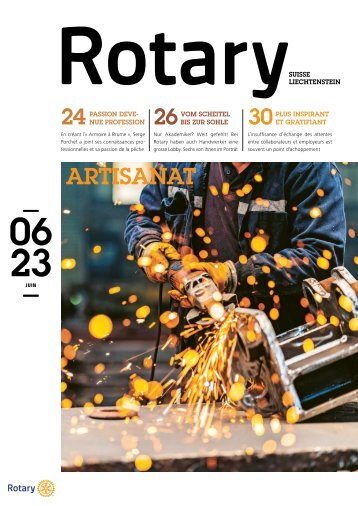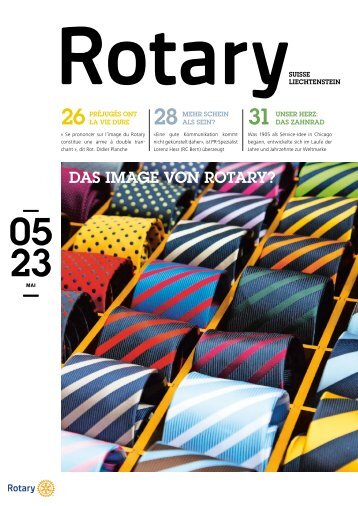Rotary Magazin 05/2019
- Text
- Rotary
- Paix
- Suisse
- Liechtenstein
- Russland
- Rotarier
- Mitglieder
- Membres
- Fondation
- Frieden
SCHWERPUNKT – ROTARY
SCHWERPUNKT – ROTARY SUISSE LIECHTENSTEIN – MAI 2019 PHILOSOPHIE KANT ET SON « PROJET DE PAIX PERPÉTUELLE » « L’état de paix n’est pas un état de nature, lequel est au contraire un état de guerre, c’est pourquoi il faut que l’état de paix soit institué », préconisa le philosophe allemand Emmanuel Kant. Pour maintenir la « paix perpétuelle » entre les nations portées naturellement au bellicisme, son projet de pacifisme se fondait sur la « raison politique », un devoir entre les Etats et leur fédération régie par une constitution républicaine. 28 Emmanuel Kant (1724–1804) fut l’un des rares philosophes à se passionner pour la paix, plus précisément la « paix perpétuelle », avec Hobbes, Leibniz, Voltaire et Rousseau. En 1795, parut à Königsberg son célèbre ouvrage intitulé Projet de paix perpétuelle ou Vers la paix perpétuelle quelques mois après la conclusion d’un traité de paix entre la Prusse et la France révolutionnaire, en conflit depuis trois ans. Son œuvre se référait au Projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe (1713) de l’abbé de Saint-Pierre (Charles-Irénée Castel de Saint-Pierre, 1658–1743), précurseur de la philosophie des Lumières, dont des extraits furent publiés et commentés par Rousseau. L’ecclésiastique y prônait la constitution d’une « Société permanente de l’Europe », qui rassemblerait des Etats souverains se pliant d’eux-mêmes à des arbitrages communs en cas de litiges. Kant s’inspira de cet écrit pour prendre position en faveur d’un pacifisme intransigeant – « la raison exige le bannissement inconditionnel de toute guerre » – tout en reconnaissant que l’enjeu restait essentiellement d’ordre juridique, et non moral ou théologique. Car, « dans son principe, le recours est incompatible avec la violence; seul le droit, généralisé à l’ensemble des relations humaines et interétatique, peut garantir une paix qui ne soit plus temporaire, simple parenthèse avant la reprise fatale d’hostilités », commente Martin Duru, auteur de diverses études sur le philosophe allemand. LE TRAITÉ DE PAIX EN QUESTION Le Projet de paix perpétuel de Kant se scinde en deux sections. La première contient six « articles préliminaires en vue d’une paix perpétuelle entre les Etats », « TOUS CITOYENS D’UNE CITÉ HUMAINE UNIVERSELLE » dans laquelle il énonce les conditions nécessaires en matière diplomatique, militaire ou économique à l’éradication progressive de la guerre. Le premier d’entre eux intitulé « Aucun traité de paix ne doit valoir comme tel, si on l’a conclu en se réservant tacitement matière à guerre future » permet d’apprécier sommairement le fond et la forme de l’argumentation du philosophe. Kant explique que « dans ce cas, en effet, ce serait un simple armistice, une suspension d’armes, mais non une paix marquant le terme de toutes les hostilités ; accoler à une semblable paix l’épithète perpétuel constitue déjà un pléonasme suspect. Les causes existantes de la guerre future, bien qu’ignorées peutêtre actuellement des parties contractantes, doivent toutes être anéanties par le traité de paix ; peu importe d’ailleurs qu’elles soient extraites de documents d’archives par l’investigation la plus subtile et la plus adroite. Réserver mentalement de vieilles prétentions, à déterminer d’abord ultérieurement et qu’aucune des parties ne tient présentement à mentionner, l’une et l’autre étant trop épuisées pour continuer la guerre, tout en ayant la mauvaise intention d’user à cette fin de la prochaine occasion favorable, c’est un procédé qui relève de la casuistique des Jésuites, et qui est au-dessous de la dignité des souverains, comme céder à de semblables séductions est au-dessous de la dignité de leurs ministres, si toutefois l’on considère la chose en elle-même. Mais si, suivant les idées éclairées de la sagesse politique, on place le véritable honneur de l’Etat dans un accroissement continuel de puissance, sans regarder aux moyens, un tel jugement, il est vrai, paraîtra scolastique et pédant. » Le deuxième article traite l’indépendance de chaque Etat qui « ne pourra être
SCHWERPUNKT – ROTARY SUISSE LIECHTENSTEIN – MAI 2019 « BANNIR TOUTE GUERRE » LA LIBERTÉ PAR LA CONSTITUTION RÉPUBLICAINE Dans la deuxième section de son Projet de paix perpétuel, Kant se livre à un vibrant plaidoyer en faveur de la constitution républicaine qui, fondée sur le respect et l’équilibre des libertés, est la seule à prémunir de la guerre. Dans ce cadre, il estime que « le droit des gens doit être fondé sur un fédéralisme d’Etats libres », lesquels renonceraient de leur plein gré à la guerre. De même, il considère que « le droit cosmopolitique doit se restreindre aux conditions de l’hospitalité universelle » ; complément du droit international, ce droit fait référence au monde qui n’appartient à personne et que chaque être humain doit être considéré comme une fin en soi, et non comme un moyen. Kant reconnaît donc la constitution républicaine comme l’unique fondement de toute législation juridique d’un peuple, car elle garantit entre autres sa liberté et l’égalité entre ses sujets. Elle pourrait même conduire à la « paix perpétuelle ». Et le philosophe de s’en expliquer : « Si l’assentiment des citoyens est exigé pour décider s’il y aura ou non la guerre, il sera tout naturel que, du moment qu’il leur faudrait décider de supporter tous les maux de la guerre, ils réfléchiront mûrement avant d’entreprendre un jeu aussi pernicieux. » acquis par un autre Etat, par héritage, échange, achat ou donation » au risque de « lui ôter son existence comme personne morale et faire de cette personne une chose », tandis que le troisième se préoccupe des armées permanentes qui « doivent être entièrement supprimées avec le temps ». Car Kant estime qu’elles représentent une perpétuelle menace de guerre pour les autres Etats et qu’elles poussent ces derniers à se surpasser les uns les autres par la masse des hommes d’armes qui n’a pas de limites. Quant aux trois derniers articles, ils concernent successivement les dettes publiques en vue de conflits extérieurs de l’Etat, le renoncement à s’immiscer de force dans les affaires d’un autre Etat, et la confiance réciproque entre deux Etats en guerre dans le cadre d’une paix future. En introduction à la deuxième section, qui comprend trois « articles définitifs en vue de la paix perpétuelle entre les Etats », Kant, qui prône la constitution républicaine, pose le postulat de base que « tous les hommes qui peuvent agir réciproquement les uns sur les autres doivent relever d’une constitution civile quelconque ». Or, toute constitution juridique, relativement aux personnes qui en relèvent, est établie d’après le droit civique des hommes dans un peuple, d’après le droit international des Etats les uns par rapport aux autres et d’après le droit cosmopolitique en tant que des hommes et des Etats, dans des conditions d’influence extérieures réciproques, doivent être considérés comme citoyens d’une cité humaine universelle. Texte: Rot. Didier Planche Référence: Martin Duru, « Kant et les frontières dans Projet de paix perpétuelle » , supplément de Philosophie Magazine, N°77, mars 2014 29
- Seite 1 und 2: SUISSE LIECHTENSTEIN 18 WIR UND DER
- Seite 3 und 4: EDITORIAL - ROTARY SUISSE LIECHTENS
- Seite 5 und 6: INHALT - ROTARY SUISSE LIECHTENSTEI
- Seite 7 und 8: CLUBLEBEN DISTRIKT 1980 - ROTARY SU
- Seite 9 und 10: CLUBLEBEN DISTRIKT 1990 - ROTARY SU
- Seite 11 und 12: CLUBLEBEN DISTRIKT 1990 - ROTARY SU
- Seite 13 und 14: CLUBLEBEN DISTRIKT 2000 - ROTARY SU
- Seite 15: CLUBLEBEN DISTRIKT 2000 - ROTARY SU
- Seite 18 und 19: SCHWERPUNKT - ROTARY SUISSE LIECHTE
- Seite 20 und 21: SCHWERPUNKT - ROTARY SUISSE LIECHTE
- Seite 22 und 23: SCHWERPUNKT - ROTARY SUISSE LIECHTE
- Seite 24 und 25: SCHWERPUNKT - ROTARY SUISSE LIECHTE
- Seite 26 und 27: SCHWERPUNKT - ROTARY SUISSE LIECHTE
- Seite 30 und 31: SCHWERPUNKT - ROTARY SUISSE LIECHTE
- Seite 32 und 33: ROTARY SCHWEIZ - ROTARY SUISSE LIEC
- Seite 34 und 35: ROTARY SCHWEIZ - ROTARY SUISSE LIEC
- Seite 36 und 37: ROTARY SCHWEIZ - ROTARY SUISSE LIEC
- Seite 38 und 39: ROTARY SCHWEIZ - ROTARY SUISSE LIEC
- Seite 40 und 41: ROTARY INTERNATIONAL - ROTARY SUISS
- Seite 42 und 43: ROTARY INTERNATIONAL - ROTARY SUISS
- Seite 44 und 45: ROTARY INTERNATIONAL - ROTARY SUISS
- Seite 46 und 47: ROTARY INTERNATIONAL - ROTARY SUISS
- Seite 48 und 49: ROTARY INTERNATIONAL - ROTARY SUISS
- Seite 50 und 51: PUBLIREPORTAGE SPENDENAUFRUF FÜR M
- Seite 52 und 53: ROTARY INTERNATIONAL - ROTARY SUISS
- Seite 54 und 55: Flussgenuss vom Reisebüro Mittelth
- Seite 56 und 57: NEUMITGLIEDER - ROTARY SUISSE LIECH
- Seite 58: AGENDA ROTARY HIGHLIGHTS 15./16.03.
Unangemessen
Laden...
Magazin per E-Mail verschicken
Laden...
Einbetten
Laden...