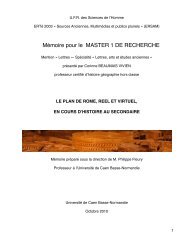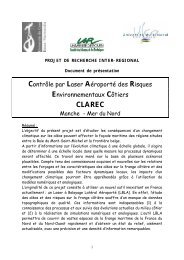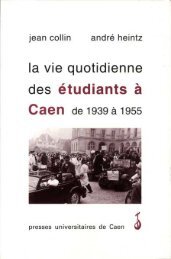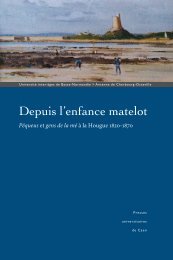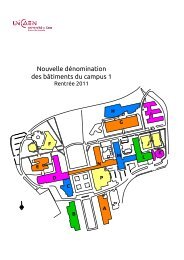« J'ai fait parler le loup et répondre l'agneau » : la Prosopopeia ...
« J'ai fait parler le loup et répondre l'agneau » : la Prosopopeia ...
« J'ai fait parler le loup et répondre l'agneau » : la Prosopopeia ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Schedae, 2009<br />
Prépublication n° 15 Fascicu<strong>le</strong> n° 2<br />
<strong>«</strong> J’ai <strong>fait</strong> <strong>par<strong>le</strong>r</strong> <strong>le</strong> <strong>loup</strong> <strong>et</strong> <strong>répondre</strong><br />
l’agneau <strong>»</strong> : <strong>la</strong> <strong>Prosopopeia</strong> aliquot animalium<br />
de Jean Ursin<br />
Brigitte Gauvin<br />
Université de Caen – CERLAM<br />
La <strong>Prosopopeia</strong> aliquot animalium, publiée en 1541 chez Macé Bonhomme, à Vienne en<br />
Dauphiné, <strong>et</strong> rééditée en 1552, est une œuvre en vers écrite par un médecin de Vienne,<br />
Johannes Ursinus, qu’on connaît aussi sous <strong>le</strong> nom de Jean Ursin ou Jean Orsini. Il a été<br />
l’auteur de nombreux livres dont quelques-uns nous sont parvenus : un commentaire des<br />
Disticha Catonis, un ouvrage moral, l’Ethologus, <strong>le</strong>s E<strong>le</strong>giae de Peste (1541) <strong>et</strong> <strong>la</strong> <strong>Prosopopeia</strong>.<br />
C<strong>et</strong>te œuvre, que <strong>le</strong> Parnasse Médical Français qualifie de <strong>«</strong> fort curieuse <strong>»</strong>, est d’emblée<br />
présentée comme une œuvre mixte, une tentative médico-poétique. En tant que traité de<br />
médecine, <strong>la</strong> <strong>Prosopopeia</strong> relève de <strong>la</strong> poésie didactique. L’œuvre, rédigée entièrement en<br />
<strong>la</strong>tin, est accompagnée d’un certain nombre de textes liminaires. El<strong>le</strong> est, tout d’abord,<br />
introduite par trois préfaces, éga<strong>le</strong>ment en <strong>la</strong>tin ; <strong>la</strong> première, en prose, est signée par<br />
Jacobus Olivarius (Jacques Olivier), <strong>le</strong> médecin avignonnais auteur des scolies ; <strong>la</strong> seconde, en<br />
prose aussi, est de Jean Ursin lui-même, il y présente son œuvre <strong>et</strong> <strong>la</strong> dédie à l’abbé Jacques<br />
de Joyeuse 1 ; <strong>la</strong> troisième préface, beaucoup plus courte, en distiques élégiaques (16<br />
vers), est signée Raymondus Aquaeus, gymnasiarcha d’Avignon, <strong>et</strong> constitue une simp<strong>le</strong><br />
captatio. Le volume s’achève sur une postface, en prose, signée par Stephanus Roybosius,<br />
l’éditeur de Jean Ursin : il expose <strong>le</strong>s problèmes techniques qui sont intervenus dans<br />
l’impression de <strong>la</strong> <strong>Prosopopeia</strong> <strong>et</strong> décharge l’auteur de toute responsabilité concernant <strong>le</strong>s<br />
défauts qui pourraient entacher l’ouvrage.<br />
Le corps du texte peut être partagé en cinq parties qu’aucune marque graphique ne<br />
délimite : <strong>la</strong> première est consacrée aux animaux sanguins, <strong>la</strong> seconde aux <strong>«</strong> animaux n’ayant<br />
pas de sang <strong>»</strong>, essentiel<strong>le</strong>ment <strong>le</strong>s repti<strong>le</strong>s, <strong>le</strong>s amphibiens <strong>et</strong> <strong>le</strong>s insectes, c’est-à-dire <strong>le</strong>s<br />
animaux dont Pline traite dans <strong>le</strong> livre XXIX de son Histoire naturel<strong>le</strong> 2 ; <strong>la</strong> troisième aux oiseaux,<br />
1. Jacques de Joyeuse, quatrième fils de Guil<strong>la</strong>ume de Joyeuse <strong>et</strong> d’Anne de Balzac, fut nommé doyen de<br />
<strong>la</strong> cathédra<strong>le</strong> du Puy, puis abbé de l’ordre de Saint-Antoine de Viennois en 1537. Il prit possession en 1539<br />
<strong>et</strong> mourut à l’abbaye en 1542 (M. Prévost, Roman d’Amat <strong>et</strong> H. Thibout de Morembert, Dictionnaire de<br />
biographie française, t. 18, Paris, L<strong>et</strong>ouzey <strong>et</strong> Ané, 1994, p. 949).<br />
2. Voir en annexe <strong>le</strong> tab<strong>le</strong>au n° 1.<br />
Brigitte Gauvin<br />
<strong>«</strong> “J’ai <strong>fait</strong> <strong>par<strong>le</strong>r</strong> <strong>le</strong> <strong>loup</strong> <strong>et</strong> <strong>répondre</strong> l’agneau” : <strong>la</strong> <strong>Prosopopeia</strong> aliquot animalium de Jean Ursin <strong>»</strong><br />
Schedae, 2009, prépublication n°15, (fascicu<strong>le</strong> n°2, p. 73-92).<br />
73
74<br />
<strong>la</strong> quatrième aux poissons, <strong>et</strong> <strong>la</strong> cinquième, qui devait, semb<strong>le</strong>-t-il, être consacrée aux<br />
insectes, est à peine ébauchée puisqu’el<strong>le</strong> ne comporte que deux poèmes. C<strong>et</strong>te c<strong>la</strong>ssification<br />
suit cel<strong>le</strong> des livres de Pline, reprise dans un grand nombre des ouvrages de zoologie<br />
médiévaux comme, par exemp<strong>le</strong>, <strong>le</strong> De natura rerum de Thomas de Cantimpré. Le<br />
nombre de poèmes dans chaque partie, vingt-cinq environ dans <strong>le</strong>s trois premières, quatre<br />
dans <strong>la</strong> quatrième, deux dans <strong>la</strong> dernière indique c<strong>la</strong>irement que <strong>le</strong> livre n’est pas comp<strong>le</strong>t,<br />
sans doute du <strong>fait</strong> de l’auteur ; cependant Stephanus Roybosius, dans <strong>la</strong> postface, explique<br />
que des imprimeurs malhabi<strong>le</strong>s ont abîmé <strong>le</strong> texte <strong>et</strong> qu’il n’en publie qu’une partie, des<br />
<strong>«</strong> prémices <strong>»</strong> à partir desquel<strong>le</strong>s, dit-il, on pourra quand même juger du ta<strong>le</strong>nt de l’auteur 3 .<br />
Je ne traiterai dans c<strong>et</strong>te étude que de <strong>la</strong> première partie de l’ouvrage, consacrée aux animaux,<br />
en me fondant uniquement sur l’édition viennoise de 1541.<br />
Les poèmes, composés en distiques élégiaques, sont re<strong>la</strong>tivement courts, puisqu’ils<br />
comptent une vingtaine de vers en moyenne ; dans <strong>la</strong> partie sur <strong>le</strong>s animaux, <strong>le</strong>s plus courts<br />
comptent quatre vers, <strong>le</strong>s plus longs trente-six. Chaque animal y prend <strong>la</strong> paro<strong>le</strong> pour <strong>par<strong>le</strong>r</strong><br />
de lui-même <strong>et</strong> des remèdes qu’il a à offrir, d’où <strong>le</strong> titre donné à l’ouvrage, <strong>Prosopopeia</strong><br />
aliquot animalium. Tous <strong>le</strong>s poèmes sont accompagnés de scolies rédigées par <strong>le</strong> médecin<br />
Jacques Olivier. L’ordre d’apparition des animaux semb<strong>le</strong>, comme souvent 4 , partagé entre<br />
un c<strong>la</strong>ssement alphabétique approximativement suivi, comme dans l’Hortus Sanitatis ou <strong>le</strong><br />
De natura rerum de Cantimpré, <strong>et</strong> des critères plus symboliques <strong>et</strong> scientifiques, notamment<br />
pour <strong>le</strong>s deux premiers animaux : <strong>le</strong> lion, en tant que roi des animaux, ouvre <strong>le</strong> défilé,<br />
immédiatement suivi de l’éléphant, dont on connaît <strong>le</strong> prestige. Ursin, bien qu’il inverse<br />
l’ordre du lion <strong>et</strong> de l’éléphant, se conforme ainsi au modè<strong>le</strong> plinien 5 .<br />
Enfin <strong>le</strong>s poèmes en eux-mêmes suivent dans <strong>le</strong>ur très grande majorité une composition<br />
toujours identique : l’animal, après avoir parfois opéré une brève transition, expose sa<br />
natura, c’est-à-dire une présentation d’ordre général, puis énumère ses uirtutes, autrement<br />
dit <strong>le</strong>s remèdes qu’on peut tirer de son corps ou de ses productions. Ces deux aspects de<br />
l’étude, qui trouvent <strong>le</strong>ur origine dans <strong>la</strong> manière dont Pline traite des animaux dans son<br />
Histoire naturel<strong>le</strong>, sont ceux qu’adoptent, ensemb<strong>le</strong> ou séparément, de nombreux bestiaires<br />
<strong>et</strong> encyclopédies médiéva<strong>le</strong>s sous <strong>le</strong>s termes de natura <strong>et</strong> d’operationes.<br />
Mais si Ursin se montre fidè<strong>le</strong> à Pline en ce qui concerne l’obj<strong>et</strong> de son discours, il est<br />
un autre auteur <strong>la</strong>tin dont l’influence est sensib<strong>le</strong>, c<strong>et</strong>te fois dans <strong>le</strong> domaine formel, <strong>et</strong> <strong>la</strong><br />
préface dédicatoire à l’abbé de Joyeuse, bien qu’el<strong>le</strong> n’expose pas si ouvertement <strong>le</strong>s choses,<br />
<strong>la</strong>isse d’emblée deviner qu’Ursin entend se montrer fidè<strong>le</strong> aux préceptes de Cicéron :<br />
docere, mouere, de<strong>le</strong>ctare. Nous allons donc essayer de montrer de quel<strong>le</strong> manière <strong>et</strong> dans<br />
quel<strong>le</strong> mesure il atteint ces objectifs.<br />
Docere : <strong>le</strong>s éléments médicaux<br />
Jean Ursin, doctor medicus, offre au public, avec sa <strong>Prosopopeia</strong>, un ouvrage de médecine<br />
dans <strong>le</strong>quel sont exposés un certain nombre de remèdes fournis par <strong>le</strong>s animaux. Nous<br />
allons voir quel<strong>le</strong> est <strong>la</strong> nature des informations qu’il présente, quel<strong>le</strong>s sont ses sources <strong>et</strong><br />
comment il <strong>le</strong>s traite.<br />
3. Cui hoc tantum decr<strong>et</strong>um fuit, umbram quandam <strong>et</strong> typum nobilis, insignis, <strong>et</strong> magni operis futuri nusquam<br />
ab aliquo antehac excogitati, atque ingenii sui (diuini profecto) specimen porrigere, <strong>«</strong> Il a décidé de<br />
ne publier qu’une ombre, un aperçu, du nob<strong>le</strong>, remarquab<strong>le</strong> <strong>et</strong> grand ouvrage à venir, ouvrage dont personne<br />
jusqu’à maintenant n’a jamais eu l’idée, <strong>et</strong> de donner un échantillon de son ta<strong>le</strong>nt, assurément<br />
divin <strong>»</strong>.<br />
4. PINON 1995, 37.<br />
5. Pline ouvre <strong>le</strong> livre VIII de son Histoire naturel<strong>le</strong>, consacré aux animaux, par l’éléphant, <strong>le</strong> lion, <strong>et</strong> <strong>le</strong> chameau.<br />
Schedae, 2009, prépublication n°15, (fascicu<strong>le</strong> n°2, p. 73-92).<br />
http://www.unicaen.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint0152009.pdf
Nous pouvons commencer par donner une définition en creux, négative, de <strong>la</strong> <strong>Prosopopeia</strong>.<br />
El<strong>le</strong> n’est pas un livre de nature rigoureusement scientifique, comme pouvaient<br />
l’être <strong>le</strong>s traités d’Aristote ; el<strong>le</strong> n’est pas un traité de médecine à caractère réaliste, comme<br />
<strong>le</strong> prouve <strong>le</strong> recours à un certain nombre d’animaux exotiques (lion, chameau, caméléon),<br />
à certains organes d’animaux dotés, croit-on, de propriétés magiques (os de cœur du cerf 6 ),<br />
ou à certaines opérations qui n’ont guère à voir avec <strong>la</strong> médecine mais relèvent de <strong>la</strong> magie 7 ;<br />
el<strong>le</strong> est encore moins un traité rédigé d’après l’expérience personnel<strong>le</strong> du médecin Ursin,<br />
qui ne s’implique jamais personnel<strong>le</strong>ment ; el<strong>le</strong> n’est pas non plus un ouvrage qui s’appuie<br />
sur <strong>la</strong> symbolique chrétienne, comme <strong>le</strong> Physiologus, ou sur quelque symbolique que ce soit.<br />
En revanche, <strong>la</strong> <strong>Prosopopeia</strong> se présente comme un ouvrage très érudit 8 , qui atteste<br />
notamment une excel<strong>le</strong>nte connaissance des livres de Pline consacrés aux animaux <strong>et</strong> aux<br />
remèdes 9 . Pline apparaît comme <strong>la</strong> source principa<strong>le</strong> d’Ursin, <strong>et</strong> celui-ci l’utilise sans jamais<br />
<strong>la</strong> rem<strong>et</strong>tre en cause, sinon par <strong>la</strong> mention humoristique de <strong>la</strong> préface : Sed dices forte :<br />
multa mentiuntur. Fateor 10 . De Pline, Ursin a repris <strong>le</strong> c<strong>la</strong>ssement zoologique qui régit l’organisation<br />
du livre, <strong>la</strong> différenciation entre natura <strong>et</strong> operationes, <strong>le</strong> caractère énumératif, <strong>le</strong><br />
c<strong>la</strong>ssement par animal plutôt que par ma<strong>la</strong>die, <strong>et</strong> surtout une bonne partie du contenu.<br />
Cependant, Pline n’est pas <strong>la</strong> seu<strong>le</strong> source de Jean Ursin. Jacques Olivier mentionne parfois<br />
dans ses scolies <strong>le</strong>s sources qu’il a pu identifier : ainsi Galien, Albert <strong>le</strong> Grand, Avicenne,<br />
Arnaldus <strong>et</strong> Rhazès apparaissent une fois, P<strong>et</strong>rus Hispanus <strong>et</strong> Hieronymus Montuus 11 deux<br />
fois, Chiron 12 <strong>et</strong> Escu<strong>la</strong>pe 13 sont mentionnés trois fois, Sextus Pythagoricus (plus connu<br />
sous <strong>le</strong> nom de Sextus Empiricus) est cité dix-neuf fois. Aristote n’est ni cité, ni utilisé, Avicenne<br />
très peu ; certains éléments très ponctuels se r<strong>et</strong>rouvent chez Thomas de Cantimpré,<br />
mais <strong>la</strong> rar<strong>et</strong>é même de ces éléments semb<strong>le</strong> indiquer que celui-ci n’a pas constitué une<br />
source directe. J’ai identifié quatorze passages venus d’Albert <strong>le</strong> Grand qui ne reprennent<br />
pas Pline ; en revanche, j’ai pu constater que Sextus Pythagoricus, bien qu’il soit cité dixneuf<br />
fois par Olivier, n’est pas <strong>la</strong> source des passages qui lui sont attribués. Les quelques<br />
pages que c<strong>et</strong> auteur consacre aux animaux, dans <strong>le</strong>s Hypotyposes Pyrrhoniennes, ne<br />
s’attachent qu’à l’étude de <strong>le</strong>ur comportement, ce qui ne correspond pas aux passages où<br />
<strong>la</strong> référence apparaît. En <strong>fait</strong> <strong>la</strong> source d’Ursin est un autre Sextus, Sextus P<strong>la</strong>citus Papyriensis,<br />
auteur d’un Libellus de medicamentis ex animalibus, postérieur au Ve sièc<strong>le</strong>, transmis<br />
avec l’Herbarius du pseudo-Apulée. L’édition princeps est de 1538, soit trois ans avant <strong>la</strong><br />
<strong>Prosopopeia</strong>, <strong>et</strong> une autre édition a vu <strong>le</strong> jour en 1539 14 . Jean Ursin s’en est beaucoup servi<br />
<strong>et</strong> j’ai identifié une centaine d’emprunts à c<strong>et</strong>te source. Le tab<strong>le</strong>au ci-dessous, récapitu<strong>la</strong>nt<br />
6. Sur l’os de cœur du cerf, voir POPLIN 1980, 26-29.<br />
7. On lit, par exemp<strong>le</strong>, que manger du lion chasse <strong>la</strong> peur des spectres, porter au coude gauche <strong>le</strong>s poils de<br />
<strong>la</strong> queue du chameau écarte <strong>la</strong> fièvre quarte, répandre <strong>le</strong> sang d’un chiot de moins d’un mois protège <strong>la</strong><br />
maison, porter sur soi l’œil droit d’un <strong>loup</strong> écarte <strong>la</strong> fièvre quarte <strong>et</strong> empêche <strong>le</strong>s chiens d’aboyer quand<br />
on passe, manger à <strong>la</strong> lune montante <strong>le</strong> cœur arraché vivant d’une be<strong>le</strong>tte donne <strong>le</strong> don de divination.<br />
Toutes ces indications viennent de l’Histoire naturel<strong>le</strong> de Pline.<br />
8. Voir <strong>la</strong> postface de Stephanus Roybosius : en prodit, optime <strong>le</strong>ctor, e<strong>le</strong>gans <strong>et</strong> noua operis eruditissimi<br />
Vrsini de animalibus idaea quaedam, <strong>«</strong> Insigne <strong>le</strong>cteur, voici que paraît un échantillon exquis <strong>et</strong> inédit de<br />
l’ouvrage sur <strong>le</strong>s animaux qu’a rédigé <strong>le</strong> très savant Ursin <strong>»</strong>.<br />
9. Livres VIII-XI pour <strong>le</strong>s animaux, livres XXVIII-XXXII pour <strong>le</strong>s remèdes.<br />
10. <strong>«</strong> Mais tu diras peut-être : “ils mentent beaucoup” ; je <strong>le</strong> reconnais. <strong>»</strong> Lorsqu’Ursin mentionne <strong>le</strong>s magi decepti<br />
ou magi delusi, ce n’est pas un commentaire de sa part : c’est que Pline signa<strong>le</strong> dans <strong>le</strong> passage correspondant<br />
que <strong>le</strong> renseignement est un mensonge des mages.<br />
11. Hieronymus Montuus est <strong>le</strong> médecin à qui Jacques Olivier adresse sa préface.<br />
12. Le nom de Chiron renvoie en <strong>fait</strong> à <strong>la</strong> Mulomedicina Chironis (III e ou IV e sièc<strong>le</strong>), manuel d’hippiatrique<br />
dont s’est inspiré Végèce (SABBAH 1987, 115-117).<br />
13. C’est-à-dire <strong>le</strong> Liber Escu<strong>la</strong>pii, manuel de médecine dont <strong>la</strong> première partie est constituée du Liber Aurelii<br />
(ibid., 87).<br />
14. Ibid., 130.<br />
Schedae, 2009, prépublication n°15, (fascicu<strong>le</strong> n°2, p.73-92).<br />
http://www.unicaen.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint0152009.pdf<br />
75
76<br />
<strong>le</strong>s sources utilisées pour écrire <strong>la</strong> prosopopée du renard, donnera une idée de <strong>la</strong> manière<br />
dont Ursin compose ses poèmes.<br />
Albert Sextus<br />
P<strong>la</strong>citus<br />
DA 22<br />
De Vulpe<br />
13<br />
DV 9<br />
DV 8<br />
DV 4<br />
DV 6<br />
DV 12<br />
Pline Vulpes Scolies<br />
28, 166<br />
28, 197<br />
28, 189<br />
Parfois, cependant, Ursin, soit à cause de <strong>la</strong> transposition en vers, soit par suite d’erreurs<br />
d’origine diverse, ne se montre pas entièrement fidè<strong>le</strong> aux indications pliniennes : il arrive<br />
par exemp<strong>le</strong> très souvent que <strong>la</strong> mise en vers l’amène à abréger ou muti<strong>le</strong>r <strong>le</strong> propos de<br />
Pline jusqu’à <strong>le</strong> déformer, comme dans <strong>le</strong> cas du <strong>loup</strong> 15 , ou <strong>le</strong> rendre diffici<strong>le</strong>ment compréhensib<strong>le</strong>,<br />
comme dans <strong>le</strong>s vers concernant <strong>la</strong> natura du lion 16 : dans ce cas précis, <strong>la</strong> ponctuation<br />
fautive de l’édition indique que <strong>le</strong> texte n’a pas été compris par l’éditeur, tandis<br />
que <strong>la</strong> note d’Olivarius, mentionnant Rhazès, semb<strong>le</strong> indiquer qu’il n’a pas reconnu <strong>le</strong> texte<br />
de Pline ou qu’il cherche une source complémentaire, peut-être pour expliquer l’étrange<br />
image supremo sidere, qu’il semb<strong>le</strong> associer à ses scolies précédentes sur <strong>le</strong> ciel <strong>et</strong> à<br />
<strong>la</strong>quel<strong>le</strong> il semb<strong>le</strong> chercher un sens astronomique. Pour une raison diffici<strong>le</strong>ment compréhensib<strong>le</strong><br />
aussi, <strong>le</strong> caméléon s’exprime partiel<strong>le</strong>ment en énigmes, de sorte que son propos est<br />
Schedae, 2009, prépublication n°15, (fascicu<strong>le</strong> n°2, p. 73-92).<br />
http://www.unicaen.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint0152009.pdf<br />
Concionor nostras <strong>la</strong>udes, induta cucul<strong>la</strong>m;<br />
Adsint, anser, anas, totaque turba alitum.<br />
Vera canam, nec more meo mendacia fingam<br />
Sed p<strong>et</strong>o pro precio sit mihi c<strong>la</strong>udus anas.<br />
Est mihi praecipuum podagrae sedare Si uiua decoquatur. Item o<strong>le</strong>um.<br />
dolores<br />
Suspensa brachio.<br />
Et cauda ad Venerem non bene calcar Cocta in o<strong>le</strong>o u<strong>et</strong>eri.<br />
hab<strong>et</strong>.<br />
Ex Sexto<br />
Mentu<strong>la</strong> pro pesso matricem summa Ex uino potus.<br />
p<strong>et</strong>entem.<br />
Si ex eis saepius confricauerit paro-<br />
Deprimit, <strong>et</strong> sanat fronte ligata caput. tidas.<br />
Inde meus <strong>la</strong>xat spirandi pulmo meatus, Instil<strong>la</strong>tus. Ex Sexto<br />
Et sp<strong>le</strong>ni <strong>et</strong> phthisicis praestat adesus<br />
opem.<br />
Inguina testiculi diramque parotida sanant<br />
Tonxil<strong>la</strong>sque meo rene fricare iuuat.<br />
Sanat adeps aures ; puero dum pectora<br />
sugit.<br />
Da cerebrum, sacro non cad<strong>et</strong> il<strong>le</strong> malo.<br />
Sed quid tanta loquor ? Nox instat, tentat<br />
orexis<br />
Pectora. Pro precio sit mihi c<strong>la</strong>udus anas.<br />
15. Ca<strong>et</strong>era delusi taceo nugamina magi/Qui putat ad pathicam pondus habere pilum, <strong>«</strong> Je tais <strong>le</strong>s autres<br />
affabu<strong>la</strong>tions du mage menteur, qui pense qu’un de mes poils est uti<strong>le</strong> aux fil<strong>le</strong>s débauchées <strong>»</strong> ; <strong>le</strong> texte<br />
de Pline (nat. 8, 83) est <strong>le</strong> suivant : quin <strong>et</strong> caudae huius animalis creditur uulgo inesse amatorium uirus exiguo<br />
in uillo eumque, cum capiatur, abici nec idem pol<strong>le</strong>re nisi uiuenti dereptum. Même chose pour <strong>le</strong> passage<br />
suivant ; Ursin <strong>fait</strong> dire au <strong>loup</strong> : Verum more meo ueneri praescribito m<strong>et</strong>am,/Mense semel satis est<br />
sit reuoluta Venus, <strong>«</strong> Mais, suis mon usage <strong>et</strong> limite <strong>le</strong>s p<strong>la</strong>isirs de Vénus : une fois par mois est un dé<strong>la</strong>i suffisant<br />
pour que Vénus revienne <strong>»</strong>, alors que Pline écrit (nat. 8, 83) : dies, quibus coeat, toto anno non<br />
amplius duodecim, <strong>«</strong> On dit que <strong>le</strong> temps de l’accoup<strong>le</strong>ment pour <strong>le</strong>s <strong>loup</strong>s ne dure pas plus de douze<br />
jours dans toute l’année <strong>»</strong> (PLINE L’ANCIEN, Ernout 1952). Il y a ici un changement du sens même du texte.<br />
16. Pline écrit (nat. 8, 52) : atque hoc ta<strong>le</strong> tamque saeuum animal rotarum orbes circumacti currusque inanes<br />
<strong>et</strong> gallinaceorum cristae cantusque <strong>et</strong>iam magis terrent, sed maxime ignes, <strong>«</strong> <strong>et</strong> pourtant un tel animal, <strong>et</strong><br />
si féroce, est effrayé par <strong>le</strong> tournoiement des roues <strong>et</strong> <strong>le</strong> mouvement d’un char vide, par <strong>la</strong> crête du coq<br />
<strong>et</strong> plus encore par son chant, mais surtout par <strong>le</strong> feu <strong>»</strong> (PLINE L’ANCIEN, Ernout 1952). Sous <strong>la</strong> plume d’Ursin,<br />
ces lignes deviennent : Hei mihi causa fugae, supremo sidere gallus/F<strong>la</strong>mmaque <strong>et</strong> obductae semita trita<br />
rotae./Fortia sic paruis interdum corpora caedunt, <strong>«</strong> Hé<strong>la</strong>s <strong>le</strong> coq, dont une étoi<strong>le</strong> surmonte <strong>la</strong> tête, me<br />
m<strong>et</strong> en fuite, de même que <strong>le</strong> feu <strong>et</strong> <strong>le</strong>s roues qui tournent sur <strong>le</strong>s chemins fréquentés. C’est ainsi parfois<br />
que <strong>le</strong>s forts cèdent aux faib<strong>le</strong>s <strong>»</strong>. Le texte dans l’édition de 1541 présente un point après fortia <strong>et</strong> non<br />
après rotae ; l’étoi<strong>le</strong> semb<strong>le</strong> être une métaphore pour désigner <strong>la</strong> crête.
non plus obscur mais privé de contenu informatif 17 . Peut-être pour des raisons métriques,<br />
ou à cause d’un exemp<strong>la</strong>ire de Pline corrompu, Ursin change des noms : <strong>le</strong> Demaenatus<br />
transformé en <strong>loup</strong> chez Pline devient Demarchus dans <strong>la</strong> <strong>Prosopopeia</strong>, à moins que <strong>la</strong> confusion<br />
ne soit plus grave 18 . Dans <strong>le</strong> poème de l’âne, une doub<strong>le</strong> confusion entre l’organe utilisé<br />
pour <strong>la</strong> thérapie <strong>et</strong> <strong>la</strong> partie soignée entraîne une déformation complète du discours<br />
de Pline 19 . Dans <strong>le</strong> poème de <strong>la</strong> be<strong>le</strong>tte, Ursin attribue à c<strong>et</strong> animal une propriété magique<br />
que Pline prête seu<strong>le</strong>ment à <strong>la</strong> taupe 20 . On trouve des problèmes du même type dans<br />
l’adaptation des autres sources : dans <strong>la</strong> prosopopée du renard, Ursin inverse tota<strong>le</strong>ment <strong>le</strong><br />
sens du texte de Sextus P<strong>la</strong>citus 21 ; dans cel<strong>le</strong> du loir, il semb<strong>le</strong> confondre paresim <strong>et</strong> paralysim<br />
22 . Mais <strong>le</strong> contraire arrive parfois : c’est ainsi que dans <strong>la</strong> prosopopée du chat, Ursin<br />
remp<strong>la</strong>ce l’indication ungu<strong>la</strong> bouis de Sextus par ungu<strong>la</strong> bubonis 23 ; or c’est ici Sextus qui<br />
17. Dicite decepti mea nunc praeconia magi,/Quid mihi uiuenti demptus ocellus agat./Num caput, <strong>et</strong> guttur<br />
cieant combusta tonitrus, <strong>«</strong> Proc<strong>la</strong>mez maintenant mes vertus, mages abusés, dites à quoi peut servir mon<br />
œil si on me l’arrache alors que je suis vivant, dites si ma tête <strong>et</strong> ma gorge, brûlés, provoquent <strong>la</strong> foudre <strong>»</strong>.<br />
18. Dic uires Demarche meas, me praeda moratur/Nam duo te referunt lustra fuisse lupum, <strong>«</strong> Dis mes qualités,<br />
Demarchus, je suis occupé à chasser : en eff<strong>et</strong>, à ce qu’on rapporte, tu as été <strong>loup</strong> pendant deux lustres <strong>»</strong> ;<br />
<strong>le</strong> texte de Pline (nat. 8, 82) est <strong>le</strong> suivant : ita < S > copas, qui Olympionicas scripsit, narrat Demaen<strong>et</strong>um<br />
Parrhasium in sacrificio, quod Arcades Ioui Lycaeo humana <strong>et</strong>iamtum hostia faciebant, immo<strong>la</strong>ti pueri exta<br />
degustasse <strong>et</strong> in lupum se conuertisse, eundem X anno restitutum ath<strong>le</strong>ticae se exercuisse in pugi<strong>la</strong>tu uictoremque<br />
Olympia reuersum, <strong>«</strong> Ainsi Scopas, <strong>le</strong> biographe des Olympioniques, raconte que, dans <strong>le</strong> sacrifice<br />
de victimes humaines que <strong>le</strong>s Arcadiens faisaient encore dans ce temps à Jupiter Lycéen, Déménète<br />
de Parrhasie, ayant goûté des entrail<strong>le</strong>s d’un enfant immolé, se trouva transformé en <strong>loup</strong> ; que dix ans<br />
après, ayant r<strong>et</strong>rouvé sa forme humaine, il reprit son entraînement athlétique, <strong>et</strong> remporta à Olympie <strong>le</strong><br />
prix du pugi<strong>la</strong>t <strong>»</strong> (PLINE L’ANCIEN, Ernout 1952). Dans ce cas, <strong>le</strong> nom n’est pas respecté. Pline rapporte dans<br />
<strong>le</strong> même passage un autre cas de lycanthropie, touchant un homme appelé Anthus. Enfin, Demarchus<br />
pourrait être un titre qui désigne Lycaon, roi d’Arcadie, dont Pausanias écrit, dans <strong>le</strong>s Arkadica (3, 5) qu’il<br />
est resté <strong>loup</strong> huit ans ; il y a peut-être ici une confusion entre différentes sources.<br />
19. Creditur [<strong>la</strong>c] <strong>et</strong> sp<strong>le</strong>nes extenuare graues./Sistit idem dentes <strong>et</strong> tabo pectora mundat,/Sp<strong>le</strong>n sp<strong>le</strong>ni<br />
admotum <strong>la</strong>c reuocare so<strong>le</strong>t, <strong>«</strong> On croit même que [mon <strong>la</strong>it] <strong>fait</strong> dégonf<strong>le</strong>r <strong>le</strong>s rates douloureuses. Il<br />
empêche aussi <strong>le</strong>s dents de bran<strong>le</strong>r <strong>et</strong> guérit <strong>la</strong> consomption ; appliquer ma rate sur <strong>la</strong> rate est un moyen<br />
courant de faire venir <strong>le</strong> <strong>la</strong>it <strong>»</strong> (littéra<strong>le</strong>ment) ; il faut, dans <strong>la</strong> première <strong>et</strong> troisième occurrence, lire ubera<br />
(<strong>«</strong> seins <strong>»</strong>) à <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ce de sp<strong>le</strong>n (<strong>«</strong> rate <strong>»</strong>), comme l’indiquent <strong>le</strong>s passages de Pline d’où viennent ces indications.<br />
En eff<strong>et</strong>, Pline (nat. 28, 250 <strong>et</strong> 251) écrit Si [ubera] do<strong>le</strong>nt, <strong>la</strong>ctis asini potu mulcentur, <strong>«</strong> si [<strong>le</strong>s seins]<br />
sont douloureux, <strong>le</strong> <strong>la</strong>it d’ânesse en boisson apaise <strong>la</strong> souffrance <strong>»</strong> (PLINE L’ANCIEN, Ernout 1962a) <strong>et</strong> Eiusdem<br />
animalis [asini] lien inu<strong>et</strong>eratus ex aqua inlitus mammis abundantiam facit, <strong>«</strong> <strong>la</strong> rate [d’âne] desséchée,<br />
appliquée sur <strong>le</strong>s seins avec de l’eau, <strong>fait</strong> venir <strong>le</strong> <strong>la</strong>it en abondance <strong>»</strong> (PLINE L’ANCIEN, Ernout 1962a).<br />
20. Mande cor incoctum, crescunt cum cornua lunae,/Sugger<strong>et</strong> id certe multa futura tibi, <strong>«</strong> Mange mon cœur<br />
cru, quand croissent <strong>le</strong>s cornes de <strong>la</strong> lune ; tu es sûr de connaître bien des événements futurs <strong>»</strong> ; ces paro<strong>le</strong>s,<br />
attribuées à <strong>la</strong> be<strong>le</strong>tte, rappel<strong>le</strong>nt Pline (nat. 30, 19) à propos de <strong>la</strong> taupe : si quis cor eius recens palpitansque<br />
deuor<strong>et</strong>, diuinationes <strong>et</strong> rerum efficiendarum euentus promittant, <strong>«</strong> à celui qui mangera un<br />
cœur de taupe frais <strong>et</strong> palpitant, ils prom<strong>et</strong>tent de connaître par divination <strong>le</strong> dérou<strong>le</strong>ment des événements<br />
futurs <strong>»</strong> (PLINE L’ANCIEN, Ernout 1963).<br />
21. Sextus P<strong>la</strong>citus, De uulpe, 9 : Ad irritamentum concubiti : uulpis cauda summa ad brachium suspensa irritamentum<br />
esse concubiti fertur, <strong>«</strong> pour stimu<strong>le</strong>r <strong>la</strong> sexualité : l’extrémité de <strong>la</strong> queue du renard, portée au<br />
bras, stimu<strong>le</strong>, à ce qu’on dit, <strong>la</strong> sexualité <strong>»</strong>. C<strong>et</strong>te indication devient chez Ursin : Et cauda ad Venerem non<br />
bene calcar hab<strong>et</strong>, <strong>«</strong> <strong>et</strong> ma queue n’est pas un bon stimu<strong>la</strong>nt pour Vénus <strong>»</strong>.<br />
22. Dans <strong>le</strong> chapitre intitulé De glire, Sextus P<strong>la</strong>citus écrit : Ad eos qui paralisi tentantur. Gliris adeps remedium<br />
affert his qui paralisi tentantur, si eo inungantur. C<strong>et</strong>te indication vient de Pline (nat. 30, 86 : Paralysin<br />
cauentibus pinguia glirium decoctorum <strong>et</strong> soricum utilissima tradunt esse) <strong>et</strong> se r<strong>et</strong>rouve chez Albert <strong>le</strong><br />
Grand. Dans <strong>le</strong> texte d’Ursin, il n’est plus question de paralysie, mais <strong>le</strong> conseil du loir (Sanguine uerrucas,<br />
paresim pinguedine curo) semb<strong>le</strong> indiquer une confusion entre <strong>le</strong>s deux termes.<br />
23. Sextus P<strong>la</strong>citus, De catta seu fe<strong>le</strong>, 4 : Ad quartanas : cattae stercus cum ungu<strong>la</strong> bouis in col<strong>le</strong> uel bracchio<br />
suspensum quartanam post septimam accessionem discutit <strong>et</strong> inde ne festinas illud soluere, <strong>«</strong> pour <strong>la</strong> fièvre<br />
quarte : <strong>la</strong> crotte de chat, portée au cou ou au bras avec un sabot de bœuf, guérit <strong>la</strong> fièvre quarte après<br />
<strong>le</strong> septième accès ; par <strong>la</strong> suite ne te hâte pas de l’en<strong>le</strong>ver <strong>»</strong>. Chez Ursin, ce conseil devient : At si feralis<br />
bubonis iunxeris ungues,/Quartanam fertur posse fugare febrim, <strong>«</strong> <strong>et</strong> si tu associes [à mes excréments] <strong>le</strong>s<br />
serres du sinistre hibou, on peut, dit-on, guérir <strong>la</strong> fièvre quarte <strong>»</strong>.<br />
Schedae, 2009, prépublication n°15, (fascicu<strong>le</strong> n°2, p.73-92).<br />
http://www.unicaen.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint0152009.pdf<br />
77
78<br />
s’était trompé, <strong>et</strong> Ursin revient ainsi à <strong>la</strong> source, c’est-à-dire au texte de Pline 24 , signe qu’il<br />
effectue un certain nombre de vérifications.<br />
Le discours médical <strong>et</strong> <strong>le</strong> discours zoologique tenus par Ursin s’inscrivent dans <strong>la</strong> droite<br />
ligne de <strong>la</strong> science médiéva<strong>le</strong>. Parmi <strong>le</strong>s indications de Pline, Ursin r<strong>et</strong>ient <strong>le</strong>s éléments<br />
re<strong>le</strong>vant de <strong>la</strong> magie, comme l’utilisation de certains organes d’animaux en amu<strong>le</strong>ttes ou<br />
l’adéquation entre l’organe traité chez l’homme <strong>et</strong> celui utilisé chez l’animal : cendre de<br />
tête pour maux de tête, excréments pour maux de ventre, urine pour maux de reins, poumons<br />
pour <strong>le</strong>s problèmes de respiration… Le second tab<strong>le</strong>au présenté en annexe montre<br />
<strong>le</strong>s différentes ma<strong>la</strong>dies traitées <strong>et</strong> <strong>le</strong>s parties d’animaux ou <strong>le</strong>s productions anima<strong>le</strong>s utilisées<br />
comme remèdes. Sur <strong>le</strong> p<strong>la</strong>n strictement médical, <strong>le</strong> texte n’apporte donc rien de vraiment<br />
nouveau.<br />
Par ail<strong>le</strong>urs, sur <strong>le</strong> p<strong>la</strong>n concr<strong>et</strong>, on peut remarquer que <strong>le</strong> texte d’Ursin manque énormément<br />
de précision. À une exception près 25 , on ne trouve jamais d’indication de posologie,<br />
par exemp<strong>le</strong> ; de même, il est extrêmement rare que <strong>le</strong>s modes de préparation <strong>et</strong><br />
d’utilisation des différents remèdes soient indiqués : on ne sait pas s’il faut ingérer ou appliquer<br />
tel ou tel remède, si tel ou tel autre doit être utilisé broyé, brûlé, en macération ou<br />
sous une autre forme. On peut avancer que ce manque de précision est lié lui aussi au<br />
choix <strong>fait</strong> par Ursin de <strong>la</strong> forme brève <strong>et</strong> poétique : dans de nombreux cas par exemp<strong>le</strong>, là<br />
où Albert <strong>le</strong> Grand indique <strong>le</strong> remède, <strong>la</strong> façon de <strong>le</strong> préparer <strong>et</strong> de l’appliquer, Jean Ursin<br />
n’en r<strong>et</strong>ient que l’origine, <strong>le</strong> rendant de ce <strong>fait</strong> inutilisab<strong>le</strong> 26 . C’est d’ail<strong>le</strong>urs <strong>la</strong> raison pour<br />
<strong>la</strong>quel<strong>le</strong> Jacques Olivier a considéré que <strong>le</strong> texte ne pouvait être livré au public sans l’ajout<br />
de scolies, comme il l’explique dans sa préface 27 . Les notes de Jacques Olivier sont de<br />
toute sorte : il peut résumer en quelques mots l’essentiel d’un groupe de vers, ajouter un<br />
commentaire de Pline qu’Ursin n’a pas r<strong>et</strong>enu <strong>et</strong> qui éc<strong>la</strong>ire <strong>le</strong> passage, comme dans <strong>le</strong> cas<br />
du <strong>loup</strong> cité plus haut 28 , préciser <strong>le</strong>s sources, qu’Ursin ne mentionne qu’exceptionnel<strong>le</strong>ment,<br />
ajouter un mode d’utilisation, parfois une posologie, ou un commentaire tiré de sa<br />
pratique médica<strong>le</strong> personnel<strong>le</strong>. Mais si <strong>le</strong>s scolies ont <strong>le</strong> mérite de rendre un peu moins<br />
24. Pline, nat., 28, 228 : Quartanis Magi excrementa felis cum digito bubonis adalligari iubent, <strong>«</strong> Pour <strong>la</strong> fièvre<br />
quarte, <strong>le</strong>s Mages ordonnent de porter en amu<strong>le</strong>tte de <strong>la</strong> fiente de chat avec un doigt de hibou <strong>»</strong> (PLINE<br />
L’ANCIEN, Ernout 1962a).<br />
25. Dans <strong>le</strong> poème du cerf : Discutit humores, affectos curat ocellos/Et caput ex uino drachma uorata iuuat.<br />
26. Dans <strong>le</strong> paragraphe qu’il consacre au chien (De animalibus 22), Albert <strong>le</strong> Grand écrit : stercus <strong>et</strong>iam canis<br />
sumptus constringit uentrem, maxime si sit stercus ossa comedentium canum <strong>et</strong> dessicatum sit per XX<br />
dies in mense Iulio <strong>et</strong> ante solis ortum sumatur ad pondus aurei cum decoctione galli decrepiti,<br />
<strong>«</strong> Absorber <strong>le</strong>s excréments de chien resserre <strong>le</strong> ventre, surtout si ce sont <strong>le</strong>s excréments de chiens qui<br />
mangent des os, s’ils ont séché pendant vingt jours au mois de juil<strong>le</strong>t, si l’on en prend une drachme, avant<br />
<strong>le</strong> <strong>le</strong>ver du so<strong>le</strong>il, avec une décoction de vieux coq <strong>»</strong>. Dans <strong>la</strong> <strong>Prosopopeia</strong>, il ne reste que l’indication<br />
suivante : Curo malum sacrum <strong>et</strong> cruciatus stercore uentris, <strong>«</strong> Par mes excréments, je soigne <strong>le</strong> mal sacré<br />
<strong>et</strong> <strong>le</strong>s dou<strong>le</strong>urs qui déchirent <strong>le</strong> ventre <strong>»</strong>. Il existe de très nombreux exemp<strong>le</strong>s de ce type bien que <strong>le</strong>s textes<br />
de Sextus P<strong>la</strong>citus, source essentiel<strong>le</strong> de Jean Ursin, contiennent en grand nombre des indications précises<br />
de posologie.<br />
27. Verum cum perspicerem haud faci<strong>le</strong> a quouis, <strong>et</strong>iam medicinae candidato, posse intelligi citra scholia aliquot,<br />
[…] eo euestigio ad eum, rogo, dehortor, cogorque persuadere ut scholia edat, quod stultum sit id<br />
in publicum exponere quod intelligi nolumus. Negauit se esse facturum, tum quia aliis distrahebatur<br />
negociis, tum quia alio peregre profecturus erat. Sed interim me rogauit eam prouinciam uel<strong>le</strong>m suscipere,<br />
<strong>«</strong> Mais comme je voyais que l’œuvre ne serait pas faci<strong>le</strong> à comprendre par qui que ce soit, fût-ce un<br />
étudiant en médecine, sans <strong>le</strong> secours de quelques scolies […] je vais voir [Ursin] sur <strong>le</strong> champ, je<br />
l’implore, je l’exhorte, je m’efforce de <strong>le</strong> persuader d’écrire des scholies, expliquant qu’il serait stupide<br />
d’offrir au public quelque chose dont nous ne voulons pas qu’il soit compris. Il refusa de <strong>le</strong> faire, d’une<br />
part parce qu’il était alors occupé à d’autres tâches, de l’autre parce qu’il s’apprêtait à partir à l’étranger.<br />
Mais il me demanda de bien vouloir entreprendre ce travail<strong>»</strong>.<br />
28. Olivarius précise : Imo <strong>et</strong> toti caudae inest uis amatoria, <strong>«</strong> c’est plutôt dans <strong>la</strong> queue tout entière que se<br />
trouvent <strong>le</strong>s vertus aphrodisiaques <strong>»</strong>.<br />
Schedae, 2009, prépublication n°15, (fascicu<strong>le</strong> n°2, p. 73-92).<br />
http://www.unicaen.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint0152009.pdf
abstrait <strong>le</strong> propos d’Ursin, el<strong>le</strong>s sont cependant trop incomplètes pour faire véritab<strong>le</strong>ment<br />
du recueil un manuel de médecine.<br />
L’aspect didactique n’apparaît donc pas comme <strong>le</strong> plus original de l’œuvre d’Ursin, ni<br />
comme <strong>le</strong> plus remarquab<strong>le</strong>. Le contenu médical de <strong>la</strong> <strong>Prosopopeia</strong> est pour l’essentiel tiré<br />
de Pline <strong>et</strong> de Sextus P<strong>la</strong>citus <strong>et</strong>, comme nous l’avons montré, <strong>la</strong> forme poétique adoptée<br />
dessert <strong>le</strong> propos scientifique plus qu’el<strong>le</strong> ne <strong>le</strong> sert. Voyons donc quel autre objectif peut<br />
rechercher Jean Ursin en faisant <strong>par<strong>le</strong>r</strong> <strong>le</strong>s animaux.<br />
Mouere : <strong>le</strong>s éléments rhétoriques<br />
Si <strong>le</strong> poème relève de <strong>la</strong> poésie didactique, il est certain que l’é<strong>la</strong>boration d’un savoir<br />
nouveau n’est pas <strong>le</strong> premier but d’Ursin. Voyons donc si son objectif ne pourrait pas être,<br />
en donnant <strong>la</strong> paro<strong>le</strong> directement aux animaux, d’agir sur <strong>le</strong> <strong>le</strong>cteur, en d’autres termes de<br />
faire ce que Cicéron nomme mouere. Deux éléments techniques liés à c<strong>et</strong>te perspective<br />
bénéficient en eff<strong>et</strong> d’un intérêt manifeste de sa part : l’énonciation <strong>et</strong> <strong>la</strong> tonalité.<br />
La prosopopée est un moyen de jouer sur de multip<strong>le</strong>s formes d’énonciation. Il perm<strong>et</strong><br />
notamment l’emploi de <strong>la</strong> première personne, mais aussi de <strong>la</strong> deuxième. La forme<br />
même de l’œuvre, puisque <strong>le</strong>s animaux se succèdent, <strong>fait</strong> qu’on ne peut jamais arriver à un<br />
échange, mais <strong>le</strong>s répliques peuvent s’adresser à différents interlocuteurs : l’animal, nous y<br />
reviendrons, par<strong>le</strong> souvent, pour faire une transition, à celui qui l’a précédé : on trouve alors<br />
l’emploi de <strong>la</strong> première <strong>et</strong> de <strong>la</strong> deuxième personnes, des impératifs, des apostrophes 29 .<br />
Dans <strong>le</strong>s operationes, lorsqu’il dresse <strong>la</strong> liste des remèdes, l’animal s’adresse très fréquemment<br />
au <strong>le</strong>cteur en quête de médications 30 , ou directement à tel ou tel ma<strong>la</strong>de 31 , <strong>le</strong> plus<br />
souvent sur <strong>le</strong> mode de l’injonction. Il arrive aussi que <strong>le</strong>s animaux s’adressent aux hommes<br />
qui <strong>le</strong>s entourent habituel<strong>le</strong>ment 32 , ou prennent à témoin des êtres appartenant à <strong>la</strong> légende<br />
ou à l’histoire 33 ; enfin, une seu<strong>le</strong> fois, un animal s’adresse à l’auteur lui-même : c’est l’ours<br />
qui s’autorise c<strong>et</strong>te familiarité, encouragé par <strong>la</strong> ressemb<strong>la</strong>nce entre <strong>le</strong> nom de l’auteur <strong>et</strong><br />
<strong>le</strong> sien 34 . Tous ces procédés donnent beaucoup d’animation au texte <strong>et</strong> font vivre <strong>le</strong>s animaux.<br />
Mais on pourrait penser que l’utilisation de <strong>la</strong> première personne <strong>et</strong> de <strong>la</strong> deuxième<br />
constitue aussi pour <strong>le</strong>s animaux un moyen de convaincre <strong>et</strong> de persuader <strong>le</strong> <strong>le</strong>cteur, destinataire<br />
de l’œuvre <strong>et</strong> de chaque discours.<br />
Cependant, l’un des problèmes posés par c<strong>et</strong>te œuvre est qu’on ne distingue pas de<br />
propos global, d’objectif <strong>et</strong> de discours communs aux animaux ; bien plus, l’œuvre renferme<br />
des contradictions manifestes qui <strong>la</strong> rendent diffici<strong>le</strong> à interpréter <strong>et</strong> à situer. Dans sa dédicace<br />
à l’abbé de Joyeuse, Ursin avait résumé <strong>le</strong> propos des animaux en ces termes : Vitia<br />
29. Le bélier : Siste gradum e<strong>le</strong>phas, <strong>«</strong> Arrête-toi, éléphant <strong>»</strong> ; <strong>le</strong> chameau : Sum piger, at cursus uinco, caba<strong>le</strong>,<br />
tuos, <strong>«</strong> Je suis paresseux, mais je te bats à <strong>la</strong> course, cheval <strong>»</strong> ; <strong>la</strong> chèvre sauvage : Capra, tuas iactas nullo<br />
discrimine <strong>la</strong>udes,/Harum nempe mihi portio magna datur ?, <strong>«</strong> Chèvre, tu t’attribues tous <strong>le</strong>s mérites sans<br />
distinction, mais ne crois-tu pas qu’une grande partie m’en revient ? <strong>»</strong>.<br />
30. Le chameau : Vre fimum <strong>et</strong> poteris <strong>la</strong>ssos crispare capillos, <strong>«</strong> Brû<strong>le</strong> mes excréments <strong>et</strong> tu pourras friser <strong>le</strong>s<br />
cheveux dévitalisés <strong>»</strong>.<br />
31. La taupe : Et munus nostri, calue, cruoris habe, <strong>«</strong> Et procure-toi <strong>le</strong> présent de notre sang, toi qui es<br />
chauve <strong>»</strong> ; <strong>la</strong> chèvre : Surde, meum sumas Ga<strong>le</strong>no teste cruorem, <strong>«</strong> Toi qui es sourd, suis <strong>le</strong> conseil de<br />
Galien <strong>et</strong> prends mon sang <strong>»</strong>.<br />
32. Le bélier : Dicite pastores, nostis, quid uel<strong>le</strong>re possim, <strong>«</strong> Dites, bergers, <strong>le</strong>s vertus de ma toison – vous <strong>le</strong>s<br />
connaissez <strong>»</strong>.<br />
33. Le <strong>loup</strong> : Dic uires, Demarche, meas, me praeda moratur,/Nam duo te referunt lustra fuisse lupum, <strong>«</strong> Dis<br />
mes qualités, Demarchus, je suis occupé à chasser : à ce qu’on dit, en eff<strong>et</strong>, tu as été <strong>loup</strong> pendant deux<br />
lustres <strong>»</strong> ; <strong>le</strong> rat : Vel dicat Carbo, aut clypeis Lauinus adesis,/Cui tulimus belli nuncia certa trucis, <strong>«</strong> Que<br />
Carbon <strong>le</strong> dise, ou l’habitant de Lavinium, dont <strong>le</strong>s boucliers ont été rongés, à qui nous avions donné <strong>le</strong><br />
présage certain d’une guerre terrib<strong>le</strong> <strong>»</strong>.<br />
34. L’ours : Ne taceas titulos, Vrse po<strong>et</strong>a, meos, <strong>«</strong> Ne tais pas mes titres de gloire, poète Ursin <strong>»</strong>.<br />
Schedae, 2009, prépublication n°15, (fascicu<strong>le</strong> n°2, p.73-92).<br />
http://www.unicaen.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint0152009.pdf<br />
79
80<br />
arguent, mores <strong>la</strong>udabunt, religionem extol<strong>le</strong>nt, si aegrotare contigerit sese morti exponent,<br />
aliud cerebrum, aliud cor, aliud oculos, aliud sanguinem, iecur, lotium, aliud denique<br />
praesegmina omnia ueluti pharmacopol<strong>la</strong> suas merces extrud<strong>et</strong> 35 . En somme, il <strong>le</strong>ur prête<br />
deux missions à défendre : l’une salvatrice <strong>et</strong> thérapeutique, l’autre mora<strong>le</strong>, consistant à<br />
défendre <strong>la</strong> vertu contre <strong>le</strong> vice. Si nous commençons par <strong>la</strong> mission thérapeutique, il est<br />
vrai que l’objectif de ces animaux, pour <strong>la</strong> plupart, semb<strong>le</strong> être de persuader l’homme de<br />
<strong>le</strong>ur utilité médica<strong>le</strong>, quitte à ce que c<strong>et</strong>te reconnaissance aboutisse à <strong>le</strong>ur mort, parfois<br />
cruel<strong>le</strong> 36 : d’où l’emploi de <strong>la</strong> deuxième personne, des modes de l’injonction, <strong>et</strong>c. Or deux<br />
animaux, <strong>le</strong> castor <strong>et</strong> <strong>le</strong> cerf, adoptent une attitude exactement opposée à cel<strong>le</strong> des autres :<br />
<strong>le</strong> castor, dans quatre vers <strong>la</strong>pidaires 37 , enjoint à l’homme de lui <strong>la</strong>isser <strong>la</strong> vie sauve en<br />
échange de ses testicu<strong>le</strong>s. De manière plus développée <strong>et</strong> plus travaillée, c’est aussi <strong>le</strong> cas<br />
du cerf. Dans un premier temps, il tente de convaincre <strong>le</strong>s <strong>le</strong>cteurs que seu<strong>le</strong>s ses cornes<br />
possèdent des vertus, <strong>et</strong> qu’il est donc inuti<strong>le</strong> de <strong>le</strong> chasser 38 . On peut remarquer <strong>le</strong> caractère<br />
très rigoureux de sa démonstration (Nonne satis <strong>la</strong>crimae ramosaque cornua prosunt ?<br />
[…] Crede mihi, in nostro tot sunt medicamina cornu/In sene quot ramos cornua utraque<br />
ferunt […] Sed frustra (heu) cecini nostri praeconia cornu). Parallè<strong>le</strong>ment, il cherche à émouvoir<br />
son interlocuteur <strong>et</strong> déploie pour ce<strong>la</strong> toutes <strong>le</strong>s ressources de l’elocutio <strong>la</strong> plus expressive :<br />
interrogation rhétorique, apostrophe, hyperbo<strong>le</strong>, interjection. Faisant porter tous ses efforts<br />
sur <strong>le</strong> pathétique, il mentionne ses <strong>la</strong>rmes à deux reprises 39 , évoque <strong>la</strong> mort cruel<strong>le</strong> qui<br />
l’attend 40 , accuse l’homme de ne pas <strong>répondre</strong> à <strong>la</strong> confiance qu’il m<strong>et</strong> en lui 41 . L’attention<br />
<strong>et</strong> <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ce accordée au cerf, puisque c’est à lui qu’il consacre <strong>le</strong> plus long poème <strong>et</strong> celui<br />
dont <strong>la</strong> composition est <strong>la</strong> plus travaillée, brouil<strong>le</strong>nt ainsi quelque peu <strong>le</strong> sens de l’ensemb<strong>le</strong>.<br />
C<strong>et</strong>te impression de contradiction est accentuée par <strong>la</strong> confusion du discours moral<br />
tenu par <strong>le</strong>s animaux. Il est vrai, conformément à <strong>la</strong> promesse d’Ursin, que <strong>le</strong> discours médical<br />
se mê<strong>le</strong> parfois de quelques conseils de nature mora<strong>le</strong>, notamment dans <strong>le</strong> domaine de<br />
<strong>la</strong> sexualité. Par exemp<strong>le</strong> <strong>le</strong> cerf, pour échapper à <strong>la</strong> mort, veut convaincre <strong>le</strong>s jeunes fil<strong>le</strong>s<br />
désireuses d’avorter qu’il n’est pas efficace, contrairement à ce qu’on croit, de porter au<br />
coude gauche l’os qu’il renferme dans son cœur :<br />
35. <strong>«</strong> Ils fustigeront <strong>le</strong>s vices, ils loueront <strong>le</strong>s bonnes mœurs, ils glorifieront <strong>la</strong> religion. S’il t’arrive de tomber<br />
ma<strong>la</strong>de, ils s’exposeront à <strong>la</strong> mort, l’un offrira sa cervel<strong>le</strong>, un autre son cœur, un autre ses yeux, un autre<br />
son sang, son foie, son urine, un autre enfin tout ce qu’il possède, comme un pharmacien offre sa<br />
marchandise <strong>»</strong> (Préface de Jean Ursin à Jacques de Joyeuse).<br />
36. Ainsi, dans <strong>le</strong> poème du cheval : Spuma phthisim curat (sed me docuisse pigebit/Si me pro uita mors uio<strong>le</strong>ntia<br />
man<strong>et</strong>), <strong>«</strong> Mon écume soigne <strong>la</strong> phtisie (mais il m’en coûtera de l’avoir enseigné si une mort vio<strong>le</strong>nte<br />
m’attend en échange de <strong>la</strong> vie) <strong>»</strong> ; dans celui du rat : Et cor, si qua fides, e uiuo pectore uulsum,/<br />
Compressam pathicam non sin<strong>et</strong> esse grauem, <strong>«</strong> Et mon cœur arraché vivant de ma poitrine, si tu y crois,<br />
évitera une grossesse à une fil<strong>le</strong> mise à mal <strong>»</strong> ; dans celui du caméléon : Dicite decepti mea nunc praeconia<br />
magi,/Quid mihi uiuenti demptus ocellus agat, <strong>«</strong> Proc<strong>la</strong>mez maintenant mes vertus, mages trompeurs,<br />
dites à quoi peut servir mon œil si on me l’arrache alors que je suis vivant <strong>»</strong>.<br />
37. Cum mea sit <strong>la</strong>utis caro non admissa catinis/Cur praedae ingratae r<strong>et</strong>ia tanta paras ?/An quia teste putor<br />
gelidos arcere dolores ?/Sume ergo testes, c<strong>et</strong>era linque mihi, <strong>«</strong> Puisque <strong>le</strong>s gourm<strong>et</strong>s ne veu<strong>le</strong>nt pas de<br />
ma chair dans <strong>le</strong>urs assi<strong>et</strong>tes, pourquoi prépares-tu tant de fi<strong>le</strong>ts pour une proie que tu n’apprécies pas ?<br />
Est-ce parce que mes testicu<strong>le</strong>s, à ce qu’on croit, sont un remède contre <strong>la</strong> paralysie <strong>et</strong> ses dou<strong>le</strong>urs ?<br />
Prends mes testicu<strong>le</strong>s, alors, <strong>et</strong> <strong>la</strong>isse-moi <strong>le</strong> reste <strong>»</strong>.<br />
38. Nonne satis <strong>la</strong>crimae ramosaque cornua prosunt ?/Num pili <strong>et</strong> lotium commoda multa parant ?, <strong>«</strong> Mes <strong>la</strong>rmes<br />
<strong>et</strong> mes bois ramifiés ne sont-ils pas suffisamment uti<strong>le</strong>s ? Mes poils <strong>et</strong> mon urine comporteraient-ils<br />
de nombreux avantages ? <strong>»</strong>.<br />
39. Nonne satis <strong>la</strong>crimae ramosaque cornua prosunt ? […] Nil lotium aut <strong>la</strong>crimae, nil mea merda iuuat, <strong>«</strong> Mon<br />
urine, mes <strong>la</strong>rmes, ne servent à rien, pas plus que mes excréments <strong>»</strong>.<br />
40. Iam properant ce<strong>le</strong>res in mea damna canes./R<strong>et</strong>ia tenduntur, frangit iam buccina coelum,/Mittitur in nostrum<br />
iamque sagitta <strong>la</strong>tus, <strong>«</strong> Déjà <strong>le</strong>s chiens rapides se hâtent pour me tuer. Les fi<strong>le</strong>ts sont tendus, déjà <strong>le</strong><br />
son du cor déchire l’air, déjà on perce mon f<strong>la</strong>nc d’une flèche <strong>»</strong>.<br />
41. Ad te pro uita ut tuti si pergimus ultro,/Cur mihi cum canibus, r<strong>et</strong>ia tendis homo ?, <strong>«</strong> Si je me réfugie<br />
auprès de toi pour sauver ma vie, pourquoi, homme, tends-tu tes fi<strong>le</strong>ts contre moi, avec l’aide de tes<br />
chiens ? <strong>»</strong>.<br />
Schedae, 2009, prépublication n°15, (fascicu<strong>le</strong> n°2, p. 73-92).<br />
http://www.unicaen.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint0152009.pdf
Siue quod autum<strong>et</strong> (scelus est id promere) uirgo<br />
Hoc cubito appenso, ponere uentris onus.<br />
Error hic 42 […]<br />
Et, hors de tout intérêt personnel, il ajoute immédiatement ce conseil, de nature très<br />
vertueuse :<br />
[…] Ah potius uitam seruate pudicam,<br />
Excipite aut sancti pignora sana thori 43 !<br />
De même, dans <strong>le</strong> poème qui lui est consacré, par suite de <strong>la</strong> déformation d’une indication<br />
de Pline, <strong>le</strong> <strong>loup</strong> prône <strong>la</strong> modération en ce domaine :<br />
Verum more meo ueneri praescribito m<strong>et</strong>am,<br />
Mense semel satis est sit reuoluta uenus 44 .<br />
Mais ces incitations à <strong>la</strong> tempérance sont en tota<strong>le</strong> contradiction avec d’autres qui<br />
semb<strong>le</strong>nt constituer une véritab<strong>le</strong> incitation au p<strong>la</strong>isir. On trouve par exemp<strong>le</strong> des conseils<br />
pour goûter <strong>le</strong>s p<strong>la</strong>isirs de Vénus sans avoir d’enfant. Ces conseils peuvent être des simp<strong>le</strong>s<br />
méthodes de contraception 45 , mais il peut aussi s’agir de méthodes abortives, comme<br />
nous venons de <strong>le</strong> voir à propos du cerf. Or Pline lui-même limite à un seul <strong>le</strong>s conseils en<br />
ce domaine, se justifiant longuement pour avoir osé c<strong>et</strong>te exception 46 , <strong>et</strong> <strong>le</strong>s animaux<br />
d’Ursin tiennent en ce domaine un discours extrêmement subversif. Par ail<strong>le</strong>urs nombreux<br />
sont <strong>le</strong>s conseils destinés à augmenter <strong>le</strong> p<strong>la</strong>isir sexuel : ainsi, <strong>le</strong> <strong>loup</strong> ne conseil<strong>le</strong> <strong>la</strong> tempérance<br />
qu’après avoir donné des conseils pour améliorer l’érection 47 . Le plus étonnant<br />
cependant est que, <strong>le</strong> plus souvent, <strong>le</strong>s préceptes licencieux donnés par Ursin semb<strong>le</strong>nt<br />
viser un certain public féminin, comme <strong>le</strong> prouve <strong>la</strong> quadrup<strong>le</strong> occurrence du terme pathica<br />
qui semb<strong>le</strong> désigner ici une femme faci<strong>le</strong>, qui cherche <strong>le</strong> p<strong>la</strong>isir. Ainsi, si <strong>le</strong> <strong>loup</strong> donne des<br />
conseils d’ordre assez général, comme <strong>le</strong> suivant :<br />
ou comme celui-ci :<br />
[oculum] Ferto <strong>et</strong>iam furtim pathicae qui gaudia quaeris<br />
Latratu r<strong>et</strong>eg<strong>et</strong> ne tua furta canis. 48<br />
42. <strong>«</strong> Ou est-ce parce que <strong>la</strong> jeune fil<strong>le</strong> croit (c’est un crime de faire courir ce bruit) qu’en l’accrochant à son<br />
coude, el<strong>le</strong> débarrassera son ventre de son fardeau ? C’est une erreur. <strong>»</strong><br />
43. <strong>«</strong> Ah, menez plutôt une vie honnête, ou concevez des enfants honorab<strong>le</strong>s, nés d’une union consacrée. <strong>»</strong><br />
44. <strong>«</strong> Mais, suis mon usage <strong>et</strong> limite <strong>le</strong>s p<strong>la</strong>isirs de Vénus : une fois par mois est un dé<strong>la</strong>i suffisant pour que<br />
Vénus revienne. <strong>»</strong><br />
45. L’éléphant : Sed contra aeugio pro pesso stercora subdat/Gaudia Pennati cui sine pro<strong>le</strong> p<strong>la</strong>cent (<strong>«</strong> Mais,<br />
en revanche, qu’el<strong>le</strong> utilise mes excréments en pessaire, cel<strong>le</strong> qui goûte <strong>le</strong>s p<strong>la</strong>isirs de Cupidon sans souhaiter<br />
de descendance <strong>»</strong>) ; <strong>le</strong> rat : Et cor, si qua fides, e uiuo pectore uulsum/Compressam pathicam non<br />
sin<strong>et</strong> esse grauem (<strong>«</strong> Et mon cœur arraché vivant de ma poitrine, si tu veux y croire, évitera une grossesse<br />
à une fil<strong>le</strong> mise à mal <strong>»</strong>).<br />
46. Plin., nat. 29, 85 : Tertium genus [araneorum] est eodem pha<strong>la</strong>ngi nomine araneus <strong>la</strong>nuginosus, grandissimo<br />
capite, quo dissecto inueniri intus dicuntur uermiculi duo adalligatique mulieribus pel<strong>le</strong> ceruina ante<br />
solis ortum praestare, ne concipiant, ut Caecilius in Commentariis reliquit. Vis ea annua est. Quam so<strong>la</strong>m<br />
ex omni atocio dixisse fas sit, quoniam aliquarum fecunditas p<strong>le</strong>na liberis tali uenia indig<strong>et</strong>.<br />
47. Ex nostro rotu<strong>la</strong>s deduces ore priapo,/Mentu<strong>la</strong> Lampsaceni stabit ut il<strong>la</strong> dei (<strong>«</strong> De ma gueu<strong>le</strong> tu tireras de<br />
“p<strong>et</strong>ites roues” pour Priape, ton sexe se dressera comme celui du dieu de Lampsaque <strong>»</strong>).<br />
48. <strong>«</strong> Porte-<strong>le</strong> aussi, toi qui cherches à <strong>la</strong> dérobée <strong>le</strong>s p<strong>la</strong>isirs des fil<strong>le</strong>s, afin que l’aboiement des chiens ne<br />
vienne révé<strong>le</strong>r tes <strong>la</strong>rcins. <strong>»</strong><br />
Schedae, 2009, prépublication n°15, (fascicu<strong>le</strong> n°2, p.73-92).<br />
http://www.unicaen.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint0152009.pdf<br />
81
82<br />
Ca<strong>et</strong>era delusi taceo nugamina magi<br />
Qui putat ad pathicam pondus habere pilum. 49<br />
d’autres animaux sont beaucoup plus directs dans l’aide qu’ils proposent <strong>et</strong> peuvent faire<br />
dire que <strong>le</strong> <strong>la</strong>tin <strong>«</strong> brave l’honnêt<strong>et</strong>é <strong>»</strong>, pour reprendre <strong>le</strong> mot de Boi<strong>le</strong>au. C’est par exemp<strong>le</strong><br />
<strong>le</strong> cas de l’âne, lorsqu’il donne ce conseil :<br />
Curat adeps <strong>et</strong>iam, ut paticae submissum in anum<br />
Criss<strong>et</strong>, <strong>et</strong> in uenerem dente fremente uac<strong>et</strong>. 50<br />
Aussi pouvons-nous conclure, là encore, que si Ursin recourt à <strong>la</strong> rhétorique, il ne<br />
donne pas à son œuvre un objectif fort de conviction ou de persuasion, <strong>et</strong> <strong>le</strong> message<br />
qu’el<strong>le</strong> transm<strong>et</strong> est obscur. C’est ail<strong>le</strong>urs qu’il faut chercher, semb<strong>le</strong>-t-il, <strong>le</strong> but que se fixe<br />
Ursin.<br />
Aussi pouvons-nous conclure, là encore, que si Ursin recourt à <strong>la</strong> rhétorique, il ne donne<br />
pas à son œuvre un objectif fort de conviction ou de persuasion, <strong>et</strong> <strong>le</strong> message qu’el<strong>le</strong><br />
transm<strong>et</strong> est obscur. C’est ail<strong>le</strong>urs qu’il faut chercher, semb<strong>le</strong>-t-il, <strong>le</strong> but que se fixe Ursin.<br />
De<strong>le</strong>ctare : <strong>le</strong>s éléments poétiques<br />
C’est en eff<strong>et</strong> sur <strong>le</strong> p<strong>la</strong>isir de l’auditoire qu’Ursin a <strong>fait</strong> porter l’essentiel de ses efforts,<br />
<strong>et</strong> pour <strong>le</strong> provoquer il a appliqué là encore <strong>le</strong>s préceptes de Cicéron. Dans <strong>la</strong> <strong>Prosopopeia</strong>,<br />
en eff<strong>et</strong>, charmer <strong>le</strong> <strong>le</strong>cteur passe souvent par <strong>le</strong>s trois qualités du sty<strong>le</strong> que sont ornement,<br />
variété <strong>et</strong> pur<strong>et</strong>é.<br />
Même si, comme nous l’avons observé précédemment, <strong>le</strong> contenu de l’œuvre relève<br />
essentiel<strong>le</strong>ment de <strong>la</strong> fonction didactique, <strong>la</strong> <strong>le</strong>cture montre qu’Ursin est loin d’avoir tout<br />
sacrifié à cel<strong>le</strong>-ci. Il est c<strong>la</strong>ir qu’il n’a pas voulu plonger son <strong>le</strong>cteur dans l’ennui en l’accab<strong>la</strong>nt<br />
sous une énorme masse de connaissances, <strong>et</strong> qu’il n’a en aucun cas cherché à réunir sur chaque<br />
animal un savoir exhaustif. Lui-même écrit dans sa dédicace, à propos des animaux : multa<br />
tacent 51 , <strong>et</strong> <strong>la</strong> moitié des poèmes <strong>fait</strong> moins de seize vers. Par ail<strong>le</strong>urs, comme nous l’avons<br />
déjà signalé, <strong>le</strong>s prosopopées bril<strong>le</strong>nt par l’absence de toute précision technique : aucun mode<br />
d’utilisation, aucune posologie, rien qui pourrait <strong>la</strong>sser <strong>le</strong> <strong>le</strong>cteur. Il est probab<strong>le</strong> aussi que <strong>le</strong>s<br />
animaux exotiques, comme <strong>le</strong> chameau, <strong>le</strong> lion ou <strong>le</strong> caméléon, sont mentionnés autant parce<br />
qu’ils sont cités par Pline que parce qu’ils fournissent un élément propice à enchanter l’imagination.<br />
Enfin l’introduction d’éléments légendaires, surnaturels ou historiques vise à p<strong>la</strong>ire<br />
à un public que pourrait fatiguer une stricte énumération de ma<strong>la</strong>dies <strong>et</strong> de remèdes. On<br />
trouve ainsi, sur <strong>le</strong> mode allusif, <strong>la</strong> mention d’un épisode de lycanthropie, des <strong>fait</strong>s historiques<br />
comme <strong>la</strong> lutte des armées d’Auguste contre <strong>le</strong>s <strong>la</strong>pins des Baléares 52 ou encore des<br />
49. <strong>«</strong> Je tais <strong>le</strong>s autres affabu<strong>la</strong>tions du mage ignorant, qui pense qu’un de mes poils est uti<strong>le</strong> aux fil<strong>le</strong>s<br />
débauchées <strong>»</strong>.<br />
50. <strong>«</strong> En application sur l’anus, ma graisse amènera une fil<strong>le</strong> à ondu<strong>le</strong>r de <strong>la</strong> croupe <strong>et</strong> se consacrer à Vénus<br />
avec appétit <strong>»</strong>; c<strong>et</strong>te indication vient de Sextus P<strong>la</strong>citus (De asino, 10) : ut ad concubitum paratus sis : asini<br />
adeps cum anserino masculino mixtus <strong>et</strong> ad anum positus ad concubitum mox praeparat (<strong>«</strong> Pour se préparer<br />
au coït : <strong>la</strong> graisse d’âne, mêlée à de <strong>la</strong> graisse de jars <strong>et</strong> appliquée sur l’anus, prépare rapidement<br />
au coït <strong>»</strong>).<br />
51. <strong>«</strong> Ils tairont bien des choses. <strong>»</strong><br />
52. Sim lic<strong>et</strong> imbellis, c<strong>la</strong>ros funda Ba<strong>le</strong>ares,/Frugibus errosis, in fera bel<strong>la</strong> traho, <strong>«</strong> Bien que je sois paisib<strong>le</strong>,<br />
j’entraîne dans des guerres sans merci <strong>le</strong>s Baléares célèbres pour <strong>le</strong>urs frondes à cause des récoltes que<br />
je ronge <strong>»</strong> ; cf. Pline, nat. 8, 218 : Certum est Baliaricos aduersus prouentum eorum auxilium militare a Diuo<br />
Augusto p<strong>et</strong>isse, <strong>«</strong> Il est sûr que <strong>le</strong>s habitants des Baléares réc<strong>la</strong>mèrent au dieu Auguste <strong>le</strong> secours d’une<br />
garnison pour lutter contre <strong>le</strong>ur pullu<strong>le</strong>ment <strong>»</strong>.<br />
Schedae, 2009, prépublication n°15, (fascicu<strong>le</strong> n°2, p. 73-92).<br />
http://www.unicaen.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint0152009.pdf
prodiges, par exemp<strong>le</strong> <strong>la</strong> manière dont <strong>le</strong>s rats avaient annoncé <strong>la</strong> guerre des Marses en rongeant<br />
<strong>le</strong>s boucliers des soldats de Lanuvium 53 , autant d’anecdotes rapportées par Pline.<br />
Un second élément contribue à <strong>la</strong> de<strong>le</strong>ctatio du <strong>le</strong>cteur : <strong>le</strong> <strong>fait</strong> que <strong>le</strong> texte soit rédigé<br />
en vers. Que l’on considère l’Antiquité, <strong>le</strong> Moyen Âge ou <strong>la</strong> Renaissance, <strong>le</strong>s vers sont rarement<br />
utilisés dans <strong>le</strong>s traités médicaux ou zoologiques 54 . C’est à <strong>la</strong> prose qu’ont recouru<br />
Albert <strong>le</strong> Grand <strong>et</strong> Thomas de Cantimpré dans <strong>le</strong>urs traités sur <strong>le</strong>s animaux, de même que<br />
<strong>le</strong> médecin Mercuria<strong>le</strong> pour son De Arte Gymnastica ou, un peu plus tard, Ambroise Paré.<br />
Lorsqu’un auteur choisit <strong>le</strong>s vers, c’est en général dans une perspective différente de cel<strong>le</strong><br />
de <strong>la</strong> prose. Columel<strong>le</strong> l’avait déjà montré en déclinant <strong>le</strong> thème des jardins potagers à <strong>la</strong><br />
fois en vers <strong>et</strong> en prose, peu confiant, semb<strong>le</strong>-t-il, dans <strong>la</strong> va<strong>le</strong>ur didactique de <strong>la</strong> poésie.<br />
Si l’on prend l’exemp<strong>le</strong> d’un contemporain de Jean Ursin, <strong>le</strong> médecin <strong>et</strong> poète italien Giro<strong>la</strong>mo<br />
Fracastoro, celui-ci traite de <strong>la</strong> syphilis dans deux ouvrages : d’une part un long poème<br />
didactique en hexamètres intitulé Syphilis siue de morbo Gallico, dans <strong>le</strong>quel il mê<strong>le</strong> une<br />
description des symptômes <strong>et</strong> des remèdes à des évocations mythologiques (une catabase<br />
pour al<strong>le</strong>r chercher <strong>le</strong> mercure) <strong>et</strong> épiques (une version corrigée de <strong>la</strong> découverte du Nouveau<br />
Monde) ; de l’autre un traité en prose, de nature exclusivement scientifique, intitulé<br />
De Contagione, dans <strong>le</strong>quel il expose, <strong>le</strong> premier, l’hypothèse de <strong>la</strong> contagion vira<strong>le</strong>. C’est<br />
cependant de son poème Syphilis, qu’il mit vingt ans à rédiger, qu’il était <strong>le</strong> plus fier, <strong>et</strong><br />
c’est c<strong>et</strong>te œuvre qui lui apporta <strong>la</strong> gloire. Les préfaces de <strong>la</strong> <strong>Prosopopeia</strong> insistent toutes<br />
sur <strong>le</strong>s ta<strong>le</strong>nts de poète de Jean Ursin 55 , <strong>la</strong> préface en vers oubliant même de mentionner<br />
sa qualité de médecin. Ce choix du <strong>la</strong>ngage poétique pour un traité médical inscrit <strong>le</strong> recueil<br />
dans <strong>le</strong> genre de <strong>la</strong> poésie didactique. Cependant l’utilisation systématique du distique<br />
élégiaque <strong>et</strong> non de l’hexamètre apparente plutôt <strong>la</strong> <strong>Prosopopeia</strong> à l’Ars Amatoria ou aux<br />
Remedia Amoris d’Ovide qu’au De Rerum Natura de Lucrèce ou aux Géorgiques de Virgi<strong>le</strong>.<br />
La parution, <strong>la</strong> même année <strong>et</strong> chez <strong>le</strong> même éditeur, des E<strong>le</strong>giae de peste, el<strong>le</strong>s aussi<br />
composées en distiques, confirme qu’il y a là un choix poétique déterminé. Or on considère<br />
souvent que <strong>le</strong>s ouvrages d’Ovide mentionnés ci-dessus sont des parodies de <strong>la</strong> poésie<br />
didactique. Faut-il voir ici une intention précise de Jean Ursin, cel<strong>le</strong> de se situer dans <strong>le</strong><br />
registre parodique ? Si l’on ne peut pas nier que certaines prosopopées ne manquent pas<br />
d’humour, il faut plus probab<strong>le</strong>ment y voir un goût particulier pour l’élégie <strong>et</strong> <strong>le</strong> distique,<br />
souvent partagé par ses contemporains sensib<strong>le</strong>s à l’influence d’Ovide, ce que pourrait<br />
confirmer <strong>la</strong> parution des E<strong>le</strong>giae de Peste. Nous étudierons plus loin un exemp<strong>le</strong> précis<br />
du travail poétique de Jean Ursin.<br />
Cependant, dans <strong>la</strong> recherche de <strong>la</strong> de<strong>le</strong>ctatio, <strong>la</strong> vraie nouveauté <strong>et</strong> l’atout majeur de<br />
l’œuvre résident dans <strong>la</strong> forme de discours adoptée, c’est-à-dire <strong>la</strong> prosopopée. Ursin<br />
semb<strong>le</strong> avoir été particulièrement fier de son idée puisqu’il a tiré du procédé <strong>le</strong> titre de son<br />
œuvre. Une longue énumération dans <strong>la</strong> préface-dédicace qu’il rédige à l’intention de<br />
Jacques de Joyeuse, dans <strong>la</strong>quel<strong>le</strong> il insiste sur <strong>le</strong> thème de <strong>la</strong> paro<strong>le</strong>, <strong>le</strong> montre bien :<br />
53. Vel dicat Carbo, aut clypeis Lauinus adesis,/Cui tulimus belli nuncia certa trucis, <strong>«</strong> Que Carbon <strong>le</strong> dise, ou<br />
l’habitant de Lavinium, dont <strong>le</strong>s boucliers ont été rongés, à qui nous avions donné <strong>le</strong> présage certain<br />
d’une guerre terrib<strong>le</strong> <strong>»</strong> ; cf. Pline, nat. 8, 221 : Adrosis Lanuui clipeis argenteis Marsicum portendere bellum,<br />
Carboni imperatori, apud Clusium fasceis quibus in calciatu utebatur, exitium, <strong>«</strong> En rongeant <strong>le</strong>s boucliers<br />
d’argent de Lanuvium, ils annoncèrent <strong>la</strong> guerre des Marses ; en rongeant à Clusium <strong>le</strong>s <strong>la</strong>c<strong>et</strong>s des<br />
chaussures de Carbon, <strong>le</strong> général en chef, ils annoncèrent sa fin <strong>»</strong> (PLINE L’ANCIEN, Ernout 1952).<br />
54. On ne peut guère citer que Quintus Serenus (II e ? IV e ?), Liber Medicinalis, texte établi, traduit <strong>et</strong> commenté<br />
par <strong>le</strong> docteur R. Pépin, Paris, PUF, 1950 (voir aussi SABBAH 1987, 142-144).<br />
55. Ursin est qualifié de <strong>la</strong>ureatus po<strong>et</strong>a dans l’en-tête du livre, de tantus po<strong>et</strong>a dans <strong>la</strong> préface de Raymondus<br />
Aquaeus, de mirus po<strong>et</strong>a dans <strong>la</strong> postface de Stephanus Roybosius ; Jacques Olivier, quant à lui, écrit<br />
dans sa préface : non potui non <strong>la</strong>udare in primis hominis institutum, dein e<strong>le</strong>gantiam, festiuitatem <strong>et</strong> dexteritatem<br />
admirari, <strong>«</strong> je n’ai pu m’empêcher de louer en premier lieu son entreprise, puis d’admirer l’élégance<br />
de son sty<strong>le</strong>, sa verve <strong>et</strong> son ta<strong>le</strong>nt <strong>»</strong>.<br />
Schedae, 2009, prépublication n°15, (fascicu<strong>le</strong> n°2, p.73-92).<br />
http://www.unicaen.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint0152009.pdf<br />
83
84<br />
Tecum ubi uo<strong>le</strong>s uerba facient, iussa tacebunt, iniussa non sese ultro proferrent, omnia<br />
dicent, nihil ce<strong>la</strong>bunt, uitia arguent, mores <strong>la</strong>udabunt, religionem extol<strong>le</strong>nt 56 . La prosopopée<br />
est dans sa stricte définition une figure de rhétorique qui perm<strong>et</strong> de <strong>«</strong> m<strong>et</strong>tre en scène<br />
<strong>le</strong>s absents, <strong>le</strong>s morts, <strong>le</strong>s êtres surnaturels ou même <strong>le</strong>s êtres inanimés, <strong>le</strong>s faire agir, <strong>par<strong>le</strong>r</strong>,<br />
<strong>répondre</strong> <strong>»</strong> 57 . C’est une figure du sublime. Ce n’est cependant pas dans c<strong>et</strong>te perspective que<br />
Jean Ursin l’utilise. L’emploi qu’il <strong>fait</strong> de <strong>la</strong> prosopopée possède deux grandes particu<strong>la</strong>rités :<br />
d’une part, en l’étendant à tous ses poèmes, il <strong>la</strong> <strong>fait</strong> passer du statut de figure du discours<br />
à celui de genre littéraire ; de l’autre, en lui associant personnification <strong>et</strong> dialogisme, il ne<br />
vise pas tant à un eff<strong>et</strong> de sublime – eff<strong>et</strong> que <strong>le</strong> contenu du discours, souvent très trivial,<br />
viendrait de toute façon annu<strong>le</strong>r – qu’à amender l’austérité de son propos par <strong>le</strong> recours à<br />
une forme littéraire vivante, produire un eff<strong>et</strong> d’animation, de vie, de diversité, suivant en<br />
ce<strong>la</strong> <strong>le</strong>s indications de Quintilien 58 .<br />
Ursin tire de son idée un certain nombre d’eff<strong>et</strong>s véritab<strong>le</strong>ment heureux. Conscient<br />
sans doute du caractère mécanique qui pourrait ressortir de <strong>la</strong> répétition des monologues,<br />
il recourt sans cesse à <strong>la</strong> qualité <strong>et</strong> <strong>la</strong> variété pour agrémenter son ouvrage. Cel<strong>le</strong>s-ci s’observent<br />
essentiel<strong>le</strong>ment dans <strong>la</strong> partie des poèmes consacrée à <strong>la</strong> natura des animaux, c’està-dire<br />
en début de texte.<br />
On remarque d’abord un effort pour m<strong>et</strong>tre en scène, à <strong>la</strong> manière d’un défilé, <strong>la</strong> succession<br />
des animaux. Dans six cas, tous situés dans <strong>la</strong> première moitié du livre, <strong>le</strong>s animaux<br />
commencent <strong>le</strong>ur discours par une transition, directe ou indirecte, avec celui qui <strong>le</strong>s a<br />
précédés : l’âne répond au sanglier 59 , <strong>la</strong> chèvre sauvage à <strong>la</strong> chèvre 60 , <strong>le</strong> chameau au cheval<br />
61 , <strong>le</strong> caméléon au chameau 62 ; une variation apparaît quand <strong>le</strong> cerf mentionne <strong>le</strong>s chiens<br />
du chapitre précédent, mais sans s’adresser directement à eux car il <strong>le</strong>s craint 63 ; enfin<br />
l’ours signa<strong>le</strong> qu’il a vaincu <strong>le</strong> taureau en un combat célèbre 64 . Notons que dans un cas on<br />
trouve aussi une transition fina<strong>le</strong>, <strong>la</strong> chèvre indiquant qu’el<strong>le</strong> est obligée de se taire pour<br />
<strong>la</strong>isser <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ce au chevreuil 65 . Ce procédé donne beaucoup de fluidité au recueil. Il existe<br />
aussi deux cas où l’animal qui prend <strong>la</strong> paro<strong>le</strong> établit un lien non avec celui qui <strong>le</strong> précède<br />
56. <strong>«</strong> Quand tu <strong>le</strong> voudras, ils <strong>par<strong>le</strong>r</strong>ont avec toi, quand tu <strong>le</strong>ur en donneras l’ordre, ils se tairont, ils ne prendront<br />
pas l’initiative de s’avancer sans en avoir reçu l’ordre, ils diront tout, ils ne cacheront rien, ils fustigeront<br />
<strong>le</strong>s vices, ils loueront <strong>le</strong>s bonnes mœurs, ils glorifieront <strong>la</strong> religion. <strong>»</strong><br />
57. FONTANIER 1968, 404.<br />
58. Quintilien, Institutio Oratoria, IX, 2, 29 : il<strong>la</strong> adhuc audaciora <strong>et</strong> maiorum, ut Cicero existimat, <strong>la</strong>terum, fictiones<br />
personarum, quae proswpopoijiai dicuntur. Mire namque cum uariant orationem, tum excitant,<br />
<strong>«</strong> Plus audacieuse, <strong>et</strong>, de l’avis de Cicéron, exigeant un plus grand effort est l’intervention imaginaire de<br />
personnages, qui est appelée “prosopopée”. C’est une figure merveil<strong>le</strong>use pour donner au discours de<br />
<strong>la</strong> variété <strong>et</strong> surtout de l’animation <strong>»</strong> (QUINTILIEN, Cousin 1978).<br />
59. Et mihi ruditu naturae promere dotes/Fas erit, excello stultus asellus aprum./Dentibus il<strong>le</strong> noc<strong>et</strong>, duro<br />
fero pondera dorso./Sum mitis, sed aper frend<strong>et</strong> in arma ruens, <strong>«</strong> Il me sera permis, à moi aussi, de braire<br />
pour faire connaître <strong>le</strong>s vertus dont <strong>la</strong> nature m’a doté, <strong>et</strong> moi, l’âne stupide, je l’emporte sur <strong>le</strong> sanglier.<br />
Il b<strong>le</strong>sse de ses défenses, moi je porte <strong>le</strong>s charges sur mon dos résistant. Je suis doux, mais <strong>le</strong> sanglier, lui,<br />
grince des dents en se j<strong>et</strong>ant dans <strong>la</strong> batail<strong>le</strong> <strong>»</strong>.<br />
60. Capra, tuas iactas nullo discrimine <strong>la</strong>udes,/Harum nempe mihi portio magna datur, <strong>«</strong> Chèvre, tu t’attribues<br />
tous <strong>le</strong>s mérites sans distinction, mais ne crois-tu pas qu’une grande partie m’en revient ? <strong>»</strong>.<br />
61. En tibi nunc adsum Panchais gibbus ab oris/Sum piger, at cursus uinco, caba<strong>le</strong>, tuos, <strong>«</strong> C’est moi, <strong>le</strong> bossu<br />
des rivages de Panchaïe, qui me présente maintenant devant toi ; je suis paresseux, mais je te bats à <strong>la</strong><br />
course, cheval <strong>»</strong>.<br />
62. Qui <strong>le</strong>gis hos uersus, ne credas me esse camelum,/Nam qui me nouit chame<strong>le</strong>onta uocat, <strong>«</strong> Toi qui lis ces<br />
vers, ne me confonds pas avec <strong>le</strong> chameau, car celui qui me connaît m’appel<strong>le</strong> <strong>le</strong> caméléon <strong>»</strong>.<br />
63. Ad te pro uita ut tuti, si pergimus ultro,/Cur mihi cum canibus r<strong>et</strong>ia tendis, homo ?, <strong>«</strong> Si je me réfugie<br />
auprès de toi pour sauver ma vie, pourquoi, homme, tends-tu tes fi<strong>le</strong>ts contre moi, avec l’aide de tes<br />
chiens ? <strong>»</strong>.<br />
64. Indomitum sterno c<strong>la</strong>ro certamine taurum,/Vnguibus atque bouis pectora dura seco, <strong>«</strong> Dans un combat<br />
célèbre, je terrasse un taureau indompté, <strong>et</strong> de mes griffes j’ouvre <strong>la</strong> dure poitrine d’un bœuf <strong>»</strong>.<br />
65. Epatis <strong>et</strong> fellis mens gestit dicere uires,/Sed contra capreae cedere iura monent, <strong>«</strong> J’ai l’intention de dire<br />
<strong>le</strong>s vertus de mon foie <strong>et</strong> de mon fiel, mais <strong>la</strong> règ<strong>le</strong> m’enjoint de <strong>la</strong>isser <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ce à <strong>la</strong> chèvre sauvage <strong>»</strong>.<br />
Schedae, 2009, prépublication n°15, (fascicu<strong>le</strong> n°2, p. 73-92).<br />
http://www.unicaen.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint0152009.pdf
mais avec un autre, dont il est proche par une ressemb<strong>la</strong>nce, comme <strong>le</strong> chat avec <strong>le</strong> lion<br />
(poèmes 10 <strong>et</strong> 2), ou par une légende, comme <strong>le</strong> bélier avec l’éléphant (poèmes 7 <strong>et</strong> 2). Si,<br />
dans <strong>le</strong> premier cas, on comprend que c’est <strong>la</strong> fidélité à l’ordre établi par Pline qui n’a pas<br />
permis de traiter <strong>le</strong> chat après <strong>le</strong> lion, on comprend moins bien pourquoi <strong>le</strong> bélier n’apparaît<br />
pas après l’éléphant, auquel il s’adresse. Peut-être c<strong>et</strong>te transition est-el<strong>le</strong> <strong>la</strong> trace d’un<br />
changement d’ordre au moment de l’impression ? À partir du poème 13, <strong>le</strong>s transitions<br />
disparaissent, comme si Ursin avait renoncé à poursuivre dans c<strong>et</strong>te voie, peut-être là encore<br />
par crainte de voir sa bonne idée tourner au procédé. Ces transitions, qui animent <strong>le</strong><br />
dérou<strong>le</strong>ment du recueil, font de l’œuvre un théâtre sur <strong>le</strong>quel chaque animal s’avance successivement<br />
pour se présenter au <strong>le</strong>cteur. C<strong>et</strong> eff<strong>et</strong> est d’autant plus sensib<strong>le</strong> que certains<br />
animaux indiquent eux-mêmes qu’ils accomplissent un dép<strong>la</strong>cement, qu’ils achèvent alors<br />
même qu’ils sont déjà en train de <strong>par<strong>le</strong>r</strong> : <strong>le</strong> chameau commence par en tibi nunc adsum 66 ,<br />
<strong>le</strong> taureau par en ego prosilio 67 , <strong>le</strong> lion <strong>et</strong> l’ours utilisent aussi adsum. Le bélier, en prenant<br />
<strong>la</strong> paro<strong>le</strong>, indique <strong>le</strong> dép<strong>la</strong>cement d’un autre animal qui semb<strong>le</strong> fuir devant lui : siste gradum,<br />
e<strong>le</strong>phas 68 . Ce<strong>la</strong> semb<strong>le</strong> confirmer l’hypothèse déjà évoquée selon <strong>la</strong>quel<strong>le</strong>, dans un<br />
premier temps, <strong>le</strong> chapitre consacré au bélier suivait immédiatement celui de l’éléphant.<br />
D’autres semb<strong>le</strong>nt prendre <strong>la</strong> paro<strong>le</strong> uniquement quand ils sont déjà en p<strong>la</strong>ce (sum est <strong>le</strong><br />
verbe <strong>le</strong> plus fréquent). Un autre animal, <strong>le</strong> renard, annonce son départ 69 ; <strong>la</strong> chèvre, en<br />
annonçant el<strong>le</strong> aussi qu’el<strong>le</strong> se r<strong>et</strong>ire 70 , <strong>fait</strong> référence à une loi ou un principe d’organisation<br />
qui <strong>fait</strong> de c<strong>et</strong>te succession d’animaux une procession organisée. Enfin l’un des animaux<br />
semb<strong>le</strong> oublier <strong>«</strong> l’illusion théâtra<strong>le</strong> <strong>»</strong>, pour ainsi dire : <strong>le</strong> caméléon, qui commence son intervention<br />
par ces mots : Qui <strong>le</strong>gis hos uersus 71 .<br />
Pour <strong>le</strong> discours de présentation des animaux, Ursin a recouru à différentes méthodes.<br />
Le plus souvent, l’animal se présente en donnant, dans <strong>le</strong>s tout premiers mots, son nom<br />
associé à un pronom ou à un verbe exprimant <strong>la</strong> première personne (c’est ce que font douze<br />
animaux : lion, sanglier, âne, chèvre, caméléon, chat, chien, taureau, lièvre, souris, loir,<br />
taupe). Ce n’est cependant pas toujours <strong>le</strong> cas, <strong>et</strong> alors c’est <strong>le</strong> titre du poème qui tient lieu<br />
de présentation (pour l’éléphant, <strong>la</strong> chèvre sauvage, <strong>le</strong> bélier, <strong>le</strong> cheval, <strong>le</strong> castor, <strong>la</strong> be<strong>le</strong>tte,<br />
<strong>le</strong> <strong>la</strong>pin, <strong>le</strong> renard, <strong>le</strong> cerf). L’animal peut aussi avoir recours à une périphrase qui <strong>le</strong> définit,<br />
comme <strong>le</strong> chameau 72 , à une allusion plus ou moins transparente, comme <strong>le</strong> <strong>loup</strong> 73 , ou à un<br />
jeu de mots, ce que <strong>fait</strong> l’ours 74 . C<strong>et</strong>te variété de forme se r<strong>et</strong>rouve dans <strong>le</strong> contenu des<br />
présentations puisque <strong>le</strong>s éléments par <strong>le</strong>squels <strong>le</strong>s animaux se caractérisent sont de nature<br />
très variée : croyances popu<strong>la</strong>ires, fab<strong>le</strong>s, allusions mythologiques, observations zoologiques,<br />
savantes ou quotidiennes, discours linguistique, épisode historique. Tous <strong>le</strong>s savoirs, culture<br />
popu<strong>la</strong>ire <strong>et</strong> culture savante confondues, sont mis en œuvre pour <strong>la</strong> présentation de l’animal.<br />
Ursin entreprend ensuite de donner, en quelques mots, une vraie personnalité aux animaux<br />
sans tomber dans l’absurdité, comme <strong>le</strong> conseil<strong>le</strong> là encore Quintilien 75 , unissant variété<br />
66. <strong>«</strong> Je me présente maintenant devant toi. <strong>»</strong><br />
67. <strong>«</strong> Me voici, je bondis. <strong>»</strong><br />
68. <strong>«</strong> Arrête-toi, éléphant. <strong>»</strong><br />
69. Sed quid tanta loquor ? Nox instat, tentat orexis/Pectora, <strong>«</strong> Mais pourquoi tant <strong>par<strong>le</strong>r</strong> ? La nuit arrive, <strong>la</strong><br />
faim <strong>fait</strong> gronder mes entrail<strong>le</strong>s <strong>»</strong>.<br />
70. Voir <strong>la</strong> note 66.<br />
71. <strong>«</strong> Toi qui lis ces vers. <strong>»</strong><br />
72. En tibi nunc adsum, Panchais gibbus ab oris, <strong>«</strong> C’est moi, <strong>le</strong> bossu des rivages de Panchaïe, qui me présente<br />
maintenant devant toi <strong>»</strong>.<br />
73. Dic uires Demarche meas, me praeda moratur/Nam duo te referunt lustra fuisse lupum, <strong>«</strong> Dis mes qualités,<br />
Demarchus, je suis occupé à chasser ; à ce qu’on dit, en eff<strong>et</strong>, tu as été <strong>loup</strong> pendant deux lustres <strong>»</strong>.<br />
74. Ne taceas titulos, Vrse po<strong>et</strong>a, meos, <strong>«</strong> Ne tais pas mes titres de gloire, poète Ursin <strong>»</strong>.<br />
75. Quintilien, IX, 2, 30 : His <strong>et</strong> aduersariorum cogitationes uelut secum loquentium protrahimus (qui tamen<br />
ita demum a fide non abhorrent si ea locutos finxerimus quae cogitasse eos non sit absurdum) <strong>et</strong> nostros cum<br />
aliis sermones <strong>et</strong> aliorum inter se credibiliter introducimus, <strong>et</strong> suadendo, obiurgando, querendo, <strong>la</strong>udando,<br />
Schedae, 2009, prépublication n°15, (fascicu<strong>le</strong> n°2, p.73-92).<br />
http://www.unicaen.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint0152009.pdf<br />
85
86<br />
<strong>et</strong> qualité. C<strong>et</strong>te tentative n’est d’ail<strong>le</strong>urs pas dénuée d’humour. Les animaux présents dans<br />
<strong>le</strong> recueil sont fiers d’avoir été choisis pour <strong>le</strong>urs vertus thérapeutiques <strong>et</strong> <strong>le</strong> montrent, chaque<br />
animal tenant à affirmer ses qualités <strong>et</strong>, parfois, à être tenu pour supérieur aux autres.<br />
Dotes, uirtutes <strong>et</strong> uires sont <strong>le</strong>s termes qui reviennent <strong>le</strong> plus souvent, ainsi que titulos. Certains<br />
se contentent d’annoncer sobrement qu’ils possèdent des qualités comme <strong>le</strong> rat 76 ,<br />
l’ours 77 , <strong>le</strong> renard 78 ; d’autres expriment <strong>le</strong>ur supériorité sur l’animal qui <strong>le</strong>s a précédés,<br />
comme l’âne ou <strong>le</strong> chevreuil 79 ; d’autres, parfois <strong>le</strong>s mêmes, n’hésitent pas, pour exprimer<br />
<strong>le</strong>ur excel<strong>le</strong>nce, à manier l’hyperbo<strong>le</strong>, comme <strong>le</strong> chien 80 <strong>et</strong> <strong>le</strong> lièvre 81 , à recourir à des comparaisons<br />
<strong>la</strong>udatives comme <strong>le</strong> cerf 82 ou à m<strong>et</strong>tre en scène <strong>le</strong>ur déc<strong>la</strong>ration, comme <strong>la</strong> chèvre<br />
83 , par des appels à l’auditoire <strong>et</strong> des interrogations rhétoriques. Cependant on trouve<br />
aussi des animaux qui affichent une modestie désolée, comme <strong>le</strong> taureau 84 . Dans l’expression<br />
même de <strong>la</strong> fierté donc, Ursin veil<strong>le</strong> à varier <strong>le</strong>s discours <strong>et</strong> <strong>le</strong>s attitudes.<br />
Par ail<strong>le</strong>urs <strong>le</strong>s rapports de chaque animal avec l’homme sont l’occasion pour Ursin<br />
d’exprimer des sentiments divers mais forts. Certains manifestent de l’indignation face à <strong>la</strong><br />
réputation que l’homme <strong>le</strong>ur <strong>fait</strong> ou <strong>la</strong> manière dont il <strong>le</strong>s traite. Le rat déplore qu’on ne<br />
reconnaisse pas ses qualités <strong>et</strong> énumère tristement <strong>le</strong>s moyens d’extermination employés<br />
contre lui 85 ; <strong>la</strong> be<strong>le</strong>tte se p<strong>la</strong>int <strong>la</strong> piètre opinion qu’on a d’el<strong>le</strong> 86 ; <strong>le</strong> cerf regr<strong>et</strong>te qu’on <strong>le</strong><br />
chasse 87 . La même gamme de réactions se r<strong>et</strong>rouve dans l’attitude des animaux lorsqu’il<br />
s’agit d’aider l’homme en lui faisant don de soi-même ou de ses productions, comme nous<br />
l’avons déjà montré : si, pour <strong>la</strong> plupart, ils se contentent d’énumérer des listes de remèdes<br />
de manière neutre, se conformant à <strong>le</strong>ur statut d’animaux de papier 88 , certains s’offrent en<br />
sacrifice tandis que d’autres se répandent en <strong>la</strong>mentations pour garder <strong>la</strong> vie sauve.<br />
76. miserando personas idoneas damus, <strong>«</strong> Grâce à el<strong>le</strong>, nous dévoilons <strong>le</strong>s pensées de nos adversaires,<br />
comme s’ils s’entr<strong>et</strong>enaient avec eux-mêmes, mais on ne <strong>le</strong>s croira que si nous <strong>le</strong>s représentons avec des<br />
idées qu’il n’est pas absurde de <strong>le</strong>ur attribuer ; de plus, nous pouvons introduire ainsi d’une manière convaincante<br />
des conversations tenues par nous avec d’autres <strong>et</strong> par d’autres entre eux <strong>et</strong>, en <strong>le</strong>ur attribuant<br />
des conseils, des objurgations, des p<strong>la</strong>intes, des éloges, des accents de pitié, nous <strong>le</strong>ur donnons <strong>le</strong>s<br />
caractères qui conviennent <strong>»</strong>.<br />
76. Sed neque dote uaco, <strong>«</strong> mais je ne manque pas de vertus <strong>»</strong>.<br />
77. Voir <strong>la</strong> note 73.<br />
78. Concionor nostras <strong>la</strong>udes, <strong>«</strong> je proc<strong>la</strong>me mes qualités <strong>»</strong>.<br />
79. Me ne putas titulis cedere uel<strong>le</strong> meis ?/Cede meis potius, tanto te munere uinco/Naturae, quantum corpore<br />
uincis apes./Nam tibi si memorem nostri praeconia fellis/Et iecoris ; dices numen inesse mihi,<br />
<strong>«</strong> Penses-tu par hasard que je veuil<strong>le</strong> te <strong>la</strong>isser <strong>le</strong> premier rang en ce qui concerne <strong>le</strong>s qualités ? Cède-<strong>le</strong>moi<br />
plutôt au vu des miennes ; je te suis aussi supérieure par mes dons naturels que tu l’es aux abeil<strong>le</strong>s<br />
par <strong>le</strong> corps. En eff<strong>et</strong>, si je te rappel<strong>le</strong> l’éloge de mon fiel <strong>et</strong> de mon foie, tu diras qu’il y a en moi quelque<br />
puissance divine <strong>»</strong>.<br />
80. Sum canis excel<strong>le</strong>ns naturae dotibus omne/Pene animal : titulos ergo tacebo meos ?, <strong>«</strong> Je suis <strong>le</strong> chien,<br />
animal excel<strong>le</strong>nt dans sa presque totalité par <strong>le</strong>s vertus dont <strong>la</strong> nature m’a doté : tairai-je pour autant mes<br />
qualités ? <strong>»</strong>.<br />
81. Non ab re dicor, si quis mea praemia pens<strong>et</strong>,/Inter quadrupedes gloria prima <strong>le</strong>pus, <strong>«</strong> Si on évalue mes<br />
dons, on aura bien raison de dire que je suis, moi, <strong>le</strong> lièvre, <strong>la</strong> plus grande gloire des quadrupèdes <strong>»</strong>.<br />
82. Crede mihi, in nostro tot sunt medicamina cornu/In sene quot ramos cornua utraque ferunt, <strong>«</strong> Crois-moi,<br />
mes bois renferment autant de remèdes qu’ils comptent de rameaux quand ce sont ceux d’un vieil<strong>la</strong>rd <strong>»</strong>.<br />
83. Propterea nostras noli contemnere uires/Hoc tibi pro uitio commoda multa feram./Ergo praebe aures,<br />
grauis <strong>et</strong> spectanda bisulco/Arunco, titulos iam recitabo meos, <strong>«</strong> Ne méprise pas mes pouvoirs. Pour<br />
compenser ce défaut, je te rendrai bien des services. Prête donc l’oreil<strong>le</strong> : tandis que ma barbiche fourchue<br />
<strong>fait</strong> de moi <strong>la</strong> cib<strong>le</strong> des regards, je vais maintenant énoncer avec dignité mes titres d’honneur <strong>»</strong>.<br />
84. Parua lic<strong>et</strong> uasto sit corpore uirtus, <strong>«</strong> Bien que mes qualités soient de peu d’importance en regard d’un<br />
corps si gros <strong>»</strong>.<br />
85. Heu, uideo, nemo uult muris promere <strong>la</strong>udes,/Imo malos succos in mea fata parant, <strong>«</strong> Hé<strong>la</strong>s, je <strong>le</strong> vois<br />
bien, personne ne veut chanter <strong>le</strong>s louanges du rat ; on prépare plutôt des poisons pour me tuer <strong>»</strong>.<br />
86. Cur mihi triste omen Graecus inesse putat ?, <strong>«</strong> Pourquoi <strong>le</strong>s Grecs voient-ils en moi un funeste présage ? <strong>»</strong>.<br />
87. Cur mihi cum canibus r<strong>et</strong>ia tendis, homo ?, <strong>«</strong> Pourquoi, homme, tends-tu tes fi<strong>le</strong>ts contre moi, avec l’aide<br />
de tes chiens ? <strong>»</strong>.<br />
88. Multorum generum animantia, papiriaca quidem, <strong>«</strong> Des animaux de nombreuses espèces, bien qu’ils<br />
soient de papier <strong>»</strong>.<br />
Schedae, 2009, prépublication n°15, (fascicu<strong>le</strong> n°2, p. 73-92).<br />
http://www.unicaen.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint0152009.pdf
Enfin, à côté de <strong>la</strong> fierté <strong>et</strong> de l’indignation, <strong>le</strong>s caractères se dessinent, bien individualisés.<br />
Là encore, Ursin multiplie <strong>le</strong>s nuances, mais aussi <strong>le</strong>s sources : si <strong>la</strong> personnalité de<br />
certains animaux correspond au discours popu<strong>la</strong>ire, d’autres se voient dotés de traits de<br />
caractère plus étonnants. Nous n’en r<strong>et</strong>iendrons que quelques-uns. Le chameau, par exemp<strong>le</strong>,<br />
est caractérisé par deux traits : sa paresse (piger sum) <strong>et</strong> sa rivalité avec <strong>le</strong> cheval (cursus<br />
uinco, caba<strong>le</strong>, tuos). Or ces deux traits viennent de remarques de Pline (8, 68) : l’observation<br />
Nec ultra adsu<strong>et</strong>um procedit spatium nec plus instituto onere recipit a été adaptée<br />
pour créer un trait de caractère, <strong>la</strong> paresse, tandis que <strong>la</strong> remarque Velocitas < ut > equo,<br />
sed sua cuique mensura sicuti uires […] odium aduersus equos gerunt natura<strong>le</strong> a donné<br />
naissance à un sentiment d’inimitié. Il y a là un travail de création de <strong>la</strong> part d’Ursin. Le taureau,<br />
de manière assez origina<strong>le</strong>, est présenté comme un animal doté d’humilité, qui se définit<br />
lui-même comme une brute, ressent comme une marque d’infériorité <strong>la</strong> supériorité intel<strong>le</strong>ctuel<strong>le</strong><br />
de l’homme <strong>et</strong> souffre de voir <strong>le</strong> p<strong>et</strong>it nombre de ressources médica<strong>le</strong>s qu’il est<br />
en mesure d’apporter 89 . Quand Ursin donne à ses animaux des traits individuels plus convenus,<br />
présents dans l’imagerie popu<strong>la</strong>ire, il compense <strong>la</strong> banalité du propos par un travail<br />
de <strong>la</strong> forme : si l’on regarde <strong>le</strong> <strong>loup</strong> par exemp<strong>le</strong>, il est caractérisé essentiel<strong>le</strong>ment par sa<br />
férocité ; mais Ursin ne se contente pas du <strong>le</strong>xique (praeda, carniuoro lupo) : il ajoute un<br />
dialogue dans <strong>le</strong>quel <strong>le</strong> <strong>loup</strong> feint de <strong>la</strong>isser Demarchus <strong>par<strong>le</strong>r</strong> à sa p<strong>la</strong>ce, car il est trop occupé<br />
à chasser pour perdre son temps en discours, ce qui donne vie <strong>et</strong> naturel à <strong>la</strong> présentation 90 .<br />
Le phénomène est plus sensib<strong>le</strong> encore dans <strong>le</strong> poème consacré au renard 91 , caractérisé<br />
de manière traditionnel<strong>le</strong> par <strong>la</strong> ruse <strong>et</strong> l’avidité : tout d’abord, <strong>le</strong> renard est <strong>le</strong> seul animal<br />
qui se présente avec un accessoire (induta cucul<strong>la</strong>m), <strong>et</strong>, plus qu’un accessoire, <strong>le</strong> capuchon<br />
apparaît comme un emblème de dissimu<strong>la</strong>tion <strong>et</strong> de ruse ; ensuite il est <strong>le</strong> seul qui appel<strong>le</strong><br />
des témoins : or ces témoins sont précisément ceux dont il compte se repaître, <strong>et</strong> un jeu<br />
d’assonances ([a]) <strong>et</strong> d’allitérations ([t]) semb<strong>le</strong> imiter <strong>le</strong>s cris <strong>et</strong> <strong>la</strong> précipitation des palmipèdes<br />
(adsint, anser, anas totaque turba alitum) ; il souligne lui-même sa réputation au moyen<br />
d’une allitération marquée (more meo mendacia), <strong>et</strong> a recours à une autre allitération, jointe<br />
aux homéoté<strong>le</strong>utes dans <strong>le</strong> vers suivant (p<strong>et</strong>o pro pr<strong>et</strong>io, pr<strong>et</strong>io étant mis en va<strong>le</strong>ur par <strong>la</strong><br />
penthémimère) lorsqu’il réc<strong>la</strong>me, ce qu’il est <strong>le</strong> seul à faire, une récompense en échange<br />
de ses informations (sed p<strong>et</strong>o pro precio sit mihi c<strong>la</strong>udus anas) ; il interrompt vite son discours<br />
pour se m<strong>et</strong>tre en chasse (Sed quid tanta loquor ? nox instat, tentat orexis/pectora) ; on peut<br />
noter <strong>la</strong> ponctuation forte, particulièrement expressive, à <strong>la</strong> penthémimère, <strong>le</strong>s allitérations<br />
en denta<strong>le</strong>s <strong>et</strong> en siff<strong>la</strong>ntes, <strong>la</strong> diérèse bucolique <strong>et</strong> <strong>le</strong> rej<strong>et</strong> de pectora. Enfin il est <strong>le</strong> seul à<br />
recourir à un système d’écho, puisque <strong>la</strong> demande de récompense exprimée au vers 4 est<br />
reprise au dernier vers, soulignant l’avidité <strong>et</strong> <strong>le</strong> caractère intéressé du renard mais aussi<br />
son habi<strong>le</strong>té, qui se manifeste ici sur <strong>le</strong> p<strong>la</strong>n de l’elocutio.<br />
89. Heu cedunt fortia cuncta uiro./O nimium foelix cui seruit quicquid in orbe est,/Quicquid uel tellus, uel<br />
maris unda fou<strong>et</strong>./Ob quem cuncta suos absoluunt sidera cursus/Ob quem dote sua belua nul<strong>la</strong> car<strong>et</strong>,<br />
<strong>«</strong> Hé<strong>la</strong>s, toutes <strong>le</strong>s puissances cèdent à l’homme. Trop heureux celui à qui obéit tout ce qui est au monde,<br />
sur <strong>la</strong> terre ou dans <strong>le</strong>s flots de <strong>la</strong> mer. C’est pour lui que tous <strong>le</strong>s astres accomplissent <strong>le</strong>ur course, pour<br />
lui que chaque animal a des vertus <strong>»</strong>.<br />
90. Dic uires, Demarche, meas, me praeda moratur,/Nam duo te referunt lustra fuisse lupum./Vos quos fama<br />
refert, nostram sumpsisse figuram/Dicite carniuoro gratia quanta lupo, <strong>«</strong> Dis mes qualités, Demarchus, je<br />
suis occupé à chasser ; à ce qu’on dit, en eff<strong>et</strong>, tu as été <strong>loup</strong> pendant deux lustres. Vous qui, selon <strong>la</strong><br />
légende, avez pris notre aspect, dites quel<strong>le</strong> grande reconnaissance on doit au <strong>loup</strong> carnivore <strong>»</strong>.<br />
91. Concionor nostras <strong>la</strong>udes induta cucul<strong>la</strong>m/Adsint, anser, anas, totaque turba alitum./Vera canam, nec<br />
more meo mendacia fingam/Sed p<strong>et</strong>o pro precio sit mihi c<strong>la</strong>udus anas […] Sed quid tanta loquor ? Nox<br />
instat, tentat orexis/Pectora. Pro precio sit mihi c<strong>la</strong>udus anas, <strong>«</strong> Couvert d’un capuchon, je proc<strong>la</strong>me mes<br />
vertus. Que m’assistent l’oie, <strong>le</strong> canard, toute <strong>la</strong> gent ailée. Je chanterai <strong>la</strong> vérité, <strong>et</strong>, contrairement à mon<br />
habitude, je n’inventerai pas de mensonges. Mais en récompense, je demande qu’on me donne un<br />
canard qui se dandine. […] Mais pourquoi tant <strong>par<strong>le</strong>r</strong> ? La nuit arrive, <strong>la</strong> faim <strong>fait</strong> gronder mes entrail<strong>le</strong>s.<br />
Qu’on me donne en récompense un canard qui se dandine <strong>»</strong>.<br />
Schedae, 2009, prépublication n°15, (fascicu<strong>le</strong> n°2, p.73-92).<br />
http://www.unicaen.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint0152009.pdf<br />
87
88<br />
Conclusion<br />
Jean Ursin a donc, dans sa Prosopeia, lié intimement l’animal <strong>et</strong> <strong>le</strong> savoir. L’œuvre a pour<br />
suj<strong>et</strong> <strong>le</strong> savoir médical sur <strong>le</strong>s animaux, mais, par <strong>le</strong> biais de <strong>la</strong> prosopopée, ce sont <strong>le</strong>s animaux<br />
eux-mêmes qui deviennent <strong>le</strong>s dispensateurs de ce savoir. Ce procédé perm<strong>et</strong> à Ursin de<br />
faire passer de manière agréab<strong>le</strong> un contenu médical fondé sur l’accumu<strong>la</strong>tion, parfois peu<br />
scientifique, qui n’a rien de novateur ; mais on comprend vite qu’il veut surtout m<strong>et</strong>tre en<br />
va<strong>le</strong>ur, par une mise en forme p<strong>la</strong>isante de c<strong>et</strong>te matière ingrate, ses dons de poète. Malgré<br />
toute <strong>la</strong> prudence avec <strong>la</strong>quel<strong>le</strong> il convient de prendre <strong>le</strong>s préfaces <strong>et</strong> <strong>la</strong> postface, ces<br />
textes perm<strong>et</strong>tent de percevoir qu’Ursin a connu une certaine gloire comme poète dans <strong>la</strong><br />
société viennoise <strong>et</strong> y a été considéré comme un novateur dans <strong>le</strong> domaine poétique 92 . La<br />
<strong>Prosopopeia</strong> a ses limites, notamment scientifiques ; mais il faut reconnaître qu’il s’agit<br />
d’une œuvre d’une certaine amp<strong>le</strong>ur, d’une grande érudition <strong>et</strong> très agréab<strong>le</strong> à lire en dépit<br />
de son caractère parfois obscur, grâce au procédé imaginé <strong>et</strong> fort habi<strong>le</strong>ment exploité par<br />
Ursin : faire <strong>par<strong>le</strong>r</strong> <strong>le</strong> cheval <strong>et</strong> <strong>répondre</strong> <strong>le</strong> chameau.<br />
Bibliographie<br />
Éditions<br />
PLINE L’ANCIEN (Ernout 1952), Histoire naturel<strong>le</strong>, livre VIII, A. Ernout (éd. <strong>et</strong> trad.), Paris, Les Bel<strong>le</strong>s L<strong>et</strong>tres<br />
(CUF).<br />
PLINE L’ANCIEN (Ernout 1962a), Histoire naturel<strong>le</strong>, livre XXVIII, A. Ernout (éd. <strong>et</strong> trad.), Paris, Les Bel<strong>le</strong>s L<strong>et</strong>tres<br />
(CUF).<br />
PLINE L’ANCIEN (Ernout 1962b), Histoire naturel<strong>le</strong>, livre XXIX, A. Ernout (éd. <strong>et</strong> trad.), Paris, Les Bel<strong>le</strong>s L<strong>et</strong>tres<br />
(CUF).<br />
PLINE L’ANCIEN (Ernout 1963), Histoire naturel<strong>le</strong>, livre XXX, A. Ernout (éd. <strong>et</strong> trad.), Paris, Les Bel<strong>le</strong>s L<strong>et</strong>tres<br />
(CUF).<br />
PLINE L’ANCIEN (Ernout 1966), Histoire naturel<strong>le</strong>, livre XXXII, A. Ernout (éd. <strong>et</strong> trad.), Paris, Les Bel<strong>le</strong>s L<strong>et</strong>tres<br />
(CUF).<br />
QUINTILIEN (Cousin 1978), Institution Oratoire, t. V, livres VIII <strong>et</strong> IX, J. Cousin (éd. <strong>et</strong> trad.), Paris, Les Bel<strong>le</strong>s<br />
L<strong>et</strong>tres (CUF).<br />
QUINTUS SERENUS (Pépin 1950), Liber Medicinalis, R. Pépin (éd. <strong>et</strong> trad.), Paris, PUF.<br />
SEXTI PLACITI PAPYRIENSIS, De medicamentis ex animalibus libellus, ant. Musae ad Moecenatem suum, de<br />
bona ua<strong>le</strong>tudine conseruanda instructio, MDXXXVIII.<br />
Études<br />
ADAMS J. N. (1982), The <strong>la</strong>tin sexual vocabu<strong>la</strong>ry, Londres, The John Hopkins University Press.<br />
ANDRÉ J. (1991), Le vocabu<strong>la</strong>ire <strong>la</strong>tin de l’anatomie, Paris, Les Bel<strong>le</strong>s L<strong>et</strong>tres.<br />
FONTANIER P. (1968), Les Figures du discours, Paris, F<strong>la</strong>mmarion.<br />
PINON L. (1995), Livres de <strong>la</strong> zoologie de <strong>la</strong> Renaissance, une anthologie, Paris, Klincksieck.<br />
POPLIN F. (1980), <strong>«</strong> À propos de deux col<strong>le</strong>ctions de croix (os) du cœur de Cerf des Princes de Condé <strong>et</strong><br />
de <strong>la</strong> couronne de France <strong>»</strong>, Vénerie, 57, p. 26-29.<br />
92. Stephanus Roybosius, l’éditeur, évoque Ursin avec lyrisme (Mirus po<strong>et</strong>a, eximius <strong>et</strong> bene fortunatus Medicus,<br />
Philosophus summus, Orator facundus) <strong>et</strong> attribue à son œuvre <strong>le</strong>s qualificatifs nobilis, insignis, <strong>et</strong> magni<br />
operis. Raymondus Aquaeus écrit : Is doctus, <strong>le</strong>pidus, foelici sidere natus/Huic pia Thespiadum turba ministrat<br />
aquas. Même Olivarius, plus réticent peut-être en ce qui concerne <strong>le</strong> p<strong>la</strong>n médical, se <strong>la</strong>isse al<strong>le</strong>r à<br />
saluer <strong>le</strong>s ta<strong>le</strong>nts littéraires de son confrère : non potui non <strong>la</strong>udare in primis hominis institutum, dein e<strong>le</strong>gantiam,<br />
festiuitatem <strong>et</strong> dexteritatem admirari. En ce qui concerne <strong>le</strong> caractère novateur de l’œuvre, Stephanus<br />
Roybosius écrit : <strong>et</strong> magni operis futuri nusquam ab aliquo antehac excogitati, renchérissant ainsi<br />
sur <strong>le</strong>s vers de Raymondus Aquaeus : Exprimit hic uarias animantum carmine dotes/Hactenus atque loqui<br />
quae tacuere iub<strong>et</strong>.<br />
Schedae, 2009, prépublication n°15, (fascicu<strong>le</strong> n°2, p. 73-92).<br />
http://www.unicaen.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint0152009.pdf
SABBAH G. (dir.) (1987), Bibliographie des textes médicaux <strong>la</strong>tins, Antiquité <strong>et</strong> haut Moyen Âge, Saint-<br />
Étienne, Publications de l’université de Saint-Étienne.<br />
SABBAH G. (dir.) (1991), Le <strong>la</strong>tin médical, <strong>la</strong> constitution d’un <strong>la</strong>ngage scientifique, Saint-Étienne,<br />
Publications de l’université de Saint-Étienne.<br />
VOISENET J. (2006), <strong>«</strong> L’animal <strong>et</strong> <strong>la</strong> pensée médica<strong>le</strong> dans <strong>le</strong>s textes du haut Moyen Âge <strong>»</strong>, in Actes du<br />
XXXVIIIe Congrès international de l’APLAES, A. ZUCKER <strong>et</strong> M.-C. OLIVI (éd.), Nice, Presses universitaires<br />
de Nice.<br />
Schedae, 2009, prépublication n°15, (fascicu<strong>le</strong> n°2, p.73-92).<br />
http://www.unicaen.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint0152009.pdf<br />
89
90<br />
Annexes<br />
Tab<strong>le</strong>au n° 1 : liste des animaux mentionnés dans <strong>la</strong> <strong>Prosopopeia</strong> aliquot<br />
animalium<br />
Animaux (24) Animaux qui n’ont pas de<br />
sang (26)<br />
Leo (18 vers)<br />
E<strong>le</strong>phas (10)<br />
Aper (18)<br />
Asinus (28)<br />
Capra (36)<br />
Caprea (16)<br />
Aries (12)<br />
Equa <strong>et</strong> equus (12)<br />
Camelus (16)<br />
Chame<strong>le</strong>on (12)<br />
Cata (10)<br />
Canis (24)<br />
Ceruus (36)<br />
Taurus (26)<br />
Vrsus (20)<br />
Lupus (24)<br />
Lepus (26)<br />
Vulpes (16)<br />
Castor (4)<br />
Cuniculus (4)<br />
Mustel<strong>la</strong> (6)<br />
Mus (20)<br />
Glis (4)<br />
Talpa (10)<br />
Buffo<br />
Millipes<br />
Vipera<br />
Cerastes<br />
Aspis<br />
Locusta<br />
Muscae<br />
Cicada<br />
Lumbrici terrestres<br />
Lumbrici ex uentre<br />
hominis<br />
Aranea<br />
Attotius<br />
Cimex<br />
Pu<strong>le</strong>x<br />
Scarabeus<br />
Cancer<br />
Stellio<br />
Draco<br />
Cantharis<br />
Limax<br />
Formica<br />
Stinchus<br />
Vermis in capite uirgae<br />
pastoris<br />
Vermis in raphano<br />
Rana<br />
Coluber<br />
Tab<strong>le</strong>au n° 2 : ma<strong>la</strong>dies mentionnées dans <strong>la</strong> <strong>Prosopopeia</strong> <strong>et</strong> <strong>le</strong>urs remèdes<br />
Schedae, 2009, prépublication n°15, (fascicu<strong>le</strong> n°2, p. 73-92).<br />
http://www.unicaen.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint0152009.pdf<br />
Oiseaux (25) Poissons (4) Insectes (2)<br />
Aqui<strong>la</strong><br />
Vultur<br />
Bubo<br />
Pauo<br />
Coruus<br />
Miluus<br />
Gallus<br />
Gallina<br />
Anser<br />
Anas<br />
Grus<br />
Turtur<br />
Palumbes<br />
Columba<br />
Cuculus<br />
Philome<strong>la</strong><br />
Galbu<strong>la</strong><br />
Hirundo<br />
Vpupa<br />
Passer<br />
Noctua<br />
Cornix<br />
Accipiter<br />
Perdix<br />
Pica<br />
Anguil<strong>la</strong><br />
Siren<br />
Delphinus<br />
Sepia<br />
Bombex<br />
Borax<br />
Problèmes <strong>et</strong> affections Remèdes<br />
Fièvres (quarte surtout) Lion (cœur), âne (sang), chameau (poils), caméléon<br />
(cœur), chat (griffes), cerf (chair), <strong>loup</strong> (œil), lièvre<br />
(cœur)<br />
Mal d’Hercu<strong>le</strong> ou mal sacré (épi<strong>le</strong>psie) Âne (foie, sabots, peau du front, sang), chèvre (chair),<br />
pou<strong>la</strong>in (hippomane), ours (fiel), lièvre (cœur), chevreuil<br />
(cervel<strong>le</strong>), bélier (testicu<strong>le</strong>s), chameau (cerveau),<br />
chien (excréments), renard (cervel<strong>le</strong>)<br />
Léthargie Sanglier (sang), chèvre (poils)<br />
Vertiges, tremb<strong>le</strong>ments Lièvre (cervel<strong>le</strong>, sang)<br />
Nervosité Lion (graisse), chèvre (excréments), ours (fiel), <strong>la</strong>pin<br />
(graisse)<br />
Troub<strong>le</strong>s du sommeil Chèvre (cornes)<br />
Tête Bélier (cornes), chameau (urine), cerf (cornes), <strong>loup</strong><br />
(tête)<br />
Vue Âne (yeux), chevreuil (fiel, foie), cerf (cornes), taureau<br />
(fiel), lièvre (fiel), souris (tête)<br />
Oreil<strong>le</strong>s, surdité Sanglier (urine), chèvre (sang), chevreuil (fiel), taureau<br />
(fiel)<br />
Ha<strong>le</strong>ine Âne (urine)<br />
Gorge Chevreuil (fiel), chat (excréments)
Dents Ânesse (<strong>la</strong>it), cheval (dent), chienne (<strong>la</strong>it), cerf (cornes),<br />
taupe (cendres)<br />
Cheveux (calvitie, canitie, poux, pellicu<strong>le</strong>s) Chèvre (cornes), chameau (urine), chien (urine), taureau<br />
(excréments), ours (suif), taupe (sang)<br />
Teint brouillé ou coloré Lion (graisse), éléphant (défenses), ânesse (<strong>la</strong>it),<br />
chevreuil (fiel), taureau (fiel, sang, pénis), lièvre (sang,<br />
foie)<br />
Affections de <strong>la</strong> peau/écrouel<strong>le</strong>s, lèpre Âne (graisse, foie), chameau (excréments), chien<br />
(urine), cerf (cornes), souris (sang), taupe (cendres)<br />
Piqûres, morsures Âne (excréments), chien (tête), taureau (fiel)<br />
Sciatique <strong>et</strong> dou<strong>le</strong>urs articu<strong>la</strong>ires Sanglier (excréments), chèvre (excréments)<br />
Hydropisie Sanglier (urine), ânesse (<strong>la</strong>it), chèvre (urine <strong>et</strong> suif,<br />
<strong>la</strong>it), chameau (urine), chien (excréments <strong>et</strong> vomissures)<br />
Hémorragies Âne (excréments), chèvre (sang <strong>et</strong> poils), lièvre (poils)<br />
P<strong>le</strong>urésie, phtisie Sanglier (défenses), ânesse (<strong>la</strong>it), cheval (excréments,<br />
salive), renard (poumon)<br />
Impuissance Cerf (testicu<strong>le</strong>s), <strong>loup</strong> (gueu<strong>le</strong>)<br />
Infertilité Éléphant (défenses), chèvre (urine, <strong>la</strong>it), jument (<strong>la</strong>it),<br />
cerf (cornes), lièvre (vulve, écume, cœur)<br />
Contraception Éléphant (excréments)<br />
Expulsion d’un fœtus Mort : cheval (graisse), chienne (<strong>la</strong>it) ; vivant : <strong>loup</strong><br />
(chair)<br />
Maux de vessie, calculs, reins Sanglier (vessie, urine), âne (urine), chat (reins), lièvre<br />
(excréments, sang), souris (excréments)<br />
Goutte Lion (graisse), chat (chair), chien (dents), lièvre (sang)<br />
Maux de ventre, diarrhée, dysenterie, constipation Ânesse (<strong>la</strong>it), chèvre (sang <strong>et</strong> excréments), chevreuil<br />
(rate), cheval (excréments), chameau (queue, excréments),<br />
chien (excréments, dents), cerf (cornes,<br />
moel<strong>le</strong>), taureau (fiel, moel<strong>le</strong>), lièvre (présure, foie)<br />
Ébriété Sanglier (poumons)<br />
Cancer Chien (tête)<br />
Schedae, 2009, prépublication n°15, (fascicu<strong>le</strong> n°2, p.73-92).<br />
http://www.unicaen.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint0152009.pdf<br />
91
Schedae, 2009, prépublication n°15, (fascicu<strong>le</strong> n°2, p.73-92).<br />
http://www.unicaen.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint0152009.pdf<br />
92