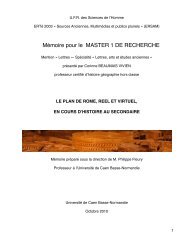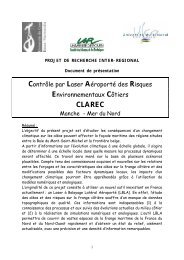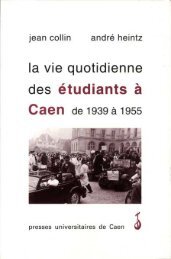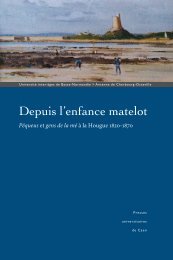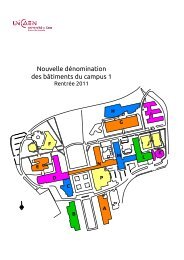La mise en valeur du patrimoine culturel par - Université de Caen ...
La mise en valeur du patrimoine culturel par - Université de Caen ...
La mise en valeur du patrimoine culturel par - Université de Caen ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Schedae<br />
Prépublications <strong>de</strong> l’<strong>Université</strong> <strong>de</strong> Ca<strong>en</strong> Basse-Normandie<br />
Prépublication n° 10 2008<br />
<strong>La</strong> <strong>mise</strong> <strong>en</strong> <strong>valeur</strong> <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong> <strong>culturel</strong><br />
<strong>par</strong> les nouvelles technologies<br />
Presses<br />
universitaires<br />
<strong>de</strong> Ca<strong>en</strong><br />
I
Schedae, 2008<br />
Prépublication n° 10<br />
<strong>La</strong> <strong>mise</strong> <strong>en</strong> <strong>valeur</strong> <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong> <strong>culturel</strong><br />
<strong>par</strong> les nouvelles technologies<br />
ERSAM – Sources Anci<strong>en</strong>nes, Multimédias et publics pluriels<br />
Statut : équipe <strong>de</strong> recherche technologique é<strong>du</strong>cation, <strong>Université</strong> <strong>de</strong> Ca<strong>en</strong> Basse-Normandie<br />
Directeur : Philippe Fleury<br />
Axes <strong>de</strong> recherches : l’objectif <strong>de</strong> l’ERSAM est <strong>de</strong> r<strong>en</strong>dre accessibles les sources anci<strong>en</strong>nes<br />
à <strong>de</strong> larges publics <strong>en</strong> utilisant les technologies multimédias. L’ERSAM réalise <strong>de</strong>s restitutions<br />
<strong>de</strong> monum<strong>en</strong>ts, <strong>de</strong> villes, <strong>de</strong> machines ou d’instrum<strong>en</strong>ts dans <strong>de</strong>s perspectives à fois<br />
sci<strong>en</strong>tifiques, pédagogiques et muséographiques, <strong>de</strong>s éditions électroniques, <strong>de</strong>s outils<br />
pédagogiques interactifs sur <strong>de</strong>s supports variés : web, DVD, CD-ROM…, sans négliger le<br />
support multimédia non virtuel que constitue la maquette réelle.<br />
III
Schedae, 2008<br />
Prépublication n° 10<br />
Sommaire<br />
<strong>La</strong> valorisation <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong> <strong>culturel</strong>, contexte et <strong>en</strong>jeux. . . . . . . . . . . . . . . . . 4<br />
Une approche complexe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4<br />
Les glissem<strong>en</strong>ts sémantiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4<br />
Patrimoine et politique : la construction d’une id<strong>en</strong>tité nationale. . . . . . 11<br />
Patrimoine et République : vers un <strong>patrimoine</strong> total . . . . . . . . . . . . . . . . 17<br />
Les <strong>en</strong>jeux <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25<br />
Une (nouvelle) manne économique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25<br />
Les cultes <strong>du</strong> <strong>culturel</strong> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31<br />
Pour une culture raisonnée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39<br />
<strong>La</strong> <strong>mise</strong> <strong>en</strong> <strong>valeur</strong> <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong> <strong>culturel</strong> <strong>par</strong> la réalité virtuelle . . . . . . . . . . . . . 44<br />
<strong>La</strong> réalité virtuelle appliquée à l’histoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44<br />
Vers un <strong>patrimoine</strong> <strong>du</strong>rable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44<br />
Une démarche rigoureuse et méthodique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51<br />
Les limites <strong>de</strong> l’outil virtuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55<br />
Les expéri<strong>en</strong>ces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58<br />
Vers l’écriture d’une histoire locale : le territoire saint-lois . . . . . . . . . . . 58<br />
Pour une nouvelle écriture <strong>de</strong> la gran<strong>de</strong> histoire . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
<strong>La</strong> restitution virtuelle <strong>de</strong> l’église Notre-Dame <strong>de</strong> Saint-Lô<br />
63<br />
et sa valorisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66<br />
Saint-Lô, une terre <strong>de</strong> <strong>patrimoine</strong> <strong>en</strong>tre histoire et mémoire . . . . . . . . .<br />
Une t<strong>en</strong>tative <strong>de</strong> <strong>mise</strong> <strong>en</strong> <strong>valeur</strong> <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong> bâti :<br />
66<br />
une approche novatrice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82<br />
Conclusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90<br />
Bibliographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92<br />
V
Schedae,<br />
2008<br />
Prépublication n° 10<br />
<strong>La</strong> <strong>mise</strong> <strong>en</strong> <strong>valeur</strong> <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong> <strong>culturel</strong><br />
<strong>par</strong> les nouvelles technologies<br />
Marie-Pierre Besnard<br />
Chef <strong>du</strong> dé<strong>par</strong>tem<strong>en</strong>t Services et Réseaux <strong>de</strong> Communication et responsable <strong>de</strong> la lic<strong>en</strong>ce professionnelle D2PC<br />
“Développem<strong>en</strong>t et Protection <strong>du</strong> Patrimoine Culturel – option réalité virtuelle et formation multimédia”<br />
IUT Cherbourg Manche, Site <strong>de</strong> Saint-Lô<br />
marie-pierre.besnard@unica<strong>en</strong>.fr<br />
Résumé :<br />
À la lumière <strong>du</strong> double processus d’une marchandisation croissante <strong>de</strong> la culture et <strong>du</strong> passage<br />
au tout numérique qui bouleverse notre rapport au matériel et au s<strong>en</strong>sible, il convi<strong>en</strong>t pour l’historiographe<br />
d’interroger la démarche <strong>de</strong> <strong>mise</strong> <strong>en</strong> <strong>valeur</strong> <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong> <strong>culturel</strong> <strong>par</strong> les nouvelles<br />
technologies. Prés<strong>en</strong>té sous sa première forme dans un mémoire <strong>de</strong> Master 2, ce texte propose<br />
un état <strong>de</strong>s lieux sur la question.<br />
Abstract :<br />
In the light of the <strong>du</strong>al course of an evergrowing marketization of culture and the shift to an all digital<br />
world which upsets our very link to the what is material and tangible, the historiographer must<br />
question the process of <strong>en</strong>hancing the cultural heritage thanks to new technologies. First pres<strong>en</strong>ted<br />
as “Master 2 recherche” resume, the following study pres<strong>en</strong>ts a wi<strong>de</strong>spread insight to the subject.<br />
Le prés<strong>en</strong>t travail est le résultat d’un cheminem<strong>en</strong>t personnel et professionnel débutant<br />
à l’<strong>Université</strong> <strong>de</strong> Ca<strong>en</strong> où nous avons rédigé un mémoire <strong>de</strong> maîtrise d’Histoire médiévale,<br />
dirigé <strong>par</strong> feu le Professeur André Debord. L’étu<strong>de</strong> portait sur le temporel d’une abbaye, celle<br />
1<br />
<strong>de</strong> Saint-Éti<strong>en</strong>ne-<strong>de</strong>-Font<strong>en</strong>ay, près <strong>de</strong> Ca<strong>en</strong> . En réalité, si nous avons acquis <strong>du</strong>rant cette<br />
année <strong>de</strong> recherches une métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> travail qui <strong>de</strong>meure vali<strong>de</strong> aujourd’hui, nous avons<br />
surtout développé un intérêt, jamais dém<strong>en</strong>ti <strong>de</strong>puis, pour l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’importance <strong>culturel</strong>le<br />
<strong>de</strong> l’Église dans la construction <strong>de</strong>s repères <strong>de</strong>s hommes, et <strong>de</strong> l’id<strong>en</strong>tité <strong>de</strong>s territoires.<br />
Dev<strong>en</strong>ue <strong>en</strong>seignante dans le secondaire, d’abord <strong>en</strong> lycée professionnel <strong>en</strong> banlieue<br />
<strong>par</strong>isi<strong>en</strong>ne, mutée <strong>en</strong>suite dans un collège rural <strong>de</strong> la Manche, puis dans un lycée d’<strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>t<br />
général <strong>de</strong> c<strong>en</strong>tre-ville à Saint-Lô, nous avons approché <strong>de</strong>s publics d’élèves très<br />
différ<strong>en</strong>ts, socialem<strong>en</strong>t et <strong>culturel</strong>lem<strong>en</strong>t. Au fil <strong>de</strong>s années, nous nous sommes interrogée<br />
sur l’approche <strong>culturel</strong>le <strong>de</strong> l’histoire religieuse dans les programmes d’Histoire, sur le s<strong>en</strong>s<br />
<strong>de</strong>s métho<strong>de</strong>s préconisées, et sur l’interprétation relayée <strong>par</strong> les manuels scolaires. De façon<br />
1. Le temporel <strong>de</strong> l’Abbaye <strong>de</strong> Saint-Éti<strong>en</strong>ne <strong>de</strong> Font<strong>en</strong>ay, esquisse d’une histoire économique et sociale,<br />
<strong>Université</strong> <strong>de</strong> Ca<strong>en</strong>, 1993, 204 pages.<br />
Marie-Pierre Besnard<br />
« <strong>La</strong> <strong>mise</strong> <strong>en</strong> <strong>valeur</strong> <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong> <strong>culturel</strong> <strong>par</strong> les nouvelles technologies »<br />
Schedae,<br />
2008, prépublication n°10, (p. 1-96).<br />
1
2<br />
plus précise, nous nous sommes <strong>de</strong>mandé dans quelle mesure cet <strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>t revêtait<br />
<strong>en</strong>core un caractère indisp<strong>en</strong>sable. De notre point <strong>de</strong> vue, la réponse est incontestablem<strong>en</strong>t<br />
positive, ce qui justifie le prés<strong>en</strong>t projet. L’expéri<strong>en</strong>ce acquise sur le terrain pédagogique<br />
nous est d’une ai<strong>de</strong> précieuse pour sa construction.<br />
Aujourd’hui responsable <strong>de</strong> la Lic<strong>en</strong>ce professionnelle « Développem<strong>en</strong>t et Protection<br />
<strong>du</strong> Patrimoine Culturel – option réalité virtuelle et formation multimédia » (LP D2PC) à l’IUT<br />
Cherbourg Manche, site <strong>de</strong> Saint-Lô, nous sommes au cœur <strong>de</strong> la problématique. Il nous<br />
est possible <strong>de</strong> r<strong>en</strong>dre compte <strong>de</strong> la question <strong>de</strong> la <strong>mise</strong> <strong>en</strong> <strong>valeur</strong> <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong> <strong>culturel</strong><br />
<strong>par</strong> les nouvelles technologies, à la fois <strong>du</strong> point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong> la formation <strong>de</strong> jeunes professionnels<br />
et <strong>de</strong> celui <strong>de</strong>s acteurs politiques locaux, dans une ville, et plus largem<strong>en</strong>t dans un<br />
dé<strong>par</strong>tem<strong>en</strong>t, riches d’une longue tradition historique et <strong>du</strong>rem<strong>en</strong>t frappés <strong>par</strong> la secon<strong>de</strong><br />
guerre mondiale. C’est dans ce cadre que nous avons r<strong>en</strong>contré le Professeur Philippe Fleury.<br />
Il a souhaité que la formation intègre le CIREVE (C<strong>en</strong>tre Interdisciplinaire <strong>de</strong> Réalité Virtuelle)<br />
naissant, et, fait déterminant pour nous, il a accepté que nous rejoignions l’équipe <strong>du</strong> « Plan<br />
<strong>de</strong> Rome », au nom <strong>de</strong> l’interdisciplinarité autour <strong>de</strong> la réalité virtuelle.<br />
De façon assez naturelle, le sujet traité <strong>de</strong>vait croiser les chemins <strong>par</strong>courus et proposer<br />
une métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>mise</strong> <strong>en</strong> <strong>valeur</strong> <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong> <strong>culturel</strong> <strong>par</strong> la réalité virtuelle, métho<strong>de</strong> inscrite<br />
dans un territoire et appliquée à l’église Notre-Dame <strong>de</strong> Saint-Lô. <strong>La</strong> logique <strong>du</strong> <strong>par</strong>cours,<br />
les r<strong>en</strong>contres, les opportunités ne saurai<strong>en</strong>t à elles seules justifier le choix sci<strong>en</strong>tifique. Les<br />
tâches accomplies dans le cadre <strong>de</strong> la LP D2PC nous offr<strong>en</strong>t la possibilité d’appréh<strong>en</strong><strong>de</strong>r les<br />
réalités <strong>de</strong> terrain dans le domaine <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong> <strong>culturel</strong> et ses rapports nouveaux avec la<br />
réalité virtuelle. Elles nous démontr<strong>en</strong>t chaque jour davantage la nécessité d’ancrer cette<br />
thématique dans le champ <strong>de</strong> la recherche universitaire.<br />
On ne peut plus feindre d’ignorer combi<strong>en</strong> la culture est vecteur d’espoir pour ses acteurs.<br />
Associée au tourisme, elle est <strong>mise</strong> <strong>en</strong> avant comme un facteur déterminant <strong>de</strong> développem<strong>en</strong>t<br />
local et ti<strong>en</strong>t une place <strong>de</strong>v<strong>en</strong>ue souv<strong>en</strong>t non négligeable <strong>en</strong> matière d’aménagem<strong>en</strong>t<br />
<strong>du</strong> territoire. Longtemps restée l’apanage d’une élite sociale et <strong>de</strong>s pouvoirs c<strong>en</strong>traux, et<br />
<strong>du</strong> même coup plutôt <strong>par</strong>isi<strong>en</strong>ne, la préoccupation <strong>culturel</strong>le est tombée progressivem<strong>en</strong>t<br />
dans le giron <strong>de</strong>s collectivités locales. Celles-ci s’interrog<strong>en</strong>t avec <strong>de</strong> plus <strong>en</strong> plus d’acuité<br />
sur les aspirations <strong>de</strong> publics sans lesquels elles ne sont ri<strong>en</strong> et qui n’ont que l’embarras <strong>du</strong><br />
choix d’une offre toujours plus nombreuse et diversifiée. Toutefois, force est <strong>de</strong> constater<br />
que, malgré l’<strong>en</strong>thousiasme affiché, elles ne dispos<strong>en</strong>t pas toujours <strong>de</strong>s moy<strong>en</strong>s matériels et<br />
humains adéquats et souffr<strong>en</strong>t <strong>en</strong>core d’un manque <strong>de</strong> cohér<strong>en</strong>ce dans les décisions prises.<br />
À cet égard, l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s politiques <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong> constitue un observatoire <strong>de</strong> premier<br />
choix, que leur échelle soit nationale ou locale. De son acception originale à l’élargissem<strong>en</strong>t<br />
qu’il connaît aujourd’hui jusque dans les confins <strong>de</strong> l’immatériel, le <strong>patrimoine</strong> est <strong>de</strong>v<strong>en</strong>u<br />
l’interface privilégiée <strong>de</strong> la culture et <strong>de</strong> la mémoire. Parce qu’il semble s’inscrire dans une<br />
dynamique proche <strong>de</strong> l’emballem<strong>en</strong>t, <strong>par</strong>ce qu’il est <strong>de</strong>v<strong>en</strong>u le prétexte d’incessantes commémorations,<br />
il nous oblige à nous interroger sur le s<strong>en</strong>s <strong>de</strong> l’Histoire qui s’écrit sous nos yeux,<br />
et sur celui <strong>de</strong>s symboles véhiculés à grand train, à l’heure d’Internet et <strong>du</strong> tout numérique.<br />
Sa <strong>mise</strong> <strong>en</strong> <strong>valeur</strong> <strong>par</strong> les nouvelles technologies pose <strong>de</strong>s questions lour<strong>de</strong>s <strong>de</strong> s<strong>en</strong>s.<br />
Il s’agit d’une <strong>par</strong>t <strong>de</strong> placer <strong>en</strong> exergue un <strong>patrimoine</strong> bâti, préservé, restauré à grands<br />
frais – et dans un cadre administratif et juridique très contraignant. Plus que jamais considéré<br />
comme la pierre angulaire et l’incarnation d’un passé commun, d’une id<strong>en</strong>tité politique,<br />
il est l’objet d’une véritable vénération. D’autre <strong>par</strong>t, <strong>de</strong>v<strong>en</strong>u <strong>culturel</strong>, le <strong>patrimoine</strong><br />
est <strong>de</strong>puis quelques années soumis au développem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> pro<strong>du</strong>its dérivés, cédéroms et<br />
dévédéroms <strong>en</strong> tête, <strong>de</strong>stinés à pré<strong>par</strong>er, accompagner ou approfondir une év<strong>en</strong>tuelle visite.<br />
Ceci revi<strong>en</strong>t à dire que l’on procè<strong>de</strong> à ce sta<strong>de</strong> à une dématérialisation <strong>de</strong> la trace patrimoniale.<br />
On passe alors <strong>du</strong> mon<strong>de</strong> réel au mon<strong>de</strong> virtuel. C’est la question <strong>de</strong> la représ<strong>en</strong>tation<br />
et <strong>de</strong> ses cont<strong>en</strong>us qui est à examiner ici.<br />
Schedae,<br />
2008, prépublication n°10, (p. 1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf
<strong>La</strong> technologie permet aujourd’hui <strong>de</strong> t<strong>en</strong>ter <strong>de</strong> concilier ces <strong>de</strong>ux mon<strong>de</strong>s ap<strong>par</strong>emm<strong>en</strong>t<br />
antinomiques, voire antagonistes, sous l’appellation « réalité virtuelle ». <strong>La</strong> notion est<br />
sémantiquem<strong>en</strong>t complexe à démêler, mais les <strong>en</strong>jeux qui y sont attachés – tant <strong>en</strong> termes<br />
économiques que <strong>du</strong> point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong> la transmission d’un savoir visant à la construction d’une<br />
mémoire indivi<strong>du</strong>elle et collective –, sont <strong>en</strong> passe <strong>de</strong> <strong>de</strong>v<strong>en</strong>ir tellem<strong>en</strong>t importants que la<br />
communauté sci<strong>en</strong>tifique n’a d’autre choix que <strong>de</strong> s’em<strong>par</strong>er <strong>de</strong> ce nouvel outil pour ne pas<br />
le laisser <strong>de</strong>v<strong>en</strong>ir la proie <strong>de</strong> la seule logique économique, toujours prompte à exploiter les<br />
secteurs porteurs.<br />
Loin <strong>de</strong> constituer une m<strong>en</strong>ace pour les sci<strong>en</strong>ces humaines, la réalité virtuelle doit <strong>de</strong>v<strong>en</strong>ir<br />
un atout inestimable pour le chercheur. Elle donne aux mots une interprétation et une<br />
tra<strong>du</strong>ction <strong>en</strong> images. Elle peut légitimem<strong>en</strong>t, <strong>en</strong> tant qu’outil, prét<strong>en</strong>dre proposer au public<br />
visé une autre visite <strong>du</strong> lieu, dans un espace/temps (re) défini sci<strong>en</strong>tifiquem<strong>en</strong>t <strong>par</strong> le support.<br />
Grâce au développem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> techniques performantes, celles <strong>de</strong> l’immersion et <strong>de</strong> la stéréoscopie,<br />
elle permet à l’utilisateur <strong>de</strong> se rapprocher d’un mon<strong>de</strong> s<strong>en</strong>sible.<br />
Par ailleurs, les questions que soulève l’interactivité sont extrêmem<strong>en</strong>t intéressantes<br />
dans la mesure où elles amèn<strong>en</strong>t le concepteur, autrem<strong>en</strong>t appelé « émetteur » dans le schéma<br />
<strong>de</strong> la communication, à considérer que le pro<strong>du</strong>it <strong>culturel</strong> est <strong>de</strong>stiné à un « récepteur », soit<br />
à un public, et que l’un ne va plus sans l’autre. Si le message, ici lié au s<strong>en</strong>s évocateur <strong>du</strong><br />
<strong>patrimoine</strong> <strong>culturel</strong>, est transmis dans un langage – ou co<strong>de</strong> – ad hoc,<br />
il a toutes ses chances<br />
<strong>de</strong> connaître l’heur d’un franc succès. En ce s<strong>en</strong>s, on peut se pr<strong>en</strong>dre à croire que c’est<br />
une métho<strong>de</strong> qui permet <strong>de</strong> travailler dans le s<strong>en</strong>s d’une démocratisation plus gran<strong>de</strong> <strong>du</strong><br />
savoir et <strong>de</strong> la culture, sujet s<strong>en</strong>sible et toujours <strong>en</strong> débat <strong>de</strong>puis les années 1950. Il s’agit<br />
<strong>en</strong> quelque sorte <strong>de</strong> trouver le bon équilibre et <strong>de</strong> redonner sa juste place à la dim<strong>en</strong>sion<br />
technologique <strong>du</strong> travail. Surtout, il ne faut pas confondre la fin et les moy<strong>en</strong>s. Conçue à<br />
<strong>par</strong>tir d’un cahier <strong>de</strong>s charges établi sur la base d’un dossier sci<strong>en</strong>tifique, une borne interactive,<br />
puisque c’est l’objectif à atteindre, n’a pas pour vocation <strong>de</strong> se substituer à l’espace<br />
physique représ<strong>en</strong>té et développé – lorsque celui-ci est existant, comme c’est la cas pour<br />
l’église Notre-Dame <strong>de</strong> Saint-Lô.<br />
Le choix <strong>de</strong> faire porter l’étu<strong>de</strong> <strong>du</strong> cas sur le <strong>patrimoine</strong> <strong>culturel</strong> <strong>de</strong> la ville <strong>de</strong> Saint-Lô<br />
se justifie à maints égards. Terre d’histoire baptisée « capitale <strong>de</strong>s ruines » après sa <strong>de</strong>struction<br />
presque totale <strong>par</strong> les bombar<strong>de</strong>m<strong>en</strong>ts <strong>de</strong>s Alliés <strong>en</strong> 1944, « la jolie lai<strong>de</strong> » s’est forgé une<br />
id<strong>en</strong>tité <strong>de</strong> ville martyre. Les choix opérés pour sa reconstruction font <strong>en</strong>core aujourd’hui porter<br />
au <strong>patrimoine</strong> saint-lois les stigmates <strong>de</strong> l’Histoire. Ainsi, le projet <strong>de</strong> réalisation d’une<br />
borne interactive se doit <strong>de</strong> t<strong>en</strong>ir compte <strong>de</strong>s « vérités » historiques, aussi bi<strong>en</strong> que <strong>de</strong>s<br />
<strong>en</strong>jeux <strong>culturel</strong>s d’une ville mo<strong>de</strong>rne. C’est d’autant plus vrai dans le cas prés<strong>en</strong>t que la ville<br />
<strong>de</strong> Saint-Lô affirme avec force sa volonté <strong>de</strong> s’affranchir <strong>de</strong> cette image longtemps <strong>en</strong>tret<strong>en</strong>ue<br />
mais jugée aujourd’hui comme ap<strong>par</strong>t<strong>en</strong>ant à un passé révolu.<br />
L’église Notre-Dame est probablem<strong>en</strong>t le monum<strong>en</strong>t saint-lois qui offre le panel d’interrogations<br />
le plus large autour <strong>de</strong>s <strong>en</strong>jeux <strong>de</strong> la <strong>mise</strong> <strong>en</strong> <strong>valeur</strong> <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong> <strong>culturel</strong> <strong>par</strong> les<br />
nouvelles technologies. Construite au Moy<strong>en</strong>-Âge, et souv<strong>en</strong>t considérée à tort comme<br />
une cathédrale, détruite p<strong>en</strong>dant la Secon<strong>de</strong> Guerre Mondiale, elle fut reconstruite <strong>par</strong> un<br />
architecte audacieux, Yves-Marie Froi<strong>de</strong>vaux, mêlant tradition et mo<strong>de</strong>rnité. Amputée <strong>de</strong><br />
ses flèches, re<strong>de</strong>v<strong>en</strong>ue lieu <strong>de</strong> culte, elle pr<strong>en</strong>d <strong>valeur</strong> allégorique. C’est donc meurtrie<br />
dans sa chair, et dans une atmosphère <strong>de</strong> contestation, qu’elle r<strong>en</strong>aît à la vie, dans un<br />
mon<strong>de</strong> laïque et profane, mais qui accor<strong>de</strong> une <strong>valeur</strong> sacrée, et <strong>par</strong> la même figée, à son<br />
<strong>patrimoine</strong> religieux. Le <strong>par</strong>adoxe est tel qu’aujourd’hui il n’est plus <strong>en</strong>visageable, raisonnablem<strong>en</strong>t,<br />
<strong>de</strong> reconstruire l’église à l’id<strong>en</strong>tique <strong>de</strong> ce qu’elle était avant les bombar<strong>de</strong>m<strong>en</strong>ts.<br />
C’est dans sa nouvelle physionomie qu’elle porte le souv<strong>en</strong>ir et ap<strong>par</strong>aît recevable<br />
aujourd’hui. Il est communém<strong>en</strong>t admis que c’est ainsi qu’elle doit être trans<strong>mise</strong> aux<br />
générations futures.<br />
Schedae,<br />
2008, prépublication n°10, (p.1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf<br />
3
4<br />
Des t<strong>en</strong>tatives <strong>de</strong> restitution ont vu le jour avant la nôtre : restitution éphémère dans son<br />
état d’avant-guerre <strong>de</strong> la faça<strong>de</strong> <strong>en</strong> trompe l’œil sur une bâche <strong>par</strong> l’artiste Bruno Dufoure<br />
Coppolani à l’occasion <strong>de</strong>s commémorations <strong>du</strong> 50 anniversaire <strong>du</strong> Débarquem<strong>en</strong>t ; plus<br />
récemm<strong>en</strong>t reconstruction et visite virtuelles <strong>de</strong>s rues <strong>de</strong> Saint-Lô <strong>par</strong> l’Association « Saint-Lô<br />
Retrouvé ». D’autres événem<strong>en</strong>ts comme un colloque sur les villes <strong>de</strong> la Reconstruction ou un<br />
projet ample <strong>de</strong> coloration <strong>de</strong> faça<strong>de</strong>s marqu<strong>en</strong>t la volonté sincère <strong>de</strong> la Ville <strong>de</strong> Saint-Lô<br />
<strong>de</strong> s’interroger sur ses nouveaux visages. L’<strong>en</strong>thousiasme manifesté <strong>par</strong> le Maire François<br />
Digard et le Père Daniel Jamelot autour <strong>de</strong> la restitution virtuelle sur une borne in situ <strong>de</strong><br />
l’église d’avant guerre ne font que r<strong>en</strong>forcer notre propre détermination à voir le projet aboutir.<br />
C’est dans ce contexte général que s’inscrit l’étu<strong>de</strong> qui suit. <strong>La</strong> métho<strong>de</strong> ret<strong>en</strong>ue ne<br />
semble pas souffrir d’alternative. Elle est avant tout celle d’une histori<strong>en</strong>ne confrontée pour<br />
la constitution <strong>du</strong> dossier sci<strong>en</strong>tifique à la difficulté <strong>de</strong> réunir un corpus docum<strong>en</strong>taire significatif,<br />
les Archives dé<strong>par</strong>tem<strong>en</strong>tales <strong>de</strong> la Manche ayant brûlé p<strong>en</strong>dant les bombar<strong>de</strong>m<strong>en</strong>ts<br />
<strong>de</strong> juin 1944. Si le bâtim<strong>en</strong>t <strong>de</strong>meure, les docum<strong>en</strong>ts retraçant son histoire sont peu nombreux,<br />
souv<strong>en</strong>t lacunaires ou laconiques, é<strong>par</strong>pillés et pour nombre d’<strong>en</strong>tre eux sujets à caution.<br />
Rassemblés et étudiés avec pati<strong>en</strong>ce et rigueur, ils constitueront le matériau indisp<strong>en</strong>sable<br />
<strong>de</strong> l’écriture, d’abord d’une histoire puis d’un scénario. Si grammaticalem<strong>en</strong>t les <strong>de</strong>ux étapes<br />
ci-<strong>de</strong>ssus citées support<strong>en</strong>t d’être accolées dans une phrase simple, la réalité <strong>de</strong> la démarche<br />
suppose un cheminem<strong>en</strong>t plus complexe. <strong>La</strong> seule étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’histoire <strong>du</strong> monum<strong>en</strong>t vi<strong>en</strong>drait<br />
contredire les propos ci-<strong>de</strong>ssus t<strong>en</strong>us sur les vertus <strong>de</strong> la médiation <strong>culturel</strong>le. Et sa restitution<br />
ne prés<strong>en</strong>terait d’intérêt que <strong>du</strong> point <strong>de</strong> vue technique. L’excès inverse revi<strong>en</strong>drait à proposer<br />
un pro<strong>du</strong>it au seul caractère ludique, qui serait démagogique et faussem<strong>en</strong>t pédagogique.<br />
Le prés<strong>en</strong>t travail se propose d’être une étu<strong>de</strong> pré<strong>par</strong>atoire à la thèse <strong>de</strong> Doctorat qui<br />
suivra. Il est un temps important dans notre démarche qui consiste à appréh<strong>en</strong><strong>de</strong>r le <strong>patrimoine</strong><br />
dans un contexte plus général <strong>du</strong> point <strong>de</strong> vue spatio-temporel. Au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> ses évolutions<br />
sémantiques, indisp<strong>en</strong>sables pour cerner le sujet, c’est dans son acceptation <strong>culturel</strong>le<br />
que sa <strong>mise</strong> <strong>en</strong> <strong>valeur</strong> pr<strong>en</strong>d tout son s<strong>en</strong>s. Elle oblige à bi<strong>en</strong> connaître l’évolution <strong>de</strong> son<br />
histoire et <strong>de</strong>s politiques qui l’accompagn<strong>en</strong>t, à bi<strong>en</strong> délimiter les contours d’une notion<br />
complexe et <strong>en</strong> constant élargissem<strong>en</strong>t. Elle oblige aussi à mieux compr<strong>en</strong>dre les <strong>en</strong>jeux<br />
qui l’<strong>en</strong>tour<strong>en</strong>t, qu’ils soi<strong>en</strong>t, économiques, <strong>culturel</strong>s ou sci<strong>en</strong>tifiques. Grâce à cet exam<strong>en</strong>,<br />
nous pourrons réfléchir sur le rôle indisp<strong>en</strong>sable que l’histori<strong>en</strong> doit jouer dans l’ère <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong><br />
<strong>culturel</strong> virtuel: nourrissant la démarche <strong>de</strong> son savoir et <strong>de</strong> ses métho<strong>de</strong>s <strong>de</strong> travail, il<br />
doit aussi apprivoiser un outil dont l’usage ne lui est pas familier. Nous verrons égalem<strong>en</strong>t<br />
que la réalité virtuelle n’a pas <strong>de</strong> vertus miraculeuses et que, comme toute application sci<strong>en</strong>tifique,<br />
elle comporte <strong>de</strong>s limites. C’est sur la base <strong>de</strong> l’analyse d’expéri<strong>en</strong>ces déjà m<strong>en</strong>ées,<br />
et plus <strong>par</strong>ticulièrem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> celle <strong>de</strong> l’équipe <strong>du</strong> Plan <strong>de</strong> Rome, que nous t<strong>en</strong>terons d’élaborer<br />
<strong>de</strong> notre projet <strong>de</strong> réalisation <strong>de</strong> la reconstruction virtuelle <strong>de</strong> l’église Notre-Dame <strong>de</strong><br />
Saint-Lô. Projet novateur qui s’inscrit dans un cadre territorial riche d’histoire et <strong>de</strong> tragédies,<br />
il met <strong>en</strong> lumière le monum<strong>en</strong>t phare <strong>de</strong> la ville reconstruite, tout ceci n’étant r<strong>en</strong><strong>du</strong> possible<br />
que <strong>par</strong> l’exploitation juste <strong>de</strong>s sources que nous aurons <strong>mise</strong>s au jour.<br />
<strong>La</strong> valorisation <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong> <strong>culturel</strong>, contexte et <strong>en</strong>jeux<br />
Une approche complexe<br />
Les glissem<strong>en</strong>ts sémantiques<br />
Avant d’<strong>en</strong>visager le <strong>patrimoine</strong> comme objet d’étu<strong>de</strong>, il convi<strong>en</strong>t <strong>de</strong> s’arrêter sur la<br />
2<br />
question <strong>de</strong> sa définition. Au s<strong>en</strong>s étymologique, et si l’on s’<strong>en</strong> réfère au dictionnaire Littré ,<br />
2. Littré Dictionnaire <strong>de</strong> la <strong>La</strong>ngue française, 1866, p. 1560.<br />
Schedae,<br />
2008, prépublication n°10, (p. 1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf
<strong>en</strong> 1866, il est un « bi<strong>en</strong> d’héritage qui <strong>de</strong>sc<strong>en</strong>d, suivant les lois, <strong>de</strong>s pères et mères à leurs<br />
<strong>en</strong>fants ». On mesure dans la simplicité <strong>de</strong> la formulation toute la complexité <strong>de</strong> la notion.<br />
En effet, soumis aux lois, le <strong>patrimoine</strong> voit sa réalité intrinsèquem<strong>en</strong>t corrélée à l’évolution<br />
<strong>de</strong>s sociétés. Et si Françoise Choay peut écrire « ce beau et très anci<strong>en</strong> mot était, à l’origine,<br />
lié aux structures économiques et juridiques d’une société stable, <strong>en</strong>racinée dans l’espace<br />
3<br />
et dans le temps » , cette définition ne peut s’appliquer qu’à un instantané : les sociétés les<br />
plus stables ne sont pas immobiles, et bi<strong>en</strong> que fixées, les coutumes ne sont jamais figées.<br />
En compulsant les dictionnaires, <strong>de</strong>s plus anci<strong>en</strong>s aux plus réc<strong>en</strong>ts, <strong>de</strong>s plus savants aux plus<br />
populaires, l’article « <strong>patrimoine</strong> » évoque toujours, à la nuance près, cette même notion<br />
d’héritage, <strong>de</strong> transmission <strong>de</strong>s bi<strong>en</strong>s aux <strong>de</strong>sc<strong>en</strong>dants.<br />
L’objet n’est pas ici <strong>de</strong> dresser un inv<strong>en</strong>taire <strong>de</strong>s définitions collectées. On <strong>en</strong> trouve<br />
4<br />
chez beaucoup d’auteurs et notre propos vi<strong>en</strong>drait répéter ce qui s’est fait sans ri<strong>en</strong> ajouter<br />
<strong>de</strong> pertin<strong>en</strong>t. En revanche, il est intéressant <strong>de</strong> se questionner sur le s<strong>en</strong>s donné au terme<br />
dans d’autres langues et ainsi <strong>de</strong> constater que la définition n’est pas, loin s’<strong>en</strong> faut, univer-<br />
5<br />
selle. Mariannick Jadé propose une étu<strong>de</strong> riche et fort intéressante <strong>du</strong> mot « <strong>patrimoine</strong> »<br />
qu’elle place <strong>en</strong> perspective avec ses synonymes étrangers. Repr<strong>en</strong>ant les travaux <strong>de</strong> André<br />
Desvallées, elle invite à se méfier <strong>de</strong>s transpositions systématiques. On compr<strong>en</strong>d <strong>en</strong> quelques<br />
phrases la difficulté <strong>du</strong> passage d’une langue à l’autre pour définir une réalité, presque<br />
6<br />
une id<strong>en</strong>tité <strong>culturel</strong>le . Si nous nous arrêtons plus <strong>par</strong>ticulièrem<strong>en</strong>t sur la langue anglaise,<br />
la com<strong>par</strong>aison <strong>en</strong>tre « <strong>patrimoine</strong> » et « heritage » montre que pour définir précisém<strong>en</strong>t le<br />
mot français, dans son s<strong>en</strong>s français, la langue anglaise ne peut se cont<strong>en</strong>ter <strong>du</strong> seul terme<br />
d’« heritage ». On y trouve bi<strong>en</strong> la dim<strong>en</strong>sion <strong>de</strong> « bi<strong>en</strong> public ». Concernant la sphère privée,<br />
il faudra préférer tra<strong>du</strong>ire « <strong>patrimoine</strong> » <strong>par</strong> legacy.<br />
L’histoire, la culture et la langue sav<strong>en</strong>t<br />
affirmer leur singularité dans une même aire civilisationnelle et plai<strong>de</strong>r pour la pluralité linguistique.<br />
Le temps et l’espace vi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t ainsi faire évoluer le s<strong>en</strong>s <strong>du</strong> terme, ce qui est fort<br />
intéressant pour notre étu<strong>de</strong>.<br />
À considérer le seul territoire français, on constate au fil <strong>de</strong> l’histoire un glissem<strong>en</strong>t <strong>de</strong><br />
s<strong>en</strong>s évocateur. Héritées <strong>de</strong> l’Empire romain, les premières lois sur la transmission patrimoniale<br />
favorisai<strong>en</strong>t d’une <strong>par</strong>t l’aîné <strong>par</strong> rapport à ses ca<strong>de</strong>ts, d’autre <strong>par</strong>t les fils <strong>par</strong> rapport<br />
e<br />
aux filles. <strong>La</strong> Loi salique, établie au IV siècle <strong>par</strong> les Francs, actait qu’aucune <strong>par</strong>tie <strong>de</strong> l’héritage<br />
ne revi<strong>en</strong>ne à une femme, mais qu’il passe tout <strong>en</strong>tier au sexe masculin. C’est elle qui<br />
e<br />
régit tout le Moy<strong>en</strong>-Âge. Revue et corrigée abusivem<strong>en</strong>t au XIV siècle pour <strong>de</strong>s raisons <strong>de</strong><br />
succession au trône, alors que Louis X le Hutin mourait sans laisser d’héritier mâle, la Loi<br />
salique posa les jalons d’une pratique discriminante qui ne prit fin qu’avec la chute <strong>de</strong> l’Anci<strong>en</strong><br />
Régime : le principe <strong>de</strong> masculinité était posé pour la succession au trône. En outre, bi<strong>en</strong><br />
que le Royaume <strong>de</strong>s Français, bi<strong>en</strong>tôt <strong>de</strong>v<strong>en</strong>u, sous Hugues Capet, le Royaume <strong>de</strong> France,<br />
ne puisse être considéré comme <strong>patrimoine</strong> dans une acception stricte <strong>de</strong> la définition <strong>du</strong><br />
Littré, il est symptomatique <strong>de</strong> noter que la transmission <strong>en</strong> était héréditaire. Le Royaume<br />
était le bi<strong>en</strong> d’une Monarchie qui possédait ses sujets. Celle-ci <strong>de</strong>vait être léguée, au même<br />
titre que n’importe quel autre bi<strong>en</strong>, à l’aîné <strong>de</strong>s fils. C’est le régime monarchique qui portait<br />
3. Françoise Choay, L’allégorie <strong>du</strong> Patrimoine,<br />
Paris, Le Seuil, 1999, p. 9.<br />
4. Jean-Yves Andrieux, Françoise Choay <strong>en</strong>tre autres, voir bibliographie <strong>en</strong> fin <strong>de</strong> volume.<br />
5. Mariannick Jadé, Patrimoine immatériel, perspectives d’interprétation <strong>du</strong> concept <strong>de</strong> <strong>patrimoine</strong>,<br />
Paris,<br />
L’Harmattan, 2006, p. 29-32.<br />
6. « Cette distinction linguistique témoigne <strong>de</strong>s diss<strong>en</strong>sions et <strong>du</strong> divorce. L’évolution <strong>de</strong> l’historiographie<br />
française <strong>du</strong> concept <strong>de</strong> <strong>patrimoine</strong> a été marquée <strong>par</strong> un certain nombre <strong>de</strong> facteurs qui le distingue <strong>de</strong><br />
celle <strong>de</strong> tous les autres pays. En <strong>de</strong>hors <strong>du</strong> cadre national, cette appréciation hexagonale ne trouve ni<br />
résonance ni équival<strong>en</strong>t. Elle génère une certaine incompréh<strong>en</strong>sion pour d’autres cultures chez lesquelles<br />
la question ne se pose pas <strong>en</strong> terme <strong>de</strong> « <strong>patrimoine</strong> ». Dans le contexte <strong>en</strong>g<strong>en</strong>dre un décalage <strong>par</strong>fois<br />
mal admis », ibid. , p. 29.<br />
Schedae,<br />
2008, prépublication n°10, (p.1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf<br />
5
6<br />
<strong>en</strong> son sein les germes <strong>du</strong> passage d’une transmission <strong>de</strong> ses bi<strong>en</strong>s, <strong>du</strong> père à ses <strong>en</strong>fants,<br />
à la transmission <strong>de</strong>s <strong>valeur</strong>s, d’une nation à ses citoy<strong>en</strong>s.<br />
7<br />
<strong>La</strong> Monarchie absolue confondait le bi<strong>en</strong> public et le bi<strong>en</strong> privé . <strong>La</strong> Révolution française,<br />
<strong>en</strong> confisquant les bi<strong>en</strong>s <strong>de</strong>s nobles émigrés, transféra au public le privé, dans une forme <strong>de</strong><br />
collectivisation. <strong>La</strong> République, elle, transmit à ses citoy<strong>en</strong>s, et exhiba aux yeux <strong>du</strong> mon<strong>de</strong><br />
qui se p<strong>en</strong>chait sur elle, les symboles <strong>de</strong>s <strong>valeur</strong>s qui présidai<strong>en</strong>t à sa gloire. <strong>La</strong> justification <strong>de</strong><br />
son exist<strong>en</strong>ce est ambiguë. Elle s’imposa dans le cadre d’une rupture politique et s’exposa<br />
comme le fruit d’un long passé. Lorsque Pierre Nora écrit que « la République se confond<br />
8<br />
pratiquem<strong>en</strong>t avec sa mémoire, elle est comme le sujet dans le sujet » , il montre que le<br />
<strong>patrimoine</strong> a basculé dans le champ <strong>de</strong> la mémoire. Ce faisant, il a accédé au rang <strong>de</strong><br />
l’évocation, et, <strong>par</strong> ess<strong>en</strong>ce lié au passé, il commémore. Ainsi, il a acquis une <strong>valeur</strong> sacrale,<br />
celle <strong>de</strong> l’écriture d’une mémoire au service <strong>de</strong> la construction d’une id<strong>en</strong>tité, souv<strong>en</strong>t<br />
nationale.<br />
On ne peut néanmoins pas confondre « <strong>patrimoine</strong> », « Histoire » et « mémoire ». En effet,<br />
9<br />
si « la mémoire […] est plus un cadre qu’un cont<strong>en</strong>u » , ce qui est aujourd’hui communém<strong>en</strong>t<br />
admis comme le « <strong>de</strong>voir <strong>de</strong> mémoire » est intimem<strong>en</strong>t lié à une politisation <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong>.<br />
De l’abbé Grégoire s’élevant contre la t<strong>en</strong>tation suicidaire <strong>de</strong> la Révolution <strong>de</strong> faire table rase<br />
<strong>de</strong> son propre passé à l’« Année <strong>du</strong> Patrimoine » célébrée <strong>en</strong> France <strong>de</strong>puis 1981, on peut<br />
affirmer sans peine avec Pierre Nora que « ce n’est pas ce qu’il (le passé) nous impose qui<br />
10<br />
compte mais ce que l’on y met » . Sans pour autant les opposer <strong>de</strong> manière radicale, on ne<br />
peut nier que l’écriture <strong>de</strong> l’Histoire est r<strong>en</strong><strong>du</strong>e sujette à caution <strong>par</strong> « la reconstruction toujours<br />
11<br />
problématique et incomplète <strong>de</strong> ce qui n’est plus » . Que vaut la commémoration <strong>de</strong> la nais-<br />
e<br />
sance <strong>de</strong> la III République <strong>de</strong>vant l’incapacité <strong>de</strong>s programmes scolaires à <strong>en</strong>seigner à ses<br />
<strong>en</strong>fants les drames <strong>de</strong> la Commune ? Que vaut <strong>en</strong>core l’inauguration d’un Mémorial <strong>de</strong> la<br />
Shoah <strong>de</strong>vant l’impossibilité <strong>de</strong> l’État <strong>de</strong> se juger lui-même à travers le procès <strong>de</strong> Maurice<br />
Papon ?<br />
H<strong>en</strong>ri Bergson nous <strong>en</strong>seigne que l’action <strong>du</strong> passé sur l’av<strong>en</strong>ir, ce que l’on pourrait<br />
appeler <strong>en</strong> somme la capacité propre <strong>de</strong> l’homme à tirer <strong>de</strong>s leçons <strong>de</strong> l’histoire, sert <strong>en</strong><br />
12<br />
réalité à <strong>en</strong>richir le passé . Cette idée est reprise <strong>par</strong> Paul Veyne lorsqu’il affirme – a contrario<br />
<strong>de</strong> Max Weber qui p<strong>en</strong>se que l’Histoire est un rapport aux <strong>valeur</strong>s – que l’Histoire est<br />
idéographique, que le temps n’est pas nécessaire à son écriture : « puisque tout est histo-<br />
13<br />
rique, l’histoire sera ce que nous choisissons » . Il conteste ainsi à l’histoire d’être une sci<strong>en</strong>ce,<br />
et selon lui « les histori<strong>en</strong>s racont<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s événem<strong>en</strong>ts mais qui ont l’homme pour acteur ;<br />
14<br />
l’histoire est un roman vrai » . Cette posture très critique <strong>en</strong>vers l’écriture <strong>de</strong> l’Histoire nous<br />
oblige à une gran<strong>de</strong> vigilance dans notre démarche. Loin <strong>de</strong> prét<strong>en</strong>dre à une quelconque<br />
objectivité, dont plus personne ne se risquerait à dire qu’elle est nécessaire, il faut <strong>en</strong> revanche<br />
démontrer que, contrairem<strong>en</strong>t à la provocation d’un Paul Veyne, l’histoire existe, qu’elle est<br />
7. On pourra <strong>de</strong> manière caricaturale illustrer le propos <strong>par</strong> l’exemple célèbre d’un Louis XIV clamant « l’État<br />
c’est moi ».<br />
8. Pierre Nora (dir.), Les lieux <strong>de</strong> mémoire,<br />
Tome 1, Paris, Gallimard, 1997, p. 17.<br />
9. Ibid. , p. 17.<br />
10. Pierre Nora (dir.), Les lieux <strong>de</strong> mémoire,<br />
Tome 3, Paris, Gallimard, 1997, p. 4696.<br />
11. Pierre Nora (dir.), Les lieux <strong>de</strong> mémoire,<br />
Tome 1, Paris, Gallimard, 1997, p. 23.<br />
12. « Comme, pour créer l’av<strong>en</strong>ir, il faut <strong>en</strong> pré<strong>par</strong>er quelque chose dans le prés<strong>en</strong>t, comme la pré<strong>par</strong>ation <strong>de</strong><br />
ce qui sera ne peut se faire que <strong>par</strong> l’utilisation <strong>de</strong> ce qui a été, la vie s’emploie dès le début à conserver<br />
le passé et à anticiper sur l’av<strong>en</strong>ir, dans une <strong>du</strong>rée où passé, prés<strong>en</strong>t et av<strong>en</strong>ir empièt<strong>en</strong>t l’un sur l’autre et<br />
form<strong>en</strong>t une continuité indivisée : cette mémoire et cette anticipation sont […] la consci<strong>en</strong>ce même. Et c’est<br />
pourquoi, <strong>en</strong> droit sinon <strong>en</strong> fait, la consci<strong>en</strong>ce est coext<strong>en</strong>sive à la vie », in H<strong>en</strong>ri Bergson, <strong>La</strong> consci<strong>en</strong>ce<br />
<strong>de</strong> la vie,<br />
cité <strong>par</strong> Antigone Mouchtouris, sociologie <strong>du</strong> public dans le champ <strong>culturel</strong> et artistique,<br />
Paris,<br />
L’Harmattan, 2003, p. 112.<br />
13. Paul Veyne, Comm<strong>en</strong>t on écrit l’histoire,<br />
Paris, Éditions <strong>du</strong> Seuil, rééd. 1979, 1971, p. 64.<br />
14. Ibid.,<br />
p. 10.<br />
Schedae,<br />
2008, prépublication n°10, (p. 1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf
15<br />
une sci<strong>en</strong>ce et qu’elle répond à une métho<strong>de</strong> . Le <strong>patrimoine</strong> <strong>en</strong> est l’incarnation, voire<br />
l’allégorie. Il est donc <strong>du</strong> <strong>de</strong>voir <strong>de</strong> l’historiographe, dans une démocratie et selon une démarche<br />
humaniste, que d’apporter sa contribution à l’édification <strong>du</strong> s<strong>en</strong>s historique attribué à un<br />
<strong>patrimoine</strong>, lui-même <strong>de</strong>stiné à être légué aux générations futures. Le <strong>patrimoine</strong> est un fragm<strong>en</strong>t,<br />
un prélèvem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> l’Histoire. À ce titre, sa <strong>valeur</strong> symbolique doit être fondée sur <strong>de</strong>s<br />
critères sci<strong>en</strong>tifiquem<strong>en</strong>t recevables, et non seulem<strong>en</strong>t politiquem<strong>en</strong>t corrects.<br />
Dans une société prônant les <strong>valeur</strong>s d’une réussite indivi<strong>du</strong>elle, on peut se risquer à<br />
p<strong>en</strong>ser avec Hannah Ar<strong>en</strong>dt citant Karl Marx que « personne ne pro<strong>du</strong>it <strong>de</strong> <strong>valeur</strong> dans la<br />
16 solitu<strong>de</strong> » . S’opposant à la lecture d’un Aristote <strong>en</strong>clin à démontrer l’immortalité <strong>de</strong>s hommes,<br />
<strong>par</strong>ce que la nature est immortelle et que l’homme est <strong>par</strong>tie intégrante <strong>de</strong> la nature,<br />
Hannah Ar<strong>en</strong>dt écrit :<br />
Les hommes sont les mortels,<br />
les seules choses mortelles qu’il y ait, car les animaux n’exist<strong>en</strong>t<br />
17<br />
que comme membres <strong>de</strong> leur espèce et non comme indivi<strong>du</strong>s .<br />
Pour sortir <strong>de</strong> la torpeur <strong>de</strong> la matérialité donc d’un temps et d’un espace finis, la seule<br />
issue <strong>en</strong>visageable serait <strong>de</strong> faire porter aux objets, artefacts, l’immortalité <strong>de</strong> l’esprit <strong>de</strong>s<br />
hommes dont l’<strong>en</strong>veloppe est vouée à la dis<strong>par</strong>ition. On touche ici à une autre contradiction<br />
<strong>de</strong> l’évocation patrimoniale. Pas plus que lui-même, les pro<strong>du</strong>ctions nées <strong>de</strong> la main <strong>de</strong><br />
l’homme ne sont éternelles.<br />
<strong>La</strong> <strong>du</strong>rabilité <strong>de</strong> l’artifice humain n’est pas absolue ; l’usage que nous <strong>en</strong> faisons l’use, bi<strong>en</strong> que<br />
nous ne le consommions pas. Le processus vital qui imprègne tout notre être l’<strong>en</strong>vahit aussi, et<br />
si nous n’utilisons pas les objets <strong>du</strong> mon<strong>de</strong>, ils finiss<strong>en</strong>t <strong>par</strong> se corrompre, <strong>par</strong> retourner au pro-<br />
18<br />
cessus naturel global d’où ils fur<strong>en</strong>t tirés, contre lequel ils fur<strong>en</strong>t dressés .<br />
Hannah Ar<strong>en</strong>dt pose ici trois problèmes fort utiles à notre étu<strong>de</strong>. Elle inscrit l’objet dans<br />
une perspective <strong>culturel</strong>le <strong>en</strong> opposition à la nature. Elle montre aussi la volonté absur<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> toute puissance <strong>de</strong> l’homme qui le pousse à défier le temps et la matière tandis que ses<br />
pro<strong>du</strong>ctions ne sont que <strong>de</strong>s prélèvem<strong>en</strong>ts d’une nature généreuse, mais sans scrupule.<br />
19<br />
Enfin, l’objet utile est dégradé <strong>par</strong> ses usagers – <strong>en</strong> 1867, Ludovic Vitet <strong>par</strong>lait <strong>de</strong> l’usage<br />
20<br />
comme d’un « vandalisme l<strong>en</strong>t » – ; inusité, il est dégradé <strong>par</strong> un processus naturel. Si l’objet<br />
considéré est le <strong>patrimoine</strong>, on mesure toute la vanité <strong>de</strong> l’<strong>en</strong>treprise. Pour toute éternité,<br />
l’homme s’est inv<strong>en</strong>té la trace, l’empreinte. Il cherche un s<strong>en</strong>s <strong>culturel</strong> à son exist<strong>en</strong>ce et t<strong>en</strong>te<br />
<strong>de</strong> l’immortaliser dans la pierre. « <strong>La</strong> <strong>de</strong>struction et la ruine <strong>de</strong> l’inutile est une loi <strong>de</strong> la nature.<br />
<strong>La</strong> culture intervi<strong>en</strong>t pour annuler ou retar<strong>de</strong>r cette loi, au nom d’impératifs plus élevés » nous<br />
21<br />
dit André Chastel . Néanmoins, on ne peut être que frappé <strong>par</strong> le ton presque fataliste<br />
employé <strong>par</strong> l’UNESCO dans le préambule <strong>de</strong> sa Conv<strong>en</strong>tion, qui, déjà <strong>en</strong> 1972, déclarait :<br />
Le <strong>patrimoine</strong> <strong>culturel</strong> et le <strong>patrimoine</strong> naturel sont <strong>de</strong> plus <strong>en</strong> plus m<strong>en</strong>acés <strong>de</strong> <strong>de</strong>struction,<br />
non seulem<strong>en</strong>t <strong>par</strong> les causes traditionnelles <strong>de</strong> la dégradation, mais <strong>en</strong>core <strong>par</strong> l’évolution <strong>de</strong><br />
15. « L’histoire n’est pas une sci<strong>en</strong>ce et n’a pas beaucoup à att<strong>en</strong>dre <strong>de</strong>s sci<strong>en</strong>ces ; elle n’explique pas et n’a<br />
pas <strong>de</strong> métho<strong>de</strong> ; mieux <strong>en</strong>core, l’histoire dont on <strong>par</strong>le beaucoup <strong>de</strong>puis <strong>de</strong>ux siècles n’existe pas », Paul<br />
Veyne, Comm<strong>en</strong>t on écrit l’histoire,<br />
Paris, Éditions <strong>du</strong> Seuil, rééd. 1979,1971, p. 10.<br />
16. Hannah Ar<strong>en</strong>dt, Condition <strong>de</strong> l’homme mo<strong>de</strong>rne,<br />
Paris, Pocket, 1994, p. 219.<br />
17. Hannah Ar<strong>en</strong>dt, <strong>La</strong> crise <strong>de</strong> la culture,<br />
Paris, Gallimard, p. 58.<br />
18. Hannah Ar<strong>en</strong>dt, Condition <strong>de</strong> l’homme mo<strong>de</strong>rne,<br />
Paris, Pocket, 1994, p. 187.<br />
19. Louis, dit Ludovic Vitet (1802-1873) : archéologue ; nommé à l’Académie <strong>de</strong>s Inscriptions <strong>en</strong> 1839, puis Inspecteur<br />
général <strong>de</strong>s Monum<strong>en</strong>ts Historiques.<br />
20. Ludovic Vitet cité in Pierre Nora (dir.), Les lieux <strong>de</strong> mémoire,<br />
Tome 1, Paris, Gallimard, 1997, p. 1465 (étu<strong>de</strong><br />
sur l’art anglais <strong>en</strong> 1867).<br />
21. Ibid., p. 1460.<br />
Schedae,<br />
2008, prépublication n°10, (p.1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf<br />
7
8<br />
la vie sociale et économique qui les aggrave <strong>par</strong> <strong>de</strong>s phénomènes d’altération ou <strong>de</strong> <strong>de</strong>struc-<br />
22<br />
tion <strong>en</strong>core plus redoutables .<br />
Il est important <strong>de</strong> se questionner sur le s<strong>en</strong>s <strong>du</strong> transfert <strong>de</strong>s <strong>valeur</strong>s sacrales dans notre<br />
société contemporaine. Il semblerait que l’homme universel, lancé dans une course effrénée<br />
au progrès, se recroqueville sur <strong>de</strong>s <strong>valeur</strong>s fondatrices, s’accroche à <strong>de</strong>s repères, qu’il énonce<br />
dans une histoire récrite <strong>par</strong> peur <strong>du</strong> vi<strong>de</strong>. Pour Pierre Nora, les lieux <strong>de</strong> mémoire « sont<br />
d’abord <strong>de</strong>s restes », ce qu’il appelle « <strong>de</strong>s illusions d’éternité », « <strong>de</strong>s rituels d’une société<br />
23<br />
sans rituels » . Le <strong>patrimoine</strong> <strong>par</strong>aît pouvoir s’accommo<strong>de</strong>r d’une lecture <strong>de</strong> la doctrine<br />
positiviste <strong>du</strong> philosophe Auguste Comte. Dans ses premiers développem<strong>en</strong>ts, elle plaçait<br />
<strong>en</strong> avant la foi <strong>en</strong> la sci<strong>en</strong>ce, récusant le temps théologique pour <strong>en</strong>suite accepter un retour<br />
au religieux. Le <strong>patrimoine</strong> religieux semble être le <strong>par</strong>adigme d’un <strong>patrimoine</strong> porteur <strong>de</strong><br />
contradictions et qui avancerait à contre-courant <strong>de</strong> l’histoire. Après 1792, le Roi <strong>de</strong> France<br />
éliminé, <strong>en</strong>combrés <strong>de</strong> la République nouvelle, s’empêtrant dans une viol<strong>en</strong>ce grandissante,<br />
les révolutionnaires fur<strong>en</strong>t écartelés <strong>en</strong>tre <strong>de</strong>s pulsions iconoclastes et la prise <strong>de</strong> consci<strong>en</strong>ce<br />
que la nation qu’ils bâtissai<strong>en</strong>t était l’héritière d’une longue tradition. S’opposai<strong>en</strong>t alors<br />
24<br />
dans les mêmes esprits le désir <strong>de</strong> <strong>de</strong>struction et celui <strong>de</strong> conservation .<br />
On peut sans peine dire que c’est la mémoire qui a vaincu. 1789 fut bel et bi<strong>en</strong> une révo-<br />
e<br />
lution politique, mais elle était fille <strong>de</strong>s Lumières. Tout le XIX siècle témoigne <strong>de</strong> l’héritage,<br />
tant <strong>par</strong> ses hésitations politiques que <strong>par</strong> la naissance <strong>de</strong>s différ<strong>en</strong>tes institutions prônant<br />
la déf<strong>en</strong>se <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong> et dont on trouve l’origine dans l’Anci<strong>en</strong> régime comme nous le<br />
verrons ci-après. Dans une France <strong>de</strong>v<strong>en</strong>ue républicaine et laïque – la Loi <strong>de</strong> 1905 ayant<br />
instauré la sé<strong>par</strong>ation <strong>de</strong> l’Église et <strong>de</strong> l’État –, et à bi<strong>en</strong> <strong>de</strong>s égards athée et anticléricale,<br />
abbayes, cathédrales et autres bâtim<strong>en</strong>ts religieux fur<strong>en</strong>t placés sous la tutelle <strong>de</strong> l’État, <strong>par</strong><br />
25<br />
la grâce <strong>du</strong> Service <strong>de</strong>s Monum<strong>en</strong>ts historiques né <strong>en</strong> 1830 . Ce sont aujourd’hui <strong>en</strong>core<br />
les communes qui sont propriétaires d’églises dans lesquelles, souv<strong>en</strong>t, aucun prêtre n’officie<br />
plus. Le bâtim<strong>en</strong>t <strong>de</strong>meure, <strong>de</strong>bout mais statufié, vidé <strong>de</strong> son s<strong>en</strong>s premier, et <strong>de</strong> ce point<br />
<strong>de</strong> vue inutile, mais témoin d’un temps <strong>de</strong>v<strong>en</strong>u inaliénable.<br />
À bi<strong>en</strong> <strong>de</strong>s égards, le musée peut-être lu comme la dim<strong>en</strong>sion <strong>par</strong>oxystique <strong>de</strong> la sacralisation<br />
politique <strong>de</strong> l’objet patrimonial. Déjà <strong>en</strong> 1815, Quatremère <strong>de</strong> Quincy s’élevait et<br />
mettait <strong>en</strong> gar<strong>de</strong> contre le cercle vicieux <strong>du</strong> rassemblem<strong>en</strong>t d’œuvres. Selon lui, ce processus<br />
visait à générer <strong>de</strong>s créations, dont la seule fin serait d’alim<strong>en</strong>ter <strong>de</strong>s rassemblem<strong>en</strong>ts.<br />
26<br />
Deux siècles plus tard, on mesure la clairvoyance <strong>de</strong> l’archéologue <strong>de</strong>v<strong>en</strong>u Int<strong>en</strong>dant <strong>de</strong>s<br />
Arts et Monum<strong>en</strong>ts publics. Sa double compét<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> sci<strong>en</strong>tifique et d’homme politique<br />
lui offrait tout loisir, <strong>en</strong> <strong>de</strong>s temps politiquem<strong>en</strong>t troublés, d’observer le risque <strong>de</strong> confusion<br />
<strong>de</strong>s g<strong>en</strong>res, ce qu’<strong>en</strong> d’autres termes il aurait pu appeler une instrum<strong>en</strong>talisation, si souv<strong>en</strong>t<br />
dénoncée <strong>de</strong>puis. André Malraux abordait cette question <strong>de</strong> l’instrum<strong>en</strong>talisation sous un<br />
autre angle, <strong>en</strong> étant plus sévère <strong>en</strong>core. Il considérait <strong>en</strong> effet que c’est le musée qui fabrique<br />
27<br />
les œuvres d’art <strong>par</strong> la décontextualisation. Dénonçant le « fragm<strong>en</strong>t » tout autant que ladite<br />
22. Conv<strong>en</strong>tion <strong>du</strong> Patrimoine mondial <strong>de</strong> l’UNESCO ; http//www.unesco.org/fr/182.<br />
23. Pierre Nora (dir.), Les lieux <strong>de</strong> mémoire,<br />
Tome 1, Paris, Gallimard, 1997, p. 29.<br />
24. On trouve l’évocation <strong>du</strong> « <strong>patrimoine</strong> » dans nombre <strong>de</strong> discours <strong>de</strong> Robespierre, qu’il rattache toujours<br />
au peuple.<br />
25. En 2005, le Ministère chiffrait à 35 % la <strong>par</strong>t <strong>de</strong>s édifices religieux et funéraires protégés au titre <strong>de</strong>s monum<strong>en</strong>ts<br />
historiques, sur un total <strong>de</strong> 42 310 monum<strong>en</strong>ts historiques protégés.<br />
26. Antoine Chrysostome Quatremère <strong>de</strong> Quincy (1755-1849) fut élu député à l’Assemblée législative <strong>en</strong> 1791,<br />
où il siégeait avec les royalistes constitutionnels. Après avoir connu <strong>de</strong>s heures sombres <strong>de</strong> la Révolution<br />
française puisqu’il fut emprisonné puis proscrit, il recouvra sa légitimité sous la Restauration qui le nomma<br />
au poste d’Int<strong>en</strong>dant <strong>de</strong>s Arts et Monum<strong>en</strong>ts publics. Il fut élu une nouvelle fois à la députation <strong>en</strong> 1820.<br />
27. « Le fragm<strong>en</strong>t est un maître <strong>de</strong> l’école <strong>de</strong>s arts fictifs », André Malraux, Le musée imaginaire,<br />
Paris, Gallimard,<br />
1947, p. 118.<br />
Schedae,<br />
2008, prépublication n°10, (p. 1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf
décontextualisation, il s’insurgeait contre cette manipulation qui permet qu’« à la représ<strong>en</strong>-<br />
28<br />
tation <strong>du</strong> mon<strong>de</strong> succè<strong>de</strong> son annexion » . Plus près <strong>de</strong> nous <strong>en</strong>core, s’appuyant sur les<br />
argum<strong>en</strong>ts qui précèd<strong>en</strong>t, Patrice Béghain invective l’opportunisme économique trop souv<strong>en</strong>t<br />
attaché à la question patrimoniale. L’exemple <strong>de</strong> la grotte <strong>de</strong> <strong>La</strong>scaux fournit, selon<br />
lui, un exemple significatif, malheureux et absur<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’exploitation touristique donc éco-<br />
29<br />
nomique <strong>de</strong>s sites patrimoniaux, <strong>de</strong> ce qu’il appelle la « généralisation <strong>du</strong> fac-similé ou<br />
30<br />
<strong>de</strong> la visite virtuelle » .<br />
Tout <strong>en</strong> <strong>par</strong>tageant les analyses qui précèd<strong>en</strong>t, il nous ap<strong>par</strong>ti<strong>en</strong>dra dans cette étu<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> montrer que, bi<strong>en</strong> que les dérives exist<strong>en</strong>t, et continueront vraisemblablem<strong>en</strong>t d’exister,<br />
l’abus n’est pas lié à l’outil mais à l’usage qui <strong>en</strong> est fait. Il ne doit jamais être question <strong>de</strong><br />
31<br />
«faire comme si », <strong>de</strong> <strong>du</strong>per, sans quoi à coup sûr, «la patrimonialisation rompt le li<strong>en</strong> social » .<br />
On peut p<strong>en</strong>ser avec André Malraux qu’« une tête gothique est rarem<strong>en</strong>t plus belle que<br />
32<br />
brisée » mais l’illusion n’est pas le progrès, pas plus que la copie. Platon déjà dénonçait<br />
33<br />
l’imitateur comme un usurpateur . Ainsi qu’a pu l’écrire Walter B<strong>en</strong>jamin, « à la plus <strong>par</strong>faite<br />
34<br />
repro<strong>du</strong>ction il manque toujours quelque chose : l’ici et le maint<strong>en</strong>ant <strong>de</strong> l’œuvre d’art […] » .<br />
35<br />
L’histori<strong>en</strong> n’est pas Zeuxis et n’a pour vocation ni d’imiter ni <strong>de</strong> copier la réalité. S’il <strong>par</strong>vi<strong>en</strong>t<br />
à ce résultat, c’est dans le meilleur <strong>de</strong>s cas <strong>par</strong> souci <strong>de</strong> réalisme et <strong>de</strong> <strong>mise</strong> <strong>en</strong> contexte.<br />
Il est <strong>en</strong> revanche <strong>du</strong> <strong>de</strong>voir <strong>du</strong> sci<strong>en</strong>tifique d’apporter à la « trace » ce qui lui manque,<br />
<strong>de</strong> lutter contre le temps avec le temps, <strong>en</strong> se servant <strong>du</strong> progrès technique, et <strong>de</strong> restituer<br />
la <strong>par</strong>t <strong>de</strong> contexte qui manque à l’objet évoqué. Pierre Nora pourtant très critique face à<br />
l’exploitation démesurée <strong>de</strong> la mémoire collective concè<strong>de</strong> que les nouvelles technologies<br />
permett<strong>en</strong>t d’augm<strong>en</strong>ter les chances « d’un accès nouveau et inéluctable au <strong>patrimoine</strong>, avec<br />
les chances d’un approfondissem<strong>en</strong>t qui est une nouvelle preuve <strong>de</strong> son importance ».<br />
D’autres <strong>par</strong>adoxes peuv<strong>en</strong>t être relevés, comme celui d’un retour affirmé aux terroirs,<br />
aux racines, tandis que la mondialisation poursuit son œuvre globalisante. Il existe <strong>du</strong> reste<br />
un étagem<strong>en</strong>t, une stratification <strong>de</strong> la notion <strong>de</strong> <strong>patrimoine</strong> comme héritage : <strong>de</strong> la famille à<br />
l’ethnie, <strong>de</strong> la nation au contin<strong>en</strong>t, <strong>de</strong> la commune à l’UNESCO, le <strong>patrimoine</strong> s’empile et<br />
se distribue, dans une forme <strong>de</strong>v<strong>en</strong>ue schizophrénique. Yvon <strong>La</strong>my abor<strong>de</strong> la notion comme<br />
tiraillée <strong>en</strong>tre « propriété et héritage, indivi<strong>du</strong> et collectivité, nation et humanité, nature et<br />
culture, culte <strong>du</strong> passé et mémoire collective, sélection et classem<strong>en</strong>t, profane et sacré,<br />
36<br />
réalité susceptible (ou non) d’aliénation » . Cherchant à dégager <strong>de</strong>s <strong>valeur</strong>s communes,<br />
28. André Malraux, Le musée imaginaire,<br />
Paris, Gallimard, 1947, p. 72.<br />
29. <strong>La</strong> dim<strong>en</strong>sion économique comme facteur <strong>de</strong> décision n’est qu’évoquée dans cette <strong>par</strong>tie <strong>du</strong> texte. Un<br />
développem<strong>en</strong>t lui est consacré plus loin.<br />
30. Patrice Béghain, Le <strong>patrimoine</strong>, culture et li<strong>en</strong> social,<br />
Paris, Presses <strong>de</strong> Sci<strong>en</strong>ces Po, 1998, p. 43.<br />
31. Ibid,<br />
p. 46.<br />
32. André Malraux, Le musée imaginaire,<br />
Paris, Gallimard, 1947, p. 56.<br />
33. « Socrate : Lequel <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>ux buts se propose la peinture relativem<strong>en</strong>t à chaque objet ? Est-ce <strong>de</strong> représ<strong>en</strong>ter<br />
ce qui est tel qu’il est, ou ce qui <strong>par</strong>aît tel qu’il <strong>par</strong>aît ? Est-ce l’imitation <strong>de</strong> l’ap<strong>par</strong><strong>en</strong>ce ou <strong>de</strong> la<br />
réalité ?/ Glaucon : De l’ap<strong>par</strong><strong>en</strong>ce./ Socrate : L’imitation est donc loin <strong>du</strong> vrai, et, si elle façonne tous les<br />
objets, c’est semble-t-il, <strong>par</strong>ce qu’elle ne touche qu’à une petite <strong>par</strong>tie <strong>de</strong> chacun, laquelle n’est d’ailleurs<br />
qu’une ombre. Le peintre, dirons-nous <strong>par</strong> exemple, nous représ<strong>en</strong>tera un cordonnier, un charp<strong>en</strong>tier ou<br />
tout autre artisan sans avoir aucune connaissance <strong>de</strong> leur métier ; il cep<strong>en</strong>dant, s’il est bon peintre, ayant<br />
représ<strong>en</strong>té un charp<strong>en</strong>tier et le montrant <strong>de</strong> loin, il trompera les <strong>en</strong>fants et les hommes privés <strong>de</strong> raison,<br />
<strong>par</strong>ce qu’il aura donné à sa peinture l’ap<strong>par</strong><strong>en</strong>ce d’un charp<strong>en</strong>tier véritable », Platon, <strong>La</strong> République,<br />
Livre X, 597d-598c, trad. Robert Baccou, Garnier Flammarion, 1966, 510 pages.<br />
34. Walter B<strong>en</strong>jamin, « L’œuvre d’art à l’ère <strong>de</strong> sa repro<strong>du</strong>ctivité technique », in Le langage et la culture,<br />
Paris,<br />
D<strong>en</strong>oël, 1971, p. 141.<br />
e<br />
35. Pline l’Anci<strong>en</strong>, dans ses Histoires naturelles,<br />
décrit le tal<strong>en</strong>t avec lequel il peignait au V siècle avant notre<br />
ère, rapportant un épiso<strong>de</strong> <strong>de</strong>v<strong>en</strong>u célèbre d’oiseaux qui se méprir<strong>en</strong>t et vinr<strong>en</strong>t becqueter les raisins<br />
peints <strong>par</strong> l’artiste.<br />
36. Cité <strong>par</strong> Jean-Yves Andrieux, Patrimoine et Histoire,<br />
Belin, 1997, 283 pages.<br />
Schedae,<br />
2008, prépublication n°10, (p.1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf<br />
9
10<br />
à bâtir une culture, il pr<strong>en</strong>d <strong>valeur</strong> allégorique jusqu’à <strong>par</strong>fois <strong>de</strong>v<strong>en</strong>ir la proie d’actions vio-<br />
37<br />
l<strong>en</strong>tes .<br />
M<strong>en</strong>acé comme objet, il est aussi vivem<strong>en</strong>t dénoncé comme concept. Il est curieux <strong>de</strong><br />
constater que ceux dont le métier est <strong>de</strong> le protéger, <strong>de</strong> le restaurer, <strong>de</strong> le mettre <strong>en</strong> <strong>valeur</strong>,<br />
autrem<strong>en</strong>t dit <strong>de</strong> le considérer comme « être », sont aussi ceux qui sont le plus <strong>en</strong>clins à la<br />
méfiance, dès lors qu’il <strong>en</strong>tre dans la sphère <strong>de</strong> la <strong>mise</strong> <strong>en</strong> <strong>valeur</strong>, <strong>du</strong> « <strong>par</strong>aître ». Les référ<strong>en</strong>ces<br />
qui sont citées dans le prés<strong>en</strong>t texte <strong>en</strong> témoign<strong>en</strong>t pleinem<strong>en</strong>t. Au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong>s colères,<br />
c’est aussi une inquiétu<strong>de</strong>, répétée et grandissante, qui se lit dans les discours <strong>de</strong>s spécia-<br />
es<br />
listes les plus r<strong>en</strong>ommés. Ainsi, Pierre Nora, dans son intro<strong>du</strong>ction aux « 7 Actes <strong>de</strong>s <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>s<br />
<strong>du</strong> Patrimoine » écrit-il :<br />
L’heure n’est plus à l’euphorie. Le <strong>patrimoine</strong> se trouve <strong>de</strong>vant plus <strong>de</strong> questions que <strong>de</strong><br />
réponses, plus d’inquiétu<strong>de</strong>s que <strong>de</strong> certitu<strong>de</strong>s, <strong>de</strong>vant <strong>de</strong>s choix stratégiques et politiques,<br />
38<br />
<strong>de</strong>s redéfinitions indisp<strong>en</strong>sables .<br />
L’objet serait-il davantage contrôlable que les idées qu’il véhicule ? Il n’est pas <strong>de</strong> doute<br />
sur cette question. Et comm<strong>en</strong>t dans ce cas être favorable à sa dim<strong>en</strong>sion immatérielle ?<br />
L’équation à résoudre relève <strong>de</strong> la quadrature <strong>du</strong> cercle.<br />
Il est remarquable que <strong>par</strong>tant <strong>de</strong> la sphère <strong>du</strong> privé, et transmis à <strong>de</strong>s <strong>de</strong>sc<strong>en</strong>dants<br />
comme une richesse matérielle, dénombrable et monnayable, le <strong>patrimoine</strong> porte dans la<br />
sphère publique avant tout une <strong>valeur</strong> symbolique, indivisible et inestimable. Progressivem<strong>en</strong>t<br />
et logiquem<strong>en</strong>t, on glisse alors d’un <strong>patrimoine</strong> matériel à un <strong>patrimoine</strong> ét<strong>en</strong><strong>du</strong> à ses<br />
champs immatériels. Françoise Choay <strong>par</strong>le d’un <strong>patrimoine</strong> <strong>de</strong>v<strong>en</strong>u un « concept noma<strong>de</strong> ».<br />
Jean-Yves Andrieux abor<strong>de</strong> différemm<strong>en</strong>t le glissem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> s<strong>en</strong>s lorsqu’il écrit <strong>de</strong> manière<br />
synthétique :<br />
Né dans le giron étroit <strong>de</strong> l’esthétique, il est finalem<strong>en</strong>t une anthropologie <strong>de</strong> la vie brassant, sans<br />
véritable distinction, tous les élém<strong>en</strong>ts qui caractéris<strong>en</strong>t une civilisation […]. De communautaire,<br />
le <strong>patrimoine</strong> se reconnaît maint<strong>en</strong>ant comme id<strong>en</strong>titaire <strong>par</strong>ce qu’il est bi<strong>en</strong> <strong>de</strong> proximité et<br />
d’usage fréqu<strong>en</strong>t. L’immatériel est son nouveau territoire […]<br />
Il se montre plus critique <strong>en</strong>core, lorsqu’il <strong>par</strong>le d’« implosion <strong>de</strong>s métaphores ».<br />
Néanmoins, il faut se gar<strong>de</strong>r <strong>de</strong> p<strong>en</strong>ser que ce qui est souv<strong>en</strong>t considéré aujourd’hui<br />
comme une forme <strong>de</strong> dilatation maximale <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong> serait une critique portée <strong>par</strong> les<br />
e<br />
seuls observateurs d’un XX siècle finissant qui aurait per<strong>du</strong> <strong>valeur</strong>s et repères. En effet, l’article<br />
« Patrimoine », <strong>de</strong> L’Encyclopédie<br />
ou dictionnaire raisonné, <strong>de</strong>s sci<strong>en</strong>ces, <strong>de</strong>s arts et <strong>de</strong>s<br />
e<br />
métiers <strong>de</strong> D<strong>en</strong>is Di<strong>de</strong>rot et Jean d’Alembert, rédigé <strong>par</strong> M Boucher d’Argis disait déjà <strong>en</strong><br />
1765 que le terme « se pr<strong>en</strong>d quelquefois pour toute sorte <strong>de</strong> bi<strong>en</strong>s », sous-<strong>en</strong>t<strong>en</strong>dant cette<br />
dilution <strong>du</strong> concept. L’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s politiques <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong> est pourtant tout réc<strong>en</strong>te dans<br />
l’historiographie puisque ce n’est que dans les années 1970 que vir<strong>en</strong>t le jour les premiers<br />
40<br />
41<br />
travaux , un siècle après la <strong>par</strong>ution <strong>de</strong> l’ouvrage fondateur d’Aloïs Riegl . C’est le domaine<br />
37. Les exemples sont nombreux mais il suffira ici <strong>de</strong> m<strong>en</strong>tionner la <strong>de</strong>struction <strong>de</strong>s Bouddhas <strong>de</strong> Bamyan <strong>en</strong><br />
Afghanistan <strong>par</strong> les Talibans pour montrer combi<strong>en</strong> la pierre sculptée est symbolique, à la fois fragile et<br />
précieuse.<br />
38. Pierre Nora (dir.), Sci<strong>en</strong>ce et consci<strong>en</strong>ce <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong>,<br />
Actes <strong>de</strong>s <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>s <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong>, 28-30 novem-<br />
e<br />
bre 1994, 7 édition, Éditions <strong>du</strong> Patrimoine, 1997, p. 12.<br />
39. Jean-Yves Andrieux, Patrimoine et Histoire,<br />
Paris, Belin, 1997, 283 pages.<br />
40. Pascal Ory, « Pour une histoire <strong>de</strong>s politiques <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong>, esquisse d’une questionnem<strong>en</strong>t » in Philippe<br />
Poirrier et Loïc Vale<strong>de</strong>lorge (dir.), Pour une histoire <strong>de</strong>s politiques <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong>, Paris, <strong>La</strong> Docum<strong>en</strong>tation<br />
Française, 2005, p. 27-32.<br />
41. Aloïs Riegl, Le culte mo<strong>de</strong>rne <strong>de</strong>s monum<strong>en</strong>ts, son ess<strong>en</strong>ce et sa g<strong>en</strong>èse, Paris, Éditions <strong>du</strong> Seuil, 1984,<br />
122 pages.<br />
Schedae,<br />
2008, prépublication n°10, (p. 1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf<br />
39.
qui connaît le développem<strong>en</strong>t le plus tardif dans le champ <strong>de</strong>s politiques <strong>culturel</strong>les. <strong>La</strong><br />
bibliographie <strong>de</strong>vi<strong>en</strong>t conséqu<strong>en</strong>te à dater <strong>de</strong> la déc<strong>en</strong>nie 1990, pério<strong>de</strong> qui correspond à<br />
un véritable tournant dans l’histoire <strong>de</strong>s politiques <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong>.<br />
Patrimoine et politique : la construction d’une id<strong>en</strong>tité nationale<br />
L’histoire <strong>de</strong>s politiques <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong> est nécessairem<strong>en</strong>t aussi complexe que celle <strong>du</strong><br />
<strong>patrimoine</strong> lui-même. On ne peut traiter la question <strong>de</strong> manière chronologique sans l’<strong>en</strong>visager<br />
<strong>en</strong> termes <strong>de</strong> continuités et <strong>de</strong> ruptures. Objet politique s’il <strong>en</strong> est, le <strong>patrimoine</strong> ne peut<br />
être dissocié <strong>de</strong>s acteurs qui le mett<strong>en</strong>t <strong>en</strong> scène. Le <strong>patrimoine</strong> privé est une notion aussi<br />
vieille que celle <strong>de</strong> l’histoire <strong>de</strong>s sociétés, mais sa dim<strong>en</strong>sion politique, <strong>en</strong> tant que « chose<br />
publique » 42 trouve, <strong>en</strong> toute logique, ses racines actuelles dans l’épiso<strong>de</strong> révolutionnaire.<br />
De nombreux auteurs relèv<strong>en</strong>t dans les discours, correspondances et autres édits <strong>de</strong> l’Anci<strong>en</strong><br />
Régime <strong>de</strong>s allusions claires au rôle pot<strong>en</strong>tiel que le <strong>patrimoine</strong> pourrait jouer et qui serait<br />
exploitable politiquem<strong>en</strong>t. Ainsi, Dominique Poulot fait-il remonter à 1601 la naissance <strong>du</strong><br />
<strong>patrimoine</strong> <strong>en</strong> tant qu’objet politique, citant le Grand Duc Ferdinand <strong>de</strong> Médicis qui inv<strong>en</strong>toriait<br />
les noms <strong>de</strong>s dix-huit peintres célèbres <strong>du</strong> passé qu’il ne fallait pas v<strong>en</strong>dre à l’étranger 43 .<br />
Patrice Béghain évoque <strong>en</strong>core Nicolas François <strong>de</strong> Neufchâteau 44 , prononçant le<br />
27 juillet 1798 ce discours sur le Champ <strong>de</strong> Mars :<br />
Français, gar<strong>de</strong>z religieusem<strong>en</strong>t cette propriété qu’ont léguée à la République les grands hommes<br />
<strong>de</strong> tous les siècles ; ce dépôt qui vous est remis <strong>par</strong> l’estime dans l’univers, ce trésor dont<br />
vous <strong>de</strong>vez r<strong>en</strong>dre compte à toutes les postérités 45 .<br />
L’auteur lit dans ces <strong>par</strong>oles l’acte fondateur <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong> <strong>en</strong> tant que notion mo<strong>de</strong>rne.<br />
On peut noter dans cette citation l’importance <strong>par</strong>ticulière <strong>de</strong> la dim<strong>en</strong>sion religieuse. <strong>La</strong><br />
sacralité <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong> est ici posée, <strong>en</strong> <strong>de</strong>s temps plus <strong>en</strong>clins, à première vue, à la bannir<br />
qu’à la déf<strong>en</strong>dre. Mais, une étu<strong>de</strong> plus fine <strong>de</strong>s décisions prises, montre toute l’ambiguïté <strong>de</strong><br />
la pério<strong>de</strong> révolutionnaire. C’est sur cette <strong>de</strong>rnière que nous allons tout d’abord nous arrêter.<br />
<strong>La</strong> littérature traitant <strong>de</strong> la Révolution française est aussi abondante qu’elle divise les<br />
histori<strong>en</strong>s. Cep<strong>en</strong>dant, la bibliographie que nous avons explorée s’avère être <strong>en</strong> accord sur un<br />
point au moins : si la Révolution n’a pas inv<strong>en</strong>té le <strong>patrimoine</strong>, elle pose les premiers jalons<br />
<strong>de</strong> ce que l’on appelle désormais une « politique <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong> ». On retrouve <strong>par</strong> ailleurs<br />
dans les écrits traitant <strong>de</strong> cette question, un large cons<strong>en</strong>sus sur les <strong>par</strong>adoxes <strong>de</strong>s acteurs<br />
politiques, écartelés <strong>en</strong>tre le désir <strong>de</strong> faire table rase <strong>du</strong> passé, pour ne laisser aucune chance<br />
à la Réaction, et l’impossibilité, autant psychologique que politique, <strong>de</strong> fon<strong>de</strong>r une nation<br />
neuve, créée ex-nihilo. Comm<strong>en</strong>t, <strong>en</strong> effet, mobiliser, dans une nation unie, <strong>de</strong>s citoy<strong>en</strong>s<br />
sans passé ? Aucune révolution, à ce jour, ne peut se targuer d’avoir t<strong>en</strong>u le <strong>par</strong>i. Si l’on peut<br />
lutter contre la rancœur, la rancune, on ne peut s’abstraire <strong>de</strong> la mémoire. Faire table rase <strong>du</strong><br />
passé, c’est ne ri<strong>en</strong> léguer, c’est abolir la trace, c’est nier sa propre exist<strong>en</strong>ce sociale et refuser<br />
la filiation. Il s’agirait donc <strong>de</strong> trouver une forme <strong>de</strong> compromis qui permettrait d’instaurer<br />
un nouvel ordre politique et qui conserverait un cadre et une somme <strong>de</strong> repères indisp<strong>en</strong>sables<br />
à l’équilibre social, espérant ainsi garantir la pér<strong>en</strong>nité <strong>de</strong> l’œuvre révolutionnaire.<br />
Françoise Bercé éclaire cette thèse lorsqu’elle avance :<br />
42. <strong>La</strong> référ<strong>en</strong>ce est ici liée à l’étymologie <strong>du</strong> mot « République », régime qui fait immédiatem<strong>en</strong>t suite, <strong>en</strong><br />
1792 <strong>en</strong> France, à la fin <strong>de</strong> la Monarchie absolue <strong>de</strong> droit divin.<br />
43. Dominique Poulot (dir.), Patrimoine et mo<strong>de</strong>rnité, Paris, L’Harmattan, 1998, p. 11.<br />
44. Nicolas François <strong>de</strong> Neufchâteau (1750-1828) : Ministre <strong>de</strong> l’Intérieur, il mit <strong>en</strong> place ce qui allait <strong>de</strong>v<strong>en</strong>ir<br />
les Bibliothèques et les Archives dé<strong>par</strong>tem<strong>en</strong>tales, le Dépôt général <strong>de</strong>s cartes, etc.<br />
45. Patrice Béghain, Le <strong>patrimoine</strong>, culture et li<strong>en</strong> social, Paris, Presses <strong>de</strong> Sci<strong>en</strong>ces Po, 1998, p. 7.<br />
Schedae, 2008, prépublication n°10, (p.1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf<br />
11
12<br />
À la <strong>valeur</strong> d’anci<strong>en</strong>neté, liée aux leçons <strong>de</strong> la tradition, le siècle <strong>de</strong>s Lumières allait substituer<br />
une autre vision <strong>du</strong> mon<strong>de</strong> : la société ne serait plus construite sur l’expéri<strong>en</strong>ce et les habitu<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong>s anci<strong>en</strong>s, mais, avec un optimisme fondé notamm<strong>en</strong>t sur la démographie croissante <strong>du</strong> siècle,<br />
sur un av<strong>en</strong>ir <strong>en</strong> progrès que chacun pourrait légitimem<strong>en</strong>t contribuer à construire. […] <strong>La</strong> <strong>valeur</strong><br />
reconnue à l’anci<strong>en</strong>neté n’était pas oubliée, mais elle faisait l’objet d’autres interprétations, les<br />
antiquités nationales <strong>de</strong>vant constituer une source <strong>de</strong> jouv<strong>en</strong>ce pour les nouvelles générations 46 .<br />
Il a été noté plus haut que la bibliographie traitant <strong>de</strong>s politiques <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong>, quoique<br />
réc<strong>en</strong>te, est fournie. Cep<strong>en</strong>dant, on pourra s’étonner que les historiographes <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong><br />
ne s’intéress<strong>en</strong>t que très peu à la <strong>du</strong>rée, dans leur analyse. En effet, s’ils accord<strong>en</strong>t<br />
aux révolutionnaires <strong>de</strong> n’avoir pas fait totalem<strong>en</strong>t fi <strong>du</strong> passé, ils n’évoqu<strong>en</strong>t pas <strong>en</strong> profon<strong>de</strong>ur<br />
– <strong>en</strong> terme <strong>de</strong> cont<strong>en</strong>u – cette mémoire, autrem<strong>en</strong>t appelée héritage <strong>culturel</strong>. Les<br />
racines <strong>de</strong>vi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t, dans la démonstration, un concept. Ils trait<strong>en</strong>t finalem<strong>en</strong>t la pério<strong>de</strong> révolutionnaire,<br />
sur ce point, sous le seul angle <strong>de</strong> la rupture. Cela revi<strong>en</strong>t à considérer que c’est la<br />
rupture qui génère le besoin vital <strong>de</strong> retrouver les racines, pour calmer l’angoisse <strong>du</strong> vi<strong>de</strong>. Ne<br />
pourrait-on pas <strong>en</strong>visager la question sous son angle opposé et traiter avec davantage <strong>de</strong><br />
détail <strong>de</strong> l’importance <strong>du</strong> passé dans l’inconsci<strong>en</strong>t collectif, <strong>de</strong> la racine comme élém<strong>en</strong>t indisp<strong>en</strong>sable<br />
<strong>de</strong> tout r<strong>en</strong>ouveau ? <strong>La</strong> Révolution, elle-même, fut le fruit d’un long mûrissem<strong>en</strong>t, et,<br />
si l’explosion est conjoncturelle, tout le mon<strong>de</strong> s’accor<strong>de</strong> à dire que son temps était v<strong>en</strong>u.<br />
Par ailleurs, c’est toujours aux Antiques que l’on attribue d’avoir éclairé les Temps Mo<strong>de</strong>rnes.<br />
Leur influ<strong>en</strong>ce est indéniable mais elle ne doit pas être évoquée <strong>de</strong> manière exclusive.<br />
Certes, l’Humanisme et son corrélat la R<strong>en</strong>aissance ont redonné leurs lettres <strong>de</strong> noblesse à la<br />
tradition antique, à son esthétique et à sa p<strong>en</strong>sée. Plus prosaïque, mais d’une importance<br />
majeure, fut l’ouverture sur le mon<strong>de</strong>, grâce aux échanges économiques. Elle aussi a contribué<br />
à ouvrir les esprits. Sans ri<strong>en</strong> oublier <strong>de</strong>s heures sombres <strong>de</strong>s Croisa<strong>de</strong>s, <strong>de</strong> l’esclavage<br />
ou <strong>de</strong> la Reconquête, les influ<strong>en</strong>ces <strong>culturel</strong>les 47 fur<strong>en</strong>t telles que le savoir ne pouvait<br />
désormais plus se construire sans référ<strong>en</strong>ce à l’Autre, dans toute sa différ<strong>en</strong>ce. Cette confrontation,<br />
même sanglante, obligeait à porter un regard sur soi et sur la construction <strong>de</strong> sa<br />
propre id<strong>en</strong>tité <strong>culturel</strong>le. C’<strong>en</strong> était fini <strong>de</strong>s temps obscurs <strong>du</strong> Haut Moy<strong>en</strong>-Âge, <strong>de</strong>s pillages<br />
et <strong>de</strong>s invasions barbares. À la perte <strong>de</strong> l’écriture allait succé<strong>de</strong>r la redécouverte <strong>de</strong>s Anci<strong>en</strong>s.<br />
Le temps <strong>de</strong>s bâtisseurs était adv<strong>en</strong>u 48 . C’est cette conjonction <strong>du</strong> retour sur un passé riche<br />
et sa <strong>mise</strong> <strong>en</strong> lumière <strong>par</strong> la r<strong>en</strong>contre d’un Autre possible, voire incontournable, qui <strong>de</strong>vait<br />
nourrir les consci<strong>en</strong>ces <strong>du</strong> siècle <strong>de</strong>s Lumières, ce que Françoise Bercé appelle « le commun<br />
dénominateur préalable pour <strong>en</strong>traîner la conservation <strong>de</strong>s témoins <strong>du</strong> passé et l’émerg<strong>en</strong>ce<br />
<strong>de</strong> l’idée <strong>de</strong> monum<strong>en</strong>t historique » 49 .<br />
Il n’est nullem<strong>en</strong>t question ici <strong>de</strong> faire <strong>de</strong> l’angélisme et d’opposer radicalem<strong>en</strong>t et définitivem<strong>en</strong>t<br />
<strong>de</strong>ux ères. Les guerres <strong>de</strong> religion, celles d’hier comme celles d’aujourd’hui, les<br />
nationalismes et leurs extrémistes ne <strong>de</strong>vai<strong>en</strong>t pas dis<strong>par</strong>aître <strong>par</strong> l’<strong>en</strong>chantem<strong>en</strong>t <strong>du</strong> commerce<br />
et <strong>de</strong> la sci<strong>en</strong>ce. Mais le progrès technique allait permettre aux hommes d’appuyer la<br />
construction <strong>de</strong> leur id<strong>en</strong>tité sur <strong>de</strong>s fondations plus soli<strong>de</strong>s. Plus complexe dans son édification,<br />
le bâtim<strong>en</strong>t s’avérait aussi plus difficile à détruire. <strong>La</strong> trace était <strong>de</strong>v<strong>en</strong>ue soli<strong>de</strong>, donc<br />
<strong>du</strong>rable. Les frontières serai<strong>en</strong>t progressivem<strong>en</strong>t r<strong>en</strong><strong>du</strong>es moins poreuses et une id<strong>en</strong>tité<br />
46. Françoise Bercé, Des monum<strong>en</strong>ts historiques au Patrimoine <strong>du</strong> XVIII e siècle à nos jours ou les égarem<strong>en</strong>ts<br />
<strong>du</strong> cœur et <strong>de</strong> l’esprit, Paris, Flammarion, 2000, p. 16.<br />
47. On ne procé<strong>de</strong>ra pas ici à un exam<strong>en</strong> détaillé <strong>de</strong>s influ<strong>en</strong>ces héritées <strong>de</strong>s différ<strong>en</strong>tes aires civilisationnelles<br />
qui ne sont pas l’objet <strong>de</strong> notre étu<strong>de</strong>, mais l’on peut r<strong>en</strong>voyer à quelques auteurs qui font référ<strong>en</strong>ce<br />
sur la question : Bartolomé B<strong>en</strong>assar, Georges Duby, ou Jacques le Goff.<br />
48. Lire Georges Duby, Le temps <strong>de</strong>s cathédrales, l’art <strong>de</strong> la cité (980-1420), Paris, Gallimard, 1976, 379 pages<br />
49. Françoise Bercé, Des monum<strong>en</strong>ts historiques au Patrimoine <strong>du</strong> XVIII e siècle à nos jours ou les égarem<strong>en</strong>ts<br />
<strong>du</strong> cœur et <strong>de</strong> l’esprit, Paris, Flammarion, 2000, p. 16.<br />
Schedae, 2008, prépublication n°10, (p. 1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf
nationale <strong>de</strong>v<strong>en</strong>ait <strong>en</strong>visageable. Une conséqu<strong>en</strong>ce <strong>par</strong>adoxale <strong>de</strong>vait <strong>en</strong> être la montée <strong>de</strong>s<br />
querelles intestines, et, dans ce nouvel espace, celui <strong>de</strong> la nation, <strong>de</strong>s guerres civiles. <strong>La</strong> vigilance<br />
<strong>de</strong>meurait <strong>de</strong> <strong>mise</strong> mais la déf<strong>en</strong>se n’était plus obsessionnelle. Du même coup, lorsqu’elle<br />
avait lieu, la <strong>de</strong>struction pr<strong>en</strong>ait une <strong>valeur</strong> symboliquem<strong>en</strong>t plus forte. On la redoutait<br />
davantage. C’est ainsi que le bâtim<strong>en</strong>t, <strong>par</strong> sa longévité, <strong>de</strong>v<strong>en</strong>ait transmissible. Désormais,<br />
il <strong>en</strong>trait dans la sphère <strong>de</strong> l’héritage, celle <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong>. On <strong>par</strong>lerait bi<strong>en</strong>tôt <strong>de</strong> monum<strong>en</strong>t.<br />
À cet égard, ce qui se joua dans la pério<strong>de</strong> révolutionnaire fut fondam<strong>en</strong>tal, pour compr<strong>en</strong>dre,<br />
d’une <strong>par</strong>t le li<strong>en</strong> étroit <strong>en</strong>tre politique et <strong>patrimoine</strong>, d’autre <strong>par</strong>t, pour <strong>en</strong> dé<strong>du</strong>ire<br />
ce que le recul <strong>de</strong> l’histoire autorise aujourd’hui à considérer comme une évolution logique<br />
<strong>de</strong> son utilisation : son institutionnalisation. <strong>La</strong> t<strong>en</strong>tation fut gran<strong>de</strong> <strong>de</strong> détruire les symboles<br />
<strong>de</strong> l’Anci<strong>en</strong> Régime, et à travers eux <strong>de</strong> l’oppression, lorsque, dans la nuit <strong>du</strong> 4 août 1789,<br />
les privilèges, et avec eux les Ordres, fur<strong>en</strong>t abolis. Porter atteinte à une église, c’était s’<strong>en</strong><br />
pr<strong>en</strong>dre à l’Église, et à ses représ<strong>en</strong>tants. Cep<strong>en</strong>dant, les révolutionnaires ne constituai<strong>en</strong>t<br />
pas une catégorie à <strong>par</strong>t, un ordre social <strong>par</strong>ticulier dans la société d’Ordres, ils se recrutai<strong>en</strong>t<br />
aussi <strong>par</strong>mi les nobles et les clercs. C’est ainsi que si la masse populaire put se laisser <strong>en</strong>traîner<br />
à <strong>de</strong>s excès, sous le feu d’une colère qui lui faisait oublier qu’elle regroupait <strong>en</strong> son sein ceux<br />
qui <strong>par</strong> ailleurs étai<strong>en</strong>t <strong>par</strong>oissi<strong>en</strong>s, la mission <strong>de</strong> l’élite fut bel et bi<strong>en</strong> <strong>de</strong> t<strong>en</strong>ter d’organiser<br />
l’action révolutionnaire, au moins dans les premiers temps, <strong>de</strong> gui<strong>de</strong>r le peuple, peut-on se<br />
risquer à dire. Toutefois, le chanoine Houël, historiographe <strong>de</strong> Saint-Lô au XIXe siècle rapporte<br />
à propos <strong>de</strong> l’aliénation <strong>de</strong>s bi<strong>en</strong>s <strong>du</strong> clergé que c’est <strong>par</strong>fois le processus inverse qui<br />
put s’opérer :<br />
<strong>La</strong> v<strong>en</strong>te <strong>de</strong>s terres affectées aux dotations <strong>du</strong> clergé, que l’on appela bi<strong>en</strong>s <strong>de</strong> main-morte, fut<br />
décrétée (1792), et l’on s’empressa <strong>de</strong> les mettre à l’<strong>en</strong>chère. Le peuple, qu’un reste d’égards<br />
ret<strong>en</strong>ait <strong>en</strong>core, ne voulut point d’abord acquérir <strong>de</strong>s immeubles qui, dans l’origine, avai<strong>en</strong>t été<br />
donnés comme le <strong>patrimoine</strong> <strong>de</strong>s pauvres. Des hommes au-<strong>de</strong>ssus <strong>de</strong>s préjugés levèr<strong>en</strong>t bi<strong>en</strong>tôt<br />
ce scrupule, <strong>en</strong> faisant <strong>de</strong>s acquisitions ; le pas une fois franchi, beaucoup <strong>de</strong> g<strong>en</strong>s suivir<strong>en</strong>t<br />
leurs exemples 50 .<br />
L’un <strong>de</strong>s grands personnages <strong>de</strong> cette pério<strong>de</strong>, dont l’action a été primordiale pour<br />
l’étu<strong>de</strong> qui nous concerne, fut l’abbé Grégoire. Cet ecclésiastique, député rallié au Tiers-État,<br />
œuvra pour l’abolition totale <strong>de</strong>s privilèges et le suffrage universel. Confronté à la question<br />
<strong>de</strong> la démolition <strong>de</strong>s monum<strong>en</strong>ts, il réussit à imposer une vision à la fois radicale et nuancée.<br />
Lorsque le 23 octobre 1790 fut prononcée l’aliénation <strong>de</strong>s bi<strong>en</strong>s nationaux, la tâche <strong>de</strong>vint<br />
complexe, <strong>de</strong>vant la multitu<strong>de</strong> et la variété <strong>de</strong>s « acquis » et le risque d’un vandalisme généralisé<br />
51 . <strong>La</strong> première étape était celle <strong>de</strong> l’inv<strong>en</strong>taire. Comme le souligne Françoise Bercé,<br />
« <strong>en</strong> 1789, v<strong>en</strong>dre, fondre ou réutiliser les bâtim<strong>en</strong>ts et les matériaux selon les opportunités,<br />
correspondait <strong>en</strong>core à un type <strong>de</strong> comportem<strong>en</strong>t familier <strong>de</strong> l’anci<strong>en</strong>ne société » 52 . Ainsi,<br />
la « gestion » <strong>de</strong>s monum<strong>en</strong>ts n’exclut pas sa <strong>de</strong>struction – officielle –, y compris, pour les<br />
cloches <strong>par</strong> exemple à <strong>de</strong>s fins militaires 53 . À Saint-Lô même, cinq cloches fur<strong>en</strong>t fon<strong>du</strong>es<br />
pour faire <strong>de</strong>s canons. Le bourdon fut quant à lui sauvé, presque <strong>par</strong> miracle : le curé réussit<br />
à convaincre les révolutionnaires que le métal dont il était fait se révélait dangereux, si on<br />
le transformait <strong>en</strong> canon. Partout, la nécessité <strong>du</strong> tri s’imposait. Mais comm<strong>en</strong>t tout gar<strong>de</strong>r ?<br />
Fallait-il tout gar<strong>de</strong>r ?<br />
50. Chanoine Houël, Histoire <strong>de</strong> la ville <strong>de</strong> Saint-Lô, Paris, Res Universis, 1992, p. 151.<br />
51. Ce que Dominique Poulot appelle « le faire-valoir <strong>de</strong> l’action républicaine », in Dominique Poulot, Patrimoine<br />
et mo<strong>de</strong>rnité, Paris, L’Harmattan, 1998, p. 23.<br />
52. Françoise Bercé, Des monum<strong>en</strong>ts historiques au Patrimoine, <strong>du</strong> XVIII e siècle à nos jours ou les égarem<strong>en</strong>ts<br />
<strong>du</strong> cœur et <strong>de</strong> l’esprit, Paris, Flammarion, 2000, p. 17.<br />
53. Les exemples sont innombrables et pas seulem<strong>en</strong>t attachés à cette pério<strong>de</strong> ; on notera que la statue « <strong>La</strong><br />
<strong>La</strong>itière » <strong>de</strong> la Place <strong>du</strong> Marché <strong>de</strong> Saint-Lô fut démontée et fon<strong>du</strong>e p<strong>en</strong>dant la Secon<strong>de</strong> Guerre Mondiale.<br />
Schedae, 2008, prépublication n°10, (p.1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf<br />
13
14<br />
<strong>La</strong> réponse ne saurait être positive, et le choix <strong>du</strong>t toujours être cornéli<strong>en</strong>. Paradoxalem<strong>en</strong>t,<br />
au mom<strong>en</strong>t <strong>de</strong> déci<strong>de</strong>r <strong>de</strong> démolir une église <strong>par</strong>oissiale <strong>par</strong>ce qu’elle était <strong>en</strong> mauvais<br />
état et ne prés<strong>en</strong>tait pas un intérêt <strong>par</strong>ticulier, justifiant d’<strong>en</strong>gager <strong>de</strong>s frais importants <strong>de</strong><br />
restauration, on note une cristallisation <strong>de</strong> l’intérêt <strong>de</strong>s <strong>par</strong>oissi<strong>en</strong>s concernés, et une mobilisation<br />
forte pour la sauver. Du reste, la problématique se pose <strong>en</strong>core <strong>de</strong> nos jours. Mais<br />
dans la confusion, une conception ap<strong>par</strong>aît, qui ne fera jamais machine arrière : le monum<strong>en</strong>t<br />
– au s<strong>en</strong>s premier <strong>du</strong> terme, c’est-à-dire comme témoin, souv<strong>en</strong>ir –, s’il intéressait<br />
jusqu’alors <strong>de</strong>s amateurs, autrem<strong>en</strong>t collectionneurs, <strong>de</strong>s architectes ou <strong>de</strong>s histori<strong>en</strong>s, <strong>de</strong>vint<br />
d’intérêt public. <strong>La</strong> confiscation <strong>de</strong>s bi<strong>en</strong>s <strong>du</strong> clergé, <strong>de</strong>s émigrés fut d’abord une œuvre<br />
visant à ce que Jean-Michel L<strong>en</strong>iaud appelle « une unification volontariste <strong>du</strong> corps social<br />
<strong>en</strong> détruisant les mémoires <strong>par</strong>ticulières et <strong>en</strong> étatisant ce qui relève <strong>de</strong> la culture, <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong>,<br />
<strong>de</strong> la création, <strong>de</strong> l’instruction » 54 .<br />
<strong>La</strong> préoccupation affichée ne fut pas, dans un premier temps, d’ordre purem<strong>en</strong>t sci<strong>en</strong>tifique.<br />
<strong>La</strong> mesure était d’abord conservatoire. Néanmoins, on peut <strong>par</strong>ler d’emblée, pour<br />
citer <strong>de</strong> nouveau Jean-Michel L<strong>en</strong>iaud, d’un « instrum<strong>en</strong>t <strong>de</strong> communication politique » 55 .<br />
C’est à ce mom<strong>en</strong>t précis que la notion <strong>patrimoine</strong> émergea, à l’interface <strong>de</strong> l’histoire, <strong>de</strong><br />
la mémoire, <strong>de</strong> la culture et <strong>de</strong> la politique. L’objectif <strong>de</strong>vint, <strong>en</strong> effet, d’offrir au peuple un<br />
accès à sa propre culture. Une telle ambition justifia la création, <strong>en</strong> 1790, <strong>de</strong> la Commission<br />
<strong>de</strong>s Arts, qui donna <strong>en</strong>suite naissance aux premiers musées et annonça les mesures prises<br />
sous la Monarchie <strong>de</strong> Juillet. « C’est cette conversion <strong>de</strong> la <strong>valeur</strong> d’usage <strong>de</strong>s monum<strong>en</strong>ts <strong>en</strong><br />
une <strong>valeur</strong> é<strong>du</strong>cative susceptible <strong>de</strong> justifier leur conservation qui fon<strong>de</strong> la notion <strong>de</strong> monum<strong>en</strong>t<br />
historique et constitue une vraie nouveauté » 56 écrit Françoise Bercé.<br />
On abor<strong>de</strong> ici un thème délicat, et qui jalonne notre propos, relatif à l’écriture historique.<br />
Si comme cela est évoqué plus haut, nulle histoire n’est objective, il faut bi<strong>en</strong> admettre<br />
que dès lors qu’il s’agit d’une écriture, à <strong>de</strong>stination <strong>de</strong> l’é<strong>du</strong>cation <strong>de</strong>s masses, se pose la<br />
question <strong>de</strong> la manipulation 57 . Dominique Poulot dénonce ceux qui chargerai<strong>en</strong>t le <strong>patrimoine</strong><br />
<strong>de</strong> ce rôle ingrat d’instrum<strong>en</strong>t <strong>de</strong> propagan<strong>de</strong>.<br />
Le <strong>patrimoine</strong> n’est pas un instrum<strong>en</strong>t <strong>de</strong> manipulation <strong>de</strong>s populations, comme d’aucuns le<br />
dénonçai<strong>en</strong>t naguère 58 , non plus que la panacée <strong>du</strong> développem<strong>en</strong>t local, ainsi que d’autres<br />
le rev<strong>en</strong>diquai<strong>en</strong>t 59 . Ce qu’assume, finalem<strong>en</strong>t, le <strong>patrimoine</strong>, c’est qu’il y a bi<strong>en</strong> un s<strong>en</strong>s aux<br />
choses et aux usages 60 .<br />
D’autres, comme Pierre Toubert, mais ils serai<strong>en</strong>t nombreux à pouvoir être cités,<br />
appell<strong>en</strong>t à la vigilance.<br />
Le docum<strong>en</strong>t est un monum<strong>en</strong>t. Il est le résultat <strong>de</strong> l’effort <strong>de</strong>s sociétés historiques pour imposer,<br />
volontairem<strong>en</strong>t ou involontairem<strong>en</strong>t, telle image d’elles-mêmes au futur. Il n’y a pas, à la<br />
limite, <strong>de</strong> docum<strong>en</strong>t-vérité. Tout docum<strong>en</strong>t est m<strong>en</strong>songe. Il ap<strong>par</strong>ti<strong>en</strong>t à l’histori<strong>en</strong>, <strong>en</strong> premier<br />
54. Jean-Michel L<strong>en</strong>iaud, « Vingt-cinq ans d’histoire <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong> », in Philippe Poirrier et Loïc Val<strong>de</strong>lorge<br />
(dir.), Pour une histoire <strong>de</strong>s politiques <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong>, Paris, <strong>La</strong> Docum<strong>en</strong>tation Française, p. 33-44.<br />
55. Ibid.<br />
56. Françoise Bercé, Des monum<strong>en</strong>ts historiques au Patrimoine <strong>du</strong> XVIII e siècle à nos jours ou les égarem<strong>en</strong>ts<br />
<strong>du</strong> cœur et <strong>de</strong> l’esprit, Paris, Flammarion, 2000, p. 17.<br />
57. À l’heure <strong>de</strong> la controverse sur la lecture <strong>de</strong> la lettre <strong>de</strong> Guy Môquet, l’interrogation n’est peut-être pas<br />
inutile.<br />
58. Pr<strong>en</strong>ant l’exemple <strong>de</strong> Massada ou d’Alésia, Patrice Béghain écrit « Le <strong>patrimoine</strong> peut être l’instrum<strong>en</strong>t <strong>de</strong><br />
la manipulation » in Le <strong>patrimoine</strong>, culture et li<strong>en</strong> social, Paris, Presses <strong>de</strong> Sci<strong>en</strong>ces Po, 1998, p. 96.<br />
59. C’est <strong>par</strong> exemple la position <strong>de</strong> Yvon <strong>La</strong>my.<br />
60. Dominique Poulot, Patrimoine et mo<strong>de</strong>rnité, Paris, L’Harmattan, 1998, p. 65.<br />
Schedae, 2008, prépublication n°10, (p. 1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf
lieu, <strong>de</strong> démonter ce montage, <strong>de</strong> distribuer cette construction et d’analyser les conditions <strong>de</strong><br />
pro<strong>du</strong>ction <strong>de</strong> docum<strong>en</strong>ts-monum<strong>en</strong>ts 61 .<br />
Le XIX e fut un siècle <strong>par</strong>ticulièrem<strong>en</strong>t instable politiquem<strong>en</strong>t, <strong>de</strong> ce fait même sujet à<br />
caution <strong>en</strong> regard <strong>de</strong> ce qui précè<strong>de</strong>. <strong>La</strong> France oscillait alors <strong>en</strong>tre république et retour à un<br />
régime monarchique. C’est aussi le temps où, inspirés d’elle, ses voisins comm<strong>en</strong>cèr<strong>en</strong>t à se<br />
structurer politiquem<strong>en</strong>t. L’imagerie nationale, voire nationaliste, s’organisa et alla cresc<strong>en</strong>do.<br />
Ce mouvem<strong>en</strong>t accompagna la révolution in<strong>du</strong>strielle et son corollaire, l’ext<strong>en</strong>sion <strong>de</strong> l’espace<br />
urbain. D’un XVIII e siècle rural et paysan on passa à un XIX e siècle urbain et ouvrier. On pourra<br />
nous objecter le manque <strong>de</strong> nuances dans ces assertions. Il ne s’agit ni d’ignorance <strong>de</strong> la<br />
complexité <strong>de</strong>s phénomènes, étalés dans le temps, ni d’une volonté <strong>de</strong> caricaturer la réalité.<br />
En dégageant les gran<strong>de</strong>s t<strong>en</strong>dances, on compr<strong>en</strong>d mieux la notion <strong>de</strong> mutations 62 . À<br />
l’échelle humaine, un siècle est un temps extrêmem<strong>en</strong>t rapi<strong>de</strong> et les changem<strong>en</strong>ts qui<br />
s’opèr<strong>en</strong>t dans cette pério<strong>de</strong> sont tout à fait évocateurs d’une accélération <strong>du</strong> temps et <strong>de</strong><br />
son appropriation <strong>par</strong> l’homme.<br />
C’est dans la confusion et les soubresauts <strong>de</strong> l’histoire que la Monarchie <strong>de</strong> Juillet<br />
augura <strong>de</strong> la reprise <strong>en</strong> main étatique <strong>de</strong> ce qui est <strong>de</strong>v<strong>en</strong>u bi<strong>en</strong> public. Lorsque fut créé<br />
<strong>en</strong> 1830, sous l’autorité <strong>de</strong> François Guizot alors député et Ministre <strong>de</strong> l’Intérieur, le Service<br />
<strong>de</strong> l’Inv<strong>en</strong>taire général <strong>de</strong>s Monum<strong>en</strong>ts historiques, c’est la c<strong>en</strong>tralisation, ce <strong>par</strong>ticularisme<br />
français 63 , que l’on officialisa. Si la protection était l’une <strong>de</strong>s préoccupations <strong>du</strong> Service<br />
<strong>de</strong> l’Inv<strong>en</strong>taire, il ne faut pas négliger que, souv<strong>en</strong>t, il lui fallut opérer <strong>de</strong>s choix.<br />
Devant la pression démographique, <strong>de</strong>vant l’élargissem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s villes et la nécessité <strong>de</strong>s<br />
ori<strong>en</strong>tations budgétaires, la question <strong>du</strong> passé <strong>de</strong>v<strong>en</strong>ait épineuse. Fallait-il le sacrifier au<br />
nom <strong>du</strong> progrès, l’isoler soit le sanctifier, le fondre dans le nouvel espace ?<br />
Le concept <strong>de</strong> <strong>patrimoine</strong>, qui suppose un impératif moral universellem<strong>en</strong>t <strong>par</strong>tagé, semble<br />
n’appeler que le cons<strong>en</strong>sus, alors même qu’il est le fruit d’une dialectique complexe <strong>de</strong> la conservation<br />
et <strong>de</strong> la <strong>de</strong>struction 64 .<br />
Dans l’œuvre <strong>de</strong> conservation et <strong>de</strong> restauration se posait aussi, et peut-être surtout,<br />
la question <strong>du</strong> style. <strong>La</strong> décontextualisation impose <strong>de</strong> fixer un temps <strong>de</strong> référ<strong>en</strong>ce, celui<br />
qui détermine la <strong>valeur</strong> historique. « Le monum<strong>en</strong>t restauré <strong>de</strong>vait constituer un modèle,<br />
compréh<strong>en</strong>sible <strong>par</strong> tous » 65 . Deux influ<strong>en</strong>ces conditionn<strong>en</strong>t le choix : l’un est établi <strong>en</strong><br />
fonction <strong>de</strong>s époques supposées être phares et pr<strong>en</strong>ant <strong>valeur</strong> <strong>de</strong> modèle ; l’autre incombe<br />
à la personnalité <strong>de</strong>s déci<strong>de</strong>urs. Ainsi, l’histoire, interprétée, <strong>de</strong>vi<strong>en</strong>t qualifiée. Comm<strong>en</strong>t <strong>en</strong><br />
effet retrouver « le vrai » ? Selon Adolphe Napoléon Didron 66 et Ludovic Vitet, le XIX e siècle<br />
était dans l’incapacité <strong>de</strong> trouver son style propre, sa seule voie était <strong>de</strong> copier les styles<br />
anci<strong>en</strong>s, ce qui pro<strong>du</strong>isait l’avantage <strong>de</strong> créer une harmonie <strong>en</strong>tre construction et restauration<br />
61. Pierre Toubert, in Pierre Nora (dir.), Sci<strong>en</strong>ce et consci<strong>en</strong>ce <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong>, Entreti<strong>en</strong>s <strong>du</strong> Patrimoine, 28-<br />
30 novembre 1994, Paris, Éditions <strong>du</strong> Patrimoine, 1994, p. 26.<br />
62. Il ne faut voir ici <strong>de</strong> contradiction avec la critique qui précè<strong>de</strong> dans la mesure où les nous étudierons plus<br />
loin la question non <strong>en</strong> termes <strong>de</strong> dates mais <strong>en</strong> termes <strong>de</strong> pério<strong>de</strong>s.<br />
63. Il prés<strong>en</strong>te pour nous un atout considérable. Les Archives dé<strong>par</strong>tem<strong>en</strong>tales <strong>de</strong> la Manche ayant brûlé, les<br />
docum<strong>en</strong>ts conservés <strong>par</strong> les services <strong>par</strong>isi<strong>en</strong>s constitu<strong>en</strong>t un accès aux sources irremplaçable.<br />
64. Dominique Poulot, Patrimoine et mo<strong>de</strong>rnité, Paris, L’Harmattan, 1997, p. 9.<br />
65. Françoise Bercé, Des monum<strong>en</strong>ts historiques au Patrimoine <strong>du</strong> XVIII e siècle à nos jours ou les égarem<strong>en</strong>ts<br />
<strong>du</strong> cœur et <strong>de</strong> l’esprit, Paris, Flammarion, 2000, p. 46.<br />
66. Adolphe Napoléon Didron (1806-1868) : archéologue, il fut sous la Monarchie <strong>de</strong> Juillet secrétaire <strong>du</strong><br />
comité <strong>de</strong>s travaux historiques au Ministère <strong>de</strong> l’Instruction publique. Professeur d’archéologie sous le<br />
Second Empire, il fonda les Annales archéologiques.<br />
Schedae, 2008, prépublication n°10, (p.1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf<br />
15
16<br />
mais sclérosait la création contemporaine. <strong>La</strong> question se posa à Saint-Lô autour <strong>de</strong> l’église<br />
Notre-Dame au milieu <strong>du</strong> XIX e siècle :<br />
Monsieur le Préfet,<br />
<strong>La</strong> section d’Archéologie compte au nombre <strong>de</strong> ses buts les plus impérieux tout ce qui se rapporte<br />
à la conservation <strong>de</strong>s monum<strong>en</strong>ts religieux ou civils, dont les temps anci<strong>en</strong>s ont couvert<br />
notre pays. À ses yeux, <strong>de</strong>s restaurations faites sans goût et <strong>en</strong> désaccord avec le style architectural<br />
d’un édifice sont moins regrettables que <strong>de</strong>s mutilations ou <strong>de</strong>s dégradations <strong>par</strong><br />
ignorance ou <strong>par</strong> insouciance ; elle s’inquiète donc à bon droit si elle voit <strong>de</strong>s travaux <strong>de</strong> cette<br />
nature et elle croirait se manquer à elle-même, si, dans son impuissance à prév<strong>en</strong>ir le mal, elle<br />
ne le signalait point au moins à l’autorité qui peut les arrêter et les faire même ré<strong>par</strong>er.<br />
Des travaux vi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t tout récemm<strong>en</strong>t d’être exécutés à l’église Notre-Dame <strong>de</strong> Saint-Lô, dans<br />
la chapelle dite <strong>du</strong> Rosaire. <strong>La</strong> simplicité primitive <strong>de</strong> la voûte <strong>de</strong> cette chapelle se trouve<br />
cachée <strong>par</strong> <strong>de</strong> lourds p<strong>en</strong>d<strong>en</strong>tifs attachés au point d’intersection <strong>de</strong>s nervures. On eût dû se<br />
rappeler qu’à une époque peu éloignée, <strong>de</strong>s sculptures <strong>par</strong>eilles avai<strong>en</strong>t été presqu’aussitôt<br />
supprimées qu’exécutées, précisém<strong>en</strong>t <strong>par</strong>ce qu’elles choquai<strong>en</strong>t tous les yeux 67 .<br />
Suivit la création d’une commission pour étudier quel était « le style le plus conv<strong>en</strong>able<br />
à la construction <strong>de</strong>s églises dans notre pays ? Comm<strong>en</strong>t doiv<strong>en</strong>t être <strong>en</strong>t<strong>en</strong><strong>du</strong>es les ré<strong>par</strong>ations<br />
ou restaurations <strong>de</strong> nos anci<strong>en</strong>s monum<strong>en</strong>ts religieux ? » 68 .<br />
Si Didron réclamait le seul sauvetage <strong>de</strong>s bâtim<strong>en</strong>ts et blâmait leur reconstruction, un<br />
Viollet-le-Duc 69 , quant à lui, prônait le remplacem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s élém<strong>en</strong>ts mala<strong>de</strong>s <strong>par</strong> <strong>de</strong>s élém<strong>en</strong>ts<br />
id<strong>en</strong>tiques.<br />
Il faut laisser les monum<strong>en</strong>ts dans l’état où ils sont et se cont<strong>en</strong>ter <strong>de</strong> les consoli<strong>de</strong>r ou <strong>de</strong> les<br />
empêcher <strong>de</strong> tomber. Une restauration, quelque intellig<strong>en</strong>te qu’elle soit, est rarem<strong>en</strong>t utile à<br />
un édifice. Pour une restauration bi<strong>en</strong> faite il y <strong>en</strong> a c<strong>en</strong>t déplorables 70 .<br />
Avec Prosper Mérimée 71 , Viollet-le-Duc a instauré, à la tête <strong>de</strong>s Monum<strong>en</strong>ts historiques,<br />
<strong>en</strong>tre 1848 et 1870, ce que Jean-Michel L<strong>en</strong>iaud s’autorise à appeler un véritable<br />
« lobby ». On retrouve leur credo dans leur correspondance, passionnant objet d’étu<strong>de</strong>,<br />
publié et comm<strong>en</strong>té <strong>par</strong> Françoise Bercé 72 . Dans une vision idéalisée et nostalgique, passéiste<br />
certainem<strong>en</strong>t, ils s’insurgeai<strong>en</strong>t contre les villes riches et commerçantes qui « ont<br />
démoli leurs anci<strong>en</strong>nes murailles, leurs jolies maisons, leurs bâtim<strong>en</strong>ts municipaux, pour<br />
remplacer tout cela <strong>par</strong> <strong>de</strong>s édifices sans nom et que l’on ne voit qu’à regret si l’on songe<br />
à tous les trésors per<strong>du</strong>s » 73 .<br />
<strong>La</strong> ville <strong>de</strong> Lyon offre un exemple éclairant <strong>de</strong>s difficultés r<strong>en</strong>contrées au XIX e pour<br />
l’aménagem<strong>en</strong>t <strong>du</strong> territoire 74 . Florissante <strong>de</strong>puis l’Antiquité, la ville ne cessa « <strong>de</strong> reconstruire<br />
67. Extrait d’une lettre <strong>du</strong> Commandant <strong>La</strong>marche, vice-présid<strong>en</strong>t <strong>de</strong> la Société d’Agriculture, d’Archéologie<br />
et d’Histoire Naturelle <strong>du</strong> dé<strong>par</strong>tem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> la Manche au préfet <strong>de</strong> la Manche, datée <strong>du</strong> 3 mars 1845, in<br />
Charles <strong>de</strong> Gerville, Voyage archéologique dans la Manche (1818-1820), Tome 2, Saint-Lô, Société<br />
d’Archéologie et d’Histoire <strong>de</strong> la Manche, 2000, p. 314-315.<br />
68. Ibid., p. 315.<br />
69. Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879) : architecte, ami <strong>de</strong> Prosper Mérimée qui lui confie la restauration<br />
d’édifices religieux <strong>de</strong> r<strong>en</strong>om (abbaye <strong>de</strong> Vézelay, Notre-Dame <strong>de</strong> Paris, Basilique <strong>de</strong> Saint-D<strong>en</strong>is, etc.).<br />
70. Cité <strong>par</strong> Françoise Bercé, Des monum<strong>en</strong>ts historiques au Patrimoine <strong>du</strong> XVIII e siècle à nos jours ou les<br />
égarem<strong>en</strong>ts <strong>du</strong> cœur et <strong>de</strong> l’esprit, Paris, Flammarion, 2000, p. 37.<br />
71. Prosper Mérimée (1803-1870) : succè<strong>de</strong> à Ludovic Vitet au poste d’Inspecteur général <strong>de</strong>s Monum<strong>en</strong>ts<br />
historiques.<br />
72. Françoise Bercé, <strong>La</strong> correspondance Mérimée-Viollet-le-Duc, Paris, Éditions <strong>du</strong> CHTS, 2001, 301 pages.<br />
73. Extrait d’une lettre <strong>de</strong> Viollet-le-Duc à Mérimée, datée <strong>du</strong> 23 avril 1843.<br />
74. Nathalie Mathian, « Quelques jalons dans la protection <strong>du</strong> tissu urbain à Lyon », in Philippe Poirrier et Loïc<br />
Val<strong>de</strong>lorge (dir.), Pour une histoire <strong>de</strong>s politiques <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong>, Paris, <strong>La</strong> Docum<strong>en</strong>tation Française, 2003,<br />
p. 123-145.<br />
Schedae, 2008, prépublication n°10, (p. 1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf
sur elle-même sous l’Anci<strong>en</strong> Régime ». Après 1793, et jusqu’au milieu <strong>du</strong> XIX e siècle, elle<br />
fut la proie d’une <strong>de</strong>struction méthodique. <strong>La</strong> topographie, la pression urbaine, les principes<br />
hygiénistes mêmes sont autant <strong>de</strong> facteurs disputant leur légitimité aux monum<strong>en</strong>ts.<br />
Devant la dis<strong>par</strong>ition <strong>de</strong> ses quartiers historiques, un s<strong>en</strong>tim<strong>en</strong>t <strong>de</strong> nostalgie se fit jour, <strong>en</strong><br />
<strong>par</strong>ticulier sous l’impulsion d’un r<strong>en</strong>ouveau <strong>du</strong> catholicisme. À la démolition ou à la réaffectation<br />
<strong>de</strong>s bâtim<strong>en</strong>ts, étai<strong>en</strong>t opposés la nostalgie, l’évocation <strong>du</strong> « Vieux Lyon » 75 . Ce n’est<br />
réellem<strong>en</strong>t qu’au début <strong>du</strong> XX e que le cons<strong>en</strong>sus semble avoir été définitivem<strong>en</strong>t 76 trouvé<br />
avec la définition <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux espaces : la ville poursuivrait son ext<strong>en</strong>sion tout <strong>en</strong> conservant<br />
ses quartiers.<br />
L’exemple ret<strong>en</strong>u ici ne doit pas ap<strong>par</strong>aître étrange. Bi<strong>en</strong> que très rapi<strong>de</strong>m<strong>en</strong>t évoqué,<br />
il a été pesé et doit nourrir la réflexion <strong>de</strong> notre cas d’étu<strong>de</strong> : quelle que soit la taille <strong>de</strong> la<br />
ville concernée, Lyon, carrefour économique, ou Saint-Lô, préfecture d’un dé<strong>par</strong>tem<strong>en</strong>t<br />
rural, l’époque donnée, dans un cas le XIX e siècle dans l’autre le XX e , ou <strong>en</strong>fin la cause <strong>de</strong><br />
la <strong>de</strong>struction, l’in<strong>du</strong>strialisation ou la Secon<strong>de</strong> Guerre Mondiale, le <strong>patrimoine</strong> est aussi, et<br />
peut-être surtout, une affaire s<strong>en</strong>tim<strong>en</strong>tale. « Les périls sembl<strong>en</strong>t être une <strong>de</strong>s conditions<br />
nécessaires à la prise <strong>de</strong> consci<strong>en</strong>ce patrimoniale <strong>de</strong>s citoy<strong>en</strong>s » 77 , pas toujours compatible<br />
dans l’Histoire avec la dim<strong>en</strong>sion économique. Mais les temps chang<strong>en</strong>t et lorsque, comme<br />
aujourd’hui, cette dim<strong>en</strong>sion intègre le champ <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong>, non <strong>en</strong> termes <strong>de</strong> dép<strong>en</strong>ses,<br />
mais d’investissem<strong>en</strong>t, c’est tout le concept <strong>de</strong> <strong>mise</strong> <strong>en</strong> <strong>valeur</strong> qu’il faut reconsidérer.<br />
Patrimoine et République : vers un <strong>patrimoine</strong> total<br />
En visite à Ami<strong>en</strong>s pour le lancem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s « Journées <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong> », le jeudi 14 septembre<br />
2006, le Premier ministre Dominique <strong>de</strong> Villepin 78 soulignait l’attachem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s Français<br />
à leur <strong>patrimoine</strong> :<br />
Cet attachem<strong>en</strong>t, il ne tra<strong>du</strong>it pas une quelconque nostalgie <strong>du</strong> passé. C’est au contraire un<br />
attachem<strong>en</strong>t vivant, fermem<strong>en</strong>t ancré dans notre époque, dans les <strong>en</strong>jeux et les interrogations<br />
que suscite la mondialisation. Les Français veul<strong>en</strong>t avancer. Ils sont ambitieux pour leur av<strong>en</strong>ir<br />
et celui <strong>de</strong> leurs <strong>en</strong>fants. Mais ils ne veul<strong>en</strong>t pas r<strong>en</strong>oncer à leur id<strong>en</strong>tité ni aux <strong>valeur</strong>s qu’ils<br />
ont héritées <strong>de</strong> l’histoire. Dans nos archives, dans nos musées, sur les pierres anci<strong>en</strong>nes nous<br />
cherchons non seulem<strong>en</strong>t ce que nous sommes mais aussi ce que nous <strong>de</strong>vons être et ce que<br />
nous voulons <strong>de</strong>v<strong>en</strong>ir 79 .<br />
Plus loin, il déclarait <strong>en</strong>core :<br />
Aujourd’hui, alors que notre société semble <strong>par</strong>fois <strong>en</strong> perte <strong>de</strong> repères, la place <strong>de</strong> notre<br />
<strong>patrimoine</strong> est plus importante que jamais 80 .<br />
On voit bi<strong>en</strong> ici que le s<strong>en</strong>s premier <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong> est conservé mais que son champ est<br />
ét<strong>en</strong><strong>du</strong>. Les termes d’« <strong>en</strong>jeux », <strong>de</strong> « mondialisation » révèl<strong>en</strong>t pleinem<strong>en</strong>t les nouveaux pouvoirs,<br />
et on le verra, les <strong>de</strong>voirs, qui lui sont conférés. Longtemps synonyme <strong>de</strong> « monum<strong>en</strong>ts<br />
75. Pour la première fois semble-t-il <strong>en</strong> 1843, sous la plume <strong>de</strong> H. Leymarie.<br />
76. L’éboulem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> la colline <strong>de</strong> Fourvière, <strong>en</strong> 1930, donna toutefois lieu à <strong>de</strong>s affrontem<strong>en</strong>ts <strong>en</strong>tre les <strong>de</strong>ux<br />
camps.<br />
77. Françoise Bercé, Des monum<strong>en</strong>ts historiques au Patrimoine <strong>du</strong> XVIII e siècle à nos jours ou les égarem<strong>en</strong>ts<br />
<strong>du</strong> cœur et <strong>de</strong> l’esprit, Paris, Flammarion, 2000, p. 51.<br />
78. Il était accompagné <strong>de</strong> R<strong>en</strong>aud Donnedieu <strong>de</strong> Vabres, Ministre <strong>de</strong> la Culture et <strong>de</strong> la Communication,<br />
qu’il a alors prés<strong>en</strong>té comme très attaché à sa mission <strong>de</strong> déf<strong>en</strong>se <strong>de</strong> « la place <strong>de</strong> la culture, <strong>de</strong> la création<br />
et <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong> ».<br />
79. http://www.culture.gouv.fr/culture/actualités/.<br />
80. Ibid.<br />
Schedae, 2008, prépublication n°10, (p.1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf<br />
17
18<br />
historiques », le <strong>patrimoine</strong> est aujourd’hui <strong>de</strong>v<strong>en</strong>u <strong>culturel</strong> 81 . Le prés<strong>en</strong>t développem<strong>en</strong>t<br />
vise à montrer qu’il est ess<strong>en</strong>tiellem<strong>en</strong>t <strong>en</strong>visagé selon le critère <strong>de</strong> sa valorisation. Ainsi,<br />
nous verrons que toute politique <strong>de</strong> conservation, <strong>de</strong> restauration est <strong>en</strong>t<strong>en</strong><strong>du</strong>e <strong>de</strong> ce point<br />
<strong>de</strong> vue. <strong>La</strong> fin <strong>du</strong> XX e siècle a vu une accélération phénoménale, un emballem<strong>en</strong>t, <strong>de</strong> la<br />
<strong>valeur</strong> patrimoniale. Cette <strong>de</strong>rnière est tout à la fois politique et économique, et impose au<br />
sci<strong>en</strong>tifique <strong>de</strong> réévaluer son positionnem<strong>en</strong>t, dans le champ nouveau <strong>de</strong> la culture. Avant<br />
d’<strong>en</strong> examiner les <strong>en</strong>jeux, indép<strong>en</strong>damm<strong>en</strong>t les uns <strong>de</strong>s autres, et d’<strong>en</strong> montrer les interactions,<br />
il convi<strong>en</strong>t <strong>de</strong> s’attar<strong>de</strong>r quelque peu sur les origines <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rniers développem<strong>en</strong>ts<br />
<strong>de</strong> son s<strong>en</strong>s.<br />
<strong>La</strong> longue pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> la III e et <strong>de</strong> la IV e Républiques est ess<strong>en</strong>tielle, et son étu<strong>de</strong> fut<br />
précieuse pour la construction et l’articulation <strong>de</strong> notre p<strong>en</strong>sée. Néanmoins, ce n’est pas<br />
dans cet intervalle que se manifest<strong>en</strong>t les mutations les plus visibles, celles qui nous amèn<strong>en</strong>t<br />
au traitem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> notre problématique. Elle est marquée, pour l’ess<strong>en</strong>tiel, <strong>par</strong> le r<strong>en</strong>forcem<strong>en</strong>t<br />
<strong>du</strong> rôle et <strong>du</strong> poids <strong>de</strong> l’État dans la gestion d’un <strong>patrimoine</strong>, incontestablem<strong>en</strong>t<br />
<strong>en</strong>tré dans le champ public. Jean-Michel L<strong>en</strong>iaud <strong>par</strong>le <strong>de</strong> la « fabrication <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong> <strong>de</strong><br />
l’État-nation » 82 . En attest<strong>en</strong>t certaines mesures prises comme la Loi <strong>de</strong> 1887 qui autorise la<br />
démolition d’un édifice sans nécessité préalable d’expropriation. À la veille <strong>de</strong> la Première<br />
Guerre Mondiale, la légitimité <strong>de</strong> l’État est ét<strong>en</strong><strong>du</strong>e à la déf<strong>en</strong>se <strong>de</strong> l’intérêt public et non plus<br />
au seul intérêt national. Les conséqu<strong>en</strong>ces directes <strong>en</strong> sont : le classem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> 4800 monum<strong>en</strong>ts,<br />
la c<strong>en</strong>tralisation <strong>de</strong>s procé<strong>du</strong>res, et <strong>du</strong> même coup l’effacem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> l’action locale,<br />
communes comme associations <strong>de</strong> bénévoles.<br />
Déjà, à la fin <strong>du</strong> XIX e siècle, « la <strong>valeur</strong> impro<strong>du</strong>ctive passée passe dans le registre <strong>de</strong> la<br />
<strong>valeur</strong> pro<strong>du</strong>ctive marchan<strong>de</strong> » 83 . Ceci autorise un Maurice Barrès, toujours prompt à dénoncer<br />
les manquem<strong>en</strong>ts au <strong>de</strong>voir patriotique <strong>de</strong> l’État, à déf<strong>en</strong>dre les églises « qui sont lai<strong>de</strong>s,<br />
dédaignées, qui ne rapport<strong>en</strong>t ri<strong>en</strong> aux chemins <strong>de</strong> fer, qui ne font pas vivre les aubergistes» 84 .<br />
L’exagération <strong>du</strong> propos ne doit pas masquer ce que conti<strong>en</strong>t <strong>en</strong> germe la politique patrimoniale.<br />
Si l’on transpose ses <strong>par</strong>oles au temps prés<strong>en</strong>t, on <strong>en</strong> admettra la pertin<strong>en</strong>ce. <strong>La</strong><br />
lecture d’Aloïs Riegl 85 fait égalem<strong>en</strong>t état pour la pério<strong>de</strong> d’une fétichisation <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong>.<br />
Au début <strong>du</strong> siècle <strong>de</strong>rnier, il dépeignait la « généralisation <strong>du</strong> concept <strong>de</strong> monum<strong>en</strong>t »,<br />
qu’il interprétait comme le triomphe d’un s<strong>en</strong>s <strong>du</strong> passé, d’un temps écoulé qui con<strong>du</strong>it à<br />
la « ré<strong>du</strong>ction constante et inévitable <strong>de</strong> la <strong>valeur</strong> monum<strong>en</strong>tale objective » au profit <strong>de</strong><br />
l’objet « le plus signifiant <strong>par</strong> son matériau, sa fortune, sa facture et sa fonction ».<br />
Ceci doit être inscrit dans le contexte <strong>de</strong> la radicalisation <strong>en</strong> Europe <strong>du</strong> s<strong>en</strong>tim<strong>en</strong>t nationaliste,<br />
<strong>en</strong> <strong>de</strong>s temps où Histoire et mémoire se mélangèr<strong>en</strong>t. Les sources sont à cet égard<br />
sans ambiguïté et tout à fait éclairantes. Ce qui se tramait d’important était diffus, déroulé<br />
dans ce qui allait <strong>de</strong>v<strong>en</strong>ir l’obsession <strong>de</strong>s déc<strong>en</strong>nies à v<strong>en</strong>ir : l’é<strong>du</strong>cation <strong>de</strong>s masses. Dans<br />
cette <strong>en</strong>treprise, l’école <strong>de</strong> la République et les loisirs d’une masse ouvrière étai<strong>en</strong>t donc<br />
concernés au premier plan. Parlant <strong>du</strong> « Dictionnaire pédagogique » <strong>de</strong> Ferdinand Buisson,<br />
Pierre Nora résume tout à fait la mission dévolue à l’instituteur sous la IIIe République :<br />
À qui voudrait saisir, dans toute la rigueur <strong>de</strong> son <strong>en</strong>chaînem<strong>en</strong>t mais aussi dans l’infinie richesse<br />
<strong>de</strong> ses constellations, le li<strong>en</strong> absolu qui unit tout droit la Révolution à la République, la République<br />
à la raison, la raison à la démocratie, la démocratie à l’é<strong>du</strong>cation et qui <strong>de</strong> proche <strong>en</strong><br />
81. Le <strong>patrimoine</strong> est ici considéré dans sa seule acception <strong>de</strong> « public ».<br />
82. Jean-Michel L<strong>en</strong>iaud, « Ving-cinq ans d’Histoire <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong> », in Philippe Poirrier et Loïc Val<strong>de</strong>lorge<br />
(dir.), Pour une histoire <strong>de</strong>s politiques <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong>, Paris, <strong>La</strong> Docum<strong>en</strong>tation française, 2003, p. 33-44.<br />
83. Sur cette question, lire, Yvon <strong>La</strong>my « Patrimoine et culture : l’institutionnalisation », ibid., p. 45-63.<br />
84. Maurice Barrès, <strong>La</strong> gran<strong>de</strong> pitié <strong>de</strong>s églises <strong>de</strong> France, Paris, Émile-Paul, 1914, 309 pages.<br />
85. Aloïs Riegl, Le culte mo<strong>de</strong>rne <strong>de</strong>s monum<strong>en</strong>ts : son ess<strong>en</strong>ce et sa g<strong>en</strong>èse, Paris, Éditions <strong>du</strong> Seuil, 1984,<br />
122 pages.<br />
Schedae, 2008, prépublication n°10, (p. 1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf
proche, fait donc reposer sur l’instruction primaire l’id<strong>en</strong>tité même <strong>de</strong> l’être national, on conseillerait<br />
son ouvrage et s’il fallait n’<strong>en</strong> élire qu’un seul, <strong>en</strong> définitive, celui-ci 86 .<br />
On pourra aussi citer un Ernest <strong>La</strong>visse que Pierre Nora qualifie d’« instituteur national » 87<br />
<strong>en</strong>seignant aux <strong>en</strong>fants : « Vous, <strong>en</strong>fants <strong>du</strong> peuple, sachez que vous appr<strong>en</strong>ez l’histoire pour<br />
graver dans vos cœurs l’amour <strong>de</strong> votre pays ». Ce n’est <strong>du</strong> reste pas la seule « histoire » <strong>en</strong><br />
tant que « matière » ou « discipline » qui était concernée : l’amour <strong>de</strong> la patrie se glissait<br />
dans les dictées, que les élèves s’appliquai<strong>en</strong>t, peu ou prou, à écrire sans faute, lors <strong>de</strong>s<br />
épreuves <strong>du</strong> Certificat d’étu<strong>de</strong>s primaires. On trouve <strong>par</strong>tout ce thème <strong>de</strong> la Revanche à<br />
pr<strong>en</strong>dre sur la défaite <strong>de</strong> 1870. Afin d’évoquer le rôle <strong>de</strong> l’Histoire et <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong> dans<br />
l’é<strong>du</strong>cation <strong>de</strong>s <strong>en</strong>fants <strong>de</strong> la République, on citera <strong>en</strong>fin « Le Tour <strong>de</strong> France <strong>par</strong> <strong>de</strong>ux<br />
<strong>en</strong>fants », Augustine Fouillée dite G. Bruno, que Jacques et Mona Ozouf appell<strong>en</strong>t « Le<br />
petit Livre rouge <strong>de</strong> la République » : <strong>en</strong> 1871, <strong>de</strong>ux orphelins lorrains franchir<strong>en</strong>t clan<strong>de</strong>stinem<strong>en</strong>t<br />
la frontière, à la recherche leur oncle et leur mère 88 . C’est dans ce livre que les<br />
<strong>en</strong>fants <strong>du</strong> cours moy<strong>en</strong> apprir<strong>en</strong>t la lecture et, ce faisant, l’histoire et la géographie 89 . <strong>La</strong><br />
France n’a-t-elle d’ailleurs pas per<strong>du</strong> l’Alsace et la Lorraine <strong>par</strong>ce que ses jeunes soldats ne<br />
connaissai<strong>en</strong>t pas bi<strong>en</strong> l’Histoire ?<br />
Monsieur,<br />
Vous avez adressé <strong>de</strong>rnièrem<strong>en</strong>t trois lettres au peuple itali<strong>en</strong>. Ces lettres, qui ont <strong>par</strong>u<br />
d’abord dans les journaux <strong>de</strong> Milan et qui ont été <strong>en</strong>suite réunies <strong>en</strong> brochure, sont un véritable<br />
manifeste contre notre nation. Vous avez quitté vos étu<strong>de</strong>s historiques pour attaquer la<br />
France ; je quitte les mi<strong>en</strong>nes pour vous répondre.<br />
[…]<br />
Ce qui distingue les nations, ce n’est ni la race, ni la langue. Les hommes s<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t dans leur<br />
cœur qu’ils sont un même peuple lorsqu’ils ont une communauté d’idées, d’intérêts, d’affections,<br />
<strong>de</strong> souv<strong>en</strong>irs et d’espérances. Voilà ce qui fait la patrie. Voilà pourquoi les hommes veul<strong>en</strong>t<br />
marcher <strong>en</strong>semble, <strong>en</strong>semble travailler, <strong>en</strong>semble combattre, vivre et mourir les uns pour<br />
les autres. <strong>La</strong> patrie, c’est ce qu’on aime. Il se peut que l’Alsace soit alleman<strong>de</strong> <strong>par</strong> la race et<br />
<strong>par</strong> le langage ; mais <strong>par</strong> la nationalité et le s<strong>en</strong>tim<strong>en</strong>t <strong>de</strong> la patrie elle est française. Et savezvous<br />
ce qui l’a r<strong>en</strong><strong>du</strong>e française ? Ce n’est pas Louis XIV, c’est notre Révolution <strong>de</strong> 1789. Depuis<br />
ce mom<strong>en</strong>t, I’Alsace a suivi toutes nos <strong>de</strong>stinées ; elle a vécu <strong>de</strong> notre vie. Tout ce que nous<br />
p<strong>en</strong>sions, elle le p<strong>en</strong>sait ; tout ce que nous s<strong>en</strong>tions, elle le s<strong>en</strong>tait. Elle a <strong>par</strong>tagé nos victoires et<br />
nos revers, notre gloire et nos fautes, toutes nos joies et toutes nos douleurs. Elle n’a ri<strong>en</strong> eu <strong>de</strong><br />
commun avec vous. <strong>La</strong> patrie, pour elle, c’est la France. L’étranger, pour elle, c’est l’Allemagne 90 .<br />
Dans l’écriture <strong>de</strong> notre chronologie, il faut égalem<strong>en</strong>t ret<strong>en</strong>ir les <strong>de</strong>ux événem<strong>en</strong>ts<br />
d’importance majeure que fur<strong>en</strong>t, d’une <strong>par</strong>t la Loi <strong>de</strong> 1905 fixant la sé<strong>par</strong>ation <strong>de</strong> l’Église<br />
et <strong>de</strong> l’État, d’autre <strong>par</strong>t la Première Guerre Mondiale. L’État, <strong>de</strong>v<strong>en</strong>u laïque, <strong>de</strong>vait dorénavant<br />
distinguer Église et église. Ceci ne fut pas sans conséqu<strong>en</strong>ce sur les édifices religieux,<br />
<strong>en</strong> <strong>par</strong>ticulier si l’on considère les terribles dégâts causés <strong>par</strong> la Gran<strong>de</strong> Guerre sur le <strong>patrimoine</strong><br />
bâti. Ce que Françoise Bercé appelle « la ferveur pour les cathédrales meurtries » 91<br />
86. Pierre Nora, « le dictionnaire <strong>de</strong> pédagogie <strong>de</strong> Ferdinand Buisson, cathédrale <strong>de</strong> l’école primaire », in<br />
Pierre Nora (dir.), Les lieux <strong>de</strong> mémoire, Tome 1, Paris, Gallimard, p. 327 ; on notera que Viollet-le-Duc<br />
contribue à la rédaction <strong>du</strong> chapitre sur l’architecture et que <strong>La</strong>visse rédige celui d’« Histoire ».<br />
87. Pierre Nora, « Le Petit <strong>La</strong>visse, évangile <strong>de</strong> la République », in Pierre Nora (dir.), Les lieux <strong>de</strong> mémoire,<br />
Tome 1, Paris, Gallimard, p. 269.<br />
88. L’oncle porte le nom <strong>du</strong> père tandis que la mère est <strong>en</strong> réalité la France.<br />
89. Jacques et Mona Ozouf <strong>par</strong>l<strong>en</strong>t d’un « art <strong>de</strong> la mémoire », in Pierre Nora (dir.), Les lieux <strong>de</strong> mémoire,<br />
Tome 1, Paris, Gallimard, p. 269.<br />
90. Extrait <strong>de</strong> la correspondance <strong>en</strong>tre Fustel <strong>de</strong> Coulanges et Momms<strong>en</strong>, tous <strong>de</strong>ux histori<strong>en</strong>s ; ici, la lettre<br />
<strong>de</strong> réponse <strong>de</strong> Fustel <strong>de</strong> Coulanges à Momms<strong>en</strong>, datée <strong>du</strong> 27 octobre 1870.<br />
91. Françoise Bercé, Des monum<strong>en</strong>ts historiques au <strong>patrimoine</strong> <strong>du</strong> XVIII e siècle à nos jours ou les égarem<strong>en</strong>ts<br />
<strong>du</strong> cœur et <strong>de</strong> l’esprit, Paris, Flammarion, 2000, p. 65.<br />
Schedae, 2008, prépublication n°10, (p.1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf<br />
19
20<br />
se vérifie pour la Première comme pour la Secon<strong>de</strong> Guerre Mondiale. Même laïcisée, la<br />
nation pleure la profanation, la violation <strong>de</strong> l’espace sacré, et se remémore ses racines<br />
judéo-chréti<strong>en</strong>nes. Nous revi<strong>en</strong>drons sur ce thème dans les pages consacrées à Saint-Lô.<br />
Si, jusqu’<strong>en</strong> 1914, l’école primaire <strong>de</strong> Jules Ferry mit <strong>en</strong> place, <strong>par</strong> l’<strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s<br />
fondam<strong>en</strong>taux, ce que Jean-Pierre Rioux appelle la « rhétorique commémorative », il ne faut<br />
pas négliger l’importance <strong>de</strong> l’<strong>en</strong>trée progressive <strong>de</strong> la société in<strong>du</strong>strielle dans l’ère <strong>du</strong><br />
loisir. Considérons d’abord le temps <strong>du</strong> seul point <strong>de</strong> vue quantitatif. Le XIX e siècle fut <strong>par</strong>tagé<br />
sur la bi<strong>en</strong>faisance <strong>du</strong> temps libre 92 . « Le loisir n’est pas une forme <strong>de</strong> temporalité qui<br />
va <strong>de</strong> soi » 93 . S’opposai<strong>en</strong>t déjà les libéraux prônant la <strong>valeur</strong> <strong>du</strong> travail, le loisir représ<strong>en</strong>tant<br />
son « négatif », autant dire un manque à gagner, et les socialistes pour lesquels, le travail<br />
aliénant la classe ouvrière, celle-ci <strong>de</strong>vait s’inscrire dans une « activité libre et créatrice » 94 .<br />
De proche <strong>en</strong> proche, la fin <strong>du</strong> XIX e et tout le XX e siècles vir<strong>en</strong>t progressivem<strong>en</strong>t s’inscrire<br />
le loisir dans la société <strong>du</strong> travail. Nous n’énumérerons pas l’<strong>en</strong>semble <strong>de</strong>s lois adoptées et<br />
<strong>de</strong>s mesures prises, relatives à l’amélioration <strong>de</strong>s conditions <strong>de</strong> travail et à la diminution <strong>de</strong><br />
sa <strong>du</strong>rée. Toutefois, nous reti<strong>en</strong>drons, pour mémoire, la création <strong>de</strong>s congés payés <strong>de</strong> 1936<br />
ét<strong>en</strong><strong>du</strong>s à cinq semaines <strong>en</strong> 1982, la semaine <strong>de</strong>s tr<strong>en</strong>te-cinq heures <strong>en</strong> 1998. Effet inatt<strong>en</strong><strong>du</strong> :<br />
déchargés <strong>par</strong> le progrès technique <strong>de</strong>s tâches les plus harassantes et les plus rébarbatives,<br />
rapprochés <strong>du</strong> mon<strong>de</strong> qui les <strong>en</strong>toure <strong>par</strong> la révolution <strong>de</strong>s transports et <strong>de</strong>s (télé) communications,<br />
nos contemporains sont obsédés <strong>par</strong> la course au temps.<br />
Dans une formulation synthétique, Jean-Clau<strong>de</strong> G<strong>en</strong>et-Delacroix juge que :<br />
« L’État […] stimule la croissance <strong>en</strong> libéralisant et <strong>en</strong> mo<strong>de</strong>rnisant les facteurs <strong>de</strong> pro<strong>du</strong>ction.<br />
Surtout, il agit sur les processus <strong>de</strong> diffusion et <strong>de</strong> consommation <strong>par</strong> la politique pédagogique,<br />
la démocratisation <strong>du</strong> goût et la socialisation patrimoniale » 95 .<br />
Se conjugu<strong>en</strong>t <strong>en</strong> effet, sur la pério<strong>de</strong>, une élévation moy<strong>en</strong>ne <strong>du</strong> niveau <strong>de</strong> vie et <strong>du</strong><br />
niveau d’instruction, l’<strong>en</strong>semble créant autant d’appels d’air pour davantage <strong>de</strong> temps<br />
libre, <strong>de</strong> temps <strong>de</strong> loisirs. Sans nous éloigner aucunem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> notre sujet, ces considérations<br />
nous amèn<strong>en</strong>t, au contraire, à approcher ce qui est au cœur <strong>du</strong> problème <strong>de</strong> la <strong>mise</strong><br />
<strong>en</strong> <strong>valeur</strong> <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong> : ses publics. <strong>La</strong> question est tout à fait complexe et oblige à croiser<br />
les regards sur les <strong>par</strong>amètres qui détermin<strong>en</strong>t à la fois leurs natures, leurs pratiques,<br />
leurs att<strong>en</strong>tes.<br />
Les généralités qui précèd<strong>en</strong>t ne peuv<strong>en</strong>t faire écran aux inégalités sociales, inhér<strong>en</strong>tes<br />
au modèle économique libéral. Il n’est question ici ni <strong>de</strong> contester la validité <strong>du</strong> modèle ni<br />
d’<strong>en</strong> examiner à la loupe les fon<strong>de</strong>m<strong>en</strong>ts théoriques. Nous nous bornerons pour notre analyse<br />
à dresser <strong>de</strong>s constats, <strong>en</strong> nous appuyant fortem<strong>en</strong>t sur les différ<strong>en</strong>tes étu<strong>de</strong>s <strong>du</strong> Ministère<br />
<strong>de</strong> la Culture et <strong>de</strong> la Communication, dirigées <strong>par</strong> Olivier Donnat sur les pratiques <strong>culturel</strong>les<br />
<strong>de</strong>s Français, sur les tr<strong>en</strong>te <strong>de</strong>rnières années 96 . Pour cela, une fois <strong>en</strong>core, il nous faut rev<strong>en</strong>ir<br />
92. Les débats actuels sur le temps <strong>de</strong> travail montr<strong>en</strong>t que la question n’est pas définitivem<strong>en</strong>t tranchée.<br />
93. R<strong>en</strong>é Teboul, Culture et loisir dans la société <strong>du</strong> temps libre, Paris, L’Aube, 2004, p. 40.<br />
94. Ibid. p. 40.<br />
95. Jean-Clau<strong>de</strong> G<strong>en</strong>et-Delacroix, « <strong>La</strong> richesse <strong>de</strong>s Beaux-Arts républicains », in Jean-Pierre Rioux et Jean-<br />
François Sirinelli (dir.), Pour une Histoire <strong>culturel</strong>le, Paris, Éditions <strong>du</strong> Seuil, 1997, p. 215.<br />
96. Lire notamm<strong>en</strong>t, Olivier Donnat et D<strong>en</strong>is Cogneau, Les pratiques <strong>culturel</strong>les <strong>de</strong>s Français : 1973-1989,<br />
Ministère <strong>de</strong> la culture et <strong>de</strong> la communication, <strong>La</strong> Docum<strong>en</strong>tation Française, Paris, <strong>La</strong> Découverte, 1992,<br />
285 pages et Olivier Donnat, Regards croisés sur les pratiques <strong>culturel</strong>les, Ministère <strong>de</strong> la culture et <strong>de</strong> la<br />
communication, <strong>La</strong> Docum<strong>en</strong>tation Française, Paris, <strong>La</strong> Découverte, 2003, 348 pages. <strong>La</strong> lecture <strong>de</strong> ces<br />
travaux est indisp<strong>en</strong>sable à quiconque souhaite explorer le thème <strong>de</strong> la médiation <strong>culturel</strong>le, mais on la<br />
conseillera plus généralem<strong>en</strong>t à tous ceux qui souhaiterai<strong>en</strong>t faire tomber <strong>de</strong>s idées reçues sur le thème<br />
<strong>de</strong> l’accès à la culture. Les étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> l’INSEE que nous avons <strong>par</strong>courues et qui ne seront pas citées ici,<br />
pour ne pas alourdir le texte, sont elles-mêmes très éclairantes et arriv<strong>en</strong>t aux mêmes conclusions.<br />
Schedae, 2008, prépublication n°10, (p. 1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf
sur un siècle républicain afin <strong>de</strong> saisir dans quelle mesure et <strong>de</strong> quelle manière, d’hier à<br />
aujourd’hui, le <strong>patrimoine</strong> a pu s’ancrer au cœur <strong>de</strong>s pratiques <strong>culturel</strong>les <strong>de</strong>s Français.<br />
Dans l’école <strong>de</strong> Jules Ferry, la masse <strong>de</strong>vint alphabétisée, mais, pour l’ess<strong>en</strong>tiel, elle<br />
fut cantonnée au socle primaire : le lycée, et a fortiori l’université, restai<strong>en</strong>t réservés « à la<br />
repro<strong>du</strong>ction tacite <strong>de</strong> la notabilité et <strong>de</strong> sa culture », « à la fine fleur ». Au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> l’école,<br />
c’est surtout à la croissance <strong>de</strong> l’imprimé, <strong>par</strong> voie <strong>de</strong> presse, qu’il faut reconnaître d’avoir<br />
permis une diffusion <strong>du</strong> savoir. C’est l’espace social qui se re<strong>de</strong>ssinait sous la plume <strong>de</strong>s<br />
journalistes : <strong>de</strong> la vie locale à la gran<strong>de</strong> politique, la nouvelle <strong>de</strong>v<strong>en</strong>ait universelle. Elle était<br />
aussi presque instantanée. Avec elle, c’est aussi la p<strong>en</strong>sée, l’opinion qui se diffusèr<strong>en</strong>t et<br />
s’étalèr<strong>en</strong>t dans les journaux : à cet égard, l’Affaire Dreyfus marqua indiscutablem<strong>en</strong>t un tournant<br />
dans le combat pour la liberté d’expression. C’est égalem<strong>en</strong>t à ce mom<strong>en</strong>t qu’ap<strong>par</strong>ut<br />
la notion d’intellectuel, que la politique ne fut plus l’affaire <strong>de</strong>s seuls représ<strong>en</strong>tants <strong>de</strong>s<br />
citoy<strong>en</strong>s dans la république qui s’<strong>en</strong>racinait. Au fur et à mesure que le progrès technique a<br />
raccourci le temps <strong>de</strong> diffusion, le citoy<strong>en</strong> a accru l’espace couvert <strong>par</strong> l’information et a<br />
éprouvé le besoin grandissant <strong>de</strong> se l’approprier. Informé <strong>en</strong> un temps qui lui laisse aujourd’hui<br />
tout loisir d’interférer dans la prise <strong>de</strong> décision, <strong>par</strong> le forum ou le blog, il <strong>en</strong> <strong>de</strong>vi<strong>en</strong>t l’acteur 97 .<br />
C’est ici qu’intervi<strong>en</strong>t une fois <strong>en</strong>core la question <strong>de</strong> l’égalité face au savoir et à la culture.<br />
Les guerres et le temps qui les sé<strong>par</strong>e ont apporté leur lot d’émancipation, d’évolutions<br />
politiques et comportem<strong>en</strong>tales, chaque fois élargissant le cercle <strong>de</strong>s initiés. On peut <strong>par</strong>ler<br />
d’un grand tournant à la fin <strong>de</strong>s années 1950, avec la création <strong>du</strong> Ministère <strong>de</strong>s Affaires<br />
<strong>culturel</strong>les, et l’<strong>en</strong>trée sur la scène gouvernem<strong>en</strong>tale, d’André Malraux. Il donna une impulsion<br />
qui ne fut jamais profondém<strong>en</strong>t re<strong>mise</strong> <strong>en</strong> cause <strong>par</strong> ses successeurs à la tête <strong>du</strong> Ministère,<br />
quelle que soit leur ap<strong>par</strong>t<strong>en</strong>ance politique. On a tout dit <strong>de</strong> ce personnage haut <strong>en</strong><br />
couleurs, sur sa manière <strong>de</strong> faire, on a même <strong>par</strong>lé d’un « royaume farfelu » 98 . Sa personnalité<br />
hors <strong>du</strong> commun, son imm<strong>en</strong>se érudition, et le souti<strong>en</strong> sans faille que lui accordait le<br />
Général <strong>de</strong> Gaulle au pouvoir, l’autorisèr<strong>en</strong>t pourtant à bousculer la tradition, à imposer un<br />
nouveau regard sur la culture et son <strong>par</strong>tage. En 1967, il déclarait :<br />
Il faudra bi<strong>en</strong> admettre qu’un jour on aura fait pour la culture ce que Jules Ferry a fait pour<br />
l’instruction : la culture sera gratuite 99 .<br />
C’est ainsi qu’il rompit avec le dogme <strong>de</strong>s Beaux-Arts et prôna une démocratisation<br />
<strong>de</strong> la culture, qu’il voulait égalitaire. Refusant tout académisme et tout pédagogisme, son<br />
credo était celui <strong>de</strong> la confrontation directe à l’œuvre. Il disait lui-même proscrire « la con<strong>de</strong>sc<strong>en</strong>dance<br />
tout autant que le paternalisme ».<br />
Le musée est une œuvre anci<strong>en</strong>ne qui trouve ses racines dans les premières collections<br />
privées <strong>de</strong> l’Anci<strong>en</strong> Régime mais qui naît réellem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> la Révolution française. Les bi<strong>en</strong>s<br />
confisqués aurai<strong>en</strong>t pour vocation d’é<strong>du</strong>quer le peuple. Dès 1792, fut évoquée l’idée <strong>de</strong><br />
créer un musée <strong>par</strong> dé<strong>par</strong>tem<strong>en</strong>t, afin, dans un effort <strong>de</strong> proximité, <strong>de</strong> r<strong>en</strong>dre accessible aux<br />
citoy<strong>en</strong>s leur culture. <strong>La</strong> vision fut d’abord toute <strong>par</strong>isi<strong>en</strong>ne et instaurait une fausse déc<strong>en</strong>tralisation<br />
: le <strong>par</strong>tage <strong>culturel</strong> serait hiérarchisé, la capitale et ses grands musées <strong>de</strong>vant, <strong>en</strong><br />
toute logique, recevoir les plus belles et les plus importantes collections :<br />
Il est question <strong>de</strong> faire un Muséum aux galeries <strong>du</strong> Louvre. Il est décrété, et comme Ministre<br />
<strong>de</strong> l’Intérieur, j’<strong>en</strong> suis l’ordonnateur et le surveillant. J’<strong>en</strong> dois compte à la nation. Tel est<br />
l’esprit <strong>de</strong> la loi. C’<strong>en</strong> est aussi la lettre. Le Muséum doit être le développem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s gran<strong>de</strong>s<br />
97. Sur cette question, lire Frédéric Barbier, L’histoire <strong>de</strong>s médias, <strong>de</strong> Di<strong>de</strong>rot à l’Internet, Paris, Armand Colin,<br />
2000, 398 pages.<br />
98. Philippe Poirrier, L’État et la culture <strong>en</strong> France au XX e siècle, Paris, Le Livre <strong>de</strong> Poche, 2006, 258 pages.<br />
99. Nous revi<strong>en</strong>drons plus loin sur cette question épineuse <strong>de</strong> la gratuité dans la diffusion <strong>de</strong> la culture.<br />
Schedae, 2008, prépublication n°10, (p.1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf<br />
21
22<br />
richesses que possè<strong>de</strong> la nation <strong>en</strong> <strong>de</strong>ssins, peintures, sculptures et autres monum<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> l’art.<br />
Ainsi que je le conçois, il doit attirer les étrangers et fixer leur att<strong>en</strong>tion. Il doit nourrir le goût<br />
<strong>de</strong>s Beaux-Arts, recréer les amateurs et servir d’école aux artistes. Il doit être ouvert à tout le<br />
mon<strong>de</strong>. Ce monum<strong>en</strong>t sera national. Il ne sera pas un indivi<strong>du</strong> qui n’ait le droit d’<strong>en</strong> jouir. Il<br />
aura un tel <strong>de</strong>gré d’asc<strong>en</strong>dant sur les esprits, il élèvera tellem<strong>en</strong>t les âmes, il réchauffera tellem<strong>en</strong>t<br />
les cœurs, qu’il sera un <strong>de</strong>s plus puissants moy<strong>en</strong>s d’illustrer la République française 100 .<br />
Si la décision fut nuancée et que le musée le plus proche <strong>de</strong>vait finalem<strong>en</strong>t être privilégié,<br />
il y aurait beaucoup à dire sur l’état actuel <strong>de</strong> la culture <strong>en</strong> région com<strong>par</strong>ée à celle <strong>de</strong><br />
Paris. Nous n’<strong>en</strong>trerons cep<strong>en</strong>dant pas dans le débat, nourri <strong>par</strong> une littérature prolifique,<br />
mais revi<strong>en</strong>drons plus loin sur le fond <strong>de</strong> la question, <strong>en</strong> termes d’offre et <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>.<br />
Avec le Ministère Malraux fut donc posée la question, toujours actuelle, <strong>de</strong> la démocratisation<br />
<strong>de</strong> la culture. Comm<strong>en</strong>t <strong>en</strong> effet passer d’une d’élite <strong>culturel</strong>le à une culture <strong>de</strong><br />
masse ? Et que signifie culture <strong>de</strong> masse ? Les politiques <strong>culturel</strong>les achopp<strong>en</strong>t toujours sur<br />
ces questions. Il semble que, face à l’échec <strong>de</strong> la mission <strong>culturel</strong>le <strong>de</strong> l’école, la culture<br />
elle-même soit contrainte d’une <strong>par</strong>t à l’autosuffisance ; d’autre <strong>par</strong>t, et plus étonnant, elle<br />
<strong>en</strong>dosse la mission é<strong>du</strong>cative d’une école qui ne remplit pas toutes ses promesses. Pourtant,<br />
le bilan d’Olivier Donnat est terrible :<br />
<strong>La</strong> fin <strong>du</strong> XIXe siècle avait fait <strong>de</strong> l’école la principale instance <strong>de</strong>s savoirs et <strong>de</strong>s représ<strong>en</strong>tations<br />
<strong>du</strong> mon<strong>de</strong>, et avait vu l’émerg<strong>en</strong>ce d’un champ artistique largem<strong>en</strong>t autonome, plus dégagé<br />
<strong>de</strong>s finalités religieuses ou sociales dans lesquelles il était inscrit jusqu’alors. <strong>La</strong> fin <strong>du</strong> XXe siècle<br />
a vu à bi<strong>en</strong> <strong>de</strong>s égards un éclatem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> ce double dispositif au point qu’on peut aujourd’hui<br />
se <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r si la <strong>par</strong><strong>en</strong>thèse qui avait été alors ouverte n’est pas déjà refermée 101 .<br />
Journaux, radio, puis télévision et <strong>en</strong>fin Internet sont maint<strong>en</strong>ant à la portée <strong>de</strong> tous.<br />
Mais pour quel cont<strong>en</strong>u ? Pour quel usage ? Et <strong>en</strong>fin la pot<strong>en</strong>tialité se confond-elle avec la<br />
réalité ? Des Maisons <strong>de</strong> la culture au TNP <strong>de</strong> Jean Vilar (<strong>de</strong>v<strong>en</strong>u Théâtre national <strong>de</strong> Chaillot),<br />
la démocratisation a fait son œuvre, mais toutes les <strong>en</strong>quêtes sérieuses montr<strong>en</strong>t qu’il faut<br />
distinguer les g<strong>en</strong>res. <strong>La</strong> catégorie professionnelle et son corollaire le niveau <strong>de</strong> rev<strong>en</strong>us,<br />
l’origine sociale sont souv<strong>en</strong>t avancés pour mesurer les discriminations à la culture. S’il veut<br />
être pertin<strong>en</strong>t, le champ <strong>de</strong> l’observation doit être ét<strong>en</strong><strong>du</strong> à d’autres critères, y compris à<br />
celui <strong>de</strong> la géographie spatiale.<br />
Les mesures prises jusqu’alors ont été pour l’ess<strong>en</strong>tiel d’ordre économique. On p<strong>en</strong>sait<br />
que la culture était une affaire <strong>de</strong> moy<strong>en</strong>s, un poste <strong>de</strong> dép<strong>en</strong>ses et que, pour les personnes<br />
disposant d’un faible niveau <strong>de</strong> vie, elle était superflue. Il suffirait donc d’agir sur le levier<br />
financier. Il faut se r<strong>en</strong>dre à l’évid<strong>en</strong>ce : la gratuité ou les tarifs préfér<strong>en</strong>tiels pratiqués <strong>par</strong><br />
les théâtres, et autres musées 102 ne sont pas la seule réponse possible 103 . On peut se risquer<br />
100. Extrait d’une lettre <strong>du</strong> Ministre <strong>de</strong> l’Intérieur Roland, au peintre David, datée <strong>du</strong> 17 octobre 1792.<br />
101. Olivier Donnat, Les Français face à la culture: <strong>de</strong> l’exclusion à l’éclectisme, Paris, <strong>La</strong> Découverte, 1994, p. 127.<br />
102. En janvier 2000, Catherine Trautmann, Ministre <strong>de</strong> la Culture et <strong>de</strong> la Communication lançait l’ouverture<br />
gratuite <strong>de</strong>s musées nationaux, le premier dimanche <strong>de</strong> chaque mois dans 23 musées nationaux d’Ile-<strong>de</strong>-<br />
France et 11 <strong>en</strong> régions. Pour la Ministre, « <strong>La</strong> culture doit être un élém<strong>en</strong>t moteur <strong>du</strong> mouvem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> la<br />
société, au cœur <strong>de</strong> la cité, au plus près <strong>du</strong> quotidi<strong>en</strong> […]. Démocratiser l’accès à la culture ce n’est pas<br />
adapter la culture à un public large mais susciter un désir <strong>de</strong> culture, <strong>en</strong>core très minoritaire aujourd’hui.<br />
Il ne s’agit pas seulem<strong>en</strong>t d’élargir la base sociale <strong>de</strong>s publics <strong>de</strong> la culture <strong>en</strong> favorisant l’accès <strong>du</strong> plus<br />
grand nombre aux lieux et œuvres reconnues, mais <strong>de</strong> pr<strong>en</strong>dre <strong>en</strong> considération les pratiques <strong>culturel</strong>les<br />
<strong>de</strong>s Français, <strong>de</strong> les accompagner dans leurs aspirations au savoir et à la connaissance ». De manière<br />
expérim<strong>en</strong>tale, la mesure est ét<strong>en</strong><strong>du</strong>e au premier semestre 2008 à la gratuité d’accès aux collections perman<strong>en</strong>tes<br />
<strong>de</strong> quatorze musées nationaux (sous conditions). http://www.culture.gouv.fr/culture.<br />
103. L’étu<strong>de</strong> com<strong>par</strong>ée avec <strong>de</strong>s pays comme l’Allemagne ou l’Angleterre t<strong>en</strong>d à montrer que la gratuité ellemême<br />
est une culture. <strong>La</strong> France ne possédant pas cette culture, ses habitants manifest<strong>en</strong>t plutôt une<br />
démarche opportuniste.<br />
Schedae, 2008, prépublication n°10, (p. 1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf
à <strong>par</strong>ler d’une société plurielle tant on mesure l’abîme qui existe <strong>en</strong>tre les composantes d’une<br />
même nation. En se p<strong>en</strong>chant sur les travaux d’Olivier Donnat 104 , on lit ce constat d’échec :<br />
Certes, le niveau monte, mais l’amélioration <strong>de</strong>s conditions <strong>de</strong> vie et les transformations <strong>de</strong>s<br />
conditions d’accès aux savoirs et aux œuvres n’ont pas permis la réalisation <strong>du</strong> projet <strong>de</strong> démocratisation<br />
qui avait justifié, à la fin <strong>de</strong>s années cinquante, d’un Ministère <strong>de</strong>s Affaires Culturelles<br />
105 . Le niveau <strong>de</strong> vie est tout à fait ess<strong>en</strong>tiel mais les statistiques montr<strong>en</strong>t que le milieu social<br />
dans lequel on grandit est plus déterminant <strong>en</strong>core. Une analyse synthétique <strong>de</strong>s résultats publiés<br />
montre qu’<strong>en</strong> dépit <strong>de</strong> toutes les mesures prises, 15 % <strong>de</strong>s Français sont jugés totalem<strong>en</strong>t exclus<br />
<strong>de</strong> la culture. À l’exception <strong>de</strong> la télévision et <strong>de</strong> la presse régionale, ces personnes n’ont jamais<br />
eu accès au mon<strong>de</strong> <strong>de</strong> la culture. À mieux regar<strong>de</strong>r la composition sociale <strong>de</strong> ce groupe, on<br />
remarque qu’elles sont dépourvues <strong>de</strong> diplômes, âgées et rurales. On note aussi que cela concerne<br />
40 % <strong>de</strong> la population <strong>de</strong>s retraités <strong>de</strong> l’agriculture et <strong>de</strong>s ouvriers. Si l’on comptabilise<br />
<strong>en</strong> outre les 31 % <strong>de</strong> la catégorie <strong>de</strong>s démunis <strong>culturel</strong>lem<strong>en</strong>t on constate que presque la moitié<br />
<strong>de</strong> la population française évolue hors <strong>du</strong> champ <strong>de</strong> la culture. À l’autre extrémité, ceux<br />
qu’Olivier Donnat appelle les branchés représ<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t une frange <strong>de</strong> 8 %, qui se recrute pour<br />
plus <strong>de</strong> la moitié <strong>par</strong>mi les 25/44 ans, diplômés <strong>de</strong> l’<strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>t supérieur. En l’abs<strong>en</strong>ce <strong>de</strong><br />
toute évolution structurelle significative, doit-on <strong>par</strong>ler d’un « épuisem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s utopies » 106 ?<br />
On a, à la lecture <strong>de</strong> ce qui précè<strong>de</strong>, <strong>de</strong>s raisons objectives <strong>de</strong> s’interroger voire <strong>de</strong><br />
s’inquiéter sur le rôle é<strong>du</strong>catif <strong>de</strong> l’école, mais aussi sur la vertu <strong>de</strong> la culture à rassembler<br />
les hommes dans une société dominée <strong>par</strong> le rationalisme, comme le prét<strong>en</strong>dait André<br />
Malraux : <strong>en</strong> 2002, le Ministre <strong>de</strong> la Culture, Jean-Jacques Aillagon, adressait à Catherine<br />
Clém<strong>en</strong>t une lettre <strong>de</strong> mission, qu’il débutait <strong>en</strong> ces termes :<br />
<strong>La</strong> télévision est avec l’école, le seul moy<strong>en</strong> <strong>de</strong> toucher chacun <strong>de</strong> nos concitoy<strong>en</strong>s, <strong>de</strong> faire<br />
naître <strong>en</strong> lui le désir et le goût <strong>de</strong> la culture, d’éveiller la s<strong>en</strong>sibilité <strong>de</strong>s jeunes, <strong>de</strong> favoriser<br />
l’intégration <strong>par</strong> la diffusion d’une culture commune 107 .<br />
Le constat est clair : l’élite s’oppose toujours à la masse et la culture <strong>de</strong> masse<br />
<strong>de</strong>meure une culture populaire.<br />
Certes, une politique <strong>culturel</strong>le n’a pas pour seul objectif <strong>de</strong> coller à la vie mouvante <strong>de</strong> la<br />
société : elle déf<strong>en</strong>d avant tout la création, elle conserve la mémoire 108 . Mais elle ne saurait<br />
plus longtemps être décalée <strong>par</strong> rapport aux mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> vie sans perdre une <strong>par</strong>tie <strong>de</strong> son<br />
ancrage dans la réalité contemporaine 109 .<br />
Ce que l’on appelle couramm<strong>en</strong>t le niveau <strong>culturel</strong> détermine assez largem<strong>en</strong>t les conditions<br />
<strong>de</strong> réception <strong>de</strong> l’œuvre et les modalités <strong>de</strong>s pratiques <strong>culturel</strong>les 110 .<br />
Faut-il r<strong>en</strong>oncer à l’idée selon laquelle, le peuple, é<strong>du</strong>qué, <strong>par</strong>tagerait les mêmes<br />
<strong>valeur</strong>s que l’élite ? Le temps et les moy<strong>en</strong>s déployés n’ont pas permis la réussite <strong>de</strong> ce<br />
grand projet humaniste, hérité <strong>du</strong> siècle <strong>de</strong>s Lumières. C’est désormais à la culture <strong>de</strong><br />
s’adapter à la <strong>de</strong>man<strong>de</strong>, non point simplem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> termes d’accessibilité géographique ou<br />
104. Olivier Donnat et D<strong>en</strong>is Cogneau, Les pratiques <strong>culturel</strong>les <strong>de</strong>s Français : 1973-1989, Ministère <strong>de</strong> la culture<br />
et <strong>de</strong> la communication, <strong>La</strong> Docum<strong>en</strong>tation Française, Paris, <strong>La</strong> Découverte, 1992, 285 pages.<br />
105. Olivier Donnat, Les Français face à la culture : <strong>de</strong> l’exclusion à l’éclectisme, Paris, <strong>La</strong> Découverte, 1994, p. 10.<br />
106. Olivier Donnat, Les Français face à la culture : <strong>de</strong> l’exclusion à l’éclectisme, Paris, <strong>La</strong> Découverte, 1994,<br />
p. 364.<br />
107. http://www.culture.gouv.fr/culture.<br />
108. Les auteurs repr<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t ici les points forts sur lesquels s’appuyait la politique d’André Malraux.<br />
109. Olivier Donnat et D<strong>en</strong>is Cogneau, Les pratiques <strong>culturel</strong>les <strong>de</strong>s Français : 1973-1989, Ministère <strong>de</strong> la culture<br />
et <strong>de</strong> la communication, <strong>La</strong> Docum<strong>en</strong>tation Française, Paris, <strong>La</strong> Découverte, 1992, 285 pages.<br />
110. Olivier Donnat, Les Français face à la culture : <strong>de</strong> l’exclusion à l’éclectisme, Paris, <strong>La</strong> Découverte, 1994, p. 16.<br />
Schedae, 2008, prépublication n°10, (p.1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf<br />
23
24<br />
économique mais <strong>en</strong> termes <strong>de</strong> cont<strong>en</strong>u. « Le <strong>patrimoine</strong>, c’est un facteur <strong>de</strong> cohésion et<br />
<strong>de</strong> fraternité. Ce sont <strong>de</strong>s <strong>valeur</strong>s que l’on <strong>par</strong>tage, <strong>de</strong>s principes que l’on respecte. C’est<br />
aussi un av<strong>en</strong>ir que l’on construit <strong>en</strong>semble » 111 déclarait Dominique <strong>de</strong> Villepin. Ainsi, le<br />
<strong>patrimoine</strong>, cette somme <strong>de</strong> <strong>valeur</strong>s sur laquelle s’est construite la nation, sur laquelle elle<br />
a prospéré et doit continuer à prospérer, semble investi d’une mission.<br />
<strong>La</strong> France est <strong>de</strong>v<strong>en</strong>ue une terre <strong>de</strong> commémoration 112 . On peut considérer que c’est<br />
avec la célébration <strong>du</strong> Bic<strong>en</strong>t<strong>en</strong>aire <strong>de</strong> la Révolution française, symbole fort, que l’impulsion<br />
a été donnée. Chaque année représ<strong>en</strong>te une occasion nouvelle <strong>de</strong> se souv<strong>en</strong>ir : <strong>du</strong><br />
Soixantième anniversaire <strong>du</strong> Débarquem<strong>en</strong>t au c<strong>en</strong>tième anniversaire <strong>de</strong> la mort <strong>de</strong> Jules<br />
Verne, la France se remémore, et surtout commémore, ses gran<strong>de</strong>s heures, ses grands<br />
hommes. L’histoire est <strong>de</strong>v<strong>en</strong>ue une manifestation, l’occasion d’un mom<strong>en</strong>t <strong>de</strong> fête. C’est<br />
le s<strong>en</strong>s <strong>de</strong>s « Journées <strong>du</strong> Patrimoine », créées <strong>en</strong> 1984 et qui ont rassemblé <strong>en</strong> 2007, sur<br />
le thème <strong>de</strong> « Les Métiers <strong>du</strong> Patrimoine » plus <strong>de</strong> 12 millions <strong>de</strong> visiteurs – chiffre <strong>de</strong> fréqu<strong>en</strong>tation<br />
<strong>de</strong>v<strong>en</strong>u constant ces <strong>de</strong>rnières années – dans plus <strong>de</strong> 15 000 sites et 20 000 animations<br />
113 . Couronnée <strong>de</strong> succès, la formule est ét<strong>en</strong><strong>du</strong>e aujourd’hui à 48 pays d’Europe.<br />
Il suffit <strong>de</strong> se p<strong>en</strong>cher sur la presse locale pour illustrer à la fois l’<strong>en</strong>gouem<strong>en</strong>t populaire<br />
et ce qui ressemble, <strong>du</strong> point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong> l’histori<strong>en</strong>, à une dérive <strong>mise</strong> <strong>en</strong> place et cautionnée<br />
<strong>par</strong> le pouvoir politique. Lors <strong>de</strong>s Journées <strong>de</strong> septembre 2006, dont le thème<br />
était « Faisons vivre notre <strong>patrimoine</strong> », les bayeusains ont pu visiter l’église Saint-Patrice<br />
grâce à l’Association <strong>de</strong>s Amis <strong>de</strong> l’Église Saint-Patrice, qui œuvre à « la <strong>par</strong>faite conservation<br />
et à l’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> <strong>de</strong> l’église ainsi qu’à l’animation <strong>de</strong> l’édifice <strong>en</strong> <strong>de</strong>hors <strong>du</strong> culte » 114 . À<br />
Bricqueville, l’Office <strong>de</strong> Tourisme d’Omaha Beach proposait une visite guidée dans les rues<br />
<strong>du</strong> village, commune <strong>du</strong> <strong>par</strong>c <strong>de</strong>s marais <strong>du</strong> Cot<strong>en</strong>tin et <strong>du</strong> Bessin. « Un verre <strong>de</strong> l’amitié »<br />
<strong>de</strong>vait clôturer la prom<strong>en</strong>a<strong>de</strong> 115 . Plus étonnante, et toujours dans le cadre <strong>de</strong>s Journées <strong>du</strong><br />
Patrimoine 2006 à Bayeux, la prestation <strong>de</strong> « Radio Bazarnaom » et <strong>de</strong> « la Famille Magnifique »<br />
offrant aux spectateurs « leur théâtre <strong>de</strong> rue » et <strong>de</strong>s visites « <strong>par</strong> <strong>de</strong>s animateurs spéciaux<br />
<strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong> » 116 .<br />
Le <strong>de</strong>rnier exemple développé <strong>par</strong> le journal relate les « séances d’initiation aux sci<strong>en</strong>ces<br />
et délices <strong>du</strong> chocolat et <strong>du</strong> thé ». Si Val<strong>en</strong>tine Tibère, spécialiste <strong>de</strong> la question apportait<br />
sa caution sci<strong>en</strong>tifique à l’affaire, et que les visiteurs ont pu se régaler, on ne peut<br />
s’empêcher <strong>de</strong> p<strong>en</strong>ser à une opération marketing, confessée à <strong>de</strong>mi-mots <strong>par</strong> le rédacteur<br />
<strong>de</strong> l’article :<br />
Les seigneurs d’Argouges n’ont pas fini <strong>de</strong> faire <strong>par</strong>ler d’eux et <strong>de</strong> promouvoir leur domaine,<br />
classé Monum<strong>en</strong>t historique, l’une <strong>de</strong>s plus antiques et <strong>en</strong>voûtantes <strong>de</strong>meures <strong>du</strong> Bessin,<br />
habitée <strong>par</strong> une Fée millénaire. Pour preuve le magazine TV <strong>de</strong> France 3 sera consacré au<br />
Manoir d’Argouges ce v<strong>en</strong>dredi 15 septembre <strong>en</strong> soirée 117 .<br />
On mesure à travers ce qui précè<strong>de</strong> combi<strong>en</strong> la vocation patrimoniale a évolué et<br />
<strong>en</strong>tre <strong>de</strong> plein fouet dans le secteur marchand. Pour alim<strong>en</strong>ter le concept, l’ouverture<br />
sémantique est infinie, <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong> bâti au <strong>patrimoine</strong> immatériel, <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong> <strong>culturel</strong><br />
au <strong>patrimoine</strong> naturel. Plus <strong>en</strong>core, sa dim<strong>en</strong>sion est mouvante :<br />
111. http://www.culture.gouv.fr/culture.<br />
112. En février 2007, dans le revue <strong>de</strong> l’Institut National <strong>du</strong> Patrimoine, Pierre Nora fustigeait « la dilatation<br />
phénoménale <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong> possible, […] si bi<strong>en</strong> que tout, d’une certaine façon, est frappé <strong>du</strong> signe <strong>du</strong><br />
mémorable ».<br />
113. http://www.journees<strong>du</strong><strong>patrimoine</strong>.gouv.fr/.<br />
114. <strong>La</strong> Manche Libre, 17/9/2006, p. 9.<br />
115. <strong>La</strong> Manche Libre, 17/9/2006, p. 9.<br />
116. Ibid.<br />
117. Ibid.<br />
Schedae, 2008, prépublication n°10, (p. 1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf
Notre <strong>patrimoine</strong> est vivant, il se métamorphose, au fur et à mesure et à mesure <strong>de</strong>s créations<br />
qui l’<strong>en</strong>richiss<strong>en</strong>t. Il évolue avec le temps. Il ne se limite pas aux seuls monum<strong>en</strong>ts historiques,<br />
aussi importants et aussi nombreux soi<strong>en</strong>t-ils. Je p<strong>en</strong>se <strong>en</strong> <strong>par</strong>ticulier aux musées, mais aussi<br />
au <strong>patrimoine</strong> <strong>de</strong> proximité, au <strong>patrimoine</strong> <strong>du</strong> XXe siècle, au <strong>patrimoine</strong> in<strong>du</strong>striel, au <strong>patrimoine</strong><br />
immatériel, au <strong>patrimoine</strong> écrit, à la numérisation <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong> 118 .<br />
On peut douter <strong>de</strong> l’int<strong>en</strong>tion même <strong>de</strong> la naissance <strong>de</strong> ces Journées: précédées <strong>en</strong> 1980<br />
<strong>de</strong> l’Année <strong>du</strong> Patrimoine, elles sont ap<strong>par</strong>ues dans un contexte politique, où Jean-Philippe<br />
Lecat vit, <strong>en</strong> 1978, son Ministère se scin<strong>de</strong>r – signe <strong>de</strong>s temps – <strong>en</strong> un Ministère <strong>de</strong> la Culture<br />
et <strong>de</strong> l’Environnem<strong>en</strong>t. Parce que, selon lui, « a priori tout <strong>de</strong>vrait être considéré comme<br />
élém<strong>en</strong>t <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong> », il jugea opportun <strong>de</strong> créer une Direction <strong>du</strong> Patrimoine. Alors que<br />
le contexte semblait défavorable, puisque l’on se situait alors à la veille d’une élection présid<strong>en</strong>tielle,<br />
la proposition fut très bi<strong>en</strong> accueillie et remporta le succès qu’on lui connaît 119 .<br />
<strong>La</strong> régionalisation allait permettre une déconc<strong>en</strong>tration <strong>de</strong>s pouvoirs, une déc<strong>en</strong>tralisation<br />
<strong>de</strong>s prises <strong>de</strong> décisions. Elle allait aussi signifier un dés<strong>en</strong>gagem<strong>en</strong>t financier progressif et<br />
<strong>du</strong>rable <strong>en</strong> faveur <strong>de</strong>s collectivités locales. Ces <strong>de</strong>rnières, dans une économie dont la pro<strong>du</strong>ction<br />
se dématérialise sont dans une perman<strong>en</strong>te quête <strong>de</strong> la <strong>mise</strong> <strong>en</strong> <strong>valeur</strong> <strong>de</strong> leur territoire.<br />
Sous cette impulsion, celui-ci <strong>de</strong>vait <strong>de</strong>v<strong>en</strong>ir terroir, à mettre <strong>en</strong> <strong>valeur</strong>, sous le vocable<br />
<strong>de</strong> <strong>patrimoine</strong> <strong>culturel</strong>. Le processus nous allons le voir ci-<strong>de</strong>ssous est toujours actif.<br />
À <strong>en</strong> croire les politiques, l’<strong>en</strong>jeu est crucial, la mémoire est un pilier 120 . À <strong>en</strong> croire les<br />
histori<strong>en</strong>s, le péril m<strong>en</strong>ace, la mémoire est un prétexte. Pour les <strong>de</strong>ux, le <strong>patrimoine</strong> est<br />
une opportunité.<br />
Quand une autre manière <strong>de</strong> l’être <strong>en</strong>semble se sera <strong>mise</strong> <strong>en</strong> place, quand on aura fini <strong>de</strong> se<br />
fixer la ligne <strong>de</strong> ce que l’on appellera même plus l’id<strong>en</strong>tité, le besoin aura dis<strong>par</strong>u d’exhumer<br />
les repères et d’explorer les lieux. L’ère <strong>de</strong> la commémoration sera définitivem<strong>en</strong>t close. <strong>La</strong><br />
tyrannie <strong>de</strong> la mémoire n’aura <strong>du</strong>ré qu’un temps, mais c’était le nôtre 121 .<br />
Faut-il sauver la culture ? Le <strong>patrimoine</strong> ? Les acteurs finiront-ils <strong>par</strong> s’<strong>en</strong>t<strong>en</strong>dre et se<br />
développer conjointem<strong>en</strong>t pour le bi<strong>en</strong> <strong>de</strong> tous ? Pour t<strong>en</strong>ter <strong>de</strong> répondre à ces interrogations,<br />
il est nécessaire <strong>de</strong> consacrer un développem<strong>en</strong>t <strong>par</strong>ticulier aux <strong>en</strong>jeux qui se tram<strong>en</strong>t<br />
autour <strong>de</strong> la question <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong>.<br />
Les <strong>en</strong>jeux <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong><br />
Une (nouvelle) manne économique<br />
On pourra s’étonner <strong>du</strong> choix opéré <strong>de</strong> traiter la question <strong>de</strong>s ressorts économiques<br />
<strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong>, avant <strong>de</strong> l’<strong>en</strong>visager sous son angle purem<strong>en</strong>t <strong>culturel</strong>. Les extraits <strong>de</strong> discours<br />
qui précèd<strong>en</strong>t <strong>en</strong> attest<strong>en</strong>t – morceaux choisis, certes, mais non isolés, prélevés dans<br />
une masse abondante 122 – son exploitation représ<strong>en</strong>te un atout majeur <strong>de</strong> développem<strong>en</strong>t.<br />
118. Discours <strong>de</strong> R<strong>en</strong>aud Donnedieu <strong>de</strong> Vabres à l’occasion <strong>de</strong> son audition <strong>de</strong>vant la Mission d’information sur<br />
la conservation et l’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong> à l’Assemblée nationale, le 13/9/2006, http://www.cult.gouv.fr/<br />
culture.<br />
119. Le Ministère <strong>La</strong>ng a poursuivi dans le s<strong>en</strong>s <strong>de</strong>s gran<strong>de</strong>s manifestations populaires <strong>culturel</strong>les <strong>en</strong> créant « la<br />
Fête <strong>de</strong> la Musique », et autre « Fête <strong>du</strong> Cinéma », et dont on connaît le succès ret<strong>en</strong>tissant.<br />
120. « Id<strong>en</strong>tité, mémoire, <strong>patrimoine</strong> : les trois mots clés <strong>de</strong> la consci<strong>en</strong>ce contemporaine, les trois faces <strong>du</strong><br />
nouveau contin<strong>en</strong>t culture », Pierre Nora, Les lieux <strong>de</strong> mémoire, Tome 4, Paris, Gallimard, 1997, p. 4713.<br />
121. Pierre Nora (dir.), Les lieux <strong>de</strong> mémoire, Tome 4, Paris, Gallimard, p. 4715.<br />
122. Il a précisém<strong>en</strong>t été préféré <strong>de</strong> sélectionner un nombre restreint <strong>de</strong> discours politiques afin <strong>de</strong> montrer<br />
combi<strong>en</strong> le propos conc<strong>en</strong>tre les <strong>en</strong>jeux et les prés<strong>en</strong>te <strong>en</strong> interaction. Il ne faudrait pas <strong>en</strong> dé<strong>du</strong>ire une<br />
<strong>par</strong>tialité politique : la sélection est le seul fruit d’une volonté <strong>de</strong> coller aux développem<strong>en</strong>ts les plus<br />
actuels <strong>de</strong> l’objet <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong>.<br />
Schedae, 2008, prépublication n°10, (p.1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf<br />
25
26<br />
Ce n’est, <strong>du</strong> reste, pas tant la nouveauté <strong>de</strong> la dim<strong>en</strong>sion économique qui reti<strong>en</strong>t notre<br />
att<strong>en</strong>tion, puisque, dès 1963 123 , la culture était intégrée aux plans quinqu<strong>en</strong>naux, que<br />
l’ampleur <strong>du</strong> phénomène. « Le <strong>patrimoine</strong> c’est le pétrole <strong>de</strong> la France » 124 , il est <strong>de</strong>v<strong>en</strong>u<br />
« une richesse et un outil <strong>de</strong> développem<strong>en</strong>t économique social et <strong>culturel</strong> » 125 . C’est <strong>en</strong><br />
<strong>par</strong>ticulier dans le secteur <strong>du</strong> tourisme 126 que l’ess<strong>en</strong>tiel se joue. Pour Rachid Amirou, « le<br />
tourisme est <strong>de</strong>v<strong>en</strong>u une pratique <strong>culturel</strong>le comme une autre » 127 . Premier pays d’accueil<br />
touristique au mon<strong>de</strong> 128 , la France a su jouer, <strong>de</strong>puis longtemps, la carte <strong>de</strong> la diversité.<br />
Toute l’étu<strong>de</strong> qui précè<strong>de</strong> doit être maint<strong>en</strong>ant réévaluée dans ses implications spatiales.<br />
Nous nous sommes jusqu’alors limitée à une analyse d’ordre institutionnel ou politique.<br />
Ce qui nous préoccupe ici est <strong>de</strong> compr<strong>en</strong>dre comm<strong>en</strong>t s’est progressivem<strong>en</strong>t mis <strong>en</strong><br />
place un dispositif <strong>de</strong> <strong>mise</strong> <strong>en</strong> <strong>valeur</strong> et d’exploitation <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong>, face à la nécessité<br />
économique, dans un jeu subtil <strong>de</strong> réponses <strong>de</strong> l’offre et <strong>de</strong> la <strong>de</strong>man<strong>de</strong>. Ce que l’on appelait<br />
« voyage » jusqu’au XIX e siècle allait bi<strong>en</strong>tôt pr<strong>en</strong>dre le vocable <strong>de</strong> « tourisme ». Nous<br />
abor<strong>de</strong>rons la question <strong>du</strong> seul point <strong>de</strong> vue <strong>culturel</strong>. Il est <strong>en</strong>core une fois nécessaire <strong>de</strong><br />
distinguer <strong>en</strong>tre le temps <strong>de</strong> l’élite et celui <strong>de</strong> la masse. Les premiers émois touristiques <strong>de</strong><br />
cette <strong>de</strong>rnière dat<strong>en</strong>t <strong>du</strong> Front populaire et <strong>de</strong>s congés payés <strong>de</strong> 1936 129 . Les acquis sociaux<br />
<strong>de</strong> l’immédiat avant-guerre donnèr<strong>en</strong>t le la pour les Tr<strong>en</strong>te Glorieuses. L’accès au savoir, une<br />
aisance matérielle s<strong>en</strong>siblem<strong>en</strong>t améliorée, mais aussi la crainte <strong>du</strong> pain noir rev<strong>en</strong>u, avec<br />
la baisse <strong>de</strong> la croissance <strong>de</strong>s années 1970, fir<strong>en</strong>t se confondre démocratisation et consommation.<br />
Il semble que c’est dans cette lecture double et décalée <strong>en</strong>tre l’idéal <strong>du</strong> politique<br />
et le vécu <strong>du</strong> peuple que le hiatus s’est installé, et que s’est inscrit l’échec d’une politique<br />
<strong>culturel</strong>le élitiste <strong>en</strong> faveur <strong>de</strong> la masse : <strong>en</strong>tre temps, le citoy<strong>en</strong> était <strong>de</strong>v<strong>en</strong>u consommateur.<br />
De ce fait, on mesure aujourd’hui tout l’intérêt d’<strong>en</strong>visager la culture et le <strong>patrimoine</strong><br />
– puisqu’ils t<strong>en</strong>d<strong>en</strong>t maint<strong>en</strong>ant à se confondre –, <strong>en</strong> terme <strong>de</strong> marché.<br />
C’est ainsi que dans une politique <strong>de</strong> déc<strong>en</strong>tralisation et <strong>de</strong> développem<strong>en</strong>t local, les<br />
régions, les dé<strong>par</strong>tem<strong>en</strong>ts, les communautés <strong>de</strong> communes et les communes t<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t <strong>de</strong><br />
tirer <strong>par</strong>ti <strong>de</strong> leurs richesses. Les t<strong>en</strong>tatives fur<strong>en</strong>t dans un premier temps fructueuses et<br />
fir<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s émules. Quand la Creuse ou la Dordogne, laissées à l’écart <strong>de</strong> la Révolution<br />
in<strong>du</strong>strielle et <strong>de</strong>v<strong>en</strong>ues friches rurales, <strong>en</strong> voie <strong>de</strong> désertification 130 <strong>mise</strong>nt sur le <strong>patrimoine</strong><br />
naturel, via le tourisme comme voie nouvelle <strong>de</strong> développem<strong>en</strong>t et que le prix <strong>de</strong> l’immobilier<br />
dix ans plus tard s’<strong>en</strong>vole 131 , on compr<strong>en</strong>d que le cas fasse école. On ne pourra citer<br />
tous les exemples tant ils sont nombreux mais on reti<strong>en</strong>dra <strong>par</strong>mi les espaces les plus sinistrés<br />
celui <strong>de</strong> la région Nord-Pas <strong>de</strong> Calais, et son projet d’implantation d’un Louvre à L<strong>en</strong>s<br />
à l’horizon 2009. Le livret <strong>de</strong> l’exposition « De la Fosse 9 au Louvre-L<strong>en</strong>s », est intro<strong>du</strong>it sous<br />
123. Année qui correspond à la naissance <strong>de</strong> la DATAR.<br />
124. Déclaration <strong>de</strong> Philippe <strong>de</strong> Villiers au Puy <strong>du</strong> Fou, cité <strong>par</strong> Rachid Amirou, Imaginaire <strong>du</strong> tourisme <strong>culturel</strong>,<br />
Paris, PUF, 2000, 155 pages.<br />
125. Discours <strong>de</strong> R<strong>en</strong>aud Donnedieu <strong>de</strong> Vabres lors d’une confér<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> presse donnée le 7/9/2006 pour les<br />
Journées europé<strong>en</strong>nes <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong>, http://www.cult.gouv.fr/culture.<br />
126. Le thème n’est dans cette <strong>par</strong>tie que sur le plan <strong>de</strong> la <strong>mise</strong> <strong>en</strong> <strong>valeur</strong> économique : les cont<strong>en</strong>us <strong>culturel</strong>s,<br />
<strong>en</strong> terme <strong>de</strong> programme et <strong>de</strong> publics seront étudiés dans le point suivant.<br />
127. Lire sur cette question Rachid Amirou, Imaginaire <strong>du</strong> tourisme <strong>culturel</strong>, Paris, PUF, 2000, 155 pages.<br />
128. « Avec 76 millions d’arrivées <strong>de</strong> touristes étrangers <strong>en</strong> 2005, la France ap<strong>par</strong>aît comme la première <strong>de</strong>stination<br />
touristique mondiale <strong>de</strong>vant l’Espagne (56 millions), les États-Unis (49 millions) ». Tableaux <strong>de</strong><br />
l’Économie Française, Édition 2007, http://www.insee.fr/fr/ffc.<br />
129. Les congés payés doiv<strong>en</strong>t être vus <strong>en</strong> 1936 comme un temps accordé aux travailleurs pour se reposer. <strong>La</strong><br />
préoccupation <strong>culturel</strong>le n’a ri<strong>en</strong> à y voir.<br />
130. Le site http://tourisme-creuse.com prés<strong>en</strong>te ainsi la Creuse : « Située à moins <strong>de</strong> 350 km au sud <strong>de</strong> Paris,<br />
à 350 km <strong>de</strong> Lyon et à 315 km <strong>de</strong> Bor<strong>de</strong>aux, le dé<strong>par</strong>tem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> la Creuse est un écrin <strong>de</strong> ver<strong>du</strong>re plantée au<br />
milieu <strong>de</strong> la France ». Pour une cartographie signifiante, on pourra se reporter aux modèles <strong>de</strong> Roger Brunet.<br />
131. <strong>La</strong> Dordogne était, <strong>en</strong> 2005, le premier dé<strong>par</strong>tem<strong>en</strong>t français d’accueil <strong>de</strong> touristes, soit 2,6 millions, avec<br />
<strong>en</strong> moy<strong>en</strong>ne 10 nuitées. Le tourisme représ<strong>en</strong>te 22 % <strong>de</strong> l’économie <strong>du</strong> dé<strong>par</strong>tem<strong>en</strong>t. http://www.dordogneperigord.fr.<br />
Schedae, 2008, prépublication n°10, (p. 1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf
le titre « Un soli<strong>de</strong> espoir… » conjointem<strong>en</strong>t, <strong>par</strong> le Présid<strong>en</strong>t <strong>du</strong> Conseil régional, le Présid<strong>en</strong>t<br />
<strong>du</strong> Conseil général, le Présid<strong>en</strong>t <strong>de</strong> l’agglomération <strong>de</strong> communes et le Maire <strong>de</strong> L<strong>en</strong>s.<br />
Nous avons choisi <strong>de</strong> le citer exhaustivem<strong>en</strong>t et <strong>de</strong> le reporter dans le corps <strong>du</strong> texte, tant<br />
il nous <strong>par</strong>aît, à lui seul, synthétiser et symboliser, incarner dira-t-on, la mission dévolue au<br />
<strong>patrimoine</strong>, et <strong>en</strong> cela justifier toute l’étu<strong>de</strong> ici m<strong>en</strong>ée, ce, d’autant que les couleurs politiques<br />
qui l’exprim<strong>en</strong>t sont différ<strong>en</strong>tes.<br />
L’implantation <strong>du</strong> Louvre sur l’anci<strong>en</strong> carreau <strong>de</strong> la fosse 9 <strong>de</strong> L<strong>en</strong>s, au cœur <strong>de</strong> la cité Sainte-<br />
Théodore, est un extraordinaire événem<strong>en</strong>t pour notre région.<br />
C’est d’abord une forme <strong>de</strong> reconnaissance <strong>du</strong> labeur et <strong>de</strong>s sacrifices cons<strong>en</strong>tis <strong>par</strong> la population<br />
<strong>du</strong> Bassin Minier <strong>du</strong> Nord-Pas <strong>de</strong> Calais, p<strong>en</strong>dant plus <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux siècles pour fournir son<br />
énergie à la France.<br />
C’est <strong>en</strong>suite un soli<strong>de</strong> espoir <strong>de</strong> tourner la page <strong>de</strong>puis la fermeture <strong>de</strong>s puits <strong>de</strong> mine, fortem<strong>en</strong>t<br />
<strong>en</strong>gagée dans les années 60 et achevée <strong>en</strong> 1990.<br />
C’est <strong>en</strong>fin, après la douloureuse pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> conversion <strong>de</strong> l’in<strong>du</strong>strie houillère, le résultat et<br />
le couronnem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s efforts m<strong>en</strong>és pour changer l’image <strong>du</strong> Bassin Minier, <strong>par</strong>fois décrit à tort<br />
comme un territoire <strong>en</strong> déclin.<br />
Que le Louvre élise domicile au cœur <strong>du</strong> Bassin Minier est égalem<strong>en</strong>t un symbole <strong>culturel</strong>,<br />
alliant l’excell<strong>en</strong>ce <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong> français classique ou traditionnel et d’un <strong>patrimoine</strong> in<strong>du</strong>striel<br />
exceptionnel, candidat à l’inscription sur la liste <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong> mondial <strong>de</strong> l’Humanité.<br />
L’arrivée <strong>du</strong> Louvre à L<strong>en</strong>s est l’occasion <strong>de</strong> faire découvrir ou redécouvrir l’histoire humaine,<br />
économique et sociale <strong>de</strong> cette ville, <strong>en</strong> <strong>par</strong>tie oubliée <strong>du</strong> fait <strong>de</strong> sa <strong>de</strong>struction totale lors <strong>de</strong><br />
la Première Guerre mondiale et <strong>de</strong> la cessation <strong>de</strong> l’activité houillère. Il ne s’agit pas d’<strong>en</strong> dresser<br />
un tableau idyllique qui serait aussi m<strong>en</strong>songer que l’image <strong>du</strong> « pays noir » habituellem<strong>en</strong>t<br />
véhiculée, mais <strong>de</strong> proposer l’histoire réelle <strong>de</strong> ses acteurs p<strong>en</strong>dant près <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux mille ans.<br />
Un véritable travail <strong>de</strong> recherche historique a été m<strong>en</strong>é dans les c<strong>en</strong>tres d’archives et auprès<br />
d’érudits d’histoire locale et d’habitants « <strong>du</strong> 9 <strong>de</strong> L<strong>en</strong>s » pour monter une exposition grand<br />
public. S’il peut <strong>de</strong> plus susciter <strong>de</strong> nouveaux projets <strong>de</strong> recherche sur le Bassin Minier, sa<br />
population, son histoire, son économie… et sur son <strong>patrimoine</strong> et, chez les histori<strong>en</strong>s, l’<strong>en</strong>vie<br />
d’écrire les monographies <strong>de</strong> ses villes, <strong>de</strong> ses hommes et <strong>de</strong> ses femmes au <strong>de</strong>stin exceptionnel,<br />
alors tous nos espoirs seront comblés.<br />
Par leur propre expéri<strong>en</strong>ce, comme <strong>par</strong> celle <strong>de</strong>s autres, les espaces ont appris à se<br />
structurer. On <strong>par</strong>le aujourd’hui <strong>de</strong> Pôles d’Économie <strong>du</strong> Patrimoine (PEP), <strong>de</strong> Pays d’Art et<br />
d’Histoire (PAH) qui sont, pour la DATAR « <strong>de</strong>ux faces d’une même ambition : le <strong>patrimoine</strong><br />
offert à chacun » 132 . Ils constitu<strong>en</strong>t surtout une chance inespérée <strong>de</strong> viser grâce au tourisme<br />
une requalification économique <strong>en</strong> s’inspirant <strong>de</strong>s techniques managériales <strong>de</strong> développem<strong>en</strong>t<br />
global. Hérités <strong>de</strong> la Loi Malraux <strong>de</strong> 1965 sur les « Villes d’Art », les Pays d’Art et d’Histoire<br />
vir<strong>en</strong>t le jour <strong>en</strong> 1987. <strong>La</strong>bellisés à <strong>par</strong>tir d’un cahier <strong>de</strong>s charges 133 , les PAH doiv<strong>en</strong>t<br />
satisfaire à l’exig<strong>en</strong>ce d’un projet <strong>culturel</strong> global visant à l’animation et la valorisation <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong><br />
bâti. Nous revi<strong>en</strong>drons plus loin sur les objectifs <strong>culturel</strong>s <strong>de</strong> ce label, <strong>de</strong>v<strong>en</strong>u <strong>en</strong> 1995,<br />
« Villes et Pays d’Art et d’Histoire ».<br />
Fig. 1 : Logo <strong>de</strong>s Villes et Pays d’Art et d’Histoire<br />
132. Lire sur cette question, Alain Rallet, IRIS, Pays d’Art et d’Histoire et Pôles d’économie <strong>du</strong> Patrimoine,<br />
DATAR, Paris, <strong>La</strong> Docum<strong>en</strong>tation française, 1999, p. 9.<br />
133. Circulaire n° 2001/006 <strong>du</strong> 1 er mars 2001.<br />
Schedae, 2008, prépublication n°10, (p.1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf<br />
27
28<br />
<strong>La</strong> formule est voisine pour les Pôles d’Économie <strong>du</strong> Patrimoine (PEP). Les PEP pos<strong>en</strong>t<br />
les premiers jalons d’un rapprochem<strong>en</strong>t <strong>en</strong>tre développem<strong>en</strong>t <strong>culturel</strong> et aménagem<strong>en</strong>t <strong>du</strong><br />
territoire, dans une action conjointe <strong>en</strong>tre Ministère <strong>de</strong> la Culture et <strong>de</strong> la DATAR. Bi<strong>en</strong> que<br />
trouvant leur source eux aussi dans les années 1980 et dans le projet <strong>de</strong> déc<strong>en</strong>tralisation,<br />
issus <strong>du</strong> rapport Querri<strong>en</strong> 134 et <strong>de</strong> la Commission « P2000 », ils s’inscriv<strong>en</strong>t dans un champ<br />
plus vaste. <strong>La</strong> philosophie qui les anime incarne une vision contemporaine d’un <strong>patrimoine</strong><br />
tourné vers l’av<strong>en</strong>ir qui <strong>en</strong>gagerait les acteurs locaux dans <strong>de</strong>s projets <strong>de</strong> développem<strong>en</strong>t<br />
global. Ils sont à la jonction <strong>de</strong> l’hier et <strong>du</strong> <strong>de</strong>main. On t<strong>en</strong>te alors <strong>de</strong> sortir <strong>de</strong> l’image passéiste,<br />
pour créer un atout <strong>de</strong> développem<strong>en</strong>t, qui intègre les technologies nouvelles et<br />
pr<strong>en</strong>d <strong>en</strong> considération <strong>de</strong>s dynamiques territoriales qui se re<strong>de</strong>ssin<strong>en</strong>t, <strong>en</strong> terme <strong>de</strong> culture.<br />
Comme nous l’avons suggéré plus haut, pour intro<strong>du</strong>ire cette <strong>par</strong>tie <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong>, « après<br />
avoir été considéré comme facteur <strong>de</strong> dép<strong>en</strong>se, le <strong>patrimoine</strong> <strong>de</strong>vi<strong>en</strong>t facteur direct <strong>de</strong><br />
création <strong>de</strong> richesse » 135 . C’est dans ce schéma nouveau, lié <strong>en</strong> gran<strong>de</strong> <strong>par</strong>tie, d’une <strong>par</strong>t<br />
aux mutations économiques d’un système tourné vers une pro<strong>du</strong>ction immatérielle, <strong>de</strong> services,<br />
et d’autre <strong>par</strong>t aux mutations sociales intro<strong>du</strong>isant la Ré<strong>du</strong>ction <strong>du</strong> Temps <strong>de</strong> Travail<br />
(RTT), l’accroissem<strong>en</strong>t <strong>du</strong> niveau <strong>de</strong> vie et <strong>de</strong> la consommation, que le <strong>patrimoine</strong> <strong>de</strong>vi<strong>en</strong>t<br />
pot<strong>en</strong>tiellem<strong>en</strong>t moteur pour la création d’emplois directs et d’emplois in<strong>du</strong>its. Il est supposé<br />
pallier la récession toujours <strong>en</strong> marche dans les secteurs traditionnels. Plus <strong>en</strong>core, distribué<br />
<strong>de</strong> manière équilibrée sur l’<strong>en</strong>semble <strong>du</strong> territoire, il laisse <strong>en</strong>trevoir une redistribution plus<br />
équitable <strong>de</strong>s <strong>valeur</strong>s. <strong>La</strong> différ<strong>en</strong>ce <strong>de</strong>vi<strong>en</strong>t, à cet égard, diversité autant que variété et<br />
représ<strong>en</strong>te un atout supplém<strong>en</strong>taire susceptible, non seulem<strong>en</strong>t d’attirer le visiteur, mais<br />
surtout, <strong>de</strong> le faire rev<strong>en</strong>ir.<br />
Aussi sembl<strong>en</strong>t coexister <strong>de</strong>ux voies <strong>de</strong> développem<strong>en</strong>t : l’une consistant à créer ou r<strong>en</strong>forcer<br />
l’offre <strong>culturel</strong>le sur <strong>de</strong>s territoires à forte conc<strong>en</strong>tration touristique, l’autre à mettre <strong>en</strong> <strong>valeur</strong><br />
une offre <strong>culturel</strong>le pour <strong>en</strong> faire le pro<strong>du</strong>it d’appel d’une fréqu<strong>en</strong>tation touristique que l’on<br />
espère accompagnée <strong>de</strong> retombées économiques significatives 136 .<br />
On revi<strong>en</strong>t ici <strong>de</strong> façon naturelle à la question <strong>du</strong> tourisme et <strong>de</strong> la position prépondérante<br />
<strong>de</strong> la France dans ce secteur. Le <strong>par</strong>i réussi <strong>de</strong> la déc<strong>en</strong>tralisation doit servir l’économie<br />
nationale.<br />
Cet aspect a été largem<strong>en</strong>t développé dans le discours d’Ami<strong>en</strong>s <strong>du</strong> Premier Ministre.<br />
Il y voyait « un <strong>en</strong>jeu crucial pour l’emploi dans notre pays. Pour l’emploi indirect, lié au tourisme<br />
et aux implantations d’<strong>en</strong>treprises, mais aussi, naturellem<strong>en</strong>t pour l’emploi direct (pour<br />
perpétuer) <strong>de</strong>s métiers qui sont à la fois un héritage <strong>du</strong> passé qu’il nous faut préserver et<br />
un formidable pot<strong>en</strong>tiel pour l’av<strong>en</strong>ir ». Devant une telle marque d’<strong>en</strong>thousiasme, on ne peut<br />
qu’applaudir <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux mains, mais la réalité doit être nuancée. En s’arrêtant un instant sur<br />
une autre <strong>par</strong>tie, plus prosaïque, dans laquelle il est dit que « L’État s’<strong>en</strong>gage <strong>en</strong> faveur <strong>du</strong><br />
<strong>patrimoine</strong> », il nous faut confronter les points <strong>de</strong> vue. Il est indéniable <strong>de</strong> dire que l’État<br />
est <strong>en</strong>gagé, <strong>de</strong>puis toujours, <strong>en</strong> faveur <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong>. D’un point <strong>de</strong> vue <strong>du</strong> dynamisme et<br />
<strong>de</strong>s retombées économiques on peut sans peine <strong>par</strong>ler <strong>de</strong> divid<strong>en</strong><strong>de</strong>s, donc d’un investissem<strong>en</strong>t<br />
qui <strong>en</strong> vaut la peine. Mais <strong>en</strong> terme <strong>de</strong> budget, et, <strong>par</strong> conséqu<strong>en</strong>t, <strong>en</strong> regard <strong>de</strong> la<br />
<strong>de</strong>tte publique dont la ré<strong>du</strong>ction est <strong>de</strong>v<strong>en</strong>ue obsessionnelle pour répondre aux critères<br />
europé<strong>en</strong>s, l’affaire est toute autre. Montrant l’absurdité <strong>de</strong>s politiques tarifaires susceptibles<br />
134. Max Querri<strong>en</strong>, Pour une nouvelle politique <strong>du</strong> Patrimoine. Rapport au Ministre <strong>de</strong> la Culture, Paris, <strong>La</strong><br />
Docum<strong>en</strong>tation française, 1982, 138 pages.<br />
135. Alain Rallet, IRIS, Pays d’Art et d’Histoire et Pôles d’économie <strong>du</strong> Patrimoine, DATAR, Paris, <strong>La</strong> Docum<strong>en</strong>tation<br />
française, 1999, p. 57.<br />
136. Clau<strong>de</strong> Origet <strong>du</strong> Cluzeau, Le tourisme <strong>culturel</strong>, Paris, PUF, 2005, p. 49.<br />
Schedae, 2008, prépublication n°10, (p. 1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf
d’attirer <strong>de</strong>s visiteurs plus nombreux pour <strong>de</strong>s musées plus r<strong>en</strong>tables, Patrice Béghain écrivait<br />
<strong>en</strong> 1998 137 que lorsque le visiteur dép<strong>en</strong>se 10 francs dans un monum<strong>en</strong>t ou un musée,<br />
il dép<strong>en</strong>se 100 francs pour bénéficier <strong>de</strong>s dép<strong>en</strong>ses qui sont liées à sa visite. Assurém<strong>en</strong>t,<br />
<strong>de</strong>vant une offre toujours plus nombreuse et variée <strong>de</strong> la culture et l’ext<strong>en</strong>sion <strong>du</strong> champ<br />
patrimonial, l’État doit opérer <strong>de</strong>s choix d’autant plus draconi<strong>en</strong>s que la r<strong>en</strong>tabilité <strong>de</strong>vi<strong>en</strong>t<br />
un critère s<strong>en</strong>sible. D’aucuns préféreront alors <strong>par</strong>ler d’un dés<strong>en</strong>gagem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> l’État <strong>en</strong><br />
matière patrimoniale – et <strong>de</strong> façon plus globale <strong>en</strong> matière <strong>culturel</strong>le.<br />
<strong>La</strong> proposition « sur la base d’un strict volontariat » <strong>de</strong> déc<strong>en</strong>tralisation vers les collectivités<br />
territoriales <strong>de</strong> monum<strong>en</strong>ts historiques ap<strong>par</strong>t<strong>en</strong>ant jusqu’alors à l’État 138 a été r<strong>en</strong><strong>du</strong>e<br />
légale <strong>par</strong> le vote <strong>de</strong> la Loi d’août 2004. Sont conservés dans le giron <strong>de</strong> l’État les « bi<strong>en</strong>s<br />
commémoratifs <strong>de</strong>s gran<strong>de</strong>s dates <strong>de</strong> l’Histoire <strong>de</strong> France, les anci<strong>en</strong>s bi<strong>en</strong>s <strong>de</strong> la Couronne,<br />
ou <strong>en</strong>core les types architecturaux d’une qualité exceptionnelle et possédant une <strong>valeur</strong><br />
pédagogique ». Ce sont au total 176 monum<strong>en</strong>ts qui sont proposés dont 67 sont finalem<strong>en</strong>t<br />
transférés. Le chiffre est symbolique com<strong>par</strong>é aux 41526 monum<strong>en</strong>ts classés <strong>en</strong> 2005, mais il<br />
est surtout symptomatique d’une dynamique marchan<strong>de</strong> à laquelle le <strong>patrimoine</strong> n’échappe<br />
pas. Michel Clém<strong>en</strong>t, directeur <strong>de</strong> l’Architecture et <strong>du</strong> Patrimoine soulignait <strong>en</strong> 2006 que<br />
la <strong>par</strong>t prise dans la conservation et la restauration <strong>de</strong>s monum<strong>en</strong>ts historiques <strong>de</strong> l’État est<br />
une spécificité française. L’État consacre <strong>en</strong>viron 250 millions d’euros pour les dép<strong>en</strong>ses <strong>de</strong><br />
restauration <strong>de</strong>s monum<strong>en</strong>ts historiques. Le gratifiant d’un satisfecit, il ajoute que le budget<br />
affecté au <strong>patrimoine</strong> est abondé <strong>de</strong> 100 millions d’euros <strong>en</strong> 2006. Pourtant, on compr<strong>en</strong>d<br />
que cette somme provi<strong>en</strong>t « <strong>de</strong>s recettes <strong>de</strong> privatisation ».<br />
Interrogé sur cette question <strong>du</strong> dés<strong>en</strong>gagem<strong>en</strong>t progressif <strong>de</strong> l’État, il r<strong>en</strong>voyait la<br />
balle aux collectivités locales, acteurs <strong>de</strong> leur propre développem<strong>en</strong>t, mais c’était, <strong>en</strong> réalité,<br />
pour mieux <strong>en</strong>chaîner sur l’importance <strong>du</strong> mécénat :<br />
Le développem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> cette ressource nouvelle a gagné le <strong>patrimoine</strong> sous la forme <strong>de</strong> mécénat<br />
<strong>de</strong> compét<strong>en</strong>ce: Vinci a financé la restauration <strong>de</strong> la Galerie <strong>de</strong>s Glaces <strong>de</strong> Versailles et Bouygues<br />
vi<strong>en</strong>t <strong>de</strong> s’<strong>en</strong>gager sur l’Hôtel <strong>de</strong> la Marine. L’objectif est désormais <strong>de</strong> favoriser le mécénat <strong>de</strong><br />
proximité au profit <strong>de</strong>s milliers <strong>de</strong> monum<strong>en</strong>ts historiques <strong>de</strong> nos régions, qui aujourd’hui est<br />
embryonnaire, mais a <strong>de</strong>vant lui <strong>de</strong> grands pot<strong>en</strong>tiels <strong>de</strong> développem<strong>en</strong>t 139 .<br />
Le ton est donné, appuyé <strong>par</strong> les pages <strong>de</strong> publicité <strong>de</strong>s Connaissances <strong>de</strong>s Arts hors<br />
série « Journées <strong>du</strong> Patrimoine » dans lesquelles Vinci n’est plus ri<strong>en</strong> d’autre que « Grand<br />
mécène <strong>du</strong> Ministère <strong>de</strong> la Culture et <strong>de</strong> la Communication », où la Société Générale informe<br />
que « Symbole <strong>de</strong> sa créativité, la collection d’art contemporain <strong>du</strong> groupe Société Générale<br />
est exposée à la Mo<strong>de</strong>rn Art Gallery, musée virtuel sur Internet », où Gaz <strong>de</strong> France, qui n’a<br />
ri<strong>en</strong> à v<strong>en</strong>dre, « souti<strong>en</strong>t la restauration <strong>de</strong> vitraux anci<strong>en</strong>s et la création <strong>de</strong> vitraux contemporains.<br />
Mais Gaz <strong>de</strong> France va <strong>en</strong>core plus loin <strong>en</strong> aidant l’association « la Source » qui permet<br />
à <strong>de</strong>s jeunes défavorisés <strong>de</strong> créer leurs propres œuvres avec la <strong>par</strong>ticipation <strong>de</strong> grands<br />
artistes ».<br />
Avec l’arrivée <strong>de</strong> la présid<strong>en</strong>te <strong>du</strong> musée et <strong>du</strong> domaine <strong>de</strong> Versailles, Christine Albanel à a<br />
tête <strong>du</strong> Ministère <strong>de</strong> la Culture, on peut espérer que <strong>de</strong>s budgets pér<strong>en</strong>nes plus conséqu<strong>en</strong>ts<br />
seront attribués au <strong>patrimoine</strong> et que le mariage public-privé, amorcé <strong>par</strong> ses prédécesseurs,<br />
137. Patrice Béghain, Le <strong>patrimoine</strong>, culture et li<strong>en</strong> social, Paris, Presses <strong>de</strong> Sci<strong>en</strong>ces Po, 1998, 115 pages.<br />
138. Cette proposition <strong>de</strong> transfert <strong>de</strong> propriété vers les collectivités territoriales est le fruit d’un rapport <strong>de</strong> la<br />
Commission pilotée <strong>par</strong> l’histori<strong>en</strong> R<strong>en</strong>é Rémond, dans le cadre <strong>de</strong> l’élaboration d’un « Plan national pour<br />
le Patrimoine » <strong>de</strong>mandé <strong>par</strong> le Ministère <strong>de</strong> la Culture et <strong>de</strong> la Communication <strong>en</strong> 2003.<br />
139. Entreti<strong>en</strong> avec Michel Clém<strong>en</strong>t, directeur <strong>de</strong> l’Architecture et <strong>du</strong> Patrimoine, in Connaissance <strong>de</strong>s Arts, HS<br />
n° 290, 9/2006, p. 7.<br />
Schedae, 2008, prépublication n°10, (p.1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf<br />
29
30<br />
va se développer. Elle, qui a su impliquer <strong>de</strong>s sociétés comme Bréguet et Vinci dans les chantiers<br />
<strong>du</strong> château royal, <strong>de</strong>vrait pouvoir accroître l’implication <strong>de</strong>s gran<strong>de</strong>s <strong>en</strong>treprises sur les<br />
hauts lieux <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong> national, à l’instar <strong>du</strong> Crédit Agricole au château <strong>de</strong> Fontainebleau<br />
140 .<br />
On compr<strong>en</strong>d aussi que le Salon <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong> <strong>culturel</strong> 2006, t<strong>en</strong>u au Carroussel <strong>du</strong><br />
Louvre, fût consacré aux « Entreprises et <strong>patrimoine</strong>s » avec ces quatre idées-forces que sont :<br />
« savoir-faire, transmission, développem<strong>en</strong>t économique, Europe » et probablem<strong>en</strong>t <strong>en</strong>core<br />
moins <strong>en</strong>core que l’édition 2007 soit consacrée au <strong>de</strong>rnier thème <strong>en</strong> vogue : « Patrimoine<br />
et <strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t ». En att<strong>en</strong>dant le prochain…<br />
Fig. 2 : Publicité pour Vinci<br />
On est loin <strong>de</strong> l’opération marketing d’un Manoir <strong>de</strong> province. Pourtant la dynamique<br />
est la même : à ceci près que le Manoir déf<strong>en</strong>d une gastronomie toute patrimoniale. Il serait<br />
140. Édito <strong>de</strong> Guy Boyer et Axelle Corty intitulé « Le privé au secours <strong>du</strong> mécénat », in Connaissance <strong>de</strong>s Arts,<br />
HS n° 336, 9/2007, p. 3.<br />
Schedae, 2008, prépublication n°10, (p. 1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf
peu crédible et peu professionnel <strong>de</strong> faire comme si le mécénat était un fait nouveau dans<br />
le mon<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’art et <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong>. Léonard <strong>de</strong> Vinci n’aurait ri<strong>en</strong> été sans la puissance <strong>du</strong><br />
Duc <strong>de</strong> Milan et Flor<strong>en</strong>ce eût été moins brillante si elle n’avait su favoriser les tal<strong>en</strong>ts d’un<br />
génial Michel-Ange. Le mécénat est aux fon<strong>de</strong>m<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> l’expression artistique <strong>de</strong>puis l’Antiquité.<br />
Plus <strong>en</strong>core, il a édifié, décoré, restauré le <strong>patrimoine</strong> religieux que nous déf<strong>en</strong>dons<br />
aujourd’hui. <strong>La</strong> Finance a toujours été aux côtés <strong>de</strong>s puissants. En cela ri<strong>en</strong> n’a changé. Mais<br />
un pas est franchi. Ce qui précè<strong>de</strong> date d’un temps où l’art et la culture servai<strong>en</strong>t les puissants,<br />
où la masse <strong>en</strong> était le témoin. Aujourd’hui, la culture est <strong>de</strong>v<strong>en</strong>ue marchandise, et<br />
le mécénat n’a plus <strong>de</strong> visage. Il convi<strong>en</strong>t donc à l’historiographe <strong>de</strong> se montrer vigilant face<br />
à <strong>de</strong>s dérives toujours m<strong>en</strong>açantes. Avant <strong>de</strong> nous poser la question <strong>de</strong>s <strong>en</strong>jeux sci<strong>en</strong>tifiques<br />
qui sont liés aux constats qui précèd<strong>en</strong>t, nous allons poursuivre l’analyse <strong>en</strong> nous interrogeant<br />
sur les <strong>en</strong>jeux <strong>culturel</strong>s inhér<strong>en</strong>ts à la <strong>mise</strong> <strong>en</strong> <strong>valeur</strong> <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong>.<br />
Les cultes <strong>du</strong> <strong>culturel</strong><br />
<strong>La</strong> question <strong>de</strong>s <strong>en</strong>jeux <strong>culturel</strong>s liés à la <strong>mise</strong> <strong>en</strong> <strong>valeur</strong> <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong> mérite un traitem<strong>en</strong>t<br />
<strong>par</strong>ticulier, dans la mesure où, la conception même <strong>de</strong> <strong>patrimoine</strong>, est liée à la culture.<br />
C’est donc le cœur <strong>du</strong> sujet qui est abordé ici. Dignes héritières <strong>du</strong> siècle <strong>de</strong>s Lumières<br />
et <strong>de</strong> la Révolution française, les politiques <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong> vis<strong>en</strong>t <strong>de</strong>puis le XIX e siècle à<br />
é<strong>du</strong>quer et à instruire le peuple. Nous avons vu qu’elles sont historiquem<strong>en</strong>t liées <strong>de</strong> façon<br />
très étroite aux temps qu’elles travers<strong>en</strong>t. Il nous ap<strong>par</strong>ti<strong>en</strong>t ici <strong>de</strong> t<strong>en</strong>ter <strong>de</strong> mesurer quels<br />
<strong>en</strong> sont les t<strong>en</strong>ants et les aboutissants, à l’heure d’une marchandisation croissante <strong>de</strong> la culture.<br />
Trois axes directeurs gui<strong>de</strong>ront la réflexion. Nous étudierons tout d’abord comm<strong>en</strong>t<br />
s’est manifesté à travers le temps le processus qui a mis <strong>en</strong> relation les hommes et leur espace<br />
<strong>culturel</strong>, définissant ce que l’on appelle aujourd’hui « tourisme <strong>culturel</strong> ». Dans un second<br />
temps, nous verrons quelles sont les ori<strong>en</strong>tations actuellem<strong>en</strong>t ret<strong>en</strong>ues pour favoriser ce<br />
type <strong>de</strong> tourisme. Le troisième temps se proposera d’observer comm<strong>en</strong>t le <strong>patrimoine</strong> bâti,<br />
plus spécifiquem<strong>en</strong>t religieux, est abordé dans les programmes scolaires. Nous pourrons, à<br />
<strong>par</strong>tir <strong>de</strong> cette étu<strong>de</strong> préalable, nourrir le propos sur le s<strong>en</strong>s <strong>de</strong> l’histoire et sur le rôle dévolu<br />
à l’historiographe, dans le schéma contemporain.<br />
<strong>La</strong> relation établie <strong>en</strong>tre « tourisme » et « <strong>patrimoine</strong> » est réc<strong>en</strong>te mais on peut faire<br />
remonter le concept <strong>de</strong> voyage <strong>culturel</strong> jusqu’à l’Antiquité. Il suffit <strong>de</strong> lire Hérodote décrivant<br />
la Tour <strong>de</strong> Babel ou <strong>de</strong> p<strong>en</strong>ser aux Sept Merveilles <strong>du</strong> Mon<strong>de</strong> pour s’<strong>en</strong> convaincre. Les<br />
textes anci<strong>en</strong>s sont <strong>du</strong> reste nombreux qui relat<strong>en</strong>t l’exploitation commerciale <strong>de</strong>s souv<strong>en</strong>irs<br />
et autres talismans ou ex-voto. <strong>La</strong> pério<strong>de</strong> qui suivit les invasions barbares, plus prospère,<br />
fut aussi plus ambiguë dans son rapport au déplacem<strong>en</strong>t. <strong>La</strong> motivation était d’abord<br />
religieuse et le temps marqué <strong>par</strong> les Croisa<strong>de</strong>s. Pourtant, ainsi que nous l’avons évoqué<br />
plus haut, la r<strong>en</strong>contre <strong>de</strong> l’Autre et <strong>de</strong> sa culture, même si c’était pour les combattre, a marqué<br />
les esprits d’une empreinte <strong>de</strong> curiosité et d’<strong>en</strong>vie. Si le pèlerinage et le commerce fur<strong>en</strong>t<br />
les moteurs <strong>de</strong>s voyages jusqu’<strong>en</strong> Chine ou permir<strong>en</strong>t la découverte <strong>du</strong> Nouveau Mon<strong>de</strong>,<br />
la mathématique, la mé<strong>de</strong>cine ou l’architecture, mais aussi la littérature, la gastronomie et<br />
le vêtem<strong>en</strong>t, pour ne pr<strong>en</strong>dre que ces quelques exemples, ont évolué sur cette base.<br />
Après la redécouverte <strong>de</strong> l’Antiquité à la fin <strong>du</strong> Moy<strong>en</strong>-Âge, les aristocrates développèr<strong>en</strong>t<br />
à <strong>par</strong>tir <strong>du</strong> XVIe siècle un goût <strong>par</strong>ticulier pour le voyage, à <strong>valeur</strong> initiatique, <strong>en</strong> Europe.<br />
Héritée <strong>de</strong> l’Humanisme 141 , cette tradition, qui allait per<strong>du</strong>rer tout au long <strong>de</strong>s siècles suivants,<br />
<strong>de</strong>vait permettre aux jeunes nantis <strong>de</strong> <strong>par</strong>faire leur é<strong>du</strong>cation et leur érudition, <strong>de</strong> vivre<br />
141. On pourra lire sur cette question la communication <strong>de</strong> Emanuele Kanceff, « Les lieux <strong>de</strong>s voyageurs <strong>en</strong>tre<br />
le XVI e et le XVIII e siècles », in Daniel J. Grange et Dominique Poulot (dir.), L’esprit <strong>de</strong>s lieux, le <strong>patrimoine</strong><br />
et la cité, Gr<strong>en</strong>oble, PUG, 1997, p. 63-69.<br />
Schedae, 2008, prépublication n°10, (p.1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf<br />
31
32<br />
l’expéri<strong>en</strong>ce livresque, l’« autopsie » <strong>de</strong>s Grecs. En 1743, fut publié le premier gui<strong>de</strong> <strong>du</strong> Grand<br />
Tour, <strong>par</strong> Thomas Nag<strong>en</strong>t, véritable précurseur <strong>du</strong> gui<strong>de</strong> touristique, puisque ce <strong>de</strong>rnier livrait<br />
les informations pratiques liées au voyage. De quelques semaines ou <strong>de</strong> plusieurs mois, le<br />
périple fut r<strong>en</strong><strong>du</strong> plus facile d’accès et moins dangereux au XIX e siècle grâce à la révolution<br />
<strong>de</strong>s transports. Des carnets <strong>de</strong> voyages publiés nous instruis<strong>en</strong>t sur la perception <strong>de</strong>s lieux.<br />
On pourra citer pour l’anecdote, un voyageur anglais passant <strong>par</strong> Saint-Lô et livrant une<br />
<strong>de</strong>scription, pour le moins sans concession, <strong>de</strong> l’église Notre-Dame :<br />
Je frémis lorsqu’<strong>en</strong> <strong>en</strong>trant dans la nef où je vis, à gauche, une statue <strong>de</strong> la Vierge t<strong>en</strong>ant<br />
l’<strong>en</strong>fant Jésus dans ses bras et peinte d’une horrible manière. <strong>La</strong> figure est aussi difforme, aussi<br />
vieille, aussi repoussante que l’<strong>en</strong>luminure est à mépriser : je ne vis jamais <strong>par</strong>eil barbouillage.<br />
Quel amour religieux, quelles émotions, quelle ferveur <strong>de</strong> zèle ! la vue d’un tel objet peut-elle<br />
exciter dans les cœurs ? Il faut que la <strong>par</strong>oisse ait per<strong>du</strong> le goût et l’esprit pour souffrir cette<br />
monstrueuse pro<strong>du</strong>ction 142 .<br />
Ce sont <strong>en</strong>core, <strong>par</strong> exemple, les carnets <strong>de</strong> Viollet-le-Duc ou <strong>de</strong> Victor Hugo plus tard<br />
dans le siècle.<br />
Ainsi, au XIX e siècle le <strong>patrimoine</strong> bâti prit consistance, ce qui lui conféra une importance<br />
nouvelle, laquelle justifiait qu’il fasse corps avec la nation.<br />
Il y a désormais une continuité <strong>de</strong> perception <strong>en</strong>tre la ville et la campagne qui <strong>en</strong>traîne la fin<br />
<strong>de</strong> l’isolem<strong>en</strong>t <strong>du</strong> noyau urbain et ouvre les regards sur <strong>de</strong>s réalités et traditions <strong>en</strong> ap<strong>par</strong><strong>en</strong>ce<br />
plus humbles. À côté <strong>du</strong> voyage érudit ou touristique pr<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t désormais dignem<strong>en</strong>t leur<br />
place le voyage archéologique, celui <strong>de</strong> la peinture, <strong>de</strong> la musique et <strong>de</strong>s idées et <strong>de</strong>s vérifications<br />
philosophiques, et même <strong>de</strong>s voyages sci<strong>en</strong>tifiques et médicaux 143 .<br />
Dans ce cadre, l’église n’était plus seulem<strong>en</strong>t un lieu <strong>de</strong> culte, elle faisait <strong>par</strong>tie <strong>du</strong><br />
vivant, définissait une <strong>par</strong>oisse. Dans le même temps, la <strong>mise</strong> <strong>en</strong> place <strong>de</strong>s préceptes révolutionnaires<br />
connut ses premiers effets. Le phénomène peut sembler contradictoire mais la<br />
démarche est <strong>en</strong> réalité logique : la Révolution a manifesté la nécessité <strong>de</strong> construire une<br />
id<strong>en</strong>tité nationale autour d’un héritage commun, et, lorsque celui-ci <strong>de</strong>vint réalité, et qu’il<br />
ap<strong>par</strong>ut comme tel aux yeux <strong>de</strong> ses instigateurs, la t<strong>en</strong>tation fut gran<strong>de</strong> <strong>de</strong> prélever l’objet<br />
<strong>de</strong> son contexte pour l’<strong>en</strong>fermer dans la cage dorée que sont les musées.<br />
Si les musées, créés sur les fonds <strong>de</strong>s collections privées 144 <strong>de</strong> l’Anci<strong>en</strong> Régime, <strong>de</strong>meurèr<strong>en</strong>t<br />
d’abord confid<strong>en</strong>tiels, ils fur<strong>en</strong>t ouverts au public à <strong>par</strong>tir <strong>de</strong> 1855. En 1890, la France<br />
<strong>en</strong> comptait déjà neuf c<strong>en</strong>ts 145 . Outre la <strong>mise</strong> <strong>en</strong> <strong>valeur</strong> <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong> national, les collections<br />
s’étoffèr<strong>en</strong>t ess<strong>en</strong>tiellem<strong>en</strong>t, à cette époque, <strong>par</strong> la grâce <strong>de</strong>s pillages opérés lors <strong>de</strong>s<br />
opérations militaires, à l’instar d’un Champollion accompagnant Napoléon 1 er dans sa campagne<br />
d’Égypte. Plus tard dans le siècle, ce sont les colonies qui, <strong>en</strong> toute impunité, fur<strong>en</strong>t<br />
dépouillées <strong>de</strong> leur <strong>patrimoine</strong> <strong>culturel</strong>. C’est ainsi qu’<strong>en</strong> Algérie, les vestiges romains <strong>de</strong>meurés<br />
intacts passionnèr<strong>en</strong>t les <strong>en</strong>vahisseurs, tandis qu’<strong>en</strong> France, à la même époque, les vestiges<br />
<strong>de</strong> la ville <strong>de</strong> Lyon étai<strong>en</strong>t m<strong>en</strong>acés <strong>de</strong> dis<strong>par</strong>ition 146 . Le mouvem<strong>en</strong>t fut d’une ampleur<br />
142. Extrait <strong>de</strong> « Voyage bibliographique, archéologique et pittoresque <strong>en</strong> France » <strong>de</strong> l’anglais Dibdin, in Chanoine<br />
Houël, Histoire <strong>de</strong> la ville <strong>de</strong> Saint-Lô, Paris, Res Universis, 1992, p. 236-237.<br />
143. Emanuele Kanceff, « Les lieux <strong>de</strong>s voyageurs <strong>en</strong>tre le XVI e et le XVIII e siècles, in Daniel J. Grange et Dominique<br />
Poulot (dir.), L’esprit <strong>de</strong>s lieux, le <strong>patrimoine</strong> et la cité, Gr<strong>en</strong>oble, <strong>La</strong> pierre et l’écrit, PUG, 1997, p. 68<br />
144. Par le commerce, allai<strong>en</strong>t se constituer les premières collections. Les terres étrangères, celles <strong>de</strong>s Croisa<strong>de</strong>s<br />
et <strong>du</strong> Nouveau Mon<strong>de</strong>, n’étai<strong>en</strong>t plus vues <strong>du</strong> seul point <strong>de</strong> vue <strong>du</strong> pillage <strong>de</strong> l’or et <strong>de</strong>s pierres précieuses,<br />
c’étai<strong>en</strong>t désormais les richesses intellectuelles et artistiques qui allai<strong>en</strong>t <strong>de</strong>v<strong>en</strong>ir moteur <strong>de</strong> la<br />
démarche d’acquisition.<br />
145. Ils sont aujourd’hui <strong>en</strong>viron 3 000 à répondre aux critères <strong>de</strong> l’ICOM (International Council of Museums).<br />
146. Voir plus haut.<br />
Schedae, 2008, prépublication n°10, (p. 1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf
telle que l’on peut aller jusqu’à affirmer que la préoccupation <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong> fut importée<br />
<strong>par</strong> les colons 147 .<br />
L’av<strong>en</strong>ture outre-mer constitua le noyau <strong>de</strong>s collections <strong>de</strong>s grands musées. Que serai<strong>en</strong>t<br />
<strong>en</strong> effet aujourd’hui les sections antiques <strong>du</strong> Louvre, musée le plus visité au mon<strong>de</strong>, le Musée<br />
Guimet, ou <strong>en</strong>core le tout nouveau Musée <strong>de</strong>s Arts Premiers <strong>du</strong> Quai Branly sans ces exactions<br />
? Il est nécessaire <strong>de</strong> se poser aujourd’hui la question <strong>de</strong> la légitimité historique <strong>de</strong><br />
cet héritage, alors que la France voit aboutir un projet <strong>de</strong> construction <strong>du</strong> Louvre à Abou<br />
Dabi aux Émirats Arabes Unis et que les nations spoliées réclam<strong>en</strong>t pour certaines la restitution<br />
<strong>de</strong>s pièces. Interrogé récemm<strong>en</strong>t <strong>par</strong> un journaliste français sur l’ap<strong>par</strong><strong>en</strong>te contradiction<br />
<strong>en</strong>tre la proclamation <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong> <strong>de</strong> l’humanité et l’opposition <strong>de</strong> principe aux<br />
restitutions, Neil Mac Gregor, le Directeur <strong>du</strong> British Museum <strong>de</strong> Londres, répondait :<br />
Au contraire. Comme élém<strong>en</strong>t <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong> <strong>de</strong> l’humanité, chaque pièce a sa place dans le<br />
mon<strong>de</strong>, que ce soit à Pékin ou à Londres. J’ajouterais que la confrontation <strong>de</strong>s civilisations qui<br />
se joue au travers <strong>de</strong>s collections est fondam<strong>en</strong>tale. Le British Museum <strong>en</strong> lui-même est aussi<br />
un joyau <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong> <strong>de</strong> l’humanité. C’est un point unique <strong>de</strong> rassemblem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s cultures<br />
<strong>du</strong> mon<strong>de</strong>. Cette ambition était la même que celle affichée au XVIIIe siècle <strong>par</strong> les savants, dont<br />
la démarche était <strong>de</strong> rassembler l’univers dans une même <strong>en</strong>ceinte. Il ne fait aucun doute que<br />
le mon<strong>de</strong> y a gagné. Il s’agissait alors, <strong>par</strong> l’interrogation <strong>de</strong>s objets, non seulem<strong>en</strong>t d’<strong>en</strong>richir<br />
la connaissance mais d’intégrer <strong>de</strong>s civilisations et <strong>de</strong>s croyances radicalem<strong>en</strong>t différ<strong>en</strong>tes. C’est<br />
une proclamation <strong>de</strong> tolérance, et <strong>de</strong> liberté intellectuelle, dont la <strong>valeur</strong> aujourd’hui n’a pas<br />
besoin d’être soulignée.<br />
Avec la multiplication <strong>de</strong>s rev<strong>en</strong>dications ou <strong>de</strong>s restitutions, il faut pr<strong>en</strong>dre gar<strong>de</strong> à ne pas<br />
fixer les œuvres dans le cadre d’une propriété et d’un lieu uniques. Est ainsi posée la mauvaise<br />
question qui est celle <strong>de</strong> la propriété <strong>de</strong>s œuvres. Elle va à l’<strong>en</strong>contre <strong>de</strong> l’ap<strong>par</strong>t<strong>en</strong>ance au<br />
<strong>patrimoine</strong> <strong>de</strong> l’humanité, et <strong>en</strong>cl<strong>en</strong>che un réflexe <strong>de</strong> fermeture. En interdisant aux pièces noks<br />
<strong>de</strong> circuler, on empêche le mon<strong>de</strong> d’accé<strong>de</strong>r à la beauté créée <strong>par</strong> une <strong>de</strong>s plus anci<strong>en</strong>nes civilisations<br />
africaines. À l’inverse, il faut poser le problème <strong>de</strong> leur accessibilité au public et <strong>de</strong><br />
leur circulation. L’UNESCO pourrait faire beaucoup <strong>en</strong> allant dans ce s<strong>en</strong>s, plutôt que <strong>de</strong><br />
s’obnubiler sur les questions <strong>de</strong> restitution 148 .<br />
Ce qui précè<strong>de</strong>, et qui <strong>en</strong> l’occurr<strong>en</strong>ce s’adresse à l’Angleterre, peut sembler anecdotique<br />
ou polémique. <strong>La</strong> France, <strong>de</strong>uxième empire colonial n’est pas é<strong>par</strong>gnée <strong>par</strong> les affaires<br />
<strong>de</strong> restitutions 149 . <strong>La</strong> volonté <strong>du</strong> conservateur <strong>du</strong> Musée <strong>de</strong> Rou<strong>en</strong> <strong>de</strong> rétrocé<strong>de</strong>r aux<br />
Maori <strong>de</strong> Nouvelle-Zélan<strong>de</strong> <strong>de</strong>s têtes <strong>en</strong>treposées dans les réserves, a été contrée <strong>par</strong> la<br />
Ministre <strong>de</strong> la Culture et <strong>de</strong> la Communication Christine Albanel Dégager <strong>de</strong>s fonds pour<br />
acquérir <strong>de</strong>s œuvres et restituer aux pays leur <strong>patrimoine</strong> spolié ne va pas <strong>de</strong> soi 150 . Comme<br />
147. Lire sur le sujet, Monique Doudin-Payre « L’archéologie <strong>en</strong> Algérie à <strong>par</strong>tir <strong>de</strong> 1830 : une politique<br />
patrimoniale ? », in Philippe Poirrier et Loïc Val<strong>de</strong>lorge (dir.), Pour une histoire <strong>de</strong>s politiques <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong>,<br />
Paris, <strong>La</strong> Docum<strong>en</strong>tation française, 2003, p. 145-170.<br />
148. Extrait d’un article <strong>du</strong> journal Libération, 10 février 2007.<br />
149. Il ne faut pas négliger la <strong>par</strong>t sombre <strong>de</strong> l’héritage historique, <strong>en</strong> <strong>par</strong>ticulier à un mom<strong>en</strong>t où les histori<strong>en</strong>s,<br />
<strong>en</strong> qualité d’experts, sont sollicités pour exprimer <strong>de</strong>vant les politiques, la validité, la bi<strong>en</strong>faisance <strong>de</strong> tel<br />
ou tel chapitre <strong>de</strong> notre passé, ainsi celui <strong>de</strong> la traite négrière.<br />
150. « Le tribunal administratif <strong>de</strong> Rou<strong>en</strong> a susp<strong>en</strong><strong>du</strong>, mercredi 24 octobre, la décision <strong>de</strong> la ville <strong>de</strong> restituer à<br />
la Nouvelle Zélan<strong>de</strong> une tête maori. Ce conflit relance un peu plus une question que beaucoup jug<strong>en</strong>t<br />
iconoclaste : les musées peuv<strong>en</strong>t-ils cé<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s élém<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> leurs collections, qui sont actuellem<strong>en</strong>t<br />
inaliénables ? Cette tête ornée <strong>de</strong> tatouages, qui dormait <strong>de</strong>puis <strong>de</strong>s déc<strong>en</strong>nies dans les réserves <strong>du</strong><br />
Muséum d’histoire naturelle <strong>de</strong> Rou<strong>en</strong> (Le Mon<strong>de</strong> <strong>du</strong> 9 octobre), a été symboliquem<strong>en</strong>t restituée, le 23<br />
octobre, <strong>par</strong> la ville aux Maori <strong>de</strong> Nouvelle-Zélan<strong>de</strong>, qui désir<strong>en</strong>t donner une sépulture à ces vestiges <strong>de</strong><br />
“guerriers morts au combat”. <strong>La</strong> ministre <strong>de</strong> la culture, Christine Albanel, a attaqué cette démarche<br />
<strong>de</strong>vant le tribunal administratif au motif que le <strong>de</strong>ssaisissem<strong>en</strong>t d’une pièce ap<strong>par</strong>t<strong>en</strong>ant à une collection<br />
publique doit obéir à une procé<strong>du</strong>re, précisée dans une loi <strong>de</strong> 2002, que n’a pas respectée Rou<strong>en</strong>. <strong>La</strong> loi<br />
Tasca sur les musées <strong>du</strong> 4 janvier 2002, qui rappelle l’inaliénabilité <strong>de</strong>s collections confiées aux musées <strong>de</strong><br />
Schedae, 2008, prépublication n°10, (p.1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf<br />
33
34<br />
Marcel Roncayolo, on peut affirmer que « tout comm<strong>en</strong>ce <strong>par</strong> le sol » 151 et, <strong>par</strong> conséqu<strong>en</strong>t,<br />
que cette question, ess<strong>en</strong>tielle, est loin d’être tranchée 152 . Vi<strong>en</strong>dra certainem<strong>en</strong>t un temps où<br />
le musée virtuel saura se poser comme une réponse à l’accessibilité <strong>de</strong>s collections pour tous.<br />
Dans cette nouvelle appréh<strong>en</strong>sion <strong>de</strong> l’espace vécu c’est <strong>du</strong> même coup la relation à<br />
la nature qui vint à changer. Le paysage qui, dans les tableaux r<strong>en</strong>aissants, se résumait à une<br />
représ<strong>en</strong>tation symbolique <strong>de</strong> la Nature créée <strong>par</strong> Dieu, <strong>de</strong>v<strong>en</strong>ait réalité et livrait les secrets<br />
d’une gran<strong>de</strong> générosité et d’une gran<strong>de</strong> variété. L’av<strong>en</strong>ture n’était plus seulem<strong>en</strong>t celle<br />
<strong>de</strong>s explorateurs, contée dans les livres. Certes, seules les classes les plus aisées pouvai<strong>en</strong>t<br />
s’offrir un tel luxe, mais c’était pour elles l’occasion <strong>de</strong> côtoyer <strong>de</strong>s populations <strong>de</strong> condition<br />
plus mo<strong>de</strong>ste, <strong>de</strong> donner corps aux connaissances livresques, finalem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> s’extraire d’une<br />
forme <strong>de</strong> naïveté <strong>de</strong>vant l’exist<strong>en</strong>ce. Ap<strong>par</strong>ur<strong>en</strong>t alors les premières sociétés <strong>de</strong> géographie,<br />
le Club Alpin Français <strong>en</strong> 1874, et <strong>en</strong> 1898, Gimel-les-Casca<strong>de</strong>s, <strong>en</strong> Corrèze, fut le premier<br />
site naturel à être classé. Ce n’est pas le fruit <strong>du</strong> hasard si, à la même époque, ceux qui allai<strong>en</strong>t<br />
<strong>de</strong>v<strong>en</strong>ir les « impressionnistes » sortir<strong>en</strong>t <strong>de</strong> leurs ateliers pour peindre à la lumière <strong>du</strong> jour<br />
<strong>de</strong>s tableaux évoquant <strong>de</strong>s scènes <strong>de</strong> la vie quotidi<strong>en</strong>ne <strong>de</strong> leurs contemporains.<br />
Nous avons vu dans les développem<strong>en</strong>ts précéd<strong>en</strong>ts que le XXe siècle est jalonné <strong>de</strong><br />
mom<strong>en</strong>ts cruciaux qui le plac<strong>en</strong>t face à son Histoire. Ainsi doit-on évoquer la Loi <strong>de</strong> sé<strong>par</strong>ation<br />
<strong>de</strong> l’Église et <strong>de</strong> l’État <strong>de</strong> 1905 faisant <strong>de</strong> la France un État laïque, les dévastations <strong>de</strong> la<br />
Première Guerre Mondiale ou <strong>en</strong>core la lutte contre les fascismes, brandissant le spectre d’un<br />
ordre nouveau, p<strong>en</strong>dant la Secon<strong>de</strong> Guerre Mondiale. Dans le même temps, ce sont aussi<br />
les phénomènes <strong>de</strong> démocratisation et <strong>de</strong> massification <strong>culturel</strong>les qui se sont installés et ont<br />
grandi dans la société in<strong>du</strong>strielle. En associant les <strong>de</strong>ux facteurs, on compr<strong>en</strong>d que l’é<strong>du</strong>cation<br />
et la s<strong>en</strong>sibilisation populaires <strong>du</strong> XIX e et <strong>du</strong> début <strong>du</strong> XX e siècles ont fait leur œuvre et<br />
que, désormais, le peuple est à même <strong>de</strong> mesurer le s<strong>en</strong>s d’une Histoire qui s’écrit sous ses<br />
yeux. De proche <strong>en</strong> proche, il <strong>en</strong> réclame l’accès et, plus <strong>en</strong>core, s’<strong>en</strong> fait l’acteur. C’est tout<br />
le s<strong>en</strong>s <strong>de</strong> l’évolution actuelle <strong>du</strong> champ <strong>de</strong> l’action <strong>culturel</strong>le à <strong>de</strong>stination <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong>.<br />
L’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s <strong>en</strong>jeux économiques a montré que le tourisme constitue un atout majeur<br />
<strong>de</strong> développem<strong>en</strong>t local. Il nous faut donc nous intéresser ici aux moy<strong>en</strong>s mis <strong>en</strong> place pour<br />
r<strong>en</strong>dre attractifs les territoires et nous interroger sur les métho<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>mise</strong> <strong>en</strong> <strong>valeur</strong> <strong>du</strong> strict<br />
point <strong>de</strong> vue <strong>culturel</strong>. Selon Clau<strong>de</strong> Origet <strong>du</strong> Cluzeau, « le tourisme constitue une voie<br />
royale, et plutôt démocratique d’accès à la culture » 153 . Le champ est tellem<strong>en</strong>t vaste qu’il<br />
serait fastidieux et peu instructif dans le cadre <strong>de</strong> notre travail <strong>de</strong> proposer ne serait-ce qu’une<br />
typologie. Nous avons privilégié la piste qui nous amène à nous arrêter sur quelques exemples,<br />
afin d’<strong>en</strong> tirer <strong>de</strong>s <strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>ts pour notre étu<strong>de</strong>. Si nous nous p<strong>en</strong>chons sur la conv<strong>en</strong>tion<br />
signée <strong>en</strong> 1989 <strong>par</strong> la Ville <strong>de</strong> Coutances, on peut lire :<br />
L’objectif principal <strong>du</strong> PAH est <strong>de</strong> contribuer au développem<strong>en</strong>t touristique et <strong>culturel</strong> <strong>de</strong> la<br />
région. Le tourisme local repose ess<strong>en</strong>tiellem<strong>en</strong>t sur la frange littorale <strong>du</strong> pays. Le label PAH a<br />
151. France, prévoit que le déclassem<strong>en</strong>t d’une pièce (qui peut <strong>en</strong>traîner sa cession) ne peut être pris que sur<br />
avis conforme d’une commission sci<strong>en</strong>tifique. <strong>La</strong> ville <strong>de</strong> Rou<strong>en</strong> répond que la tête maori n’est pas un élém<strong>en</strong>t<br />
<strong>de</strong> collection, mais un vestige humain qui relève <strong>de</strong> la bioéthique et donc échappe à la loi Tasca. Le<br />
tribunal administratif n’a pas suivi ce raisonnem<strong>en</strong>t. En cinq ans, aucun objet n’a <strong>en</strong>core subi la procé<strong>du</strong>re<br />
<strong>de</strong> déclassem<strong>en</strong>t : la direction <strong>de</strong>s musées <strong>de</strong> France redouterait qu’une telle <strong>de</strong>man<strong>de</strong> ne débouche sur<br />
une bra<strong>de</strong>rie <strong>de</strong>s collections. C’est la raison pour laquelle, Jacques Rigaud, ex-patron <strong>de</strong> RTL et anci<strong>en</strong> directeur<br />
<strong>de</strong> cabinet <strong>du</strong> ministre <strong>de</strong> la culture Jacques Duhamel (1971-1973), a reçu, le 23 octobre, une mission<br />
<strong>de</strong> M me Albanel : comm<strong>en</strong>t appliquer la loi <strong>de</strong> 2002 “<strong>en</strong> évitant […] la circulation totale <strong>de</strong>s œuvres et le<br />
stockage définitif aboutissant à un accroissem<strong>en</strong>t mécanique <strong>de</strong> leur nombre”. », Emmanuel <strong>de</strong> Roux, Le<br />
Mon<strong>de</strong>, 26 octobre 2007.<br />
151. Marcel Roncayolo, in Sci<strong>en</strong>ce et consci<strong>en</strong>ce <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong>, Pierre Nora (dir.), Entreti<strong>en</strong>s <strong>du</strong> Patrimoine,<br />
Théâtre national <strong>de</strong> Chaillot, Paris, 28-30 novembre 1994, Paris, Éditions <strong>du</strong> Patrimoine, p. 19.<br />
152. Nous aimerions intro<strong>du</strong>ire ici la notion <strong>de</strong> <strong>patrimoine</strong> éthique.<br />
153. Clau<strong>de</strong> Origet <strong>du</strong> Cluzeau, Le tourisme <strong>culturel</strong>, Paris, PUF, 2005, p. 14.<br />
Schedae, 2008, prépublication n°10, (p. 1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf
permis <strong>de</strong> mettre <strong>en</strong> découverte les ressources <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong> rural, aussi bi<strong>en</strong> auprès <strong>de</strong> la<br />
population locale que <strong>de</strong> la population touristique 154 .<br />
On voit bi<strong>en</strong> ici que la préoccupation est avant tout économique mais c’est précisém<strong>en</strong>t<br />
pour cette raison qu’il faut examiner les implications <strong>culturel</strong>les d’un tel choix.<br />
Trois points mérit<strong>en</strong>t d’être soulevés ici. Tout d’abord, le constat est cruel pour ceux<br />
qui s’imagin<strong>en</strong>t que la masse se presse, sur son temps libre, vers les portes <strong>de</strong> la culture.<br />
Le texte indique clairem<strong>en</strong>t que le tourisme dans la Manche est avant tout un tourisme balnéaire,<br />
non <strong>culturel</strong> 155 . Voici <strong>en</strong>core une pierre jetée dans le jardin <strong>de</strong>s ard<strong>en</strong>ts déf<strong>en</strong>seurs<br />
<strong>de</strong> la culture <strong>de</strong> masse. Le dé<strong>par</strong>tem<strong>en</strong>t n’est pas une exception sur le territoire national.<br />
On compr<strong>en</strong>d alors la t<strong>en</strong>tation qui se fait jour <strong>de</strong> r<strong>en</strong>dre les espaces <strong>culturel</strong>s attractifs <strong>par</strong><br />
une forme <strong>de</strong> démagogie. Il est vrai qu’« un musée sans public est un musée inachevé » 156<br />
et l’esprit <strong>de</strong> consommation qui gui<strong>de</strong> le visiteur oblige le médiateur <strong>culturel</strong> à être inv<strong>en</strong>tif.<br />
Mais le <strong>patrimoine</strong> ne s’use que si la communication qui le met au jour n’est qu’un emballage<br />
vi<strong>de</strong> <strong>de</strong> s<strong>en</strong>s et qu’elle ne sait ret<strong>en</strong>ir l’att<strong>en</strong>tion <strong>du</strong> visiteur. C’est ce que nous t<strong>en</strong>terons<br />
<strong>de</strong> démontrer plus bas. Le <strong>de</strong>scriptif nous indique <strong>en</strong>suite que le territoire lui-même est<br />
am<strong>en</strong>é à se p<strong>en</strong>ser <strong>du</strong> point <strong>de</strong> vue patrimonial. Il convi<strong>en</strong>t donc d’inv<strong>en</strong>torier ce qui mérite<br />
d’être mis au jour dans le cadre d’une exploitation touristique, ce qui, on le verra dans le point<br />
suivant, peut-être fort intéressant pour faire avancer la recherche archéologique et historique.<br />
Enfin, la <strong>mise</strong> <strong>en</strong> scène patrimoniale d’un territoire est un facteur <strong>de</strong> cohésion pour la<br />
population locale qui redécouvre, mais <strong>en</strong> réalité le plus souv<strong>en</strong>t découvre, les racines <strong>de</strong><br />
son propre territoire. Ainsi, on pourra sur ce point s’inscrire <strong>par</strong>tiellem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> faux avec Rachid<br />
Amirou lorsqu’il écrit que la <strong>mise</strong> <strong>en</strong> <strong>patrimoine</strong> équivaut souv<strong>en</strong>t à « un travail <strong>de</strong> <strong>de</strong>uil » 157 .<br />
Les dérives sont toujours à craindre, justifiant la démarche sci<strong>en</strong>tifique. Néanmoins,<br />
nous ne pouvons que constater l’intérêt réc<strong>en</strong>t et grandissant manifesté <strong>par</strong> les Français<br />
pour leur <strong>patrimoine</strong>. <strong>La</strong> multiplication <strong>de</strong>s évocations patrimoniales, qu’il s’agisse <strong>du</strong> foisonnem<strong>en</strong>t<br />
<strong>de</strong>s éco-musées ou <strong>en</strong>core le succès croissant <strong>du</strong> retour à <strong>de</strong>s fêtes traditionnelles,<br />
au folklore, <strong>en</strong> atteste. On peut <strong>en</strong>core noter la t<strong>en</strong>dance à la rénovation <strong>de</strong> l’habitat<br />
anci<strong>en</strong>, qui n’est pas le simple fruit d’une pression immobilière forte. Il est toujours possible<br />
<strong>de</strong> se montrer critique <strong>de</strong>vant le phénomène <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>, indéniable, mais force est <strong>de</strong> constater<br />
que, bi<strong>en</strong> loin <strong>de</strong> passer, l’<strong>en</strong>gouem<strong>en</strong>t pour le <strong>patrimoine</strong> voit au contraire son champ<br />
s’ét<strong>en</strong>dre. Il est <strong>en</strong> revanche raisonnable d’<strong>en</strong>visager le processus <strong>en</strong> réaction à la crainte<br />
<strong>de</strong> la perte d’une id<strong>en</strong>tité qui serait soluble dans la mondialisation, ou celle <strong>de</strong> l<strong>en</strong><strong>de</strong>mains<br />
inquiétants sur le plan <strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>tal 158 . Face à l’imm<strong>en</strong>sité <strong>du</strong> mon<strong>de</strong>, <strong>de</strong>vant l’infini <strong>de</strong>s<br />
possibles, l’homme <strong>du</strong> XXI e siècle se raccroche à <strong>de</strong>s réalités palpables. Il semble écartelé<br />
<strong>en</strong>tre l’infinim<strong>en</strong>t grand et l’infinim<strong>en</strong>t petit. À ce titre, les racines sont <strong>de</strong>s <strong>valeur</strong>s sûres<br />
auxquelles se référer. Le tourisme <strong>culturel</strong> à vocation patrimoniale propose à ses visiteurs <strong>de</strong><br />
s’intéresser à <strong>de</strong>s racines qui ne sont pas les leurs mais grâce auxquelles ils appréh<strong>en</strong>d<strong>en</strong>t<br />
un quotidi<strong>en</strong>, une réalité tangible et à dim<strong>en</strong>sion humaine. On peut aller jusqu’à <strong>par</strong>ler<br />
d’un véritable <strong>en</strong>richissem<strong>en</strong>t.<br />
154. Fiche signalétique extraite <strong>de</strong> Pays d’Art et d’Histoire et Pôles d’Économie <strong>du</strong> Patrimoine, DATAR, <strong>La</strong><br />
Docum<strong>en</strong>tation Française, 1999, p. 129.<br />
155. Une étu<strong>de</strong> statistique m<strong>en</strong>ée <strong>par</strong> le Conseil régional <strong>de</strong> Basse-Normandie est disponible sur le site :<br />
http://www.crbn.fr/tourisme-politique-regionale.php.<br />
156. Philippe Mairot, cité <strong>par</strong> Clau<strong>de</strong> Origet <strong>du</strong> Cluzeau, Le tourisme <strong>culturel</strong>, Paris, PUF, 2005, p. 70.<br />
157. Rachid Amirou, Imaginaire <strong>du</strong> tourisme <strong>culturel</strong>, Paris, PUF, 2000, p. 69.<br />
158. On a noté plus haut dans le texte le thème <strong>de</strong> l’édition 2007 <strong>du</strong> Salon <strong>du</strong> Patrimoine mais on peut <strong>en</strong>core<br />
citer l’attribution <strong>du</strong> Prix Nobel 2007 à l’américain Al Gore pour sa contribution à la lutte contre le réchauffem<strong>en</strong>t<br />
climatique ou le « Gr<strong>en</strong>elle <strong>de</strong> l’Environnem<strong>en</strong>t » français qui sont autant <strong>de</strong> marques d’une généralisation<br />
<strong>de</strong> l’inquiétu<strong>de</strong>.<br />
Schedae, 2008, prépublication n°10, (p.1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf<br />
35
36<br />
On l’a vu : les Français sont friands <strong>de</strong>s gran<strong>de</strong>s manifestations populaires évoquant la<br />
mémoire collective. Majoritairem<strong>en</strong>t, ils pratiqu<strong>en</strong>t un tourisme national. Contrairem<strong>en</strong>t aux<br />
idées reçues, les étrangers ne représ<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t que 20 % <strong>de</strong>s touristes sur le territoire français<br />
– 30 % <strong>en</strong> Basse-Normandie. Il faut donc s’adresser à une population désireuse <strong>de</strong> découvrir<br />
son <strong>patrimoine</strong> ou <strong>de</strong> le redécouvrir, ou, le cas échéant, d’éveiller <strong>en</strong> elle ce s<strong>en</strong>tim<strong>en</strong>t.<br />
Les vacances sont le temps privilégié <strong>de</strong> la découverte mais la ré<strong>du</strong>ction <strong>du</strong> temps <strong>de</strong> travail<br />
permet <strong>de</strong>s déplacem<strong>en</strong>ts pour un temps moins long et sur <strong>de</strong>s distances plus courtes.<br />
Il semble donc que le développem<strong>en</strong>t d’un tourisme à forte t<strong>en</strong>eur patrimoniale s’adresse<br />
davantage aux visiteurs nationaux et plus <strong>en</strong>core locaux. En se p<strong>en</strong>chant sur <strong>de</strong>s données<br />
statistiques, on constate que les visiteurs occasionnels <strong>en</strong>tr<strong>en</strong>t dans une logique <strong>de</strong> découverte<br />
<strong>culturel</strong>le se situant dans un rayon géographique <strong>de</strong> 50 kilomètres autour <strong>de</strong> chez eux.<br />
De manière <strong>par</strong>adoxale, on peut noter que jusqu’au début <strong>du</strong> XXe siècle, le tourisme<br />
était pratiquem<strong>en</strong>t synonyme <strong>de</strong> <strong>culturel</strong>. Clau<strong>de</strong> Origet <strong>du</strong> Cluzeau nous <strong>en</strong>seigne que la<br />
culture n’arrive aujourd’hui qu’<strong>en</strong> quatrième position <strong>de</strong>s motivations <strong>du</strong> touriste, lequel<br />
souhaite avant tout se divertir, se reposer, voir ses <strong>par</strong><strong>en</strong>ts et ses amis. <strong>La</strong> démocratisation <strong>du</strong><br />
savoir, <strong>du</strong> temps libre et <strong>de</strong> la culture aurait-elle in<strong>du</strong>it le phénomène exactem<strong>en</strong>t inverse<br />
<strong>de</strong> celui escompté ? Il n’<strong>en</strong> est ri<strong>en</strong>. Mais ainsi que l’écrit Antigone Mouchtouris, « plus la<br />
société <strong>de</strong> masse veut s’adresser à toutes les catégories <strong>par</strong> sa démarche, plus elle favorise la<br />
division <strong>en</strong> sous-catégories » 159 . Il serait illusoire <strong>de</strong> continuer à prôner un égalitarisme forcé<br />
dont nous mesurons toujours aujourd’hui l’échec pat<strong>en</strong>t. Il faut, au contraire, <strong>mise</strong>r sur la pluralité<br />
et la diversité <strong>de</strong> l’offre et <strong>de</strong> la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> pour t<strong>en</strong>ter <strong>de</strong> satisfaire un public multiple.<br />
Force est donc <strong>de</strong> nous interroger sur l’approche <strong>de</strong>s publics. Nous n’avons pas ici la<br />
prét<strong>en</strong>tion <strong>de</strong> révolutionner la question <strong>de</strong> l’approche <strong>de</strong>s publics et <strong>de</strong> réussir le <strong>par</strong>i <strong>de</strong><br />
la démocratisation <strong>de</strong> la culture là où les plus grands ont échoué. Néanmoins, l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s<br />
expéri<strong>en</strong>ces m<strong>en</strong>ées sur le terrain <strong>de</strong> la Lic<strong>en</strong>ce professionnelle « Développem<strong>en</strong>t et Protection<br />
<strong>du</strong> Patrimoine Culturel » nous autoris<strong>en</strong>t à <strong>en</strong>visager <strong>de</strong>s pistes. Ainsi que nous l’avons<br />
évoqué précé<strong>de</strong>mm<strong>en</strong>t et à la lumière <strong>de</strong>s travaux d’Olivier Donnat, il est évid<strong>en</strong>t que les<br />
mesures financières ne peuv<strong>en</strong>t suffire à elles seules à am<strong>en</strong>er un public socialem<strong>en</strong>t défavorisé<br />
vers la culture. Compte t<strong>en</strong>u <strong>de</strong> la forte corrélation qui existe <strong>en</strong>tre le niveau <strong>de</strong>s pratiques<br />
<strong>culturel</strong>les, le milieu social d’origine et le pouvoir d’achat, il faut t<strong>en</strong>ter d’agir sur ces<br />
critères, <strong>en</strong> interrogeant les facteurs d’empêchem<strong>en</strong>t pour mieux les combattre. Pour cela<br />
il faut probablem<strong>en</strong>t comm<strong>en</strong>cer <strong>par</strong> faire tomber tabous et barrières idéologiques. André<br />
Malraux, Jean Vilar 160 p<strong>en</strong>sai<strong>en</strong>t qu’il suffisait <strong>de</strong> calquer le modèle <strong>de</strong> l’école <strong>de</strong> Jules Ferry,<br />
« laïque, gratuite et obligatoire » sur la culture pour obt<strong>en</strong>ir le même succès. Mais les débats<br />
sur l’école, toujours vifs presque un siècle et <strong>de</strong>mi plus tard, sur l’égalité <strong>de</strong>s chances à l’école<br />
<strong>de</strong> la République 161 nous oblig<strong>en</strong>t à nuancer le propos. Faut-il absolum<strong>en</strong>t que tous soi<strong>en</strong>t<br />
intéressés <strong>de</strong> manière égale sur tout ? L’excell<strong>en</strong>ce et l’expertise représ<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t-elles un absolu ?<br />
Plus <strong>en</strong>core, faut-il tout savoir ?<br />
Toutes ces questions peuv<strong>en</strong>t donner le s<strong>en</strong>tim<strong>en</strong>t <strong>de</strong> fouler <strong>de</strong>s s<strong>en</strong>tiers maintes fois<br />
battus mais <strong>de</strong>vant la réalité <strong>de</strong>s <strong>en</strong>quêtes et <strong>de</strong>s statistiques qui ne laiss<strong>en</strong>t <strong>en</strong>trevoir aucune<br />
mutation fondam<strong>en</strong>tale, il convi<strong>en</strong>t <strong>de</strong> se poser une fois <strong>en</strong>core les mêmes interrogations et<br />
<strong>de</strong> préconiser <strong>de</strong>s remédiations, voire d’emprunter d’autres chemins. Ceci nous ap<strong>par</strong>aît<br />
d’autant plus nécessaire que la bibliographie que nous avons explorée t<strong>en</strong>d fortem<strong>en</strong>t vers un<br />
constat <strong>de</strong> pessimisme. Le sociologue Rachid Amirou écrit que « <strong>de</strong>v<strong>en</strong>ue pratique <strong>de</strong> consommation<br />
<strong>culturel</strong>le ou pro<strong>du</strong>it <strong>culturel</strong>, la culture est perçue comme un outil <strong>de</strong> développem<strong>en</strong>t<br />
159. Antigone Mouchtouris, Sociologie <strong>du</strong> public dans le champ <strong>culturel</strong> et artistique, Paris, L’Harmattan, p. 15.<br />
160. Dev<strong>en</strong>u Théâtre National <strong>de</strong> Chaillot.<br />
161. Il suffit d’évoquer ici <strong>par</strong> exemple le débat autour <strong>de</strong> la carte scolaire ou la discrimination positive, ou<br />
<strong>en</strong>core <strong>de</strong> se référer aux statistiques sur les origines sociales <strong>de</strong>s lauréats <strong>de</strong>s gran<strong>de</strong>s écoles.<br />
Schedae, 2008, prépublication n°10, (p. 1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf
économique » 162 , il <strong>par</strong>le <strong>en</strong>core <strong>du</strong> « <strong>culturel</strong> contre la culture » 163 . Histori<strong>en</strong>s et sociologues,<br />
désabusés, sembl<strong>en</strong>t démissionner et se cont<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t trop souv<strong>en</strong>t <strong>de</strong> déplorer les dérives<br />
<strong>culturel</strong>les motivées <strong>par</strong> les <strong>en</strong>jeux économiques. C’est précisém<strong>en</strong>t <strong>par</strong>ce que nous <strong>par</strong>tageons<br />
ces constats inquiétants que nous refusons <strong>de</strong> leur laisser le champ libre. Ainsi nous<br />
déf<strong>en</strong>dons pour notre <strong>par</strong>t une troisième. Il faut poursuivre la tâche qui est d’am<strong>en</strong>er le<br />
plus grand nombre à la culture sans pour autant rogner sur l’exig<strong>en</strong>ce sci<strong>en</strong>tifique.<br />
Nous p<strong>en</strong>sons que la démocratisation a davantage à voir avec la pédagogie différ<strong>en</strong>ciée<br />
qu’avec l’égalitarisme. Ceci impose <strong>de</strong> comm<strong>en</strong>cer <strong>par</strong> se questionner sur les objectifs<br />
fixés. En effet, il semble qu’<strong>en</strong> premier lieu il convi<strong>en</strong>t <strong>de</strong> distinguer <strong>en</strong>tre loisir et culture,<br />
comme on doit distinguer <strong>en</strong>tre histoire et mémoire. Le début <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong> est consacré à une<br />
exploration <strong>de</strong>s glissem<strong>en</strong>ts sémantiques <strong>de</strong> la notion <strong>de</strong> « <strong>patrimoine</strong> ». Ceux-ci sont à mettre<br />
<strong>en</strong> correspondance avec une t<strong>en</strong>dance plus générale à employer facilem<strong>en</strong>t un mot pour<br />
un autre. Ainsi voit-on se superposer dans les textes <strong>de</strong>s notions, certes voisines, et qui pourtant<br />
appell<strong>en</strong>t à être différ<strong>en</strong>ciées. On a beaucoup disserté sur la différ<strong>en</strong>ciation nécessaire<br />
<strong>en</strong>tre culture populaire et culture <strong>de</strong> masse 164 mais l’on semble beaucoup moins <strong>en</strong>clin à<br />
marquer la différ<strong>en</strong>ce avec la même rigueur dans les domaines <strong>du</strong> tourisme, <strong>de</strong> la culture<br />
et <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong>. On peut même se laisser aller à p<strong>en</strong>ser que la confusion <strong>de</strong>s termes, loin<br />
d’être une néglig<strong>en</strong>ce, s’avère être une manière <strong>de</strong> masquer l’échec <strong>de</strong>s politiques m<strong>en</strong>ées.<br />
Ceci justifierait que <strong>du</strong> côté <strong>de</strong> la politique l’on se gausse <strong>du</strong> succès populaire tandis que<br />
<strong>du</strong> côté sci<strong>en</strong>tifique l’on s’exaspère <strong>du</strong> marché <strong>de</strong> la mémoire.<br />
Nous avons posé un regard critique sur les propos <strong>de</strong> Rachid Amirou <strong>par</strong>ce qu’il ne<br />
nous semble pas proposer <strong>de</strong> réflexion constructive dans son ouvrage. Pourtant son étu<strong>de</strong><br />
est tout à fait <strong>en</strong>richissante et, comme pédagogue, nous le rejoignons tout à fait lorsqu’il<br />
déf<strong>en</strong>d l’idée que la confusion <strong>en</strong>tre loisir et culture s’amorce dès l’école. Les pratiques<br />
muséales s’inscriv<strong>en</strong>t dans le registre <strong>du</strong> faire au détrim<strong>en</strong>t <strong>du</strong> voir et <strong>de</strong> l’approche et <strong>de</strong><br />
la visite au musée. Par ailleurs, trop souv<strong>en</strong>t le musée n’est pas considéré <strong>par</strong> l’<strong>en</strong>seignant<br />
comme un outil au service <strong>du</strong> savoir : il vi<strong>en</strong>t récomp<strong>en</strong>ser les élèves ou marquer la fin <strong>de</strong><br />
l’année scolaire. On <strong>par</strong>le alors <strong>de</strong> « sortie » pédagogique. Élisabeth Caillet déf<strong>en</strong>d au contraire<br />
l’idée que c’est <strong>par</strong>ce que le musée n’est pas assez ludique que « si presque tous les<br />
<strong>en</strong>fants vont au moins une fois au musée <strong>du</strong>rant leur scolarité, il est amplem<strong>en</strong>t démontré<br />
165 qu’à l’âge a<strong>du</strong>lte seuls les indivi<strong>du</strong>s qui ont suivi <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s au-<strong>de</strong>là <strong>du</strong> lycée y<br />
retourn<strong>en</strong>t » 166 . <strong>La</strong> faute revi<strong>en</strong>drait à ce que la visite au musée soit assimilée à un cours<br />
classique et qu’elle laisse peu <strong>de</strong> place à l’appr<strong>en</strong>tissage informel, ce, d’autant que le<br />
retour <strong>en</strong> classe est souv<strong>en</strong>t synonyme pour les élèves d’évaluation. Elle invoque égalem<strong>en</strong>t<br />
la notion d’interdits qui accompagn<strong>en</strong>t les visites et qui serai<strong>en</strong>t rebutants pour les<br />
<strong>en</strong>fants et les adolesc<strong>en</strong>ts. Certes, la pratique muséale, <strong>par</strong>ticulièrem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> France, est<br />
sanctuarisée et ne laisse que peu <strong>de</strong> latitu<strong>de</strong> <strong>en</strong> terme <strong>de</strong> comportem<strong>en</strong>t. Une fois <strong>en</strong>core,<br />
nous nous positionnons <strong>en</strong>tre les <strong>de</strong>ux analyses mais nous ti<strong>en</strong>drons compte <strong>de</strong>s remarques<br />
formulées <strong>par</strong> chacun.<br />
Nous nous sommes intéressée à la façon dont est abordée la question patrimoniale<br />
dans les programmes scolaires, à travers les textes officiels, les manuels scolaires 167 et les<br />
162. Rachid Amirou, Imaginaire <strong>du</strong> tourisme <strong>culturel</strong>, Paris, PUF, 2000, p. 35.<br />
163. Ibid., p. 119.<br />
164. Lire sur le sujet Christopher <strong>La</strong>sch, Culture <strong>de</strong> masse ou culture populaire, trad. Frédéric Joly, Paris, Climats,<br />
2003, 80 pages.<br />
165. L’auteur s’appuie sur les <strong>en</strong>quêtes d’Olivier Donnat.<br />
166. Élisabeth Caillet, À l’approche <strong>du</strong> musée, la médiation <strong>culturel</strong>le, Lyon, PUL, 1995, p. 127.<br />
167. Les éditions <strong>de</strong> manuels sont nombreuses et les cont<strong>en</strong>us d’une gran<strong>de</strong> diversité, y compris sur le plan qualitatif.<br />
Nous avons compulsé les manuels <strong>de</strong>s classes <strong>de</strong> cinquième et <strong>de</strong> secon<strong>de</strong> qui sont les niveaux qui<br />
traitant <strong>de</strong> la naissance <strong>du</strong> mon<strong>de</strong> chréti<strong>en</strong> abord<strong>en</strong>t plus <strong>par</strong>ticulièrem<strong>en</strong>t <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong> bâti religieux. Nous<br />
Schedae, 2008, prépublication n°10, (p.1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf<br />
37
38<br />
ouvrages pédagogiques et didactiques 168 . Les Instructions officielles 169 <strong>du</strong> cycle c<strong>en</strong>tral <strong>de</strong><br />
l’<strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>t secondaire 170 <strong>en</strong>visag<strong>en</strong>t l’étu<strong>de</strong> <strong>du</strong> docum<strong>en</strong>t patrimonial 171 comme un<br />
support, un accompagnem<strong>en</strong>t au programme. Nous nous raccrochons donc aux manuels<br />
scolaires, outil <strong>de</strong> travail dont l’usage est quasi universel pour les <strong>en</strong>seignants et les élèves. Il<br />
est aussi pour ces <strong>de</strong>rniers, avec le cahier, le seul support <strong>de</strong> cours. Un manuel <strong>de</strong> cinquième<br />
<strong>de</strong> 2005 <strong>de</strong>s éditions Nathan, propose une double page <strong>de</strong> dossier, intitulée « <strong>patrimoine</strong> »<br />
au cœur <strong>de</strong> chaque chapitre étudié. Si l’on s’arrête sur celui <strong>de</strong> « L’Église <strong>en</strong> Occid<strong>en</strong>t », on<br />
trouve trois dossiers évoquant les églises romanes <strong>de</strong> Saint-Savin-sur-Gartempe et <strong>de</strong> Sainte-<br />
Trophime d’Arles, et l’abbaye <strong>de</strong> Font<strong>en</strong>ay. Les activités proposées sont tout à fait significatives<br />
<strong>du</strong> décalage qui existe <strong>en</strong>tre le vécu et le livresque et <strong>de</strong> la confusion qui <strong>en</strong> résulte.<br />
Après avoir relevé <strong>de</strong>s informations sur <strong>de</strong>s plans, <strong>de</strong>s photographies, les élèves sont am<strong>en</strong>és<br />
à rédiger un texte avec pour consigne : « Vous êtes un gui<strong>de</strong> et vous faites visiter l’église <strong>de</strong><br />
Saint-Savin-sur-Gartempe. Qu’expliquez-vous aux touristes qui vous écout<strong>en</strong>t ? ». On pourra<br />
facilem<strong>en</strong>t compr<strong>en</strong>dre qu’une telle expéri<strong>en</strong>ce ne puisse ri<strong>en</strong> apporter <strong>en</strong> terme <strong>de</strong> ress<strong>en</strong>ti<br />
à un pré-adolesc<strong>en</strong>t et qu’il n’<strong>en</strong> reti<strong>en</strong>ne que la notion <strong>de</strong> contrainte. Sans pour l’heure<br />
<strong>en</strong>trer dans le débat <strong>du</strong> classique (voire rétrogra<strong>de</strong>) ou <strong>du</strong> ludique, on ne peut <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r<br />
à un élève <strong>de</strong> douze ans <strong>de</strong> faire <strong>par</strong>tager une expéri<strong>en</strong>ce qu’il n’a lui-même vécue.<br />
Loin d’être un procès int<strong>en</strong>té au seul éditeur concerné <strong>par</strong> la rédaction <strong>du</strong> dossier, notre<br />
réflexion veut abor<strong>de</strong>r la question <strong>de</strong> la classe <strong>en</strong> tant qu’espace dans l’appr<strong>en</strong>tissage scolaire.<br />
Dans la mesure où la classe <strong>de</strong>meure le lieu privilégié, le <strong>patrimoine</strong> continue d’être<br />
une connaissance livresque, une repro<strong>du</strong>ction photographique et non un espace vécu, que<br />
l’indivi<strong>du</strong> s’approprie. L’<strong>en</strong>fant, l’adolesc<strong>en</strong>t viv<strong>en</strong>t dans un mon<strong>de</strong> étourdissant <strong>de</strong> mouvem<strong>en</strong>t.<br />
Comme élèves, ils connaiss<strong>en</strong>t l’immobilité : cathédrales, tableaux <strong>de</strong> maîtres et manuscrits<br />
ne sont plus que <strong>de</strong>s repro<strong>du</strong>ctions consignées dans <strong>de</strong>s manuels. Il nous semble que<br />
l’école <strong>de</strong> ce point <strong>de</strong> vue doit se rep<strong>en</strong>ser et, qu’à ce titre, le développem<strong>en</strong>t et la <strong>mise</strong> <strong>en</strong><br />
<strong>valeur</strong> <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong> local constitu<strong>en</strong>t un atout majeur pour un retour au réel dans la pédagogie.<br />
Toujours dans le souci <strong>de</strong> déf<strong>en</strong>dre l’égalité <strong>de</strong>s chances à l’école, il est bon <strong>de</strong> rappeler<br />
que seulem<strong>en</strong>t un <strong>en</strong>fant sur <strong>de</strong>ux <strong>par</strong>t <strong>en</strong> vacances. De ce fait, ai<strong>de</strong>r l’élève à découvrir<br />
et à côtoyer son lieu <strong>de</strong> vie, son milieu géographique et historique contribue à l’égalité <strong>de</strong>s<br />
chances. <strong>La</strong> pédagogie et le tourisme local sembl<strong>en</strong>t sur ce point tout à fait conciliables et<br />
notre projet <strong>de</strong> borne interactive in situ ap<strong>par</strong>aît comme un outil tout à fait appréciable et<br />
souhaitable pour p<strong>en</strong>ser l’espace vécu, qu’il soit historique ou géographique.<br />
Depuis 1988 172 , il existe pour les élèves <strong>du</strong> premier <strong>de</strong>gré un dispositif appelé « Classes<br />
<strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong> » 173 . L’expéri<strong>en</strong>ce se poursuit au collège <strong>en</strong> classe <strong>de</strong> cinquième. L’objectif<br />
est <strong>de</strong> permettre « aux jeunes <strong>de</strong> découvrir les richesses d’un site, son <strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t, les<br />
témoins historiques et artistiques qui le marqu<strong>en</strong>t, la vie qui les anime aujourd’hui ». Le texte<br />
est suffisamm<strong>en</strong>t ouvert pour laisser la pédagogie s’exprimer dans la diversité. On pourra<br />
se référer à <strong>de</strong>s expéri<strong>en</strong>ces d’<strong>en</strong>seignants ayant la charge <strong>de</strong> ces classes. Par exemple, <strong>de</strong>s<br />
élèves <strong>par</strong>tis à la découverte <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong> d’Arras découvr<strong>en</strong>t l’espace urbain <strong>en</strong> le foulant,<br />
168. avons dépouillé les publications <strong>de</strong>s éditeurs suivants : Belin, Bertrand-<strong>La</strong>coste, Bordas, Bréal, Hachette,<br />
Hatier, Magnard, Nathan.<br />
168. Les ouvrages <strong>de</strong> référ<strong>en</strong>ce sont cités dans la bibliographie <strong>en</strong> fin <strong>de</strong> volume.<br />
169. Les <strong>de</strong>rnières dat<strong>en</strong>t <strong>de</strong> février 2003.<br />
170. Soi<strong>en</strong>t les classes <strong>de</strong> cinquième et <strong>de</strong> quatrième générale.<br />
171. « L’étu<strong>de</strong> <strong>du</strong> docum<strong>en</strong>t patrimonial, nouveauté affichée <strong>de</strong>s programmes scolaires d’histoire et <strong>de</strong> géographie<br />
continue à faire ap<strong>par</strong>aître l’unité <strong>de</strong>s appr<strong>en</strong>tissages au collège », p. 93.<br />
172. Circulaire <strong>de</strong> l’É<strong>du</strong>cation nationale n° 88-063 <strong>du</strong> 10 mars 1988.<br />
173. Ce que Danielle Marcoin-Dubois et Odile Parsis-Barubé appell<strong>en</strong>t le « <strong>de</strong>rnier avatar <strong>de</strong> la classe<br />
transplantée », in Danielle Marcoin-Dubois et Odile Parsis-Barubé, Textes et lieux historiques à l’école,<br />
Paris, Bertrand-<strong>La</strong>coste, 1998, p. 21.<br />
Schedae, 2008, prépublication n°10, (p. 1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf
approch<strong>en</strong>t <strong>du</strong> regard le paysage <strong>du</strong> haut <strong>du</strong> beffroi, etc 174 . Lorsqu’ils regagn<strong>en</strong>t la salle <strong>de</strong><br />
classe, ils peuv<strong>en</strong>t effectivem<strong>en</strong>t travailler sur <strong>de</strong>s plans et autres docum<strong>en</strong>ts, iconographiques,<br />
textuels ou audiovisuels. On pourra att<strong>en</strong>dre d’eux une capacité à transposer cette<br />
expéri<strong>en</strong>ce à d’autres espaces <strong>par</strong>ce qu’une méthodologie aura été <strong>mise</strong> <strong>en</strong> place. Cette<br />
pédagogie ne concerne pourtant que trop peu d’élèves. On mesure la lour<strong>de</strong>ur <strong>du</strong> dispositif,<br />
<strong>en</strong> termes <strong>de</strong> moy<strong>en</strong>s humains et financiers et l’on ne peut que constater son caractère<br />
exceptionnel dans l’école égalitaire <strong>de</strong> la République. Ainsi, grâce au développem<strong>en</strong>t<br />
et à la <strong>mise</strong> <strong>en</strong> <strong>valeur</strong> <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong> <strong>culturel</strong> local, on peut imaginer que les élèves puiss<strong>en</strong>t<br />
vivre leur <strong>patrimoine</strong> et qu’il <strong>de</strong>vi<strong>en</strong>ne source <strong>de</strong> savoir, ne r<strong>en</strong>iant ri<strong>en</strong> <strong>du</strong> plaisir.<br />
Si l’on s’intéresse à prés<strong>en</strong>t aux réflexions qui guid<strong>en</strong>t la volonté d’intégrer le champ<br />
patrimonial <strong>de</strong> manière plus large dans le système é<strong>du</strong>catif français, on est étonné <strong>de</strong> constater<br />
que la littérature sur le sujet, prov<strong>en</strong>ant ess<strong>en</strong>tiellem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> tables ron<strong>de</strong>s ou <strong>de</strong> séminaires<br />
175 , met ess<strong>en</strong>tiellem<strong>en</strong>t l’acc<strong>en</strong>t sur la dim<strong>en</strong>sion civique <strong>de</strong>s projets et sur ces classes<br />
comme <strong>de</strong>s « expéri<strong>en</strong>ces d’appr<strong>en</strong>tissage <strong>de</strong> la tolérance et comme facteurs d’intégration<br />
sociale ». En fait, le <strong>patrimoine</strong> n’est pas <strong>en</strong>visagé <strong>de</strong> son point <strong>de</strong> vue matériel mais <strong>du</strong> point<br />
<strong>de</strong> vue <strong>de</strong>s <strong>valeur</strong>s qu’il transmet. On pourra <strong>par</strong>ler d’une église romane ou gothique mais<br />
ess<strong>en</strong>tiellem<strong>en</strong>t pour <strong>par</strong>ler <strong>de</strong> laïcité et d’intégration. Ainsi les actes <strong>du</strong> séminaire <strong>de</strong> Bruxelles<br />
nous dis<strong>en</strong>t :<br />
Le but <strong>de</strong> ce séminaire était <strong>de</strong> montrer comm<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s actions <strong>de</strong> pédagogie <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong>,<br />
<strong>en</strong> milieu scolaire et extra-scolaire, concour<strong>en</strong>t à l’objectif (<strong>de</strong> lutte contre la résurg<strong>en</strong>ce actuelle<br />
<strong>de</strong>s phénomènes <strong>de</strong> racisme, <strong>de</strong> xénophobie et d’antisémitisme, le développem<strong>en</strong>t d’un climat<br />
d’intolérance, la multiplication <strong>de</strong>s actes <strong>de</strong> viol<strong>en</strong>ce, notamm<strong>en</strong>t à l’égard <strong>de</strong>s migrants et <strong>de</strong>s<br />
personnes issues <strong>de</strong> l’immigration). Que ce soi<strong>en</strong>t les classes europé<strong>en</strong>nes <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong>, les<br />
ateliers, les opérations, les chantiers d’été, et bi<strong>en</strong> d’autres, <strong>par</strong>tout <strong>en</strong> Europe, ces actions<br />
éveill<strong>en</strong>t chez les jeunes <strong>de</strong>s dispositions autres que celles évaluées <strong>par</strong> le milieu scolaire. Elles<br />
sont précieuses comme moy<strong>en</strong> d’intégration <strong>de</strong> tous les jeunes <strong>par</strong> la diversité, <strong>en</strong>tre autres,<br />
<strong>de</strong>s moy<strong>en</strong>s <strong>de</strong> communication mis <strong>en</strong> œuvre 176 .<br />
Si l’intégralité <strong>du</strong> texte ne peut être reportée ici, le tout forme un <strong>en</strong>semble riche d’<strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>ts<br />
sur les nouveaux <strong>en</strong>jeux <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong> et sur l’utilisation politique nouvelle qui <strong>en</strong><br />
est faite, sous couvert <strong>de</strong> culture. Bi<strong>en</strong> que la démarche ne puisse que ret<strong>en</strong>ir notre intérêt<br />
puisqu’elle s’inscrit dans le s<strong>en</strong>s d’une plus gran<strong>de</strong> égalité <strong>de</strong>s citoy<strong>en</strong>s, elle nous oblige <strong>en</strong><br />
tant qu’histori<strong>en</strong>ne à nous interroger sur les s<strong>en</strong>s nouveaux <strong>de</strong> l’Histoire et <strong>de</strong> ce fait, sur le<br />
rôle dévolu à l’histori<strong>en</strong> dans le schéma nouveau qui se <strong>de</strong>ssine.<br />
Pour une culture raisonnée<br />
Nous avons vu dans l’étu<strong>de</strong> sémantique <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong> que la <strong>valeur</strong> <strong>de</strong> l’Histoire a toujours<br />
recouvert la dim<strong>en</strong>sion politique. Du temps <strong>de</strong> l’Anci<strong>en</strong> Régime déjà, dans la hiérarchie<br />
<strong>de</strong>s peintures, le g<strong>en</strong>re historique était celui qui t<strong>en</strong>ait la place la plus haute. Il ne s’agit pas<br />
dans le développem<strong>en</strong>t qui suit <strong>de</strong> rev<strong>en</strong>ir sur cette question. En revanche, ce qui précè<strong>de</strong><br />
nous amène à nous interroger sur le s<strong>en</strong>s <strong>de</strong> l’histoire aujourd’hui, et plus précisém<strong>en</strong>t sur<br />
son écriture. En regard <strong>de</strong> ce qui a pu être dit, l’histori<strong>en</strong> doit-il, et peut-il, <strong>en</strong>core jouer un<br />
rôle dans l’écriture <strong>de</strong> l’Histoire à l’heure <strong>de</strong> la médiation <strong>culturel</strong>le ? En d’autres termes,<br />
l’Histoire a-t-elle <strong>en</strong>core un s<strong>en</strong>s ? Pour nous, la question est une provocation à laquelle nous<br />
ne pouvons répondre que <strong>par</strong> l’affirmative. Il suffit <strong>de</strong> citer le proverbe qui dit « si tu ne sais<br />
174. Ibid., p. 50.<br />
175. Nous appuyons notre réflexion ici <strong>en</strong> <strong>par</strong>ticulier sur les actes d’un séminaire organisé <strong>par</strong> le Conseil <strong>de</strong><br />
l’Europe <strong>en</strong> août 1995 à Bruxelles.<br />
176. Ibid., p. 7.<br />
Schedae, 2008, prépublication n°10, (p.1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf<br />
39
40<br />
pas où tu vas, regar<strong>de</strong> d’où tu vi<strong>en</strong>s » pour décrire ce qui nous semble être la réalité <strong>de</strong> notre<br />
temps. Encore faut-il pour cela que la rigueur sci<strong>en</strong>tifique <strong>par</strong>ticipe à la transmission <strong>de</strong> la<br />
mémoire. Parce que nos sociétés, ayant accès à tout type d’information, mais aussi <strong>par</strong>ce<br />
que les médias, comme le système é<strong>du</strong>catif, sont obsédés <strong>par</strong> le fait que chaque citoy<strong>en</strong> doit<br />
ap<strong>par</strong>aître avant tout comme un acteur <strong>de</strong> sa citoy<strong>en</strong>neté, il semble que la notion d’expertise<br />
se dilue dans le schéma <strong>de</strong> la communication. Communiquer, voici le maître mot 177 . Mais<br />
à quelles fins ? Avec quels co<strong>de</strong>s ? Pour quel niveau <strong>de</strong> réception ? <strong>La</strong> communication est<br />
un processus complexe qui ne s’emplit <strong>de</strong> s<strong>en</strong>s que si chacun s’exprime dans son domaine<br />
<strong>de</strong> compét<strong>en</strong>ce 178 .<br />
Les m<strong>en</strong>aces sont nombreuses qui plan<strong>en</strong>t au <strong>de</strong>ssus <strong>de</strong> la sci<strong>en</strong>ce historique.<br />
Face à la nécessité <strong>de</strong> valorisation économique, un nouveau danger peut ap<strong>par</strong>aître pour le<br />
<strong>patrimoine</strong> : celui d’être dénaturé <strong>par</strong> un recours excessif à <strong>de</strong>s animations technologiques<br />
plus adaptées aux <strong>par</strong>cs à thèmes qu’à <strong>de</strong>s lieux d’histoire et <strong>de</strong> mémoire 179 .<br />
Les chiffres <strong>par</strong>l<strong>en</strong>t d’eux-mêmes : le site le plus visité <strong>en</strong> France est Disneyland, avec<br />
<strong>en</strong> moy<strong>en</strong>ne 12 millions <strong>de</strong> visiteurs <strong>par</strong> an. Le Louvre arrive <strong>en</strong> <strong>de</strong>uxième position comptant<br />
moitié moins <strong>de</strong> visiteurs 180 . Que faut-il <strong>en</strong> dé<strong>du</strong>ire ? On compr<strong>en</strong>dra aisém<strong>en</strong>t la t<strong>en</strong>tation<br />
d’utiliser les outils <strong>de</strong> Disneyland pour attirer un public au musée 181 . Guido Guerzoni<br />
et Gabriele Troilo r<strong>en</strong>forc<strong>en</strong>t les craintes lorsque, relatant une étu<strong>de</strong> m<strong>en</strong>ée à <strong>par</strong>tir <strong>de</strong> 110<br />
ouvrages traitant <strong>de</strong> la question <strong>du</strong> marketing dans les musées, ils déclar<strong>en</strong>t : « les économistes<br />
sont <strong>par</strong>v<strong>en</strong>us à transférer dans le domaine muséal la perception et les outils <strong>du</strong> marketing<br />
le plus traditionnel, sans pour ainsi dire y apporter <strong>de</strong> modifications […] : jusqu’à la fin<br />
<strong>de</strong>s années 1970, le marketing <strong>en</strong> milieu muséal consistait à réaliser <strong>de</strong>s <strong>en</strong>quêtes auprès<br />
<strong>du</strong> public et à analyser la composition <strong>de</strong> ce <strong>de</strong>rnier ; il prit <strong>par</strong> la suite le s<strong>en</strong>s <strong>de</strong> fixation<br />
<strong>de</strong>s prix et <strong>de</strong> communication, puis <strong>de</strong> développem<strong>en</strong>t et <strong>de</strong> collecte <strong>de</strong> fonds, avant <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>v<strong>en</strong>ir un marketing stratégique, etc. » 182 .<br />
Ainsi peut-on déplorer « l’habilitation <strong>du</strong> marketing comme moy<strong>en</strong> d’usage dans les<br />
musées » 183 . Pourtant, la suite <strong>du</strong> texte impose <strong>de</strong> nuancer le point <strong>de</strong> vue. En effet, « on<br />
s’aperçoit que l’adoption d’une logique et d’outils <strong>de</strong> communication intégrés incite le musée<br />
à considérer l’<strong>en</strong>semble <strong>de</strong> ses <strong>par</strong>t<strong>en</strong>aires comme son public <strong>de</strong> référ<strong>en</strong>ce » 184 . Faudrait-il<br />
donc a priori se priver d’un atout <strong>de</strong> développem<strong>en</strong>t au seul motif que <strong>de</strong>s dérives exist<strong>en</strong>t ?<br />
Insoupçonnable <strong>de</strong> démagogie dans le traitem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s œuvres, le Louvre réussit à gagner<br />
le <strong>par</strong>i <strong>de</strong> 6 millions <strong>de</strong> visiteurs. Le marketing et ses outils <strong>de</strong> positionnem<strong>en</strong>t permett<strong>en</strong>t<br />
une approche stratégique <strong>du</strong> public. Utilisé à bon esci<strong>en</strong>t, il satisfait le musée et son public.<br />
Or, le succès public est ess<strong>en</strong>tiel à la légitimité politique, <strong>culturel</strong>le, économique et sociale <strong>de</strong>s<br />
musées. En regard <strong>de</strong> tout ce qui précè<strong>de</strong>, on mesure que désormais ri<strong>en</strong> n’est plus <strong>en</strong>visageable<br />
sans cette même notion <strong>de</strong> public, et <strong>par</strong> conséqu<strong>en</strong>t <strong>de</strong> médiation <strong>culturel</strong>le. <strong>La</strong><br />
177. Dans la bibliographie nombreuse sur le question, on pourra se référer à quelques titres très éclairants sur<br />
la question : Ignacio Ramonet, <strong>La</strong> tyrannie <strong>de</strong> la communication, Paris, Gallimard, 2001, 290 pages. Dominique<br />
Wolton, Faut-il sauver la communication ?, Paris, Flammarion, 2005, 224 pages.<br />
178. On peut p<strong>en</strong>ser ici à une application <strong>de</strong> la théorie économique <strong>de</strong>s jeux afin d’opti<strong>mise</strong>r le processus <strong>de</strong><br />
communication.<br />
179. Rachid Amirou, Imaginaire <strong>du</strong> tourisme <strong>culturel</strong>, Paris, PUF, 2000, p. 102.<br />
180. INSEE, France <strong>en</strong> faits et chiffres, 12/2005, http://www.insee.fr.<br />
181. On pourra égalem<strong>en</strong>t noter ici l’impact <strong>du</strong> succès mondial <strong>du</strong> roman <strong>de</strong> Dan Brown, Da Vinci Co<strong>de</strong>, Paris,<br />
Pocket, 2004, 745 pages, dont il est intéressant <strong>de</strong> préciser qu’il fut tra<strong>du</strong>it <strong>par</strong> Daniel Roche.<br />
182. Guido Guerzoni et Gabriele Troilo, « Pour et contre le marketing », in L’av<strong>en</strong>ir <strong>de</strong>s musées, Actes <strong>du</strong> colloque<br />
<strong>de</strong>s 23-25 mars 2000, Paris, Réunion <strong>de</strong>s musées nationaux, 2001, p. 138.<br />
183. Ibid., p. 140.<br />
184. Ibid., p. 142.<br />
Schedae, 2008, prépublication n°10, (p. 1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf
lecture <strong>de</strong>s actes <strong>du</strong> colloque international qui s’est t<strong>en</strong>u au Louvre <strong>en</strong> 2000 interrogeant<br />
« l’av<strong>en</strong>ir <strong>de</strong>s musées » montre à quel point l’inquiétu<strong>de</strong> est gran<strong>de</strong>. Outre le « marketing »,<br />
on y lit une communication traitant <strong>du</strong> « sponsoring » 185 . Joch<strong>en</strong> San<strong>de</strong>r se <strong>de</strong>man<strong>de</strong>, lui,<br />
si le musée est <strong>en</strong>core un lieu <strong>de</strong> recherche 186 .<br />
Les <strong>mise</strong>s <strong>en</strong> gar<strong>de</strong> sont pléthore dans nos référ<strong>en</strong>ces bibliographiques. <strong>La</strong> somme dirigée<br />
<strong>par</strong> Pierre Nora 187 , rédigée <strong>par</strong> les plus grands noms <strong>de</strong> l’histoire, représ<strong>en</strong>te l’archétype<br />
<strong>de</strong>s craintes exprimées <strong>par</strong> les spécialistes. Elle pose les jalons d’un emballem<strong>en</strong>t <strong>de</strong><br />
l’histoire, d’une « accélération » 188 , qui se confondrait avec l’exercice <strong>de</strong> mémoire. Toujours<br />
selon Pierre Nora :<br />
L’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s lieux <strong>de</strong> mémoire se trouve ainsi à la croisée <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux mouvem<strong>en</strong>ts qui lui donn<strong>en</strong>t,<br />
<strong>en</strong> France et aujourd’hui sa place et son s<strong>en</strong>s : d’une <strong>par</strong>t un mouvem<strong>en</strong>t purem<strong>en</strong>t historiographique,<br />
le mom<strong>en</strong>t d’un retour réflexif <strong>de</strong> l’histoire sur elle-même ; d’autre <strong>par</strong>t, un mouvem<strong>en</strong>t<br />
proprem<strong>en</strong>t historique, la fin d’une tradition <strong>de</strong> mémoire. Le temps <strong>de</strong>s lieux, c’est ce<br />
mom<strong>en</strong>t précis où un imm<strong>en</strong>se capital que nous vivions dans l’intimité d’une mémoire dis<strong>par</strong>aît<br />
pour ne plus vivre que sous le regard d’une histoire reconstituée 189 .<br />
Pourtant, et avec tout le respect que nous <strong>de</strong>vons à nos maîtres, nous <strong>de</strong>meurons sceptique<br />
sur le s<strong>en</strong>s <strong>de</strong>s interrogations qui anim<strong>en</strong>t les experts. À explorer la bibliographie, il<br />
semble qu’il y ait un décalage <strong>en</strong>tre leurs tourm<strong>en</strong>ts et la réalité <strong>de</strong>s faits. Les universitaires<br />
sont incontestablem<strong>en</strong>t inquiets. L’affaire est <strong>en</strong>t<strong>en</strong><strong>du</strong>e. Mais <strong>de</strong> quoi s’inquièt<strong>en</strong>t-ils ? Les<br />
musées connaiss<strong>en</strong>t un succès croissant. On <strong>en</strong> compte aujourd’hui <strong>en</strong>viron 3 000 répondant<br />
aux critères <strong>de</strong> l’ICOM 190 qui reçoiv<strong>en</strong>t chaque année plus <strong>de</strong> 50 millions <strong>de</strong> visiteurs. Le<br />
<strong>patrimoine</strong> <strong>culturel</strong> semble ne s’être jamais si bi<strong>en</strong> porté : il vit, s’anime sous les regards <strong>de</strong>s<br />
Français et <strong>de</strong>s visiteurs étrangers. On déplore davantage sa dilution que l’on ne craint son<br />
rétrécissem<strong>en</strong>t. Pourtant, on le traite aujourd’hui comme une espèce à protéger. Il nous<br />
semble que les inquiétu<strong>de</strong>s qui se manifest<strong>en</strong>t ont précisém<strong>en</strong>t à voir avec l’<strong>en</strong>thousiasme<br />
populaire. Dans les discours, l’effet <strong>de</strong> masse ap<strong>par</strong>aît toujours suspicieux 191 .<br />
Nous nous plaisons à imaginer que l’on peut lire dans les statistiques le signe d’un début<br />
<strong>de</strong> victoire <strong>de</strong> la démocratisation <strong>de</strong> la culture. Mais la masse n’est pas l’élite et le peuple<br />
éclairé n’a pas nécessairem<strong>en</strong>t les mêmes <strong>de</strong>sseins <strong>culturel</strong>s que l’érudit ou le passionné.<br />
Dominique Poulot cite H<strong>en</strong>ri Verne justifiant <strong>en</strong> 1936 192 avec difficulté auprès <strong>du</strong> cercle <strong>de</strong>s<br />
initiés l’ouverture <strong>du</strong> musée <strong>du</strong> Louvre <strong>en</strong> soirée. Il écrit :<br />
Peut-être <strong>en</strong> effet, tous nos visiteurs ne tireront-ils <strong>du</strong> Louvre et <strong>de</strong> nos autres musées ni les<br />
hypothèses subtiles <strong>du</strong> savant, ni les <strong>en</strong>chantem<strong>en</strong>ts délicats <strong>du</strong> connaisseur. Mais s’il est <strong>par</strong>mi<br />
eux quelques collectionneurs inspirés, quelques artistes inatt<strong>en</strong><strong>du</strong>s, cela ne suffit-il pas ?<br />
185. Berndt W. Lind<strong>en</strong>mann « Financem<strong>en</strong>t public, mécénat et sponsoring », in L’av<strong>en</strong>ir <strong>de</strong>s musées, Actes <strong>du</strong><br />
colloque <strong>de</strong>s 23-25 mars 2000, Paris, Réunion <strong>de</strong>s musées nationaux, 2001, p. 123-132.<br />
186. Joch<strong>en</strong> San<strong>de</strong>r, « Le musée est-il <strong>en</strong>core un lieu <strong>de</strong> recherche ? », in L’av<strong>en</strong>ir <strong>de</strong>s musées, Actes <strong>du</strong> colloque<br />
<strong>de</strong>s 23-25 mars 2000, Paris, Réunion <strong>de</strong>s musées nationaux, 2001, p. 329-340.<br />
187. Pierre Nora (dir.), Les lieux <strong>de</strong> mémoire, Tome 1, Paris, Gallimard, p. 28.<br />
188. Ibid., p. 23.<br />
189. Pierre Nora (dir.), Les lieux <strong>de</strong> mémoire, Tome 1, Paris, Gallimard, p. 28.<br />
190. International Council of Museum, « Le musée est une institution perman<strong>en</strong>te, sans but lucratif, au service<br />
<strong>de</strong> la société et <strong>de</strong> son développem<strong>en</strong>t, ouverte au public, et qui fait <strong>de</strong>s recherches concernant les<br />
témoins matériels <strong>de</strong> l’homme et <strong>de</strong> son <strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t, acquiert ceux-là, les conserve, les communique<br />
et notamm<strong>en</strong>t les expose à <strong>de</strong>s fins d’étu<strong>de</strong>s, d’é<strong>du</strong>cation et <strong>de</strong> délectation ».<br />
191. Pour une analyse historique <strong>du</strong> phénomène, on pourra se reporter à l’ouvrage <strong>de</strong> Louis Chevalier, Classes<br />
laborieuses et classes dangereuses, Paris, Perrin, 2002, 630 pages.<br />
192. H<strong>en</strong>ri Verne, Le Louvre la nuit, Paris, Éditions B. Arthaud, 1936, p. 40.<br />
Schedae, 2008, prépublication n°10, (p.1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf<br />
41
42<br />
Le débat nous semble être d’une gran<strong>de</strong> contemporanéité, tant le décalage <strong>en</strong>tre les<br />
aspirations <strong>de</strong> l’élite éclairée et les réalités vécues <strong>par</strong> la masse est important.<br />
Rompant avec l’approche traditionnelle, qui se voulait littéraire, sélective, esthétique, commémorative,<br />
les classes moy<strong>en</strong>nes ont imposé une visite plutôt visuelle, émotionnelle, historique,<br />
scolaire et surtout id<strong>en</strong>titaire, s’appropriant ainsi un passé historique qui jusqu’alors ne leur avait<br />
cons<strong>en</strong>ti aucune reconnaissance. Le tourisme <strong>culturel</strong> a per<strong>du</strong> sa vocation <strong>de</strong> signe social 193 .<br />
Il est aujourd’hui capital que les universitaires, sans ri<strong>en</strong> rogner <strong>de</strong> leur exig<strong>en</strong>ce sci<strong>en</strong>tifique,<br />
sort<strong>en</strong>t <strong>de</strong> leur tour d’ivoire et sacrifi<strong>en</strong>t davantage au <strong>de</strong>voir <strong>de</strong> transmission.<br />
En effet, il est très symptomatique <strong>de</strong> constater que les ouvrages qui trait<strong>en</strong>t <strong>de</strong> cette<br />
question r<strong>en</strong>d<strong>en</strong>t le public responsable <strong>de</strong> ces mutations tandis que souv<strong>en</strong>t la masse – mais<br />
il s’agit bi<strong>en</strong> là <strong>de</strong>s mêmes indivi<strong>du</strong>s – est condamnée pour sa passivité. Nous vivons dans<br />
un mon<strong>de</strong> où la vulgarisation est trop souv<strong>en</strong>t considérée comme une défaite <strong>du</strong> savoir. <strong>La</strong><br />
réalité ne saurait être si maniché<strong>en</strong>ne, et ceux-là mêmes qui sont ess<strong>en</strong>tiellem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s cibles<br />
pour les spots publicitaires lorsqu’ils allum<strong>en</strong>t leur télévision 194 , <strong>de</strong>vrai<strong>en</strong>t-ils, dans un schéma<br />
déterministe, se trouver <strong>en</strong> marge <strong>du</strong> chemin <strong>culturel</strong> ? C’est justem<strong>en</strong>t sur la question <strong>de</strong><br />
la cohabitation <strong>de</strong>s publics <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong> au s<strong>en</strong>s large qu’il faut aujourd’hui se p<strong>en</strong>cher.<br />
Toutes les étu<strong>de</strong>s démontr<strong>en</strong>t que le rapport aux choix <strong>culturel</strong>s est une affaire indivi<strong>du</strong>elle. <strong>La</strong><br />
masse se décompose <strong>en</strong> autant d’indivi<strong>du</strong>s. Les classes proposées <strong>par</strong> Olivier Donnat définiss<strong>en</strong>t<br />
tant <strong>de</strong> dis<strong>par</strong>ités qu’il est impossible <strong>de</strong> réfléchir à un emboîtem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s classes. <strong>La</strong><br />
réponse doit être indivi<strong>du</strong>elle, comme à la carte, susceptible <strong>de</strong> répondre à l’« expéri<strong>en</strong>ce<br />
s<strong>en</strong>sible » 195 vécue <strong>par</strong> le visiteur.<br />
Si les missions cardinales sont restées inchangées dans leurs gran<strong>de</strong>s lignes l’institution musée<br />
a profondém<strong>en</strong>t évolué : dans les mêmes murs, il ne s’agit plus <strong>du</strong> même équipem<strong>en</strong>t. Au cours<br />
<strong>de</strong>s tr<strong>en</strong>te <strong>de</strong>rnières années, ont interagi les politiques <strong>de</strong> l’État <strong>en</strong> faveur <strong>de</strong> la culture, <strong>de</strong> nouvelles<br />
ambitions architecturales, le r<strong>en</strong>ouveau <strong>de</strong>s conceptions muséographiques et <strong>de</strong>s médiations<br />
<strong>culturel</strong>les, l’ap<strong>par</strong>ition <strong>de</strong> nouveaux g<strong>en</strong>res <strong>de</strong> musées, mais aussi l’évolution <strong>du</strong> goût pour<br />
l’art ou <strong>en</strong>core l’attractivité <strong>de</strong>s gran<strong>de</strong>s expositions et <strong>de</strong>s lieux <strong>de</strong> <strong>patrimoine</strong>. Cette mutation<br />
que l’on a qualifiée <strong>de</strong> fièvre muséale s’est trouvée <strong>en</strong> phase avec l’évolution d’une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
loisirs stimulée <strong>par</strong> l’évolution <strong>du</strong> niveau <strong>de</strong> vie et la ré<strong>du</strong>ction <strong>du</strong> temps <strong>de</strong> travail, et marquée<br />
<strong>par</strong> l’int<strong>en</strong>sification <strong>de</strong> la mobilité et <strong>de</strong> l’int<strong>en</strong>sification <strong>du</strong> tourisme international <strong>de</strong> masse 196 .<br />
Faute d’une réponse adéquate au défi posé, il ne faut pas s’étonner que le vi<strong>de</strong> laissé<br />
<strong>par</strong> le sci<strong>en</strong>tifique fasse la <strong>par</strong>t belle à la motivation économique, racoleuse mais efficace.<br />
Il est temps pour les sci<strong>en</strong>tifiques <strong>de</strong> considérer la vulgarisation <strong>de</strong> leur savoir comme<br />
un atout pour permettre son développem<strong>en</strong>t. <strong>La</strong> crainte sous-jac<strong>en</strong>te est celle <strong>de</strong> la véracité<br />
<strong>de</strong> l’Histoire. <strong>La</strong> question est posée <strong>par</strong> Michel <strong>de</strong> Certeau : « Que fabrique l’histori<strong>en</strong><br />
lorsqu’il fait <strong>de</strong> l’histoire ? » 197 . En réalité, l’Histoire ne saurait s’écrire au singulier et il serait<br />
fort naïf <strong>de</strong> considérer le danger qui plane au-<strong>de</strong>ssus <strong>de</strong> la vérité historique comme le signe<br />
193. Valéry Patin, « Tourisme et culture », Les Cahiers Espaces, n° 37, juin 1994.<br />
194. «Il y a beaucoup <strong>de</strong> façons <strong>de</strong> <strong>par</strong>ler <strong>de</strong> la télévision. Mais dans une perspective “business”, soyons réalistes :<br />
à la base, le métier <strong>de</strong> TF1 c’est d’ai<strong>de</strong>r Coca Cola, <strong>par</strong> exemple, à v<strong>en</strong>dre son pro<strong>du</strong>it. Or pour qu’un message<br />
publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau <strong>du</strong> téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont pour<br />
vocation <strong>de</strong> la r<strong>en</strong>dre disponible : c’est-à-dire <strong>de</strong> divertir, <strong>de</strong> le dét<strong>en</strong>dre pour le pré<strong>par</strong>er <strong>en</strong>tre <strong>de</strong>ux messages.<br />
Ce que nous v<strong>en</strong>dons à Coca-Cola c’est <strong>du</strong> temps <strong>de</strong> cerveau humain disponible », propos <strong>de</strong> Patrick<br />
Le <strong>La</strong>y, PDG <strong>de</strong> TF1, extraits <strong>de</strong> Les dirigeants face au changem<strong>en</strong>t, Paris, Huitième Jour, 120 pages.<br />
195. Olivier Donnat et Paul Tolila (dir.), Les publics <strong>de</strong> la culture, Paris, Presses <strong>de</strong> Sci<strong>en</strong>ces Po, 2003, 393 pages.<br />
196. Anna Krebs et Bruno Maresca, Le r<strong>en</strong>ouveau <strong>de</strong>s musées, <strong>La</strong> Docum<strong>en</strong>tation Française, mars 2005, n° 910,<br />
p. 6.<br />
197. Michel <strong>de</strong> Certeau, L’écriture <strong>de</strong> l’histoire, Paris, Gallimard, 1975, p. 62.<br />
Schedae, 2008, prépublication n°10, (p. 1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf
d’un mon<strong>de</strong> qui <strong>par</strong>tirait a volo. Que vaudrait <strong>du</strong> reste une Histoire <strong>en</strong> réécriture perman<strong>en</strong>te<br />
qui resterait l’apanage d’un cercle d’initiés ? <strong>La</strong> démocratisation <strong>du</strong> savoir et <strong>de</strong> la culture<br />
implique un <strong>par</strong>tage nécessaire <strong>de</strong> la sci<strong>en</strong>ce historique, sans pour autant appeler ni une<br />
démission <strong>de</strong> ceux qui la maîtris<strong>en</strong>t ni une appropriation abusive <strong>de</strong> ceux qui n’<strong>en</strong> sont pas<br />
les garants. L’on ne peut, <strong>en</strong> effet, <strong>en</strong>visager comme aboutissem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s politiques <strong>culturel</strong>les<br />
et d’é<strong>du</strong>cation, héritées <strong>de</strong> la Révolution française, le mainti<strong>en</strong> <strong>du</strong> peuple à l’écart d’un savoir<br />
qui lui est désormais accessible et compréh<strong>en</strong>sible.<br />
En revanche, la situation actuelle pose <strong>de</strong>s <strong>en</strong>jeux importants. On a pu voir grâce aux<br />
<strong>en</strong>quêtes d’Olivier Donnat que les pratiques <strong>culturel</strong>les sont très loin d’être homogènes à la<br />
fois quantitativem<strong>en</strong>t et qualitativem<strong>en</strong>t. L’école n’est pas un moule dans lequel sont fon<strong>du</strong>es<br />
les inégalités.<br />
Le quasi doublem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> la proportion <strong>de</strong> la proportion <strong>de</strong>s bacheliers <strong>en</strong>tre 1973 et 1988, n’a<br />
eu aucun effet mécanique sur les sorties et les visites <strong>culturel</strong>les classiques. À ce titre, il vi<strong>en</strong>t<br />
rappeler l’efficacité <strong>de</strong>s barrières matérielles et surtout symboliques qui limit<strong>en</strong>t l’accès à cellesci,<br />
ainsi que la force <strong>de</strong>s mécanismes sociaux et économiques que doit affronter toute politique<br />
<strong>culturel</strong>le 198 .<br />
Pourtant, aujourd’hui, la massification scolaire a fait son œuvre : 70 % <strong>de</strong>s jeunes générations<br />
accèd<strong>en</strong>t à la classe terminale alors qu’elles étai<strong>en</strong>t 35 % <strong>en</strong> 1985 ; 97 % atteign<strong>en</strong>t<br />
le niveau <strong>de</strong> troisième. Si le milieu familial, on l’a vu, est capital pour le <strong>de</strong>v<strong>en</strong>ir <strong>culturel</strong> <strong>de</strong><br />
l’<strong>en</strong>fant, il n’<strong>en</strong> reste pas moins vrai que l’<strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>t disp<strong>en</strong>se un socle <strong>de</strong> connaissances<br />
qui r<strong>en</strong>d possible l’asc<strong>en</strong>sion sociale. Cette mission ne doit pas faillir à son <strong>de</strong>voir. Il faut faire<br />
face au déficit pédagogique et <strong>mise</strong>r sur <strong>de</strong>s nouvelles médiations possibles.<br />
Dans cette <strong>par</strong>tie, nous avons évoqué la question <strong>du</strong> point <strong>de</strong> vue <strong>du</strong> récepteur. Si nous<br />
nous p<strong>en</strong>chons maint<strong>en</strong>ant sur celle <strong>de</strong> la déf<strong>en</strong>se <strong>de</strong> la sci<strong>en</strong>ce historique elle-même, nous<br />
<strong>de</strong>vons considérer une fois <strong>en</strong>core la dim<strong>en</strong>sion économique. Il a été vu plus haut combi<strong>en</strong><br />
l’État se trouve dans une position délicate <strong>en</strong> matière <strong>culturel</strong>le. Plusieurs <strong>par</strong>amètres <strong>en</strong>tr<strong>en</strong>t<br />
<strong>en</strong> ligne <strong>de</strong> compte pour l’analyse. Tout d’abord, il n’existe ni art officiel ni histoire officielle<br />
dans la République. Pourtant, chaque jour la question <strong>de</strong> la mémoire et plus <strong>en</strong>core <strong>de</strong> la<br />
commémoration est soulevée 199 . Des choix s’opèr<strong>en</strong>t, qu’il est <strong>par</strong>fois besoin <strong>de</strong> motiver. Le<br />
champ <strong>culturel</strong> ayant le v<strong>en</strong>t <strong>en</strong> poupe, dans une économie dont la vocation non marchan<strong>de</strong><br />
est <strong>en</strong> pleine croissance, le pot<strong>en</strong>tiel économique est exploité à son comble. Il suffit <strong>de</strong> rappeler<br />
les extraits <strong>de</strong>s discours <strong>de</strong> nos dirigeants politiques cités plus haut. Il est donc avant<br />
tout question d’un investissem<strong>en</strong>t, soit d’un coût. Ainsi, à l’échelle <strong>du</strong> pays, on compr<strong>en</strong>d<br />
pourquoi et comm<strong>en</strong>t il est indisp<strong>en</strong>sable pour l’État c<strong>en</strong>tralisé <strong>de</strong> faire re<strong>de</strong>sc<strong>en</strong>dre à l’échelle<br />
locale, <strong>en</strong> premier lieu, l’intérêt <strong>de</strong>s populations locales pour leur <strong>patrimoine</strong> et, <strong>en</strong> conséqu<strong>en</strong>ce<br />
<strong>en</strong> second lieu, la décision budgétaire.<br />
On a pu <strong>par</strong>ler d’un dés<strong>en</strong>gagem<strong>en</strong>t progressif <strong>de</strong> l’État <strong>en</strong> faveur <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong>, mais<br />
le <strong>patrimoine</strong> ne dis<strong>par</strong>aît pas avec la transaction : il change <strong>de</strong> mains. Abondant et souv<strong>en</strong>t<br />
restauré à grands frais, le <strong>patrimoine</strong> bâti, <strong>en</strong> <strong>par</strong>ticulier, ne peut être mis <strong>en</strong> <strong>valeur</strong> sur les<br />
seuls subsi<strong>de</strong>s publics. C’est ici que l’on retrouve le mécénat et le sponsoring dont nous avons<br />
<strong>par</strong>lé plus haut. Si nous brandissons ces mots comme une m<strong>en</strong>ace, la défaite n’est pas <strong>en</strong>térinée.<br />
Le sci<strong>en</strong>tifique peut et doit générer les besoins qui conditionn<strong>en</strong>t aujourd’hui sa survie.<br />
S’il n’<strong>en</strong>t<strong>en</strong>d ri<strong>en</strong> aux dynamiques <strong>de</strong> son temps, son champ d’étu<strong>de</strong> se trouvera rapi<strong>de</strong>m<strong>en</strong>t,<br />
et irrémédiablem<strong>en</strong>t, <strong>en</strong>glouti <strong>par</strong> la sphère marchan<strong>de</strong>. En revanche, une discussion m<strong>en</strong>ant<br />
198. Olivier Donnat et D<strong>en</strong>is Cogneau, Les pratiques <strong>culturel</strong>les <strong>de</strong>s Français : 1973-1989, Ministère <strong>de</strong> la culture<br />
et <strong>de</strong> la communication, <strong>La</strong> Docum<strong>en</strong>tation Française, Paris, <strong>La</strong> Découverte, 1992, p. 102.<br />
199. Le scandale <strong>de</strong> Dominique <strong>de</strong> Villepin commémorant la bataille d’Austerlitz <strong>en</strong> fait foi.<br />
Schedae, 2008, prépublication n°10, (p.1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf<br />
43
44<br />
à la construction d’un véritable <strong>par</strong>t<strong>en</strong>ariat, dont les divid<strong>en</strong><strong>de</strong>s, intellectuels et financiers<br />
sont équitablem<strong>en</strong>t <strong>par</strong>tagés, et ce, au bénéfice d’un public comblé, ne nous semble pas une<br />
démarche inique.<br />
Nous avons évoqué un peu plus haut le déni social trop souv<strong>en</strong>t marqué chez les histori<strong>en</strong>s.<br />
De la même manière, dans un schéma où la recherche est avant tout publique, il<br />
semble y avoir une certaine pu<strong>de</strong>ur à <strong>par</strong>ler d’arg<strong>en</strong>t. L’état <strong>de</strong> la recherche <strong>en</strong> France est<br />
un sujet d’actualité, s<strong>en</strong>sible, qu’il ne nous ap<strong>par</strong>ti<strong>en</strong>t pas <strong>de</strong> comm<strong>en</strong>ter ici, mais dont nous<br />
pouvons tirer quelques <strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>ts pour notre étu<strong>de</strong>. Lorsque l’État déplore le gaspillage<br />
<strong>de</strong> moy<strong>en</strong>s, les laboratoires s’insurg<strong>en</strong>t et dénonc<strong>en</strong>t le manque <strong>de</strong> moy<strong>en</strong>s. Il n’est pas<br />
utopique ou scandaleux d’imaginer que les fonds publics et privés pourrai<strong>en</strong>t servir une<br />
même cause : celle <strong>de</strong> l’intérêt général et <strong>par</strong>ticulier. À l’heure où les nouvelles technologies<br />
investiss<strong>en</strong>t les ménages et permett<strong>en</strong>t un développem<strong>en</strong>t rapi<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’information et <strong>de</strong> la<br />
communication, il est urg<strong>en</strong>t pour l’histori<strong>en</strong> <strong>de</strong> s’intégrer au processus, sans quoi il sera<br />
rapi<strong>de</strong>m<strong>en</strong>t dépassé <strong>par</strong> la logique économique. <strong>La</strong> lecture <strong>de</strong>s lignes qui précèd<strong>en</strong>t semble<br />
sacrifier au réflexe <strong>de</strong> dépit et <strong>de</strong> non choix. Pourtant, nous déf<strong>en</strong>dons ar<strong>de</strong>mm<strong>en</strong>t l’idée,<br />
et c’est l’objet <strong>de</strong> la <strong>par</strong>tie qui suit, que loin d’être une fatalité, la réalité virtuelle et le multimédia<br />
constitu<strong>en</strong>t une vraie chance pour le développem<strong>en</strong>t et la <strong>mise</strong> <strong>en</strong> <strong>valeur</strong> <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong><br />
<strong>culturel</strong>.<br />
<strong>La</strong> <strong>mise</strong> <strong>en</strong> <strong>valeur</strong> <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong> <strong>culturel</strong> <strong>par</strong> la réalité virtuelle<br />
<strong>La</strong> réalité virtuelle appliquée à l’histoire<br />
Vers un <strong>patrimoine</strong> <strong>du</strong>rable<br />
Comme les lignes qui précèd<strong>en</strong>t le suggèr<strong>en</strong>t, nous étudierons la question <strong>de</strong> la réalité<br />
virtuelle au service <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux points <strong>de</strong> vue. L’un sera consacré aux <strong>en</strong>jeux liés<br />
à une évolution <strong>de</strong>s outils technologiques au service <strong>de</strong>s chercheurs. L’autre montrera que<br />
l’outil réalité virtuelle constitue un atout majeur pour l’approche <strong>de</strong>s publics. Cep<strong>en</strong>dant,<br />
nous souhaitons d’abord préciser quelques points quant à la bibliographie sur laquelle nous<br />
appuyons notre étu<strong>de</strong>. En premier lieu, il convi<strong>en</strong>t <strong>de</strong> remarquer qu’il n’existe que très peu<br />
<strong>de</strong> référ<strong>en</strong>ces relatives à la <strong>mise</strong> <strong>en</strong> <strong>valeur</strong> <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong> <strong>culturel</strong> <strong>par</strong> la réalité virtuelle ou<br />
les technologies multimédia. On trouve, chez certains auteurs 200 , une réflexion allant dans<br />
le s<strong>en</strong>s <strong>de</strong> l’approche <strong>de</strong>s publics et <strong>de</strong> la médiation <strong>culturel</strong>le, aspects ess<strong>en</strong>tiels, certes,<br />
mais qui n’abord<strong>en</strong>t pas la question <strong>du</strong> point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong> l’avancée <strong>de</strong> la recherche. En second<br />
lieu, lorsque les ouvrages trait<strong>en</strong>t <strong>de</strong> la question <strong>de</strong> la <strong>mise</strong> <strong>en</strong> <strong>valeur</strong> <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong> <strong>culturel</strong>,<br />
soit les nouvelles technologies – au s<strong>en</strong>s large – sont totalem<strong>en</strong>t abs<strong>en</strong>tes <strong>du</strong> propos, soit<br />
un court développem<strong>en</strong>t leur est consacré, mais comme un risque, une fatalité à laquelle il<br />
faut sacrifier, ou un danger contre lequel il faut appr<strong>en</strong>dre à se prémunir.<br />
Nous prét<strong>en</strong>dons que l’écriture virtuelle va dans le s<strong>en</strong>s <strong>de</strong> l’Histoire. Il fut un temps,<br />
long, <strong>du</strong>rant lequel l’Histoire était celle <strong>de</strong>s gran<strong>de</strong>s dates, <strong>de</strong>s grands hommes, et plus<br />
<strong>en</strong>core celle <strong>de</strong>s gran<strong>de</strong>s batailles. Le peuple se dissolvait dans le temps, sauf à considérer<br />
les révoltes, les gran<strong>de</strong>s pestes. L’indivi<strong>du</strong> dis<strong>par</strong>aissait au profit <strong>de</strong> la masse, <strong>de</strong> la culture<br />
et <strong>de</strong> la civilisation. Depuis quelques déc<strong>en</strong>nies, <strong>de</strong>s histori<strong>en</strong>s étudi<strong>en</strong>t le quotidi<strong>en</strong> <strong>de</strong>s<br />
hommes 201 , jusqu’à approcher leurs s<strong>en</strong>tim<strong>en</strong>ts 202 . En toute logique, il convi<strong>en</strong>t maint<strong>en</strong>ant<br />
200. On p<strong>en</strong>se <strong>en</strong> <strong>par</strong>ticulier aux travaux <strong>de</strong> G<strong>en</strong>eviève Vidal, voir bibliographie <strong>en</strong> fin <strong>de</strong> volume.<br />
201. On peut faire référ<strong>en</strong>ce ici à la série intitulée <strong>La</strong> vie quotidi<strong>en</strong>ne au temps <strong>de</strong>…, publiée chez Hachette.<br />
202. On p<strong>en</strong>se <strong>par</strong> exemple aux travaux <strong>de</strong> Philippe Ariès sur la mort <strong>en</strong> Occid<strong>en</strong>t qui ont montré <strong>par</strong> l’analyse<br />
comportem<strong>en</strong>tale ce que les statistiques contestai<strong>en</strong>t : la mort n’était pas anodine à l’Époque Mo<strong>de</strong>rne<br />
et les <strong>par</strong><strong>en</strong>ts aimai<strong>en</strong>t leurs <strong>en</strong>fants.<br />
Schedae, 2008, prépublication n°10, (p. 1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf
<strong>de</strong> proposer <strong>de</strong>s images <strong>de</strong> restitution <strong>de</strong> ce qui un jour fut vécu 203 . Certes, la construction<br />
<strong>de</strong> modèles pose <strong>de</strong>s limites que nous étudierons plus loin. Même loin d’être <strong>par</strong>faites, ces<br />
images offr<strong>en</strong>t au regard <strong>de</strong>s visiteurs au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> ce que leur imagination leur laisse press<strong>en</strong>tir<br />
ou ress<strong>en</strong>tir. Non seulem<strong>en</strong>t la restitution virtuelle ne r<strong>en</strong>ie <strong>en</strong> ri<strong>en</strong> les outils qui l’ont<br />
précédée (peinture, maquettes, photographies), mais plus <strong>en</strong>core elle les utilise et les intègre<br />
dans le travail pré<strong>par</strong>atoire. Elle constitue un nouvel aboutissem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> la recherche. Comme<br />
l’indique le psychanalyste Serge Tisseron, il ne faut pas p<strong>en</strong>ser que la réalité virtuelle est, soit<br />
une réalité concrète externe à tous, soit une réalité psychique interne, propre à chacun 204 .<br />
Elle crée une illusion <strong>de</strong> réalité presque <strong>par</strong>faite, <strong>par</strong>ticipant ainsi <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux. C’est sur cette<br />
base que nous <strong>en</strong>visagerons l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> la représ<strong>en</strong>tation virtuelle <strong>du</strong> temps historique.<br />
Quelques ouvrages exist<strong>en</strong>t néanmoins, non théoriques, mais relatant une expéri<strong>en</strong>ce<br />
<strong>de</strong> <strong>mise</strong> <strong>en</strong> virtualité d’un <strong>patrimoine</strong> défini 205 . Ainsi, pour alim<strong>en</strong>ter la réflexion, nous avons<br />
constitué d’une <strong>par</strong>t un corpus docum<strong>en</strong>taire sur le sujet <strong>en</strong> prélevant, <strong>de</strong> manière é<strong>par</strong>se,<br />
les quelques lignes consacrées à la réalité virtuelle dans les ouvrages étudiés ; d’autre <strong>par</strong>t,<br />
pour son<strong>de</strong>r ce thème <strong>en</strong>core largem<strong>en</strong>t inexploré <strong>en</strong> matière <strong>de</strong> <strong>patrimoine</strong> <strong>culturel</strong>, nous<br />
avons élargi l’étu<strong>de</strong> aux technologies nouvelles, appliquées à la culture <strong>de</strong> manière générale.<br />
Nous v<strong>en</strong>ons d’écrire que le plus souv<strong>en</strong>t, la question <strong>de</strong>s technologies nouvelles est<br />
abs<strong>en</strong>te <strong>de</strong>s ouvrages traitant <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong> <strong>culturel</strong> ou que ceux qui y sacrifi<strong>en</strong>t s’<strong>en</strong> méfi<strong>en</strong>t.<br />
Nous ne pourrons mesurer les <strong>en</strong>jeux d’un tel progrès que si, au<strong>par</strong>avant, nous avons id<strong>en</strong>tifié<br />
et comm<strong>en</strong>té les freins les plus forts qui s’opèr<strong>en</strong>t. D’une certaine manière, le premier<br />
<strong>en</strong>jeu <strong>de</strong> la réalité virtuelle appliquée à l’histoire consiste à combattre les résistances. « <strong>La</strong><br />
réalité d’une inv<strong>en</strong>tion n’est pas la preuve <strong>de</strong> sa légitimité » 206 pas plus que « la virtualité <strong>du</strong><br />
mon<strong>de</strong> ne suffit […] à la r<strong>en</strong>dre compréh<strong>en</strong>sible » 207 . Les raisons qui les expliqu<strong>en</strong>t sont nombreuses.<br />
Nous nous proposons d’<strong>en</strong> expliciter quelques unes ici. Nous veillerons, néanmoins,<br />
dans notre étu<strong>de</strong>, à ne pas opposer <strong>de</strong>ux mon<strong>de</strong>s, l’un garant d’une tradition, l’autre tourné<br />
vers le progrès.<br />
Pour beaucoup, l’histori<strong>en</strong> nourrit son travail <strong>de</strong> l’observation <strong>de</strong>s autres sci<strong>en</strong>ces. Pourquoi<br />
<strong>de</strong>vrait-il craindre d’être soumis aux mêmes règles ? L’histori<strong>en</strong> n’est spécialiste que d’histoire,<br />
et c’est déjà beaucoup. Chacune <strong>de</strong>s pierres posées sur l’édifice <strong>du</strong> temps a construit<br />
le raisonnem<strong>en</strong>t historique, lequel avance corrélativem<strong>en</strong>t aux progrès qui <strong>en</strong>tour<strong>en</strong>t sa<br />
sci<strong>en</strong>ce. Aujourd’hui, il pr<strong>en</strong>d peur face aux « nouvelles technologies ». Pourquoi échapperai<strong>en</strong>t-elles<br />
davantage à son contrôle que les sci<strong>en</strong>ces humaines, dans la mesure où la réalité<br />
virtuelle ne fait que représ<strong>en</strong>ter le savoir historique ? Il n’y a pas <strong>de</strong> perte <strong>de</strong> dignité à<br />
s’allier aux sci<strong>en</strong>ces dite <strong>du</strong>res. Chaque âge <strong>de</strong> l’Histoire craint la mo<strong>de</strong>rnité <strong>en</strong> même temps<br />
que cette <strong>de</strong>rnière le fascine. Du reste, l’Histoire s’écrit beaucoup sur <strong>de</strong>s extrapolations à<br />
<strong>par</strong>tir <strong>de</strong>s sources et les exemples sont innombrables qui vi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t démonter telle thèse<br />
déf<strong>en</strong><strong>du</strong>e toute une vie mais qu’une découverte vi<strong>en</strong>t mettre à mal. Il est probablem<strong>en</strong>t<br />
symptomatique <strong>de</strong> constater que beaucoup <strong>de</strong> nos référ<strong>en</strong>ces bibliographiques jett<strong>en</strong>t un<br />
regard critique à la fois sur les nouvelles technologies et sur l’histoire. En réalité cette méfiance,<br />
203. Le cinéma s’em<strong>par</strong>e <strong>de</strong> cette nouvelle conception <strong>de</strong> l’écriture historique, si l’on se réfère à Rome, péplum<br />
qui traite <strong>de</strong> la fin <strong>de</strong> la République romaine <strong>du</strong> point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux soldats, Marcus Vor<strong>en</strong>ius et Titus Poulo.<br />
Si l’on ne peut trouver <strong>de</strong> trace <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>ux hommes dans l’histoire <strong>de</strong> Rome, ils incarn<strong>en</strong>t <strong>en</strong> revanche<br />
ce que pouvai<strong>en</strong>t être la vie <strong>du</strong> quidam, fait nouveau dans le g<strong>en</strong>re <strong>du</strong> péplum, d’ordinaire plus <strong>en</strong>clin à<br />
mettre <strong>en</strong> exergue le <strong>de</strong>stin d’hommes lég<strong>en</strong>daires. Ce qui précè<strong>de</strong> doit v<strong>en</strong>ir r<strong>en</strong>forcer nos propos sur la<br />
nécessité pour l’histori<strong>en</strong> <strong>de</strong> s’inscrire dans le champ <strong>de</strong> l’histoire racontée.<br />
204. Serge Tisseron (dir.), Adolesc<strong>en</strong>ce, « Virtuel », n° 47, printemps 2004, Tome 22, n° 1.<br />
205. Nous faisons référ<strong>en</strong>ce <strong>en</strong> <strong>par</strong>ticulier ici aux travaux <strong>de</strong> Philippe Fleury et <strong>de</strong> Jean-Clau<strong>de</strong> Golvin, voir<br />
bibliographie <strong>en</strong> fin <strong>de</strong> volume.<br />
206. Clau<strong>de</strong> Cadoz, Les réalités virtuelles, un exposé pour compr<strong>en</strong>dre, Paris, Flammarion, 1994, p. 74.<br />
207. Philippe Fuchs, Les interfaces <strong>de</strong> la réalité virtuelle, Montpellier, Association <strong>de</strong>s journées internationales<br />
<strong>de</strong> Montpellier-district, 1996, p. 18.<br />
Schedae, 2008, prépublication n°10, (p.1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf<br />
45
46<br />
a priori, ne s’inscrit pas dans le cadre sci<strong>en</strong>tifique mais dans celui <strong>de</strong> l’usage pot<strong>en</strong>tiel <strong>de</strong><br />
chacune d’elles, a fortiori, si elles se trouv<strong>en</strong>t associées. Des confessions <strong>de</strong> Patrick le <strong>La</strong>y<br />
à Second Life, les écueils sont nombreux à l’heure <strong>de</strong> la médiation <strong>culturel</strong>le.<br />
<strong>La</strong> préoccupation première, lorsqu’il s’agit <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong> bâti, va souv<strong>en</strong>t à l’effort <strong>de</strong><br />
restauration <strong>de</strong>s bâtim<strong>en</strong>ts eux-mêmes. L’État <strong>en</strong> assume la <strong>par</strong>t la plus gran<strong>de</strong> mais, <strong>de</strong> plus<br />
<strong>en</strong> plus, les prérogatives re<strong>de</strong>sc<strong>en</strong>d<strong>en</strong>t vers les collectivités locales. Dans la perspective <strong>de</strong><br />
sa <strong>mise</strong> <strong>en</strong> <strong>valeur</strong> pour un développem<strong>en</strong>t local, le petit <strong>patrimoine</strong> bâti <strong>de</strong>s <strong>par</strong>ticuliers<br />
sort <strong>de</strong> l’ombre 208 . Mais le plus souv<strong>en</strong>t il est <strong>en</strong> mauvais état <strong>de</strong> conservation : l’<strong>en</strong>gouem<strong>en</strong>t<br />
pour les boulangeries, moulins et autres lavoirs est somme toute réc<strong>en</strong>t. Le charme<br />
romantique <strong>de</strong> l’évocation <strong>de</strong>s ruines a connu ses heures <strong>de</strong> gloire : les tableaux nostalgiques<br />
d’Hubert Robert, au XVIII e siècle, <strong>en</strong> témoign<strong>en</strong>t. <strong>La</strong> ruine, loin <strong>du</strong> souci <strong>de</strong> véracité<br />
historique, s’imposait alors dans le tableau pour lui donner une atmosphère. On <strong>par</strong>le<br />
aujourd’hui fréquemm<strong>en</strong>t <strong>de</strong> nostalgie pour t<strong>en</strong>ter d’expliquer la fièvre patrimoniale qui<br />
s’est em<strong>par</strong>ée <strong>de</strong>s Français 209 . Pourtant, si sur le fond on peut s’accor<strong>de</strong>r avec cette thèse,<br />
on ne saurait rapprocher les <strong>de</strong>ux époques sur la <strong>valeur</strong> symbolique qu’elles transmett<strong>en</strong>t.<br />
<strong>La</strong> ruine n’est plus au goût <strong>du</strong> jour. Il faut reconstruire et restaurer. <strong>La</strong> trace doit être physique,<br />
ce qui explique l’empilem<strong>en</strong>t <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong>. Et dans le cas où les moy<strong>en</strong>s financiers<br />
manqu<strong>en</strong>t, les lieux sont laissés à l’abandon… <strong>en</strong> att<strong>en</strong>dant. Dans cette logique, la question<br />
<strong>de</strong> la reconstruction virtuelle n’ap<strong>par</strong>aît pas comme une alternative <strong>en</strong>visageable. On<br />
peut légitimem<strong>en</strong>t s’interroger sur cet aspect cumulatif <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong> et rev<strong>en</strong>ir <strong>de</strong> ce fait<br />
sur la dim<strong>en</strong>sion sci<strong>en</strong>tifique : le <strong>patrimoine</strong> bâti pr<strong>en</strong>d facilem<strong>en</strong>t une <strong>valeur</strong> illustrative qui<br />
n’apporte ri<strong>en</strong> à une sci<strong>en</strong>ce qui s’<strong>en</strong> désintéresse et l’abandonne au profit <strong>du</strong> tourisme.<br />
Une autre difficulté rési<strong>de</strong> dans l’impression que les g<strong>en</strong>s peuv<strong>en</strong>t avoir, a priori, d’une<br />
facilité d’utilisation <strong>de</strong> l’outil informatique. <strong>La</strong> vulgarisation <strong>de</strong>s outils, leur accessibilité, à<br />
la fois financière et technique, t<strong>en</strong>d<strong>en</strong>t à laisser p<strong>en</strong>ser que chacun peut tout faire. <strong>La</strong> réalité<br />
est toute autre, et l’outil 3D, <strong>en</strong> <strong>par</strong>ticulier, ne souffre aucun amateurisme, tant le travail<br />
<strong>de</strong> restitution, s’il prét<strong>en</strong>d à un quelconque intérêt sci<strong>en</strong>tifique, est d’une gran<strong>de</strong> complexité.<br />
Le plus souv<strong>en</strong>t, les t<strong>en</strong>tatives qui se font sans savoir se font aussi sans moy<strong>en</strong>s. Un matériel<br />
performant, doublé <strong>de</strong> l’achat <strong>de</strong>s lic<strong>en</strong>ces <strong>de</strong> logiciels, nécessite une <strong>mise</strong> <strong>de</strong> fonds qui<br />
dépasse les ambitions <strong>de</strong> <strong>mise</strong> <strong>en</strong> <strong>valeur</strong> <strong>de</strong>s <strong>par</strong>ticuliers mais aussi souv<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s équipes<br />
<strong>de</strong> recherche qui <strong>en</strong>visag<strong>en</strong>t le travail <strong>de</strong> restitution virtuelle comme une <strong>valeur</strong> ajoutée. Il<br />
s’agit là <strong>en</strong>core d’une stratégie d’accompagnem<strong>en</strong>t à la <strong>mise</strong> <strong>en</strong> <strong>valeur</strong>. Il faut ajouter à cela<br />
que les matériels évolu<strong>en</strong>t très vite et, pis <strong>en</strong>core, les supports <strong>de</strong>vi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t obsolètes <strong>de</strong><br />
plus <strong>en</strong> plus rapi<strong>de</strong>m<strong>en</strong>t 210 . Les systèmes d’exploitation informatique eux-mêmes r<strong>en</strong>d<strong>en</strong>t<br />
la pér<strong>en</strong>nité <strong>de</strong>s supports très incertaine : <strong>de</strong> la disquette au cédérom, <strong>du</strong> dévédérom à la<br />
clé USB, les projets oblig<strong>en</strong>t à une veille technologique et à une capacité <strong>de</strong> sauvegar<strong>de</strong><br />
importante. Nous revi<strong>en</strong>drons plus précisém<strong>en</strong>t sur ce point dans l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s limites <strong>de</strong>s<br />
nouvelles technologies.<br />
On peut <strong>en</strong>core <strong>en</strong>visager la question <strong>de</strong>s rétic<strong>en</strong>ces sous l’angle d’une peur irrationnelle<br />
<strong>du</strong> progrès, <strong>en</strong> <strong>par</strong>ticulier ici dans la mesure où le progrès apporté <strong>par</strong> la réalité virtuelle<br />
impose <strong>de</strong> reconsidérer la représ<strong>en</strong>tation que l’homme se faisait <strong>de</strong> l’espace <strong>de</strong>puis l’inv<strong>en</strong>tion<br />
<strong>de</strong> la perspective classique au XVe siècle. Avec Giotto, l’aplat trouvait sa profon<strong>de</strong>ur<br />
208. On trouve sur le sujet <strong>du</strong> « petit <strong>patrimoine</strong> local » une bibliographie très abondante dont certains titres<br />
sont cités <strong>en</strong> fin <strong>de</strong> volume.<br />
209. Jean-Pierre Rioux <strong>par</strong>le lui <strong>de</strong> « rétromanie », in Jean-Pierre Rioux et Jean-François Sirinelli (dir.), Pour une<br />
histoire <strong>culturel</strong>le, Éditions <strong>du</strong> Seuil, Paris, 1997, p. 328 ; pour Alain Bourdin, il s’agirait même d’un « mouvem<strong>en</strong>t<br />
d’opinion », in Alain Bourdin, Le <strong>patrimoine</strong> réinv<strong>en</strong>té, Paris, PUF, 1984, p. 19.<br />
210. Référ<strong>en</strong>ce à la Loi <strong>de</strong> Moore qui montre que la puissance <strong>de</strong>s microprocesseurs double tous les dix-huit<br />
mois <strong>de</strong>puis leur création.<br />
Schedae, 2008, prépublication n°10, (p. 1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf
géométrique <strong>par</strong> la ligne <strong>de</strong> fuite. L’homme singeait le Créateur dans une conception aristotélici<strong>en</strong>ne<br />
<strong>du</strong> mon<strong>de</strong>. Le système allait installer <strong>du</strong>rablem<strong>en</strong>t l’histoire <strong>de</strong> l’art dans un<br />
nouveau géoc<strong>en</strong>trisme et appuyer le travail <strong>de</strong> l’architecture dans les premiers efforts <strong>de</strong><br />
restitution historique 211 . Bi<strong>en</strong> au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong>s velléités <strong>du</strong> cubisme <strong>de</strong> représ<strong>en</strong>ter sur un même<br />
plan toutes les faces d’un même volume, la réalité virtuelle simule le volume dans un espace<br />
à <strong>de</strong>ux dim<strong>en</strong>sions, ce que vi<strong>en</strong>t corriger l’immersion. Un pas est franchi dans le système<br />
<strong>de</strong> représ<strong>en</strong>tation, qui inquiète. Et si la réalité virtuelle se substituait à la réalité et qu’elle<br />
ne laissait plus <strong>de</strong> distinction possible <strong>en</strong>tre l’original et la copie ?<br />
Pourra-t-on <strong>en</strong>core longtemps prét<strong>en</strong>dre comme Clau<strong>de</strong> Cadoz que « la seule représ<strong>en</strong>tation<br />
absolue d’un objet est l’objet lui-même » 212 car « <strong>de</strong>ux objets quels qu’ils soi<strong>en</strong>t<br />
ont au moins une différ<strong>en</strong>ce : celle qui nous permet <strong>de</strong> considérer qu’ils sont <strong>de</strong>ux » 213 ? Il<br />
est un grand débat tout à fait passionnant et ess<strong>en</strong>tiel sur les technologies. Sont-elles au<br />
service <strong>de</strong> l’homme ou serv<strong>en</strong>t-elles à l’asservir toujours davantage 214 ? Nous n’avons pour<br />
vocation ici ni <strong>de</strong> trancher ni <strong>de</strong> réconcilier les <strong>de</strong>ux <strong>par</strong>ties dans un débat philosophique.<br />
Néanmoins, tout l’objet <strong>de</strong> ce travail est <strong>de</strong> faire avancer ledit débat <strong>par</strong> l’action <strong>en</strong> montrant<br />
que les nouvelles technologies peuv<strong>en</strong>t s’inscrire dans un cercle vertueux <strong>de</strong> la connaissance<br />
et <strong>du</strong> plaisir que l’on y pr<strong>en</strong>d, à considérer leur bon usage.<br />
Partant <strong>de</strong> ce postulat, il est temps <strong>de</strong> laisser <strong>de</strong>rrière nous l’explosion <strong>de</strong> craintes sur<br />
<strong>de</strong> pot<strong>en</strong>tielles dérives et <strong>de</strong> mesurer les apports <strong>de</strong> la réalité virtuelle pour la sci<strong>en</strong>ce historique<br />
et pour sa <strong>mise</strong> à disposition <strong>du</strong> public. Tout d’abord, interrogeons le champ <strong>de</strong> la<br />
sci<strong>en</strong>ce historique. Les avantages sont nombreux à utiliser l’outil virtuel comme élém<strong>en</strong>t <strong>de</strong><br />
recherche. Pour repr<strong>en</strong>dre la question <strong>de</strong> la représ<strong>en</strong>tation, la <strong>valeur</strong> ajoutée est considérable :<br />
là où l’architecture, la restauration sont contraintes <strong>de</strong> choisir, la reconstitution virtuelle permet<br />
une juxtaposition, voire une superposition <strong>de</strong>s styles. Cette démarche est fort intéressante<br />
et surtout instructive : elle permet <strong>de</strong> compr<strong>en</strong>dre la notion d’évolution architecturale et,<br />
ce faisant, stylistique. Le visiteur qui est habitué à voir, <strong>par</strong> exemple, dans une église gothique<br />
les fondations romanes, doit visualiser les transformations à <strong>par</strong>tir <strong>de</strong>s comm<strong>en</strong>taires<br />
<strong>du</strong> gui<strong>de</strong> (personne ou livre). Ce qui est valable pour l’évolution d’un édifice religieux l’est<br />
égalem<strong>en</strong>t pour l’archéologie : Jean-Clau<strong>de</strong> Golvin souligne dans son cours <strong>de</strong> Tunis tout<br />
l’intérêt <strong>de</strong> la réalité virtuelle <strong>en</strong> com<strong>par</strong>aison d’une maquette rigi<strong>de</strong>, pr<strong>en</strong>ant l’exemple <strong>de</strong>s<br />
quinze étapes d’évolution ré<strong>par</strong>ties sur plus <strong>de</strong> vingt siècles distinguées dans le grand temple<br />
d’Amon-Rê 215 .<br />
<strong>La</strong> visite virtuelle propose cet avantage considérable <strong>de</strong> donner une dim<strong>en</strong>sion temporelle<br />
à la représ<strong>en</strong>tation spatiale. L’imagination est un outil précieux mais qui pose <strong>de</strong>s<br />
limites sur lesquelles intervi<strong>en</strong>t la réalité virtuelle. En déambulant virtuellem<strong>en</strong>t dans un<br />
espace reconstitué, le visiteur doit pouvoir s<strong>en</strong>tir que, ce que l’on considère aujourd’hui être<br />
un <strong>patrimoine</strong> a vécu, traversé le temps, son usure et ses affres, subi <strong>de</strong>s <strong>de</strong>structions, <strong>de</strong>s<br />
inc<strong>en</strong>dies, <strong>de</strong>s guerres, autant que <strong>de</strong>s aménagem<strong>en</strong>ts, <strong>de</strong>s modifications, qu’il convi<strong>en</strong>t <strong>de</strong><br />
nommer mo<strong>de</strong>rnisations. Tout ceci se <strong>de</strong>ssine sous les yeux <strong>du</strong> visiteur, qui voit se recomposer,<br />
211. C’est certainem<strong>en</strong>t avec Viollet-le-Duc au XIX e siècle que le travail <strong>de</strong> restitution architecturale vécut ses<br />
plus gran<strong>de</strong>s heures.<br />
212. Clau<strong>de</strong> Cadoz, Les réalités virtuelles, un exposé pour compr<strong>en</strong>dre, Paris, Flammarion, 1994, p. 103.<br />
213. Ibid., p. 78.<br />
214. On lira sur le sujet le passionnant livre <strong>de</strong> Andrew Fe<strong>en</strong>berg, (Re)p<strong>en</strong>ser la technique, vers une technologie<br />
démocratique, Paris, <strong>La</strong> Découverte, MAUSS, Coll. Recherches, 2004, 230 pages et bi<strong>en</strong> sûr les ouvrages<br />
d’Annah Ar<strong>en</strong>dt, <strong>La</strong> condition <strong>de</strong> l’Homme mo<strong>de</strong>rne, Paris, Pocket, 1989, 380 pages et <strong>de</strong> Walter B<strong>en</strong>jamin,<br />
« L’œuvre d’art à l’heure <strong>de</strong> sa repro<strong>du</strong>ctivité technique », in Le langage et la culture, Paris, D<strong>en</strong>oël, 1971,<br />
181 pages.<br />
215. Jean-Clau<strong>de</strong> Golvin, L’image <strong>de</strong> restitution et la restitution <strong>de</strong> l’image, cours <strong>de</strong> DPEA « Culture numérique<br />
et <strong>patrimoine</strong> architectural », p. 18, http://www.map.archi.fr/cycle3/DPEA_MCAN/supportsCours/JCG2.pdf.<br />
Schedae, 2008, prépublication n°10, (p.1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf<br />
47
48<br />
et dans un grand souci <strong>de</strong> réalisme, <strong>de</strong>s siècles <strong>de</strong> labeur, <strong>de</strong>s <strong>par</strong>tis pris architecturaux et <strong>de</strong>s<br />
mo<strong>de</strong>s. On ne peut rêver meilleure <strong>mise</strong> <strong>en</strong> <strong>valeur</strong> que celle qui redonne un corps et une vie<br />
à ce qui n’est plus.<br />
On mesure immédiatem<strong>en</strong>t l’intérêt <strong>de</strong> la réalité virtuelle qui intègre ce qu’aucune autre<br />
technologie n’avait jamais permis jusqu’alors : la notion <strong>de</strong> prom<strong>en</strong>a<strong>de</strong>, <strong>de</strong> déambulation<br />
dans un espace reconstitué, celui d’une ville 216 <strong>par</strong> exemple. Elle permet une appropriation<br />
<strong>de</strong> cet espace <strong>par</strong> le visiteur, le chercheur <strong>en</strong> premier lieu, offrant <strong>par</strong>fois une solution à <strong>de</strong>s<br />
énigmes sci<strong>en</strong>tifiques 217 , ce, <strong>par</strong>ce qu’elle rapporte l’Histoire à échelle humaine, d’un point<br />
<strong>de</strong> vue spatio-temporel, voire à ses préoccupations quotidi<strong>en</strong>nes. L’hypothèse ret<strong>en</strong>ue lors <strong>de</strong><br />
l’exam<strong>en</strong> <strong>de</strong>s sources textuelles, iconographiques, archéologiques, trouve ici sa cohér<strong>en</strong>ce,<br />
ou son incohér<strong>en</strong>ce – ce qui oblige dans le <strong>de</strong>rnier cas à réévaluer la thèse déf<strong>en</strong><strong>du</strong>e – à<br />
l’épreuve <strong>de</strong> la réalité virtuelle. C’est ce que rapporte l’archéologue et histori<strong>en</strong> Jean-Pierre<br />
Bost, à propos <strong>du</strong> site gallo-romain <strong>de</strong> Plassac.<br />
Face à l’écran, impossible d’élu<strong>de</strong>r les problèmes. <strong>La</strong> réalité virtuelle oblige à se poser les bonnes<br />
questions, « à préciser ce que l’on sait déjà ». Les fondations indiqu<strong>en</strong>t l’emplacem<strong>en</strong>t d’une<br />
porte ? Oui, mais à quelle hauteur ? De quel aspect ? Avec un ou <strong>de</strong>ux battants ? 218 .<br />
Toujours à considérer la notion d’échelle, on peut, grâce à cette application, aller plus loin<br />
dans le réalisme <strong>du</strong> vécu. En effet, lorsque les sites ont dis<strong>par</strong>u <strong>par</strong>tiellem<strong>en</strong>t ou <strong>en</strong> totalité, ou<br />
qu’ils <strong>de</strong>meur<strong>en</strong>t à l’état <strong>de</strong> monum<strong>en</strong>ts, mais qu’ils n’ont plus l’activité pour laquelle ils ont<br />
été édifiés, la simulation offre aux yeux <strong>du</strong> spectateur une idée (plus) juste <strong>de</strong> la réalité vécue :<br />
« les édifices et les sites que nous étudions n’étai<strong>en</strong>t pas <strong>de</strong>s ruines » 219 dit Jean-Clau<strong>de</strong><br />
Golvin. « C’est la volonté <strong>de</strong> créer un édifice pour lui faire assumer une fonction qui explique<br />
son exist<strong>en</strong>ce et celle-ci avait un rapport direct avec sa forme », « une forme signifiante » 220 .<br />
C’est le cas <strong>du</strong> théâtre <strong>de</strong> Pompée, qui a presque totalem<strong>en</strong>t dis<strong>par</strong>u 221 . Lorsque Marcus, le<br />
visiteur virtuel, <strong>de</strong> sa taille d’homme, observe <strong>du</strong> haut <strong>de</strong>s gradins la scène sur laquelle se<br />
jouai<strong>en</strong>t les pièces au IV e siècle <strong>de</strong> notre ère, le théâtre ap<strong>par</strong>aît gigantesque. On compr<strong>en</strong>d<br />
alors aisém<strong>en</strong>t, <strong>en</strong>tre autres, pourquoi les comédi<strong>en</strong>s portai<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s costumes <strong>de</strong> couleurs<br />
tranchées qui permettai<strong>en</strong>t <strong>de</strong> mieux les id<strong>en</strong>tifier.<br />
Ainsi, le procès qui vi<strong>en</strong>drait condamner la réalité virtuelle comme outil sci<strong>en</strong>tifique<br />
tombe <strong>de</strong> lui-même. <strong>La</strong> création virtuelle ne saurait être l’abstraction <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong> bâti voire<br />
sa négation. Il ne s’agit <strong>en</strong> ri<strong>en</strong> d’un travail <strong>de</strong> substitution. Comme le carbone 14 <strong>en</strong> son<br />
temps a permis <strong>de</strong> dater <strong>de</strong>s découvertes archéologiques majeures, ou les infrarouges qui<br />
donn<strong>en</strong>t à voir les couches successives d’un tableau, id<strong>en</strong>tifiant <strong>du</strong> même coup maître et<br />
faussaire, la réalité virtuelle marque un progrès déterminant dans l’histoire <strong>de</strong>s techniques.<br />
Elle contribue dans une certaine mesure à écrire l’histoire <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong>. Elle prés<strong>en</strong>te égalem<strong>en</strong>t<br />
l’intérêt <strong>de</strong> s’inscrire dans un processus plus général d’informatisation <strong>du</strong> savoir.<br />
André Chastel, dont on ne pouvait soupçonner la complaisance <strong>en</strong>vers la manipulation<br />
patrimoniale, a écrit que les nouvelles technologies, la mo<strong>de</strong>rnité permett<strong>en</strong>t d’accroître<br />
216. On p<strong>en</strong>se ici <strong>en</strong> <strong>par</strong>ticulier aux travaux <strong>de</strong> Jean-Clau<strong>de</strong> Golvin <strong>en</strong> Tunisie, à Dougga.<br />
217. Nous nous référons ici au travail réalisé <strong>par</strong> Sophie Ma<strong>de</strong>leine sur la simulation <strong>de</strong> l’<strong>en</strong>soleillem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> l’édifice<br />
pour t<strong>en</strong>ter <strong>de</strong> reconstituer la technologie <strong>du</strong> velum la plus probable. Voir bibliographie <strong>en</strong> fin <strong>de</strong> volume.<br />
218. Libération, 24 septembre 2005, Virtuel antique, <strong>par</strong> Rafaëlle Brillaud.<br />
219. Jean-Clau<strong>de</strong> Golvin, Jean-Clau<strong>de</strong> Golvin, « L’image <strong>de</strong> restitution et la restitution <strong>de</strong> l’image », cours<br />
donné à Tunis dans le cadre <strong>de</strong> DPEA « Culture numérique et <strong>patrimoine</strong> architectural », <strong>de</strong> l’École Nationale<br />
Supérieure d’Architecture (ENSA) <strong>de</strong> Marseille, p. 17.<br />
220. Ibid., p. 17.<br />
221. Voir Sophie Ma<strong>de</strong>leine, Le complexe pompéi<strong>en</strong> <strong>du</strong> Champ <strong>de</strong> Mars, une ville dans la Ville : reconstitution<br />
virtuelle d’un théâtre et à portique au IV e siècle après J.-C., Thèse <strong>de</strong> doctorat, 4 vol., 2006, 637 pages.<br />
Schedae, 2008, prépublication n°10, (p. 1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf
les opportunités d’un « accès nouveau et inéluctable au <strong>patrimoine</strong>, avec les chances d’un<br />
approfondissem<strong>en</strong>t qui est une nouvelle preuve <strong>de</strong> son importance » 222 . Si elle permet à la<br />
sci<strong>en</strong>ce historique, mais pas seulem<strong>en</strong>t à elle 223 , d’approfondir son savoir, elle lui offre, <strong>en</strong><br />
outre, une occasion inestimable <strong>de</strong> remplir son <strong>de</strong>voir <strong>de</strong> transmission et <strong>de</strong> pédagogie,<br />
d’éclairer l’histoire et <strong>de</strong> la r<strong>en</strong>dre intelligible, visible même, lorsqu’elle abor<strong>de</strong> l’Antiquité<br />
dis<strong>par</strong>ue.<br />
<strong>La</strong> question se pose <strong>de</strong> savoir quel est le risque <strong>de</strong> remplacem<strong>en</strong>t <strong>du</strong> musée <strong>par</strong> les pro<strong>du</strong>its<br />
audiovisuels et interactifs, <strong>par</strong> tous ces êtres virtuels qui, prét<strong>en</strong>d-on, vont pr<strong>en</strong>dre une place<br />
<strong>de</strong> plus <strong>en</strong> plus gran<strong>de</strong> dans nos vies. Le musée va-t-il <strong>de</strong>v<strong>en</strong>ir un musée à distance 224 ?<br />
Et ce musée à distance serait-il « le <strong>par</strong>adigme <strong>du</strong> musée révolutionnaire » ? Comme le<br />
rappelle très justem<strong>en</strong>t G<strong>en</strong>eviève Vidal, si l’on est am<strong>en</strong>é à <strong>par</strong>ler <strong>de</strong> musée virtuel, c’est<br />
bi<strong>en</strong> <strong>en</strong> référ<strong>en</strong>ce au musée réel 225 . Sans cé<strong>de</strong>r à la facilité et répondre <strong>de</strong> manière systématique<br />
à la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong>s publics <strong>en</strong> matière <strong>culturel</strong>le, il faut bi<strong>en</strong> concé<strong>de</strong>r que le <strong>patrimoine</strong>,<br />
comme le musée, « est un espace <strong>de</strong> la représ<strong>en</strong>tation qu’une société, ou plutôt une<br />
fraction <strong>de</strong> société 226 , se donne d’elle même » 227 . Nous citons ici abondamm<strong>en</strong>t Élisabeth<br />
Caillet car son ouvrage est très intéressant <strong>du</strong> point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong>s interrogations formulées,<br />
comme <strong>de</strong>s craintes qu’il énonce. Selon l’auteur, « nouvelle machine à <strong>en</strong>seigner, le musée<br />
technologique, s’ap<strong>par</strong><strong>en</strong>te d’un côté au spectacle (et à son élém<strong>en</strong>t ludique), <strong>de</strong> l’autre à<br />
l’école (et à son élém<strong>en</strong>t sérieux) » 228 . Nous retrouvons ici l’un <strong>de</strong>s aspects qui nous importe<br />
et qui est tourné vers le public scolaire. Analysant la question <strong>de</strong>s sorties pédagogiques et<br />
l’approche patrimoniale au sein <strong>de</strong> la classe, nous avons sout<strong>en</strong>u plus haut dans le texte que<br />
la rigidité <strong>de</strong> l’espace <strong>de</strong> l’appr<strong>en</strong>tissage pouvait constituer pour l’élève un frein au développem<strong>en</strong>t<br />
<strong>du</strong> goût d’appr<strong>en</strong>dre. Il semble que l’on ti<strong>en</strong>ne avec la réalité virtuelle un outil<br />
qui puisse <strong>en</strong> <strong>par</strong>tie réconcilier le s<strong>en</strong>s <strong>de</strong> l’effort et le plaisir.<br />
<strong>La</strong> visite virtuelle, offrant <strong>de</strong>s informations à <strong>de</strong>s <strong>de</strong>grés divers, pré<strong>par</strong>e la visite réelle ou la complète.<br />
Elle <strong>de</strong>vi<strong>en</strong>t une valorisation importante et permet <strong>de</strong>s mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> diffusion <strong>de</strong>s savoirs<br />
diversifiés 229 .<br />
Si l’on repr<strong>en</strong>d l’exemple <strong>de</strong> la visite <strong>de</strong> l’église <strong>de</strong> Saint-Savin-sur-Gartempe 230 , on compr<strong>en</strong>d<br />
qu’un élève ne se déplaçant pas sur le site – la visite restant l’idéal –, mais qui a accès<br />
à une visite virtuelle <strong>de</strong> l’espace, est bi<strong>en</strong> plus à même <strong>de</strong> répondre à la consigne qu’avec<br />
les seuls docum<strong>en</strong>ts consignés dans le manuel. Dans ce cas, la reconstitution n’a pas pour<br />
but premier <strong>de</strong> faire avancer la sci<strong>en</strong>ce. Elle peut même être jugée inutile car redondante.<br />
Pourtant, elle offre <strong>de</strong> nombreux avantages, à <strong>de</strong>s <strong>de</strong>grés divers. Dans sa version minimale,<br />
222. Pierre Nora (dir.), Les lieux <strong>de</strong> mémoire, Tome 1, Paris, Gallimard, p. 1461.<br />
223. On voit se regrouper autour <strong>de</strong> la réalité virtuelle <strong>de</strong>s champs disciplinaires très vastes. Ainsi, le CIREVE<br />
(C<strong>en</strong>tre Interdisciplinaire <strong>de</strong> Réalité Virtuelle) à l’<strong>Université</strong> <strong>de</strong> Ca<strong>en</strong> Basse-Normandie compte-t-il douze<br />
équipes <strong>de</strong> chercheurs, mé<strong>de</strong>cins, géographes, psychologues, etc., ayant choisi la réalité virtuelle pour<br />
approfondir leurs travaux sci<strong>en</strong>tifiques.<br />
224. Élisabeth Caillet, À l’approche <strong>du</strong> musée, la médiation <strong>culturel</strong>le, Lyon, PUL, 1995, p. 231-232.<br />
225. G<strong>en</strong>eviève Vidal, « Vers les musées numérisés : <strong>de</strong> la visite à la navigation », http://commposite.uqam.ca.<br />
226. Si l’on considère les réalités <strong>de</strong>s publics <strong>de</strong> la culture ainsi que cela a été décrit dans la première <strong>par</strong>tie <strong>de</strong><br />
ce texte.<br />
227. Élisabeth Caillet, À l’approche <strong>du</strong> musée, la médiation <strong>culturel</strong>le, Lyon, PUL, 1995, p. 38.<br />
228. Élisabeth Caillet, À l’approche <strong>du</strong> musée, la médiation <strong>culturel</strong>le, Lyon, PUL, 1995, p. 237.<br />
229. <strong>La</strong>ur<strong>en</strong>t Gervereau, Vous avez dit musées ? Tout savoir sur la crise <strong>culturel</strong>le, Paris, CNRS Éditions, 2006,<br />
p. 50-51.<br />
230. Pour mémoire : « Vous êtes un gui<strong>de</strong> et vous faites visiter l’église <strong>de</strong> Saint-Savin-sur-Gartempe. Qu’expliquez-vous<br />
aux touristes qui vous écout<strong>en</strong>t ? ».<br />
Schedae, 2008, prépublication n°10, (p.1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf<br />
49
50<br />
c’est-à-dire comme simple restitution, elle permet une visite interactive à distance. On pourra<br />
espérer que la forme et le cont<strong>en</strong>u auront donné l’<strong>en</strong>vie <strong>de</strong> la visite réelle. Dans une version<br />
plus complète, évoquant les différ<strong>en</strong>ts styles à travers les âges, <strong>en</strong> somme écrivant l’histoire<br />
<strong>du</strong> lieu, elle vi<strong>en</strong>dra avantageusem<strong>en</strong>t compléter la visite. Le cas échéant, r<strong>en</strong><strong>du</strong>e accessible<br />
sur Internet, elle évitera <strong>de</strong> trop alourdir le dispositif sur le site. Mais, interactive, la visite<br />
impliquera « physiquem<strong>en</strong>t » l’élève. Il avancera à son rythme dans un espace qu’il peut<br />
s’approprier. Il n’est même pas besoin <strong>de</strong> craindre le ludique – que nous n’écartons pas –<br />
car, facteur trop souv<strong>en</strong>t négligé, le support proposé s’inscrit dans une démarche déterminée<br />
<strong>par</strong> son créateur et dans un espace fini.<br />
Ainsi, il n’est pas <strong>de</strong> dérive possible au-<strong>de</strong>là <strong>du</strong> cont<strong>en</strong>u préconçu. Il <strong>de</strong>vi<strong>en</strong>t possible<br />
d’allier savoir, savoir-faire et peut-être aussi savoir être. Comme Clau<strong>de</strong> Cadoz, on peut p<strong>en</strong>ser<br />
que « toute forme <strong>de</strong> représ<strong>en</strong>tation qui permet d’atteindre les mêmes phénomènes<br />
avec une plus gran<strong>de</strong> économie <strong>de</strong> moy<strong>en</strong>s est une connaissance. Il n’y a d’ailleurs pas <strong>de</strong><br />
connaissance absolue, c’est-à-dire <strong>de</strong> manière <strong>de</strong> modéliser la réalité qui serait la meilleure,<br />
l’ultime, la définitive » 231 , propos corroborés <strong>par</strong> Jean-Pierre Bost : « ce que l’on vous propose,<br />
ce n’est pas la vérité, Mais l’état actuel <strong>de</strong> ce que l’on sait, un mom<strong>en</strong>t <strong>de</strong> la connaissance.<br />
C’est un état provisoire : si quelqu’un a une idée, on modifiera la chose » 232 . En effet,<br />
nous évoquions plus haut la possibilité <strong>de</strong> superposer les styles mais il ne faudrait pas oublier<br />
que la réalité virtuelle dispose aussi d’un « outil gomme » : la question <strong>de</strong>s corrections ou<br />
<strong>de</strong>s modifications est abordée avec beaucoup plus <strong>de</strong> souplesse que lorsqu’il s’agit d’une<br />
maquette 233 . Pour repr<strong>en</strong>dre l’exemple <strong>de</strong> Plassac, « quant aux sculptures <strong>de</strong> la spina […],<br />
elles étai<strong>en</strong>t au dé<strong>par</strong>t représ<strong>en</strong>tées <strong>en</strong> vert, car on p<strong>en</strong>sait que le bronze qui les recouvrait<br />
s’oxydait. Depuis, on a découvert que les Romains avai<strong>en</strong>t l’habitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> les briquer ; les<br />
monum<strong>en</strong>ts virtuels ont alors viré à l’ocre » 234 . Permettant une recontextualisation, la visite<br />
virtuelle peut faire accé<strong>de</strong>r le site modélisé au rang <strong>de</strong> véritable musée, un musée virtuel. Et<br />
si l’on repr<strong>en</strong>d les missions dévolues au musée « traditionnel » : la recherche, la conservation<br />
et la diffusion – <strong>en</strong> y adjoignant la pointe <strong>de</strong> plaisir notée <strong>par</strong> l’ICOM – on ne peut nier que<br />
le musée virtuel remplit une à une ces fonctions, soit dans un espace dédié, soit sur un support<br />
multimédia, qui le r<strong>en</strong>d <strong>en</strong> outre transportable.<br />
Nous avons pour l’heure disserté selon un mo<strong>de</strong> opératoire dans lequel le public est<br />
confronté à un choix, pr<strong>en</strong>dre ou laisser, et s’il choisit <strong>de</strong> pr<strong>en</strong>dre, que pr<strong>en</strong>dre <strong>de</strong>vant la<br />
multitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’offre ? Il faut, <strong>en</strong> somme, pour chacun gérer l’abondance. Nous avons déjà<br />
évoqué à maintes reprises cette forme d’empêchem<strong>en</strong>t, qui concerne les publics éloignés<br />
<strong>de</strong> la culture, <strong>de</strong> <strong>par</strong> leur é<strong>du</strong>cation et leur milieu social. Le frein est ici <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux ordres: économique<br />
et plus <strong>en</strong>core psychologique. Mais nous occultons que la réalité est <strong>par</strong>fois beaucoup<br />
plus complexe et rédhibitoire pour certains types <strong>de</strong> populations et plus <strong>par</strong>ticulièrem<strong>en</strong>t<br />
les personnes à mobilité ré<strong>du</strong>ite, qu’elles souffr<strong>en</strong>t d’un handicap moteur ou qu’il s’agisse<br />
<strong>de</strong> personnes âgées. Le handicap ne doit pas être un empêchem<strong>en</strong>t pour celles et ceux,<br />
désireux <strong>de</strong> culture et friands <strong>de</strong> <strong>patrimoine</strong>, mais pour lesquels gravir les gradins d’un théâtre<br />
antique, pour ne citer que cet exemple, est rigoureusem<strong>en</strong>t impossible. Il est vrai que les<br />
structures d’accueil ont fait beaucoup d’efforts et <strong>de</strong> progrès <strong>en</strong> terme d’immersion et d’intégration<br />
<strong>de</strong>s personnes souffrant d’un handicap dans nos sociétés, et <strong>par</strong> ext<strong>en</strong>sion dans nos<br />
musées. Pourtant, les statistiques montr<strong>en</strong>t que le handicap <strong>en</strong>g<strong>en</strong>dre souv<strong>en</strong>t isolem<strong>en</strong>t et<br />
pauvreté. Ainsi, on mesure quelle importance peut revêtir pour ces personnes la visite virtuelle.<br />
231. Clau<strong>de</strong> Cadoz, Les réalités virtuelles, un exposé pour compr<strong>en</strong>dre, Paris, Flammarion, 1994, p. 96.<br />
232. Libération, 24 septembre 2005, Virtuel antique, <strong>par</strong> Rafaëlle Brillaud.<br />
233. On citera ici l’exemple <strong>de</strong> la maquette <strong>de</strong> Paul Bigot restituant la Ville <strong>de</strong> Rome au IV e siècle, achevée <strong>en</strong><br />
1942, conservée <strong>par</strong> l’<strong>Université</strong> <strong>de</strong> Ca<strong>en</strong>.<br />
234. Libération, 24 septembre 2005, Virtuel antique, <strong>par</strong> Rafaëlle Brillaud.<br />
Schedae, 2008, prépublication n°10, (p. 1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf
Elle est le seul moy<strong>en</strong>, à l’exception <strong>de</strong> la <strong>mise</strong> <strong>en</strong> place in situ d’équipem<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> type<br />
asc<strong>en</strong>seur et autres nacelles, mais qui ne sont pas adaptables <strong>par</strong>tout – et qui pos<strong>en</strong>t égalem<strong>en</strong>t<br />
le problème <strong>de</strong> la dénaturation <strong>de</strong>s sites – <strong>de</strong> donner un accès à la représ<strong>en</strong>tation<br />
visuelle <strong>du</strong> site. Par ce type d’expéri<strong>en</strong>ce, on se r<strong>en</strong>d compte que les interprétations, et <strong>par</strong><br />
la même la notion d’échelle, sont très variables d’un indivi<strong>du</strong> à l’autre. En ce s<strong>en</strong>s égalem<strong>en</strong>t,<br />
le travail <strong>de</strong> restitution est un outil précieux.<br />
Une démarche rigoureuse et méthodique<br />
Tout le corps <strong>du</strong> texte a eu jusqu’ici pour vocation <strong>de</strong> montrer que les secteurs <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong><br />
et <strong>de</strong> la réalité virtuelle, loin <strong>de</strong> se contrarier, pouvai<strong>en</strong>t répondre avantageusem<strong>en</strong>t<br />
à la fois à l’évolution <strong>de</strong> l’écriture <strong>de</strong> l’Histoire et à l’att<strong>en</strong>te <strong>de</strong>s publics, lorsqu’ils se trouv<strong>en</strong>t<br />
réunis autour <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong> <strong>culturel</strong>. Toutefois, ri<strong>en</strong> ne peut être <strong>en</strong>visagé sans l’application<br />
d’une métho<strong>de</strong> rigoureuse qu’il convi<strong>en</strong>t maint<strong>en</strong>ant <strong>de</strong> prés<strong>en</strong>ter. Pour cela, il faut dans un<br />
premier temps bi<strong>en</strong> s’accor<strong>de</strong>r sur les termes qui sont employés et <strong>en</strong> proposer une définition.<br />
Comme nous l’avons fait pour le <strong>patrimoine</strong>, <strong>en</strong> toute logique, l’exam<strong>en</strong> comm<strong>en</strong>cera<br />
<strong>par</strong> celle <strong>de</strong> la réalité virtuelle. <strong>La</strong> tâche n’est pas si simple. En effet, l’usage <strong>du</strong> multimédia<br />
est abondamm<strong>en</strong>t traité dans la littérature relative à la <strong>mise</strong> <strong>en</strong> <strong>valeur</strong> <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong> <strong>culturel</strong>,<br />
mais tel n’est pas le cas pour la réalité virtuelle. Cette <strong>de</strong>rnière est <strong>en</strong>core très peu prés<strong>en</strong>te<br />
sur ce terrain. Lorsque c’est le cas, le terme est employé, suggéré, dans une acception large<br />
et souv<strong>en</strong>t floue.<br />
Si nous reportons tout d’abord au dictionnaire Robert <strong>de</strong>s noms communs, la réalité<br />
virtuelle est définie comme un « système <strong>de</strong> simulation interactif <strong>par</strong> images <strong>de</strong> synthèse<br />
tridim<strong>en</strong>sionnelles ». C’est cette définition que repr<strong>en</strong>d Philippe Fuchs :<br />
<strong>La</strong> réalité virtuelle lui (l’homme) offre une dim<strong>en</strong>sion supplém<strong>en</strong>taire <strong>en</strong> lui procurant un <strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t<br />
virtuel dans lequel il <strong>de</strong>vi<strong>en</strong>t acteur, et avec lequel il interagit 235 .<br />
Cette alliance <strong>de</strong> termes antinomiques n’est d’ailleurs pas sans poser problème,<br />
comme le souligne le titre <strong>de</strong> l’ouvrage <strong>de</strong> Rodolphe Gelin, Comm<strong>en</strong>t la réalité peut-elle<br />
être virtuelle ? 236 . Pour ce <strong>de</strong>rnier, « un système <strong>de</strong> réalité virtuelle est toujours composé <strong>de</strong><br />
quatre élém<strong>en</strong>ts » 237 : un mon<strong>de</strong> virtuel, l’immersion, les retours s<strong>en</strong>soriels, l’interactivité.<br />
C’est donc une définition plus complète qu’il nous fournit au début <strong>de</strong> son livre, repr<strong>en</strong>ant<br />
les élém<strong>en</strong>ts énoncés ci-<strong>de</strong>ssus :<br />
Voulant r<strong>en</strong>dre compte <strong>de</strong> la réalité telle qu’elle est, la réalité virtuelle se doit <strong>de</strong> représ<strong>en</strong>ter les<br />
objets tels qu’ils sont, c’est-à-dire volumiques, (<strong>en</strong> 3D), et non plans (<strong>en</strong> 2D). De ce fait, une fois<br />
qu’un objet est décrit à l’ordinateur <strong>en</strong> 3D, l’observateur peut choisir le point <strong>de</strong> vue d’où regar<strong>de</strong>r<br />
la scène qui lui est proposée 238 .<br />
Clau<strong>de</strong> Cadoz, relevant l’absurdité <strong>de</strong> la dénomination, préfère <strong>par</strong>ler <strong>de</strong> « représ<strong>en</strong>tation<br />
intégrale » 239 . L’expression n’est guère plus satisfaisante : la représ<strong>en</strong>tation ne saurait être<br />
intégrale au seul prétexte d’être tridim<strong>en</strong>sionnelle, mais elle a le mérite d’éviter l’écueil <strong>de</strong><br />
l’oxymore 240 .<br />
235. Philippe Fuchs, Les interfaces <strong>de</strong> la réalité virtuelle, Montpellier, Association <strong>de</strong>s journées internationales<br />
d’informatique <strong>de</strong> Montpellier-district, 1996, p. 1<br />
236. Rodolphe Gelin, Comm<strong>en</strong>t la réalité peut-elle être virtuelle ?, Les pommes <strong>du</strong> savoir, 2006.<br />
237. Ibid., p. 5.<br />
238. Ibid., p. 9.<br />
239. Clau<strong>de</strong> Cadoz, Les réalités virtuelles, un exposé pour compr<strong>en</strong>dre, Paris, Flammarion, 1994, p. 11.<br />
240. On trouve d’autres dénominations, <strong>par</strong>mi lesquelles celle <strong>de</strong> Philippe Quéau, qui <strong>par</strong>le lui d’« immersion<br />
virtuelle », in Philippe Quéau, Le virtuel, vertus et vertiges, Paris, Vallon, INA, 1993, p. 18.<br />
Schedae, 2008, prépublication n°10, (p.1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf<br />
51
52<br />
Sans <strong>en</strong>trer dans un développem<strong>en</strong>t technique qui dépasse le cadre <strong>de</strong> nos compét<strong>en</strong>ces,<br />
nous allons abor<strong>de</strong>r la question <strong>de</strong> la réalité virtuelle <strong>en</strong> comm<strong>en</strong>çant <strong>par</strong> apporter<br />
quelques éclaircissem<strong>en</strong>ts sur ce que recouvre le concept <strong>de</strong> réalité virtuelle. Il est <strong>en</strong> effet<br />
nécessaire <strong>de</strong> s’accor<strong>de</strong>r sur la terminologie employée afin <strong>de</strong> bi<strong>en</strong> poser la métho<strong>de</strong>, laquelle<br />
implique <strong>de</strong> travailler <strong>en</strong> interdisciplinarité. Les lignes qui suiv<strong>en</strong>t doiv<strong>en</strong>t leur inspiration au<br />
« Cours <strong>de</strong> Tunis » <strong>de</strong> Jean-Clau<strong>de</strong> Golvin 241 . Elles définiss<strong>en</strong>t les principaux termes que nous<br />
seront am<strong>en</strong>ée à employer dans notre étu<strong>de</strong>. Nous distinguerons ainsi la restitution, la reconstitution<br />
et la reconstruction. Partant <strong>du</strong> s<strong>en</strong>s étymologique pour définir la restitution, le fait<br />
<strong>de</strong> r<strong>en</strong>dre, dans un souci <strong>de</strong> fidélité <strong>de</strong>vrait-on ajouter, Jean-Clau<strong>de</strong> Golvin nuance la définition.<br />
Selon lui, « la restitution est avant tout, celle <strong>de</strong> l’image qu’un édifice pourrait nous<br />
donner si l’on pouvait le revoir tel qu’il était à l’origine. Concernant la reconstitution, qui signifie<br />
au s<strong>en</strong>s propre l’action <strong>de</strong> former <strong>de</strong> nouveau, l’idéal consiste à remonter les <strong>par</strong>ties <strong>de</strong><br />
l’édifice qui ont été dispersées. « Il y a dans le mot reconstitution (d’un monum<strong>en</strong>t), une idée<br />
d’auth<strong>en</strong>ticité et une idée <strong>de</strong> concret. Ce mot recouvre donc et dépasse le s<strong>en</strong>s <strong>du</strong> mot reconstruction<br />
». Les termes ci-<strong>de</strong>ssus définis sont un aboutissem<strong>en</strong>t. Ils sont la <strong>par</strong>tie visible,<br />
le « pro<strong>du</strong>it » <strong>de</strong> tout un travail dont les t<strong>en</strong>ants et les aboutissants ne laiss<strong>en</strong>t ri<strong>en</strong> au hasard.<br />
Restituer, reconstituer ne sont pas un simple jeu avec les mots. Ce sont les objectifs qui les<br />
détermin<strong>en</strong>t. En découle l’usage qui doit <strong>en</strong> être fait. Nous y revi<strong>en</strong>drons dans l’exam<strong>en</strong> <strong>de</strong>s<br />
expéri<strong>en</strong>ces m<strong>en</strong>ées puis dans l’étu<strong>de</strong> <strong>par</strong>ticulière <strong>de</strong> l’église Notre-Dame <strong>de</strong> Saint-Lô.<br />
<strong>La</strong> première étape <strong>du</strong> processus est celle <strong>de</strong> la constitution <strong>du</strong> dossier sci<strong>en</strong>tifique. <strong>La</strong><br />
question <strong>de</strong>s sources est ess<strong>en</strong>tielle, <strong>en</strong> <strong>par</strong>ticulier celle <strong>de</strong> l’état <strong>de</strong> conservation <strong>du</strong> site<br />
ou <strong>du</strong> bâtim<strong>en</strong>t à modéliser. Plus les données archéologiques sont conséqu<strong>en</strong>tes, meilleures<br />
sont les indications topographiques et architecturales. Néanmoins, il ne faut pas occulter<br />
la notion d’époques et <strong>de</strong> styles, que l’archéologie ne permet pas toujours à elle seule<br />
<strong>de</strong> distinguer. Les superpositions, les <strong>de</strong>structions aussi, que l’on pourrait nommer la « <strong>par</strong>t<br />
manquante », r<strong>en</strong>d<strong>en</strong>t souv<strong>en</strong>t la tâche difficile. L’histoire est une sédim<strong>en</strong>tation <strong>de</strong>s artefacts<br />
dont on doit démêler les couches avant <strong>de</strong> pouvoir prét<strong>en</strong>dre à un quelconque choix<br />
<strong>de</strong> <strong>mise</strong> <strong>en</strong> <strong>valeur</strong>. Il faut compléter l’information <strong>par</strong> les sources textuelles, iconographiques<br />
ou <strong>en</strong>core archéologiques. Si l’information est <strong>par</strong>cellaire ou laconique, voire si elle suggère<br />
<strong>de</strong>s interprétations contradictoires, les données doiv<strong>en</strong>t être recoupées avec d’autres sites<br />
id<strong>en</strong>tifiés comme com<strong>par</strong>ables 242 . Jean-Clau<strong>de</strong> Golvin divise <strong>en</strong> trois étapes le travail <strong>du</strong><br />
chercheur. <strong>La</strong> première s’établit sur ce qui subsiste <strong>de</strong> l’édifice ou <strong>de</strong> l’<strong>en</strong>semble. <strong>La</strong> secon<strong>de</strong>,<br />
la <strong>par</strong>tie dite reconstituée, t<strong>en</strong>te <strong>de</strong> retrouver la cohér<strong>en</strong>ce <strong>de</strong>s blocs é<strong>par</strong>s : c’est l’anastylose.<br />
<strong>La</strong> troisième est fondée sur une étu<strong>de</strong> com<strong>par</strong>ée et <strong>de</strong>s hypothèses 243 .<br />
L’on peut s’imaginer que la quantité et la qualité <strong>de</strong> la docum<strong>en</strong>tation sont <strong>en</strong> li<strong>en</strong> direct<br />
avec l’époque étudiée, mais la réalité est plus compliquée. Il y a, certes, corrélation <strong>en</strong> termes<br />
<strong>de</strong> risques <strong>de</strong> dis<strong>par</strong>ition mais le rayonnem<strong>en</strong>t et les aléas <strong>de</strong> l’Histoire y sont pour davantage<br />
<strong>en</strong>core. Pour ne pr<strong>en</strong>dre que l’exemple qui nous préoccupe dans cette étu<strong>de</strong>, bi<strong>en</strong> que<br />
l’édifice fût construit au Moy<strong>en</strong>-Âge et qu’il soit <strong>en</strong>core <strong>de</strong>bout aujourd’hui, nous verrons<br />
que la question <strong>de</strong>s sources est épineuse dans le cas <strong>de</strong> l’église Notre-Dame <strong>de</strong> Saint-Lô.<br />
L’ess<strong>en</strong>tiel <strong>de</strong>s archives a brûlé dans les bombar<strong>de</strong>m<strong>en</strong>ts alliés. L’édifice lui-même fut très<br />
<strong>en</strong>dommagé. Ce que l’on sait résulte ess<strong>en</strong>tiellem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> docum<strong>en</strong>ts disséminés et <strong>de</strong> la<br />
241. Jean-Clau<strong>de</strong> Golvin, « L’image <strong>de</strong> restitution et la restitution <strong>de</strong> l’image », cours donné à Tunis dans le<br />
cadre <strong>de</strong> DPEA « Culture numérique et <strong>patrimoine</strong> architectural », <strong>de</strong> l’École Nationale Supérieure<br />
d’Architecture (ENSA) <strong>de</strong> Marseille,http://www.map.archi.fr.<br />
242. C’est le cas pour nombre d’abbayes bénédictines ou cisterci<strong>en</strong>nes. L’abbaye d’Hambye (50), <strong>par</strong> exemple, fut<br />
transformée <strong>en</strong> carrière (pierre <strong>de</strong> Ca<strong>en</strong>) après la Révolution française et la plu<strong>par</strong>t <strong>de</strong>s archives, déposées<br />
au Archives dé<strong>par</strong>tem<strong>en</strong>tales <strong>de</strong> la Manche, ont brûlé p<strong>en</strong>dant la Secon<strong>de</strong> Guerre Mondiale. C’est grâce<br />
à l’étu<strong>de</strong> d’autres abbayes que l’on peut avancer <strong>de</strong>s hypothèses soli<strong>de</strong>s sur ce que fut celle <strong>de</strong> Hambye.<br />
243. cf. cours <strong>de</strong> Tunis, vol. 1, p. 19.<br />
Schedae, 2008, prépublication n°10, (p. 1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf
econstruction <strong>de</strong> l’édifice. L’abondance <strong>de</strong>s sources, lorsqu’elle existe, implique quant à elle<br />
la confrontation, le discernem<strong>en</strong>t, surtout lorsqu’elle s’appuie, pour <strong>de</strong>s sources textuelles<br />
ou audiovisuelles, sur le témoignage. Dans tous les cas <strong>de</strong> figure, seul un travail minutieux<br />
<strong>de</strong> spécialistes (archéologues, linguistes, histori<strong>en</strong>s <strong>de</strong> l’art ou d’une époque donnée, architectes,<br />
etc.), non isolé mais complém<strong>en</strong>taire, peut permettre d’aboutir à un résultat sci<strong>en</strong>tifique<br />
satisfaisant.<br />
Le dossier sci<strong>en</strong>tifique constitué, la phase suivante est consacrée au travail infographique,<br />
lequel est lui-même subdivisé <strong>en</strong> trois temps : la modélisation, l’application <strong>de</strong>s textures et<br />
l’éclairage. <strong>La</strong> modélisation constitue une étape capitale <strong>de</strong> la qualité <strong>du</strong> travail <strong>de</strong> restitution.<br />
C’est <strong>en</strong> effet à ce sta<strong>de</strong> qu’est déterminée la géométrie <strong>du</strong> bâtim<strong>en</strong>t, qu’est donc<br />
définie sa forme. Les difficultés ap<strong>par</strong>aiss<strong>en</strong>t le plus souv<strong>en</strong>t pour donner son élévation à<br />
l’<strong>en</strong>semble. L’archéologie est, <strong>en</strong> toute logique, plus bavar<strong>de</strong> pour restituer le plan au sol.<br />
« Les canons architecturaux, comme <strong>par</strong> exemple le rapport <strong>en</strong>tre la hauteur d’une colonne<br />
244<br />
et son diamètre au sol, sont souv<strong>en</strong>t d’un grand secours » nous dis<strong>en</strong>t Philippe Fleury et<br />
e<br />
Sophie Ma<strong>de</strong>leine à propos <strong>de</strong> la restitution <strong>de</strong> la Rome <strong>du</strong> IV siècle après J.-C. Parfois aussi,<br />
<strong>de</strong>vant le sil<strong>en</strong>ce <strong>de</strong>s sources, les plus grands spécialistes doiv<strong>en</strong>t cons<strong>en</strong>tir à extrapoler sur<br />
les données recueillies afin <strong>de</strong> pouvoir achever la construction, <strong>en</strong> att<strong>en</strong>dant que d’autres<br />
découvertes ne vi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t compléter et corriger l’état <strong>de</strong>s connaissances. Jean-Clau<strong>de</strong> Golvin<br />
précise qu’il est possible graphiquem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> distinguer les différ<strong>en</strong>tes <strong>par</strong>ties ci-<strong>de</strong>ssus décrites<br />
(structure existante, anastylose, hypothèses). Cette démarche peut être intéressante si<br />
la maquette virtuelle réalisée a pour vocation <strong>de</strong> mettre au jour les étapes <strong>de</strong> l’évolution <strong>de</strong><br />
la connaissance. En revanche, dans le cas où l’objectif consiste à redonner <strong>de</strong> la vie au lieu,<br />
245<br />
il est préférable <strong>de</strong> favoriser l’esthétique d’<strong>en</strong>semble <strong>de</strong> la représ<strong>en</strong>tation graphique .<br />
On mesure toute l’importance que pr<strong>en</strong>d le dialogue <strong>en</strong>tre l’équipe, qui a constitué le<br />
dossier sci<strong>en</strong>tifique et les infographistes. L’équipe aura pu se choisir un coordinateur qui<br />
assurera le relais <strong>en</strong>tre les <strong>de</strong>ux. Il est indisp<strong>en</strong>sable qu’il y ait un dialogue, chacun n’étant<br />
spécialiste que <strong>de</strong> son domaine. Plus <strong>en</strong>core, si les infographistes ont pour tâche <strong>de</strong> redonner<br />
virtuellem<strong>en</strong>t la vie à un bâtim<strong>en</strong>t ou à un <strong>en</strong>semble, ils ne peuv<strong>en</strong>t le réaliser que dans la<br />
mesure où eux-mêmes sont imprégnés <strong>de</strong> ce que pouvait être la vie dans les lieux, <strong>en</strong> un temps<br />
donné. Cette première étape est fort longue, pouvant <strong>du</strong>rer plusieurs semaines, et la dim<strong>en</strong>sion<br />
<strong>de</strong> l’espace n’a ri<strong>en</strong> à voir avec le <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> difficulté <strong>de</strong> la modélisation. Une colonne<br />
peut s’avérer beaucoup plus compliquée à concevoir que tout un podium <strong>par</strong> exemple.<br />
Une fois bâti, il convi<strong>en</strong>t d’habiller le lieu <strong>de</strong> matériaux, soit <strong>de</strong> le texturer.<br />
Le choix <strong>de</strong>s<br />
matériaux est un travail très précis et ar<strong>du</strong>. Minéraux, <strong>de</strong> différ<strong>en</strong>tes natures et <strong>de</strong> différ<strong>en</strong>tes<br />
couleurs, ess<strong>en</strong>ces <strong>de</strong> bois etc., sont photographiés, numérisés, mais il faut souv<strong>en</strong>t recourir<br />
à une création lorsque la qualité n’est pas satisfaisante. Sont alors mobilisés <strong>de</strong>s infographistes<br />
2D, lesquels constitu<strong>en</strong>t, au fur et à mesure, <strong>de</strong>s banques <strong>de</strong> données, le cas échéant<br />
mutualisables. Cette <strong>par</strong>t <strong>du</strong> travail est capitale. C’est à ce sta<strong>de</strong> que se construit ce que nous<br />
pouvons nommer le réalisme <strong>de</strong> la scène repro<strong>du</strong>ite. <strong>La</strong> ressemblance est indisp<strong>en</strong>sable pour<br />
donner <strong>de</strong> la <strong>valeur</strong> au travail, celle <strong>de</strong> la vraisemblance. Le r<strong>en</strong><strong>du</strong>, <strong>en</strong> tant que <strong>par</strong>aître,<br />
revêt ici une gran<strong>de</strong> importance. Pourtant, <strong>de</strong> manière <strong>par</strong>adoxale, alors que la perfection<br />
<strong>de</strong> la reconstitution est voulue <strong>par</strong> ses concepteurs, elle est aussi celle qui fait peur aux plus<br />
récalcitrants, qui craign<strong>en</strong>t confusion et substitution plus <strong>en</strong>core qu’inutilité. Cep<strong>en</strong>dant, le<br />
souci esthétique ne doit jamais cé<strong>de</strong>r le pas sur la dim<strong>en</strong>sion sci<strong>en</strong>tifique <strong>de</strong> la réalisation<br />
e<br />
244. Philippe Fleury et Sophie Ma<strong>de</strong>leine, « Réalité virtuelle et restitution <strong>de</strong> la Rome antique au IV siècle<br />
après J.-C. », Histoire urbaine,<br />
18, 2007, p. 166.<br />
245. « Il est exagéré <strong>de</strong> dire que l’image didactique est indisp<strong>en</strong>sable dans tous les cas. L’excès d’information<br />
au public sur un site peut nuire. Tout dép<strong>en</strong>d <strong>de</strong> l’axe <strong>du</strong> discours t<strong>en</strong>u <strong>par</strong> les auteurs <strong>du</strong> livre ou <strong>de</strong>s panneaux<br />
<strong>du</strong> musée où l’image ap<strong>par</strong>aît », Jean-Clau<strong>de</strong> Golvin, cours <strong>de</strong> Tunis, vol. 1, p. 19.<br />
Schedae,<br />
2008, prépublication n°10, (p.1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf<br />
53
54<br />
et l’infographiste ne doit pas se laisser transporter <strong>par</strong> la quête <strong>de</strong> la perfection. Elle est<br />
d’une <strong>par</strong>t vaine, une imitation <strong>de</strong>meurant un substitut, et d’autre <strong>par</strong>t inutile, <strong>par</strong>tant <strong>du</strong><br />
postulat qui précè<strong>de</strong>. Dans son travail <strong>de</strong> texturing,<br />
l’infographiste est fortem<strong>en</strong>t contraint<br />
<strong>par</strong> <strong>de</strong>ux facteurs. Le premier est celui <strong>du</strong> temps, si précieux <strong>de</strong> nos jours. Le second est celui<br />
<strong>de</strong>s limites <strong>de</strong>s matériels. Chaque détail ajouté vi<strong>en</strong>t alourdir le dispositif, ce qui se tra<strong>du</strong>it<br />
immédiatem<strong>en</strong>t <strong>par</strong> une image saccadée. L’effet obt<strong>en</strong>u est alors exactem<strong>en</strong>t l’inverse <strong>de</strong><br />
celui escompté : le système virtuel n’est plus crédible comme simulation <strong>de</strong> la réalité.<br />
Le réalisme est <strong>en</strong> gran<strong>de</strong> <strong>par</strong>tie attribuable à la qualité <strong>de</strong> l’imitation <strong>de</strong>s matériaux<br />
mais il doit égalem<strong>en</strong>t beaucoup aux éclairages, qui constitu<strong>en</strong>t le troisième temps <strong>de</strong> la<br />
reconstitution. Au-<strong>de</strong>là <strong>du</strong> fait qu’il intervi<strong>en</strong>t lui aussi dans le calcul <strong>de</strong>s positions et qu’il<br />
alourdit le dispositif, cet aspect, déclinable à l’<strong>en</strong>vi, est extrêmem<strong>en</strong>t fastidieux, tant la précision<br />
<strong>du</strong> travail est indisp<strong>en</strong>sable pour créer une ambiance réaliste. Les logiciels <strong>de</strong> modélisation<br />
offr<strong>en</strong>t une multitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> possibilités <strong>par</strong> la définition <strong>de</strong> <strong>par</strong>amètres très variés. Outre<br />
l’esthétique, la simulation <strong>de</strong> l’éclairage apporte une contribution non négligeable à <strong>de</strong>ux<br />
autres égards. En permettant une simulation <strong>du</strong> <strong>par</strong>cours <strong>du</strong> soleil (le logiciel intègre les<br />
notions <strong>de</strong> latitu<strong>de</strong>, <strong>de</strong> solstice, d’heure, etc.), la reconstitution virtuelle ai<strong>de</strong> à répondre à <strong>de</strong>s<br />
interrogations que se pos<strong>en</strong>t les chercheurs et pour lesquelles il n’est pour l’heure aucune<br />
source incontestable. C’est le cas <strong>par</strong> exemple pour l’équipe <strong>du</strong> « Plan <strong>de</strong> Rome » :<br />
Le placem<strong>en</strong>t d’un éclairage réaliste permet <strong>de</strong> proposer <strong>de</strong> véritables simulations solaires, notam-<br />
246<br />
m<strong>en</strong>t dans les édifices <strong>de</strong> spectacle protégés <strong>par</strong> <strong>de</strong>s systèmes mécaniques <strong>de</strong> voiles ( velum) .<br />
Fig. 3 : Simulation <strong>de</strong> l’<strong>en</strong>soleillem<strong>en</strong>t <strong>du</strong> théâtre <strong>de</strong> Pompée au solstice d’été à 18h<br />
(Source : Sophie Ma<strong>de</strong>leine)<br />
e<br />
246. Philippe Fleury et Sophie Ma<strong>de</strong>leine, « Réalité virtuelle et restitution <strong>de</strong> la Rome antique au IV siècle<br />
après J.-C. », Histoire urbaine,<br />
18, 2007, p. 167.<br />
Schedae,<br />
2008, prépublication n°10, (p. 1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf
Dans le cadre <strong>de</strong> l’immersion, la simulation <strong>du</strong> réel se trouve d’autant plus crédible que<br />
l’avatar qui déambule dans l’espace pro<strong>du</strong>it <strong>de</strong>s ombres sur son passage, que la source <strong>de</strong><br />
lumière imitant le soleil vi<strong>en</strong>t teinter le sol ou les murs, et ce, <strong>en</strong> temps réel. De la même<br />
manière, si l’avatar passe <strong>de</strong>vant un miroir ou un plan d’eau et que ces <strong>de</strong>rniers réfléchiss<strong>en</strong>t<br />
son image, l’immersion gagne <strong>du</strong> s<strong>en</strong>s.<br />
Ce qui précè<strong>de</strong> est étudié <strong>du</strong> point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong>s concepteurs, mais nous avons vu que,<br />
pour <strong>par</strong>ler d’une véritable <strong>mise</strong> <strong>en</strong> <strong>valeur</strong> <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong> <strong>par</strong> la réalité virtuelle, il est indisp<strong>en</strong>sable<br />
<strong>de</strong> faire <strong>en</strong>trer l’étu<strong>de</strong> dans le champ <strong>de</strong> la communication, considérant évi<strong>de</strong>mm<strong>en</strong>t<br />
le message à faire passer, dans un co<strong>de</strong> accessible au public. Nous avons <strong>par</strong>lé <strong>de</strong><br />
transmission et <strong>de</strong> vulgarisation. Il va sans dire que tout ceci n’est ri<strong>en</strong> si nous faisons abstraction<br />
<strong>du</strong> récepteur <strong>de</strong> ce message r<strong>en</strong><strong>du</strong> accessible. Aujourd’hui, il semble que tout ou<br />
presque reste à faire dans le domaine <strong>de</strong> la <strong>mise</strong> à disposition <strong>de</strong> systèmes virtuels à <strong>de</strong>stination<br />
<strong>du</strong> (grand) public. Nous avons évoqué le peu d’ouvrages consacrés à la question alors<br />
que le multimédia est quant à lui très prés<strong>en</strong>t 247 . Bornes interactives, cédéroms, sites Internet<br />
multimédia font désormais <strong>par</strong>tie intégrante <strong>de</strong> la <strong>mise</strong> <strong>en</strong> <strong>valeur</strong> <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong> <strong>culturel</strong>,<br />
et plus <strong>par</strong>ticulièrem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s musées.<br />
Souv<strong>en</strong>t associée au jeu vidéo, et souffrant <strong>du</strong> succès qu’elle remporte dans ce secteur,<br />
la réalité virtuelle connaît une percée difficile dans le domaine <strong>culturel</strong>. Lorsqu’il existe, son<br />
développem<strong>en</strong>t est <strong>de</strong> peu d’ampleur. Il semble qu’il y ait là un hiatus à combler <strong>en</strong>tre les<br />
att<strong>en</strong>tes d’un public, <strong>en</strong> <strong>par</strong>ticulier jeune et la nouvelle muséographie. G<strong>en</strong>eviève Vidal rappelle<br />
que, dès 1998, une <strong>en</strong>quête m<strong>en</strong>ée <strong>en</strong> ligne <strong>par</strong> le Louvre montre que « ces <strong>de</strong>rniers<br />
(les visiteurs jeunes) ont <strong>de</strong>man<strong>de</strong>urs d’images <strong>en</strong> ligne, 3D et virtuelles » 248 . Musée emblématique,<br />
le Louvre offre sur son site « <strong>de</strong>s propositions <strong>de</strong> visites avec « quicktime » qui simule<br />
une visite virtuelle extrêmem<strong>en</strong>t ré<strong>du</strong>ctrice, et <strong>de</strong>puis 2005 avec une rubrique panoramas<br />
qui fonctionne sur le même principe » 249 . Peut-être l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s limites <strong>de</strong>s dispositifs <strong>de</strong> la<br />
réalité virtuelle nous permettra-t-elle <strong>de</strong> mieux appréh<strong>en</strong><strong>de</strong>r la question et <strong>de</strong> trouver une<br />
réponse adéquate pour notre projet <strong>de</strong> conception.<br />
Les limites <strong>de</strong> l’outil virtuel<br />
Toujours classée <strong>par</strong>mi les nouvelles technologies, la réalité virtuelle n’est pourtant plus<br />
une idée neuve. Elle a connu ses premiers développem<strong>en</strong>ts au début <strong>de</strong>s années 1980.<br />
Aujourd’hui, elle intègre les foyers grâce aux fulgurants progrès <strong>de</strong>s matériels informatiques,<br />
toujours plus puissants, plus rapi<strong>de</strong>s et financièrem<strong>en</strong>t plus accessibles. Pourtant, si l’Internet<br />
et le multimédia connaiss<strong>en</strong>t un succès sans cesse grandissant et un très fort <strong>de</strong>gré d’inv<strong>en</strong>tivité,<br />
et ce, dans tous les domaines, la réalité virtuelle reste <strong>en</strong> marge. Certes, le mon<strong>de</strong> <strong>du</strong><br />
jeu vidéo est chaque année plus florissant et ses a<strong>de</strong>ptes plus nombreux. Les mon<strong>de</strong>s virtuels<br />
attir<strong>en</strong>t un public qui s’élargit fortem<strong>en</strong>t. Bi<strong>en</strong> qu’ils <strong>de</strong>meur<strong>en</strong>t <strong>en</strong>core les cibles privilégiées,<br />
les adolesc<strong>en</strong>ts ne sont plus, loin s’<strong>en</strong> faut, les seuls intéressés. Les mon<strong>de</strong>s virtuels s’ét<strong>en</strong>d<strong>en</strong>t<br />
maint<strong>en</strong>ant à toutes les classes sociales, et à toutes les classes d’âges, <strong>en</strong> témoign<strong>en</strong>t<br />
<strong>de</strong>s expéri<strong>en</strong>ces extrêmes comme « Second life » 250 . Les mon<strong>de</strong>s qui sont simulés sont <strong>de</strong>s<br />
espaces fictionnels, qu’ils soi<strong>en</strong>t tournés vers le passé ou qu’ils s’inscriv<strong>en</strong>t dans le futur. Tabous<br />
et interdits sont battus <strong>en</strong> brèche et la liberté, l’abs<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> limites sont les règles à adopter.<br />
On peut imaginer que le virtuel se fait alors l’instrum<strong>en</strong>t d’une opposition au réel.<br />
247. Nous r<strong>en</strong>voyons volontiers à la lecture <strong>de</strong>s travaux <strong>de</strong> G<strong>en</strong>eviève Vidal, <strong>en</strong> <strong>par</strong>ticulier, Contribution à l’étu<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> l’interactivité, les usages <strong>du</strong> multimédia <strong>de</strong> musée, Bor<strong>de</strong>aux, PUB, 2006, 168 pages.<br />
248. Ibid., p. 38.<br />
249. Ibid., p. 38.<br />
250. Mon<strong>de</strong> virtuel, simulation qui permet aux joueurs <strong>de</strong> vivre une secon<strong>de</strong> vie.<br />
Schedae, 2008, prépublication n°10, (p.1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf<br />
55
56<br />
Pour Serge Tisseron qui <strong>par</strong>le <strong>de</strong> « super-illusions » 251 pour définir la réalité virtuelle,<br />
l’opposition se fait soit avec le pot<strong>en</strong>tiel, soit avec l’actuel, soit avec le tangible. Le temporel,<br />
le spatial et l’abstraction sont les trois cadres <strong>de</strong> référ<strong>en</strong>ce. Devant le succès fracassant<br />
<strong>de</strong> la 3D dans le domaine <strong>du</strong> ludique, on peut s’étonner <strong>de</strong> la difficulté que r<strong>en</strong>contr<strong>en</strong>t<br />
ceux qui souhait<strong>en</strong>t la promouvoir dans le champ <strong>de</strong> la sci<strong>en</strong>ce historique. Serait-ce une<br />
simple question <strong>de</strong> métho<strong>de</strong> ? <strong>La</strong> preuve n’<strong>en</strong> est pas faite. En regard <strong>de</strong> ce qui précè<strong>de</strong>,<br />
la transition n’est pas aisée à trouver pour prôner la réalité virtuelle comme outil <strong>de</strong> <strong>mise</strong><br />
<strong>en</strong> <strong>valeur</strong> pour le <strong>patrimoine</strong> <strong>culturel</strong>. On mesure ici la difficulté qu’il peut y avoir à réunir<br />
<strong>de</strong>s mon<strong>de</strong>s que tout semble opposer : virtuel et réel, fiction et Histoire, jeu et <strong>de</strong>voir <strong>de</strong><br />
mémoire, etc. Les limites <strong>de</strong> son développem<strong>en</strong>t dans le domaine patrimonial sont à examiner<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>ux points <strong>de</strong> vue. D’une <strong>par</strong>t, il faut considérer celles qui sont <strong>de</strong> l’ordre <strong>de</strong> la<br />
conception et <strong>de</strong> la diffusion ; d’autre <strong>par</strong>t, celles qui sont inhér<strong>en</strong>tes à sa perception.<br />
L’informatique a <strong>en</strong>vahi les foyers. Internet s’est répan<strong>du</strong> comme une traînée <strong>de</strong> poudre<br />
dans la société française et les plus rétifs aux nouvelles technologies sembl<strong>en</strong>t avoir cédé<br />
à la t<strong>en</strong>tation <strong>de</strong> la cybercommunication. Les <strong>Université</strong>s Inter-âges offr<strong>en</strong>t aux s<strong>en</strong>iors la<br />
possibilité <strong>de</strong> se former tandis que les plus défavorisés socialem<strong>en</strong>t ont accès aux espaces<br />
publics numériques 252 . Les <strong>en</strong>fants sont initiés dès leur plus jeune âge et l’école intègre<br />
désormais la pratique <strong>de</strong> l’informatique dans ses cont<strong>en</strong>us et dans sa pédagogie. Ainsi, on<br />
peut <strong>par</strong>ler d’un véritable <strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t informatique, dont l’usage est <strong>de</strong>v<strong>en</strong>u vulgaire.<br />
En plus <strong>de</strong> la baisse <strong>de</strong>s prix à l’achat <strong>de</strong>s ordinateurs domestiques, un autre phénomène<br />
a permis l’équipem<strong>en</strong>t massif <strong>de</strong>s Français <strong>en</strong> matière <strong>de</strong> logiciels : le piratage. Qu’il <strong>par</strong>te <strong>de</strong><br />
l’int<strong>en</strong>tion <strong>de</strong> contrer le monopole <strong>de</strong> fait <strong>de</strong> la société Microsoft – thèse déf<strong>en</strong><strong>du</strong>e <strong>par</strong> la<br />
communauté <strong>de</strong>s hackers – ou qu’il soit motivé <strong>par</strong> le plaisir d’<strong>en</strong>freindre la loi, il est indéniable<br />
qu’il a permis aux foyers <strong>de</strong> s’équiper <strong>en</strong> logiciels, inaccessibles <strong>par</strong> leur cherté, pour<br />
la majeure <strong>par</strong>tie <strong>de</strong> la population.<br />
C'est ici qu'arrive la première difficulté. En effet, <strong>de</strong>s logiciels normalem<strong>en</strong>t dévolus aux<br />
professionnels ont pénétré les foyers. De manière inopportune, ils ont généré <strong>de</strong>s <strong>en</strong>vies,<br />
que nos sociétés consuméristes sav<strong>en</strong>t fort bi<strong>en</strong> transformer <strong>en</strong> besoins. Pour ne pr<strong>en</strong>dre<br />
que cet exemple, c'est <strong>par</strong> Photoshop, diffusé <strong>par</strong> Adobe (<strong>en</strong>viron 1700 euros la lic<strong>en</strong>ce<br />
pour la Creative Suite 3) qu'ont fleuri <strong>de</strong>s logiciels <strong>de</strong> retouche photo, beaucoup plus accessibles<br />
pour <strong>de</strong>s novices, au mom<strong>en</strong>t <strong>de</strong> l'explosion <strong>du</strong> marché <strong>de</strong> l'ap<strong>par</strong>eil photographique<br />
numérique. Aujourd'hui, avec les logiciels libres <strong>de</strong> droits, on <strong>par</strong>le d'op<strong>en</strong> source : conçus<br />
sur une base collaborative qui autorise la modification et l'amélioration <strong>de</strong>s programmes et<br />
<strong>de</strong>s systèmes, c'est aussi <strong>du</strong> point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong> l'usager une opportunité pour contourner le<br />
piratage. On peut <strong>par</strong>ler d'un véritable contre-pouvoir. Avec le développem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> modèles<br />
sur le Net, les CMS (Cont<strong>en</strong>t Managem<strong>en</strong>t System), chacun peut concevoir son site, son forum,<br />
son blog sans même avoir à saisir une seule ligne <strong>de</strong> co<strong>de</strong> <strong>de</strong> programmation. Par ailleurs, la<br />
moindre recherche <strong>par</strong> mot-clé sur Google, ou sur tout autre moteur <strong>de</strong> recherche, affiche<br />
jusqu'à <strong>de</strong>s millions <strong>de</strong> pages sur le sujet.<br />
L’infini <strong>du</strong> champ <strong>de</strong>s possibles, aussi curieux que cela puisse <strong>par</strong>aître, <strong>de</strong> prime abord,<br />
constitue un frein relatif à la création. En effet, face à l’abondance, l’intérêt se dilue. Ce qui<br />
était exceptionnel <strong>de</strong>vi<strong>en</strong>t banal, normal, et plus tard démodé, délaissé. Tel n’est pas <strong>en</strong>core<br />
le cas pour la réalité virtuelle, pourtant, elle s’inscrit dans le même processus. A priori, la<br />
conception s’ap<strong>par</strong><strong>en</strong>te à un jeu d’<strong>en</strong>fant. Chacun peut t<strong>en</strong>ter sa chance. Rapi<strong>de</strong>m<strong>en</strong>t pourtant,<br />
le non professionnel mesure les limites <strong>de</strong> son savoir-faire. Ayant pu exercer ses maigres<br />
251. Serge Tisseron (dir.), Adolesc<strong>en</strong>ce, « Virtuel », n° 47, 2004, n°, 1, p. 10.<br />
252. Voir ci-après l’exemple <strong>de</strong> l’<strong>Université</strong> Inter-âges <strong>de</strong> Basse-Normandie au sein <strong>de</strong> l’IUT Cherbourg Manche,<br />
site <strong>de</strong> Saint-Lô, pour l’expéri<strong>en</strong>ce « Saint-Lô Retrouvé ».<br />
Schedae, 2008, prépublication n°10, (p. 1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf
compét<strong>en</strong>ces et pro<strong>du</strong>ire un résultat peu satisfaisant, même frustrant, il sera pourtant moins<br />
<strong>en</strong>clin désormais à dép<strong>en</strong>ser plusieurs milliers d’euros pour un résultat professionnel. Alors<br />
même que le multimédia connaît une explosion <strong>en</strong> terme <strong>de</strong> formation – 45000 <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s<br />
d’emploi <strong>par</strong> an –, le secteur ne recrute que très peu – 4500 offres. <strong>La</strong> démocratisation <strong>de</strong>s<br />
pratiques <strong>en</strong>traîne une déprofessionnalisation d’un secteur pourtant émerg<strong>en</strong>t – ou sa nonprofessionnalisation.<br />
<strong>La</strong> très petite taille <strong>de</strong>s <strong>en</strong>treprises <strong>du</strong> secteur <strong>en</strong> est un autre signe<br />
tangible. C’est ainsi que les musées, collectivités locales ou les <strong>par</strong>ticuliers, à la tête d’un<br />
<strong>patrimoine</strong> à valoriser, t<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t <strong>de</strong> communiquer à moindre coût. Le mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> diffusion <strong>de</strong>s<br />
nouvelles technologies dans la société, jusqu’à leur gratuité supposée car possible – avec un<br />
taux <strong>de</strong> répression proche <strong>de</strong> zéro et une difficulté très importante à légiférer sur la question,<br />
compte t<strong>en</strong>u <strong>de</strong>s <strong>en</strong>jeux économiques in<strong>du</strong>its – constitue le propre frein <strong>de</strong> son développem<strong>en</strong>t,<br />
puisqu’il dévalorise symboliquem<strong>en</strong>t, et <strong>de</strong> facto, le travail <strong>de</strong>s professionnels.<br />
Nous avons évoqué ci-<strong>de</strong>ssus la diffusion massive <strong>de</strong>s savoirs et <strong>de</strong>s savoir-faire <strong>de</strong> base<br />
dans la société <strong>du</strong> multimédia. Il faut considérer ce secteur avant tout <strong>du</strong> point <strong>de</strong> vue économique.<br />
Aujourd’hui, non seulem<strong>en</strong>t les matériels évolu<strong>en</strong>t très vite car les progrès sont fulgurants<br />
mais il faut aussi compter avec la concurr<strong>en</strong>ce qui s’exerce dans ce secteur. <strong>La</strong> course<br />
effrénée au progrès, ici synonyme <strong>de</strong> vitesse (rapport temps-capacité) <strong>en</strong>traîne une obsolesc<strong>en</strong>ce<br />
très rapi<strong>de</strong> <strong>de</strong>s supports. Par ailleurs, les matériels ne sont pas toujours compatibles.<br />
Il est à la fois étonnant et certainem<strong>en</strong>t inquiétant <strong>de</strong> noter que l’informatique annule et remplace<br />
systématiquem<strong>en</strong>t toutes les versions antérieures. Le progrès n’intègre pas ce qu’il<br />
améliore. Les temps d’effici<strong>en</strong>ce <strong>de</strong>s matériels sont <strong>de</strong> plus <strong>en</strong> plus courts et l’heure est<br />
aujourd’hui celle <strong>de</strong> la dématérialisation <strong>de</strong>s supports. On peut imaginer que <strong>de</strong> ce point <strong>de</strong><br />
vue, la virtualisation s’intègre tout à fait dans le nouveau schéma <strong>de</strong>s représ<strong>en</strong>tations. Pour<br />
autant, cette fuite <strong>en</strong> avant doit être intégrée dans la métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> travail.<br />
L’exig<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> performance <strong>de</strong>s matériels, <strong>en</strong> terme <strong>de</strong> mémoire <strong>de</strong> stockage et <strong>de</strong><br />
mémoire vive, mais aussi l’impossible harmonisation <strong>de</strong> la diffusion (Quicktime, Mediaplayer,<br />
Shockwave ou Realtime se <strong>par</strong>tag<strong>en</strong>t un marché que chacun s’applique à cloisonner), sans<br />
<strong>par</strong>ler <strong>de</strong>s différ<strong>en</strong>ces <strong>en</strong>tre Internet Explorer et Mozilla Firefox, sont autant <strong>de</strong> freins à une<br />
large diffusion <strong>de</strong> mo<strong>du</strong>les <strong>de</strong> réalité virtuelle sur le net. Les logiciels <strong>de</strong> création tridim<strong>en</strong>sionnelle<br />
sont eux-mêmes nombreux. Certes, le plus répan<strong>du</strong> est-il 3DSmax mais ses concurr<strong>en</strong>ts<br />
s’affirm<strong>en</strong>t, chacun offrant <strong>de</strong>s spécificités et comportant ses inconvéni<strong>en</strong>ts. <strong>La</strong> plu<strong>par</strong>t<br />
sont développés <strong>en</strong> anglais. Bl<strong>en</strong><strong>de</strong>r est un logiciel libre <strong>de</strong> droits, ce qui le r<strong>en</strong>d accessible<br />
mais le système est instable, les images retravaillées, sur Photoshop <strong>par</strong> exemple, chang<strong>en</strong>t<br />
<strong>de</strong> couleur, ou <strong>en</strong>core les textures ne sont pas appliquées correctem<strong>en</strong>t, voire elle ne le sont<br />
pas <strong>du</strong> tout. Ce sont ainsi <strong>de</strong>s heures qui sont passées à compr<strong>en</strong>dre les problèmes, à t<strong>en</strong>ter<br />
<strong>de</strong> les résoudre, avec un succès souv<strong>en</strong>t tout relatif. En un mot, c’est un travail <strong>de</strong> spécialiste<br />
qui ne peut et ne doit ri<strong>en</strong> laisser au hasard.<br />
Un problème <strong>en</strong>core, celui <strong>de</strong> l’intégration <strong>de</strong> la modélisation dans Virtools, qui déti<strong>en</strong>t<br />
le monopole <strong>du</strong> marché : le coût prohibitif <strong>de</strong> ses lic<strong>en</strong>ces, à presque 10 000 euros l’unité<br />
pour les <strong>par</strong>ticuliers. Flash n’offrant pas les mêmes pot<strong>en</strong>tialités <strong>en</strong> matière d’interactivité,<br />
le logiciel anglais est incontournable pour <strong>en</strong>visager l’immersion. On le voit, les problèmes<br />
sont avant tout d’ordres technique et financier, le premier impliquant souv<strong>en</strong>t le <strong>de</strong>uxième.<br />
C’est le cas, bi<strong>en</strong> évi<strong>de</strong>mm<strong>en</strong>t pour la <strong>mise</strong> <strong>en</strong> immersion <strong>du</strong> dispositif. Afin d’obt<strong>en</strong>ir une<br />
simulation <strong>de</strong> mon<strong>de</strong> virtuel, la visite se fait <strong>en</strong> stéréoscopie, dans <strong>de</strong>s salles immersives. Ce<br />
sont ainsi les échelles qui sont respectées et la qualité <strong>de</strong>s écrans permet une simulation<br />
réussie. Mais là <strong>en</strong>core, les tarifs sont prohibitifs, avec <strong>de</strong>s projets qui atteign<strong>en</strong>t jusqu’à<br />
500 000 euros pour une capacité d’<strong>en</strong>viron cinquante personnes.<br />
Du point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong> l’expéri<strong>en</strong>ce <strong>de</strong>s dispositifs <strong>de</strong> réalité virtuelle, il convi<strong>en</strong>t <strong>de</strong> dire<br />
que la dim<strong>en</strong>sion s<strong>en</strong>sorielle <strong>en</strong> est <strong>en</strong>core à ses balbutiem<strong>en</strong>ts. Certes, la recherche avance<br />
sur ce terrain, mais les matériels (gants, casques, etc.) coût<strong>en</strong>t <strong>en</strong>core très cher et leur diffusion<br />
Schedae, 2008, prépublication n°10, (p.1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf<br />
57
58<br />
reste confid<strong>en</strong>tielle. On peut <strong>par</strong>ler d’un sta<strong>de</strong> expérim<strong>en</strong>tal qui per<strong>du</strong>re. L’immersion et<br />
l’interactivité rest<strong>en</strong>t pour l’ess<strong>en</strong>tiel limitées au s<strong>en</strong>s <strong>de</strong> la vue, toujours privilégié. Or, il est<br />
évid<strong>en</strong>t que dans la perspective <strong>de</strong> restitution d’ambiances, le son apporte une dim<strong>en</strong>sion<br />
réaliste incom<strong>par</strong>able. Si l’on se réfère aux propos <strong>de</strong> Jean-Clau<strong>de</strong> Golvin cités plus haut,<br />
les vestiges archéologiques lorsqu’ils sont reconstitués virtuellem<strong>en</strong>t repr<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t vie dans<br />
le mouvem<strong>en</strong>t. On oublie les ruines pour se plonger dans un espace-temps reconstitué. <strong>La</strong><br />
déambulation virtuelle dans un marché, pour atteindre un fort <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> réalisme, doit idéalem<strong>en</strong>t<br />
s’accompagner <strong>de</strong> bruits. Il est <strong>en</strong>core nécessaire <strong>de</strong> distinguer la diffusion <strong>de</strong> bruits<br />
restituant une ambiance et la reconstitution <strong>de</strong> l’acoustique <strong>de</strong>s lieux.<br />
Cette dim<strong>en</strong>sion est extrêmem<strong>en</strong>t complexe et nombre <strong>de</strong> projets ont achoppé sur ce<br />
problème. Il faut <strong>en</strong>core ajouter les o<strong>de</strong>urs, le toucher, et le goût pour avoir pleinem<strong>en</strong>t <strong>en</strong>visagé<br />
la plongée s<strong>en</strong>sorielle dans un univers virtuel. On mesure ici tout le chemin qui reste<br />
à <strong>par</strong>courir pour remporter le défi <strong>de</strong> l’interactivité <strong>de</strong>s visites virtuelles. Par ailleurs, et sans<br />
considérer la dim<strong>en</strong>sion s<strong>en</strong>sorielle <strong>de</strong> l’expéri<strong>en</strong>ce, comme le note G<strong>en</strong>eviève Vidal, l’interactivité<br />
est souv<strong>en</strong>t limitée à son strict minimum, <strong>de</strong> sorte que l’on est am<strong>en</strong>é à se <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r<br />
si cela est vraim<strong>en</strong>t utile sur les sites Internet développés <strong>par</strong> les musées. On se cont<strong>en</strong>te <strong>de</strong><br />
zoomer un fragm<strong>en</strong>t <strong>de</strong> tableau, on <strong>en</strong>tre dans une section <strong>du</strong> musée 253 .<br />
L’idée que l’on pourrait se faire <strong>du</strong> musée virtuel idéal est <strong>en</strong>core très éloignée <strong>de</strong> la réalité.<br />
Aujourd’hui <strong>en</strong> effet, compte t<strong>en</strong>u <strong>de</strong>s difficultés <strong>de</strong> <strong>mise</strong> <strong>en</strong> œuvre, on est t<strong>en</strong>té <strong>de</strong> p<strong>en</strong>ser<br />
qu’elle est bi<strong>en</strong> davantage un outil à <strong>de</strong>stination <strong>de</strong> la recherche, une possibilité offerte<br />
aux historiographes <strong>de</strong> redonner corps et vie au passé, dans un souci <strong>de</strong> précision et <strong>de</strong><br />
vérification <strong>par</strong> l’expéri<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> simulation, comme nous l’avons noté plus haut, plutôt que<br />
d’un gadget offert à la médiation <strong>culturel</strong>le. Il est un fossé important à combler <strong>en</strong>tre le mon<strong>de</strong><br />
sci<strong>en</strong>tifique et le mon<strong>de</strong> ludique avant <strong>de</strong> prét<strong>en</strong>dre répandre une nouvelle forme <strong>de</strong> médiation<br />
<strong>culturel</strong>le à travers la réalité virtuelle. Ainsi, contrairem<strong>en</strong>t aux idées reçues, aux peurs<br />
exprimées <strong>par</strong> les plus rétic<strong>en</strong>ts, cette nouvelle forme <strong>de</strong> représ<strong>en</strong>tation spatio-temporelle<br />
n’est guère répan<strong>du</strong>e dans le domaine <strong>de</strong> la <strong>mise</strong> <strong>en</strong> <strong>valeur</strong> <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong>.<br />
Il semble que d’une certaine façon cette technologie innovante soit quelque peu <strong>en</strong>combrante<br />
pour la médiation <strong>culturel</strong>le. Et si les expéri<strong>en</strong>ces répertoriées sur Internet sont nombreuses,<br />
on constate rapi<strong>de</strong>m<strong>en</strong>t que l’emploi <strong>de</strong> l’expression « réalité virtuelle » est <strong>en</strong> fait,<br />
le plus souv<strong>en</strong>t, un abus <strong>de</strong> langage. Ce <strong>de</strong>rnier développem<strong>en</strong>t pourra, à juste titre, être<br />
considéré comme très critique à l’égard <strong>de</strong> la réalité virtuelle. Il s’agit seulem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> mesurer<br />
les difficultés auxquelles ceux, qui prôn<strong>en</strong>t son développem<strong>en</strong>t et dont nous faisons <strong>par</strong>tie,<br />
doiv<strong>en</strong>t faire face. C’est la raison pour laquelle ceux qui se sont véritablem<strong>en</strong>t <strong>en</strong>gagés dans<br />
cette voie sont assez peu nombreux et l’audace <strong>de</strong> leur démarche, leur condition pionnière<br />
et la qualité <strong>de</strong> leurs travaux, mérit<strong>en</strong>t ici que nous nous y attardions afin <strong>de</strong> tirer <strong>de</strong>s leçons<br />
<strong>de</strong> leur expéri<strong>en</strong>ce.<br />
Les expéri<strong>en</strong>ces<br />
Vers l’écriture d’une histoire locale : le territoire saint-lois<br />
En 2000, l’Association « Saint-Lô Retrouvé » a été à l’initiative d’un projet original et fort<br />
riche d’<strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>ts. L’objectif fixé, et rempli, était <strong>de</strong> réaliser une visite virtuelle dans les<br />
rues <strong>de</strong> la ville, avant les <strong>de</strong>structions <strong>de</strong> juin 1944. Ce très beau projet proposait à la fois<br />
un travail <strong>de</strong> mémoire et l’usage <strong>de</strong> technologies innovantes :<br />
253. C’est le cas <strong>par</strong> exemple <strong>de</strong>s musées virtuels édités sous la forme <strong>de</strong> dvdroms <strong>par</strong> le Louvre ou le C<strong>en</strong>tre<br />
Georges Pompidou, dans leur <strong>de</strong>rnière version.<br />
Schedae, 2008, prépublication n°10, (p. 1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf
Dans la salle informatique <strong>de</strong> l’IUT Réseaux et Services <strong>de</strong> communication 254 , <strong>de</strong>s étudiants<br />
pianot<strong>en</strong>t sur leur clavier. Banal, sauf que, <strong>de</strong>rrière un écran, une institutrice <strong>de</strong> 80 ans évoque<br />
ses souv<strong>en</strong>irs visuels <strong>du</strong> Saint-Lô d’avant 1944… Un écran plus loin, un septuagénaire se remémore<br />
le kiosque à musique d’Alfred-Dusseaux, rasé lors <strong>de</strong> la Libération.<br />
De cette collaboration <strong>en</strong>tre générations, <strong>en</strong>tre jeunes informatici<strong>en</strong>s et habitants beaucoup<br />
moins jeunes, est née la reconstitution virtuelle <strong>du</strong> Saint-Lô d’avant guerre. Et plus <strong>par</strong>ticulièrem<strong>en</strong>t<br />
<strong>de</strong> l’Enclos, la <strong>par</strong>tie <strong>de</strong> la ville <strong>en</strong>serrée dans les rem<strong>par</strong>ts. Une reconstitution sur place<br />
avec places, rues, monum<strong>en</strong>ts et maisons. Jamais réalisée, la confrontation <strong>de</strong>s plans communaux<br />
et <strong>de</strong>s archives dé<strong>par</strong>tem<strong>en</strong>tales a facilité cette « reconstruction » 255 .<br />
Ainsi, fondé sur les archives sauvées <strong>du</strong> désastre mais surtout sur les témoignages, les<br />
souv<strong>en</strong>irs <strong>de</strong> ceux qui avai<strong>en</strong>t survécu aux bombar<strong>de</strong>m<strong>en</strong>ts alliés, le projet serait conçu <strong>par</strong><br />
une poignée <strong>de</strong> jeunes informatici<strong>en</strong>s passionnés. En réalité, ce sont plus <strong>de</strong> 600 personnes<br />
qui, <strong>de</strong> près ou <strong>de</strong> loin, ont apporté une contribution à l’<strong>en</strong>treprise. Il est intéressant <strong>de</strong><br />
mesurer que ce projet inaugure une véritable croisée <strong>de</strong>s chemins : la mémoire n’est pas la<br />
seule affaire <strong>de</strong>s générations passées, d’un côté, la réalité virtuelle n’est pas le médium <strong>de</strong>s<br />
seuls passionnés <strong>de</strong> jeux vidéos, <strong>de</strong> l’autre. Des générations que tout pourrait sé<strong>par</strong>er, <strong>en</strong><br />
termes <strong>de</strong> référ<strong>en</strong>ces <strong>culturel</strong>les, ont su échanger. Raconter ce qui fut, montrer ce qui n’est<br />
plus, pour transmettre, assurém<strong>en</strong>t, <strong>par</strong>tager, sans doute, et peut-être compr<strong>en</strong>dre, telles<br />
fur<strong>en</strong>t les motivations qui ont guidé les acteurs <strong>du</strong> projet.<br />
Comme nous le verrons ci-après, les sources qui attest<strong>en</strong>t <strong>du</strong> Saint-Lô d’avant-guerre<br />
ont pour l’ess<strong>en</strong>tiel dis<strong>par</strong>u dans les décombres, à comm<strong>en</strong>cer <strong>par</strong> le visage <strong>de</strong> la ville luimême<br />
puisqu’elle a été détruite aux neuf dixièmes. Les Archives dé<strong>par</strong>tem<strong>en</strong>tales ont brûlé,<br />
emportant dans les flammes les traces <strong>de</strong> siècles d’histoire locale. Demeur<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s séries <strong>de</strong><br />
cartes postales, qui elles-mêmes racont<strong>en</strong>t leurs histoires, quelques vestiges, à <strong>valeur</strong> archéologique,<br />
et surtout les souv<strong>en</strong>irs précieux <strong>de</strong> ceux qui ont vu leur ville s’effondrer comme un<br />
château <strong>de</strong> cartes, <strong>en</strong> quelques heures. L’occasion qui leur a été donnée <strong>de</strong> livrer aux jeunes<br />
générations leur témoignage est capitale. Elle ne relève pas <strong>du</strong> seul exorcisme, d’une réconciliation<br />
avec les heures tragiques <strong>de</strong> l’histoire vécue. <strong>La</strong> visite virtuelle, qui est le fruit <strong>de</strong><br />
cinq années <strong>de</strong> recherches, <strong>de</strong> scénarisation et <strong>de</strong> <strong>mise</strong> <strong>en</strong> œuvre constitue aujourd’hui une<br />
trace historique <strong>en</strong> tant que telle, un matériau, dont la dim<strong>en</strong>sion virtuelle est étonnamm<strong>en</strong>t<br />
humaine et chargée d’une émotion forte.<br />
Ce très beau succès a posé les premiers jalons <strong>de</strong> ce qui allait <strong>de</strong>v<strong>en</strong>ir <strong>en</strong> 2005 la Lic<strong>en</strong>ce<br />
professionnelle « Développem<strong>en</strong>t et Protection <strong>du</strong> Patrimoine Culturel – option réalité virtuelle<br />
et formation multimédia », (LP D2PC) ouverte à l’IUT Cherbourg Manche sur le site <strong>de</strong> Saint-<br />
Lô 256 . L’expéri<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> « Saint-Lô Retrouvé » montre que la ville, si meurtrie <strong>par</strong> l’Histoire, ne<br />
pouvait et ne voulait oublier ce pan désastreux <strong>de</strong> son passé, son statut <strong>de</strong> « capitale <strong>de</strong>s<br />
ruines», repro<strong>du</strong>it à l’<strong>en</strong>vi dans les manuels scolaires. Peut-être fallait-il le sol<strong>de</strong>r car le statut <strong>de</strong><br />
ville martyre ne doit pas <strong>en</strong>courager ou excuser une forme d’immobilisme. <strong>La</strong> ville souhaite<br />
aujourd’hui, sans ri<strong>en</strong> oublier, se détacher <strong>de</strong> cette image quelque peu sclérosante et qui<br />
appelle une forme <strong>de</strong> con<strong>de</strong>sc<strong>en</strong>dance. Saint-Lô, préfecture <strong>de</strong> la Manche, s’inscrit dans un<br />
territoire à forte vocation rurale, qui, comme beaucoup d’autres, est <strong>en</strong> perte <strong>de</strong> vitesse économique.<br />
Elle <strong>mise</strong> beaucoup sur le fort pot<strong>en</strong>tiel touristique <strong>du</strong> dé<strong>par</strong>tem<strong>en</strong>t, sa richesse naturelle<br />
et son <strong>patrimoine</strong> <strong>culturel</strong>. Abritant déjà une formation <strong>de</strong> DUT tournée vers les « Services<br />
254. On aura rectifié l’intitulé : IUT Cherbourg Manche site <strong>de</strong> Saint-Lô, dé<strong>par</strong>tem<strong>en</strong>t Services et Réseaux <strong>de</strong><br />
Communication.<br />
255. Le Point, 30 septembre 2004.<br />
256. En <strong>par</strong>t<strong>en</strong>ariat avec la Maison <strong>de</strong> la Recherche <strong>en</strong> Sci<strong>en</strong>ces Humaines (MRSH) – et tout <strong>par</strong>ticulièrem<strong>en</strong>t<br />
l’équipe <strong>du</strong> « Plan <strong>de</strong> Rome » –, et l’UFR d’Histoire et l’UFR <strong>de</strong>s Sci<strong>en</strong>ces <strong>de</strong> l’Homme <strong>de</strong> l’<strong>Université</strong> <strong>de</strong><br />
Ca<strong>en</strong> Basse-Normandie.<br />
Schedae, 2008, prépublication n°10, (p.1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf<br />
59
60<br />
et Réseaux <strong>de</strong> Communication », la ville voyait tous les ingrédi<strong>en</strong>ts réunis pour faire aboutir<br />
le projet <strong>de</strong> Lic<strong>en</strong>ce professionnelle et lui permettre <strong>de</strong> pr<strong>en</strong>dre tout son s<strong>en</strong>s dans la cité.<br />
Ouverte <strong>en</strong> formation initiale et <strong>en</strong> formation continue à <strong>de</strong>s étudiants issus <strong>de</strong> filières<br />
informatique, communicationnelle, historique ou graphique, la LP D2PC forme <strong>de</strong>s assistants<br />
chefs <strong>de</strong> projets dans les domaines <strong>de</strong> la création multimédia appliquée au <strong>patrimoine</strong>,<br />
l’infographie tridim<strong>en</strong>sionnelle et la formation ouverte à distance (FOAD). Les filières d’origine<br />
<strong>de</strong>s candidats sont assez hétérogènes ce qui implique la même hétérogénéité <strong>en</strong> matière<br />
<strong>de</strong> compét<strong>en</strong>ces. On peut déplorer cet aspect, qui dans la formation n’est pas toujours simple<br />
à gérer. Toutefois, nous préférons ici déf<strong>en</strong>dre ce modèle pour les raisons qui suiv<strong>en</strong>t.<br />
Tout d’abord, s’il est vrai que le cursus d’origine différ<strong>en</strong>cie <strong>de</strong>s niveaux <strong>de</strong> compét<strong>en</strong>ces<br />
<strong>par</strong>mi les étudiants, soit dans le domaine technique, soit dans celui <strong>de</strong> la constitution <strong>de</strong>s<br />
dossiers sci<strong>en</strong>tifiques, le fait que les travaux soi<strong>en</strong>t le plus souv<strong>en</strong>t m<strong>en</strong>és <strong>en</strong> groupes – ou<br />
ag<strong>en</strong>ces – r<strong>en</strong>force le caractère pluridisciplinaire <strong>de</strong>s collaborations et l’<strong>en</strong>richit. Ainsi, dans la<br />
mesure où ils se <strong>de</strong>stin<strong>en</strong>t à l’<strong>en</strong>cadrem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> projets, les étudiants <strong>en</strong>visag<strong>en</strong>t le processus<br />
dans son <strong>en</strong>semble et peuv<strong>en</strong>t affiner leur choix d’ori<strong>en</strong>tation professionnelle au sein même<br />
<strong>de</strong> la formation. Ayant abordé les aspects techniques, ceux qui se <strong>de</strong>stin<strong>en</strong>t à la constitution<br />
<strong>de</strong>s dossiers sci<strong>en</strong>tifiques et plus <strong>en</strong>core ceux qui s’ori<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t vers la filière <strong>de</strong> la médiation<br />
<strong>culturel</strong>le, grâce à leur double compét<strong>en</strong>ce, approch<strong>en</strong>t et con<strong>du</strong>is<strong>en</strong>t les projets avec<br />
davantage <strong>de</strong> réalisme que s’ils étai<strong>en</strong>t ignorants <strong>de</strong> ces contraintes. De la même manière,<br />
ceux qui se <strong>de</strong>stin<strong>en</strong>t à l’infographie 3D compr<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t les niveaux d’exig<strong>en</strong>ce <strong>de</strong>s chercheurs<br />
qui <strong>par</strong>fois peuv<strong>en</strong>t ap<strong>par</strong>aître fort sourcilleux. C’est ainsi que toute la filière <strong>de</strong> pro<strong>du</strong>ction<br />
<strong>de</strong> mo<strong>du</strong>les <strong>de</strong> réalité virtuelle appliqués au <strong>patrimoine</strong> gagne <strong>en</strong> rigueur et <strong>en</strong> efficacité –<br />
peut-être <strong>de</strong>vrons-nous bi<strong>en</strong>tôt <strong>par</strong>ler <strong>de</strong> pro<strong>du</strong>ctivité -. Nous n’<strong>en</strong>trerons pas dans le détail<br />
<strong>de</strong>s cont<strong>en</strong>us <strong>de</strong>s <strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>ts, qui n’est que <strong>de</strong> peu d’importance ici. En revanche, nous<br />
nous attacherons à montrer combi<strong>en</strong>, <strong>en</strong> l’espace <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux années l’implantation <strong>de</strong> cette<br />
formation au caractère innovant, grâce à ses <strong>par</strong>t<strong>en</strong>ariats, a maillé le territoire saint-lois et<br />
au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> ses projets et <strong>de</strong> ses réalisations.<br />
<strong>La</strong> première <strong>par</strong>tie <strong>de</strong> ce texte a insisté sur les développem<strong>en</strong>ts réc<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> la dim<strong>en</strong>sion<br />
patrimoniale et sur les <strong>en</strong>jeux <strong>de</strong> sa <strong>mise</strong> <strong>en</strong> <strong>valeur</strong> <strong>par</strong> la réalité virtuelle. Les projets<br />
sur lesquels les étudiants <strong>de</strong> la LP D2PC sont am<strong>en</strong>és à travailler sont tout à fait révélateurs<br />
<strong>de</strong>s opportunités qu’offre la réalité virtuelle pour concilier les intérêts sci<strong>en</strong>tifiques et ceux<br />
<strong>du</strong> public. Tout d’abord, il est très important <strong>de</strong> noter que dès le dé<strong>par</strong>t, la formation a été<br />
sout<strong>en</strong>ue <strong>par</strong> l’équipe <strong>du</strong> « Plan <strong>de</strong> Rome », l’une <strong>de</strong>s plus actives et les plus reconnues dans<br />
le domaine <strong>de</strong> la réalité virtuelle appliquée à l’Histoire antique : Philippe Fleury, Professeur<br />
<strong>de</strong> latin et Sophie Ma<strong>de</strong>leine, ingénieur <strong>de</strong> recherche, disp<strong>en</strong>s<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s cours d’Histoire <strong>de</strong><br />
l’Urbanisme et Nicolas Lefèvre, infographiste 3D, les mo<strong>du</strong>les d’infographie 3D. Un autre<br />
souti<strong>en</strong> capital est celui <strong>de</strong> l’UFR d’Histoire, dont le directeur, le Professeur Jean Quelli<strong>en</strong>,<br />
spécialiste <strong>de</strong> la Secon<strong>de</strong> Guerre Mondiale, a rejoint l’équipe <strong>en</strong>seignante. Leur savoir et<br />
leur savoir-faire réunis constitu<strong>en</strong>t une caution précieuse pour la crédibilité <strong>de</strong> la formation,<br />
à la fois pour les étudiants qui la suiv<strong>en</strong>t et pour les <strong>par</strong>t<strong>en</strong>aires qui intègr<strong>en</strong>t le réseau.<br />
Dès le dé<strong>par</strong>t, et s’appuyant sur le très bon accueil reçu <strong>par</strong> l’expéri<strong>en</strong>ce m<strong>en</strong>ée à l’IUT<br />
<strong>par</strong> l’Association « Saint-Lô Retrouvé », tous les projets m<strong>en</strong>és c<strong>en</strong>trés sur le <strong>patrimoine</strong> <strong>culturel</strong><br />
au sein <strong>de</strong> la formation ont été conçus pour la <strong>mise</strong> <strong>en</strong> <strong>valeur</strong> <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong> local. Impliquer<br />
<strong>en</strong> premier lieu les <strong>par</strong>t<strong>en</strong>aires locaux prés<strong>en</strong>tait au moins trois avantages. Le premier<br />
est celui <strong>de</strong> former <strong>de</strong>s étudiants sur <strong>de</strong>s projets concrets, ce qui écarte d’emblée la critique<br />
d’une <strong>Université</strong> détachée <strong>de</strong>s préoccupations professionnelles. En second lieu, les <strong>par</strong>t<strong>en</strong>aires<br />
pouvai<strong>en</strong>t d’emblée mesurer la faisabilité <strong>de</strong> la démarche, sans <strong>en</strong>gager <strong>de</strong> frais dans<br />
un premier temps, <strong>en</strong> termes matériels et humains. Enfin, la problématique posée dans<br />
l’intitulé <strong>de</strong> la Lic<strong>en</strong>ce professionnelle trouvait une application concrète, se plaçant ainsi au<br />
service <strong>de</strong> l’intérêt général.<br />
Schedae, 2008, prépublication n°10, (p. 1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf
<strong>La</strong> première préoccupation fut donc <strong>de</strong> trouver, <strong>de</strong> manière empirique, avec la Ville <strong>de</strong><br />
Saint-Lô et le Conseil général <strong>de</strong> la Manche <strong>de</strong>s projets pour lesquels la réalité virtuelle constituerait<br />
un atout <strong>de</strong> <strong>mise</strong> <strong>en</strong> <strong>valeur</strong>. Ce fut une <strong>en</strong>treprise assez simple puisque le champ d’application<br />
est très ét<strong>en</strong><strong>du</strong>. Il n’est pas question ici d’énumérer l’<strong>en</strong>semble <strong>de</strong>s travaux réalisés,<br />
<strong>en</strong> cours ou <strong>en</strong> projet. <strong>La</strong> tâche serait fastidieuse et ne prés<strong>en</strong>terait d’autre intérêt que celui<br />
d’un inv<strong>en</strong>taire, à vocation illustrative. Toutefois, nous allons <strong>en</strong> examiner quelques-uns,<br />
qui montr<strong>en</strong>t que le spectre d’une formation comme la LP D2PC est large. Son succès<br />
immédiat laisse <strong>en</strong>trevoir un développem<strong>en</strong>t rapi<strong>de</strong> <strong>de</strong>s métiers auxquels elle pré<strong>par</strong>e.<br />
Sous l’égi<strong>de</strong> <strong>de</strong> la Ville <strong>de</strong> Saint-Lô, la Médiathèque dispose d’un fonds précieux, doté<br />
notamm<strong>en</strong>t <strong>de</strong> plusieurs incunables et <strong>du</strong> fonds <strong>de</strong> l’Abbaye <strong>de</strong> Mortain. Pour <strong>de</strong>s raisons<br />
évid<strong>en</strong>tes <strong>de</strong> conservation, ce fonds n’est accessible au grand public que <strong>de</strong> manière exceptionnelle<br />
257 . Il fut donc choisi <strong>de</strong> réaliser une visite virtuelle <strong>de</strong> cette <strong>par</strong>tie <strong>de</strong>s collections,<br />
<strong>de</strong> manière thématique 258 . Cette action fait <strong>par</strong>tie d’un programme plus vaste <strong>de</strong> restauration<br />
et <strong>de</strong> <strong>mise</strong> <strong>en</strong> <strong>valeur</strong> <strong>du</strong> fonds précieux <strong>par</strong> la DRAC <strong>de</strong> Basse-Normandie. Ap<strong>par</strong>t<strong>en</strong>ant<br />
lui aussi à la Ville <strong>de</strong> Saint-Lô, le Musée <strong>du</strong> Bocage Normand – Ferme <strong>de</strong> Boisjugan est un<br />
musée <strong>de</strong>s arts et traditions populaires. Les étudiants <strong>de</strong> la LP D2PC ont <strong>en</strong>tamé le travail,<br />
long et fastidieux, <strong>de</strong> numérisation <strong>de</strong>s réserves dans la perspective <strong>de</strong> la constitution d’une<br />
base <strong>de</strong> données patrimoniales mutualisable, ainsi que la visite virtuelle <strong>du</strong> musée <strong>par</strong> sections.<br />
<strong>La</strong> <strong>de</strong>uxième année, une toute autre dim<strong>en</strong>sion a été donnée au <strong>par</strong>t<strong>en</strong>ariat autour <strong>de</strong><br />
la reconstitution virtuelle. Le musée <strong>du</strong> Bocage Normand possè<strong>de</strong> une boulangerie <strong>en</strong><br />
ruine : la région <strong>en</strong> compte d’innombrables mais celle-ci prés<strong>en</strong>te la <strong>par</strong>ticularité d’être<br />
construite sur l’eau. Ainsi, les étudiants fur<strong>en</strong>t-ils mis à contribution pour proposer, à <strong>par</strong>tir<br />
d’un dossier sci<strong>en</strong>tifique constitué <strong>de</strong>s données archéologiques, <strong>de</strong> photos anci<strong>en</strong>nes, <strong>de</strong><br />
plans, etc., une reconstitution virtuelle <strong>du</strong> bâtim<strong>en</strong>t dis<strong>par</strong>u. Leur travail est utile à <strong>de</strong>ux titres.<br />
D’une <strong>par</strong>t, la modélisation proposée <strong>par</strong> chacun montre que le travail <strong>de</strong> restitution nécessite<br />
<strong>de</strong>s interprétations, <strong>de</strong>s extrapolations qu’il faut justifier. D’autre <strong>par</strong>t, et c’est dans ce cadre<br />
que la contribution pr<strong>en</strong>d tout son s<strong>en</strong>s, dans le cas prés<strong>en</strong>t, la modélisation a pour objectif<br />
<strong>de</strong> servir <strong>de</strong> base à la reconstruction <strong>du</strong> bâtim<strong>en</strong>t <strong>par</strong> <strong>de</strong>s jeunes <strong>en</strong> difficulté d’insertion.<br />
Ce projet, symboliquem<strong>en</strong>t fort est bi<strong>en</strong> la preuve que la réalité virtuelle n’est non seulem<strong>en</strong>t<br />
pas inutile pour l’Histoire mais qu’elle a un rôle à jouer <strong>en</strong> matière sociale. Nous touchons<br />
là une <strong>de</strong>s préoccupations majeures <strong>de</strong> l’équipe d’<strong>en</strong>cadrem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> la Lic<strong>en</strong>ce professionnelle.<br />
Si la vocation première d’une telle formation est <strong>de</strong> con<strong>du</strong>ire <strong>de</strong>s jeunes professionnels vers<br />
<strong>de</strong>s métiers innovants, ceci doit s’opérer dans un cadre soucieux d’intégration. Comme nous<br />
l’avons vu, les fossés qui sé<strong>par</strong><strong>en</strong>t le public <strong>de</strong> la <strong>mise</strong> <strong>en</strong> <strong>valeur</strong> <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong> <strong>culturel</strong> sont à<br />
la fois générationnel, <strong>culturel</strong>, économique, social mais il faut égalem<strong>en</strong>t s’efforcer <strong>de</strong> combler<br />
celui qui sé<strong>par</strong>e le mon<strong>de</strong> <strong>de</strong>s vali<strong>de</strong>s <strong>de</strong> celui <strong>du</strong> handicap. Ainsi, les projets sont-ils maint<strong>en</strong>ant<br />
expertisés <strong>par</strong> <strong>de</strong>s référ<strong>en</strong>ts pour les publics à mobilité ré<strong>du</strong>ite, pour les mal-voyants et<br />
les non-voyants ainsi que pour les sourds et mal<strong>en</strong>t<strong>en</strong>dants. Montrant l’exemple, la formation<br />
accueillait <strong>en</strong> 2006-2007 un étudiant sourd profond <strong>en</strong> immersion totale.<br />
Le sérieux <strong>de</strong> la formation ayant été attesté d’emblée, les souti<strong>en</strong>s et les <strong>par</strong>t<strong>en</strong>ariats se<br />
sont étoffés : <strong>par</strong>t<strong>en</strong>aires régionaux, avec le Conseil Économique et Social (CESR), les Espaces<br />
publics numériques bas-normands (EPNBN), nationaux avec <strong>de</strong>s projets <strong>de</strong> formation continue<br />
pour les professionnels <strong>de</strong> la médiation <strong>culturel</strong>le, sur le mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> la formation ouverte à distance,<br />
ou internationaux avec une <strong>Université</strong> étasuni<strong>en</strong>ne 259 et une canadi<strong>en</strong>ne 260 , toutes <strong>de</strong>ux<br />
très intéressées <strong>par</strong> la virtualisation <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong> <strong>culturel</strong> normand. On compr<strong>en</strong>d bi<strong>en</strong> la<br />
257. En <strong>par</strong>ticulier lors <strong>de</strong>s Journées <strong>du</strong> Patrimoine.<br />
258. En 2006, la première déclinaison fut consacrée aux cabinets <strong>de</strong> curiosités.<br />
259. Middle T<strong>en</strong>nessee State University, T<strong>en</strong>nessee, États-Unis.<br />
260. CEGEP <strong>de</strong> Saint-Hyacinthe, Québec, Canada.<br />
Schedae, 2008, prépublication n°10, (p.1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf<br />
61
62<br />
démarche : acteurs d’une <strong>par</strong>tie <strong>de</strong> l’Histoire <strong>de</strong> la Normandie, ils ne possèd<strong>en</strong>t pas le <strong>patrimoine</strong><br />
physique. Sa modélisation <strong>de</strong>vi<strong>en</strong>t un lieu <strong>de</strong> <strong>par</strong>tage <strong>de</strong> l’histoire. <strong>La</strong> formation a égalem<strong>en</strong>t<br />
intégré le CIREVE (C<strong>en</strong>tre Interdisciplinaire <strong>de</strong> Réalité Virtuelle), dirigé <strong>par</strong> Philippe Fleury<br />
et qui regroupe les équipes <strong>de</strong> recherche <strong>de</strong> l’<strong>Université</strong> <strong>de</strong> Ca<strong>en</strong> Basse-Normandie, qui, <strong>en</strong><br />
interdisciplinarité, utilis<strong>en</strong>t la réalité virtuelle comme outil <strong>de</strong> recherche. Le tout jeune CIREVE –<br />
il a vu le jour <strong>en</strong> 2006 –, <strong>de</strong>v<strong>en</strong>u service commun <strong>de</strong> l’<strong>Université</strong>, est un pôle riche d’échanges<br />
et <strong>de</strong> projets, qui nourrit les ambitions <strong>de</strong> chacune <strong>de</strong>s équipes <strong>de</strong> recherche dans une dynamique<br />
collaborative. <strong>La</strong> contribution <strong>de</strong>s étudiants connaît <strong>en</strong> son sein un développem<strong>en</strong>t rapi<strong>de</strong>.<br />
Il semble d’ores et déjà que le bilan dressé soit très positif au bout <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>ux années<br />
d’expéri<strong>en</strong>ces. Si l’on s’essaie à une typologie, on note que le champ patrimonial couvert<br />
est ét<strong>en</strong><strong>du</strong>. Le <strong>patrimoine</strong> religieux est très prés<strong>en</strong>t, traité selon <strong>de</strong>s problématiques différ<strong>en</strong>tes.<br />
L’abbaye bénédictine <strong>de</strong> Hambye, gérée <strong>par</strong> le Conseil général <strong>de</strong> la Manche est un<br />
<strong>en</strong>semble qui a <strong>en</strong> très gran<strong>de</strong> <strong>par</strong>tie dis<strong>par</strong>u <strong>de</strong> même que les sources jadis conservées<br />
aux Archives dé<strong>par</strong>tem<strong>en</strong>tales. Le travail effectué <strong>par</strong> les étudiants <strong>de</strong> la LP D2PC aura été<br />
précieux pour le site puisque la reconstitution virtuelle <strong>de</strong> l’église abbatiale, fondée ess<strong>en</strong>tiellem<strong>en</strong>t<br />
sur <strong>de</strong>s relevés archéologiques, a montré que la nef, que l’on croyait jusque là<br />
compter trois travées <strong>en</strong> possédait <strong>en</strong> réalité quatre. L’abbaye, cisterci<strong>en</strong>ne cette fois, <strong>de</strong><br />
Villers-Canivet, prés<strong>en</strong>te <strong>de</strong>s caractéristiques proches. Acquis il y a tr<strong>en</strong>te ans et <strong>de</strong>puis restauré<br />
<strong>par</strong> un <strong>par</strong>ticulier, le lieu est très <strong>en</strong>dommagé. Il est in<strong>en</strong>visageable <strong>de</strong> rebâtir le site,<br />
<strong>du</strong> reste maintes fois transformé. En revanche, la réalité virtuelle permettra <strong>de</strong> restituer les<br />
différ<strong>en</strong>tes époques <strong>de</strong> l’abbaye et <strong>de</strong> proposer une déambulation à travers le temps. Pour<br />
clore l’énumération, on pourrait <strong>en</strong>fin citer l’église Notre-Dame <strong>du</strong> Vœu <strong>de</strong> Cherbourg, fouillée<br />
<strong>par</strong> le CRAHM dont la modélisation <strong>en</strong> cours vise à restituer les styles successifs <strong>de</strong> l’édifice.<br />
<strong>La</strong> région fut très exposée p<strong>en</strong>dant la Secon<strong>de</strong> Guerre Mondiale <strong>du</strong> fait <strong>du</strong> choix d’un<br />
débarquem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s troupes alliées sur les plages <strong>de</strong> Normandie. Après les commémorations<br />
<strong>de</strong>s 50e et 60 e anniversaires <strong>de</strong> la Libération, la Secon<strong>de</strong> Guerre Mondiale pose <strong>de</strong>s questions<br />
fort intéressantes <strong>en</strong> matière <strong>de</strong> <strong>mise</strong> <strong>en</strong> <strong>valeur</strong> <strong>de</strong> son <strong>patrimoine</strong>, à l’heure <strong>de</strong>s nouvelles<br />
technologies. C’est d’abord la question <strong>de</strong> la mémoire qui est posée, ainsi que nous<br />
l’avons vu plus haut avec « Saint-Lô Retrouvé ». Quel est aujourd’hui l’intérêt <strong>de</strong> conserver<br />
un <strong>patrimoine</strong> <strong>de</strong> guerre dans <strong>de</strong>s musées alors que ceux qui seront le public <strong>de</strong> <strong>de</strong>main<br />
n’auront pas vécu les faits et seront peut-être plutôt <strong>en</strong>clins à oublier une <strong>par</strong>t sombre <strong>de</strong><br />
l’Histoire ? Comm<strong>en</strong>t alors, mettre <strong>en</strong> <strong>valeur</strong> ce <strong>patrimoine</strong> grâce aux nouvelles technologies ?<br />
<strong>La</strong> réalité virtuelle ne constitue-t-elle pas un risque <strong>de</strong> dérive ? Toutes ces questions sont<br />
passionnantes et nous oblig<strong>en</strong>t à trouver <strong>de</strong>s réponses rapi<strong>de</strong>s et pertin<strong>en</strong>tes. <strong>La</strong> perspective<br />
<strong>de</strong> l’ext<strong>en</strong>sion <strong>du</strong> Musée – privé – Airborne <strong>de</strong> Sainte-Mère-Église 261 , à laquelle la LP D2PC<br />
est associée offre un cas d’étu<strong>de</strong> tout à fait intéressant. Le Conseil général <strong>de</strong> la Manche<br />
se trouve confronté aux mêmes interrogations sur les sites qu’il gère, <strong>en</strong> <strong>par</strong>ticulier pour la<br />
batterie d’Azeville : celle <strong>de</strong> Crisbecq, privée, distante <strong>de</strong> seulem<strong>en</strong>t quelques kilomètres,<br />
accueille <strong>de</strong>s groupes <strong>de</strong> vétérans nazis <strong>en</strong> uniforme 262 . Le service <strong>de</strong>s sites et musées <strong>du</strong><br />
dé<strong>par</strong>tem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> la Manche 263 s’est rapproché <strong>de</strong> la Lic<strong>en</strong>ce professionnelle pour t<strong>en</strong>ter <strong>de</strong><br />
trouver <strong>de</strong>s solutions novatrices <strong>de</strong> <strong>mise</strong> <strong>en</strong> <strong>valeur</strong> <strong>de</strong> ce <strong>patrimoine</strong> architectural militaire.<br />
261. Musée dédié aux troupes américaines aéroportées.<br />
262. « Sur ces terres meurtries <strong>de</strong> Normandie la mémoire est un <strong>de</strong>voir. Chaque mois <strong>de</strong> juin, se succèd<strong>en</strong>t les<br />
commémorations. Celui qui se prés<strong>en</strong>te comme le “conservateur” <strong>de</strong> la batterie a ouvert Crisbecq aux<br />
reconstitutions. “Je voulais un musée vivant, j’ai fait appel à <strong>de</strong>s collectionneurs qui font ça avec respect”.<br />
Depuis septembre 2006, V<strong>en</strong>t d’Europe est v<strong>en</strong>u régulièrem<strong>en</strong>t aménager l’un <strong>de</strong>s bunkers, “afin <strong>de</strong> nous<br />
assurer un meilleur confort lors <strong>de</strong> nos sorties à Crisbeq. Ses hommes, qui compt<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s Itali<strong>en</strong>s et <strong>de</strong>s<br />
Belges, n’hésit<strong>en</strong>t plus à se montrer au grand jour […] dans d’autres musées <strong>du</strong> Débarquem<strong>en</strong>t” », Ouest-<br />
France, 11 septembre 2007.<br />
263. Ce service gère dix-sept sites.<br />
Schedae, 2008, prépublication n°10, (p. 1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf
Le <strong>patrimoine</strong> religieux et les vestiges <strong>de</strong> la Secon<strong>de</strong> Guerre sont les fleurons <strong>de</strong> la<br />
région. Ils contribu<strong>en</strong>t indéniablem<strong>en</strong>t à sa promotion touristique. Pourtant, et loin s’<strong>en</strong> faut,<br />
ils ne sont pas les seuls à pouvoir prét<strong>en</strong>dre être mis <strong>en</strong> <strong>valeur</strong> <strong>par</strong> les technologies nouvelles.<br />
Nous avons vu, avec l’exemple <strong>de</strong> la Ferme <strong>de</strong> Boisjugan, que les musées, qu’ils soi<strong>en</strong>t<br />
<strong>de</strong> tradition populaire ou d’une toute autre nature, peuv<strong>en</strong>t tout à fait s’inscrire dans cette<br />
dynamique. Pourtant, nous constatons une rétic<strong>en</strong>ce importante, corroborant <strong>par</strong> l’expéri<strong>en</strong>ce<br />
les propos critiques t<strong>en</strong>us <strong>par</strong> G<strong>en</strong>eviève Vidal 264 . Les contacts qui ont été pris n’ont<br />
pas porté les fruits escomptés, <strong>par</strong>ticulièrem<strong>en</strong>t dans les musées <strong>de</strong>s Beaux-Arts, alors même<br />
que la formation se rapproche <strong>de</strong> l’ESBACO 265 . On s<strong>en</strong>t une méfiance certaine à l’<strong>en</strong>contre<br />
<strong>de</strong> technologies qui exporterai<strong>en</strong>t le musée hors-les-murs, une peur <strong>de</strong> perdre le contrôle.<br />
On peut aussi supputer qu’il n’y a pas <strong>de</strong> réel projet autour <strong>de</strong> la réalité virtuelle et que c’est<br />
ce qui justifie une réaction, dans le meilleur <strong>de</strong>s cas con<strong>de</strong>sc<strong>en</strong>dante et <strong>par</strong>fois agressive.<br />
Nous poursuivons toutefois notre <strong>en</strong>treprise <strong>de</strong> persuasion, <strong>par</strong> le dialogue et <strong>par</strong> <strong>de</strong>s projets<br />
m<strong>en</strong>és dans d’autres cadres, avec d’autres <strong>par</strong>t<strong>en</strong>aires.<br />
Aussi, <strong>en</strong> 2007, l’acc<strong>en</strong>t a-t-il été mis sur la question <strong>du</strong> paysage comme construction<br />
<strong>culturel</strong>le. Le syMEL (syndicat mixte <strong>de</strong>s espaces littoraux), vi<strong>en</strong>t d’associer la LP D2PC sur<br />
le programme europé<strong>en</strong> HEATH pour la modélisation <strong>de</strong>s <strong>du</strong>nes. Un rapprochem<strong>en</strong>t est <strong>en</strong><br />
cours avec le GEOPHEN sur une thématique proche. Logiquem<strong>en</strong>t, abordant la question<br />
<strong>du</strong> paysage, la Lic<strong>en</strong>ce professionnelle <strong>de</strong>vait se tourner vers sa protection et intégrer la<br />
dim<strong>en</strong>sion <strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>tale. Un <strong>par</strong>t<strong>en</strong>ariat, associant un autre dé<strong>par</strong>tem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> l’IUT 266 , a<br />
été signé avec la SCIC <strong>de</strong>s « Sept V<strong>en</strong>ts <strong>du</strong> Cot<strong>en</strong>tin », spécialisée dans les énergies r<strong>en</strong>ouvelables.<br />
On peut critiquer une démarche qui s’écarte <strong>du</strong> chemin <strong>de</strong> la mémoire. Mais le<br />
<strong>patrimoine</strong> est aussi celui que nous construisons. Nous avons étudié <strong>en</strong> premier lieu l’ét<strong>en</strong><strong>du</strong>e<br />
sémantique <strong>du</strong> terme « <strong>patrimoine</strong> », montrant que son champ ne cesse <strong>de</strong> s’élargir. L’expéri<strong>en</strong>ce<br />
montre que le <strong>patrimoine</strong> est aujourd’hui un concept qui s’anticipe et nous opérons<br />
<strong>de</strong>s choix <strong>en</strong> fonction <strong>de</strong> ce que nous souhaitons léguer aux générations futures.<br />
Ainsi, la formation a été contactée <strong>par</strong> l’ANDRA 267 laquelle, <strong>en</strong> 2006 268 , a organisé un<br />
colloque sur la question patrimoniale. Aussi surpr<strong>en</strong>ant que cela puisse <strong>par</strong>aître, la problématique<br />
qui se pose à cette ag<strong>en</strong>ce est celle <strong>de</strong> la <strong>du</strong>rée : elle <strong>en</strong>visage la question <strong>de</strong>s déchets<br />
qu’elle lègue aux générations futures – dangereusem<strong>en</strong>t actifs sur une échelle <strong>de</strong> temps qui<br />
se compte <strong>en</strong> millions d’années – comme le legs d’un <strong>patrimoine</strong>. Il est <strong>de</strong>s héritages qui<br />
<strong>par</strong>fois embarrass<strong>en</strong>t et dont finalem<strong>en</strong>t on préférerait ignorer jusqu’à l’exist<strong>en</strong>ce… Si les<br />
lignes qui précèd<strong>en</strong>t interrog<strong>en</strong>t sur le s<strong>en</strong>s critique et le recul nécessaires <strong>de</strong>s porteurs <strong>de</strong><br />
projets, <strong>par</strong>fois aujourd’hui « fabricants » <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong>, c’est précisém<strong>en</strong>t <strong>par</strong> ce qu’elles<br />
démontr<strong>en</strong>t qu’il y a une vraie pertin<strong>en</strong>ce à inscrire la <strong>mise</strong> <strong>en</strong> <strong>valeur</strong> <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong> <strong>culturel</strong><br />
<strong>par</strong> les nouvelles technologies dans une démarche structurée, selon une méthodologie. C’est<br />
<strong>en</strong> effet la métho<strong>de</strong> ret<strong>en</strong>ue et suivie qui justifie l’exist<strong>en</strong>ce <strong>de</strong>s projets sur un territoire, qui<br />
les r<strong>en</strong>d crédibles et <strong>par</strong> conséqu<strong>en</strong>t indiscutables.<br />
Pour une nouvelle écriture <strong>de</strong> la gran<strong>de</strong> histoire<br />
Nous avons fait référ<strong>en</strong>ce, plus haut dans le texte, à la méthodologie proposée <strong>par</strong><br />
Jean-Clau<strong>de</strong> Golvin dans son cours <strong>de</strong> Tunis. <strong>La</strong> très gran<strong>de</strong> exig<strong>en</strong>ce et l’imm<strong>en</strong>se qualité<br />
<strong>du</strong> travail <strong>de</strong> cet architecte <strong>de</strong> formation, qui a voué sa vie <strong>de</strong> chercheur à la restitution <strong>de</strong><br />
264. G<strong>en</strong>eviève Vidal, Contribution à l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’interactivité, les usages <strong>du</strong> multimédia <strong>de</strong> musée, Bor<strong>de</strong>aux,<br />
PUB, 2006, 168 pages.<br />
265. École supérieure <strong>de</strong>s Beaux-Arts <strong>de</strong> Cherbourg Octeville.<br />
266. Le dé<strong>par</strong>tem<strong>en</strong>t Génie Thermique et Énergie (GTE).<br />
267. Ag<strong>en</strong>ce nationale pour la gestion <strong>de</strong>s déchets radioactifs.<br />
268. Un colloque sur le même thème s’est déroulé <strong>en</strong> décembre 2007.<br />
Schedae, 2008, prépublication n°10, (p.1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf<br />
63
64<br />
269<br />
sites archéologiques aux quatre coins <strong>du</strong> mon<strong>de</strong> , sont pour nous <strong>de</strong>s modèles. Il a su<br />
montrer <strong>de</strong> manière très pédagogique les t<strong>en</strong>ants et les aboutissants <strong>de</strong> l’outil informatique<br />
au service <strong>de</strong> la restitution architecturale. Ses <strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>ts seront précieux pour notre<br />
projet <strong>de</strong> reconstitution <strong>de</strong> l’église Notre-Dame <strong>de</strong> Saint-Lô dans son état d’avant-guerre.<br />
Néanmoins, c’est sur les travaux <strong>de</strong> l’équipe <strong>du</strong> « Plan <strong>de</strong> Rome » que nous nous appuierons<br />
pour montrer combi<strong>en</strong> la réalité virtuelle est un outil précieux pour restituer les civilisations<br />
antiques. Le choix <strong>de</strong> se fon<strong>de</strong>r sur cette expéri<strong>en</strong>ce se justifie à maints égards. En premier<br />
lieu, rattachée au laboratoire, nous sommes am<strong>en</strong>ée à côtoyer l’équipe <strong>de</strong> près et à cerner<br />
les métho<strong>de</strong>s <strong>de</strong> travail qui sont les si<strong>en</strong>nes. En second lieu, la démarche s’inscrit dans une<br />
continuité sci<strong>en</strong>tifique et technique, qui est intéressante à analyser. En troisième lieu, se pro-<br />
e<br />
posant <strong>de</strong> restituer la Rome <strong>du</strong> IV siècle après J.-C., la reconstitution virtuelle est, d’une <strong>par</strong>t,<br />
am<strong>en</strong>ée à opérer <strong>de</strong>s choix urbanistiques inscrits dans un temps, à l’échelle d’une ville – capitale<br />
<strong>de</strong> surcroît – ce qui r<strong>en</strong>d la tâche pour le moins complexe ; d’autre <strong>par</strong>t, elle est confrontée<br />
à la question <strong>de</strong>s sources pour fon<strong>de</strong>r ses choix. En <strong>de</strong>rnier lieu, c’est peut-être <strong>du</strong> reste<br />
l’ess<strong>en</strong>tiel pour notre projet, le <strong>par</strong>ti a été pris <strong>de</strong> ne pas cantonner le travail <strong>de</strong> recherche<br />
aux arcanes universitaires mais au contraire <strong>de</strong> le faire <strong>par</strong>tager à un public, sans ri<strong>en</strong> abandonner<br />
<strong>de</strong> la rigueur sci<strong>en</strong>tifique.<br />
e<br />
<strong>La</strong> reconstitution virtuelle <strong>de</strong> la Rome antique <strong>du</strong> IV siècle après J.-C. est une <strong>en</strong>treprise<br />
270<br />
qui trouve sa source dans un lointain passé. Paul Bigot , architecte normand, 1 er Grand<br />
Prix <strong>de</strong> Rome <strong>en</strong> 1900, œuvra près d’un <strong>de</strong>mi siècle sur la reconstitution <strong>en</strong> relief <strong>de</strong> la Ville.<br />
Son héritier, H<strong>en</strong>ri Bernard a légué la maquette à l’<strong>Université</strong> <strong>de</strong> Ca<strong>en</strong>, qui l’abrite <strong>de</strong>puis<br />
1995 au cœur <strong>de</strong> la Maison <strong>de</strong> la Recherche <strong>en</strong> Sci<strong>en</strong>ces Humaines (MRSH). Depuis cette date,<br />
l’équipe <strong>du</strong> « Plan <strong>de</strong> Rome » travaille sur une modélisation <strong>de</strong> la Ville à la même époque,<br />
laquelle marque l’apogée <strong>de</strong> la Rome monum<strong>en</strong>tale. <strong>La</strong> démarche est claire : « <strong>La</strong> maquette<br />
virtuelle ne remplace pas l’objet <strong>de</strong> plâtre, elle le complète : elle permet la visite intérieure<br />
<strong>de</strong>s bâtim<strong>en</strong>ts, la représ<strong>en</strong>tation <strong>du</strong> fonctionnem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s systèmes mécaniques […], elle peut<br />
comporter diverses strates chronologiques montrant l’évolution <strong>de</strong> l’urbanisation, elle peut<br />
être corrigée <strong>en</strong> fonction <strong>du</strong> progrès <strong>de</strong> la connaissance ou montrer simultaném<strong>en</strong>t plusieurs<br />
271<br />
hypothèses » . Ce sont là, <strong>en</strong> effet, énumérés tous les avantages que procure la modélisation<br />
<strong>de</strong> la maquette sur son aïeule.<br />
Peut-être pouvons-nous imaginer que ces complém<strong>en</strong>ts cach<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s désagrém<strong>en</strong>ts.<br />
Or, il n’<strong>en</strong> est ri<strong>en</strong> : aujourd’hui, grâce à la stéréoscopie, c’est même l’impression <strong>de</strong> volume<br />
qui est donnée au visiteur. <strong>La</strong> virtualisation prés<strong>en</strong>te <strong>en</strong>core quelques lacunes pour imiter<br />
la réalité : dans le schéma s<strong>en</strong>soriel, seule la vue est considérée. « L’équipe s’ori<strong>en</strong>te vers la<br />
272<br />
création d’ambiances sonores pour accompagner l’immersion » . On touche au but espéré<br />
<strong>par</strong> Jean-Clau<strong>de</strong> Golvin visant à redonner <strong>de</strong> la vie aux civilisations dis<strong>par</strong>ues. C’est même<br />
<strong>en</strong> l’occurr<strong>en</strong>ce aller au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> cette ambition, puisque l’évolution urbanistique d’une ville<br />
comme Rome a effacé les ruines, donnant naissance à d’autres époques, à d’autres formes<br />
<strong>de</strong> vie.<br />
Si l’on relève les quatre argum<strong>en</strong>ts listés <strong>par</strong> Philippe Fleury, justifiant la conception d’une<br />
maquette virtuelle, on compr<strong>en</strong>d que chacun d’eux, loin <strong>de</strong> nier l’œuvre <strong>de</strong> Paul Bigot, constitue<br />
un apport au travail initié <strong>par</strong> l’architecte. Ce <strong>de</strong>rnier n’aurait <strong>en</strong> ri<strong>en</strong> dénoncé la démarche<br />
<strong>de</strong> l’équipe. Il s’était lui-même <strong>en</strong>gagé dans une œuvre novatrice puisque, les architectes<br />
269. Jean-Clau<strong>de</strong> Golvin, L’Antiquité retrouvée,<br />
Paris, Errance, 2005, 189 pages.<br />
270. Lire sur la vie et l’œuvre <strong>de</strong> Paul Bigot (1870-1942), Manuel Royo, Rome et l’architecte, Conception et<br />
esthétique <strong>du</strong> plan-relief <strong>de</strong> Paul Bigot,<br />
Ca<strong>en</strong>, PUC, 2006, 212 pages.<br />
271. Philippe Fleury (dir.), <strong>La</strong> Rome antique, plan relief et reconstitution virtuelle,<br />
Ca<strong>en</strong>, PUC, 2005, p. 10.<br />
e<br />
272. Philippe Fleury et Sophie Ma<strong>de</strong>leine, « Réalité virtuelle et restitution <strong>de</strong> la Rome antique au IV siècle<br />
après J.-C. », Histoire urbaine,<br />
18, 2007, p. 167.<br />
Schedae,<br />
2008, prépublication n°10, (p. 1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf
Grand Prix <strong>de</strong> Rome procédai<strong>en</strong>t, <strong>de</strong> coutume, à la restitution <strong>de</strong> planches archéologiques, <strong>en</strong><br />
utilisant les techniques graphiques. Son relief fut « conçu comme un bilan <strong>du</strong> savoir archéologique<br />
disponible à l’époque <strong>de</strong> son créateur » 273 . Son plan <strong>de</strong> Rome « est le témoin <strong>de</strong>s<br />
transformations qui touch<strong>en</strong>t l’exercice académique <strong>du</strong> Prix <strong>de</strong> Rome ainsi que <strong>de</strong>s avancées<br />
contemporaines <strong>de</strong> l’archéologie romaine. D’autre <strong>par</strong>t, il pr<strong>en</strong>d acte <strong>de</strong> la perception nouvelle<br />
<strong>de</strong> l’espace urbain et <strong>de</strong>s monum<strong>en</strong>ts au tournant <strong>du</strong> XX e siècle. Il est <strong>en</strong>fin prétexte,<br />
pour Paul Bigot lui-même, à <strong>de</strong> nombreux comm<strong>en</strong>taires explicatifs » 274 .<br />
Ainsi que le note Philippe Fleury, « sa <strong>valeur</strong> sci<strong>en</strong>tifique est naturellem<strong>en</strong>t datée : la<br />
maquette <strong>de</strong> Paul Bigot représ<strong>en</strong>te l’état <strong>de</strong>s connaissances historiques et archéologiques<br />
avant la Secon<strong>de</strong> Guerre Mondiale » 275 , mais elle est une base <strong>de</strong> travail, un « fon<strong>de</strong>m<strong>en</strong>t » 276 .<br />
Le plan-relief <strong>de</strong>meure une référ<strong>en</strong>ce 277 . Dans son intro<strong>du</strong>ction, Sophie Ma<strong>de</strong>leine m<strong>en</strong>tionnet-elle<br />
les représ<strong>en</strong>tations <strong>de</strong> Paul Bigot, à propos <strong>du</strong> théâtre <strong>de</strong> Pompée :<br />
Seuls P. Bigot et I. Gismondi s’y sont intéressés pour le faire figurer sur leur maquette respective<br />
représ<strong>en</strong>tant la Rome <strong>du</strong> IVe siècle p.C., <strong>en</strong> pr<strong>en</strong>ant cette fois <strong>en</strong> compte l’<strong>en</strong>semble <strong>du</strong> complexe.<br />
Tous <strong>de</strong>ux ont représ<strong>en</strong>té le temple <strong>de</strong> Vénus Victrix avec une absi<strong>de</strong>, conformém<strong>en</strong>t aux indications<br />
<strong>de</strong> V. Baltard et <strong>de</strong> L. Canina, mais ni l’un ni l’autre n’ont représ<strong>en</strong>té les ae<strong>de</strong>s d’Honos, Virtus<br />
et Felicitas. De même, chacun a restitué trois étages au mur <strong>de</strong> scène, comme l’avait proposé<br />
V. Baltard, ce qui semble être un choix pertin<strong>en</strong>t. Par contre, là où I. Gismondi a choisi <strong>de</strong> faire<br />
ap<strong>par</strong>aître un escalier monum<strong>en</strong>tal d’accès au temple <strong>de</strong> Vénus, P. Bigot s’est cont<strong>en</strong>té <strong>de</strong> faire<br />
figurer <strong>de</strong>s gradins, comme nous l’avons égalem<strong>en</strong>t postulé […]. P. Bigot a choisi d’insérer dans<br />
le portique <strong>de</strong>s bosquets <strong>de</strong> platanes, m<strong>en</strong>tionnés <strong>par</strong> Properce, <strong>en</strong> ordre assez confus, alors<br />
qu’I. Gismondi a fait figurer <strong>de</strong>ux portiques, <strong>en</strong> suivant certainem<strong>en</strong>t une mauvaise interprétation<br />
d’un texte <strong>de</strong> l’Histoire d’Auguste sous Carin. Nous verrons que notre hypothèse se dégage <strong>de</strong><br />
ces <strong>de</strong>ux représ<strong>en</strong>tations […].<br />
<strong>La</strong> démarche luci<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’architecte faisait-elle davantage <strong>de</strong> son plan-relief une source<br />
pour les recherches à v<strong>en</strong>ir qu’une œuvre d’art sacrée et intouchable, un dogme. C’est cet<br />
outil que l’équipe <strong>du</strong> « Plan <strong>de</strong> Rome » s’est approprié. <strong>La</strong> visite virtuelle permet une nouvelle<br />
forme <strong>de</strong> représ<strong>en</strong>tation <strong>de</strong> l’espace, un espace pénétrable, plus <strong>en</strong>core, un espace<br />
<strong>en</strong> abyme, que le volume ne contraint pas, tout au moins <strong>du</strong> point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong> la perception.<br />
L’idée <strong>de</strong> la visite guidée est inhér<strong>en</strong>te à l’œuvre <strong>de</strong> Paul Bigot. <strong>La</strong> vue d’<strong>en</strong>semble incite à<br />
la visite et l’objet fut réalisé comportant <strong>de</strong>s notices explicatives. Son objectif premier était<br />
bi<strong>en</strong> celui <strong>de</strong> <strong>de</strong>v<strong>en</strong>ir un gui<strong>de</strong>. En ce s<strong>en</strong>s, les visites <strong>du</strong> Plan <strong>de</strong> Rome s’inscriv<strong>en</strong>t-elles dans<br />
la stricte continuité <strong>de</strong> la démarche <strong>du</strong> concepteur <strong>de</strong> la maquette, qu’il s’agisse <strong>de</strong>s visites<br />
à <strong>de</strong>stination <strong>de</strong>s scolaires ou <strong>de</strong>s toutes réc<strong>en</strong>tes « Nocturnes <strong>du</strong> Plan <strong>de</strong> Rome » 278 .<br />
Pr<strong>en</strong>ons un exemple pour illustrer l’apport <strong>de</strong> la visite virtuelle non seulem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> termes<br />
<strong>de</strong> construction <strong>de</strong>s savoirs mais aussi <strong>de</strong> leur <strong>par</strong>tage. <strong>La</strong> restitution <strong>de</strong>s rues sur la maquette<br />
<strong>de</strong> plâtre <strong>en</strong> fait <strong>de</strong>s espaces <strong>de</strong> sé<strong>par</strong>ations, comme <strong>de</strong>s bornes <strong>en</strong> creux qui permett<strong>en</strong>t aux<br />
monum<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> se détacher les uns <strong>de</strong>s autres à la vue <strong>de</strong>s spectateurs. Ce sont les monum<strong>en</strong>ts,<br />
<strong>en</strong> tant que grands <strong>en</strong>sembles 279 , qui sont représ<strong>en</strong>tés. <strong>La</strong> proposition faite est celle<br />
273. Manuel Royo, Rome et l’architecte, Conception et esthétique <strong>du</strong> plan-relief <strong>de</strong> Paul Bigot, Ca<strong>en</strong>, PUC,<br />
2006, p. 41<br />
274. Ibid., p. 13.<br />
275. Philippe Fleury (dir.), <strong>La</strong> Rome antique, plan relief et reconstitution virtuelle, Ca<strong>en</strong>, PUC, 2005, p. 9.<br />
276. Ibid., p. 9.<br />
277. Sophie Ma<strong>de</strong>leine, Le complexe pompéi<strong>en</strong> <strong>du</strong> Champ <strong>de</strong> Mars, une ville dans la Ville, reconstitution virtuelle<br />
d’un théâtre à arca<strong>de</strong>s et à portique au IV e siècle p. C., Thèse <strong>de</strong> Doctorat, 4 vol., <strong>Université</strong> <strong>de</strong> Ca<strong>en</strong><br />
Basse-Normandie, 2006, p. 17.<br />
278. Depuis janvier 2007, chaque premier mercredi <strong>du</strong> mois, une visite virtuelle <strong>en</strong> immersion et <strong>en</strong> stéréoscopie<br />
est proposée au grand public, selon une déclinaison thématique (les basiliques, les rues, etc.).<br />
279. 102 mo<strong>du</strong>les <strong>de</strong> plâtre constitu<strong>en</strong>t l’<strong>en</strong>semble <strong>de</strong> la maquette.<br />
Schedae, 2008, prépublication n°10, (p.1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf<br />
65
66<br />
d’un espace urbanistique, point <strong>de</strong> vue tout à fait déf<strong>en</strong>dable pour un architecte. Ceci réalisé,<br />
on peut <strong>en</strong>visager grâce aux technologies nouvelles d’approfondir le niveau <strong>de</strong> perception.<br />
<strong>La</strong> maquette virtuelle permet un tout autre point <strong>de</strong> vue. D’une <strong>par</strong>t, grâce à l’immersion,<br />
la ville re<strong>de</strong>vi<strong>en</strong>t à hauteur d’homme. L’avatar qui se promène n’a plus une vue <strong>en</strong> plongée,<br />
directe ou oblique, omnisci<strong>en</strong>t, <strong>de</strong>s bâtim<strong>en</strong>ts, voulue <strong>par</strong> Paul Bigot pour son plan relief.<br />
Il est dans la rue. Nécessairem<strong>en</strong>t, c’est aussi le point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong> celui qui conçoit sci<strong>en</strong>tifiquem<strong>en</strong>t<br />
la déambulation qui se trouve modifié.<br />
<strong>La</strong> maison <strong>de</strong>vi<strong>en</strong>t un lieu d’habitation qui confronte <strong>en</strong> quelque sorte le chercheur aux<br />
problèmes <strong>de</strong> son aménagem<strong>en</strong>t. Lorsque l’avatar pénètre dans l’insula, gravit un étage,<br />
atteint un long et sombre corridor, la question <strong>de</strong> l’éclairage alors. On ne peut plus guère se<br />
cont<strong>en</strong>ter <strong>de</strong> <strong>par</strong>ler <strong>de</strong> la promiscuité <strong>de</strong>s habitations, <strong>de</strong> leur insalubrité sans se <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r<br />
ce que cela pouvait recouvrir comme réalité au IVe siècle. Les fragm<strong>en</strong>ts retrouvés sur les murs<br />
<strong>de</strong> certaines maisons serv<strong>en</strong>t alors <strong>de</strong> base pour donner une texture, <strong>du</strong> point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong><br />
l’infographiste, mais surtout un cadre <strong>de</strong> vie, pour les contemporains. C’est ce que Jean-<br />
Clau<strong>de</strong> Golvin rev<strong>en</strong>dique comme <strong>de</strong>s espaces vécus avant qu’ils ne <strong>de</strong>vinss<strong>en</strong>t ruines et dont<br />
il faut restituer les palpitations. <strong>La</strong> visite virtuelle, <strong>en</strong> immersion et <strong>en</strong> stéréoscopie permet<br />
cette nouvelle acception <strong>de</strong> la réalité <strong>de</strong> l’espace vécu.<br />
L’intérêt pédagogique d’une telle <strong>en</strong>treprise est indéniable. <strong>La</strong> maquette <strong>de</strong> Paul Bigot<br />
offrait déjà aux <strong>en</strong>seignants d’histoire et <strong>de</strong> latin une précieuse et instructive t<strong>en</strong>tative <strong>de</strong><br />
reconstitution d’un espace vécu, grâce à la vision d’<strong>en</strong>semble qu’elle offre aux yeux <strong>du</strong><br />
spectateur. Grâce à la maquette virtuelle et à la focalisation interne, l’id<strong>en</strong>tification <strong>de</strong>vi<strong>en</strong>t<br />
possible. L’Antiquité s’inscrit alors dans un rapport spatio-temporel intelligible pour le visiteur,<br />
curieux ou appr<strong>en</strong>ant. Il nous semble que, sur ce point, l’avancée proposée <strong>par</strong> la réalité<br />
virtuelle est considérable, ce qui r<strong>en</strong>force d’autant l’impati<strong>en</strong>ce manifestée plus haut<br />
dans le texte <strong>de</strong> voir les visites virtuelles se charger <strong>de</strong> données s<strong>en</strong>sorielles. Du reste le<br />
succès remporté <strong>par</strong> les travaux <strong>de</strong> l’équipe ne peuv<strong>en</strong>t que la conforter dans ses choix :<br />
les succès populaires <strong>de</strong>s Journées <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong> ou <strong>de</strong>s Nocturnes <strong>du</strong> Plan <strong>de</strong> Rome<br />
montr<strong>en</strong>t que l’Antiquité romaine tardive, traitée <strong>par</strong> la réalité virtuelle, est susceptible <strong>de</strong><br />
drainer un public large nombreux et hétérogène, non spécialiste tandis que la prés<strong>en</strong>ce <strong>de</strong><br />
Philippe Fuchs au colloque Virtualia <strong>du</strong> mois <strong>de</strong> mai 2007, à la MRSH, est un signe fort <strong>de</strong><br />
la crédibilité accordée aux travaux réalisés. <strong>La</strong> fréqu<strong>en</strong>tation <strong>du</strong> site Internet <strong>en</strong> est une<br />
autre manifestation : une progression constante qui dépasse <strong>en</strong> 2006 les <strong>de</strong>ux millions <strong>de</strong><br />
connexions pour l’année.<br />
Le « Plan <strong>de</strong> Rome » représ<strong>en</strong>te, <strong>en</strong> somme, l’exemple type <strong>de</strong> ce que l’on est <strong>en</strong> droit<br />
d’att<strong>en</strong>dre <strong>de</strong> la réalité virtuelle au service <strong>de</strong> la <strong>mise</strong> <strong>en</strong> <strong>valeur</strong> <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong> – ici à <strong>de</strong>ux<br />
niveaux : la Rome antique <strong>en</strong> tant que telle et sa restitution <strong>par</strong> Paul Bigot sous la forme d’une<br />
maquette <strong>en</strong> plâtre – soit une démarche sci<strong>en</strong>tifique qui place les sources et leur confrontation<br />
au premier plan, une démarche empirique qui se nourrit <strong>de</strong>s avancées <strong>de</strong> la recherche<br />
et qui les intègre à ses propres travaux, une démarche pluridisciplinaire qui considère toute<br />
contribution comme un progrès, <strong>en</strong>fin une démarche humaniste <strong>de</strong> transmission <strong>du</strong> savoir,<br />
auprès <strong>de</strong>s spécialistes comme <strong>de</strong>s amateurs. C’est dans ce sillage que nous souhaitons<br />
inscrire notre propre étu<strong>de</strong>.<br />
<strong>La</strong> restitution virtuelle <strong>de</strong> l’église Notre-Dame <strong>de</strong> Saint-Lô<br />
et sa valorisation<br />
Saint-Lô, une terre <strong>de</strong> <strong>patrimoine</strong> <strong>en</strong>tre histoire et mémoire<br />
Nous avons déjà noté la difficulté d’écrire une histoire <strong>de</strong> la ville <strong>de</strong> Saint-Lô compte<br />
t<strong>en</strong>u <strong>de</strong> la dis<strong>par</strong>ition <strong>de</strong> la quasi totalité <strong>de</strong>s sources <strong>en</strong> 1944. Cep<strong>en</strong>dant, nous disposons<br />
<strong>de</strong> quelques ouvrages, qui ont permis à la mémoire <strong>de</strong> se perpétuer. Ce sont <strong>en</strong> <strong>par</strong>ticulier<br />
Schedae, 2008, prépublication n°10, (p. 1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf
les livres <strong>de</strong> Toustain <strong>de</strong> Billy et <strong>du</strong> chanoine Houël 280 qui nous permett<strong>en</strong>t, ici, <strong>de</strong> brosser<br />
à grands traits une Histoire <strong>de</strong> Saint-Lô et <strong>de</strong> ses <strong>en</strong>virons. Même si l’objectif n’est pas <strong>de</strong><br />
pro<strong>du</strong>ire une étu<strong>de</strong> exhaustive <strong>de</strong> la ville, il ap<strong>par</strong>aît nécessaire <strong>de</strong> se p<strong>en</strong>cher sur son Histoire,<br />
pour <strong>de</strong>ux raisons principales, liées à la nature même <strong>de</strong> l’objet <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong>. D’une <strong>par</strong>t,<br />
les premières sources attestant l’exist<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> l’église Notre-Dame remont<strong>en</strong>t au XI e siècle, ce<br />
qui l’inscrit dans une tradition longue. D’autre <strong>par</strong>t, une église ap<strong>par</strong>ti<strong>en</strong>t à une <strong>par</strong>oisse : au<strong>de</strong>là<br />
<strong>du</strong> bâtim<strong>en</strong>t, elle est un lieu <strong>de</strong> vie pour toute une population. L’église, construite au cœur<br />
<strong>de</strong> la ville s’étoffe <strong>en</strong> gagnant sur l’espace urbain tandis qu’elle vit et souffre au rythme <strong>de</strong>s<br />
aléas <strong>de</strong> l’histoire <strong>de</strong> la ville. En ce s<strong>en</strong>s, elle <strong>en</strong> offre un reflet fiable, comme nous allons le voir.<br />
D’autres argum<strong>en</strong>ts abond<strong>en</strong>t dans ce s<strong>en</strong>s et vi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t légitimer la <strong>mise</strong> <strong>en</strong> contexte<br />
<strong>de</strong> l’édifice. Dans la stricte ligne <strong>de</strong> ce qui précè<strong>de</strong>, on peut mesurer toute la dim<strong>en</strong>sion<br />
symbolique <strong>de</strong> l’édifice lors <strong>de</strong> sa <strong>de</strong>struction p<strong>en</strong>dant la Secon<strong>de</strong> Guerre Mondiale. Les<br />
flèches comme les cloches <strong>de</strong> Notre-Dame avai<strong>en</strong>t été un li<strong>en</strong> presque organique avec les<br />
Saint-lois. Nous l’étudierons ci-après <strong>en</strong> détail. À cela, il faut ajouter que c’est l’étu<strong>de</strong> <strong>du</strong><br />
<strong>patrimoine</strong> qui gui<strong>de</strong> notre projet <strong>de</strong> recherche : celui-ci se construit dans un espace, dont<br />
il convi<strong>en</strong>t <strong>de</strong> retracer les étapes ess<strong>en</strong>tielles, pour bi<strong>en</strong> <strong>en</strong> compr<strong>en</strong>dre la portée. <strong>La</strong> contextualisation<br />
est un outil précieux pour une approche s<strong>en</strong>sible et réaliste dans un projet <strong>de</strong><br />
reconstitution virtuelle. Enfin, nous avancerons un <strong>de</strong>rnier argum<strong>en</strong>t visant à contrer l’idée<br />
selon laquelle la ville <strong>de</strong> Saint-Lô n’existerait d’une certaine manière aujourd’hui que <strong>par</strong>ce<br />
qu’elle a subi les outrages <strong>de</strong> la guerre et que ce serait dans l’œuvre <strong>de</strong> reconstruction qu’elle<br />
trouverait une id<strong>en</strong>tité propre et les grâces <strong>de</strong> l’Histoire.<br />
Fig. 4 : Place Notre-Dame un jour <strong>de</strong> marché<br />
(Source : Archives dé<strong>par</strong>tem<strong>en</strong>tales <strong>de</strong> la Manche, 6Fi5021921)<br />
D’après les Comm<strong>en</strong>taires sur la Guerre <strong>de</strong>s Gaules 281 , la ville, qui portait alors le nom <strong>de</strong><br />
Briovère, Briovera, « Pont sur la Vire » <strong>en</strong> langue celtique, fut conquise <strong>en</strong> 56 avant J.-C. À <strong>en</strong><br />
croire le chanoine Houël, l’exist<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> Saint-Lô/Briovère est attestée pour la première fois, <strong>de</strong><br />
façon fiable, au IV e siècle <strong>de</strong> notre ère 282 . Quelques vestiges <strong>de</strong> la pério<strong>de</strong> gallo-romaine<br />
280. Voir les référ<strong>en</strong>ces bibliographiques <strong>en</strong> fin <strong>de</strong> volume.<br />
281. Jules César, Comm<strong>en</strong>taires sur la Guerre <strong>de</strong>s Gaules, III, 17.<br />
282. « Il serait impossible <strong>de</strong> <strong>par</strong>ler <strong>de</strong> Saint-Lo d’une manière un peu précise avant le IV e siècle », Chanoine<br />
Houël, Histoire <strong>de</strong> la ville <strong>de</strong> Saint-Lô, 1992, Paris, Res Universis, p. 4.<br />
Schedae, 2008, prépublication n°10, (p.1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf<br />
67
68<br />
ont été trouvés 283 , mais ri<strong>en</strong> ne semble attester d’un site économiquem<strong>en</strong>t ou stratégiquem<strong>en</strong>t<br />
important. Nous avons souhaité repro<strong>du</strong>ire ci-<strong>de</strong>ssous le passage qui raconte les<br />
débuts <strong>de</strong> la ville. Rédigé dans un style très fleuri, il r<strong>en</strong>d compte <strong>de</strong>s débuts supposés <strong>de</strong><br />
la ville, tout <strong>en</strong> rappelant à la raison ceux qui se targu<strong>en</strong>t <strong>de</strong> débuts flamboyants 284 . <strong>La</strong> citation<br />
vi<strong>en</strong>t appuyer les propos qui précèd<strong>en</strong>t et qui déf<strong>en</strong>d<strong>en</strong>t la longue tradition d’une ville<br />
fière d’elle-même :<br />
Si c’est un honneur pour les villes, comme pour les familles, d’étaler une origine qui se perd dans<br />
la nuit <strong>de</strong>s temps, et que pour obt<strong>en</strong>ir ce précieux avantage, on ait porté la fureur jusqu’à <strong>de</strong>s<br />
querelles sanglantes, je suis loin <strong>de</strong> ces idées, et je reconnais sans peine que la ville qui m’a vu<br />
naître doit r<strong>en</strong>oncer à l’orgueil d’une haute antiquité 285 .<br />
L’argum<strong>en</strong>t <strong>de</strong> Houël disant qu’« on ne donne point ordinairem<strong>en</strong>t le nom d’un lieu <strong>de</strong><br />
passage à une place <strong>de</strong> quelqu’importance » 286 est recevable pour justifier <strong>du</strong> peu d’éclat <strong>de</strong><br />
la ville avant le V e siècle. C’est <strong>en</strong> 525 que celui qui allait donner son nom à la ville, Lô, fut<br />
élu évêque, <strong>par</strong> « les vieux Chréti<strong>en</strong>s, réunis <strong>en</strong> chapitre à Coutances » 287 , à l’âge <strong>de</strong> douze<br />
ans. Visiblem<strong>en</strong>t doué et volontaire :<br />
et :<br />
Il acheva <strong>de</strong> convertir les habitans <strong>de</strong> son diocèse,<br />
P<strong>en</strong>dant quarante ans il prêcha toutes les vertus, dont il donna l’exemple. Il eut pu passer pour<br />
un Saint, même sans le secours <strong>de</strong>s miracles qui lui sont attribués 288 .<br />
De la pério<strong>de</strong> qui suit, on ne sait pas grand-chose. <strong>La</strong> ville <strong>de</strong>vait battre monnaie puisque<br />
l’on a retrouvé un tri<strong>en</strong>s portant la m<strong>en</strong>tion brioviri. C’est sous le règne <strong>de</strong> Charlemagne<br />
que la ville fut fortifiée, pour la protéger <strong>de</strong>s invasions. Toustain <strong>de</strong> Billy rapporte les vers<br />
<strong>de</strong> Robert le Roquez qui le m<strong>en</strong>tionn<strong>en</strong>t 289 . <strong>La</strong> situation n’<strong>en</strong> <strong>de</strong>meura pas moins fragile et<br />
les invasions Viking ravagèr<strong>en</strong>t le Cot<strong>en</strong>tin au IX e siècle. Saint-Lô fut assiégée, affamée et<br />
assoiffée <strong>en</strong> 889 : protégée <strong>par</strong> ses rem<strong>par</strong>ts, la ville refusait <strong>de</strong> se r<strong>en</strong>dre. Les habitants fur<strong>en</strong>t<br />
massacrés et les rares survivants ré<strong>du</strong>its <strong>en</strong> esclavage. D’abord transporté <strong>de</strong> Coutances à<br />
Saint-Lô, l’évêché s’installa finalem<strong>en</strong>t à Rou<strong>en</strong>. Ce n’est qu’<strong>en</strong> 1025 qu’il fut rétabli à Saint-Lô,<br />
<strong>par</strong> l’évêque Herbert, et que les murailles fur<strong>en</strong>t reconstruites. Notre-Dame, alors simple<br />
chapelle Sainte-Marie <strong>du</strong> Château, <strong>de</strong>vint une <strong>par</strong>oisse.<br />
Des temps plus prospères s’annonçai<strong>en</strong>t, pourtant, qui permir<strong>en</strong>t à la ville <strong>de</strong> se développer<br />
économiquem<strong>en</strong>t. « L’état prospère <strong>du</strong> <strong>du</strong>ché, le succès <strong>de</strong> ses armes, y avait fait refleurir<br />
le commerce à l’ombre <strong>de</strong> ses lauriers » 290 dit le chanoine Houël. « Le premier g<strong>en</strong>re d’in<strong>du</strong>strie<br />
qui se fit remarquer à Saint-Lô, fut son orfèvrerie » ajoute-t-il, précisant que Mathil<strong>de</strong>,<br />
épouse <strong>de</strong> Guillaume le Conquérant, aurait doté l’abbaye <strong>de</strong> la Trinité 291 <strong>de</strong> Ca<strong>en</strong> <strong>de</strong> coupes<br />
283. Vestiges d’habitations, quelques tuiles à rebord, ainsi que <strong>de</strong>s ust<strong>en</strong>siles.<br />
284. « Un manuscrit fort intéressant n’estime pas cette ville aussi anci<strong>en</strong>ne que voudrai<strong>en</strong>t le faire croire le<br />
grand nombre <strong>de</strong> ceux qui préfèr<strong>en</strong>t copier une erreur que <strong>de</strong> la vérifier » écrit-il <strong>de</strong> manière caustique.<br />
285. Ibid., p. 6.<br />
286. Ibid., p. 4.<br />
287. Ibid., p. 10.<br />
288. Ibid., p. 11<br />
289. « Construire il fist, sur roche divisée une cité Sainte-Croix appelée, qui maint<strong>en</strong>ant <strong>de</strong> Saint-Lô ti<strong>en</strong>t le<br />
nom, ville moult forte et d’antique r<strong>en</strong>om ».<br />
290. Chanoine Houël, Histoire <strong>de</strong> la ville <strong>de</strong> Saint-Lô, 1992, Paris, Res Universis, p. 26.<br />
291. Aujourd’hui l’abbaye aux Dames.<br />
Schedae, 2008, prépublication n°10, (p. 1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf
et <strong>de</strong> chan<strong>de</strong>liers fabriqués à Saint-Lô. <strong>La</strong> ville, qui connut <strong>de</strong> nouveaux soubresauts politiques<br />
après la mort <strong>de</strong> Guillaume le Conquérant, se soumit à Philippe-Auguste <strong>en</strong> 1204. <strong>La</strong><br />
pério<strong>de</strong> qui suivit la couvrit <strong>de</strong>s largesses <strong>de</strong> ses bi<strong>en</strong>faiteurs. Les bourgeois <strong>de</strong> la ville fir<strong>en</strong>t<br />
bâtir l’hôtel-Dieu, l’église Notre-Dame vit ériger sa tour nord <strong>en</strong> 1297.<br />
Depuis la réunion <strong>de</strong> la Normandie à la couronne <strong>de</strong> France, jusque vers le milieu <strong>du</strong> XIVe siècle,<br />
le repos <strong>de</strong> la province ne fut troublé que <strong>par</strong> quelques divisions <strong>par</strong>ticulières et Saint-Lô ne prés<strong>en</strong>te<br />
pas ost<strong>en</strong>siblem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> faits dignes <strong>de</strong> mémoires, puisque la r<strong>en</strong>ommée n’a point eu la voix<br />
assez forte pour les faire <strong>par</strong>v<strong>en</strong>ir jusqu’à nous 292 .<br />
Il fait référ<strong>en</strong>ce ici à la décapitation <strong>en</strong> place <strong>de</strong> Grève <strong>de</strong> seigneurs normands, Perci,<br />
Bacon, soupçonnés <strong>de</strong> favoriser le <strong>par</strong>ti anglais <strong>de</strong> Go<strong>de</strong>froy <strong>de</strong> Harcourt. <strong>La</strong> région, prise<br />
dans les affres <strong>de</strong> la guerre <strong>de</strong> C<strong>en</strong>t ans, ne <strong>de</strong>vait jouir que peu <strong>de</strong> temps <strong>de</strong> cette situation<br />
<strong>de</strong> paix. Harcourt, mais les sources diverg<strong>en</strong>t, aurait échappé au supplice et serait rev<strong>en</strong>u<br />
v<strong>en</strong>ger ses <strong>par</strong>tisans aux côtés <strong>de</strong> Édouard III. Ce <strong>de</strong>rnier ravagea le Cot<strong>en</strong>tin, pillant la ville<br />
<strong>de</strong> Saint-Lô après avoir débarqué à Saint-Vaast-la-Hougue, <strong>en</strong> 1344. Elle fut <strong>en</strong> outre ravagée<br />
<strong>par</strong> la peste <strong>de</strong> 1347.<br />
Le XVI e siècle ne livra pas davantage <strong>de</strong> calme à la ville pour <strong>par</strong>tie passée au protestantisme.<br />
Un moine nommé Solaire, ne trouvant pas les divisions assez gran<strong>de</strong>s, les augm<strong>en</strong>ta <strong>par</strong> tous<br />
les sacrifices que peut suggérer un zèle ard<strong>en</strong>t, qui ne repose pas uniquem<strong>en</strong>t sur le désir <strong>de</strong><br />
répandre <strong>de</strong>s vérités éternelles, il s’intro<strong>du</strong>isit dans les maisons les plus considérables <strong>de</strong> la ville,<br />
y propagea ses doctrines ; mais bi<strong>en</strong>tôt forcé d’<strong>en</strong> sortir, il alla établir son prêche <strong>du</strong> côté <strong>de</strong><br />
Moncoq, dans un lieu nommé la Grotte <strong>du</strong> serp<strong>en</strong>t, qui se trouve presque vis-à-vis le château<br />
d’Agnaux ; il <strong>en</strong>traîna la majeure <strong>par</strong>tie <strong>de</strong>s esprits vers la réforme ; ils n’y étai<strong>en</strong>t déjà que trop<br />
bi<strong>en</strong> exposés ; l’indiscipline et l’ignorance <strong>du</strong> clergé, la vénalité <strong>de</strong>s bénéfices, la simonie, le<br />
dérèglem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s religieux, avai<strong>en</strong>t éloigné le peuple <strong>de</strong> tout ce qui ti<strong>en</strong>t au sacerdoce et pré<strong>par</strong>é<br />
les funestes événem<strong>en</strong>ts qui <strong>en</strong> fur<strong>en</strong>t la suite 293 .<br />
L’année 1562 fut marquée <strong>par</strong> <strong>de</strong>s troubles graves. Ayant pris la ville, les Hugu<strong>en</strong>ots<br />
fir<strong>en</strong>t « abattre les images <strong>du</strong> <strong>de</strong>dans <strong>de</strong> l’église et <strong>du</strong> portail <strong>de</strong> Nôtre-Dame », dit André<br />
Dupont dans ses Héphéméri<strong>de</strong>s. Ils s’<strong>en</strong> prir<strong>en</strong>t à l’évêque <strong>de</strong> Coutances, Artus <strong>de</strong> Cossé,<br />
qu’ils exhibèr<strong>en</strong>t dans les rues <strong>de</strong> Saint-Lô, monté sur un âne et couvert d’une mitre <strong>de</strong> papier.<br />
Pourtant le quotidi<strong>en</strong> semble avoir été moins marqué d’horreurs et l’on pourrait dire que<br />
d’une certaine façon les fidèles <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux confessions vécur<strong>en</strong>t <strong>en</strong> bonne intellig<strong>en</strong>ce :<br />
Les catholiques et les protestans se <strong>par</strong>tagèr<strong>en</strong>t l’église Notre-Dame pour y exercer chacun leur<br />
culte ; on y célébrait souv<strong>en</strong>t <strong>en</strong> même temps l’office d’un côté, et <strong>de</strong> l’autre <strong>de</strong>s cérémonies<br />
protestantes. S’il fallait <strong>en</strong> croire même une tradition populaire, on ne vit jamais plus <strong>de</strong> déc<strong>en</strong>ce<br />
régner dans le service divin : il y avait une émulation <strong>de</strong> ferveur 294 .<br />
Logiquem<strong>en</strong>t, à la même époque, fut diffusée la première œuvre d’imprimerie, une Bible<br />
<strong>en</strong> langue vulgaire. En 1574, p<strong>en</strong>dant plus d’un mois, la ville connut <strong>de</strong> nouveau <strong>de</strong>s troubles<br />
d’une gran<strong>de</strong> viol<strong>en</strong>ce. Saint-Lô sortit affaiblie <strong>de</strong>s Guerres <strong>de</strong> Religion et la moitié <strong>de</strong> la ville<br />
périt <strong>en</strong>tre 1629 et 1632.<br />
292. Chanoine Houël, Histoire <strong>de</strong> la ville <strong>de</strong> Saint-Lô, 1992, rééd. Res Universis, p. 34.<br />
293. Ibid., p. 54-55.<br />
294. Ibid., p. 57.<br />
Schedae, 2008, prépublication n°10, (p.1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf<br />
69
70<br />
Pourtant, le XVII e siècle fut prospère sur le plan économique, ce qui se tra<strong>du</strong>isit sur le<br />
plan urbanistique. <strong>La</strong> ville doit beaucoup à son bi<strong>en</strong>faiteur Jean Dubois (1554-1639), procureur<br />
<strong>du</strong> Roi. Le chanoine Houël lui consacre <strong>de</strong> nombreuses pages pleines d’emphase et<br />
d’admiration, au fil <strong>de</strong>squelles il énumère toutes les dép<strong>en</strong>ses <strong>de</strong>stinées à améliorer le quotidi<strong>en</strong><br />
<strong>de</strong>s malheureux comme à embellir la ville. Ainsi, fit-il « rétablir la voûte <strong>du</strong> chœur <strong>de</strong><br />
l’église Notre-Dame, bâtir la tour nord <strong>de</strong> la même église, dont la construction n’avait point<br />
été achevée » 295 . En 1678, les reliques <strong>de</strong> saint-<strong>La</strong>ud (Lô), fur<strong>en</strong>t ram<strong>en</strong>ées à l’église Notre-<br />
Dame, réconciliant la ville avec son histoire. <strong>La</strong> ville connut dans la secon<strong>de</strong> moitié <strong>du</strong> siècle<br />
une prospérité commerciale et in<strong>du</strong>strielle, <strong>en</strong> <strong>par</strong>ticulier grâce à l’essor <strong>de</strong> la draperie<br />
et <strong>du</strong> cuir, spécialités qui avai<strong>en</strong>t fait la r<strong>en</strong>ommée <strong>de</strong> Saint-Lô. Cette croissance économique<br />
justifiait que la ville se dés<strong>en</strong>clavât : d’importants travaux routiers fur<strong>en</strong>t <strong>en</strong>trepris tout<br />
au long <strong>du</strong> XVIII e siècle : d’abord pour relier Saint-Lô à Coutances ; la ville <strong>de</strong>vait <strong>en</strong> outre<br />
bénéficier <strong>de</strong>s avantages <strong>de</strong> la construction <strong>de</strong> l’axe (route royale) Paris-Cherbourg, que<br />
Louis XVI emprunta pour l’inauguration <strong>de</strong> la ra<strong>de</strong> <strong>de</strong> Cherbourg <strong>en</strong> 1786. Son c<strong>en</strong>tre fut<br />
pavé <strong>en</strong> maints <strong>en</strong>droits. Même la Vire fut « comprise dans le tableau général <strong>de</strong>s rivières<br />
<strong>du</strong> royaume qui doiv<strong>en</strong>t être r<strong>en</strong><strong>du</strong>es navigables » 296 .<br />
Avec la Révolution française, Saint-Lô <strong>de</strong>vint le « Rocher <strong>de</strong> la Liberté », les champs Saint-<br />
Thomas se transformèr<strong>en</strong>t <strong>en</strong> Champ-<strong>de</strong>-Mars, où un arbre fut symboliquem<strong>en</strong>t planté. En<br />
1800, la ville fut choisie <strong>par</strong> Bona<strong>par</strong>te pour <strong>de</strong>v<strong>en</strong>ir le chef lieu administratif <strong>du</strong> dé<strong>par</strong>tem<strong>en</strong>t<br />
<strong>de</strong> la Manche. Une ville mo<strong>de</strong>rne comm<strong>en</strong>çait à voir le jour : tribunal, prison, hôtel <strong>de</strong> ville,<br />
haras, caserne, théâtre lui <strong>de</strong>ssinai<strong>en</strong>t un nouveau visage. Pourtant le XIX e siècle finissant<br />
marquait déjà le déclin <strong>de</strong> la cité. Le début <strong>du</strong> siècle avait fait naître <strong>de</strong> nombreux espoirs,<br />
avec la révolution <strong>de</strong>s transports et un bel essor économique, mais écartée <strong>du</strong> tracé <strong>de</strong> la<br />
ligne ferroviaire Paris-Cherbourg, la ville ne <strong>de</strong>vait être reliée au réseau qu’<strong>en</strong> 1860. On avait<br />
même fermem<strong>en</strong>t cru que l’on pourrait, <strong>en</strong> creusant, trouver <strong>de</strong>s gisem<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> charbon et<br />
<strong>de</strong> la sorte <strong>par</strong>ticiper à la Révolution in<strong>du</strong>strielle naissante. Mais la région resterait rurale,<br />
et connaîtrait l’exo<strong>de</strong>. C’est cette petite préfecture <strong>de</strong> province aux ap<strong>par</strong><strong>en</strong>ces si tranquilles,<br />
mais dont l’histoire fut finalem<strong>en</strong>t, <strong>de</strong> tous temps, mouvem<strong>en</strong>tée, qui allait basculer dans<br />
l’Histoire dans la nuit <strong>du</strong> 6 juin 1944.<br />
Ce mardi matin, 6 heures v<strong>en</strong>ai<strong>en</strong>t <strong>de</strong> sonner à l’église Notre-Dame. <strong>La</strong> nuit qui s’achevait avait<br />
été très mouvem<strong>en</strong>tée <strong>par</strong> une succession <strong>de</strong> <strong>du</strong>els <strong>en</strong>tre les mitrailleurs <strong>de</strong>s avions alliés et<br />
ceux <strong>de</strong>s miradors allemands. Malgré cette heure matinale une effervesc<strong>en</strong>ce inhabituelle régnait<br />
<strong>en</strong> ville. Les passants qui s’activai<strong>en</strong>t longeai<strong>en</strong>t les murs <strong>de</strong>s maisons selon les obligations formelles<br />
<strong>de</strong> l’occupant, tandis que <strong>de</strong>s membres <strong>de</strong> la Déf<strong>en</strong>se Passive <strong>en</strong> alerte, rassemblés <strong>par</strong><br />
petits groupes stationnai<strong>en</strong>t aux points névralgiques <strong>de</strong> la ville, et que <strong>de</strong> f<strong>en</strong>être à f<strong>en</strong>être l’on<br />
s’interpellait <strong>en</strong>tre voisins.<br />
L’on v<strong>en</strong>ait d’appr<strong>en</strong>dre la s<strong>en</strong>sationnelle nouvelle: « C’est le débarquem<strong>en</strong>t et cela se passe chez<br />
nous » ? Déjà, prêtant l’oreille, l’on percevait distinctem<strong>en</strong>t le martellem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> la grosse artillerie<br />
<strong>de</strong> marine qui, à vingt-cinq kilomètres à vol d’oiseau, pilonnait les blockhaus allemands <strong>du</strong> littoral.<br />
Dans ces <strong>de</strong>rniers mois, combi<strong>en</strong> <strong>de</strong> fois n’avait-on aperçu, traversant le ciel <strong>de</strong> notre ville, <strong>de</strong>s<br />
escadres <strong>de</strong> quatre à cinq c<strong>en</strong>ts forteresses volantes alliées qui, ailes contre ailes, allai<strong>en</strong>t effectuer<br />
<strong>de</strong>s bombar<strong>de</strong>m<strong>en</strong>ts massifs. Chaque fois notre cœur se serrait à l’idée que quelques minutes<br />
plus tard c’était un quartier d’une ville française qui « allait mourir ». Ce matin <strong>du</strong> Six Juin nous<br />
n’imaginions que confusém<strong>en</strong>t ce qui pourrait nous arriver, cep<strong>en</strong>dant qu’une p<strong>en</strong>sée allait vers<br />
ces villes martyres.<br />
Maint<strong>en</strong>ant que nous nous savions intégrés «aux événem<strong>en</strong>ts dramatiques <strong>de</strong> la gran<strong>de</strong> histoire»,<br />
qu’allait-il adv<strong>en</strong>ir <strong>de</strong> Saint-Lô dans les heures qui allai<strong>en</strong>t suivre ? Nous le sûmes le soir même,<br />
295. Ibid., p. 100.<br />
296. Ibid., p. 131.<br />
Schedae, 2008, prépublication n°10, (p. 1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf
et la nuit suivante avec une ampleur jamais atteinte, et dans une atmosphère d’horreur dépassant<br />
toute imagination, alors qu’une semaine <strong>du</strong>rant, les avions qui rev<strong>en</strong>ai<strong>en</strong>t toutes les trois<br />
ou quatre heures s’acharnai<strong>en</strong>t sur les ruines. Ce fut <strong>en</strong>suite les quarante jours <strong>de</strong> la bataille qui<br />
avait pour objet la prise même <strong>de</strong> ce qui avait été Saint-Lô, bataille qui consacra la rupture <strong>du</strong><br />
front allemand dans le secteur américain ; ce qui permit <strong>de</strong> gagner la bataille <strong>de</strong> France.<br />
C’est <strong>en</strong> ces termes, concis et poignants, que Auguste Lefrançois désigné, à la Libération,<br />
Administrateur <strong>en</strong> second <strong>de</strong> la Ville <strong>de</strong> Saint-Lô, ouvrait le livre <strong>de</strong> Maurice <strong>La</strong>ntier, Saint-<br />
Lô au Bûcher, écrit <strong>en</strong> 1969. Certes occupée, <strong>en</strong><strong>de</strong>uillée <strong>par</strong> ses soldats tombés au combat et<br />
att<strong>en</strong>dant le retour <strong>de</strong> ses prisonniers <strong>de</strong> guerre, <strong>de</strong>s réquisitionnés <strong>par</strong> le STO, la ville avait<br />
été é<strong>par</strong>gnée <strong>par</strong> la guerre avant ce jour funeste. <strong>La</strong> « <strong>La</strong>itière norman<strong>de</strong> », statue <strong>de</strong> bronze<br />
sculptée <strong>par</strong> Arthur le Duc <strong>en</strong> 1887 fut déboulonnée et fon<strong>du</strong>e <strong>par</strong> l’Occupant <strong>en</strong> 1942 pour<br />
faire un canon.<br />
Fig. 5 : « <strong>La</strong> laitière norman<strong>de</strong> » d’Arthur le Duc<br />
(Source : Archives Dé<strong>par</strong>tem<strong>en</strong>tales <strong>de</strong> la Manche, 6Fi5021420)<br />
Les privations étai<strong>en</strong>t importantes, restrictions et réquisitions étai<strong>en</strong>t sévères, ici comme<br />
ailleurs, mais la vie dans la cité <strong>par</strong>v<strong>en</strong>ait à s’organiser. Tirant <strong>par</strong>ti <strong>de</strong> la campagne toute<br />
proche, la ville donnait, comme à son habitu<strong>de</strong>, une impression <strong>de</strong> relative tranquillité.<br />
<strong>La</strong> Résistance, elle aussi, s’organisait. En somme, feignant d’ignorer la m<strong>en</strong>ace <strong>de</strong>s avions<br />
qui survolai<strong>en</strong>t les <strong>en</strong>virons, l’on s’attachait à essayer <strong>de</strong> vivre le plus normalem<strong>en</strong>t possible,<br />
<strong>en</strong> cette fin <strong>de</strong> printemps. Ensoleillé, le dimanche 4 juin assura le succès <strong>de</strong> la fête <strong>du</strong><br />
village <strong>de</strong> Baudre et grâce au retour <strong>de</strong> l’électricité le soir, le gala d’escrime put se t<strong>en</strong>ir au<br />
théâtre municipal <strong>de</strong> Saint-Lô. Pourtant, la crainte était palpable. Ainsi, celle d’Yvonne<br />
Dubois, qui regrettait, dans un courrier adressé à sa sœur et à son beau-frère <strong>de</strong> ne pouvoir<br />
les réunir pour la première communion <strong>de</strong> sa fille :<br />
Cette année hélas, nous n’oserions pas insister, car avec les trains journellem<strong>en</strong>t mitraillés, les<br />
bombar<strong>de</strong>m<strong>en</strong>ts qui se succèd<strong>en</strong>t sans répit, il n’est plus prud<strong>en</strong>t <strong>de</strong> voyager […] Nous prierons<br />
pour que vous soyez é<strong>par</strong>gnés et nous aussi, car à la veille <strong>de</strong> si terribles événem<strong>en</strong>ts, on<br />
se <strong>de</strong>man<strong>de</strong> si on <strong>en</strong> sortira vivants et in<strong>de</strong>mnes 297 .<br />
297. Cité <strong>par</strong> Maurice <strong>La</strong>ntier, Saint-Lô au Bûcher : le martyre d’une cité <strong>de</strong> Basse-Normandie p<strong>en</strong>dant la<br />
secon<strong>de</strong> guerre mondiale, juin-juillet 1944, Saint-Lô, Association Saint-Lô 44, p. 21-22.<br />
Schedae, 2008, prépublication n°10, (p.1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf<br />
71
72<br />
Fig. 6 : Jour <strong>de</strong> marché sur la Place <strong>du</strong> Champ <strong>de</strong> Mars p<strong>en</strong>dant l’occupation<br />
(Source : Collection Musée <strong>de</strong>s Beaux Arts <strong>de</strong> Saint-Lô)<br />
À la veille même <strong>de</strong>s bombar<strong>de</strong>m<strong>en</strong>ts, alors qu’ils étai<strong>en</strong>t annoncés, la population restait<br />
circonspecte, certainem<strong>en</strong>t pas <strong>du</strong>pe, mais nourrissant l’espoir d’une fausse nouvelle, comme<br />
il <strong>en</strong> circulait tant. M me Turboult, institutrice, avait repris sa classe comme à l’ordinaire au début<br />
<strong>de</strong> l’après-midi. Prév<strong>en</strong>ue <strong>par</strong> un billet que le débarquem<strong>en</strong>t était annoncé pour le soir, elle<br />
poursuivit imperturbablem<strong>en</strong>t son cours :<br />
En r<strong>en</strong>trant chez moi, je racontai cela à mon mari qui ne dit ri<strong>en</strong>. Mais je comm<strong>en</strong>çais à le s<strong>en</strong>tir<br />
moins calme qu’à l’ordinaire 298 .<br />
Tous les témoignages que nous avons pu lire montr<strong>en</strong>t la même att<strong>en</strong>te, teintée <strong>de</strong> la<br />
volonté <strong>de</strong> détourner sa propre att<strong>en</strong>tion, comme pour conjurer le sort. Vers 20 heures, après<br />
une journée douce, beaucoup terminai<strong>en</strong>t leur repas, d’autres flânai<strong>en</strong>t <strong>en</strong>core.<br />
Après le dîner, <strong>de</strong>s terrasses <strong>de</strong> l’École Normale, nous contemplons la petite ville, tranquillem<strong>en</strong>t<br />
assise sur son éperon rocheux, au creux d’un vaste amphithéâtre bocager 299 .<br />
Et puis l’ahurissem<strong>en</strong>t. Le soir vint. Tout comm<strong>en</strong>ça <strong>par</strong> un :<br />
[…] imposant ronronnem<strong>en</strong>t d’avions (qui) se fait <strong>en</strong>t<strong>en</strong>dre v<strong>en</strong>ant <strong>du</strong> côté <strong>de</strong> est. […] Je sors sur<br />
le pas <strong>de</strong> la porte, je vois arriver très haut une vague peu fournie <strong>de</strong> gros avions étincelant dans<br />
le ciel. Tout à coup <strong>de</strong>s points noirs se détach<strong>en</strong>t, un puissant chuintem<strong>en</strong>t comme un souffle<br />
s’int<strong>en</strong>sifie très vite. Je n’ai que le temps <strong>de</strong> franchir le seuil précipitamm<strong>en</strong>t et un déluge <strong>de</strong><br />
bombes éclate sur la ville 300 ,<br />
raconte un jeune garçon. Après les effets <strong>du</strong> premier bombar<strong>de</strong>m<strong>en</strong>t :<br />
Au presbytère Notre-Dame, quelques carreaux et <strong>de</strong>s débris <strong>de</strong> zinc fir<strong>en</strong>t plus <strong>de</strong> bruit que <strong>de</strong><br />
mal. À la première secousse d’ailleurs, Mgr <strong>de</strong> Chivré, <strong>en</strong> vieux soldat, s’était rapi<strong>de</strong>m<strong>en</strong>t allongé<br />
à terre. L’alerte passée, il s’<strong>en</strong> fut quérir une bonne bouteille pour réconforter tout son mon<strong>de</strong>301 .<br />
298. Ibid., p. 22.<br />
299. Note E. Herpin dans ses mémoires, in Maurice <strong>La</strong>ntier, Saint-Lô au Bûcher : le martyre d’une cité <strong>de</strong> Basse-<br />
Normandie p<strong>en</strong>dant la secon<strong>de</strong> guerre mondiale, juin-juillet 1944, Saint-Lô, Association Saint-Lô 44, p. 53.<br />
300. Philippe Bertin, Saint-Lô, R<strong>en</strong>nes, Éditions Ouest-France, 1998, p. 35.<br />
301. Maurice <strong>La</strong>ntier, Saint-Lô au Bûcher : le martyre d’une cité <strong>de</strong> Basse-Normandie p<strong>en</strong>dant la secon<strong>de</strong><br />
guerre mondiale, juin-juillet 1944, Saint-Lô, Association Saint-Lô 44, p. 59.<br />
Schedae, 2008, prépublication n°10, (p. 1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf
On semblait croire <strong>en</strong>core à un retour possible au calme. Le premier assaut n’avait <strong>du</strong>ré<br />
qu’un quart d’heure. André, jeune garçon <strong>de</strong> dix-sept ans rapporte :<br />
J’ai pu me r<strong>en</strong>dormir légèrem<strong>en</strong>t, quelque peu inquiet <strong>par</strong> la perspective d’une composition<br />
<strong>de</strong> maths prévue pour le l<strong>en</strong><strong>de</strong>main 302 .<br />
Les tracts qui <strong>de</strong>vai<strong>en</strong>t prév<strong>en</strong>ir les habitants <strong>de</strong> Saint-Lô d’évacuer, déportés vers l’est<br />
<strong>par</strong> le v<strong>en</strong>t, n’atteignir<strong>en</strong>t jamais leur cible. Ce ne fut qu’un répit <strong>de</strong> courte <strong>du</strong>rée. Bi<strong>en</strong>tôt,<br />
les événem<strong>en</strong>ts allai<strong>en</strong>t pr<strong>en</strong>dre une autre tournure. Les saint-lois étai<strong>en</strong>t prisonniers dans<br />
leur ville, impuissants. Les expressions employées <strong>par</strong> ceux qui raconteront leur nuit <strong>du</strong> 6<br />
au 7 juin évoqu<strong>en</strong>t l’Apocalypse : « mer <strong>de</strong> feu », « imm<strong>en</strong>se brasier houleux », « lueur <strong>de</strong> mille<br />
inc<strong>en</strong>dies » « orchestre d’<strong>en</strong>fer composé <strong>de</strong> gongs colossaux, <strong>de</strong> timbales titaniques, <strong>de</strong><br />
contrebasses gigantesques » que les g<strong>en</strong>s voyai<strong>en</strong>t et <strong>en</strong>t<strong>en</strong>dai<strong>en</strong>t <strong>de</strong> leurs abris.<br />
Bi<strong>en</strong> <strong>de</strong>s personnes préférèr<strong>en</strong>t faire confiance à une protection souterraine située à proximité,<br />
et <strong>de</strong>meurer ainsi près <strong>de</strong> leurs affaires et <strong>de</strong> leurs bi<strong>en</strong>s 303 .<br />
D’innombrables témoignages <strong>en</strong> attest<strong>en</strong>t. D’aucuns vinr<strong>en</strong>t se réfugier à Notre-Dame,<br />
comme le précis<strong>en</strong>t les notes retrouvées dans le journal 304 t<strong>en</strong>u <strong>par</strong> Mgr <strong>de</strong> Chivré :<br />
Bi<strong>en</strong> <strong>de</strong>s g<strong>en</strong>s fui<strong>en</strong>t. Nous restons espérant que les caves <strong>du</strong> presbytères seront un abri suffisant.<br />
D’autres <strong>en</strong>fin se risquèr<strong>en</strong>t dans les rues pour fuir ou pour porter <strong>du</strong> secours aux victimes,<br />
avec plus ou moins <strong>de</strong> succès. Au petit matin, après une nuit <strong>de</strong> cauchemar, c’est un spectacle<br />
<strong>de</strong> désolation qui s’offrit aux yeux <strong>de</strong>s survivants.<br />
À l’heure où Saint-Lô croulait sous les bombes explosives et crépitait sous le feu <strong>de</strong>s bombes inc<strong>en</strong>diaires,<br />
<strong>de</strong>s c<strong>en</strong>taines <strong>de</strong> réfugiés […] assistai<strong>en</strong>t terrorisés à la grind breulerie <strong>de</strong> leur ville 305 .<br />
Saint-Lô est <strong>de</strong>v<strong>en</strong>ue à jamais la « capitale <strong>de</strong>s ruines ».<br />
Fig. 7 : Saint-lô après les bombar<strong>de</strong>m<strong>en</strong>ts<br />
(Source : Conseil régional <strong>de</strong> Basse-Normandie/National Archives USA)<br />
302. Philippe Bertin, Saint-Lô, R<strong>en</strong>nes, Éditions Ouest-France, 1998, p. 35.<br />
303. Maurice <strong>La</strong>ntier, Saint-Lô au Bûcher : le martyre d’une cité <strong>de</strong> Basse-Normandie p<strong>en</strong>dant la secon<strong>de</strong><br />
guerre mondiale, juin-juillet 1944, Saint-Lô, Association Saint-Lô 44, p. 85.<br />
304. Mgr <strong>de</strong> Chivré a t<strong>en</strong>u un journal p<strong>en</strong>dant l’été 1944, notifiant au jour le jour les événem<strong>en</strong>ts dont il fut le<br />
témoin. Ses lignes ont été publiées chaque mois, dans le Bulletin <strong>par</strong>oissial, <strong>en</strong>tre 1953 et 1954, L’église<br />
dans la Cité, « Sur les événem<strong>en</strong>ts tragiques <strong>de</strong> juin-juillet-août 1944 ».<br />
305. Maurice <strong>La</strong>ntier, Saint-Lô au Bûcher : le martyre d’une cité <strong>de</strong> Basse-Normandie p<strong>en</strong>dant la secon<strong>de</strong><br />
guerre mondiale, juin-juillet 1944, Saint-Lô, Association Saint-Lô 44, p. 140.<br />
Schedae, 2008, prépublication n°10, (p.1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf<br />
73
74<br />
C’est <strong>en</strong> effet toute la ville qui est tombée comme un château <strong>de</strong> cartes. Elle continuera<br />
d’être pilonnée jusqu’au 19 juillet 306 , date à laquelle les Américains pénétrèr<strong>en</strong>t dans la ville<br />
<strong>en</strong>fin libérée. Le tribut humain fut lourd : <strong>de</strong> plusieurs c<strong>en</strong>taines à un millier <strong>de</strong> victimes selon<br />
les estimations. Les photos qui ont été prises montr<strong>en</strong>t un « désert <strong>de</strong> pierres », « une imm<strong>en</strong>se<br />
carrière <strong>de</strong> schiste », un « chaos » que découvrir<strong>en</strong>t ceux qui revinr<strong>en</strong>t dans leur ville désolée.<br />
Ceux qui étai<strong>en</strong>t restés étai<strong>en</strong>t peu nombreux. L’exo<strong>de</strong> forcé avait été promulgué le 8 juillet.<br />
Au début <strong>du</strong> mois d’août, Georges <strong>La</strong>valley, le Maire <strong>de</strong> Saint-Lô, avait rec<strong>en</strong>sé soixantequinze<br />
personnes à ravitailler 307 . Les g<strong>en</strong>s revinr<strong>en</strong>t progressivem<strong>en</strong>t, mais le 6 octobre <strong>en</strong>core,<br />
le Préfet publiait un arrêté d’interdiction :<br />
En accord avec les Autorités américaines, aucune autorisation <strong>de</strong> résid<strong>en</strong>ce ne sera donnée aux<br />
civils. Des autorisations exceptionnelles pourront, toutefois, être délivrées <strong>par</strong> le Maire <strong>de</strong> Saint-Lô,<br />
<strong>en</strong> accord avec l’autorité préfectorale, et pour les besoins exclusifs <strong>de</strong> la communauté.<br />
Ré<strong>du</strong>ite <strong>en</strong> c<strong>en</strong>dres et <strong>en</strong> poussière, la ville allait <strong>de</strong>v<strong>en</strong>ir un champ <strong>de</strong> boue lorsque les<br />
premières pluies tombèr<strong>en</strong>t. Les opérations <strong>de</strong> déblaiem<strong>en</strong>t, gigantesque tâche à la mesure<br />
<strong>de</strong>s <strong>de</strong>structions, comm<strong>en</strong>cèr<strong>en</strong>t bi<strong>en</strong>tôt. Le 10 juin 1945, le Général <strong>de</strong> Gaulle se r<strong>en</strong>dit à<br />
Saint-Lô. Ouest-France dans son édition <strong>du</strong> 11 juin écrivit : « Le cortège (<strong>de</strong>s personnalités)<br />
gagne le cœur <strong>de</strong> la cité, après <strong>de</strong>ux arrêts <strong>de</strong>vant la croix <strong>de</strong> Lorraine qui barre symboliquem<strong>en</strong>t<br />
l’<strong>en</strong>trée <strong>de</strong> la prison 308 et l’église Notre-Dame, dans laquelle le général ti<strong>en</strong>t à pénétrer».<br />
Nous connaissons vos besoins. […] Je vous assure très simplem<strong>en</strong>t et sérieusem<strong>en</strong>t que, dans<br />
la mesure <strong>de</strong> nos moy<strong>en</strong>s, nos pouvoirs publics ai<strong>de</strong>ront Saint-Lô autant qu’ils le pourront <strong>par</strong>ce<br />
que Saint-Lô le mérite, Saint-Lô avec ses pertes d’hommes, ses ruines, mais Saint-Lô avec sa<br />
vaillance, sa volonté. C’est cela la France, et c’est une sorte <strong>de</strong> symbole <strong>de</strong> la Patrie que je veux<br />
voir aujourd’hui dans cette ville martyre et courageuse.<br />
Ainsi la vie repr<strong>en</strong>ait le <strong>de</strong>ssus, mais à quel prix ?<br />
Fig. 8 : <strong>La</strong> rue Torteron au l<strong>en</strong><strong>de</strong>main <strong>de</strong> la Libération<br />
(Source : Collection Musée <strong>de</strong>s Beaux Arts <strong>de</strong> Saint-Lô)<br />
306. Les <strong>de</strong>ux tours <strong>de</strong> l’église Notre-Dame <strong>de</strong>meurai<strong>en</strong>t <strong>de</strong>bout à cette date. C’est la nuit suivante qu’une<br />
batterie alleman<strong>de</strong> stationnée à Agneaux démolit la faça<strong>de</strong>, laquelle <strong>en</strong>traîna dans sa chute la tour nord.<br />
307. Lire sur ces aspects, R<strong>en</strong>aissance et Reconstruction <strong>de</strong> Saint-Lô (1944-1964), <strong>Université</strong> Inter-Âges, Tome<br />
2, 2000, 319 pages.<br />
308. <strong>La</strong> prison fut <strong>en</strong>tièrem<strong>en</strong>t détruite lors <strong>de</strong>s bombar<strong>de</strong>m<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> la nuit <strong>du</strong> 6 juin et presque tous les dét<strong>en</strong>us<br />
périr<strong>en</strong>t sous les décombres.<br />
Schedae, 2008, prépublication n°10, (p. 1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf
Les ruines <strong>de</strong> la ville l’ont r<strong>en</strong><strong>du</strong>e célèbre et célébrée. Les photographies <strong>de</strong> sa dévastation<br />
totale ont fait le tour <strong>du</strong> mon<strong>de</strong>. Une autre, ap<strong>par</strong>emm<strong>en</strong>t plus anecdotique, si tant est<br />
que l’on puisse se permettre l’usage <strong>de</strong> ce terme <strong>en</strong> <strong>par</strong>eilles circonstances, fut aussi très<br />
largem<strong>en</strong>t diffusée : le Christ <strong>en</strong> croix <strong>de</strong>meuré intact dans l’église Notre-Dame év<strong>en</strong>trée.<br />
Fig. 9 : Le jubé (dit « perque ») <strong>de</strong> Notre-Dame<br />
(Source : Collection Notre-Dame)<br />
Cette image nous semble tout à fait métaphorique <strong>de</strong> la situation. En effet, si l’on ne<br />
<strong>de</strong>vait ret<strong>en</strong>ir <strong>de</strong> l’histoire <strong>de</strong> la ville <strong>de</strong> Saint-Lô qu’un édifice, nul doute que c’est l’église<br />
Notre-Dame qui remporterait le suffrage. Nous avons vu au fil <strong>du</strong> texte que son histoire est<br />
longue. C’est un millénaire qu’elle traverse et qui la traverse. Toute l’étu<strong>de</strong> qui précè<strong>de</strong>,<br />
comme celle qui suit, vise à montrer que l’église Notre-Dame incarne la ville <strong>de</strong> Saint-Lô qui<br />
<strong>en</strong> a fait un symbole, une allégorie 309 . Surplombant le rocher sur lequel elle fut érigée, elle<br />
continue <strong>de</strong> dominer la ville. Même amputée <strong>de</strong> ses <strong>de</strong>ux flèches, cette mo<strong>de</strong>ste église, aux<br />
allures <strong>de</strong> cathédrale, semble toiser l’Histoire et se jouer d’elle. Elle est à l’image <strong>de</strong> la ville :<br />
mo<strong>de</strong>ste et fière, fragile et résistante. Les gran<strong>de</strong>s étapes <strong>de</strong> sa construction sont bi<strong>en</strong> connues.<br />
Peu <strong>de</strong> sources nous sont <strong>par</strong>v<strong>en</strong>ues mais elles sont suffisantes <strong>en</strong> nombre et <strong>en</strong> qualité<br />
pour permettre une reconstitution chronologique assez fiable. C’est cette histoire <strong>par</strong>ticulière<br />
que nous nous proposons <strong>de</strong> restituer 310 .<br />
C’est au XI e siècle, <strong>en</strong>tre 1025 et 1048, que fut fondée Notre-Dame <strong>du</strong> Château, <strong>par</strong><br />
Robert I er , 35 e évêque <strong>de</strong> Coutances. Elle était alors simple chapelle. Guillaume le Conquérant<br />
l’offrit <strong>en</strong> premier lieu à l’abbaye Saint-Lô <strong>de</strong> Rou<strong>en</strong>. Bi<strong>en</strong>tôt, il <strong>en</strong> fit don à la cathédrale<br />
<strong>de</strong> Coutances, diocèse dont elle dép<strong>en</strong>d toujours. Construite sur un terrain donné <strong>par</strong> l’abbé<br />
<strong>de</strong> Sainte-Croix, c’est <strong>en</strong> 1202 qu’elle <strong>de</strong>vint église <strong>par</strong>oissiale. L’une <strong>de</strong>s caractéristiques<br />
309. Au s<strong>en</strong>s ou Françoise Choay l’<strong>en</strong>t<strong>en</strong>d, voir Françoise Choay, Allégorie <strong>du</strong> Patrimoine, Paris, Éditions <strong>du</strong><br />
Seuil, 1992, rééd. 1999, 271 pages.<br />
310. Nous nous appuyons ess<strong>en</strong>tiellem<strong>en</strong>t sur l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’abbé Bernard et sur celle <strong>du</strong> chanoine Houël et surtout<br />
sur un précieux article <strong>de</strong> Gabrielle Thibout écrit sur la base <strong>de</strong> recherches effectuées avant les <strong>de</strong>structions<br />
<strong>de</strong> 1944 aux Archives dé<strong>par</strong>tem<strong>en</strong>tales <strong>de</strong> la Manche.<br />
Schedae, 2008, prépublication n°10, (p.1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf<br />
75
76<br />
principales <strong>de</strong> l’édifice est <strong>de</strong> ne pas avoir été bâti sur un vaste espace inoccupé. Disposant<br />
<strong>de</strong> peu <strong>de</strong> moy<strong>en</strong>s, les trésoriers <strong>de</strong> la <strong>par</strong>oisse se vir<strong>en</strong>t contraints d’acquérir les terrains, à<br />
mesure qu’ils se libérai<strong>en</strong>t 311 . <strong>La</strong> conséqu<strong>en</strong>ce directe <strong>en</strong> est que son architecture, loin d’être<br />
canonique, <strong>du</strong>t s’adapter aux contraintes topographiques. C’est <strong>en</strong>tre 1290 et 1300 que le<br />
chœur gothique et la tour nord, dite « tour <strong>de</strong> la ville », inspirée <strong>de</strong> la cathédrale <strong>de</strong> Coutances,<br />
<strong>du</strong>r<strong>en</strong>t être achevés. Au début <strong>du</strong> XV e siècle, les travaux se poursuivir<strong>en</strong>t à une belle<br />
allure. Des terrains s’étant libérés, la nef et les collatéraux fur<strong>en</strong>t construits <strong>en</strong>tre 1400 et 1428.<br />
Il fallut élargir la nef au sud <strong>par</strong> rapport au chœur, ce qui fait dévier l’axe <strong>de</strong> l’édifice 312 . Cet<br />
élargissem<strong>en</strong>t semble trouver sa justification dans l’exist<strong>en</strong>ce d’une construction antérieure 313 .<br />
Des élém<strong>en</strong>ts d’architecture subsistants l’attest<strong>en</strong>t <strong>en</strong> plusieurs <strong>en</strong>droits :<br />
Les piliers à colonnettes multiples, les bases à <strong>de</strong>ux tores aplatis, les chapiteaux à tailloirs circulaires<br />
et corbeilles ornées <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux rangées <strong>de</strong> feuilles, tous ces détails portai<strong>en</strong>t la marque <strong>de</strong><br />
la secon<strong>de</strong> moitié <strong>du</strong> XIIIe siècle, ainsi que le ban<strong>de</strong>au à quatre lobes <strong>en</strong> creux couronnant le<br />
premier niveau 314 .<br />
En 1430, le premier bourdon fut posé dans la tour nord. Plus tard, <strong>en</strong> 1464, la tour sud,<br />
autrem<strong>en</strong>t appelée « tour <strong>de</strong> la <strong>par</strong>oisse », fut érigée sur le modèle <strong>de</strong> la tour nord dans le<br />
style gothique flamboyant. L’inscription qu’elle porte permet <strong>de</strong> la dater avec précision 315 .<br />
Entre 1479 et 1510, l’évêque <strong>de</strong> Coutances, Geoffroy Herbert, ayant offert tout le terrain<br />
nécessaire s’ét<strong>en</strong>dant jusqu’à l’anci<strong>en</strong>ne chapelle Sainte-Marie-<strong>du</strong>-Château 316 , permit l’édification<br />
<strong>du</strong> déambulatoire et <strong>du</strong> second collatéral nord <strong>du</strong> chœur avec la chaire extérieure.<br />
En 1497, fut construite la chapelle absidiale, logeant Notre-Dame <strong>du</strong> Pilier. Il est fort<br />
probable que dans le même temps Herbert fit procé<strong>de</strong>r à <strong>de</strong>s ré<strong>par</strong>ations dans l’édifice. Un<br />
écusson surmonté d’une crosse et portant ses armes surplombe la porte nord, ouverte vers<br />
1500 sur la cour <strong>du</strong> château (elle fut murée <strong>en</strong> 1628 et remplacée <strong>par</strong> une porte plus large <strong>en</strong><br />
style néo-gothique). Des comptes publiés <strong>par</strong> la Société <strong>de</strong>s Antiquaires <strong>de</strong> Normandie 317<br />
attest<strong>en</strong>t <strong>de</strong> l’adjonction <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux travées au nord <strong>de</strong> la nef vers le milieu <strong>du</strong> XVI e siècle. Il<br />
fallut att<strong>en</strong>dre le XVII e siècle pour que les flèches <strong>de</strong> pierre, inspirées <strong>de</strong> celle <strong>de</strong> Saint-Pierre<br />
<strong>de</strong> Ca<strong>en</strong>, ne vinss<strong>en</strong>t coiffer les <strong>de</strong>ux tours 318 . Il avait fallu quatre siècles pour l’achever.<br />
Ainsi, on peut dégager quatre phases majeures dans l’édification <strong>de</strong> l’église Notre-Dame<br />
<strong>de</strong> Saint-Lô <strong>en</strong>tre le XIII e et le XVII e siècles: la tour nord et le chœur primitif (fin XIII e -début XIV e ),<br />
la nef et les collatéraux (début XV e ), le grand chœur flamboyant, son déambulatoire et son<br />
double collatéral nord (fin XV e -début XVI e ), les <strong>par</strong>ties hautes <strong>du</strong> chœur et les flèches (XVII e ).<br />
311. Un registre <strong>de</strong> 1437 donne le détail <strong>de</strong> l’acquisition <strong>de</strong>s terrains. L’original, conservé aux Archives dé<strong>par</strong>tem<strong>en</strong>tales<br />
fut détruit <strong>en</strong> 1944. On <strong>en</strong> possè<strong>de</strong> néanmoins une publication, <strong>par</strong> Éd. Lepingard, « Le cartulaire<br />
<strong>de</strong> l’église Notre-Dame <strong>de</strong> Saint-Lô », Notices, mémoires et docum<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> la Société d’archéologie<br />
et d’histoire naturelle <strong>de</strong> la Manche, 1899-1908.<br />
312. Lors <strong>de</strong> la reconstitution virtuelle nous <strong>de</strong>vrons porter une att<strong>en</strong>tion <strong>par</strong>ticulière à la nef : les développem<strong>en</strong>ts,<br />
liés aux acquisitions successives déport<strong>en</strong>t l’<strong>en</strong>semble vers le sud.<br />
313. Un fragm<strong>en</strong>t <strong>de</strong> colonnette prés<strong>en</strong>t qui subsiste sans correspondance avec le reste le long <strong>de</strong> l’arc triomphal<br />
<strong>du</strong> côté <strong>du</strong> chœur vi<strong>en</strong>t corroborer cette hypothèse.<br />
314. Gabrielle Thibout, « L’église Notre-Dame <strong>de</strong> saint-Lô, ses campagnes <strong>de</strong> construction », Congrès archéologique,<br />
Cot<strong>en</strong>tin-Avranchin, Paris, Société Française d’Archéologie, 1966, p. 284.<br />
315. « A la lou<strong>en</strong>ge et honeur <strong>de</strong> Dieu, <strong>de</strong> Nre Dame et <strong>de</strong> Saint Jehan le Virge, ce portal et la tour fur<strong>en</strong>t<br />
<strong>en</strong>comm<strong>en</strong>cés à édiffier <strong>de</strong>s d<strong>en</strong>iers <strong>de</strong>s proissi<strong>en</strong>s el bi<strong>en</strong>facteurs <strong>de</strong> ceste église au moys <strong>de</strong> mars l’an<br />
mil IIIIe LX IIII <strong>par</strong>. Jehan <strong>de</strong> Caumont, Jehan Farry et Richart le Rossignol lors trésoriers d’icelle. Dieu leur<br />
face <strong>par</strong>don. Am<strong>en</strong>. Paster Noster »<br />
316. Voir plan.<br />
317. Le Cacheux, Pr<strong>en</strong>tout, « Blaise Le Prestre l’église Notre-Dame <strong>de</strong> Saint-Lô et le château <strong>de</strong> Fontaine-<br />
H<strong>en</strong>ry », Bulletin <strong>de</strong> la Société <strong>de</strong>s Antiquaires <strong>de</strong> Normandie, Tome XXXIV, Paris, Société <strong>de</strong>s Antiquaires<br />
<strong>de</strong> Normandie, 1920, p. 267-280.<br />
318. Toustain <strong>de</strong> Billy repro<strong>du</strong>it dans son ouvrage un tableau, conservé au musée <strong>de</strong> Torigni-sur-Vire, qui montre,<br />
vers 1620 les <strong>de</strong>ux tours surmontées <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux flèches <strong>de</strong> bois recouvertes d’ardoises.<br />
Schedae, 2008, prépublication n°10, (p. 1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf
Fig. 10 : Rue Thiers et Chaire extérieure <strong>de</strong> l’église Notre-Dame<br />
(Source : Archives dé<strong>par</strong>tem<strong>en</strong>tales <strong>de</strong> la Manche, 6Fi502413)<br />
Les modifications qui fur<strong>en</strong>t apportées <strong>par</strong> la suite sont à considérer comme <strong>de</strong> peu d’importance<br />
pour l’aspect général <strong>du</strong> lieu. Les archives conservées à la Médiathèque <strong>de</strong> l’Architecture<br />
et <strong>du</strong> Patrimoine montr<strong>en</strong>t qu’à <strong>de</strong> multiples reprises dès le milieu <strong>du</strong> XIX e siècle le Service<br />
<strong>de</strong>s Monum<strong>en</strong>ts historiques alertait sur l’état <strong>de</strong> l’édifice, lequel manifestait <strong>de</strong>s fragilités et<br />
nécessitait <strong>de</strong>s ré<strong>par</strong>ations importantes 319 . En 1844 était ainsi préconisée « la reconstruction<br />
d’une <strong>par</strong>tie d’une flèche à la fermeture <strong>de</strong>s ogives et barbacanes <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux tours <strong>de</strong> la cathédrale<br />
<strong>de</strong> (Saint-Lô) au moy<strong>en</strong> <strong>de</strong> <strong>par</strong>ties <strong>en</strong> fonte » 320 . Nous v<strong>en</strong>ons <strong>de</strong> le voir, les datations<br />
<strong>de</strong>s différ<strong>en</strong>tes phases <strong>de</strong> construction sont à la fois assez précises, et sujettes à caution dans<br />
leur détail, <strong>du</strong> fait <strong>de</strong> la difficulté <strong>de</strong> réunir les sources, qui <strong>par</strong>fois se contrari<strong>en</strong>t.<br />
<strong>La</strong> difficulté est plus gran<strong>de</strong> <strong>en</strong>core pour la question <strong>du</strong> mobilier, <strong>de</strong> la statuaire et <strong>de</strong>s<br />
vitraux. Quelques élém<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> mobilier subsist<strong>en</strong>t, un lutrin, un chan<strong>de</strong>lier pascal et l’anci<strong>en</strong>maître<br />
autel, mais l’ess<strong>en</strong>tiel nous reste inconnu. Un article <strong>de</strong> journal est à ce titre très évocateur.<br />
Ainsi, dans l’édition <strong>de</strong>s 5 et 6 juin 1993, un appel est lancé :<br />
Cette tête <strong>de</strong> Vierge <strong>du</strong> XIV e siècle vous dit quelque chose ? Contactez le musée <strong>de</strong>s Beaux-Arts.<br />
Toutefois, <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s, comme celle <strong>de</strong> Martine Callias-Bey, qui s’appuie à la fois sur <strong>de</strong>s<br />
fragm<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> vitraux, sur <strong>de</strong>s recoupem<strong>en</strong>ts avec d’autres édifices, églises ou cathédrales,<br />
pour lesquels les maîtres-verriers ont travaillé mais aussi sur <strong>de</strong>s sources écrites permett<strong>en</strong>t<br />
d’<strong>en</strong> connaître davantage. Il ne s’agira donc pas ici d’<strong>en</strong>trer dans <strong>de</strong> plus amples détails<br />
architecturaux, <strong>par</strong>tie ess<strong>en</strong>tielle <strong>du</strong> travail à v<strong>en</strong>ir, et qui n’apporterai<strong>en</strong>t dans le contexte<br />
ri<strong>en</strong> <strong>de</strong> significatif quant à la dim<strong>en</strong>sion symbolique <strong>de</strong> l’édifice. En revanche, la chronologie<br />
319. « Dans une délibération qu’il a prise le 29 janvier 1843 […] le Conseil <strong>de</strong> fabrique a exposé que l’église exige<br />
<strong>de</strong>s ré<strong>par</strong>ations assez importantes qu’il serait urg<strong>en</strong>t d’<strong>en</strong>trepr<strong>en</strong>dre […]. Il a reconnu <strong>en</strong> même temps l’indisp<strong>en</strong>sable<br />
nécessité <strong>de</strong> placer sur les clochers un ou plusieurs <strong>par</strong>atonnerres afin <strong>de</strong> préserver l’édifice <strong>de</strong>s<br />
effets souv<strong>en</strong>t désastreux <strong>de</strong> la foudre […] », extrait d’une lettre <strong>du</strong> Préfet au Maire <strong>de</strong> Saint-Lô, docum<strong>en</strong>t<br />
sinistré <strong>en</strong> 1944 et très abîmé, in Charles <strong>de</strong> Gerville, Voyage archéologique dans la Manche (1818-1820),<br />
Tome 2, Arrondissem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> Saint-Lô, Saint-Lô, Société d’Archéologie et d’Histoire <strong>de</strong> la Manche, 2000, p. 314.<br />
320. Extrait d’une Lettre <strong>de</strong> Pinard Frères (Paris), Hauts-Fourneaux <strong>de</strong> Marquises (Pas-<strong>de</strong>-Calais) au Maire <strong>de</strong><br />
Saint-Lô, le 13 août 1944 ; on notera au passage la référ<strong>en</strong>ce une fois <strong>en</strong>core à la cathédrale <strong>de</strong> Saint-Lô.<br />
Schedae, 2008, prépublication n°10, (p.1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf<br />
77
78<br />
Fig. 11 : Plan <strong>de</strong> l’église Notre-Dame <strong>de</strong> 1754<br />
(Source : Gabrielle Thibout)<br />
établie ci-<strong>de</strong>ssus permet <strong>de</strong> mesurer combi<strong>en</strong> non seulem<strong>en</strong>t l’église Notre-Dame, impose<br />
sa physionomie et sa marque dans la ville mais égalem<strong>en</strong>t, dans la mesure où sa construction<br />
s’inscrit dans la longue <strong>du</strong>rée, combi<strong>en</strong> son histoire avance au rythme <strong>de</strong> la conjoncture <strong>de</strong><br />
la ville. On peut bi<strong>en</strong> évi<strong>de</strong>mm<strong>en</strong>t pour s’<strong>en</strong> convaincre confronter les frises chronologiques<br />
relatant les événem<strong>en</strong>ts historiques <strong>de</strong>puis les débuts <strong>de</strong> la christianisation <strong>de</strong> la Normandie<br />
jusqu’à la guerre <strong>de</strong> C<strong>en</strong>t Ans, puis les Guerres <strong>de</strong> Religions.<br />
L’une <strong>de</strong>s coquetteries <strong>de</strong> Notre-Dame est d’avoir su <strong>en</strong>tret<strong>en</strong>ir jusqu’à aujourd’hui une<br />
lég<strong>en</strong><strong>de</strong> selon laquelle l’église serait <strong>en</strong> réalité une cathédrale. Françoise Bercé elle-même<br />
s’y mépr<strong>en</strong>d à plusieurs reprises, dans ses écrits sur le lieu. En fait, il n’<strong>en</strong> est ri<strong>en</strong> et il n’<strong>en</strong> a<br />
jamais ri<strong>en</strong> été. D’abord attachée à Notre-Dame <strong>de</strong> Rou<strong>en</strong>, comme ci-<strong>de</strong>ssus expliqué, l’église<br />
Notre-Dame <strong>de</strong> Saint-Lô dép<strong>en</strong>d <strong>de</strong>puis le XIe siècle <strong>de</strong> l’évêché <strong>de</strong> Coutances. <strong>La</strong> confusion<br />
s’explique <strong>par</strong> plusieurs facteurs. Tout d’abord, le nom <strong>de</strong> la ville qui l’abrite : Saint-Lô.<br />
Briovère adopta ce nom <strong>en</strong> hommage à l’évêque <strong>de</strong> Coutances qui faisait <strong>de</strong> la ville sa résid<strong>en</strong>ce<br />
habituelle. Aussi, dès cette époque, nous rapporte l’abbé Bernard, on trouve m<strong>en</strong>tion<br />
<strong>du</strong> titre d’« Évêque <strong>de</strong> Saint-Lô ». Une autre raison, voisine, ti<strong>en</strong>t au fait que les évêques <strong>de</strong><br />
Coutances ont cherché et trouvé refuge dans la ville <strong>de</strong> Saint-Lô et qu’ils y ont installé leur<br />
évêché, d’abord pour se préserver <strong>de</strong>s invasions barbares au IX e siècle puis p<strong>en</strong>dant la guerre<br />
<strong>de</strong> C<strong>en</strong>t Ans. <strong>La</strong> situation géographique <strong>de</strong> la ville les plaçait <strong>en</strong> un lieu plus sûr. Enfin, <strong>du</strong><br />
point <strong>de</strong> vue architectural, les dim<strong>en</strong>sions imposantes <strong>de</strong> l’édifice et les inspirations nombreuses<br />
<strong>de</strong> la cathédrale <strong>de</strong> Coutances <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t l’ambiguïté. Ainsi, il est assez cocasse<br />
<strong>de</strong> voir qu’après les bombar<strong>de</strong>m<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> 1944, la Société d’Archéologie, déf<strong>en</strong>dant à tout<br />
crin la reconstruction à l’id<strong>en</strong>tique <strong>de</strong> l’église 321 dans son état d’avant-guerre, soit avec ses<br />
tours gothiques, se constitua, <strong>en</strong> février 1947, <strong>en</strong> « Amis <strong>de</strong> la Cathédrale » 322 .<br />
321. « Ce qui a été peut se refaire », extrait <strong>de</strong> la Manche Libre, daté <strong>du</strong> 4 novembre 1945.<br />
322. Les statuts fur<strong>en</strong>t déposés au début <strong>de</strong> l’année 1947. On les retrouve dans le Bulletin <strong>par</strong>oissial <strong>du</strong> mois<br />
<strong>de</strong> mars <strong>de</strong> la même année.<br />
Schedae, 2008, prépublication n°10, (p. 1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf
<strong>La</strong> métho<strong>de</strong> peut <strong>par</strong>aître abusive et elle ne fut d’aucun secours, car comme nous le<br />
verrons ci-après, le projet n’aboutit pas. Pourtant, elle est la marque significative <strong>du</strong> fait que les<br />
bombar<strong>de</strong>m<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> 1944 représ<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t un tournant majeur dans l’histoire <strong>de</strong> la ville et que<br />
l’église, qui <strong>en</strong> porte les stigmates, incarne aussi la douleur. Nous avons <strong>par</strong>lé plus haut d’allégorie<br />
et le terme n’est <strong>en</strong> ri<strong>en</strong> exagéré. Bi<strong>en</strong> avant la <strong>de</strong>struction <strong>de</strong> 1944, les flèches <strong>de</strong> l’église<br />
étai<strong>en</strong>t la fierté dressée <strong>de</strong> la ville. Remarquables, elles savai<strong>en</strong>t se faire remarquer. Elles ont<br />
fait les beaux jours <strong>de</strong>s cartes postales, toutes les photographies <strong>de</strong> la ville les magnifi<strong>en</strong>t.<br />
Fig. 12 : Carte postale « De Saint-Lô, je vous <strong>en</strong>voie <strong>de</strong>s fleurs »<br />
(Source : Archives dé<strong>par</strong>tem<strong>en</strong>tales <strong>de</strong> la Manche, 6Fi5022080)<br />
De manière chirurgicale, la Société d’Archéologie donne l’inv<strong>en</strong>taire <strong>de</strong>s dégâts 323 :<br />
Bombar<strong>de</strong>m<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> Juin & Juillet 1944. Manche – Saint-Lô – Église Notre-Dame.<br />
Cet édifice est fort <strong>en</strong>dommagé <strong>par</strong> les bombar<strong>de</strong>m<strong>en</strong>ts aéri<strong>en</strong>s et terrestres.<br />
Sur la faça<strong>de</strong> ouest : la tour nord avec sa flèche est écroulée jusqu’à la hauteur <strong>de</strong>s clefs <strong>de</strong><br />
voûtes <strong>de</strong>s nefs. <strong>La</strong> tour sud, très mutilée, plusieurs obus l’ayant frappée <strong>de</strong> plein fouet. Elle<br />
est <strong>en</strong>core <strong>de</strong>bout, jusqu’à la galerie supérieure. Les clochetons sont découronnés et la flèche<br />
est écroulée. Le remplage <strong>de</strong> la gran<strong>de</strong> baie au-<strong>de</strong>ssus <strong>du</strong> porche est détruit. Le portail est<br />
mutilé. Les (mot laissé <strong>en</strong> blanc – ndlr) <strong>en</strong> verrerie écornées.<br />
<strong>La</strong> face nord est criblée d’éclats. Un obus a percuté sur la <strong>par</strong>oi extérieure <strong>de</strong> la tour nord. Tous<br />
les remplages <strong>de</strong>s tours sont brisés sauf un qui n’est que <strong>par</strong>tiellem<strong>en</strong>t détruit mais les morceaux<br />
subsist<strong>en</strong>t.<br />
Sur la face sud : <strong>de</strong>ux obus ont percuté dans les arcs <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux f<strong>en</strong>êtres. Les assises <strong>de</strong>s contreforts<br />
sont écornées, <strong>de</strong>s gargouilles sont détruites et une <strong>par</strong>tie <strong>du</strong> <strong>par</strong>apet <strong>de</strong> chêne est démolie.<br />
L’absi<strong>de</strong> est criblée d’éclats et tous les remplages <strong>de</strong> baies sauf un, sont brisés.<br />
Intérieur. Dans la nef ; la f<strong>en</strong>être ouest <strong>en</strong>tre tours est détruite, les portiers et les arcs sont<br />
<strong>de</strong>bout sauf un qui est détruit près <strong>de</strong> la tour sud. Les voûtes sont écroulées ainsi que la charp<strong>en</strong>te<br />
et la toiture. L’arc triomphal <strong>du</strong> chéneau est intact. <strong>La</strong> chaire est à <strong>de</strong>mi-détruite.<br />
Dans le chœur: les colonnes et les arcs sont à peu près intacts. Les voûtes sont <strong>en</strong> place, sauf celles<br />
<strong>de</strong> la première travée près <strong>de</strong> l’arc triomphal, mais elles sont lézardées dans les autres travées<br />
et dans l’absi<strong>de</strong>, la charp<strong>en</strong>te est restée <strong>en</strong> place, mais la toiture est pratiquem<strong>en</strong>t démolie.<br />
323. Charles <strong>de</strong> Gerville, Voyage archéologique dans la Manche (1818-1820), Tome 2, Arrondissem<strong>en</strong>t <strong>de</strong><br />
Saint-Lô, Saint-Lô, Société d’Archéologie et d’Histoire <strong>de</strong> la Manche, 2000, p. 328-329.<br />
Schedae, 2008, prépublication n°10, (p.1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf<br />
79
80<br />
Bas-côtés nord : les piliers et le mur extérieur nord sont <strong>de</strong>bout. Les voûtes ont résisté mais sont<br />
ébranlées et lézardées et beaucoup <strong>de</strong> claveaux <strong>de</strong>s arcs ogifs sont tombés. Plusieurs sont crevés.<br />
Chapelle <strong>de</strong> l’absi<strong>de</strong> : les f<strong>en</strong>êtres sont criblées d’éclats. Les voûtes ont résisté.<br />
Bas-côtés sud : les piliers et les voûtes, jusqu’à la tour sud, ont résisté, sauf quatre qui sont<br />
effondrées, mais celles-ci ont lézardées. Quelques remplages <strong>de</strong> f<strong>en</strong>êtres sont <strong>en</strong>core <strong>en</strong> place.<br />
D’une façon générale, toutes les toitures sont ou effondrées ou soufflées et serai<strong>en</strong>t à refaire<br />
<strong>en</strong> totalité.<br />
Schedae, 2008, prépublication n°10, (p. 1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf<br />
Signé : Levavasseur.<br />
Les photographies, innombrables, qui fur<strong>en</strong>t prises <strong>de</strong> l’église Notre-Dame <strong>en</strong> ruines<br />
témoign<strong>en</strong>t, <strong>en</strong> images, <strong>de</strong> l’état ci-<strong>de</strong>ssus notifié et nous laiss<strong>en</strong>t sans peine imaginer la torpeur<br />
que connur<strong>en</strong>t les Saint-Lois aux l<strong>en</strong><strong>de</strong>mains <strong>de</strong>s bombar<strong>de</strong>m<strong>en</strong>ts. L’édifice fut gravem<strong>en</strong>t<br />
<strong>en</strong>dommagé dès les premiers assauts. Au soir <strong>du</strong> 6 juin :<br />
L’effondrem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s voûtes <strong>de</strong> Notre-Dame interrompt <strong>par</strong>fois la prière angoissée, qui repr<strong>en</strong>d<br />
lorsque s’achève l’avalanche. Les <strong>de</strong>rniers mots <strong>du</strong> Te Deum prononcés, les explosions se tais<strong>en</strong>t.<br />
Les explosions mais pas le crépitem<strong>en</strong>t viol<strong>en</strong>t <strong>du</strong> feu qui dévore toute la <strong>par</strong>tie supérieure <strong>du</strong><br />
presbytère. […] On sort <strong>du</strong> refuge <strong>par</strong> trop m<strong>en</strong>acé maint<strong>en</strong>ant. Il est peut-être <strong>de</strong>ux heures <strong>du</strong><br />
matin. Les <strong>de</strong>ux vicaires se hasard<strong>en</strong>t à chercher le Saint-Sacrem<strong>en</strong>t et les reliques <strong>de</strong> l’église<br />
déjà bouleversée 324 .<br />
Le pire était <strong>en</strong>core à v<strong>en</strong>ir. Le v<strong>en</strong>dredi, tout est détruit : amas <strong>de</strong> ruines ! Spectacle<br />
lam<strong>en</strong>table. Et l’église a bi<strong>en</strong> souffert, ses portails sont mutilés, sa voûte <strong>en</strong> <strong>par</strong>tie découverte.<br />
Une cloche gît sous la tour sud. À la sacristie, beaucoup <strong>de</strong> choses sont intactes. « S’il<br />
y avait eu un moy<strong>en</strong> d’opérer <strong>en</strong> équipe, on <strong>en</strong> aurait sauvé beaucoup » 325 . Mais les flèches<br />
<strong>de</strong>meur<strong>en</strong>t. Le coup <strong>de</strong> grâce fut porté le 19 juillet. Les Américains déployai<strong>en</strong>t leurs <strong>de</strong>rniers<br />
efforts pour vi<strong>de</strong>r la ville <strong>de</strong>s Allemands résistant <strong>en</strong>core. Seul, un guetteur allemand,<br />
juché sur Notre-Dame indiquait à son artillerie les positions alliées. Repéré, il se jeta <strong>de</strong> la<br />
tour mais les Allemands qui avai<strong>en</strong>t miné l’église la fir<strong>en</strong>t sauter. À Saint-Lô, le glas sonnait<br />
sur la guerre et sur les flèches <strong>de</strong> Notre-Dame.<br />
Fig. 13 : Notre-Dame <strong>en</strong> ruines<br />
(Source : Conseil régional <strong>de</strong> Basse-Normandie/National Archives USA)<br />
324. Maurice <strong>La</strong>ntier, Saint-Lô au Bûcher : le martyre d’une cité <strong>de</strong> Basse-Normandie p<strong>en</strong>dant la secon<strong>de</strong><br />
guerre mondiale, juin-juillet 1944, Saint-Lô, Association Saint-Lô 44, p. 109<br />
325. Ibid., p. 166.
Il suffit <strong>de</strong> lire les articles <strong>de</strong>s journaux après la Libération pour se convaincre <strong>de</strong> la relation<br />
viscérale établie <strong>en</strong>tre l’image <strong>de</strong> la ville et l’église Notre-Dame. Le sobriquet <strong>de</strong> « capitale<br />
<strong>de</strong>s ruines » serait d’ailleurs v<strong>en</strong>u à l’esprit <strong>de</strong> Mgr Jacqueline, alors jeune vicaire auprès <strong>de</strong><br />
Mgr Chivré, curé-archiprêtre <strong>de</strong> Notre-Dame, lorsqu’il sut que les flèches ne serai<strong>en</strong>t pas<br />
reconstruites. Plus <strong>en</strong>core que l’église <strong>en</strong> tant que telle, ses flèches, dont Victor Hugo avait<br />
écrit, <strong>en</strong> juin 1836, alors qu’il était <strong>de</strong> passage à Saint-Lô « admirable église qui a <strong>de</strong>ux clochers<br />
aussi beaux que la gran<strong>de</strong> flèche <strong>de</strong> Saint-D<strong>en</strong>is » 326 , allai<strong>en</strong>t <strong>de</strong>v<strong>en</strong>ir le symbole <strong>du</strong><br />
martyre <strong>de</strong> la ville. Si rapi<strong>de</strong>m<strong>en</strong>t <strong>en</strong> effet, il ap<strong>par</strong>ut évid<strong>en</strong>t que l’église serait reconstruite 327 ,<br />
les difficultés ne faisai<strong>en</strong>t que comm<strong>en</strong>cer. <strong>La</strong> restauration posait <strong>de</strong>s questions épineuses,<br />
qui sont celles qui aujourd’hui nous intéress<strong>en</strong>t dans la perspective d’une <strong>mise</strong> <strong>en</strong> <strong>valeur</strong> <strong>du</strong><br />
<strong>patrimoine</strong> bâti. <strong>La</strong> population saint-loise était pressée et les rumeurs allai<strong>en</strong>t bon train :<br />
J’ai l’honneur <strong>de</strong> vous informer qu’à mon <strong>de</strong>rnier passage à Saint-Lô j’ai été interrogé <strong>par</strong> un<br />
certain nombre d’habitants <strong>de</strong> la ville qui me <strong>de</strong>mandai<strong>en</strong>t si la restauration <strong>de</strong> l’église Notre-<br />
Dame serait continuée. Ils m’exprimai<strong>en</strong>t leur émoi d’un certain projet qui aurait été incorporé<br />
au plan d’urbanisme qui est <strong>en</strong> voie d’achèvem<strong>en</strong>t. Dans ce projet, il serait question <strong>de</strong> laisser<br />
l’église à l’état <strong>de</strong> ruine, tandis qu’une autre gran<strong>de</strong> église serait élevée à côté 328 .<br />
Louis Barbier, architecte <strong>en</strong> chef désigné à la fin <strong>de</strong> la guerre, fut tôt remplacé <strong>par</strong><br />
Yves-Marie Froi<strong>de</strong>vaux, qui dirigea la totalité <strong>de</strong>s opérations <strong>de</strong> reconstruction. Des quatre<br />
possibilités <strong>en</strong>visagées <strong>en</strong> 1945 pour l’église Notre-Dame 329 , qui opposai<strong>en</strong>t « Anci<strong>en</strong>s » et<br />
« Mo<strong>de</strong>rnes », c’est celle d’une reconstruction visant à la restauration <strong>de</strong>s <strong>par</strong>ties <strong>en</strong>core<br />
<strong>de</strong>bout et à la composition d’« une faça<strong>de</strong> nouvelle à l’<strong>en</strong>trée <strong>de</strong> la nef <strong>en</strong> retrait <strong>de</strong>s tours »<br />
et à « achever au mieux la silhouette actuelle (1945) ». Yves-Marie Froi<strong>de</strong>vaux invoqua quatre<br />
argum<strong>en</strong>ts pour justifier ce choix. Le coût évi<strong>de</strong>mm<strong>en</strong>t était à pr<strong>en</strong>dre <strong>en</strong> considération<br />
puisque <strong>de</strong>ux tiers <strong>de</strong> la maçonnerie aurai<strong>en</strong>t été nécessaires à la reconstruction <strong>en</strong> totalité<br />
<strong>de</strong> l’édifice. Sur le plan architectural, il déf<strong>en</strong>dit, à juste titre, que la juxtaposition <strong>de</strong>s styles<br />
s’était faite – et fut souv<strong>en</strong>t décriée au XIX e siècle – sans plan d’<strong>en</strong>semble ce qui <strong>en</strong>traînait<br />
une faiblesse <strong>de</strong> la composition. Panser ses plaies permettait <strong>de</strong> lui conférer une beauté<br />
nouvelle, magnifiant « l’indéniable gran<strong>de</strong>ur <strong>de</strong>s élém<strong>en</strong>ts échappés à la <strong>de</strong>struction » 330 et<br />
qui ferait d’elle le témoin <strong>de</strong>s événem<strong>en</strong>ts tragiques.<br />
<strong>La</strong> restauration prit un temps long : comm<strong>en</strong>cée <strong>en</strong> 1945 avec les travaux <strong>de</strong> déblaiem<strong>en</strong>t,<br />
ce n’est qu’<strong>en</strong> 1963 que l’<strong>en</strong>semble fut pour l’ess<strong>en</strong>tiel achevé. L’importance pour la<br />
population <strong>de</strong> ces travaux est tout à fait s<strong>en</strong>sible à la lecture <strong>de</strong>s articles consacrés à l’église<br />
Notre-Dame sur toute le pério<strong>de</strong>. On peut suivre, pas à pas, l’avancem<strong>en</strong>t <strong>du</strong> chantier. Des<br />
cloches aux dallages, on s<strong>en</strong>t vibrer l’église retrouvée dans le cœur <strong>de</strong>s Saint-Lois :<br />
Certes le bourdon 331 qui appela autrefois les saint-lois dans les mom<strong>en</strong>ts graves : l’inc<strong>en</strong>die <strong>de</strong><br />
l’Hôpital ou <strong>de</strong> l’usine à papier qui annonça la Libération et chanta l’Armistice, n’est pas <strong>en</strong> état<br />
326. Extrait d’une lettre <strong>de</strong> Victor Hugo à sa femme, datée <strong>du</strong> 30 juin 1836, in Victor Hugo, Correspondance<br />
familiale et écrits intimes, Tome 2, 1828-1839, Robert <strong>La</strong>font, p. 298.<br />
327. Raoul Dantry, ministre <strong>du</strong> Gouvernem<strong>en</strong>t provisoire avait un temps <strong>en</strong>visagé <strong>de</strong> laisser les ruines telles<br />
quelles et <strong>de</strong> les <strong>en</strong>tourer <strong>de</strong> fils barbelés.<br />
328. Extrait d’une lettre <strong>de</strong> Louis Barbier au Directeur Général <strong>de</strong> l’Architecture le 30 octobre 1945, Charles <strong>de</strong><br />
Gerville, Voyage archéologique dans la Manche (1818-1820), Tome 2, Arrondissem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> Saint-Lô,<br />
Société d’Archéologie et d’Histoire <strong>de</strong> la Manche, Saint-Lô, 2000, p. 331.<br />
329. Extrait d’une lettre <strong>du</strong> P. Régamey O.P., Directeur <strong>de</strong> la Revue Art Sacré, à l’abbé Bernard Jacqueline, datée<br />
<strong>du</strong> 19 novembre 1945, in Charles <strong>de</strong> Gerville, Voyage archéologique dans la Manche (1818-1820), Tome 2,<br />
Arrondissem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> Saint-Lô, Saint-Lô, Société d’Archéologie et d’Histoire <strong>de</strong> la Manche, 2000, p. 333.<br />
330. Ouest-France, 26 mai 1965.<br />
331. Inscrit aux Monum<strong>en</strong>ts Historiques, le bourdon, qui pèse trois tonnes, avait comm<strong>en</strong>cé à sonner faux à<br />
<strong>par</strong>tir <strong>de</strong> 1980 après une chute <strong>de</strong> 50 mètres suite aux bombar<strong>de</strong>m<strong>en</strong>ts ; il a été restauré et r<strong>en</strong><strong>du</strong> à l’église<br />
<strong>en</strong> avril 2003.<br />
Schedae, 2008, prépublication n°10, (p.1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf<br />
81
82<br />
<strong>de</strong> faire <strong>en</strong>t<strong>en</strong>dre sa voix. Cep<strong>en</strong>dant, posé sur le « puits » dans la cour <strong>du</strong> presbytère, il y a<br />
retrouvé ses quatre sœurs : Aurélie-Louise, Valérie-Marie-Antoinette, Marie-Gabrielle, H<strong>en</strong>riette-<br />
Stéphanie 332 .<br />
Pourtant, et nous l’avons déjà évoqué avec les « Amis <strong>de</strong> la Cathédrale » le choix ne<br />
remporta pas l’unanimité, loin s’<strong>en</strong> faut. Le temps qui passe n’a pas éteint toute polémique.<br />
En 1970, un saint-lois :<br />
Tout cela est très joli, mais je prét<strong>en</strong>ds que si l’on ne vit pas avec les morts, on ne vit pas non<br />
plus avec les ruines, je trouve qu’une ville sans flèches à ses églises, est une ville écrasée, une<br />
ville sans hauteur 333 .<br />
Encore <strong>en</strong> 1990, l’écrivain Jean Phaure s’indignait :<br />
Cette rénovation est un saccage. Ils ont détruit l’âme <strong>de</strong> cette église. Il aurait mille fois mieux<br />
valu la laisser <strong>en</strong> ruines 334 .<br />
Il se trouve toujours aujourd’hui quelques ferv<strong>en</strong>ts <strong>par</strong>tisans 335 pour déf<strong>en</strong>dre la reconstruction<br />
totale <strong>de</strong> l’église, <strong>par</strong>mi lesquels comptait Mgr Jacqueline 336 . Pourtant, on peut dire<br />
que l’église ainsi restaurée a trouvé une place <strong>de</strong> choix dans la ville et dans le cœur <strong>de</strong>s<br />
Saint-Lois. Elle porte dans sa chair la marque d’un passé que nul ne peut effacer quoi qu’il<br />
t<strong>en</strong>te. R<strong>en</strong><strong>du</strong>e au culte dès 1948 337 , l’église très active dans la vie <strong>de</strong> la cité est <strong>en</strong>trée dans<br />
une nouvelle phase <strong>de</strong> son exist<strong>en</strong>ce. Le temps s’est figé sur elle <strong>en</strong> 1944. Il nous incombe<br />
maint<strong>en</strong>ant <strong>de</strong> réfléchir au s<strong>en</strong>s à donner à son histoire, à l’heure <strong>de</strong> la réalité virtuelle.<br />
Une t<strong>en</strong>tative <strong>de</strong> <strong>mise</strong> <strong>en</strong> <strong>valeur</strong> <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong> bâti : une approche novatrice<br />
Avant tout, l’église Notre-Dame est un édifice religieux, voué au culte. Il serait ridicule<br />
d’omettre cette réalité, dans la mesure où c’est cette seule et unique vocation qui lui a permis<br />
<strong>de</strong> traverser d’aussi nombreux siècles. Et si aujourd’hui Notre-Dame recouvre toutes les<br />
<strong>valeur</strong>s dédiées à l’idée que l’on se fait <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong>, il n’<strong>en</strong> <strong>de</strong>meure pas moins – et toute<br />
la première <strong>par</strong>tie <strong>de</strong> notre texte r<strong>en</strong>voie à cette thèse – que l’exploitation <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong>,<br />
dans tous les s<strong>en</strong>s <strong>du</strong> terme, est une préoccupation réc<strong>en</strong>te. Il ne s’agit évi<strong>de</strong>mm<strong>en</strong>t pas<br />
pour nous <strong>de</strong> sacrifier à une mo<strong>de</strong> et nous avons t<strong>en</strong>té d’<strong>en</strong> faire ici, a priori, la démonstration.<br />
En revanche, il nous <strong>par</strong>aît ess<strong>en</strong>tiel, à la lumière <strong>de</strong> ce qui précè<strong>de</strong> <strong>de</strong> se poser <strong>de</strong>s<br />
questions sur ce que peut apporter la réalité virtuelle à un édifice religieux comme celui-ci.<br />
Notre tâche <strong>de</strong> reconstitution consiste à <strong>en</strong> proposer une histoire, une interprétation et à<br />
offrir aux fidèles, aux habitants, aux visiteurs <strong>de</strong> la ville, l’image d’un édifice qui, portant les<br />
stigmates <strong>de</strong> la mémoire, s’inscrit à la fois dans une tradition millénaire et connaît une<br />
<strong>de</strong>uxième vie après la Secon<strong>de</strong> Guerre Mondiale. L’affaire est ambitieuse et pose d’emblée<br />
<strong>de</strong> nombreuses questions que nous allons ci-<strong>de</strong>ssous développer. Pourtant, nous <strong>de</strong>vons<br />
constater que lorsque nous avons prés<strong>en</strong>té notre projet au Père Daniel Jamelot, actuel curé<br />
<strong>de</strong> la <strong>par</strong>oisse <strong>de</strong> Notre-Dame, il a immédiatem<strong>en</strong>t manifesté son <strong>en</strong>thousiasme et a mis à<br />
notre disposition les sources d’information dont il disposait. De la même manière, le Maire<br />
332. Ouest-France, 5 décembre 1964 ; les cloches ont donné lieu à <strong>de</strong> très nombreux articles <strong>de</strong> presse.<br />
333. <strong>La</strong> Manche Libre, 12 juillet 1970.<br />
334. Ouest-France, 12 novembre 1990.<br />
335. http://normandie.canalblog.com/archives/2007.<br />
336. Monseigneur Jacqueline est décédé au mois <strong>de</strong> mars 2007.<br />
337. « Dimanche soir à 18 heures les nouvelles cloches <strong>de</strong> Saint-Lô ont carillonné pour la première fois », extrait<br />
<strong>de</strong> Ouest-France, 15 novembre 1945.<br />
Schedae, 2008, prépublication n°10, (p. 1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf
<strong>de</strong> Saint-Lô, François Digard a-t-il manifesté un intérêt certain pour notre travail. Il faut dire<br />
ici <strong>en</strong> toute honnêteté que sans le souti<strong>en</strong>, même moral, <strong>de</strong> l’un et <strong>de</strong> l’autre, nous ne nous<br />
serions pas lancée dans cette av<strong>en</strong>ture. À l’autre bout <strong>de</strong> la chaîne, l’équipe <strong>du</strong> Plan <strong>de</strong> Rome<br />
nous a ouvert ses portes, nous <strong>en</strong>cadre chaleureusem<strong>en</strong>t et nous prodigue <strong>de</strong> précieux<br />
conseils.<br />
Ce n’est pas la première fois, loin s’<strong>en</strong> faut, qu’un travail, universitaire, à caractère historique,<br />
est <strong>en</strong>trepris sur l’église Notre-Dame <strong>de</strong> Saint-Lô. Martine Callias-Bey avait rédigé<br />
un mémoire <strong>de</strong> maîtrise sur les vitraux <strong>de</strong> Notre-Dame 338 . C’est <strong>en</strong> revanche la première<br />
fois qu’un travail <strong>de</strong> recherche <strong>en</strong>visage une restitution <strong>de</strong> l’édifice dans son état d’avantguerre.<br />
<strong>La</strong> difficulté <strong>de</strong> réunir <strong>de</strong>s sources suffisamm<strong>en</strong>t nombreuses et fiables a dû <strong>en</strong> décourager<br />
plus d’un. Nous le verrons ci-<strong>de</strong>ssous, la tâche est <strong>en</strong> effet loin d’être facile, mais la<br />
bibliographie explorée est suffisamm<strong>en</strong>t <strong>en</strong>courageante pour nous pousser à relever le défi.<br />
Comme nous souhaitions proposer un travail d’histori<strong>en</strong> tourné vers la <strong>mise</strong> <strong>en</strong> <strong>valeur</strong> <strong>du</strong><br />
<strong>patrimoine</strong> <strong>culturel</strong> bâti, il nous a semblé pertin<strong>en</strong>t <strong>de</strong> nous p<strong>en</strong>cher sur un travail <strong>de</strong> reconstitution<br />
virtuelle. Bruno Dufour-Coppolani a montré la voie <strong>en</strong> 1994. Professeur d’Arts plastiques<br />
et peintre <strong>de</strong> nombreux trompe-l’oeil à Saint-Lô 339 , il lui fut <strong>de</strong>mandé à cette date <strong>de</strong><br />
redonner une vie à l’église Notre-Dame. Il accepta à la condition que la « toile t<strong>en</strong><strong>du</strong>e sur la<br />
place et le visage d’une église soit l’occasion d’<strong>en</strong> pénétrer le cœur » 340 . De son travail il dit :<br />
Tout fut mis <strong>en</strong> œuvre pour reconstituer le plus fidèlem<strong>en</strong>t possible, et à l’échelle exacte <strong>de</strong> l’édifice,<br />
l’architectonique et les nom<strong>en</strong>clatures <strong>de</strong> la faça<strong>de</strong> per<strong>du</strong>e, […] mais je souhaitais dépasser<br />
le simple travail d’illusion, aussi ai-je proposé une suite qui pr<strong>en</strong>drait à revers la représ<strong>en</strong>tation<br />
servile et illusoire <strong>du</strong> trompe-l’œil. […]. Chaque fragm<strong>en</strong>t est <strong>de</strong>v<strong>en</strong>u un lieu d’interv<strong>en</strong>tion pictural<br />
répondant au désir double et contradictoire d’épouser et <strong>de</strong> réfuter le souv<strong>en</strong>ir <strong>de</strong> la reconstitution.<br />
J’ai ainsi pu opérer un difficile retour à la surface libre <strong>de</strong> contraintes mais chargé <strong>de</strong> mémoire 341 .<br />
On lit ici nombre <strong>de</strong>s interrogations qui nous anim<strong>en</strong>t dans notre projet. Tout tourne<br />
autour <strong>de</strong> la reconstitution et <strong>de</strong> l’impossible réalité. Comm<strong>en</strong>t, faute <strong>de</strong> pouvoir repro<strong>du</strong>ire<br />
la réalité, <strong>de</strong> lutter contre le temps <strong>en</strong> somme, proposer d’aller au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> la réalité ? Et surtout<br />
comm<strong>en</strong>t la transc<strong>en</strong><strong>de</strong>r ? En sus <strong>de</strong> ces questions que l’on pourrait qualifier d’éthiques<br />
ou <strong>de</strong> philosophiques sur la matière, Bruno Dufour-Coppolani qui est peintre, se pose <strong>de</strong>s<br />
questions qui sont relatives à l’échelle, à la matière, au support. Là <strong>en</strong>core, nous le rejoignons<br />
dans ses questionnem<strong>en</strong>ts, bi<strong>en</strong> que le mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> représ<strong>en</strong>tation soit différ<strong>en</strong>t puisque la<br />
reconstitution est pour nous immatérielle : ceci ne nous abstrait <strong>en</strong> ri<strong>en</strong> <strong>de</strong> résoudre les<br />
problèmes d’échelle ou <strong>de</strong> texture.<br />
Un autre travail, dont il a été fait m<strong>en</strong>tion plus haut a permis d’<strong>en</strong>gager une réflexion<br />
sur le <strong>de</strong>v<strong>en</strong>ir <strong>de</strong> la mémoire <strong>de</strong> la ville <strong>de</strong> Saint-Lô. Il s’agit <strong>de</strong> la reconstitution virtuelle <strong>de</strong><br />
Saint-Lô avant-guerre <strong>par</strong> l’Association « Saint-Lô retrouvé ». Fédérant les générations autour<br />
d’un projet utile à la cité, ce travail <strong>de</strong> très gran<strong>de</strong> qualité, à la fois esthétiquem<strong>en</strong>t et historiquem<strong>en</strong>t,<br />
n’écartant pas l’émotion, sans s’appesantir, est un exemple à suivre. Il s’adresse<br />
à un public large sans sombrer dans la démagogie. Il est une chose que <strong>de</strong> rassembler <strong>de</strong>s<br />
personnes d’âges et <strong>de</strong> conditions différ<strong>en</strong>ts autour d’un projet qui les intéresse, il <strong>en</strong> est<br />
une autre que <strong>de</strong> remporter un succès populaire. L’expéri<strong>en</strong>ce montre que les plus âgés,<br />
peu <strong>en</strong>clins à l’admiration <strong>de</strong>vant les nouvelles technologies manifest<strong>en</strong>t leur émotion <strong>en</strong><br />
338. Martine Callias-Bey, « Les vitraux <strong>de</strong> la chapelle Saint-Thomas <strong>en</strong> l’église Notre-Dame <strong>de</strong> Saint-Lô<br />
(Manche) », Mémoire <strong>de</strong> Maîtrise, dir. Louis Godrecki, Faculté <strong>de</strong>s Lettres, Paris IV.<br />
339. Le plus connu, réalisé <strong>en</strong> 1987 est celui qui habille le mur aveugle <strong>de</strong> 300 m 2 <strong>du</strong> bâtim<strong>en</strong>t « Groupama ».<br />
http//perso.orange. fr/<strong>du</strong>four-coppolani/.<br />
340. Philippe Bertin, Saint-Lô, R<strong>en</strong>nes, Éditions Ouest-france, 1998, p. 105.<br />
341. http//perso.orange. fr/<strong>du</strong>four-coppolani/.<br />
Schedae, 2008, prépublication n°10, (p.1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf<br />
83
84<br />
Fig. 14 : Mise <strong>en</strong> place <strong>de</strong>s lais<br />
(Source : Collection Bruno Dufour-Coppolani)<br />
visionnant ce que nous nous risquons ici à appeler un docum<strong>en</strong>taire, ce qui montre que le<br />
message historique, relatif au vécu est bi<strong>en</strong> passé et que le support ne prime pas.<br />
<strong>La</strong> réalité virtuelle – laquelle, <strong>en</strong> l’occurr<strong>en</strong>ce, ne signifie que peu <strong>de</strong> choses pour ce<br />
public <strong>en</strong> termes <strong>de</strong> technologie – s’<strong>en</strong> trouve <strong>du</strong> même coup presque réhabilitée. Cette<br />
expéri<strong>en</strong>ce fut m<strong>en</strong>ée à peu près dans le même temps qu’un autre projet <strong>de</strong> Bruno Dufour-<br />
Coppolani dans le cadre plus large <strong>de</strong>s villes <strong>de</strong> la reconstruction, dont on sait qu’elles continu<strong>en</strong>t<br />
<strong>de</strong> faire débat. Là aussi sont interv<strong>en</strong>ues les technologies nouvelles – et l’IUT – puisqu’il<br />
s’agissait <strong>de</strong> proposer une colorisation <strong>de</strong>s faça<strong>de</strong>s d’avant-guerre, reconstituées, <strong>de</strong> la rue<br />
Torteron et <strong>de</strong> la rue Havin <strong>par</strong> projection <strong>de</strong> motifs, soit huit séries thématiques, avec pour<br />
objectif d’« inciter à la couleur et créer <strong>de</strong> « nouvelles s<strong>en</strong>sations urbaines ».<br />
Fig. 15 : Urbanités<br />
(Source : http://urbanites.free.fr)<br />
Ce fut un grand succès populaire qui réunit plusieurs milliers <strong>de</strong> personnes et qui semble<br />
avoir permis d’<strong>en</strong>tamer une réflexion, jusque-là refusée au nom <strong>de</strong> l’histoire <strong>de</strong> la ville, sur<br />
la possibilité et la pertin<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> r<strong>en</strong>dre ce projet réel. Tout ceci réuni montre que d’une <strong>par</strong>t<br />
la ville reconstruite se cherche et se trouve une âme dans sa mo<strong>de</strong>rnité, d’autre <strong>par</strong>t que<br />
son <strong>patrimoine</strong> est tout à fait intégré comme élém<strong>en</strong>t dynamisant <strong>du</strong> territoire.<br />
Schedae, 2008, prépublication n°10, (p. 1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf
Dans la visite virtuelle <strong>du</strong> Saint-Lô d’avant-guerre, l’église Notre-Dame est bi<strong>en</strong> évi<strong>de</strong>mm<strong>en</strong>t<br />
reconstituée, <strong>de</strong> fort belle manière, avec sa faça<strong>de</strong> et ses <strong>de</strong>ux flèches. Il ne s’agira pas<br />
<strong>de</strong> répéter ce qui a déjà été fait mais <strong>de</strong> permettre au visiteur <strong>de</strong> pénétrer virtuellem<strong>en</strong>t<br />
dans le lieu. Bi<strong>en</strong> que nous ne puissions <strong>en</strong>core préjuger <strong>de</strong> ri<strong>en</strong>, il ap<strong>par</strong>aît raisonnable <strong>de</strong><br />
p<strong>en</strong>ser que la difficulté ne sera pas majeure quant à la reconstitution <strong>du</strong> corps <strong>du</strong> bâtim<strong>en</strong>t.<br />
D’une <strong>par</strong>t, l’édifice <strong>en</strong> tant que tel est un atout considérable et d’autre <strong>par</strong>t, les <strong>de</strong>scriptions<br />
qui <strong>en</strong> sont faites dans les docum<strong>en</strong>ts-sources sembl<strong>en</strong>t suffisants pour une restitution précise<br />
342 . Cette <strong>par</strong>tie <strong>du</strong> travail représ<strong>en</strong>te l’étu<strong>de</strong>, dont on pourrait dire qu’elle est <strong>de</strong>v<strong>en</strong>ue<br />
« classique » dans la démarche <strong>de</strong> reconstitution virtuelle <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong> bâti. En revanche,<br />
nous ambitionnons <strong>de</strong> nous <strong>en</strong>gager sur <strong>de</strong>ux pistes lesquelles poseront avec certitu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s<br />
difficultés. Nous souhaitons faire la <strong>par</strong>t belle à la question <strong>de</strong> la lumière dans le travail <strong>de</strong><br />
reconstitution. Il faudra donc être <strong>en</strong> mesure <strong>de</strong> donner une idée la plus exacte possible <strong>de</strong> ce<br />
que fur<strong>en</strong>t les vitraux aux différ<strong>en</strong>tes époques. Quelques vitraux subsist<strong>en</strong>t mais, la majeure<br />
<strong>par</strong>tie, ayant subi les outrages <strong>du</strong> temps, a dis<strong>par</strong>u.<br />
Fig. 16 : Vitrail royal offert <strong>par</strong> Louis XI à Saint-Lô <strong>en</strong> 1470<br />
(Source : Musée <strong>de</strong>s Beaux-Arts <strong>de</strong> Saint-Lô)<br />
Le travail <strong>de</strong> reconstitution sera très complexe car peu <strong>de</strong> traces conséqu<strong>en</strong>tes <strong>de</strong>meur<strong>en</strong>t,<br />
mais il nous <strong>en</strong>gage sur la voie passionnante <strong>de</strong> la recherche <strong>de</strong> sources fragm<strong>en</strong>taires<br />
lesquelles, une fois assemblées, recoupées, interprétées simuleront ce que fut un jour la réalité.<br />
Les vitraux nous offriront, <strong>en</strong> outre, l’opportunité <strong>de</strong> réfléchir à la question <strong>de</strong> la restitution<br />
virtuelle <strong>de</strong> la lumière naturelle – et divine ici – dans un édifice, à la suite <strong>du</strong> très beau<br />
travail <strong>de</strong> Sophie Ma<strong>de</strong>leine dans sa thèse. Cette préoccupation dans un édifice religieux<br />
nous <strong>par</strong>aît d’une importance <strong>de</strong> tout premier ordre au mom<strong>en</strong>t <strong>de</strong> sa virtualisation, quand<br />
on sait combi<strong>en</strong> la lumière fut déterminante dans l’évolution <strong>de</strong>s styles architecturaux. Nous<br />
voudrions, <strong>en</strong> outre, nous p<strong>en</strong>cher sur la question <strong>de</strong> la restitution sonore. Nous avons dit<br />
précé<strong>de</strong>mm<strong>en</strong>t combi<strong>en</strong> il nous <strong>par</strong>aissait nécessaire <strong>de</strong> développer la dim<strong>en</strong>sion s<strong>en</strong>sorielle<br />
<strong>de</strong>s restitutions virtuelles d’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>ts historiques. De la même manière qu’on ne peut<br />
s’interroger sur la restitution <strong>de</strong> l’architecture religieuse sans faire la <strong>par</strong>t belle à la lumière,<br />
il nous <strong>par</strong>aît indisp<strong>en</strong>sable <strong>de</strong> consacrer une <strong>par</strong>tie <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong> à l’acoustique, ce, d’autant<br />
que l’église Notre-Dame possè<strong>de</strong> <strong>de</strong>s orgues.<br />
Une fois le modèle conçu, le visiteur virtuel <strong>de</strong>vra pouvoir accé<strong>de</strong>r aux différ<strong>en</strong>tes <strong>par</strong>ties<br />
<strong>de</strong> l’édifice restituées dans l’état dans lequel elles se trouvai<strong>en</strong>t juste avant les bombar<strong>de</strong>m<strong>en</strong>ts.<br />
Toutefois, la reconstitution virtuelle permettant, comme dit plus haut, une superposition <strong>de</strong>s<br />
342. Toute la correspondance relative à l’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> <strong>de</strong> l’église comme les <strong>de</strong>vis qui l’accompagn<strong>en</strong>t, archivés à<br />
la Médiathèque <strong>de</strong> l’Architecture et <strong>du</strong> Patrimoine <strong>de</strong> Paris nous seront extrêmem<strong>en</strong>t précieux.<br />
Schedae, 2008, prépublication n°10, (p.1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf<br />
85
86<br />
élém<strong>en</strong>ts et une juxtaposition <strong>de</strong>s styles, nous souhaitons égalem<strong>en</strong>t proposer <strong>de</strong> restituer<br />
les différ<strong>en</strong>tes étapes <strong>de</strong> la construction <strong>de</strong> l’édifice, dans la mesure où elles nous sont indiquées<br />
<strong>par</strong> les sources. Ce sera <strong>en</strong> <strong>par</strong>ticulier le cas pour les vitraux puisque ceux-ci ont subi<br />
<strong>de</strong>s évolutions nombreuses, et que la pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’immédiat avant-guerre n’est pas, et <strong>de</strong><br />
loin, la plus intéressante. Lesdites sources doiv<strong>en</strong>t être <strong>mise</strong>s à disposition <strong>du</strong> visiteur <strong>par</strong><br />
un simple clic <strong>de</strong> souris, au moins pour une <strong>par</strong>tie. Ce sont elles qui sont à la base <strong>de</strong> toute<br />
l’étu<strong>de</strong> et leur exposition donne tout son crédit au travail <strong>en</strong>gagé, <strong>en</strong> même temps que, dans<br />
un souci pédagogique, elles offr<strong>en</strong>t un accès facile à la méthodologie. R<strong>en</strong><strong>du</strong>es accessibles <strong>de</strong><br />
manière pertin<strong>en</strong>te, elles doiv<strong>en</strong>t pouvoir ai<strong>de</strong>r à la composition <strong>de</strong> dossiers pédagogiques<br />
à <strong>de</strong>stination <strong>de</strong>s <strong>en</strong>seignants d’histoire et <strong>de</strong>s élèves (<strong>de</strong>s niveaux primaire, collège et lycée).<br />
Nous n’oublions pas que ces mêmes sources, ainsi que la reconstitution virtuelle – n’ont pas<br />
pour seul objectif d’être <strong>mise</strong>s à disposition <strong>du</strong> grand public. Elles doiv<strong>en</strong>t aussi apporter<br />
leur pierre à l’édifice <strong>de</strong> la recherche <strong>en</strong> matière <strong>de</strong> <strong>mise</strong> <strong>en</strong> <strong>valeur</strong> <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong> bâti <strong>par</strong><br />
la réalité virtuelle, <strong>en</strong> faisant ainsi honneur à notre équipe d’accueil.<br />
Ce que nous savons <strong>de</strong> l’église Notre-Dame sur le plan architectural nous est ess<strong>en</strong>tiellem<strong>en</strong>t<br />
livré <strong>par</strong> l’édifice lui-même. Le bâtim<strong>en</strong>t a beaucoup souffert p<strong>en</strong>dant la guerre,<br />
et nous l’avons évoqué ci-<strong>de</strong>ssus, mais la structure même <strong>du</strong> bâtim<strong>en</strong>t a été conservée.<br />
Fig. 17 : Plan <strong>de</strong> 1944<br />
(Source : Gabrielle Thibout)<br />
<strong>La</strong> <strong>de</strong>struction <strong>de</strong> l’église représ<strong>en</strong>te incontestablem<strong>en</strong>t une perte considérable. <strong>La</strong> portée<br />
symbolique <strong>en</strong> est énorme. Outre l’édifice, ce sont les sources qui l’évoqu<strong>en</strong>t qui sont<br />
per<strong>du</strong>es. Les publications, relativem<strong>en</strong>t nombreuses au <strong>de</strong>meurant, sembl<strong>en</strong>t abon<strong>de</strong>r <strong>de</strong><br />
dates et d’anecdotes précises. En réalité, les unes cit<strong>en</strong>t les autres, faute d’avoir eu accès aux<br />
sources, dont il ne reste presque ri<strong>en</strong>. Un rapport <strong>de</strong> la Société d’Archéologie et d’Histoire<br />
naturelle <strong>du</strong> dé<strong>par</strong>tem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> la Manche, repr<strong>en</strong>ant ses activités dans les ruines à <strong>par</strong>tir <strong>du</strong><br />
mois d’octobre 1944, note dans un procès-verbal <strong>de</strong> séance :<br />
Schedae, 2008, prépublication n°10, (p. 1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf
L’abbé Jacqueline rapporte la <strong>de</strong>struction <strong>de</strong>s archives <strong>de</strong> la fabrique <strong>de</strong> Notre-Dame <strong>de</strong> Saint-<br />
Lô qui ne comportai<strong>en</strong>t pas moins <strong>de</strong> 250 liasses. Les docum<strong>en</strong>ts les plus anci<strong>en</strong>s datai<strong>en</strong>t <strong>du</strong><br />
XIVe siècle.<br />
On <strong>par</strong>le moins <strong>de</strong> l’inc<strong>en</strong>die qui a totalem<strong>en</strong>t ravagé le bâtim<strong>en</strong>t qui abritait les archives<br />
<strong>du</strong> dé<strong>par</strong>tem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>puis 1845. Pour l’historiographie pourtant, les 85 000 liasses qui ont brûlé<br />
ont emporté à jamais l’ess<strong>en</strong>tiel <strong>de</strong> la vie passée <strong>de</strong> Saint-Lô et <strong>du</strong> dé<strong>par</strong>tem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> la Manche<br />
et bi<strong>en</strong> au-<strong>de</strong>là 343 . Certes, la <strong>de</strong>struction d’un bâtim<strong>en</strong>t est plus spectaculaire que la perte <strong>de</strong><br />
ce qu’il abritait mais quels que soi<strong>en</strong>t les efforts fournis, il ne sera jamais possible <strong>de</strong> pallier<br />
ces manques.<br />
Ce qui nous reste <strong>en</strong> est d’autant plus précieux. À ce titre, la mémoire vivante que représ<strong>en</strong>te<br />
la génération qui a connu le Saint-Lô d’avant-guerre est ess<strong>en</strong>tielle et doit être interrogée,<br />
comme une source <strong>de</strong> première main, avant que le temps ne fasse <strong>de</strong> nouveau son<br />
œuvre. L’expéri<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> « Saint-Lô Retrouvé » <strong>en</strong> est la meilleure preuve. Par ailleurs, toutes<br />
les archives, relevés, rapports, correspondances c<strong>en</strong>tralisés dans les services <strong>par</strong>isi<strong>en</strong>s <strong>de</strong>s<br />
monum<strong>en</strong>ts historiques 344 , permett<strong>en</strong>t aujourd’hui <strong>de</strong> retrouver une <strong>par</strong>tie <strong>de</strong> la mémoire<br />
d’un territoire. Enfin, l’imprimerie a permis la diffusion <strong>de</strong>s écrits au-<strong>de</strong>là <strong>du</strong> territoire saintlois.<br />
Comme dans tout travail <strong>de</strong> recherche, la première tâche est <strong>de</strong> faire l’inv<strong>en</strong>taire <strong>de</strong>s<br />
sources. C’est sur cette base que nous pouvons aujourd’hui travailler. Il faut distinguer nettem<strong>en</strong>t<br />
<strong>de</strong>ux temps consacrés à la collecte <strong>de</strong>s sources. Pour cette étu<strong>de</strong> pré<strong>par</strong>atoire, un<br />
premier état a été dressé. <strong>La</strong> docum<strong>en</strong>tation réunie a permis, d’une <strong>par</strong>t, <strong>de</strong> rédiger le prés<strong>en</strong>t<br />
texte, d’autre <strong>par</strong>t, et dans un <strong>de</strong>uxième temps, elle <strong>de</strong>vra être complétée sur la base <strong>de</strong>s<br />
pistes nouvelles qu’elle laisse <strong>en</strong>visager et <strong>de</strong>s découvertes que nous ferons.<br />
L’édifice, tel qu’il est conservé, tel qu’il fut restauré, est une source ess<strong>en</strong>tielle <strong>de</strong> savoir,<br />
avantageusem<strong>en</strong>t complétée <strong>par</strong> les plans <strong>de</strong> la reconstruction. Ces <strong>de</strong>rniers sont conservés<br />
à la Médiathèque <strong>de</strong> l’Architecture et <strong>du</strong> Patrimoine à Paris 345 . <strong>La</strong> <strong>par</strong>tie iconographique est<br />
conséqu<strong>en</strong>te. Avant guerre, <strong>de</strong>s tableaux fur<strong>en</strong>t peints <strong>par</strong> nombre d’artistes, dont un illustre,<br />
Camille Corot, qui peignit <strong>en</strong> 1833 une Vue générale <strong>de</strong> Saint-Lô 346 . Beaucoup <strong>de</strong> lithogravures<br />
et <strong>de</strong> <strong>de</strong>ssins fur<strong>en</strong>t réalisés <strong>par</strong> Pierre-Désiré Levavasseur (1810-1900).<br />
Conservée au musée, la collection périt <strong>en</strong> 1944 mais <strong>par</strong> chance <strong>de</strong>s cartes postales<br />
repro<strong>du</strong>isant ses vues <strong>de</strong> Saint-Lô avai<strong>en</strong>t été éditées au début <strong>du</strong> siècle. Ces cartes postales,<br />
dont certaines ont été repro<strong>du</strong>ites dans le texte, et qui sembl<strong>en</strong>t si anodines lorsque nous<br />
nous prom<strong>en</strong>ons sont aujourd’hui <strong>de</strong>s images très précieuses pour l’histori<strong>en</strong>. En effet, avec<br />
le XX e siècle comm<strong>en</strong>ça la diffusion <strong>de</strong> la photographie et les clichés pris à Saint-Lô fur<strong>en</strong>t<br />
nombreux et <strong>par</strong> la grâce <strong>du</strong> courrier postal, et <strong>de</strong> l’esprit conservateur <strong>de</strong> leurs <strong>de</strong>stinataires,<br />
<strong>de</strong>meurèr<strong>en</strong>t. Évi<strong>de</strong>mm<strong>en</strong>t, beaucoup donn<strong>en</strong>t une vue d’<strong>en</strong>semble, magnifiant la domination<br />
<strong>de</strong>s flèches <strong>de</strong> Notre-Dame sur la ville. Néanmoins, et fort heureusem<strong>en</strong>t, quelques-unes<br />
d’<strong>en</strong>tre elles nous sont <strong>par</strong>v<strong>en</strong>ues, qui montr<strong>en</strong>t l’intérieur <strong>de</strong> l’édifice. Bi<strong>en</strong> qu’<strong>en</strong> noir et<br />
blanc, ces sources nous seront fort utiles. De surcroît, elles offr<strong>en</strong>t un r<strong>en</strong><strong>du</strong> plus proche <strong>de</strong> la<br />
réalité que nombre <strong>de</strong> <strong>de</strong>ssins. Les photographies <strong>de</strong>s ruines sont elles aussi <strong>de</strong>s sources sur<br />
lesquelles nous <strong>de</strong>vons nous attar<strong>de</strong>r. Si toutes donn<strong>en</strong>t l’impression <strong>de</strong> se ressembler et<br />
qu’elles montr<strong>en</strong>t les malheureux restes d’un édifice <strong>en</strong>foui sous les gravats, il n’<strong>en</strong> <strong>de</strong>meure<br />
343. <strong>La</strong> série H rec<strong>en</strong>sait « le plus beau fonds d’abbayes <strong>de</strong> toute la France, fonds absolum<strong>en</strong>t incom<strong>par</strong>able<br />
<strong>par</strong> le nombre <strong>de</strong>s docum<strong>en</strong>ts et <strong>par</strong> la r<strong>en</strong>ommée <strong>de</strong> ses établissem<strong>en</strong>ts monastiques dont les bi<strong>en</strong>s<br />
s’ét<strong>en</strong>dai<strong>en</strong>t souv<strong>en</strong>t <strong>en</strong> Angleterre, et dans les îles anglo-norman<strong>de</strong>s, voire <strong>en</strong> Bretagne et <strong>en</strong> Italie » cité<br />
<strong>par</strong> Maurice <strong>La</strong>ntier, Saint-Lô au Bûcher : le martyre d’une cité <strong>de</strong> Basse-Normandie p<strong>en</strong>dant la secon<strong>de</strong><br />
guerre mondiale, juin-juillet 1944, Saint-Lô, Association Saint-Lô 44, p. 161.<br />
344. Séries 82/50/2016, 82/50/2017.<br />
345. Séries 82/50/1017, 82/50/1018. 82/50/2016,82/50/2017.<br />
346. Tableau conservé au musée <strong>du</strong> Louvre à Paris.<br />
Schedae, 2008, prépublication n°10, (p.1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf<br />
87
88<br />
pas moins que les différ<strong>en</strong>ts angles <strong>de</strong> prise <strong>de</strong> vue mett<strong>en</strong>t au jour <strong>de</strong>s détails riches<br />
d’<strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>ts.<br />
Les ressources textuelles sont <strong>de</strong> nature différ<strong>en</strong>te. Des textes anci<strong>en</strong>s <strong>de</strong>meur<strong>en</strong>t, dont<br />
certains ont été répertoriés voire exploités pour <strong>de</strong>s recherches 347 . Nous n’avons pour l’heure<br />
pas <strong>en</strong>core <strong>en</strong>tamé ce travail <strong>de</strong> collectes <strong>de</strong> sources anci<strong>en</strong>nes, passionnant, mais qui ne<br />
trouvait pas d’utilité <strong>par</strong>ticulière dans cette phase <strong>de</strong> recherche. Les textes anci<strong>en</strong>s auxquels<br />
nous avons eu accès sont pour l’instant ceux qui ont été utilisés <strong>par</strong> d’autres dans leurs travaux.<br />
Là <strong>en</strong>core il faut différ<strong>en</strong>cier <strong>en</strong>tre eux. Pour les publications d’avant-guerre, nous disposons<br />
pour l’ess<strong>en</strong>tiel <strong>de</strong> trois ouvrages <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> importance. Celui <strong>de</strong> R<strong>en</strong>é Toustain <strong>de</strong><br />
Billy dont l’ouvrage Mémoire <strong>de</strong> l’Histoire <strong>du</strong> Cot<strong>en</strong>tin et <strong>de</strong> ses villes, ne fut publié qu’<strong>en</strong><br />
1912, <strong>par</strong> la Société d’Archéologie et d’Histoire naturelle <strong>de</strong> la Manche, dans une version<br />
revue et annotée. Cet opus est pour nous très important à plus d’un titre. En premier lieu,<br />
rédigé au XVIIIe siècle, le texte comporte moult détails et anecdotes dont nous ne conservons<br />
plus la trace <strong>par</strong> ailleurs, permettant d’aller au-<strong>de</strong>là <strong>du</strong> simple relevé chronologique :<br />
Ce que je dis ici avoit été ignoré <strong>de</strong> tous les Cot<strong>en</strong>tinois jusqu’à nos jours ; mais <strong>en</strong> 1677, Messire<br />
Jacques <strong>de</strong> Matignon, évèque <strong>de</strong> Condom, passant <strong>par</strong> Tulle, le jour que l’on faisoit <strong>en</strong> cette<br />
ville une fête <strong>de</strong> cette sainte relique <strong>de</strong> saint Lo, et trouvant, (<strong>par</strong> tous) les r<strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>ts possibles,<br />
que c’étoi<strong>en</strong>t celles <strong>du</strong> saint évèque <strong>de</strong> Coutances qui y avoi<strong>en</strong>t été transférées au IXe siècle,<br />
comme <strong>en</strong> un lieu éloigné <strong>de</strong>s incursions <strong>de</strong>s infidèles, il fit tant auprès <strong>de</strong> Messire Jules Mascaron,<br />
alors évèque <strong>de</strong> Tulle, qu’il <strong>en</strong> obtint une <strong>par</strong>tie, ce fur<strong>en</strong>t trois os, la première vertèbre <strong>du</strong><br />
col, que les anatomistes appell<strong>en</strong>t l’atlas, et les <strong>de</strong>ux palettes <strong>de</strong>s g<strong>en</strong>oux ; et, comme ce prélat<br />
est né <strong>en</strong> la ville <strong>de</strong> Saint-Lo, et que feue Madame la douairière <strong>de</strong> Matignon y <strong>de</strong>meuroit au<br />
temps dont nous <strong>par</strong>lons, il résolut d’<strong>en</strong> faire prés<strong>en</strong>t à cette église <strong>de</strong> Saint-Lo. Il fit donc <strong>en</strong>chasser<br />
ces reliques dans un beau buste d’arg<strong>en</strong>t, et les <strong>en</strong>voya <strong>en</strong> notre ville.<br />
Le lundi <strong>de</strong> la P<strong>en</strong>tecôte 22e mai 1679, fut choisi pour la cérémonie <strong>de</strong> cette translation sol<strong>en</strong>nelle.<br />
Les seigneurs évèques <strong>de</strong> Bayeux et <strong>de</strong> Coutances y ayant été invités et s’y étant r<strong>en</strong><strong>du</strong>s, on<br />
fut les quérir <strong>en</strong> l’église <strong>de</strong> l’Abbaye, où elles avoi<strong>en</strong>t été déposées, et les apporta-t-on processionnellem<strong>en</strong>t<br />
<strong>en</strong> l’église Notre-Dame.<br />
<strong>La</strong> chasse était portée <strong>par</strong> <strong>de</strong>ux prètres vètus <strong>en</strong> diacres, sur une espèce <strong>de</strong> civière richem<strong>en</strong>t<br />
ornée, précédée <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> c<strong>en</strong>t ecclésiastiques <strong>en</strong> échappes, avec une excell<strong>en</strong>te musique suivie<br />
<strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux prélats, dont celui <strong>de</strong> Bayeux étoit à la droite, <strong>de</strong> Madame la douairière <strong>de</strong> Matignon,<br />
<strong>de</strong>s officiers <strong>de</strong> la ville <strong>en</strong>suite, et d’un nombre innombrable <strong>de</strong> peuple <strong>de</strong> toutes sortes <strong>de</strong> qualités,<br />
v<strong>en</strong>us à cette fète <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> dix lieues à la ron<strong>de</strong>. Les poëtes <strong>de</strong> la ville fir<strong>en</strong>t plusieurs<br />
sortes <strong>de</strong> vers latins et françois sur ce sujet qui fur<strong>en</strong>t imprimés 348 .<br />
Le récit <strong>de</strong> Toustain <strong>de</strong> Billy permet d’avoir accès à un texte qui va bi<strong>en</strong> au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> la chronologie.<br />
En second lieu, il cite abondamm<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s sources anci<strong>en</strong>nes qui vi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t attester<br />
ses propos. En troisième lieu, quelques docum<strong>en</strong>ts iconographiques vi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t étayer le texte.<br />
Enfin, les notes apport<strong>en</strong>t un éclairage d’un très grand intérêt.<br />
C’est <strong>en</strong>suite le livre <strong>du</strong> chanoine Houël, Histoire <strong>de</strong> la ville <strong>de</strong> Saint-Lô, publié <strong>en</strong> 1825<br />
et réédité <strong>en</strong> 1992, lui aussi fort instructif. Le caractère polémique <strong>de</strong> ses propos, donnant<br />
certes un ton amusant à la lecture, l’empêche toutefois souv<strong>en</strong>t <strong>de</strong> citer <strong>de</strong>s sources, <strong>de</strong>s noms,<br />
<strong>de</strong>s référ<strong>en</strong>ces qui serai<strong>en</strong>t fort utiles à l’histori<strong>en</strong>, pour recouper les données. Ne nous rest<strong>en</strong>t<br />
347. Ceux retrouvés <strong>par</strong> Élisabeth Callias-Bey pour son travail sur les vitraux <strong>de</strong> Notre-Dame dans <strong>de</strong>s livres <strong>de</strong><br />
compte <strong>par</strong> exemple.<br />
348. Extrait <strong>du</strong> récit <strong>de</strong> la cérémonie <strong>de</strong> re<strong>mise</strong> <strong>de</strong>s reliques <strong>de</strong> saint Lo à l’église Notre-Dame ; <strong>de</strong>s notes <strong>en</strong><br />
fin <strong>de</strong> volume apport<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s précisions et <strong>de</strong>s variantes, in R<strong>en</strong>é Toustain <strong>de</strong> Billy, Mémoires sur l’histoire<br />
<strong>du</strong> Cot<strong>en</strong>tin et <strong>de</strong> ses villes : villes <strong>de</strong> Saint-Lô et Car<strong>en</strong>tan, Société d’archéologie et d’histoire naturelle<br />
<strong>du</strong> dé<strong>par</strong>tem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> la Manche, 1912, p. 151-152.<br />
Schedae, 2008, prépublication n°10, (p. 1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf
alors que <strong>de</strong>s assertions ou au contraire <strong>de</strong>s dénégations, l’objectif <strong>du</strong> chanoine étant toujours<br />
d’échapper au <strong>de</strong>voir <strong>de</strong> justification :<br />
Cette (démonstration <strong>du</strong> fait que la ville conserva longtemps le nom <strong>de</strong> Sainte-Croix après<br />
l’érection <strong>de</strong> la chapelle) dissertation est EMMINEMMENT utile ; pour effacer les impressions<br />
DANGEREUSES qu’aurai<strong>en</strong>t pu jeter dans les esprits les PERNICIEUSES suggestions <strong>du</strong> curé<br />
<strong>de</strong> Maneval, qui a eu la TEMERITE <strong>de</strong> prét<strong>en</strong>dre qu’elle fut toujours appelée Saint-Lo ; mais<br />
nous possédons <strong>de</strong>s témoins irréfragables pour confondre ces impostures ; ils serviront <strong>en</strong>core<br />
à prouver aux plus incré<strong>du</strong>les, que nous n’admettrons ri<strong>en</strong> sans preuves, et que quand nous<br />
disons quelque chose <strong>en</strong>tre Normands, nos <strong>par</strong>oles sont ce qu’il y a <strong>de</strong> plus certain, dans le<br />
mon<strong>de</strong> moral, et <strong>par</strong>ticulièrem<strong>en</strong>t dans une histoire qui nous a coûté tant <strong>de</strong> veilles, <strong>de</strong> papier<br />
et d’huile ; ce n’est que d’après un mûr exam<strong>en</strong> que nous nous sommes permis les plus légères<br />
assertions ; je désire vivem<strong>en</strong>t que ce principe soit reconnu dès le début, <strong>par</strong>ce que j’éviterai à<br />
l’av<strong>en</strong>ir beaucoup <strong>de</strong> justifications : je me permettrai même peu <strong>de</strong> r<strong>en</strong>vois et <strong>de</strong> notes, qui,<br />
tournant au profit <strong>de</strong>s éditeurs, prouv<strong>en</strong>t moins l’érudition chez ceux qui les rédig<strong>en</strong>t que le<br />
désir d’<strong>en</strong> montrer et <strong>de</strong> grossir inutilem<strong>en</strong>t le volume 349 .<br />
C’est <strong>en</strong>fin l’œuvre <strong>de</strong> l’Abbé Bernard 350 , écrit <strong>en</strong> 1884. Il a bi<strong>en</strong> failli ne jamais <strong>par</strong>v<strong>en</strong>ir<br />
jusqu’à nous : conservé aux Archives dé<strong>par</strong>tem<strong>en</strong>tales <strong>de</strong> la Manche, le manuscrit original,<br />
Notes historiques sur le dé<strong>par</strong>tem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> la Manche, a brûlé avec le reste dans la nuit <strong>du</strong> 6<br />
juin 1944. Sa trace fut sauvée <strong>par</strong> la Société d’Archéologie et d’Histoire naturelle <strong>de</strong> la Manche<br />
qui avait <strong>en</strong>visagé <strong>de</strong> le publier dans son intégralité, et avait <strong>de</strong> ce fait procédé à l’écriture<br />
d’une version dactylographiée. Par chance, la <strong>par</strong>tie consacrée au canton <strong>de</strong> Saint-Lô avait<br />
été intégralem<strong>en</strong>t réalisée. Et cette copie fut retrouvée <strong>par</strong> l’abbé Jacqueline dans les ruines<br />
<strong>de</strong> la maison occupée <strong>par</strong> l’abbé Frémy. À la suite <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux autres, il vi<strong>en</strong>t donc nous rapporter<br />
une histoire <strong>de</strong> Saint-Lô. Il appuie pour beaucoup son propos sur les étu<strong>de</strong>s précéd<strong>en</strong>tes.<br />
C’est donc un état <strong>de</strong> l’art qui a permis <strong>de</strong> poser le sujet et <strong>de</strong> r<strong>en</strong>dre crédible et souhaitable<br />
sa réalisation. Fort heureusem<strong>en</strong>t, les sources anci<strong>en</strong>nes ne se limit<strong>en</strong>t pas à ces trois<br />
ouvrages. D’autres publications, comme celle <strong>de</strong> Gabrielle Thibout, L’église Notre-Dame <strong>de</strong><br />
Saint-Lô, ses campagnes <strong>de</strong> construction 351 , si elles sont postérieures aux bombar<strong>de</strong>m<strong>en</strong>ts<br />
s’appui<strong>en</strong>t sur <strong>de</strong>s sources exploitées avant les bombar<strong>de</strong>m<strong>en</strong>ts :<br />
<strong>La</strong> plu<strong>par</strong>t <strong>de</strong>s r<strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>ts cont<strong>en</strong>us dans cette étu<strong>de</strong> ont été fournis <strong>par</strong> <strong>de</strong>s textes conservés,<br />
jadis, aux Archives dé<strong>par</strong>tem<strong>en</strong>tales <strong>de</strong> la Manche, <strong>en</strong> <strong>par</strong>ticulier dans les séries G (Archives<br />
<strong>de</strong> la fabrique », H (6 liasses sur Notre-Dame dans le fonds <strong>de</strong> l’abbaye <strong>de</strong> Sainte-Croix) et B<br />
(baillage <strong>de</strong> Saint-Lô, que j’avais consultées avant 1944. Elles ont été brûlées <strong>en</strong> juin 194, mais<br />
avai<strong>en</strong>t été heureusem<strong>en</strong>t publiées <strong>en</strong> <strong>par</strong>tie dans <strong>de</strong>s ouvrages <strong>de</strong> la fin <strong>du</strong> XIXe siècle ou <strong>du</strong><br />
début <strong>du</strong> XXe siècle 352 .<br />
Le discours est clair, <strong>de</strong>s sources <strong>par</strong>cellaires exist<strong>en</strong>t et sont rec<strong>en</strong>sées, ce qui est rassurant.<br />
Mais il faut bi<strong>en</strong> se convaincre que pour le sujet qui nous préoccupe, dans son détail, et<br />
là rési<strong>de</strong> l’ess<strong>en</strong>tiel, la bibliographie reste à établir. C’est presque pierre à pierre qu’il nous faudra<br />
reconstruire cet édifice millénaire. À cet égard nous avons étudié avec une att<strong>en</strong>tion toute<br />
<strong>par</strong>ticulière, et force admiration, la démarche <strong>de</strong> Martine Callias-Bey dans ses différ<strong>en</strong>ts écrits<br />
sur les vitraux, et plus <strong>par</strong>ticulièrem<strong>en</strong>t le <strong>de</strong>rnier livre <strong>par</strong>u, Les vitraux <strong>de</strong> Basse-Normandie 353 .<br />
349. Ibid., p. 13-14.<br />
350. Voir bibliographie.<br />
351. Voir bibliographie.<br />
352. <strong>La</strong> thèse <strong>de</strong> Gabrielle Thibout, L’architecture religieuse flamboyante dans l’anci<strong>en</strong> diocèse <strong>de</strong> Coutances,<br />
Paris, 1935 ainsi que ses notes <strong>de</strong> travail et dépouillem<strong>en</strong>ts sont conservée aux Archives dé<strong>par</strong>tem<strong>en</strong>tales<br />
<strong>de</strong> la Manche, séries 6J 11/1 à 6J11/6.<br />
353. Martine Callias-Bey, Les vitraux <strong>de</strong> Basse-Normandie, R<strong>en</strong>nes, PUR, 2006, 255 pages.<br />
Schedae, 2008, prépublication n°10, (p.1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf<br />
89
90<br />
Son état <strong>de</strong> l’art <strong>du</strong> vitrail nous donne <strong>de</strong>s pistes sérieuses pour notre travail et montre, pour<br />
qui aurait <strong>en</strong>core besoin <strong>de</strong> s’<strong>en</strong> convaincre que la recherche est un véritable jeu <strong>de</strong> piste.<br />
Peut-on imaginer que repr<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t virtuellem<strong>en</strong>t vie ces vitraux dis<strong>par</strong>us à l’issue <strong>de</strong> notre<br />
reconstitution ?<br />
Jean <strong>La</strong>fond et d’autres auteurs nous permett<strong>en</strong>t <strong>de</strong> retrouver leur trace. Ainsi la faça<strong>de</strong> occid<strong>en</strong>tale<br />
a-t-elle per<strong>du</strong> son décor d’architecture sur fond bleu, <strong>de</strong>s anges à longues robes et ailes<br />
roses, un Christ glorieux sortant <strong>du</strong> tombeau, auréolé <strong>de</strong> rayons et vêtu <strong>de</strong> blanc, déjà remplacés<br />
<strong>par</strong> <strong>du</strong> verre blanc lors <strong>de</strong> la campagne <strong>de</strong> restauration <strong>de</strong>s années 1930-1940. Les baies <strong>du</strong> bascôté<br />
sud cont<strong>en</strong>ai<strong>en</strong>t d’autres fragm<strong>en</strong>ts non retrouvés, comme une tête <strong>de</strong> moine, une sainte<br />
auréolée, Moïse t<strong>en</strong>ait les Tables <strong>de</strong> la loi. Le vitrail royal était surmonté <strong>en</strong> 1845 d’un vitrail circulaire<br />
<strong>du</strong> XIII e siècle représ<strong>en</strong>tant l’Annonciation, prov<strong>en</strong>ant probablem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> l’anci<strong>en</strong> chœur.<br />
Les f<strong>en</strong>êtres <strong>de</strong> la chapelle <strong>du</strong> Rosaire affichai<strong>en</strong>t <strong>en</strong> 1837 <strong>de</strong>s armes <strong>de</strong>s familles bi<strong>en</strong>faitrices <strong>de</strong><br />
l’église : les Boucart, les Talv<strong>en</strong><strong>de</strong>, les Pontbell<strong>en</strong>ger, les Saint-Germain Gros<strong>par</strong>my. Une verrière<br />
signée <strong>de</strong> Claudius <strong>La</strong>vergne remplaça <strong>en</strong> 1869 dans le déambulatoire nord <strong>du</strong> chœur, un vitrail<br />
orné <strong>de</strong>s armes <strong>de</strong>s familles d’Allix et <strong>du</strong> Molay. […] 354 .<br />
On mesure l’ampleur <strong>de</strong> la tâche. Cep<strong>en</strong>dant, <strong>en</strong> qualité d’histori<strong>en</strong>ne, nous l’<strong>en</strong>visageons<br />
avec un plaisir non dissimulé.<br />
Conclusion<br />
Au mom<strong>en</strong>t d’achever cette étu<strong>de</strong>, et d’<strong>en</strong> dresser un bilan, nous souhaitons d’emblée<br />
dire combi<strong>en</strong> cette expéri<strong>en</strong>ce fut pour nous importante et riche d’<strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>ts. Le choix<br />
<strong>du</strong> sujet s’imposa rapi<strong>de</strong>m<strong>en</strong>t, et jamais ne fut remis <strong>en</strong> question <strong>par</strong> la démonstration. Au<br />
fur et à mesure que le projet avançait, il nous ap<strong>par</strong>aissait <strong>de</strong> plus <strong>en</strong> plus clairem<strong>en</strong>t, au<br />
contraire, que la question patrimoniale <strong>de</strong>vait être abordée selon une perspective nouvelle,<br />
celle <strong>de</strong> sa <strong>mise</strong> <strong>en</strong> <strong>valeur</strong> <strong>par</strong> la réalité virtuelle. Il ne s’agit bi<strong>en</strong> évi<strong>de</strong>mm<strong>en</strong>t pas <strong>de</strong> faire<br />
table rase <strong>du</strong> passé, démarche qui serait un non-s<strong>en</strong>s, compte-t<strong>en</strong>u <strong>du</strong> thème étudié. En<br />
outre, les lectures nombreuses que nous avons pu faire nous ont permis <strong>de</strong> faire progresser<br />
le raisonnem<strong>en</strong>t. Pourtant, la bibliographie réunie montre que ce champ d’étu<strong>de</strong> est à ce<br />
jour complètem<strong>en</strong>t inexploré, alors même que la réalité virtuelle est déjà un outil <strong>de</strong> travail<br />
utilisé <strong>par</strong> la recherche et <strong>par</strong> la muséographie. L’ambition que nous nourrissons est <strong>de</strong> proposer<br />
quelques pistes <strong>de</strong> réflexion méthodologique sur cette question.<br />
Logiquem<strong>en</strong>t, semble-t-il, nous avons comm<strong>en</strong>cé les lectures <strong>par</strong> <strong>de</strong>s ouvrages généraux<br />
sur le <strong>patrimoine</strong>, son histoire, ses politiques, égalem<strong>en</strong>t ses <strong>en</strong>jeux et ses dérives, lesquels<br />
sont souv<strong>en</strong>t étudiés dans un même opus. Les histori<strong>en</strong>s qui se sont p<strong>en</strong>chés sur la<br />
question patrimoniale nous ont beaucoup aidée à construire notre raisonnem<strong>en</strong>t. Dans la<br />
gran<strong>de</strong> majorité <strong>de</strong>s cas, il ap<strong>par</strong>aît sous leur plume que le <strong>patrimoine</strong> est avant tout une<br />
question liée à la mémoire et que toute t<strong>en</strong>tative <strong>de</strong> passage à une mémoire collective, <strong>par</strong>tagée<br />
<strong>par</strong> le plus grand nombre, porte les germes d’une dénaturation <strong>de</strong> son s<strong>en</strong>s premier.<br />
Avec tout le respect que nous <strong>de</strong>vons à ces grands noms <strong>de</strong> la sci<strong>en</strong>ce historique, il nous<br />
semble que cette vision <strong>de</strong> l’histoire doit aujourd’hui être re<strong>mise</strong> <strong>en</strong> question. En effet, lorsque<br />
nous abordons la question <strong>de</strong> la culture <strong>en</strong> France, le constat d’échec est criant. <strong>La</strong> démocratisation<br />
<strong>de</strong> la culture est, certes, quantitativem<strong>en</strong>t, et sur le plan <strong>de</strong> l’offre, <strong>en</strong> constant<br />
progrès, mais les étu<strong>de</strong>s plus fines affich<strong>en</strong>t toujours <strong>de</strong>s dis<strong>par</strong>ités très fortes <strong>en</strong>tre la masse<br />
et l’élite. Nous <strong>en</strong> restons aujourd’hui au sta<strong>de</strong> <strong>du</strong> vœu pieux.<br />
354. Martine Callias-Bey, Les verrières anci<strong>en</strong>nes <strong>de</strong> Notre-Dame <strong>de</strong> Saint-Lô, Actes <strong>du</strong> colloque « <strong>La</strong> Normandie<br />
au XV e siècle, Art et Histoire », Saint-Lô, 2-5 décembre 1998, Saint-Lô, Archives dé<strong>par</strong>tem<strong>en</strong>tales, p. 264.<br />
Schedae, 2008, prépublication n°10, (p. 1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf
Alors que le <strong>patrimoine</strong> est <strong>en</strong>tré <strong>de</strong> plein fouet dans la vie <strong>culturel</strong>le <strong>de</strong>s Français, <strong>en</strong><br />
témoigne le succès important <strong>de</strong>s Journées <strong>du</strong> Patrimoine, il faut s’interroger sur le s<strong>en</strong>s à<br />
donner à ce phénomène nouveau. Doit-on déplorer l’appropriation <strong>par</strong> le peuple <strong>de</strong> sa propre<br />
histoire ? Doit-on abandonner l’écriture <strong>de</strong> l’histoire à l’in<strong>du</strong>strie touristique ? <strong>La</strong> vérité se<br />
situe certainem<strong>en</strong>t <strong>en</strong>tre les <strong>de</strong>ux. Et dans ce cadre, l’histori<strong>en</strong> est condamné à jouer un rôle<br />
prépondérant. Les expéri<strong>en</strong>ces m<strong>en</strong>ées dans <strong>de</strong>s laboratoires, <strong>par</strong> <strong>de</strong>s équipes d’archéologues<br />
et d’histori<strong>en</strong>s <strong>de</strong> l’Antiquité, ou plus mo<strong>de</strong>stem<strong>en</strong>t <strong>par</strong> une association comme « Saint-<br />
Lô Retrouvé », montr<strong>en</strong>t que loin <strong>de</strong>s dérives pro<strong>mise</strong>s <strong>par</strong> une p<strong>en</strong>sée conservatrice, non<br />
seulem<strong>en</strong>t l’outil technologique permet à la sci<strong>en</strong>ce d’avancer mais il offre une histoire rigoureuse<br />
et accessible à un public large et captivé. Plus que jamais, il est nécessaire <strong>de</strong> déployer<br />
notre énergie à convaincre les plus rétic<strong>en</strong>ts <strong>du</strong> bi<strong>en</strong>-fondé <strong>de</strong> la démarche, pour faire <strong>en</strong>trer<br />
la réalité virtuelle dans le champ <strong>de</strong>s sci<strong>en</strong>ces humaines et sociales. Pour remporter le <strong>par</strong>i,<br />
la seule maîtrise <strong>de</strong> son sujet et <strong>de</strong> la notion <strong>de</strong> <strong>patrimoine</strong> <strong>par</strong> l’histori<strong>en</strong> ne saurai<strong>en</strong>t suffire<br />
à répondre aux <strong>en</strong>jeux actuels. Il est indisp<strong>en</strong>sable d’ét<strong>en</strong>dre l’étu<strong>de</strong> à la question <strong>de</strong><br />
l’approche <strong>de</strong>s publics et <strong>de</strong> la médiation <strong>culturel</strong>le. C’est à ce seul prix que nous p<strong>en</strong>sons<br />
pouvoir concilier <strong>de</strong>s <strong>en</strong>jeux sci<strong>en</strong>tifiques et <strong>culturel</strong>s.<br />
Fortem<strong>en</strong>t convaincue que l’église Notre-Dame <strong>de</strong> Saint-Lô s’inscrit pleinem<strong>en</strong>t dans<br />
ce cadre, c’est une nouvelle étape qui s’ouvre <strong>de</strong>vant nous. Il nous faut maint<strong>en</strong>ant nous<br />
confronter à la réalisation <strong>de</strong> la reconstitution virtuelle <strong>du</strong> bâtim<strong>en</strong>t, dans son état d’avantguerre.<br />
Bi<strong>en</strong> que l’édifice soit <strong>de</strong>bout, reconstruit et fonctionnel, la tâche n’est pas simple.<br />
<strong>La</strong> reconstruction s’est faite sur les ruines laissées <strong>par</strong> les bombar<strong>de</strong>m<strong>en</strong>ts et avec une physionomie<br />
nouvelle. Au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> la volonté <strong>de</strong> marquer l’église <strong>du</strong> sceau <strong>de</strong> la mémoire, les<br />
raisons ti<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t ess<strong>en</strong>tiellem<strong>en</strong>t au coût qu’une reconstruction totale aurait impliqué, dans<br />
une situation d’urg<strong>en</strong>ce et <strong>de</strong> détresse généralisée, et à la dis<strong>par</strong>ition <strong>de</strong>s archives qui aurai<strong>en</strong>t<br />
présidé aux travaux. En regard <strong>de</strong> ces trois points, notre travail <strong>de</strong> reconstitution virtuelle<br />
semble pouvoir prét<strong>en</strong>dre être une réponse appropriée aux besoins nouveaux générés <strong>par</strong><br />
la volonté <strong>de</strong> <strong>mise</strong> <strong>en</strong> <strong>valeur</strong> <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong>.<br />
Compte-t<strong>en</strong>u <strong>de</strong> l’accueil très positif qui a été réservé au projet, à la suite <strong>de</strong> celui réalisé<br />
<strong>par</strong> « Saint-Lô Retrouvé », nous ferons tout pour être à la hauteur <strong>de</strong> l’ambition. Il peut <strong>par</strong>aître<br />
déplacé <strong>de</strong> comm<strong>en</strong>cer <strong>par</strong> préciser que la question <strong>de</strong>s coûts n’est pas un problème<br />
qui se pose à nous. <strong>La</strong> reconstitution virtuelle ne coûte qu’<strong>en</strong> temps et <strong>en</strong> énergie. Quant<br />
à la borne interactive, sa <strong>mise</strong> <strong>en</strong> place est d’ores et déjà actée, si la qualité <strong>du</strong> travail le<br />
justifie. Ce premier écueil, dont on a vu qu’il pouvait être dirim<strong>en</strong>t dans <strong>de</strong> nombreux cas<br />
est ici écarté. Reste la question majeure <strong>de</strong>s sources. C’est <strong>par</strong> elles que tout comm<strong>en</strong>ce et<br />
elles sont le socle <strong>de</strong> la crédibilité <strong>de</strong> la démonstration. Or, comme nous l’avons développé<br />
dans le corps <strong>du</strong> texte, avec leur dis<strong>par</strong>ition, c’est la mémoire <strong>de</strong> l’église qui s’est <strong>en</strong>volée,<br />
pour l’ess<strong>en</strong>tiel.<br />
On a vu que les campagnes <strong>de</strong> construction et <strong>de</strong> restauration fur<strong>en</strong>t nombreuses et<br />
étalées dans le temps, ce qui complique <strong>en</strong>core la tâche <strong>de</strong> restituer un style daté. À cet<br />
égard, le XIXe siècle est pour nous d’un grand secours, puisqu’avec la création <strong>du</strong> Service <strong>de</strong>s<br />
Monum<strong>en</strong>ts historiques, on bénéficie d’une source fiable et docum<strong>en</strong>tée sur le bâti religieux,<br />
au titre <strong>de</strong> l’inv<strong>en</strong>taire. Pourtant, il est aussi le siècle <strong>de</strong> restaurations pas toujours <strong>de</strong> très<br />
bon aloi et qui ont aussi fait perdre la trace <strong>de</strong> temps plus reculés. Nous avons consci<strong>en</strong>ce<br />
<strong>de</strong> la difficulté que nous aurons à rassembler les docum<strong>en</strong>ts qui permettront une reconstitution<br />
fidèle <strong>de</strong> l’église dans son état d’avant-guerre. C’est un travail <strong>par</strong> touches qu’il faut<br />
<strong>en</strong>tamer et, ainsi que nous l’avons dit, pour y <strong>par</strong>v<strong>en</strong>ir, nous emboîtons le pas <strong>de</strong> Martine<br />
Callias-Bey pour ses étu<strong>de</strong>s sur les vitraux.<br />
Si nous attachons tant d’importance à son travail, c’est d’une <strong>par</strong>t que ses pistes <strong>de</strong><br />
recherches pour les vitraux <strong>de</strong> Notre-Dame sont ext<strong>en</strong>sibles au reste <strong>de</strong> l’édifice ; d’autre<br />
<strong>par</strong>t <strong>par</strong>ce que l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s vitraux <strong>en</strong> tant que telle constituera une <strong>de</strong>s étapes ess<strong>en</strong>tielles<br />
Schedae, 2008, prépublication n°10, (p.1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf<br />
91
92<br />
<strong>de</strong> la restitution <strong>de</strong> l’église. Il serait très intéressant <strong>de</strong> pouvoir faire aboutir le travail qu’elle<br />
a <strong>en</strong>tamé dans son mémoire <strong>de</strong> maîtrise et <strong>de</strong> redonner une vie aux vitraux dis<strong>par</strong>us. Outre<br />
l’aspect esthétique qui n’est une préoccupation majeure que dans la limite où il vi<strong>en</strong>t donner<br />
<strong>du</strong> s<strong>en</strong>s au bâti, on mesurerait <strong>par</strong> la même toute l’importance <strong>de</strong> l’apport <strong>de</strong> la réalité<br />
virtuelle pour la sci<strong>en</strong>ce historique. Nous aimerions égalem<strong>en</strong>t <strong>par</strong> notre travail ouvrir <strong>de</strong>s<br />
pistes novatrices touchant à la restitution <strong>de</strong> l’ambiance sonore. <strong>La</strong> réussite <strong>de</strong> ce chantier<br />
ouvrirait <strong>de</strong>s perspectives passionnantes <strong>en</strong> terme d’interactivité, permettant une étu<strong>de</strong> riche<br />
notamm<strong>en</strong>t sur les orgues <strong>de</strong> Notre-Dame. <strong>La</strong> difficulté sera d’une autre nature, et plus<br />
gran<strong>de</strong> <strong>en</strong>core, que pour les vitraux, puisque l’acoustique est une sci<strong>en</strong>ce <strong>du</strong>re, à laquelle<br />
nous n’<strong>en</strong>t<strong>en</strong>dons ri<strong>en</strong> à ce jour.<br />
Si la constitution d’un dossier sci<strong>en</strong>tifique soli<strong>de</strong> et crédible s’appuie pour l’ess<strong>en</strong>tiel sur<br />
les qualités <strong>de</strong> pati<strong>en</strong>ce et <strong>de</strong> persévérance, voire d’opiniâtreté, <strong>de</strong> l’histori<strong>en</strong>, ce n’est que<br />
<strong>par</strong> un travail d’équipe, <strong>en</strong> interdisciplinarité que nous <strong>par</strong>vi<strong>en</strong>drons à nos fins <strong>de</strong> reconstitution<br />
virtuelle. Nous mesurons déjà l’ampleur <strong>de</strong> la tâche et comptons nous appuyer sur<br />
l’efficacité <strong>de</strong>s métho<strong>de</strong>s et sur les conseils avisés <strong>de</strong> ceux qui montr<strong>en</strong>t la voie <strong>de</strong> l’usage <strong>de</strong><br />
la réalité virtuelle, à <strong>de</strong>s fins <strong>de</strong> restitution historique et <strong>de</strong> <strong>par</strong>tage <strong>du</strong> savoir. Nous mesurons<br />
ainsi la chance que nous avons d’avoir été si bi<strong>en</strong> accueillie au sein <strong>de</strong> l’équipe <strong>du</strong> « Plan <strong>de</strong><br />
Rome ». Nous souhaitons, <strong>par</strong> nos efforts, contribuer à promouvoir l’outil <strong>de</strong> la réalité virtuelle,<br />
et ainsi apporter notre mo<strong>de</strong>ste pierre à l’édifice <strong>de</strong> la recherche dans ce domaine.<br />
Bibliographie<br />
Abbé BERNARD, Histoire <strong>de</strong> la ville <strong>de</strong> Saint-Lô et <strong>de</strong> ses <strong>en</strong>virons, Saint-Lô, Éditions R. Jacqueline, 1953,<br />
120 pages.<br />
Abbé DELAUNEY, « Notice sur l’église Notre-Dame <strong>de</strong> Saint-Lô », in Notices, mémoires et docum<strong>en</strong>ts <strong>de</strong><br />
la Société d’agriculture et d’histoire naturelle <strong>de</strong> la Manche, Tome 2, Saint-Lô, Impr. d’Élie Fils, 1864,<br />
p. 59-147.<br />
AMIROU Rachid, Imaginaire <strong>du</strong> tourisme <strong>culturel</strong>, Paris, PUF, 2000, 155 pages.<br />
ANDRIEUX Jean-Yves, Patrimoine et Histoire, Paris, Belin, 1997, 283 pages.<br />
ARENDT Hannah, Condition <strong>de</strong> l’Homme mo<strong>de</strong>rne, Paris, Pocket, 1994, 406 pages.<br />
ARENDT Hannah, <strong>La</strong> crise <strong>de</strong> la culture, Paris, Gallimard, 1989, 380 pages.<br />
AUDRERIE Dominique, <strong>La</strong> protection <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong> <strong>culturel</strong> dans les pays francophones, <strong>Université</strong>s<br />
francophones, Savoir Plus <strong>Université</strong>s, 2000, 114 pages.<br />
L’av<strong>en</strong>ir <strong>de</strong>s musées, Actes <strong>du</strong> colloque au musée <strong>du</strong> Louvre, 23-25 mars Paris, Réunion <strong>de</strong>s musées<br />
nationaux, 2000, 539 pages.<br />
BABELON Jean-Pierre et CHASTEL André, <strong>La</strong> notion <strong>de</strong> <strong>patrimoine</strong>, Paris, Liana Lévi, 1994, 141 pages.<br />
BARBIER Frédéric, Histoire <strong>de</strong>s médias : <strong>de</strong> Di<strong>de</strong>rot à Internet, Paris, Armand Colin, 2000, 351 pages.<br />
BARTHES Roland, Mythologies, Paris, Éditions <strong>du</strong> Seuil, 1957 (rééd. 1970), 233 pages.<br />
<strong>La</strong> Bataille <strong>de</strong> Saint-Lô (7-19 juillet 1944), Tra<strong>du</strong>ction <strong>de</strong>s docum<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> la Division historique <strong>du</strong><br />
dé<strong>par</strong>tem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> la guerre américain, Saint-Lô, Éditions R. Jacqueline, 1951, 200 pages.<br />
BÉGHAIN Patrice, Le <strong>patrimoine</strong> : culture et li<strong>en</strong> social, Paris, Presses <strong>de</strong> Sci<strong>en</strong>ces Po, 1998, 115 pages.<br />
BENJAMIN Walter, Le langage et la culture, Paris, D<strong>en</strong>oël, 1971, 181 pages.<br />
BERCÉ Françoise, <strong>La</strong> correspondance Mérimée – Viollet-le-Duc, Paris, Éditions <strong>du</strong> CHTS, 2001, 301 pages.<br />
BERCÉ Françoise, Des monum<strong>en</strong>ts historiques au <strong>patrimoine</strong> <strong>du</strong> XVIIIe siècle à nos jours ou les égarem<strong>en</strong>ts<br />
<strong>du</strong> cœur et <strong>de</strong> l’esprit, Paris, Flammarion, 2000, 225 pages.<br />
BERTIN Philippe, Saint-Lô, R<strong>en</strong>nes, Éditions Ouest-France, 1998, 137 pages.<br />
BOURDIN Alain, Le <strong>patrimoine</strong> réinv<strong>en</strong>té, Paris, PUF, 1984, 239 pages.<br />
CADOZ Clau<strong>de</strong>, Les réalités virtuelles : un exposé pour compr<strong>en</strong>dre, un essai pour réfléchir, Paris, Flammarion,<br />
1994, 125 pages.<br />
CAILLET Élisabeth, À l’approche <strong>du</strong> musée, la médiation <strong>culturel</strong>le, Lyon, PUL, 1995, 306 pages.<br />
Schedae, 2008, prépublication n°10, (p. 1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf
CAILLET Élisabeth et COPPEY Odile, Stratégies pour l’action <strong>culturel</strong>le, Paris Budapest Torino, L’Harmattan,<br />
2003, 126 pages.<br />
CALLIAS-BEY Martine, Les verrières anci<strong>en</strong>nes <strong>de</strong> Notre-Dame <strong>de</strong> Saint-Lô, Actes <strong>du</strong> colloque «<strong>La</strong> Normandie<br />
au XVe siècle, Art et Histoire », Saint-Lô, 2-5 décembre 1998, Saint-Lô, Archives dé<strong>par</strong>tem<strong>en</strong>tales,<br />
p. 259-267.<br />
CALLIAS-BEY Martine, « Les vitraux <strong>de</strong> Notre-Dame <strong>de</strong> Saint-Lô », Art <strong>de</strong> Basse-Normandie, n° 62, Ca<strong>en</strong>,<br />
1974, p. 24-27.<br />
CERTEAU Michel <strong>de</strong>, L’écriture <strong>de</strong> l’histoire, Paris, Gallimard, 1975, 358 pages.<br />
CHOAY Françoise, L’allégorie <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong>, Paris, Éditions <strong>du</strong> Seuil, 1992, rééd. 1999, 271 pages.<br />
CITRON Suzanne, Enseigner l’histoire aujourd’hui : la mémoire per<strong>du</strong>e et retrouvée, Paris, Les Éditions<br />
ouvrières, 159 pages.<br />
CRUBELLIER Maurice, Histoire <strong>culturel</strong>le <strong>de</strong> la France (XIXe-XXe ), Paris, Armand Colin, 1974, 454 pages.<br />
DEBORD Guy, <strong>La</strong> société <strong>du</strong> spectacle, Paris, Folio, 3e éd., 1992, 209 pages.<br />
DEBRAY Régis, Vie et mort <strong>de</strong> l’image, Une histoire <strong>du</strong> regard <strong>en</strong> Occid<strong>en</strong>t, Paris, Gallimard, 1992, 412 pages.<br />
DONNAT Olivier, Les dép<strong>en</strong>ses <strong>de</strong>s ménages, Ministère <strong>de</strong> la culture et <strong>de</strong> la communication, <strong>La</strong> Docum<strong>en</strong>tation<br />
française, Paris, <strong>La</strong> Découverte, 1989, 75 pages.<br />
DONNAT Olivier et COGNEAU D<strong>en</strong>is, Les pratiques <strong>culturel</strong>les <strong>de</strong>s Français: 1973-1989, Ministère <strong>de</strong> la culture<br />
et <strong>de</strong> la communication, <strong>La</strong> Docum<strong>en</strong>tation Française, Paris, <strong>La</strong> Découverte, 1992, 285 pages.<br />
DONNAT Olivier, Regards croisés sur les pratiques <strong>culturel</strong>les, Ministère <strong>de</strong> la culture et <strong>de</strong> la communication,<br />
<strong>La</strong> Docum<strong>en</strong>tation Française, Paris, <strong>La</strong> Découverte, 2003, 348 pages.<br />
DONNAT Olivier, Les Français face à la culture : <strong>de</strong> l’exclusion à l’éclectisme, Paris, <strong>La</strong> Découverte, 1994,<br />
368 pages.<br />
DONNAT Olivier et TOLILA Paul (dir.), Les publics <strong>de</strong> la culture, Paris, Presses <strong>de</strong> Sci<strong>en</strong>ces Po, 2003,<br />
393 pages.<br />
DUBY Georges, Le temps <strong>de</strong>s cathédrales, l’art et la cité (980-1420), Paris, Gallimard, 1976, 379 pages.<br />
DUMOULIN Olivier, Le rôle social <strong>de</strong> l’histori<strong>en</strong>, <strong>de</strong> la chaire au prétoire, Paris, Albin Michel, 2003,<br />
350 pages.<br />
FEENBERG Andrew, (Re)p<strong>en</strong>ser la technique, vers une technologie démocratique, Paris, <strong>La</strong> Découverte,<br />
2004, 230 pages.<br />
FERRO Marc, Cinéma et histoire, Paris, Folio Histoire, édition refon<strong>du</strong>e 1993, 1977, 264 pages.<br />
FLEURY Philippe (dir.), <strong>La</strong> Rome antique : plan relief et reconstitution virtuelle, Ca<strong>en</strong>, PUC, 205,<br />
267 pages.<br />
FLÉCHY Patrice, L’imaginaire d’Internet, Paris, <strong>La</strong> Découverte, 2001, 272 pages.<br />
FOURNÉE Jean, « Notre-Dame <strong>en</strong> Basse-Normandie : la vie <strong>de</strong> la Vierge, étu<strong>de</strong> iconologique », Art <strong>de</strong><br />
Basse-Normandie, n° 99, Ca<strong>en</strong>, 1990, 127 pages.<br />
FRISON Daniel (dir.), Médias et technologies : l’exemple <strong>de</strong>s États-Unis, Paris, Ellipses Marketing, 2001,<br />
223 pages.<br />
FROIDEVAUX Yves-Marie, « <strong>La</strong> restauration <strong>de</strong> l’église Notre-Dame <strong>de</strong> Saint-Lô », in Art <strong>de</strong> Basse-<br />
Normandie, n° 62, Ca<strong>en</strong>, 1974, p. 29-32.<br />
FUCHS Philippe, Le traité <strong>de</strong> réalité virtuelle, vol. 4, « Les applications <strong>de</strong> la réalité virtuelle », Paris,<br />
Presses <strong>de</strong> l’École <strong>de</strong>s Mines, 2006, 290 pages.<br />
GAREL-LUCAS Nicole, Enseigner l’histoire dans le secondaire, Manuels et <strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>ts <strong>de</strong>puis 1902,<br />
R<strong>en</strong>nes, PUR, 2001, 319 pages.<br />
GELIN Rodolphe, Comm<strong>en</strong>t la réalité peut-elle être virtuelle ?, Paris, Éditions Le Pommier, 2006,<br />
63 pages.<br />
GERVEREAU <strong>La</strong>ur<strong>en</strong>t, Histoire <strong>du</strong> visuel au XXe siècle, Paris, Éditions <strong>du</strong> Seuil, 2003, 544 pages.<br />
GERVEREAU <strong>La</strong>ur<strong>en</strong>t, Vous avez dit musées ? Tout savoir sur la crise <strong>culturel</strong>le, Paris, CNRS Éditions, 2006,<br />
130 pages.<br />
GERVILLE Charles <strong>de</strong>, Voyage archéologique dans la Manche (1818-1820), Tome 2, Arrondissem<strong>en</strong>t <strong>de</strong><br />
Saint-Lô, Société d’Archéologie et d’Histoire <strong>de</strong> la Manche, Saint-Lô, 2000, 422 pages.<br />
GOLVIN Jean-Clau<strong>de</strong>, L’Antiquité retrouvée, 2e éd., Paris, Errance, 2005, 189 pages.<br />
Schedae, 2008, prépublication n°10, (p.1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf<br />
93
94<br />
GOLVIN Jean-Clau<strong>de</strong>, L’image <strong>de</strong> restitution et la restitution <strong>de</strong> l’image, cours <strong>de</strong> DPEA «Culture numérique<br />
et <strong>patrimoine</strong> architectural »,http://www.map.archi.fr/cycle3/DPEA_MCAN/supportsCours/JCG2.pdf<br />
GRANGE Daniel J. et POULOT Dominique (dir.), L’esprit <strong>de</strong>s lieux : le <strong>patrimoine</strong> et la cité, Colloque international,<br />
Conservatoire d’Art et d’Histoire d’Annecy, Gr<strong>en</strong>oble, PUG, 1997, 476 pages.<br />
GREFFE Xavier, <strong>La</strong> gestion <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong> <strong>culturel</strong>, Paris, Éditions Anthropos, 1999, 253 pages.<br />
HOUËL Chanoine, Histoire <strong>de</strong> la ville <strong>de</strong> Saint-Lô, Paris, Res Universis, 1992, 256 pages.<br />
JADÉ Mariannick, Patrimoine immatériel, perspectives d’interprétation <strong>du</strong> concept <strong>de</strong> <strong>patrimoine</strong>, Paris,<br />
L’Harmattan, 2006, 277 pages.<br />
KREBS Anna et MARESCA Bruno, Le r<strong>en</strong>ouveau <strong>de</strong>s musées, <strong>La</strong> Docum<strong>en</strong>tation Française, mars 2005,<br />
n° 910, 120 pages.<br />
JOLIVALT Bernard, <strong>La</strong> réalité virtuelle, Paris, PUF, 1996, 123 pages.<br />
JOLIVET Isabelle, Éric Martin, Saint-Lô court sur un siècle, Balla<strong>de</strong> <strong>en</strong> clichés, Guilberville, Le cyprès p<strong>en</strong>ché,<br />
2001, 219 pages.<br />
LANTIER Maurice, Saint-Lô au bûcher : le martyre d’une cité <strong>de</strong> Basse-Normandie p<strong>en</strong>dant la secon<strong>de</strong><br />
guerre mondiale, juin-juillet 1944, Saint-Lô, Association Saint-Lô 44, 1994, 270 pages.<br />
LASCHChristopher, Culture <strong>de</strong> masse ou culture populaire ?, Paris, Climats, 2003, 80 pages.<br />
Dr LE CLERC, « Notre-Dame <strong>de</strong> Saint-Lô », in Notices, mémoires et docum<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> la Société d’archéologie<br />
et d’histoire naturelle <strong>de</strong> la Manche, Tome 43, 1931.<br />
MADELEINE Sophie, Le complexe pompéi<strong>en</strong> <strong>du</strong> Champ <strong>de</strong> Mars, une ville dans la Ville : reconstitution virtuelle<br />
d’un théâtre et à portique au IVe siècle après J.-C., Thèse <strong>de</strong> doctorat, 4 vol., 2006, 637 pages.<br />
MALRAUX André, Le musée imaginaire, Paris, Gallimard, rééd. 1996, 1947, 285 pages.<br />
MARCOIN-DUBOIS Danielle et PARSIS-BARNUBÉ Odile, Textes et lieux historiques à l’école, Paris, Bertrand-<br />
<strong>La</strong>coste, 1998, 159 pages.<br />
MINUTI Rolando, Internet et le métier d’histori<strong>en</strong> : réflexion sur les incertitu<strong>de</strong>s d’une mutation, Paris,<br />
PUF, 2002, 146 pages.<br />
MOUCHTOURIS Antigone, Sociologie <strong>du</strong> public dans le champ <strong>culturel</strong> et artistique, Paris, L’Harmattan,<br />
2003, 130 pages.<br />
MOUCHTOURIS Antigone, Sociologie <strong>du</strong> temps libre, Paris, L’Harmattan, 2003, 130 pages.<br />
NORA Pierre, Sci<strong>en</strong>ce et consci<strong>en</strong>ce <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong> (dir.), Entreti<strong>en</strong>s <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong>, Théâtre national <strong>de</strong><br />
Chaillot, Paris, 28-30 novembre 1994, Paris, Éditions <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong>, 407 pages.<br />
NORA Pierre (dir.), Les lieux <strong>de</strong> mémoire, 3 volumes,1 – <strong>La</strong> République, 2 – <strong>La</strong> Nation, 3 – Les France,<br />
Paris, Gallimard, 1997, 4751 pages.<br />
ORIGET DU CLUZEAU Clau<strong>de</strong>, Le tourisme <strong>culturel</strong>, 3e éd., Paris, PUF, 2005, 125 pages.<br />
PATIN Valéry, Tourisme et <strong>patrimoine</strong>, Paris, <strong>La</strong> Docum<strong>en</strong>tation Française, 2005,<br />
Pays d’Art et d’Histoire et Pôles d’Économie <strong>du</strong> Patrimoine, DATAR, Paris, <strong>La</strong> Docum<strong>en</strong>tation française,<br />
1999, 184 pages.<br />
POIRRIER Philippe, L’État et la culture <strong>en</strong> France au XXe siècle, Paris, Le Livre <strong>de</strong> Poche, 2006, 258 pages.<br />
POIRRIER Philippe et VALEDELORGE Loïc (dir.), Pour une histoire <strong>de</strong>s politiques <strong>du</strong> <strong>patrimoine</strong>, Paris, <strong>La</strong><br />
Docum<strong>en</strong>tation française, 2003, 615 pages.<br />
POULOT Dominique (dir.), Patrimoine et mo<strong>de</strong>rnité, Paris, L’Harmattan, 1997, 311 pages.<br />
POULOT Dominique, Patrimoine et musées : l’institution <strong>de</strong> la culture, Paris, Hachette, 2001, 223 pages.<br />
POULOT Dominique, Musée et muséologie, Paris, Éditions <strong>La</strong> Découverte, 2005, 122 pages.<br />
QUÉAU Philippe, Le virtuel, vertu et vertiges, Paris, Édition Champ Vallon, INA, 1993, 215 pages.<br />
RECHT Roland, Le croire et le voir, l’art <strong>de</strong>s cathédrales (XIIe-XVe ), Paris, Gallimard, 1999, 446 pages.<br />
RAMONET Ignacio, <strong>La</strong> tyrannie <strong>de</strong> la communication, Paris, Gallimard, 2001, 290 pages.<br />
R<strong>en</strong>aissance et reconstruction <strong>de</strong> Saint-Lô (1944-1964), <strong>Université</strong> Inter-Âges, Tome 2, 2000, 319 pages.<br />
RIEGL Aloïs, Le culte mo<strong>de</strong>rne <strong>de</strong>s monum<strong>en</strong>ts : son ess<strong>en</strong>ce et sa g<strong>en</strong>èse, Paris, Éditions <strong>du</strong> Seuil,<br />
1984, 122 pages.<br />
RIOUX Jean-Pierre et SIRINELLI François (dir.), Pour une histoire <strong>culturel</strong>le, Paris, Éditions <strong>du</strong> Seuil, 1997,<br />
455 pages.<br />
Schedae, 2008, prépublication n°10, (p. 1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf
RIOUX Jean-Pierre et SIRINELLI François (dir.), Histoire <strong>culturel</strong>le <strong>de</strong> la France, Tome 4, « Le temps <strong>de</strong>s<br />
masses, le vingtième siècle », Paris, Éditions <strong>du</strong> Seuil, 1998, 403 pages.<br />
RIOUX Jean-Pierre et SIRINELLI François (dir.), <strong>La</strong> culture <strong>de</strong> masse <strong>en</strong> France : <strong>de</strong> la Belle Époque à<br />
aujourd’hui, Paris, Fayard, 2002, 461 pages.<br />
SAUVAGEOT Anne, L’épreuve <strong>de</strong>s s<strong>en</strong>s : <strong>de</strong> l’action sociale à la réalité virtuelle, Paris, PUF, 2003, 291 pages.<br />
SCHAEFFER Jean-Marie, Pourquoi la fiction ?, Paris, Éditions <strong>du</strong> Seuil, 346 pages.<br />
TEBOUL R<strong>en</strong>é, Culture et loisirs dans la société <strong>du</strong> temps libre, Paris, L’Aube, 2004, 208 pages.<br />
TEBOUL R<strong>en</strong>é, Les mutations technologiques, institutionnelles et sociales dans l’économie <strong>de</strong> la culture,<br />
Paris, L’Harmattan, 2004, 290 pages.<br />
THIBOUT Gabrielle, « L’église Notre-Dame <strong>de</strong> Saint-Lô, ses campagnes <strong>de</strong> construction », Congrès<br />
archéologique, Cot<strong>en</strong>tin-Avranchin, Paris, Société Française d’Archéologie, 1966, p. 280-299.<br />
TISSERON Serge (dir.), Virtuel, Paris, Les Éditions Greupp, 2004, 200 pages.<br />
TOUSTAIN DE BILLY R<strong>en</strong>é, Mémoires sur l’histoire <strong>du</strong> Cot<strong>en</strong>tin et <strong>de</strong>s ses villes: villes <strong>de</strong> Saint-Lô et Car<strong>en</strong>tan,<br />
Société d’archéologie et d’histoire naturelle <strong>du</strong> dé<strong>par</strong>tem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> la Manche, 1912, 570 pages.<br />
TRÉMEL <strong>La</strong>ur<strong>en</strong>t, Jeux <strong>de</strong> rôles, jeux vidéos, multimédia: les faiseurs <strong>de</strong> mon<strong>de</strong>s, Paris, PUF, 2001, 309 pages.<br />
VEYNE Paul, Comm<strong>en</strong>t on écrit l’histoire, Paris, Éditions <strong>du</strong> Seuil, 1979, 242 pages.<br />
VIDAL G<strong>en</strong>eviève, Contribution à l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’interactivité: les usages <strong>du</strong> multimédia <strong>de</strong> musée, Bor<strong>de</strong>aux,<br />
PUB, 2006, 168 pages.<br />
VIRILIO Paul, <strong>La</strong> machine <strong>de</strong> vision, Paris, Galilée, 1988, 158 pages.<br />
VOGLER Jean, Pourquoi <strong>en</strong>seigner l’histoire à l’école, Paris, Hachette, 1999, 187 pages.<br />
WUNENBURGER Jean-Jacques, Philosophie <strong>de</strong>s images, Paris, PUF, 2001, 352 pages.<br />
Schedae, 2008, prépublication n°10, (p.1-96).<br />
http://www.unica<strong>en</strong>.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint00102008.pdf<br />
95