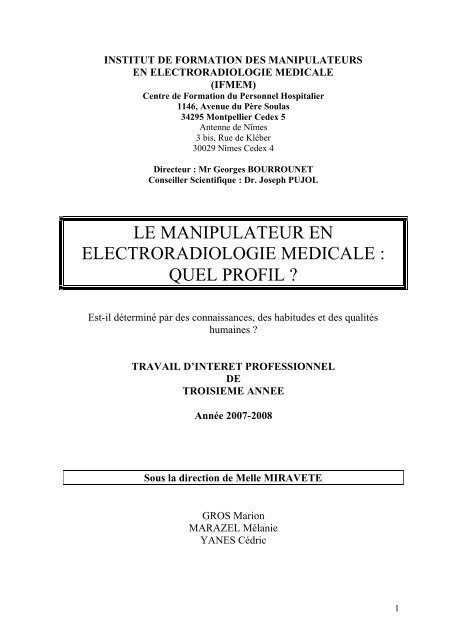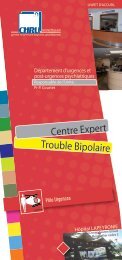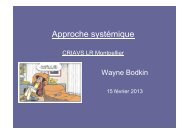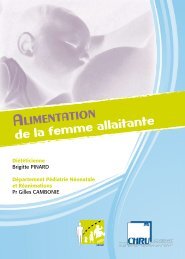quel profil - CHU Montpellier
quel profil - CHU Montpellier
quel profil - CHU Montpellier
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
INSTITUT DE FORMATION DES MANIPULATEURS<br />
EN ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE<br />
(IFMEM)<br />
Centre de Formation du Personnel Hospitalier<br />
1146, Avenue du Père Soulas<br />
34295 <strong>Montpellier</strong> Cedex 5<br />
Antenne de Nîmes<br />
3 bis, Rue de Kléber<br />
30029 Nîmes Cedex 4<br />
Directeur : Mr Georges BOURROUNET<br />
Conseiller Scientifique : Dr. Joseph PUJOL<br />
LE MANIPULATEUR EN<br />
ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE :<br />
QUEL PROFIL ?<br />
Est-il déterminé par des connaissances, des habitudes et des qualités<br />
humaines ?<br />
TRAVAIL D’INTERET PROFESSIONNEL<br />
DE<br />
TROISIEME ANNEE<br />
Année 2007-2008<br />
Sous la direction de Melle MIRAVETE<br />
GROS Marion<br />
MARAZEL Mélanie<br />
YANES Cédric<br />
1
Remerciements,<br />
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés pour la<br />
réalisation de ce travail.<br />
En particulier,<br />
Mademoiselle Véronique MIRAVETTE, notre directrice de mémoire, pour ses<br />
conseils et sa disponibilité tout au long de cette recherche<br />
Monsieur Jean Pierre RUBIO pour son soutien et la pertinence de ses remarques<br />
Toute l’équipe de formateurs pour son accompagnement au quotidien<br />
Les professionnels de santé des services d’imagerie auprès des<strong>quel</strong>s nous avons<br />
conduit nos entretiens<br />
Nos familles pour leur soutien tout au long de cette année de formation.<br />
2
SOMMAIRE<br />
INTRODUCTION 5<br />
PARTIE 1 : DU CHOIX DU THEME A LA QUESTION DE DEPART 6<br />
1.1 : Demande de l’institution 7<br />
1.2 : Vécu 7<br />
1.3 : Constats 8<br />
1.4 : Question de départ 9<br />
PARTIE 2 : DE LA PROBLEMATIQUE A L’HYPOTHESE 10<br />
2.1 : La profession du manipulateur en électroradiologie 11<br />
2.1.1 : Son Identité 11<br />
2.1.2 : Son Statut Administratif 11<br />
2.1.3 : Evolution des Compétences 12<br />
2.2 : Les rôles du manipulateur 12<br />
2.3: La formation 13<br />
2.4 : La Responsabilité 14<br />
2.4.1 : Système juridique actuel 14<br />
2.4.2 : Responsabilité source de Sanction 14<br />
2.4.3 : Responsabilité source d’indemnisation 15<br />
2.5 : Le Patient 17<br />
2.6 : L’acte Optimal 17<br />
2.6.1 : La Qualité 17<br />
2.6.2 : La Qualité de Soin 18<br />
2.6.3 : La Qualité Technique 19<br />
2.6.4 : Assurance Qualité 19<br />
2.7 : ENONCE DEL’HYPOTHESE 20<br />
PARTIE 3 : CADRE THEORIQUE 21<br />
3.1 : Concept de la confiance en soi 22<br />
3.2 : La construction de la confiance en soi 23<br />
3.3 : Comment bâtir la confiance en soi 24<br />
PARTIE 4 : METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 26<br />
4.1 : Introduction 27<br />
4.2 : Recueil des Données 27<br />
4.1.1 : Choix du terrain 27<br />
3
4.1.2 : Choix de la population 27<br />
4.1.3 : Choix de l’outil 27<br />
4.2 : Traitement des données 28<br />
4.3 : Limites de l’étude 28<br />
PARTIE 5 : RESULTATS ET ANALYSE DES ENTRETIENS 29<br />
5.1 : Résultats et analyses de l’enquête 30<br />
5.1.1 : Analyse du « JE SUIS » 30<br />
5.1.2 : Analyse du « JE RESSENS » 33<br />
5.1.3 : Analyse du « JE FAIS » 36<br />
5.1.4 : Analyse du « JE SUIS RECONNU » 37<br />
5.2 : Synthèse des analyses 38<br />
PARTIE 6 : PISTES DE REFLEXION 39<br />
CONCLUSION 42<br />
BIBLIOGRAPHIE 43<br />
ANNEXES 44<br />
4
Introduction<br />
Le milieu médical dans son ensemble a subi de profondes mutations durant ces vingt<br />
dernières années. L’imagerie médicale est l’un des domaines de la médecine qui a le plus<br />
évolué. Le nombre d’examens radiologiques a considérablement augmenté.<br />
La radiologie est une des plaques tournantes de la médecine actuelle et bien peu de<br />
patients échappent à son passage.<br />
Cependant l’hypertechnicitée et l’hyperspécialisation ne doivent pas faire oublier le<br />
côté humain et relationnel du métier.<br />
Historiquement, c’est vrai, que la profession de manipulateur s’attachait à assurer la<br />
bonne utilisation des installations qui se trouvent dans une salle de radiologie. Les qualités<br />
requises pour un manipulateur étaient, avant tout, qu’il sache exploiter ces appareils, et qu’il<br />
produise de bonnes images. Mais qu’en est-il de la relation que les manipulateurs établissent<br />
avec les patients qui viennent passer un examen ?<br />
Spécialistes de technologies lourdes, les manipulateurs d’aujourd’hui jouent un rôle<br />
intermédiaire entre le patient et les machines qui peuvent sembler angoissantes.<br />
En effet bien que fascinés par les exploits techniques modernes, les patients reprochent<br />
souvent à l’hôpital la dépersonnalisation des relations entre le patient et l’équipe de radiologie<br />
où les exigences techniques semblent l’emporter sur les préoccupations humaines. Or, si nous<br />
occultons notre rôle de soignant et que nous restons focalisés sur la technique, cela pourrait-il<br />
entraîner la disparition de notre profession ? La technique a-t-elle tendance à faire oublier<br />
l’humain ?<br />
Dans un premier temps nous allons définir la question de départ issue de notre vécu et<br />
constat. Puis après avoir étudié l’évolution du métier de manipulateur, ses responsabilités et<br />
défini la qualité d’un acte radiologique, nous exposerons notre hypothèse.<br />
Par la suite nous développerons le concept qui sera la base théorique de notre mémoire et qui<br />
nous permettra ensuite d’analyser les résultats de notre enquête.<br />
A la suite de cette analyse, nous pourrons ou non valider notre hypothèse et annoncer notre<br />
conclusion ainsi que nos pistes de réflexions.<br />
5
PARTIE 1<br />
DU CHOIX DU THEME A LA<br />
QUESTION DE DEPART<br />
6
1. DU CHOIX DU THEME A LA QUESTION<br />
DE DEPART<br />
Demande de l’Institution :<br />
Etudiants en troisième année de la formation « Manipulateur en électroradiologie »,<br />
nous devons réaliser un travail d’intérêt professionnel.<br />
Dès la deuxième année de formation, nous avons pu réfléchir au choix de notre sujet et<br />
notre réflexion porta sur « la communication et l’information des populations à risques en vu<br />
d’un examen avec injection de P.C.I. (produit de contraste iodé) ». Nous avons alors pris<br />
connaissance de l’existence d’un mémoire sur « la gestion des risques ». L’Institution nous a<br />
alors proposé d’approfondir cette réflexion.<br />
Après avoir assisté à la soutenance de ce mémoire, nous avons constaté que leur<br />
travail sur ce sujet était complet car, en effet, ils étaient parvenus à valider leur hypothèse de<br />
départ en affirmant que « les manipulateurs en électroradiologie manquent de compétences en<br />
matière de communication, la transmission des risques n’étant pas mentionnée explicitement<br />
dans leur décret de compétences ».<br />
Nous avons retenu de ce mémoire l’importance de la communication soignant/soigné<br />
au cours de l’acte radiologique.<br />
Nous avons alors voulu approfondir, au travers de cet acte radiologique, <strong>quel</strong>s sont les<br />
rôles et places du manipulateur, dans la prise en charge globale du patient et dans l’objectif<br />
d’un résultat de qualité.<br />
Vécu<br />
La formation de manipulateur en électroradiologie médicale s’effectue en trois ans<br />
comprenant à la fois des stages pratiques et des cours théoriques.<br />
Au fur et à mesure des années, notre parcours au sein du milieu hospitalier a beaucoup<br />
évolué. Nous avons été amenés à effectuer des stages dans différents services<br />
Dès la première année nous découvrons le milieu hospitalier dans toute sa complexité.<br />
La majorité de nos stages s’effectuant en service de soins marque le début de nos relations<br />
avec le patient. C’est ainsi que notre rôle de soignant se développe, nous apprenons à être à<br />
l’écoute de chaque patient et à répondre à leurs besoins.<br />
7
A partir de la deuxième année et jusqu’à la fin de notre formation nous réalisons nos<br />
stages dans des services d’imagerie médicale. Nous développons alors le côté technique du<br />
métier (choix des paramètres, protocoles, acquisition des images, traitement et archivage).<br />
Bien que nos objectifs de stages concilient les deux, il nous semble difficile, de part<br />
notre statut d’étudiants et notre faible expérience, de maîtriser ces deux versants.<br />
Constat<br />
De part notre vécu et cette constante évolution de l’imagerie médicale nous avons<br />
constaté que certains manipulateurs ont tendance à s’éloigner du malade, le contact avec<br />
celui-ci est plus bref et la majeure partie de l’examen est réalisée sur une console. Le coté<br />
relationnel est secondaire. L’important est alors l’acte (injection, clichés…) : en un mot la<br />
technique.<br />
D’autres manipulateurs mettent l’accent sur l’importance de la relation au malade à<br />
travers l’accueil, le questionnement, l’information avant l’examen. Ils démontrent que ce lien<br />
avec le patient permet un meilleur déroulement de l’examen, le malade étant en confiance, le<br />
résultat est meilleur.<br />
Nous constatons ainsi qu’il existe un déséquilibre entre la technique et le relationnel.<br />
On repère deux fonctions différentes pour la même profession.<br />
- « maintenant que tu es en troisième année reste derrière la console »<br />
- « tu devrais te préoccuper d’avantage des images plutôt que du patient »<br />
Sont souvent des remarques qui nous sont faites.<br />
De même qu’il existe des lieux de stages où des infirmières sont en charge du patient<br />
pour tout ce qui concerne le soin a proprement parlé, le manipulateur s’occupe seulement de<br />
réaliser l’examen.<br />
La prise en charge des stagiaires en début de leur formation est plutôt assurée par le<br />
manipulateur qui est à l’aise dans le relationnel. Au fur et à mesure des stages, de la demande<br />
croissante et du besoin du stagiaire, les manipulateurs dits « techniques » seront alors<br />
personnes ressources.<br />
8
Question de Départ<br />
En tant que futur professionnel de santé il nous semble important que le manipulateur<br />
soit capable de concilier technique et relationnel pour réaliser un acte de qualité optimal.<br />
Pour cela nous avons tenu à réaliser notre mémoire sur la véritable implication du<br />
manipulateur en imagerie médicale.<br />
Ce qui nous a amenés à notre question de départ :<br />
Qu’est-ce qui détermine le niveau d’implication du<br />
Manipulateur en Electroradiologie Médicale dans les domaines<br />
techniques et / ou relationnels ?<br />
Afin d’éclairer notre questionnement nous allons nous intéresser à l’évolution de la<br />
profession en regard des exigences des patients en terme de qualité.<br />
9
PARTIE 2<br />
DE LA PROBLEMATIQUE A<br />
L’HYPOTHESE<br />
10
2. DE LA PROBLEMATIQUE A L’HYPOTHESE<br />
2.1 La profession du manipulateur<br />
2.1.1 Son Identité<br />
En 1937 une circulaire précise les mesures de protections contre les rayonnements<br />
nocifs pour les « personnels » appelés à manipuler les appareils de radiologie ainsi que les<br />
produits radioactifs.<br />
De 1937 à 1983 l’identité de cette profession va se décliner successivement. D’une<br />
appellation, au départ généraliste, elle se précise au fil des ans et revêt de nos jours une<br />
identité spécifique et reconnue: (Annexe A)<br />
c « Manipulateur radiographe » (1943)<br />
c « Manipulateur radiologiste » (1949)<br />
c « Manipulateur de radiologie » (1955)<br />
c « Manipulateur d’électroradiologie » (1964)<br />
c « Manipulateur d’électroradiologie médicale » (1983)<br />
2.1.2 Son Statut Administratif<br />
Parallèlement à sa quête d’identité, il aura fallu plus de quarante ans pour que cette<br />
profession obtienne une reconnaissance statutaire. (Annexe B)<br />
1943 : les manipulateurs radiographes font partie du personnel secondaire spécialisé<br />
1963 : les manipulateurs sont classés dans un échelonnement indiciaire spécifique.<br />
1964 : création de trois grades parmi les personnels d’encadrement et d’exécution des services<br />
d’électroradiologie : manipulateur d’électroradiologie, aide technique et aide<br />
d’électroradiologie.<br />
Les recrutements s’opèrent dorénavant par concours sur épreuves.<br />
1984 : les personnes effectuant à titre principal des fonctions de manipulateurs sans en<br />
posséder les titres, les diplômes, avant le 25 juillet 1984, doivent se soumettre aux épreuves<br />
de vérification de connaissances pour pouvoir continuer à exercer.<br />
1989 : les manipulateurs font partie des personnels médico techniques de la fonction<br />
publique hospitalière et possèdent désormais un statut particulier. Ils sont constitués en<br />
un corps comprenant quatre grades : classe normale, classe supérieure, surveillant et<br />
surveillant chef.<br />
11
1995 : la profession de manipulateur est inscrite au code de la fonction publique.<br />
Chaque professionnel a l’obligation de se faire inscrire sur une liste départementale.<br />
L’usurpation du titre et l’exercice illégal sont réprimés par la loi.<br />
2.1.3 Evolution des compétences<br />
De 1949 à 1997, le législateur a reconnu les compétences de ce professionnel de santé et l’a<br />
habilité à accomplir certains actes d’électroradiologie médicale. (Annexe C)<br />
En 1995, la profession de manipulateur d’électroradiologie médicale est inscrite au code de la<br />
santé publique, protégeant son exercice professionnel.<br />
Le décret du 19 novembre 1997 est relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la<br />
profession de manipulateur d’électroradiologie médicale.<br />
2.2 Les rôles du manipulateur<br />
Les rayonnements et les machines utilisées pour détecter et soigner n’ont cessé, au<br />
cours de ces vingt dernières années, de se multiplier faisant des manipulateurs les spécialistes<br />
de la manipulation d’appareil de diagnostic ou de thérapie de plus en plus sophistiqués et<br />
performants.<br />
Ainsi témoins de cette évolution, les manipulateurs ont vu leurs compétences s’étendre<br />
rapidement.<br />
Le décret du 19 novembre 1997 actualise les fonctions du manipulateur en<br />
électroradiologie médicale et précise les diverses facettes de la profession dans la<br />
pluridisciplinarité et la polyvalence tout en contribuant au coté soignant. Il définit ses<br />
rôles dans les domaines de l’imagerie médicale, de la radiothérapie, de l’électrologie et<br />
précise, dans le cadre de l’exécution de ces actes, son implication auprès du patient.<br />
(Annexe D)<br />
Le métier de manipulateur exige des compétences définies en fonction de l’activité<br />
exercée basées sur :<br />
c La connaissance (le savoir)<br />
c Les aptitudes opérationnelles (le savoir faire)<br />
c Les aptitudes comportementales (le savoir être)<br />
Réaliser des clichés, des films à des fins diagnostiques est l’activité la plus fréquente<br />
du manipulateur, en effet elle concerne plus de 85% d’entre eux. Les rayonnements qui eux<br />
servent à soigner directement (exemple de la Radiothérapie) concernent 10%. Enfin les 5%<br />
restant sont les manipulateurs travaillant en service de médecine nucléaire (administration de<br />
produits radioactifs)<br />
12
Quelques soit le domaine d’activité considéré la fonction comprend un double aspect :<br />
soignant et médico technique.<br />
˘ Dans sa fonction de soignant, le manipulateur joue un rôle d’intermédiaire entre le<br />
patient et les machines.<br />
Le manipulateur va : accueillir le patient, le questionner afin de déceler d’éventuelles<br />
contres indications (allergie, claustrophobie….), l’informer sur le déroulement de l’examen<br />
ou le traitement.<br />
Il lui prodigue les soins nécessaires à la réalisation de l’examen (injection de PCI par<br />
exemple), le positionne et participe à sa surveillance pendant l’examen.<br />
Il lui donne les premiers soins en cas d’urgence médicale (exemple du choc<br />
anaphylactique).<br />
˘ Dans sa fonction médico-technique, le manipulateur effectue l’acquisition des<br />
images suivant un protocole tout en respectant la prescription définie par le médecin. Il<br />
analyse les images (anatomie, critères de réussites…), les traite informatiquement avant de<br />
les transmettre au médecin.<br />
L’objectif final du manipulateur est de rendre un travail le plus juste pour permettre au<br />
médecin radiologue de poser un diagnostic pertinent et rigoureux ou d’adapter son traitement.<br />
Tout examen ou traitement effectué par le MERM nécessite le respect des règles<br />
d’hygiène, de sécurité et de radioprotection comme précisé dans le décret de compétence.<br />
2.3 La formation<br />
Objectifs de la formation :<br />
Au terme de leur formation les étudiants doivent avoir acquis des connaissances<br />
humaines, scientifiques, médicales, techniques nécessaire à l’exercice de la profession de<br />
manipulateur en adéquation avec le décret n°97, 1057 du 19 novembre 1977 relatif aux actes<br />
professionnels et à l’exercice de la profession.<br />
Déroulement de la formation<br />
Le DE (Diplôme D’Etat) de manipulateur se prépare dans des écoles, le plus souvent<br />
publiques, rattachées à un centre hospitalier.<br />
On y entre par concours, ce dernier porte sur deux épreuves basées sur le programme<br />
de 1ere et terminale en biologie et physique chimie. Certaines écoles rajoutent des épreuves, il<br />
peut s’agir d’un entretien, de tests psychotechniques ou encore de contraction de texte. Dans<br />
certaines villes l’admission s’effectue à l’issue d’une première année de médecine.<br />
Les études se déroulent sur trois ans (soit 1550h d’enseignement théorique et 2894h de<br />
stage) post bac et sont validées par un DE.<br />
A l’école l’étudiant manipulateur commence à être formé à la technique a proprement<br />
parlé (électrophysiologie, médecine nucléaire, radiothérapie, techniques de soins ;<br />
13
informatique…) ce qui nécessite des connaissances physiques (électricité, radioprotection,<br />
radio physique, radiobiologie…)<br />
Il apprend aussi à connaître le patient (anatomie, physiologie, travaux dirigés…).<br />
Il a également des cours plus généraux sur l’hygiène, la santé publique, déontologie.<br />
Toutes ces formations théoriques sont complétées par des stages pratiques<br />
(institutionnels et mises en situation professionnelle).<br />
Chaque enseignement fait l’objet de contrôle écrit, des évaluations pratiques réalisées<br />
en stage sont incluses dans le contrôle continu.<br />
2.4 Responsabilité<br />
2.4.1 Système juridique actuel<br />
Venue de l’antiquité et affiné par les doctrines du christianisme, le principe de la<br />
responsabilité est justifié par la faute (exemple : violation d’une obligation morale). Cette<br />
conception envisage que chaque être humain est animé par la raison et jouit d’un libre arbitre,<br />
il est donc maître de son destin, il a autant de droits que de devoirs. La responsabilité incite<br />
donc les citoyens à examiner leur conduite et à en écarter les fautes.<br />
La responsabilité permet également de protéger la liberté humaine et la cohésion de la<br />
société, elle renvoie au respect et à la dignité d’autrui.<br />
Cette conception s’appuie également sur la notion d’équilibre. Ainsi tous les membres<br />
de l’humanité peuvent agir librement en conscience ; ils doivent néanmoins accepter de<br />
répondre des conséquences de leurs actes afin de rétablir l’équilibre qu’ils auraient rompu.<br />
La responsabilité est désignée par l’obligation de réparer un dommage causé à autrui<br />
par un acte contraire à l’ordre juridique.<br />
La loi prononce des faits justificatifs ou excuses à l’égard des actes dommageables. En<br />
effet lorsque l’agent peut se prévaloir d’un fait justificatif ce dernier entraîne la disparition à<br />
la fois de la responsabilité pénale et de la responsabilité civile de l’agent. D’autre faits, qui<br />
tout en supposant la responsabilité pénale ou civile établie, emportent une suppression ou une<br />
atténuation de la peine, ce sont les excuses.<br />
2.4.2 Responsabilité, source de sanction<br />
La responsabilité pénale :<br />
La responsabilité pénale peut être mise en cause, <strong>quel</strong>que soit la qualité et la mode<br />
d’exercice (libéral ou hospitalier)<br />
14
Il suffit, pour cela, que la faute soit constitutive d’une infraction dont la répression est<br />
prévue par le code pénal (violence, infraction à la législation, euthanasie, violation du secret<br />
professionnel, non assistance à personne en danger).<br />
C’est le malade qui, s’estimant victime choisit la voie judiciaire, il peut :<br />
- saisir la justice civile pour demander réparation de son dommage<br />
- déposer plainte avec constitution de partie civile entre les mains d’un juge<br />
d’instruction.<br />
La responsabilité disciplinaire :<br />
La responsabilité disciplinaire est l’exercice du pouvoir de sanction dont dispose<br />
l’employeur à l’égard du manipulateur.<br />
Ce pouvoir de sanction est exercé par le Directeur de l’Hôpital qui peut déclencher<br />
l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre du manipulateur, les sanctions prévues<br />
sont classées en quatre groupes :<br />
- 1 er : avertissement, blâme<br />
- 2 ème : radiation du tableau d’avancement, abaissement d’échelon, exclusion temporaire<br />
de fonction pour une durée de quinze jours maximum.<br />
- 3 ème : rétrogradation, exclusion temporaire de fonction de six mois à deux ans<br />
- 4 ème : mise à la retraite d’office, révocation.<br />
Les autres sanctions nécessitent la comparution devant le Conseil de Discipline qui<br />
émet un avis, le Directeur prend la décision.<br />
Une faute grave peut entraîner une suspension immédiate ou un licenciement.<br />
2.4.3 Responsabilité, source d’indemnisation<br />
C’est l’Etablissement et non le manipulateur qui est tenu de réparer les fautes<br />
commises sauf dans le cas exceptionnel où la faute commise est une faute personnelle<br />
détachable du service (faute qui traduit un comportement de l’agent étranger à sa fonction).<br />
Respect du secret médical :<br />
La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est<br />
dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission<br />
temporaire est punissable par la Loi (article 226-13 du Code Pénal).<br />
Il existe des exceptions au secret médical en France. Notamment concernant les<br />
dénonciations de crimes comme le viol (avec l’accord cependant de la victime si elle est<br />
majeure), les agressions sexuelles et les mauvais traitements sur des personnes vulnérables<br />
15
(enfants et personnes âgées ou handicapées). Certaines informations échappent au secret<br />
médical notamment les accidents du travail et maladies professionnelles.<br />
Le devoir d’assistance :<br />
La non assistance à personne en péril est définie à l’article 223-6, alinéa 2 du Code<br />
Pénal (ancien article 63, alinéa 2), aux termes du<strong>quel</strong> est puni celui qui, ayant connaissance du<br />
péril encouru par une personne, ne lui porte pas assistance. Ce délit résulte d’une indifférence<br />
au sort d’autrui puisque le défaut d’assistance résulte d’une abstention voulue face au péril<br />
au<strong>quel</strong> a été exposé autrui. Deux notions sont, dès lors, essentielles pour parler de cette<br />
infraction : le péril appelant l’assistance et l’assistance requise par le péril.<br />
Obtention du consentement réciproque :<br />
Elle est subordonnée à l’information du malade qui ne peut consentir à un acte médical<br />
que s’il a été informé de son contenu.<br />
La jurisprudence estime que cette information doit être claire, loyale, approximative et<br />
intelligible.<br />
Seuls les risques habituels doivent être explicités. Les risques exceptionnels peuvent<br />
être retenus, sauf s’ils sont disproportionnés ou si l’objet de l’acte médical s’éloigne par trop<br />
de la finalité thérapeutique.<br />
L’information est donnée au malade lui-même ou au titulaire de l’autorité parentale<br />
pour le mineur, ou au représentant légal pour le majeur incapable.<br />
Elle est orale sauf circonstances prévues par la loi.<br />
L’information doit porter sur :<br />
- l’état du malade,<br />
- la nature et la mise en œuvre du traitement ainsi que les risques<br />
- les précautions à prendre après l’acte médical<br />
La preuve du défaut d’information est à la charge du malade.<br />
16
2.5 Le Patient<br />
Définition :<br />
Dans le domaine de la médecine, le terme patient désigne couramment une personne<br />
recevant une attention médicale ou à qui est prodigué un soin.<br />
Le patient à l’hôpital :<br />
Tout patient accueilli en Etablissement de Santé doit être considéré comme une<br />
personne à part entière, et pas uniquement au regard de sa pathologie ou de son âge.<br />
Au-delà de la réglementation sanitaire qu’ils appliquent, les Etablissements de Santé<br />
se doivent de veiller au respect des droits de l’homme et du citoyen reconnus universellement<br />
ainsi que des principes généraux du droit français.<br />
Une Charte du patient hospitalisé a été créée en 1995 afin de définir concrètement les<br />
droits essentiels des patients accueillis, affirmés par lois, décrets et circulaires ; cette charte<br />
est annexée à la circulaire ministérielle N° 95 – 22 du 6 mai 1995 (Annexe E ).<br />
2.6 L’acte optimal<br />
Définition :<br />
2.6.1 La qualité<br />
Selon l’organisation internationale de normalisation, la qualité est « l’ensemble des<br />
propriétés et caractéristiques d’un service ou d’un produit qui confèrent l’aptitude à satisfaire<br />
des besoins exprimés ou implicites ».<br />
La qualité en milieu hospitalier :<br />
Le but de la qualité en milieu hospitalier est de satisfaire le patient en mettant à sa<br />
disposition du matériel fiable et performant ainsi que des compétences et des savoirs faire<br />
humains. Cette qualité concerne aussi l’optimisation des ressources, la maîtrise des coûts et<br />
des délais.<br />
En soins de santé, le Dr Avedis DONABEDIAN, médecin et expert en santé publique,<br />
explique que « la qualité de soins techniques réside dans l’application de la science et de la<br />
technologie médicale de manière à maximiser ses avantages pour la santé sans accroître ses<br />
risques de manière correspondante. Le degré de qualité consiste, par conséquent, à voir dans<br />
<strong>quel</strong>le mesure les soins prodigués sont censés atteindre le plus favorable équilibre entre les<br />
risques et les avantages ».<br />
17
Réaliser un acte optimal en radiologie nécessite des qualités de soins et des qualités<br />
techniques.<br />
Les éléments de la qualité :<br />
Certains éléments ou dimensions sont le fondement des critères de qualité, tels que :<br />
c Compétence professionnelle : elle s’applique aux aptitudes techniques,<br />
interpersonnelles, ainsi qu’à la performance des agents de santé. Cet élément inclut les<br />
méthodes des services cliniques, tant sur le plan du diagnostic que du traitement et les<br />
services non cliniques, telles que les relations d’aide entre malade et soignant.<br />
c Accessibilité : l’accès aux services de santé se traduit par l’absence de barrières<br />
(géographiques, financières, sociales, culturelles, linguistiques).<br />
c Efficacité : pour être efficace, la méthode ou le traitement appliqué doit donner le<br />
résultat espéré.<br />
c Les relations interpersonnelles : elles établissent la confiance et la crédibilité à<br />
travers la démonstration de respect, confidentialité, courtoisie et empathie. Les bonnes<br />
relations soignants / soignés entraînent la satisfaction du patient ; un patient satisfait est plus à<br />
même de se conformer au traitement et d’utiliser les services de santé.<br />
c Continuité du soin : le patient doit pouvoir recevoir des services de santé dont il a<br />
besoin sans interruption, dans un délai correspondant à ses attentes.<br />
c Innocuité : en tant que dimension de la qualité, elle vise à diminuer les risques de<br />
blessures, d’infections, d’effets secondaires nuisibles.<br />
c Agréments : ils concernent l’aspect des services de santé notamment l’apparence<br />
des lieux (propreté), du personnel (tenue des blouses, confort de l’accueil) et du matériel.<br />
2.6.2 La qualité de soin<br />
Selon l’O.M.S., la qualité de soins est le fait de garantir à chaque patient l’assortiment<br />
d’actes diagnostiques et thérapeutiques lui assurant le meilleur résultat en terme de santé,<br />
conformément à l’état actuel de la science médicale, au meilleur coût pour le même résultat,<br />
au moindre risque iatrogénique, pour sa plus grande satisfaction, en terme de procédures, de<br />
résultats, de contacts humains à l’intérieur du système de soins.<br />
Avedis DONABEDIAN définit les soins de haute qualité comme étant des soins<br />
maximisant le bien-être des patients après avoir pris en compte le rapport bénéfices/risques à<br />
chaque étape du processus de soins.<br />
18
Evaluation de la qualité de soin en fonction des deux acteurs de la relation<br />
soignant/soigné :<br />
Pour le patient : elle est plus orientée sur le vécu des soins et porte sur la<br />
communication avec les soignants, les délais d’attente, les conditions d’accueil.<br />
Pour le soignant : les compétences des professionnels et l’opportunité d’exécution des<br />
soins sont primordiales. Il s’agit d’appliquer la médecine en prenant en compte les besoins et<br />
les souhaits des patients, en maximisant la relation avec ces derniers.<br />
cause:<br />
2.6.3 La qualité technique :<br />
La qualité en radiologie correspond à la satisfaction de chacune des personnes en<br />
- satisfaction du malade dont le diagnostic a été fait rapidement sans souffrance<br />
excessive, sans risque, sans déplacement, sans attente et avec un accueil de qualité.<br />
- satisfaction des opérateurs par la simplicité de la technique, l’automatisme et la<br />
fiabilité du matériel.<br />
- Satisfaction des organismes responsables, coût…<br />
L’activité technique repose sur plusieurs niveaux :<br />
- qualité administrative<br />
- qualité photographique : contraste, netteté<br />
- qualité de positionnement du malade : incidence, centrage<br />
- nombre de clichés<br />
- choix des paramètres médicaux<br />
Juger la qualité en radiologie ne doit pas reposer que sur une analyse subjective, on ne<br />
doit pas se contenter de dire qu’un film est beau, encore faut-il démontrer sa supériorité<br />
qualitative pour l’objectif décidé.<br />
2.6.4. Assurance qualité :<br />
L’assurance qualité est en ensemble de mesures défini et réparti dans le cadre d’une<br />
démarche de qualité visant à améliorer la performance des services et des agents pour que les<br />
soins de santé soient aussi efficaces et sûrs que possible.<br />
19
Elle repose sur les quatre principes suivants :<br />
- La satisfaction des besoins et attente des patients à travers un dialogue.<br />
- L’amélioration du processus de soins afin d’aboutir à des résultats attendus.<br />
- L’utilisation de données pour l’analyse des situations afin de confirmer la cause des<br />
problèmes ou de connaître <strong>quel</strong>le solution appliquer.<br />
- Le travail en équipe qui par le partage des connaissances et de l’information permet<br />
de prendre des décisions consensuelles.<br />
2.7. ENONCE DE L’HYPOTHESE<br />
Face à l’évolution de l’imagerie médicale qui se veut de plus en plus complexe, la<br />
profession du manipulateur se diversifie et devient ainsi plus pointue.<br />
En regard de nos constats et de cette évolution il nous parait important de s’interroger<br />
sur le niveau d’implication du manipulateur en service de radiologie.<br />
Nous posons donc l’hypothèse :<br />
La technique étant une sécurité acquise, la confiance en soi<br />
devient un atout indispensable pour l’implication du<br />
manipulateur dans sa relation avec le patient.<br />
20
PARTIE 3<br />
CADRE THEORIQUE<br />
21
3. CADRE THEORIQUE<br />
3.1 Concept de la confiance en soi<br />
c Selon le dictionnaire Larousse :<br />
la confiance : sentiment d’assurance, de sécurité de celui qui se fie à <strong>quel</strong>qu’un, à<br />
<strong>quel</strong>que chose.<br />
Avoir confiance en soi : être assuré de ses possibilités (de confiance, en confiance,<br />
sans crainte, sans hésitation).<br />
c Etymologie :<br />
confiance : composé du « cum », avec, et du vieux français « fiance » (qui a donné<br />
fiancé et fiançailles) ; confiance est un dérivé du latin « fidem » : « foi » et son équivalent<br />
savant était confidence…c’est dire la richesse et la complexité de ce terme.<br />
soi : vient du latin « se » en position accentuée.<br />
c En sociologie :<br />
la confiance en soi est considérée comme fondatrice de tout échange. Les études<br />
entreprises en psychologie sociale affirment que la confiance en soi exerce une influence<br />
importante et positive sur les interactions inter-individuelles : « si vous avez confiance en<br />
vous-même, vous inspirerez confiance aux autres » (JOHANN WOLFGANG VON<br />
GOETHE).<br />
Pour certains philosophes, la confiance en soi est LA qualité suprême. Il y a 2000 ans<br />
Horace disait « celui qui a confiance en lui mènera les autres ».<br />
De nos jours, la définition de la confiance en soi ne fait pas l’unanimité. Certains<br />
insistent sur son caractère innée et l’assimile à un trait de personnalité, un don de la nature,<br />
d’autres insistent sur son caractère acquis et en font une bonne réponse apprise à l’occasion<br />
d’expériences abouties, d’autres en font une des compétences de la force du moi.<br />
La confiance en soi apparaît souvent comme le fondement d’une relation de qualité,<br />
autant au travail que dans la vie de tous les jours.<br />
En effet, tous les êtres humains ont besoin d’avoir confiance en eux pour atteindre un<br />
objectif, pour mener à bien un projet ou tout simplement se sentir à l’aise dans certaines<br />
situations.<br />
La confiance est essentielle, sans elle nous ne ferions jamais le premier pas pour faire<br />
ce que nous voulons vraiment. La confiance nous permet d’avancer en dépit des<br />
découragements provisoires.<br />
La confiance vient de nos pensées, nous en sommes donc totalement responsable. « la<br />
confiance est une des possibilités divines de l’homme » Henry de MONTHERLANT<br />
22
3.2 La construction de la confiance en soi<br />
Selon la psychothérapeute Isabelle FILLIOZAT, la confiance en soi se construit en<br />
quatre étapes : sécurité intérieure, affirmation des besoins, acquisition des compétences et<br />
reconnaissance par les autres.<br />
1) La confiance de base, aussi appelée sécurité intérieure : être bien dans son<br />
corps, se sentir à sa place sur cette terre (« Je suis »). A partir du moment où nous sommes<br />
bien à notre place, nous pouvons tout entreprendre. Cette confiance est menacée quand les<br />
parents ne s’occupent pas du bébé, ne le portent pas, ne le désirent pas…. Ce manque de<br />
confiance, extrêmement profond, est plus difficile à rattraper<br />
2) Ensuite se construit la confiance en nos désirs et besoins (« Je ressens »). Elle<br />
s’acquiert à travers la phase d’opposition (entre 18 mois et 2 ans), phase essentielle pour<br />
accéder à cette confiance en notre personne propre, qui permet de dire « je ».<br />
3) Puis vient la confiance en ces compétences, qui apparaît quand l’enfant<br />
commence à vouloir agir seul (« Je fais »). Beaucoup de gens ne se sentent pas « capable<br />
de ». Souvent, ils n’ont même pas vérifié et s’estiment d’emblée incompétents. Alors qu’en<br />
réalité les compétences s’acquièrent, se construisent. Mais il y a tellement de malentendus<br />
autour de la confiance : l’idée « Je n’y arriverais pas » est tellement ancrée à l’intérieur de<br />
nous qu’on ne la met même pas à l’épreuve de la réalité. On n’essaye même pas. Mais la<br />
réalité de la confiance dans ses compétences, c’est qu’elle se construit dans la réalisation.<br />
Cette conviction négative vient d’expériences d’avoir été humilié, dévalorisé, traité<br />
d’incapable….<br />
4) Enfin vient la confiance sociale, relationnelle (« Je suis reconnu »). Ai-je<br />
confiance dans le fait que je vais être accepté par les autres ? Est-ce que je me vois comme<br />
<strong>quel</strong>qu’un de bien ou comme un nul qui ne va intéresser personne ? Dans le second cas je vais<br />
me cacher, éviter les autres et éventuellement développer des phobies sociales. Cette<br />
confiance se développe d’abord dans la cellule familiale (rapport aux parents, aux frères et<br />
sœurs), mais elle est aussi liée à ce qu’on vit à l’école. Beaucoup de gens sont paralysés<br />
socialement parce qu’ils ont vécu des expériences de rejet et d’humiliation de la part de<br />
camarade de classe.<br />
23
3.3 Comment bâtir sa confiance en soi ?<br />
Pour Jean GARNEAU, psychologue, co-fondateur des ressources en développement,<br />
bâtir sa confiance en soi s’appuie sur :<br />
- l’accumulation d’expérience<br />
- l’évaluation des résultats<br />
- l’innovation volontaire<br />
- les risques calculés.<br />
˘ L’accumulation d’expérience :<br />
Aborder un domaine nouveau nous met en situation d’insécurité : qu’est ce qui nous<br />
attend ? Comment s’adapter ? Dans l’ignorance de ce qu’il va se passer, comment anticiper<br />
nos réactions ? Donc dans ce cas de figure, se lancer avec assurance serait même dangereux.<br />
Pour d’autres personnes, expérimentées, habituées à ce domaine, elles seront en<br />
confiance car elles en ont mesuré les dangers, connaissent les caractéristiques et ce qui s’y<br />
passe habituellement et savent pouvoir trouver en elles une façon de s’adapter à toute<br />
situation particulière.<br />
Avoir confiance en soi nécessite déjà de s’impliquer activement pour « acquérir de<br />
l’expérience »<br />
˘ L’évaluation des résultats :<br />
Il faut savoir aussi tirer des leçons de ses erreurs pour avancer. En effet, en<br />
comprendre les causes et savoir les corriger, permet de trouver la meilleure solution.<br />
En plus de l’accumulation d’expériences, la confiance en soi exige une réflexion<br />
critique constante sur ces expériences afin d’en comprendre les jeux de forces, les variables<br />
principales et les liens de cause à effet.<br />
˘ L’innovation volontaire :<br />
Une confiance en soi solide suppose une expérience variée ; en effet si on répète<br />
toujours les mêmes gestes, on ne peut maîtriser que ceux-ci. Toute nouvelle situation nous<br />
met alors en difficulté, rendant notre méthode inapplicable et notre adaptation difficile. Donc<br />
pour obtenir cette richesse d’expérience, il est nécessaire d’introduire volontairement de la<br />
variété.<br />
La vraie confiance suppose qu’on est capable de s’adapter rapidement aux situations et<br />
de trouver de nouvelles solutions lorsque nécessaire.<br />
Oser chercher des solutions meilleures que celles connues renforce notre confiance<br />
mais il est nécessaire de savoir évaluer et gérer les risques.<br />
24
˘ Risques calculés :<br />
La stratégie la plus efficace pour que notre expérience nous serve à développer<br />
rapidement notre confiance en nous-mêmes, c’est de bien maîtriser les risques que nous<br />
prenons. En effet, il est nécessaire de prendre des risques pour sortir des solutions toutes faites<br />
et explorer vraiment le nouveau domaine. Cependant pour éviter des échecs qui pourraient<br />
être destructeurs, il faut augmenter le niveau de difficultés et l’importance des risques de<br />
façon progressive. Ainsi, nous pourrons avoir les ressources et la sécurité personnelle pour<br />
accepter et exploiter les échecs que nous rencontrerons.<br />
Comme pour tout apprentissage, il ne faut pas rester limité à ce que l’on connaît déjà,<br />
il ne faut pas se lancer aveuglément dans des situations trop difficiles avec les moyens dont<br />
nous disposons mais il faut graduer la difficulté pour progresser.<br />
25
PARTIE 4<br />
METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE<br />
26
4. METHODOLOGIE DE L’ENQUETE<br />
4.1 Introduction :<br />
Afin de pouvoir répondre à notre question de départ (Qu’est ce qui détermine le<br />
niveau d’implication du manipulateur dans les domaines techniques ou relationnels ?) et<br />
de vérifier notre hypothèse (La technique étant une sécurité acquise, la confiance en soi<br />
devient un atout indispensable pour l’implication du manipulateur), nous avons eu recours<br />
à plusieurs entretiens.<br />
4.2 Recueil des données<br />
4.2.1 Choix du terrain<br />
Nous avons tenu à réaliser notre enquête au niveau du C.H.U. de MONTPELLIER car<br />
c’est le lieu principal où nous sommes formés et où nous réalisons l’essentiel de nos stages au<br />
cours de nos trois ans d’études.<br />
4.2.2 Choix de la population<br />
Nous avons choisi d’interroger des manipulateurs travaillant dans le même domaine<br />
d’activité (le scanner) car il nous semble que la technique et le soin sont deux activités<br />
indissociables de ce lieu.<br />
Pour cela, nous avons réalisé une étude sur un échantillon de douze manipulateurs en<br />
tenant compte de leur ancienneté.<br />
Nous avons interviewé :<br />
- six manipulateurs avec cinq à quinze ans d’ancienneté<br />
- six manipulateurs avec plus de quinze ans d’ancienneté<br />
4.2.3 Choix de l’outil<br />
Nous nous sommes rendus sur différents sites pour réaliser notre enquête. Elle s’est<br />
déroulée sous la forme d’entretiens semi directifs, à partir d’un questionnaire élaboré au<br />
préalable, basé sur le concept de la confiance en soi. Nous avons garanti à chaque<br />
interlocuteur anonymat et confidentialité de leurs propos.<br />
27
4.3 Traitement des données<br />
Le questionnaire a été réalisé autour des quatre étapes de la confiance en soi :<br />
- je suis<br />
- je ressens<br />
- je fais<br />
- je suis reconnu<br />
4.4 Limites de l’étude<br />
Par faute de temps et de moyens, l’étude réalisée a des limites :<br />
La population<br />
Le faible nombre de manipulateurs interrogés ne nous permet pas de généraliser nos<br />
conclusions de l’enquête<br />
Les interviews<br />
Du fait de notre manque d’expérience et la complexité à mener à bien un entretien, il<br />
nous a paru difficile de recadrer le manipulateur dans ses réponses.<br />
28
PARTIE 5<br />
RESULTATS ET ANALYSES DES<br />
ENTRETIENS<br />
29
5. RESULTATS ET ANALYSE DE<br />
L’ENQUETE<br />
5.1 Résultats de l’enquête<br />
Par commodité, nous avons appelé :<br />
MA manipulateur ayant entre cinq et quinze ans de métier<br />
MB manipulateur ayant plus de quinze ans de métier<br />
Les données recueillies par l’enquête vont être analysées selon les différentes étapes<br />
de la Confiance en Soi :<br />
- représentation du « je suis » (questions 1 et 2)<br />
- représentation du « je ressens » (question 3, 4 et 5)<br />
- représentation du « je fais » (question 6)<br />
- représentation du « je suis reconnu » (question 7)<br />
(Annexe F)<br />
5.1.1 Résultats et Analyse du « JE SUIS »<br />
• Qu’est ce qui vous a poussé à devenir manipulateur ?<br />
MA : « C’est une réorientation professionnelle »<br />
« Par hasard, après avoir échoué médecine »<br />
« Je recherchais un métier avec du contact humain »<br />
« Une personne de ma famille est manipulateur, c’est elle qui m’a poussé à passer le<br />
concours »<br />
MB : « Par opportunité tout simplement »<br />
« Je voulais faire des études courtes »<br />
« Je cherchais un métier en relation avec l’hôpital »<br />
Près de la moitié des manipulateurs interrogés avoue être arrivé à ce choix par défaut<br />
(échec médecine, pharmacie, autres…), par hasard ou par opportunité.<br />
Deux d’entre eux indiquent avoir connu le métier par personne interposée, ou suite à<br />
une réflexion concernant une réorientation professionnelle.<br />
Un tiers des professionnels interrogé précisent avoir été attiré par le coté relationnel, le<br />
contact humain, le lien avec l’hôpital (milieu médical) et l’attrait de la technique.<br />
30
L’ensemble de ces résultats s’applique aussi bien aux MA qu’aux MB.<br />
Pourquoi arrive-t-on à cette profession avec un tel pourcentage de hasard que ce soit il<br />
y a trente ans ou aujourd’hui ?<br />
- La profession de manipulateur reste peut être encore trop méconnue et peu<br />
représentée dans les forums carrières ou métiers.<br />
- A durée d’études équivalentes, la profession de manipulateur est peut être moins<br />
valorisée que d’autres professions paramédicales.<br />
Arriver suite à un échec dans une profession, c’est peut être à l’origine ne pas arriver<br />
à s’affirmer, ne pas se sentir à sa place dans ces choix originaux, douter de soi même, mettre<br />
en cause sa propre sécurité intérieure et peut ébranler sa confiance de base.<br />
Pour certains, choisir cette profession fait suite à une réflexion personnelle, donc ils se<br />
sentent à leur place, ils ont pu acquérir une certaine sécurité intérieure qui leur a permis ce<br />
cheminement. Ils ont montré leur capacité à entreprendre (dans un premier temps dans le<br />
choix de leur réorientation). Au niveau professionnel ils sauront trouver en eux les moyens de<br />
se remettre en cause et d’entreprendre.<br />
Les professionnels qui disent être attirés par ce métier, nécessitant des qualités<br />
techniques et relationnelles, ont peut être suffisamment confiance en eux :<br />
- pour gérer les inter actions interindividuelles et mener à bien les échanges avec les<br />
patients où les professionnels.<br />
- pour atteindre un objectif (examen de qualité)<br />
- pour se sentir à l’aise dans toutes situations (savoir s’adapter et entreprendre).<br />
31
• Qu'est ce qui vous plait dans le métier de manipulateur?<br />
4<br />
3,5<br />
3<br />
2,5<br />
2<br />
1,5<br />
1<br />
0,5<br />
0<br />
67% des MA préfèrent la technique contre 16% des MB.<br />
50% des MB préfèrent le soin contre 16% des MA.<br />
MA MB<br />
TECHNIQUE 4 1<br />
SOIN 1 3<br />
TECHNIQUE+SOIN 1 2<br />
TECHNIQUE SOIN TECHNIQUE+SOIN<br />
Le reste des manipulateurs n’exprime pas de préférence<br />
Les trois quarts des jeunes interrogés confessent un intérêt tout particulier pour la<br />
technique. Ils avouent maîtriser facilement les outils informatiques et leurs dérivés ; cette<br />
connaissance leur confère une certaine confiance en eux.<br />
Pour la moitié des MB, ils se plaisent dans la relation aux patients, dans leur capacité à<br />
adapter leurs pratiques, à oser entreprendre.<br />
MA<br />
MB<br />
32
5.1.2 Résultats et Analyse du « JE RESSENS »<br />
L’exploitation des résultats obtenus à la représentation du « je ressens », à travers les<br />
questions :<br />
« Qu’est ce qui vous paraît le plus difficile dans la profession ? »<br />
« Dans <strong>quel</strong> domaine vous sentez vous plus à l’aise ? »<br />
nous a amenés à effectuer une analyse commune, ces deux questions étant complémentaires.<br />
• Qu'est ce qui vous parez le plus difficile dans la profession?<br />
4<br />
3,5<br />
3<br />
2,5<br />
2<br />
1,5<br />
1<br />
0,5<br />
0<br />
MA MB<br />
Technique 2 4<br />
Soin 4 2<br />
Technique + Soin 0 0<br />
Technique Soin Technique + Soin<br />
33% des MA trouvent la technique le domaine d’activité le plus difficile de la profession<br />
contre 66% des MB.<br />
66% des MA expriment la difficulté dans le soin contre 33% des MB.<br />
Aucun des manipulateurs interrogés ne situe la difficulté dans les deux domaines d’activité.<br />
MA<br />
MB<br />
33
• Dans <strong>quel</strong> domaine vous sentez-vous le plus à l'aise?<br />
4<br />
3,5<br />
3<br />
2,5<br />
2<br />
1,5<br />
1<br />
0,5<br />
0<br />
MA MB<br />
Technique 4 1<br />
Soin 2 3<br />
Technique + Soin 0 2<br />
Technique Soin Technique + Soin<br />
66% des MA se sentent à l’aise dans la technique contre 16% des MB.<br />
50% des MB se sentent à l’aise dans le soin contre 33% des MA.<br />
33% des MB s’estiment à l’aise autant dans la technique que dans le soin.<br />
Si 66 % des MA s’estiment plus à l’aise dans la technique, donc derrière la console,<br />
c’est qu’ils sont nés et ont grandi avec la technologie, phénomène de société dont ils ont<br />
intégré la technique, et qui fait leur force.<br />
Inversement, ces MA expriment leur difficulté dans le soin, en effet leur technicité<br />
n’a-t-elle pas tendance à faire oublier l’humain ? Pour eux, le patient est rarement considéré<br />
comme un partenaire, mais bien plus comme un objet d’investigations.<br />
Pour les MA, une machine même compliquée a toujours un mode d’emploi, qu’ils<br />
arrivent à comprendre sans difficultés, pour comprendre l’être humain, il n’y a pas de mode<br />
d’emploi.<br />
MA<br />
MB<br />
34
Pour les MB, 66 % d’entre eux, malgré leur expérience professionnelle, avouent être<br />
mal à l’aise dans la technique, ils se disent parfois dépassés par la constante évolution des<br />
techniques, et la complexité des appareils.<br />
Par contre, cette expérience auprès des patients, leur a permis de situer ce dernier au<br />
centre de la profession de manipulateur, leur permettant ainsi de privilégier l’aspect<br />
relationnel de la profession. Avec le temps, la relation soignant/soigné s’est approfondie et<br />
améliorée.<br />
La confiance en tant que professionnel que l’on acquiert grâce à l’expérience, permet<br />
au manipulateur de s’affirmer dans son contact à l’autre. Le MB n’a pas eu la chance de<br />
naître avec la technologie, il a du et doit encore aujourd’hui se l’approprier.<br />
Si on suit une logique, dans trente ans, le manipulateur devrait être aussi bien à l’aise<br />
dans la technique qui évolue avec lui et qu’il maîtrise, que dans la relation soignant/soigné<br />
qu’il va perfectionner et affiner avec l’expérience.<br />
35
5.1.3 Résultats et Analyse du « JE FAIS »<br />
• Quels sont pour vous les actes les plus engageants ?<br />
MA : « Pour moi l’acte le plus engageant est l’injection du PCI ».<br />
« Tous les actes sont importants mais le plus engageant reste l’injection d’iode ».<br />
« C’est l’injection d’iode qui me fait le plus peur »<br />
MB : « L’injection d’iode même si le médecin est présent ».<br />
« L’examen dans sa globalité ».<br />
Pour la majorité des manipulateurs interrogés, l’acte le plus engageant est un acte de<br />
soin : l’injection du produit de contraste.<br />
Pour l’ensemble, le meilleur moyen de prévention de ce risque est l’interrogatoire du<br />
patient avant l’injection : « si j’ai mal fait mon interrogatoire et que le patient fait une réaction<br />
après l’injection, je me sens totalement responsable ».<br />
Chaque manipulateur possède les compétences requises pour réaliser cet acte de soin,<br />
il est en capacité d’évaluer les risques encourus et d’adapter les gestes et l’attitude<br />
(interrogatoire) nécessaires.<br />
Cependant les compétences et la responsabilité du manipulateur au travers de<br />
l’interrogatoire et de l’injection ne peuvent pas être banalisées. Ainsi, même si le<br />
manipulateur va répéter inlassablement ces actes, il doit y apporter attention et sérieux, et ne<br />
pas se laisser surprendre par l’habitude.<br />
Nous pouvons dire que la maîtrise de l’acte, la confiance en soi dans la réalisation de<br />
ce dernier exige malgré tout une réflexion critique et constructive tout au long de la prise en<br />
charge d’un patient.<br />
Nous pouvons dire aussi que c’est avec l’expérience et la réalisation que les<br />
compétences s’acquièrent et se construisent.<br />
Pour certains manipulateurs, il n’y a pas particulièrement d’actes engageants, pour<br />
eux, tout geste effectué sur un patient que ce soit du soin, ou de la technique, engage leur<br />
responsabilité et nécessite leurs compétences<br />
Tout manipulateur doit faire preuve de conscience professionnelle, il doit savoir se<br />
remettre en question à tout moment.<br />
36
5.1.4 Résultats et Analyse du « JE SUIS RECONNU »<br />
• Quelle satisfaction vous procure votre travail ?<br />
MA et MB : « on reçoit uniquement la reconnaissance du patient »<br />
« on est content si le patient est content »<br />
« on est satisfait de pouvoir aider le Médecin à poser un diagnostic, grâce à nos<br />
images de qualité ».<br />
Pour la majorité des manipulateurs, il n’y a pas de reconnaissance ni de compensation<br />
du corps médical, même si le travail augmente de jour en jour et s’ils doivent s’adapter aux<br />
nouvelles technologies.<br />
Certains avouent même se sentir considérés comme de simples « presses boutons ».<br />
Même si les manipulateurs n’obtiennent pas la reconnaissance à la<strong>quel</strong>le ils aspirent de<br />
la part des professionnels de santé, en égard aux patients qu’ils accueillent à leur arrivée dans<br />
le service d’imagerie, et la qualité du lien – soin qu’ils vont créer, les manipulateurs vont<br />
continuer d’évoluer, de se perfectionner.<br />
Aujourd’hui, la seule reconnaissance, que les manipulateurs pensent recevoir, passe à<br />
travers « le merci » du patient qu’ils viennent d’écouter, de rassurer, d’accompagner dans<br />
l’acte radiologique.<br />
37
5.2 Synthèse des Analyses<br />
que :<br />
L’exploitation des résultats, à travers le concept de la confiance en soi, fait apparaître<br />
˘ Les Manipulateurs MA, dans l’exercice de leur profession, se considèrent en tant<br />
que véritables professionnels de santé (JE). Riches des connaissances acquises en formation,<br />
de leur expérimentation au cour des stages et après <strong>quel</strong>ques années de travail en tant que<br />
professionnels, ils parviennent à entreprendre des situations (JE FAIS) plus particulièrement<br />
dans le domaine technique qu’ils maîtrisent au mieux et dont ils connaissent les risques (JE<br />
RESSENS).<br />
Même s’ils se sentent moins à l’aise dans la relation au patient (JE RESSENS) ils<br />
effectuent tout de même les actes de soins nécessaires avec professionnalisme.<br />
˘ Les Manipulateurs MB, pas de doute, pour eux, ils sont professionnels (JE). Forts<br />
de leurs expériences auprès des patients, de leurs capacités à s’adapter aux différentes<br />
situations (JE FAIS), ils savent prendre en charge un patient et connaissent parfaitement les<br />
risques (JE RESSENS).<br />
Même s’ils ne maîtrisent pas toujours complètement la technologie qui évolue, leur<br />
vécu professionnel fait leur force et leur permet d’aller de l’avant (JE RESSE NS et JE FAIS).<br />
˘ Manipulateur MA et MB sont unanimes pour dire que la reconnaissance qu’ils<br />
reçoivent est essentiellement celle du patient et, peut être, à travers la qualité des clichés<br />
indirectement celle du médecin radiologue (JE SUIS RECONNU).<br />
La confiance en soi du MA s’affirme plus dans le domaine technique, à l’inverse pour<br />
le MB elle se réalise plus au travers de la relation soignant-soigné.<br />
Au terme de ce travail de recherche, les entretiens et leur analyse ne nous<br />
permettent pas de valider totalement notre hypothèse de départ qui était<br />
La technique étant une sécurité acquise, la confiance en soi devient un atout<br />
indispensable pour l’implication du manipulateur dans sa relation au patient.<br />
Aujourd’hui, nous pouvons affirmer que la confiance en soi est indispensable pour que<br />
la relation soignant-soigné existe.<br />
Par contre, en raison de la constante évolution de la technique et de la nécessité pour le<br />
professionnel de s’adapter et de suivre cette évolution, nous ne pouvons pas dire que la<br />
technique est une sécurité acquise.<br />
38
PARTIE 6<br />
PISTES DE REFLEXION<br />
39
6. PISTES DE REFLEXION<br />
Tout au long de ce travail autour de l’implication du manipulateur dans les différents<br />
domaines de la profession, nous avons pu développer notre réflexion personnelle. Les<br />
résultats obtenus nous ont permis de répondre à notre questionnement mais aussi à nous faire<br />
prendre conscience des rôles que nous devons jouer tant dans les domaines techniques que<br />
relationnels sans distinction.<br />
Plusieurs pistes nous paraissent intéressantes à développer contribuant au<br />
prolongement de notre réflexion<br />
Les attentes du patient sur l’implication des manipulateurs.<br />
La formation à l'institut<br />
6.1 Les attentes du patient sur l'implication des manipulateurs<br />
Il se dessine au terme de cette phase exploratrice que les manipulateurs ne percevaient<br />
ni la nécessité, ni le besoin de se former ou de se perfectionner dans le "social". Nous relevons<br />
ici le paradoxe suivant : Le manipulateur considère ses relations avec le patient comme<br />
importantes, néanmoins, il ne les qualifie pas, il les considère seulement comme implicite.<br />
Pourtant : Quelles sont les attentes des patients vis-à-vis du manipulateur ?<br />
Comment voit-il le manipulateur ?<br />
Nous avons vu que cette profession s'est construite d'abord et surtout autour de la<br />
manipulation des appareils de radiologie.<br />
Les patients ne sont pas effrayés par la technologie si celle-ci est pratiquée par des<br />
professionnels qui savent à travers leur pratique faire preuve de chaleur et d'humanité.<br />
Le manipulateur doit se différencier de l'effet de sa machine qui "déshumanise la<br />
maladie" pour mieux pouvoir l'observer. Il peut être attentif à l'histoire singulière de chacun<br />
des patients qu'il rencontre et ainsi personnaliser son attitude professionnelle.<br />
Si la réalisation des scanners peut être routinière pour le manipulateur, cette dernière<br />
nous montre qu'il n'en est pas de même pour les patients.<br />
Passer un examen en radiologie n'est jamais une démarche banale.<br />
Le manipulateur qui choisit de se cacher derrière sa machine peut se soustraire de<br />
l'anxiété et de l'attente explicite ou implicite des patients.<br />
Le manipulateur n'est pas qu'un exécutant, "un presse boutons" comme le laissent<br />
entendre certaines mauvaises langues. Il a une place à prendre auprès du patient.<br />
Au terme de cette recherche, nous sommes convaincus que patient et manipulateur ont<br />
tout à gagner à ce qu'une attention particulière soit accordée à cette relation.<br />
40
Malheureusement, dans l'univers de la radiologie, bien des choses s'y opposent: du<br />
soucis de la technique à la performance de production.<br />
6.2 La formation à l'institut<br />
La technologie poursuit ses progrès, la radiologie vit une résolution technique.<br />
De nouvelles techniques apparaissent, la radiologie interventionnelle se développe, les<br />
traitements en radio-oncologie s'affinent et la médecine nucléaire se complexifie.<br />
Cette évolution, avec l'arrivée de machines toujours plus complexes, accompagnée de<br />
techniques plus sophistiquées nécessite la refonte des programmes de formation à l'institut.<br />
En un siècle, nous sommes passés d'une formation sur le tas, sans réels programmes de<br />
formations, ni titre décerné, à une formation disposant de programmes reconnus par les<br />
autorités cantonales et fédérales compétentes, et d'une durée de trois ans.<br />
Mais force est de constater que les éléments déterminants ayant le plus fortement<br />
contribué à ces changements sont en relation avec l'extraordinaire évolution des appareils<br />
radiologiques ainsi qu'aux progrès technologiques.<br />
Le patient, qui a de tout temps été au côté de celui qui utilisait les rayons X, n'a<br />
rarement été au centre des préoccupations ni des programmes de formations.<br />
Voici venu l'opportunité de s'interroger sur le savoir- être et non plus uniquement sur<br />
le savoir-faire de ceux qui le pratiquent.<br />
41
CONCLUSION<br />
Ce travail de recherche nous a permis de rencontrer des professionnels de santé et de<br />
mieux connaître notre future profession de Manipulateur en Electroradiologie Médicale.<br />
Il nous a permis d’approfondir la notion de confiance en soi, de voir son incidence sur<br />
l’implication du manipulateur dans les domaines techniques et relationnels.<br />
Ainsi nous pouvons affirmer aujourd’hui que chaque Manipulateur a besoin d’avoir<br />
confiance en lui tant pour développer au maximun ses qualités techniques au travers des<br />
« clichés » que pour optimiser ses qualités relationnelles.<br />
L’élaboration de ce travail nous a donc permis de nous intéresser et de réfléchir sur<br />
divers sujets que ce soit la profession, les rôles du manipulateur, sa responsabilité, l’acte<br />
optimal ou encore le patient.<br />
Il nous a également permis d’acquérir une méthodologie et d’apprendre à travailler en<br />
équipe.<br />
Ce travail a été pour nous une source d’enrichissement personnel et professionnel.<br />
Au terme de notre démarche exploratoire nous pensons que le sujet mériterait d’être<br />
complété par une étude auprès des patients, de leur ressenti lors d’examens radiologiques et<br />
de leurs attentes vis-à-vis des professionnels de Santé.<br />
42
Revues :<br />
BIBLIOGRAPHIE<br />
LE MANIPULATEUR n°126, septembre 1997<br />
LE MANIPULATEUR n° 144, mars 2002<br />
Mémoires :<br />
Cours :<br />
Article :<br />
« La gestion des risques »<br />
Cours de Législation Hospitalière IFMEM <strong>Montpellier</strong> 2007-2008<br />
« La confiance en soi peut se conquérir » Isabelle FILLIOZAT<br />
Documents multimédias :<br />
SFR : Société Française de Radiologie<br />
Internet :<br />
www.legifrance.fr<br />
www.sante.gouv.fr<br />
www.wikipidia.fr<br />
www.psychologie.com<br />
43
LISTE DES ANNEXES<br />
Annexe A : Affirmation de notre identité<br />
Annexe B : Reconnaissance statutaire de la profession<br />
Annexe C : De la reconnaissance de nos compétences à l’habilitation à<br />
accomplir certains actes<br />
Annexe D : Décret n°97-1057 du 19 novembre 1997<br />
Relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession de<br />
Manipulateur en Electroradiologie Médicale<br />
Annexe E : Charte du patient hospitalisé<br />
Annexe F : Grille d’entretien<br />
44
ANNEXE A<br />
45
L'Evolution de la profession<br />
de Manipulateur d'Electroradiologie Médicale<br />
à travers les textes officiels<br />
1937<br />
Circulaire du 17 juin 1937<br />
Elle précise les mesures de protection à appliquer contre les rayonnements nocifs pour les<br />
personnels appelés à manipuler les appareils de radiologie ainsi que les produits radioactifs.<br />
1943<br />
Décret n°891 du 17 avril 1943<br />
"Manipulateurs radiographes"<br />
1949<br />
Arrêté du 10 janvier 1949<br />
"Manipulateurs radiologistes"<br />
Arrêté du 2 février 1949 (Hôpitaux psychiatriques)<br />
"Manipulateurs radiologistes"<br />
1955<br />
Circulaire n°154 du 21 novembre 1955<br />
"Manipulateur de radiologie"<br />
1964<br />
Décret 64-748 du 17 juillet 1964<br />
"Manipulateur d'électroradiologie"<br />
1983<br />
Décret 83-770 du 24 août 1983<br />
"Manipulateur d'Electroradiologie Médicale"<br />
1989<br />
Décret 89-613 du 1 er septembre 1989<br />
"Manipulateur d'Electroradiologie Médicale":<br />
de classe normale, de classe supérieure, Surveillant, Surveillant-Chef<br />
(Fonction Publique Hospitalière)<br />
46
ANNEXE B<br />
47
L'Evolution de la profession<br />
de Manipulateur d'Electroradiologie Médicale<br />
à travers les textes officiels<br />
1943<br />
Décret 891 du 17 avril 1943<br />
Les manipulateurs radiographes font partie du personnel secondaire spécialisé.<br />
1949<br />
Arrêté du 10 janvier 1949<br />
Les manipulateurs radiologistes font maintenant partie de la catégorie des infirmiers<br />
spécialisés avec une échelle indiciaire supérieure à celle des infirmières diplômés d'Etat.<br />
1962<br />
Décret 62-132 du 2 février 1962; Circulaire du 5 mars 1962<br />
Les manipulateurs de radiologie ne font plus partie de la catégorie des infirmiers spécialisés<br />
qui est réservée aux aides anesthésistes et aux aides dermatologistes.<br />
1963<br />
Arrêté du 8 juillet 1963<br />
Les manipulateurs sont classés dans un échelonnement indiciaire spécifique mais commun<br />
avec les laborantins et les préparateurs en pharmacie.<br />
1964<br />
Décret 64-748 du 17 juillet 1964<br />
Création de 3 grades, parmi les personnels d'encadrement et d'exécution des services<br />
d'électroradiologie: manipulateur d'électroradiologie, aide technique d'électroradiologie,<br />
aide d'électroradiologie.<br />
Les recrutements s'opèrent dorénavant par concours sur épreuves.<br />
1968<br />
Décret 68-97 du 10 janvier 1968<br />
- création des emplois de surveillants et surveillants-chefs des services d'électroradiologie<br />
- les aides techniques sont placés en cadre d'extinction.<br />
1970<br />
Décret 70-13 du 3 novembre 1970<br />
Les personnes ayant obtenu le D.E. par la voie de la promotion professionnelle sont<br />
dispensées de subir les épreuves du concours pour accéder aux emplois de manipulateur.<br />
48
1973<br />
Décret 73-1095 du 29 novembre 1973<br />
Les titulaires du D.E. peuvent maintenant accéder aux emplois de manipulateur par concours<br />
sur titres.<br />
1977<br />
Décret 77-1038 du 12 septembre 1977<br />
Les concours sur titres sont ouverts aux personnes titulaires du B.T.S.<br />
1982<br />
Décret 82-1010 du 21 décembre 1982<br />
Les titulaires du certificat de cadre peuvent accéder aux fonctions de surveillant après 5<br />
années de service.<br />
1984<br />
Décret 84-710 du 17 juillet 1984<br />
Les personnes effectuant à titre principal des fonctions de manipulateur sans en possèder les<br />
titres ou diplômes, avant le 25 juillet 1984, doivent se soumettre aux épreuves de vérification<br />
des connaissances pour pouvoir continuer à exercer.<br />
1989<br />
Décret 89-613 du 1 er septembre 1989<br />
Les manipulateurs d'électroradiologie médicale font partie des personnels médico-techniques<br />
de la Fonction Publique Hospitalière et possèdent désormais un statut particulier. Ils sont<br />
constitués en un corps, comprenant 4 grades: classe normale, classe supérieure, surveillant,<br />
surveillant-chef.<br />
1991<br />
Décret 91-1273 du 18 décembre 1991<br />
Les manipulateurs d'électroradiologie médicale surveillants-chefs sont rangés dans un corps<br />
de la catégorie A de la Fonction Publique. Ils sont reclassés dans le nouveau classement<br />
indiciaire intermédiaire CII à compter du 1 er août 1991.<br />
1993<br />
Décret 93-333 du 12 mars 1993<br />
Reclassement des manipulateurs surveillants dans le CII à compter du 1 er août 1992.<br />
1994<br />
Décret 94-77 du 25 janvier 1994<br />
Du 1 er août 1993 au 1 er août 1994, tous les manipulateurs sont reclassés dans une nouvelle<br />
classe normale (ou 1 er grade nouveau).<br />
A compter du 1 er août 1994, les manipulateurs de la nouvelle classe normale (ou 1 er grade<br />
49
nouveau) accèdent à la nouvelle classe supérieure (ou 2 ème grade nouveau).<br />
Ce changement de grade s'étale jusqu'au 1 er août 1996.<br />
1995<br />
Loi 95-116 du 4 février 1995<br />
La profession de manipulateur d'électroradiologie médicale est inscrite au code de la Santé<br />
Publique. Chaque professionnel a l'obligation de se faire inscrire sur une liste<br />
départementale.<br />
L'usurpation du titre et l'exercice illégal sont réprimés par la loi.<br />
50
ANNEXE C<br />
51
L'Evolution de la profession<br />
de Manipulateur d'Electroradiologie Médicale<br />
à travers les textes officiels<br />
1949<br />
Circulaire n°125 du 24 mai 1949<br />
Manipulateurs radiologistes: les agents manipulant des appareils à rayons X.<br />
1964<br />
Décret 64-748 du 17 juillet 1964<br />
Les manipulateurs d'électroradiologie, sous le contrôle des chefs de service<br />
d'électroradiologie, sont chargés de l'encadrement du personnel. Ils doivent faire preuve<br />
d'une compétence étendue dans la mise au point et l'utilisation des appareils de leur<br />
spécialité. Ils sont chargés de l'entretien du matériel. Ils participent à l'exécution de tous<br />
travaux et notamment au développement des clichés, à la mise en place des malades et à la<br />
préparation des appareils. Ils peuvent être chargés de la manipulation des substances<br />
radioactives.<br />
1968<br />
Décret 68-97 du 10 janvier 1968<br />
Les manipulateurs d'électroradiologie assurent sous les directives et le contrôle des chefs de<br />
service et des assistants d'électroradiologie, des Surveillants-Chefs et Surveillants des<br />
services d'électroradiologie, l'entretien du matériel, l'exécution de tous les travaux et<br />
notamment le développement des clichés, la mise en place des malades et la préparation des<br />
substances radioactives.<br />
1973<br />
Décret 73-1095 du 29 novembre 1973 modifiant le Décret 68-97 du 10 janvier 1968<br />
... de plus, les manipulateurs, sont habilités, sous les directives et le contrôle des chefs de<br />
service et de leurs collaborateurs Médecins à manipuler les appareils d'électroradiologie, les<br />
générateurs électriques de rayonnements ionisants... Ils sont en particulier autorisés à<br />
effectuer des clichés de pratique courante.<br />
1974<br />
Arrêté du 9 mai 1974<br />
Création de la commission des manipulateurs à la Commission Supérieure des Professions<br />
Paramédicales.<br />
52
1984<br />
Décret 84-710 du 17 juillet 1984<br />
Les personnes remplissant les conditions d'exercice peuvent, sur prescription médicale<br />
contribuer:<br />
- à la réalisation des examens nécessaires à l'établissement d'un diagnostic,<br />
- aux traitements mettant en oeuvre des rayonnements ionisants ou non, ou d'autres agents<br />
physiques.<br />
Sous la responsabilité et le contrôle d'un médecin, ces personnes peuvent:<br />
- assurer le déclenchement et le réglage des appareils,<br />
- faire des administrations orales et rectales, des injections intramusculaires, sous-cutanées,<br />
et dans les veines superficielles,<br />
- préparer du matériel d'exploration et médico-chirurgical,<br />
- manipuler des substances, y compris des composés radio-actifs.<br />
Des compétences particulières leurs sont également reconnues en radiothérapie et en<br />
électrologie.<br />
1995<br />
Loi 95-116 du 4 février 1995<br />
La profession de manipulateur d'électroradiologie médicale est inscrite au code de la Santé<br />
Publique, protégeant notre exercice professionnel.<br />
1997<br />
Décret 97-1057 du 19 novembre 1997<br />
relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de manipulateur<br />
d'électroradiologie médicale.<br />
53
ANNEXE D<br />
54
Décret no 97-1057 du 19 novembre 1997<br />
relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de manipulateur<br />
d'électroradiologie médicale<br />
Le Premier ministre,<br />
Sur le rapport du ministre de l'emploi et de la solidarité,<br />
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 372, L. 504-13 à L. 504-16 et L.<br />
510-10 ;<br />
Vu le décret no 84-710 du 17 juillet 1984 modifié fixant les catégories de personnes habilitées<br />
à effectuer certains actes d'électroradiologie médicale ;<br />
Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine en date du 11 mars 1997 ;<br />
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,<br />
Décrète :<br />
Art. 1er. - Le manipulateur d'électroradiologie médicale contribue, dans les conditions<br />
définies aux articles ci-dessous, à la réalisation :<br />
1° Des examens nécessaires à l'établissement d'un diagnostic qui relèvent soit des<br />
techniques d'électroradiologie médicale soit des techniques d'imagerie médicale ou<br />
d'exploration fonctionnelle impliquant l'utilisation des rayonnements ionisants ou non<br />
ou d'autres agents physiques ;<br />
2° Des traitements mettant en oeuvre des rayonnements ionisants ou non ou d'autres<br />
agents physiques.<br />
Art. 2. - Sous la responsabilité et la surveillance d'un médecin en mesure d'en contrôler<br />
l'exécution et d'intervenir immédiatement, le manipulateur d'électroradiologie médicale est<br />
habilité à accomplir les actes suivants :<br />
1° Dans le domaine de l'imagerie médicale :<br />
a) Préparation du matériel de ponction, de cathétérisme, d'injection,<br />
d'exploration et du matériel médico-chirurgical ;<br />
b) Mise sous une forme appropriée à leur administration des substances, y compris des<br />
composés radioactifs, nécessaires à l'obtention d'une image ;<br />
c) Administration orale, rectale, en injections intramusculaires,<br />
sous-cutanées et dans les veines superficielles ou dans les montages d'accès<br />
vasculaires implantables des substances, y compris des composés radioactifs,<br />
nécessaires à l'obtention d'une image ;<br />
d) Mesure et vérification de l'activité des composés radioactifs ;<br />
e) Réalisation de prélèvements de sang veineux et capillaire en vue du dosage par<br />
radio-analyse ou par d'autres techniques ;<br />
f) Réglage et déclenchement des appareils ;<br />
g) Recueil de l'image ou du signal, sauf en échographie ;<br />
h) Traitement de l'image ou du signal ;<br />
i) Aide à l'exécution par le médecin des actes d'échographie ;<br />
j) Préparation, déclenchement et surveillance des systèmes d'injection automatique ;<br />
55
k) Calcul des doses de produits radioactifs à visée diagnostique ou thérapeutique ;<br />
l) Aide opératoire ;<br />
2° Dans le domaine de la radiothérapie :<br />
a) Confection des moyens de contention et des caches ;<br />
b) Acquisition des données anatomiques des zones à traiter ;<br />
c) Réglage du simulateur et de l'appareil de traitement ;<br />
d) Mise en place des modificateurs des faisceaux ;<br />
e) Application des procédures de contrôle des champs d'irradiation et de la dosimétrie ;<br />
f) Affichage du temps de traitement ;<br />
g) Déclenchement de l'irradiation ;<br />
h) Préparation et contrôle du matériel vecteur et radioactif en curiethérapie ;<br />
i) Mise à jour de la fiche d'irradiation et de traitement ;<br />
j) Participation aux procédures relatives à la dosimétrie et à la préparation des<br />
traitements ;<br />
k) Acquisition des paramètres d'irradiation, repérage cutané, réalisation des clichés de<br />
centrage ;<br />
l) Assistance du médecin dans la pose du matériel vecteur et radioactif en<br />
curiethérapie<br />
3° Dans le domaine de l'électrologie :<br />
a) Enregistrement des signaux électrophysiologiques ;<br />
b) En électrothérapie et selon les indications de la fiche de traitement,<br />
réglage et déclenchement des appareils, surveillance de l'application du traitement ;<br />
c) Dans le domaine des explorations fonctionnelles, enregistrement des signaux et des<br />
images au cours des épreuves d'effort ou lors de l'emploi de modificateurs de<br />
comportement.<br />
Art. 3. - En outre, dans le cadre de l'exécution des actes mentionnés à l'article 2 ci-dessus, le<br />
manipulateur d'électroradiologie médicale :<br />
a) Participe à l'accueil du patient et l'informe du déroulement de l'examen ou du<br />
traitement ;<br />
b) Participe à l'identification des besoins somatiques du patient en rapport avec les<br />
techniques utilisées ;<br />
c) Met en place le patient, conformément aux exigences de la technique utilisée, en<br />
tenant compte de son état clinique ;<br />
d) Participe à la surveillance clinique du patient au cours des investigations et<br />
traitements et à la continuité des soins ;<br />
e) Participe à l'exécution des soins nécessités par l'acte réalisé ;<br />
f) Accomplit, en cas d'urgence, les actes conservatoires nécessaires jusqu'à<br />
l'intervention du médecin ;<br />
g) Participe à la transmission écrite de toutes les informations relatives au déroulement<br />
des examens et traitements ;<br />
h) Participe à l'application des règles relatives à la gestion des stocks et des déchets, y<br />
compris radioactifs ;<br />
i) S'assure du bon fonctionnement du matériel qui lui est confié et en assure l'entretien<br />
courant ;<br />
56
j) Participe à l'application des règles d'hygiène et de radioprotection,<br />
tant en ce qui concerne le patient que son environnement ;<br />
k) Participe à l'élaboration des programmes d'assurance de la qualité et à l'application<br />
des protocoles de contrôle de qualité.<br />
Art. 4. - La prescription médicale mentionnée au second alinéa de l'article L. 504-13 du code<br />
de la santé publique peut faire référence à des protocoles préalablement établis, datés et signés<br />
par le médecin sous la responsabilité du<strong>quel</strong> exerce le manipulateur d'électroradiologie<br />
médicale.<br />
Art. 5. - Le manipulateur d'électroradiologie médicale adapte sa pratique professionnelle à<br />
l'évolution des sciences et des techniques.<br />
Dans l'exercice de son activité, il tient compte des caractéristiques psychologiques et sociales<br />
de la personnalité de chaque patient, à tous les âges de la vie.<br />
Art. 6. - Selon les secteurs d'activité où il exerce et les besoins rencontrés, le manipulateur<br />
d'électroradiologie médicale propose et organise différentes actions, notamment d'éducation,<br />
de recherche, de prévention, de dépistage, de formation et d'encadrement, ou y participe. Ces<br />
actions concernent en particulier :<br />
a) La formation initiale et continue des manipulateurs d'électroradiologie médicale et<br />
d'autres professionnels ;<br />
b) La collaboration, en particulier avec les membres des autres professions sanitaires<br />
et sociales, à la réalisation d'interventions coordonnées, y compris en matière de<br />
prévention ;<br />
c) La recherche dans son domaine professionnel, notamment en ce qui concerne<br />
l'hygiène, la sécurité, la radioprotection et l'assurance de la qualité.<br />
Il participe également à des actions de secours, de médecine de catastrophe et d'aide<br />
humanitaire.<br />
Art. 7. - Le décret du 17 juillet 1984 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :<br />
1° Les articles 1er, 2 et 3 sont abrogés ;<br />
2° A l'article 2-1, les mots : > sont remplacés par les<br />
mots : >, les mots : ><br />
sont remplacés par les mots : >, et les mots : > sont remplacés par les<br />
mots : > ;<br />
3° Aux articles 2-2 et 2-3, les mots : >.<br />
57
Art. 8. - Le ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé sont<br />
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au<br />
Journal officiel de la République française.<br />
Fait à Paris, le 19 novembre 1997.<br />
Lionel Jospin<br />
Par le Premier ministre :<br />
Le ministre de l'emploi et de la solidarité,<br />
Martine Aubry<br />
Le secrétaire d'Etat à la santé,<br />
Bernard Kouchner<br />
58
ANNEXE E<br />
59
CHARTE DU PATIENT HOSPITALISÉ<br />
Annexe à la circulaire Ministérielle n° 95-22 du 6 mai 1995 relative aux droits des patients hospitalisés.<br />
PRINCIPES GÉNÉRAUX<br />
1. Le service public hospitalier est accessible tous et en particulier aux personnes<br />
les plus d€munies. Il est adapt€ aux personnes handicap€es.<br />
2. Les €tablissements de sant€ garantissent la qualit€ des traitements, des soins et<br />
de l'accueil. Ils sont attentifs au soulagement de la douleur.<br />
3. L'information donn€e au patient doit tre accessible et loyale. Le patient participe<br />
aux choix th€rapeutiques qui le concernent.<br />
4. Un acte m€dical ne peut tre pratiqu€ qu'avec le consentement libre et €clair€ du<br />
patient.<br />
5. Un consentement sp€cifique est pr€vu notamment pour les patients participant<br />
une recherche biom€dicale, pour le don et l'utilisation des €l€ments et produits du<br />
corps humain et pour les actes de d€pistage.<br />
6. Le patient hospitalis€ peut, tout moment, quitter l'€tablissement sauf exceptions<br />
pr€vues par la loi, apr‚s avoir €t€ inform€ des risques €ventuels qu'il encourt.<br />
7. La personne hospitalis€e est trait€e avec €gards. Ses croyances sont respect€es.<br />
Son intimit€ doit tre pr€serv€e ainsi que sa tranquillit€.<br />
8. Le respect de la vie priv€e est garanti tout patient hospitalis€ ainsi que la<br />
confidentialit€ des informations personnelles, m€dicales et sociales qui le<br />
concernent.<br />
9. Le patient a acc‚s aux informations contenues dans son dossier notamment<br />
d'ordre m€dical par l'interm€diaire d'un praticien qu'il choisit librement.<br />
10. Le patient hospitalis€ exprime ses observations sur les soins et l'accueil et<br />
dispose du droit de demander r€paration des pr€judices qu'il estimerait avoir subis.<br />
60
I - De l'acc s au service hospitalier<br />
Les établissements de santé qui assurent le service public hospitalier accueillent toutes<br />
personnes, <strong>quel</strong>s que soient leur origine, leur sexe, leur situation de famille, leur âge, leur état<br />
de santé, leur handicap, leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses.<br />
Ils les accueillent de jour comme de nuit, éventuellement en urgence. A défaut, ils doivent<br />
tout mettre en uvre pour assurer leur admission dans un autre établissement.<br />
Les établissements doivent réaliser les aménagements nécessaires à l'accueil des personnes<br />
souffrant d'un handicap physique, mental ou sensoriel. Ils prennent les mesures de nature à<br />
tenir compte des difficultés de compréhension et de communication des patients et de leurs<br />
mandataires.<br />
A l'égard des difficultés de nature linguistique, le recours à des interprètes ou à des<br />
associations spécialisées dans les actions d'accompagnement des populations immigrées sera<br />
recherché.<br />
L'accès au service public hospitalier est garanti à tous, et, en particulier, aux personnes les<br />
plus démunies, quand bien même elles ne pourraient justifier d'une prise en charge par<br />
l'assurance maladie ou l'aide médicale. En situation d'urgence, lorsque leur état le justifie,<br />
elles doivent être admises à l'hôpital. Lorsque l'hospitalisation n'est pas justifiée, il importe<br />
que celles-ci puissent être examinées et que des soins leur soient prescrits. L'hôpital est un<br />
lieu d'accueil privilégié où les personnes les plus démunies doivent pouvoir faire valoir leurs<br />
droits, y compris sociaux. Dans ce but, le soin et l'accueil doivent s'accompagner d'une aide<br />
dans les démarches administratives et sociales, tels qu'ils sont définis par circulaires .<br />
(circulaire DH/DAS n°93-33 du 17 septembre 1993 et circulaire n°95-08 du 21 mars 1995<br />
relatives à l'accès aux soins des personnes les plus démunies.)<br />
L'assistance sociale ou, à défaut, la surveillante du service, est à la disposition des patients, ou<br />
à celle de leur famille, pour les aider à résoudre leurs difficultés personnelles, familiales,<br />
administratives ou matérielles liées à leur hospitalisation.<br />
Dans l'esprit de la Charte des associations de bénévoles à l'hôpital du 29 mai 1991, le<br />
directeur peut conclure des conventions avec des associations de patients, précisant les<br />
conditions d'intervention de celles-ci dans l'établissement. Leur mission est d'apporter une<br />
aide et un soutien à toute personne qui le souhaite, ou de répondre à des demandes<br />
spécifiques. La liste des associations concernées figure de préférence dans le livret d'accueil.<br />
A défaut, tout patient peut la demander.<br />
II - Des soins<br />
Les établissements de santé assurent les examens de diagnostic, la surveillance et le traitement<br />
des malades, des blessés et femmes enceintes en tenant compte des aspects psychologiques<br />
des patients. Ils leur dispensent les soins préventifs, curatifs ou palliatifs que requiert leur état,<br />
et veillent à la continuité des soins à l'issue de leur admission ou de leur hébergement.<br />
Au cours de ces traitements et ces soins, la prise en compte de la dimension douloureuse,<br />
physique et psychologique des patients, et le soulagement de la souffrance, doivent être une<br />
préoccupation constante de tous les intervenants. Tout établissement doit se doter des moyens<br />
propres à prendre en charge la douleur des patients qu'ils accueillent, et intégrer ces moyens<br />
dans son projet d'établissement, en application de l'article L. 710-3-1 du code de la santé<br />
publique. L'évolution des connaissances scientifiques et techniques permet d'apporter, dans la<br />
quasi-totalité des cas, une réponse aux douleurs, qu'elles soient chroniques ou non, qu'elles<br />
61
soient ressenties par des enfants, des adultes ou des personnes en fin de vie.<br />
Lorsque des personnes sont parvenues au terme de leur existence, elles reçoivent des soins<br />
d'accompagnement qui répondent à leurs besoins spécifiques. Elles sont accompagnées, si<br />
elles le souhaitent, par leurs proches et les personnes de leur choix et, naturellement, par le<br />
personnel. La circulaire DGS du 26 août 1986 constitue en ce domaine une référence en<br />
matière d'organisation des soins et d'accompagnement.<br />
III- De l'information du patient et de ses proches<br />
Les établissements doivent veiller à ce que l'information médicale et sociale des patients soit<br />
assurée et que les moyens mis en uvre soient adaptés aux éventuelles difficultés de<br />
communication ou de compréhension des patients, afin de garantir à tous l'égalité d'accès à<br />
l'information.<br />
Le secret médical n'est pas opposable au patient.<br />
Le médecin doit donner une information simple, accessible, intelligible et loyale à tous les<br />
patients. Il répond avec tact et de façon adaptée aux questions de ceux-ci.<br />
Afin que le patient puisse participer pleinement, notamment aux choix thérapeutiques qui le<br />
concernent et à leur mise en uvre quotidienne, les médecins et le personnel paramédical<br />
participent à l'information du malade, chacun dans son domaine de compétences.<br />
Comme le suggère l'article 4 de la Charte de l'enfant hospitalisé , les mineurs sont informés<br />
des actes et examens nécessaires à leur état de santé, en fonction de leur âge et de leurs<br />
facultés de compréhension, dans la mesure du possible et indépendamment de l'indispensable<br />
information de leurs représentants légaux.<br />
Les majeurs protégés bénéficient d'une information appropriée. La famille et les proches<br />
doivent pouvoir disposer d'un temps suffisant pour avoir un dialogue avec les médecins<br />
responsables.<br />
Pour des raisons légitimes et qui doivent demeurer exceptionnelles, un malade peut être laissé<br />
dans l'ignorance d'un pronostic ou d'un diagnostic graves. Un pronostic fatal doit être révélé<br />
avec circonspection, mais, à moins que le patient n'ait préalablement interdit, notamment au<br />
cours d'entretiens avec le médecin, cette révélation, ou désigné les tiers aux<strong>quel</strong>s elle doit être<br />
faite, les proches doivent généralement en être prévenus. De même, la volonté du patient de<br />
ne pas être informé sur son état de santé doit être respectée.<br />
IV - Du principe g€n€ral du consentement pr€alable<br />
L'intangibilité de l'intégrité corporelle de chaque personne et l'indisponibilité du corps humain<br />
sont des principes fondamentaux aux<strong>quel</strong>s il ne peut être dérogé que par nécessité<br />
thérapeutique pour la personne et avec son consentement préalable. C'est pourquoi, aucun acte<br />
médical ne peut être pratiqué sans le consentement du patient, hors le cas où son état rend<br />
nécessaire cet acte au<strong>quel</strong> il n'est pas à même de consentir.<br />
Ce consentement doit être libre et renouvelé pour tout acte médical ultérieur. Il doit être<br />
éclairé, c'est-à-dire que le patient doit avoir été préalablement informé des actes qu'il va subir,<br />
des risques normalement prévisibles en l'état des connaissances scientifiques et des<br />
conséquences que ceux-ci pourraient entraîner.<br />
Tout patient, informé par un praticien des risques encourus, peut refuser un acte de diagnostic<br />
ou un traitement, l'interrompre à tout moment à ses risques et périls. Il peut également estimer<br />
ne pas être suffisamment informé, souhaiter un délai de réflexion ou l'obtention d'un autre<br />
62
avis professionnel. Le mineur ne pouvant prendre de décisions graves le concernant, il revient<br />
aux détenteurs de l'autorité parentale d'exprimer leur consentement. Toutefois, lorsque la<br />
santé ou l'intégrité corporelle d'un mineur risque d'être compromise par le refus du<br />
représentant légal ou l'impossibilité de recueillir le consentement de celui-ci, le médecin<br />
responsable peut saisir le Procureur de la République, afin de provoquer les mesures<br />
d'assistance éducative permettant de donner les soins qui s'imposent. La Charte de l'enfant<br />
hospitalisé suggère que si l'avis du mineur peut être recueilli, le médecin doit en tenir compte<br />
dans toute la mesure du possible.<br />
Le médecin doit tenir compte de l'avis de l'incapable majeur. Toutefois, l'attention est appelée<br />
sur le fait que dans certains cas, précisés par le juge, il convient également de recueillir le<br />
consentement des représentant légaux. Le médecin responsable a la capacité de saisir le<br />
Procureur de la République si la santé ou l'intégralité corporelle du majeur protégé risque<br />
d'être compromise par le refus du représentant légal ou l'impossibilité de recueillir le<br />
consentement de celui-ci.<br />
V - Du consentement sp€cifique pour certains actes<br />
En plus du principe général du consentement préalable, des dispositions particulières<br />
s'appliquent notamment pour les actes ci-après.<br />
Préalablement à la réalisation d'une recherche biomédicale sur une personne, le consentement<br />
libre, éclairé et exprès doit être recueilli dans le strict respect des articles L. 209-1 et suivants<br />
du code de la santé publique. Des dispositions particulières sont applicables respectivement<br />
aux femmes enceintes ou qui allaitent, aux personnes privées de liberté par une décision<br />
judiciaire ou administrative, aux mineurs, majeurs sous tutelle, personnes séjournant dans un<br />
établissement sanitaire ou social et malades en situation d'urgence.<br />
Le traitement de données nominatives ayant pour fin la recherche a lieu dans les conditions<br />
prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée. Le consentement, dans le domaine du<br />
don et de l'utilisation des éléments et des produits du corps humain, de l'assistance médicale à<br />
la procréation et du diagnostic prénatal, est recueilli dans les conditions prévues par les<br />
articles L. 145-15 et suivants du code de la santé publique. Le prélèvement d'éléments du<br />
corps humain et la collecte de ses produits ne peuvent être pratiqués sans le consentement du<br />
donneur. Le consentement est révocable à tout moment.<br />
Le consentement de la personne vivante, sur la<strong>quel</strong>le peut être effectué un prélèvement<br />
d'organe en vue de don, est formalisé devant le tribunal de grande instance ou recueilli, en cas<br />
d'urgence, par le procureur de la République, dans les conditions définies par la loi. Ce<br />
consentement est révocable à tout moment et sans condition de forme.<br />
Aucun prélèvement d'organe, de tissus, de cellules, aucune collecte de produits du corps<br />
humain en vue de dons ne peut avoir lieu sur une personne vivante mineure ou sur une<br />
personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale. Toutefois, un<br />
prélèvement de moelle osseuse peut être effectué sur une personne mineure au bénéfice de<br />
son frère ou de sa sur avec les garanties et dans les conditions définies par la loi. Le<br />
prélèvement d'organe, à des fins thérapeutiques, sur une personne décédée, ne peut être réalisé<br />
que si la personne n'a pas fait connaître de son vivant son refus d'un tel prélèvement, dans les<br />
conditions définies par la loi. Si le médecin n'a pas connaissance de la volonté du défunt, il<br />
doit s'efforcer de recueillir les témoignages de la famille.<br />
Si la personne décédée était un mineur ou un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection<br />
légale, le prélèvement en vue d'un don ne peut avoir lieu qu'à la condition que chacun des<br />
63
titulaires de l'autorité parentale ou le représentant légal y consente expressément par écrit.<br />
Aucun prélèvement à des fins scientifiques autres que celles ayant pour but de rechercher les<br />
causes du décès ne peut être effectué sans le consentement du défunt, exprimé directement ou<br />
par le témoignage de sa famille. Toutefois, lorsque le défunt est un mineur, ce consentement<br />
est exprimé par un des titulaires de l'autorité parentale.<br />
La famille et les proches doivent être informés des prélèvements en vue de rechercher les<br />
causes du décès.<br />
Le consentement préalable des personnes sur les<strong>quel</strong>les sont effectuées des études de leurs<br />
caractéristiques génétiques est recueilli par écrit dans les conditions fixées par les articles 16<br />
et suivants du code civil.<br />
Le dépistage notamment du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) n'est obligatoire que<br />
dans certains cas (dons de sang, de tissus, de cellules et notamment de sperme et de lait). Dans<br />
les autres cas, tout dépistage pour le<strong>quel</strong> un consentement préalable n'a pas été obtenu est<br />
interdit. Aucun dépistage ne peut être fait à l'insu du patient. Un tel dépistage est passible d'un<br />
recours pour atteinte à la vie privée. Un dépistage volontaire peut être proposé au patient, dans<br />
le respect des règles appelées par la circulaire DGS/DH du 28 octobre 1987, dont celle du<br />
libre consentement, après information personnalisée.<br />
VI - De la libert€ individuelle<br />
Un patient hospitalisé peut, à tout moment, quitter l'établissement après avoir été informé des<br />
risques possibles pour son état, et après avoir signé une décharge. A défaut de cette décharge,<br />
un document interne est rédigé.<br />
Le patient ne peut être retenu dans l'établissement en dehors du cas des personnes ayant<br />
nécessité, en raison de troubles mentaux, une hospitalisation à la demande d'un tiers, ou<br />
d'office , et sous réserve des dispositions applicables aux mineurs, et sous certaines conditions<br />
aux majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection légale.<br />
Toute personne hospitalisée avec son consentement pour des troubles mentaux dispose des<br />
mêmes droits liés à l'exercice des libertés individuelles que ceux reconnus aux autres patients.<br />
Les articles L. 326 et suivants du code de la santé publique prévoient des restrictions à<br />
l'exercice des libertés individuelles des personnes hospitalisées sans consentement pour<br />
troubles mentaux, limitées à celles nécessitées par leur état de santé et la mise en oeuvre de<br />
leur traitement. Ces personnes doivent être informées dès leur admission et, par la suite à leur<br />
demande, de leur situation juridique et de leurs droits.<br />
Les personnes gardées à vue et les détenus hospitalisés disposent des mêmes droits que les<br />
autres patients hospitalisés, dans les limites prévues par la législation concernant, en<br />
particulier, les communications avec l'extérieur et la possibilité de se déplacer à l'intérieur de<br />
l'établissement. Lorsqu'un détenu ou une personne gardée à vue demande à quitter<br />
l'établissement de soins, les mesures sont prises pour qu'il soit remis à la disposition des<br />
autorités qui en ont la charge<br />
.<br />
VII - Du respect de la personne et de son intimit€<br />
Le respect de l'intimité du patient doit être préservée lors des soins, des toilettes, des<br />
consultations et des visites médicales, des traitements pré et post-opératoires, des<br />
radiographies, des brancardages et à tout moment de son séjour hospitalier. La personne<br />
hospitalisée est traitée avec égards et ne doit pas souffrir de propos et d'attitudes équivoques<br />
de la part du personnel.<br />
64
Les patients hospitalisés dans un établissement assurant également des missions<br />
d'enseignement donnent leur consentement préalable, s'ils sont amenés à faire l'objet de ces<br />
missions, notamment lors de la présentation de cas aux étudiants en médecine. Il ne peut être<br />
passé outre à un refus du patient. Les mêmes prescriptions doivent être respectées en ce qui<br />
concerne les actions de formation initiale et continue des personnels médicaux et<br />
paramédicaux ayant lieu auprès des patients.<br />
L'établissement de santé doit respecter les croyances et convictions des personnes accueillies.<br />
Un patient doit pouvoir, dans la mesure du possible, suivre les préceptes de sa religion<br />
(recueillement, présence d'un ministre du culte de sa religion, nourriture, liberté d'action et<br />
d'expression...). Ces droits s'exercent dans le respect de la liberté des autres. Tout<br />
prosélytisme est interdit, qu'il soit le fait d'une personne accueillie dans l'établissement, d'une<br />
personne bénévole, d'un visiteur ou d'un membre du personnel.<br />
Les établissements prennent les mesures qui assurent la tranquillité des patients et réduisent<br />
au mieux les nuisances liées notamment au bruit et à la lumière, en particulier aux heures de<br />
repos et de sommeil des patients. Ils organisent le fonctionnement des consultations externes<br />
et l'accomplissement des formalités administrative liées à l'hospitalisation, de manière à ce<br />
que les déplacements et les délais d'attente soient réduits le plus possible.<br />
VIII - Du droit la vie priv€e et la confidentialit€<br />
Tout patient hospitalisé a le droit au respect de sa vie privée comme le prévoient l'article 9 du<br />
code civil et la Convention européenne des Droits de l'Homme.<br />
Le personnel hospitalier est tenu au secret professionnel défini par les articles 226-13 et 226-<br />
14 du code pénal et à la discrétion professionnelle définie par l'article 26 de la loi n° 83-634<br />
du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires.<br />
Une personne hospitalisée peut demander que sa présence ne soit pas divulguée.<br />
L'établissement public de santé garantit la confidentialité des informations qu'il détient sur les<br />
personnes hospitalisées (informations médicales, d'état civil, administratives, financières).<br />
Aucune personne non habilitée par le malade lui-même ne peut y avoir accès, sauf procédures<br />
judiciaires exécutées dans les formes prescrites. Toutefois, ces procédures judiciaires ne sont<br />
pas de nature à entraîner la levée des anonymats garantis par la loi . La personne hospitalisée<br />
peut recevoir dans sa chambre les visites de son choix en respectant l'intimité et le repos des<br />
autres patients. Elle a le droit à la confidentialité de son courrier, de ses communications<br />
téléphoniques, de ses entretiens avec des visiteurs et avec les professionnels de santé.<br />
L'accès des journalistes, photographes, démarcheurs publicitaires et représentants de<br />
commerce auprès des patients ne peut avoir lieu qu'avec l'accord exprès de ceux-ci et sous<br />
réserve de l'autorisation écrite donnée par le directeur de l'établissement. Cet accès doit être<br />
utilisé avec mesure afin d'éviter tout abus de l'éventuelle vulnérabilité des patients. La<br />
personne hospitalisée peut, dans la limite du respect des autres patients et de l'espace de sa<br />
chambre, apporter des effets personnels. Le régime de responsabilité, en cas de perte, vol ou<br />
détérioration de ces objets, ainsi que des objets autorisés à être déposés, est défini par la loi n°<br />
92-614 du 6 juillet 1992 et ses textes d'application<br />
IX - De l'acc s aux informations contenues dans les dossiers administratifs et<br />
m€dicaux<br />
Des dispositions sont prises dans chaque établissement pour que soient appliqués les principes<br />
et les modalités des articles L. 710-2 et R. 710-2-1 et suivants du code de la santé publique<br />
relatifs à la communication des informations médicales contenues dans le dossier médical par<br />
65
l'intermédiaire d'un praticien, aux personnes qui en font la demande. Ce praticien<br />
communique, dans le cadre d'un dialogue, les informations médicales au patient ou à son<br />
représentant légal dans le respect des règles de déontologie, et aux ayants-droit dans le respect<br />
des règles du secret médical. Le médecin qui a orienté un patient vers un établissement de<br />
santé a accès au dossier médical de ce patient, avec l'accord de celui-ci. Il est tenu informé de<br />
l'état de santé de son patient par un praticien hospitalier, dans les meilleurs délais.<br />
Dans les établissements de santé, les conditions de communications entre médecins,<br />
établissements de santé et patients, du carnet de santé s'appliquent selon les articles L. 162-1-1<br />
et suivants et R. 162-1-1 et suivants du code de la sécurité sociale.<br />
Toute personne accueillie a accès, sur sa demande, aux informations la concernant et<br />
contenues dans les fichiers informatiques de l'établissement, en application de la loi n° 78-17<br />
du 6 janvier 1978 (Commission nationale de l'informatique et des libertés 21, rue Saint<br />
Guillaume 75007 PARIS 01.45.44.40.65).<br />
L'usager a un droit d'accès aux documents administratifs, dans les conditions prévues par la<br />
loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Il en fait la demande auprès du directeur de l'hôpital. En cas<br />
de refus exprès ou tacite de celui-ci, il peut solliciter l'avis de la CADA (Commission d'accès<br />
aux documents administratifs : 64 rue de Varenne - 75700 Paris...)<br />
X - Des voies de recours<br />
Indépendamment de la possibilité de répondre au questionnaire de sortie remis avec le livret<br />
d'accueil à chaque patient, une personne hospitalisée peut faire part directement au directeur<br />
de l'établissement de santé de ses observations. Chaque établissement est invité à organiser un<br />
suivi de la qualité des soins et de l'accueil à partir notamment de l'examen et du traitement des<br />
questionnaires, des réclamations exprimées auprès du directeur ou de son représentant et des<br />
plaintes ultérieures.<br />
Si la personne hospitalisée ou ses ayants-droit estiment avoir subi un préjudice, lors du séjour<br />
dans l'établissement de celle-ci, ils peuvent saisir le directeur de l'hôpital d'une réclamation<br />
préalable en vue d'obtenir réparation.<br />
Si celle-ci n'aboutit pas comme il le souhaite, soit que la demande soit rejetée, soit que<br />
l'hôpital garde le silence pendant plus de quatre mois, l'auteur de la réclamation dispose de<br />
droits de recours contentieux. Le directeur s'efforce de mettre en place une fonction de<br />
médiation entre l'établissement et les patients, afin d'instruire dans les meilleurs délais les<br />
demandes de réparation pour préjudice et de donner à leurs auteurs les explications<br />
nécessaires.<br />
66
ANNEXE F<br />
67
GRILLE D'ENTRETIEN<br />
1. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce métier ?<br />
2. Qu'est-ce qui vous plait dans la profession de manipulateur ?<br />
3. Qu'est-ce qui vous paraît le plus difficile dans la profession ?<br />
4. Dans <strong>quel</strong> domaine vous-sentez vous le plus à l'aise ? Pourquoi ?<br />
5. Quels sont pour vous les actes les plus engageants ? (Connaissezvous<br />
le Décret de Compétence ?)<br />
68
6. Quelle(s) satisfaction(s) vous procure votre travail ?<br />
Problématique: Qu'est ce qui détermine le niveau d'implication du<br />
Manipulateur en Electroradiologie Médicale dans les domaines techniques et /<br />
ou relationnel<br />
Résumé: la profession du Manipulateur en Electroradiologie Médicale s'est<br />
développé jusqu'à peu principalement autour des appareils qu'il utilise.<br />
Aujourd'hui on l'invite à s'interroger sur ses rôles techniques et soignants et donc<br />
sa place auprès du patient.<br />
Ainsi à travers une relation évènementielle le Manipulateur doit être capable de<br />
réaliser un acte de qualité optimal en s'impliquant aussi bien dans son rôle<br />
technique que relationnel.<br />
Mots clés: Implication, Technique, Soin, Qualité, Confiance en Soi<br />
69