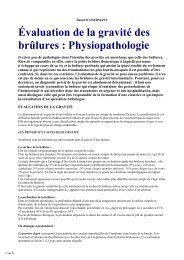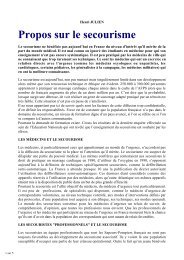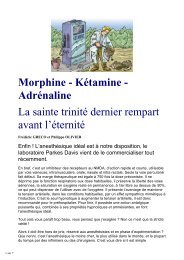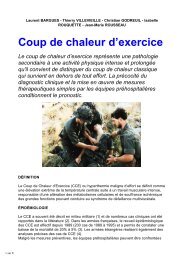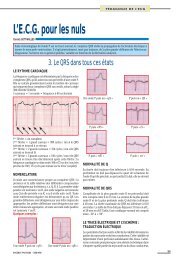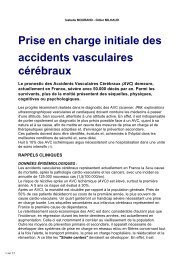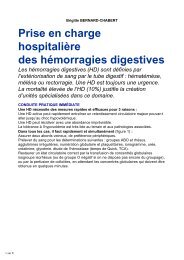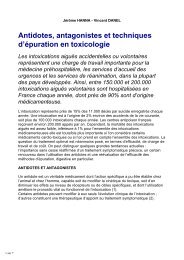Les dérivés nitrés - Urgence Pratique
Les dérivés nitrés - Urgence Pratique
Les dérivés nitrés - Urgence Pratique
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
1 sur 17<br />
Docteur Jean-Claude DESLANDES<br />
<strong>Urgence</strong> <strong>Pratique</strong><br />
LES DÉRIVÉS NITRÉS<br />
Principes d’action et indications en urgence<br />
La nitroglycérine (NTG) est synthétisée en 1846 par Sobrero. Ses propriétés<br />
anti-angoreuses sont décrites en 1879 par Murrel, qui en démontre l’efficacité, par voie<br />
sub-linguale, dans le traitement curatif et préventif de l’angor. Malgré son intérêt prouvé,<br />
l’utilisation de la NTG a longtemps été restreint par sa courte durée d’action par la seule<br />
voie alors utilisable. C’est la mise au point d’autres formes, pommades et formes orales à<br />
libération prolongée, qui a permis d’élargir les indications à l’insuffisance cardiaque<br />
congestive ou survenant au décours d’un infarctus du myocarde (IDM), mais aussi à la<br />
préservation du myocarde ischémié. L’administration I.V. est possible depuis 1969.<br />
Concentration plasmatique de trinitrine après administration sublinguale de 0,6 mg chez 10 volontaires<br />
sains. (d’après Armstrong L.W., Armstrong J.A., Marks G.S. Circulation 1979, 59 ; 585-88)<br />
PHYSIOLOGIE DE LA VASO-MOTRICITÉ
2 sur 17<br />
1 - RÉGULATION DE LA VASO-MOTRICITÉ<br />
La régulation de la vaso-motricité obéit à des lois et des mécanismes différents selon le<br />
type de vaisseau concerné : artériole, artère ou veine.<br />
a) Vasomotricité artériolaire<br />
<strong>Les</strong> artérioles constituent la majeure part des " résistances périphériques " opposées à<br />
l’éjection ventriculaire gauche (EVG). Ces résistances sont proportionnelles à la pression<br />
artérielle (PA), et inversement proportionnelles au débit cardiaque (DC). Elles sont<br />
diminuées par l’administration d’un vasodilatateur et obéissent à la loi de Poiseuille<br />
régissant l’écoulement des flux laminaires. Cette loi ne peut cependant être retenue pour<br />
évaluer les résistances de l’individu " global ", compte tenu de l’extrême hétérogénéité<br />
de réponse des différentes régions de l’organisme. <strong>Les</strong> circulations cérébrales,<br />
cutanées, rénales, musculaires, par exemple, sont modulées par des systèmes<br />
régulateurs différents, qui peuvent être nerveux, métaboliques ou endothéliaux. Présents<br />
à tous les niveaux, ils jouent selon les territoires un rôle quantitatif variable.<br />
Par ailleurs, lors d’une vasodilatation, la PA et le DC ne varient pas indépendamment<br />
l’un de l’autre. Des mécanismes d’adaptation, notamment baro-réflexes, se mettent en<br />
jeu. Nous pouvons, en fait, considérer que les résistances périphériques sont la<br />
résultante à la fois d’un phénomène vasomoteur et de mécanismes compensateurs<br />
variables d’un territoire à l’autre.<br />
b) Vaisseaux artériels de gros calibre<br />
<strong>Les</strong> vaisseaux artériels de gros calibre sont des vaisseaux de distribution, ou de<br />
conductance. Leur structure histologique conjonctive est dense en fibres élastiques, et ils<br />
ne représentent qu’une faible part des résistances à l’écoulement du sang. Cependant<br />
l’échographie vasculaire, mesurant de façon précise et reproductible le diamètre de ces<br />
vaisseaux, a pu permettre de souligner leur rôle dans la régulation de la vasomotricité. Il<br />
a été longtemps communément admis qu’ils subissaient une dilatation " passive " sous<br />
l’effet d’une augmentation de la PA. En fait certains vasodilatateurs comme la trinitrine et<br />
les inhibiteurs de l’enzyme de conversion augmentent le diamètre des artères alors que<br />
la PA diminue, tandis que d’autres comme la di-hydralazine diminuent concomitamment<br />
diamètre des vaisseaux et PA. Il est admis maintenant que ces vaisseaux peuvent être<br />
composés de 40% de fibres musculaires lisses, et ont, sous l’effet d’une régulation<br />
endothéliale propre, un certain rôle à jouer dans la variation des flux et pressions.<br />
c) Le secteur veineux ou capacitif<br />
<strong>Les</strong> mécanismes de régulation du secteur veineux sont variables en fonction du territoire,<br />
mais aussi du statut hémodynamique et de l’existence d’une pathologie sous jacente.<br />
L’action d’un vasodilatateur se traduit, non pas par une simple augmentation de<br />
diamètre, mais aussi par une modification de forme de la veine. Elliptique pour les<br />
basses pressions, elle devient de plus en plus circulaire sous l’effet de leur<br />
augmentation. Parallèlement à ce mécanisme passif, existe une activité musculaire lisse<br />
d’autant plus importante qu’une pression élevée est durablement appliquée. C’est le<br />
phénomène retrouvé dans les cas d’insuffisance cardiaque chronique.
3 sur 17<br />
Courbe pression-volume d’une veine isolée (d’après Escourrou-Arch. Mal. Cœur, 1991 : 84, (1), 53).<br />
d) Mise en jeu des mécanismes compensateurs<br />
L’administration d’une molécule vasodilatatrice, ou la mise en jeu d’un réflexe<br />
vaso-dilatateur, active des mécanismes de régulation, ou de contre régulation,<br />
responsables de divers effets : tachycardie, augmentation du DC, vasoconstriction<br />
artériolaire ou veineuse (voire des gros troncs artériels). L’effet physiologique, ou<br />
pharmacologique, obtenu est la résultante de l’ensemble des réactions.
4 sur 17<br />
<strong>Les</strong> mécanismes de "contre-régulation" à un stimulus vaso-dilatateur.<br />
Dans un premier temps, la régulation est végétative, et met en jeu un baro-réflexe. Si la<br />
stimulation se prolonge, la régulation devient neuro-hormonale par le biais de l’action du<br />
système rénine angiotensine. Cette " contre régulation " explique le phénomène de<br />
rebond observé à l’arrêt d’un traitement anti-hypertenseur, et aussi les différences<br />
pharmacologiques entre les divers vasodilatateurs.<br />
2 - PHYSIOLOGIE DE LA CELLULE MUSCULAIRE LISSE VASCULAIRE, ET DE SES<br />
RÉCEPTEURS.<br />
La cellule musculaire lisse vasculaire est la cible ultime des stimuli vaso-moteurs, qu’ils<br />
soient d’origine nerveuse, hormonale ou métabolique. <strong>Les</strong> informations sont transmises<br />
in situ par l’intermédiaire de récepteurs membranaires. L’activation de ces récepteurs<br />
modifie la quantité d’ions Calcium disponible au niveau des sites actifs des protéines<br />
actine et myosine.
5 sur 17<br />
Expression d’un stimulus vaso-dilatateur au niveau de la fibre lisse vasculaire.<br />
Il existe deux catégories de récepteurs :<br />
des récepteurs modifiant directement les mouvements de Calcium.<br />
des récepteurs entraînant la production d’un deuxième messager, le GMP-cyclique<br />
(Guanosine-monophosphate cyclique)<br />
3 - RÉGULATION ENDOTHÉLIALE DE LA VASO-MOTRICITÉ<br />
Jusqu’au début des années 80, l’endothélium vasculaire était considéré comme une<br />
simple barrière, jouant cependant un rôle dans la prévention de la thrombose par ses<br />
capacités de synthèse de prostaglandines anti-agrégantes (prostacycline – PGI2).<br />
Furgott mettra en évidence le rôle physiologique actif de l’endothélium. L’exposition in<br />
vitro d’un fragment artériel isolé à de l’acétylcholine entraîne soit une vasodilatation, soit<br />
une vasoconstriction selon que l’endothélium a été préservé ou enlevé. Furgott en a<br />
déduit que si l’acétylcholine, vasoconstrictrice, pouvait induire un effet inverse, c’est<br />
qu’elle générait la production d’un vasodilatateur plus puissant que son effet propre. Ce<br />
vasodilatateur ne pouvait être issu que de l’endothélium. Ce n’est que plus tard, baptisé<br />
EDRF (Endothelium Derived Relaxing Factor), qu’il a été chimiquement identifié. En fait<br />
l’endothélium est capable, en réponse à des stimuli, de produire des substances<br />
vasodilatatrices, mais aussi vasoconstrictrices, jouant là un rôle de régulation complexe.<br />
Il est possible, cela est bien connu maintenant, de distinguer des facteurs<br />
vasodilatateurs par médiation endothéliale, et des facteurs vasodilatateurs d’origine<br />
endothéliale.
6 sur 17<br />
<strong>Les</strong> stimulants de la vasodilatation endothéliale.<br />
Physiologie de l’EDRF 1.
7 sur 17<br />
a) Le premier facteur décrit a été l’EDRF 1 ou Monoxyde d’Azote (NO). Son précurseur<br />
métabolique est la L-arginine. Si le radical NO est l’élément actif, un doute subsiste sur<br />
la production directe libre par la cellule endothéliale. Elle ne pourrait se faire qu’après<br />
synthèse de nitroso-cystèine. Le radical NO, doté d’un électron célibataire, est<br />
extrêmement réactif, ce qui explique sa haute activité biologique est sa brève demi-vie.<br />
Le mécanisme d’action de l’EDRF1 passe par l’activation de la guanylate-cyclase et la<br />
production de GMP-cyclique, second messager de la relaxation musculaire et donc de la<br />
vasodilatation.<br />
L’EDRF1, par activation de la guanylate plaquettaire a aussi un effet anti adhésif et<br />
anti-agrégant plaquettaire.<br />
Notons que le L.N – monométhyl arginine ( L-NMMA) est le plus puissant inhibiteur<br />
connu de la synthèse de l’EDRF1 à partir de la L-arginine.<br />
b) L’EDRF2 est un facteur hyperpolarisant. Son existence a été suspectée par la<br />
constatation de phénomènes de vasodilatation non affectés par le L-NMMA. Sa nature<br />
chimique n’est pas encore exactement connue. Son effet vasodilatateur est<br />
sélectivement bloqué par les digitaliques (et principalement l’ouabaïne), alors que ceux<br />
ci n’altèrent pas la vasodilatation endothéliale liée à l’EDRF1.<br />
Physiologie de l’EDRF 2.
8 sur 17<br />
<strong>Les</strong> facteurs de relaxation endothéliaux.<br />
L’action de ces facteurs vasodilatateurs est altérée dans certaines pathologies :<br />
athérome, hypertension artérielle, ou insuffisance cardiaque. <strong>Les</strong> dérivé <strong>nitrés</strong> trouvent là<br />
une justification thérapeutique " substitutive ".<br />
Vasoconstriction à médiation endothéliale.<br />
L’endothélium, en réponse à des stimuli, comme l’hypoxie ou certains métabolites de<br />
l’acide arachidonique, est capable d’induire une vasoconstriction.<br />
Trois facteurs vasoconstricteurs sont connus :<br />
- Le thromboxane A2, produit de l’activation de la cyclo-oxygénase.<br />
- Des ions superoxydes qui ont un rôle vasoconstricteur direct ou par dégradation de<br />
l’EDRF1.<br />
- L’endothéline, polypeptide de 21 acides aminés, dont la synthèse endothéliale est<br />
stimulée par la thrombine, l’adrénaline, l’interleukine 1 et l’hypoxie.
9 sur 17<br />
En résumé :<br />
<strong>Les</strong> principaux systèmes vaso-régulateurs.<br />
<strong>Les</strong> stimuli nerveux sympathiques et para-sympathiques renseignent le segment<br />
vasculaire sur l’hémodynamique systémique, et sont les principaux déterminants de la<br />
vasomotricité réflexe.<br />
<strong>Les</strong> contraintes de pression au niveau du segment vasculaire transmettent leurs<br />
informations directement, et de façon perpendiculaire, à la fibre musculaire lisse, ou<br />
tangentiellement, par l’intermédiaire de l’endothélium.<br />
<strong>Les</strong> produits du métabolisme local renseignent la fibre musculaire sur les besoins<br />
tissulaires.<br />
<strong>Les</strong> médiateurs circulants mettent en jeu des facteurs vasomoteurs endothéliaux.<br />
MÉCANISMES D’ACTION DES DÉRIVÉS NITRÉS<br />
1 - ACTION CELLULAIRE DES DÉRIVÉS NITRÉS<br />
L’augmentation de la biosynthèse de la prostacycline (PGI2), démontrée par Levin en<br />
1983, n’explique pas à elle seule l’effet vasodilatateur des <strong>dérivés</strong> <strong>nitrés</strong>. La partie active<br />
de la molécule, tout comme le NO, se fixerait sur la guanylate-cyclase qu’elle active par<br />
l’intermédiaire d’une protéine de couplage. Cet enzyme transforme ensuite le Guanosite<br />
triphosphate en GMP cyclique, qui est le second messager intra-cellulaire de l’effet des<br />
<strong>dérivés</strong> <strong>nitrés</strong>. Il active une protéine Kinase qui favorise la phosphorylation des protéines<br />
intra cellulaires régulant les mouvements de calcium, et est ainsi responsable d’une<br />
diminution de la concentration en calcium intra-cytosolique disponible au site actif des<br />
protéines contractiles.
10 sur 17<br />
Récapitulatif du mécanisme d’action intra-cellulaire des <strong>nitrés</strong>.<br />
<strong>Les</strong> DN doivent subir à l’intérieur de la cellule musculaire lisse une transformation<br />
chimique complexe impliquant des radicaux soufrés et permettant notamment la<br />
réduction du radical NO2 en radical NO, puis la formation d’une nouvelle molécule, le S.<br />
nitrosothiol, qui est l’ultime composant activant la guanylate-cyclase.<br />
Cette connaissance des mécanismes d’action cellulaire est essentielle. Il est possible<br />
désormais de concevoir une potentialisation clinique des effets des DN par la<br />
co-prescription de molécules soufrées.<br />
2 - EFFETS HÉMODYNAMIQUES DES DÉRIVÉS NITRÉS<br />
a) Vasodilatation veineuse<br />
<strong>Les</strong> DN exercent leurs effets vasodilatateurs sur le système veineux dés les plus faibles<br />
posologies.<br />
Cette veino-dilatation est d’autant plus marquée qu’elle est initialement plus élevée. Il en<br />
résulte une augmentation de la capacitance veineuse et une diminution du retour<br />
veineux. La diminution de pression de remplissage du ventricule droit (VD) entraîne<br />
secondairement une diminution de pression de remplissage du ventricule gauche (VG).<br />
Cet effet hémodynamique fondamental des DN explique leur efficacité dans<br />
l’insuffisance cardiaque gauche et dans l’insuffisance coronaire. La pression<br />
télédiastolique du VG détermine la tension pariétale du VG, donc la consommation en
11 sur 17<br />
oxygène du myocarde.<br />
En application de la loi de Starling, la diminution de la pression télédiastolique du VG<br />
(PTDVG) s’accompagne d’une diminution du volume d’éjection systolique (VES) lorsque<br />
les pressions de remplissage du VG sont basses ou normales. L’hypotension artérielle<br />
qui en résulte peut s’accompagner de tachycardie et vasoconstriction réflexe. Cette<br />
réponse délétère augmente les besoins en O2 du myocarde. Au contraire, pour des<br />
pressions initiales élevées de remplissage du VG, la diminution du PTDVG n’entraîne<br />
pas de diminution du VES.<br />
Conséquences de la veinodilatation induite par les <strong>nitrés</strong>. (Une même diminution de PTDVG entraîne : -<br />
une diminution du VES lorsque la PTDVG était initialement normale (1). - Une faible modification du VES<br />
lorsque la PTDVG était initialement élevée (2).<br />
b) Vasodilatation artérielle<br />
- A faible posologie, la vasodilatation veineuse entraîne une désensibilisation des<br />
mécano-récepteurs basse pression de l’oreillette droite, induisant une légère<br />
vasodilatation périphérique.<br />
- A forte posologie, l’effet vasodilatateur artériel est direct, et surtout marqué sur les gros<br />
troncs. L’abaissement des résistances à l’éjection ventriculaire gauche contribue à<br />
l’amélioration du débit cardiaque.
12 sur 17<br />
Influence du débit de perfusion sur les effets hémodynamiques des <strong>dérivés</strong> <strong>nitrés</strong>.<br />
- Influence de l’état initial<br />
- Pour une fonction ventriculaire gauche conservée, les mécanismes de " contre<br />
régulation " sont actifs (tachycardie). Dans l’insuffisance cardiaque, le baro-réflexe est<br />
moins marqué, par contre les résistances à l’éjection du VG étant initialement plus<br />
élevées, l’effet vasodilatateur artériel direct est plus marqué au niveau du débit<br />
cardiaque.<br />
- Effets des DN sur la circulation coronaire<br />
** Sur la circulation coronaire normale.<br />
<strong>Les</strong> DN vasodilatent les gros troncs qui ne représentent qu’une partie négligeable des<br />
résistances à la circulation coronaire. En pratique, l’effet des DN sur cette circulation<br />
dépend des modifications de consommation en O2 du myocarde qu’ils induisent par leur<br />
action hémodynamique systémique.<br />
** Sur une circulation coronaire pathologique.<br />
L’effet des DN se marque par différents mécanismes<br />
- Levée d’un spasme coronaire, et diminution du tonus vasoconstricteur coronaire<br />
(anormalement élevé chez l’insuffisant coronarien).<br />
- Augmentation du flux collatéral, et perfusion des zones ischémiques.<br />
- Diminution de la PTDVG, ce qui diminue la tension myocardique, et diminue les<br />
besoins en O2.<br />
3 - EFFETS DES DÉRIVÉS NITRÉS SUR LES FONCTIONS PLAQUETTAIRES<br />
L’effet anti-agrégant plaquettaire des DN s’explique par la stimulation de la prostacycline<br />
(PGI2), et par l’action des radicaux NO sur la guanylate-cyclase plaquettaire.<br />
Ces effets jouent en faveur de l’amélioration des circulations locales.<br />
PHARMACOCINÉTIQUE DES DÉRIVÉS NITRÉS<br />
1 - DIFFICULTÉS MÉTHODOLOGIQUES<br />
Elles sont de quatre ordres :
13 sur 17<br />
- les techniques de dosage sont complexes et font appel à la chromatographie en phase<br />
gazeuse couplée à la spectrographie de masse.<br />
- il est nécessaire de traiter instantanément les échantillons prélevés.<br />
- les taux sanguins de DN ne reflètent qu’une partie de leur devenir dans l’organisme.<br />
- les métabolites actifs sont difficiles à identifier.<br />
2 - PHARMACOCINETIQUE DE LA TRINITRINE<br />
La trinitrine est catabolisée au niveau des érythrocytes, du foie et de l’endothélium<br />
vasculaire. L’enzyme hépatique active est la gluthation-nitrate réductase. Elle existe en<br />
quantité importante, et seule une diminution du débit sanguin hépatique (lors<br />
d’insuffisance cardiaque par exemple) peut altérer le catabolisme de la trinitrine. <strong>Les</strong><br />
métabolites sont éliminés par voie urinaire.<br />
a) Utilisation de la voie sub-linguale<br />
<strong>Les</strong> concentrations sanguines sont rapidement élevées, mais du fait du catabolisme, la<br />
demi-vie n’est que de 2 à 4 minutes (voir schéma 1).<br />
b) Utilisation de la voie transcutanée<br />
Des patchs transdermiques peuvent assurer la délivrance de 5 à 10 mg de TNT sur une<br />
période de 24 heures. <strong>Les</strong> taux plasmatiques sont alors constants.<br />
c) Utilisation de la voie intraveineuse<br />
Pour une utilisation par voie veineuse, seul le mode d’administration continu est<br />
pratiqué. Cette voie, et ce mode, permettent une juste adéquation des posologies aux<br />
besoins. Il faut tenir compte de l’interaction de la TNT avec les tubulures de perfusion ou<br />
les seringues en polyvinyle, et seul du matériel en polyéthylène ou polypropylène doit<br />
être employé.<br />
<strong>Les</strong> posologies courantes vont de 0,5 à 5 mg/heure.<br />
3 - PHARMACOCINÉTIQUE DU DINITRATE D’ISOSORBIDE<br />
Son métabolisme aboutit à la formation de deux <strong>dérivés</strong> mono<strong>nitrés</strong> qui sont,<br />
contrairement aux métabolites de la trinitrine, hémodynamiquement actifs.<br />
a) Utilisation de la voie sub-linguale<br />
La résorption du DNIS est aussi rapide que celle de la TNT, mais sa demi-vie<br />
d’élimination est de 1 heure.<br />
b) Utilisation de la voie intraveineuse<br />
La rémanence de l’effet hémodynamique à l’arrêt de la perfusion du DNIS est plus<br />
longue que pour la TNT. Si le mode d’utilisation de la TNT et du DNIS par voie veineuse<br />
est identique, les posologies doivent tenir compte de la puissance d’action des 2<br />
molécules et en général sont 1,5 à 2 fois supérieure avec le DNIS par rapport à la TNT<br />
DÉRIVÉS NITRÉS DANS LE TRAITEMENT DE L’INSUFFISANCE<br />
CORONAIRE<br />
L’insuffisance coronaire est la plus ancienne et la principale indication des DN.<br />
1 - MÉCANISMES DE L’EFFET ANTI-ANGINEUX<br />
La veinodilatation augmente la capacitance veineuse et diminue la pré-charge. La
14 sur 17<br />
diminution de la PTDVG diminue la tension myocardique, qui est, avec la fréquence<br />
cardiaque et l’inotropisme, un des déterminants majeurs des besoins en O2 du<br />
myocarde. Par ailleurs, cette diminution de la PTDVG décomprime les artérioles<br />
coronaires sous endocardiques et facilite leur remplissage diastolique.<br />
D’autres effets notables des DN sont la vasodilatation des artères coronaires<br />
épicardiques de gros calibre, la levée du spasme localisé retrouvé dans l’Angor de<br />
Prinzmetal et certains angors instables, et la vasodilatation de l’arc sain des coronaires<br />
non complètement athéromateuses.<br />
Enfin les DN sont susceptibles d’augmenter la perfusion des zones ischémiques par<br />
l’intermédiaire de l’établissement d’une circulation collatérale.<br />
Par contre, les DN n’ont aucun effet vasodilatateur sur les coronaires de petit calibre.<br />
2 - ASSOCIATION DES DÉRIVÉS NITRÉS A D’AUTRES MOLÉCULES<br />
L’association DN et bêta-bloquants permet une synergie potentiellement efficace sur le<br />
plan hémodynamique, en diminuant les effets indésirables de chacune des molécules.<br />
Effets des <strong>nitrés</strong> et des b-bloquants sur les déterminants de l’équilibre énergétique du myocarde.<br />
La tachycardie réflexe des DN est antagonisée par l’effet chronotrope (-), et<br />
l’augmentation de la PTDVG éventuelle des bêta-bloquants est contre-balancée par<br />
l’effet veinodilatateur des DN.<br />
L’association d’inhibiteurs calciques, souvent préconisée, peut cependant induire une<br />
hypotension orthostatique. Ils seront réservés aux angors spastiques.<br />
La triple association DN, bêta-bloquants et inhibiteurs calciques a montré son efficacité<br />
dans les formes réfractaires d’angor d’effort, et dans le traitement de l’angor instable.<br />
3 - DÉRIVÉS NITRÉS A LA PHASE AIGUË DE L’INFARCTUS DU MYOCARDE<br />
- Traitement de l’IDM compliqué d’insuffisance ventriculaire gauche.<br />
Cette éventualité, relativement fréquente en cas d’infarctus étendu récidivant est une<br />
indication élective des DN. Ils diminuent la pression capillaire pulmonaire, diminuent les<br />
résistances à l’éjection du VG défaillant, diminuent les besoins en O2 du myocarde.<br />
L’utilisation de fortes posologies, 3 à 6 mg/h, est parfois nécessaire. Il peut être utile<br />
aussi d’associer des inotropes positifs (dobutamine).<br />
- Traitement de l’IDM non compliqué.<br />
L’utilisation systématique de DN par voie IV permet une réduction significative de la<br />
mortalité et des complications immédiates.
15 sur 17<br />
Effets des <strong>nitrés</strong> à la phase aiguë de l’infarctus du myocarde. (D’après Judgutt, Circulation, 1988, 78,<br />
906).<br />
- Contre-indications à l’emploi de DN, lors d’un IDM.<br />
<strong>Les</strong> DN ne sont pas recommandés lorsque le patient est hypovolémique et/ou<br />
hypotendu. De même, lors des extensions ventriculaires droites de la lésion, le ventricule<br />
droit devient moins compliant, et ne peut se remplir que sous l’effet d’une pré-charge<br />
élevée. Si des DN sont utilisé, se devra être à faible posologie (0,5 mg/h), et en<br />
surveillant attentivement le régime tensionnel.<br />
DÉRIVÉS NITRÉS DANS LE TRAITEMENT DE L’INSUFFISANCE<br />
CARDIAQUE<br />
Cette indication des DN n’a été que tardivement proposée. Il était postulé que la pré et la<br />
post-charge étaient régulées au mieux par les mécanismes compensateurs de<br />
l’insuffisance cardiaque.
16 sur 17<br />
1 - MÉCANISMES DE L’EFFET THÉRAPEUTIQUE DES DÉRIVÉS NITRÉS DANS<br />
L’INSUFFISANCE CARDIAQUE<br />
LA VASODILATATION VEINEUSE.<br />
Elle est l’effet hémodynamique principal des DN, et est marquée dés les faibles<br />
posologies (50µg/min.). L’augmentation de capacitance du secteur veineux revient à<br />
reproduire une " saignée " pharmacologique. La diminution de pression de remplissage<br />
du VG diminue la pression capillaire pulmonaire d’amont. <strong>Les</strong> signes cliniques et<br />
radiologiques de " poumon cardiaque " s’amendent. La symptomatologie de défaillance<br />
du cœur droit s’atténue, mais les valeurs de volume d’éjection systolique restent<br />
préservées.<br />
LA VASODILATATION ARTÉRIELLE.<br />
Elle n’est marquée que pour des posologies élevées de DN. Cette vasodilatation permet,<br />
en luttant contre l’hypertonie sympathique, de diminuer les résistances à l’éjection<br />
ventriculaire gauche. Cet effet est intéressant dans les formes sévères d’insuffisance<br />
cardiaque. Le VG défaillant est particulièrement sensible aux variations de la<br />
post-charge.<br />
2 - TRAITEMENT DE L’INSUFFISANCE VENTRICULAIRE GAUCHE AIGUË.<br />
L’utilisation des DN dans le traitement de l’Œdème Aigu Pulmonaire, nous venons de le<br />
voir, permet de modifier rapidement et favorablement les régimes de pression. Cette<br />
utilisation, même par voie veineuse, s’est simplifiée, et est possible même en<br />
préhospitalier. Un monitorage simple, PNI et SaO2, sont suffisants.<br />
La voie sub-linguale est utile en première intention.<br />
Lénitral ® Spray : 2 à 4 pulvérisations de 0.4 mg, à renouveler toutes les 15 min.<br />
La perfusion intraveineuse continue permet une meilleure adaptation posologique aux<br />
besoins, et assure un traitement facilement maîtrisable durant les temps de transport et<br />
transfert du patient. Le débit initial de 1 mg/h sera augmenté toutes les 15 min., en<br />
fonction de la clinique.<br />
Dans les formes graves d’insuffisance ventriculaire gauche, de la dobutamine peut être<br />
associée aux DN.<br />
CONCLUSION<br />
<strong>Les</strong> DN sont parmi les plus anciens produits de la pharmacopée à disposition des<br />
médecins. Une meilleure connaissance de leurs mécanismes d’action a permis de<br />
préciser les indications. De nouvelles voie d’administration en facilitent l’usage.<br />
BIBLIOGRAPHIE<br />
Armstrong L.W. - Blood levels after sublingual nitroglycerin. - Circulation 1979, 59 :<br />
585-88.<br />
Armstrong L.W. - Vasodilatator therapy in acute myocardial infarction. - Circulation<br />
52.1975.<br />
Bolton T.B. - Mechanisms of action of transmitters and others substances on smooth<br />
muscle. - Physio. Rev. 1979, 59 ; n°3 : 3 : 606-718.<br />
Curfman G.D. - Intravenous nytroglycerin in the treatment of spontaneous angina<br />
pectoris : A prospective, randomized trial. – Circulation, 1983, 67 ; n°2 : 276-282.
17 sur 17<br />
Dupuis J. - Tolerance to intravenous nytroglycerin in patients with congestive heart<br />
failure : Role of increased intravascular volume, neurohumoral activation and lack of<br />
prevention with N-acethylcysteine. - J. Am. Coll. Cardiol., 1990, 82 ; n°4 : 923-931.<br />
Epstein S.E. - Reduction of ischemic injury by nitroglycerin during acute myocardial<br />
infarction. - N. England J. Med. 292. 1975.<br />
Flaherty J.T et All. - A randomized prospective trial of intavenous nitroglycerin in patients<br />
with acute myocardial infraction. - Circulation, 1983, 68 ; n°3 : 576-588.<br />
Furchgott R.F. - The obligatory role of endothelial cells in the relaxation of arterial smooth<br />
muscle by acetycholine. - Nature, 1980, 288 : 373-6.<br />
Furhgott R.F. - Endothelium-derived relaxing and contracting factors. - FASEB J., 1983,<br />
3 ; n°9 : 2007-18.<br />
Grobecker H. - Pharmacology and clinical pharmacology of organic nitrates. - Eur. J. Clin.<br />
Pharmacol., 1990, 38 : (suppl. 1) 53-57.<br />
Levin R.E. - Nitroglycerin stimulates synthesis of prostacyclin by cultured human<br />
endothelial cells. - Journal of clinical investigation, 1981, 67 ;n°3 : 762-769.<br />
Mikolich J.R. - Relief of refractory angina with continuous infusion of nitroglycerin. - Chest<br />
77.1980<br />
Miller R.R. - Pharmacologic mechanism for left ventricular unloading in clinical congestive<br />
heart fealure. - Circ. Res. 39. 1976<br />
Murrel W. - Nitroglycerinas a remedy for angina pectoris. - Lancet 1 : 80, 1879.<br />
Sauvageon X. - <strong>Les</strong> <strong>dérivés</strong> <strong>nitrés</strong>. - <strong>Urgence</strong> <strong>Pratique</strong> n°10 ; 15-17, 1995.<br />
Weber S. - Monographie : <strong>dérivés</strong> <strong>nitrés</strong> : de la pharmacologie à la pratique.<br />
TRAITEMENT DE L’OAP<br />
Position demi-assise (en l’absence de signes de choc).<br />
SaO2<br />
02 au masque<br />
Prise TA<br />
Lénitral Spray : 2 bouffées®<br />
Voie veineuse<br />
Lasilix® 20 mg, ou Burinex® 2mg IV.<br />
DN IV :Lénitral® trinitrine : amp. de 3mg/ 2 ml ou 15 mg/ 10 ml.<br />
En cas d’urgence extrême, ou en l’absence de matériel : 0.5 mg IV en 30 sec.<br />
A la seringue électrique :<br />
30 mg / 50 ml, et débuter à la vitesse 2.<br />
Choc cardiogénique :<br />
Dobutrex® 250 mg / 20 ml<br />
Ramener à 50 ml, et vitesse 1 à 1,5.