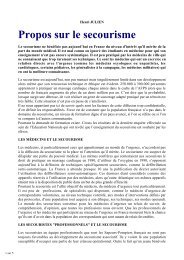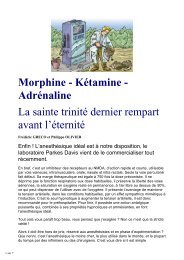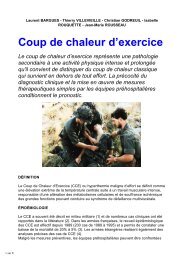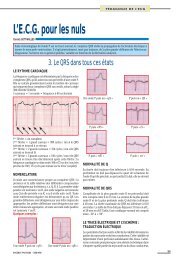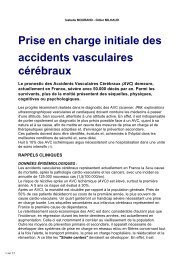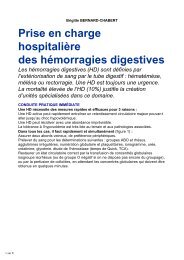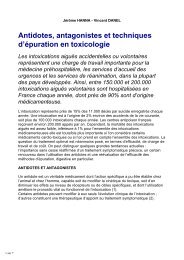Évaluation de la gravité des brûlures ... - Urgence Pratique
Évaluation de la gravité des brûlures ... - Urgence Pratique
Évaluation de la gravité des brûlures ... - Urgence Pratique
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
1 sur 6<br />
Daniel WASSERMANN<br />
<strong>Évaluation</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>gravité</strong> <strong>de</strong>s<br />
<strong>brûlures</strong> : Physiopathologie<br />
Il existe peu <strong>de</strong> pathologies dont l’étendue <strong>de</strong>s <strong>gravité</strong>s est aussi <strong>la</strong>rge que celle <strong>de</strong>s <strong>brûlures</strong>.<br />
Rien <strong>de</strong> comparable, en effet, entre <strong>la</strong> petite brûlure domestique à <strong>la</strong>quelle personne<br />
n’échappe au cours <strong>de</strong> sa vie et <strong>la</strong> brûlure profon<strong>de</strong> qui atteint <strong>la</strong> quasi totalité du revêtement<br />
cutané et qui représente un <strong>de</strong>s traumatismes les plus lourds auxquels il est possible d’être<br />
confronté. Si, dans les cas extrêmes, l’évaluation <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>gravité</strong> ne pose aucun problème, il n’en<br />
est pas <strong>de</strong> même en ce qui concerne les <strong>brûlures</strong> <strong>de</strong> <strong>gravité</strong> intermédiaire. Pourtant, pour ces<br />
<strong>de</strong>rnières, un diagnostic précis <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>gravité</strong> est absolument déterminant : il faut non<br />
seulement savoir reconnaître <strong>la</strong> brûlure qui risque d’entraîner <strong>de</strong>s perturbations <strong>de</strong><br />
l’homéostasie et qui nécessite donc <strong>de</strong>s traitements en urgence et une hospitalisation, mais<br />
aussi distinguer celle qui peut être responsable <strong>de</strong> <strong>la</strong> formation d’une cicatrice et qui impose<br />
<strong>la</strong> consultation d’un spécialiste brûlologue.<br />
ÉVALUATION DE LA GRAVITÉ<br />
La détermination <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>gravité</strong> d’une brûlure se fera sur <strong>la</strong> prise en compte <strong>de</strong> nombreux facteurs. La pondération <strong>de</strong> ces<br />
différents facteurs permet l’établissement d’indices <strong>de</strong> <strong>gravité</strong> qui, le plus souvent, ne concernent que le risque vital.<br />
Elle doit également aboutir à une c<strong>la</strong>ssification simple <strong>de</strong>s patients en rapport avec les risques encourus (vitaux et non<br />
vitaux) et le type <strong>de</strong> prise en charge souhaitable.<br />
LES PRINCIPAUX FACTEURS DE GRAVITÉ<br />
Nombreux sont les éléments qui interviennent dans <strong>la</strong> <strong>gravité</strong> d’une brûlure<br />
La surface <strong>de</strong> <strong>la</strong> brûlure :<br />
Elle est évaluée en pourcentage <strong>de</strong> <strong>la</strong> surface corporelle totale.<br />
Pour les <strong>brûlures</strong> peu étendues, l’évaluation sera réalisée en tenant compte du fait qu’une paume <strong>de</strong> main (il s’agit <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
main <strong>de</strong> <strong>la</strong> victime) représente environ 1% <strong>de</strong> <strong>la</strong> surface corporelle totale.<br />
La règle <strong>de</strong>s neufs qui a l’avantage d’être facile à mémoriser permet une évaluation rapi<strong>de</strong> <strong>de</strong>s <strong>brûlures</strong> étendues : elle<br />
attribue <strong>de</strong>s multiples <strong>de</strong> 9% <strong>de</strong> <strong>la</strong> surface corporelle totale à différents territoires cutanés (9% pour l’extrémité<br />
céphalique, 9% pour chaque membre supérieur, 18% pour chaque membre inférieur, 18% pour chaque face du tronc,<br />
1% pour le périnée). En fait <strong>la</strong> règle <strong>de</strong>s neufs est trop imprécise et ignore les variations morphologiques en rapport<br />
avec l’âge.<br />
Une évaluation rigoureuse ne sera possible qu’en ayant recours à <strong>de</strong>s tables plus détaillées tenant compte <strong>de</strong> l’âge, telles<br />
les tables <strong>de</strong> Berkow.<br />
Il faut noter <strong>la</strong> gran<strong>de</strong> variabilité <strong>de</strong> cette estimation <strong>de</strong> <strong>la</strong> surface <strong>de</strong> brûlure, même lorsqu’elle est réalisée par <strong>de</strong>s<br />
spécialistes. Il est donc indispensable d’y apporter une attention toute particulière et <strong>de</strong> s’ai<strong>de</strong>r d’un schéma.<br />
La profon<strong>de</strong>ur <strong>de</strong> <strong>la</strong> brûlure :<br />
Dans les <strong>brûlures</strong> thermiques, <strong>la</strong> profon<strong>de</strong>ur dépend d’une part <strong>de</strong> <strong>la</strong> température atteinte par <strong>la</strong> surface cutanée et,<br />
d’autre part, <strong>de</strong> <strong>la</strong> durée <strong>de</strong> l’exposition à cette température.<br />
Par exemple, lors <strong>de</strong> l’immersion dans <strong>de</strong> l’eau chau<strong>de</strong>, une brûlure en 3ème <strong>de</strong>gré est provoquée en 2 secon<strong>de</strong>s à 65°C,<br />
10 secon<strong>de</strong>s à 60°C et en 30 secon<strong>de</strong>s à 54°C.<br />
En cas <strong>de</strong> <strong>brûlures</strong> chimiques, <strong>la</strong> profon<strong>de</strong>ur dépend <strong>de</strong> <strong>la</strong> durée du contact et <strong>de</strong> l’écart entre le pH du produit corrosif<br />
et le pH neutre.<br />
On distingue 4 profon<strong>de</strong>urs :<br />
Le premier <strong>de</strong>gré correspond à une atteinte <strong>de</strong>s couches superficielles <strong>de</strong> l’épi<strong>de</strong>rme sans lésion <strong>de</strong> <strong>la</strong> basale. Il se<br />
reconnaît à l’absence <strong>de</strong> décollement (pas <strong>de</strong> phlyctène) et à <strong>la</strong> présence d’un érythème douloureux. La cicatrisation<br />
spontanée se fait en 2 à 3 jours sans aucune séquelle.
2 sur 6<br />
Le <strong>de</strong>uxième <strong>de</strong>gré superficiel correspond à une lésion <strong>de</strong> <strong>la</strong> quasi totalité <strong>de</strong> l’épi<strong>de</strong>rme y compris une partie <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
basale et <strong>de</strong>s cellules <strong>de</strong> Malpighi. Sur le p<strong>la</strong>n morphologique,<br />
il se reconnaît par <strong>la</strong> présence constante <strong>de</strong> phlyctènes dont le p<strong>la</strong>ncher, après excision, est rouge, bien vascu<strong>la</strong>risé et<br />
très sensible. La cicatrisation spontanée en 1 à 2 semaines, sans séquelle, est <strong>la</strong> règle, mais on ne peut écarter totalement<br />
le risque <strong>de</strong> cicatrice indélébile notamment chez les enfants, les sujets <strong>de</strong> couleur et d’une façon plus générale lorsque <strong>la</strong><br />
cicatrisation est retardée par une complication (infection locale le plus souvent).<br />
Le <strong>de</strong>uxième <strong>de</strong>gré profond est une <strong>de</strong>struction complète <strong>de</strong> l’épi<strong>de</strong>rme et du <strong>de</strong>rme superficiel. Ne persistent intacts<br />
que le <strong>de</strong>rme profond et les annexes épi<strong>de</strong>rmiques (poils, g<strong>la</strong>n<strong>de</strong>s sudoripares et sébacées). Ces <strong>brûlures</strong> présentent,<br />
comme celles du <strong>de</strong>uxième <strong>de</strong>gré superficiel, <strong>de</strong>s phlyctènes mais, après excision, le p<strong>la</strong>ncher <strong>de</strong> celles-ci apparaît<br />
b<strong>la</strong>nc-rosé, mal vascu<strong>la</strong>risé, peu sensible. La cicatrisation spontanée à partir <strong>de</strong>s annexes est possible mais longue (2 à 4<br />
semaines). Bien souvent, l’état général du patient ou une surinfection locale, entraînera un approfondissement <strong>de</strong>s<br />
lésions par <strong>de</strong>struction <strong>de</strong>s quelques cellules épi<strong>de</strong>rmiques survivantes qui ne permettra pas <strong>la</strong> cicatrisation spontanée.<br />
Le 3ème <strong>de</strong>gré correspond à une <strong>de</strong>struction totale <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau incluant, au minimum,<strong>la</strong> totalité <strong>de</strong> l’épi<strong>de</strong>rme et du <strong>de</strong>rme.<br />
Il se présente comme une nécrose cutanée adhérente, sans phlyctène, <strong>de</strong> couleur plus ou moins foncée (al<strong>la</strong>nt du b<strong>la</strong>nc<br />
au noir en passant par le marron), avec perte totale <strong>de</strong> <strong>la</strong> sensibilité. La complète disparition <strong>de</strong>s cellules<br />
épi<strong>de</strong>rmiques ne permet pas <strong>la</strong> cicatrisation spontanée. La fermeture cutanée définitive ne peut alors être obtenue que par<br />
autogreffe, c’est à dire par l’importation <strong>de</strong> tissus épi<strong>de</strong>rmiques autologues, prélevés sur une zone <strong>de</strong> peau intacte. Cette<br />
greffe ne sera possible qu’après excision <strong>de</strong> <strong>la</strong> nécrose cutanée.<br />
L’âge :<br />
Il représente un élément déterminant du pronostic. Les âges extrêmes <strong>de</strong> <strong>la</strong> vie sont c<strong>la</strong>ssiquement défavorables, avec<br />
une mention particulière pour les patients âgés pour lesquels une brûlure, même mo<strong>de</strong>ste, engage souvent le pronostic<br />
vital, tant les capacités <strong>de</strong> cicatrisation et <strong>de</strong> défense contre les infections sont réduites.<br />
La présence <strong>de</strong> lésions pulmonaires d’inha<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> fumées :<br />
Ces lésions pulmonaires sont fréquentes au cours <strong>de</strong>s <strong>brûlures</strong> secondaires à un incendie. Elles sont en rapport avec<br />
l’inha<strong>la</strong>tion <strong>de</strong>s gaz corrosifs et/ou toxiques contenus dans <strong>la</strong> fumée et sont retrouvées chez environ 25% <strong>de</strong>s brûlés<br />
hospitalisés dans les centres spécialisés. Elles aggravent considérablement le pronostic vital puisque <strong>la</strong> mortalité <strong>de</strong>s<br />
patients brûlés qui en sont victimes est évaluée entre 30 et 40%.<br />
Cliniquement ces lésions d’inha<strong>la</strong>tion seront suspectées en cas <strong>de</strong> <strong>brûlures</strong> survenues en espace clos, <strong>de</strong> <strong>brûlures</strong><br />
localisées au niveau du visage, <strong>de</strong> <strong>brûlures</strong> <strong>de</strong>s vilbisses ou encore en cas <strong>de</strong> constatation d’une voie rauque, d’un<br />
wheezing, d’un stridor ou <strong>de</strong> présence <strong>de</strong> dépôts <strong>de</strong> suie au niveau <strong>de</strong>s muqueuses nasales et buccales.<br />
Le diagnostic sera affirmé par <strong>la</strong> fibroscopie bronchique qui montrera, en fonction <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>gravité</strong> <strong>de</strong> l’atteinte <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
muqueuse bronchique : érythème, œdème, dépôts <strong>de</strong> suie, érosions <strong>de</strong> <strong>la</strong> muqueuse, p<strong>la</strong>ques <strong>de</strong> nécrose.<br />
La localisation <strong>de</strong>s <strong>brûlures</strong> :<br />
Certaines localisations compliquent les traitements et augmentent les risques vitaux et fonctionnels :<br />
Les <strong>brûlures</strong> du visage sont particulièrement défavorables. Cette localisation est évocatrice d’une lésion d’inha<strong>la</strong>tion <strong>de</strong><br />
fumée. Elle peut entraîner, en raison <strong>de</strong> <strong>la</strong> formation rapi<strong>de</strong> d’un œdème, une détresse respiratoire aiguë. Elle peut<br />
<strong>la</strong>isser persister, en cas <strong>de</strong> lésions profon<strong>de</strong>s, <strong>de</strong>s cicatrices dont les conséquences psycho-sociologiques sont majeures.<br />
Les <strong>brûlures</strong> <strong>de</strong>s mains, très fréquentes, peuvent entraîner <strong>de</strong>s séquelles fonctionnelles et esthétiques particulièrement<br />
handicapantes.<br />
Les <strong>brûlures</strong> <strong>de</strong>s jambes et <strong>de</strong>s pieds contraignent le sujet au décubitus et l’expose ainsi au risque thrombo-embolique.<br />
Les <strong>brûlures</strong> du siège augmentent le risque infectieux.<br />
L’existence d’états pathologiques préexistants :<br />
Ethylisme, diabète, insuffisance cardiaque, insuffisance rénale, déficit immunitaire représentent <strong>de</strong>s "terrains" qui<br />
aggravent lour<strong>de</strong>ment le pronostic <strong>de</strong> <strong>la</strong> brûlure.<br />
LES INDICES PRONOSTIQUES :<br />
De nombreux indices pronostiques spécifiques <strong>de</strong> <strong>la</strong> brûlure ont été décrits. Ils associent, en les pondérant<br />
éventuellement, plusieurs <strong>de</strong>s facteurs <strong>de</strong> <strong>gravité</strong> évoqués ci-<strong>de</strong>ssus, pour essayer <strong>de</strong> déterminer, à partir d’étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
popu<strong>la</strong>tions témoins, une probabilité <strong>de</strong> survie.<br />
Une remarque préa<strong>la</strong>ble doit être faite concernant l’utilisation <strong>de</strong> ces indices : aucun d’entre eux ne peut être<br />
suffisamment riche en paramètres et performant pour prendre en compte <strong>la</strong> totalité <strong>de</strong>s particu<strong>la</strong>rités d’un patient<br />
déterminé. Leurs valeurs représentent le pronostic d’un patient "moyen". Ils ne peuvent donc permettre d’évaluer "les<br />
chances" d’un individu particulier qui a ses propres caractéristiques. En revanche, ils permettent d’analyser<br />
statistiquement les résultats obtenus sur un groupe <strong>de</strong> patients en les comparant à ceux observés sur le groupe ayant servi<br />
à <strong>la</strong> <strong>de</strong>scription <strong>de</strong> l’indice considéré ou à un autre groupe, précé<strong>de</strong>mment évalué. Ils représentent donc un outil
3 sur 6<br />
extrêmement utile pour évaluer, par comparaison, l’efficacité thérapeutique en terme <strong>de</strong> mortalité.<br />
Les principaux indices pronostiques utilisés sont :<br />
L’indice <strong>de</strong> Baux, uniquement applicable chez l’adulte, qui se définit comme <strong>la</strong> somme <strong>de</strong> <strong>la</strong> surface brûlée, exprimée<br />
en pourcentage <strong>de</strong> <strong>la</strong> surface cutanée totale, et <strong>de</strong> l’âge en années. Il a le mérite <strong>de</strong> <strong>la</strong> simplicité et, en fait, se montre très<br />
performant bien que ne prenant pas en compte <strong>la</strong> profon<strong>de</strong>ur <strong>de</strong>s <strong>brûlures</strong> ni <strong>la</strong> présence <strong>de</strong> lésions d’inha<strong>la</strong>tion. Les<br />
bons résultats obtenus avec l’indice <strong>de</strong> Baux peuvent être expliqués par le fait que, sur une <strong>la</strong>rge popu<strong>la</strong>tion, condition<br />
obligatoire pour l’utilisation d’un indice pronostique, <strong>la</strong> proportion <strong>de</strong>s différentes profon<strong>de</strong>urs <strong>de</strong> <strong>brûlures</strong> et<br />
l’inci<strong>de</strong>nce <strong>de</strong>s lésions d’inha<strong>la</strong>tion sont constantes et pratiquement i<strong>de</strong>ntiques dans <strong>de</strong>s pays présentant un niveau <strong>de</strong><br />
développement équivalent.<br />
Des étu<strong>de</strong>s statistiques nous ont permis <strong>de</strong> montrer que l’âge n’a, aujourd’hui, pas d’influence défavorable sur le<br />
pronostic vital <strong>de</strong>s brûlés avant 50 ans, contrairement à ce que décrivait l’indice <strong>de</strong> Baux (proposé il y a plus <strong>de</strong> 30<br />
ans). Ceci est probablement en rapport avec les progrès réalisés dans le domaine <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé publique et nous a amené à<br />
proposer une modification <strong>de</strong> l’indice <strong>de</strong> Baux, qui consiste à ne faire intervenir que <strong>la</strong> surface brûlée totale avant 50<br />
ans et, au <strong>de</strong>là, à additionner <strong>la</strong> surface brûlée totale avec le double <strong>de</strong>s années d’âge au <strong>de</strong>ssus <strong>de</strong> 50 ans :<br />
Indice <strong>de</strong> Baux modifié = Surface brûlée totale + (nombre d’années>50 ans) x 2.<br />
L’indice UBS est égal à <strong>la</strong> somme <strong>de</strong> <strong>la</strong> surface totale <strong>de</strong> <strong>la</strong> brûlure plus 3 fois <strong>la</strong> surface brûlée en 3ème <strong>de</strong>gré, les<br />
surfaces étant exprimées en pourcentage <strong>de</strong> <strong>la</strong> surface corporelle. Outre le fait que cet indice ne prend pas en compte<br />
l’âge du patient, l’analyse statistique montre qu’il décrit mal le risque <strong>de</strong> mortalité sur une popu<strong>la</strong>tion <strong>la</strong>rge <strong>de</strong> brûlés.<br />
L’indice ABSI prend en compte <strong>de</strong> nombreux paramètres (surface <strong>de</strong> <strong>la</strong> brûlure, présence <strong>de</strong> lésions du 3ème <strong>de</strong>gré et<br />
<strong>de</strong> lésions pulmonaires d’inha<strong>la</strong>tion, âge du patient et sexe).<br />
D’autres indices plus complexes, comme l’indice <strong>de</strong> Roi, nécessitent un ordinateur pour être évalués.<br />
CLASSIFICATION DE LA GRAVITÉ<br />
D’UNE BRÛLURE :<br />
Dans <strong>la</strong> pratique, <strong>la</strong> c<strong>la</strong>ssification <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>gravité</strong> d’une brûlure ne doit pas seulement tenir compte du pronostic vital. Les<br />
risques <strong>de</strong> séquelles, <strong>de</strong> complications diverses, les difficultés particulières <strong>de</strong> <strong>la</strong> mise en œuvre <strong>de</strong>s traitements sont<br />
autant d’éléments qui doivent intervenir dans <strong>la</strong> c<strong>la</strong>ssification.<br />
Brûlures bénignes :<br />
Il s’agit <strong>de</strong> lésions peu étendues (moins <strong>de</strong> 2% <strong>de</strong> <strong>la</strong> surface corporelle), du premier et du <strong>de</strong>uxième <strong>de</strong>gré superficiel,<br />
ne touchant ni <strong>la</strong> face, ni le siège, ni les mains. Elles peuvent être traitées en ambu<strong>la</strong>toire. Attention ! Si <strong>la</strong> cicatrisation<br />
n’est pas obtenue au bout <strong>de</strong> 10 jours, <strong>la</strong> consultation spécialisée est obligatoire.<br />
Brûlures <strong>de</strong> <strong>gravité</strong> intermédiaire :<br />
Elle correspon<strong>de</strong>nt soit à <strong>de</strong>s <strong>brûlures</strong> peu étendues mais profon<strong>de</strong>s ou siégeant au niveau du visage, du siège ou <strong>de</strong>s<br />
mains, soit à <strong>de</strong>s <strong>brûlures</strong> dont l’étendue dépasse 2% <strong>de</strong> <strong>la</strong> surface corporelle mais reste inférieure à 10% <strong>de</strong> celle-ci. Il<br />
n’existe pas <strong>de</strong> lésions respiratoires (pas d’inha<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> fumée) ni <strong>de</strong> risque particulier (cf. les <strong>brûlures</strong> graves). Ce<br />
type <strong>de</strong> <strong>brûlures</strong> nécessitera un avis médical et le plus souvent une hospitalisation dans une structure spécialisée.<br />
Brûlures graves :<br />
Il s’agit <strong>de</strong> <strong>brûlures</strong> dont l’étendue (entre 15 et 50% <strong>de</strong> <strong>la</strong> surface corporelle) et <strong>la</strong> profon<strong>de</strong>ur (2ème et 3ème <strong>de</strong>gré)<br />
entraînent un risque vital, risque qui peut aussi être le fait <strong>de</strong> lésions pulmonaires par inha<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> fumées, d’un b<strong>la</strong>st<br />
(explosion <strong>de</strong> gaz), <strong>de</strong> l’origine <strong>de</strong> <strong>la</strong> brûlure (<strong>brûlures</strong> électriques, <strong>brûlures</strong> chimiques), d’un traumatisme associé ou<br />
d’un terrain débilité. Ce risque vital est considéré comme faible dans les conditions actuelles <strong>de</strong> prise en charge, mais<br />
impose l’hospitalisation en centre <strong>de</strong> brûlés.<br />
Brûlures très graves :<br />
Brûlures en majorité profon<strong>de</strong>s dont <strong>la</strong> surface dépasse 50% <strong>de</strong> <strong>la</strong> surface corporelle. Les risques vitaux sont majeurs<br />
pour ces <strong>brûlures</strong> qui ne peuvent évoluer favorablement que si l’on utilise toutes les ressources thérapeutiques<br />
mo<strong>de</strong>rnes.<br />
Rappelons enfin le rôle essentiel <strong>de</strong> l’âge qui se traduit par le fait qu’une brûlure, même peu étendue, est toujours grave<br />
chez une personne âgée.<br />
PHYSIOPATHOLOGIE<br />
La brûlure, lorsqu’elle est étendue, entraîne <strong>de</strong> profonds déséquilibres <strong>de</strong> l’homéostasie qui peuvent mettre <strong>la</strong> vie du
4 sur 6<br />
patient en danger.<br />
La connaissance <strong>de</strong> l’origine <strong>de</strong> ces perturbations, <strong>de</strong> leur importance et <strong>de</strong> leur évolution dans le temps est essentielle à<br />
une prise en charge efficace du brûlé.<br />
Les déséquilibres sont d’autant plus graves et précoces que <strong>la</strong> lésion cutanée est plus étendue. Ils persistent d’autant plus<br />
longtemps et exposent ainsi à <strong>de</strong>s complications d’autant plus nombreuses que <strong>la</strong> brûlure est plus profon<strong>de</strong>.<br />
En pratique ce n’est que pour les <strong>brûlures</strong> du 2ème ou du 3ème <strong>de</strong>gré dont <strong>la</strong> surface dépasse 10% <strong>de</strong> <strong>la</strong> surface<br />
corporelle que les problèmes se posent.<br />
Perturbations hydro-électrolytiques :<br />
Il existe une fuite p<strong>la</strong>smatique massive et brutale dès les premières minutes après <strong>la</strong> brûlure. L’importance <strong>de</strong> cette<br />
p<strong>la</strong>smorragie dépend <strong>de</strong> <strong>la</strong> surface <strong>de</strong> <strong>la</strong> lésion et peut dépasser 1 litre au cours <strong>de</strong> <strong>la</strong> première heure, lorsque les<br />
<strong>brûlures</strong> atteignent plus <strong>de</strong> 50 % <strong>de</strong> <strong>la</strong> surface corporelle.<br />
L’hypovolémie résultante peut entraîner un choc et engager le pronostic vital en cas <strong>de</strong> <strong>brûlures</strong> étendues et <strong>de</strong> retard à<br />
<strong>la</strong> mise en œuvre <strong>de</strong> mesures adaptées. Sa compensation est donc au premier p<strong>la</strong>n du traitement d’urgence <strong>de</strong>s premières<br />
heures.<br />
Les mécanismes <strong>de</strong> ces perturbations sont bien compris aujourd’hui.<br />
Libérations <strong>de</strong> médiateurs <strong>de</strong> l’inf<strong>la</strong>mmation :<br />
La dénaturation <strong>de</strong>s protéines par <strong>la</strong> chaleur entraîne une activation du complément par l’intermédiaire <strong>de</strong> <strong>la</strong> xantine<br />
oxydase, du facteur <strong>de</strong> Hageman et <strong>de</strong> <strong>la</strong> libération <strong>de</strong> radicaux libres. La casca<strong>de</strong> ainsi initiée se poursuit par <strong>la</strong><br />
libération d’histamine, <strong>de</strong> kinines, <strong>de</strong> prostag<strong>la</strong>ndines, <strong>de</strong> cytokines (TNF, IL1, 1L6) et <strong>de</strong> produits oxydants (NO).<br />
Vasodi<strong>la</strong>tation et hyperperméabilité <strong>de</strong> l’endothélium capil<strong>la</strong>ire :<br />
Ces effets vascu<strong>la</strong>ires sont secondaires à <strong>la</strong> libération <strong>de</strong>s médiateurs <strong>de</strong> l’inf<strong>la</strong>mmation dont le rôle (utile) est <strong>de</strong><br />
favoriser l’attraction <strong>de</strong>s leucocytes circu<strong>la</strong>nts et leur dia-pédèse.<br />
P<strong>la</strong>smorragie :<br />
L’extravasation p<strong>la</strong>smatique est une conséquence <strong>de</strong> ces modifications, sorte d’effet secondaire inévitable <strong>de</strong> <strong>la</strong> défense<br />
<strong>de</strong> l’organisme. Elle concerne initialement l’albumine qui fuit vers le secteur interstitiel <strong>de</strong> <strong>la</strong> zone lésée et provoque<br />
ainsi une diminution <strong>de</strong> <strong>la</strong> pression oncotique, déséquilibrant les échanges transcapil<strong>la</strong>ires en faveur d’une fuite associée<br />
d’eau et d’électrolytes. Au total, c’est du p<strong>la</strong>sma sans les grosses molécules protidiques (immunoglobulines) qui<br />
s’accumule dans l’espace interstitiel et est soustrait à <strong>la</strong> volémie.<br />
Formation <strong>de</strong>s œdèmes :<br />
Ces fuites p<strong>la</strong>smatiques sont responsables non seulement d’une hypovolémie mais aussi <strong>de</strong> <strong>la</strong> formation <strong>de</strong>s œdèmes et,<br />
dans le cas <strong>de</strong> <strong>brûlures</strong> du 2ème <strong>de</strong>gré, <strong>de</strong> celle du liqui<strong>de</strong> <strong>de</strong>s phlyctènes et <strong>de</strong>s exsudats. Ces perturbations sont<br />
maximales dès les premières minutes suivant <strong>la</strong> brûlure, diminuant par <strong>la</strong> suite progressivement pour disparaître après<br />
environ 24 heures.<br />
Les œdèmes formés peuvent provoquer <strong>de</strong>s compressions vascu<strong>la</strong>ires qui risquent d’aggraver les lésions et peuvent<br />
même entraîner, en cas <strong>de</strong> <strong>brûlures</strong> circu<strong>la</strong>ires profon<strong>de</strong>s, <strong>de</strong>s nécroses ischémiques extensives.<br />
Par ailleurs, lorsque <strong>la</strong> perméabilité normale <strong>de</strong> l’endothélium sera restaurée, <strong>la</strong> récupération <strong>de</strong>s liqui<strong>de</strong>s d’œdème par<br />
le système lymphatique exposera, en cas <strong>de</strong> maintien <strong>de</strong> <strong>la</strong> volémie à <strong>la</strong> normale par les perfusions, à une hypervolémie<br />
secondaire dont il faudra tenir compte dans <strong>la</strong> poursuite <strong>de</strong> <strong>la</strong> réanimation hydro-électrolytique.<br />
Autres perturbations :<br />
Au niveau <strong>de</strong>s tissus lésés, <strong>de</strong>ux autres phénomènes sont responsables d’une majoration <strong>de</strong>s fuites hydriques : une<br />
hyperosmo<strong>la</strong>rité du milieu interstitiel, en re<strong>la</strong>tion avec l’afflux <strong>de</strong> molécules et <strong>de</strong> diverses particules provenant <strong>de</strong>s<br />
cellules détruites et une évaporation <strong>de</strong> surface dont l’intensité dépend <strong>de</strong>s conditions du traitement local.<br />
Ces pertes, en re<strong>la</strong>tion avec l’hyperosmo<strong>la</strong>rité et l’évaporation, persisteront beaucoup plus longtemps que celles<br />
générées par l’hyperperméabilité capil<strong>la</strong>ire.<br />
A distance <strong>de</strong>s territoires brûlés, il ne semble pas y avoir d’augmentation durable <strong>de</strong> <strong>la</strong> perméabilité capil<strong>la</strong>ire, à <strong>la</strong><br />
condition que <strong>la</strong> réanimation initiale ait permis d’éviter l’hypovolémie et les phénomènes d’ischémie-reperfusion.<br />
Néanmoins, on constate une fuite hydro-électrolytique explicable par <strong>la</strong> baisse <strong>de</strong> <strong>la</strong> concentration p<strong>la</strong>smatique <strong>de</strong><br />
l’albumine et donc <strong>de</strong> <strong>la</strong> pression oncotique.<br />
PERTURBATIONS MÉTABOLIQUES :<br />
Les <strong>brûlures</strong> étendues entraînent un hypermétabolisme considérable pouvant multiplier par plus <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux les besoins<br />
caloriques normaux.<br />
Mécanismes :
5 sur 6<br />
Cet hypermétabolisme répond à plusieurs mécanismes dont <strong>la</strong> connaissance débouche sur <strong>de</strong>s mesures thérapeutiques<br />
efficaces.<br />
Pertes <strong>de</strong> chaleur en re<strong>la</strong>tion avec <strong>la</strong> perte <strong>de</strong> l’iso<strong>la</strong>nt cutané et l’évaporation à <strong>la</strong> surface <strong>de</strong> <strong>la</strong> brûlure.<br />
Sécrétion massive, en réponse au stress, d’hormones calorigènes (catécho<strong>la</strong>mines, glucagon, cortisol).<br />
Libération <strong>de</strong> produits <strong>de</strong> l’inf<strong>la</strong>mmation à partir <strong>de</strong> <strong>la</strong> brûlure (cytokines, radicaux libres, prostag<strong>la</strong>ndines).<br />
Conséquences :<br />
Cet emballement métabolique est responsable d’une négativation <strong>de</strong>s bi<strong>la</strong>ns calorique et protidique avec<br />
néoglycogénèse, d’une fonte muscu<strong>la</strong>ire et d’un diabète <strong>de</strong> stress en re<strong>la</strong>tion avec une résistance à l’insuline et<br />
l’abondance <strong>de</strong>s sécrétions d’hormones hyperglycémiantes. En l’absence <strong>de</strong> mesures thérapeutiques adéquates, <strong>la</strong><br />
conséquence principale <strong>de</strong> ces perturbations métaboliques est l’instal<strong>la</strong>tion rapi<strong>de</strong> d’une dénutrition, elle-même<br />
responsable d’une absence <strong>de</strong> cicatrisation et d’une dépression immunitaire.<br />
COMPLICATIONS INFECTIEUSES :<br />
Elles représentent <strong>la</strong> principale cause <strong>de</strong> mortalité chez les grands brûlés (plus d’un décès sur <strong>de</strong>ux leur sont<br />
directement imputables) et le principal facteur <strong>de</strong> morbidité.<br />
Origines :<br />
La rupture <strong>de</strong> <strong>la</strong> barrière cutanée représente un porte d’entrée d’autant plus importante que <strong>la</strong> surface <strong>de</strong> <strong>la</strong> brûlure est<br />
plus étendue et d’autant plus durable que <strong>la</strong> lésion est plus profon<strong>de</strong> et reste non couverte pendant longtemps.<br />
Une translocation bactérienne au niveau du tube digestif pourrait, même si <strong>la</strong> preuve formelle <strong>de</strong> son existence n’a<br />
jamais été apportée chez l’homme, être à l’origine <strong>de</strong> bactériémies, voir <strong>de</strong> septicémies.<br />
Une dépression immunitaire marquée est retrouvée chez tous les grands brûlés. Elle touche aussi bien l’immunité<br />
humorale que l’immunité cellu<strong>la</strong>ire. Elle est en re<strong>la</strong>tion avec les effets suppresseurs <strong>de</strong> certains médiateurs, déversés<br />
massivement dans <strong>la</strong> circu<strong>la</strong>tion pour atténuer <strong>la</strong> réaction inf<strong>la</strong>mmatoire systémique qui submerge l’organisme <strong>de</strong>s grands<br />
brûlés. Cet effet inhibiteur peut être considéré comme régu<strong>la</strong>teur, <strong>de</strong>stiné à contrer les conséquences délétères du<br />
passage <strong>de</strong> médiateurs <strong>de</strong> l’inf<strong>la</strong>mmation dans <strong>la</strong> circu<strong>la</strong>tion systémique. En quelque sorte, entre <strong>de</strong>ux maux, représentés<br />
par le danger potentiel <strong>de</strong> l’infection et celui immédiat <strong>de</strong> <strong>la</strong> f<strong>la</strong>mbée inf<strong>la</strong>mmatoire, l’organisme choisit le moindre,<br />
c’est à dire le risque infectieux.<br />
Rappelons enfin que <strong>la</strong> dénutrition augmente cette dépression immunitaire.<br />
Caractéristiques <strong>de</strong> l’infection :<br />
La présence, après quelques jours d’évolution, <strong>de</strong> germes pathogènes au niveau d’une brûlure doit être considérée<br />
comme normale tant qu’il n’existe pas <strong>de</strong> signes d’infection locale ou générale.<br />
L’infection correspond à un débor<strong>de</strong>ment <strong>de</strong>s moyens <strong>de</strong> défense <strong>de</strong> l’organisme par <strong>la</strong> virulence <strong>de</strong>s germes. Elle fait<br />
courir un double risque au brûlé : local (arrêt <strong>de</strong> <strong>la</strong> cicatrisation, approfondissement <strong>de</strong>s lésions, échec <strong>de</strong>s greffes) et<br />
général (septicémies).<br />
Les germes les plus souvent en cause dans ces complications septiques sont Pseudomonas æruginosa et Staphylococcus<br />
aureus.<br />
L’infection peut avoir une origine endogène, à partir <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau ou du tube digestif, ou exogène, par contamination à<br />
partir <strong>de</strong> l’air, <strong>de</strong>s objets ou du personnel soignant. La <strong>gravité</strong> <strong>de</strong> ces infections exogènes contractées à l’hôpital, dites<br />
nosocomiales, justifie pleinement les mesures d’hygiène et d’asepsie draconiennes prises dans les centres <strong>de</strong> brûlés.<br />
PERTURBATIONS RESPIRATOIRES<br />
Elles sont décrites <strong>de</strong> façon spécifique plus loin dans cette revue. Nous rappellerons seulement ici leur gran<strong>de</strong>s<br />
caractéristiques.<br />
L’inha<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> fumées est le plus souvent responsable <strong>de</strong>s perturbations respiratoires précoces. Les fumées émises au<br />
cours d’un incendie peuvent être composées <strong>de</strong> facteurs toxiques, responsables d’intoxications générales (intoxications<br />
au CO et aux cyanures) et <strong>de</strong> produits corrosifs qui entraînent <strong>de</strong>s <strong>brûlures</strong> chimiques <strong>de</strong> <strong>la</strong> muqueuse respiratoire.<br />
Les lésions <strong>de</strong> b<strong>la</strong>st sont plus rares. Il s’agit <strong>de</strong> lésions traumatiques du poumon en rapport, au cours <strong>de</strong>s explosions en<br />
espace clos le plus souvent, avec <strong>la</strong> compression brutale <strong>de</strong> <strong>la</strong> cage thoracique par l’on<strong>de</strong> <strong>de</strong> choc.
6 sur 6<br />
Un œdème pulmonaire <strong>de</strong> surcharge peut survenir au cours <strong>de</strong>s premiers jours comme conséquence <strong>de</strong> l’hypervolémie<br />
secondaire à <strong>la</strong> résorption <strong>de</strong>s liqui<strong>de</strong>s extravasés et <strong>de</strong> <strong>la</strong> baisse <strong>de</strong> <strong>la</strong> pression oncotique.<br />
Enfin les pneumopathies infectieuses sont fréquentes tout au long <strong>de</strong> l’évolution.<br />
AUTRES PERTURBATIONS<br />
Toutes les gran<strong>de</strong>s fonctions peuvent être touchées par les perturbations entraînées par les <strong>brûlures</strong> étendues :<br />
La fonction rénale :<br />
L’insuffisance rénale aiguë précoce, secondaire à un défaut <strong>de</strong> remplissage initial ne se voit pratiquement plus. En<br />
revanche, les <strong>brûlures</strong> électriques ou <strong>de</strong>s <strong>brûlures</strong> thermiques étendues et profon<strong>de</strong>s peuvent entraîner une libération<br />
massive <strong>de</strong> myoglobine qui, précipitant en milieu aci<strong>de</strong>, peut bloquer les tubules rénaux et être ainsi responsable d’une<br />
insuffisance rénale aiguë.<br />
Enfin, au cours <strong>de</strong>s épiso<strong>de</strong>s septiques peuvent survenir <strong>de</strong>s perturbations plus ou moins profon<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong> fonction rénale.<br />
Le tube digestif :<br />
Les ulcères <strong>de</strong> Curling sont <strong>de</strong>venus, avec les progrès <strong>de</strong> <strong>la</strong> réanimation précoce, exceptionnels. Les perturbations les<br />
plus fréquemment rencontrées sont <strong>de</strong>s diarrhées apparaissant le plus souvent au cours <strong>de</strong>s pério<strong>de</strong>s <strong>de</strong> sepsis.<br />
L’hémostase :<br />
Il existe au cours <strong>de</strong>s premiers jours une hypocoagu<strong>la</strong>bilité <strong>de</strong> consommation. Une thrombopénie, proportionnelle à<br />
l’étendue <strong>de</strong>s lésions, apparaît vers le 3ème jour chez tous les patients gravement brûlés.<br />
Ultérieurement existe au contraire une tendance à l’hypercoagu<strong>la</strong>bilité en rapport avec l’importance <strong>de</strong>s processus<br />
inf<strong>la</strong>mmatoires.<br />
CONCLUSIONS<br />
Il peut paraître surprenant qu’une brûlure dont les caractéristiques se résument à <strong>de</strong>ux paramètres parfaitement<br />
quantifiables, <strong>la</strong> surface et <strong>la</strong> profon<strong>de</strong>ur, puisse poser <strong>de</strong> délicats problèmes d’évaluation <strong>de</strong> <strong>gravité</strong>. On peut aussi<br />
avoir <strong>de</strong>s difficultés à comprendre que l’atteinte d’un seul tissu, <strong>de</strong> surcroît superficiel, puisse engendrer une casca<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
perturbations mettant en péril <strong>la</strong> totalité <strong>de</strong>s gran<strong>de</strong>s fonctions <strong>de</strong> l’organisme.<br />
Pourtant l’expérience <strong>de</strong> tous les jours <strong>de</strong> ceux qui prennent en charge les grands brûlés montre que l’évaluation initiale<br />
est fréquemment erronée et peut conduire à une orientation inadéquate dont les conséquences peuvent être dramatiques.<br />
Cette expérience montre aussi qu’à tous les sta<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong> prise en charge, <strong>la</strong> parfaite connaissance <strong>de</strong>s perturbations <strong>de</strong><br />
l’homéostasie et <strong>de</strong> leurs origines est indispensable pour choisir une stratégie thérapeutique adaptée en évitant le piège<br />
<strong>de</strong>s raisonnements physiopathologiques simplistes.<br />
Daniel WASSERMANN<br />
Centre <strong>de</strong>s brûlés - Hôpital Cochin<br />
27, rue du Faubourg Saint Jacques 75014 Paris