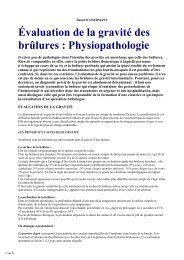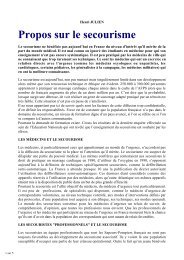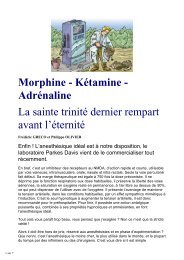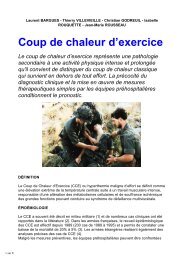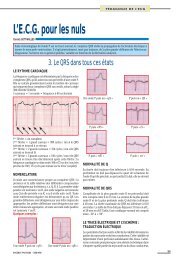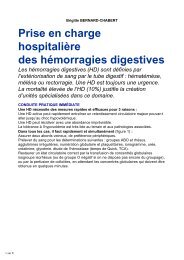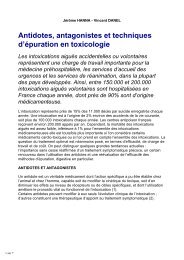Prise en charge initiale des accidents ... - Urgence Pratique
Prise en charge initiale des accidents ... - Urgence Pratique
Prise en charge initiale des accidents ... - Urgence Pratique
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
1 sur 12<br />
Isabelle MOURAND - Didier MILHAUD<br />
<strong>Prise</strong> <strong>en</strong> <strong>charge</strong> <strong>initiale</strong> <strong>des</strong><br />
accid<strong>en</strong>ts vasculaires<br />
cérébraux<br />
Le pronostic <strong>des</strong> Accid<strong>en</strong>ts Vasculaires Cérébraux (AVC) demeure,<br />
actuellem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> France, sévère avec 50.000 décès par an. Parmi les<br />
survivants, plus de la moitié prés<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t <strong>des</strong> séquelles, physiques,<br />
cognitives ou psychologiques.<br />
Les progrès récemm<strong>en</strong>t réalisés dans le diagnostic <strong>des</strong> AVC (scanner, IRM, explorations<br />
ultrasonographiques vasculaires et cardiaques) doiv<strong>en</strong>t conduire les médecins à passer<br />
d'une attitude, bi<strong>en</strong> souv<strong>en</strong>t, att<strong>en</strong>tiste à une attitude active. En effet, il est indisp<strong>en</strong>sable<br />
de porter rapidem<strong>en</strong>t un diagnostic le plus précis possible face à un AVC, quant à sa<br />
nature et à sa cause, afin de mettre <strong>en</strong> œuvre <strong>des</strong> mesures de prise <strong>en</strong> <strong>charge</strong> et de<br />
thérapeutiques générales adaptées et, d'<strong>en</strong>visager la prév<strong>en</strong>tion secondaire.<br />
Ces pati<strong>en</strong>ts doiv<strong>en</strong>t donc être id<strong>en</strong>tifiés, évalués et, acheminés à l'hôpital dans les<br />
meilleures conditions de sécurité et, sans délai.<br />
Huit à 10% <strong>des</strong> AVC ischémiques aigus nécessiteront une hospitalisation dans une unité<br />
de soins int<strong>en</strong>sifs (1).<br />
RAPPELS CLINIQUES<br />
DONNÉES ÉPIDÉMIOLOGIQUES :<br />
Les accid<strong>en</strong>ts vasculaires cérébraux représ<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t actuellem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> France la 3ème cause<br />
de mortalité, après la pathologie cardio-vasculaire et les cancers, avec une incid<strong>en</strong>ce<br />
annuelle de 125.000 nouveaux cas (1,5/100.000/an).<br />
Le risque de récidive après un AVC Ischémique (AVCI) est élevé, surtout la première<br />
année. A 5 ans ce risque est évalué à 30%.<br />
Après un AVCI, la mortalité est doublée par rapport à la population générale. Prés de<br />
50% de ces pati<strong>en</strong>ts décèderont au cours de la première année, le plus souv<strong>en</strong>t de<br />
cause cardio-vasculaire. Un quart garderont un handicap sévère nécessitant une prise<br />
<strong>en</strong> <strong>charge</strong> lourde. Les séquelles secondaires aux infarctus cérébraux représ<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t <strong>en</strong><br />
France la première cause de dép<strong>en</strong>dance.<br />
Le ret<strong>en</strong>tissem<strong>en</strong>t socio-économique <strong>des</strong> AVC est donc considérable d'autant plus que<br />
l'incid<strong>en</strong>ce, <strong>en</strong> régression durant les tr<strong>en</strong>te dernières années, est actuellem<strong>en</strong>t <strong>en</strong><br />
augm<strong>en</strong>tation. Celle-ci est notamm<strong>en</strong>t à corréler au vieillissem<strong>en</strong>t de la population.<br />
Outre les moy<strong>en</strong>s de prév<strong>en</strong>tion primaire et secondaire, il apparaît nécessaire de<br />
développer <strong>des</strong> systèmes de prise <strong>en</strong> <strong>charge</strong> <strong>en</strong> réseaux et/ou <strong>en</strong> filières concernant tout<br />
à la fois l'alerte, le transport primaire, la prise <strong>en</strong> <strong>charge</strong> hospitalière, la rééducation et la<br />
réinsertion. A ce titre les "Stroke c<strong>en</strong>ters" devrai<strong>en</strong>t se développer. En effet, il est
2 sur 12<br />
maint<strong>en</strong>ant bi<strong>en</strong> admis qu'ils permett<strong>en</strong>t une réduction significative de la mortalité, du<br />
taux de mauvais pronostic et de la durée de séjour (2,3).<br />
AVC ISCHÉMIQUE ET HÉMORRAGIQUE : DÉFINITION, GÉNÉRALITÉS :<br />
Selon la définition internationale(4) un AVC correspond à un "déficit neurologique<br />
soudain d'origine vasculaire présumée". Cette définition, apparemm<strong>en</strong>t simple,<br />
implique d'une part une lésion par<strong>en</strong>chymateuse responsable du déficit neurologique, et<br />
d'autre part une lésion vasculaire causale.<br />
Parmi les AVC, 80% sont d'origine ischémique, contre 20% <strong>en</strong> rapport avec une<br />
hémorragie.<br />
Les accid<strong>en</strong>ts ischémiques résult<strong>en</strong>t d'une réduction de l'apport sanguin global ou focal<br />
au par<strong>en</strong>chyme. Selon le profil évolutif, on distingue, les accid<strong>en</strong>ts transitoires, <strong>en</strong><br />
évolution, ou constitués.<br />
Les accid<strong>en</strong>ts hémorragiques inclu<strong>en</strong>t les hémorragies cérébrales (5 à 10%), méningées<br />
(5 à 10%) ou cérébro-méningées, avec ou sans inondation v<strong>en</strong>triculaire.<br />
Les lésions vasculaires responsables intéress<strong>en</strong>t les artères ou, beaucoup moins<br />
fréquemm<strong>en</strong>t, les veines. Pour ces dernières il s'agit le plus souv<strong>en</strong>t d'une thrombose,<br />
pourvoyeuse d'infarctus veineux, volontiers hémorragiques.<br />
Les lésions artérielles responsables d'hémorragies sont ess<strong>en</strong>tiellem<strong>en</strong>t de trois types :<br />
les malformations (anévrismes, angiomes caverneux, fistules artério-veineuses), les<br />
altérations de la paroi artérielle au cours de l'hypert<strong>en</strong>sion artérielle, l'angiopathie<br />
amyloïde (surtout chez le sujet âgé). En fonction de la lésion, le type d'hémorragie sera<br />
différ<strong>en</strong>t.<br />
Les lésions artérielles responsables d'accid<strong>en</strong>ts ischémiques sont presque toujours <strong>en</strong><br />
rapport avec une occlusion de mécanisme embolique (d'origine cardiaque ou artérielle),<br />
thrombotique (avant tout athéromateux) ou lié à une anomalie de la paroi (artérites,<br />
dissections...). Malgré la multiplicité <strong>des</strong> mécanismes <strong>en</strong> cause trois anomalies r<strong>en</strong>d<strong>en</strong>t<br />
compte de plus de 90% <strong>des</strong> ischémies : l'athérosclérose (60 à 70%), l'embolie d'origine<br />
cardiaque (10 à 20%), la lipohyalinose <strong>des</strong> artérioles perforantes responsable <strong>des</strong><br />
accid<strong>en</strong>ts lacunaires.<br />
ZONE DE PÉNOMBRE ISCHÉMIQUE :<br />
Autour de la zone de nécrose ischémique irréversible, territoire d'hypoperfusion sévère<br />
constitué rapidem<strong>en</strong>t, il existe <strong>des</strong> régions dans lesquelles le débit sanguin est moins<br />
diminué, se maint<strong>en</strong>ant à <strong>des</strong> valeurs juste supérieures au seuil de nécrose (10<br />
ml/100g/mn). Dans cette zone les cellules ne fonctionn<strong>en</strong>t plus mais elles ne meur<strong>en</strong>t<br />
pas, c'est la zone dite de pénombre ischémique. Le tissu cérébral peut-être sauvé par la<br />
restauration du flux sanguin. Cette notion a d'importantes implications dans la<br />
thérapeutique à adopter à la phase aiguë de l'AVC. Le premier objectif doit donc être de<br />
restaurer un débit sanguin cérébral normal. Toutefois, la viabilité de cette zone est<br />
limitée et la pénombre ischémique se transforme <strong>en</strong> majorité <strong>en</strong> nécrose dans les 6<br />
premières heures.<br />
PRISE EN CHARGE INITIALE EXTRA-HOSPITALIÈRE<br />
Etablir un diagnostic clinique précoce constitue une étape ess<strong>en</strong>tielle dans la prise <strong>en</strong><br />
<strong>charge</strong> <strong>des</strong> pati<strong>en</strong>ts victimes d'un AVC. Cette évaluation doit permettre de répondre à<br />
différ<strong>en</strong>tes questions d'ordre général et neurologique : un traitem<strong>en</strong>t vital doit-il être mis<br />
<strong>en</strong> route ? La fonction respiratoire et l'état hémodynamique et t<strong>en</strong>sionnel sont-ils<br />
satisfaisants ? Existe-t-il <strong>des</strong> signes d'hypert<strong>en</strong>sion intracrâni<strong>en</strong>ne ? Existe-t-il une<br />
affection sévère sous-jac<strong>en</strong>te ? Quel sont les antécéd<strong>en</strong>ts et les facteurs de risque<br />
vasculaire du pati<strong>en</strong>t ? Quel délai s'est-il écoulé depuis le début <strong>des</strong> symptômes ? Le
3 sur 12<br />
tableau clinique apporte-t-il <strong>des</strong> argum<strong>en</strong>ts <strong>en</strong> faveur d'un AVC ? Quel est son type, le<br />
territoire atteint, l'étiologie suspectée ? Quel est le pronostic et, vers quel type d'unité le<br />
pati<strong>en</strong>t doit-il être adressé ?<br />
Il est préférable que l'évaluation et le transport de ces pati<strong>en</strong>ts soi<strong>en</strong>t réalisés par une<br />
équipe médicale et paramédicale préhospitalière. Cela permet une approche<br />
diagnostique plus précise, la possibilité de recourir à <strong>des</strong> moy<strong>en</strong>s de réanimation et<br />
l'administration plus rapide de thérapeutiques générales ou plus spécifiques (5).<br />
LES MESURES GENERALES :<br />
La prise <strong>en</strong> <strong>charge</strong> <strong>initiale</strong> du pati<strong>en</strong>t doit être focalisée sur <strong>des</strong> mesures d'ordre général<br />
de réanimation que sont la respiration et la circulation.<br />
Evaluation et surveillance respiratoire (5,6) :<br />
Les problèmes respiratoires sont très communém<strong>en</strong>t prés<strong>en</strong>ts chez les pati<strong>en</strong>ts victimes<br />
d'un accid<strong>en</strong>t hémorragique cérébral et/ou méningé, particulièrem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> cas d'altération<br />
de la consci<strong>en</strong>ce. Au cours <strong>des</strong> accid<strong>en</strong>ts ischémiques, la v<strong>en</strong>tilation est habituellem<strong>en</strong>t<br />
respectée sauf si coexist<strong>en</strong>t <strong>des</strong> crises d'épilepsie, ou <strong>en</strong> cas d'infarctus du tronc<br />
cérébral.<br />
Lors de la prise <strong>en</strong> <strong>charge</strong> préhospitalière, il convi<strong>en</strong>t de veiller à établir, puis à maint<strong>en</strong>ir,<br />
une v<strong>en</strong>tilation et une oxygénation adéquates, surtout s'il existe <strong>des</strong> troubles de la<br />
consci<strong>en</strong>ce. En effet, l'hypoxie provoque la formation de métabolites anaérobies et une<br />
déplétion <strong>des</strong> réserves énergétiques dans les tissus lésés, responsables de l'ext<strong>en</strong>sion<br />
lésionnelle. Les causes les plus communes d'hypoxie sont représ<strong>en</strong>tées par l'obstruction<br />
<strong>des</strong> voies aéri<strong>en</strong>nes, l'inhalation pulmonaire, l'hypov<strong>en</strong>tilation et l'atélectasie.<br />
Pour éviter l'obstruction <strong>des</strong> voies respiratoires, notamm<strong>en</strong>t <strong>en</strong> cas d'altération de la<br />
consci<strong>en</strong>ce, le pati<strong>en</strong>t doit être placé <strong>en</strong> position latérale de sécurité, la nuque <strong>en</strong> légère<br />
ext<strong>en</strong>sion et le visage tourné vers le matelas.<br />
Si la v<strong>en</strong>tilation est jugée instable, non satisfaisante ou <strong>en</strong> cas de sécrétions abondantes<br />
non contrôlables, une assistance respiratoire doit être mise <strong>en</strong> route par v<strong>en</strong>tilation au<br />
masque voire, dans les cas plus sévères, par intubation <strong>en</strong>do-trachéale. La mise <strong>en</strong><br />
place d'une sonde naso-gastrique et l'évacuation gastrique sont nécessaires pour<br />
améliorer la v<strong>en</strong>tilation et prév<strong>en</strong>ir l'inhalation. L'exist<strong>en</strong>ce d'une hypoxie, év<strong>en</strong>tuellem<strong>en</strong>t<br />
confirmée par les gaz du sang, justifie une supplém<strong>en</strong>tation <strong>en</strong> oxygène.<br />
A la phase précoce <strong>des</strong> AVC, il existe fréquemm<strong>en</strong>t <strong>des</strong> troubles hydro-électrolytiques, le<br />
plus souv<strong>en</strong>t une déshydratation, notamm<strong>en</strong>t chez les sujets âgés, par défaut d'apport<br />
et/ou perte d'eau et d'électrolytes. Cette déshydratation peut aggraver le processus<br />
ischémique (élévation de la viscosité sanguine et réduction de la pression artérielle) (6).<br />
Le maniem<strong>en</strong>t du sérum glucosé est délicat car, l'hypoglycémie, de même que<br />
l'hyperglycémie, peuv<strong>en</strong>t aggraver la souffrance cérébrale et augm<strong>en</strong>ter la Pression<br />
IntraCrâni<strong>en</strong>ne (PIC) (1). Aussi est-il conseillé de maint<strong>en</strong>ir la glycémie <strong>en</strong>tre 1,40 et 1,80<br />
g/l (1).<br />
Evaluation et surveillance de l'état hémodynamique et t<strong>en</strong>sionel :<br />
Tout pati<strong>en</strong>t susceptible de constituer un AVC doit bénéficier immédiatem<strong>en</strong>t d'une<br />
surveillance de la pression artérielle, de la fréqu<strong>en</strong>ce cardiaque et de l'état<br />
hémodynamique (5,6).<br />
Un collapsus circulatoire est inhabituel <strong>en</strong> cas d'AVC isolé. De même, l'hypot<strong>en</strong>sion<br />
artérielle est peu commune, <strong>en</strong> préhospitalier. Si elle existe-elle doit être traitée<br />
d'urg<strong>en</strong>ce, sous couvert d'une surveillance clinique et biologique rigoureuse (1). La<br />
correction d'une hypovolémie ou la restauration d'une fonction cardiaque normale sont<br />
<strong>des</strong> mesures prioritaires.<br />
L'hypert<strong>en</strong>sion est fréqu<strong>en</strong>te (<strong>en</strong>viron 70%, (1)) à la phase <strong>initiale</strong> <strong>des</strong> AVC. Les<br />
traitem<strong>en</strong>ts anti-hypert<strong>en</strong>seurs influ<strong>en</strong>c<strong>en</strong>t toujours le débit sanguin cérébral. Ils peuv<strong>en</strong>t<br />
le plus souv<strong>en</strong>t être différés, notamm<strong>en</strong>t <strong>en</strong> cas d'ischémie (1). Ainsi, chez la plupart <strong>des</strong>
4 sur 12<br />
pati<strong>en</strong>ts, la pression artérielle ne doit pas être abaissée sauf si la pression sanguine<br />
moy<strong>en</strong>ne dépasse 130 mm de Hg ou si la pression systolique dépasse 220 mm de Hg.<br />
En effet, l'autorégulation de la circulation cérébrale au niveau et autour (pénombre<br />
ischémique) de la zone d'ischémie est altérée et le flux sanguin régional varie<br />
passivem<strong>en</strong>t avec les changem<strong>en</strong>ts de la pression de perfusion. Il <strong>en</strong> résulte, <strong>en</strong> cas de<br />
baisse intempestive de la t<strong>en</strong>sion artérielle, un risque d'ext<strong>en</strong>sion de la lésion cérébrale.<br />
Dans la plupart <strong>des</strong> cas, la pression artérielle se normalise <strong>en</strong> 1 à 2 semaines. Enfin,<br />
l'abaissem<strong>en</strong>t de la pression sanguine au sein de la zone infarcie est délétère, tout<br />
particulièrem<strong>en</strong>t chez les pati<strong>en</strong>ts prés<strong>en</strong>tant <strong>des</strong> chiffres t<strong>en</strong>sionnels élevés de façon<br />
chronique, chez qui l'autorégulation du débit sanguin cérébral est totalem<strong>en</strong>t modifiée.<br />
En urg<strong>en</strong>ce, le choix de l'anti-hypert<strong>en</strong>seur est important (cf tableau n°1). Les ag<strong>en</strong>ts<br />
anti-adrénergique comme la clonidine ou les alpha ou bêta-bloquants de courte durée<br />
d'action comme le labétalol ou l'urapidil, sont préférables. Par contre, il faut éviter le<br />
nitroprussiate de sodium, la dihydralazine et les inhibiteurs calciques dont l'effet<br />
vasodilatateur cérébral t<strong>en</strong>d à augm<strong>en</strong>ter la PIC. De même, on évitera les inhibiteurs de<br />
l'<strong>en</strong>zyme de conversion (1).<br />
Pression systolique < 220<br />
Pression diastolique < 120<br />
Pression diastolique > 120,<br />
Pression systolique légèrem<strong>en</strong>t augm<strong>en</strong>tée lors de<br />
mesures répétées à 15 mn d'intervalle<br />
Pression systolique > 220 ou<br />
diastolique de 110-120 ou<br />
les 2 à <strong>des</strong> mesures répétées<br />
Pas de traitem<strong>en</strong>t<br />
Nitroprussiate de Sodium 10 mg PO<br />
Nifedipine 10 mg SL<br />
Clonidine 0,075 mg SL<br />
Urapidil 12,5 mg IV<br />
Tableau n° 1 : Traitem<strong>en</strong>t anti-hypert<strong>en</strong>seur à la phase aiguë de l'ischémie cérébrale (1).<br />
Pression mesurée <strong>en</strong> mm Hg. IV : intraveineux; PO : per os; SL : sublinguale.<br />
Dépister et lutter contre l'Hypert<strong>en</strong>sion Intra-Crani<strong>en</strong>ne (HIC) (1) :<br />
Des signes d'HIC survi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t, habituellem<strong>en</strong>t, chez <strong>des</strong> pati<strong>en</strong>ts prés<strong>en</strong>tant un AVC<br />
ischémique ou hémorragique hémisphérique ét<strong>en</strong>du. En général, <strong>en</strong> cas d'infarctus<br />
cérébral, l'œdème cytotoxique est retardé, surv<strong>en</strong>ant dans un délai de 24 à 96 heures.<br />
Toutefois, <strong>des</strong> signes d'HTIC peuv<strong>en</strong>t être prés<strong>en</strong>ts à la phase précoce. Ils justifi<strong>en</strong>t, dès<br />
leur auth<strong>en</strong>tification, la mise <strong>en</strong> œuvre de mesures spécifiques.<br />
Les pati<strong>en</strong>ts doiv<strong>en</strong>t avoir la tête positionnée avec une pro-clivité de 30° et ne doiv<strong>en</strong>t<br />
pas être placés <strong>en</strong> décubitus latéral p<strong>en</strong>dant les premières 24 heures. Le niveau de<br />
sédation doit être ajusté, si nécessaire, pour lutter contre la douleur et l'anxiété.<br />
La prise <strong>en</strong> <strong>charge</strong> inclue aussi une hyperv<strong>en</strong>tilation modérée, afin de maint<strong>en</strong>ir la<br />
PaCO2 autour de 35 mm de Hg (elle ne concerne que les pati<strong>en</strong>ts sous assistance<br />
respiratoire). Malheureusem<strong>en</strong>t ses effets sont limités <strong>en</strong>tre 12 et 36 heures au<br />
maximum. Les hautes pressions positives expiratoires doiv<strong>en</strong>t être évitées puisqu'elles<br />
élèv<strong>en</strong>t la PIC.<br />
La perfusion intraveineuse de substances hyperosmotiques créée un gradi<strong>en</strong>t osmotique<br />
via la barrière hémato-<strong>en</strong>céphalique. Pour éviter un rebond à l'arrêt de la perfusion, il est<br />
nécessaire que cette barrière soit intacte. Différ<strong>en</strong>tes substances peuv<strong>en</strong>t être<br />
administrées telles que le glycérol per os à 10% (1,5g/kg) ou le Mannitol intraveineux à<br />
20% (4 fois 100 ml par jour) dans les cas plus sévères, p<strong>en</strong>dant au maximum 48 heures
5 sur 12<br />
ou, <strong>en</strong> situation d'urg<strong>en</strong>ce (1). Att<strong>en</strong>tion, la perfusion de solutés hypo-osmolaires t<strong>en</strong>d à<br />
augm<strong>en</strong>ter l'œdème cérébral et l'HIC (6).<br />
En prés<strong>en</strong>ce d'une HIC rebelle l'utilisation intraveineuse de barbituriques, voir de<br />
thiop<strong>en</strong>tal, peut être justifiée, sous couvert d'une v<strong>en</strong>tilation assistée.<br />
Enfin, une décompression chirurgicale peut-être <strong>en</strong>visagée <strong>en</strong> cas d'AVC hémisphérique<br />
expansif ou d'AVC cérébelleux. L'heure de la chirurgie doit être déterminée précisém<strong>en</strong>t<br />
par une surveillance clinique et scannographique rigoureuse.<br />
Apprécier le terrain et les facteurs de risque vasculaire :<br />
L'interrogatoire du pati<strong>en</strong>t ou de l'<strong>en</strong>tourage doit permettre de connaître les antécéd<strong>en</strong>ts<br />
médico-chirurgicaux du pati<strong>en</strong>t, notamm<strong>en</strong>t cardio-vasculaires et neurologiques, les<br />
facteurs de co-morbidité ainsi que les Facteurs de Risque Vasculaire (FRV).<br />
Globalem<strong>en</strong>t, les FRV se confond<strong>en</strong>t avec ceux de l'athérome.<br />
Trois types peuv<strong>en</strong>t être distingués : non modifiables (âge, sexe, race, climat...),<br />
facteurs classiques (HTA, tabac, diabète, dyslipidémie...). Leur risque relatif est évalué<br />
séparém<strong>en</strong>t <strong>en</strong>tre 1,2 et 2, sauf pour l'HTA (> 4). Pour le tabac le risque attribuable est<br />
très élevé compte t<strong>en</strong>u de la fréqu<strong>en</strong>ce de ce facteur dans la population. Autres facteurs<br />
cliniques (AIT, migraine, diffusion de la maladie athéromateuse), biologiques (dont les<br />
troubles de l'hémostase acquis et congénitaux) et morphologiques ultra-sonographiques<br />
(épaisseur de l'intima, HITS) et radiologiques (infarctus anci<strong>en</strong>s, leucoaraïose).<br />
N.B. :<br />
HITS = High Int<strong>en</strong>sity Transi<strong>en</strong>t Signal, perceptibles <strong>en</strong> doppler trans-crâni<strong>en</strong>, témoignant<br />
du passage d'embolies, le plus souv<strong>en</strong>t "sil<strong>en</strong>cieuses".<br />
Leucoaraïose : raréfaction de la substance blanche, principalem<strong>en</strong>t dans les régions<br />
c<strong>en</strong>trales <strong>des</strong> hémisphères se révélant sous forme d'une hypod<strong>en</strong>sité diffuse, hétérogène,<br />
mal limitée au scanner.<br />
ÉVALUATION NEUROLOGIQUE :<br />
Aujourd'hui, il apparaît nécessaire de reconnaître l'AVC, d'<strong>en</strong> préciser la nature<br />
(ischémique, hémorragique) et la cause, afin d'<strong>en</strong>visager une prise <strong>en</strong> <strong>charge</strong><br />
thérapeutique cohér<strong>en</strong>te.<br />
La suspicion diagnostique de l'AVC est faite le plus souv<strong>en</strong>t par le pati<strong>en</strong>t ou son<br />
<strong>en</strong>tourage. Cep<strong>en</strong>dant l'information du public est souv<strong>en</strong>t limitée. Il ignore que<br />
l'altération de la vigilance, de la parole ou du langage, <strong>des</strong> fonctions motrices ou<br />
s<strong>en</strong>sitives et de la coordination indiqu<strong>en</strong>t souv<strong>en</strong>t un AVC. Des campagnes de<br />
s<strong>en</strong>sibilisation, notamm<strong>en</strong>t par voie audiovisuelle, serai<strong>en</strong>t souhaitables.<br />
Evaluation <strong>des</strong> délais de prise <strong>en</strong> <strong>charge</strong> :<br />
L'appréciation du délai écoulé <strong>en</strong>tre le début <strong>des</strong> symptômes et le mom<strong>en</strong>t de la prise <strong>en</strong><br />
<strong>charge</strong> médicale pré puis hospitalière est importante à considérer. Cela est r<strong>en</strong>du<br />
indisp<strong>en</strong>sable par les essais thérapeutiques pratiqués à la phase précoce <strong>des</strong> AVCI<br />
(neuroprotection, fibrinolyse). En cas d'administration de traitem<strong>en</strong>t fibrinolytique les<br />
délais d'inclusion t<strong>en</strong>d<strong>en</strong>t à être ram<strong>en</strong>és à 3 heures, afin d'améliorer les résultats<br />
cliniques et de réduire les risques de transformations hémorragiques. Tout retard<br />
compromet donc la réponse thérapeutique.<br />
Reconnaître l'AVC et son profil évolutif (4) :<br />
La prés<strong>en</strong>tation clinique varie considérablem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> fonction du siège et de la taille de la<br />
lésion, allant de symptômes très fugaces, parfois négligés par le pati<strong>en</strong>t, au coma<br />
hémiplégique mortel <strong>en</strong> quelques heures.<br />
La principale caractéristique <strong>des</strong> AVC est la brutalité du mode de constitution du déficit<br />
(quelques secon<strong>des</strong> ou minutes, le plus souv<strong>en</strong>t). Le territoire <strong>en</strong> cause, carotidi<strong>en</strong>, avant<br />
tout sylvi<strong>en</strong>, ou vertébro-basialire, modifie l'expression clinique : hémiplégie ou<br />
hémiparésie, hémianesthésie, hémiparesthésie, aphasie, pour le premier, ataxie,
6 sur 12<br />
diplopie, vertige, hémianopsie latérale homonyne, amaurose, ou amblyopie bilatérale<br />
pour le second. Mais, sur les seules données cliniques il peut parfois être difficile de<br />
définir le territoire précis.<br />
L'interrogatoire du sujet ou de l'<strong>en</strong>tourage permettra égalem<strong>en</strong>t de classer l'AVC dans<br />
une <strong>des</strong> trois variétés évolutives. Les accid<strong>en</strong>ts transitoires (AIT) correspond<strong>en</strong>t à <strong>des</strong><br />
déficits neurologiques focalisés, d'installation brutale, régressant sans séquelles <strong>en</strong><br />
moins de 24 h (le plus souv<strong>en</strong>t <strong>en</strong> quelques minutes). Leur importance est capitale car ils<br />
constitu<strong>en</strong>t un signal d'alarme d'infarctus cérébral, avec un risque de récidive de l'ordre<br />
de 5% par an. Un bilan étiologique et une prév<strong>en</strong>tion secondaire doiv<strong>en</strong>t être initiés. Les<br />
accid<strong>en</strong>ts <strong>en</strong> évolution sont définis comme un déficit s'aggravant sur plusieurs heures et<br />
d'une durée supérieure à 24 h. Ils constitu<strong>en</strong>t une urg<strong>en</strong>ce thérapeutique. Enfin, dans<br />
les accid<strong>en</strong>ts constitués le déficit atteint son maximum d'int<strong>en</strong>sité <strong>en</strong> moins d'une heure<br />
et dure plus de 24 h. Leur sévérité est variable : mort, séquelles majeures, régression<br />
<strong>des</strong> symptômes <strong>en</strong> 1 à 3 semaines (accid<strong>en</strong>t rapidem<strong>en</strong>t régressif).<br />
Etablir le diagnostic différ<strong>en</strong>tiel <strong>en</strong>tre AVC ischémique et hémorragique (4) :<br />
Lors de la prise <strong>en</strong> <strong>charge</strong> neurologique <strong>des</strong> AVC, il est ess<strong>en</strong>tiel de savoir rapidem<strong>en</strong>t<br />
s'il s'agit d'un accid<strong>en</strong>t ischémique ou hémorragique. Cette étape diagnostique est<br />
importante puisqu'elle conditionne la prise <strong>en</strong> <strong>charge</strong> thérapeutique ultérieure, qui<br />
s'avère très différ<strong>en</strong>te. Ainsi une hémorragie cérébrale doit impérativem<strong>en</strong>t être éliminée<br />
avant d'instaurer un traitem<strong>en</strong>t anti-coagulant à forte dose. Les argum<strong>en</strong>ts cliniques<br />
classiques (début brutal avec céphalées, détérioration rapide de l'état de consci<strong>en</strong>ce,<br />
abs<strong>en</strong>ce d'antécéd<strong>en</strong>ts d'AIT) peuv<strong>en</strong>t être pris <strong>en</strong> défaut pour les hématomes de petite<br />
taille. Cep<strong>en</strong>dant, différ<strong>en</strong>ts scores cliniques sont proposés (7) ; pour être effectifs ils<br />
doiv<strong>en</strong>t être simples, rapidem<strong>en</strong>t réalisables et reproductibles.<br />
Le score Siriraj (8) comporte 5 items : le niveau de consci<strong>en</strong>ce, <strong>des</strong> vomissem<strong>en</strong>ts, <strong>des</strong><br />
céphalées, la pression sanguine diastolique, <strong>des</strong> marqueurs d'athérome. Un score élevé<br />
est corrélé positivem<strong>en</strong>t avec un accid<strong>en</strong>t hémorragique. L'analyse "bivariable" du score<br />
de Besson (9) qui inclue 8 variables montre que l'hypert<strong>en</strong>sion artérielle et <strong>des</strong><br />
céphalées sont significativem<strong>en</strong>t plus fréqu<strong>en</strong>tes <strong>en</strong> cas d'accid<strong>en</strong>t hémorragique alors<br />
qu'un antécéd<strong>en</strong>t d'AIT, de dyslipidémie et une fibrillation auriculaire à l'admission sont<br />
plus fréqu<strong>en</strong>ts <strong>en</strong> cas d'ischémie.<br />
Le scanner sans contraste est le seul exam<strong>en</strong> permettant de trancher avec certitude. En<br />
cas d'hémorragie il montre un hyperd<strong>en</strong>sité spontanée. Dans l'infarctus au stade initial il<br />
peut-être normal, montrer <strong>des</strong> signes précoces d'ischémie (indiffér<strong>en</strong>ciation corticosous-corticale,<br />
perte <strong>des</strong> contours du noyau l<strong>en</strong>ticulaire, effacem<strong>en</strong>t <strong>des</strong> sillons ...) ou<br />
une hyperd<strong>en</strong>sité vasculaire spontanée, témoignant d'un thrombus frais. Cet exam<strong>en</strong><br />
pertin<strong>en</strong>t doit donc être réalisé systématiquem<strong>en</strong>t et <strong>en</strong> urg<strong>en</strong>ce devant toute suspicion<br />
d'AVC.<br />
La prise <strong>en</strong> <strong>charge</strong> d'un accid<strong>en</strong>t hémorragique dép<strong>en</strong>d de son type, de l'état clinique<br />
du pati<strong>en</strong>t et de son âge. Schématiquem<strong>en</strong>t l'hémorragie méningée justifie une<br />
hospitalisation <strong>en</strong> urg<strong>en</strong>ce <strong>en</strong> neuro-chirurgie <strong>en</strong> vue d'une év<strong>en</strong>tuelle interv<strong>en</strong>tion sur la<br />
malformation <strong>en</strong> cause. Les hémorragies intra-par<strong>en</strong>chymateuses primitives sont très<br />
rarem<strong>en</strong>t opérées d'emblée, <strong>en</strong> dehors toutefois <strong>des</strong> hématomes du cervelet avec<br />
hydrocéphalie aiguë (mise <strong>en</strong> place d'une dérivation et/ou évacuation de l'hématome).<br />
En prés<strong>en</strong>ce d'un accid<strong>en</strong>t ischémique, le diagnostic doit être affiné <strong>en</strong> pr<strong>en</strong>ant <strong>en</strong><br />
considération différ<strong>en</strong>ts élém<strong>en</strong>ts : profil évolutif (cf supra), mécanisme et cause de la<br />
pathologie vasculaire sous-jac<strong>en</strong>te, topographie de l'atteinte par<strong>en</strong>chymateuse. Ces<br />
différ<strong>en</strong>tes caractéristiques doiv<strong>en</strong>t permettre d'ori<strong>en</strong>ter la prise <strong>en</strong> <strong>charge</strong> thérapeutique<br />
immédiate et secondaire.<br />
Classification précoce <strong>des</strong> AVC ischémiques <strong>en</strong> sous-types étiologiques (cf tableau<br />
n°2) :
7 sur 12<br />
Les AVC ischémiques sont <strong>en</strong> relation avec trois principaux mécanismes : l'hypot<strong>en</strong>sion<br />
artérielle systémique, les embolies, la thrombose.<br />
A la phase précoce, au lit du pati<strong>en</strong>t, avant la réalisation d'explorations complém<strong>en</strong>taires,<br />
l'id<strong>en</strong>tification du mécanisme responsable est une étape importante, nécessaire, mais<br />
pas toujours possible, pour ori<strong>en</strong>ter la prise <strong>en</strong> <strong>charge</strong> précoce, l'év<strong>en</strong>tuelle<br />
randomisation dans <strong>des</strong> essais thérapeutiques, puis la prév<strong>en</strong>tion secondaire. Les<br />
facteurs de risque vasculaire peuv<strong>en</strong>t être utiles pour indiquer le sous-type de l'infarctus.<br />
Une revue globale de la littérature permet de ret<strong>en</strong>ir schématiquem<strong>en</strong>t les données<br />
étiologiques suivantes : athérome 30%, lacunes (occlusion <strong>des</strong> petites artères) 20%,<br />
embolie d'origine cardiaque 20%, autres causes (dont dissection, artérite, troubles de<br />
l'hémostase...) 5%, cause inconnue 25% (7). Plusieurs étiologies peuv<strong>en</strong>t égalem<strong>en</strong>t être<br />
<strong>en</strong> cause. L'âge du pati<strong>en</strong>t, le terrain, le groupe ethnique et, les critères diagnostiques<br />
ret<strong>en</strong>us, sont autant de facteurs modifiant la répartition de ces étiologies dans les séries.<br />
Toutefois, la classification étiologique définitive nécessite le respect de différ<strong>en</strong>tes étapes<br />
diagnostiques : exam<strong>en</strong> clinique, TDM ou IRM <strong>en</strong>céphalique, explorations<br />
cardiologiques, explorations ultra-sonographiques <strong>des</strong> vaisseaux cervicaux et<br />
intracrâni<strong>en</strong>s, artériographie, bilan biologique notamm<strong>en</strong>t étude de la coagulation.<br />
ATHEROSCLEROSE DES<br />
GROS VAISSEAUX<br />
(30 %)<br />
EMBOLIE CARDIAQUE<br />
(20 %)<br />
ATTEINTE DES<br />
PETITS VAISSEAUX<br />
(20 %)<br />
AUTRES ETIOLOGIES<br />
(5 %)<br />
CAUSE INDETERMINEE<br />
(25 %)<br />
- Athérosclérose avec sténose : rétrécissem<strong>en</strong>t > ou = 50% ou<br />
occlusion de l'artère extra crâni<strong>en</strong>ne correspondante ou d'un gros<br />
vaisseau intracrâni<strong>en</strong> (MCA, PCA, BA), <strong>en</strong> l'abs<strong>en</strong>ce d'autre<br />
étiologie,<br />
- Athérosclérose sans sténose : plaque ou sténose < 50% de MCA,<br />
PCA ou BA, <strong>en</strong> l'abs<strong>en</strong>ce d'autres étiologies et chez <strong>des</strong> pati<strong>en</strong>ts<br />
porteurs d'au moins 2 <strong>des</strong> 5 facteurs de risque suivants ; age > ou =<br />
50 ans, HTA, diabète, tabac, hypercholéstérolémie.<br />
- Thrombus ou tumeur intracardiaque,<br />
- Sténose mitrale rhumatismale,<br />
- valves prothétique aortique ou mitrale,<br />
- Endocardite,<br />
- Fibrillation auriculaire, maladie de l'oreillette,<br />
- Anévrysme v<strong>en</strong>triculaire gauche ou akinésie après un infarctus du<br />
myocarde,<br />
- infarctus du myocarde < 3 mois,<br />
- Hypokinésie ou dyskinésie cardiaque globale,<br />
- Abs<strong>en</strong>ce d'autres étiologies.<br />
- Infarctus dans le territoire <strong>des</strong> artères perforantes profon<strong>des</strong> chez<br />
un pati<strong>en</strong>t hypert<strong>en</strong>du connu,<br />
- Abs<strong>en</strong>ce d'autres étiologies.<br />
- Dissection artérielle,<br />
- Dysplasie fibro-musculaire,<br />
- Anévrysme sacculaire,<br />
- Malformation artério-veineuse,<br />
- Thrombose veineuse cérébrale,<br />
- Artérite,<br />
- Affections hématologiques sous-jac<strong>en</strong>tes,<br />
- Migraine,<br />
- Autres.<br />
Aucune <strong>des</strong> causes précitées d'infarctus cérébral n'a pu être<br />
auth<strong>en</strong>tifiée.<br />
Tableau n° 2 : Etiologie <strong>des</strong> accid<strong>en</strong>ts ischémiques cérébraux selon le LSR (Lausanne Stroke Registry) (10)
8 sur 12<br />
MCA : artère cérébrale moy<strong>en</strong>ne; PCA : artère cérébrale postérieure; BA : tronc basilaire.<br />
Classification syndromique et topographique (cf tableau n°3) :<br />
Les données de l'exam<strong>en</strong> neurologique peuv<strong>en</strong>t apporter <strong>des</strong> élém<strong>en</strong>ts clefs pour le<br />
diagnostic clinique, étiologique et topographique, bi<strong>en</strong> que seulem<strong>en</strong>t quelques<br />
syndromes cliniques soi<strong>en</strong>t hautem<strong>en</strong>t suggestifs d'une étiologie et d'une localisation<br />
précise. Par ailleurs, il peut y avoir <strong>des</strong> intrications sémiologiques <strong>en</strong>tre les territoires<br />
carotidi<strong>en</strong>s et vertébro-basilaire r<strong>en</strong>dant mal aisée la localisation exacte de l'AVC.<br />
Ces classifications permett<strong>en</strong>t, parfois, d'apporter <strong>des</strong> précisions quant à l'évolution, la<br />
morbidité, la mortalité et le taux de récidive.<br />
Ainsi et, dans le meilleur <strong>des</strong> cas, un diagnostic de nature et de mécanisme peut-être<br />
avancé sur <strong>des</strong> données cliniques dés les premières heures après un AVC, et ce, avant<br />
la réalisation d'explorations complém<strong>en</strong>taires. Cela doit permettre de débuter rapidem<strong>en</strong>t<br />
une prise <strong>en</strong> <strong>charge</strong> appropriée plus spécifique.<br />
SYNDROMES CLINIQUES SYMPTOMES ET SIGNES<br />
Infarctus Lacunaire - Déficit moteur pur<br />
- Déficit s<strong>en</strong>sitif pur<br />
- Déficit moteur/s<strong>en</strong>sitif<br />
- Ataxie hémiparétique<br />
Infarctus Antérieur total - Association de dysfonctionnem<strong>en</strong>ts <strong>des</strong> fonctions cérébrales supérieures<br />
(aphasie, dyscalculie, désordre visuo-spatial),<br />
- Déficit campimétrique latéral homonyme,<br />
- Déficit moteur et/ou s<strong>en</strong>sitif homolatéral pour au moins 2 territoires (face,<br />
bras ou jambe).<br />
Infarctus Antérieur partiel Seulem<strong>en</strong>t 2 ou 3 élém<strong>en</strong>ts du tableau de l'infarctus antérieure global<br />
(atteinte <strong>des</strong> fonctions supérieures seule, ou associé à un déficit<br />
moteur/s<strong>en</strong>sitif plus restrictif que dans l'infarctus lacunaire).<br />
Infarctus Postérieur - Paralysie <strong>des</strong> nerfs crâni<strong>en</strong>s homolatéraux avec un déficit moteur/s<strong>en</strong>sitif<br />
controlatéral,<br />
- Déficit moteur/s<strong>en</strong>sitif bilatéral,<br />
- Atteinte <strong>des</strong> mouvem<strong>en</strong>ts oculaires conjugués,<br />
- Atteinte cérébelleuse sans déficit <strong>des</strong> autres voies longues homolatérales,<br />
- Déficit homonyme isolé du champs visuel.<br />
Tableau N° 3 : Classification topographique clinique <strong>des</strong> infarctus cérébraux (11,12).<br />
PRISE EN CHARGE HOSPITALIÈRE<br />
MODALITES DE PRISE EN CHARGE EN URGENCE :<br />
La prise <strong>en</strong> <strong>charge</strong> de l'AVC, <strong>en</strong> milieu hospitalier, doit être réalisée <strong>en</strong> urg<strong>en</strong>ce et sans<br />
délai selon la procédure suivante (1) : (1) exam<strong>en</strong> neurologique <strong>en</strong> urg<strong>en</strong>ce, (2) exam<strong>en</strong><br />
biologique de routine, (3) scannographie <strong>en</strong>céphalique <strong>en</strong> urg<strong>en</strong>ce, (4) coordination<br />
<strong>en</strong>tre les unités de soins int<strong>en</strong>sifs et l'angiographie, (5) explorations<br />
ultrasonographiques, (6) voie d'abord veineuse, surveillance v<strong>en</strong>tilatoire et générale<br />
(t<strong>en</strong>sionnelle, métabolique, cardiaque).
9 sur 12<br />
Une collaboration étroite est nécessaire <strong>en</strong>tre neurologues, neuro-chirurgi<strong>en</strong>s et neuroradiologues.<br />
Un neurologue et un neuroradiologue prés<strong>en</strong>ts sur place ou d'astreinte 24 heures/24<br />
sont indisp<strong>en</strong>sables pour la bonne prise <strong>en</strong> <strong>charge</strong> <strong>des</strong> AVC à la phase aiguë.<br />
Le plateau technique nécessaire à cette prise <strong>en</strong> <strong>charge</strong> doit donc comporter (1) : un<br />
scanner cérébral accessible 24 heures sur 24, <strong>des</strong> explorations ultrasonores cervicales<br />
et trans-crâni<strong>en</strong>nes réalisables 24 heures/24, la possibilité de réaliser les exam<strong>en</strong>s<br />
biologiques usuels, le monitoring ECG et t<strong>en</strong>sionnel, la possibilité de réaliser, si<br />
nécessaire, <strong>des</strong> explorations angiographiques (angiographie conv<strong>en</strong>tionnelle, ARM,<br />
angioscanner), l'accès à un service de réanimation dans l'hôpital.<br />
En effet, <strong>en</strong>viron 8 à 10% <strong>des</strong> AVCI justifieront une hospitalisation dans une unité de<br />
réanimation (1). Les raisons principales sont d'ordre neurologique ou systémique<br />
représ<strong>en</strong>tées ess<strong>en</strong>tiellem<strong>en</strong>t par l'exist<strong>en</strong>ce de troubles de la consci<strong>en</strong>ce ou de la<br />
vigilance, la progression <strong>des</strong> symptômes déficitaires, une HIC, <strong>des</strong> fluctuations<br />
hémodynamiques. Les facteurs contre-indiquant ce type de prise <strong>en</strong> <strong>charge</strong> comport<strong>en</strong>t<br />
la prés<strong>en</strong>ce d'un déficit neurologique antérieur sévère, d'une pathologie terminale, de<br />
facteurs de co-morbidité ou d'un âge avancé (1).<br />
LES UNITES D'URGENCE NEURO-VASCULAIRES (6) :<br />
L'AVC est une urg<strong>en</strong>ce neurologique. Les Unités d'Urg<strong>en</strong>ces Neurologiques ou "Stroke<br />
C<strong>en</strong>ter" offr<strong>en</strong>t actuellem<strong>en</strong>t le traitem<strong>en</strong>t le plus efficace dans l'AVC aigu <strong>en</strong> terme de<br />
réduction de la mortalité à court et moy<strong>en</strong> terme et, d'amélioration du dev<strong>en</strong>ir <strong>des</strong><br />
pati<strong>en</strong>ts.<br />
En effet, il est actuellem<strong>en</strong>t bi<strong>en</strong> démontré que la prise <strong>en</strong> <strong>charge</strong> précoce <strong>des</strong> AVC<br />
dans les Unités spécialisées permet de diminuer le nombre de décès sans pour autant<br />
augm<strong>en</strong>ter le nombre de sujets gravem<strong>en</strong>t handicapés. Par ailleurs, ces unités<br />
amélior<strong>en</strong>t la qualité de vie <strong>des</strong> survivants <strong>en</strong> diminuant le nombre de pati<strong>en</strong>ts<br />
grabataires, la récupération fonctionnelle est plus rapide, la durée de séjour hospitalier<br />
est réduite ainsi que le nombre de réhospitalisations. Une méta-analyse de 10 essais<br />
randomisés testant l'efficacité de ces unités a montré une réduction de la mortalité de<br />
30% (2,3). Cet effet bénéfique existait alors qu'aucune thérapeutique n'avait <strong>en</strong>core fait la<br />
preuve de son efficacité à la phase aiguë <strong>des</strong> AVC. Différ<strong>en</strong>tes considérations permett<strong>en</strong>t<br />
d'expliquer ces données (précocité et qualité de la prise <strong>en</strong> <strong>charge</strong>, surveillance<br />
spécialisée, rééducation précoce...). Les élém<strong>en</strong>ts ess<strong>en</strong>tiels pour le fonctionnem<strong>en</strong>t de<br />
ces unités sont la qualité de l'équipe pluridisciplinaire et l'intégration dans une filière de<br />
soins <strong>des</strong> AVC.<br />
TRAITEMENT A LA PHASE INITIALE :<br />
Les traitem<strong>en</strong>ts pharmacologiques utilisés à la phase aiguë <strong>des</strong> AVC ischémiques ont<br />
pour but de faciliter la récupération neurologique et fonctionnelle. Diverses voies<br />
d'approche sont utilisées telles que : revascularisation d'artères occluses et reperfusion<br />
du tissu ischémié, limitation du processus occlusif thrombo-embolique, amélioration de<br />
la tolérance <strong>des</strong> cellules cérébrales à l'ischémie, prév<strong>en</strong>tion <strong>des</strong> lésions de reperfusion,<br />
prév<strong>en</strong>tion et traitem<strong>en</strong>t <strong>des</strong> complications, et prév<strong>en</strong>tion de la récidive d'épiso<strong>des</strong><br />
cérébro-vasculaires.<br />
L'héparine (1, 13) :<br />
A la phase aiguë <strong>des</strong> AVC ischémiques, le but de l'anticoagulation par l'héparine est<br />
double : contrôler le phénomène thromboembolique artériel pour prév<strong>en</strong>ir l'ext<strong>en</strong>sion du<br />
thrombus et éviter la récidive, et prév<strong>en</strong>ir les thromboses veineuses.<br />
Bi<strong>en</strong> que l'efficacité de l'héparine ait été bi<strong>en</strong> démontrée dans la prév<strong>en</strong>tion <strong>des</strong><br />
complications thromboemboliques veineuses, il n'existe pas de données rigoureuses qui<br />
souti<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t un tel effet bénéfique sur la récupération neurologique ou les récidives
10 sur 12<br />
précoces dans l'infarctus cérébral constitué. L'étude clinique la plus réc<strong>en</strong>te ayant<br />
évalué l'effet de l'héparine standard (non fractionnée) dans l'AVC, l'International Stroke<br />
Trial(14) n'a pas apporté d'argum<strong>en</strong>ts significatifs <strong>en</strong> faveur de l'anticoagulation, le<br />
bénéfice sur la récidive étant contrebalancé par les accid<strong>en</strong>ts hémorragiques. Il n'existe<br />
pas, actuellem<strong>en</strong>t, de cons<strong>en</strong>sus quant à l'utilisation de l'héparine standard sauf dans le<br />
cas d'embolies à point de départ cardiaque ou <strong>en</strong> cas de dissection artérielle<br />
extracrâni<strong>en</strong>ne.<br />
Les Héparines de Bas Poids Moléculaire (HBPM) sont <strong>des</strong> produits de dégradation de<br />
l'héparine ayant une activité anti-thrombotique plus spécifique, un risque hémorragique<br />
moindre et, une plus grande facilité d'emploi. Les résultats d'un essai clinique réc<strong>en</strong>t,<br />
l'étude Kay, (15) démontrant que la Nadroparine, (Fraxiparine®) à la dose de 4100 UI<br />
anti-Xa 2 fois par jour, réduisait la mortalité et l'incapacité chez les pati<strong>en</strong>ts traités sans<br />
augm<strong>en</strong>tation du risque de transformation hémorragique, sembl<strong>en</strong>t prometteurs mais<br />
demand<strong>en</strong>t à être confirmés par d'autres étu<strong>des</strong> <strong>en</strong> cours. D'autres ag<strong>en</strong>ts<br />
anti-thrombotiques sont égalem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> cours d'investigation (ORG-10172, Hirudine...).<br />
La thrombolyse (1, 13) :<br />
Le but de la thrombolyse est d'obt<strong>en</strong>ir une revascularisation plus précoce. Depuis 1950<br />
de nombreuses étu<strong>des</strong> ont été réalisées utilisant différ<strong>en</strong>ts fibrinolytiques (Urokinase,<br />
Streptokinase, rtPA) par voie systémique ou intra-artérielle. Plusieurs étu<strong>des</strong> ont montré<br />
que la recanalisation était possible.<br />
Aux contre-indications générales <strong>des</strong> traitem<strong>en</strong>ts fibrinolytiques s'ajout<strong>en</strong>t <strong>des</strong> critères<br />
d'exclusion neurologiques parmi lesquels : un antécéd<strong>en</strong>t ischémique réc<strong>en</strong>t, un<br />
accid<strong>en</strong>t hémorragique, <strong>des</strong> signes précoces et ét<strong>en</strong>dus d'infarctus sur le scanner.<br />
Le délai écoulé <strong>en</strong>tre le début <strong>des</strong> symptômes et la mise <strong>en</strong> œuvre du traitem<strong>en</strong>t ne doit<br />
pas dépasser 6 heures et même, peut-être 3 heures au niveau hémisphérique. Pour le<br />
territoire vertébro-basilaire la f<strong>en</strong>être thérapeutique serait plus large ; la durée du coma<br />
semble être le facteur prédictif le plus important.<br />
Les résultats d'étu<strong>des</strong> randomisées, multic<strong>en</strong>triques, contre-placebo, ECASS et NINDS,<br />
ont incité la FDA à autoriser la fibrinolyse à la phase aiguë de l'ischémie cérébrale, dans<br />
les 3 premières heures. Ces résultats suggérai<strong>en</strong>t un bénéfice significatif dans le groupe<br />
traité concernant l'évolution neurologique et fonctionnelle (13).<br />
Les hémorragies intra et extra- crâni<strong>en</strong>nes constitu<strong>en</strong>t les principales complications de la<br />
thrombolyse. D'ailleurs, 2 étu<strong>des</strong> europé<strong>en</strong>nes et 1 étude australi<strong>en</strong>ne, utilisant la<br />
Streptokinase, ont été récemm<strong>en</strong>t, prématurém<strong>en</strong>t interrompues <strong>en</strong> raison d'un taux<br />
excessif d'hémorragies cérébrales (13).<br />
Les résultats d'étu<strong>des</strong> pilotes sur l'Ancrod (fraction purifiée d'un v<strong>en</strong>in de serp<strong>en</strong>t<br />
responsable chez l'homme d'une défibrination) <strong>en</strong>courag<strong>en</strong>t les essais multic<strong>en</strong>triques<br />
actuellem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> cours <strong>en</strong> Europe et aux USA.<br />
La neuro-protection et les autres traitem<strong>en</strong>ts (13) :<br />
Les traitem<strong>en</strong>ts neuroprotecteurs favoris<strong>en</strong>t la survie <strong>des</strong> cellules cérébrales <strong>en</strong><br />
interférant à différ<strong>en</strong>ts niveaux de la cascade physiopathologique qui conduit aux lésions<br />
et à la mort cellulaire par la libération de neuro-médiateurs cytotoxiques.<br />
Les approches thérapeutiques inclu<strong>en</strong>t l'inhibition de la libération du glutamate, les<br />
antagonistes <strong>des</strong> récepteurs NMDA ou <strong>des</strong> canaux calciques, l'augm<strong>en</strong>tation <strong>des</strong> effets<br />
du GABA et, la modulation de la toxicité du monoxide d'azote (NO). Certains résultats<br />
préliminaires sont prometteurs mais nécessit<strong>en</strong>t d'être confirmés par de plus larges<br />
essais cliniques.<br />
Les étu<strong>des</strong> concernant les piégeurs de radicaux libres (Tirilazad) et les inhibiteurs de<br />
l'adhésion <strong>des</strong> leucocytes (anti-ICAM-1) sont négatives.<br />
La prise <strong>en</strong> <strong>charge</strong> globale de ces pati<strong>en</strong>ts inclu aussi, la prév<strong>en</strong>tion <strong>des</strong> complications<br />
<strong>en</strong> milieu hospitalier : les thromboses veineuses profon<strong>des</strong>, l'embolie pulmonaire
11 sur 12<br />
(mobilisation passive <strong>des</strong> membres parétiques, HBPM, surveillance, dépistage), les<br />
saignem<strong>en</strong>ts gastro-intestinaux (anti-aci<strong>des</strong>, anti-histaminiques) (6).<br />
Il est égalem<strong>en</strong>t nécessaire, non pas de mettre <strong>en</strong> route systématiquem<strong>en</strong>t un traitem<strong>en</strong>t<br />
prév<strong>en</strong>tif <strong>des</strong> crises d'épilepsie, mais, de les contrôler le plus rapidem<strong>en</strong>t possible <strong>en</strong> cas<br />
de surv<strong>en</strong>ue afin d'éviter toute aggravation du processus lésionnel consécutif à l'hypoxie<br />
(6).<br />
Enfin, la rééducation est à débuter dès les 2 premiers jours suivants un AVC, y compris<br />
chez les pati<strong>en</strong>ts dans le coma. Cep<strong>en</strong>dant, à la phase aiguë, il faut se méfier de tout ce<br />
qui peut <strong>en</strong>traîner une hypot<strong>en</strong>sion artérielle d'orthostatisme susceptible d'aggraver les<br />
lésions (1).<br />
Beaucoup de traitem<strong>en</strong>ts sont <strong>en</strong>core actuellem<strong>en</strong>t sous évalués. L'association de<br />
molécules ayant <strong>des</strong> sites et <strong>des</strong> mo<strong>des</strong> d'action différ<strong>en</strong>ts est certainem<strong>en</strong>t une voie<br />
d'approche intéressante et d'av<strong>en</strong>ir mais, qui devra être évaluée par <strong>des</strong> étu<strong>des</strong><br />
randomisées. Dans tous les cas, le traitem<strong>en</strong>t pharmacologique, à la phase aiguë de<br />
l'ischémie cérébrale, doit être adapté à chaque pati<strong>en</strong>t après qu'il est été soigneusem<strong>en</strong>t<br />
évalué, principalem<strong>en</strong>t sur le plan physiopathologique.<br />
CONCLUSION<br />
L'effort de classification <strong>des</strong> AVC, pati<strong>en</strong>t par pati<strong>en</strong>t, conditionne l'utilisation optimale<br />
<strong>des</strong> traitem<strong>en</strong>ts efficaces. Il requiert la conjonction d'une démarche clinique rigoureuse<br />
et de l'utilisation raisonnée <strong>des</strong> explorations complém<strong>en</strong>taires. Cela apparaît d'autant<br />
plus nécessaire que se développ<strong>en</strong>t de nouvelles voies thérapeutiques. L'AVC doit donc<br />
être considéré, par tous médecins, comme une urg<strong>en</strong>ce diagnostique et thérapeutique et<br />
traité comme telle. C'est la condition sine qua non pour améliorer la prise <strong>en</strong> <strong>charge</strong><br />
immédiate et secondaire ainsi que le pronostic. n<br />
Docteurs Isabelle MOURAND et Didier MILHAUD<br />
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES<br />
Service de Neurologie A<br />
Hôpital Gui de Chauliac<br />
2, Av<strong>en</strong>ue Bertin Sans - 34295 Montpellier cedex 5<br />
1. - Hacke W. - Int<strong>en</strong>sive care in acute stroke. - Cerebrovasc Dis. - 1997 ;7 (suppl 3) :<br />
18-23.<br />
2. - Langhorne P, Williams BO, Gilchrist W, Howie K. - Do stroke units save lives ? -<br />
Lancet 1993 ;342 : 295-398.<br />
3. - Langhorne P, Williams BO, Gilchrist W, D<strong>en</strong>nis MS, Slattery J. A. - Formal overview<br />
of stroke unit trials. - Rev. Neurol. – 1995 ;23 : 394-398.<br />
4. - Bousser MG. - Classification et ori<strong>en</strong>tation générales du diagnostic. - In : Accid<strong>en</strong>ts<br />
vasculaires cérébraux, Bogousslavsky J, Bousser MG, Mas JL, 1993, 95-103, Doin<br />
éditeurs.<br />
5. - Brott T, Kothari R. - Prehospital managem<strong>en</strong>t of stroke pati<strong>en</strong>ts. – Cerebrovasc. Dis.<br />
1997 ;7 (suppl 3) : 2-4.<br />
6. - Yamaguchi T, Minematsu K, Hasegawa Y. - G<strong>en</strong>eral care in acute stroke. –<br />
Cerebrovasc. Dis. 1997 ;7 (suppl 3) : 12-17.<br />
7 - Castillon V, Bogousslavsky J. Early. - Classification of stroke. – Cerebrovasc. Dis.
12 sur 12<br />
1997 ;7 (suppl 3) : 5-11.<br />
8 - Pungvarin N, Viriyavejakul A, Komontri C. - Siriraj stroke score and validation study to<br />
distinguish suprat<strong>en</strong>torial intracerebral haemorrhage from infarction. - BMJ 1991 ;302 :<br />
1565-1567.<br />
9. - Besson G, Robert C, Hommel M, Perret JP. - Is it clinically possible to distinguish<br />
nonhemorrhagic infarct from hemorrhagic stroke ? – Stroke, 1995 ;26 : 1205-1209.<br />
10. - Bogousslavsky J, Van Melle G, Regli F. - The Lausanne Stroke Registry : Analysis<br />
of 1000 consecutive pati<strong>en</strong>ts with first stroke. – Stroke, 1988 ;19 : 1083-1092.<br />
11. - Ricci S, Celani MG, Righetti E. - Clinical methods for diagnostic confirmation of<br />
stroke subtypes. – Neuroepidemiology, 1994 ;13 : 290-295.<br />
12. - Bamford J, Sandercock P, D<strong>en</strong>nis M, Burn J, Warlow C. - Classification and natural<br />
history of clinical subtypes of cerebral infarction. – Lancet, 1991 ;337 : 1521-1526.<br />
13. - Wahlgr<strong>en</strong> NG. - Pharmacological treatm<strong>en</strong>t of acute stroke. - Cerebrovasc. Dis.<br />
1997 ;7 (suppl 3) : 24-30.<br />
14. - International Stroke Trial Collaborative Group. - The International Stroke Trial (IST) :<br />
a randomised trial of aspirin, subcutaneous heparin, both, or neither among 19 435<br />
pati<strong>en</strong>ts with acute ischaemic stroke. - Lancet 1997 ;349 : 1569-1581.<br />
15. - Kay R, Wong KS, Yu XL, Chan YW, Tsoi TH, Ahuja AT, Chan FL, Fong XY, Law<br />
CO, Wong A et al. - Low-molecular-weight heparin for the treatm<strong>en</strong>t of acute ischemic<br />
stroke. - NEJM, 1995 ;333 (24) : 1588-1593.