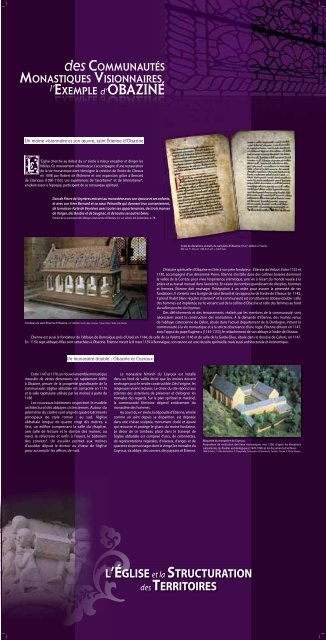Eglise dans le Bas-Limousin au Moyen Age.pdf - Archives ...
Eglise dans le Bas-Limousin au Moyen Age.pdf - Archives ...
Eglise dans le Bas-Limousin au Moyen Age.pdf - Archives ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
des COMMUNAUTÉS<br />
MONASTIQUES VISIONNAIRES,<br />
l’EXEMPLE d’OBAZINE<br />
l’E ’ l’ XE XEMP MP MPLE LE d’ MP<br />
Un moine visionnaire et son œuvre, saint Étienne d’Obazine<br />
L<br />
’Église cherche <strong>au</strong> début du XII e sièc<strong>le</strong> à mieux encadrer et diriger <strong>le</strong>s<br />
de la vie monastique dont témoigne la création de l’ordre de Cîte<strong>au</strong>x<br />
en 1098 par Robert de Mo<strong>le</strong>sme et son expansion grâce à Bernard<br />
de Clairv<strong>au</strong>x (1090-1153). Les expériences de l’ascétisme* et de l’érémitisme*,<br />
Don de Pierre de Veyrières entrant <strong>au</strong> monastère avec son épouse et ses enfants,<br />
et avec son frère Bernard et sa sœur Pétronil<strong>le</strong> qui donnent <strong>le</strong>ur consentement,<br />
de la maison-forte de Veyrières avec toutes ses appartenances, des trois manses<br />
de Varges, des Bordes et de Seugnac, et de toutes ses <strong>au</strong>tres biens.<br />
Extrait de Le cartulaire de l’abbaye cistercienne d’Obazine (XII e -XIII e sièc<strong>le</strong>), éd. B. Barrière, p. 78.<br />
Bibl. nat. Fr., Mss, lat. 1560, fol. 5 et 5 v. © BnF, Paris.<br />
L’ÉGLISE et la STRUCTURATION<br />
des TERRITOIRES<br />
XII e -début XIII e sièc<strong>le</strong>.<br />
L’histoire spirituel<strong>le</strong> d’Obazine est liée à son père fondateur : Étienne de Vielzot. Entre 1125 et<br />
1130, accompagné d’un dénommé Pierre, Étienne s’instal<strong>le</strong> <strong>dans</strong> des collines boisées dominant<br />
la vallée de la Corrèze pour vivre l’expérience érémitique, une vie à l’écart du monde vouée à la<br />
prière et <strong>au</strong> travail manuel <strong>dans</strong> l’<strong>au</strong>stérité. En raison du nombre grandissant de discip<strong>le</strong>s, hommes<br />
il prend l’habit blanc régulier cistercien* et la commun<strong>au</strong>té est constituée en abbaye doub<strong>le</strong> : cel<strong>le</strong><br />
des hommes est implantée sur <strong>le</strong> versant sud de la colline d’Obazine et cel<strong>le</strong> des femmes <strong>au</strong> fond<br />
du vallon proche du Coyroux.<br />
Des défrichements et des terrassements, réalisés par <strong>le</strong>s membres de la commun<strong>au</strong>té, sont<br />
nécessaires avant la construction des monastères. À la demande d’Étienne, des moines venus<br />
de l’abbaye cistercienne de Dalon, située <strong>dans</strong> l’actuel département de la Dordogne, initient la<br />
commun<strong>au</strong>té à la vie monastique et à la stricte observance d’une règ<strong>le</strong>. Étienne obtient en 1147,<br />
avec l’appui du pape Eugène III (1145-1153), <strong>le</strong> rattachement de son abbaye à l’ordre de Cîte<strong>au</strong>x.<br />
Étienne est <strong>au</strong>ssi <strong>le</strong> fondateur de l’abbaye de Bonnaigue près d’Ussel en 1144, de cel<strong>le</strong> de La Va<strong>le</strong>tte en 1146 et de cel<strong>le</strong> de la Garde-Dieu, située <strong>dans</strong> <strong>le</strong> diocèse de Cahors, en 1147.<br />
Tombe<strong>au</strong> de saint Étienne d’Obazine, XIII e sièc<strong>le</strong>.© Arch. dép. Corrèze, 1 Num 2055. Cliché J.-M. Nicita.<br />
Un monastère doub<strong>le</strong> : Obazine et Coyroux<br />
Entre 1147 et 1176, un nouvel ensemb<strong>le</strong> monastique<br />
à Obazine, preuve de la prospérité grandissante de la<br />
commun<strong>au</strong>té. L’église abbatia<strong>le</strong> est consacrée en 1176<br />
et la sal<strong>le</strong> capitulaire utilisée par <strong>le</strong>s moines à partir de<br />
1180<br />
Les nouve<strong>au</strong>x bâtiments respectent <strong>le</strong> modè<strong>le</strong><br />
architectural des abbayes cisterciennes. Autour du<br />
périmètre du cloître sont alignés quatre bâtiments<br />
princip<strong>au</strong>x de sty<strong>le</strong> roman : <strong>au</strong> sud, l’église<br />
abbatia<strong>le</strong> longue de quatre vingt dix mètres, à<br />
l’est, un édifice comprenant la sal<strong>le</strong> du chapitre,<br />
une sal<strong>le</strong> de <strong>le</strong>cture et <strong>le</strong> dortoir des moines, <strong>au</strong><br />
nord, <strong>le</strong> réfectoire et enfin à l’ouest, <strong>le</strong> bâtiment<br />
des convers*. Un escalier permet <strong>au</strong>x moines<br />
d’accéder depuis <strong>le</strong> dortoir <strong>au</strong> chœur de l’église<br />
pour accomplir <strong>le</strong>s offices de nuit.<br />
d’OBAZINE<br />
Le monastère féminin du Coyroux est installé<br />
<strong>dans</strong> un fond de vallée étroit que <strong>le</strong>s moines doivent<br />
aménager pour <strong>le</strong> rendre constructib<strong>le</strong>. Dès l’origine, <strong>le</strong>s<br />
religieuses vivent recluses. Le choix du site répond <strong>au</strong>x<br />
attentes des cisterciens de préserver et d’éloigner <strong>le</strong>s<br />
monia<strong>le</strong>s des regards. Sur <strong>le</strong> plan spirituel et matériel,<br />
la commun<strong>au</strong>té féminine dépend entièrement du<br />
monastère des hommes.<br />
Au cours du XIII e sièc<strong>le</strong>, la dépouil<strong>le</strong> d’Étienne, vénéré<br />
comme un saint depuis sa disparition, est déposée<br />
<strong>dans</strong> une châsse sculptée, monument ciselé et ajouré<br />
qui recouvre et protège <strong>le</strong> gisant du moine fondateur.<br />
Le décor de ce tombe<strong>au</strong> placé <strong>dans</strong> <strong>le</strong> transept de<br />
l’église abbatia<strong>le</strong> est composé d’arcs, de colonnettes,<br />
de représentations végéta<strong>le</strong>s, d’oise<strong>au</strong>x, d’anges et de<br />
quarante six personnages dont la vierge, <strong>le</strong>s monia<strong>le</strong>s du<br />
Coyroux, six abbés, des convers, des paysans et Étienne.<br />
Maquette du monastère de Coyroux.<br />
Proposition de restitution des lieux monastiques vers 1200, d’après <strong>le</strong>s élévations<br />
subsistantes, <strong>le</strong>s fouil<strong>le</strong>s archéologiques (1976-1996) et <strong>le</strong>s documents d’archives.<br />
1998. Échel<strong>le</strong> : 1/130e. Réalisation : P. Ch<strong>au</strong>prade. Conception : B. Barrière, G. Cantié, L. Ferran. © Cliché Harp<strong>au</strong>.