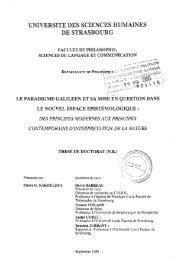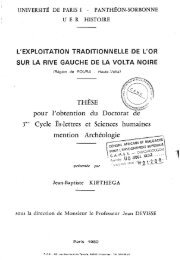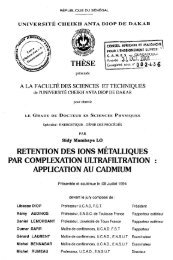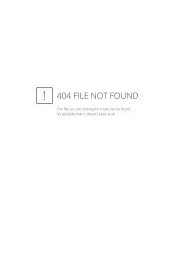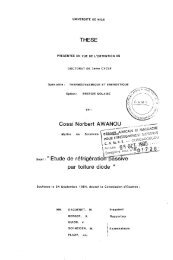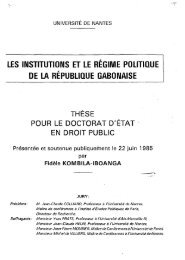Senghor, U Tam'si, Tati Loutard, TiTinga
Senghor, U Tam'si, Tati Loutard, TiTinga
Senghor, U Tam'si, Tati Loutard, TiTinga
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
A tous les miens
- 2 -<br />
ment militant etc, autant de sujets qui préoccupent les générations de<br />
poètes d'hier et d'aujourd'hui.<br />
L'aspect technique répond au souci d'introduire dans cette<br />
étude un côté plus rationnel. Car aujourd'hui toute démarche analytique<br />
doit considérer l 'irruption des terminologies linguistiques et semiolo<br />
giques dans le champ de la critique moderne. une évolution face a laquelle<br />
aucun travail de recherche ne peut rester indifférent.<br />
Nous avons par conséquent, proposé dans la dernière partie<br />
de l'exposé, plus qu'une méthode, une manière de lire le poème nègre de<br />
langue française. Le but avoué est de prouver qu'au-dela du recours a un<br />
certain nombre de "figures de rhétorique", il existe une écriture nègre<br />
avec un vocabulaire, un style, une qualité esthétique qui lui appartien<br />
nent.
PRE MIE R E PAR T l E<br />
CHa l SIR UNE MET HODE<br />
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
- 4 -<br />
l - CHOISIR UNE METHODE<br />
1 - 1 - Le débat<br />
De toute évidence, l'activité poétique est de nos jours<br />
l'apanage de la critique littéraire. Il est vrai que la profusion des re<br />
cherches sur le langage a conduit la linguistique a confisquer en une<br />
certaine manière la poésie. Cet intérêt pour le poème semble avoir pour<br />
raison l'originalité de la création poétique en tant que moyen d'expres<br />
sion et de communication.<br />
Ainsi; l'apparition de terminologies nouvelles et les défi<br />
nitions parfois contradictoires de diverses disciplines comme la linguis<br />
tique ou la sémiologie, conduisent fort logiquement a une redéfinition de<br />
la poétique.<br />
En fait, l'artiste progressivement prisonnier de son rôle<br />
de producteur, n'a d'autre choix que de céder son oeuvre a une critique<br />
soucieuse de bâtir une théorie ou une pratique de lecture textuelle capa<br />
ble d'explorer le langage poétique. Il résulte de cette situation la pro<br />
lifération de terminologies d'une complexité parfois déroutante ou fran<br />
chement rébarbative.<br />
Il faut convenir d'un constat: la destination du poème<br />
n'est pas de servir a l'illustration de théories du langage. (Aucun poète<br />
ne conviendrait de cela). Par conséquent la poésie doit répondre à sa vé<br />
ritable vocation, celle de nous communiquer ce souffle de l'âme dont la<br />
magie nous émerveille.<br />
C'est pourquoi nous avons choisi d'aller à la recherche du<br />
sens a la fois dans le fonctionnement de certains mécanismes du langage,<br />
et dans la recherche subjective des thèmes.
diction.<br />
- 7 -<br />
Cela pourrait être en un sens paradoxal, mais nous avons<br />
choisi de ne pas nous écarter de l lanalyse thématique. Certes au regard ·des mé<br />
thodes de linguistiques structurales ou sémiologiques, le choix de<br />
1<br />
thèmes paraît desuet et bien incomplet! Faut-il pour cela être de l lavis de<br />
Meschonnic lorsqu'il considère l'analyse thématique comme une "criti-<br />
li<br />
qued'Epinal ou une mythologie? A li-inverse, faut-il souscrire à l'opi-<br />
nion de Serge Doubrosky lorsqu'il affirme:<br />
"Le thème, notion clé de la critique moderne, n'est rien<br />
d'autre que la coloration affective de toute expérience<br />
humaine au niveau où elle met en jeu les relations fondamentales<br />
de l'existence. C'est-à-dire la façon particulière<br />
dont chaque homme vit son rapport au monde, aux autres<br />
et à Dieu. Le thème est donc ce choix d'être qui est<br />
au centre de toute "vision du monde", son affirmation et<br />
son développement constituent à la fois le support et<br />
l'armature de toute oeuvre littéraire ou si l'on veut,<br />
son architectonifjue"(l).<br />
1 - 2 - Nécessité du thème<br />
Au-delà du débat autour de l'efficacité de l'analyse théma-<br />
tique dans une étude critique; l'existence des thèmes au sein des oeuvres<br />
littéraires n'est pas à remettre en question. Ainsi, il serait difficile<br />
de contester l'existence du thème de l'ennui ou de la femme dans l'univers<br />
de Baudelaire.<br />
(1) Serge DOUBROSJa Pourquoi la nouvelle cY'itiqJ-f.e s p. 121·
- 8 -<br />
Ce qui est important dans la réflexion de Doubrosky, c'est<br />
l'idée d'une "vision du monde" représentée par le thème. A travers 1'ana-<br />
lyse thématique on peut aisément appréhender la manière dont un auteur<br />
donné perçoit une réalité ou un élément imaginaire par le jeu de la cons-<br />
cience. Cette perspective d'étude textuelle représentée par le thème a<br />
séduit des critiques comme Bachelard, Georges Poulet, Starobinski, ou en-<br />
core Jean-Pierre Richard, Ainsi, dans son ouvrage intitulé Poésie et pro-<br />
.<br />
fondeur, Jean-Pierre Richard analyse dans le moindre détail quatre poètes<br />
français. Tout d'abord l'itinéraire géographique de Gérard de Nerval nous<br />
fait découvrir l'Orient magique et la Grèce aux multiples trésors. Puis<br />
nous pénétrons dans l'univers baude1airien ; celui d'une âme en lutte<br />
avec ses incertitudes et ses angoisses mais toujours en quête du bonheur.<br />
Verlaine est un être passif. Les mots de ses poèmes diffusent une langueur<br />
qui nous installe dans l'indifférence. A l'opposé de cette impression, la<br />
poésie de Rimbaud est d'une créativité ex ubérante. Tout y explose dans<br />
'-'<br />
une symphonie de sons, de couleurs, et de sensations. Le moi de Rimbaud<br />
est générateur d'énergie; même lorsqu'il parait stagner dans le désir<br />
érotique ou sexuel de l'adolescence. Au terme de son étude, Jean-Pierre<br />
Richard nous fait découvrir quatre poètes aux personnalités tout à fait<br />
dissemblables.<br />
Jean-Pierre Richard précisait lui-même la finalité de sa<br />
démarche dans son avant-propos<br />
"A propos de ces quatre poètes, j'ai essayé de retrouver<br />
et de décrire l'intention fondamentale, le projet qui<br />
domine leur aventure. Ce projet, j'ai cherché à le saisir<br />
à son niveau le plus élémentaire, celui où il s'affirme
- 21 -<br />
a) - Les tr.opes par correspondance ou métonymies<br />
b) - Les tropes par ressemblance ou métaphores<br />
c) Les tropes par connexion ou synecdoques.<br />
Enfin il existe une autre catégorie de tropes dans laquelle<br />
nous retrouvons ces différents modes de relation: ce sont les syllepses<br />
ou tropes mixtes. Sans nous étendre davantage nous retiendrons les défi-<br />
nitions proposées par Fontanier. Dans ces conditions, les métonymies<br />
"<br />
consistent dans la désignation d'un objet qui fait comme lui un<br />
tout absolument à part, mais qui lui doit ou à qui il doit lui-même plus<br />
s<br />
."1'<br />
ou moins ou pour son eXltence, ou pour sa manière d'être" (1).<br />
Les métaphores présentent "... une idée sous le signe d'une<br />
autre idée plus frappante ou plus connue qui, ailleurs ne tient à la<br />
première par aucun lien que celui d'une certaine conformité ou analo-<br />
gie" (2).<br />
Les synecdoques "consistent dans la désignation d'un objet<br />
par le nom d'un autre objet avec lequel il forme un ensemble, un tout<br />
physique, ou métaphorique. L'existence ou l'idée de l'un se trouvant com-<br />
prise dans l'autre" (3).<br />
A l'inverse de la métaphore qui reste tout à fait unique,<br />
il existe plusieurs genres de synecdoques désignés selon le mode de fonc-<br />
tionnement. Par exemple les synecdoques de la manière, du tout, du genre,<br />
du nombre etc.<br />
(l) Pierre FONTANIER [,es figui'es du diecoure, p. 79.<br />
(2) Ibid. 3 p. 99·<br />
( 3) Ibid. 3 p. 89.
- 28 -<br />
tiennent. La "parole" africaine de tradition orale, "parole vivante" liée<br />
au souffle de la vie, réussit a s'incarner dans le verbe français. Aussi,<br />
certains poètes modernes comme <strong>Senghor</strong> ou Pacéré s'inspirent-ils de la<br />
tradition des "CJriots" , ces artistes traditionnels aux multiples talents<br />
que l'on compare très souvent aux troubadours des sociétés médiévales<br />
occidentales.<br />
Images et rythme sont donc les éléments fondamentaux de la<br />
poésie négro-africaine d'expression française. Ces deux aspects sont les<br />
pri nc i paux générateurs de l'uni vers poéti que négro-afri cai n. Il s lui<br />
donnent toute son originalité et contribuent à établir sa différence<br />
avec la poésie française.<br />
1 - 6 - L'image dans la poésie négra-africaine francophone<br />
1 - 6 - 1 - L'image analogique<br />
L'image est un élément essentiel de la poésie moderne con-<br />
temporaine. En matière de poésie française, la "révolution surréaliste"<br />
/<br />
a contribué à une remise en cause et une reflexion autour de l a qualité<br />
de l'image et de sa fonction poétique. A ce titre, les poèmes de Breton,<br />
Eluard, ou Aragon sont de véritables explosions d'images. Selon <strong>Senghor</strong>,<br />
c'est Arthur Rimbaud qui le premier affirmera qu'il est un nègre. Il pro<br />
clamait ainsi l'aptitude du poète nègre a la spontanéité, à une intuition<br />
poétique, et pourquoi pas à l'imagination pure.?<br />
En Afrique noire, l'oeuvre d'art est un acte de création<br />
magico-religieux. Elle est le témoignage de la présence de l'être humain
- 32 -<br />
Pour les poètes nègres qui ont choisi l'écriture et l'usage<br />
du français, cet héritage des langues et de la culture africaines fe<br />
raient défaut s'ils n'avaient su modèler le français à leur façon. Aux<br />
techniques propres à la poésie occidentale, ils associeront les ressources<br />
de la littérature nègre. Bien plus, ils y ajoutent une manière d'être,<br />
une vision du monde propres aux cultures africaines. De l'avis d'Hubert<br />
de Leusse :<br />
" Ses yeux 'perce-murailles ' à travers le signe atteignent<br />
les sens profond, dépassent l'apparence pour fondre<br />
la réalité, le 'muntu l des Bantous. Il ne s'arrête qu'au<br />
surréel.<br />
Tout être est 'animé' d'un souffle vital, une force<br />
spirituelle d'un caractère propre 'animé', la montagne,<br />
la caverne, le rocher, le lac. D'où le nom d'animisme<br />
souvent donné à cette ontologie essentiellement dynamique"<br />
(1).<br />
La poésie nègre est dans son essence surréelle. L'art, l'ex-<br />
pression religieuse, le verbe indispensable à la notion de "parole vi-<br />
vante" sont parties intégrantes de l'organisation du monde. Telle est 10<br />
qualité de 1limage négro-africaine. Le poète par le jeu de 1'écriture et<br />
l'utilisation de la langue française, tente de restituer en quelque sorte<br />
la "parole" originelle.<br />
1 - 6 - 3 - L'image et le mot<br />
L'.image doit surprendre•..Toute sa force réside dans l'effet<br />
de surprise qu'elle réussit à créer dans l'espace du poème. L'élabora-<br />
(1) Hubert DT'; LEUSSE Léopnld SédaY' SENGHOR, l'AfY"z:cœz:n, p. 203.
- 33 -<br />
tion de l'image poétique conune "crqani sme" littéraire autonome ne peut<br />
être réalisée sans l'utilisation de techniques poétiques précises. Nous<br />
devons par conséquent envisager l'image comme un organisme complexe dont<br />
la présence est indispensable à toute construction poétique. Il ne reut<br />
exister de poèmes sans images. Mais il est malgré tout difficile d'établir<br />
une typologie de l'image selon le mode de fonctionnement, tant sa nature<br />
et ses fonctions changent d'un poème à l'autre, d'un auteur à l'autre.<br />
On peut cependant se limiter à une classification thématique qui à notre<br />
avis serait tout à fait dépourvue d'intérêt. L'image est vivante. Elle est<br />
le reflet d'une perception du monde d'un auteur ou d'une culture donnée.<br />
Or la langue est le principal support de la culture. Le caractère princi<br />
pal de l'image négra-africaine d'expression française est l'adoption de<br />
mots africains.<br />
En effet, l'utilisation du français par les poètes nègres<br />
nia pas entravé l'introduction dans les roèmes écrits de mots apparte<br />
nant aux langues africaines. Chez les poètes de la négritude, le recours<br />
à ce type de vocabulaire résulte du souci de créer une poésie authentique<br />
fidèle à l'objectif du mouvement qui, rappelons-le, était la défense de<br />
toutes les valeurs du monde noir.<br />
Pour le lecteur occidental peu averti, l'espace poétique<br />
négro-africain est pittoresque et souvent difficile à saisir. Les mots<br />
IIkora ll<br />
, "balafong", "sopé" n'appartiennent pas à l'univers sensible de<br />
l'occident. A l'inverse, ils sont familiers pour le nègre d'Afrique.<br />
L'usage d'un vocabulaire directement issu des langues africaines sans<br />
aucune traduction ajoute au poème une autre connotation. Cela modifie
- 35 -<br />
poésie de Pacéré Titinga, un même mot peut avoir plusieurs sens. Ainsi,<br />
"tiraogo" provient de "tiga" (fétiche) et de "raogo" (le mâle) ; or dans<br />
la vie quotidienne, "tiga" désigne l'arbre. Même pour le moréphone, une<br />
parfaite maitrise de la lanque ne suffit oas. Il faut une initiation au<br />
- ,<br />
symbolisme magico-religieux ordonnant la cosmogonie mossi. "Tiga" désigne<br />
â la fois deux images: l'arbre et le fétiche.<br />
1 - 7 - Le rythme dans la poésie négro-africaine. francophone<br />
1 - 7 - 1 - Rythme et tradition orale<br />
Le rythme est une constante de la vie du négro-africain. Il<br />
imprègne l'ensemble de la vie artistique. On le retrouve aussi bien dans<br />
la musique, la danse, que dans la sculpture. Mais le rythme est aussi lié<br />
â la poésie orale. Nous le soulignions déjâ, le nègre est toujours â<br />
l'écoute de lui-même et des vibrations du monde. Il y a chez les poètes<br />
traditionnels, les "griots" un véritable don du rythme. Les chants consi<br />
dérés souvent comme des poèmes oraux nécessitent dans leur exécution,<br />
association des battements de mains,l 'alternance des voix, ou encore<br />
l'intervention d'instruments divers comme: korâs, balafongs ou tambours.<br />
Le monde occidental reconnait volontiers la primauté du<br />
rythme chez le négro-africain. Mais on a longtemps éprouvé quelque embar<br />
ras face à l'analyse exclusivement technique du poème de tradition orale.<br />
Notre tâche n'est pas de combler cette lacune, puisque nous portons notre<br />
intérêt autour du poème écrit de langue française. Pourtant, même dans<br />
les limites de cette question, les recherches sont difficiles. Si les<br />
poètes modernes définissent volontiers le caractère de leurs oeuvres, ils
- 38 -<br />
formelles du poète burkinabé sont difficiles à cerner. En particulier en<br />
ce qui concerne la mise en oeuvre du rythme poétique (même si Pacéré<br />
nous donne quelques précisions en avouant qu'il s'inspire du chant tra<br />
ditionnel mossi).. Du reste "1 a poésie des griots" n'est pas une traduc<br />
tion "littérale" mais une tentative d'adaptation qui dépasse une simple<br />
transcription. Dans cette mesure l'on peut émettre l'hypothèse selori la<br />
quelle, le seul fonctionnement du rythme réside dans la disposition typo<br />
graphique alternée des "couplets". Cette manière d'occuper la page carac<br />
térise l'écriture de Fréderic Pacéré Titinga. Nous verrons plus loin la<br />
raison de ce choix formel.<br />
1 - 7 - 2 - Le rythme dans la poésie négro-africaine écrite<br />
de langue française<br />
1 - 7 - 2 - 1 - Le _choi x typographi que<br />
L'acte de l'écriture s'exerce le plus souvent sur le<br />
support de la page. Ecrire, c'est ordonner l'espace de la page selon<br />
les lois de la syntaxe. C'est aussi tenter de restituer avec fidélité<br />
le caractère oral d'une langue donnée. A ce titre, même les espaces<br />
libres laissés dans le texte participent activement à l'ordre de la page.<br />
Ce linon dit" textuel est aussi une signification. C'est même ce qui<br />
permet le plus souvent de classifier le genre littéraire auquel nous<br />
entendons porter notre intérêt. L'espace textuel théâtral est différent<br />
de celui du roman, de la poésie ou du simple texte d'information de la<br />
page de journal.
- 42 -<br />
Pour créer ce que <strong>Senghor</strong> qualifie de "s'ding" l'écriture<br />
doit se laisser guider par l'émotion. A la lecture des poèmes nègres, le<br />
rythme est semblable au cours d'un fleuve. Tantôt il s'écoule, lent et<br />
majestueux, puis se prend de folie en de brutales accélérations avant de<br />
se briser sur llécueil de mots isolés, de mots durs comme des rochers. La<br />
répétition est presque toujours présente. Le mot ou la phrase leit motiv<br />
v<br />
sont de véritables refrains dans la structure phono-sémantique du poème.<br />
1 - 7 - 2 - 3 - Le mot et la phrase: deux éléments rythmiques<br />
La technique la plus évidente de la répétition est le re-<br />
tour de mots ou de phrases identiques contribuant a l'instauration d'un<br />
rythme. Très souvent l'inspiration naît à partir d'un thème-clé qui sera<br />
répété en {cho dans le poème. Le retour régulier d'un même segment séman<br />
tique et formel à des intervalles plus ou moins longs crée dans l'esprit<br />
du lecteur une sorte de fascination. De la constance de la répétition naît<br />
le rythme. La rhétorique a tenté du reste d'inventorier les différentes<br />
répétitions. Citons pour exemples l'anaphore, l'antanaclase, l'allité-<br />
ration, l'assonance... Si dans la poésie occidentale ces éléments ne sont<br />
pas du tout pertinents, dans la structure rythmique, dans la poésie négro<br />
africaine écrite francophone, l'utilisation du décompte syllabique n'est<br />
retenu que slil participe activement à la structure rythmique de l'en<br />
semble du poème. Cela demande au poète la volonté de créer un fonctionne<br />
ment du rythme fondé effectivement sur le nombre de syllabes, soit par<br />
la régularité, soit par l'alternance de parisyllabiques et d'imparisyl<br />
labiques, soit encore par le retour de syllabes brèves et longues. Si la
- 47 -<br />
poèmes. Certains poèmes de <strong>Senghor</strong> semblent en être totalement dépourvus.<br />
Il en est de même dans les oeuvres de Tchicaya, Pacéré ou <strong>Tati</strong> <strong>Loutard</strong>.<br />
Le rythme n'est révélé que par l'observation attentive des structures<br />
phono-sémantiques de chaque poème.<br />
1 - 7 - 3 - Rythme, musique et poésie traditionnelle orale<br />
Rythme et musique sont étroitement liés dans le jeu de la<br />
création poétique. <strong>Senghor</strong> considère ses poèmes comme de véritables par<br />
titions musicales. Il conseille à dessein l'utilisation d'un accompagne-<br />
ment musical pendant les auditions de ses poèmes. Ainsi le poème<br />
"L'absente" s'accompagne pendant sa lecture de trois kôras et d'un bala-<br />
fong. Tandis que "Mort à la princesse" a recours au tam-tam funèbre.<br />
En ce qui concerne une analyse du rythme, il est impossible<br />
de retenir le support musical des poèmes. D'abord pour une raison évi-<br />
dente, tous les poètes ne donnent pas d'indications instrumentales pour<br />
l'exécution de leurs oeuvres. Ensuite l'intervention d'une section ins-<br />
trumentale est parfois si complexe qu'elle demanderait la présence d'un<br />
orchestre entier.<br />
"La grande 1eçon que j'ai retenue de Marône, 1a poétesse<br />
de mon village, est que la poésie est chant sinon musique,<br />
et ce n'est pas là un cliché littéraire. Le poème est une<br />
partition de jazz dont l'exécution est aussi importante<br />
que le texte.<br />
D'un recueil à l'autre, cette idée s'est fortifiée en moi<br />
et lorsqu'en tête d'un poème, je donne une indication ins-
o EUX lEM E PAR T l E<br />
LES THE MES DOM INA N T S<br />
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-:-=-=-=-=-=-=-=-:-=-=-
- 58 -<br />
Pourquoi porter le choix de notre étude vers un genre 1it-<br />
téraire qui somme toute connait de nos jours, même dans le monde occi-<br />
denta 11 une "crise" ? Parce que nous pensons qu'en dépit de l'attitude<br />
du public, la poésie n'est pas un art littéraire désuet ou moribond. Il<br />
est édifiant pour nous de constater l'éclosion de talents nouveaux<br />
comme le Togolais Yves Emmanuel Dogbé, le Camerounais Paul Dakego, le<br />
Mauricien Edouard Maunick, le Burkinabé Fréderic Pacéré Titinga. L'écri<br />
ture poétique aujourd'hui offre à la fois des thèmes et des modes d'ex<br />
pression originaux qui sont la preuve certaine d'une évolution de la<br />
poésie. On peut globalement distinguer trois générations de poètes depuis<br />
la naissance de cette littérature:<br />
La première génération, celle qui a forgé la littérature<br />
négra-africaine écrite de langue française en lançant le cri "négritude"<br />
regroupe en son sein <strong>Senghor</strong>, Césaire, Dadié ... Les grands thèmes sont:<br />
l'émancipation politique, la revendication raciale, le retour aux sources<br />
de la civilisation nègre dans ce qu'elle représente comme valeur cultu<br />
relle.<br />
L'action politique accompagne toujours la création des<br />
oeuvres de cette période. Aimé Césaire ne cessera de dénoncer le colo<br />
nialisme à travers ses écrits; tandis que Léopold Sédar <strong>Senghor</strong> affirme<br />
quant à lui la nécessité d'assimiler sans être assimilé et travaille à<br />
l'avènement d'une civilisation universelle où le nègre apporterait aussi<br />
sa contribution.<br />
Cette période, sans doute l'une des plus fécondes. de la
- 59 -<br />
poésie, oriente son combat culturel autour de l'idée d'une diaspora<br />
noire opprimée en reconnaissant la réalité d'une exploitation fondée sur<br />
le racisme du blanc à l'égard du noir. En conséquence l'écriture exalte<br />
les valeurs du monde noir. <strong>Senghor</strong> écrit alors ses pages fameuses célé<br />
brant la beauté de la femme ou encore les charmes de la terre natale du<br />
Sine.<br />
Cependant en mil neuf cent soixante, avec l'attribution<br />
des indépendances africaines, le brasier de la négritude s'éteint déjà<br />
et l'on assiste à l'éveil des grands romanciers. Cela n'empêche pas<br />
<strong>Senghor</strong> de publier en 1960 "Nocturnes" mais il faudra attendre 1973<br />
pour la publication des "Lettres d'hivernage" ; treize années pendant<br />
lesquelles l'une des grandes voix de la poésie africaine francophone<br />
restera muette.<br />
La deuxième génération de poètes a pour chef de file le<br />
Congolais Tchicaya U Tam' si. On retrouve encore dans beaucoup d'oeuvres<br />
les thèmes fondamentaux de la négritude, inais la poésie décrit des<br />
expériences personnelles 00 explose la douleur de vivre. Ce thème<br />
rimbaldien ou verlanien séduit pourtant les aînés. <strong>Senghor</strong> écrit au<br />
sujet de Tchicaya:<br />
"Voilà vingt ans que je lis des poèmes de jeunes nègres ...<br />
Que de papiers, que de cris vengeurs, que d'éloquence!<br />
(.:..7 Mais en mille neuf cent cinquante cinq "Le mauvais<br />
sang" de Tchicaya m'avait frappé, m'était entré dans la<br />
chair jusqu'au coeur.<br />
Il avait le caractère insolite du message. Et plus encore
- 62 -<br />
L'inspiration poétique aujourd'hui se refuse à puiser son dynamisme dans<br />
un mouvement politico-littéraire semblable à celui de la "négritude". Les<br />
jeunes poètes veulent chanter l'amour. la joie de vivre. Ils veulent<br />
décrire l'angoisse de l'exil. la difficulté de vivre libre.<br />
Certains d'entre eux comme Fréderic Pacéré Titinga s'ins<br />
pirent résolument de la tradition. Sans doute sont-ils conscients de<br />
la nécessité de préserver même par l'écriture une parole poétique menacée<br />
par les assauts de la modernité?<br />
Cependant, cette jeune génération semble avoir beaucoup<br />
moins de célébrité que leurs aînés de l'époque de la "nêqri tude". A<br />
l'exception de quelques succès de librairie suscités par l'obtention de<br />
prix littéraires, les oeuvres de la troisième génération se heurtent à<br />
l'engouement du public africain pour la nouvelle. le roman ou le théâtre.<br />
Conscients de cette difficulté, ils affirment de plus en plus la néces<br />
sité de restituer à la poésie négro-africaine son caractère oral sans<br />
toutefois proposer les moyens d'y parvenir.<br />
En dépit de tous ces obstacles. les grandes voix de la<br />
négritude sont toujours vivantes. A cela il faut ajouter l'éclosion de<br />
nouveaux talents.qui, après quelque labeur. affirmeront la qualité de<br />
leur art. De plus, la poésie nègre d'expression française possède<br />
encore parmi ses défenseurs, les plus fervents des écrivains comme<br />
Léopold Sédar <strong>Senghor</strong>, Tchicaya U'Tam si, Aimé Césaire... Peut-être<br />
gardent-ils dans le secret de leurs tiroirs quelques manuscrits suscep<br />
tibles de provoquer une nouvelle passion du public pour la poésie, même
- 63 -<br />
si certains d'entre eux affirment avoir irrémédiablement abandonné le<br />
métier d'écrivain.<br />
2 - 2 - Poésie des origines et terres d'exils<br />
Tout d'abord, une remarque s'impose. Un travail de recher-<br />
che doit s'efforcer de préciser ses objectifs et ses moyens d'investiga-<br />
tion. C'est en partie pour cette raison que nous avons choisi de limiter<br />
notre étude à quatre auteurs. Ceci ne signifie pas que nous\ écarterons<br />
d'emblée tout exemple emprunté à un auteur négro-africain de langue fran-<br />
çaise qui n'appartiendrait pas à notre corpus. Mais l'essentiel de<br />
l'étude portera sur les oeuvres de <strong>Senghor</strong>, Tchicaya, <strong>Tati</strong>-<strong>Loutard</strong> et<br />
Pacéré Titinga. Cette précision semble à notre avis nécessaire car elle<br />
nous évite de tomber dans le piège d'une étude trop restrictive.<br />
Voilà donc réunis quatre auteurs différents quant à la<br />
personnalité, .l e style d'écriture, mais si proches par l'inspiration.<br />
<strong>Senghor</strong> ct Pacéré sont tous deux originaires de l'ouest africain. Ils<br />
sont les héritiers des griots; les maîtres de la parole.<br />
U <strong>Tam'si</strong> et <strong>Tati</strong>-<strong>Loutard</strong> ont les mêmes "Racines congolaises"<br />
Chaque poète, au-delà de ce qui lui est propre, puise l' ori gi nalité de<br />
son inspiration dans l'environnement culturel auquel il appartient. En<br />
témoignent les mots sérères, wolofs, moré,"qu'ils emploient volontiers<br />
dans leurs poèmes. L'expression poétique reste étroitement liée à un<br />
espace culturel et géographique tant il est vrai que: "L'artiste, poète,<br />
peintre, musicien, crée des formes jamais vues, jamais entendues, c'est<br />
r ten<br />
exprimant cetaines idées en s'appuyant sur certaines techniques qui
- 67 -<br />
La poésie négro-africaine d'expression française forge<br />
son art au contact de la nature. Les forces naturelles: vents, soleil,<br />
pluie, feu, lumière, sont toujours célébrées dans les poèmes. Tous les<br />
éléments de la cosmogonie traditionnelle y sont représentés.<br />
L'espace poétique ne donne jamais lieu à l'expression<br />
d'un patriotisme étroit. On y affirme plutôt un humanisme profond mêlé<br />
d'un attachement aux cultures originelles africaines. Le destin a conduit<br />
très souvent les poètes nègres vers des contrées étrangères à l'Afrique. Aussi<br />
t8t apparaissent dans chacune des écritures quelquefois dissernolables<br />
quant à l'inspiration, les thèmes de l'ennui, de la séparation ou de la<br />
douleur de vivre. Nul mieux que <strong>Senghor</strong> n'a décrit à travers les lignes<br />
de ses poèmes, le drame du deséquilibre entre deux mondes différents:<br />
l'Occident et l'Afrique noire.<br />
2 - 2 - 1 - Le royaume d'enfance de <strong>Senghor</strong><br />
"J'aime la France" confie volontiers l'auteur d'IlHosties<br />
noires".Mais cet aveu ne l'empêche nullement d'apprécier et d'exalter<br />
les charmes de Joal et du Sine. Ce paradoxe trouve difficilement explica-<br />
tion. Peut-être faut-il chercher une réponse au royaume de l'enfance dont<br />
les images surgissent souvent dans le parcours des différents recueils.<br />
"La poesle et la redécouverte du royaume d'enfance ne font<br />
qu'un. Le souvenir, pour <strong>Senghor</strong> comme pour Proust, nlest<br />
pas un acte intellectuel, mais plutôt l'abandon d'un homme<br />
qui se laisserait glisser tel un plongeur, dans l labîme des<br />
hautes profondeurs à la recherche d'une vérité intérieure,
- 74 -<br />
c'est pour-tant: un suc cr-i.etal.l.i.n qu'elles distillent<br />
C'est que mes yeux sont tout couvert:s de mi eère<br />
Et la mi.eère n'aime pas la Lumi è re (... )" (1)<br />
2 - 3 - Poètes solitaires<br />
2 - 3 - 1 - Terres d'exil<br />
Si les poètes chantent toujours les charmes de leurs terres<br />
natales, ils sont parfois sensibles à la beauté de lointaines contrées.<br />
De ces voyages au bout du monde, ils apportent des images nouvelles et<br />
des expériences originales. Parfois nous pénétrons à l'intérieur de<br />
mondes irréels ou étrangers. L'imagination poétique retrouve la magie<br />
des univers intérieurs. Le voyage a une double signification: c'est<br />
d'abord le parcours de l'ame ou de la conscience dans les régions loin-<br />
taines de la mémoire par le jeu du souvenir. C'est aussi l'expérience<br />
plus commune de la découverte d'un autre monde "hors frontières" selon<br />
1<br />
l'expression de Jean-Baptiste <strong>Tati</strong>-<strong>Loutard</strong>.<br />
Souvent, le glissement d'une conscience dans le souvenir<br />
nous fait basculer dans l"imaginaire ou le fantastique -voyages de l'âme<br />
au bout d'une imagination exacerbée-.<br />
Où donc retrouver ces femmes mythiques amantes farouches<br />
ou maîtresses soumises? Comment donc revivre le faste et le raffinement<br />
de l'Afrique ancienne sinon par la plume magique des poètes?<br />
(l ) Jean-Baptiste TATI-LOUTARD "Le pauvY'e et les étoiles" t.n Les Y'acines<br />
congolaises, p. 45K
- 89 -<br />
d'une organisation religieuse chrétienne au rôle politique certain<br />
dans le monde. En outre, Tchicaya exècre la hiérarchie ecclésiastique<br />
dont l'aisance matérielle le révolte. Et puis le sacrifice du Christ,<br />
le récit de la passion ne sont-ils pas des pièges pour retenir davan-·<br />
tage la foule des fidèles trop crédules? Tchicaya constate lui-même,<br />
non sans ironie,<br />
"Le Christ ne vaut qu'une messe<br />
L'amour qu'une trahison<br />
Ah je suis loin du poème nègre<br />
Je comprends le diaLoque d'oubli !" (1).<br />
Une allusion qui précise son opposition au pardon sen<br />
ghorien. Pour lui, il niest pas questi on dl oublier l es souffrances de<br />
la race noire.<br />
(1) Tchicaya U TAM'SI<br />
(2) Tchicaya U TAM'SI<br />
"Christ je crache à ta joie<br />
Le soleil est noir de nègres qui souffrent<br />
De Juifs qui quêtent le levain de leur pain<br />
Que sais-tu de New Bell<br />
A Durban deux mille femmes<br />
A Prétoria deux mille femmes<br />
A Kin aussi deux mille femmes<br />
A Antsirabé deux mille femmes<br />
Que sais-tu de Harlem<br />
Le vin pèse sur mon coeur je souffre de jouir<br />
Christ je hais tes chrétiens" (2).<br />
"Obol.e", "Epitomé" in Arc muei cal, pp. 68-69.<br />
"Le contemp teux:", "Epitome" in Arc muei.calçpp . 64-65.
- 98 -<br />
le siècle tirera quelque vanité Le<br />
Congoléther".<br />
Le chemin de l'exil n'engendre pas en Tchicaya la tris-<br />
tesse, mais le rire libérateur de l'angoisse existentielle. Derrière le rire<br />
se profilent<br />
poème politique.<br />
l'amertume et la violence toute pamphlétaire du<br />
'V'ai la bouche ouverte d toutes les<br />
oraisons<br />
Je n'empoisonne plus ma vie<br />
Je la reconstruis autour d "un rauon<br />
Celui qui va du coeur au dehors où la nuit<br />
N'est plus plantigrade où la nuit n'est que<br />
la nuit<br />
Adieu !" (1).<br />
2 - 6 - A la rencontre de l'amour<br />
Thème universel, l'amour est un ferment de l'inspiration<br />
poétique. Il est tout naturellement lié à celui de la femme. Amante<br />
ou mère, la femme ser-a toujours au coeur de la conscience des poètes.<br />
Francis Fouet dans le cadre du roman négro-africain francophone fai<br />
sait remarquer l lextrême pudeur des auteurs devant les choses<br />
de l'amour. L'expression romanesque malgré son réalisme se refuse aux<br />
descriptions et détails trop précis. Tout y est suggéré. Pas de pré<br />
cisions quant aux rencontres charnelles ou de longs baisers qui font<br />
(1) Tchicaya U TAM'SI "La rm.ee d mox-t:", "Le pain ou la cendre" in<br />
Le uent.re, p. 168.
- 102 -<br />
Ma Saô mon amante aux cut.eeee furieuses, aux longs bras<br />
de nénuphars calmes<br />
Femme précieuse d'ouzougou, corps d'huile imputrescible à<br />
la peau de nuit diaman tine (... )" (1).<br />
Pour Geneviève Lebaud,<br />
"L'image de l'amante fut probablement suggérée au poète<br />
par le spectacle de la lutte des piroguiers contre le<br />
courant; celle-ci devient, dans la rêverie poétique, un<br />
corps-à-corps amoureux avec la Femme-Fleuve. Dans une<br />
amplification épique, les monts deviennent des phallus, la<br />
rivière une femme 'aux cuisses furieuses, aux longs bras<br />
de nénuphars calmes'. Il n'y a pas là un simple travestissement<br />
poétique; si l'eau est la Mère primordiale,<br />
l'homme ne peut revenir à elle que par l'amour, par ce<br />
sixième sens qui est le sexe, 'antenne au centre du multiple<br />
où s'échangent des messages fulgurants'. Etant amante,<br />
l'eau est une nouvelle fois mère pour l'homme qu1elle reçoit"<br />
(2).<br />
Les images aux connotations sexuelles sont présentes dans<br />
les mots phallus, cuisses furieuses, corps d'huile etc. La femme sen-<br />
ghorienne est la médiatrice privilégiée entre l 'Homme et le cosmos,<br />
entre le visible et l'invisible. Dans le poème "Congo" par exemple,<br />
l'eau et la femme ont la même identité dans leur expression symbolique.<br />
Leurs qualités sont communes ou complémentaires. Ce sont: la sensua<br />
lité, la maternité, la grâce dans le mouvement ... L'image de la fémi-<br />
(1) Léopold Sédar SENGHOR: "Congo", "Ethiopiques" in Poèmes, p. 99.<br />
(2) Geneviève LEBAUD : Léopold Sédar <strong>Senghor</strong> ou la poésie du royaume<br />
d'enfance, p. 50.
préter" .<br />
- 123 -<br />
Dans ce poème, Pacéré Titinga observe, s'étonne, se<br />
moque, nous livre sentiments et sensations devant la vie des Améri-<br />
cains. l'ensemble utilise un procédé comparable a celui des cèlèbres<br />
"lettres persanes" de Montesquieu. Un étranger observe une autre so<br />
cièté avec naivété. Dans ce long monologue, nous retrouvons mêlés,<br />
tristesse, nostalgie, étonnement et l 'humour un peu froid de Pacéré<br />
Titinga. Parfois un symbolisme personnel rend le message poétique<br />
plutôt ob.....scur. Ai nsi, le mot "sperme" si gnifi e sans doute l' énergi e<br />
vitale.<br />
"Ce nridi Là,<br />
Le téléphone sonna<br />
Je le pris;<br />
Il coul.ai.t,<br />
Le venin<br />
Du dimanche<br />
Ici<br />
C'est New-York<br />
Tout est beau<br />
Et<br />
Le sperme<br />
Coule à gogo<br />
Tu viendrae voir ? 1/ (1).<br />
D'une façon générale, a l'examen des oeuvres de ces<br />
quatre poètes, l 'humour n'est guère l'expression d'une technique ou<br />
(1) Fréderic Pacéré TITINGA "Les reflets de New-York" in Poèmes pour<br />
l ï Anqol.a, p 4 g.
T ROI SIE M E PARTIE<br />
E T U 0 E PRATIQUE<br />
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-:-:-=
- 127 -<br />
dre sur le fonctionnement de la triade métaphore, métonymie, synec-<br />
doque. D'autres mécanismes poétiques restent à définir. Ils complé<br />
teront les caractères manifestes de l'écriture poétique nègre comme<br />
l'abondance des images, l'abolition de la rime et de l'accent sylla<br />
bique (éléments rythmiques de base), au profit de l'assonance ou de<br />
l'allitération.<br />
Il est certain que la poésie nègre africaine de langue<br />
française, en choisissant tout naturellement le "vers libre" et la<br />
poésie graphique, ne présente aucune homogenéhé formelle du point de<br />
vue de son fonctionnement général. Chaque poète a le libre choix de la<br />
forme de l'oeuvre qu'il entend créer. Cette liberté explique la variété<br />
des expressions poétiques. Ainsi <strong>Senghor</strong> affectionne le verset, tandis<br />
que Tchicaya U Tamlsi d'abord séduit par les formes rigides comme<br />
le sonnet, choisira de laisser le poème s'écouler comme un long<br />
fleuve intarissable.<br />
Si l'on se place du point de vue des techniques usitées<br />
par 1es poètes français, 1a poésie a renouve.....Jé bon nombre d' éléments<br />
fondamentaux. Citons brièvement l'introduction dlun vocabulaire direc<br />
tement issu des langues africaines, la substitution des strophes par<br />
le verset, l'abondance et la force des images, la prépondérance du<br />
rythme etc.<br />
En élaborant une pratique exploratoire de l'univers poé<br />
tique, nous prendrons toujours soin d'accompagner les termes linguisti<br />
ques d'une définition claire. Ceci dans le but affirmé d'échapper à
de l'inspiration poétique.<br />
- 134 -<br />
"Voici que jaillit l'inspiration, en nappes larges, de<br />
plus en plus pressées, en cascades d'images et le verset<br />
l'accueille, ne se fermant qu'à l'expiration du soùffle.<br />
C'est la fin du verset que marque le blanc typographique"(l).<br />
Ainsi chaque espace vierge, chaque blanc typographique,<br />
nous indiquent la fin du verset. L'analyste devra donc déterminer<br />
lui-même les limites et le nombre de versets dans le poème avec pour<br />
seules indications les mouvements de texte et le blanc typographique.<br />
Parfois la strophe est parfaitement exprimée comme<br />
dans l'oeuvre de Pacéré Titinga. t 'al ternance de groupe;-strophiques<br />
sur la partie droite et gauche de la page donne à la fois au texte<br />
son rythme et sa structure formelle générale.<br />
Afin d'éviter une inutile recherche de l'identité du<br />
"vers" ou de la strophe, nous choisirons volontiers d'examiner<br />
chaque ligne du poème. Le regroupement en strophes ou versets déter<br />
minera les différentes séquences ou parties du poème.<br />
3 - 1 - 2 - Une poésie négra-africaine versifiée?<br />
Léopold Sédar <strong>Senghor</strong> a été souvent désigné comme le<br />
plus occidental des poètes nègres de langue française. S'il avoue<br />
(1) Hubert de LEUSSE LéopoZd Sédar <strong>Senghor</strong> Z'Africain, p. 117.
- 136 -<br />
les rimes sont groupées deux a deux de manière suivie. Toutefois, le<br />
dernier vers du premier tercet s'accorde avec le vers final du point<br />
de vue de la rime.<br />
Notons que le sonnet est apprécié des poètes modernes.<br />
En dépit des contraintes formelles qu'il impose, des poètes français<br />
comme Alain Bosquet ou Pierre Seghers l'utilisent volontiers dans<br />
leurs recueils.Il faut signaler que les poètes africains de langue<br />
française sont en général peu attirés par la poésie versifiée et<br />
Tchicaya U <strong>Tam'si</strong> abandonnera par la suite la pratique des construc<br />
tions poétiques codifiées. Peut-être s'est-il laissé séduire par la<br />
lecture des poèmes occidentaux? Il en est de même de l lusage de la<br />
rime chez Fréderic Pacéré Titinga. Dans le poème "Héros d'ébène", on<br />
découvre une structure régulière formée de quatre vers aux rimes<br />
embrassées.<br />
"{... } Spectre d'infamie? Scandale du Monde?<br />
Réalisations de frondées anathèmes ?<br />
Ou prostitutions de Pouvoirs suprêmes ?<br />
Ou grands que 7:fJPprob,.,'i et l'hypocrisie confondent ?(... }"(1).<br />
Dans les "oeuvres de jeunesse" de Tchicaya, on retrouve<br />
non seulement l'usage des rimes, mais aussi les thèmes propres aux<br />
occidentaux, comme l'angoisse existentielle, la nostalgie. Mais il est<br />
inutile de nous étendre autour de cette question. Très vite, l'oeuvre<br />
de Tchicaya s'exprimera autrement. Aujourd'hui les accents de colère,<br />
{1} Fréderic Pacéré TITINGA "Héroe dt ébëne", p. 56.
- 141 -<br />
Ces techniques de répétition ne sont que des exemples.<br />
Il reste aux poètes la possibilité de créer à la mesure de leur talent<br />
des cas particuliers. Les auteurs nègres quant à eux empruntent sou<br />
vent les ressources techniques de leur art à la littérature orale.<br />
Ainsi, l'interpellation, l'interjection, l'énumération apparaissent<br />
elles dans la plupart des poèmes. Liart des qriots y l es "troubadours",<br />
trouve chez les écrivains nègres ùes héritiers particulièrement<br />
enthousiastes.<br />
1/( ••• ) Dyôb ! tui ai-Je dit, Beleup de Kaymôr ! Je te<br />
respire parfum de gommier, et proclœne ton nom<br />
Surgi du Royaume d'enfance et des fonds sous-marins des<br />
terres ancestrales.<br />
Héraut! Proclame mon char blanc et ses chevaux obscurs.<br />
Des navires-de-terre m'accompagnent aux voiles étendars,<br />
les présents d'au-delà les mers.<br />
Grâces à toi pour le vin de palme, le coupe d'amitiés<br />
de la lèvre à la lèvre.<br />
Grâces pour la jeune fi LLe nubi le au vent.re de douceur<br />
n'deissane ! A la croupe de colline à la poitrine de<br />
fruits de rôni.er !" (1).<br />
Comment retrouver le rythme?<br />
L'adoption d'une écriture libérée de toute contrainte<br />
est le premier obstacle à l'analyse du rythme poétique nègre.<br />
La poésie versifiée de tradition française repose sur<br />
l'accent et la syllabe, éléments rythmiques de base. On pourrait fort<br />
(1) Léopold Sédar SENGHOR "Message", "Ethiopiques" t.n Poèmes, p. 105.
- 145 -<br />
3 - 2 - 2 - Les segments rythmiques manquants<br />
S'il est un élément difficile à saisir dans l 'étude du<br />
rythme, c'est llintervention d'un support instrumental ou musical<br />
Léopold Sédar <strong>Senghor</strong> et Fréderic Pacéré Titinga sont<br />
tous deux inspirés par la poésie orale ou le chant traditionnel. Mais<br />
l'écriture semble avoir des limites. Elle ne parvient pas à repro<br />
duire tous les éléments rythmiques propres à l'oralité.<br />
Dans la poésie française occidentale, on sait que la<br />
strophe est en quelque sorte une adaptation graphique des refrains.<br />
De plus, accents syllabiques, assonances, allitérations et même la<br />
diction, sont liés à la recherche d'une musicalité du poème. Si le<br />
poème occidental semble trouver une solution à cet obstacle, la poésie<br />
négro-africaine éprouve quelque embarras face au problème de l'inclu<br />
sion graphique d'éléments oraux comme l 'intervention du choeur ou<br />
l'intégration dans le mécanisme rythmique d'instruments de musique .<br />
....<br />
La plupart des poèmes de <strong>Senghor</strong> requierentpour leur exécution, des<br />
instruments de musique. Trois tabalas (tam-tam de guerre) pour<br />
"L'homme et la bête" ; kôras et balafongs pour "Epitres à la Princesse"<br />
etc. Ces indications ne sont pas l'oeuvre de la fantaisie de l'auteur.<br />
Elles montrent la volonté de trouver une solution à la rupture entre<br />
l'oral et l'écrit.
- 151 -<br />
3 - 3 - 4 - L'image dans la poésie nègre<br />
Le mécanisme de l'image poétique est souvent complexe. Il<br />
peut naître d'une subtile combinaison des différents tropes. 5'il est<br />
difficile d'établir une typologie des images, on peut néanmoins isoler<br />
dans un poème donné les principales images qui l'animent. De plus,<br />
comme nous l'avons déjà évoqué, tout le mécanisme de l'image poétique<br />
est étroitement lié à la perception sensorielle. Il existe par consé-<br />
quent deux approches.<br />
L'image mentale ou visuelle<br />
Elle fait appel à la description de ce que la conscience<br />
et le sens perçoivent. C'est l'expérience personnelle brutale et sen-<br />
sitive. Elle met en oeuvre le fonctionnement de la conscience par une<br />
combinaison psycho-sensitive représentée dans le langage par les mots.<br />
Elle est toujours en relation avec la culture à laquelle nous appartenons.<br />
L' image "1 ittéraire"<br />
Elle ajoute au sens commun, un deuxième sens plus complexe.<br />
L'image littéraire va au-delà de la simple perception.<br />
5elon Dupriez,<br />
"Au sens strict, l'image littéraire est donc un procédé qui<br />
consiste à remplacer ou à prolonger un terme -appelé thème<br />
ou comparé désignant ce dont il s'agit "au propre"- en se<br />
servant d'un autre terme, qui n'entretient avec le premier
- 152 -<br />
qu'un rapport d'analogie laissé a la sensibilité de l'auteur<br />
et du lecteur. Le terme imagé est appelé phore (d'où<br />
le terme métaphore) ou comparant et s'emploie pour désigner<br />
la même réalité par le détour d'une autre par figure<br />
il est pris 'au sens figuré'" (1).<br />
Or lion sait que l'image chez le négro-africain est tou-<br />
jours en étroite liaison avec le symbole. Les mots, même les plus con<br />
crets, répondent à plusieurs signifiés. L'image est analogique, elle<br />
est toujours au-delà du "sens propre" sans jamais rompre le lien avec<br />
ce sens premier. La mise en oeuvre de l'image dans le domaine poétique<br />
est souvent liée a l'usage des tropes et des procédés de composition.<br />
L'écriture nègre abonde d'images parce qu'elle est naturellement en-<br />
cline à l'analogie. Nous le disions, en Afrique noire, chaque mot,<br />
chaque geste est chargé de symboles. Une analyse descriptive place sou-<br />
vent l'image dans une étroite dépendance avec le thème. Ainsi nous<br />
avons des images de mort, de douceur, de violence, etc.<br />
En ce qui nous concerne, nous retiendrons l'image comme<br />
le résultat de la combinaison et de la mise en oeuvre des différents<br />
procédés littéraires que nous avons déjà tenté de définir. Citons le<br />
choix des mots, métaphores, métonymies, synecdoques, comparaisons,etc.<br />
Cette perspective d'analyse donne à l'image une définition<br />
élargie. Elle est le résultat de l'association de plusieurs éléments;<br />
(1) Bernard DUPRIEZ Gradus - Les procédés littéraires, p. 242.
- 153 -<br />
la métaphore y joue un rôle déterminant. Parfois, l limage est réduc<br />
tible à un seul mot. <strong>Senghor</strong> a longuement insisté dans ses essais sur<br />
la complexité èt la multivalence des images négra-africaines. C'est<br />
l lune des raisons pour lesquelles on découvre dans ses poèmes la pré<br />
sence active de mots sérères ou wolofs. Car les langues africaines sug<br />
gèrent des sens bien plus quel Ies ne définissent l t obje t ou le concept<br />
quel les désignent. En langue bambara, "kuma", la parole a une triple<br />
signification: t l signifie à la fois "créer", la "bouche" et la "mar-<br />
mite". Le mot "kuma" a toutes les qua lités du syrnbo le (1).<br />
Notre analyse s'efforcera de mettre à jour tous les<br />
éléments qui ont participé à l'élaboration de l limage poétique en<br />
dégageant le rôle déterminant des mots et des tropes.<br />
(l) Voir Léopod Sédar SENGHOR "Comme les lamantins vont boivent: à la<br />
eource"; postface d "'Ethiopiques" in Poèmes.
- 154 -<br />
3 - 4 - NIVEAU IV : LE NIVEAU GRAMMATICAL<br />
Deux obstacles s'opposent à l'analyse grammaticale du<br />
poème. Ce sont: d'une part la particularité de l'écriture poétique<br />
comme transgression du langage ordinaire; d'autre part nous avons pris<br />
l'engagement de ne pas rompre notre analyse avec le sens. En effet,<br />
quel serait l'intérêt d'une approche grammaticale si elle devait se<br />
limiter à l'observation de phénomènes syntaxiques, ou de l'illustration<br />
de certaines catégories grammaticales?<br />
Le poème génère souvent des lois de compositions autonomes<br />
sans pour autant remettre en cause les règles de communications propres<br />
à tout langage humain.Voici donc proposés les points essentiels à<br />
l'étude d'un poème donné.<br />
3 - 4 - 1 - La construction verbale<br />
Le traitement du verbe a trois axes essentiels le<br />
temps, le mode, et l'aspect. Nous obtenons le schéma suivant<br />
VERBE<br />
i ndicati f<br />
mode subjonctif<br />
\<br />
impératif<br />
aspec t<br />
perfect i f<br />
{<br />
imperfectif<br />
(passé et futur simples }<br />
. Présent<br />
(imparfait en ais et en ralS
- 158 -<br />
plus généralement grammaticales. Au contraire, c'est dans la phrase<br />
poétique que nous retrouverons les plus parfaites illustrations des<br />
règles de composition en langue française. Ainsi, Léopold Sédar<br />
<strong>Senghor</strong> -dont on connaît l'audace pour l'insertion dans ses poèmes<br />
de mots peuls, wolofs ou sérères- a le strict respect des règles gram<br />
maticales.<br />
Notre intérêt se trouve naturellement porté vers les<br />
catégories grammaticales les plus remarquables dans l'organisation<br />
d'un poème donné. Bien souvent, la répétition d'un élément, nom,<br />
adverbe, adjectif, ou d'une unité syntaxique (la phrase) demande<br />
l'analyse de sa fonction grammaticale. Nous tenterons de voir si<br />
cette redondance formelle exprime toujours les mêmes fonctions dans<br />
le poème.<br />
Voici donc brièvement exposés les critères d'analyse<br />
qui nous guideront dans l'exploration des poèmes. Nous prendrons tou<br />
jours soin d'examiner tout d'abord le fonctionnement du poème afin<br />
de faire apparaître l'essentiel des lois qui le régissent. En un mot,<br />
c'est la lecture de l'oeuvre qui nous importe non l'application<br />
stricte d'une "méthode" d'analyse. C'est dans cette liberté de l'ana<br />
lyste que se trouve la vérité du poème.
- 160 -<br />
C 29 Avant que le Destin ja Loux ne te rédui.ee en cendre<br />
30 pour nourrir les racines de la vie (1)<br />
"Femme noire" est l'un des plus célèbres poèmes de<br />
<strong>Senghor</strong>. La structure paraît d'emblée assez simple puisque l'on pour<br />
rait aisément distinguer quatre strophes marquées par la typographie.<br />
A la division strophique s'ajoute la subdivision en versets dont<br />
l'identité n'est jamais précise. En nous laissant porter par le sens,<br />
il est néanmoins possible d'établir une segmentation à laquelle nous<br />
avons adjoint les lettres de l'alphabet. On observe une troisième<br />
strophe plus contractée qui fait office de conclusion. Elle achève le<br />
poème. De plus, chaque début de strophe marque la répétition d'un même<br />
segment de phrase: "femme nue" avec une variante quant à la deuxième et<br />
à la troisième strophe (femme nue, femme obscure). La construction typo<br />
graphique en dépit de certaines apparences, est stricte et rigoureuse.<br />
Chaque verset incarne une unité sémantique qui pourrait fort bien<br />
assurer son autonomie parce qu'elle est image.<br />
Répétition et rythme<br />
Le premier élément de la répétition est le retour complet<br />
ou partiel du titre "femme noire". Ce segment joue un peu le rôle de<br />
refrain avec une légère modification adjectivale puisque "nâire" est<br />
remplacé par "obscure". On remarque tout particulièrement la suppression<br />
des articles aux lignes suivantes: l, 2, 9, 10, 11, 14, etc. Ce qui donne<br />
davantage de force aux images. Cette forme contractée de l'écriture poé<br />
tique est souvent illustrée dans la poésie senghorienne. Ainsi, il écrit
- 164 -<br />
existence véritable que dans son essence. La construction du poème est<br />
d'emblée d'une grande simplicité comme 1Ion peut le remarquer dans le<br />
tableau suivant:<br />
"Femme noire" 1 Strophe l<br />
nue - vie - beauté - ombre - rerre promise.<br />
Strophe II<br />
nue, obscure - fruit mûr - sombres extases <br />
bouche - savane frémissante - tam-tam sculpté<br />
et grondant - spiritualité.<br />
Strophe III<br />
nue, obscure - huile calme - gazelle - délices<br />
des jeux de l'esprit.<br />
Strophe IV<br />
nue - noire - beauté fugitive.<br />
La lecture de ce tableau nous montre la progression du<br />
poème. "Femme noire" représente le titre; c'est l'idée à partir de la<br />
quelle se construit 1'ensemble du poème. C'est aussi l'élément toujours<br />
présent et répété dans les quatre strophes du poème. Un seul terme de<br />
comparaison ùpparaît de façon explicite, l'emploi de "comme".
- 173 -<br />
Comme dans la poésie de <strong>Senghor</strong>, le rythme est donné par<br />
le retour des temps forts placés sur les dernières syllabes. Ceci con<br />
duit à souligner les mots forts du poème. Mais c'est surtout dans le<br />
retour de sonorités identiques que s'exprime tout le génie de <strong>Tati</strong>-<strong>Loutard</strong>.<br />
Que notre corps double soit une ancre plus lourde<br />
dans le flot du vent !<br />
Il est facile d'établir un lien sonore et sémantique<br />
entre les adjectifs "double" et "lourde". Cette technique apparaît à<br />
nouveau dans le verset D.<br />
1 1<br />
Nous rirons aux éclats de tous les éclairs...<br />
On remarque le rapprochement entre "éclats" "éclairs".<br />
Malgré la présence de tous ces éléments rythmiques actifs, on ne décèle<br />
aucune véritable organisation du rythme. "La force du couple" est, à<br />
l'examen des sonorités et des syllabes, un poème sémantique.<br />
Le niveau métaphorique<br />
En dépit de sa concision formelle, "La force du couple"<br />
possède un grand intérêt par la puissance de ses images. Le sens général<br />
du poème pourrait se résumer de façon très simple: l'unité du couple<br />
dans llamour est sa force face aux multiples difficultés de l'existence.<br />
Certes l'amour est un thème universel, mais <strong>Tati</strong>-<strong>Loutard</strong> a su créer un<br />
climat personnel, subtil mélange de tendresse, d'érotisme ou de sensualité<br />
diffuse. Comme toujours, nous retrouvons la présence des forces du cosmos,<br />
vent, tonnerre, feu ... L'isotopie de la tempête symbolise aussi la diffi-
- 176 -<br />
du cosmos, l'amour, et toujours la douleur de vivre. Il y a presqu e un<br />
combat entre la nature et l 'Homme. A l'issue de l'affrontement, Homme<br />
nature, le couple sortira vainqueur grâce à sa cohésion. Mais c'est<br />
avant tout une victoire de l'amour.<br />
Quelques éléments grammaticaux<br />
L'utilisation du temps varie en fonction des versets. Le<br />
poème est construit comme une invitation à l'amour. Le verset B exprime<br />
parfaitement cette affirmation .<br />
.4 son approche viens ci l tabi-i de ma tempe<br />
et de mon bras<br />
Le recours à l'impératif marque une certaine autorité de<br />
l 'Homme. Cette impression est justifiée par la volonté masculine<br />
d'apporter à la femme aimée protection et réconfort.<br />
troisième verset.<br />
(... ) viens à l.t abri. de ma tempe<br />
et de mon bras(... J.<br />
Le subjonctif présent apparait très nettement dans le<br />
Que not.re corps double soit une ancre plus lourde<br />
dans le flot du vent !<br />
Voici le désir et le souhait des amants. Le souhait est<br />
prolongé dans la rêverie de l'amour triomphant. Ceci correspond bien à<br />
l'utilisation du futur simple.
- 179 -<br />
CON C LUS ION<br />
-=-=-=-=-=-=-=-=-:-<br />
Au terme de cette étude, nous avons proposé une méthode<br />
de lecture des poèmes nègres de langue française. Cette proposition<br />
d'analyse nous a conduit à l'adoption de nombreuses définitions linguis-<br />
tiques et sémiologiques. Paradoxalement, le désintéressement du public<br />
à l'égard des poèmes coïncide avec l'intérêt que la pensée universi-<br />
taire porte à la poésie. Alors, peut-on vraiment parler d'une "crise"<br />
de genre au XX è siècle? Ne s'agit-il pas en quelque sorte d'une recon-<br />
version normale? Car les linguistes en conviendront certainement, une<br />
langue donnée évolue, se transforme, s'enrichit au gré des mutations<br />
de l 'histoire. La poésie n'échappe aucunement à cette règle. Aujourd'hui<br />
on s'accorde à reconnaître les qualités et les valeurs esthétiques du<br />
poème comme "oeuvre d'art". Ce qui n'empêche guère le public de porter<br />
son intérêt vers des genres littéraires à la mode comme le roman, les<br />
essais ou de nombreux témoignages autobiographiques dont notre époque<br />
raffole. Seule la critique universitaire actuelle laisse une place<br />
honorable à la poésie, lui accordant ainsi ce second souffle indispen<br />
sable à sa survie.<br />
Le poème nègre n'échappe guère à des contradictions<br />
similaires. Le public nègre délaisse souvent la lecture du poème pour<br />
le roman, la nouvelle, ou le théâtre. On recherche le plus souvent, dans<br />
la littérature, une réponse ou une illustration des problèmes actuels
- 180 -<br />
comme la corruption, la soif du pouvoir, l'intolérance et l'irrespon<br />
sabilité des dirigeants politiques. Pourtant les poètes sont loin d'être<br />
méconnus du public. Demandez à un lecteur africain le nom d'un grand<br />
poète du monde noir. Selon la préférence, on vous répondra: <strong>Senghor</strong>,<br />
Dadié ou Aimé Césaire. Plus rarement l'on pourra vous citer les noms de<br />
jeunes poètes comme Paul Dakeyo, Yves Emmanuel Dogbé ou Fréderic Pacéré<br />
Titinga.<br />
De plus, il ne faut pas l'oublier, l'accroissement du<br />
nombre de lecteurs est étroitement dépendant des politiques d'éducation<br />
et d'alphabétisation. Certains poètes conscients des obstacles qui les<br />
éloignent de leur public, proposent de rendre la poésie à l'oralité.<br />
Une proposition que les moyens de communication comme la radio pourraient<br />
aisément faciliter en comblant le fossé entre l'oral et l'écrit. On<br />
pourrait aller encore plus loin en supprimant le clivage entre les<br />
genres littéraires. Pourquoi ne pas insérer dans les pièces de théâtre<br />
des fragments de poèmes ou mettre en scène des poèmes célèbres après<br />
leurs traductions dans les langues africaines? Depuis de nombreuses<br />
années, les linguistes ont réussi à transcrire la plupart des langues<br />
africaines de tradition orale. Il est curieux de retrouver aisément<br />
dans les rayons de librairies, des traductions des poèmes de <strong>Senghor</strong> en<br />
Finlandais ou en Portugais, mais peu ou nulle trace d'une traduction en<br />
Wolof, Dioula, Swahili, Bambara, etc. Les lois du commerce n'expliquent<br />
pas totalement ce nouveau paradoxe. Il appartient aux poètes de retrou<br />
ver le contact avec le public en proposant des oeuvres dont les thèmes<br />
et les techniques mises en oeuvre répondent à l'attente de leurs peuples.<br />
C'est en ce sens que nous assisterons peut-étre à une nouvelle révolution<br />
culturelle dans le monde négro-africain contemporain.
- 181 -<br />
B l B LlO G R A PHI E<br />
Bibliographie des auteurs à l'étude (suivie de quelques indications<br />
biographiques)<br />
- SENGHOR (Léopold Sédar)<br />
l - Poèmes<br />
- Chants d'ombre, Paris, Editions du Seuil, 1945.<br />
- Hosties noires, Paris, Editions du Seuil, 1958.<br />
- Chants pour Naett Paris, Editions Pierre Seghers, 1949.<br />
- Ethiopiques, Paris, Editions du Seuil, 1956·<br />
- Nocturnes, Pari s , Edi ti ons du Seui1, 1961.<br />
- Lettres d'hivernage, co-édition Dakar, Abidjan, Paris, Nouvelles Edi-<br />
tions Africaines, Editions du Seuil, 1973.<br />
- Poèmes, Paris, Editions du Seuil, 1964, 1973·<br />
- E1égies majeures, Paris, Editions du Seuil, 1979. (1)<br />
II - Essaies, études et anthologies:<br />
Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache, Paris, P.U.F, 1948.<br />
- Liberté l Négritude et humanisme, Paris, le Seuil , 1964·<br />
- Liberté II Nation et voie africaine du socialisme, Paris, le Seuil, 1971.<br />
- Liberté III Négritude et civilisation de l'universe1,Paris,le Seuil ,1977.<br />
- La parole chez Claudel et chez les négro-africains, Dakar, N.E.A., 1973.<br />
(1) On compl:e igCil emen i;
- 182 -<br />
Léopold Sédar <strong>Senghor</strong> est le plus célèbre des écrivains<br />
négra-africains de langue française. Son oeuvre a été traduite dans plu<br />
sieurs langues: italien, arabe, tchèque... Voici les principales étapes<br />
de sa vie:<br />
- 1906 Naissance à Joal en pays sérère. Le jeune <strong>Senghor</strong> fréquente<br />
l'école religieuse de N'Gazobil, avant d'être admis à<br />
Dakar au collège Libermann, puis au lycée Van Vollenhoven.<br />
- 1928 Il obtient le baccalauréat. Il poursuit ses études à Paris<br />
au lycée Louis Le Grand où il aura des camarades d'études<br />
cél èbres comme Georges Pompi dou , Thierry Iviaulnier.<br />
- 1931 Il entre à la Sorbonne. Licencié ès-lettres.<br />
- 1935 : <strong>Senghor</strong> est le premier agrégé d'Afrique Noire·<br />
- 1935-1938 Il enseigne les lettres classiques au Lycée Descartes<br />
à Tours.<br />
- 20 Juin 1940 Mobilisé, <strong>Senghor</strong> est fait prisonnier au camp Stalag.<br />
- 1955<br />
- 1959<br />
- 1960<br />
A la libération, il mène une intense activité<br />
li ttérai re.<br />
Il est sécrétaire d'Etat à la présidence du conseil de<br />
la république.<br />
Conseiller à la présidence de la communauté française.<br />
Il est président de l'Assemblée Fédérale du Mali. Après<br />
l'éclatement de celle-ci, il est nommé président de la
- 183 -<br />
République du Sénégal.<br />
- 1980 <strong>Senghor</strong> quitte volontairement le pouvoir. Abdou Diouf<br />
devient président de la république sénégalaise.
- 185 -<br />
IV - Romans<br />
- Les cancrelats, Paris, Albin Michel, 1980.<br />
V - Nouvelles<br />
- La main sèche, Paris, Laffont, 1980.<br />
Tchicaya U <strong>Tam'si</strong> est moins célèbre que son aîné Léopold<br />
Sédar <strong>Senghor</strong>. Néanmoins son oeuvre est appréciable. De nombreux poèmes<br />
ont été traduits en italien, allemand, portugais, etc. Voici les prin-<br />
cipales étapes de sa vie:<br />
- 1931 Naissance de Gérald Félix Tchicaya à Mpili au Congo<br />
Son père est alors député du Moyen Congo.<br />
- 1946 : Tchicaya se rend à Paris au Lycée Janson de Sailly.<br />
- 1957-1960 Il exerce divers metiers·<br />
- 1960 Retour au Congo où il soutient la cause de Patrice Lumumba<br />
,<br />
en devenant redacteur en chef du journal "Congo". Après<br />
l'arrestation de Lumumba, il revient en France où il est<br />
depuis,fonctionnaire à l'U.N.E.S.C.O. Il partage son temps<br />
entre son activité professionnelle et littéraire.
- 186 -<br />
- TATI-LOUTARD Jean Baptiste<br />
I - Poèmes<br />
- Les racines congolaises précédé de La vie poétique, Honfleur Paris<br />
Pierre Jean Oswald, 1968·<br />
- Poèmes de la mer, Yaoundé, Editions Clé, 1968.<br />
- L'envers du soleil, Honfleur, Pierre Jean Oswald, 1970.<br />
- Les normes du temps, Kinshasa/Lumumbashi, Editions du Mont-Noir, 1974.<br />
II - Essais, études et anthologies<br />
- Le poète africain, Kinshasa/Lumumbashi, Editions du Mont-Noir, 1975<br />
- Anthologie de la littérature congolaise d'expression française,<br />
Editions Clé, 1977·<br />
III - Romans, nouvelles<br />
- Chroniques congolaises, Paris, Oswald, 1974 (nouvelle)·<br />
de la vie de cet auteur.<br />
Quelques éléments biographiques. On sait peu de choses<br />
- 1938 Naissance de <strong>Tati</strong>-<strong>Loutard</strong> à Ngoyo au Congo.
- 1975<br />
- 187 -<br />
Il est directeur général de l'enseignement supérieur et<br />
de la recherche scientifique au Congo. Il enseigne éga<br />
lement la littérature à l'université de Brazzaville;<br />
occupe par la suite la responsabilité de ministre de la<br />
culture du Congo.