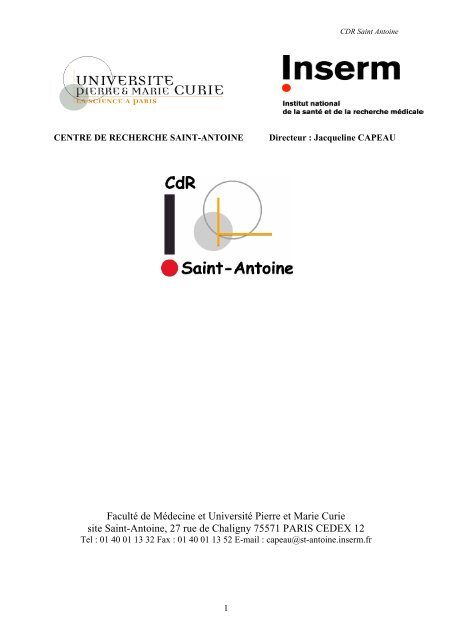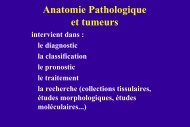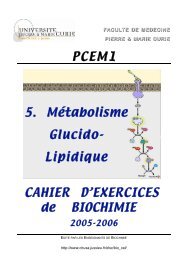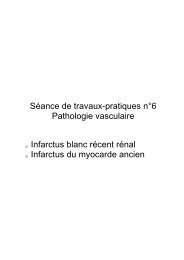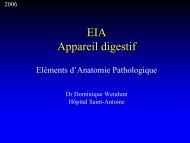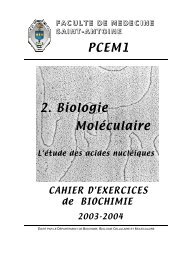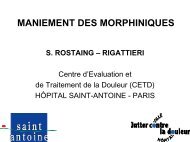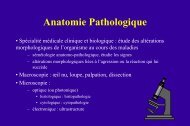Jacqueline CAPEAU - Faculté de médecine Saint-Antoine - UPMC
Jacqueline CAPEAU - Faculté de médecine Saint-Antoine - UPMC
Jacqueline CAPEAU - Faculté de médecine Saint-Antoine - UPMC
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
1<br />
CDR <strong>Saint</strong> <strong>Antoine</strong><br />
CENTRE DE RECHERCHE SAINT-ANTOINE Directeur : <strong>Jacqueline</strong> <strong>CAPEAU</strong><br />
<strong>Faculté</strong> <strong>de</strong> Mé<strong>de</strong>cine et Université Pierre et Marie Curie<br />
site <strong>Saint</strong>-<strong>Antoine</strong>, 27 rue <strong>de</strong> Chaligny 75571 PARIS CEDEX 12<br />
Tel : 01 40 01 13 32 Fax : 01 40 01 13 52 E-mail : capeau@st-antoine.inserm.fr
2<br />
CDR <strong>Saint</strong> <strong>Antoine</strong><br />
Justification du Centre <strong>de</strong> Recherche mixte <strong>Saint</strong>-<strong>Antoine</strong> Inserm/ <strong>UPMC</strong><br />
LE CDR SAINT-ANTOINE FONCTIONNE DEJA:<br />
Il représente un potentiel <strong>de</strong> recherche biomédicale conséquent orienté à la fois vers la<br />
recherche fondamentale et la recherche translationnelle, en interface forte avec les services<br />
cliniques du CHU <strong>Saint</strong>-<strong>Antoine</strong>. Ce potentiel se concrétise autour <strong>de</strong> 15 équipes <strong>de</strong> recherche<br />
labellisées, 14 équipes ou unités mixtes Inserm/<strong>UPMC</strong> et une équipe d’accueil <strong>UPMC</strong>, pour<br />
former un centre <strong>de</strong> recherche.<br />
Cette situation géographique favorise les échanges entre équipes et la mise en place <strong>de</strong><br />
structures communes. L’essentiel <strong>de</strong>s équipes est en effet regroupé dans <strong>de</strong>ux bâtiments (le<br />
bâtiment Kourilsky Inserm et le bâtiment Facultaire <strong>UPMC</strong>) placés au cœur <strong>de</strong> l'hôpital <strong>Saint</strong>-<br />
<strong>Antoine</strong> et suffisamment proches l’un <strong>de</strong> l’autre pour permettre une utilisation en commun <strong>de</strong><br />
locaux et <strong>de</strong> plateformes techniques.<br />
Nous avons mis en place un fonctionnement collectif pour <strong>de</strong> nombreux aspects <strong>de</strong> la vie<br />
scientifique du site comme la formation, l’animation, les services communs et les plateformes<br />
(imagerie, spectrométrie <strong>de</strong> masse, laboratoire L3 et animalerie notamment). Une partie <strong>de</strong> la<br />
gestion financière et la gestion <strong>de</strong>s problèmes techniques liés à la rénovation du bâtiment<br />
Kourilsky qui vient <strong>de</strong> démarrer est prise en charge <strong>de</strong> façon collective par les responsables<br />
du futur CDR.<br />
Cette <strong>de</strong>man<strong>de</strong> est fortement soutenue par les directions <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux organismes <strong>de</strong> tutelle,<br />
<strong>UPMC</strong> et Inserm, qui se sont engagées à soutenir ce projet en termes <strong>de</strong> moyens et <strong>de</strong><br />
personnels.<br />
LE CDR SAINT-ANTOINE PERMETTRA D’AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ DE SES ÉQUIPES :<br />
Le projet <strong>de</strong> CDR a déjà permis et va permettre la mise en place <strong>de</strong> collaborations<br />
scientifiques privilégiées entre ses équipes. Ce projet s’est également traduit par une<br />
amplification <strong>de</strong>s actions d’animation avec, en particulier, le séminaire annuel du CDR dont<br />
les <strong>de</strong>ux premières manifestations ont eu lieu en octobre 2005 et 2006 à Dourdan et dont la<br />
3 ème édition est programmée en octobre prochain.<br />
Le projet <strong>de</strong> création <strong>de</strong> CDR a permis d’élaborer une stratégie scientifique sur le site.<br />
Depuis la première <strong>de</strong>man<strong>de</strong>, le projet s’est recentré sur 3 axes scientifiques, mieux définis,<br />
autour <strong>de</strong>s points forts <strong>de</strong> nos équipes les plus performantes. Cette restructuration <strong>de</strong>s équipes<br />
et ce recentrage ont conduit à proposer un CDR formé <strong>de</strong> 15 équipes au lieu <strong>de</strong> 22. Un<br />
Conseil scientifique extérieur a été créé pour nous ai<strong>de</strong>r dans ce travail.<br />
Ce renforcement <strong>de</strong>s liens entre équipes, catalysé par le CDR, va <strong>de</strong> pair avec une<br />
mutualisation et une gestion commune <strong>de</strong>s ressources humaines et <strong>de</strong>s équipements. Une<br />
telle politique permettra <strong>de</strong> mieux exploiter les gros équipements déjà présents dans les<br />
équipes, <strong>de</strong> mieux négocier les achats collectifs, <strong>de</strong> mettre en concurrence les prestataires <strong>de</strong><br />
contrats <strong>de</strong> maintenance, <strong>de</strong> financer <strong>de</strong>s activités ou <strong>de</strong>s équipements à l’échelle d’un CDR,<br />
<strong>de</strong> créer une équipe <strong>de</strong> gestion administrative et financière, enfin, <strong>de</strong> mettre en oeuvre une<br />
politique d’attribution et <strong>de</strong> gestion collective <strong>de</strong>s surfaces <strong>de</strong> recherche.
3<br />
CDR <strong>Saint</strong> <strong>Antoine</strong><br />
Le CDR permettra <strong>de</strong> créer <strong>de</strong> nouvelles structures collectives adaptées à sa taille telles<br />
qu’une cellule <strong>de</strong> valorisation et d’ai<strong>de</strong> aux appels d’offre et aux contrats internationaux.<br />
Enfin, <strong>de</strong>s actions collectives <strong>de</strong> formation <strong>de</strong>s doctorants et <strong>de</strong>s post-doctorants<br />
permettront <strong>de</strong> compléter celles déjà existantes <strong>de</strong> l’Institut <strong>de</strong>s Formations Doctorales <strong>de</strong><br />
l’<strong>UPMC</strong>. Des initiatives seront également mises en œuvre en direction <strong>de</strong>s personnels <strong>de</strong><br />
recherche : IT et IATOS, chercheurs, en vue <strong>de</strong> favoriser leur formation et leur promotion.<br />
Contours <strong>de</strong> la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> CDR<br />
La structure qui est <strong>de</strong>mandée par les acteurs du site est une structure mixte Inserm et<br />
Université.<br />
Le CDR est constitué <strong>de</strong> 15 équipes. Toutes sont labellisées par le MENESR, 14 sont déjà<br />
labellisées Inserm. Une équipe universitaire est considérée comme émergente et la <strong>de</strong>man<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> labellisation Inserm est envisagée pour le prochain quadriennal dans un an.<br />
Ce dossier a fortement évolué par rapport à la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’an <strong>de</strong>rnier. L’équipe 14 du<br />
dossier présent (EA1638 <strong>de</strong> NC Gorin) a <strong>de</strong>mandé et vient d’obtenir sa labellisation Inserm<br />
(UMRS832 Douay). Plusieurs équipes se sont structurées <strong>de</strong> façon à atteindre une meilleure<br />
cohérence scientifique ou du fait <strong>de</strong> leur taille réduite : les personnels <strong>de</strong> l’EA3500 <strong>de</strong><br />
virologie se sont intégrés dans l’équipe 5 du dossier actuel dirigée par S Chwetzoff et J<br />
Masliah. Deux équipes qui font partie <strong>de</strong> l’U515 d’Y Le Bouc se sont regroupées dans<br />
l’équipe 2 actuelle. Il a été décidé que <strong>de</strong>ux équipes EA postulantes dans le dossier antérieur<br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong>raient d’abord une labellisation Inserm avant d’intégrer les CDR (EA1533 <strong>de</strong> P<br />
Bouchard et EA2392 <strong>de</strong> JC Petit). Deux équipes ou chercheurs ont rejoint d’autres projets <strong>de</strong><br />
CDR pour <strong>de</strong>s raisons <strong>de</strong> cohérence thématique : équipe UMRS732 <strong>de</strong> P Kitabgi en<br />
neurosciences qui va rejoindre <strong>de</strong>ux unités sur le site <strong>de</strong> la Pitié, l’une <strong>de</strong>s équipes <strong>de</strong><br />
l’UMRS538 dirigée par P Verroust, qui rejoint l’UMRS592 <strong>de</strong> J Sahel sur la thématique<br />
« développement <strong>de</strong> l’œil ».<br />
Le CDR sera composé <strong>de</strong> 15 équipes:<br />
Equipe 1 Cécile Martinerie (UMRS515)<br />
"Rôles et mécanismes d'action <strong>de</strong> NOV/CCN3 dans les processus <strong>de</strong><br />
différenciation et <strong>de</strong> tumorigénèse"<br />
Equipe 2 Yves Le Bouc (UMRS515)<br />
"Système IGF : développement, croissance et vieillissement"<br />
Equipe 3 Martin Holzenberger (UMRS515)<br />
"Physiopathologie expérimentale et moléculaire <strong>de</strong>s IGF et longévité "<br />
Equipe 4 Michèle Maurice, Clau<strong>de</strong> Wolf (UMRS538)<br />
"Epithéliums et trafic membranaire"<br />
Equipe 5 Serge Chwetzoff, Joëlle Masliah (UMRS538 et ED 3500)<br />
"Inflammation et Infections <strong>de</strong> l’Intestin (I 3 )"<br />
Equipe 6 Azeddine Atfi (UMRS673)<br />
"TGF-β et progression néoplasique"<br />
Equipe 7 Patricia Forgez, Michèle Sabbah (UMRS673)<br />
"Etapes précoces et tardives <strong>de</strong> la progression tumorale <strong>de</strong>s cellules<br />
épithéliales"
Equipe 8 Annette Larsen, Aimery <strong>de</strong> Gramont (UMRS673)<br />
"Biologie et Thérapeutiques du Cancer"<br />
Equipe 9 <strong>Jacqueline</strong> Capeau (UMRS680)<br />
"Pathologie du tissu adipeux et conséquences hépatiques"<br />
Equipe 10 Chantal Housset (UMRS680)<br />
"Pathologies Biliaires, Fibrose et Cancer du Foie"<br />
Equipe 11 Pierre Aucouturier (UMRS712)<br />
"Maladies à prions et système immunitaire"<br />
Equipe 12 Annick Clément (UMRS719)<br />
"Maladies respiratoires chroniques et développement pulmonaire "<br />
Equipe 13 Alex Duval (UMRS762)<br />
"Instabilité <strong>de</strong>s microsatellites et cancers"<br />
Equipe 14 Luc Douay (UMRS832)<br />
"Prolifération et différenciation <strong>de</strong>s cellules souches - Application à la<br />
thérapie cellulaire en hématologie et aux lésions radioinduites "<br />
Equipe 15 Sélim Aractingi (EA4053)<br />
"Cellules souches fœtales"<br />
Le CDR n’est pas organisé en départements.<br />
4<br />
CDR <strong>Saint</strong> <strong>Antoine</strong><br />
Le CDR regroupe 295 personnels <strong>de</strong> recherche (plus les étudiants en M2):<br />
132 chercheurs et enseignants-chercheurs dont 45 chercheurs EPST, 58 chercheurs<br />
hospitalo-universitaires, 20 hospitaliers et 9 universitaires. Parmi eux 88 sont titulaires d’une<br />
HDR.<br />
99 personnels IT et IATOS dont 48 ingénieurs et 51 techniciens<br />
56 étudiants doctorants et chercheurs post-doctorants : 49 doctorants, 7 postdoctorants<br />
(les étudiants M2 n’ont pas été comptabilisés)<br />
8 personnels autres<br />
Du fait <strong>de</strong> l’anticipation d’un an par rapport par rapport à l’échéance du quadriennal, les<br />
unités UMRS constituant le centre ne sont réévaluées ni pour leur activité scientifique ni pour<br />
leur composition par les CSS cette année. La création du CDR pour 5 ans permettra leur<br />
évaluation quadriennale l’an prochain. C’est dans le cadre <strong>de</strong> cette prochaine évaluation que<br />
les <strong>de</strong>ux équipes issues <strong>de</strong> l’UMRS 538 envisagent <strong>de</strong> participer à un projet <strong>de</strong> création d’une<br />
structure <strong>de</strong> recherche interdisciplinaire.<br />
Principes <strong>de</strong> fonctionnement du CDR<br />
La réflexion qui a entouré la rédaction du projet du CDR <strong>Saint</strong>-<strong>Antoine</strong> a concerné<br />
l’ensemble <strong>de</strong> la communauté scientifique du site à travers <strong>de</strong> multiples réunions, <strong>de</strong>s forums<br />
<strong>de</strong> discussion et une large diffusion sur internet. Le CDR fonctionnera avec un directeur et un<br />
comité <strong>de</strong> direction (CD). Il sera épaulé par un CCDR (conseil du centre <strong>de</strong> recherche)<br />
constitué <strong>de</strong> membres élus et nommés. <strong>Jacqueline</strong> Capeau a été élue directeur pour le premier<br />
mandat. Le CD également élu est actuellement composé <strong>de</strong> Clau<strong>de</strong> Carnaud, Chantal Housset,<br />
Yves le Bouc et Françoise Praz. Véronique Soulier a été désignée comme responsable<br />
gestionnaire.
5<br />
CDR <strong>Saint</strong> <strong>Antoine</strong><br />
Les règles <strong>de</strong> fonctionnement du centre ont été validées par le CCDR. Elles privilégient,<br />
sous la responsabilité du directeur, une direction collégiale au sein du comité directeur<br />
assurant la gestion au quotidien et le suivi <strong>de</strong> la politique scientifique, du budget, <strong>de</strong>s<br />
ressources humaines, <strong>de</strong>s actions <strong>de</strong> communication, d’animation, <strong>de</strong> formation et <strong>de</strong><br />
valorisation. Les décisions importantes sont prises par le CCDR dans lequel toutes les équipes<br />
sont représentées ainsi que les différentes catégories <strong>de</strong> personnels du CDR.<br />
Un conseil scientifique formé <strong>de</strong> personnalités extérieures a été désigné pour évaluer et<br />
orienter l’activité scientifique du centre (voir annexe 1, statuts du CDR). Sa composition<br />
actuelle est :<br />
• Alain Beau<strong>de</strong>t, Prési<strong>de</strong>nt-directeur général du Fonds <strong>de</strong> la Recherche en Santé du<br />
Québec, Montréal (Canada)<br />
• Christian Dittrich, Ludwig Boltzmann Institute for Applied Cancer Research, Vienne<br />
(Autriche)<br />
• Albert Geerts, Faculty of Medicine and Pharmacy, Vrije Universiteit Brussel, Jette<br />
(Belgique)<br />
• Camille Locht U629 Inserm, Institut Pasteur, Lille<br />
• Clau<strong>de</strong> Sar<strong>de</strong>t CNRS UMR5535, Institut <strong>de</strong> Génétique Moléculaire, Montpellier<br />
• Jean-Paul Thissen, Unité <strong>de</strong> Diabétologie et <strong>de</strong> Nutrition, Université Libre <strong>de</strong> Louvain,<br />
Bruxelles (Belgique)<br />
Une première réunion est prévue fin mai 2007 pour examiner le dossier <strong>de</strong> CDR et <strong>de</strong>s<br />
équipes qui le constituent avant le CS <strong>de</strong> l’Inserm.<br />
Objectifs généraux du CDR<br />
Ces objectifs se déclinent dans le cadre d’un partenariat étroit avec les autorités <strong>de</strong> tutelle et<br />
les autres composantes du site : Inserm, <strong>UPMC</strong>, <strong>Faculté</strong> <strong>de</strong> Mé<strong>de</strong>cine, AP-HP<br />
Objectifs scientifiques<br />
Mieux organiser le potentiel <strong>de</strong> recherche existant<br />
Renforcer la compétitivité <strong>de</strong>s équipes<br />
Optimiser les interactions scientifiques entre équipes, créer une synergie, favoriser les<br />
échanges<br />
Augmenter la qualité <strong>de</strong> la production scientifique et la visibilité <strong>de</strong> notre recherche vis-à-vis<br />
<strong>de</strong> nos partenaires extérieurs publics et privés dont l’Europe.<br />
Renforcer la recherche translationnelle en collaboration avec l’hôpital et les autres<br />
composantes <strong>de</strong> l’université (site Pitié-Salpétrière, CDR <strong>de</strong>s Cor<strong>de</strong>liers, UFR <strong>de</strong>s Sciences <strong>de</strong><br />
la Vie, <strong>de</strong> Physique, Chimie, Mathématiques, Informatique)<br />
Attirer <strong>de</strong>s moyens matériels et humains<br />
Ai<strong>de</strong>r à l’émergence et à l’attraction <strong>de</strong> nouvelles équipes.<br />
Diminuer les charges administratives reposant sur les chercheurs<br />
Objectifs <strong>de</strong> formation et d’animation<br />
Faciliter l’accueil <strong>de</strong>s étudiants et post-doctorants<br />
Favoriser la promotion et la formation <strong>de</strong> l’ensemble <strong>de</strong>s personnels,<br />
Améliorer l’information et la formation <strong>de</strong>s doctorants et post-doctorants<br />
Renforcer l’animation
6<br />
CDR <strong>Saint</strong> <strong>Antoine</strong><br />
Moyens technologiques et architecturaux pour atteindre ces objectifs<br />
Disposer d’outils performants communs : équipements et services communs<br />
Renforcer les plates-formes technologiques<br />
Faciliter le transfert technologique et le transfert vers l’hôpital<br />
Attirer <strong>de</strong>s start-up<br />
Créer <strong>de</strong> nouvelles surfaces <strong>de</strong> recherche et surfaces communes et réhabiliter les surfaces<br />
actuelles<br />
Outils <strong>de</strong> mutualisation à mettre en place pour atteindre ces objectifs<br />
Améliorer la gestion <strong>de</strong>s ressources et <strong>de</strong>s personnels,<br />
Mettre en commun <strong>de</strong>s moyens,<br />
Mettre en place une gestion commune<br />
Faire <strong>de</strong>s économies d’échelle : marché, équipements, réactifs<br />
Améliorer l’organisation du travail administratif et technique<br />
Mutualiser et échanger les savoir-faire et les réactifs<br />
Dégager du temps pour <strong>de</strong> nouvelles fonctions : marchés, contrats, valorisation, Europe<br />
Dossier scientifique : principaux axes stratégiques<br />
La recherche s’organise autour <strong>de</strong> trois axes scientifiques transversaux qui abor<strong>de</strong>nt plusieurs<br />
aspects <strong>de</strong> la recherche translationnelle :<br />
• aspects fondamentaux tels que la biologie cellulaire, la signalisation, la physiologie<br />
animale,<br />
• aspects précliniques comme la génétique médicale, la génomique et la protéomique,<br />
• aspects <strong>de</strong> physiopathologie, comme la recherche <strong>de</strong> cibles et <strong>de</strong> molécules<br />
thérapeutiques, la thérapie cellulaire,<br />
• enfin aspects à proprement parler cliniques tels que la prévalence et l’épidémiologie <strong>de</strong>s<br />
atteintes cliniques, les nouvelles stratégies diagnostiques et thérapeutiques.<br />
Par rapport à la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> précé<strong>de</strong>nte, une restructuration importante a été réalisée. Un <strong>de</strong>s<br />
axes thématique (épithéliums, relations hôte-pathogène) a été supprimé. Les équipes qui y<br />
participaient se sont fortement restructurées autour <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux équipes au lieu <strong>de</strong> 5 (équipes 4 et<br />
5 du dossier actuel) intégrant l’EA 3500 <strong>de</strong> virologie et recentrant leurs thématiques.<br />
L’EA2392 <strong>de</strong> bactériologie ne fait pas partie <strong>de</strong> la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> cette année. Les 3 axes ont été et<br />
vont être renforcés. L’axe 1 cancérologie a été renforcé par la labellisation Inserm <strong>de</strong> l’équipe<br />
14 (L Douay). L’axe 2, immunité/inflammation et réparation, a intégré les <strong>de</strong>ux équipes issues<br />
<strong>de</strong> l’U538 et <strong>de</strong> l’EA3500. L’axe 4 du projet antérieur a été recentré en supprimant la<br />
reproduction et l’endocrinologie. De ce fait l’EA1533 <strong>de</strong> P Bouchard ne fait plus partie <strong>de</strong> la<br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong>. Cet axe sera renforcé dans sa partie développement dans un an par l’intégration <strong>de</strong><br />
l’Unité Inserm <strong>de</strong> S Amsellem lorsque cette équipe arrivera sur la <strong>Faculté</strong>. Par ailleurs, dans<br />
un souci <strong>de</strong> cohérence scientifique, les personnels <strong>de</strong> l’équipe <strong>de</strong> P Kitabgi (U732), seule<br />
équipe en neurosciences du CDR, vont rejoindre <strong>de</strong>ux unités sur le site <strong>de</strong> la Pitié et cette<br />
équipe ne fait plus partie <strong>de</strong> la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> actuelle. Nous avons nommé un conseil scientifique<br />
extérieur qui se réunira avant le CS <strong>de</strong> l’Inserm pour évaluer ce projet.
1. Axe Cancérologie<br />
7<br />
CDR <strong>Saint</strong> <strong>Antoine</strong><br />
Équipes impliquées:<br />
- Équipe 6 Azeddine Atfi<br />
- Équipe 7 Patricia Forgez, Michèle Sabbah<br />
- Équipe 8 Annette K. Larsen, Aimery <strong>de</strong> Gramont<br />
- Équipe 10 Chantal Housset<br />
- Équipe 13 Alex Duval<br />
- Équipe 14 Luc Douay<br />
Participent également:<br />
- Équipe 1 Cécile Martinerie<br />
- Équipe 2 Yves Le Bouc<br />
- Équipe 15 Sélim Aractingi<br />
Mots clés : Apoptose, Angiogenèse, Cancer colorectal, Cancer du sein, Carcinome<br />
hépatocellulaire, Chimiothérapie, Facteurs <strong>de</strong> croissance, Instabilité <strong>de</strong>s microsatellites,<br />
Métastase, Radiothérapie, Récepteurs à dépendance, Réparation <strong>de</strong> l’ADN, Signalisation<br />
oncogénique.<br />
Introduction<br />
L’hôpital <strong>Saint</strong>-<strong>Antoine</strong>, intégré dans le réseau CancerEst, est particulièrement reconnu dans<br />
le domaine <strong>de</strong>s tumeurs colorectales et hépatiques, tant pour son activité <strong>de</strong> recherche<br />
fondamentale que pour la prise en charge thérapeutique <strong>de</strong>s patients. Avec une inci<strong>de</strong>nce <strong>de</strong><br />
36600 nouveaux cas par an en France, le cancer colorectal (CCR) est au premier rang <strong>de</strong>s<br />
cancers et représente un véritable problème <strong>de</strong> santé publique. Son pronostic reste médiocre,<br />
avec 16 000 décès annuels et une survie à 5 ans <strong>de</strong> 40%. L’i<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong> critères prédictifs<br />
<strong>de</strong> réponse à la chimiothérapie est un enjeu considérable dans le traitement <strong>de</strong>s CCR, puisque<br />
près <strong>de</strong> la moitié <strong>de</strong>s patients récidive ou développe une maladie métastatique qui nécessite<br />
une chimiothérapie dans la majorité <strong>de</strong>s cas. L’hôpital <strong>Saint</strong>-<strong>Antoine</strong>, lea<strong>de</strong>r dans la mise au<br />
point <strong>de</strong> nouveaux protocoles cliniques, a ainsi établi l’actuel standard international pour le<br />
traitement adjuvant du CCR. Le carcinome hépatocellulaire (CHC) est un cancer <strong>de</strong> très<br />
mauvais pronostic (le taux <strong>de</strong> survie à 5 ans est approximativement <strong>de</strong> 2 à 10%) et représente<br />
le <strong>de</strong>uxième cancer digestif en terme <strong>de</strong> fréquence en France (6000 nouveaux cas par an). Il<br />
survient dans plus <strong>de</strong> 80% <strong>de</strong>s cas sur un foie cirrhotique. Actuellement, les ressources<br />
thérapeutiques pour le CHC sont très limitées. La transplantation hépatique est le meilleur<br />
traitement curatif, mais moins <strong>de</strong> 5% <strong>de</strong>s patients peuvent en bénéficier. L’hépatectomie<br />
partielle ou le traitement percutané sont <strong>de</strong>s alternatives mais le risque <strong>de</strong> récidive est très<br />
élevé. La chimio-prévention primaire ou secondaire du CHC est donc considérée comme une<br />
voie <strong>de</strong> développement thérapeutique prioritaire.<br />
La recherche en cancérologie implique 9 équipes, qui, ensemble, abor<strong>de</strong>nt <strong>de</strong>s questions<br />
fondamentales en relation avec les différentes étapes <strong>de</strong> la tumorigenèse, <strong>de</strong> l’initiation du<br />
processus <strong>de</strong> transformation tumorale à l’envahissement métastatique. Certaines équipes<br />
développent également une recherche <strong>de</strong> transfert en étroite collaboration avec les Services<br />
cliniques impliqués: Hépatologie (Pr R. Poupon), Pôle <strong>de</strong>s Maladies Digestives (Pr O.<br />
Chazouillères), Oncologie Clinique (Pr A. <strong>de</strong> Gramont et Pr J.-P. Lotz), Gynécologie (Pr S.<br />
Uzan), Dermatologie (Pr C. Frances), Onco-Hématologie Pédiatrique (Pr G. Leverger), le<br />
Service d’Explorations Fonctionnelles Endocriniennes (Pr Y. Le Bouc) et le Centre
8<br />
CDR <strong>Saint</strong> <strong>Antoine</strong><br />
d’Investigation Clinique. Ces recherches concernent <strong>de</strong>s tumeurs soli<strong>de</strong>s <strong>de</strong> différentes<br />
localisations, ainsi que <strong>de</strong>s tumeurs hématologiques, <strong>de</strong> l’enfant ou <strong>de</strong> l’adulte.<br />
Différents modèles sont utilisés : prélèvements tumoraux humains, lignées cellulaires ou<br />
modèles animaux. La constitution <strong>de</strong> tumorothèques sur les sites <strong>Saint</strong>-<strong>Antoine</strong> et Trousseau<br />
sous la responsabilité <strong>de</strong>s Pr J.F. Fléjou, chef du Service d’Anatomo-Pathologie <strong>de</strong> l’hôpital<br />
<strong>Saint</strong>-<strong>Antoine</strong> (membre <strong>de</strong> l'équipe 13), d’une part, et Pr L. Douay, chef du service<br />
d’Hématologie Biologique <strong>de</strong> l’hôpital Trousseau (responsable <strong>de</strong> l'équipe 14), d’autre part,<br />
sont <strong>de</strong>s atouts majeurs dans la réalisation <strong>de</strong>s projets <strong>de</strong> recherche en Cancérologie.<br />
Les projets choisis pour illustrer l'activité <strong>de</strong> recherche en Cancérologie sont <strong>de</strong>s projets<br />
émergents, associant plusieurs équipes et en relation étroite avec les activités cliniques <strong>de</strong><br />
l'hôpital <strong>Saint</strong>-<strong>Antoine</strong>.<br />
1- Tumeurs <strong>de</strong> phénotype MSI : rôle <strong>de</strong> l’immunité dans le contrôle <strong>de</strong> l’émergence et <strong>de</strong><br />
la prolifération clonale MSI.<br />
Les cancers <strong>de</strong> phénotype dit MSI (pour MicroSatellite Instability) sont caractérisés par une<br />
instabilité <strong>de</strong>s séquences répétées <strong>de</strong> type microsatellite (répétitions <strong>de</strong> motifs <strong>de</strong> 1 à 6<br />
paires <strong>de</strong> bases), résultant <strong>de</strong> l’inactivation du système <strong>de</strong> réparation <strong>de</strong>s mésappariements <strong>de</strong><br />
bases. Ils peuvent être héréditaires ou <strong>de</strong> survenue sporadique. Ils représentent environ 15%<br />
<strong>de</strong>s cancers colorectaux, gastriques ou <strong>de</strong> l’endomètre; le spectre clinique <strong>de</strong> ces tumeurs s’est<br />
récemment étendu à <strong>de</strong> nouvelles localisations (cancers du pancréas, <strong>de</strong> la prostate, <strong>de</strong>s voies<br />
urinaires, …). Les modalités <strong>de</strong> transformation <strong>de</strong>s cancers MSI sont originales car<br />
essentiellement liées à l'accumulation <strong>de</strong> mutations par insertion/délétion dans <strong>de</strong>s gènes<br />
comportant <strong>de</strong>s répétitions codantes, entraînant un décalage du cadre <strong>de</strong> lecture et la synthèse<br />
d'une protéine tronquée inactive. L'équipe 13 (A. Duval) a très largement contribué à<br />
démontrer qu'un tel processus est susceptible d’être oncogénique lorsqu’il affecte <strong>de</strong>s gènes<br />
impliqués dans la régulation du cycle et/ou <strong>de</strong> la prolifération cellulaire, la régulation <strong>de</strong><br />
l’apoptose ou les voies <strong>de</strong> signalisation et <strong>de</strong> réparation <strong>de</strong>s dommages <strong>de</strong> l’ADN. Ainsi, le<br />
gène codant le récepteur <strong>de</strong> type II du TGFß comporte une répétition poly-A10 mutée dans<br />
près <strong>de</strong> 90% <strong>de</strong>s cancers colorectaux MSI, à la transition adénome-adénocarcinome. Les CCR<br />
MSI se caractérisent également pas un caryotype peu remanié, un pronostic plutôt favorable et<br />
une chimiosensibilité particulière (voir chapitre 3.1).<br />
De nombreuses étu<strong>de</strong>s ont mis en évi<strong>de</strong>nce le caractère très immunogène <strong>de</strong>s cancers MSI et<br />
suggèrent un rôle <strong>de</strong> l’immunité dans l’émergence et la prolifération clonale MSI. Des<br />
travaux récents <strong>de</strong> l'équipe 13 ont montré que la survenue <strong>de</strong> lymphomes non hodgkiniens<br />
(LNH) <strong>de</strong> phénotype MSI était favorisée dans certains contextes d’immunodépression<br />
clinique (infection par le VIH, immunosuppression iatrogénique au long cours). Le projet se<br />
poursuit par l'analyse <strong>de</strong>s caractéristiques phénotypiques <strong>de</strong>s cancers MSI survenant dans<br />
différents contextes cliniques d’immunosuppression et/ou d’inflammation chronique: SIDA<br />
(LNH, sarcome <strong>de</strong> Kaposi), greffe d’organe (lymphomes, cancers cutanés), maladies<br />
inflammatoires du tube digestif (MICI) (cancers intestinaux, LNH), polyarthrite rhumatoï<strong>de</strong><br />
(lymphomes, myélodysplasies secondaires, leucémies aiguës), sujet âgé (lymphomes), dont la<br />
collecte est en cours. L'intégration <strong>de</strong> l'équipe 13 au Centre <strong>de</strong> Recherche est particulièrement<br />
propice à la réalisation <strong>de</strong> ce projet qui bénéficie <strong>de</strong>s compétences <strong>de</strong>s équipes impliquées<br />
dans l'axe "Immunité/Inflammation/Infection et Réparation Tissulaire". L'équipe 13 a d'ores et<br />
déjà montré que le phénotype MSI était observé dans environ 10% <strong>de</strong>s cas <strong>de</strong> cancers <strong>de</strong><br />
l’intestin survenant chez <strong>de</strong>s patients atteints <strong>de</strong> MICI (maladie <strong>de</strong> Crohn ou rectocolite<br />
hémorragique). Ces tumeurs MSI ont <strong>de</strong>s caractéristiques cliniques et biologiques différentes<br />
<strong>de</strong>s CCR MSI sporadiques, notamment une absence <strong>de</strong> méthylation anormale du promoteur
9<br />
CDR <strong>Saint</strong> <strong>Antoine</strong><br />
du gène MLH1. En revanche, elles présentent <strong>de</strong>s pertes d’expression variables <strong>de</strong>s gènes<br />
MLH1, MSH2, MSH6 et PMS2, rappelant les LNH MSI <strong>de</strong>s sujets immunodéprimés, et dont<br />
les mécanismes moléculaires sont actuellement à l'étu<strong>de</strong> dans l'équipe.<br />
2- Invasion, métastase<br />
Plus <strong>de</strong> 90 % <strong>de</strong>s décès dus aux cancers résulte <strong>de</strong> la dissémination métastatique. Ce<br />
processus complexe dépend <strong>de</strong>s propriétés intrinsèques <strong>de</strong>s cellules cancéreuses (survie,<br />
apoptose,...), <strong>de</strong> leur interaction avec les cellules stromales et <strong>de</strong> la capacité du microenvironnement<br />
tumoral <strong>de</strong> fournir une "niche" pour l’implantation à distance <strong>de</strong> la tumeur<br />
primitive. Plusieurs équipes étudient les mécanismes fondamentaux <strong>de</strong> la dissémination<br />
métastatique en analysant dans <strong>de</strong>s modèles cellulaires ou animaux l’influence <strong>de</strong> certaines<br />
voies <strong>de</strong> signalisation (récepteurs à dépendance, TGFβ) et/ou <strong>de</strong>s produits <strong>de</strong> certains gènes<br />
capables d’inhiber (NM23, WISP-2) ou <strong>de</strong> potentialiser (neurotensine, nétrine) ce processus.<br />
L’influence <strong>de</strong>s récepteurs à dépendance comme les intégrines et les récepteurs <strong>de</strong> la famille<br />
DCC (Deleted in Colon Cancer), dont UNC5, et leurs ligands respectifs (fibronectine, nétrine)<br />
sur l’invasion et la survie cellulaire est étudiée par l’équipe 7 (C. Gespach et S. Emami). Le<br />
projet consiste à établir le rôle respectif <strong>de</strong> ces récepteurs et <strong>de</strong> leur signalisation sur la survie<br />
(apoptose, nécrose, viabilité cellulaire, réparation <strong>de</strong> l'ADN) et la mobilité cellulaire pendant<br />
l'invasion et le processus métastatique et en réponse à la chimiothérapie ciblant l'intégrité <strong>de</strong><br />
l'ADN (5-FU, dérivés du platine et inhibiteurs <strong>de</strong>s topo-isomérases), et/ou la signalisation<br />
oncogénique. Les signalosomes Akt1/ Akt2, NF-ΚB (en collaboration avec S. Attoub), p53<br />
(p63-p73) et Abl (S. Emami) seront tout particulièrement explorés à l’ai<strong>de</strong> d’inhibiteurs<br />
pharmacologiques et interférence ARN.<br />
Le TGF-β (transforming growth factor beta), considéré comme un suppresseur <strong>de</strong> tumeur<br />
dans les sta<strong>de</strong>s précoces <strong>de</strong> la tumorigenèse, peut également promouvoir la progression<br />
néoplasique dans les sta<strong>de</strong>s tardifs en induisant l’invasion cellulaire. L’équipe 6 (A. Atfi) a<br />
montré que Smad2, un composant <strong>de</strong> la voie <strong>de</strong> signalisation du TGF-β ainsi que TGIF, un<br />
répresseur majeur <strong>de</strong> Smad2, jouent un rôle dans la progression maligne induite par le TGF-β.<br />
L’équipe 6 a i<strong>de</strong>ntifié <strong>de</strong> nouveaux partenaires moléculaires du TGIF et poursuit la<br />
caractérisation du rôle <strong>de</strong> ces nouvelles protéines dans la transformation néoplasique.<br />
NM23, suppresseur <strong>de</strong> métastases dans <strong>de</strong> nombreuses lignées cellulaires agressives, a une<br />
expression inversement corrélée au mauvais pronostic <strong>de</strong> nombreuses tumeurs soli<strong>de</strong>s<br />
humaines, en particulier, sein, colon, foie et mélanomes. L'équipe 10 (M.-L. Lacombe) a<br />
démontré l’effet suppresseur <strong>de</strong> métastases dans un modèle animal développant <strong>de</strong>s cancers<br />
hépatiques. Ce modèle <strong>de</strong> souris doublement transgéniques présente toutes les étapes <strong>de</strong> la<br />
progression tumorale, <strong>de</strong> la formation <strong>de</strong> la tumeur primaire à la dissémination <strong>de</strong>s<br />
métastases. L’invalidation <strong>de</strong> l’expression <strong>de</strong> ce gène par interférence ARN induit <strong>de</strong>s<br />
altérations <strong>de</strong> certaines voies <strong>de</strong> signalisation et <strong>de</strong>s capacités invasives <strong>de</strong> lignées<br />
d’hépatomes (collaboration équipes 7 et 10).<br />
WISP-2 (Wnt1-Induced Secreted Protein-2) co<strong>de</strong> une protéine appartenant à la famille <strong>de</strong>s<br />
protéines CCN. L'équipe 7 (M. Sabbah) a montré que l’expression <strong>de</strong> WISP-2/CCN5 est<br />
augmentée au cours <strong>de</strong> la différenciation cellulaire et que l’expression <strong>de</strong>s transcrits est<br />
inversement corrélée avec le potentiel invasif <strong>de</strong> lignées <strong>de</strong> cancer du sein, comme cela a déjà<br />
été rapporté pour NM23, suggérant l'intervention <strong>de</strong> mécanismes similaires. NOV/CCN3 l’un<br />
<strong>de</strong>s membres <strong>de</strong> la famille CCN cloné par l’équipe 1 (C. Martinerie) est impliqué dans la<br />
tumorigenèse corticosurrénalienne; son rôle comme suppresseur potentiel <strong>de</strong> tumeurs est<br />
étudié par l'équipe 1 en collaboration avec E. Lalli (UMR 6097) et l'équipe 13 (F. Praz).
10<br />
CDR <strong>Saint</strong> <strong>Antoine</strong><br />
L'équipe 7 (P. Forgez) a montré que la neurotensine, un pepti<strong>de</strong>-hormone du système gastrointestinal,<br />
est un facteur potentialisant la croissance et l'agressivité tumorales. Une boucle <strong>de</strong><br />
régulation autocrine et paracrine a pu être observée chez l'homme dans les cancers du<br />
poumon, du mésothéliome et du sein. L'expression du récepteur à la neurotensine (NT-1) est<br />
corrélée avec la taille <strong>de</strong> la tumeur, le nombre <strong>de</strong> ganglions envahis et la mortalité <strong>de</strong>s<br />
patientes atteintes <strong>de</strong> cancer du sein intra-canalaire. Les effets <strong>de</strong> la neurotensine sur la survie,<br />
la prolifération, la mobilité et l'invasion cellulaire sont probablement à l'origine <strong>de</strong> ces<br />
observations et suggèrent un rôle déterminant <strong>de</strong> la neurotensine dans la progression tumorale<br />
<strong>de</strong> certains cancers.<br />
L’angiogenèse tumorale est également impliquée dans le risque d’invasion métastatique <strong>de</strong><br />
certaines tumeurs. L’équipe 15 (S. Aractingi) a récemment montré que <strong>de</strong>s progéniteurs<br />
fœtaux peuvent migrer vers la peau et s’y différencier en cellules endothéliales. Le mélanome<br />
et le carcinome mammaire sont <strong>de</strong>s tumeurs fréquentes pendant la grossesse au cours <strong>de</strong><br />
laquelle elles présentent une sévérité accrue. L’influence <strong>de</strong> la grossesse sur l’angiogenèse<br />
tumorale, par l’intermédiaire ou non <strong>de</strong> cellules fœtales migrant dans la tumeur, pourrait<br />
expliquer leur gravité. Cette équipe a initié un travail sur l’angiogenèse étudiée dans <strong>de</strong>s<br />
tumeurs, chez les femmes et dans <strong>de</strong>s modèles murins pendant la grossesse, en comparant à<br />
<strong>de</strong>s tumeurs appariées survenant en <strong>de</strong>hors <strong>de</strong> la gestation; l'analyse <strong>de</strong> l’évolution<br />
métastatique, pendant et en <strong>de</strong>hors <strong>de</strong> la grossesse, représente un objectif majeur <strong>de</strong> ce projet.<br />
Les objectifs <strong>de</strong>s travaux entrepris visent à i<strong>de</strong>ntifier les mécanismes, les effecteurs et les<br />
signalisations modulant la formation et l'agressivité <strong>de</strong>s tumeurs par 1) <strong>de</strong>s approches<br />
moléculaires comparatives ("microarray" et protéomique <strong>de</strong>s tissus normaux et tumoraux et<br />
<strong>de</strong>s métastases) 2) l'analyse <strong>de</strong>s conséquences <strong>de</strong> l'extinction <strong>de</strong> l’expression <strong>de</strong>s gènes<br />
d'intérêt par interférence ARN sur les processus métastatiques et oncogéniques 3) la recherche<br />
<strong>de</strong>s facteurs régulant ces gènes.<br />
L'étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s mécanismes moléculaires associés aux effets modulateurs <strong>de</strong> ces protéines sur<br />
l’agressivité tumorale <strong>de</strong>vrait permettre d’i<strong>de</strong>ntifier <strong>de</strong> nouveaux signaux et/ou <strong>de</strong> nouvelles<br />
cibles impliqués dans la dissémination métastatique. Des étu<strong>de</strong>s précliniques visant à définir<br />
le statut (mutations, délétions, remaniements, niveau d'expression...) <strong>de</strong> ces différents acteurs<br />
dans <strong>de</strong>s tumeurs humaines à différents sta<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la progression néoplasique permettront <strong>de</strong><br />
préciser l'impact diagnostique et pronostic <strong>de</strong> ces anomalies grâce à la tumorothèque <strong>de</strong><br />
l'hôpital <strong>Saint</strong>-<strong>Antoine</strong>.<br />
3- Thérapie <strong>de</strong>s cancers<br />
3-1. I<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong> facteurs prédictifs <strong>de</strong> réponse <strong>de</strong>s cancers à la chimiothérapie<br />
L'arsenal thérapeutique disponible pour le traitement <strong>de</strong>s patients atteints <strong>de</strong> CCR s'est<br />
considérablement accru ces <strong>de</strong>rnières années notamment avec l’utilisation <strong>de</strong> nouveaux<br />
agents alkylants, d'inhibiteurs <strong>de</strong> topo-isomérases, seuls ou en association. Néanmoins,<br />
seuls certains patients tirent bénéfice <strong>de</strong> ces traitements qui présentent une toxicité parfois<br />
invalidante et un coût très important pour le système <strong>de</strong> santé publique, justifiant le<br />
développement <strong>de</strong> recherches visant à optimiser la prise en charge thérapeutique <strong>de</strong>s patients.<br />
Plusieurs équipes du CDR <strong>Saint</strong>-<strong>Antoine</strong> ont une expertise reconnue dans l'étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s agents<br />
capables d'interagir avec l'ADN pour le traitement du CCR, alliant <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s fondamentales<br />
<strong>de</strong>s mécanismes d'action <strong>de</strong>s drogues et <strong>de</strong>s réponses cellulaires (équipe 8 et 13, A. Larsen et<br />
F. Praz), <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s translationnelles (équipe 13, J.-F. Fléjou et F. Praz) et <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s<br />
cliniques pour lesquelles le service d'Oncologie Médicale <strong>de</strong> l'hôpital <strong>Saint</strong>-<strong>Antoine</strong> (équipe<br />
8, A. <strong>de</strong> Gramont) occupe une place <strong>de</strong> lea<strong>de</strong>r mondial.
11<br />
CDR <strong>Saint</strong> <strong>Antoine</strong><br />
En ce qui concerne le CHC, les ressources thérapeutiques sont bien plus limitées. Toutefois,<br />
les nouvelles thérapies ciblées anti-récepteurs EGFR et IGF-1R pourraient offrir <strong>de</strong> réelles<br />
perspectives en terme <strong>de</strong> chimio-prévention primaire ou secondaire du CHC. En particulier,<br />
l’équipe 10 (O Rosmorduc, C Desbois-Mouthon) a récemment montré que le gefitinib, un<br />
inhibiteur spécifique <strong>de</strong> l’activité tyrosine kinase d’EGFR, inhibe le développement du CHC<br />
dans un modèle <strong>de</strong> cancérogenèse sur cirrhose induite chez le rat. Cependant, <strong>de</strong>s données<br />
obtenues in vivo et in vitro suggèrent que l’activation <strong>de</strong> voies <strong>de</strong> signalisation initiée par<br />
l’IGF-II et relayée par son récepteur IGF-1R pourrait induire une résistance aux anti-EGFR.<br />
Le transfert <strong>de</strong> cette recherche vers la clinique se fait en collaboration avec le service<br />
d'Hépatologie au sein du pôle Maladies digestives <strong>de</strong> l'hôpital <strong>Saint</strong>-<strong>Antoine</strong>.<br />
Nos projets développés dans le cadre du CCR et du CHC s’organisent selon un continuum<br />
allant <strong>de</strong> la recherche fondamentale vers la recherche clinique et poursuivent les mêmes<br />
objectifs. Ils se proposent <strong>de</strong> caractériser les mécanismes d'action <strong>de</strong> ces nouveaux agents<br />
anti-cancéreux et <strong>de</strong> rechercher <strong>de</strong>s facteurs cellulaires (génétiques et épigénétiques)<br />
prédictifs <strong>de</strong> la réponse cellulaire aux molécules d'intérêt. Les observations pré-cliniques<br />
seront ensuite confirmées dans différents modèles animaux. Les aspects fondamentaux et précliniques<br />
pourront également être analysés dans <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s cliniques rétrospectives grâce à la<br />
collection <strong>de</strong> prélèvements fixés en paraffine et <strong>de</strong>s tumeurs congelées regroupées dans la<br />
tumorothèque <strong>de</strong> l'hôpital <strong>Saint</strong>-<strong>Antoine</strong> (sous la responsabilité <strong>de</strong> J.-F. Fléjou, équipe 13).<br />
Les étu<strong>de</strong>s en cours dans le Département d'Oncologie Clinique (A. <strong>de</strong> Gramont, équipe 7)<br />
visant à développer <strong>de</strong>s approches expérimentales permettant d'isoler <strong>de</strong>s cellules tumorales<br />
circulantes sont particulièrement prometteuses dans ce domaine car elles permettent l'accès à<br />
<strong>de</strong>s cellules tumorales en temps réel. L’ensemble <strong>de</strong> ces travaux <strong>de</strong>vrait permettre d’optimiser<br />
les cinétiques d’administration et les combinaisons <strong>de</strong> ces différents inhibiteurs dans le<br />
traitement du CCR et du CHC.<br />
3-2. I<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong> gènes impliqués dans le phénotype leucémique Malgré une<br />
amélioration régulière <strong>de</strong>s chimiothérapies appliquées au traitement <strong>de</strong>s leucémies aigües<br />
myéloblastiques (LAM) <strong>de</strong> l’enfant, 40% d’entre eux présenteront une rechute <strong>de</strong> leur cancer.<br />
Pour améliorer la survie globale <strong>de</strong> ces patients, l'i<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong> gènes impliqués dans la<br />
constitution du phénotype leucémique sera entreprise par l’équipe 14 (H. Lapillonne, A.<br />
Auvrignon, J. Landman-Parker and G. Leverger) afin d'isoler (1) <strong>de</strong> nouveaux marqueurs<br />
pronostiques, (2) les LAM <strong>de</strong> mauvais pronostic, (3) la valeur prédictive <strong>de</strong> la quantification<br />
<strong>de</strong> la maladie résiduelle dans le suivi <strong>de</strong>s patients. Une attention particulière sera portée à<br />
<strong>de</strong>ux gènes, WT1 (Wilms’ Tumor gene) et EVI1 (Ecotropic viral integration site 1) et aux<br />
mécanismes <strong>de</strong> leur hyperexpression rencontrée respectivement dans 80% et 20% <strong>de</strong>s cas <strong>de</strong><br />
LAM <strong>de</strong> l’enfant. Pour comprendre les mécanismes impliqués, l'équipe utilisera <strong>de</strong>s<br />
techniques <strong>de</strong> CGH array, et étudiera l’état <strong>de</strong> méthylation <strong>de</strong> ces gènes et l’effet <strong>de</strong> leur<br />
extinction par interférence ARN.<br />
3-3. Thérapie cellulaire: prévention <strong>de</strong>s effets secondaires <strong>de</strong> la radiothérapie<br />
anticancéreuse par injection localisée <strong>de</strong> cellules souches mésenchymateuses (CSM)<br />
Chez l'homme, <strong>de</strong>s CSM ont été utilisées avec succès pour <strong>de</strong>s réparations tissulaires,<br />
notamment après brûlures, irradiation acci<strong>de</strong>ntelle ou dans <strong>de</strong>s cas d’aplasies médullaires. Les<br />
traitements du cancer rectal chez l’homme par radiothérapie combinée à la chimiothérapie<br />
sont souvent accompagnés d’effets secondaires par atteinte <strong>de</strong>s tissus sains irradiés. L’équipe<br />
14 (M. Lopez, A. Chapel et L. Douay) a démontré, chez le rat, que ces CSM possè<strong>de</strong>nt un<br />
tropisme pour les cryptes <strong>de</strong> l’intestin grêle caractérisées par le renouvellement constant <strong>de</strong>s<br />
progéniteurs <strong>de</strong> l’épithélium intestinal. Le projet consiste à vali<strong>de</strong>r l’hypothèse selon laquelle<br />
les CSM seraient capables <strong>de</strong> protéger la muqueuse colorectale contre les effets délétères <strong>de</strong> la<br />
radiothérapie, en utilisant le modèle <strong>de</strong> cancer du côlon chimio-induit chez le rat mis au point
12<br />
CDR <strong>Saint</strong> <strong>Antoine</strong><br />
par l’équipe 7 (M.-E. Forgue-Lafitte, S. Emami et C. Gespach), dans lequel l'apparition <strong>de</strong><br />
foyers <strong>de</strong> cryptes aberrantes (ACF) précè<strong>de</strong> le développement d'adénomes et<br />
d'adénocarcinomes sur certains ACF exprimant le marqueur oncofœtal MUC5AC. Le<br />
traitement par CSM lors <strong>de</strong> la formation <strong>de</strong>s ACF permettra <strong>de</strong> vérifier : le tropisme <strong>de</strong> ces<br />
cellules vers les cryptes colorectales et ces lésions ACF, l’impact <strong>de</strong> ces cellules sur la<br />
formation <strong>de</strong> ces lésions et leur évolution vers le carcinome et la métastase. Une <strong>de</strong>uxième<br />
étape consistera à effectuer une irradiation localisée sur <strong>de</strong>s rats ayant développé les tumeurs<br />
colorectales, et <strong>de</strong> leur injecter <strong>de</strong>s CSM (marquées à la GFP) afin d’évaluer la diminution <strong>de</strong>s<br />
effets secondaires <strong>de</strong> la radiothérapie et l’efficacité <strong>de</strong> la chimiothérapie. Le rôle <strong>de</strong>s CSM<br />
médullaires sera exploré au niveau <strong>de</strong>s lésions précancéreuses et carcinomateuses du côlon et<br />
<strong>de</strong>s atteintes inflammatoires <strong>de</strong> la muqueuse intestinale (modèles animaux <strong>de</strong> colites /maladie<br />
<strong>de</strong> Crohn) selon trois directions: 1) la croissance tumorale, la dispersion métastatique et le<br />
tropisme <strong>de</strong>s cellules cancéreuses vers <strong>de</strong>s tissus cibles "spécifiques" (ganglions, poumon,<br />
foie...), 2) les réponses à la radiothérapie et à la chimiothérapie (réparation, impact<br />
thérapeutique et survie <strong>de</strong>s cellules cancéreuses résiduelles), 3) la progression ou la régression<br />
<strong>de</strong> la réaction inflammatoire.<br />
Le CDR <strong>Saint</strong>-<strong>Antoine</strong> possè<strong>de</strong> une expertise reconnue internationalement dans la domaine<br />
<strong>de</strong> la cancérologie tant en recherche fondamentale (signalisation oncogénique, altérations<br />
génétiques,...) qu’en recherche clinique (chirurgie, oncologie médicale, tumorothèque...),<br />
permettant un transfert optimal <strong>de</strong>s connaissances <strong>de</strong> la clinique vers la recherche<br />
fondamentale et réciproquement. L'i<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong> nouvelles cibles moléculaires et la<br />
caractérisation <strong>de</strong>s voies <strong>de</strong> signalisation impliquées dans la progression tumorale et dans la<br />
réponse aux différents traitements <strong>de</strong>vraient permettre <strong>de</strong> définir <strong>de</strong> nouvelles stratégies<br />
thérapeutiques.<br />
2. Axe Immunité/Inflammation/Infection et Réparation Tissulaire<br />
Équipes impliquées:<br />
- Équipe 4 Michèle Maurice, Clau<strong>de</strong> Wolf<br />
- Équipe 5 Serge Chwetzoff, Joëlle Masliah<br />
- Équipe 10 Chantal Housset<br />
- Équipe 11 Pierre Aucouturier<br />
- Equipe 12 Annick Clément<br />
- Equipe 15 Selim Aractingi<br />
Participent également:<br />
- Équipe 3 Martin Holzenberger<br />
- Équipe 9 <strong>Jacqueline</strong> Capeau<br />
- Équipe 14 Luc Douay<br />
Mots clés : Immunité innée et adaptative, inflammation, cytokines, chimiokines, fibrose,<br />
stress oxydant, régénération, dégénérescence, mucoviscidose, maladies à prion,<br />
lipodystrophies, cirrhose, pathologie respiratoire, épithélium intestinal, infections intestinales,<br />
maladies inflammatoires chroniques intestinales (MICI), flore intestinale<br />
Les maladies inflammatoires et infectieuses sont associées à un déséquilibre <strong>de</strong>s voies <strong>de</strong><br />
communication et <strong>de</strong> signalisation réglant le fonctionnement normal <strong>de</strong>s tissus et <strong>de</strong>s cellules.<br />
L’immunité au sens large du terme, recouvre <strong>de</strong>s mécanismes allant <strong>de</strong> l’inflammation à<br />
l’immunité adaptative, dont la finalité est <strong>de</strong> préserver l’intégrité <strong>de</strong>s tissus contre les
13<br />
CDR <strong>Saint</strong> <strong>Antoine</strong><br />
dommages d’origine endogène ou exogène, notamment d’origine infectieuse. Ces<br />
mécanismes mettent en jeu un réseau <strong>de</strong> médiateurs (chimiokines et cytokines) et <strong>de</strong><br />
récepteurs, dont les effets sont pro-inflammatoires pour certains, anti-inflammatoires pour<br />
d’autres. C’est <strong>de</strong> l’équilibre entre ces différents médicateurs que dépend l’issue favorable <strong>de</strong><br />
la réponse aux dommages (régénération sans séquelle <strong>de</strong>s tissus) ou défavorable (autoimmunité,<br />
inflammation chronique, fibrose, cancer). Seule une approche intégrative <strong>de</strong> la<br />
biologie <strong>de</strong> l’ensemble <strong>de</strong>s cellules impliquées dans ces mécanismes est à même <strong>de</strong> répondre<br />
aux nombreuses questions non résolues en pathologie. Les équipes impliquées dans l’axe<br />
Immunité/Inflammation/Infection et Réparation Tissulaire travaillent pour l’essentiel sur<br />
<strong>de</strong>s tissus épithéliaux (foie, intestin, poumon, peau) mais aussi le tissu adipeux. Dans tous ces<br />
tissus, les cellules du système immunitaire jouent un rôle majeur dans l’orchestration du<br />
déclenchement et <strong>de</strong> la régression <strong>de</strong>s processus inflammatoires et infectieux. Tout en<br />
travaillant sur <strong>de</strong>s organes et <strong>de</strong>s pathologies différentes, les équipes impliquées dans cet axe<br />
partagent <strong>de</strong>s hypothèses pathogéniques, <strong>de</strong>s modèles expérimentaux et <strong>de</strong>s outils<br />
technologiques communs. Les collaborations actuelles et futures s’organisent autour <strong>de</strong>s<br />
thèmes suivants :<br />
1 - Immunité/Inflammation/Infection<br />
Constituée d’immunologistes, l’Equipe 11 (P. Aucouturier, C Carnaud) étudie les interactions<br />
entre le système immunitaire et les prions. Cette équipe a été la première à démontrer le rôle<br />
clé <strong>de</strong>s cellules <strong>de</strong>ndritiques dans la propagation <strong>de</strong>s prions. Les objectifs <strong>de</strong> l’équipe sont <strong>de</strong><br />
déterminer la nature <strong>de</strong>s cellules impliquées dans le transport et la réplication <strong>de</strong>s prions à la<br />
phase pré-neurologique <strong>de</strong> la maladie, le rôle <strong>de</strong> la protéine prion (PrP) dans les interactions<br />
fonctionnelles entre sous-populations du système immunitaire, et les mécanismes <strong>de</strong> la<br />
tolérance immunologique aux prions dans le but <strong>de</strong> développer <strong>de</strong>s approches<br />
immunothérapeutiques. L’équipe 4 (M Maurice, C Wolf) possè<strong>de</strong> une expertise sur le trafic<br />
intracellulaire et a développé <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s sur le trafic polarisé <strong>de</strong> la protéine prion dans les<br />
cellules intestinales qui constituent un apport à cette thématique. l’Equipe 11 interagit avec<br />
l’équipe 15 (S Aractingi) sur la contribution <strong>de</strong>s cellules foetales à la restauration <strong>de</strong><br />
l’immunité chez la mère. Les <strong>de</strong>ux équipes ont <strong>de</strong>s techniques communes d’évaluation<br />
fonctionnelle <strong>de</strong>s lymphocytes, et <strong>de</strong>s modèles animaux trangéniques comme <strong>de</strong>s souris<br />
porteuses <strong>de</strong> TCR dirigés contre <strong>de</strong>s épitopes <strong>de</strong> classe I et II <strong>de</strong> l’ovalbumine.<br />
L’inflammation joue un rôle clé dans les lipodystrophies, maladies caractérisées par <strong>de</strong>s<br />
anomalies <strong>de</strong> répartition du tissu adipeux. L’Equipe 9 (J. Capeau) travaille sur les<br />
lipodystrophies induites par les traitements antirétroviraux <strong>de</strong> l’infection VIH. Le tissu<br />
adipeux est capable <strong>de</strong> sécréter en réponse aux molécules anti-rétrovirales <strong>de</strong>s cytokines proinflammatoires<br />
(TNF-α, IL-6, IL-1β). Le rôle délétère <strong>de</strong> l’IL-6 et <strong>de</strong> l’IL-1β sur les fonctions<br />
adipocytaires a été montré (M Caron). Une infiltration <strong>de</strong> macrophages et <strong>de</strong> cellules<br />
<strong>de</strong>ndritiques est observée dans le tissu adipeux <strong>de</strong>s patients. Les projets portent sur le rôle du<br />
système immunitaire dans la survenue <strong>de</strong> ces lipodystrophies et <strong>de</strong> leurs conséquences<br />
hépatiques (JP Bastard). En collaboration avec l’Equipe 11 (P. Aucouturier), il est prévu<br />
d’analyser le profil phénotypique et fonctionnel <strong>de</strong>s cellules immunitaires du tissu adipeux <strong>de</strong><br />
sujets infectés par le VIH en comparaison avec <strong>de</strong>s contrôles, <strong>de</strong>s sujets obèses et <strong>de</strong>s patients<br />
porteurs <strong>de</strong> mutations dans le gène <strong>de</strong> la lamine A/C. Les étu<strong>de</strong>s réalisées in vitro visent à<br />
analyser les mécanismes par l’intermédiaire <strong>de</strong>squels, différentes classes <strong>de</strong> molécules antirétrovirales<br />
modifient la production <strong>de</strong> différentes cytokines proinflammatoires et<br />
d’adiponectine.
14<br />
CDR <strong>Saint</strong> <strong>Antoine</strong><br />
Enfin, les équipes 9 (J. Capeau, L Serfaty) et 10 (C. Housset) développent ensemble un projet<br />
sur l’expression <strong>de</strong>s cytokines et chimiokines au cours <strong>de</strong>s sta<strong>de</strong>s évolutifs successifs <strong>de</strong><br />
stéatose, stéatohépatite, et fibrose hépatique chez les patients ayant une lipodystrophie ou un<br />
syndrome métabolique, par l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> biopsies humaines et à l’ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> différents modèles<br />
murins. Les relations entre infection par le virus <strong>de</strong> l’hépatite C et insulinorésistance sont<br />
également étudiées dans ce contexte.<br />
Le CDR bénéficie <strong>de</strong> la proximité d’équipes cliniques qui abor<strong>de</strong>nt d’autres aspects <strong>de</strong>s<br />
pathologies inflammatoires humaines ou <strong>de</strong> la composante inflammatoire <strong>de</strong> pathologies<br />
infectieuses en se concentrant sur le tube digestif. Ainsi l’équipe 5 (S Chwetzoff, J Masliah)<br />
s’intéresse aux voies <strong>de</strong> signalisation du stress et <strong>de</strong> l’inflammation impliquées dans différents<br />
types <strong>de</strong> pathologies intestinales. Dans l’infection à rotavirus, le stress cellulaire induit et ses<br />
conséquences sur le cycle viral sont étudiés. Dans la maladie <strong>de</strong> Crohn, le rôle <strong>de</strong> la flore<br />
commensale sur le déclenchement <strong>de</strong> l’inflammation digestive chronique à travers son<br />
interaction avec les récepteurs TLR <strong>de</strong>s cellules <strong>de</strong> la muqueuse intestinale fait l’objet <strong>de</strong><br />
plusieurs projets qui pourraient être développés en collaboration avec l’équipe 11. Dans les<br />
cancers colorectaux, le rôle <strong>de</strong>s médiateurs lipidiques dans la transition inflammationprolifération-invasion<br />
métastatique pourra être analysé en collaboration avec <strong>de</strong>s équipes <strong>de</strong><br />
l’axe « Cancerologie ».<br />
2 - Réparation Tissulaire<br />
L’inflammation et l’immunité conditionnent la régénération <strong>de</strong>s épithéliums qui constitue un<br />
aspect majeur <strong>de</strong> la réparation tissulaire. Les mécanismes <strong>de</strong> la régénération épithéliale sont<br />
étudiés par différentes équipes dans le contexte <strong>de</strong>s maladies inflammatoires pulmonaires,<br />
hépatiques, biliaires et intestinales, notamment au cours <strong>de</strong> la mucoviscidose et <strong>de</strong>s MICI.<br />
L’inflammation chronique est particulièrement cruciale pour la pathologie respiratoire <strong>de</strong> la<br />
mucoviscidose étudiée par l’Equipe 12 (A. Clément). Les travaux <strong>de</strong> cette équipe portent sur<br />
la régulation <strong>de</strong> production <strong>de</strong> médiateurs pro et anti-inflammatoires, en particulier les<br />
interleukines IL-8, IL-6, IL-10, ainsi que les voies <strong>de</strong> signalisation impliquées (MAP kinases,<br />
NF-kB), et les conséquences sur l'apoptose <strong>de</strong>s neutrophiles. Les étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> l’équipe 10 (C.<br />
Housset) visent à i<strong>de</strong>ntifier les facteurs responsables <strong>de</strong> lésions fibrogéniques du foie et <strong>de</strong>s<br />
voies biliaires, parfois sévères, également associées à la mucoviscidose. Ces <strong>de</strong>ux équipes<br />
travaillent ensemble sur différents modèles murins <strong>de</strong> souris CF. Les atteintes biliaires <strong>de</strong> la<br />
mucoviscidose et d’autre maladies biliaires <strong>de</strong> nature inflammatoire, comme celles qui sont<br />
associées aux défauts génétiques du transporteur <strong>de</strong>s phospholipi<strong>de</strong>s, MDR3, font également<br />
l’objet <strong>de</strong> travaux à la fois <strong>de</strong>s équipes 10 et 4 (M. Maurice & C. Wolf). Cette <strong>de</strong>rnière équipe<br />
a pour expertise le trafic membranaire <strong>de</strong> transporteurs <strong>de</strong> la famille MDR, en particulier<br />
MDR3, et l’analyse <strong>de</strong>s aci<strong>de</strong>s biliaires. Ces travaux font l’objet <strong>de</strong> nouvelles collaborations<br />
entre les <strong>de</strong>ux équipes, et s’inscrivent dans une activité <strong>de</strong> transfert importante vers l’hôpital.<br />
Citons pour exemple, le génotypage <strong>de</strong> MDR3 chez les patients, la spectrométrie <strong>de</strong> masse<br />
<strong>de</strong>s aci<strong>de</strong>s biliaires dans les maladies inflammatoires biliaires chez les patients et dans les<br />
modèles animaux, le dosage <strong>de</strong>s lécithines biliaires dans les déficits du transporteur MDR3.<br />
La réparation tissulaire dépend en gran<strong>de</strong> partie <strong>de</strong> facteurs <strong>de</strong> croissance qui interviennent<br />
dans le contrôle <strong>de</strong> la prolifération <strong>de</strong>s cellules épithéliales. Les équipes qui travaillent sur la<br />
réparation tissulaire du foie (Equipe 10, C. Housset) et du poumon (Equipe 12, A. Clément)<br />
ont un intérêt particulier pour le système <strong>de</strong>s Insulin like growth factor (IGF). Dans le<br />
poumon, ce système joue un rôle dominant dans la ré-épithélialisation <strong>de</strong> la surface <strong>de</strong>s voies
15<br />
CDR <strong>Saint</strong> <strong>Antoine</strong><br />
respiratoires. L’Equipe 12 a pour objectif d’i<strong>de</strong>ntifier les mécanismes responsables <strong>de</strong> la<br />
régulation d’IGF-I, <strong>de</strong> son récepteur IGF-IR, et <strong>de</strong> la protéine <strong>de</strong> liaison IGFBP-2, et <strong>de</strong><br />
préciser comment ce système interagit avec les acteurs principaux du cycle cellulaire. Au<br />
cours <strong>de</strong>s maladies chroniques du foie, les mécanismes <strong>de</strong> régénération et <strong>de</strong> fibrogenèse<br />
aboutissent à la constitution d’une cirrhose, principal facteur <strong>de</strong> risque du carcinome<br />
hépatocellulaire. La dérégulation <strong>de</strong>s voies intervenant dans la carcinogenèse se produit dès<br />
les sta<strong>de</strong>s précoces <strong>de</strong> la réparation tissulaire hépatique. C’est le cas <strong>de</strong> l’IGF-1 qui agit <strong>de</strong><br />
plus sur la régénération hépatocellulaire, la survie, la prolifération et l’état <strong>de</strong> différenciation<br />
<strong>de</strong>s différents types <strong>de</strong> cellules fibrogéniques du foie. L’équipe 10 a développé plusieurs<br />
modèles <strong>de</strong> régénération hépatique sans séquelle (post-hépatectomie) et avec fibrose<br />
hépatique (ischémie biliaire, ligature <strong>de</strong> la voie biliaire, tétrachlorure <strong>de</strong> carbone,<br />
diéthylnitrosamine) lui permettant d’étudier les voies impliquées dans les <strong>de</strong>ux types <strong>de</strong><br />
réponse favorable et défavorable. Ces <strong>de</strong>ux équipes utilisent différents modèles <strong>de</strong> souris<br />
invalidées pour IGF-IR en collaboration avec l’Equipe 3 (M. Holzenberger).<br />
3 - Contribution <strong>de</strong>s cellules progénitrices à la réparation tissulaire<br />
Les cellules fœtales constituent un contingent <strong>de</strong> cellules transférées et spontanément tolérées<br />
chez les mères au long cours. Au sein <strong>de</strong> cette population, il existe <strong>de</strong>s cellules capables<br />
d’induire <strong>de</strong>s réactions immunes mais surtout <strong>de</strong>s cellules souches hématopoiétiques et<br />
mésenchymales. Ces cellules peuvent persister dans <strong>de</strong>s sites maternels sains (niches) comme<br />
le mœlle osseuse et migrer vers <strong>de</strong>s sites maternels lésés afin <strong>de</strong> participer à la réparation<br />
tissulaire. L’Equipe 15 (S. Aractingi) a précé<strong>de</strong>mment montré dans <strong>de</strong>s modèles murins la<br />
participation <strong>de</strong> progéniteurs fœtaux à l’angiogénèse accompagnant <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rmites<br />
d’hypersensibilité. Cette équipe poursuit l’objectif d’évaluer (a) l’intervention <strong>de</strong> cellules<br />
fœtales dans <strong>de</strong>s phénomènes <strong>de</strong> cicatrisation cutanée altérée chez <strong>de</strong>s mères, en collaboration<br />
avec l’Equipe 14 (L. Douay) et l’équipe 3 (M Holzenberger) dans <strong>de</strong>s souris avec un KO<br />
<strong>de</strong>rmique ou épi<strong>de</strong>rmique <strong>de</strong> IGF1-R (b) la fonctionnalité <strong>de</strong>s lymphocytes issus <strong>de</strong><br />
progéniteurs fœtaux chez <strong>de</strong>s mères immunodéficientes en s’appuyant sur <strong>de</strong>s croisements<br />
RAG° x souris monoclonales pour un antigène, en collaboration avec l’Equipe 11 (P.<br />
Aucouturier).<br />
L’Equipe 14 (L. Douay) a pour objectif <strong>de</strong> démontrer l’efficacité thérapeutique <strong>de</strong>s cellules<br />
souches mésenchymateuses humaines (CSM) à l’ai<strong>de</strong> notamment d’un modèle d’irradiation<br />
chez la souris immunotolérante NOD/SCID. Dans ce modèle, les cellules souches<br />
mésenchymateuses migrent majoritairement vers les sites <strong>de</strong> lésions radio induits (intestin,<br />
peau, moelle osseuse). Le potentiel thérapeutique <strong>de</strong>s cellules souches mésenchymateuses a<br />
été validé au niveau <strong>de</strong>s atteintes <strong>de</strong> la peau et du système digestif. Les prochains objectifs<br />
sont d’étudier les mécanismes impliqués dans la réparation tissulaire et également dans le rôle<br />
immunosuppresseur <strong>de</strong>s cellules souches mésenchymateuses. Les premiers résultats indiquent<br />
que la régénération tissulaire par les cellules souches mésenchymateuses implique <strong>de</strong>s<br />
facteurs trophiques plutôt qu’une reconstruction tissulaire après irradiation.
3. Axe Développement, Métabolisme et Vieillissement<br />
Equipes impliquées<br />
- Equipe 1 : C. Martinerie<br />
- Equipe 2 : Y. Le Bouc<br />
- Equipe 3 : M. Holzenberger<br />
- Equipe 9 : J. Capeau<br />
16<br />
CDR <strong>Saint</strong> <strong>Antoine</strong><br />
Mots clés<br />
Système IGF (Insulin like growth factor), NOV et gènes <strong>de</strong> la famille CCN, résistance à<br />
l’insuline, lipodystrophie, laminopathie, développement, croissance, périnatologie,<br />
vieillissement,<br />
Introduction<br />
Cet axe thématique regroupe 4 équipes du Centre <strong>de</strong> Recherche dont l’activité <strong>de</strong> recherche<br />
fondamentale, physiopathologique ou clinique intéresse le développement du fœtus, la<br />
croissance, le métabolisme et le vieillissement. Notre recherche concerne les mécanismes<br />
moléculaires, cellulaires, biochimiques, génétiques, épigénétiques, physiologiques ou<br />
pathologiques en cause dans ces processus.<br />
- Une expertise nationale et internationale est reconnue aux équipes du CDR dans ces<br />
domaines <strong>de</strong> recherche : IGF et longévité ; résistance à l’insuline et complications, tissu<br />
adipeux et lipodystrophies, vieillissement ; pathologies <strong>de</strong> la croissance staturale du fœtus et<br />
<strong>de</strong> l’enfant ; anomalie épigénétique et l’ai<strong>de</strong> médicale à la procréation ; rôle physiologique <strong>de</strong><br />
NOV ;<br />
- Un lien très fort existe entre la recherche biologique du site et l’activité biomédicale <strong>de</strong><br />
différents Services biocliniques, Explorations Fonctionnelles Endocriniennes (Trousseau),<br />
Service d’Hépatologie et <strong>de</strong> Gastro-Entérologie (<strong>Saint</strong>-<strong>Antoine</strong>), Service <strong>de</strong> Biochimie et<br />
Hormonologie (Tenon). De plus, nous allons mettre en place un réseau <strong>de</strong> recherche sur les<br />
maladies du tissu adipeux au sein <strong>de</strong> l’Université Pierre et Marie Curie associant, outre les<br />
équipes du CDR, <strong>de</strong>s groupes Inserm du CDR <strong>de</strong>s Cor<strong>de</strong>liers (équipes <strong>de</strong> P Ferre, K Clément<br />
et J Chambaz) et <strong>de</strong> la Pitié Salpétrière (Unité Inserm UMRS551 <strong>de</strong> J Chapman) ainsi que <strong>de</strong>s<br />
service cliniques <strong>de</strong> diabétologie et nutrition.<br />
- L’axe DMV présente <strong>de</strong>s interactions transversales avec l’axe Cancer : système IGF, KO<br />
IGF-1R, oestrogènes, neurotensine, Nov notamment au sujet du cancer du colon, du sein, du<br />
foie, <strong>de</strong>s gliomes et <strong>de</strong>s tumeurs pédiatriques et l’axe Immunité/Inflammation/Infection et<br />
Réparation- : système IGF, chimiokines, cytokines, notamment en ce qui concerne les<br />
pathologies du foie et du tissu adipeux.<br />
1- Développement et croissance<br />
L’implication du récepteur <strong>de</strong>s IGF <strong>de</strong> type 1 dans le développement et la croissance est<br />
étudiée par l’équipe 3 (M. Holzenberger) qui a développé <strong>de</strong>s modèles murins d’inactivation<br />
conditionnelle Cre-lox d’IGF-1R. Selon les résultats <strong>de</strong> cette équipe, l’IGF-1R serait plus<br />
particulièrement impliqué dans le développement <strong>de</strong>s cellules somatotropes au niveau
17<br />
CDR <strong>Saint</strong> <strong>Antoine</strong><br />
hypothalamique, notamment en pério<strong>de</strong> périnatale. Ainsi, une diminution <strong>de</strong> la signalisation<br />
IGF spécifiquement au niveau hypothalamique au cours du développement périnatal<br />
produirait peu après la naissance une déficience en hormone <strong>de</strong> croissance qui persiste chez<br />
l’adulte. Ce manque persistant <strong>de</strong> tonus somatotrope retar<strong>de</strong> ensuite la croissance postnatale et<br />
entraîne <strong>de</strong>s altérations du métabolisme énergétique, mais se répercute également sur les<br />
mécanismes <strong>de</strong> mortalité chez les souris âgées. L’équipe 3 s’intéresse maintenant aux<br />
mécanismes cellulaires et moléculaires impliqués dans cette régulation neuroendocrinienne<br />
ainsi qu’aux liens entre ce phénotype et <strong>de</strong>s facteurs environnementaux, tels que la nutrition<br />
en phase péri- et postnatale.<br />
Le rôle <strong>de</strong> NOV/CCN3 (un gène <strong>de</strong> la famille CCN) est encore mal connu. Or le SNC est un<br />
site majeur <strong>de</strong> son expression. Des données récentes montrent notamment que NOV serait un<br />
élément important du développement du cervelet, compte-tenu <strong>de</strong> son expression spécifique<br />
dans les cellules <strong>de</strong> Purkinje et <strong>de</strong> son action sur le contrôle <strong>de</strong> la prolifération et <strong>de</strong> la<br />
migration <strong>de</strong>s neurones granulaires. Les objectifs <strong>de</strong> l’équipe 1 (C. Martinerie, M. Laurent)<br />
concerneront l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> la fonction <strong>de</strong> NOV et <strong>de</strong>s mécanismes <strong>de</strong> son action dans ce tissu,<br />
dans un modèle murin d’inactivation conditionnelle qui est en cours <strong>de</strong> développement et dont<br />
le phénotype sera réalisé en collaboration avec l’équipe 3 et le laboratoire <strong>de</strong> J Mariani,<br />
UMR7102<br />
Les travaux <strong>de</strong>s équipes 1, 2 et 3 portent sur les anomalies <strong>de</strong> croissance staturo-pondérale<br />
fœtale et périnatale et recherchent les anomalies génétiques et épigénétiques (notamment <strong>de</strong><br />
l’empreinte parentale) dans les retards <strong>de</strong> croissance intra-utérins (RCIU, encore appelés<br />
« Small for Gestational Age »). Ces étu<strong>de</strong>s sont plus particulièrement centrées sur les<br />
paramètres du système IGF par l’équipe 2 (Y. Le Bouc). Des anomalies génétiques et<br />
épigénétiques notamment <strong>de</strong> la région 11p15 (Centre d’empreinte ICR1, IGF-II, H19,<br />
KCNQ1OT1) sont caractérisées dans les syndromes <strong>de</strong> croissance excessive tels que le<br />
syndrome <strong>de</strong> Beckwith-Wiedmann. A l’inverse dans <strong>de</strong>s tableaux cliniques inverses <strong>de</strong> RCIU,<br />
tels que le syndrome <strong>de</strong> Silver Russell, <strong>de</strong>s modifications épigénétiques en miroir <strong>de</strong> la région<br />
11p15 ont été décrites comme cause majeure <strong>de</strong> cette pathologie.<br />
Les données <strong>de</strong>s modèles murins d’invalidation du récepteur <strong>de</strong>s IGF <strong>de</strong> type 1 ou <strong>de</strong><br />
transgénèse d’IGFBP-1 (Equipe 3, M. Holzenberger) seront d’un grand apport dans l’analyse<br />
<strong>de</strong>s phénotypes cliniques et biologiques chez les enfants RCIU. En effet, ces <strong>de</strong>rnières années<br />
plusieurs mutations d’IGF-1R ont été découverts chez <strong>de</strong>s enfants, et les souris knock-down<br />
développées par l’équipe modélisent certains <strong>de</strong>s retards <strong>de</strong> croissance observés chez<br />
l’homme.<br />
Certains travaux <strong>de</strong> l’équipe 2 portent sur l’association éventuelle <strong>de</strong> l’assistance médicale à<br />
la procréation aux pathologies <strong>de</strong> l’empreinte parentale. En effet, l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s syndromes <strong>de</strong><br />
croissance excessive, réalisée par cette équipe (C. Gicquel, Y. Le Bouc) a permis <strong>de</strong> montrer<br />
grâce à l’analyse d’une gran<strong>de</strong> cohorte <strong>de</strong> patients avec syndrome <strong>de</strong> Wie<strong>de</strong>mann-Beckwith<br />
(SWB) que la prévalence <strong>de</strong>s procédures d’assistance médicale à la procréation (AMP) est<br />
plus élevée (<strong>de</strong> 3 à 4 fois) dans la population <strong>de</strong> patients SWB que dans la population<br />
générale. Il s’agit d’une seule et même anomalie épigénétique (déméthylation du gène<br />
maternel KCNQ1OT) suggérant que l’AMP empêche le maintien <strong>de</strong>s marques <strong>de</strong> méthylation<br />
<strong>de</strong>s gènes maternels dans les jours suivants la fécondation. On sait en effet l’importance <strong>de</strong><br />
ces pério<strong>de</strong>s (fin <strong>de</strong> différenciation ovarienne et phase préimplantatoire) dans les mécanismes<br />
<strong>de</strong> l’empreinte parentale. Il apparaît dès lors très important d’évaluer <strong>de</strong> manière précise si<br />
l’AMP comporte un risque d’anomalie épigénétique <strong>de</strong>s régions soumises à empreinte et si<br />
oui, <strong>de</strong> déterminer si certaines procédures d’AMP ou <strong>de</strong> stimulation ovarienne sont
18<br />
CDR <strong>Saint</strong> <strong>Antoine</strong><br />
spécifiquement associées à ce risque. D’autres régions soumises à l’empreinte parentale<br />
seront systématiquement analysées, pour caractériser les mécanismes moléculaires impliqués<br />
(méthylation, acétylation, co<strong>de</strong> histone). Un PHRC (coordonateurs : Y Le Bouc et S.<br />
Rossignol) va débuter. Des retards <strong>de</strong> croissance intra-utérin induits par <strong>de</strong>s modifications<br />
épigénétiques seront également recherchés.<br />
2- Résistance à l’insuline et pathologie du tissu adipeux<br />
Un ensemble <strong>de</strong> travaux concerne l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s anomalies <strong>de</strong> répartition du tissu adipeux ou<br />
lipodystrophies associées à <strong>de</strong>s troubles métaboliques et à une résistance à l’insuline.<br />
Ces étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> recherche translationnelle partent <strong>de</strong>s patients avec <strong>de</strong>s approches génétiques et<br />
cliniques, utilisent <strong>de</strong>s modèles cellulaires et animaux et aboutissent à la mise en place <strong>de</strong><br />
protocoles <strong>de</strong> recherche clinique en particulier thérapeutique.<br />
Le rôle <strong>de</strong>s protéines mutées dans le syndrome <strong>de</strong> diabète lipoatrophique (ou syndrome <strong>de</strong><br />
Beradinelli-Seip), la seipine et l’enzyme acyl transférase impliquée dans la synthèse <strong>de</strong><br />
l’aci<strong>de</strong> phosphatidique et <strong>de</strong>s triglycéri<strong>de</strong>s, AGPAT2 est étudié par l’équipe 9 (J. Magre) en<br />
collaboration avec le CEPH (M. Lathrop) ce qui a permis <strong>de</strong> créer le modèle <strong>de</strong> souris<br />
transgénique KO pour la seipine.<br />
Un ensemble <strong>de</strong> travaux porte sur les lipodystrophies partielles génétiques associées à une<br />
résistance sévère à l’insuline familiale, ou syndrome <strong>de</strong> Dunnigan (C Vigouroux). Des<br />
mutations hétérozygotes du gène <strong>de</strong> la lamine A/C ont été mises en évi<strong>de</strong>nce. Ces mutations<br />
induisent <strong>de</strong>s phénotypes <strong>de</strong> vieillissement accéléré (voir ci-<strong>de</strong>ssous). Les étu<strong>de</strong>s concernent<br />
le rôle <strong>de</strong> la lamine A/C dans la différenciation adipocytaire <strong>de</strong> cellules souches (collaboration<br />
C Dani, CNRS, Nice) et les anomalies induites par certaines mutations<br />
La survenue <strong>de</strong> syndromes lipodystrophiques avec résistance à l’insuline chez les patients<br />
infectés par le VIH ont conduit à démontrer l’effet <strong>de</strong>s molécules antirétrovirales, inhibiteurs<br />
<strong>de</strong> protéase et analogues nucléosidiques, sur les cellules adipocytaires en culture. Ces<br />
molécules sont capables, à <strong>de</strong>s <strong>de</strong>grés divers, d’induire <strong>de</strong>s anomalies <strong>de</strong> différentiation, une<br />
résistance à l’insuline, une dysfonction <strong>de</strong> la mitochondrie et un état <strong>de</strong> stress oxydant<br />
aboutissant à une sécrétion inappropriée <strong>de</strong> cytokines pro-inflammatoires et d’adipokines (M<br />
Caron). Des anomalies touchant ces différentes fonctions sont également présentes dans le<br />
tissu adipeux lipoatrophique <strong>de</strong>s patients. Ces résultats permettent <strong>de</strong> comprendre la<br />
physiopathologie <strong>de</strong>s lipodystrophies. Le traitement anti-rétroviral induit aussi un risque<br />
cardio-vasculaire accru et un risque <strong>de</strong> lésions hépatiques <strong>de</strong> stéatose et <strong>de</strong> steatohépatite<br />
étudié en collaboration entre l’équipe 9 et 10 (J. Capeau, L. Serfaty, C. Housset). Les étu<strong>de</strong>s<br />
sont poursuivies, en particulier au niveau clinique, par la mise en place <strong>de</strong> protocoles <strong>de</strong><br />
recherche thérapeutique portant sur l’effet <strong>de</strong> nouvelles molécules thérapeutiques : effet <strong>de</strong>s<br />
thiazolidinediones sur la lipodystrophie et sur la stéatohépatite, effet <strong>de</strong>s sartans sur la<br />
lipodystrophie et le risque cardio-vasculaire, effet <strong>de</strong> l’uridine sur la toxicité mitochondriale.<br />
Les anomalies <strong>de</strong> croissance fœtale touchant le développement du tissu adipeux sont associées<br />
à une insulinorésistance (M. Holzenberger, I. Netchine, Y. le Bouc). Celle-ci est d’autant plus<br />
importante à prendre en considération que l’on connaît le lien entre ces anomalies fœtales et<br />
leurs conséquences métaboliques et cardiovasculaires à l’âge adulte. La encore, les modèles<br />
animaux disponibles sur le site peuvent être source <strong>de</strong> réflexion par rapport aux pathologies<br />
humaines explorées tant pendant la pério<strong>de</strong> pédiatrique (retards staturaux, I.Netchine, S<br />
Cabrol, Y. le Bouc) qu’à l’état adulte (insulinorésistance, équipe 9, J. Capeau)
3- Vieillissement et stress oxydant<br />
19<br />
CDR <strong>Saint</strong> <strong>Antoine</strong><br />
Le rôle <strong>de</strong> la signalisation <strong>de</strong> l’IGF-1 dans les processus <strong>de</strong> vieillissement a été démontré <strong>de</strong><br />
façon remarquable par l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s souris hétérozygotes invalidées pour le récepteur IGF <strong>de</strong> type<br />
1, qui présentent une durée <strong>de</strong> vie prolongée. Cette longévité semble être la conséquence d’une<br />
meilleure résistance au stress oxydant, et l’équipe <strong>de</strong> M. Holzenberger continue d’étudier les<br />
liens entre IGF et résistance au stress oxydant par une étu<strong>de</strong> sur <strong>de</strong>s cellules humaines obtenues à<br />
partir <strong>de</strong> patients présentant <strong>de</strong>s mutations <strong>de</strong>s gènes d’IGF-1R et <strong>de</strong> IGF-I. Les étu<strong>de</strong>s sur le rôle<br />
<strong>de</strong> l’IGF-1R dans la régulation <strong>de</strong> la longévité seront poursuivies également grâce à <strong>de</strong>s modèles<br />
murins d’inactivation conditionnelle et tissu spécifique basés sur le système Cre-lox. Le rôle<br />
d’IGF-1R dans le cerveau sera évalué quant à la régulation <strong>de</strong> la longévité, car il semble selon<br />
<strong>de</strong>s résultats chez le vers C. élégans et selon les résultats préliminaires <strong>de</strong> l’équipe 3, que la<br />
durée <strong>de</strong> vie pourrait être sous contrôle neuroendocrinien, indépendamment d’un contrôle<br />
cellulaire autonome. Pour cela, ont été établis <strong>de</strong>s modèles KO hétérozygote du récepteur IGF<br />
spécifiquement dans le SNC, et <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s sont actuellement en cours pour évaluer le<br />
retentissement physiopathologique en relation avec le vieillissement (équipe 3, M.<br />
Holzenberger). Cette équipe a aussi évalué un modèle transgénique surexprimant un inhibiteur<br />
naturel d’IGF (l’IGFBP-1, protéine <strong>de</strong> liaison spécifique <strong>de</strong>s IGF, capable <strong>de</strong> séquestrer l’IGF-I),<br />
qui est approprié pour explorer les possibilités <strong>de</strong> la modulation pharmacologique <strong>de</strong> la<br />
régulation <strong>de</strong> la durée <strong>de</strong> vie.<br />
Dans le cadre <strong>de</strong>s maladies dues à <strong>de</strong>s mutations du gène <strong>de</strong> la lamine A/C, certaines<br />
mutations donnent <strong>de</strong>s syndromes <strong>de</strong> vieillissement accéléré (progéria) suggérant que cette<br />
protéine joue un rôle important dans le vieillissement tissulaire. Les étu<strong>de</strong>s sur les patients<br />
présentant <strong>de</strong>s laminopathies sont effectuées <strong>de</strong> façon complémentaire au niveau génétique,<br />
cellulaire et clinique (équipe 9, C. Vigouroux). Les mécanismes en cause dans le<br />
vieillissement sont étudiés dans les cellules <strong>de</strong> patients. Les résultats montrent que<br />
l’accumulation <strong>de</strong> prélamine (résultant <strong>de</strong> la présence <strong>de</strong> différentes mutations du gène <strong>de</strong> la<br />
lamine A/C) induit un stress oxydant et une sénescence prématurée <strong>de</strong>s cellules. Par ailleurs<br />
les travaux réalisés par l’équipe 9 sur les complications <strong>de</strong>s traitements anti-rétroviraux <strong>de</strong><br />
l’infection par le VIH (M Caron, J.P. Bastard) montrent que certaines molécules<br />
thérapeutiques sont capables d’induire une accumulation <strong>de</strong> prélamine, un stress oxydant et<br />
<strong>de</strong>s dysfonctions mitochondriales entraînant un vieillissement accéléré <strong>de</strong>s cellules et <strong>de</strong>s<br />
tissus <strong>de</strong>s patients infectés par le VIH.<br />
Modalités <strong>de</strong> fonctionnement du CDR<br />
Statuts et structures<br />
Le texte <strong>de</strong>s statuts du CDR a été discuté au CCDR et approuvé le 9 mars 2007 (voir annexe).<br />
Budget mutualisé et dépenses regroupées<br />
La gestion commune du CDR concernera le budget mutualisé du CDR, d’une part, et une<br />
gestion commune <strong>de</strong> certaines dépenses négociées en commun par le CDR, mais réglées sur<br />
les crédits <strong>de</strong> fonctionnement <strong>de</strong> chaque équipe, d’autre part. La cellule <strong>de</strong> gestion sera<br />
également chargée <strong>de</strong> négocier <strong>de</strong>s offres commerciales avec les principaux fournisseurs <strong>de</strong><br />
réactifs et consommables ainsi que <strong>de</strong> la négociation <strong>de</strong>s achats, <strong>de</strong>s contrats <strong>de</strong> maintenance
20<br />
CDR <strong>Saint</strong> <strong>Antoine</strong><br />
et <strong>de</strong>s appels d’offre <strong>de</strong>s équipements communs. La cellule administrative et financière du<br />
CDR, placée sous la responsabilité <strong>de</strong> Véronique Soulier, va accueillir une secrétaire d’unité<br />
Christine Bove, qui souhaite rejoindre le CDR pour s’occuper <strong>de</strong> cette cellule <strong>de</strong> gestion.<br />
Le budget mutualisé sera constitué d’une part du prélèvement d'un pourcentage (évalué à<br />
20%) <strong>de</strong>s dotations récurrentes (Inserm + <strong>UPMC</strong>) <strong>de</strong>s équipes affiliées au CDR. D’autre part,<br />
il est constitué <strong>de</strong>s budgets obtenus par le CDR dans le cadre <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s spécifiques auprès<br />
<strong>de</strong>s autorités <strong>de</strong> tutelle du CDR ou à l’occasion d’appels d’offre institutionnels, associatifs,<br />
industriels...<br />
Le budget récurrent du CDR (INSERM et Université) est estimé à 1 550 000 euros pour<br />
l’année 2008. En prélevant 20 % <strong>de</strong> ce budget pour la mutualisation, nous obtiendrons un<br />
montant disponible d’environ 310 000 euros. L’utilisation du budget mutualisé que nous<br />
prévoyons pour la première année correspond à :<br />
1°) Mutualisation <strong>de</strong>stinée à l’IFR soit 3,5 % du budget initial : Soit ~ 54 000 euros<br />
2°) Règlement <strong>de</strong>s contrats d’entretien <strong>de</strong>s équipements mutualisés<br />
par les Unités : Soit ~ 80 000 euros<br />
3°) Animation scientifique :<br />
• Journée Scientifique <strong>de</strong>s doctorants<br />
• Colloque Annuel du CDR<br />
•Déplacement et frais <strong>de</strong>s intervenants pour les Séminaires<br />
<strong>de</strong>s « Lundis <strong>de</strong> St <strong>Antoine</strong> »<br />
• Frais <strong>de</strong> missions <strong>de</strong>s experts du Conseil Scientifique du CDR Soit ~ 20 000 euros<br />
4°) Renouvellement <strong>de</strong>s équipements mutualisés (jouvence)<br />
hors plateforme et éventuellement l’entretien ponctuel d’appareils<br />
collectifs. Soit ~ 80 000 euros<br />
5°) Frais <strong>de</strong> fonctionnement du Service Administratif du CDR Soit ~ 10 000 euros<br />
6°) Politique Scientifique du CDR Soit ~ 130 000 euros<br />
• Soutien aux équipes émergentes : appel d’offre, pour une ai<strong>de</strong><br />
pour <strong>de</strong>s projets émergents en interne <strong>de</strong>stinée à valoriser <strong>de</strong>s<br />
projets d’interface ou collaboratifs, une transversalité et<br />
mobilité <strong>de</strong>s équipes.<br />
• Accueil <strong>de</strong> nouvelles équipes : ce soutien servira à promouvoir<br />
l’accueil d’équipes visant à renforcer la politique scientifique<br />
du centre.<br />
• Politique scientifique incitative <strong>de</strong>s 3 axes thématiques du<br />
Centre.<br />
Soit un Total général <strong>de</strong> ~374 000 euros<br />
Les dépenses regroupées concerneront les services et les services communs et seront<br />
prélevées sur les crédits <strong>de</strong> chaque équipe au prorata <strong>de</strong> l'utilisation <strong>de</strong> ces services. En<br />
particulier, ce type <strong>de</strong> gestion englobe la plus gran<strong>de</strong> partie <strong>de</strong> ce qui est géré <strong>de</strong>puis plusieurs<br />
années pour les unités Inserm présentes sur le site <strong>Saint</strong>-<strong>Antoine</strong> sous le nom <strong>de</strong> "centre <strong>de</strong><br />
dépenses regroupées". Ces dépenses concernent en particulier les frais d’animalerie.<br />
Mutualisation <strong>de</strong>s outils et <strong>de</strong>s compétences<br />
Le CDR va mettre en place un site Web dans lequel sera affiché un tableau permettant <strong>de</strong><br />
connaître les compétences <strong>de</strong>s personnels du centre. Un site <strong>de</strong> dialogue permettra à tout<br />
personnel du centre <strong>de</strong> s’enquérir <strong>de</strong> la disponibilité d’un outil ou d’une compétence<br />
spécifique.
21<br />
CDR <strong>Saint</strong> <strong>Antoine</strong><br />
Accueil <strong>de</strong> nouvelles équipes<br />
La création <strong>de</strong> nouvelles surfaces <strong>de</strong> recherche et la libération <strong>de</strong>s surfaces occupées par<br />
l’unité 592 (J. Sahel) et l’unité 732 (P Kitabgi) vont nous permettre d’accueillir <strong>de</strong> nouvelles<br />
équipes. Pour les équipes qui souhaitent nous rejoindre, la procédure sera définie : audition<br />
par le CCDR, avis du conseil scientifique, décision prise par le CCDR<br />
Pour recruter <strong>de</strong>s équipes dans les axes scientifiques définis du CDR, nous aurons une<br />
politique d’appel d’offre : définition <strong>de</strong>s souhaits et <strong>de</strong>s besoins par le CCDR, montage <strong>de</strong><br />
l’appel d’offre avec le conseil scientifique et avis sur les équipes candidates, sélection<br />
définitive <strong>de</strong>s équipes par le CCDR.<br />
Evolution interne <strong>de</strong>s équipes<br />
Le conseil scientifique ai<strong>de</strong> à l’évaluation <strong>de</strong>s équipes du CDR. Il sera réuni au printemps<br />
2007, pour auditionner toutes les équipes et donner un avis scientifique et stratégique. Le<br />
CCDR aura pour tâche <strong>de</strong> proposer le renouvellement <strong>de</strong>s équipes du CDR en prenant en<br />
compte les avis du CS.<br />
Si l’évaluation du CDR par l’Inserm et le MENESR conduit à faire <strong>de</strong>s propositions <strong>de</strong> noncréation<br />
<strong>de</strong> certaines équipes, le Directeur du CDR, après avis du CCDR, déci<strong>de</strong>ra du<br />
maintien ou non <strong>de</strong> l’équipe dans le CDR. Si leur maintien est décidé, les équipes auront un<br />
an pour redéposer un dossier. Si, à ce terme, l’équipe n’est pas recréée, soit elle quitte le CDR<br />
soit son personnel rejoint d’autres équipes du CDR.<br />
Pour la suite, le CS sera réuni tous les <strong>de</strong>ux ans pour donner son avis sur les équipes et<br />
proposer <strong>de</strong>s modifications, restructurations et fermetures. Le CCDR en fonction <strong>de</strong> cet avis<br />
proposera <strong>de</strong>s modifications et suivra l’évolution <strong>de</strong> ces équipes pour l’examen quadriennal<br />
suivant.<br />
Services communs et plateformes technologiques du CDR et <strong>de</strong> l’IFR<br />
Les équipes du futur CDR bénéficient pour le développement <strong>de</strong> leurs projets <strong>de</strong> recherche <strong>de</strong><br />
services communs gérés en propre et <strong>de</strong> plates-formes technologiques gérées au niveau <strong>de</strong><br />
l'IFR65 dont certaines sont elles-mêmes incluses dans <strong>de</strong>s réseaux <strong>de</strong> plates-formes trans-IFR<br />
et trans-UFR.<br />
Positionnement <strong>de</strong>s PF et SC<br />
L’IFR 65 et le CDR travaillent en concertation étroite. L’IFR continuera à assurer le<br />
développement <strong>de</strong> ses plates-formes avec une évolution progressive vers une organisation en<br />
CDR sur les trois sites concernés à terme par la création d’un CDR (Quinze-Vingt, Tenon et<br />
<strong>Saint</strong> <strong>Antoine</strong>). Les SC seront progressivement transférés vers les CDR lors <strong>de</strong> leur mise en<br />
place en veillant à ce que chaque CDR ait accès aux équipements collectifs dont il a besoin<br />
(ex : animalerie).<br />
Sont définies comme plate-formes, les entités dotées d'un ensemble <strong>de</strong> gros équipements,<br />
disposant d’un personnel technique spécifique, ayant une activité <strong>de</strong> développement<br />
technologique et <strong>de</strong> formation et offrant <strong>de</strong>s services technologiques tournés en partie sur<br />
l’extérieur. Sont définis comme services communs <strong>de</strong>s installations techniques mises à la<br />
disposition <strong>de</strong> la communauté scientifique du CDR et qui peuvent fournir <strong>de</strong>s prestations à<br />
d’autres utilisateurs. Sont actuellement i<strong>de</strong>ntifiés comme SC du CDR <strong>Saint</strong> <strong>Antoine</strong><br />
l’animalerie et le L3.<br />
Services communs
22<br />
CDR <strong>Saint</strong> <strong>Antoine</strong><br />
L’animalerie présente sur le Bâtiment Kourilsky au 7 ème et 8 ème étages fonctionne en service<br />
commun. Une réhabilitation totale <strong>de</strong> ses locaux est prévue avec installation au sous-sol du<br />
bâtiment Kourilsky et zone EOPS au 7 ème étage.<br />
Le laboratoire L3 installé au 7 ème étage du bâtiment Kourilsky a été mis en conformité par<br />
l’Inserm pour une utilisation pour les prions et pour les adénovirus.<br />
Un laboratoire L2 doit être installé au 13 ème étage <strong>de</strong> la <strong>Faculté</strong>.<br />
Descriptif <strong>de</strong>s plate-formes technologiques<br />
Plate-forme spectrométrie <strong>de</strong> masse et protéomique (PF-SM)<br />
Les équipements disponibles sont placés sous la responsabilité du réseau Physique-Chimie-<br />
Biologie-Mé<strong>de</strong>cine (PCBM) <strong>de</strong> l’<strong>UPMC</strong> dirigé par G Chassaing et G Trugnan, qui regroupe<br />
notamment l’ensemble <strong>de</strong>s IFR <strong>de</strong> l’<strong>UPMC</strong>.<br />
L’équipement du site <strong>Saint</strong>-<strong>Antoine</strong> est centré sur les petites molécules en particulier les<br />
lipi<strong>de</strong>s, les médicaments et les pepti<strong>de</strong>s avec :<br />
- <strong>de</strong>ux GCMS consacrés aux lipi<strong>de</strong>s<br />
- un micro-LC-MS-MS dédié à la lipidomique (aci<strong>de</strong>s biliaires, phospholipi<strong>de</strong>s, eicosanoi<strong>de</strong>s)<br />
- un Maldi–tof <strong>de</strong> «paillasse » dédié à la protéomique (pepti<strong>de</strong>s et petites protéines)<br />
Plate-forme Imagerie cellulaire et tissulaire (PF-I) et Cytométrie <strong>de</strong> flux<br />
Cette plate-forme est également une PF multisite placée sous la responsabilité <strong>de</strong> l’IFR 65<br />
(responsable G Trugnan). Elle fait partie d’un réseau <strong>de</strong> PF d’imagerie <strong>de</strong> l’<strong>UPMC</strong> est<br />
équipée <strong>de</strong> :<br />
- huit microscopes à fluorescence conventionnels avec un système d’imagerie calcique, <strong>de</strong>s<br />
systèmes d’analyse et d’édition d’images associés, un analyseur d’images<br />
- <strong>de</strong>ux vidéo-microscopes conventionnels dont un plus spécifiquement dédié à <strong>de</strong>s<br />
expériences <strong>de</strong> biophysique membranaire<br />
- <strong>de</strong>ux microscopes à flurorescence confocaux sur le site Tenon dont un possédant un laser<br />
biphotonique. L’acquisition d’un microscope confocal 4D, à implanter à <strong>Saint</strong> <strong>Antoine</strong>, est<br />
prévue en 2007.<br />
- un microscope électronique sur le site Tenon.<br />
- un cytomètre <strong>de</strong> flux acquis fin 2006 et un cytomètre <strong>de</strong> flux dédié aux étu<strong>de</strong>s sur les<br />
prions.<br />
Plate-forme d’imagerie et d’exploration fonctionnelle du petit animal<br />
L’IFR65 propose également aux équipes du CDR une plate-forme d’imagerie non-invasive du<br />
petit animal qui comprend une imagerie moléculaire positonique (TEP) petit animal et <strong>de</strong>s<br />
appareillages associés localisés à Tenon dans <strong>de</strong>s locaux dédiés comprenant une zone<br />
contrôlée permettant l’accueil <strong>de</strong>s animaux en cours d’exploration.<br />
Les équipes du CDR disposent d'une station <strong>de</strong> morphologie et d'anatomo-pathologie du petit<br />
animal placée. L’IFR65 vient dans ce cadre <strong>de</strong> se doter d’un microdissecteur laser Palm sur le<br />
site <strong>Saint</strong>-<strong>Antoine</strong>. L’IFR dispose par ailleurs d’une expertise et <strong>de</strong> plusieurs équipements<br />
permettant l’exploration phénotypique du petit animal. Il s’agit notamment d’une station<br />
d’explorations néphro-vasculaire, <strong>de</strong> système d’étu<strong>de</strong>s comportementales, d’un plateau <strong>de</strong><br />
microdosages hormonaux et biochimiques à orientation endocrino-métabolique,<br />
d’explorations pulmonaires. L’ensemble <strong>de</strong>s activités dans ce secteur s’insère dans le réseau<br />
<strong>de</strong> phénotypage du petit animal <strong>de</strong> l’<strong>UPMC</strong> créé avec le soutien du CPER (Contrat <strong>de</strong> Plan<br />
Etat Région). Cette plate-forme est actuellement en cours <strong>de</strong> constitution.
Locaux<br />
23<br />
CDR <strong>Saint</strong> <strong>Antoine</strong><br />
Les équipes du CDR sont localisées sur le site <strong>Saint</strong>-<strong>Antoine</strong> soit dans le bâtiment facultaire<br />
soit dans le bâtiment Kourilsky.<br />
<strong>Faculté</strong> <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine<br />
Soit 2680 m 2 actuels en surface <strong>de</strong> recherche et locaux <strong>de</strong> services communs et 150 m 2 qui<br />
doivent être réhabilités.<br />
Bâtiment Kourilsky :<br />
Soit 3017 m 2 <strong>de</strong> surface <strong>de</strong> recherche et communes (animalerie, bibliothèque, salles <strong>de</strong><br />
réunion, cafétéria).<br />
Pour ces <strong>de</strong>ux bâtiments, le total est <strong>de</strong> 5847 m 2 surface <strong>de</strong> recherche et services communs<br />
Animation scientifique et site Web<br />
Le CDR a décidé <strong>de</strong> créer un comité <strong>de</strong> l’animation scientifique (CAS) qui a pour fonctions:<br />
l’animation scientifique du CDR, l’information et la formation <strong>de</strong>s nouveaux étudiants.<br />
Son travail se fait selon 3 axes déjà fonctionnels :<br />
- l’accueil <strong>de</strong>s étudiants et <strong>de</strong>s jeunes doctorants et la journée annuelle <strong>de</strong>s doctorants et postdoctorants<br />
- l’organisation du séminaire annuel (Dourdan)<br />
- la planification <strong>de</strong>s séminaires hebdomadaires « les Lundis <strong>de</strong> <strong>Saint</strong>-<strong>Antoine</strong> »<br />
Le CDR a mis en place un site Web (sous la responsabilité d’O Lascols) qui permet<br />
d’annoncer toutes les manifestations du CDR, <strong>de</strong> recenser les outils disponibles et les<br />
compétences <strong>de</strong>s personnels du CDR.<br />
Formation <strong>de</strong>s doctorants, post-doctorants et personnels<br />
Implication <strong>de</strong>s personnels du CDR dans la formation à et par la recherche<br />
Les chercheurs et enseignants-chercheurs du CDR sont directement responsables <strong>de</strong> plusieurs<br />
modules <strong>de</strong> master M1 et M2 <strong>de</strong> l’Université Pierre et Marie Curie :<br />
Responsabilités dUE <strong>de</strong> M1<br />
J Capeau : UE signalisation normale et pathologique FPMC<br />
A Clement, P Le Rouzic : UE Homéostasie du système circulatoire, échanges gazeux,<br />
appareil respiratoire, M1 Biologie Intégrative et Physiologie (BIP), UMPC<br />
C Housset : UE Physiopathologie hépatique FPMC<br />
JC Nicolas : UE Virologie-Bactériologie-Parasitologie FPMC<br />
JC Nicolas : UE Microbiologie moléculaire et cellulaire, mention Biologie moléculaire et<br />
cellulaire (BMC), <strong>UPMC</strong><br />
G Trugnan : UE Géopolitique <strong>de</strong> la cellule, <strong>Faculté</strong> Pierre et Marie Curie (FPMC)<br />
Responsabilités d’UE <strong>de</strong> M2<br />
J Capeau : UE Physiopathologie <strong>de</strong>s maladies métaboliques, mention BIP, spécialité Nutrition<br />
A Clément : UE Physiologie et physiopathologie respiratoire, mention BIP, spécialité<br />
Physiologie et Physiopathologie<br />
A Garbarg-Chenon : UE virologie, mention BMC, spécialité microbiologie
24<br />
CDR <strong>Saint</strong> <strong>Antoine</strong><br />
C Housset : UE Physiopathologie hépatique, mention BIP, spécialité Physiologie et<br />
Physiopathologie<br />
G Trugnan et JP Grill : UE Microflore et tube digestif, Mention BIP, spécialité Nutrition,<br />
<strong>UPMC</strong><br />
Responsabilités d’écoles doctorales<br />
G Trugnan dirige l’ED Interbio<br />
J Capeau fait partie du conseil <strong>de</strong> l’ED Physiologie et Physiopathologie<br />
Accueil et formation <strong>de</strong>s doctorants<br />
La formation <strong>de</strong>s doctorants et <strong>de</strong>s post-doctorants impliquera <strong>de</strong>s actions complémentaires <strong>de</strong><br />
celles mise en place par la Maison <strong>de</strong>s Ecoles Doctorales <strong>de</strong> l’<strong>UPMC</strong> qui a une politique<br />
dynamique et ambitieuse <strong>de</strong> formation <strong>de</strong>s étudiants, politique à laquelle participent<br />
activement les personnels du CDR.<br />
Une journée d’accueil annuelle <strong>de</strong>s nouveaux étudiants et <strong>de</strong> présentation <strong>de</strong> leur résultats est<br />
organisée « la journée <strong>de</strong>s doctorants « en mai. La présentation <strong>de</strong>s travaux <strong>de</strong>s doctorants est<br />
organisée <strong>de</strong> façon mensuelle lors <strong>de</strong>s séminaires hebdomadaires du lundi dans la séance « les<br />
doctorants vous parlent » (<strong>de</strong>ux doctorants par séance). Il leur sera proposé la mise en place<br />
d’un Club <strong>de</strong>s doctorants et post-doctorants qui pourraient organiser <strong>de</strong>s cycles <strong>de</strong><br />
présentations, type "journal club" et/ou "data club".<br />
Formation <strong>de</strong>s personnels <strong>de</strong> recherche<br />
Le CDR va renforcer les actions <strong>de</strong> formation permanente pour les personnels <strong>de</strong> recherche et<br />
valoriser les acquis professionnels. Il participe également aux actions <strong>de</strong> formation<br />
permanente en particulier au niveau <strong>de</strong> ses PF.<br />
Valorisation, transfert <strong>de</strong> technologie<br />
La valorisation s’entend dès lors qu’il y a une propriété industrielle ou un protocole clinique<br />
sous promotion publique. Le CDR a pour mission :<br />
1) d’i<strong>de</strong>ntifier les projets à fort potentiel <strong>de</strong> valorisation industrielle pouvant faire l’objet <strong>de</strong><br />
dépôts <strong>de</strong> brevets, voire <strong>de</strong> création <strong>de</strong> structures <strong>de</strong> biotechnologies auxquelles pourraient<br />
participer les chercheurs et <strong>de</strong> les accompagner dans les démarches auprès d’"Inserm<br />
Transfert". Plusieurs équipes du CDR ont <strong>de</strong>s projets <strong>de</strong> valorisation en cours avec prise <strong>de</strong><br />
brevets.<br />
2) <strong>de</strong> favoriser la valorisation clinique <strong>de</strong>s recherches d’amont en créant <strong>de</strong>s points <strong>de</strong><br />
rencontre avec les services hospitaliers et d’orienter les équipes vers le Comité d’Orientation<br />
Stratégique et <strong>de</strong> Suivi <strong>de</strong>s Essais Cliniques (COSSEC) <strong>de</strong> l’Inserm pour la mise en œuvre <strong>de</strong><br />
protocoles cliniques.<br />
L’implication <strong>de</strong>s équipes Inserm dans les Programmes Hospitaliers <strong>de</strong> Recherche Clinique<br />
(PHRC) est déjà effective pour plusieurs équipes et sera encouragée en concertation étroite<br />
avec la structure URC-Est coordonnée par T Simon. Les chercheurs seront incités à postuler<br />
pour <strong>de</strong>s contrats d’interface APHP/Inserm ou Université/Inserm.
25<br />
CDR <strong>Saint</strong> <strong>Antoine</strong><br />
La valorisation au niveau européen dans le cadre <strong>de</strong>s PCRDT sera encouragée grâce à la<br />
participation <strong>de</strong> plusieurs chercheurs du CDR à <strong>de</strong>s réseaux européens avec l’ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> la<br />
cellule Inserm.<br />
Le CDR souhaite recruter un personnel dédié à la prise en charge <strong>de</strong> la valorisation et l’ai<strong>de</strong><br />
au montage <strong>de</strong>s contrats européens. Dans ce but, une cellule d’expertise composée en outre <strong>de</strong><br />
représentants <strong>de</strong> chaque axe thématique sera créée.