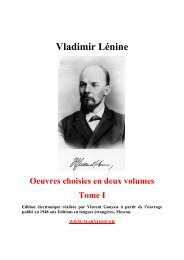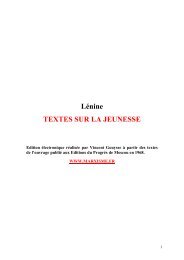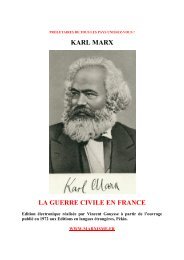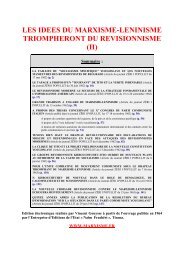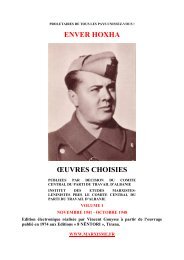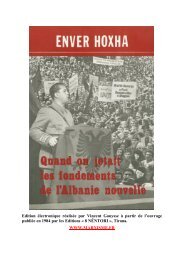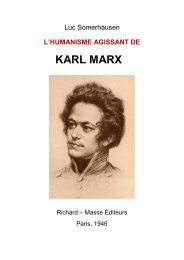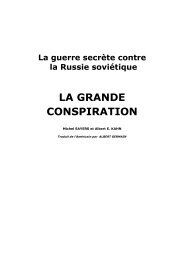LENINE Textes choisis (II) - communisme-bolchevisme
LENINE Textes choisis (II) - communisme-bolchevisme
LENINE Textes choisis (II) - communisme-bolchevisme
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
PARTICULIER est GENERAL. (Cf. Aristote, Métaphysique, traduction de Schwegler, Bd. <strong>II</strong>, S. 40, 3<br />
Buch, 4 Kapitel, 8-9 : « denn naturlich kann man nicht der Meinung sein, dass es ein Haus — une<br />
maison en général — gebe ausser den sichtbaren Häusern. » « Ainsi, les contraires (le particulier est<br />
contraire au général) sont identiques : le particulier n'existe que dans la relation qui mène au général.<br />
Le général n'existe que dans le particulier, à travers le particulier. Tout élément particulier a (d'une<br />
façon ou de l'autre) son caractère de généralité. Toute généralité est (parcelle ou côté ou essence) du<br />
particulier. Toute généralité n'englobe qu'à peu près tous les objets particuliers. Tout élément<br />
particulier ne participe pas entièrement du général, etc., etc. Tout élément particulier se relie par mille<br />
inférences à des éléments particuliers d'une autre NATURE (choses, phénomènes, processus), etc. Déjà<br />
là il y a des éléments, des embryons, des concepts de nécessité, de relation objective de la nature, etc.<br />
Le contingent et le nécessaire, le phénomène et l'essence s'y trouvent déjà, car lorsqu'on dit : Jean est<br />
un homme, Médor est un chien, ceci est une feuille d'arbre, etc., nous rejetons une série de signes, en<br />
tant que CONTINGENTS, nous dissocions l'essentiel de ce qui est fortuit, et nous l'opposons l'un à<br />
l'autre. Ainsi, dans toute proposition l'on peut (et l'on doit) discerner comme dans une « alvéole » («<br />
cellule ») les embryons de tous les éléments de la dialectique, afin de montrer qu'en général la<br />
dialectique est inhérente à toute connaissance humaine. Or, les sciences naturelles nous apprennent (et<br />
cette fois-ci encore il faut en faire la preuve par n'importe quel exemple, très simple) la nature<br />
objective en ses mêmes qualités, la transformation du particulier en général, du contingent en<br />
nécessaire, les inférences, les nuances, la relation réciproque des contraires. La dialectique est bien la<br />
théorie de la connaissance (de Hegel et) du marxisme : ce « côté » des choses (ce n'est pas un «côté»,<br />
c'est le fond des choses) a été négligé par Plékhanov sans parler des autres marxistes. La connaissance<br />
figurée par une suite de cercles a été définie et par Hegel (Logique) et par Paul Volkmann, «<br />
gnoséologiste » moderne en sciences naturelles, éclectique, adversaire de l'hégélianisme (qu'il n'a pas<br />
compris !) (voir son Erkentnistheoretische Grundzüge der Naturwissenschaften).<br />
« Cercles » en philosophie : [la chronologie des personnes est-elle bien nécessaire ? Non !].<br />
Philosophie antique : de Démocrite à Platon et à la dialectique d'Heraclite.<br />
Renaissance : Descartes versus Gassendi (Spinoza ?).<br />
Philosophie moderne : de Holbach à Hegel (par Berkeley, Hume, Kant).<br />
Hegel — Feuerbach — Marx.<br />
La dialectique, en tant que connaissance vivante, polyscopique (les aspects se multipliant sans cesse)<br />
avec une infinité de nuances en vue d'aborder, d'approcher la réalité (avec un système philosophique<br />
sortant de chaque nuance pour constituer un tout), voilà un contenu d'une richesse immense par<br />
rapport au matérialisme « métaphysique », dont le plus grand malheur est qu'il est inapte à appliquer la<br />
dialectique à la Bildertheorie, au processus et à l'évolution de la connaissance.<br />
L'idéalisme philosophique n'est que sottise du point de vue d'un matérialisme grossier, simpliste,<br />
métaphysique. Au contraire, du point de vue du matérialisme dialectique, l'idéalisme philosophique est<br />
un développement unilatéral, exagéré, überschwengliches (Dietzgen) — amplification, grossissement<br />
— d'un des petits traits, des côtés, des facettes de la connaissance, en un absolu détaché de la matière,<br />
de la nature, divinisé. L'idéalisme, c'est de l'obscurantisme clérical. Cela est vrai. Mais l'idéalisme<br />
philosophique est (« plutôt » et « en outre ») une voie conduisant à l'obscurantisme clérical à travers<br />
UNE DES NUANCES de l'infiniment complexe connaissance (dialectique) de l'homme. La<br />
connaissance de l'homme n'est pas (resp. ne suit pas) une ligne droite, mais une ligne courbe, qui<br />
s'approche indéfiniment d'une suite de cercles, d'une spirale. Un fragment, un tronçon, un segment de<br />
cette courbe peut être transformé (transformé unilatéralement) en ligne droite, indépendante, intégrale,<br />
qui (si les arbres empêchent de voir la forêt) conduirait alors dans le marais, dans l'obscurantisme<br />
clérical (où la fixe l'intérêt social des classes dominantes). Le caractère rectiligne et unilatéral, la<br />
pétrification et l'ossification, le subjectivisme et la cécité subjective, voilà [En français dans le texte.<br />
(N.R.).] les racines gnoséologiques de l'idéalisme. Or, l'obscurantisme clérical (= l'idéalisme<br />
philosophique) a certes des racines gnoséologiques ; il a du terrain, c'est une fleur stérile, sans<br />
conteste, mais qui pousse sur l'arbre vivant de la vraie connaissance humaine, vivace, féconde,<br />
vigoureuse, toute-puissante, objective, absolue.<br />
1915 ou 1916<br />
40