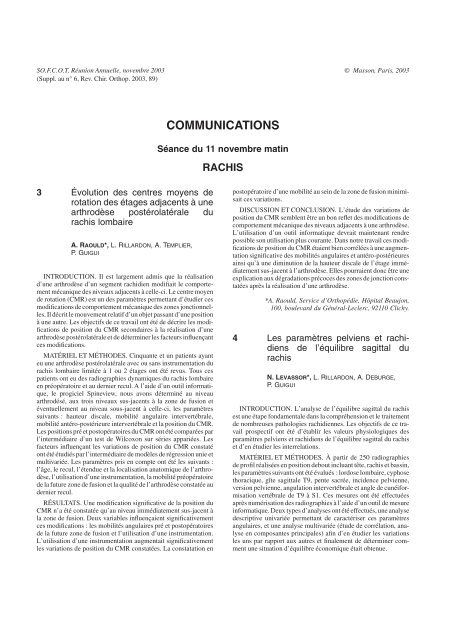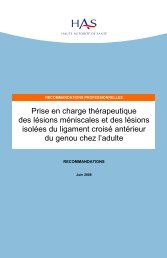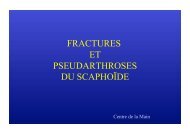Tous les résumés des communications - Sofcot
Tous les résumés des communications - Sofcot
Tous les résumés des communications - Sofcot
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
SO.F.C.O.T. Réunion Annuelle, novembre 2003 © Masson, Paris, 2003<br />
(Suppl. au n° 6, Rev. Chir. Orthop. 2003, 89)<br />
3 Évolution <strong>des</strong> centres moyens de<br />
rotation <strong>des</strong> étages adjacents à une<br />
arthrodèse postérolatérale du<br />
rachis lombaire<br />
A. RAOULD*, L. RILLARDON, A.TEMPLIER,<br />
P. GUIGUI<br />
INTRODUCTION. Il est largement admis que la réalisation<br />
d’une arthrodèse d’un segment rachidien modifiait le comportement<br />
mécanique <strong>des</strong> niveaux adjacents à celle-ci. Le centre moyen<br />
de rotation (CMR) est un <strong>des</strong> paramètres permettant d’étudier ces<br />
modifications de comportement mécanique <strong>des</strong> zones jonctionnel<strong>les</strong>.<br />
Il décrit le mouvement relatif d’un objet passant d’une position<br />
à une autre. Les objectifs de ce travail ont été de décrire <strong>les</strong> modifications<br />
de position du CMR secondaires à la réalisation d’une<br />
arthrodèse postérolatérale et de déterminer <strong>les</strong> facteurs influençant<br />
ces modifications.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Cinquante et un patients ayant<br />
eu une arthrodèse postérolatérale avec ou sans instrumentation du<br />
rachis lombaire limitée à1ou2étages ont été revus. <strong>Tous</strong> ces<br />
patients ont eu <strong>des</strong> radiographies dynamiques du rachis lombaire<br />
en préopératoire et au dernier recul. A l’aide d’un outil informatique,<br />
le progiciel Spineview, nous avons déterminé au niveau<br />
arthrodésé, aux trois niveaux sus-jacents à la zone de fusion et<br />
éventuellement au niveau sous-jacent à celle-ci, <strong>les</strong> paramètres<br />
suivants : hauteur discale, mobilité angulaire intervertébrale,<br />
mobilité antéro-postérieure intervertébrale et la position du CMR.<br />
Les positions pré et postopératoires du CMR ont été comparées par<br />
l’intermédiaire d’un test de Wilcoxon sur séries appariées. Les<br />
facteurs influençant <strong>les</strong> variations de position du CMR constaté<br />
ont été étudiés par l’intermédiaire de modè<strong>les</strong> de régression unie et<br />
multivariée. Les paramètres pris en compte ont été <strong>les</strong> suivants :<br />
l’âge, le recul, l’étendue et la localisation anatomique de l’arthrodèse,<br />
l’utilisation d’une instrumentation, la mobilité préopératoire<br />
de la future zone de fusion et la qualité de l’arthrodèse constatée au<br />
dernier recul.<br />
RÉSULTATS. Une modification significative de la position du<br />
CMR n’a été constatée qu’au niveau immédiatement sus-jacent à<br />
la zone de fusion. Deux variab<strong>les</strong> influençaient significativement<br />
ces modifications : <strong>les</strong> mobilités angulaires pré et postopératoires<br />
de la future zone de fusion et l’utilisation d’une instrumentation.<br />
L’utilisation d’une instrumentation augmentait significativement<br />
<strong>les</strong> variations de position du CMR constatées. La constatation en<br />
COMMUNICATIONS<br />
Séance du 11 novembre matin<br />
RACHIS<br />
postopératoire d’une mobilité au sein de la zone de fusion minimisait<br />
ces variations.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. L’étude <strong>des</strong> variations de<br />
position du CMR semblent être un bon reflet <strong>des</strong> modifications de<br />
comportement mécanique <strong>des</strong> niveaux adjacents à une arthrodèse.<br />
L’utilisation d’un outil informatique devrait maintenant rendre<br />
possible son utilisation plus courante. Dans notre travail ces modifications<br />
de position du CMR étaient bien corrélées à une augmentation<br />
significative <strong>des</strong> mobilités angulaires et antéro-postérieures<br />
ainsi qu’à une diminution de la hauteur discale de l’étage immédiatement<br />
sus-jacent à l’arthrodèse. El<strong>les</strong> pourraient donc être une<br />
explication aux dégradations précoces <strong>des</strong> zones de jonction constatées<br />
après la réalisation d’une arthrodèse.<br />
*A. Raould, Service d’Orthopédie, Hôpital Beaujon,<br />
100, boulevard du Général-Leclerc, 92110 Clichy.<br />
4 Les paramètres pelviens et rachidiens<br />
de l’équilibre sagittal du<br />
rachis<br />
N. LEVASSOR*, L. RILLARDON, A.DEBURGE,<br />
P. GUIGUI<br />
INTRODUCTION. L’analyse de l’équilibre sagittal du rachis<br />
est une étape fondamentale dans la compréhension et le traitement<br />
de nombreuses pathologies rachidiennes. Les objectifs de ce travail<br />
prospectif ont été d’établir <strong>les</strong> valeurs physiologiques <strong>des</strong><br />
paramètres pelviens et rachidiens de l’équilibre sagittal du rachis<br />
et d’en étudier <strong>les</strong> interrelations.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. À partir de 250 radiographies<br />
de profil réalisées en position debout incluant tête, rachis et bassin,<br />
<strong>les</strong> paramètres suivants ont été évalués : lordose lombaire, cyphose<br />
thoracique, gîte sagittale T9, pente sacrée, incidence pelvienne,<br />
version pelvienne, angulation intervertébrale et angle de cunéiformisation<br />
vertébrale de T9 à S1. Ces mesures ont été effectuées<br />
après numérisation <strong>des</strong> radiographies à l’aide d’un outil de mesure<br />
informatique. Deux types d’analyses ont été effectués, une analyse<br />
<strong>des</strong>criptive univariée permettant de caractériser ces paramètres<br />
angulaires, et une analyse multivariée (étude de corrélation, analyse<br />
en composantes principa<strong>les</strong>) afin d’en étudier <strong>les</strong> variations<br />
<strong>les</strong> uns par rapport aux autres et finalement de déterminer comment<br />
une situation d’équilibre économique était obtenue.
3S22 78 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
RÉSULTATS ET DISCUSSION. Les valeurs moyennes <strong>des</strong><br />
principaux paramètres angulaires pris en compte étaient <strong>les</strong> suivantes<br />
: lordose lombaire maximale 61 degrés (± 12,7), cyphose<br />
thoracique maximale 41,4 degrés (± 9,2), pente sacrée 42 degrés<br />
(± 8,5), version pelvienne 13 degrés (± 6), incidence pelvienne 55<br />
degrés (± 11,2), gîte sagittale T9 10,5 degrés (± 3,1). Il existait une<br />
corrélation étroite entre pente sacrée et incidence pelvienne (r =<br />
0,8), lordose lombaire et pente sacrée (r = 0,86), version pelvienne<br />
et incidence pelvienne (r = 0,66), lordose lombaire incidence pelvienne<br />
version pelvienne et cyphose thoracique (r = 0,9) et finalement<br />
entre incidence pelvienne d’une part et gîte sagittale T9,<br />
pente sacrée, version pelvienne, lordose lombaire, cyphose thoracique<br />
d’autre part (r = 0,98). L’étude <strong>des</strong> relations entre <strong>les</strong> divers<br />
paramètres pris en compte a permis d’établir que la gîte sagittale<br />
T9, reflet de la situation d’équilibre du rachis de profil, était fonction<br />
de trois paramètres indépendants : le premier était une combinaison<br />
linéaire de l’incidence pelvienne, de la lordose lombaire<br />
et de la pente sacrée, le second était représenté par la version<br />
pelvienne et le troisième par la cyphose thoracique.<br />
CONCLUSION. Ce travail a permis de fournir une aide à l’analyse<br />
et à la compréhension <strong>des</strong> déséquilibres antéropostérieurs<br />
rencontrés en pathologie rachidienne ainsi qu’aux calculs <strong>des</strong> corrections<br />
à effectuer lors de leur traitement grâce aux équations de<br />
régression linéaire qu’il a été possible d’établir.<br />
*N. Levassor, Service d’Orthopédie, Hôpital Beaujon,<br />
100, boulevard du Général-Leclerc, 92110 Clichy.<br />
5 Anomalies radiculaires congénita<strong>les</strong><br />
en chirurgie de la colonne<br />
lombo-sacrée<br />
D.O. RICCIARDI*, A.J. SAROTTO, G.G.CARRIOLI<br />
INTRODUCTION. Les anomalies congénita<strong>les</strong> dans le secteur<br />
invaginé <strong>des</strong> racines lombo-sacrées constituent une variable dans<br />
la planification et la thérapeutique <strong>des</strong> lombo-sciatiques. Les<br />
auteurs exposent leur expérience clinique et chirurgicale, et analysent<br />
<strong>les</strong> aspects pré, per et postopératoire.<br />
MATÉRIEL. Deux cent quatre-vingt-un dossiers cliniques,<br />
protoco<strong>les</strong> opératoires et radiologiques chez <strong>des</strong> patients adultes<br />
(un seul avait 17 ans, sans potentiel de croissance) opérés entre<br />
mars 1988 et janvier 2003 ont été analysés. Les cas <strong>des</strong> données<br />
imprécises ont été exclus ; 9 sur 20 en ressortent avec <strong>des</strong> désaccords<br />
clinico-radiologiques.<br />
MÉTHODES. Sur 9 cas documentés, <strong>les</strong> signes cliniques, <strong>les</strong><br />
diagnostics pré et postopératoires, <strong>des</strong> constations chirurgica<strong>les</strong> se<br />
relient, ainsi que <strong>les</strong> techniques chirurgica<strong>les</strong> employées, évolution<br />
et complications. La technique employée était : voie postéromédiale<br />
incision de 3 cm, et laminectomie (a dû être augmentée<br />
dans tous <strong>les</strong> cas). Pour <strong>les</strong> constatations opératoires, on a utilisé la<br />
classification de Postacchini et al. La douleur a été évaluée sur<br />
l’échelle visuelle analogique.<br />
RÉSULTATS. Neuf patients opérés (5 hommes) avaient un âge<br />
moyen de 44,2 ans (extrêmes : 17 et 69 ans). Le suivi moyen était<br />
de 22,3 mois (extrêmes : 2 et 48 mois). Les racines symptomatiques<br />
étaient : L5 (2), L5-S1 (4), S1 (2), S1-S2 (1). <strong>Tous</strong> avaient un<br />
signe de Lasegue. Trois patients avaient <strong>des</strong> anomalies radiologiques<br />
préopératoires. Les constatations opératoires étaient : 1 type<br />
I, 1 type II, 6 types III, 1 type IV. Six patients ont eu une dissectomie,<br />
tous une laminectomie, et deux une facétectomie associée.<br />
Chez tous, <strong>les</strong> structures neurologiques ont présenté une franche<br />
résistance au déplacement médial. La douleur était en préopératoire<br />
de 8,6 (extrêmes : 7 et 10), en postopératoire immédiat de 1,4<br />
(extrêmes : 0 et 3) ; et il a été noté une aggravation après le 6e mois<br />
(sacralgie-équipe de douleur). Aucune complication infectieuses<br />
ou neurologiques n’a été constatée dans l’échantillon.<br />
DISCUSSION. Pour Kikuchi, lorsqu’il existe 2 niveaux cliniques,<br />
il faut penser à 4 causes possib<strong>les</strong>, parmi el<strong>les</strong> <strong>des</strong> anomalies<br />
radiculaires. Aota suggère d’utiliser <strong>des</strong> coupes de IRM corona<strong>les</strong><br />
avec technique de suppression graisse.Akbapak souligne la nécessité<br />
d’une ample exposition de la zone et le diagnostic préalable<br />
dans <strong>les</strong> chirurgies percutanées, afin d’éviter <strong>des</strong> résultats catastrophiques.<br />
CONCLUSION. Il faut suspecter <strong>des</strong> anomalies radiculaires<br />
possib<strong>les</strong> devant un désaccord clinico-radiologique (demander<br />
<strong>des</strong> coupes fronta<strong>les</strong> et obliques dans la IRM), ou en intra opératoire<br />
face à la résistance <strong>des</strong> structures neurologiques. Le chirurgien<br />
qui n’est pas prévenu préopératoirement peut provoquer une<br />
lésion de la racine anomale et un dommage neurologique irréparable,<br />
particulièrement en chirurgie mini-invasive ou percutanée.<br />
*D.O. Ricciardi, Remedios de Escalada de San Martin 3279,<br />
1416 Buenos Aires, Argentine.<br />
6 Arthrodèse inter somatique antérieure<br />
par mini-thoracotomie vidéoassistée<br />
dans <strong>les</strong> fractures de la<br />
charnière thoraco-lombaire<br />
J.-P. SCHEINER*, B. RIPOLL<br />
INTRODUCTION. Proposée dans <strong>les</strong> factures à potentiel instable<br />
avec rupture de la colonne antérieure après réduction et<br />
ostéosynthèse postérieure satisfaisante, l’arthrodèse intersomatique<br />
antérieure réalisée par technique vidéo assistée « miniinvasive<br />
» apporte <strong>les</strong> meilleurs résultats à long terme dans la<br />
qualité de la greffe et la stabilité du gain angulaire post-opératoire.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Quatre-vingt-onze patients, âgés<br />
en moyenne de 36 ans, victimes de fractures du rachis de T12 à L2,<br />
ont bénéficié d’une arthrodèse par mini-thoracotomie vidéoassistée<br />
en complément d’un temps de réduction et d’ostéosynthèse<br />
postérieure sans greffe. L’abord gauche nous a paru préférable<br />
à une mini-thoracotomie droite plus hémorragique dans notre<br />
expérience. Un greffon iliaque massif tri cortical antéro-latéral est<br />
encastré dans une logette inter somatique à l’intérieur de laquelle il<br />
est parfaitement stable (nous avons utilisé l’ancillaire MIASPAS,<br />
qui permet une mesure exacte <strong>des</strong> dimensions de la logette et du<br />
greffon).<br />
RÉSULTATS. Le recul était de 5 ans pour <strong>les</strong> premiers cas (avril<br />
1997) et de 10 mois pour <strong>les</strong> derniers (janvier 2003). Au dernier<br />
recul, l’évaluation basée sur le score fonctionnel de Stauffer-<br />
Coventry, a donné respectivement 52 % et 41 % d’excellents et<br />
bons résultats cliniques, contre 7 % de résultats plus décevants. Du
point de vue radiographique, nous avons obtenu 100 % de fusion<br />
<strong>des</strong> greffons (confirmées par <strong>des</strong> tomographies) et nous n’avons<br />
constaté aucune perte angulaire (cyphose régionale).<br />
DISCUSSION. Ainsi, cette approche originale permet de<br />
conserver la correction obtenue par le montage postérieur et réalise<br />
une fusion antérieure (en zone de contraintes maxima<strong>les</strong>),<br />
c’est-à-dire une bonne arthrodèse. La relative facilitée technique<br />
de cette méthode, ajoutée à un temps opératoire cours, à peu de<br />
complications postopératoires, et à un résultat esthétique certain,<br />
permet de confirmer et de redéfinir <strong>les</strong> indications d’arthrodèses<br />
inter somatiques complémentaires. Cette fusion antérieure est<br />
pour nous le seul garant du maintien de la correction dans le temps.<br />
Enfin, l’abord discal sans nécessité d’hémostase métamérique le<br />
plus souvent, écarte tout risque vasculaire médullaire.<br />
CONCLUSION. Cette technique d’arthrodèse antérieure sous<br />
thoracoscopie précédée d’une ostéosynthèse postérieure courte et<br />
sans greffe va profondément modifier <strong>les</strong> indications d’abord antérieur<br />
complémentaire du rachis dans <strong>les</strong> fractures thoracolombaires<br />
instab<strong>les</strong>.<br />
*J.-P. Scheiner, Centre Hospitalier du Pays d’Aix,<br />
avenue <strong>des</strong> Tamaris, 13616 Aix-en-Provence Cedex 1.<br />
7 Place et résultats de la chirurgie<br />
thoracoscopique vidéo-assistée<br />
dans le traitement <strong>des</strong> fractures de<br />
la charnière thoracolombaire opérées<br />
en deux temps : étude rétrospective<br />
à partir d’une série de 26<br />
cas<br />
Y. JULIEN*, J. BEAURAIN, L.DEVILLIERS,<br />
P. LECLERC, E.BAULOT, P.TROUILLOUD<br />
INTRODUCTION. L’objectif de ce travail est d’analyser, à<br />
partir d’une série de 26 cas, <strong>les</strong> résultats et la morbidité de l’arthrodèse<br />
antérieure par minithoracotomie vidéo-assistée appliquée au<br />
traitement <strong>des</strong> fractures de la charnière thoraco-lombaire opérées<br />
en deux temps et d’en évaluer l’efficacité à moyen terme.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. De novembre 1997 à juin 2002,<br />
26 patients ont été opérés d’une fracture thoracolombaire instable<br />
avec réduction ostéosynthèse première par voie postérieure associée<br />
dans un second temps à une arthrodèse antérieure avec greffon<br />
tricortico-spongieux par minithoracotomie vidéo-assistée. Il<br />
s’agissait de 6 femmes et 18 hommes, d’âge moyen 34,5 ans. Le<br />
niveau lésionnel touchait par ordre décroissant L1 (n = 14), T12 (n<br />
= 10) et T11 (n = 2).A la prise en charge initiale, <strong>les</strong> patients étaient<br />
classés selon Franckel : A (3), B (1), C (1), D (3), E (18). Le délai<br />
moyen entre la voie postérieure et la synthèse antérieure par technique<br />
mini-invasive était de 30,2 jours (6-86). Les paramètres per<br />
et postopératoires ont été analysés ainsi que le délai de consolidation<br />
de l’arthrodèse. <strong>Tous</strong> <strong>les</strong> patients ont été revus avec un recul<br />
moyen de 21 mois (6-45) pour évaluation fonctionnelle et radiologique.<br />
RÉSULTATS. La durée opératoire moyenne était de 188 mn<br />
(80-240) avec un saignement de 235 ml (150-1000), sans incident<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S23<br />
peropératoire justifiant une conversion en thoracotomie classique.<br />
En postopératoire immédiat, la durée moyenne d’administration<br />
<strong>des</strong> morphiniques était de 2,2 jours, identiques à celle du drainage<br />
thoracique. Un épanchement pleural résiduel et deux pneumothorax<br />
résiduels ont évolué spontanément favorablement. La durée<br />
moyenne d’hospitalisation était de 12 jours (6-27). Vingt-cinq<br />
patients étaient considérés comme consolidé au 4 e mois, 1 patient<br />
présentant une pseudarthrose radiologique, asymptomatique à 1<br />
an. A la révision, le score fonctionnel d’Oswestry moyen était de<br />
22,6 %, 18 % pour <strong>les</strong> patients Franckel D ou E (n = 21) et 42 %<br />
pour <strong>les</strong> patients Franckel A B et C (n = 5). La perte de correction<br />
angulaire de la cyphose vertébrale et de l’angulation régionale<br />
traumatique entre le contrôle postopératoire et celui à la révision<br />
était de 2 en moyenne.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. Cette série d’arthrodèse<br />
antérieure complémentaire par minithoracotomie vidéo-assistée<br />
confirme le caractère sur et peu invasif de cet abord comparé à la<br />
thoraco-phréno-laparotomie et ses complications.A moyen terme,<br />
cette technique est efficace puisque <strong>les</strong> résultats fonctionnels et<br />
radiologiques sont satisfaisants. Appliquée aux fractures de la<br />
charnière thoraco-lombaire, cette prise en charge chirurgicale<br />
combinée permet de limiter la morbidité periopératoire et d’assurer<br />
un bon résultat à moyen terme.<br />
*Y. Julien, Service Orthopédie-Traumatologie,<br />
CHU Dijon, Hôpital Général, 3, rue du Faubourg-Raines,<br />
BP 1519, 21033 Dijon Cedex.<br />
8 Instrumentation <strong>des</strong> scolioses par<br />
vis lombaires et thoraciques : résultats<br />
sur 50 scolioses<br />
J.-L. CLEMENT*, J. BREAUD, E.CHAU,<br />
M.-J. VALLADE, C.HAYEM<br />
INTRODUCTION. Les auteurs présentent leur expérience de<br />
l’utilisation de vis pédiculaires thoraciques et lombaires pour la<br />
correction chirurgicale <strong>des</strong> scolioses thoraciques.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Cinquante scolioses idiopathiques<br />
(âge moyen 20 ans) ont été instrumentées par <strong>des</strong> vis pédiculaires<br />
polyaxia<strong>les</strong> à long bras du matériel Moss Miami. La<br />
méthode de mise en place était basée sur un repérage anatomique<br />
de l’entrée du pédicule et un sondage progressif du pédicule. Les<br />
résultats ont été analysés avec un recul moyen de 3,5 ans.<br />
RÉSULTATS. L’angulation moyenne de la courbure principale<br />
instrumentée passait de 54° en préopératoire à 14° en postopératoire<br />
(réduction initiale 75 %, bending 53 %) et 15° au recul (correction<br />
de 74 %). La courbure lombaire non instrumentée passait<br />
de 34° à 10°, soit une correction spontanée au recul de 72 %<br />
(bending 49 %). L’inclinaison de la première vertèbre non instrumentée<br />
était de 11° en préopératoire et 6° au recul. La cyphose était<br />
constamment améliorée avec un gain moyen de 10° pour <strong>les</strong> dos<br />
creux et plats.<br />
DISCUSSION. La correction morphologique de la déformation<br />
scoliotique, et le résultat à long terme dépendent de la qualité de la<br />
réduction initiale. Les techniques de monitoring de la moelle épi-
3S24 78 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
nière permettent, actuellement, de chercher à améliorer la qualité<br />
de la réduction.<br />
Dans le plan frontal, <strong>les</strong> résultats <strong>des</strong> montages par crochets<br />
varient selon <strong>les</strong> auteurs de 38 à 55 %. Ce pourcentage augmente à<br />
60 % lorsque la courbure lombaire est instrumentée par vis. Nous<br />
retrouvons comme Suk et Harms une correction supérieure à 70 %<br />
lorsque toute la courbure est instrumentée par vis, en lombaire et<br />
en thoracique. Dans le plan sagittal, <strong>les</strong> résultats <strong>des</strong> montages<br />
avec crochets sont pour beaucoup d’auteurs décevants (Betz,<br />
Rhee...). Le montage par vis nous a permis d’améliorer constamment<br />
et de manière nette <strong>les</strong> hypocyphoses. La qualité de ces<br />
résultats a, pour nous, une double origine : La stabilité de<br />
l’ancrage qui ne peut se déplacer lors <strong>des</strong> manœuvres de réduction<br />
et permet d’exercer <strong>des</strong> forces importantes de réduction ; la polyaxialité<br />
qui permet d’engager <strong>les</strong> tiges dans toutes <strong>les</strong> vis simultanément,<br />
et de répartir ainsi <strong>les</strong> forces de réduction. Les vis à bras<br />
longs permettent, par le serrage progressif <strong>des</strong> écrous, d’exercer<br />
une force de rappel qui ramène <strong>les</strong> vertèbres sur la tige. Nous<br />
n’avons pas observé de complication liée aux 550 vis mises en<br />
place. Il n’a pas été utilisé de distraction qui nous parait dangereuse<br />
sur le plan neurologique, ni de contraction, à l’étage thoracique,<br />
qui est lordosante.<br />
CONCLUSION. L’utilisation d’ancrages stab<strong>les</strong> dans <strong>les</strong> instrumentations<br />
pour scoliose, permet d’améliorer nettement la qualité<br />
de la réduction.<br />
*J.-L. Clement, Service d’Orthopédie Pédiatrique et Chirurgie<br />
<strong>des</strong> Scolioses, Hôpital Lenval, 57, avenue de la Californie,<br />
06200 Nice.<br />
9 Arthrodèse transforaminale intercorporéale<br />
lombaire : étude prospective<br />
à partir de 20 cas<br />
N. PASSUTI*, J. DELÉCRIN, M.ROMIH<br />
INTRODUCTION. L’indication d’une arthrodèse circonférentielle<br />
lombaire est nécessaire dans certains cas spécifiques (sténose<br />
lombaire avec instabilité et hauteur discale conservée ou<br />
spondylolisthésis). La technique d’arthrodèse intercorporéale par<br />
voie postérieure (PLIF) est à l’origine de saignements importants,<br />
de fibrose autour <strong>des</strong> racines et de complications neurologiques.<br />
L’arthrodèse transforaminale (TLIF) offre l’intérêt d’éviter un<br />
saignement significatif et une mobilisation <strong>des</strong> racines. La mise en<br />
place <strong>des</strong> cages se fait par voie unilatérale.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. L’étude prospective monocentrique<br />
a intéressé 20 cas (9 hommes et 11 femmes) avec un âge<br />
moyen de 49 ans. Les indications opératoires étaient un spondylolisthésis<br />
dégénératif dans 9 cas, 5 fois il s’agissait de douleurs<br />
lombaires discogéniques avec sténose foraminale. Les patients ont<br />
été évalués du point de vue clinique par le score Oswestry, l’autoquestionnaire<br />
SF 36 et l’EVA. Les paramètres radiologiques<br />
concernaient la consolidation intervertébrale, la lordose segmentaire,<br />
<strong>les</strong> paramètres lombo-pelviens. La technique associe : un<br />
abord postérieur, la mise en place de vis pédiculaires titane CDH<br />
(Medtronic Sofamor Danek), la distraction temporaire unilatérale<br />
permettant l’ouverture du foramen. L’arthrectomie unilatérale<br />
permet un abord latéral du disque en respectant <strong>les</strong> racines et en<br />
évitant toute mobilisation du sac dural. L’excision discale et la<br />
préparation <strong>des</strong> plateaux vertébraux précèdent l’introduction <strong>des</strong> 2<br />
cages(pyramesh) remplies de granulés de céramique macroporeuse<br />
(BCP) mélangées à de la moelle osseuse autologue. La mise<br />
en place <strong>des</strong> 2 tiges cintrées va permettre une compression segmentaire<br />
stabilisant <strong>les</strong> 2 cages, associée à une arthrodèse postérolatérale.<br />
RÉSULTATS. La durée opératoire moyenne était de 3 heures et<br />
la perte sanguine moyenne de 400 ml. Les patients ont été verticalisés<br />
au 3e jour sans corset. Le recul moyen est de 6 mois avec<br />
évaluation rétrospective du score Oswestry, du SF 36 et l’EVA.<br />
Nous avons signalé la disparition rapide <strong>des</strong> douleurs postopératoires<br />
et nous avons noté un déficit transitoire incomplet L5 chez 2<br />
patients. Les radiographies ont confirmé à6mois<strong>les</strong>signes de<br />
ponts osseux autour <strong>des</strong> cages et en zone postéro-latérale. L’analyse<br />
par radiographies dynamiques (spineview) confirme la qualité<br />
de la consolidation et <strong>les</strong> paramètres lombo-pelviens ont révélé la<br />
restauration d’une lordose segmentaire.<br />
CONCLUSION. L’arthrodèse transforaminale par abord unilatéral<br />
est une technique fiable, peu agressive sur <strong>les</strong> racines. La<br />
technique assure une stabilité primaire très fiable et permet la<br />
récupération d’une lordose locale segmentaire. Nous pensons<br />
développer une technique percutanée et mini-invasive pour réaliser<br />
cette intervention.<br />
*N. Passuti, Service d’Orthopédie, CHU, Hôtel Dieu,<br />
44093 Nantes Cedex 1.<br />
10 Résultats à long terme du traitement<br />
chirurgical <strong>des</strong> sténoses lombaires<br />
L. RILLARDON*, P. GUIGUI, A.VEIL-PICARD,<br />
H. SLULITTEL, A.DEBURGE<br />
INTRODUCTION. La qualité du résultat fonctionnel du traitement<br />
chirurgical <strong>des</strong> sténoses lombaires constaté à long terme<br />
reste encore discuté. Les objectifs de cette étude rétrospective<br />
d’observation ont été d’évaluer en moyenne 10 ans après la réalisation<br />
d’un traitement chirurgical d’une sténose lombaire, le résultat<br />
fonctionnel obtenu, de déterminer le taux de réintervention et<br />
d’apprécier <strong>les</strong> facteurs influençant le résultat constaté au dernier<br />
recul.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Cent-quarante et un patients<br />
opérés de sténose lombaire de janvier 1990 à décembre 1992 ont<br />
été inclus dans cette étude. Le recul moyen était de 10 ans. La<br />
symptomatologie fonctionnelle constatée au dernier examen a été<br />
appréciée par l’intermédiaire d’un autoquestionnaire spécifique<br />
renseignant sur <strong>les</strong> douleurs lombaires et radiculaires et <strong>les</strong> signes<br />
d’ischémie radiculaire, d’un questionnaire auto-administré renseignant<br />
sur la satisfaction du patient vis à vis de son intervention et<br />
de 2 EVA lombaires et radiculaires. Les autres données prises en<br />
compte concernaient : <strong>les</strong> paramètres épidémiologiques et morphologiques<br />
de la cohorte, <strong>les</strong> facteurs de co-morbidité, la présence<br />
ou non de signes neurologiques objectifs, <strong>les</strong> paramètres<br />
anatomiques de la sténose et <strong>les</strong> résultats d’un autoquestionnaire<br />
de qualité de vie le SF36 et d’un autoquestionnaire anxiété dépression<br />
le GHQ28. Deux types d’analyses ont été effectués. La pre-
mière, <strong>des</strong>criptive, précisait l’importance de la symptomatologie<br />
fonctionnelle constatée au dernier examen, la satisfaction du<br />
patient et le taux d’incidence et <strong>les</strong> raisons d’éventuel<strong>les</strong> réinterventions<br />
chirurgica<strong>les</strong>. La seconde, multivariée, avait pour objectif<br />
d’estimer <strong>les</strong> facteurs pouvant faire varier le score obtenu à l’autoquestionnaire<br />
sténose.<br />
RÉSULTATS. Durant la période d’étude, 15 patients ont été<br />
opérés à une reprise du rachis lombaire. Au dernier recul, l’indice<br />
global de satisfaction était de 71 %. Les meilleurs résultats ont été<br />
obtenus sur <strong>les</strong> radiculalgies et la claudication neurogène intermittente.<br />
La lombalgie résiduelle était le motif principal de mécontentement<br />
allégué par <strong>les</strong> patients au dernier recul. Le profil psychologique<br />
du patient était le facteur influençant prépondérant du<br />
résultat fonctionnel. Les autres facteurs influençant mis en évidence<br />
dans cette étude étaient : la notion de réintervention chirurgicale,<br />
la persistance de troub<strong>les</strong> neurologiques objectifs, l’importance<br />
<strong>des</strong> facteurs de co-morbidité.<br />
CONCLUSION. Le traitement chirurgical <strong>des</strong> sténoses lombaire<br />
permet d’obtenir à long terme dans la majorité <strong>des</strong> cas, un<br />
résultat jugé satisfaisant par le patient. Le risque de réintervention<br />
a été évalué, avec un recul moyen de 10 ans, à 10 %. L’étude de la<br />
littérature montre que ces résultats sont meilleurs que ceux du<br />
traitement médical et que ces interventions permettent d’obtenir<br />
une qualité de vie voisine de celle constatée dans une population<br />
témoin de même âge.<br />
*L. Rillardon, Service d’Orthopédie, Hôpital Beaujon,<br />
100, Boulevard du Général-Leclerc, 92110 Clichy.<br />
11 Myélopathies cervicarthrosiques : à<br />
propos de 42 observations<br />
H. PASCAL-MOUSSELARD*, R. DESPEIGNES,<br />
S. OLINDO, J.-L. ROUVILLAIN<br />
INTRODUCTION. Les auteurs rapportent <strong>les</strong> résultats de 42<br />
patients opérés pour une myélopathie d’origine cervicarthrosique.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Il s’agit d’une étude prospective<br />
concernant 42 patients opérés de manière consécutive par le<br />
même opérateur entre 1999 et 2002.<br />
Les patients étaient inclus devant l’association d’un critère clinique<br />
de souffrance médullaire cervicale et d’un critère radiologique<br />
(présence d’un hypersignal intramédullaire en séquence pondérée<br />
T2 à l’IRM). Le traitement était chirurgical et reposait sur<br />
une décompression par voie antérieure (corporectomie(s) associée<br />
à une greffe autologue et une ostéosynthèse par plaque vissée) ou<br />
postérieure (laminoplastie ou laminectomie). Le choix de l’abord<br />
était déterminé par le nombre de niveaux à décomprimer et <strong>les</strong><br />
troub<strong>les</strong> de la statique du rachis cervical. L’évaluation clinique<br />
utilisait le score de la Japanese Orthopaedic Association (JOA),<br />
calculé en préopératoire età6moispostopératoire.<br />
RÉSULTATS. Quarante-deux patients (25 hommes et 17 femmes)<br />
d’âge moyen 65,7 ans (38-80 ans) ont été inclus. Dix-huit<br />
abords antérieurs et 24 abords postérieurs ont étés réalisés. Il n’y a<br />
pas eu de complication neurologique ou infectieuse. Un hématome<br />
suffocant a nécessité une reprise chirurgicale précoce après abord<br />
antérieur. Deux hyperpathies métamériques sont survenues à dis-<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S25<br />
tance d’une laminectomie segmentaire. Le JOA préopératoire<br />
moyen était de 8,3/17 (2-15) età6moisde13,4 (5-17). Il n’y avait<br />
pas de différence significative sur le score JOA entre <strong>les</strong> patients<br />
opérés par voie antérieure ou postérieure.<br />
DISCUSSION. Le score JOA est l’un <strong>des</strong> rares scores validé<br />
pour <strong>les</strong> myélopathies cervicarthrosiques. Facile d’utilisation, il<br />
semble cependant sous estimer l’importance <strong>des</strong> troub<strong>les</strong> de la<br />
manipulation et de l’engourdissement <strong>des</strong> mains. Ce score repose<br />
essentiellement sur <strong>des</strong> données d’interrogatoire. La mise en place<br />
de sores mesurab<strong>les</strong> récemment décrits semble essentielle à une<br />
meilleure évaluation <strong>des</strong> patients. Les myélopathies graves (3<br />
patients dans notre série), considérées comme de mauvaises indications<br />
opératoires ne semblent pas de si mauvais pronostic lorsqu’el<strong>les</strong><br />
sont évolutives et si l’objectif de la décompression est<br />
limité. Le choix d’un abord antérieur ou postérieur est lié à la<br />
prévision de la position post opératoire de la moelle. Cette position<br />
dépend de paramètres statiques du rachis cervical de profil dont il<br />
existe peu d’étu<strong>des</strong>.<br />
CONCLUSION. L’étude <strong>des</strong> myélopathies cervicarthrosique<br />
nécessite la mise en place de score chiffrés, mesurab<strong>les</strong> et reproductib<strong>les</strong>.<br />
L’étude de la statique du rachis cervical de profil devrait<br />
permettre d’apporter de nouveaux critères dans le choix de la voie<br />
d’abord chirurgical.<br />
*H. Pascal-Mousselard, Service Orthopédie 2C,<br />
CHU La Meynard, 97200 Fort-de-France, Martinique.<br />
12 Abord trans-sacré rétro péritonéal<br />
radioguidé du disque L5-S1<br />
S. AUNOBLE*, J.-C. LE HUEC<br />
INTRODUCTION. La réalisation d’arthrodèse intersomatique<br />
à l’étage L5-S1 est une chirurgie courante en pathologie rachidienne.<br />
Deux voies d’abords sont classiquement utilisées : la voie<br />
antérieure trans ou rétro péritonéal et la voie postérieure en passant<br />
par le canal rachidien ou latéralement. Nous avons réalisé une<br />
étude anatomique et animale pour étudier la faisabilité d’une nouvelle<br />
voie d’abord du disque L5-S1.<br />
MÉTHODE. Cinq sujets anatomiques ont été utilisés pour mettre<br />
au point l’abord. Celui ci consiste à introduire par voie latérosacrée<br />
postérieure en regard du bord gauche ou droit de l’articulation<br />
sacro-coccygienne, un trocart mousse de 5 mm. Une incision<br />
de 2 cm est préalablement réalisée pour repérer la face antérieure<br />
du sacrum. Un contrôle scopique est réalisé pour suivre la progression<br />
du trocart de face et de profil. Le guide doit être médialisé et<br />
glissé à la partie médiane du sacrum Un tube plus gros, à embout<br />
oblique est glissé sur le précédent et est impacté sur le bord inférieur<br />
du disque S1-S2. Le trocart mousse est ensuite enlevé et le<br />
tube impacté dans l’os de S2 sous contrôle scopique. Au travers de<br />
ce tube on peut passer une tarière ou une mèche creuse pour<br />
perforer S2 et atteindre le disque L5-S1. L’utilisation d’instruments<br />
angulés permet de réaliser une nucléectomie sans léser<br />
l’annulus. <strong>Tous</strong> <strong>les</strong> sujets ont ensuite été explorés par voie antérieure<br />
pour analyse. Cinq porcelets de 40 à 50 kg ont été utilisés<br />
pour réaliser cette technique sur le vivant. Après mise en place de<br />
la tarière, une laparoscopie a été réalisée pour visualiser le trajet du<br />
tube et rechercher d’éventuel<strong>les</strong> complications.
3S26 78 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
RÉSULTATS. L’étude anatomique, sujet à plat ventre, a permis<br />
de confirmer la possibilité de réalisation de cet abord mini invasif.<br />
Le décollement sous péritonéal pré sacré est de réalisation aisée<br />
avec le trocart mousse. Aucune perforation <strong>des</strong> éléments digestifs<br />
tel le sigmoïde ou le colon n’a été constaté. La membrane pré<br />
sacrée était fragilisée dans deux cas mais ceci semblait avoir était<br />
favorisé par <strong>des</strong> chirurgies intra péritonéa<strong>les</strong> préalab<strong>les</strong> avec existence<br />
adhérences. La perforation de S1 et la dissectomie partielle<br />
du disque L5-S1 ont toujours été possible. En l’absence d’instruments<br />
spécifiques cette nucléectomie est restée difficile. La mise<br />
en place du trocart et l’atteinte du disque L5-S1 a pu être réalisée<br />
sans problème sur tous <strong>les</strong> porcelets. La faible angulation du<br />
sacrum par rapport au rachis lombaire rend parfois difficile<br />
l’impaction du tube dans la vertèbre S1. La laparoscopie a permis<br />
de retrouver un petit hématome pré sacré dans 4 cas sans hémorragie<br />
notable associée. Dans un cas l’hématome était beaucoup<br />
plus important et était en rapport avec un saignement artériel ou<br />
veineux provenant de vaisseaux pré sacrés. La mise en place du<br />
trocart avait été difficile et un mouvement un glissement de l’instrument<br />
vers le promontoire était probablement à l’origine d’une<br />
lésion d’une branche <strong>des</strong> vaisseaux sacrés qui sont de très gros<br />
volume sur le porcelet.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. Cette étude confirme la<br />
faisabilité d’une nouvelle approche du disque L5-S1. Cette approche<br />
peut être intéressante dans plusieurs indications : pour <strong>des</strong><br />
chirurgies de reprise après pseudarthrose avec <strong>les</strong> autres métho<strong>des</strong>,<br />
pour le traitement de certains spondylolisthésis. Pour <strong>les</strong> remplacements<br />
prothétiques partiels (nucléoplastie) cette technique<br />
d’approche a pour avantage d’éviter d’ouvrir l’annulus qui reste<br />
un élément essentiel de la stabilité du disque. D’autres essais<br />
restent nécessaires avec mise au point d’instruments adaptés mais<br />
cette voie nouvelle présente un intérêt car située dans une zone peu<br />
vascularisée. Une vidéo assistance dans le trocart permet d’optimiser<br />
sa mise en place et de contrôler la dissection pré-sacrée.<br />
*S. Aunoble, DETERCA, batiment Nord, université Bordeaux<br />
II, rue Léo-Saignat, 33076 Bordeaux Cedex.<br />
13 Analyse de l’effet amortisseur de<br />
deux modè<strong>les</strong> de prothèses disca<strong>les</strong><br />
lombaires<br />
J.-C. LE HUEC*, S. AUNOBLE, M.LIU,<br />
L. EISERMANN<br />
INTRODUCTION. L’objectif de l’étude est d’étudier la capacité<br />
d’absorption <strong>des</strong> chocs entre deux types de prothèses disca<strong>les</strong><br />
lombaires actuellement commercialisées, l’une comportant un<br />
couple métal- polyéthylène et l’autre comportant un couple métalmétal.<br />
La capacité d’absorption <strong>des</strong> chocs de ces types de prothèses<br />
n’a jamais été publiée dans la littérature, mais constitue un<br />
argument dans le choix éventuel <strong>des</strong> implants.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Deux types de prothèses ont été<br />
testés : la prothèse Maverick de la société Medtronic, la prothèse<br />
Prodisc de la société Spine Solution. Cinq prothèses de chaque<br />
type ont été testées. Les prothèses disca<strong>les</strong> ont été montées sur un<br />
appareil pour analyse de la transmission <strong>des</strong> chocs par application<br />
d’une charge constante. La partie supérieure et la partie inférieure<br />
de la prothèse étaient équipé de capteurs de force. La mesure du<br />
choc appliqué et la mesure du choc reçu par le coté opposé ont été<br />
mesurés et enregistrés simultanément. Une pré-charge statique de<br />
350 Newton était appliquée et le test d’absorption <strong>des</strong> chocs réalisé<br />
en utilisation une vibration oscillatoire supplémentaire de 100<br />
Newton avec une fréquence variant de 0 à 100 Hertz. Un choc<br />
supplémentaire de 250 Newton était appliqué toutes <strong>les</strong> 10 secon<strong>des</strong><br />
; chaque mesure d’impact appliqué et d’impact reçu était enregistré<br />
et transformé en leur spectre de fréquence. La vibration et la<br />
transmission du choc au travers de l’implant sont définies comme<br />
le ratio du spectre de sortie sur le spectre d’entrée. Les mesures ont<br />
été effectuées pour toutes <strong>les</strong> fréquences comprises entre 0 et 100<br />
Hertz. La déviation de phase était calculée pour caractériser l’effet<br />
d’absorption de choc.<br />
RÉSULTAT. Pour <strong>les</strong> deux prothèses testées sous vibration et<br />
application de choc, le déplacement de l’angle de phase entre<br />
l’impact d’arrivée et le signal de sortie était de moins de 10. Sous la<br />
charge vibratoire oscillante, <strong>les</strong> deux prothèses ont eu une transmission<br />
du choc supérieure à 99,8 %. Dans l’intervalle de fréquence<br />
de 1 à 100 Hertz, la différence de transmission entre <strong>les</strong><br />
deux implants était inférieure à 0,3 % (± 0,1). Pour le choc supplémentaire<br />
de 250 Newton appliqué, <strong>les</strong> deux prothèses ont eu un<br />
pourcentage de transmission supérieure à 98 %. La différence<br />
entre <strong>les</strong> deux implants est donc inférieur à 0,8 %. On peut considérer<br />
qu’il n’y a pas de différence entre <strong>les</strong> deux résultats puisque<br />
la sensibilité de la machine de test est de 0,5 %.<br />
CONCLUSION. Les deux prothèses testées ont la même capacité<br />
d’absorption et de transmission <strong>des</strong> chocs et <strong>des</strong> vibrations.<br />
Cette capacité est très proche de zéro ou, du moins, n’est pas<br />
mesurable par la sensibilité de l’appareil de test utilisé. Ce degré de<br />
liberté n’est pas un argument de choix pour <strong>les</strong> prothèses existantes<br />
actuel<strong>les</strong>.<br />
*J.-C. Le Huec, DETERCA, batiment Nord,<br />
université Bordeaux II, rue Léo-Saignat,<br />
33076 Bordeaux Cedex.<br />
14 Prothèse discale : résultats d’une<br />
série de 24 patients à 6 ans de recul<br />
minimum<br />
P. MORENO*, J. BOULOT<br />
INTRODUCTION. La prothèse de disque intervertébral (PDI)<br />
est-elle une alternative à l’arthrodèse dans le cas d’une dégénérescence<br />
discale sévère ? Le but de cette étude est de répondre à cette<br />
question par l’analyse à long terme <strong>des</strong> résultats de patients opérés<br />
par PDI SB Charité III.<br />
MATÉRIEL. Vingt-quatre patients ont été revus cliniquement<br />
et radiologiquement dont 66 % de femmes et 86 % opérés à l’étage<br />
L5 S1. Trois patients avaient subi une intervention, soit discectomie,<br />
soit nucléotomie, et 1 seul patient a été opéré à 2 niveaux.<br />
L’âge moyen au moment de l’intervention était de 42 ans (extrêmes<br />
: 26 et 50 ans). 80 % étaient actifs et 70 % étaient en arrêt<br />
maladie depuis plus de 6 mois. Le recul minimum de cette série<br />
était de 6 ans, le recul moyen de 8 ans 6 mois et 13 patients avaient<br />
plus de 10 ans de recul.
MÉTHODES. Cliniquement, l’évaluation a été réalisée par<br />
l’étude de l’EVA, du score d’Oswestry, de la reprise du travail et<br />
son délai et du sport. Radiologiquement, nous avons analysé la<br />
mobilité par <strong>des</strong> clichés dynamiques, la hauteur prothétique, <strong>les</strong><br />
étages adjacents au disque prothésé.<br />
RÉSULTATS. Quatre-vingt-trois pour cent <strong>des</strong> patients ont été<br />
considérés comme bons résultats avec 60 % d’amélioration de<br />
l’EVA et 50 % du score d’Oswestry. Ces résultats se sont tous<br />
maintenus au plus long recul. Douze patients avaient un excellent<br />
résultat maintenu c’est à dire EVA à 0 et Oswestry à 10. Pour la<br />
reprise du travail 90 % <strong>des</strong> actifs ont repris leur activité professionnelle<br />
dont 70 %à3moiset80%aumêmeniveaud’activité. Seul<br />
2 patients étaient en invalidité. Radiologiquement, la mobilité de la<br />
prothèse était de 8 en L4 L5 et 5 en L5 S1 en flexion-extension et<br />
15 Régénération osseuse et clou<br />
centro-médullaire d’allongement<br />
progressif Albizzia : expérience clinique<br />
à propos de 20 allongements<br />
et évaluation de la qualité du cal<br />
osseux<br />
E. GARRON*, S. AIRAUDI, D.BOUILLIEN,<br />
P. TROUILLOUD, P.LECLERC, E.BAULOT,<br />
P.-M. GRAMMONT<br />
INTRODUCTION. C’est à la fin <strong>des</strong> années 1980 que Grammont,<br />
Trouilloud et Guichet ont mis au point un clou centromédullaire<br />
d’allongement progressif. Nous analysons, dans ce travail<br />
rétrospectif à propos de 20 allongements, nos résultats<br />
cliniques et radiologiques et tentons d’apprécier la qualité du régénérat<br />
osseux obtenu.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Notre étude porte sur 18 patients,<br />
13 hommes et 5 femmes, opérés entre 1991 et 2000. L’analyse<br />
porte sur l’évolution clinique au vu <strong>des</strong> dossiers et <strong>des</strong> patients<br />
réexaminés, ainsi que sur l’étude radiologique précise du régénérat<br />
osseux selon un protocole standardisé.<br />
RÉSULTATS. Le recul moyen à la révision est de 4,55 ans (1,5<br />
à 10,5 ans). L’allongement moyen obtenu est de 46 mm (30 à 80<br />
mm) avec une vitesse moyenne d’allongement de 1,28 mm/j.<br />
L’index de Bastiani est de 26 j/cm. Nous relevons quelques complications<br />
: 1 paralysie régressive du SPE, 1 flexum du genou qui a<br />
nécessité une cure chirurgicale, 1 cas de consolidation prématurée<br />
du cal, 2 fractures de cal après l’ablation du clou. Le niveau d’activité<br />
de tous <strong>les</strong> patients est resté intact. La qualité du régénérat est<br />
meilleure dans <strong>les</strong> secteurs dorsal et médial <strong>les</strong> plus contraints en<br />
charge. Le cal obtenu est de type cortical et se remodèle après<br />
l’ablation du clou.<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S27<br />
Séance du 11 novembre matin<br />
INFECTIONS ET TUMEURS<br />
s’est maintenue. Aucune arthrodèse spontanée ni diminution de<br />
hauteur prothétique n’a été notée. Un seul patient a présentéà8ans<br />
de recul une dégradation de l’étage sus-jacent ayant nécessité une<br />
arthrodèse L4 L5 9 ans après. Deux complications (8 %) ont été<br />
observées : une éventration et une luxation antérieure à 6 jours de<br />
la prothèse L5 S1 du seul patient opéréà2niveaux ayant nécessité<br />
une arthrodèse secondaire.<br />
CONCLUSION. Au vu de cette étude avec un recul suffisant, la<br />
PDI peut être une alternative de l’arthrodèse dans le cadre bien<br />
défini d’un patient jeune atteint d’une dégénérescence discale à un<br />
seul niveau.<br />
*P. Moreno, Polyclinique du Parc,<br />
31, rue <strong>des</strong> Bûchers, 31400 Toulouse.<br />
DISCUSSION. L’utilisation du clouAlbizzia nécessite, comme<br />
toutes <strong>les</strong> techniques d’allongement, une planification préopératoire<br />
précise fixant notamment le niveau de l’ostéotomie<br />
endo-médullaire. Les résultats cliniques sont globalement satisfaisants.<br />
Le cal obtenu, proche de l’os cortical, est sensiblement<br />
différent du cal obtenu par <strong>les</strong> métho<strong>des</strong> externes mais notre étude<br />
met en évidence l’excellente qualité mécanique de ce régénérat.<br />
Par ailleurs, le clou Albizzia peut être laissé en place jusqu’à<br />
obtenir un cal solide et fiable, avantage certain par rapport au<br />
fixateur externe plus encombrant et moins bien toléré.<br />
Service d’Orthopédie et Traumatologie, Hôpital d’Enfants,<br />
Complexe du Bocage, CHRU, 21000 Dijon.<br />
w<br />
16 Sensibilité aux antibiotiques inhabituelle<br />
d’un Staphylococcus aureus<br />
permettant de dépister une épidémie<br />
en chirurgie orthopédique<br />
C. LAPORTE*, F. FAIBIS, F.BOTEREL<br />
INTRODUCTION. Les infections du site opératoire (ISO) en<br />
chirurgie orthopédique peuvent entraîner un préjudice catastrophique.<br />
La lutte contre ces infections est difficile du fait du grand<br />
nombre de facteur à contrôler. Nous décrivons ici le cas d’une<br />
épidémie d’ISO à StaphylococcusAureus résistant à la Meticilline<br />
(SARM) inhabituel dont la cause a pu être identifiée et maîtrisée.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. L’épidémie concernait 7 patients<br />
opérés durant une période de 13 mois en chirurgie orthopédique.<br />
<strong>Tous</strong> ces patients ont eu une ISO aiguë à SARM. L’analyse du<br />
germe incriminé permettait de conclure en une épidémie : il<br />
s’agissait d’un SARM très particulier, différent de celui rencontré<br />
dans <strong>les</strong> infections hospitalières, sensible aux quinolones et résistant<br />
à l’amikacine. Le traitement comportait toujours une antibiothérapie,<br />
associée à un lavage chirurgical dans 4 cas. Une étude
3S28 78 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
était entreprise à la recherche d’une cause environnementale ou<br />
humaine. Un audit du fonctionnement du bloc opératoire et une<br />
culture de prélèvements nasaux de tout le personnel du bloc opératoire<br />
présent lors de la dernière intervention compliquée d’ISO<br />
permettait de retrouver un portage nasal de SARM identique à<br />
celui incriminé dans l’épidémie chez un soignant paramédical<br />
présent lors de chacune <strong>des</strong> interventions. L’application nasale de<br />
mupirocine était entreprise chez le soignant incriminé, et permettait<br />
l’éradication du portage. Aucun nouveau cas n’a été détecté<br />
depuis plus de 14 mois.<br />
DISCUSSION. Les ISO orthopédiques entraînent une augmentation<br />
importante de la durée d’hospitalisation, peuvent provoquer<br />
un grave retentissement fonctionnel et sont <strong>les</strong> complications<br />
infectieuses nosocomia<strong>les</strong> <strong>les</strong> plus coûteuses à traiter. El<strong>les</strong> sont<br />
par ailleurs un facteur de mortalité significatif. Les infections à<br />
SARM apparaissent comme étant une cause majeure d’infection<br />
nosocomiale à germe pathogène, provoquant d’important problèmes<br />
de prévention, de contrôle et de traitement dans la plupart <strong>des</strong><br />
Hôpitaux du monde, et plus particulièrement en France. Il est<br />
admis que la majorité <strong>des</strong> micro-organismes responsab<strong>les</strong> <strong>des</strong> ISO<br />
contaminent directement le site durant l’acte opératoire. Le cas de<br />
cette épidémie rappelle que le respect rigoureux <strong>des</strong> règ<strong>les</strong> de<br />
discipline doit être acquis par l’ensemble de l’équipe médicale et<br />
paramédicale et non pas réservé à l’équipe chirurgicale.<br />
CONCLUSION. L’originalité de la sensibilité d’un staphylococcus<br />
aureus aux antibiotiques incriminés dans plusieurs ISO a<br />
permis de révéler une épidémie dont la cause, une fois retrouvée, a<br />
été éradiquée.<br />
*C. Laporte, Service d’Orthopédie, CH de Meaux,<br />
6 bis, rue Saint-Fiacre, 77104 Meaux Cedex.<br />
17 La bulle de pansement : technique<br />
d’isolement <strong>des</strong> lésions septiques<br />
<strong>des</strong> membres et prévention <strong>des</strong><br />
troub<strong>les</strong> de cicatrisation à propos<br />
de 250 patients<br />
J.-Y. HERY*, E. TOLEDANO, B.AMARA,<br />
S. TERVER<br />
INTRODUCTION. La fin d’une intervention chirurgicale se<br />
termine par la réalisation d’un pansement, visant à isoler la plaie<br />
opératoire de l’extérieur, afin de diminuer le risque de contamination<br />
aérienne. Dans le cas de traumatismes cutanés, brûlures, perte<br />
de substance cutanée aiguë ou chronique, fractures ouvertes, ce<br />
pansement peut, en revanche, présenter <strong>des</strong> inconvénients (macération,<br />
adhérences...). La lutte contre <strong>les</strong> infections est une constante<br />
dans notre pratique, tant pour protéger <strong>des</strong> plaies d’une infection<br />
secondaire que pour protéger <strong>les</strong> autres patients d’infection<br />
venue de mala<strong>des</strong> septiques Dans le cadre de certaines indications,<br />
nous utilisons un appareillage spécifique pour isoler un membre<br />
soit « à risque » soit septique.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Cet isolateur est en chlorure de<br />
polyvinyle de 100 cm de long et de 40 cm de diamètre, permettant<br />
de réaliser le pansement dans un espace clos. Il possède deux filtres<br />
« absolus », permettant d’assurer sa ventilation interne grâce à un<br />
moteur générateur d’air filtré, à débit variable. Les produits stérilisés<br />
sont acheminés dans l’isolateur par une navette spécifique. La<br />
spécificité de ce matériel, est de permettre le « non-isolement » du<br />
patient dans une chambre seule.<br />
Depuis 1986, plus de 250 patients ont bénéficié de ce système de<br />
pansement. Depuis 1993, une fiche de recueil concernant le suivi<br />
et <strong>les</strong> résultats du traitement a été codifiée.<br />
RÉSULTATS. Deux-cent-cinquante-huit patients ont été répertoriés<br />
dont 185 hommes (71 %). 271 segments de membres ont été<br />
atteints dont 227 membres inférieurs (83 %) dont 61 % de jambes<br />
et de chevil<strong>les</strong>. 50 % <strong>des</strong> étiologies sont <strong>des</strong> fractures ouvertes<br />
associées à <strong>des</strong> pertes de substances cutanées. L’évolution a été<br />
satisfaisante dans 75 % <strong>des</strong> cas aboutissant soit à une cicatrisation<br />
soit complète ou nécessitant une greffe cutanée complémentaire.<br />
Sept patients ont présenté une intolérance psychique. L’apparition<br />
d’un germe nouveau sur une plaie infectée et isolée n’a été observée<br />
qu’une seule fois. Aucun germe mis dans un isolateur n’a<br />
jamais été retrouvé en dehors.<br />
CONCLUSION. Ce type de pansement « lourd » dans sa logistique<br />
et dans sa réalisation apporte à l’évidence une sécurité bactériologique<br />
dans de nombreux cas diffici<strong>les</strong>.<br />
*J.-Y. Hery, Service de Chirurgie Orthopédique 2HE,<br />
CHU de Clermont-Ferrand, place Henri-Dunant,<br />
63000 Clermont-Ferrand.<br />
18 Connaissance préopératoire du<br />
germe en cause et changement de<br />
prothèse de hanche infectée en un<br />
ou deux temps<br />
J.-Y. JENNY*, P. PIRIOU, A.LORTAT-JACOB,<br />
C. VIELPEAU<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Les auteurs ont analysé une série<br />
rétrospective de 349 dossiers de prothèses tota<strong>les</strong> de hanche infectées<br />
traitées par changement de prothèse : 127 changements en un<br />
temps et 222 changements en deux temps. Le critère d’inclusion<br />
était la positivité d’un prélèvement au moins au cours de l’histoire<br />
clinique. Le choix de la stratégie opératoire était laissé à la discrétion<br />
du chirurgien. Les résultats de tous <strong>les</strong> prélèvements bactériologiques<br />
pré- et peropératoires ont été colligés. Ces prélèvements<br />
ont été considérés comme fiab<strong>les</strong> s’ils provenaient de la profondeur<br />
(ponction, biopsie, prélèvements peropératoires), ou non fiab<strong>les</strong><br />
dans le cas contraire. Les auteurs ont étudiés la concordance<br />
entre <strong>les</strong> prélèvements préopératoires et peropératoires pris pour<br />
référence, et l’importance de la connaissance préopératoire complète<br />
<strong>des</strong> germes en cause sur le résultat du traitement de l’infection<br />
au dernier recul connu.<br />
RÉSULTATS. Pour <strong>les</strong> changements en un temps, <strong>les</strong> prélèvements<br />
préopératoires étaient fiab<strong>les</strong> dans 74 cas (58 %) non fiab<strong>les</strong><br />
dans 7 cas (6 %), et stéri<strong>les</strong> ou absents dans 46 cas (36 %). Les<br />
prélèvements peropératoires étaient positifs dans 103 cas (81 %).<br />
Il existait une concordance entre <strong>les</strong> prélèvements pré- et peropératoires<br />
dans 48 cas (38 %). Le taux de succès n’était pas différent<br />
selon que le ou <strong>les</strong> germes en cause étai(en)t connu(s) de façon
fiable (66 succès soit 89 %) ou non fiable ou inconnu(s) (46 succès<br />
soit 87 %).<br />
Pour <strong>les</strong> changements en deux temps, <strong>les</strong> prélèvements préopératoires<br />
étaient fiab<strong>les</strong> dans 155 cas (70 %), non fiab<strong>les</strong> dans 15 cas<br />
(7 %), et stéri<strong>les</strong> ou absents dans 52 cas (23 %). Les prélèvements<br />
peropératoires étaient positifs dans 178 cas (80 %). Il existait une<br />
concordance entre <strong>les</strong> prélèvements pré et peropératoires dans 107<br />
dossiers (48 %). Le taux de succès n’était pas différent selon que le<br />
ou <strong>les</strong> germes en cause étai(en)t connu(s) de façon fiable (133<br />
succès soit 86 %) ou non fiable ou inconnu(s) (56 succès soit<br />
84 %).<br />
CONCLUSION. Les taux de succès <strong>des</strong> changements en un<br />
temps ou deux temps n’étaient pas différents selon la connaissance<br />
préopératoire du ou <strong>des</strong> germes responsab<strong>les</strong>. Cette étude ne permet<br />
donc pas de valider la notion d’une nécessité absolue de<br />
connaître <strong>les</strong> germes responsab<strong>les</strong> de l’infection en préopératoire<br />
pour pouvoir proposer un changement de prothèse de hanche<br />
infectée en un temps.<br />
*J.-Y. Jenny, Centre de Traumatologie et d’Orthopédie,<br />
10, avenue Baumann, 67400 Illkirch.<br />
19 Intérêt de la reconstruction osseuse<br />
par membrane induite et autogreffe<br />
spongieuse dans <strong>les</strong> ostéites : à<br />
propos de 18 cas<br />
J. REZZOUK*, J. LECLERC, O.LEGER,<br />
P. BOIREAU, T.FABRE, A.DURANDEAU<br />
Les ostéites sont moins fréquentes grâce aux progrès de la prise<br />
en charge initiale médico-chirurgicale. Cependant, <strong>les</strong> patients<br />
présentant ce type de complications sont de plus en plus diffici<strong>les</strong> à<br />
gérer. Ce sont souvent <strong>des</strong> patients au terrain difficile, multiopérés,<br />
dont l’infection traîne depuis plusieurs mois. Grâce à la<br />
technique mise au point par A.C. Masquelet et à un travail en<br />
binôme avec le service d’infectiologie, nous avons pu apporter une<br />
alternative à <strong>des</strong> patients souvent confrontés au risque d’une<br />
amputation.<br />
Nous avons opéré 18 patients (15 hommes, 3 femmes, âge<br />
moyen 37 ans).<br />
Le recul moyen est de 15 mois.<br />
Quatorze patients avaient subi une ou plusieurs interventions.<br />
La perte de substance osseuse à reconstituer était de 5à17cm,<br />
diaphysaire dans 10 cas et métaphysaire dans 8 cas. Quinze<br />
reconstructions concernaient le membre inférieur dont 3 fémurs, 9<br />
tibias et 3 tarses. Trois cas concernaient le membre supérieur dont<br />
1 cas le coude, 1 cas le radius et 1 cas la radio-carpienne. Les<br />
germes étaient <strong>des</strong> BMR dans 11 cas.<br />
<strong>Tous</strong> <strong>les</strong> cas ont été reconstruits selon le concept de A.C. Masquelet.<br />
La stabilisation a été assurée par un fixateur externe dans 16<br />
cas et par plaque ou broches dans 2 cas. Un lambeau a été nécessaire<br />
dans 9 cas. Le deuxième temps a été effectué après normalisation<br />
<strong>des</strong> paramètres biologiques de l’infection et cicatrisation.<br />
Il n’y a pas eu de complication immédiate. Ilyaeu3retards de<br />
cicatrisation nécessitant un lambeau lors du deuxième temps. Il y a<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S29<br />
eu 1 échecs après la greffe par reprise infectieuse. La durée<br />
moyenne du spacer a été de 4 mois. La consolidation a été en<br />
moyenne de 6 mois. Dans 2 cas, une greffe itérative a été réalisée.<br />
Cette série confirme l’intérêt de cette stratégie de reconstruction<br />
osseuse quel<strong>les</strong> que soient la trophicité <strong>des</strong> parties mol<strong>les</strong> et<br />
l’importance de la <strong>des</strong>truction osseuse. Elle permet un débridement<br />
maximal du tissu infecté, seul garant d’une éradication de<br />
l’infection. L’établissement d’une stratégie en binôme avec <strong>les</strong><br />
infectiologues nous permet de prendre en charge <strong>les</strong> cas <strong>les</strong> plus<br />
diffici<strong>les</strong> et de repousser <strong>les</strong> limites habituellement admises <strong>des</strong><br />
greffes osseuses.<br />
*J. Rezzouk, Service de Chirurgie Orthopédique,<br />
Hôpital de la Côte Basque, 13, avenue Jacques-Loeb,<br />
64109 Bayonne Cedex.<br />
20 Fibula bifoliée pour la reconstruction<br />
<strong>des</strong> membres : intérêt de la<br />
variante ostéo-septo-cutanée et<br />
d’une boucle artério-veineuse préliminaire<br />
(à propos de 14 cas)<br />
P. TURELL*, A. COUSIN, J.VIALANEIX,<br />
P. LASCOMBES, G.DAUTEL<br />
INTRODUCTION. L’utilisation d’une greffe de fibula vascularisée<br />
et dédoublée est une alternative intéressante en cas de nécessité<br />
de reconstruction de segments osseux larges. Le but de ce<br />
travail est d’évaluer <strong>les</strong> résultats à moyen terme de notre expérience,<br />
et notamment l’intérêt de deux options chirurgica<strong>les</strong> : la<br />
palette cutanée de monitoring et l’utilisation d’une boucle artérioveineuse.<br />
PATIENTS ET MÉTHODE. Cette étude rétrospective comporte<br />
14 patients (11 hommes et 3 femmes) traités entre 1992 et<br />
2002. L’âge moyen était de 30 ans (10-54). Les indications comportaient<br />
dans 9 cas <strong>les</strong> complications de fractures ouvertes : 2<br />
pertes osseuses initia<strong>les</strong> importantes, 4 pseudarthroses septiques,<br />
3 pseudarthroses aseptiques. Dans 5 cas, il s’agissait de reconstructions<br />
après exérèse de tumeur osseuse dont 4 reconstructions<br />
immédiates et une reconstruction après échec d’allogreffe massive<br />
infectée. Les localisations étaient tibia<strong>les</strong> (6 cas), fémora<strong>les</strong> (5<br />
cas), huméra<strong>les</strong> (2 cas) et bassin (1 cas). La longueur du défect<br />
osseux était en moyenne de 10 cm (7-15 cm). Le lambeau était<br />
ostéosynthésé a minima (brochage, cerclage, vissage) complété<br />
par une ostéosynthèse interne 4 fois et par fixateur externe 10 fois.<br />
Douze patients ont bénéficié d’un îlot cutané de monitoring (chez<br />
2 patients l’agencement de l’îlot s’est avéré impossible). Les anastomoses<br />
vasculaires ont été effectuées dans 7 cas par l’intermédiaire<br />
d’une boucle artério-veineuse, réalisée 6 fois de manière<br />
préliminaire.<br />
RÉSULTATS. Le recul moyen à la révision était de 35 mois. Un<br />
patient est décédé précocement de sa tumeur. Parmi <strong>les</strong> 7 patients<br />
qui ont bénéficié d’une boucle artério-veineuse, un seul a nécessité<br />
une reprise pour complication vasculaire. Pour <strong>les</strong> 7 pontages<br />
« classiques », on dénombre 3 complications peropératoires ou<br />
précoces ayant nécessité la reprise <strong>des</strong> anastomoses. Les patients<br />
avec souffrance de l’îlot cutané de monitoring (4 patients) ont tous
3S30 78 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
évolué vers la pseudarthrose, malgré une reprise immédiate. Les<br />
patients sans souffrance de l’îlot ont consolidé d’emblée dans un<br />
délai moyen de 11 mois pour 7 d’entre eux.<br />
CONCLUSION. Les résultats en terme de consolidation sont<br />
liés à la qualité de la vascularisation du greffon. L’observation<br />
clinique d’une palette de monitoring est le meilleur moyen de<br />
dépister et traiter précocement <strong>les</strong> complications vasculaires. Le<br />
recours à une boucle artério-veineuse préliminaire diminue <strong>les</strong><br />
risques vasculaires inhérents aux pontages longs et raccourcit <strong>les</strong><br />
durées opératoires.<br />
*P. Turell, Chirurgie Plastique et Reconstructrice de l’Appareil<br />
Locomoteur, SINCAL, Hôpital Jeanne d’Arc,<br />
54201 Dommartin-<strong>les</strong>-Toul.<br />
21 Les mycétomes de la cheville : à<br />
propos de 35 observations<br />
M.H. SY*, A.G. DIOUF, J.-M. DANGOU,<br />
G. BARBERET, I.DIAKHATÉ, A.NDIAYE,<br />
C. DIÉMÉ, A.DANSOKHO, S.I. LAYE-SEYE<br />
INTRODUCTION. Pseudo-tumeur de la peau, <strong>des</strong> parties mol<strong>les</strong><br />
et/ou de l’os d’origine bactérienne ou fongique <strong>les</strong> mycétomes<br />
sont souvent localisés au pied. Les localisations au niveau du<br />
cou-de-pied sont régulièrement confondues et comptées avec cel<strong>les</strong><br />
du pied. El<strong>les</strong> doivent pourtant être considérées et étudiées<br />
comme une entité nosologique différente. Le but de ce travail est<br />
d’étudier la fréquence de l’atteinte primitive de la cheville, ses<br />
différentes formes anatomo-cliniques et d’évaluer <strong>les</strong> différents<br />
facteurs pronostiques.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Trente-cinq mycétomes primitifs<br />
de la cheville ont été étudiés de façon rétrospective et continue.<br />
Ils sont tirés de 141 mycétomes suivis entre juillet 1988 et novembre<br />
2001. Il s’agissait de 22 hommes et de 13 femmes (ratio : 1,6)<br />
âgés en moyenne de 33,7 (extrêmes : 8 et 71 ans) cultivateurs et<br />
pasteurs et d’éthnie toucouleur ou peulh en majorité. Ils étaient<br />
porteurs d’un mycétome depuis 6 ans, en moyenne (extrêmes : 9<br />
mois et 20 ans). Le cou-de-pied droit était atteint 21 fois, le gauche<br />
12 fois et 2 fois le côté non précisé. L’origine fongique a été<br />
retrouvée 25 fois [grain noir = 24 (Madurella mycetomatis = 8,<br />
Leptospheria senegalensis=6et11=nonprécisé) et blanc=1(=<br />
Pseudoal<strong>les</strong>cheria boydii)] contre 6 fois pour la nature actinomycosique<br />
[2 fois = grain rouge (Actinomadura pelletieri), 4 fois =<br />
grain blanc (Actinomadura madurae) et 1 fos = grain jaune (Streptomyces<br />
somaliensis)] et 4 fois indéterminée. Seize parmi eux ont<br />
été opérés, 4 en instance et <strong>les</strong> 4 derniers traités médicalement.<br />
RÉSULTATS. L’atteinte primitive de la cheville représente<br />
16,3 % de nos mycétomes. Elle distingue une forme bénigne<br />
encapsulée (37,5 %) souvent nodulaire, uni-rétromalléolaire ou<br />
bi-rétromalléolaire d’origine souvent fongique ; à l’opposé une<br />
forme diffuse, polyfistulisée (41,6 %) pré-malléolaire finissant par<br />
englober toute la cheville. La contamination osseuse secondaire a<br />
entraîné une ostéite et/ou une ostéoarthrite dans 54,1 % <strong>des</strong> cas.<br />
Cette ostéite mycétomique a nécessité une amputation chez 5<br />
patients (20,8 %). Une seule récidive a été notée entre nos mains<br />
contre 5 recrutés avec cette complication.<br />
CONCLUSION. Les mycétomes de la cheville ne doivent plus<br />
être confondus avec ceux du pied. La forme bénigne fongique<br />
encapsulée située en arrière de la malléole mérite d’être distinguée<br />
de la diffuse polyfistulisée ostéophile actinomycosique ou fongique<br />
prenant en totalité le cou-de-pied.<br />
*M.H. Sy, CHU Le Dantec-Dakar,<br />
BP 15551, Dakar-Fann, Sénégal.<br />
22 Kyste hydatique de la cuisse : à<br />
propos de 8 cas<br />
T. AMMARI*, M. ZRIG, H.ANNABI, M.R.CHÉRIF,<br />
M. TRABELSI, M.M’BAREK, H.ESSADEM, H.BEN<br />
HASSINE, M.MONGI<br />
INTRODUCTION. Décrite pour la première fois en 1699, la<br />
localisation musculaire hydatique est rare de nos temps même en<br />
pays d’endémie.<br />
MATÉRIELS ET MÉTHODES. Nous rapportons une étude<br />
rétrospective de 9 observations de kyste hydatique primitif de la<br />
cuisse, colligées entre 1985 et 1998. Le terrain de prédilection a été<br />
la femme jeune d’origine rurale (37 ans de moyenne), qui avait<br />
consulté pour une tuméfaction isolée de la cuise gauche dans 7 cas<br />
sur 9, évoluant depuis 12 mois en moyenne sans altération de l’état<br />
général. L’apport de l’échographie dans la série était considérable<br />
et a permis d’évoquer le diagnostic dans tous <strong>les</strong> cas, justifiant la<br />
réalisation d’une sérologie hydatique positive dans 5 cas. La tomodensitométrie<br />
pratiquée dans 3 cas et l’IRM dans 2 cas fournissent<br />
<strong>des</strong> renseignements supplémentaires. Les musc<strong>les</strong> parasités<br />
étaient <strong>les</strong> adducteurs (4 cas), le quadriceps (3 cas) et <strong>les</strong> 3 loges<br />
dans 1 cas.<br />
RÉSULTATS. Le traitement était chirurgical chez 8 patients, à<br />
type d’exérèse en bloc du kyste hydatique avec du tissu musculaire<br />
périphérique 6 fois sur 8 et une périkystectomie subtotale dans 2<br />
cas. Les résultats cliniques et anatomiques sont exposés avec une<br />
iconographie riche avec un recul moyen de 6 ans.<br />
DISCUSSION. Les auteurs discutent la place de chacun <strong>des</strong><br />
examens radiologiques dans le diagnostic et le bilan d’extension<br />
ainsi que <strong>les</strong> modalité thérapeutiques selon le stade évolutif de la<br />
maladie hydatique <strong>des</strong> parties mol<strong>les</strong>.<br />
*T. Ammari, Service d’Orthopédie, Hôpital Aziza Othmana,<br />
place de la Kasba, 1008 Tunis, Tunisie.<br />
23 Action anti-tumorale directe de<br />
l’acide zolédroinique sur l’ostérosarcome<br />
de rat : effet thérapeutique<br />
en association à l’ifosfamide<br />
F. GOUIN*, D. HEYMANN, F.BLANCHARD,<br />
P. COIPEAU, J.-P. THIERY, N.PASSUTI, F.RÉDINI<br />
INTRODUCTION. La progression tumorale de l’ostéosarcome<br />
entraîne une ostéolyse par de mécanismes protéolytiques directs
et/ou une activation <strong>des</strong> ostéoclastes. Les biphosphonates contenant<br />
du nitrogène (N-BP) comme le zoledronate entraînent une<br />
inhibition de la fonction ostéoclastique et une apoptose <strong>des</strong> ostéoclastes<br />
ainsi que <strong>des</strong> cellu<strong>les</strong> tumora<strong>les</strong>. Sur <strong>des</strong> modè<strong>les</strong> animaux,<br />
<strong>les</strong> N-BP diminuent la progression osseuse du myélome, <strong>des</strong><br />
métastases osseuses <strong>des</strong> tumeurs mammaires et prostatiques. Les<br />
étu<strong>des</strong> in vitro ont montré une action synergique avec <strong>les</strong> drogues<br />
anti-cancéreuses classiques sur l’apoptose, sur <strong>des</strong> lignées cellulaires<br />
de myélome et de cancers mammaires. La présente étude a<br />
pour objet d’étudier l’effet de l’acide zolédronique sur la croissance<br />
de l’ostéosarcome, seul et en association avec l’ifosfamide.<br />
MÉTHODE. L’étude a été menée sur un modèle d’ostéosarcome<br />
transplantable de rat. Quatre séries de 7 rats ont été traitées<br />
avec du zolédronate (100 mg/kg au 7 e ,14 e ,21 e et 28 e jour après<br />
l’implantation) en association ou non avec de l’ifosfamide (30<br />
mg/kg au 13 e ,14 e et 15 e jour). Trente-cinq jours après l’implantation,<br />
<strong>les</strong> rats ont été euthanasiés et évalués sur le volume tumoral,<br />
la présence de métastases, <strong>les</strong> radiographies et l’examen anatomopathologique<br />
de la tumeur. De plus, le zolédronate a été étudié in<br />
vitro sur la lignée OSRGA d’ostéosarcome isolée de la même<br />
tumeur.<br />
RÉSULTATS. Le zolédronate s’est montré efficace en montrant<br />
la diminution de l’ostéolyse induite par l’ostéosarcome, mais aussi<br />
sur la progression locale de la tumeur (75 %) en comparaison avec<br />
<strong>les</strong> animaux non traités. In vitro, le zolédronate inhibe la prolifération<br />
cellulaire de 60 %. L’association de l’ifosfamide au zolédronate<br />
diminue de façon plus importante la progression tumorale<br />
qu’avec l’ifosfamide seul.<br />
CONCLUSION. Ce travail montre pour la première fois que le<br />
zolédronate par son effet direct et/ou antiostéoclastique contrôle la<br />
progression tumorale de l’ostéosarcome, et que cet effet augmente<br />
l’efficacité <strong>des</strong> anti-tumoraux classiques de l’ostéosarcome<br />
comme l’ifosfamide.<br />
*F. Gouin, service d’Orthopédie, CHU, Hôtel Dieu,<br />
44093 Nantes Cedex 1.<br />
24 Métastases du fémur fragilisantes<br />
ou fracturées traitées par<br />
enclouage centromédullaire : quel<br />
bénéfice pour <strong>les</strong> patients, quel<br />
score pronostique pour <strong>les</strong> soignants<br />
?<br />
L. OBERT*, A. JARRY, B.E. ELIAS,<br />
G. CANDELIER, P.GARBUIO, Y.TROPET<br />
INTRODUCTION. La prise en charge thérapeutique pluridisciplinaire<br />
<strong>des</strong> métastases <strong>des</strong> os longs fémurs est bien codifiée. Il<br />
existe peu de critères pronostiques évalués permettant le choix<br />
entre un traitement palliatif chirurgical ou une absence de traitement.<br />
Les auteurs rapportent une série de 24 métastases du fémur<br />
opérées et évaluées par le score de Tokuyashi.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Seize femmes et 8 hommes<br />
d’âge moyen 71 ans (58-89) ont été opérés par enclouage centromédullaire<br />
(ECMV). Le sein représentait 13/16 <strong>des</strong> néoplasies <strong>des</strong><br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S31<br />
femmes. 20/24 patients présentaient d’autres métastases. 16/24<br />
patients présentaient un score de Tokuhashi > 6. 14/24 patients<br />
présentaient <strong>des</strong> douleurs rebel<strong>les</strong> aux morphiniques. 13 patients<br />
présentaient <strong>des</strong> fractures et 11 <strong>des</strong> métastases fragilisantes. Le<br />
délai opératoire moyen était de 6 jours (1-15).<br />
RÉSULTATS. Quatre patients ont bénéficié d’un clou plein, 20<br />
d’un clou de reconstruction. La durée opératoire était de 93 minutes<br />
(57-123), <strong>les</strong> pertes sanguines de 200 ml (150-350. Aucune<br />
complication per-opératoire (embolie graisseuse) n’a été observée<br />
hormis un tulipage du fémur. La durée d’hospitalisation était de 23<br />
jours (8-55). La survie était de 148 jours (8 - 510) en cas de<br />
métastase fracturée, de 272 jours (12 - 730) en cas de métastase<br />
fragilisante. 8 décès ont été observés en cas de métastase fracturée<br />
(6 dans <strong>les</strong> 3 semaines post opératoires), 2 en cas d’enclouage<br />
préventif. L’appui chez <strong>les</strong> patients fracturés vivants était effectif<br />
au 57e jour (30-90). En postopératoire immédiat seuls 6 patients<br />
prenaient encore <strong>des</strong> morphiniques. En cas de métastase fémorale<br />
isolée, l’effet antalgique de l’ECMV était statistiquement significatif<br />
(p < 0,05). Une corrélation significative était retrouvée entre<br />
le score de Tokuyashi et la moyenne de survie, <strong>les</strong> patients avec un<br />
score < 3 ayant une moyenne de survie de 2,1 mois, ceux avec un<br />
score > 6 ayant une moyenne de survie de 17 mois.<br />
CONCLUSION. L’ECMV du fémur pour métastase fracturée<br />
ou fragilisante reste une solution thérapeutique de choix chez <strong>des</strong><br />
patients à pronostic de vie écourtée. Cette technique permet de<br />
diminuer <strong>les</strong> antalgiques et de conserver une autonomie le plus<br />
longtemps possible. Le score de Tokuyashi corrélé à la survie du<br />
patient et de calcul facile, permet, s’il est trop bas (< 3), de surseoir<br />
à l’intervention car prédictif d’une survie brève.<br />
*L. Obert, Service d’Orthopédie,<br />
CHU Jean-Minjoz, 25000 Besançon.<br />
25 Étude radiologique comparative de<br />
la repousse osseuse sur la prothèse<br />
de genou GUEPAR et sur une<br />
prothèse massive pourvue d’une<br />
collerette d’hydroxyapatite<br />
P. LAUDRIN*, A. BABINET, P.ANRACT,<br />
B. TOMENO<br />
INTRODUCTION. Les prothèses de genou à charnière sont<br />
utilisées principalement pour la reconstruction <strong>des</strong> gran<strong>des</strong> résections<br />
en chirurgie tumorale. Le <strong>des</strong>cellement aseptique est l’un <strong>des</strong><br />
principaux problèmes posé par ces implants. Une <strong>des</strong> solutions<br />
proposées pour diminuer le taux de <strong>des</strong>cellement est l’adjonction<br />
d’une collerette d’hydroxyapatite sur <strong>les</strong> tiges d’ancrage diaphysaires.<br />
Ce travail étudie la repousse osseuse radiologique sur un<br />
nouvel implant à charnière pourvu d’une collerette d’hydroxyapatite<br />
à la jonction entre la zone de résection et la diaphyse.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Vingt-neuf prothèses massives<br />
pourvues d’une collerette d’hydroxyapatite ont été implantées<br />
dans un même centre entre 1998 et 2001. Neuf dossiers ont été<br />
exclus en raison d’un recul inférieur à 2 ans. Les vingt dossiers ont<br />
été revus de façon rétrospective et comparés en <strong>les</strong> appariant à<br />
vingt dossiers de prothèse à charnière GUEPAR n’ayant pas de
3S32 78 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
collerette. On a mesuré la repousse osseuse sur <strong>les</strong> radiographies<br />
standard (2 incidences orthogona<strong>les</strong>) à 6, 12, 24 et 36 mois de<br />
recul. Le comblement jonctionnel entre l’os et l’implant a également<br />
été apprécié. On a noté <strong>les</strong> éventuels signes de <strong>des</strong>cellement.<br />
RÉSULTATS. La repousse osseuse moyenne dans le groupe <strong>des</strong><br />
implants avec collerette d’hydroxyapatite est de 6,58 mmà6mois,<br />
9,84 mm à 12 mois, 12,3 mm à 24 mois et 13,25 mm à 36 mois. La<br />
repousse osseuse moyenne dans le groupe <strong>des</strong> implants sans collerette<br />
d’hydroxyapatite est de 1,65 mm à 6 mois, 3,31 mm à 12<br />
mois, 4,89 mm à 24 mois et 4,35 mm à 36 mois.<br />
Le comblement jonctionnel dans le groupe <strong>des</strong> implants avec<br />
collerette est partiel dans 5 cas et total dans 15 cas.<br />
Le comblement jonctionnel dans le groupe <strong>des</strong> implants sans<br />
collerette est nul dans 8 cas, partiel dans 2 cas et total dans 10 cas.<br />
CONCLUSION. Les prothèses à collerette d’hydroxyapatite<br />
ont une repousse osseuse radiologique supérieure à celle observée<br />
sur <strong>les</strong> implants dépourvus d’hydroxyapatite. Le comblement<br />
jonctionnel est supérieur pour <strong>les</strong> prothèses à collerette<br />
d’hydroxyapatite. Il n’y a pas de <strong>des</strong>cellement au dernier recul<br />
pour <strong>les</strong> implants avec collerette d’hydroxyapatite.<br />
DISCUSSION. Au vu de ces résultats, on peut supposer qu’il<br />
existe un meilleur ancrage diaphysaire <strong>des</strong> implants avec collerette<br />
d’hydroxyapatite. Il est toutefois trop tôt pour conclure à une<br />
amélioration <strong>des</strong> résultats cliniques et à une diminution du taux de<br />
<strong>des</strong>cellement aseptique.<br />
*P. Laudrin, Service d’Orthopédie,<br />
Hôpital Saint-Vincent-de-Paul,<br />
82, avenue Denfert-Rochereau, 75014 Paris.<br />
26 Ostéotomie massive du grand trochanter<br />
dans la reprise <strong>des</strong> prothèses<br />
de reconstruction de l’extrémité<br />
inférieure du fémur<br />
G. CURVALE*, S. ROSCA, S.MADOUGOU,<br />
A. ROCHWERGER, A.SBIHI<br />
INTRODUCTION. Au cours <strong>des</strong> reprises de prothèses tota<strong>les</strong><br />
de genou avec reconstruction inférieure du fémur (mise en place<br />
initialement après résection tumorale), nous avons été confrontés<br />
aux difficultés d’extraction de la tige dans le fémur proximal (si<br />
elle n’est pas <strong>des</strong>cellée) et d’épargne du stock osseuse restant. Le<br />
but de ce travail est de décrire et d’analyser quelques aspects liés à<br />
l’utilisation d’une voie d’abord complémentaire par trochantérotomie<br />
massive, qui permet un bon accès endomédullaire du fémur<br />
et facilite l’ablation de la tige fémorale et du ciment périprothétique.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Cinq patients, opérés par cette<br />
technique entre 1991 et 1999, ont été revus. Il s’agissait de 4<br />
femmes et d’un homme, âgés de 18 à 45 ans. Le changement de la<br />
pièce fémorale a été effectué dans 3 cas pour une fracture de<br />
l’implant non <strong>des</strong>cellé, et dans 2 cas pour <strong>des</strong>cellement. L’implant<br />
de reprise a été une prothèse totale de reconstruction dans 1 cas de<br />
type Link et 4 fois de type Guepar. Dans toutes <strong>les</strong> cas, nous avons<br />
réalisé une trochantérotomie ou une cortico-trochantéromie massive<br />
en dièdre respectant en grande partie <strong>les</strong> insertions musculaire.<br />
RÉSULTATS. Les résultats ont été évalués rétrospectivement.<br />
Le recul moyen est de 5 ans (3 à 12 ans). Les suites n’ont été<br />
marquées par aucun <strong>des</strong>cellement ni rupture de l’implant. Dans<br />
tous <strong>les</strong> cas le fragment trochantérien (ou cortico-trochantérien) a<br />
consolidé normalement. Chez une seule patiente, une gêne douloureuse<br />
modère à la station assise, liée à la présence du matériel<br />
d’ostéosynthèse au niveau de la hanche, a été notée sans nécessiter<br />
d’ablation du matériel.<br />
CONCLUSION. La trochantérotomie de complément permet<br />
donc une ablation facile de la prothèse de reconstruction fémorale<br />
inférieure par abord direct au sommet de la tige prothétique, son<br />
expulsion de haut en bas et l’ablation du ciment. L’accès direct<br />
vertical de l’axe endo-médullaire permet un bon contrôle lors du<br />
temps de reprise prothétique, en limitant <strong>les</strong> pertes osseuses inuti<strong>les</strong>,<br />
sans apporter d’iatrogénicité particulière, autre que le délai de<br />
consolidation de la trochantérotomie.<br />
*G. Curvale, Service d’Orthopédie, Hôpital de la Conception,<br />
147, boulevard Baille, 13385 Marseille Cedex 5.
27 Y-a-t-il une relation entre <strong>les</strong> habitu<strong>des</strong><br />
postura<strong>les</strong> de l’enfant et <strong>les</strong><br />
vices torsionnels <strong>des</strong> membres<br />
inférieurs ?<br />
I. GHANEM*, D. NASSAR, K.KHARRAT,<br />
F. DAGHER<br />
INTRODUCTION. L’anxiété parentale devant la présence<br />
d’anomalies torsionnel<strong>les</strong> ou angulaires <strong>des</strong> membres inférieurs<br />
de leurs enfants est largement répandue. La relation entre <strong>les</strong> habitu<strong>des</strong><br />
postura<strong>les</strong> de l’enfant et <strong>les</strong> vices torsionnels <strong>des</strong> membres<br />
inférieurs est largement mentionnée dans la littérature sans qu’il<br />
n’y ait une seule étude traitant ce sujet d’une façon bien précise.<br />
Un traitement actif de ces déformations est exceptionnellement<br />
nécessaire et se résume dans la plupart <strong>des</strong> cas à une éducation<br />
posturale qui est très variablement appliquée par <strong>les</strong> enfants et<br />
leurs parents. Le but de cette étude n’est pas d’établir une relation<br />
de cause à effet entre <strong>les</strong> habitu<strong>des</strong> postura<strong>les</strong> et <strong>les</strong> anomalies<br />
torsionnel<strong>les</strong>, mais de savoir si <strong>les</strong> enfants qui ont une habitude<br />
posturale diurne ou nocturne privilégiée étaient porteurs d’anomalies<br />
torsionnel<strong>les</strong> <strong>des</strong> membres inférieurs.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Une étude rétrospective a été<br />
entreprise sur <strong>les</strong> dossiers de tous <strong>les</strong> patients qui s’étaient présentés<br />
à la consultation d’un même orthopédiste pédiatrique pour une<br />
marche « <strong>les</strong> pieds en dedans » (in-toeing), sur une période de 6<br />
ans. Les patients ayant une atteinte neurologique, une pathologie<br />
ostéo-articulaire, ou une déformation ou malformation congénita<strong>les</strong>,<br />
et ceux ayant dans leurs antécédents une histoire de port<br />
d’attel<strong>les</strong> ou de fracture ou de chirurgie <strong>des</strong> membres inférieurs ont<br />
été exclus. Un total de 463 enfants âgés de 1,5 an à 15 ans ont été<br />
retenus. Cinq habitu<strong>des</strong> postura<strong>les</strong> ont été considérées : assis enW,<br />
assis sur <strong>les</strong> genoux pieds sous fesses (PSF), couché sur <strong>les</strong> genoux<br />
fesses en l’air, pieds en dedans (CFEA), couché sur le ventre en<br />
extension <strong>des</strong> genoux, pieds en dedans (DVGE), position assise et<br />
couché indifférentes (ACI). L’anomalie torsionnelle a été recherchée<br />
cliniquement sans recours à <strong>des</strong> examens paracliniques. Une<br />
antéversion fémorale était considérée comme excessive (AVFE)<br />
pour une rotation interne de hanche supérieure ou égale à 70<br />
(Staheli) sur un examen effectué en décubitus ventral genoux fléchis<br />
à 90. Une torsion tibiale était étiquetée interne (TTI) quand<br />
elle était supérieure ou égale à 0 sur un examen effectué en décubitus<br />
ventral (thigh-foot angle) ou assis en bout de table avec <strong>les</strong><br />
jambes pendantes. La corrélation entre l’habitude posturale et<br />
l’anomalie torsionnelle a été étudiée et l’influence de l’âge et du<br />
sexe a été évaluée. L’étude statistique s’est basée sur le test de X 2<br />
(p < 0,05) et le quotient de cotes brut (intervalle de confiance à 95<br />
%) ; pour <strong>les</strong> patients ayant un vice torsionnel étagé (AVFE associée<br />
à une TTI), une stratification du groupe étudié a été faite, et le<br />
quotient de cotes a été calculé selon la méthode Woolf associé à un<br />
test d’homogénéité, ou selon la méthode de Mantel-Haenszel.<br />
RÉSULTATS. Les anomalies torsionnel<strong>les</strong> sont globalement<br />
plus fréquentes avant l’âge de 4 ans, sans différence significative<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S33<br />
Séance du 11 novembre matin<br />
INFANTILE<br />
entre fil<strong>les</strong> et garçons. Parmi tous <strong>les</strong> enfants de cette étude (marchant<br />
en rotation interne), 31 % n’avaient aucune position assise<br />
ou couchée privilégiée, alors que 7 % uniquement n’avaient pas<br />
d’anomalie torsionnelle évidente. Nous avons trouvé une corrélation<br />
directe significative entre l’AVFE et la position assise en W, et<br />
inverse significative entre l’AVFE et <strong>les</strong> autres habitu<strong>des</strong> postura<strong>les</strong>.<br />
Il n’y avait par contre aucune corrélation significative entre la<br />
TTI et <strong>les</strong> différentes habitu<strong>des</strong> postura<strong>les</strong> étudiées.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. Cette étude apporte <strong>des</strong><br />
renseignements objectifs sur <strong>des</strong> notions acceptées depuis longtemps<br />
et souvent utilisées mais pas suffisamment documentées.<br />
Cependant elle présente deux limites : 1/la première liée au matériel<br />
d’étude : cette étude gagnerait à être complétée en comparant<br />
le groupe étudié à un groupe témoin qui n’a pas de profil de marche<br />
particulier (en cours) ; 2/et la deuxième en rapport avec la méthode<br />
de mesure <strong>des</strong> ang<strong>les</strong> : l’absence de goniomètre pourrait mettre un<br />
doute sur la précision de l’examen, mais ce problème est partagé<br />
par la majorité <strong>des</strong> travaux principaux traitant <strong>des</strong> anomalies torsionnel<strong>les</strong><br />
qui se basent sur la simple méthode clinique utilisée<br />
dans le présent travail. Bien que la présence d’anomalie torsionnelle<br />
<strong>des</strong> membres inférieurs semble avoir une influence significative<br />
sur le profil de marche de l’enfant, il n’en est pas de même pour<br />
<strong>les</strong> habitu<strong>des</strong> postura<strong>les</strong> dans leur ensemble. Une relation significative<br />
a été retrouvée uniquement entre <strong>les</strong> habitu<strong>des</strong> postura<strong>les</strong> et<br />
l’AVFE, mais pas la TTI. Ces résultats sont à prendre en considération<br />
pour la planification du traitement.<br />
*I. Ghanem, Hôpital Hôtel-Dieu de France,<br />
boulevard Alfred-Naccache, Achrafieh, Beyrouth, Liban.<br />
28 Fractures-luxations de Monteggia<br />
chez l’enfant<br />
G. TAGARIS*, G. CHRISTODOULOU, A.VLACHOS,<br />
G. SDOUGOS, A.KASPIRIS<br />
INTRODUCTION. L’objectif de ce travail est d’étudier <strong>les</strong><br />
fractures-luxations de Monteggia chez l’enfant ainsi que <strong>les</strong> résultats<br />
du traitement de ces lésions.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Trente-deux enfants ont été<br />
hospitalisés pour une fracture-luxation de Monteggia en 12 ans<br />
(entre 1989 et 2001). Selon la classification de Bado, la série<br />
comportait 22 fractures-luxations de type I (69 %), 2 de type II (7<br />
%) et 8 de type III (24 %). Il n’y avait pas de fracture-luxation type<br />
IV selon Bado. La durée moyenne d’observation était de 7 ans (1 à<br />
12 ans). L’âge <strong>des</strong> enfants était de3à12ans(âge moyen 6 ans). Il<br />
s’agissait de 26 garçons (81 %) et 6 fil<strong>les</strong> (19 %). Le côté droit était<br />
concerné dans 62 % <strong>des</strong> cas. Dans 31 cas, le traitement a été<br />
orthopédique. On a opéré un enfant par réduction à ciel ouvert.<br />
RÉSULTATS. Les complications précoces étaient la rupture et<br />
la migration du matériel d’ostéosynthèse et la paralysie temporaire<br />
du nerf interosseux postérieur du patient. Les complications tardi-
3S34 78 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
ves étaient <strong>les</strong> cals vicieux de l’ulna en varus jusqu’à 20° dans 4<br />
cas. On a trouvé une bascule résiduelle postérieure de l’ulna jusqu’à<br />
10° chez deux enfants et une bascule antérieure dans un cas.<br />
Le bilan fonctionnel du coude était parfait dans tous <strong>les</strong> cas. Chez<br />
quatre enfants, un cubitus varus mineur a été observé.<br />
DISCUSSION. Trente et un enfants ont été traités de manière<br />
orthopédique. Cela a consisté en une réduction à foyer fermé de la<br />
fracture ulnaire et de la luxation de la tête radiale et une immobilisation<br />
par attelle brachio-anté-brachio-palmaire. Aucune récidive<br />
de la luxation de la tête radiale n’a été observée, même dans<br />
<strong>les</strong> cals vicieux de l’ulna jusqu’à 20°. On n’a observé ni déplacement<br />
secondaire ni récidive de luxation malgré <strong>des</strong> fractures assez<br />
instab<strong>les</strong> et obliques. Dans un cas, on a fait la réduction à ciel<br />
ouvert de la tête radiale et on a procédé à la stabilisation par un<br />
brochage transcondylo-radial. La réduction a été empêchée par le<br />
ligament annulaire rompu. La complication de rupture et de migration<br />
de la broche vers le poignet a mené à l’ablation de la broche à<br />
la 3e semaine postopératoire.<br />
CONCLUSION. La réduction orthopédique sans retard est le<br />
traitement de première intention chez l’enfant. Le pronostic apparaît<br />
excellent dans <strong>les</strong> cas traités immédiatement. En cas d’échec<br />
de la réduction à foyer fermé ou de reluxation de la tête radiale, il<br />
faut réaliser un abord chirurgical.<br />
*G. Tagaris, Service de Chirurgie Orthopédique Pédiatrique,<br />
Hôpital Pédiatrique de Patras « Karamandanio »,<br />
40, rue Erythrou-Staurou, 26331 Patras, Grèce.<br />
29 L’embrochage centromédullaire<br />
élastique stable dans <strong>les</strong> allongements<br />
progressifs<br />
D. POPKOV*, V. SHEVTSOV<br />
INTRODUCTION. L’étude est <strong>des</strong>tinée à évaluer une adaptation<br />
de l’embrochage centromédullaire (ECMES) aux allongements<br />
osseux. Une expérimentation animale permet de découvrir<br />
<strong>les</strong> particularités de la régénération osseuse et d’apprécier <strong>les</strong><br />
avantages de cette technique. Les premiers résultats cliniques sont<br />
présentés.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Nous avons analysé 11 allongements<br />
progressifs de tibia associés à l’ECMES chez <strong>des</strong> chiens. Le<br />
début de la distraction était à J5. La période d’élongation durait 28<br />
jours. Des artériographies étaient prises après décès. Nous avons<br />
analysé 17 allongements progressifs chez <strong>des</strong> patients : un cas<br />
d’allongement du bras, deux allongements d’avant-bras, neuf<br />
allongements de fémur, cinq allongements de tibia. L’âge moyen<br />
était de 14 ans. Le gain moyen obtenu était 6,2 cm.<br />
RÉSULTATS. Dans la série expérimentale, <strong>les</strong> radiographies<br />
ont montré une régénération osseuse intensive ce qui avait obligé à<br />
augmenter la vitesse de distraction. Une consolidation précoce<br />
avait été constatée chez quatre chiens. Vers J15, la consolidation<br />
avait été obtenue dans tous <strong>les</strong> cas. Les broches centromédullaires<br />
étaient laissées chez 3 chiens après l’ablation du fixateur externe. Il<br />
n’y avait pas de déformation secondaire. L’artériographie prouvait<br />
que l’artère nourricière n’était pas interrompue. Chez <strong>les</strong> patients,<br />
<strong>les</strong> délais de consolidation étaient abrégés. L’évolution <strong>des</strong> images<br />
radiologiques témoignait d’une régénération osseuse intensive. La<br />
régénération endostale était importante et jamais inhibée. La réaction<br />
périostée était aussi importante. Le gain d’allongement planifié<br />
a été respecté chez tous <strong>les</strong> patients. Nous n’avons pas rencontré<br />
de complications liées à l’ECMES.<br />
DISCUSSION. Les métho<strong>des</strong> d’allongement par clou centromédullaire<br />
permettent une stabilité absolue et permettent d’éviter<br />
de fixation externe au prix d’une <strong>des</strong>truction complète de la vascularisation<br />
centromédullaire. Notre expérimentaion animale et<br />
<strong>les</strong> résultats cliniques prouvent que <strong>les</strong> broches centromédullaires<br />
n’inhibitent pas le régénérat endosté mais, au contraire, une <strong>des</strong>truction<br />
partielle de la moelle avec la vascularisation intacte stimule<br />
une régénération osseuse. Lors <strong>des</strong> allongements osseux,<br />
l’embrochage centromédullaire est la seule méthode de fixation<br />
interne qui permette de respecter toutes <strong>les</strong> conditions optima<strong>les</strong><br />
de la régénération osseuse.<br />
CONCLUSION. L’étirement progressif <strong>des</strong> broches centromédullaires<br />
à travers le régénérat lors de la période d’élongation<br />
entraîne une stimulation <strong>des</strong> processus régénératifs. L’effet biologique<br />
de « chasse vasculaire » de la circulation centromédullaire<br />
vers la périphérie <strong>des</strong> fragments osseux aboutit à la réaction<br />
périostée importante. L’ECMES rajoute de la stabilité au fragments<br />
osseux. L’association de deux métho<strong>des</strong> permet de faire<br />
l’ablation du fixateur externe en laissant <strong>les</strong> broches centromédullaire.<br />
En armant le régénérat, el<strong>les</strong> assurent un certain degré de<br />
stabilité.<br />
*D. Popkov, Service Orthopédique #3,<br />
Centre scientifique d’Ilizarov, Kourgan 640014, Russie.<br />
30 Syndrome <strong>des</strong> loges aigu posttraumatique<br />
de la jambe chez<br />
l’enfant<br />
F. LAUNAY*, R. BASHYAL, J.FLYNN,<br />
P. SPONSELLER<br />
INTRODUCTION. Depuis l’avènement du traitement par<br />
embrochage <strong>des</strong> fractures supracondyliennes de l’humérus, le<br />
syndrome de Volkmann est devenu rare, et la plupart <strong>des</strong> cas de<br />
syndrome <strong>des</strong> loges post-traumatique chez l’enfant intéresse la<br />
jambe. Nous nous proposons d’étudier la cause, le diagnostic, le<br />
traitement et le résultat <strong>des</strong> syndromes <strong>des</strong> loges aigus posttraumatiques<br />
de la jambe chez l’enfant.<br />
MATÉRIEL. Vingt-huit cas consécutifs de syndrome <strong>des</strong> loges<br />
aigu post-traumatique chez 27 enfants ont pu être étudiés à partir<br />
<strong>des</strong> dossiers de deux centres de traumatologie pédiatrique américains<br />
sur une période de 10 ans.<br />
MÉTHODES. Nous avons évalué <strong>les</strong> causes du traumatisme,<br />
<strong>les</strong> lésions associées, <strong>les</strong> caractéristiques et l’évolution <strong>des</strong> symptômes,<br />
<strong>les</strong> métho<strong>des</strong> diagnostiques, <strong>les</strong> pressions au niveau <strong>des</strong><br />
différentes loges musculaires, le délai entre l’accident et le diagnostic<br />
et entre l’accident et l’intervention chirurgicale, ainsi que<br />
le résultat au dernier recul.<br />
RÉSULTATS. La population étudiée se composait de 24 garçons<br />
et 3 fil<strong>les</strong>, âgés de 4 mois à 15 ans.Vingt-quatre enfants furent<br />
renversés par une automobile. Vingt-deux avaient une fracture du
tibia, 4 avaient une fracture du fémur, et 2 n’avaient aucune fracture.<br />
Vingt-cinq syndromes <strong>des</strong> loges furent diagnostiqués par<br />
mesure <strong>des</strong> pressions. Le délai moyen entre l’accident et le diagnostic<br />
était de 19 heures (2,5 à 85 heures). Au moment du diagnostic,<br />
26 enfants présentaient une aggravation <strong>des</strong> phénomènes<br />
douloureux, 11 présentaient <strong>des</strong> paresthésies, 7 avaient un déficit<br />
moteur, et 3 avaient une diminution du pouls. Le délai moyen entre<br />
l’accident et l’intervention était de 21 heures. Le suivi moyen était<br />
de 15 mois. Les résultats finaux étaient remarquablement bons.Au<br />
moment du dernier recul, 24 patients n’avaient aucune séquelle<br />
douloureuse, fonctionnelle ou sensitive. Les 3 patients qui présentent<br />
un déficit fonctionnel avaient eu une aponévrotomie très tardive<br />
à 43, 83 et 86 heures après l’accident. Aucune infection n’est<br />
survenue même en cas d’intervention retardée.<br />
DISCUSSION. La plupart <strong>des</strong> enfants traités pour syndrome<br />
<strong>des</strong> loges aigu post-traumatique de la jambe ont un bon résultat en<br />
dépit du délai entre l’accident et le traitement qui excède souvent<br />
12 heures. <strong>Tous</strong> <strong>les</strong> patients avec <strong>des</strong> séquel<strong>les</strong> au dernier recul<br />
avaient eu une aponévrotomie plus de 36 heures après l’accident.<br />
CONCLUSION. Il s’agit de la première étude consacrée exclusivement<br />
au syndrome <strong>des</strong> loges aigu post-traumatique de la jambe<br />
chez l’enfant. Les résultats sont généralement bons en dépit d’un<br />
délai conséquent entre l’accident et le traitement.<br />
*F. Launay, Service d’Orthopédie, Hôpital Timone-Enfants,<br />
264, rue Saint-Pierre, 13385 Marseille Cedex 05.<br />
31 Utilisation d’un nouveau clou té<strong>les</strong>copique<br />
fémoral dans l’ostéogenèse<br />
imparfaite<br />
F. FASSIER*, P. DUVAL, A.DUJOVNE<br />
L’utilisation de clous té<strong>les</strong>copiques a permis de réduire le taux<br />
de re-opération au cours de la croissance de 51 à 27 % par rapport<br />
aux clous non té<strong>les</strong>copiques. Cependant, cette différence<br />
s’estompe à long terme en raison de complications mécaniques et<br />
secondaires aux effractions articulaires. Les auteurs rapportent<br />
leur expérience avec un nouveau clou té<strong>les</strong>copique développé pour<br />
l’enclouage du fémur dans l’ostéogenèse imparfaite. Ce clou est<br />
mis en place de façon antérograde par une mini voie d’abord<br />
fémorale supérieure et permet d’éviter l’abord chirurgical de<br />
l’articulation du genou. La fixation distale et proximale est assurée<br />
par un vissage du clou dans l’épiphyse.<br />
Quarante-quatre cas d’enclouage (43 fémurs, 1 humérus) chez<br />
29 patients (28 ostéogenèses imparfaites, une dysplasie squelettique)<br />
ont été revus avec un recul de 34 mois. L’âge moyen <strong>des</strong><br />
patients était de 47 mois (13 mois-11ans).<br />
Le déploiement du clou a été observé chez 93,2 % <strong>des</strong> patients.<br />
Des complications ne nécessitant pas de reprise chirurgicale ont<br />
été observées chez 20,5 % <strong>des</strong> patients : migration de la partie<br />
proximale du clou (n = 3), déformation ou fracture de fatigue du<br />
matériel (n = 4), perte de la fixation épiphysaire distale (n = 1).<br />
Trois complications ont nécessité une reprise chirurgicale : une<br />
protrusion intra-articulaire de la partie mâle qui a nécessité un<br />
repositionnement du clou, une migration proximale de la partie<br />
femelle dans la fesse due à une reprise trop précoce de l’appui et<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S35<br />
une perte de la fixation épiphysaire distale due à une manipulation<br />
peropératoire malappropriée.<br />
Les premiers résultats (suivi inférieur à 3 ans) montrent que<br />
l’utilisation de ce nouvel implant dans l’ostéogenèse imparfaite<br />
permet avec une approche mini-invasive de réduire le taux <strong>des</strong><br />
complications liées aux clous té<strong>les</strong>copiques sans nécessiter<br />
d’arthrotomie du genou.<br />
*F. Fassier, Shriners Hospital, 1529 Cedar avenue,<br />
Montréal QC, Canada H3G 1A6.<br />
32 La synostose radio-ulnaire congénitale<br />
: analyse d’une série de<br />
patients non opérés<br />
F.J. CERVIGNI*, C. NASER<br />
INTRODUCTION. La synostose radio-ulnaire congénitale<br />
(SRUC) est une malformation assez rare, qui correspond, du point<br />
de vue anatomique à une fusion <strong>des</strong> extrémités proxima<strong>les</strong> du<br />
radius et de l’ulna avec <strong>des</strong> anomalies <strong>des</strong> parties mol<strong>les</strong> adjacentes.<br />
Le but de ce travail est d’analyser une série de 36 cas de SRUC<br />
non opérés pour évaluer le retentissement fonctionnel et <strong>les</strong> mécanismes<br />
compensateurs. Revue de la littérature.<br />
MATÉRIEL. Vingt-cinq patients (16 hommes, 9 femmes) avec<br />
36 SRUC, (14 unilatéra<strong>les</strong>, 11 bilatéra<strong>les</strong>) ont été rassemblés dans<br />
une période de huit années (1994-2002). Aucun malade n’a été<br />
opéré. La moyenne d’âge au moment de l’évaluation était de 8,3<br />
ans (2-25).<br />
MÉTHODES. <strong>Tous</strong> <strong>les</strong> patients ont été évalués cliniquement en<br />
recherchant la mobilité active et passive de l’épaule, du coude, du<br />
poignet et <strong>des</strong> doigts. La fonction était évaluée par le test de Jebsen<br />
et Taylor modifié. <strong>Tous</strong> ont bénéficié d’une étude radiographique<br />
de l’avant-bras en mesurant la taille de la synostose et en recherchant<br />
toute autre anomalie osseuse.<br />
RÉSULTATS. À l’examen clinique, la position moyenne de<br />
fixation de l’avant-bras était de 35º de pronation (10° de supination<br />
à 90° de pronation). Une perte d’extension du coude (5-15 degrés)<br />
était présente dans 31 % <strong>des</strong> cas. La mobilité de l’épaule était<br />
normale chez tous <strong>les</strong> patients, et tous présentaient une laxité<br />
compensatrice dans le poignet, sauf deux patients qui présentaient<br />
une poignet raide dans <strong>des</strong> SRUC associées à un syndrome de<br />
Poland.<br />
La capacité fonctionnelle était normale sauf pour 4 patients qui<br />
se plaignaient de gêne dans certaines activités (jouer au volley,<br />
couper avec <strong>des</strong> ciseaux, se laver la face, soulever <strong>des</strong> objets<br />
lourds). Aucun patient ne demandait de chirurgie correctrice pour<br />
sa gêne.<br />
DISCUSSION. D’après la littérature, la chirurgie de la SRUC<br />
pose <strong>des</strong> problèmes techniques et <strong>des</strong> problèmes d’indications.<br />
Heureusement, la plupart <strong>des</strong> patients ne sont pas suffisamment<br />
gênés pour justifier une intervention chirurgicale. Le degré de<br />
l’angle de pronosupination fixé n’est pas le seul facteur à tenir en<br />
compte au moment de proposer une chirurgie, car la gêne fonctionnelle<br />
est liée aussi au caractère uni ou bilatéral de la malformation<br />
à l’atteinte du côté dominant ou non, à efficacité <strong>des</strong> mouvements
3S36 78 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
compensatoires par l’épaule, le poignet et <strong>les</strong> doigts, et par l’activité<br />
professionnelle du sujet. Dans cet série, la gêne était minime.<br />
CONCLUSION. La SRUC est une pathologie bien tolérée pour<br />
<strong>les</strong> mala<strong>des</strong> ne justifiant que rarement une intervention chirurgicale.<br />
*F.J. Cervigni, Obispo Luque 1323, Bº Colinas del Cerro,<br />
5009 Córdoba, Argentine.<br />
33 L’influence du mouvement articulaire<br />
sur la régénération du tissu<br />
squelettique in vivo : le mouvement<br />
articulaire signal de différenciation<br />
D. MOUKOKO*, D. POURQUIER, A.DIMÉGLIO<br />
INTRODUCTION. Les effets délétères de la privation du mouvement<br />
sur <strong>les</strong> articulations saines ont été démontrés par de nombreuses<br />
expérimentations anima<strong>les</strong> et observations humaines. Au<br />
contraire, la mobilisation <strong>des</strong> articulations est responsable d’effets<br />
métaboliques et trophiques communément attribués à <strong>des</strong> modifications<br />
du statut nutritionnel du cartilage. Cependant, <strong>les</strong> expérimentations<br />
in vitro, ainsi que <strong>les</strong> travaux récents de mécanobiologie<br />
suggèrent l’intervention de mécanismes plus fondamentaux,<br />
démontrant l’impact de facteurs physiques sur la régulation biologique<br />
cellulaire et l’organisation tissulaire. Le but de notre expérimentation<br />
est d’étudier <strong>les</strong> effets biologiques du mouvement sur<br />
un modèle de régénération squelettique d’origine mésenchymateuse.<br />
L’hypothèse testée est que le mouvement, traversant un<br />
tissu biologique, y entraîne l’émission de signaux spécifiques qui<br />
contribuent à son organisation anatomique et fonctionnelle.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Sur 27 lapins immatures, nous<br />
avons transféré un lambeau de périoste vascularisé dans la région<br />
du genou afin d’initier un processus de régénération tissulaire<br />
squelettique. Le régénérat est soumis aux mouvements articulaires<br />
lors de la déambulation spontanée de l’animal. Dans le premier<br />
groupe, le genou est conservé intact. Dans le second groupe, le<br />
fémur distal est excisé sur 25 mm, emportant <strong>les</strong> condy<strong>les</strong>. La<br />
régénération tissulaire est comparée à celle obtenue en l’absence<br />
de mouvement.<br />
RÉSULTATS. Des modifications qualitatives du régénérat sont<br />
observées sous l’influence du mouvement, la différenciation <strong>des</strong><br />
précurseurs mésenchymateux s’oriente vers une production cartilagineuse<br />
et fibro-cartilagineuse. Dans <strong>les</strong> cas de résection du<br />
fémur, un interligne cartilagineux mobile est obtenu à l’interface<br />
entre le régénérat fémoral et le tibia sous-jacent. Une néo articulation<br />
fonctionnelle est formée.<br />
DISCUSSION. Dans ce modèle de régénération tissulaire, proche<br />
de celui de la pseudarthrose expérimentale, nous montrons la<br />
contribution de cellu<strong>les</strong> souches multipotentes de diverses origines.<br />
La mobilité articulaire et ses conséquences mécaniques sont à<br />
l’origine d’informations, perçues comme une modification de<br />
l’environnement. El<strong>les</strong> régulent la différenciation <strong>des</strong> éléments<br />
cellulaires pluripotents et guident ainsi, l’organisation spatiale et<br />
temporelle <strong>des</strong> processus de réparation tissulaire in vivo.<br />
CONCLUSION. Nos travaux confirment l’influence majeure<br />
<strong>des</strong> contraintes mécaniques sur l’organisation tissulaire squelettique.<br />
Elle s’exprime sur <strong>les</strong> tissus matures (remodelage), mais aussi<br />
sur <strong>les</strong> tissus immatures impliqués dans <strong>les</strong> processus de morphogenèse<br />
et de régénération squelettique. Les mécanismes de transduction<br />
restent à définir. Cependant, <strong>les</strong> résultats obtenus sur la<br />
régénération cartilagineuse confirment l’intérêt pratique <strong>des</strong><br />
arthroplasties périostées. L’optimisation du modèle présenté, par<br />
la mobilisation passive continue, ouvre <strong>des</strong> perspectives prometteuses<br />
dans <strong>les</strong> projets de régénération articulaire in vivo.<br />
*D. Moukoko, Service d’Orthopédie Pédiatrique,<br />
CHU Lapeyronie, 191, avenue Doyen-Gaston-Giraud,<br />
34295 Montpellier.<br />
34 Traitement <strong>des</strong> défauts osseux<br />
chez <strong>les</strong> enfants par facteurs de<br />
croissance autologues (AGF) et<br />
hydroxyapatite<br />
P. DOMÉNECH*, P. GUTIÉRREZ, J.M. VALIENTE,<br />
S. SOLER, J.VERDÚ, J.FENOLLOSA<br />
INTRODUCTION. Dans la population infantile, la réalisation<br />
d’autogreffes est limitée par la quantité de tissu osseux disponible<br />
au niveau <strong>des</strong> zones donneuses, la nécessité de faire une seconde<br />
incision, la prolongation du temps chirurgical et la morbidité au<br />
niveau du site donneur. L’utilisation de substituts osseux est avantageuse<br />
dans de nombreux cas. Les facteurs de croissance autologues<br />
plasmatiques et plaquettaires favorisent l’ostéo-induction,<br />
peuvent être obtenus facilement, et conjointement à <strong>des</strong> matériaux<br />
ostéoconducteurs favorisent la croissance osseuse. L’objet de ce<br />
travail est d’évaluer <strong>les</strong> résultats de l’utilisation d’une combinaison<br />
AGF-HA en pathologie pédiatrique, en l’absence de greffe<br />
autologue.<br />
MATÉRIEL. Étude clinique prospective chez 14 enfants (16<br />
cas), 9 garçons et 6 fil<strong>les</strong> ; l’âge moyen était de 9,4 ans. Les<br />
pathologies consistaient en : ostéotomie fémorale, défect osseux<br />
après ostéomyélite, tumeurs kystiques bénignes, pseudarthrose de<br />
l’extrémité supérieure et inférieure, triple arthrodèse avec ostéopénie<br />
et manque de matériel osseux.<br />
MÉTHODE. On a utilisé dans tous <strong>les</strong> cas une combinaison de<br />
facteurs de croissance autologues avec de la thrombine humaine et<br />
de l’hydroxyapatite (AGF- HA). L’AGF a été préparé après fractionnement<br />
de sang autologue, selon la volémie, la taille et le poids<br />
<strong>des</strong> enfants. On a obtenu un ultraconcentré de plaquettes qui a été<br />
ajouté au concentré de thrombine (500 UI) et HA (500 R) au<br />
moment de l’implantation. Le temps moyen de préparation a été de<br />
20 minutes. Dans aucun <strong>des</strong> cas n’a été associé de greffe autologue.<br />
RÉSULTATS. Il n’y a pas eu d’infection superficielle ou profonde<br />
secondaire à l’implantation. La consolidation tant clinique<br />
que radiologique a été obtenue en 11 semaines en moyenne (8-16)<br />
sauf dans deux cas (11 %).<br />
DISCUSSION. L’utilisation de la combinaisonAGF-HA en cas<br />
de défauts osseux chez <strong>les</strong> enfants apporte une alternative utile,
c’est une technique simple qui accélère la consolidation et l’intégration<br />
de la HA, il n’a pas été observé de réaction de rejet.<br />
CONCLUSION. 1) Chez <strong>les</strong> enfants c’est une alternative validée<br />
qui évite un second abord et la morbidité correspondante. 2)<br />
L’utilisation de AGF-HA ne transmet pas d’infections, n’allonge<br />
pas le temps chirurgical et est une alternative au recours à la greffe<br />
osseuse, tant autologue qu’hétérologue.<br />
*P. Doménech, Seccion de traumatología y ortopedia infantil,<br />
Hospital General Universitario de Alicante,<br />
c/Maestro Alonso 109, cp 03010, Alicante, Espagne.<br />
35 Désépiphysiodèse ou chondrodiastasis<br />
V. LANGLOIS*, J.-M. LAVILLE<br />
INTRODUCTION. La distraction physaire a été utilisée pour le<br />
traitement <strong>des</strong> conséquences <strong>des</strong> ponts d’épiphysiodèse en corrigeant<br />
dans le même temps <strong>les</strong> déformations angulaires et <strong>les</strong> inégalités<br />
de longueur.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Six chondrodiastasis ont été<br />
réalisés chez six enfants [age moyen 13,1 ans (10,4-15,7). Les<br />
étiologies <strong>des</strong> épiphysiodèses étaient <strong>les</strong> suivantes : 3 post traumatiques<br />
(2 tibias distal, 1 radius distal), deux ostéomyélites (fémur<br />
distal), une post chirurgicale sur pied bot (tibia distal). Le recul est<br />
de 2 ans (18 mois-4 ans). L’appareil d’Ilizarov a été utilisé 4 fois,<br />
et l’Orthofix deux fois.<br />
RÉSULTATS. La correction de l’inégalité de longueur a toujours<br />
été obtenue, et on retrouve deux insuffisances de correction<br />
angulaire. La durée de distraction a été de quatre mois (1-9) et la<br />
durée totale de traitement de 7,5 mois (4-13). Les complications<br />
mineures ont été représentées par <strong>des</strong> infections sur broche dans<br />
deux cas et par 3 cas de raideur articulaire. La complication<br />
majeure a été une fracture du fémur sur un site de fiche, avec<br />
fermeture prématurée du cartilage de croissance traitée par callotasis,<br />
et une fracture après ablation du fixateur externe, traitée par<br />
immobilisation plâtrée. Dans <strong>les</strong> deux cas, le résultat final a quand<br />
même été bon.<br />
DISCUSSION. La technique de désépiphysiodèse par résection<br />
chirurgicale du pont osseux, est limitée par l’âge du patient (10, 11<br />
ans) et par l’incertitude de son résultat. Les avantages principaux<br />
de la distraction physaire appliquée aux déformations angulaires<br />
<strong>des</strong> patients en croissance sont l’absence d’ostéotomie et la correction<br />
progressive. Cette méthode non invasive permet le réglage<br />
de la correction angulaire chez un patient verticalisé, et un allongement<br />
concomitant. Le chondrodiastasis corrige exactement au<br />
sommet de la déformation et aucune résection du pont osseux n’est<br />
nécessaire puisque celui-ci peut être rompu par simple distraction.<br />
Les inconvénients sont ceux <strong>des</strong> fixateurs externes en distraction.<br />
La fertilité du cartilage de croissance après distraction doit être<br />
considérée comme perdue, et l’importance de la correction doit<br />
être calculée sur <strong>les</strong> bases d’une épiphysiodèse post opératoire<br />
complète et définitive.<br />
CONCLUSION. Le chondrodiastasis permet une correction<br />
<strong>des</strong> conséquences acquises et prévisib<strong>les</strong> <strong>des</strong> ponts d’épiphysiodèse,<br />
au sommet de la déformation et sans aucun abord direct.<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S37<br />
Cette méthode peut être utilisée pour <strong>les</strong> épiphysiodèses partiel<strong>les</strong><br />
(moins de 50 %) chez l’enfant n’ayant pas atteint la maturité.<br />
Après distraction, le cartilage de croissance doit être considéré<br />
comme définitivement fermé.<br />
*V. Langlois, Service de Chirurgie Infantile, CHD Félix-Guyon,<br />
97405 Saint-Denis, île de la Réunion.<br />
36 L’IRM avec reconstruction tridimentionnelle<br />
: une nouvelle technique<br />
d’analyse du pont osseux d’épiphysiodèse<br />
F. SAILHAN*, F. CHOTEL, A.-L. GUIBAL, P.ADAM,<br />
J.-P. PRACROS, J.BÉRARD<br />
INTRODUCTION. L’épiphysiodèse partielle de la plaque de<br />
croissance après agression physaire est un problème courant en<br />
pathologie pédiatrique. Sa prise en charge chirurgicale nécessite<br />
au préalable une imagerie précisant ses caractéristiques. Après un<br />
rappel <strong>des</strong> autres techniques d’imagerie employées à ce jour, <strong>les</strong><br />
auteurs décrivent une méthode originale d’étude <strong>des</strong> caractéristiques<br />
<strong>des</strong> ponts osseux d’épiphysiodèse sur une plaque de croissance<br />
: l’IRM tridimensionnelle.<br />
MATÉRIEL. Nous avons analysé rétrospectivement <strong>les</strong> IRM de<br />
27 ponts d’épiphysiodèse chez 23 enfants (10 garçons et 13 fil<strong>les</strong>)<br />
âgés de 11,3 ans en moyenne (2,5 à 15 ans). Toutes <strong>les</strong> informations<br />
précisant la cause de l’agression de la physe, l’articulation<br />
touchée, le type de pont osseux selon Ogden, la déformation clinique<br />
et le traitement proposé ont été colligées.<br />
MÉTHODE. Les 27 ponts d’épiphysiodèse ont été étudiés sur<br />
<strong>des</strong> coupes corona<strong>les</strong> d’IRM acquises en séquences avec écho de<br />
gradient et suppression de graisse (SPGR). Ces images traitées par<br />
un logiciel de reconstruction 3-D manuelle permettent, en 15<br />
minutes, de définir avec précision la localisation, le volume et la<br />
morphologie du pont osseux et de la physe active.<br />
RÉSULTATS. Soixante-cinq pour cent <strong>des</strong> épiphysiodèses sont<br />
post-traumatiques 17 % d’origine iatrogène, 9 % d’origine<br />
ischémique-infectieuse (purpura fulminans), 4,5 % liées à un<br />
kyste essentiel juxta-physaire et 4,5 % d’origine inconnue. 87 %<br />
<strong>des</strong> épiphysiodèses étudiées siègent sur une articulation du membre<br />
inférieur, dont 75 % <strong>des</strong> cas intéressent le tibia. La surface d’un<br />
pont d’épiphysiodèse représente en moyenne 20 % de la physe.<br />
46,5 % <strong>des</strong> ponts osseux sont de type périphériques, 46,5 % sont<br />
centraux et 7 % sont de type linéaires.<br />
DISCUSSION. Les techniques d’imagerie tel<strong>les</strong> que la radiographie<br />
simple, la scintigraphie, la tomographie et le TDM permettent<br />
difficilement de donner la position et <strong>les</strong> rapports tridimensionnels<br />
d’un pont d’épiphysiodèse au sein de la physe active.<br />
La méthode IRM décrite permet de distinguer sans équivoque la<br />
plaque de croissance active en hypersignal d’une part et le pont<br />
osseux d’épiphysiodèse en hyposignal d’autre part. Elle apporte<br />
<strong>les</strong> caractéristiques morphologiques (taille, forme) et topographiques<br />
précises du pont osseux et de la physe facilitant la décision<br />
thérapeutique et guidant le geste chirurgical. L’IRM n’est pas<br />
irradiante contrairement aux techniques précédemment citées.
3S38 78 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
CONCLUSION. La qualité <strong>des</strong> images obtenues, l’innocuité de<br />
l’IRM et la facilité d’interprétation <strong>des</strong> reconstructions 3-D font de<br />
cette technique d’imagerie une excellente méthode d’analyse préthérapeutique<br />
<strong>des</strong> ponts d’épiphysiodèse.<br />
*F. Sailhan, Service de Chirurgie Pédiatrique,<br />
Hôpital Debrousse, 29, rue Sœur-Bouvier,<br />
69322 Lyon Cedex 05.<br />
37 Remise en tension de l’appareil<br />
extenseur du genou de l’enfant<br />
infirme moteur cérébral (IMC) :<br />
résultat fonctionnel à l’âge adulte<br />
C. CHARBONNIER*, P. PEDELUCQ, A.FARÈS,<br />
V. TSIMBA, G.FILIPE<br />
La marche <strong>des</strong> enfants I.M.C. se dégrade fréquemment à l’ado<strong>les</strong>cence<br />
du fait d’un triple f<strong>les</strong>sum <strong>des</strong> hanches, <strong>des</strong> genoux et <strong>des</strong><br />
chevil<strong>les</strong> accompagné d’une limitation de l’extension active du<br />
genou par ascension de la rotule et étirement du tendon rotulien.<br />
L’abaissement chirurgical <strong>des</strong> rotu<strong>les</strong> associé à une libération<br />
du f<strong>les</strong>sum <strong>des</strong> hanches et parfois à un allongement <strong>des</strong> ischiojambiers<br />
permet de supprimer l’accroupissement lors de la marche<br />
et de la rendre plus fonctionnelle. L’efficacité de cette intervention<br />
est démontrée à court et moyen terme. Le but de ce travail est<br />
d’évaluer le résultat fonctionnel à long terme et dans sa dimension<br />
environnementale c’est-à-dire à l’âge adulte et dans <strong>les</strong> déplacements<br />
de la vie quotidienne.<br />
38 Traitement chirurgical <strong>des</strong> syringomyélies<br />
post-traumatiques par dérivation<br />
ou libération arachnoïdienne<br />
J.-F. LEPEINTRE*, C. COURT, F.PARKER,<br />
M. TADIÉ<br />
INTRODUCTION. Le but de cette étude rétrospective était de<br />
rapporter <strong>les</strong> résultats du traitement chirurgical <strong>des</strong> syringomyélies<br />
post-traumatiques (SPT) et de discuter la place <strong>des</strong> différents<br />
techniques.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Entre 1984 et 2001, 31 patients<br />
ont été opérés soit par une dérivation du kyste (groupe D ;n=21)<br />
soit par une libération arachnoïdienne (groupe LA ; n = 10). L’analyse<br />
<strong>des</strong> résultats a porté sur <strong>les</strong> modifications postopératoires<br />
cliniques (douleurs) et fonctionnel<strong>les</strong> (mesure de l’indépendance<br />
Séance du 11 novembre matin<br />
RACHIS<br />
Vingt deux sujets I.M.C. de 19 à 35 ans opérés à un âge moyen<br />
de 12 ans ont été étudiés. Le recul moyen post-opératoire était de<br />
11 ans. <strong>Tous</strong> <strong>les</strong> sujets ont été évalués par un questionnaire qui a<br />
permis de <strong>les</strong> classer selon <strong>les</strong> catégories fonctionnel<strong>les</strong> de marche<br />
(échelle de 6 niveaux). Le niveau de marche actuel (M3) a été<br />
comparé au niveau de marche pré-opératoire (M1) et en fin de<br />
rééducation post-opératoire (M2) également évaluées selon <strong>les</strong><br />
catégories fonctionnel<strong>les</strong> de marche.<br />
— 15 sujets ont progressé d’au moins une catégorie fonctionnelle<br />
de marche entre M1 et M3.<br />
— 5 sujets sont restés dans la même catégorie entre M1, M2 et<br />
M3 mais étaient quand même satisfaite du résultat (diminution <strong>des</strong><br />
douleurs de genoux, meilleur équilibre debout).<br />
— 2 sujets ont régressé d’une catégorie entre M2 et M3 après<br />
avoir progressé d’une catégorie entre M1 et M2.<br />
Douze sujets sur 22 ont actuellement une marche fonctionnelle<br />
hors de leur domicile, à <strong>des</strong> degrés divers alors qu’en préopératoire<br />
ils avaient systématiquement recours au fauteuil roulant<br />
pour se déplacer hors de leur domicile. L’allongement <strong>des</strong> ischiojambiers<br />
a pu être évité par la confection de plâtres anti-f<strong>les</strong>sum de<br />
genou pré-opératoires pour certains de ces sujets.<br />
Il n’existe que très peu de publications sur cette intervention<br />
chirurgicale et ses résultats fonctionnels à très long terme.<br />
Pour la majorité <strong>des</strong> sujets étudiés, le résultat fonctionnel<br />
obtenu en fin de rééducation post-opératoire se maintient au long<br />
cours. Les catégories fonctionnel<strong>les</strong> de marche permettent facilement,<br />
même par téléphone, d’évaluer le résultat fonctionnel dans<br />
sa dimension environnementale.<br />
*C. Charbonnier, Service de Chirurgie Pédiatrique,<br />
Hôpital Trousseau, 26, avenue du Docteur-Arnold-Netter,<br />
75012 Paris.<br />
fonctionnelle (MIF)). L’analyse <strong>des</strong> résultats morphologiques a<br />
porté sur l’analyse de la variation de index de Vaquero (IV) sur <strong>les</strong><br />
IRM.<br />
RÉSULTATS. En postopératoire immédiat, il yaeu24%<br />
d’aggravation de la sensibilité cordonale postérieure dans le<br />
groupe D contre 10 % dans le groupe LA. A long terme, ilyaeu<br />
une amélioration statistiquement significative <strong>des</strong> douleurs sus et<br />
sous lésionnel<strong>les</strong>. Il y a eu 77 % de stabilisation du score de Frankel<br />
et 76 % de stabilisation du score moteur MIF en postopératoire.<br />
Morphologiquement, il y a eu une diminution significative<br />
de l’IV quels que soient <strong>les</strong> groupes. L’étude vélocimétrique en<br />
IRM a été réalisée chez 7 patients. Les vitesses kystiques systoliques<br />
et diastoliques étaient plus élevées en préopératoire chez <strong>les</strong><br />
patients avec un grade clinique sévère. En postopératoire (délai<br />
moyen de 14 mois), il existait une diminution significative <strong>des</strong><br />
vitesses systoliques intra kystiques (p = 0,017). Les vitesses périmédullaires<br />
systoliques, initialement effondrées en périphérie du<br />
kyste étaient de nouveau élevées en postopératoires traduisant une<br />
re-circulation dans <strong>les</strong> espaces sous-arachnoïdiens péri-
médullaires. Le taux de réintervention a été de 43 % dans un délai<br />
moyen de 39 mois pour <strong>les</strong> patients du groupe D (suivi moyen de<br />
36 mois) contre 20 % dans le groupe LA (suivi moyen de 31 mois).<br />
Le taux de complications a été de 11 % (2 infections de cicatrices,<br />
1 méningite, 1 pneumopathie, 1 dysfonctionnement aigu de dérivation).<br />
DISCUSSION. Les interventions de libération arachnoïdienne<br />
présentent à long terme un taux de réintervention moins important<br />
que <strong>les</strong> interventions de dérivation avec un taux d’atteinte cordonale<br />
postérieure post-opératoire moindre pour un résultat fonctionnel<br />
et morphologique identique. Les auteurs proposent de définir<br />
la place respective <strong>des</strong> interventions intra et extra-dura<strong>les</strong> dans<br />
le traitement <strong>des</strong> SPT.<br />
*J.-F. Lepeintre, Service Neurochirurgie, Hôpital de Bicêtre,<br />
78, rue du Général-Leclerc, 94250 Le Kremlin-Bicêtre.<br />
39 Syringomyélie post-traumatique<br />
symptomatique : existe-t-il <strong>des</strong> facteurs<br />
prédictifs ?<br />
C. COURT*, J.-F. LEPEINTRE, J.-Y. NORDIN,<br />
M. TADIÉ, F.PARKER<br />
INTRODUCTION. L’incidence <strong>des</strong> syringomyélies après traumatisme<br />
vertébro-médullaire est difficile à estimer mais atteindrait<br />
dans <strong>les</strong> séries <strong>les</strong> plus récentes 28 %. Le but de ce travail rétrospectif<br />
a été d’étudier s’il existait <strong>des</strong> facteurs de risques d’apparition<br />
de syringomyélies post-traumatiques (SPT) symptomatiques,<br />
afin de proposer une prise en charge précoce adaptée.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Quarante-six patients ont<br />
consulté pour une SPT symptomatique à 14 ans (9 mois-45 ans) du<br />
traumatisme. La moitié <strong>des</strong> patients avaient été opérés initialement<br />
(74 % avec une ostéosynthèse et 70 % avec une laminectomie).<br />
Les modifications de l’examen clinique, du score de Frankel, de la<br />
mesure de l’Indépendance fonctionnelle (MIF) lors de la découverte<br />
de la SPT ont été comparées à la période post-traumatique<br />
initiale. La cyphose locale et la sténose canalaire résiduel<strong>les</strong> ont<br />
été mesurées. La topographie, la longueur et l’extension de la<br />
cavité syringomyélique, la présence d’une arachnoïdite et la perméabilité<br />
<strong>des</strong> espaces sous-arachnoïdiens (ESA) ont été appréciées<br />
sur l’IRM. L’importance <strong>des</strong> vitesses circulatoires liquidiennes<br />
intra-kystiques et périmédullaires ont été également<br />
quantifiées.<br />
RÉSULTATS. Le sexe, l’âge, le niveau vertébral atteint et<br />
l’importance du déficit neurologique initial n’étaient pas prédictifs<br />
de la survenue d’une SPT symptomatique. La découverte clinique<br />
d’une SPT se faisait devant <strong>des</strong> douleurs, <strong>des</strong> paresthésies ou un<br />
déficit moteur sus lésionnel dans 2/3 <strong>des</strong> cas, une modification de<br />
l’équilibre vésico-sphinctérien, ou une aggravation sous lésionnelle<br />
en cas de motricité résiduelle dans <strong>les</strong> autres cas ; le score<br />
MIF était statistiquement diminué par rapport à l’évaluation initiale.<br />
La symptomatologie clinique était significativement corrélée<br />
au profil vélocimétrique intra-cavitaire. Il n’y avait pas de corrélation<br />
entre la gravité clinique, le délai d’apparition de la SPT, le<br />
traitement initial (chirurgical versus orthopédique) et la valeur de<br />
la cyphose ou l’importance de la sténose. Cependant, lorsque la<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S39<br />
cyphose résiduelle était supérieure à 35° ou que la sténose canalaire<br />
était supérieure à 30 %, la cavité était plus étendue.<br />
DISCUSSION. Toute modification clinique ou fonctionnelle<br />
(aggravation du MIF) tardive chez un b<strong>les</strong>sé vertébro-médullaire<br />
doit faire rechercher une SPT évolutive. L’étude vélocimétrique<br />
en IRM permet une meilleure compréhension de l’évolutivité <strong>des</strong><br />
myélopathies kystiques post-traumatiques. L’importance de la<br />
cyphose et de la sténose canalaire semble un facteur prédictif<br />
d’extension <strong>des</strong> lésions.<br />
CONCLUSION. La correction initiale <strong>des</strong> déformations rachidiennes<br />
traumatiques et le recalibrage canalaire pourraient prévenir<br />
le développement et l’aggravation <strong>des</strong> SPT.<br />
*C. Court, Service d’Orthopédie, Hôpital de Bicêtre,<br />
78, rue du Général-Leclerc, 94250 Le Kremlin-Bicêtre.<br />
40 Analyse radiologique et anatomopathologique<br />
<strong>des</strong> hernies disca<strong>les</strong><br />
thoraciques calcifiées : à propos de<br />
13 cas opérés<br />
C. SÖDERLUND*, O. GILLE, P.MENEGUON,<br />
P. MANGIONE, J.-M. VITAL<br />
INTRODUCTION. La hernie discale thoracique est, dans sa<br />
forme calcifiée, rare et singulière. Le but de l’étude était : d’analyser<br />
la population concernée par cette pathologie de rechercher<br />
<strong>les</strong> signes radiologiques de séquel<strong>les</strong> de maladie de Scheuermann<br />
et <strong>les</strong> caractéristiques <strong>des</strong> hernies dans ce cadre, de confronter<br />
l’analyse radiologique par le scanner et l’IRM aux données peropératoires<br />
et histologiques.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Cette étude rétrospective a<br />
concerné 13 patients porteurs d’une hernie discale thoracique calcifiée<br />
(HDTC) symptomatique opérée entre 1996 et 2001. L’âge<br />
moyen était de 50,7 ans, la population comprenait 10 femmes et 3<br />
hommes. Les examens tomodensitométriques ont été réalisés dans<br />
tous <strong>les</strong> cas, associés à une myélographie dans 2 cas. Les examens<br />
IRM ont été réalisés dans 11 cas et avec adjonction de Gadolinium-<br />
DTPA dans 6 cas. L’ensemble <strong>des</strong> dossiers ont été examiné indépendamment<br />
par deux neuro-radiologues sans leur fournir <strong>les</strong><br />
constatations per-opératoires afin de rechercher <strong>des</strong> signes radiologiques<br />
prédictifs d’adhérences et/ou de pénétration durale, ainsi<br />
que la présence de séquel<strong>les</strong> de maladie de Scheuermann. Sur <strong>les</strong><br />
13 hernies opérées 5 ont fait l’objet d’un examen anatomopathologique.<br />
RÉSULTATS. Toutes <strong>les</strong> hernies ont été retrouvées au niveau<br />
thoracique moyen et bas chez <strong>des</strong> patients entre la 4 e et la 5 e<br />
décennie. Une calcification discale était présente en regard de la<br />
hernie dans tous <strong>les</strong> cas. La hernie occupait dans plus de la moitié<br />
<strong>des</strong> cas 70 % du canal médullaire. La nature de ces lésions a été<br />
analysée par l’examen scannographique en coupe axiale et l’IRM<br />
en séquence pondérée T1/T2 et suppression de graisse confirmant<br />
<strong>les</strong> résultats anatomopathologiques ; il s’agit dans la majorité <strong>des</strong><br />
cas de hernie ossifiée constituée d’os mature haversien. Concernant<br />
l’interface hernie/dure-mère, en séquence pondérée T2 dans<br />
10 cas sur 11 l’interprétation radiologique correspondait aux constatations<br />
per-opératoires.
3S40 78 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
DISCUSSION. L’IRM en séquences pondérée T2 et avec injection<br />
de gadolinium permet avec une sensibilité et une spécificité<br />
élevée d’étudier l’interface entre la hernie et <strong>les</strong> enveloppes<br />
médullaires et donc de prédire la pénétration durale.<br />
L’existence de séquel<strong>les</strong> de maladie de Scheuermann dans 5 cas<br />
confirme une association probablement non fortuite.<br />
CONCLUSION. L’histoire naturelle de la HDTC débute par<br />
une calcification discale sur un rachis dégénératif, lors de la migration<br />
postérieur ce matériel discal va subir un phénomène de métaplasie<br />
osseuse pouvant intéresser <strong>les</strong> structures de voisinage tel<br />
que le ligament longitudinal dorsal et aboutir à la pénétration<br />
durale de lésion ossifiée mature.<br />
*C. Söderlund, Unité de Pathologie Rachidienne,<br />
CHU Pellegrin, 33076 Bordeaux Cedex.<br />
41 Ossifications et calcifications <strong>des</strong><br />
ligaments jaunes : à propos de 19<br />
patients<br />
H. PASCAL-MOUSSELARD*, P. CABRE,<br />
O. LABRADA-BLANCO, Y.CATONNÉ,<br />
J.-L. ROUVILLAIN<br />
INTRODUCTION. Ossification (OLJ) et calcifications (CLJ)<br />
<strong>des</strong> ligaments jaunes sont <strong>des</strong> pathologies rares, décrites presque<br />
exclusivement au Japon. Les auteurs rapportent une série rétrospective<br />
de 19 patients Antillais suivis entre 1996 et 2003.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Il s’agissait de 6 hommes et 13<br />
femmes d’âge moyen 67,8 ans (31-79 ans). <strong>Tous</strong> <strong>les</strong> patients ont<br />
bénéficié d’un examen clinique neurologique. Le diagnostic positif<br />
reposait sur l’examen tomodensitométrique. Une IRM était<br />
réalisée dans 15 cas. Douze patients ont été opérés (8 laminectomies<br />
et 4 laminoplasties) et <strong>les</strong> pièces opératoires ont été analysées.<br />
L’efficacité du traitement a été évaluée en utilisant le score de<br />
Rankin.<br />
RÉSULTATS. Les patients ont consulté le plus souvent pour <strong>des</strong><br />
troub<strong>les</strong> de la marche d’aggravation progressive. L’examen clinique<br />
retrouvait une tétra ou une paraparésie spastique associée à un<br />
syndrome pyramidal réflexe et <strong>des</strong> troub<strong>les</strong> sphinctériens. Le scanner<br />
a fait le diagnostic positif et le diagnostic différentiel. Les OLJ<br />
apparaissaient sous la forme d’une hyperdensité linéaire surlignant<br />
<strong>les</strong> lames siégeant le plus souvent au niveau du rachis dorsal<br />
bas (T9- T12 : 6 fois sur 10). Les CLJ siègent au niveau du rachis<br />
cervical inférieur (9 fois sur 9) et apparaissent sous la forme<br />
d’hyperdensité arrondies, bilatéra<strong>les</strong> indépendantes <strong>des</strong> lames.<br />
L’IRM montrait la souffrance médullaire sous la forme d’un<br />
hypersignal intramédullaire en T2. Les 15 patients opérés ont étés<br />
améliorés de1à3points sur le score de Rankin. Le pronostic s’est<br />
avéré meilleur pour <strong>les</strong> CLJ. L’examen anatomo-pathologique a<br />
retrouvé une métaplasie cartilagineuse du ligament jaune aboutissant<br />
à un os lamellaire pour <strong>les</strong> OLJ et <strong>des</strong> dépôts de microcristaux<br />
de PPCD (pyrophosphate de calcium) et/ou d’hydroxyapatite pour<br />
<strong>les</strong> CLJ.<br />
DISCUSSION. OLJ et CLJ sont <strong>des</strong> pathologies rares dont plus<br />
de 90 % <strong>des</strong> cas ont été décrits au Japon et un seul cas a été rapporté<br />
dans la race noire. Les OLJ touchent l’homme dans sa 5e décennie,<br />
tandis que <strong>les</strong> CLJ atteignent préférentiellement la femme de plus<br />
65 ans. Le diagnostic positif et différentiel repose sur le scanner.<br />
L’IRM visualise la souffrance médullaire. Le traitement repose<br />
sur la décompression par voie postérieure qui doit être prudente<br />
pour <strong>les</strong> OLJ qui sont adhérentes à la dure-mère (risque de brèche<br />
durale).<br />
CONCLUSION. La fréquence de ces pathologies semble être<br />
sous-estimée dans la race noire. El<strong>les</strong> peuvent conduire à <strong>des</strong><br />
myélopathies sévères et leur traitement repose sur une décompression<br />
chirurgicale par voie postérieure, réalisée au mieux avant<br />
l’apparition d’un hypersignal à l’IRM.<br />
*H. Pascal-Mousselard, Service d’Orthopédie 2C,<br />
CHU La Meynard, 97200 Fort-de-France, Martinique.<br />
42 Traitement <strong>des</strong> cals vicieux thoracolombaires<br />
par double abord<br />
simultané du rachis et technique de<br />
galbage in situ<br />
O. GILLE*, N. AUROUER, P.BACON, M.PEDRAM,<br />
V. POINTILLART, C.SCHAELDERLE, J.-M. VITAL<br />
INTRODUCTION. Il s’agit <strong>des</strong> résultats préliminaires d’une<br />
série de 9 patients opérés d’un cal vicieux du rachis thoracolombaire<br />
par une technique associant un abord antérieur et postérieur<br />
simultanés de la colonne à un galbage in situ du matériel<br />
postérieur.<br />
MATÉRIEL. 7 femmes et 2 hommes, d’une moyenne d’âge de<br />
42 ans, ont été opérés depuis janvier 2001. Il s’agissait de 8 cals<br />
vicieux post-fracturaire et d’une séquelle de spondylodiscite. Cinq<br />
patients avaient eu un traitement chirurgical de la fracture initiale.<br />
Ces cals vicieux intéressaient la charnière thoracolombaire dans<br />
56 % <strong>des</strong> cas. Le suivi moyen était de 14 mois (22-6).<br />
MÉTHODE. La même technique chirurgicale a été appliquée<br />
chez tous <strong>les</strong> patients. L’intervention est pratiquée en décubitus<br />
latéral par 2 équipes chirurgica<strong>les</strong>. Après réalisation de l’arthrectomie<br />
postérieure et de l’ostéotomie antérieure la correction est<br />
obtenue en combinant la distraction antérieure et le galbage en<br />
lordose du matériel postérieur. Une greffe antérieure intercorporéale<br />
est ensuite encastrée.<br />
RÉSULTATS. La cyphose régionale préopératoire était de 30°,<br />
elle était de 4° en postopératoire et de 5° au recul. La cyphose a été<br />
améliorée de 87 %. Il n’y a pas eu d’aggravation neurologique. La<br />
principale complication a été un sepsis postérieur, avec une aggravation<br />
de sa cyphose régionale de 10°.<br />
DISCUSSION. Des abords postérieurs ou antérieurs, isolés ou<br />
successifs, ont été proposés pour le traitement <strong>des</strong> cals vicieux du<br />
rachis. Les résultats de la littérature montrent <strong>des</strong> corrections<br />
modérées et incomplètes de la déformation en cyphose.<br />
CONCLUSION. La technique proposée permet d’obtenir une<br />
bonne réduction du cal vicieux et <strong>les</strong> résultats semblent stab<strong>les</strong><br />
dans le temps.<br />
*O. Gille, CHU Bordeaux, place Amélie-Raba-Léon,<br />
33076 Bordeaux Cedex.
43 Failed back surgery syndrom<br />
(FBSS) : « intérêt de l’association<br />
neurostimulation médullairerestabilisation<br />
postérieure rachidienne<br />
» en un seul temps opératoire<br />
G. KERHOUSSE*, J.-L. POLARD, P.CHATELLIER,<br />
J.-L. HUSSON<br />
BUT. Le résultat d’une précédente étude prospective et homogène<br />
de 45 patients traités par stimulation électrique <strong>des</strong> cordons<br />
médullaires postérieurs pour douleurs chroniques rebel<strong>les</strong> par<br />
fibrose post opératoire ayant montré un taux global de bons résultats<br />
(fonction et analgésie) de 77 % avec un recul moyen de 51<br />
mois, <strong>les</strong> auteurs ont cherché à traiter certaines lomboradiculalgies<br />
chroniques rebel<strong>les</strong> post chirurgica<strong>les</strong> en associant dans un même<br />
temps opératoire une neurostimulation médullaire et une restabilisation<br />
rachidienne postérieure.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Avec un recul moyen de 11 ans,<br />
sont présentés <strong>les</strong> résultats d’une courte série de 8 patients d’âge<br />
moyen 48 ans, dont 5 étaient travailleurs manuels et 5 victimes<br />
d’accident du travail. <strong>Tous</strong> avaient un antécédent chirurgical endocanalaire<br />
(canal lombaire étroit, hernie discale). Ces 8 patients<br />
présentaient <strong>des</strong> douleurs mixtes, lombaires et radiculaires, chroniques<br />
rebel<strong>les</strong> aux traitements conservateurs. Ils ont bénéficié <strong>des</strong><br />
tests préopératoires habituels : test de neurostimulation épidurale<br />
percutanée pour <strong>les</strong> radiculalgies par déafférentation et test<br />
d’immobilisation par corset pour <strong>les</strong> lombalgies. La positivité de<br />
ces deux tests conduisait à l’indication de neurostimulation chronique<br />
<strong>des</strong> cordons postérieurs par matériel ITREL II ou III —<br />
Medtronic — et de restabilisation rachidienne postérieure par<br />
arthrodèse avec greffe postérolatérale ou plus récemment par neutralisation<br />
dynamique lombaire (Dynésys) dans le même temps<br />
opératoire.<br />
RÉSULTAT. Cette association thérapeutique a permis une<br />
reprise du travail chez 4 patients, 2 étant retraités.<br />
Radiculalgies : à la révision, l’efficacité antalgique de la stimulation<br />
a perduré pour 6 patients. Pour l’un, une radiculalgie est<br />
réapparue à 8 ans. Pour le dernier, malgré une sélection rigoureuse<br />
préopératoire, un échappement précoce est survenu à 2 ans.<br />
Lombalgies : 4 <strong>des</strong> 8 patients sont toujours améliorés au dernier<br />
recul. 3 ont récidivé leurs lombalgies entre 8 et 11 ans. Ces délais<br />
correspondent à la durée habituelle d’efficacité <strong>des</strong> arthrodèses en<br />
raison du développement d’un syndrome de néocharnière nous<br />
conduisant à étendre nos indications de neutralisation dynamique.<br />
Le dernier patient a présenté une néocharnière précoce à2ans<br />
faisant l’objet d’une extension d’arthrodèse avec un résultat antalgique<br />
à 10 ans.<br />
CONCLUSION. L’effet antalgique de l’association stimulation<br />
électrique et restabilisation rachidienne au cours du même temps<br />
opératoire sur certaines douleurs lombo-radiculaires postopératoires<br />
est réel. La qualité du résultat se trouve cependant altérée par<br />
l’effet moins durable de l’arthrodèse sur <strong>les</strong> lombalgies. Il reste à<br />
espérer que la nouvelle électrode de type « Synergy », qui associe-<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S41<br />
rait à son action sur <strong>les</strong> radiculalgies une action sur <strong>les</strong> lombalgies<br />
et qui est en cours d’évaluation, tienne ses promesses.<br />
*G. Kerhousse, Service Orthopédie A, CHU Hôtel Dieu,<br />
2, rue de l’Hôtel-Dieu, 35064 Rennes Cedex.<br />
44 Connection directe du système nerveux<br />
central avec <strong>les</strong> musc<strong>les</strong> chez<br />
<strong>les</strong> paraplégiques<br />
G. BRUNELLI*<br />
INTRODUCTION. Les lésions de la moelle épinière ne guérissent<br />
pas parce que el<strong>les</strong> ne permettent pas l’avancement <strong>des</strong> axones<br />
repoussants de la cellule corticale.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Les recherches ont débuté en<br />
1980 en mettant <strong>des</strong> greffes de nerfs périphériques entre le deux<br />
moignons de la moelle sectionné. Les greffes furent rehabitées par<br />
<strong>les</strong> axones <strong>les</strong>quel<strong>les</strong> cependant s’arrêtèrent à leur arrivée dans la<br />
moelle. Nous avons alors imaginé de connecter <strong>les</strong> fibres nerveuses<br />
<strong>des</strong>cendantes du faisceau cortico-spinale directement avec <strong>les</strong><br />
nerfs propres de certains musc<strong>les</strong> sélectionnés. La recherche s’est<br />
déroulée pendant 22 ans, au début sur <strong>les</strong> rats, puis sur <strong>les</strong> singes.<br />
La mortalité pour cette intervention a été élevée en raison du<br />
manque de réanimation. Pour <strong>les</strong> animaux survivants, <strong>les</strong> musc<strong>les</strong><br />
connectés à la moelle étaient trophiques, bougeaient, répondaient<br />
à la stimulation électrique soit du nerf soit de la moelle et avaient<br />
<strong>des</strong> aspects histologiques comparab<strong>les</strong> à ceux <strong>des</strong> sutures <strong>des</strong> nerfs<br />
périphériques.<br />
RÉSULTATS. Les résultats obtenus nous ont permi (après<br />
l’autorisation du Comité Ethique du service sanitaire national)<br />
d’opérer une jeune femme (volontaire et pleinement informée).<br />
Avant d’opérer d’autres patients, nous avons décidé d’attendre <strong>les</strong><br />
premiers résultats cliniques. L’opération consista en une connection<br />
du faisceau cortico-spinal avec <strong>les</strong> musc<strong>les</strong> grand et moyen<br />
fessier et quadriceps (bilatéralement). Nous attendions <strong>les</strong> premiers<br />
mouvement après 2 ans ou plus, compte tenu de la distance<br />
entre TX et <strong>les</strong> musc<strong>les</strong> innervés. La patiente a bougé et marché<br />
plus tôt que prévu. Actuellement, elle est capable de marcher<br />
pendant 10 ou 15 minutes, avec un déambulateur. En piscine, elle<br />
est même capable de monter quelques marches. Elle continue à<br />
s’améliorer.<br />
DISCUSSION. Comme l’innervation est due au motoneurone<br />
central, glutamatergique, tandis que normalement la plaque<br />
motrice est cholinergique, la recherche se poursuit chez <strong>les</strong> rats en<br />
cherchant <strong>les</strong> gênes qui codifient pour <strong>les</strong> récepteurs du muscle<br />
innervé pour savoir si c’est le motoneurone central qui change de<br />
trasmetteur ou si c’est le muscle qui change de récepteurs. La<br />
curarisation chez ces rats a paralysé <strong>les</strong> musc<strong>les</strong> normaux tandis<br />
que <strong>les</strong> musc<strong>les</strong> dénervés re-innervés par <strong>les</strong> neurones centraux ne<br />
furent pas paralysés.<br />
CONCLUSION. Il semblerait donc que soit la plaque motrice<br />
qui change de récepteurs. Des confirmations ultérieures sont de<br />
toute façon nécessaires.<br />
*G. Brunelli, Fondazione Ricerca Lesioni Midollo Spinale,<br />
Via Galvani, 26, 25123 Brescia, Italie.
3S42 78 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
45 Reconstruction d’une vertèbre lombaire<br />
à partir d’un modèle statistique<br />
tridimensionnel et de deux<br />
radiographies calibrées : étude<br />
expérimentale<br />
P. MERLOZ*, C. HUBERSON, J.TONETTI, A.EID,<br />
H. VOUAILLAT, S.PLAWESKI, J.CAZAL,<br />
C. SCHUSTER, A.BADULESCU<br />
INTRODUCTION. Le but de ce travail consiste à étudier la<br />
fiabilité et la précision de la reconstruction d’une vertèbre lombaire<br />
à partir d’images issues d’un modèle statistique tridimensionnel<br />
et de deux radiographies calibrées. Cette technique doit<br />
permettre d’aborder chirurgicalement le rachis au niveau lombaire<br />
et d’implanter du matériel d’ostéosynthèse en utilisant <strong>les</strong> technologies<br />
de réalité augmentée.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. La reconstruction d’une vertèbre<br />
lombaire a été réalisée sur plusieurs spécimen à partir d’images<br />
issues d’un modèle statistique tridimensionnel et de deux radiographies<br />
calibrées. Il est considéré que <strong>les</strong> images du modèle<br />
statistique tridimensionnel de cette vertèbre lombaire à reconstruire<br />
sont <strong>des</strong> images préopératoires. Les images per-opératoires<br />
sont représentées par deux radiographies calibrées acquises à<br />
l’aide d’un amplificateur de brillance dont le récepteur est de<br />
technologie avancée (récepteur au silicium). De plus ce dernier est<br />
doté de pastil<strong>les</strong> réfléchissantes capab<strong>les</strong> d’être détectées dans<br />
l’espace à l’aide d’un localisateur optique tridimensionnel.<br />
L’ordinateur intervient dans la phase de mise en correspondance<br />
<strong>des</strong> images du modèle statistique tridimensionnel d’une part, et<br />
<strong>des</strong> deux radiographies calibrées d’autre part. Les vues de navigation<br />
sont présentées à l’écran et permettent de guider <strong>des</strong> outils au<br />
niveau vertébral. Pour vérifier la précision et la fiabilité de ce<br />
système, nous avons implanté <strong>des</strong> vis pédiculaires sur plusieurs<br />
pièces anatomiques. Le contrôle du positionnement de ces vis a été<br />
vérifié par examen tomodensitométrique.<br />
RÉSULTATS. Le système utilisé a permis de montrer la fiabilité<br />
et la précision de la reconstruction d’une vertèbre lombaire à partir<br />
d’un modèle statistique tridimensionnel et de deux radiographies<br />
calibrées. Toutes <strong>les</strong> vis implantées étaient parfaitement placées à<br />
l’intérieur <strong>des</strong> pédicu<strong>les</strong>. La précision obtenue était de l’ordre du<br />
millimètre.<br />
DISCUSSION. La méthode utilisée est de nature passive et<br />
n’impose aucune contrainte per-opératoire au chirurgien. La<br />
reconstruction de la vertèbre lombaire à partir d’un modèle statistique<br />
tridimensionnel préopératoire et de deux radiographies calibrées<br />
per-opératoires, permet de s’affranchir de toute prise de<br />
points anatomiques et/ou de points de surface sur la vertèbre en<br />
question. le niveau de précision atteint est sensiblement le même<br />
qu’avec <strong>les</strong> techniques à base tomodensitométrique. Les examens<br />
spécifiques pré-opératoires (TDM) sont désormais inuti<strong>les</strong>, pour<br />
la navigation.<br />
CONCLUSION. Ce système devrait permettre, à terme, de voir<br />
apparaître dans <strong>les</strong> blocs opératoires <strong>des</strong> amplificateurs de<br />
brillance de nouvelle génération permettant l’acquisition de radiographies<br />
calibrées successives. Les informations numériques<br />
obtenues de cette façon, pourront être mises en correspondance<br />
avec <strong>des</strong> données anatomiques de nature statistique permettant<br />
ainsi de se passer de tout examen supplémentaire de nature TDM<br />
ou IRM en préopératoire. L’introduction progressive <strong>des</strong> examens<br />
échographiques per-opératoires, en remplacement <strong>des</strong> radiographies<br />
calibrées doit ouvrir la voie aux gestes chirurgicaux per<br />
cutanés au niveau du rachis lombaire.<br />
*P. Merloz, Service d’Orthopédie, CHU Michallon,<br />
BP 217, 38043 Grenoble Cedex 09.<br />
46 Les fractures transversa<strong>les</strong> du<br />
sacrum supérieur : analyse d’une<br />
série de 50 cas<br />
T. SOFIA*, J.-Y. LAZENNEC, G.SAILLANT<br />
INTRODUCTION. Les fractures transversa<strong>les</strong> hautes du<br />
sacrum sont rares (3-5 % <strong>des</strong> fractures sacrées) et sévères sur le<br />
plan neurologique ; el<strong>les</strong> déstabilisent le rachis par rapport à<br />
l’anneau pelvien.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Les 50 cas traités entre 1977 et<br />
2001 (31 femmes, 19 hommes d’âge moyen 31 ans) étaient essentiellement<br />
<strong>des</strong> défenestrés (46 cas), souvent <strong>des</strong> polytraumatisés<br />
(38 cas) avec 31 fractures du rachis associées (18 fractures L1).<br />
Selon la classification de Roy Camille, la série se répartissait en 6<br />
types I, 34 types II et 20 types III, avec 30 cas d’atteinte de l’anneau<br />
pelvien, surtout pour <strong>les</strong> types II et III (3 Tile A 10 Tile B 17 Tile<br />
C). Quarante-deux patients présentaient <strong>des</strong> lésions neurologiques<br />
: 10 paraplégies (7 incomplètes/3 complètes), 38 douleurs<br />
radiculaires L5 et/ou S1 et 36 atteintes périnéa<strong>les</strong>. Onze patients<br />
ont été traités fonctionnellement (dont 5 cas avec atteintes neurologiques<br />
mais présentant <strong>des</strong> lésions cutanées sévères), 25 cas ont<br />
été opérés au stade de fracture récente (3 cas sans déficit, 22<br />
déficits neurologiques) et 14 au stade de cal vicieux (après 1 mois)<br />
pour une indication neurologique 13 fois, 1 fois pour <strong>des</strong> raisons<br />
cutanées.<br />
RÉSULTATS. Le recul moyen était de 9 ans. La sévérité <strong>des</strong><br />
lésions du bassin était parallèle au degré <strong>des</strong> troub<strong>les</strong> neurologiques<br />
associés. Au cours du traitement fonctionnel, 3 récupérations<br />
incomplètes ont été observées. Dix récupérations (6 complètes et 4<br />
incomplètes) sans aggravation ont été notées après le traitement<br />
chirurgical <strong>des</strong> fractures récentes. Trois récupérations complètes<br />
et 6 incomplètes sont apparues après le traitement <strong>des</strong> cals vicieux.<br />
La chirurgie s’est compliquée de 9 infections et de 2 fistu<strong>les</strong> de<br />
liquide céphalo-rachidien qui ont guéri après réintervention.<br />
L’évolution <strong>des</strong> techniques opératoires (ostéotomies de soustraction,<br />
meilleures stabilisations) a amélioré <strong>les</strong> résultats mécaniques.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. L’analyse de ces fractures<br />
doit prendre en compte le plan frontal et le plan sagittal afin de<br />
préciser l’atteinte de l’anneau pelvien. Le résultat final dépend du<br />
délai du traitement chirurgical (en particulier dans <strong>les</strong> types II et<br />
III) et de la restitution de l’alignement sagittal du rachis par rapport<br />
au bassin.<br />
*T. Sofia, CHI de Montfermeil,<br />
10, rue du Général-Leclerc, 93370 Montfermeil.
47 Gradient cranio-caudal <strong>des</strong> ressources<br />
de régénération <strong>des</strong> membres<br />
inférieurs<br />
V. SHEVTSOV*, V. SHCHUROV<br />
Depuis <strong>les</strong> temps de Char<strong>les</strong> Darwin, on sait <strong>les</strong> 3 principes de la<br />
régénération expliquant la similititude de structures tissulaires<br />
néoformées, la dépendance du rythme de la régénération de l’âge<br />
et de l’emplacement d’un animal dans la file d’évolution. Le dernier<br />
principe porte le nom de Weisman-Pschibram. On décrit la<br />
dépendance de l’activité de régénération de plusieurs facteurs :<br />
niveau de spécialisation et différenciation de tissu, sa résistance à<br />
l’hipoxie et <strong>des</strong> autres manifestations <strong>des</strong> régularités biologiques<br />
généra<strong>les</strong> reconnues.<br />
Le quatrième principe concerne d’une dépendance comparative<br />
<strong>des</strong> possibilités régénératifs de différentes parties de l’organisme<br />
du gradient cranio-caudal <strong>des</strong> rythmes de leur croissance postnatale<br />
et développement. La séparation de ce principe est déterminée<br />
par son importance pratique. L’expérience de plusieurs années<br />
augmenter la taille <strong>des</strong> mala<strong>des</strong> achondroplaises en allongeant de<br />
différents segments <strong>des</strong> membres permet à noter que <strong>des</strong> ressources<br />
de régénération moins puissant sont au niveau du fémur malgré<br />
ses gran<strong>des</strong> dimensions longitudina<strong>les</strong>. On allonge de préférence<br />
la jambe dont la bénéfice maximum est de plus de 20 % étant<br />
sauvegarder la fonction <strong>des</strong> musc<strong>les</strong>.<br />
Il est admit que l’homme ayant le retard de dimension longitudinale<br />
de corps de 10 % est rangé de petite taille, <strong>les</strong> femmes ayant<br />
la longueur du torse moins de 73 cm ont la fonction générative<br />
violée. Avec ceci on n’a pas remarqué de malfonction de membre<br />
chez <strong>les</strong> enfants avec la croissance de la jambe retardée de 10 %,<br />
l’augmentation de valeur diminue le rythme de croissance et seulement<br />
le retard de 40 % provoque l’arrêt de croissance.<br />
Selon l’augmentation <strong>des</strong> dimensions longitudina<strong>les</strong> le moment<br />
relatif d’une force <strong>des</strong> musc<strong>les</strong> postérieurs de la jambe s’augmente<br />
(F = 0,063*L-0,7 ; r = 0,965, n = 123).<br />
L’allongement opératoire de la jambe avec croissance retardée à<br />
chaque 10 % de la longueur initiale fait limiter l’amplitude de<br />
mouvement au niveau de la cheville au moyen à 15 %. L’allongement<br />
du fémur retardant en croissance à la même valeur suivant la<br />
même technologie de traitement diminue l’amplitude de mouvement<br />
au niveau du genou à 22 %. On a noté que l’abaissement de la<br />
force <strong>des</strong> musc<strong>les</strong> jambiers à 40 % après le traitement n’altère pas<br />
la fonction locomotrice, mais l’abaissement pareil de la force <strong>des</strong><br />
musc<strong>les</strong> du fémur fait altérer la fonction.<br />
Comme plusieurs autres principes n’étant pas devenir la loi, le<br />
quatrième comporte <strong>des</strong> exceptions. Toutefois, il faudra distinguer<br />
l’influence <strong>des</strong> facteurs biologiques propres parmi <strong>des</strong> autres,<br />
comme par exemple techniques. Ainsi, pour l’allongement de<br />
membre supérieur <strong>les</strong> orthopédistes préfèrent l’épaule. Malgré le<br />
fait que cette préférence provient d’une difficulté de fixer <strong>des</strong> os de<br />
l’avant-bras en sauvegardant <strong>des</strong> mouvements de rotation.<br />
L’importance <strong>des</strong> progrès obtenus pendant <strong>les</strong> dernières années<br />
dans le traitement rétablissant <strong>des</strong> mala<strong>des</strong> avec <strong>des</strong> moignons et<br />
défauts <strong>des</strong> os de la main et du pied ne laisse pas de se douter en<br />
existence du gradient cranio-caudal <strong>des</strong> possibilités régénératifs<br />
<strong>des</strong> segments <strong>des</strong> membres.<br />
*V. Shevtsov, RNC VTO academicien G.A.Ilizarov,<br />
6, rue de Marie-Oulianova, 640015 Kurgan, Russie.<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S43<br />
48 A quoi servent <strong>les</strong> deux tiers distaux<br />
de l’ulna ?<br />
V. DUMAINE*, A. BABINET, B.TOMENO<br />
Sous ce titre volontairement provocateur, <strong>les</strong> auteurs rapportent<br />
3 observations de résection étendue de l’ulna sans reconstruction.<br />
Dans 2 cas, la résection a été faite pour une tumeur de l’ulna : un<br />
ostéosarcome de bas grade et un adamantinome. Dans 1 cas la<br />
partie distale de l’ulna a été réséquée puis utilisée comme greffon<br />
pour la réalisation d’une arthrodèse après résection du 1/3 distal du<br />
radius homolatéral pour une volumineuse tumeur à cellu<strong>les</strong> géantes.<br />
La résection concernait respectivement la moitié distale de<br />
l’os, <strong>les</strong> 3/4 distaux et le 1/3 distal.<br />
Aux reculs respectifs de 4 ans, 23 ans et 1 an, <strong>les</strong> mobilités du<br />
poignet sont norma<strong>les</strong> dans <strong>les</strong> 2 cas, <strong>les</strong> mobilités du coude sont<br />
norma<strong>les</strong> dans 2 cas sur 3, et aucun <strong>des</strong> patients n’allègue de<br />
douleur au niveau du poignet ou du moignon ulnaire. En revanche,<br />
<strong>les</strong> 2 patients qui ont eu une résection ulnaire isolée ont une diminution<br />
modérée de la force de préhension.<br />
Corroborant ainsi <strong>les</strong> données de la littérature, <strong>les</strong> auteurs<br />
concluent que : la reconstruction de l’ulna n’est pas justifiée dès<br />
lors qu’il persiste le 1/4 proximal de l’os ; l’ulna constitue un<br />
greffon de choix pour la reconstruction de la partie distale du<br />
radius homolatéral.<br />
*V. Dumaine, Service de Chirurgie Orthopédique B,<br />
Hôpital Cochin, 27, rue du Faubourg-Saint-Jacques,<br />
75014 Paris.<br />
49 Les lésions dégénératives de l’articulation<br />
métatarso sésamoïdienne :<br />
étu<strong>des</strong> anatomique et clinique<br />
F. BONNEL*, A. LARGEY, G.CAPTIER,<br />
F. CANOVAS<br />
INTRODUCTION. L’articulation métatarso sésamoïdienne<br />
par sa morphologie a <strong>des</strong> fonctions mécaniques importantes dans<br />
la stabilisation de la tête du métatarsien. Le positionnement <strong>des</strong><br />
sésamoï<strong>des</strong> au cours de la constitution d’un hallux valgus a été<br />
évalué par Inges, Haines et Tourne qui distinguent 3 sta<strong>des</strong>. Les<br />
lésions cartilagineuses dans le cadre d’un hallux valgus n’ont<br />
jamais été analysées avec précision. Notre objectif était de déterminer<br />
<strong>les</strong> lésions de la sangle métatarso sésamoïdienne sur pièce<br />
anatomique et chez <strong>des</strong> patients opérés d’hallux valgus.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Nous avons procédé à la dissection<br />
de 12 articulations métatarso-sésamoïdiennes (4 droit, 13 gauche)<br />
de sujets de laboratoire et évalué <strong>les</strong> lésions dégénératives.<br />
Pour chaque pièce, nous avons noté l’angle de déformation<br />
métatarso-phalangien et l’AADM. En complément 17 métatarsiens<br />
ont été examinés afin de déterminer la persistance ou<br />
l’absence de la crête médiane témoignant de son usure éventuel.<br />
Selon le même protocole, au cours de la cure de 20 hallux valgus<br />
par SCARF, nous avons examiné toutes <strong>les</strong> surfaces articulaires et<br />
déterminé <strong>les</strong> lésions dégénératives.
3S44 78 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
RÉSULTATS. Pour <strong>les</strong> douze pièces de laboratoire, nous avons<br />
constaté : pour la surface articulaire plantaire de M1 une intégrité<br />
<strong>des</strong> surfaces articulaires dans 2 cas, une disparition de la crête<br />
sagittale dans 4 cas, <strong>des</strong> lésions dégénératives de la surface<br />
médiale dans 4 cas, de la surface latérale dans 2 cas. Pour <strong>les</strong><br />
sésamoï<strong>des</strong>, <strong>les</strong> lésions dégénératives intéressaient : <strong>les</strong> 2 sésamoï<strong>des</strong><br />
1 cas, le sésamoïde latéral 2 cas, le sésamoïde médial 4 cas,<br />
absent dans 3 cas. Les lésions observées au niveau de l’articulation<br />
métatarso phalangienne lésion diffuse dans 1 cas, localisée dans 5<br />
cas, absent dans 6 cas.<br />
Pour <strong>les</strong> 17 métatarsiens, il existait une intégrité <strong>des</strong> surfaces<br />
articulaires 10 cas, une disparition de la crête sagittale 4 cas, <strong>des</strong><br />
lésions dégénératives de la surface médiale 2 cas, de la surface<br />
latérale 1 cas.<br />
Pour <strong>les</strong> constatations opératoires au niveau de la métatarsosésamoïdienne,<br />
il existait pour unAADM entre 4 et 12 absences de<br />
50 Les ostéomes ostéoï<strong>des</strong> <strong>des</strong> membres<br />
H. MNIF*, S. KARRAY, A.BELLASOUED,<br />
B. KARRAY, M.ZOUARI, T.LITAIEM, M.DOUIK<br />
INTRODUCTION. L’ostéome ostéoide est une tumeur ostéoblastique<br />
bénigne, de petite taille particulièrement douloureuse,<br />
qui atteint habituellement l’adulte jeune.<br />
Dans ce travail, nous nous sommes intéressés à étudier le profil<br />
épidémiologique, clinique, radiologique et histologique de cette<br />
lésion, tout en insistant sur l’évolution dans la prise en charge<br />
thérapeutique et <strong>les</strong> difficultés rencontrées dans certaines localisations.<br />
MATÉRIELS ET MÉTHODES. Nous rapportons une série<br />
rétrospective portant sur 56 ostéomes ostéoi<strong>des</strong> <strong>des</strong> membresétalées<br />
sur une période de 25 ans allant de 1976 à 2001.<br />
La localisation a intéressé, le fémur (21 cas), le tibia (14 cas), la<br />
main (8 cas), le pied (7 cas), l’olécrane, le condyle huméral<br />
externe, l’omoplate, le col huméral et le cotyle dans un cas chacun.<br />
La douleur était le maître symptôme dans tout <strong>les</strong> cas avec un test<br />
à l’aspirine positive dans 82 % <strong>des</strong> cas. Pour <strong>les</strong> localisations<br />
articulaires il s’agissait d’un tableau d’arthropathie dans 87 % <strong>des</strong><br />
cas. L’aspect typique du nidus a été observé dans 78,5 % à la<br />
radiographie standard. Une TDM a été pratiquée dans 25 cas et une<br />
scintigraphie dans 10 cas. L’IRM a été réalisée dans 4 cas. Le<br />
traitement a été chirurgical, qui a consisté en une résection en bloc<br />
(48 cas), un curetage intra-lésionnel (6 cas) et une résection percutanée<br />
sous-contrôle tomodensitométrique (2 cas). Une protection<br />
mécanique de l’os a été fait par immobilisation plâtrée (21<br />
cas) et par un matériel d’ostéosynthèse (7 cas). Une greffe osseuse<br />
a été réalisé (22 cas). La confirmation anatomo-pathologique<br />
Séance du 11 novembre matin<br />
TUMEURS<br />
lésions 6 cas, <strong>des</strong> lésions dégénératives intéressaient <strong>les</strong> 2 sésamoï<strong>des</strong><br />
1 cas, le sésamoïde latéral 1 cas, le sésamoïde médial 2 cas.<br />
Pour un AADM supérieur à 12, nous avons noté : intégrité <strong>des</strong><br />
surfaces articulaires métatarso-sésamoïdiennes 1 cas, la disparition<br />
de la crête sagittale 4 cas, <strong>des</strong> lésions dégénératives de la<br />
surface médiale 4 cas, de la surface latérale 1 cas.<br />
CONCLUSION. Cette étude anatomique nous a permis d’aboutir<br />
à une topographie précise <strong>des</strong> lésions dégénératives de l’articulation<br />
métatarso sésamoïdienne. Notre objectif a été atteint. Cette<br />
base de données devrait nous permettre de juger <strong>les</strong> résultats fonctionnels<br />
en fonction de l’importance <strong>des</strong> lésions cartilagineuses<br />
métatarso sésamoïdiennes dans le traitement d’un hallux valgus.<br />
*F. Bonnel, Service d’Orthopédie III, Hôpital Lapeyronie,<br />
CHU Montpellier, avenue du Doyen-Gaston-Giraud,<br />
34295 Montpellier Cedex 5.<br />
d’ostéome ostéoide a été fait dans tous <strong>les</strong> cas. Des infiltrations<br />
lympho-plasmocytaires ont été observées dans 7 formes articulaires.<br />
RÉSULTATS. Nos résultats ont été analysés avec un recul<br />
moyen de 5 ans. Une disparition complète de la douleur après une<br />
seule résection dans 53 cas et reprise de la résection dans <strong>les</strong> autres<br />
cas. Pour <strong>les</strong> localisations articulaires, une récupération complète<br />
de la mobilité a été observée dans 3/4 <strong>des</strong> cas. La radiographie<br />
post-opératoire a été réalisée dans tous <strong>les</strong> cas.<br />
Les complications précoces étaient dominées par <strong>les</strong> fractures<br />
iatrogènes dans 9 % <strong>des</strong> cas essentiellement au niveau du tibia. Les<br />
complications tardives ont été marquées par la survenue d’arthrose<br />
pour une localisation cotyloidienne et 2 astragaliennes.<br />
CONCLUSION. L’ostéome ostéoïde est une lésion assez rare,<br />
dont le diagnostic est souvent facile, cependant <strong>les</strong> atypies ne sont<br />
pas rares tant sur le plan clinique que radiologique.<br />
La TDM constitue l’examen clé dans l’exploration de cette<br />
pathologie et représente de plus en plus un intérêt thérapeutique.<br />
*H. Mnif, Institut National d’Orthopédie MT Kassab,<br />
2010 La Manouba, Tunis, Tunisie.<br />
51 Dégénérescence <strong>des</strong> tumeurs cartilagineuses<br />
bénignes : diagnostic<br />
et pronostic<br />
G. DELEPINE*, F. DELEPINE, E.GUIKOV,<br />
D. GOUTALLIER<br />
INTRODUCTION. Dans notre relevé de tumeurs osseuses, <strong>les</strong><br />
chondrosarcomes secondaires représentent un peu moins de 15 %<br />
<strong>des</strong> chondrosarcomes (20/150). Leur aspect très varié et <strong>les</strong> diffi-
cultés fréquentes de leur diagnostic justifient cette étude <strong>des</strong>tinée à<br />
rappeler leur existence, leur difficulté de diagnostic fréquente et<br />
leur pronostic variable.<br />
MATÉRIEL. De 1981 à janvier 2002, nous avons observé 20<br />
chondrosarcomes survenus sur <strong>des</strong> lésions pré-existantes (11<br />
exostoses solitaires, 1 chondrome solitaire, 6 maladies polyexostosantes,<br />
2 enchondromatoses multip<strong>les</strong>). Les topographies<br />
observées ont été le bassin (9), le fémur (3), l’humérus (2), le tibia<br />
(3), le rachis (2) et l’omoplate (1). Histologiquement, il s’agissait<br />
de chondrosarcomes de degré I (7), de degré II (9), de degré III (1)<br />
et de sarcome dédifférencié (3). Le traitement a toujours été chirurgical.<br />
Chirurgical pur dans <strong>les</strong> chondrosarcomes de degré I et<br />
II ; complété par une chimiothérapie (3) et une radiothérapie (1)<br />
chez <strong>les</strong> 3 mala<strong>des</strong> souffrant de chondrosarcomes dédifférenciés.<br />
RÉSULTATS ET FACTEURS PRONOSTIQUES. Au dernier<br />
examen, avec un recul moyen de 9 ans et 10 mois, 5 mala<strong>des</strong> sont<br />
morts après récidive locale (3) ou métastase (2). Les 15 autres sont<br />
vivants avec un recul moyen de 155 mois.<br />
Le facteur pronostic essentiel est le degré histologique du chondrosarcome.<br />
<strong>Tous</strong> <strong>les</strong> mala<strong>des</strong> atteints de chondrosarcome de<br />
degré I (7) ont survécu contre seulement 2/3 <strong>des</strong> chondrosarcomes<br />
de degré II et 50 % (2/4) <strong>des</strong> chondrosarcomes de degré III ou<br />
dédifférencié. Le second facteur pronostic est celui de la prise en<br />
charge initiale. Les prises en charge initia<strong>les</strong> inadéquates ont été<br />
responsab<strong>les</strong> de 4 erreurs ou de retard important au diagnostic, de<br />
3 récidives loca<strong>les</strong> et de pertes de chances de survie chez 3 mala<strong>des</strong>.<br />
Il faut signaler ici la fréquente méconnaissance <strong>des</strong> chondrosarcomes<br />
de degré I pris pour <strong>des</strong> exostoses bana<strong>les</strong> alors même<br />
que l’épaisseur de leur coiffe cartilagineuse dépasse 1 cm ce qui<br />
devrait, normalement, faire redresser le diagnostic histologique.<br />
CONCLUSION. 1. La gravité <strong>des</strong> chondrosarcomes dédifférenciés<br />
secondaires incite à traiter préventivement par exérèse <strong>les</strong><br />
exostoses à coiffe cartilagineuse résiduelle importante chez<br />
l’adulte surtout lorsqu’ils sont dans <strong>des</strong> localisations à risque (bassin).<br />
2. Les difficultés du diagnostic histologique <strong>des</strong> chondrosarcomes<br />
de degré I doit faire rappeler que toute coiffe cartilagineuse<br />
dont l’épaisseur dépasse 5 mm est suspecte chez l’adulte et que<br />
toute épaisseur supérieureà1cmestsynonyme dégénérescence.<br />
*G. Delepine, 8, rue Eugène-Varlin, 93700 Drancy.<br />
52 Traitement <strong>des</strong> tumeurs bénignes<br />
ostéolytiques du genou<br />
K. AJOUY*, A. BABINET, P.ANRACT, B.TOMENO<br />
INTRODUCTION. Les auteurs rapportent une série rétrospective<br />
de 88 cas de tumeurs bénignes ostéolytiques du genou traitées<br />
par curetage comblement entre 1973 et 2000.<br />
Ce travail avait pour but d’évaluer la place du curetage comblement<br />
dans le traitement de ce type de tumeur.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. L’âge moyen <strong>des</strong> patients était<br />
de 31 ans avec un sexe ratio de 1. La douleur était le symptôme<br />
révélateur le plus fréquent et 9 % <strong>des</strong> patients présentaient une<br />
fracture pathologique. Il y avait autant de localisations à l’extrémité<br />
inférieure du fémur qu’à l’extrémité supérieure du tibia. Nous<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S45<br />
avons analysé <strong>les</strong> paramètres cliniques, l’imagerie, <strong>les</strong> traitements,<br />
<strong>les</strong> complications, la récidive et <strong>les</strong> traitements de ces récidives.<br />
RÉSULTATS. Ces tumeurs étaient principalement <strong>des</strong> tumeurs<br />
à cellu<strong>les</strong> géantes (63), <strong>des</strong> kystes anévrysmaux (7) et <strong>des</strong> chondroblastomes<br />
(6). El<strong>les</strong> ont été traitées par curetage éventuellement<br />
associé à un comblement (83) et à une ostéosynthèse (51).<br />
Nous avons déploré 6 complications mécaniques dont seulement 2<br />
ont nécessité la mise en place d’une arthroplastie totale de genou.<br />
En revanche, aucune intervention de type arthrolyse n’a été nécessaire.<br />
Le taux de récidive après curetage était de 23 % et nous avons<br />
pu dans 90 % <strong>des</strong> cas réaliser à nouveau un curetage - comblement.<br />
DISCUSSION. Cette étude confirme pour nous que le curetage<br />
comblement est le traitement chirurgical de référence <strong>des</strong> tumeurs<br />
bénignes ostéolytiques du genou indépendamment de leur type<br />
histologique. La simplicité du geste, le faible taux de complications<br />
mécaniques, la possibilité de conserver l’articulation chez un<br />
sujet jeune nous font préférer ce traitement à la résection — arthroplastie.<br />
Elle rapporte l’absence de facteurs prédictifs de la récidive<br />
locale quel que soit le type histologique de la tumeur ostéolytique.<br />
Elle montre enfin que la récidive peut tout à fait être traitée par<br />
curetage comblement itératif.<br />
*K. Ajouy, Service de Chirurgie Orthopédique<br />
et Traumatologique B, Hôpital Cochin,<br />
27, rue du Faubourg-Saint-Jacques, 75014 Paris.<br />
53 Le kyste osseux anévrysmal périphérique,<br />
approche diagnostique et<br />
thérapeutique : à propos de 48 cas<br />
S. KALLEL*, S. KAMMOUN, T.SOUHUN,<br />
A. CHTOUROU, M.ZOUARI, S.KARRAY,<br />
T. LIATIEM, M.DOUIK<br />
INTRODUCTION. Le kyste osseux anévrysmal est une ostéodystrophie<br />
pseudotumorale bénigne qui peut être primitive ou qui<br />
peut s’associer à une lésion osseuse préexistante. Il pose <strong>des</strong> problèmes<br />
d’ordre étiopathogénique, diagnostique et thérapeutique.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Nous avons colligé dans cette<br />
étude rétrospective, 48 cas de kystes osseux anévrysmal périphérique<br />
sur une période de 27 ans. Cette pathologie a touché essentiellement<br />
l’enfant, l’ado<strong>les</strong>cent et l’adulte jeune avec une légère<br />
prédominance féminine. Le bilan d’imagerie comprend, outre <strong>les</strong><br />
radiographies standards, une étude tomodensitométrique et IRM<br />
pour <strong>les</strong> cas <strong>les</strong> plus récents ce qui nous a permis de trouver de<br />
nouveaux éléments de sémiologie radiologique permettant une<br />
plus forte suspicion diagnostique. Une deuxième lecture <strong>des</strong> lames<br />
nous a permis de redresser le diagnostic dans certains cas mais le<br />
diagnostic différentiel ne s’est posé qu’avec <strong>des</strong> tumeurs bénignes.<br />
Le traitement est résolument chirurgical. Les autres traitements<br />
utilisés sont le curetage comblement spongieux, la résection, la<br />
résection reconstruction, le curetage comblement au ciment. Les<br />
traitements adjuvants utilisés étaient représentés essentiellement<br />
par la calcitonine. L’abstention surveillance de certains kystes<br />
inactifs nous a confirmé la possibilité de régression après biopsie.<br />
Le curetage comblement spongieux a été utilisé dans 58 % <strong>des</strong> cas<br />
donnant un score fonctionnel d’Enneking de 95,7 %.
3S46 78 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
RÉSULTATS. Nos résultats ont été revus avec un recul moyen<br />
de 7 ans. Sur le plan anatomique <strong>les</strong> récidives ont été au nombre de<br />
4 et le score moyen global d’Enneking est de 95 %. L’étude de<br />
notre série nous a permis de voir que le traitement du kyste osseux<br />
anévrysmal n’est pas univoque et que l’indication devrait prendre<br />
en considération l’âge du patient, la localisation et l’évolutivité de<br />
la lésion et nous proposons enfin un schéma thérapeutique. La<br />
place du traitement à la calcitonine reste à déterminer.<br />
CONCLUSION. Le diagnostic de kyste osseux nécessite une<br />
étroite collaboration entre chirurgien, radiologue, et pathologiste.<br />
L’indication chirurgicale doit être éclectique, adaptée à chaque cas<br />
afin d’assurer la guérison sans séquel<strong>les</strong>.<br />
*S. Kallel, Institut National Mohamed Taïeb Kassab,<br />
2010 La Manouba, Tunis, Tunisie.<br />
54 Tumeurs bénignes isolées <strong>des</strong><br />
nerfs périphériques : étude rétrospective<br />
de 51 cas<br />
G. CHICK*, J.-Y. ALNOT<br />
INTRODUCTION. Les tumeurs isolées <strong>des</strong> nerfs périphériques<br />
sont <strong>des</strong> lésions rares, bénignes dans 90 % <strong>des</strong> cas. El<strong>les</strong> se développent<br />
au dépend <strong>des</strong> éléments constitutifs du nerf. Il s’agit de<br />
schwannomes dans 80 % <strong>des</strong> cas, <strong>les</strong> autres tumeurs sont beaucoup<br />
plus rares et d’une grande diversité histologique.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Cinquante et un patients ont été<br />
revus avec un recul moyen de 4,6 ans. Quarante et un avaient une<br />
tumeur extirpable (39 schwannomes, 2 lipomes intra-nerveux) et<br />
dix une tumeur inextirpable (5 neurofibromes solitaires, 3 hémangiomes<br />
péri-neuraux, 2 neurofibrolipomes).<br />
Pour chaque type de lésions, <strong>les</strong> éléments du diagnostic, <strong>les</strong><br />
résultats <strong>des</strong> examens complémentaires ont été détaillés. En cas de<br />
tumeur extirpable une énucléation a été réalisée. Les tumeurs inextirpab<strong>les</strong><br />
ont eu une épineurotomie à visée décompressive avec<br />
biopsie interfasciculaire systématique.<br />
RÉSULTATS. Les déficits neurologiques postopératoires ont<br />
été rares et transitoires. Dans le premier cas le pronostic a été<br />
excellent compte tenu de l’absence de récidive ou de dégénérescence.<br />
Dans le deuxième cas, <strong>les</strong> troub<strong>les</strong> ont persisté sur un mode<br />
atténué (paresthésies) dont le patient avait été prévenu. L’évolution<br />
a été stabilisée.<br />
DISCUSSION. Notre expérience est conforme à la littérature.<br />
Le diagnostic de tumeur nerveuse doit être évoqué systématiquement<br />
devant une tuméfaction ou une douleur sur le trajet d’un nerf<br />
que la percussion réveille. L’IRM est l’examen complémentaire le<br />
plus performant notamment en cas de siège profond de la tumeur.<br />
Sur un faisceau d’arguments cliniques et paracliniques il est possible<br />
de prévoir l’extirpabilité de la tumeur, sa nature et son caractère<br />
bénin. Cependant, aucun n’est formel et seule l’intervention,<br />
par l’aspect macroscopique de la tumeur et surtout l’analyse histologique,<br />
donnera une certitude. Quel que soit son type, l’attitude<br />
thérapeutique est guidée par le souci de respecter la continuité<br />
nerveuse. En cas de tumeur extirpable, la persistance exceptionnelle<br />
de symptômes doit inciter à une nouvelle exploration à la<br />
recherche d’une ou d’autres tumeur(s) localisée(s) passée(s) ina-<br />
perçue(s) sur le même site opératoire du fait de la petitesse de son<br />
(leur) volume et dont la recherche doit être systématique lors de<br />
l’intervention. Dans <strong>les</strong> autres cas, toute modification récente et<br />
rapide de l’examen clinique doit faire suspecter une récidive et<br />
conduire à une intervention analogue. A notre connaissance<br />
aucune transformation maligne n’a jamais été observée.<br />
CONCLUSION. Il ne faut jamais réséquer en première intention<br />
un nerf porteur d’une tumeur nerveuse.<br />
*G. Chick, 105, chemin <strong>des</strong> Cruyes,<br />
Groupe Main-Provence, 13090 Aix-en-Provence.<br />
55 Localisations pelviennes <strong>des</strong> sarcomes<br />
d’Ewing et <strong>des</strong> ostéosarcomes<br />
: à propos de 31 cas<br />
A. BABINET*, A. MILET, V.LAURENCE,<br />
J.-Y. PIERGA, B.TOMENO, P.ANRACT<br />
INTRODUCTION. Le but de ce travail était d’analyser et de<br />
comparer la survie <strong>des</strong> ostéosarcomes (OS) et <strong>des</strong> sarcomes<br />
d’Ewing (EW) du bassin en fonction <strong>des</strong> différents traitements<br />
pratiqués.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Il s’agissait d’une étude rétrospective<br />
incluant 31 patients atteints de OS (n = 15) ou EW (n = 16)<br />
du bassin ayant eu une séquence thérapeutique homogène associant<br />
chimiothérapie, chirurgie et/ou radiothérapie. Le recul<br />
moyen était de 37 mois (2-144). L’âge moyen était de 20 ans pour<br />
<strong>les</strong> EW et de 28 ans pour <strong>les</strong> OS. Les localisations sur le bassin<br />
étaient en zone I 12 fois, en zone I et II 4 fois, en zone II 1 fois, en<br />
zone II et III 7 fois, en zone III 1 fois et en zone I II et III 6 fois. <strong>Tous</strong><br />
<strong>les</strong> patients ont reçu une chimiothérapie, 15 ont pu être opérés et 16<br />
ont été traités par radiothérapie seule. Cinq patients ont reçu une<br />
radiothérapie complémentaire après chirurgie. Une analyse de survie<br />
actuarielle globale et comparée a été réalisée en utilisant le test<br />
de Logrank. Les facteurs de comparaison étaient l’existence d’une<br />
résection chirurgicale, l’existence de métastases initia<strong>les</strong> ou<br />
secondaires, la réponse tumorale observée sur l’imagerie et à<br />
l’examen anatomopathologique (bon ou mauvais répondeur)<br />
après chimiothérapie.<br />
RÉSULTATS. La survie à 5 ans pour <strong>les</strong> EW était de 53 % et<br />
pour <strong>les</strong> OS de 31 %, sans que cette différence n’apparaisse significative<br />
pour la survie globale entre <strong>les</strong> 2 diagnostics. Seul l’existence<br />
de métastases initia<strong>les</strong> diminuait la survie de manière significative.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. La localisation pelvienne<br />
pour <strong>les</strong> ostéosarcomes et pour <strong>les</strong> sarcomes d’Ewing est un facteur<br />
de mauvais pronostic. Contrairement aux données de la littérature,<br />
l’influence de la chirurgie n’apparaît pas comme un facteur<br />
pronostic favorable dans notre série. Elle semble pourtant amélioré<br />
la survie à court terme. Dans cette localisation, l’ostéosarcome<br />
semble plus péjoratif que le sarcome d’Ewing, en terme de<br />
survie.<br />
*A. Babinet, Service de Chirurgie Orthopédique B,<br />
Hôpital Cochin, 27, rue du Faubourg-Saint-Jacques,<br />
75014 Paris.
56 Résultats du traitement chirurgical<br />
<strong>des</strong> sarcomes osseux primitifs du<br />
rachis dorsal et lombaire : à propos<br />
de 22 cas<br />
C. COURT*, G. MISSENARD, V.MOLINA,<br />
J.-Y. NORDIN<br />
INTRODUCTION. Les tumeurs malignes primitives du rachis<br />
doivent bénéficier d’une résection large tout en préservant l’axe<br />
médullo-radiculaire. Le but de ce travail était de rapporter <strong>les</strong><br />
résultats oncologiques et <strong>les</strong> complications de cette chirurgie.<br />
MATÉRIEL. Vingt-deux patients, d’âge moyen 30 ans (15-65)<br />
ont été opérés. Le diagnostic histologique a toujours été fait en<br />
préopératoire. Il y avait 16 tumeurs de haut grade (7 Ewing, 5<br />
ostéosarcomes, 4 divers) et 6 de bas grade (5 chondrosarcomes, 1<br />
ostéosarcome). Quatre patients étaient en rechute locale après une<br />
chirurgie initialement insuffisante et 3 avaient eu une laminectomie<br />
en urgence.<br />
MÉTHODE. Onze hémivertébrectomies sagitta<strong>les</strong> (HVS) pour<br />
<strong>les</strong> lésions pédiculo-transversaires et 10 vertébrectomies totale<br />
(VT) pour <strong>les</strong> lésions corporéa<strong>les</strong> ont été réalisées. Un patient<br />
(Ewing) n’a eu qu’une fixation postérieure en raison de la nécessité<br />
de préserver l’artère d’Adamkiewitz.<br />
RÉSULTATS. Quatorze fois, l’exérèse a été complète (large ou<br />
marginale) et 7 fois contaminée. A 6 ans de recul moyen, dix<br />
patients sont vivants sans maladie (4 Ewing, 4 ostéosarcomes, 2<br />
chondrosarcomes) et 1 est vivant avec la maladie (chondrosarcome).<br />
Onze patients sont décédés 4 de métastases et 6 de rechutes<br />
loca<strong>les</strong> et 1 d’un infarctus à 3 mois postopératoire. Parmi <strong>les</strong> 7<br />
rechutes loca<strong>les</strong> (5 ostéosarcomes, 2 chondrosarcomes) 3 l’étaient<br />
déjà lors de la prise en charge et un seul est encore vivant (chondrosarcome<br />
en poursuite évolutive). Il n’y a pas eu de complication<br />
neurologique ; en revanche, 4 complications mécaniques<br />
(pseudarthroses) après <strong>des</strong> VT ont nécessité 4 réinterventions.<br />
DISCUSSION. La survie de cette série est de 45 % à 6 ans et<br />
comparable aux séries de la littérature (40 % à 50 % de survie à 5<br />
ans). Dans 85 % <strong>des</strong> cas l’exérèse contaminée a entraîné une<br />
rechute locale (67 % à 100 % dans la littérature). Parmi <strong>les</strong> 4<br />
patients qui étaient en rechute lors de l’intervention, un seul a pu<br />
avoir une exérèse complète et est toujours vivant (un sarcome<br />
d’Ewing sensible au traitement adjuvant). Une chirurgie incomplète<br />
ou une biopsie mal faite aggravent le pronostic. Les échecs<br />
mécaniques sont observés dans <strong>les</strong> VT en l’absence de synthèse<br />
antérieure associée à la fixation postérieure.<br />
CONCLUSION. La chirurgie d’exérèse large <strong>des</strong> sarcomes<br />
osseux primitifs du rachis donne <strong>des</strong> résultats encourageants, lorsqu’elle<br />
est réussie d’emblée. Le meilleur contrôle local du sarcome<br />
d’Ewing s’explique par sa sensibilité au traitement adjuvant.<br />
La reconstruction <strong>des</strong> VT nécessite une stabilisation circonférentielle<br />
du rachis.<br />
*C. Court, Hôpital Bicêtre, 78, rue du Général-Leclerc,<br />
94250 Le Kremlin-Bicêtre.<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S47<br />
57 Léiomyosarcome intra-osseux : difficulté<br />
diagnostique et thérapeutique.<br />
A propos de deux cas et revue<br />
de la littérature<br />
F. ARIBIT*, J.-Y. BEAULIEU, J.-L. CHARRISSOUX,<br />
J.-P. ARNAUD<br />
INTRODUCTION. Le léiomyosarcome d’origine intraosseuse<br />
(LMIO) est une tumeur rare. L’imagerie n’est pas spécifique.<br />
Seul l’examen anatomo-pathologique permet de faire le<br />
diagnostic. La thérapeutique reste discutée car aucun traitement<br />
n’a démontré une efficacité certaine. Nous proposons à partir de<br />
deux cas et d’une revue de la littérature de faire le point sur cette<br />
tumeur maligne.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Cas n o 1 : patiente de 43 ans présentant<br />
<strong>des</strong> gonalgies droites continues depuis 6 mois. L’iconographie<br />
retrouve une zone d’ostéolyse métaphyso-épiphysaire du<br />
tibia avec atteinte <strong>des</strong> tissus mous et hyperfixation scintigraphique<br />
et tomographiques au 18-FDG. L’examen anatomo-pathologique<br />
diagnostique un LMIO de haut grade. Le bilan d’extension est<br />
négatif. On réalise une exérèse tumorale avec prothèse massive,<br />
suivie de chimiothérapie et radiothérapie.<br />
Cas n o 2 : patient de 50 ans transféré à J10 pour fracture spontanée<br />
de l’extrémité inférieure du fémur. La radiographie, le TDM,<br />
l’IRM, la scintigraphie et le PET-SCAN sont d’interprétation difficile.<br />
Une biopsie avec examen anatomopathologique est en<br />
faveur d’une tumeur bénigne. On réalise une résection associée à<br />
une greffe hétérologue synthèsée. L’examen définitif conclue à un<br />
LMIO. Le bilan d’extension est négatif, la radiothérapie est initiée.<br />
RÉSULTAT. Avec un recul moyen de 18 mois <strong>les</strong> patients sont<br />
vivants. La patiente marche sans canne, le patient en appui bipodal<br />
sous couvert de cannes. Radiologiquement, la prothèse est scellée,<br />
le greffon est en place. Les deux patients sont revus régulièrement<br />
et <strong>les</strong> bilans systématiques à la recherche d’une récidive locale ou<br />
générale sont négatifs.<br />
DISCUSSION. La littérature rapporte peu de cas de LMIO. Son<br />
diagnostic anatomo-pathologique a été pendant longtemps difficile.<br />
L’histogie peut parfois revêtir le même aspect qu’une tumeur<br />
bénigne. C’est grâce à l’himmunohistochimie et à l’étude ultrastructurale<br />
en microscopie électronique que le diagnostic positif est<br />
fait. Malheureusement le traitement de cette tumeur reste difficile.<br />
La chimiothérapie et la radiothérapie n’ont aucune efficacité. Le<br />
traitement chirurgical même carcinologique n’a pas montré de<br />
supériorité par rapport à un traitement plus conservateur en terme<br />
de durée de survie ou d’apparition de localisations secondaires.<br />
L’association du traitement médical et chirurgical ne garantit pas<br />
un meilleur résultat.<br />
CONCLUSION. Le LMIO est une tumeur rare dont le diagnostic<br />
est fait grâce à l’immunohistochimie et l’étude ultrastructurale.<br />
Malheureusement, il est difficile d’imposer une conduite thérapeutique<br />
systématique même si il semble qu’un geste chirurgical<br />
curatif associé à de la radiothérapie donne <strong>les</strong> meilleurs résultats<br />
avec malgré tout un mauvais pronostic à court terme.<br />
*F. Aribit, Service Orthopédie Traumatologie, CHU Dupuytren,<br />
2, avenue Martin-Luther-King, 87000 Limoges.
3S48 78 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
58 Vers une autre voie de traitement<br />
<strong>des</strong> tumeurs osseuses à cellu<strong>les</strong><br />
géantes : le traitement par la calcitonine.<br />
A propos de 25 cas<br />
S. KARRAY*, A. BEN LASSOUED, S.KALLEL,<br />
M. FATHI LADEB, M.ZOUARI, M.ABDELKAFI,<br />
M. DOUIK, T.LITAÏEM<br />
INTRODUCTION. Le traitement <strong>des</strong> tumeurs osseuses à cellu<strong>les</strong><br />
géantes est presque exclusivement chirurgical mais non univoque,<br />
la discussion tourne sans cesse autour du dilemme curetage<br />
— comblement ou résection, curetage avec ou sans adjuvants<br />
locaux, comblement par autogreffe, allogreffe ou ciment. Le but<br />
de notre travail est d’apporter une nouvelle perspective de traitement<br />
<strong>des</strong> TCG basées sur la physiopathologie tumorale et l’infiltration<br />
à la calcitonine.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Nous rapportons 25 cas de<br />
tumeurs osseuses bénignes à cellu<strong>les</strong> géantes traitées par calcitonine.<br />
L’âge moyen <strong>des</strong> patients est de 31 ans. La prédominance<br />
féminine est nette (75 %). Les localisations intéressaient toujours<br />
l’extrémité d’un os long. Nous avons réparti nos tumeurs en<br />
tumeurs bénignes quiescentes, actives ou agressives selon la classification<br />
d’Enneking. Notre protocole de traitement comporte 4<br />
temps successifs après confirmation histologique du diagnostic<br />
par biopsie. Le premier temps est un curetage agressif de la tumeur<br />
suivi d’un 2 e temps d’injection intramusculaire de calcitonine jusqu’à<br />
cicatrisation cutanée. Le 3 e temps comporte un lavage quotidien<br />
de la cavité tumorale au sérum physiologique par simple<br />
ponction associé à une infiltration locale de calcitonine pendant un<br />
mois. Une injection intramusculaire de calcitonine pendant 2 mois<br />
constitue le 4 e temps.<br />
RÉSULTATS. Nous avons analysé nos résultats avec un recul<br />
moyen de 3 ans (extrêmes 2 et 20 ans). Une réhabitation progressive<br />
de la cavité tumorale est apparue dans la majorité <strong>des</strong> cas à<br />
partir du premier mois du traitement même dans <strong>les</strong> formes agressives<br />
postulant du premier coup d’œil pour une résection tumorale.<br />
Nos résultats évalués par la cotation fonctionnelle d’Enneking ont<br />
donné <strong>des</strong> taux avoisinant 90 % dépassant de loin le taux <strong>des</strong> autres<br />
techniques conventionnel<strong>les</strong>. Aucune complication n’a été relevée.<br />
Toutefois, nous déplorons 8 récidives dont 3 ont été reprises<br />
par le même protocole avec de bons résultats.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. Il apparaît évident que la<br />
tumeur osseuse à cellu<strong>les</strong> géantes est une tumeur hormonosensible<br />
et que la calcitonine pourrait arrêter le processus ostéolytique en<br />
s’attaquant à la cellule multinuclée (osteoclast-like) porteuse de<br />
récepteurs à la calcitonine. Le lavage quotidien de la cavité tumorale<br />
vise à modifier le micro-environnement tumoral éliminant <strong>les</strong><br />
facteurs de croissance tumorale et <strong>les</strong> cytokines exprimées par <strong>les</strong><br />
cellu<strong>les</strong> géantes. Des étu<strong>des</strong> plus poussées à l’échelle membranaire<br />
pourraient expliquer certains phénomènes d’échappement à<br />
la calcitonine cause de récidives à plus ou moins long terme.<br />
*S. Karray, Institut National Mohamed Taïeb Kassab,<br />
2010 La Manouba, Tunis, Tunisie.<br />
59 Pronostic <strong>des</strong> sarcomes <strong>des</strong> tissus<br />
mous en fonction du lieu de la prise<br />
en charge initiale : expérience du<br />
centre de référence de Birmingham<br />
en Angleterre<br />
F. FIORENZA*, R. GRIMER, A.BHANGU,<br />
J. BEARD, R.TILLMAN, S.ABUDU, S.CARTER<br />
INTRODUCTION. L’objectif de ce travail a été d’analyser la<br />
survie et <strong>les</strong> facteurs pronostics d’une série de patients traités pour<br />
sarcomes <strong>des</strong> tissus mous en fonction du lieu de la prise en charge<br />
initiale : un centre de référence supra-régional pour la pathologie<br />
tumorale <strong>des</strong> membres (Royal Orthopaedic Hospital à Birmingham<br />
en Angleterre) et 38 hôpitaux de la région sanitaire concernée.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. La série se compose de 260<br />
patients (111 femmes et 149 hommes) traités entre 1994 et 1996.<br />
L’âge moyen lors du diagnostic était de 61 ans. 96 patients (37 %)<br />
ont été pris en charge dans le centre de référence et 164 (63 %)<br />
patients dans <strong>les</strong> autres centres. Le recul minimum était de 5 ans.<br />
Le risque de récidives loca<strong>les</strong> ainsi que le pronostic de survie ont<br />
été étudiés en analysant <strong>les</strong> différents facteurs de risque (grade,<br />
localisation sus ou sous-aponévrotique, taille <strong>des</strong> tumeurs, qualité<br />
<strong>des</strong> marges de résection).<br />
RÉSULTATS. Il s’agissait de tumeurs de haut grade dans 73 %<br />
<strong>des</strong> cas, de localisation sous aponévrotique dans 59 % <strong>des</strong> cas. La<br />
taille moyenne était de 8,6 cm. Les tumeurs <strong>des</strong> patients traités<br />
dans le centre de référence étaient en moyenne plus volumineuse<br />
(10,3 cm contre 7,5 cm) (p < 0,05). La fréquence de survenue <strong>des</strong><br />
récidives loca<strong>les</strong> étaient de 20 % pour le centre de référence contre<br />
37 % pour <strong>les</strong> autres centres. La survie globale à 5 ans était de 58 %<br />
et était corrélée au grade, à la taille ainsi qu’à la localisation sus ou<br />
sous aponévrotique <strong>des</strong> tumeurs (p < 0,05). La survie globale <strong>des</strong><br />
patients pris en charge dans le centre de référence n’était pas<br />
statistiquement différente de celle <strong>des</strong> patients opérés dans <strong>les</strong><br />
autres centres cependant pour <strong>les</strong> tumeurs de haut grade (stade III,<br />
UICC) la survie à 5 ans était de 41 % pour le centre de référence<br />
contre 14 % pour <strong>les</strong> autres centres (p < 0,05).<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. Les sarcomes <strong>des</strong> tissus<br />
mous sont <strong>des</strong> tumeurs rares. Pour <strong>les</strong> sarcomes de haut grade, <strong>les</strong><br />
taux de récidives ainsi que la survie étaient meilleurs pour <strong>les</strong><br />
patients pris en charge dans le centre de référence. La question de<br />
centraliser ce type de pathologie dans <strong>des</strong> centres de référence<br />
reste posée.<br />
*F. Fiorenza, Service d’Orthopédie et Traumatologie,<br />
Hôpital Universitaire Dupuytren, 2, avenue<br />
Martin-Luther-King, 87042 Limoges Cedex.
60 Résultat du traitement chirurgical<br />
de l’écchinococcose musculaire<br />
M. MTAOUMI*, M. MSSEDI, J.DEHMEN, R.BEN<br />
HAMIDA, R.FRIKHA, T.MOULA<br />
INTRODUCTION. L’échinococcose est une anthropozoonose<br />
cosmopolite commune à l’homme et à de nombreux mammifères<br />
liée au développement de la forme larvaire ou hydatique d’un ténia<br />
du chien appelé échinococcus granulosus. La localisation musculaire<br />
est rare et inhabituelle.<br />
MATÉRIELS ET MÉTHODES. Nous rapportons 11 cas<br />
d’échinococcose musculaire. Cette dernière était le plus souvent,<br />
unique et primitive. Les musc<strong>les</strong> proximaux <strong>des</strong> membres inférieurs<br />
étaient <strong>les</strong> plus fréquemment touchés. Le diagnostic d’hydatidose<br />
musculaire a été évoqué devant une tumeur <strong>des</strong> parties<br />
mol<strong>les</strong> évoluant dans un contexte endémique.<br />
L’échographie avait occupé une place de choix dans le diagnostic<br />
de l’affection. Le traitement était chirurgical dans tous <strong>les</strong> cas<br />
réalisant idéalement une énucléation prudente du kyste associée à<br />
une péri-kystectomie dans 4 cas.<br />
RÉSULTATS. L’évolution précoce a été favorable en dehors de<br />
la suppuration de la zone de résection chez un patient. A moyen<br />
terme, il a été constaté une 2 e localisation musculaire à distance du<br />
site initial chez un patient. Au recul moyen de 2 ans et demi,<br />
aucune récidive locale ou à distance n’a été relevée.<br />
DISCUSSION. Il est important d’établir un diagnostic préopératoire<br />
de l’hydatidose musculaire afin de réduire le risque de<br />
choc anaphylactique, de dissémination en cas de ponction ou<br />
d’ouverture accidentelle du kyste au cours de l’intervention. Le<br />
traitement de l’échinococcose musculaire doit être exclusivement<br />
chirurgical.<br />
CONCLUSION. L’hydatidose musculaire demeure rare. Son<br />
diagnostic est essentiellement échographique évitant la ponction.<br />
Le traitement est exclusivement chirurgical emportant le kyste<br />
sans effraction de ce dernier.<br />
*M. Mtaoumi, M. Mtaoumi, CHU Sahloul, Sousse, Tunisie.<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S49<br />
61 Ostéite chronique et carcinomes<br />
épidermoï<strong>des</strong> : à propos de trois<br />
cas<br />
J.-L. TRICOIRE*, J.-M. LAFFOSSE, A.NEHME,<br />
H. BENSAFI, J.PUGET<br />
INTRODUCTION. L’amélioration <strong>des</strong> techniques chirurgica<strong>les</strong><br />
et <strong>des</strong> moyens à notre disposition permettent de nos jours le<br />
sauvetage en urgence de membres très délabrés. Le résultat fonctionnel<br />
après ce type de chirurgie conservatrice est en général<br />
satisfaisant mais au pris d’un foyer d’ostéite plus ou moins quiescent.<br />
Avec le passage à la chronicité, la peau avoisinante à ce type<br />
de foyer peut subir une transformation carcinomateuse (carcinome<br />
épidermoïde ; Hawkins 1935). Le but de notre travail est de vous<br />
rapporter trois transformations de ce type et d’en discuter <strong>les</strong> indications<br />
thérapeutiques.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. La série étudiée comporte trois<br />
patients souffrant d’une ostéite chronique du tibia entrant dans un<br />
cadre post traumatique. Au décours de leur surveillance, après<br />
plusieurs années, nous avons assisté à une modification <strong>des</strong> signes<br />
locaux : douleurs croissantes, écoulements purulents et hémorragiques<br />
(triade de Rowlands). Une biopsie a été pratiquée dans<br />
chaque cas et a permis de poser le diagnostic de transformation en<br />
carcinome épidermoïde. Le bilan d’extension locorégional et<br />
général a été négatif dans <strong>les</strong> trois cas. <strong>Tous</strong> ces patients ont été<br />
traités par une amputation de cuisse.<br />
RÉSULTATS. Le résultat de ces trois amputations était satisfaisant<br />
avec une cicatrisation d’excellente qualité, une survieà3ans<br />
de 100 % et un bilan d’extension toujours négatif.<br />
DISCUSSION. La fréquence <strong>des</strong> transformations carcinomateuse<br />
au voisinage <strong>des</strong> foyers d’ostéite chronique varie selon <strong>les</strong><br />
séries entre 0,2 % et 1,7 %. Il existe en quelques sorte une rançon<br />
à la conservation fonctionnelle à tout pris. Une modification de la<br />
symptomatologie telle que la triade de Rowlands associée à une<br />
modification de la flore bactérienne et à l’apparition d’une odeur<br />
nauséabonde doit constituer un signe d’alerte et inciter à faire une<br />
biopsie. Le traitement de choix pour la majorité <strong>des</strong> auteurs qui se<br />
sont intéressés à ce sujet reste l’amputation afin d’augmenter <strong>les</strong><br />
chances de survie <strong>des</strong> patients.<br />
CONCLUSION. Le classicisme du sujet ne doit pas conduire à<br />
l’oubli d’une transformation potentielle aveuglé par le souci de la<br />
chirurgie reconstructrice à tout prix. L’amputation secondaire ne<br />
doit pas être non plus considérée comme un signe d’échec devant<br />
ces tableaux cliniques poussés à l’extrême.<br />
*J.-L. Tricoire, Service de Chirurgie Orthopédique et<br />
Traumatologique, Hôpital de Rangueil, 1, avenue Poulhès,<br />
31403 Toulouse Cedex 3.
3S50 78 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
62 Épiphysiodèse chirurgicale par vissage<br />
transphysaire dans le traitement<br />
<strong>des</strong> inégalités de longueur<br />
<strong>des</strong> membes inférieurs<br />
J.-D. METAIZEAU*, J.-P. METAIZEAU,<br />
P. JOURNEAU, P.LASCOMBES<br />
INTRODUCTION. L’épiphysiodèse chirurgicale est une technique<br />
de correction <strong>des</strong> inégalités de longueur <strong>des</strong> membres inférieurs.<br />
Les métho<strong>des</strong> décrites ont été <strong>les</strong> suivantes : greffe in situ<br />
(Phemister, 1993), agrafage (Blount, 1949), curetage percutané<br />
(Bowen, 1984. Le but de ce travail est l’évaluation d’une nouvelle<br />
technique décrite en 1998 (Metaizeau) utilisant deux vis transphysaires<br />
percutanées.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Quarante-deux patients (29 garçons<br />
et 13 fil<strong>les</strong>) d’âge moyen 13,1 ans ont été opérés. L’étiologie<br />
était inconnue (12), post-fracturaire (16), congénitale (7) et divers<br />
(7). L’épiphysiodèse par deux vis était assurée sur le fémur distal<br />
24 fois, tibia proximal 7 fois, fémoro-tibiale 11 fois. Les mesures<br />
ont été faites sur <strong>des</strong> radiographies statif <strong>des</strong> membres inférieurs<br />
obtenues avant l’intervention et jusqu’au recul. Était mesurée la<br />
longueur <strong>des</strong> membres inférieurs, <strong>des</strong> fémurs et <strong>des</strong> tibias. La<br />
différence était mesurée ainsi que le pourcentage de croissance en<br />
comparant <strong>les</strong> côtés épiphysiodésés et le côté contro-latéral. Ont<br />
été étudiés le temps opératoire, la durée d’hospitalisation et <strong>les</strong><br />
complications.<br />
RÉSULTATS. L’inégalité moyenne pré-opératoire mesurait<br />
22,3 mm (10 à 70) ; à maturité squelettique la différence mesurait<br />
11 mm (28 à -20). Le pourcentage moyen de croissance depuis la<br />
date de l’épiphysiodèse jusqu’à la fin de la croissance était de<br />
3,15 % pour le côté épiphysiodésé et de 6,26 % pour le côté<br />
contro-latéral. La durée opératoire moyenne était de 20 mn par os<br />
(15 à 40). Le taux de complications est de 16 % incluant 7 % de<br />
raideur du genou en post-opératoire immédiat, récupérant totalement<br />
en deux semaines, et 9 % de désagrément dû à la présence<br />
<strong>des</strong> vis. L’étude <strong>des</strong> pourcentages a permis de constater que l’épiphysiodèse<br />
était effective avant 3 mois. La durée moyenne d’hospitalisation<br />
était de 1,3 jour (1 à 4).<br />
DISCUSSION. Le résultat final de l’inégalité de longueur est<br />
comparable aux autres métho<strong>des</strong>. Le taux de complication semble<br />
plus favorable dans la mesure où il n’y a eu aucune infection,<br />
aucune déviation ni frontale ni sagittale, aucune lésion vasculaire<br />
ni nerveuse, et que toutes <strong>les</strong> complications ont guéri sans<br />
séquelle. Cette intervention est possible dans le cadre de la chirurgie<br />
ambulatoire et l’épiphysiodèse a toujours était obtenue en<br />
moins de 3 mois.<br />
CONCLUSION. L’épiphysiodèse par vis transphysaire percutanée<br />
est une technique simple avec un minimum de complica-<br />
Séance du 11 novembre matin<br />
INFANTILE<br />
tions, fiable et présentant <strong>des</strong> avantages par rapport aux autres<br />
métho<strong>des</strong>.<br />
*J.-D. Metaizeau, Service de Chirurgie Infantile A,<br />
CHU Brabois, Hôpital d’Enfants, rue du Morvan,<br />
54500 Vandœuvre-<strong>les</strong>-Nancy.<br />
63 Résultat du traitement <strong>des</strong> atteintes<br />
du genou par prothèse totale dans<br />
l’arthrite juvénile idiopathique : à<br />
propos de 31 cas<br />
L. N’GUYEN*, T. ODENT, M.BERCOVY,<br />
P. TOUZET, A.-M. PRIEUR, C.GLORION,<br />
J.-C. POULIQUEN<br />
INTRODUCTION. De 1985 à 2001, 31 prothèses tota<strong>les</strong> de<br />
genoux ont été posées sur 17 patients ado<strong>les</strong>cents ou adultes jeunes<br />
atteints d’une arthrite juvénile idiopathique (AJI). Le but de ce<br />
travail a été d’évaluer le résultat fonctionnel et radiographique.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. L’évaluation fonctionnelle globale<br />
a été estimée par la classification de Steinbrocker. La fonction<br />
propre du genou opéré a été évaluée par la cotation de l’IKS<br />
(International Knee Society). Plusieurs types de prothèses ont été<br />
posées : 14 prothèses contraintes de type GSB, 10 prothèses tricompartimenta<strong>les</strong><br />
semi-contraintes à plate-forme rotatoire de type<br />
tri-CCC cimentées, une prothèse ROCC semi-contrainte non<br />
cimentée, 4 prothèses LCS dont 2 non cimentées et enfin deux<br />
prothèses FINN sur un même patient (prothèses à charnières rotatoires<br />
faites sur mesure). Quatorze étaient bilatéra<strong>les</strong>, dont 3 réalisées<br />
dans le même temps opératoire.<br />
RÉSULTATS. L’âge moyen au moment de l’intervention était<br />
de 20 ans et 5 mois (14-29). Il y avait 14 fil<strong>les</strong> et 3 garçons. Il y avait<br />
8 AJI à forme systémique et 9 à forme poly-articulaire. Selon<br />
Steinbrocker 5 patients étaient classés stade II, 6 stade III et enfin 6<br />
étaient stade IV, c’est à dire grabataires. Dix patients ont eu 2<br />
prothèses de hanche avant une prothèse bilatérale <strong>des</strong> genoux. Le<br />
recul moyen était de 4,5 ans (1-12). Parmi 31 genoux opérés 16<br />
étaient indolores, 14 un peu douloureux, 1 douloureux en raison<br />
d’un <strong>des</strong>cellement. Le score articulaire était très bons 18 fois, bons<br />
4 fois, moyens 4 fois et mauvais 5 fois. Sur <strong>les</strong> radiographies, 29<br />
genoux avaient un axe normal. Des liserés ont été observés sur <strong>les</strong><br />
prothèses contraintes GSB 10 fois sur 14. Nous n’en avons pas<br />
observé sur <strong>les</strong> prothèses tri-compartimenta<strong>les</strong> non cimentées. Les<br />
complications ont été 1 nécrose cutanée limitée, 1 fracture supracondylienne<br />
bilatérale un an après la pose de ses prothèses.<br />
DISCUSSION. Les résultats <strong>des</strong> prothèses tota<strong>les</strong> de genoux<br />
dans l’AJI sont encourageants. Ces arthroplasties permettent une<br />
amélioration fonctionnelle spectaculaire. Les quelques séries<br />
publiées sur le sujet confirment ces bons résultats. Les prothèses<br />
tri-compartimenta<strong>les</strong> semi-contraintes cimentées semblent présenter<br />
à 5 ans de recul environ une meilleure stabilité d’implanta-
tion. Enfin, <strong>les</strong> prothèses tri-compartimenta<strong>les</strong> à scellement biologique<br />
paraissent être une solution très satisfaisante car el<strong>les</strong><br />
permettent une préservation du capital osseux.<br />
*L. N’Guyen, Hôpital Necker Enfants-Mala<strong>des</strong>,<br />
149, rue de Sèvres, 75743 Paris Cedex 15.<br />
64 L’ostéotomie tibiale double de valgisation<br />
par soustraction externe et<br />
relèvement du plateau tibial interne<br />
dans <strong>les</strong> formes évoluées de tibia<br />
vara infantile<br />
Y. CATONNÉ*, M. JANOYER,<br />
H. PASCAL-MOUSSELARD, O.DELATTRE,<br />
J.-L. ROUVILLAIN, D.RIBEYRE, J.SOMMIER<br />
INTRODUCTION. Les formes évoluées de maladie de Blount<br />
présentent un important varus métaphysaire associée à une obliquité<br />
du plateau tibial interne. Avant 1987, nous pratiquions dans<br />
un premier temps une ostéotomie tibiale de valgisation, et dans<br />
certains cas et secondairement un relèvement du plateau. A partir<br />
de 1987, nous avons réalisé ces deux gestes en un seul temps<br />
opératoire. Le but de ce travail est de décrire et d’évaluer cette<br />
technique d’ostéotomie tibiale double.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Entre 1987 et 2000, nous avons<br />
pratiqué 31 ostéotomies doub<strong>les</strong> de valgisation-relèvement : 15<br />
ont été faites dans <strong>des</strong> formes évoluées de maladie de Blount vues<br />
tardivement (8 avant fusion complète du cartilage de croissance et<br />
7 à l’âge adulte), 13 chez <strong>des</strong> enfants présentant une récidive de<br />
varus évolutif après une ostéotomie pratiquée dans l’enfance.<br />
Enfin, un enfant présentait un tibia vara de l’ado<strong>les</strong>cent et trois<br />
autres une dysplasie poly-épiphysaire. L’âge moyen au moment<br />
de l’ostéotomie était de 17 ans, avec <strong>des</strong> extrêmes de 10 et 40 ans.<br />
La technique opératoire a consisté dans tous <strong>les</strong> cas en une ostéotomie<br />
tibiale de valgisation avec ablation d’un coin externe associée<br />
à un relèvement du plateau interne par une seconde voie<br />
d’abord avec ostéotomie oblique dirigée vers <strong>les</strong> épines tibia<strong>les</strong> et<br />
interposition du fragment prélevé en dehors. Une ostéotomie du<br />
péroné au niveau de son tiers moyen a constamment été faite et une<br />
épiphysiodèse tibiale supérieure et externe par agrafage a été pratiquée<br />
dans <strong>les</strong> cas où le cartilage était encore actif. Dans tous <strong>les</strong><br />
cas nous avons étudié en pré et post-opératoire : l’angle fémorotibial<br />
mécanique, l’angle tibial et fémoral mécanique traduisant la<br />
déformation intra-osseuse, la pente du plateau tibial interne et la<br />
longueur <strong>des</strong> membres inférieurs en fin de croissance.<br />
RÉSULTATS. Le recul moyen était de 8 ans et tous <strong>les</strong> patients<br />
avaient fusionné leur physe au dernier recul. L’angle fémoro-tibial<br />
mécanique était en pré-opératoire en moyenne de 148,5 soit un<br />
varus de 31,5 (extrêmes 20 et 42) et de 178 en postopératoire.<br />
L’angle fémoral mécanique moyen était de 94 soit 4 de valgus<br />
fémoral avec <strong>des</strong> extrêmes de 88 et 102 et demeurait inchangé en<br />
postopératoire. L’angle tibial mécanique moyen était de 71 en<br />
préopératoire (soit un varus intra-osseux de 19) et de 89 en postopératoire.<br />
La pente du plateau tibial interne était en moyenne de 45<br />
en pré et de 22 en postopératoire. L’inégalité de longueur <strong>des</strong><br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S51<br />
membres inférieurs était en moyenne de 2,2 cm au dernier recul<br />
avec <strong>des</strong> extrêmes de 0,5 et 5 cm.<br />
DISCUSSION. Différentes techniques ont été décrites pour<br />
corriger en un temps <strong>les</strong> deux composantes de la déformation : la<br />
technique utilisée dans cette étude est une ostéotomie oblique<br />
métaphyso-épiphysaire. Elle suppose que le cartilage soit déja<br />
fusionné dans sa partie interne et nécessite une fusion associée de<br />
la partie externe de la physe si celle-ci est encore active. Actuellement,<br />
nous utilisons dans <strong>les</strong> formes où une partie du cartilage est<br />
encore actif une technique de chondrodiastasis par un fixateur<br />
externe particulier, permettant à la fois de corriger l’axe, de relever<br />
le plateau interne et de traiter l’inégalité de longueur par un allongement.<br />
La technique d’ostéotomie double est réservée aux formes<br />
avec fusion totale de la physe. Seule une étude à long terme de<br />
l’évolution <strong>des</strong> patients après ostéotomie double comparée à celle<br />
du chondrodiastasis permettra de connaître le devenir de ces<br />
genoux et de préciser la fréquence <strong>des</strong> gonarthroses secondaires<br />
(travail du service de Chirurgie Orthopédique du CHU de Fort-de-<br />
France en Martinique).<br />
*Y. Catonné, Hôpital de la Pitié-Salpétrière,<br />
47, boulevard de l’Hôpital, 75013, Paris.<br />
65 L’instabilité rotulienne de l’enfant,<br />
stabilisation de l’appareil extenseur<br />
par la technique de la baguette<br />
molle : à propos de 85 genoux<br />
S. AIRAUDI*, E. GARRON, I.GONDRAND,<br />
P. LECLERC, P.-M. GRAMMONT, E.BOULOT,<br />
P. TROUILLOUD<br />
INTRODUCTION. L’instabilité rotulienne chez l’enfant pose<br />
de nombreux problèmes cliniques et thérapeutiques. Nous présentons<br />
ici <strong>les</strong> résultats de l’intervention de la « baguette molle »<br />
pratiquée depuis 1974 dans le service du Pr Grammont.<br />
MATÉRIELS ET MÉTHODES. De 1974 à 2002, 64 patients<br />
soit 85 genoux ont été réévalués sur le plan clinique et radiologique.<br />
Sexe ratio : 79 % de fil<strong>les</strong> et 21 % de garçons. Le recul moyen<br />
à la révision est de 140 mois (14-234 mois). Dans 8 cas, une section<br />
de l’aileron externe de la rotule avait été associée à la baguette<br />
molle. Le cadre diagnostique regroupe <strong>les</strong> 5 types d’instabilité<br />
rotulienne de la luxation permanente à l’instabilité potentielle.<br />
RÉSULTATS. Au recul, 84 % de nos patients s’estiment satisfaits<br />
de l’intervention avec une amélioration significative de la<br />
douleur, de l’instabilité et de la course rotulienne. Nous trouvons<br />
23,5 % de complications mineures (hématome, épanchements)<br />
ainsi que 11 récidives à moyen et long terme soit 9,5 % de la série,<br />
qui sont considérés comme <strong>des</strong> échecs. Aucun cas d’épiphysiodèse<br />
n’a été recensé. Huit cas d’apparition de néoTTA sont constatés,<br />
preuve de l’efficacité de la réaxation <strong>des</strong> forces de traction du<br />
ligament rotulien médialisé par cette intervention. Le suivi de<br />
l’évolution de l’axe mécanique montre une nette tendance à une<br />
majoration du valgus.<br />
DISCUSSION. L’intervention de la baguette molle remplit le<br />
cahier <strong>des</strong> charges fixé initialement : stabiliser l’appareil extenseur,<br />
ne pas léser le cartilage de croissance de la TTA, obtenir un
3S52 78 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
remodelage de la trochlée pour <strong>les</strong> enfants <strong>les</strong> plus jeunes. L’évolution<br />
de l’axe mécanique vers le valgus peut poser problème. Pour<br />
cette raison, nous insistons, dans le cas d’un genu valgum initial<br />
supérieur à 5°, sur l’intérêt théorique d’une épiphysiodèse temporaire<br />
interne associé à la baguette molle pour contrôler cette évolution<br />
source potentielle de récidive et d’échec thérapeutique.<br />
*S. Airaudi, Service d’Orthopédie et de Traumatologie,<br />
Hôpital d’Enfants, Complexe du Bocage, CHRU, 21000 Dijon.<br />
66 Épiphysiolyse à grand déplacement<br />
: réduction chirurgicale par<br />
voie antérieure<br />
P. ADAM*, F. CHOTEL, P.-Y. GLAS, J.HENNER,<br />
F. SAILHAN, J.BÉRARD<br />
INTRODUCTION. Le traitement <strong>des</strong> épiphysiolyses fémora<strong>les</strong><br />
à grand déplacement reste controversé. La reposition sanglante de<br />
l’épiphyse par voie latérale proposée par Dunn permet de restituer<br />
une anatomie proche de la normale, au prix cependant d’un taux<br />
élevé de complications. Nous rapportons notre expérience de<br />
reposition sanglante par voie antérieure qui nous paraît plus fiable.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Au cours <strong>des</strong> dix dernières<br />
années, neuf hanches présentant une épiphysiolyse à grand déplacement<br />
ont été opérées par une voie d’abord antérieure afin de<br />
laisser l’artère circonflexe fémorale médiale à distance. Nous<br />
décrivons la technique opératoire employée. Aucune hanche n’a<br />
fait l’objet d’une tentative de réduction par manœuvres externes.<br />
Le déplacement préopératoire et le déplacement résiduel étaient<br />
évalués selon la méthode de Southwick et en fonction de la position<br />
de la tête fémorale par rapport à la ligne de Klein. Chaque<br />
hanche repositionnée a fait l’objet d’une scintigraphie postopératoire<br />
précoce. Toutes <strong>les</strong> hanches ont été suivies jusqu’à maturation<br />
osseuse, avec un recul moyen de 4 ans.<br />
RÉSULTATS. Sur <strong>les</strong> scintigraphies précoces, aucune hanche<br />
ne présentait d’hypofixation de la tête fémorale. La correction<br />
moyenne était de 43° sur la vue de profil, avec un déplacement<br />
préopératoire moyen de 72° et un déplacement résiduel moyen de<br />
23° en postopératoire. La position de l’épiphyse par rapport à la<br />
ligne de Klein, après reposition, n’était pas significativement différente<br />
de la position observée du côté non atteint. L’inégalité de<br />
longueur <strong>des</strong> membres inférieurs en postopératoire était de 1 cm.<br />
Au plus long recul, aucune hanche ne présentait de signes d’ostéonécrose,<br />
de chondrolyse ou de dégénérescence arthrosique. Au<br />
recul moyen de 44 mois, aucun patient ne présentait de limitation<br />
d’activité, y compris sportive. Seul un patient présentait <strong>des</strong> douleurs<br />
légères, climatiques.<br />
DISCUSSION. Par rapport à la voie d’abord latérale avec trochantérotomie<br />
proposée par Dunn, l’utilisation d’une voie antérieure<br />
nous paraît techniquement plus simple et plus sûre pour le<br />
respect de la vascularisation épiphysaire. La correction obtenue,<br />
conservant volontairement un certain degré d’hypocorrection,<br />
associée à la résection d’une portion de colpermettrait une reposition<br />
sans tension favorable à la vascularisation. Le recours à une<br />
fixation interne stable, autorisant une mobilisation précoce, pourrait<br />
expliquer l’absence de chondrolyse postopératoire.<br />
CONCLUSION. Ces résultats nous semblent suffisamment<br />
encourageants pour poursuivre dans cette voie, déjà décrite par PH<br />
Martin en 1948.<br />
*P. Adam, Service de Chirurgie Orthopédique Pédiatrique,<br />
Hôpital Debrousse, 29, rue Sœur-Bouvier, 69005 Lyon.<br />
67 Épidémiologie de la maladie<br />
luxante de hanche à partir d’une<br />
étude prospective sur vingt ans<br />
M. BERTRAND*, T. BENTAHAR, A.DIMÉGLIO<br />
INTRODUCTION. La maladie luxante est une pathologie dont<br />
le pronostic dépend essentiellement de la précocité du diagnostic<br />
et du délai de prise en charge. Repérer <strong>les</strong> hanches à risque reste<br />
l’objectif principal. Une étude prospective menée durant 20 ans de<br />
1982 à 2002, fait le point sur l’épidémiologie.<br />
MATÉRIEL. La série comporte 1056 enfants atteints d’une<br />
luxation congénitale de hanche, soit 1 491 hanches.<br />
MÉTHODE. Les données épidémiologiques, <strong>les</strong> résultats <strong>des</strong><br />
échographies, <strong>des</strong> radiographies ont permis de cerner le profil de la<br />
maladie sur 20 ans. L’étude a deux objectifs : identifier <strong>les</strong> facteurs<br />
de risques et évaluer l’impact <strong>des</strong> politiques de prévention.<br />
RÉSULTATS. Le sex-ratio était de 6/1, à prédominance féminine.<br />
L’atteinte gauche était 1,8 fois plus fréquente, elle était bilatérale<br />
dans 41 %. Les facteurs de risque liés à la luxation congénitale<br />
de hanche ont été répertoriés. Facteurs de risques majeurs :<br />
antécédents familiaux (31 %), présentation par le siège (25 %),<br />
syndrome postural (12 %). Facteurs de risque mineurs : primiparité<br />
(54,4 %), poids de naissance supérieurà4kg(9,2 %). 60,5 %<br />
<strong>des</strong> enfants avaient un ou plusieurs facteurs de risque majeurs,<br />
30 % possédaient au moins un facteur de risque mineur, 40 % ne<br />
présentaient aucun facteur de risque. Le dépistage a gagné en<br />
efficacité, le taux de diagnostic fait avant 4 mois est passé de 59 %<br />
en 1983 à 96 % en 2002. Le nombre de hanches découvertes après<br />
un an était de 15 % en 1983 et de 6 % en 2002.<br />
DISCUSSION. La gravité de la lésion n’est pas influencée ni<br />
par <strong>les</strong> facteurs de risques ni par la bilatéralité de la lésion. Le<br />
dépistage de la maladie est plus précoce, avec une augmentation de<br />
37 % du pourcentage de diagnostics fait avant l’âge de quatre<br />
mois, grâce à un meilleur examen systématique dès la naissance et<br />
à l’échographie introduite progressivement depuis 1989.<br />
CONCLUSION. Une cartographie de la région tenant compte<br />
de la répartition pédiatre/maternité/généraliste est un support<br />
essentiel à toute campagne de dépistage. Malgré tout, 40 % <strong>des</strong><br />
enfants ne présentent aucun facteur de risque et sont pourtant<br />
susceptib<strong>les</strong> d’être porteurs de maladie luxante. Ainsi, l’examen<br />
répété, une communication et une information efficaces entre <strong>les</strong><br />
différents acteurs médicaux, sont <strong>les</strong> clés du succès.<br />
*M. Bertrand, Service de Chirurgie Orthopédique Pédiatrique,<br />
CHU Lapeyronie, route de Ganges, 34000 Montpellier.
68 La butée ostéoplastique dans<br />
l’ostéochondrite primitive de la hanche<br />
L. VILLET*, J.-M. LAVILLE<br />
INTRODUCTION. Le but de cette étude est de mettre en évidence<br />
l’intérêt du traitement de l’ostéochondrite primitive de hanche<br />
par butée ostéoplastique.<br />
MATÉRIEL. Dix-huit enfants ont été opérés de 1992 à 2001.<br />
L’âge moyen au diagnostic était de 7 ans 2 mois, et à l’intervention<br />
de 8 ans 5 mois (5-13 ans). En préopératoire, la limitation<br />
moyenne de la mobilité était de -25 en abduction et en rotation<br />
interne. Radiologiquement, on retrouvait : 2 Catterall II Herring B<br />
avec <strong>des</strong> signes de tête à risque, 7 III B, 1 III C, 1 IV B, 2 IV C et 2<br />
au stade de séquelle. L’excentration moyenne était de 6,5 mm et le<br />
débord externe moyen de 10,2 mm.<br />
MÉTHODE. L’indication opératoire a été posée devant l’aggravation<br />
de l’excentration au stade de revascularisation. Un greffon<br />
iliaque était encastré dans un rail sus limbique et recouvert du<br />
tendon du rectus femoris, laissé en continuité, qui faisait office de<br />
maintien élastique. Un bermuda plâtre a assuré <strong>les</strong> suites 17 fois,<br />
avec appui immédiat dans 11 cas. L’hospitalisation a été de 36<br />
heures dans tous <strong>les</strong> cas.<br />
RÉSULTATS. 16 enfants ont été revus au recul moyen de 3 ans<br />
2 mois. Aucune complication n’était à déplorer. Cliniquement, on<br />
ne retrouvait aucune douleur, mais 3 boiteries persistantes, 10<br />
limitations modérées de la mobilité, et 3 raideurs sévères. L’analyse<br />
radiologique objectivait 15 fois une bonne couverture de la<br />
tête, et 15 fois une congruence articulaire, dont 11 fois avec caractère<br />
concentrique. L’intervention a été jugée utile 12 fois, inutile 1<br />
fois après lyse complète d’un greffon mal positionné, et d’utilité<br />
incertaine 3 fois dont 2 fois dans <strong>les</strong> 2 cas vus au stade de séquelle.<br />
DISCUSSION. Les ostéotomies de varisation fémorale et <strong>les</strong><br />
ostéotomies pelviennes de réorientation ou d’agrandissement du<br />
cotyle sont efficaces, mais présentent de nombreux désavantages<br />
(limitation de l’amplitude d’abduction, inégalité de longueur,<br />
intervention pour ablation de matériel). L’excellente intégration<br />
de la butée à moyen terme traduit son efficacité dans l’adaptation<br />
tête-cotyle, avec <strong>des</strong> résultats radio-cliniques comparab<strong>les</strong> aux<br />
autres techniques. La raideur et la boiterie postopératoire sont<br />
l’apanage <strong>des</strong> formes très sévères dont le pronostic articulaire<br />
dépend de la maladie.<br />
CONCLUSION. Dans cette série de patients n’ayant pas tous<br />
atteint leur maturité, la butée répond aux exigences de la prise en<br />
charge <strong>des</strong> OPH en voie d’excentration et en début de revascularisation,<br />
au prix d’un traitement court, peu contraignant et sans<br />
complication.<br />
*L. Villet, Service de Chirurgie Infantile, CHD Félix-Guyon,<br />
97405 Saint-Denis, île de la Réunion.<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S53<br />
69 La main de l’enfant dans la maladie<br />
d’Ollier<br />
D. MOUKOKO*, M. EZAKI, P.CARTER,<br />
A. DIMÉGLIO<br />
INTRODUCTION. La main représente la localisation la plus<br />
fréquente dans la maladie d’Ollier. Cependant, très peu de travaux<br />
lui ont été consacrés. Une seule série est publiée ainsi que quelques<br />
étu<strong>des</strong> de cas. Le traitement <strong>des</strong> enchondromes multip<strong>les</strong> est occasionnellement<br />
discuté en même temps que celui <strong>des</strong> enchondromes<br />
solitaires. Cependant, leur comportement récidivant et agressif<br />
<strong>les</strong> distingue catégoriquement <strong>des</strong> enchondromes solitaires, et<br />
justifie une approche spécifique.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Nous présentons une étude<br />
rétrospective de 22 enfants pour enchondromatose multiple de la<br />
main. Onze d’entre eux présentaient une atteinte unilatéra<strong>les</strong>, <strong>les</strong><br />
autres, bilatérale. Ainsi sur 33 mains, nous avons identifié 246<br />
enchondromes. Quatorze patients sont suivis jusqu’à maturité<br />
squelettique. Une patiente, présentant un syndrome de Maffucci,<br />
est décédée à l’âge de six ans d’une dégénérescence angiosarcomateuse<br />
de la jambe.<br />
RÉSULTAT. Lors du diagnostic, l’âge moyen est de 6 ans 9<br />
mois. Les douleurs et <strong>les</strong> fractures pathologiques sont rares, rencontrées<br />
chez trois patients. La fonction globale de la main reste<br />
satisfaisante. Nous avons opéré 14 patients (âge moyen de 8 ans 8<br />
mois) pour une augmentation symptomatique du volume tumoral.<br />
Cinq patients ont nécessité deux interventions, un patient a été<br />
réopéré une troisième fois, totalisant 18 interventions sur 37 os de<br />
la main (51 gestes chirurgicaux). Un simple curetage a été réalisé<br />
dans 21 cas, associé à une greffe autologue spongieuse dans <strong>les</strong><br />
trente autres. Un doigt a été amputé pour récidive agressive. Les<br />
lésions résiduel<strong>les</strong> radios transparentes ont été retrouvées dans 62<br />
% <strong>des</strong> cas, à un suivi minimum de 19 mois.<br />
DISCUSSION. Dans notre étude, la fonction de la main reste<br />
satisfaisante en dépit d’un aspect radiologique toujours inquiétant.<br />
L’indication opératoire était portée essentiellement sur l’aspect<br />
inesthétique de la main. Le but était d’obtenir une réduction du<br />
volume tumoral. De multip<strong>les</strong> traitements chirurgicaux sont proposés<br />
dans la littérature. Dans notre expérience, l’éradication de la<br />
lésion traitée est difficile à obtenir, plus fréquente cependant, après<br />
greffe qu’après simple curetage.<br />
CONCLUSION. En cours de croissance, la fonction reste<br />
bonne, <strong>les</strong> fractures sont exceptionnel<strong>les</strong>. En fin de croissance <strong>les</strong><br />
lésions se stabilisent. Nous n’avons observé aucune dégénérescence<br />
chondrosarcomateuse dans cette série, composée de jeunes<br />
patients. Cependant, en vieillissant, le risque de dégénérescence<br />
maligne existe et doit être suspecté devant l’apparition de douleurs,<br />
une augmentation de volume tumoral ou la survenue d’une<br />
fracture pathologique.<br />
*D. Moukoko, Service d’Orthopédie Pédiatrique,<br />
CHU Lapeyronie, 191, avenue Doyen-Gaston-Giraud,<br />
34295 Montpellier.
3S54 78 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
70 L’instabilité C1-C2 chez le trisomique<br />
21<br />
I. GHANEM*, J. CHALOUHI, K.KHARRAT,<br />
F. DAGHER<br />
INTRODUCTION. La laxité ligamentaire est un élément principal<br />
de la trisomie 21, incriminée dans la plupart <strong>des</strong> manifestations<br />
orthopédiques de cette anomalie. La reconnaissance et la<br />
prise en charge précoces de ces problèmes sont essentiels. L’instabilité<br />
C1-C2 est connue chez ces patients et s’associe, du moins<br />
théoriquement, à un risque non négligeable de complications neurologiques<br />
médullaires. Le but de cette étude est de faire une<br />
analyse <strong>des</strong>criptive de l’articulation C1-C2 chez le trisomique 21,<br />
d’analyser <strong>les</strong> facteurs liés à son instabilité, et de déterminer la<br />
limite de tolérance de la distance C1-C2.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Dans le cadre d’une enquête<br />
épidémiologique sur la trisomie 21 entreprise à l’échelle nationale,<br />
nous nous sommes particulièrement intéressés à l’articulation<br />
C1-C2. Un total de 472 trisomiques ont été retrouvés mais 458<br />
uniquement ont été examinés et font l’objet de cette étude. Un<br />
interrogatoire exhaustif, ainsi qu’un examen physique détaillé<br />
comportant un bilan neurologique (à la recherche <strong>des</strong> signes neurologiques<br />
<strong>les</strong> plus frustes), une évaluation du profil de laxité selon<br />
Carter et Wilkinson et une recherche d’autres problèmes orthopédiques<br />
ont été effectués par un même examinateur spécialisé. Les<br />
patients ont été répartis en deux groupes selon la présence ou<br />
l’absence de signes neurologiques, et en deux groupes selon qu’ils<br />
présentent ou non une laxité généralisée selon la définition de<br />
Carter et Wilkinson. Des radiographies de profil centrées sur<br />
C1-C2 ont été pratiquées par le même technicien et à l’aide de la<br />
même machine, pour chaque individu en position neutre, hyperflexion<br />
et hyperextension, selon la même technique de prise de<br />
radiographie inspirée de celle de Singer et al. et modifiée pour la<br />
rendre plus pratique. L’interprétation <strong>des</strong> radiographies a été faite<br />
par un même observateur en simple aveugle et a comporté la<br />
recherche de malformations congénita<strong>les</strong> et d’altérations dégénératives,<br />
la mesure de la distance C1-C2, du diamètre sagittal minimal<br />
(DSM), et de l’angle C1-C2 (non existant dans la littérature et<br />
décrit pour cette étude). Les différentes mesures ont été ensuite<br />
comparées aux données de la littérature quand el<strong>les</strong> étaient disponib<strong>les</strong>,<br />
et corrélées avec l’âge, le sexe, la présence de signes neurologiques,<br />
et le profil de laxité. Sept patients ont été exclus de<br />
l’étude pour manque de coopération à la prise de radiographies, et<br />
9 pour données cliniques ou radiologiques incomplètes. Une analyse<br />
statistique a été effectuée sur <strong>les</strong> 442 patients inclus, utilisant<br />
le test de Pearson pour la comparaison <strong>des</strong> variab<strong>les</strong> quantitatives<br />
entre el<strong>les</strong>, et la méthodeANOVA paramétrique pour la corrélation<br />
<strong>des</strong> variab<strong>les</strong> quantitatives et qualitatives avec un coefficient de<br />
signification pour p < 0,05.<br />
RÉSULTATS. L’âge moyen <strong>des</strong> patients était de 13,8 ans, avec<br />
184 F et 258 M. Des anomalies neurologiques minimes ont été<br />
retrouvées chez 42 % <strong>des</strong> patients sans aucun déficit majeur. Une<br />
laxité généralisée telle que définie par Carter et Wilkinson a été<br />
observée dans 24 % <strong>des</strong> cas. D’autres problèmes orthopédiques<br />
essentiellement aux pieds ont été retrouvés dans 85 % <strong>des</strong> cas. Une<br />
grande marge de valeurs radiologiques a été retrouvée, ce qui nous<br />
a amené à ne pas présenter <strong>des</strong> moyennes. Trente quatre patients<br />
avaient une distance C1-C2 > 4 mm sur <strong>les</strong> radiographies en<br />
flexion (limite établie dans la littérature pour parler d’instabilité<br />
chez le trisomique 21). La distance C1-C2 maximale était de 8 mm<br />
en position neutre et 9,6 mm en flexion ; la valeur la plus basse du<br />
DSM retrouvée était de 8 mm en flexion et de 10 mm en position<br />
neutre (14 mm étant la limite inférieure rapportée dans la littérature<br />
avant de parler de menace pour la moelle épinière). La plus<br />
grande variabilité a été retrouvée pour l’angle C1-C2. La laxité<br />
ligamentaire et la distance atlanto-axiale est inversement proportionnelle<br />
à l’âge du patient. Il n’y a cependant aucune corrélation<br />
significative entre l’instabilité atlanto-axiale (distance C1-C2 > 4<br />
mm) d’une part, et le sexe ou l’hyperlaxité généralisée d’autre<br />
part. Il n’existe pas de corrélation significative entre l’instabilité<br />
C1-C2 ou la laxité d’une part et la symptomatologie neurologique<br />
d’autre part.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. Comparé aux étu<strong>des</strong> déjà<br />
publiées sur le sujet, ce travail présente l’avantage de comporter un<br />
nombre non négligeable de patients, d’apporter <strong>des</strong> données épidémiologiques<br />
sur la maladie, et d’utiliser une méthode de standardisation<br />
<strong>des</strong> mesures radiographiques. En effet, la plus vaste<br />
majorité <strong>des</strong> valeurs radiologiques rapportées dans la littérature ne<br />
tiennent pas compte du facteur d’agrandissement ni de la variabilité<br />
de positionnement radiologiques entre un patient et un autre.<br />
Les résultats de cette étude confirment certaines données de la<br />
littérature, amènent quelques éléments nouveaux, et pousse à<br />
réfléchir sur certaines hypothèses pathogéniques de l’instabilité<br />
C1-C2 chez le trisomique 21 et de ses complications neurologiques.<br />
Les deux éléments forts de ce travail, sont l’absence de<br />
corrélation entre la laxité généralisée et l’instabilité C1-C2, et<br />
l’absence de corrélation entre l’instabilité C1-C2 et la présence de<br />
signes neurologiques.<br />
*I. Ghanem, Hôpital Hôtel-Dieu de France,<br />
boulevard Alfred Naccache, Achrafieh, Beyrouth, Liban.<br />
71 Monitoring radiculaire lors du traitement<br />
chirurgical <strong>des</strong> déformations<br />
rachidiennes : prévention <strong>des</strong> déficits<br />
neurologiques radiculaires<br />
B. DOHIN*, P. FILIPETTI, P.VERNET<br />
INTRODUCTION. Le risque de lésions radiculaires durant <strong>les</strong><br />
instrumentations rachidiennes pour déviations vertébra<strong>les</strong> est<br />
connu et sa fréquence évaluée à 50 % <strong>des</strong> complications neurologiques<br />
de cette chirurgie. Nous décrivons une technique de monitoring<br />
<strong>des</strong> racines nerveuses durant cette chirurgie. Le monitoring<br />
radiculaire a été décrit par Hormes en 1993.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Nous rapportons une étude<br />
rétrospective de 73 interventions pour déformation vertébrale<br />
durant <strong>les</strong>quel<strong>les</strong> un monitoring <strong>des</strong> racines nerveuses a été réalisé.<br />
Il s’agit de 27 hommes et 46 femmes, d’âge moyen 23,9 ans, entre<br />
4,5 et 74,9 ans. 40 patients étaient âgés de moins de 18 ans. Les<br />
interventions étaient 65 arthrodèses postérieures et 8 antérieures.<br />
Les indications étaient : 32 scolioses idiopathiques, 21 scolioses<br />
neurologiques, 4 scolioses congénita<strong>les</strong>, 2 spondylolisthésis et 3<br />
cyphoses. 68 patients ont été inclus dans l’étude chez <strong>les</strong>quels un<br />
enregistrement a pu être réalisé avec toutes <strong>les</strong> conditions requises.<br />
163 racines ont été explorées. La procédure de routine effectue une
surveillance permanente électrophysiologique de l’activité musculaire<br />
avec un électromyogramme multi canal. Nous utilisons<br />
comme électrode <strong>des</strong> micros fils implantés au niveau <strong>des</strong> musc<strong>les</strong>.<br />
Le choix <strong>des</strong> musc<strong>les</strong> cib<strong>les</strong> est décidé en collaboration entre le<br />
chirurgien et le neurophysiologiste. Les musc<strong>les</strong> cib<strong>les</strong> sont déterminés<br />
par le positionnement <strong>des</strong> implants, et en fonction de la<br />
topographie <strong>des</strong> racines susceptib<strong>les</strong> d’être mises en danger pendant<br />
le geste chirurgical ou l’instrumentation. Les racines explorées<br />
étaient 9 fois D12, 24 fois L1, 40 fois L2, 24 fois L3, 33 fois<br />
L4, 11 fois L5 et 22 fois S1. Cette technique de monitoring ne<br />
permet pas l’utilisation de curare durant l’anesthésie.<br />
RÉSULTATS. Avant l’utilisation du monitoring radiculaire, <strong>les</strong><br />
auteurs avaient recensé deux lésions radiculaires (D12 et L3) résolutives<br />
(n = 139). Durant l’étude <strong>des</strong> modifications du signal radiculaire<br />
ont été constatées chez 7 patients. Toutes <strong>les</strong> anomalies de<br />
signal ont motivé une modification du geste chirurgical et aucun<br />
déficit post-opératoire n’a pu être détecté. Les incidents constatés<br />
concernent 2 scolioses congénita<strong>les</strong>, 2 scolioses neurologiques et<br />
3 scolioses idiopathiques. Les racines concernées étaient 1 fois L1,<br />
4 fois L2, 2 fois L3 et 4 fois L4 ; soit 11/163.<br />
DISCUSSION. La surveillance per-opératoire continue <strong>des</strong><br />
racines exposées lors de la chirurgie <strong>des</strong> déviations vertébra<strong>les</strong> a<br />
permis aux auteurs de prévenir 11 complications radiculaires sur<br />
163 enregistrements. Cette surveillance permanente permet<br />
d’adapter immédiatement le geste chirurgical et de contrôler un<br />
éventuel conflit entre l’instrumentation et <strong>les</strong> racines, et un éventuel<br />
étirement radiculaire lors de la réduction <strong>des</strong> déviations vertébra<strong>les</strong>.<br />
Cette technique nécessite une surveillance permanente<br />
durant l’intervention pour éviter <strong>les</strong> faux négatifs, et ne permet pas<br />
l’utilisation <strong>des</strong> curares.<br />
CONCLUSION. Le monitoring radiculaire peropératoire est<br />
une technique efficace de prévention <strong>des</strong> complications radiculaires<br />
dans ce type de chirurgie. Cette technique est sensible et permet<br />
une adaptation immédiate du geste chirurgical. Elle nécessite une<br />
collaboration étroite entre le neurophysiologiste, le chirurgien et<br />
l’anesthésiste.<br />
*B. Dohin, Service de Chirurgie Pédiatrique, Pavillon T bis,<br />
Hôpital Edouard-Herriot, 69437 Lyon Cedex 03.<br />
72 Traitement <strong>des</strong> scolioses neuromusculaires<br />
par tiges souscutanées<br />
sans greffe<br />
P. LASCOMBES*, J.-D. METAIZEAU, G.NAVEZ,<br />
T. HAUMONT, P.JOURNEAU<br />
INTRODUCTION. C’est à John Moe que l’on doit, en 1978, la<br />
<strong>des</strong>cription de l’instrumentation de Harrington sans greffe vertébrale<br />
associée à un corset dans le traitement <strong>des</strong> scolioses sévères<br />
<strong>des</strong> jeunes enfants. En 1989, Jean Dubousset décrivait le phénomène<br />
vilebrequin dans <strong>les</strong> scolioses qui avaient subi une greffe<br />
vertébrale postérieure isolée alors que la croissance n’était pas<br />
achevée. Ainsi, face à une scoliose évolutive grave devenue inaccessible<br />
au traitement orthopédique chez un jeune enfant, plusieurs<br />
options doivent être discutées : une tige sous-cutanée sans<br />
greffe et ses allongements répétés, une épiphysiodèse arthrodèse<br />
antérieure, l’association <strong>des</strong> deux métho<strong>des</strong>...<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S55<br />
Le but de ce travail rétrospectif est de faire le point sur le seul<br />
abord postérieur avec une tige sous cutanée sans greffe, régulièrement<br />
allongée.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Durant <strong>les</strong> dix dernières années,<br />
14 scolioses ont ainsi été prises en charge : 10 amyotrophies spina<strong>les</strong><br />
infanti<strong>les</strong>, 3 IMOC et 1 congénitale ; âge moyen lors de la<br />
première intervention 8,6 ans, angle de Cobb préopératoire moyen<br />
72,5° (45-105). Dès le 3 e cas traité, le traitement fut uniforme :<br />
prise vertébrale par trois crochets en thoracique proximal montés<br />
sur une tige, pince distale lombaire par deux crochets L4-L5 montés<br />
sur une deuxième tige. Les deux tiges sous-cutanées sont<br />
reliées par un domino et <strong>les</strong> zones de fixation vertébrale sont<br />
greffées. Le premier allongement est préconisé vers le 6 e mois puis<br />
un allongement a lieu tous <strong>les</strong> ans jusqu’aux alentours de Risser 2<br />
pour envisager l’arthrodèse vertébrale.<br />
RÉSULTATS. La correction de la première intervention ramène<br />
la courbure à un angle moyen de 43,7° (28-70). Le nombre moyen<br />
<strong>des</strong> allongements avant arthrodèse définitive a été de 4. Chaque<br />
allongement de la tige a permis d’obtenir un gain de correction<br />
d’environ 16,4° (4-31) grâce à un allongement moyen de 13,7 mm<br />
(10-20). Les complications mécaniques (un arrachage <strong>des</strong> crochets<br />
proximaux, une ruptures de tige) n’ont été observées que<br />
dans la première observation, ce qui a permis de définir ultérieurement<br />
la technique présentée.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. L’absence de complication<br />
mécanique dans la méthode décrite et la qualité <strong>des</strong> résultats<br />
nous incitent à poursuivre ce traitement, évitant l’abord antérieur<br />
dans certains cas où la fonction respiratoire est précaire. L’inconvénient<br />
<strong>des</strong> réinterventions annuel<strong>les</strong> risque d’être supprimé grâce<br />
à l’utilisations <strong>des</strong> tiges Phenix & #61666 ; à allongement automatique<br />
dont nous présentons en conclusion nos deux premières<br />
observations.<br />
*P. Lascombes, Service de Chirurgie Infantile A, CHU Brabois<br />
Hôpital d’Enfants, rue du Morvan,<br />
54500 Vandoeuvre-<strong>les</strong>-Nancy.<br />
73 Avantages de la double fixation du<br />
rachis de l’IMOC opéré tardivement<br />
B. LONGIS*, P. PEYROU, D.MOULIÈS<br />
INTRODUCTION. Le but de ce travail est de comparer <strong>les</strong><br />
résultats d’une arthrodèse postérieure simple à ceux d’une double<br />
arthrodèse (antérieure et postérieure) dans le traitement de la scoliose<br />
de l’IMOC.<br />
MATÉRIEL. Trente-trois dossiers de scolioses chez <strong>des</strong> infirmes<br />
moteurs âgés en moyenne de 16 ans ont été revus. Vingt et un<br />
enfants ont subi une arthrodèse postérieure et 12 ont eu une double<br />
voie d’abord. Les étiologies de l’infirmité motrice sont très classiques.<br />
Les scolioses arthrodésées par simple voie postérieure sont<br />
<strong>des</strong> scolioses plus modérées (angle de Cobb compris entre 50 et<br />
80), réductible de 31 % au bending test. Les scolioses ayant eu une<br />
double arthrodèse sont graves (angle de Cobb supérieur à 80°),<br />
réductib<strong>les</strong> de 18 %. La technique opératoire est classique : matériel<br />
de Cotrel Dubousset en arrière, libération simple ou synthèse<br />
par tige de type Colorado en avant. La voie d’abord pour <strong>les</strong>
3S56 78 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
arthrodèses antérieures est une thoraco-phréno-laparotomie (6<br />
cas), une thoracoscopie (3 cas). Le temps postérieur dans <strong>les</strong><br />
arthrodèses mixtes s’est déroulé le même jour 11 fois sur 12.<br />
RÉSULTATS. La durée d’intervention <strong>des</strong> arthrodèses mixtes<br />
est le double de celle <strong>des</strong> arthrodèses postérieures. Il n’y a pas de<br />
différence significative dans le volume de saignement entre <strong>les</strong> 2<br />
techniques. Les complications sont plus fréquentes dans <strong>les</strong><br />
arthrodèses mixtes mais n’ont jamais entraîné de décès. (un décès<br />
par insuffisance respiratoire après une arthrodèse postérieure).<br />
Toutes <strong>les</strong> arthrodèses mixtes ont eu un séjour en réanimation de<br />
6.5 jours (2,5 à 21 jours) Seuls 6 enfants sur 21 ont séjournés 7<br />
jours en moyenne en réanimation dans <strong>les</strong> arthrodèses postérieures<br />
(2 à 15 jours). Il n’y a pas de différence significative dans la durée<br />
d’hospitalisation (18 jours en moyenne). Le gain est meilleur dans<br />
<strong>les</strong> double arthrodèses que dans <strong>les</strong> arthrodèses postérieures simp<strong>les</strong><br />
(62 % versus 52 %).<br />
CONCLUSION. La double arthrodèse chez l’infirme moteur<br />
cérébral vu tardivement est une intervention lourde, ayant une<br />
morbidité importante mais tolérable, surtout si l’angle de la scoliose<br />
est supérieur à 80°. Elle permet cependant une bonne réduction<br />
et assure la qualité de l’arthrodèse. Compte tenu <strong>des</strong> moyens<br />
actuels de réduction et de fixation, l’arthrodèse postérieure isolée<br />
garde son indication chez l’enfant plus jeune à courbure réductible.<br />
*B. Longis, Service de Chirurgie Pédiatrique,<br />
CHRU Dupuytren, 2, avenue Martin-Luther-King,<br />
87042 Limoges Cedex.<br />
74 Résultat à maturité squelettique du<br />
traitement chirurgical <strong>des</strong> hémivertèbres<br />
: à propos de 21 cas<br />
C. CADILHAC*, C. GLORION, M.TRIGUI,<br />
G. LAVELLE, J.-P. PADOVANI<br />
INTRODUCTION. Nous avons revu <strong>les</strong> dossiers de patients<br />
opérés, avant la période pré-pubertaire d’une scoliose ou d’une<br />
cyphoscoliose évolutive liée à une hémivertèbre. Les buts de notre<br />
travail étaient d’évaluer la technique chirurgicale utilisée, et<br />
d’apprécier la statique rachidienne et le résultat fonctionnel en fin<br />
de croissance.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. L’étude rétrospective porte sur<br />
21 dossiers d’enfants opérés avant l’âge de 10 ans, suivis jusqu’à la<br />
fin de la croissance. Ont été exclus de la révision <strong>les</strong> enfants présentant<br />
un syndrome poly-malformatif ou <strong>des</strong> malformations vertébra<strong>les</strong><br />
multip<strong>les</strong>. Le type et la localisation de l’hémivertèbre ont<br />
été précisés. La gibbosité, le déséquilibre transversal et <strong>les</strong> valeurs<br />
angulaires radiographiques <strong>des</strong> déviations ont été appréciés en<br />
préopératoire. Les éléments de l’indication chirurgicale, le type<br />
d’intervention et <strong>les</strong> complications ont également été colligés. Au<br />
cours de la croissance, l’évolution, <strong>les</strong> éventuels traitements complémentaires<br />
ou reprises chirurgica<strong>les</strong> ont été précisés. Au dernier<br />
recul le résultat fonctionnel et esthétique a été apprécié, <strong>les</strong> ang<strong>les</strong><br />
de déviation rachidienne ont été mesurés et comparés aux ang<strong>les</strong><br />
préopératoires.<br />
RÉSULTATS. Vingt et un enfants (13 F, 8 G) d’âge moyen 3 ans<br />
10 mois (10 mois-10 ans) répondaient aux critères d’inclusion.<br />
L’hémivertèbre était thoracique 9 fois, thoraco-lombaire 4 fois,<br />
lombaire 4 fois et lombo-sacrée 4 fois. L’indication chirurgicale a<br />
été posée sur une dégradation clinique et radiographique. Les<br />
procédures chirurgica<strong>les</strong> ont été multip<strong>les</strong>, arthrodèse sans exérèse<br />
pour <strong>les</strong> vertèbres thoraciques et exérèse associée à une arthrodèse<br />
ou une épiphysiodèse pour <strong>les</strong> autres localisations. Cinq complications<br />
ont été rapportées, 2 neurologiques, 2 infectieuses et un<br />
démontage. L’évolutivité clinique et radiographique a conduit à<br />
une reprise chirurgicale chez 10 enfants et 2 doivent être réopérés.<br />
Au recul moyen de 14 ans (9 ans-23 ans), le résultat fonctionnel<br />
était bon 19 fois, mauvais une fois dans le cas d’une hémivertèbre<br />
lombo-sacrée et une fois au niveau thoracique. Le résultat esthétique<br />
était bon 16 fois. Cinq <strong>des</strong> 9 patients porteurs d’une hémivertèbre<br />
thoracique restent insatisfaits. Enfin la correction moyenne<br />
<strong>des</strong> courbures a varié entre 26 % à l’étage thoracique, 50 % en<br />
lombo-sacré et thoraco-lombaire, et 75 % en lombaire.<br />
DISCUSSION. L’originalité de ce travail est son important<br />
recul. Le traitement de la déviation rachidienne malformative,<br />
évolutive, est difficile. La chirurgie précoce ne garantit pas un<br />
résultat définitif, dans 50 % <strong>des</strong> cas en effet, une réintervention en<br />
fin de croissance a été nécessaire. Elle laisse cependant espérer à<br />
terme, un bon résultat fonctionnel et esthétique, surtout si une<br />
hémivertébrectomie a pu être réalisée.<br />
*C. Cadilhac, Service d’Orthopédie,<br />
Hôpital Necker Enfants-Mala<strong>des</strong>,<br />
149, rue de Sèvres, 75015 Paris.
75 Allongement <strong>des</strong> membres en<br />
milieu africain : revue préliminaire<br />
de 11 cas d’allongement du fémur<br />
et du tibia<br />
F. IBRAHIMA*, C. PISOH-TAGNYI,<br />
S. ETOM-EMPIMÉ, L.ABOLO-MBENTI,<br />
M.-A. SOSSO, E.EIMO-MALONGA<br />
INTRODUCTION. Ces dernières années, l’allongement <strong>des</strong><br />
membres suscite un grand intérêt partout en Occident. Paradoxalement,<br />
enAfrique, où <strong>les</strong> indications d’allongement <strong>des</strong> membres<br />
sont nombreuses (malformations congénita<strong>les</strong> ou acquises), la<br />
pratique d’allongement <strong>des</strong> membres est peu répandue. Il nous a<br />
paru intéressant de revoir <strong>les</strong> premiers cas d’allongement <strong>des</strong><br />
membres effectués depuis 5 ans chez nous afin d’en tirer <strong>les</strong> premières<br />
leçons.<br />
MATÉRIEL. C’étaient 5 mala<strong>des</strong> de sexe masculin et 5 mala<strong>des</strong><br />
de sexe féminin dont l’âge moyen était de 16,3 ans (extrêmes allant<br />
de 5 ans à 28 ans), traités pour inégalités de longueur devenues<br />
douloureuses, gênantes, et handicapantes à rattraper (8 cas) ou<br />
pour <strong>des</strong> pertes de substances osseuses à combler (3 cas).<br />
MÉTHODES. Les indications d’allongement sont posées après<br />
un interrogatoire, un examen clinique et radiologique (notamment<br />
une télémétrie <strong>des</strong> membres inférieurs afin de chiffrer l’inégalité<br />
ou la perte de substance à combler, de diagnostiquer <strong>les</strong> autres<br />
anomalies associées). La technique d’allongement est la technique<br />
classique : pose du fixateur externe, ostéotomie, allongement progressif<br />
de 1 mm/jour après un temps de latence).<br />
RÉSULTATS. L’inégalité ou la perte de substance moyenne<br />
rattrapée était de 7,8 cm (extrêmes allant de 3 cm à 16 cm). La<br />
durée moyenne du port du fixateur externe était de 207,9 jours (de<br />
60 à 294 jours). L’index de consolidation de consolidation de De<br />
Bastiani était de 24 jours/cm. Neuf complications ont été rapportées<br />
dont un échec thérapeutique ayant obligé à une amputation.<br />
DISCUSSION. Les boîteries dues aux inégalités de longueur<br />
congénita<strong>les</strong> ou acquises sont très fréquentes chez nous. Ces inégalités<br />
vues tardivement sont très importantes (la moyenne de<br />
notre série étant supérieure aux moyennes <strong>des</strong> séries de référence<br />
de la littérature) et el<strong>les</strong> étaient associées à de multip<strong>les</strong> anomalies<br />
qui alourdissent d’autant leur prise en charge thérapeutique (temps<br />
prolongé de port du fixateur externe). Le comblement de perte de<br />
substances osseuses par allongement est une alternative cependant<br />
très séduisante aux nombreuses amputations qui sont réalisées<br />
chaque jour en Afrique.<br />
CONCLUSION. L’allongement <strong>des</strong> membres comporte encore<br />
beaucoup d’écueils dans notre pratique en milieu africain. Mais<br />
cela ne devrait pas nous faire reculer bien au contraire cela devrait<br />
nous stimuler car la demande est aussi grande que le bénéfice<br />
qu’en tirent <strong>les</strong> mala<strong>des</strong>.<br />
*F. Ibrahima, CNRH de Yaoundé,<br />
BP 1586, Yaoundé, Cameroun.<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S57<br />
Séance du 11 novembre après-midi<br />
TRAUMATOLOGIE<br />
57<br />
76 Les allongements bilatéraux simultanés<br />
<strong>des</strong> jambes pour <strong>des</strong> raisons<br />
esthétiques<br />
R. CATTANEO*, M. CATAGNI, L.LOVISETTI<br />
INTRODUCTION. La chirurgie a offert une aide remarquable<br />
pour la modification du physique <strong>des</strong> personnes selon <strong>les</strong> canons<br />
esthétiques. La taille est un élément qualifiant pour chaque individu.<br />
Les personnes courtes de stature sont parfois perçues par la<br />
société comme <strong>des</strong> personnes différentes. Voilà pourquoi <strong>les</strong><br />
deman<strong>des</strong> d’allongements <strong>des</strong> membres en vue d’améliorer<br />
l’aspect sont devenues plus fréquentes. Nous désirons, sur la base<br />
de notre expérienceprouver que cela est possible et utile.<br />
MATÉRIEL. De 1985 à 2000, nous avons opéré 54 sujets (32<br />
hommes et 22 femmes), évalués avec recul moyen de 5 ans et 3<br />
mois (16 ans-1 an). Parmi ces cas, nous avons trouvé une justification<br />
valable à leur demande d’accroissement de taille, alors que<br />
82 cas ont été refusés. L’âge moyen était de 25,8 ans (extrêmes de<br />
18 à 47 ans) (28,1 ans pour <strong>les</strong> hommes et 23,6 ans pour <strong>les</strong><br />
femmes). La taille moyenne était de 153 cm (159 cm pour <strong>les</strong><br />
hommes et 147 cm pour <strong>les</strong> femmes).<br />
MÉTHODES. Encadrement psychologique du patient. Nous<br />
exécutons l’allongement simultané bilatéral <strong>des</strong> jambes parce<br />
qu’il est beaucoup mieux toléré par rapport aux fémurs. L’appareil<br />
standard est constitué par 3 anneaux et un demi-anneau proximal.<br />
L’allongement est sur deux niveaux par double ostéotomie, une<br />
tibiale métaphysaire proximale et un distale métaphysaire. Sept<br />
jours après (ostéotomie par trépan) et douze jours après (ostéotomie<br />
par scie de Gigli), nous commençons l’allongement d’1/4 de<br />
tour (1/4 de mm) 3 fois par jour. En 19 cas, nous avons exécuté<br />
l’allongement du tendon d’Achille. En 3 cas (4 jambes), ilyaeuun<br />
affaissement du régénérat, nous avons donc placé l’appareil de<br />
nouveau.<br />
RÉSULTATS. L’allongement moyen a été de 7 cm (11-5 cm).<br />
Durée moyenne du traitement : 8 mois et 10 jours. Les résultats<br />
esthétiques ont été considérés excellents par <strong>les</strong> sujets opérés dans<br />
92 % <strong>des</strong> cas et bons dans 8 %.<br />
DISCUSSION. Le choix du patient doit être soutenu par une<br />
grande motivation de sa part et par la conscience de possib<strong>les</strong><br />
risques (consentement éclairé détaillé). L’allongement <strong>des</strong> jambes<br />
au moyen de l’appareil circulaire permet la correction de mo<strong>des</strong>tes<br />
difformités axia<strong>les</strong> associées.<br />
CONCLUSION. En cas sélectionnés ayant une justification<br />
psychologique valable et taille objectivement inférieure à la<br />
moyenne de la population d’appartenance, <strong>les</strong> allongements esthétiques<br />
<strong>des</strong> jambes peuvent être réalisés avec <strong>des</strong> risques raisonnab<strong>les</strong><br />
et <strong>des</strong> résultats satisfaisants.<br />
*R. Cattaneo, 73, Via Cavour, Lecco, Italie.
3S58 78 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
77 Traitement par enclouage centromédullaire<br />
<strong>des</strong> fractures huméra<strong>les</strong><br />
par clou Targon (AesculapT) : résultats<br />
préliminaires à propos de 45<br />
cas<br />
M. EHLINGER*, X. CHIFFOLOT, J.-M. COGNET,<br />
Y. LE CONIAT, E.DAGHER, P.SIMON<br />
INTRODUCTION. Les auteurs rapportent <strong>les</strong> résultats préliminaires<br />
du traitement <strong>des</strong> fractures huméra<strong>les</strong> par enclouage centromédullaire<br />
type clou Targon (Aesculapt).<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Quarante-cinq patients à majorité<br />
féminine, ont été opérés entre juin 2001 et juin 2002. La<br />
moyenne d’âge est de 63,5 ans, le côté droit dominant. La série<br />
comporte 28 fractures proxima<strong>les</strong> (65,9 ans) (14 à 3-4 fragments, 8<br />
à 2 fragments, 3 pathologiques, 3 métaphyso-diaphysaires), 17<br />
diaphysaires (59,5 ans) (4 pathologiques, 3 cures de pseudarthrose,<br />
10 traumatiques). L’intervention est réalisée en Beach position,<br />
membre fracturé libre, par un abord supéro-externe. Vingthuit<br />
clous Targon PH, dont 9 longs, ont été utilisés pour <strong>les</strong><br />
fractures proxima<strong>les</strong>, 17 clous Targon H pour <strong>les</strong> fractures diaphysaires.<br />
Le clou de diamètre 8 mm, est verrouillé par 4 vis proxima<strong>les</strong><br />
(5 mm) autostab<strong>les</strong> et par 2 vis dista<strong>les</strong> (3,5 mm). Les patients<br />
sont immobilisés par une attelle coude au corps, avec rééducation<br />
pendulaire immédiate puis active à la consolidation. La révision<br />
est faite par un contrôle radiologique et une évaluation clinique<br />
(score de Constant).<br />
RÉSULTATS. Le recul moyen est de 12,2 mois. Nous relevons 6<br />
décès et 5 perdus de vue. La consolidation est obtenue à 8 semaines<br />
en moyenne. La réduction fracturaire est acceptable 37 fois, dont 3<br />
ont nécessité un abord chirurgical. On déplore 9 complications<br />
post-opératoires dont 1 infection superficielle, 3 recul <strong>des</strong> vis dista<strong>les</strong>,<br />
1 fracture de vis distale, 1 rupture du clou). Le score de<br />
Constant moyen est de 69 (30-96).<br />
DISCUSSION. Les fractures huméra<strong>les</strong> proxima<strong>les</strong>, souvent<br />
comminutives et déplacées nous amènent à réaliser une arthroplastie<br />
céphalique. Celle-ci permet rarement une récupération fonctionnelle<br />
totale et pose, chez <strong>les</strong> sujets jeunes, le problème du<br />
devenir à moyen et long terme. Le quadruple verrouillage proximal<br />
stable, associé au bon remplissage du fût médullaire par le<br />
clou, permet d’obtenir la stabilisation du foyer de fracture et une<br />
tenue satisfaisante <strong>des</strong> tubérosités. Ce montage stable permet une<br />
rééducation précoce. Ces avantages sont d’autant plus intéressants<br />
dans <strong>les</strong> fractures diaphysaires que <strong>les</strong> patients sont plus jeunes.<br />
Cependant, ce matériel présente <strong>des</strong> limites par <strong>des</strong> vis dista<strong>les</strong><br />
fragi<strong>les</strong>, ayant prise moyenne et situées en regard du paquet circonflexe<br />
pour le clou Targon PH.<br />
CONCLUSION. Ces premiers résultats sont encourageants<br />
pour toutes <strong>les</strong> fractures huméra<strong>les</strong>, tant chez <strong>les</strong> personnes âgées<br />
que chez le sujet jeune. Ce type d’ostéosynthèse peut représenter<br />
une alternative à l’arthroplastie et permettre une rééducation précoce,<br />
gage d’une bonne récupération fonctionnelle.<br />
*M. Ehlinger, Département de Chirurgie Orthopédique et<br />
Traumatologique, CHU Hautepierre,<br />
avenue Molière, 67000 Strasbourg.<br />
78 Ostéosynthèse <strong>des</strong> fractures céphalo-tubérositaires<br />
: à propos d’une<br />
étude de cas<br />
S. HACINI*, R. BERTIN, B.MEGY,<br />
P. KOUYOUMDJIAN, A.BEN LASSOUED<br />
INTRODUCTION. Les fractures céphalo-tubérositaires (CT)<br />
sont <strong>des</strong> fractures complexes, de pronostic grave et leur traitement<br />
est controversé. Nous rapportons ici <strong>les</strong> résultats cliniques et<br />
radiologiques à long terme d’une série de 34 patients ostéosynthésés.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. La série comporte 34 patients<br />
opérés entre 1987 et 1997 dont 21 femmes et 13 hommes ayant un<br />
âge moyen de 61 ans. Le côté dominant était atteint 18 fois. Le<br />
traumatisme était secondaire dans 14 cas à unAVP et dans 20 cas à<br />
une chute. Le traumatisme était secondaire dans 14 cas à unAVP et<br />
dans 20 cas à une chute. Les différents types de fractures ont été<br />
classées selon Duparc en CT2 dans 10 cas, en CT3 dans 18 cas et<br />
en CT4 dans 6 cas. Etait associée dans 5 cas une complication<br />
nerveuse. Le traitement a consisté en une ostéosynthèse à foyer<br />
ouvert dans 16 cas et à foyer fermé dans 18 cas par plaque, broche<br />
ou embrochage. Les résultats fonctionnels ont été appréciés à<br />
l’aide du score de Constant prenant en compte 4 paramètres :<br />
douleur, activités, mobilité et force. Les résultats radiographiques<br />
ont été appréciés à l’aide de 2 incidences face et profil axillaire.<br />
Les tests statistiques ont été analysés à l’aide du logiciel stat-view.<br />
La durée d’immobilisation a été de 28 jours.<br />
RÉSULTATS. <strong>Tous</strong> <strong>les</strong> patients ont été revus cliniquement et<br />
radiologiquement avec un suivi moyen de 40 mois. Seuls 4<br />
patients étaient pleinement satisfaits du résultat. La douleur du<br />
score de Constant était en moyenne de 9 points. Treize patients se<br />
sont controlatéralisés depuis le traumatisme. La mobilité active en<br />
antépulsion était de 97 et la rotation externe de 30, sans corrélation<br />
statistique entre la mobilité et le type de fracture. Le score global<br />
moyen de Constant était de 60 points. La réduction avait été jugée<br />
anatomique dans 12 cas et dans 14 cas, il existait un cals vicieux.<br />
Nous rapportons 8 cas de nécrose céphaliques secondaires dans 4<br />
cas à <strong>des</strong> CT4. Les complications <strong>les</strong> plus fréquentes étaient <strong>les</strong><br />
miogrations de broches dans 15 cas et 7 cas de débricolages avec<br />
une corrélation significative entre complication et âge.<br />
CONCLUSION. L’analyse de cette série montre <strong>des</strong> résultats<br />
subjectifs et objectifs moyens avec <strong>des</strong> complications augmentant<br />
avec l’âge. Il existe une corrélation significative entre la rotation<br />
externe et la réduction du tubercule majeur. Nous n’avons pas<br />
retrouvé de corrélation radio-clinique. Les résultats, bien que globalement<br />
insatisfaisants, sont toutefois à comparer avec ceux <strong>des</strong><br />
arthroplasties.<br />
*S. Hacini, Service d’Orthopédie, CHU Nîmes,<br />
5, rue Hoche, 30029 Nîmes.
79 Pseudarthroses septiques de<br />
fémur : à propos de 11 cas<br />
C. DE LA PORTE*, T. BÉGUÉ, P.THOREUX,<br />
A.-C. MASQUELET<br />
INTRODUCTION. La diversité du traitement <strong>des</strong> pseudarthroses<br />
septiques de fémur montre leur difficulté de prise en charge et<br />
l’absence d’attitude consensuelle. Des techniques validées pour le<br />
traitement <strong>des</strong> pseudarthroses septiques de jambe ont semblé<br />
transposab<strong>les</strong> pour le fémur. L’objectif du travail concernait la<br />
comparaison <strong>des</strong> différents traitements entrepris dans notre service<br />
pour identifier une prise en charge optimale.<br />
MÉTHODE. Les auteurs rapportent une étude rétrospective clinique<br />
et radiologique concernant 11 patients (9 hommes et 2 femmes)<br />
avec pseudarthrose septique de fémur, dont 9 origines traumatiques<br />
et 2 origines tumora<strong>les</strong>. L’évolution septique était<br />
précoce dans 7 cas, tardive dans 4 cas, avec un délai moyen de 34,8<br />
mois avant prise en charge. Notre traitement <strong>des</strong> pseudarthroses<br />
septiques du fémur est fondé sur une succession d’étapes commençant<br />
par la guérison de l’infection <strong>des</strong> parties mol<strong>les</strong> et de l’os,<br />
avant d’aborder la reconstruction et la consolidation osseuses. Le<br />
1 er temps d’assèchement comportait fixation, excision, antibiothérapie<br />
et interposition d’une entretoise en ciment acrylique. Le 2 e<br />
temps de reconstruction osseuse a été effectué, après ablation de<br />
l’entretoise, par greffe de fibula vascularisée associée à de l’os<br />
spongieux (4 cas) ou par greffe spongieuse massive dans une<br />
pseudo-membrane induite par l’entretoise (7 cas).<br />
RÉSULTATS. Le délai moyen d’assèchement infectieux était<br />
de 10,9 mois. Trois patients n’ont pu être asséchés. La continuité<br />
osseuse a été obtenue en 8,8 mois en moyenne. Le délai de consolidation<br />
(i.e. durée de fixation externe) a été de 22 mois. Quatre<br />
patients se sont refracturés. Deux patients n’ont pas consolidé.<br />
DISCUSSION. Lors de la 2 e phase, une plus grande facilité<br />
technique, un délai de consolidation plus court, et une reconstruction<br />
plus adaptée en volume nous font préférer une reconstruction<br />
par greffe spongieuse massive. La durée optimale de la 1 re phase<br />
doit être de 6 mois pour éviter <strong>les</strong> reprises septiques. Nos délais de<br />
consolidation sont comparab<strong>les</strong> à ceux d’autres auteurs ; l’index<br />
de consolidation (durée de consolidation rapportée à la longueur<br />
de la perte de substance) est proche de celui obtenu par technique<br />
de compression-distraction.<br />
Les refractures liées à certains problèmes mécaniques spécifiques<br />
du fémur ont conduit à allonger la durée de fixation externe à<br />
13 mois minimum.<br />
*C. De La Porte, Hôpital Avicenne,<br />
125, rue de Stalingrad, 93009 Bobigny Cedex.<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S59<br />
80 Enclouage centro-médullaire non<br />
alésé dans <strong>les</strong> fractures de jambe :<br />
à propos de 106 cas<br />
D. GIRARD*, F. PFEFFER, L.GALOIS,<br />
R. TRAVERSARI, D.MAINARD, J.-P. DELAGOUTTE<br />
INTRODUCTION. L’objectif de cette étude rétrospective sur 7<br />
ans est d’évaluer <strong>les</strong> résultats de l’enclouage centromédullaire non<br />
alésé de type UTN dans <strong>les</strong> fractures de jambe.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Cent-six patients ont bénéficié de<br />
ce type d’enclouage (71 hommes pour 35 femmes). L’âge moyen<br />
était de 38,2 ans (de 16 à 76 ans). Un contexte de polytraumatisme<br />
était retrouvé dans 31,1 % <strong>des</strong> cas. Il s’agissait de fractures fermées<br />
dans 77,4 % <strong>des</strong> cas, ouvertes dans 22,6 % de cas (Gustilo I<br />
dans 19 cas, Gustilo II dans 5 cas). Le siège fracturaire était<br />
diaphysaire dans 77,4 %<strong>des</strong> cas, situé au quart inférieur du tibia<br />
dans 12,2 % <strong>des</strong> cas et bifocal dans 10,3 % <strong>des</strong> cas. On notait 5 cas<br />
de souffrance vasculaire initiale et 2 cas de souffrance neurologique.<br />
Un montage statique était réalisé dans tous <strong>les</strong> cas. L’appui<br />
était repris après une période de décharge précédant le déverrouillage<br />
de 6 semaines.<br />
RÉSULTATS. Le recul moyen est de 13,1 mois. La consolidation<br />
osseuse a été obtenue dans 85,8 % <strong>des</strong> cas, dans un délai de 17<br />
semaines. On note 5 cas de cals vicieux (compris entre 5 et 10 de<br />
valgus ou de varus n’ayant pas nécessité de reprise chirurgicale).<br />
On observe 7,5 % de retard de consolidation et 6,6 % de pseudarthroses<br />
vraies, ayant nécessité afin d’obtenir la consolidation<br />
soit une ostéotomie de fibula (6 cas), soit un remplacement du clou<br />
par un clou alésé de type Grosse et Kempf (1 cas). Par ailleurs, on<br />
note 10 bris de vis de verrouillage. Les résultats fonctionnels sont<br />
considérés comme très bons et bons dans 89,6 % <strong>des</strong> cas. Douze<br />
patients présentent une dorsiflexion du pied limitée, et neuf<br />
patients présentent <strong>des</strong> douleurs à l’extrémité supérieure du clou.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. L’absence d’alésage présente<br />
d’indéniab<strong>les</strong> avantages sur l’alésage, notamment au niveau<br />
de la préservation de la vascularisation endostée. Le clou non alésé<br />
constitue une alternative intéressante au fixateur externe dans <strong>les</strong><br />
fractures ouvertes.<br />
Malgré l’absence de sepsis, nous n’avons pas d’argument pour<br />
affirmer que le caractère plein du clou diminue le taux d’infection.<br />
La durée de consolidation et le taux de pseudarthroses vraies ne<br />
permettent pas de conclure formellement en sa faveur dans le débat<br />
l’opposant au clou alésé.<br />
*D. Girard, Secrétariat du service COT, Hôpital Central,<br />
29, avenue Maréchal-de-Lattre de-Tassigny,<br />
54035 Nancy Cedex.
3S60 78 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
81 Proposition d’un score lésionnel<br />
pronostique dans la prise en charge<br />
initiale <strong>des</strong> traumatismes complexes<br />
du membre supérieur<br />
S. DURAND*, K. GUELMI, D.BIAU, R.PORCHER,<br />
J.-P. LEMERLE<br />
INTRODUCTION. La prise en charge <strong>des</strong> traumatismes complexes<br />
du membre supérieur (TCMS) pose d’importants problèmes<br />
thérapeutiques, la principale difficulté en urgence étant de<br />
déterminer <strong>les</strong> cas où une chirurgie conservatrice, ambitieuse est<br />
légitime et ceux où une amputation est nécessaire. Nous proposons<br />
un score lésionnel pronostique afin de déterminer la meilleure<br />
conduite à tenir au stade de l’urgence.<br />
MATÉRIEL. Notre étude a inclus 48 patients opérés entre 1987<br />
et 1997. Il s’agissait d’amputations tota<strong>les</strong> ou sub-tota<strong>les</strong> dans 23<br />
cas, de traumatismes dévascularisants en continuité dans 7 cas ou<br />
de traumatismes complexes en continuité non dévascularisés dans<br />
18 cas (fracture de type IIIa et IIIb de Gustilo). Les traumatismes<br />
isolés de la main étaient exclus.<br />
MÉTHODE. Il a été attribué, rétrospectivement, un score<br />
lésionnel en fonction <strong>des</strong> lésions de chaque tissu (os, vaisseaux,<br />
nerfs, musc<strong>les</strong>, peau) pour chaque patient.Avec un recul minimum<br />
de 2 ans, le résultat a été jugé sur le caractère amputé ou non<br />
amputé du membre. Pour chaque patient non amputé, un résultat<br />
plus précis a été établi selon la classification de Chen. La prise en<br />
charge opératoire a toujours suivi le même protocole.<br />
RÉSULTATS. Au vu <strong>des</strong> résultats fonctionnels, l’analyse statistique<br />
a permis d’identifier <strong>les</strong> facteurs pronostiques de l’amputation<br />
parmi <strong>les</strong> cinq variab<strong>les</strong> recueillies. Une analyse par arbre de<br />
classification a permis de développer un arbre décisionnel basé sur<br />
l’atteinte musculaire, <strong>des</strong> nerfs et de la peau, conduisant à une<br />
sensibilité de 64,7 %, une spécificité de 100 %, une valeur prédictive<br />
positive de 100 % et une valeur prédictive négative de 83,8 %.<br />
Afin de confirmer ces résultats, un modèle logistique multiple a été<br />
utilisé, conduisant à la sélection <strong>des</strong> mêmes variab<strong>les</strong>.<br />
DISCUSSION. Le score TCMS est un score simple d’utilisation,<br />
seul dans la littérature à prendre en compte uniquement <strong>les</strong><br />
variab<strong>les</strong> ayant, de façon statistique adaptée, prouvé leurs caractères<br />
significatifs dans le pronostic immédiat <strong>des</strong> TCMS. Aucun<br />
score ne peut toutefois remplacer, aujourd’hui, l’expérience du<br />
chirurgien dans la décision thérapeutique. Ce score reste donc une<br />
aide thérapeutique non négligeable dans <strong>les</strong> cas limites où se discute<br />
une amputation.<br />
CONCLUSION. Une étude prospective à plus grande échelle<br />
devrait permettre de préciser <strong>les</strong> indications et conserver une spécificité<br />
de 100 % eu égard à l’irréversibilité de la sanction thérapeutique.<br />
*S. Durand, Service de Chirurgie Orthopédique<br />
Traumatologique et Réparatrice, Hôpital Européen<br />
Georges-Pompidou, 20, rue Leblanc, 75908 Paris Cedex 15.<br />
82 Incidence de la couverture par lambeau<br />
<strong>des</strong> pertes de substance cutanées<br />
de la jambe lors <strong>des</strong> fractures<br />
ouvertes à haute énergie : à propos<br />
de 26 cas<br />
B. BAUER*, P. BOYER, F.BERGER, A.FABRE,<br />
F. LAMBERT, M.LEVADOUX, S.RIGAL<br />
INTRODUCTION. L’intérêt pronostique d’une couverture précoce<br />
par lambeau d’une fracture ouverte de jambe est connu. La<br />
stratégie au delà du 8 e jour dans <strong>les</strong> traumatismes à haute énergie<br />
(stade III et IV de Byrd) n’est pas univoque. Le but de cette étude<br />
est d’analyser l’influence de la couverture par lambeau sur l’évolution<br />
de ces traumatismes complexes.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Nous avons effectué une étude<br />
clinique rétrospective incluant 26 patients opérés entre 1996 et<br />
2001. La séquence thérapeutique a comporté un débridement, une<br />
stabilisation par fixateur externe, une couverture par lambeau. Le<br />
nombre de fractures à haute énergie domine la série avec 21 cas.<br />
Nous avons réalisé 24 lambeaux homojambiers et 2 lambeaux<br />
libres de Grand Dorsal. Parmi <strong>les</strong> lambeaux homojambiers, on<br />
comptait 10 lambeaux musculaires et 14 lambeaux fascio-cutanés.<br />
Treize fractures ont été couvertes avant le 8 e jour, 11 entre le 8 e et<br />
le 45 e jour du traumatisme, 2 au-delà du 45 e jour.<br />
RÉSULTATS. Huit échecs de couverture ont conduit à une<br />
reprise chirurgicale. Le délai de couverture ou le type de lambeau<br />
utilisé ne sont pas liés statistiquement à la gravité initiale <strong>des</strong><br />
lésions. Le délai de couverture a influencé <strong>les</strong> opérateurs en terme<br />
de choix de lambeau : 8 lambeaux musculaires sur 13 ont été<br />
réalisés avant 8 jours contre 10 lambeaux fascio-cutanés sur 13<br />
réalisés après 8 jours (p < 0,05). Dans 18 cas, un apport osseux<br />
complémentaire réalisé avant le 3 mois a abouti à la consolidation<br />
avant 10 mois. Le taux de sepsis grave était de 16,66 % dans le<br />
groupe traité avant 8 jours contre 36,66 % dans le groupe traité<br />
après 8 jours. La gravité <strong>des</strong> lésions initia<strong>les</strong> et le délai de couverture<br />
ne préjugent pas <strong>des</strong> résultats fonctionnels.<br />
DISCUSSION. La prise en charge <strong>des</strong> fractures ouvertes de<br />
jambe à haute énergie (stade III et IV de Byrd) reste un sujet de<br />
controverse. La stabilisation osseuse fait appel pour la majorité <strong>des</strong><br />
auteurs à l’exo fixation. L’essor <strong>des</strong> techniques en chirurgie plastique<br />
du segment jambier incitent à un recouvrement par lambeau<br />
homojambier locorégional même après le 8 e jour. Nous privilégions<br />
à cette phase le lambeau musculaire. Cette attitude montre<br />
son intérêt en terme de délai de cicatrisation et de consolidation, et<br />
ses limites avec un risque septique élevé. Un apport osseux complémentaire<br />
est réalisé avant la fin du 3 e mois en l’absence de<br />
signes radiologiques de consolidation.<br />
*B. Bauer, Service de Chirurgie Orthopédique et<br />
Traumatologique, Hôpital d’Instruction <strong>des</strong> Armées Percy,<br />
101, avenue Henry-Barbusse, 92140 Clamart.
83 Traitement <strong>des</strong> pseudarthroses<br />
septiques <strong>des</strong> os longs : résultats<br />
préliminaires d’une technique en<br />
deux temps<br />
O. ROCHE*, L. ZABÉE, F.SIRVEAUX,<br />
E. VILLANUEVA, D.MOLÉ<br />
INTRODUCTION. La prise en charge <strong>des</strong> pseudarthroses <strong>des</strong><br />
os longs est un challenge difficile et nécessite une prise en charge<br />
multidisciplinaire. Le but de cette étude est de rapporter <strong>les</strong> résultats<br />
d’une technique en 2 temps avec utilisation d’un spacer (technique<br />
de Masquelet).<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Entre juin 1997 et juillet 2001, 11<br />
patients ont été pris en charge pour pseudarthrose septique (7 cas)<br />
ou suspecte de l’être (4 cas). Il s’agissait de 7 hommes et 4 femmes<br />
; l’âge moyen était de 38 ans (26-51). La pseudarthrose<br />
concernait l’humérus dans 1 cas, le fémur dans 1 cas, le tibia dans<br />
9 cas. La technique chirurgicale était univoque : un premier temps<br />
de nettoyage « carcinologique », avec comblement de la perte<br />
osseuse par du ciment antibiotique complété par une ostéosynthèse<br />
si nécessaire, un deuxième temps consistant en l’ablation du<br />
spacer et une greffe osseuse autologue 2 mois après la normalisation<br />
<strong>des</strong> marqueurs biologiques.<br />
RÉSULTATS. Le recul moyen est de 3 ans (1-5). <strong>Tous</strong> <strong>les</strong><br />
patients ont consolidé per-primam dans un délai de 4,5 mois (3-6)<br />
malgré un défect osseux moyen de 55 mm (15-100) après avivement.<br />
Les prélèvements peropératoires lors du deuxième temps<br />
opératoire sont tous revenus négatifs et aucune récidive infectieuse<br />
n’a été notée à la révision.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. Les résultats obtenus par<br />
cette technique en 2 temps sont encourageants en terme de « guérison<br />
infectieuse » et de consolidation. La codification de la gestion<br />
thérapeutique <strong>des</strong> pseudarthroses septiques <strong>des</strong> os longs dans<br />
notre service devrait nous permettre à terme de valider cette attitude.<br />
*O. Roche, Clinique de Traumatologie et d’Orthopédie,<br />
49, rue Hermite, 54052 Nancy Cedex.<br />
84 Bilan arthroscopique <strong>des</strong> lésions et<br />
possibilités thérapeutiques lors du<br />
premier épisode de luxation antérointerne<br />
traumatique d’épaule chez<br />
<strong>les</strong> sujets de moins de 25 ans<br />
D. SOUQUET*, B. LOCKER, F.MENGUY,<br />
G. PIERRARD, C.HULET, C.VIELPEAU<br />
INTRODUCTION. Après un premier épisode de luxation<br />
antéro-interne d’épaule, le risque de récidive et d’évolution vers<br />
une instabilité chronique est d’autant plus important que le patient<br />
est jeune. Ce risque est variable selon <strong>les</strong> différentes étu<strong>des</strong> déjà<br />
parues mais toujours majeur chez <strong>les</strong> patients de moins de 25 ans.<br />
Les lésions au premier épisode sont mal connues et rarement trai-<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S61<br />
tées. Nous avons donc proposé à <strong>des</strong> jeunes patients sportifs de<br />
réaliser un bilan arthroscopique <strong>des</strong> lésions et une stabilisation lors<br />
de la première luxation. Le but de cette communication est de faire<br />
le bilan <strong>des</strong> lésions observées et de présenter le protocole chirurgical<br />
que nous avons utilisé.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Entre février 2002 et mars<br />
2003, nous avons inclus prospectivement 15 patients, tous âgés de<br />
17 à 25 ans et atteints d’un premier épisode de luxation traumatique<br />
antéro-interne de l’épaule. Nous <strong>les</strong> avons informés <strong>des</strong><br />
« habitu<strong>des</strong> » thérapeutiques par traitement orthopédique et du<br />
risque de récidive. Nous leur avons proposé un bilan arthroscopique<br />
<strong>des</strong> lésions et leur traitement dans le même temps. <strong>Tous</strong> ont<br />
opté pour cette alternative thérapeutique. L’intervention a été réalisée<br />
dans tous <strong>les</strong> cas par le même opérateur, dans <strong>les</strong> 10 jours<br />
suivant la luxation. Les patients ont été immobilisés 21 jours coude<br />
au corps en postopératoire puis la rééducation a été débutée chez<br />
un kinésithérapeute libéral en évitant la rotation externe pendant<br />
encore 21 jours. <strong>Tous</strong> <strong>les</strong> patients ont été évalués avec le score<br />
Duplay.<br />
RÉSULTATS. Chez tous <strong>les</strong> patients de cette étude prospective,<br />
nous avons pu mettre en évidence une hémarthrose, une encoche<br />
de Malgaigne et surtout une désinsertion du complexe capsulolabral<br />
antéro-inférieur. Nous n’avons pas retrouvé de lésion de la<br />
glène ni de lésion ligamentaire sur le versant huméral. La coiffe<br />
était toujours intacte sauf dans un cas où il existait une lésion<br />
profonde du supraspinatus. Les lésions ont pu être suturées de<br />
manière satisfaisante 14 fois à l’aide d’ancres résorbab<strong>les</strong>.Actuellement,<br />
aucun patient n’a récidivé.A l’examen clinique, il n’existe<br />
aucune appréhension et l’on observe une altération isolée <strong>des</strong> rotations<br />
externes (RE1, RE2) inférieures à 5.<br />
CONCLUSION. Compte tenu du risque majeur de récidive de<br />
luxation après un premier épisode chez <strong>les</strong> patients jeunes, nous<br />
étudions une alternative au traitement orthopédique.<br />
<strong>Tous</strong> <strong>les</strong> patients ont accepté cette proposition. Les lésions<br />
étaient identiques à type de décollement capsulolabral et leur traitement<br />
en était simple.Actuellement, tous <strong>les</strong> patients ont récupéré<br />
une épaule stable et indolore. Compte tenu du nombre encore<br />
limité <strong>des</strong> patients et du faible recul, <strong>les</strong> résultats doivent être<br />
interprétés avec la plus grande prudence mais sont encourageants.<br />
*D. Souquet, Département d’Orthopédie, CHU de Caen,<br />
avenue de la Côte-de-Nâcre, 14000 Caen.<br />
85 L’effet Latarjet : est-il vraiment lié à<br />
la butée coracoïdienne ?<br />
V. TRAVERS*, E. CAMUS<br />
Le traitement chirurgical <strong>des</strong> instabilités antérieures d’épaule<br />
fait encore beaucoup appel à l’intervention de Latarjet, utilisant à<br />
la base une butée coracoïdienne fixée à la partie antéro-inférieure<br />
de la glène. Cette intervention est loin d’être facile, avec un pourcentage<br />
conséquent de complications peropératoires, de pseudarthroses<br />
ou de lyses partiel<strong>les</strong> de la butée, et surtout d’omarthrose<br />
à long terme. Cependant, un certain nombre de butées<br />
pseudarthrosées, entièrement lysées ou retirées n’altèrent pas obligatoirement<br />
la stabilité. De plus, la technique actuelle nécessite<br />
une section partielle ou une discision <strong>des</strong> fibres du sous scapulaire,
3S62 78 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
seul élément antérieur sain persistant. La question est donc de<br />
savoir si ce n’est pas l’effet hamac du coracobiceps sur le sousscapulaire<br />
qui est le plus stabilisateur.<br />
Pour ce faire, <strong>les</strong> auteurs ont initié en 1997 une série prospective<br />
consistant en la section simple du coracobiceps, le respect total du<br />
ligament acromio-coracoïdien, de la coracoïde et du sousscapulaire.<br />
Un ligament de renfort, passé par le rotator interval fixé<br />
sur la glène au même endroit que dans le Latarjet, cravate le<br />
sous-scapulaire, et lui est fixé par 4 points, le tout étant recouvert<br />
du coracobiceps lui même fixé sur l’ensemble ligament- sousscapulaire.<br />
Une série prospective de 65 cas a donc été faite, sur tous <strong>les</strong> cas<br />
d’instabilité et de luxations récidivantes antérieures pures.<br />
Les suites opératoires et la durée de récupération ont été plus<br />
simp<strong>les</strong> que pour le Latarjet traditionnel, tous <strong>les</strong> patients ont été<br />
revus à 3 semaines, 6 semaines, 3 mois, 6 mois un an, deux ans,<br />
puis une visite ou un appel téléphonique annuel.<br />
Les résultats ont été classés selon la cotation de Duplay, avec 2<br />
instabilités persistantes. Il n’y a pas eu de réaction liée au polyéthylène<br />
térephtalate. Au bilan final, le Score de Duplay fut de 23,6<br />
sur 25 sur <strong>les</strong> activités sportives ou quotidiennes, 23,6 sur 25 pour<br />
la stabilité, 22,91 sur la douleur, et 23,6 en mobilité soit un total<br />
global de 93,71 sur 100.<br />
Dans la chirurgie de reprise, cette technique s’est avérée particulièrement<br />
séduisante.<br />
Au total donc, il semble que la butée par elle même n’ait pas<br />
d’effet stabilisateur, et que l’effet hamac du coracobiceps soit<br />
prépondérant. Une technique arthroscopique utilisant cet effet est<br />
à l’étude, qui viendrait en complément <strong>des</strong> techniques purement<br />
capsulaires utilisées.<br />
*V. Travers, Clinique du Parc,<br />
86, Boulevard <strong>des</strong> Belges, 69006 Lyon.<br />
86 Influence du positionnement de la<br />
butée coracoidienne dans l’instabilité<br />
chronique antérieure traumatique<br />
sur la sensation d’appréhension<br />
postopératoire<br />
P. VALENTI*, C. RUEDA, C.ALLENDE<br />
INTRODUCTION. Le but de ce travail était d’évaluer si le<br />
positionnement de la butée coracoidienne lors de la stabilisation<br />
chirurgicale de l’épaule selon Patte influençait ou non la persistance<br />
d’une appréhension postopératoire.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Quarante patients d’âge moyen<br />
26 ans (19-37), opéré par le même chirurgien (PV), ont été revus<br />
rétrospectivement avec un recul moyen de 40 mois (24-60). L’instabilité<br />
se traduisait par <strong>des</strong> luxations (70 %), <strong>des</strong> subluxations<br />
(20 %) ou <strong>les</strong> deux (10 %). Aucun patient n’était hyperlaxe. La<br />
même technique fut utilisée : discision du sous scapulaire dans<br />
l’axe de ses fibres et fixation de la butée coracoidienne (en position<br />
couchée) à l’aide d’une seule vis corticale 4,5 en compression avec<br />
une rondelle. Un point d’angle entre le tendon coraco brachial et le<br />
fragment externe de capsule était systématiquement réalisée.<br />
L’étude radiologique à la révision comportait un cliché de face en<br />
trois rotation et un profil glénoidien de Bernageau. La position de<br />
la butée fut analysée en hauteur par rapport à l’équateur de la glène<br />
et transversalement par rapport à l’interligne articulaire glénohumérale(médiale,<br />
affleurante, latérale).<br />
RÉSULTATS. La butée était toujours inférieure ; elle était<br />
affleurante dans 70 %, médiale dans 22 % et légèrement débordante<br />
dans 8 % <strong>des</strong> cas. Vingt pour cent <strong>des</strong> patients conservaient<br />
une appréhension dans le mouvement extrême d’abduction et de<br />
rotation externe ; une seule appréhension a été rapportée dans la<br />
série <strong>des</strong> butées affleurantes alors que 7 appréhensions sont retrouvées<br />
dans la série <strong>des</strong> butées média<strong>les</strong>. Deux récidives de luxations<br />
et 2 épiso<strong>des</strong> de subluxations dans la série <strong>des</strong> butées médialisées<br />
n’ont pas nécessité de réintervention. L’évaluation fonctionnelle<br />
de l’épaule a été effectuée à la révision avec le DASH : le DASH<br />
moyen était de 6,7 pour la série complète, et passait à 10 pour <strong>les</strong><br />
butées médialisées et à 4,2 pour <strong>les</strong> butées affleurantes.<br />
CONCLUSION. Cette série rétrospective souligne la difficulté<br />
et la nécessité d’une rigueur absolue dans le positionnement<br />
« idéale », c’est-à-dire inférieure et affleurante de la butée coracoidienne.<br />
Ainsi cette technique, parfaitement réalisée dans <strong>les</strong> instabilités<br />
chroniques post traumatiques, en l’absence d’hyperlaxité,<br />
assure la disparition de l’appréhension et prévient <strong>les</strong> récidives de<br />
subluxation ou luxation.<br />
*P. Valenti, Département Epaule, Institut de la Main,<br />
6, square Jouvenet, 75016 Paris.
87 Traitement chirurgical du pied varus<br />
équin spastique de l’adulte hémiplégique<br />
: à propos d’une série de<br />
57 patients<br />
A. DURANDEAU*, B. BENQUET, L.WIART,<br />
E. BACHEVILLE, T.FABRE<br />
INTRODUCTION. Les auteurs rapportent une série rétrospective<br />
continue de 57 patients hémiplégiques (32 hommes, 25 femmes)<br />
opérés d’un pied varus équin entre 1995 et 2000 en associant<br />
une neurotomie fasciculaire du nerf tibial à <strong>des</strong> gestes tendineux<br />
permettant de récupérer une marche pied à plat et au mieux sans<br />
aide.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. L’âge moyen de patients était<br />
de 47 ans (16 à 75 ans). L’étiologie de l’hémiplégie était vasculaire,<br />
traumatique ou autre dans, 41, 8 et 8 cas respectivement.<br />
<strong>Tous</strong> <strong>les</strong> patients présentaient un équin spastique nécessitant un<br />
aide technique 46 fois. La force du triceps et la spasticité étaient<br />
cotées respectivement en moyenne à 2,1 selon la MRC et 3,66<br />
selon la classification d’Ashworth. Il existait une hypoesthésie du<br />
pied pour 23 patients. La marche évaluée par le FAC (functional<br />
ambulation classification) était cotée à 3,3 en moyenne dont 13 cas<br />
d’atteinte sévère (FAC 1 et 2). L’intervention chirurgicale se<br />
déroulait en moyenne 3 ans après l’accident. Pour 55 patients, sur<br />
<strong>les</strong> branches termina<strong>les</strong> du nerf tibial, 4/5 <strong>des</strong> fibres nerveuses<br />
<strong>des</strong>tinées au triceps et au tibial postérieur ont été sectionnées par<br />
microchirurgie après repérage par stimulations électriques. Au<br />
niveau tendineux, après étude clinique <strong>des</strong> rétractions musculotendineuses<br />
(triceps et fléchisseurs <strong>des</strong> orteils) et <strong>des</strong> paralysies <strong>des</strong><br />
releveurs, ont été réalisés un allongement percutané du tendon<br />
d’Achille dans 13 cas, une ténodèse de type Bardot ou un transfert<br />
d’hémi jambier antérieur dans 29 cas et une ténotomie <strong>des</strong> fléchisseurs<br />
<strong>des</strong> orteils dans 12 cas.<br />
RÉSULTATS. Le recul moyen de la série était de 3 ans (1 à 6<br />
ans). La force musculaire du triceps et la sensibilité du pied<br />
n’étaient pas modifiées par l’intervention. La spasticité postopératoire<br />
et au recul maximum étaient respectivement à 1,08 et 1,19<br />
selon Ashworth. Le score FAC pour la marche était retrouvé respectivement<br />
à 4,13 et 4,15 en postopératoire et au recul maximum.<br />
L’aide technique était améliorée ou supprimée dans 52 cas. Dans 3<br />
cas, une récidive du pied spastique équin a nécessité une arthrodèse<br />
tibio-talienne.<br />
DISCUSSION. L’étude clinique préopératoire de la déformation<br />
du pied et de la marche est très importante. Elle permet l’association,<br />
dans le même temps opératoire, <strong>des</strong> gestes microchirurgicaux<br />
de neurotomie fasciculaire du nerf tibial postérieur, à <strong>des</strong><br />
gestes tendineux d’allongement ou de ténodèse. Ces gestes sont<br />
indiqués, même pour <strong>les</strong> déformations sévères, en première inten-<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S63<br />
Séance du 11 novembre après-midi<br />
CHEVILLE/PIED<br />
tion avant <strong>des</strong> gestes d’arthrodèse dont la morbidité reste plus<br />
élevée.<br />
*A. Durandeau, Service d’Orthopédie-Traumatologie,<br />
Hôpital Pellegrin, place Amélie-Raba-Léon, 33076 Bordeaux.<br />
88 L’ostéotomie du calcanéum selon<br />
Dwyer : revue de 22 ostéotomies,<br />
indications et résultats<br />
T. LEEMRIJSE*, C. BASTIN, J.-J. ROMBOUTS<br />
INTRODUCTION. L’ostéotomie selon Dwyer reste controversée<br />
aux vues <strong>des</strong> nombreuses étu<strong>des</strong> déjà réalisées. Les conclusions<br />
variées n’apportent pas de lignes de conduite et restent sujettes<br />
à discussion. Une cause de divergence <strong>des</strong> résultats est la<br />
variabilité <strong>des</strong> indications (pathologie neurologique associée évolutive<br />
ou non) et <strong>les</strong> éco<strong>les</strong> chirurgica<strong>les</strong> ; leurs interprétations sont<br />
donc rendues diffici<strong>les</strong> et <strong>les</strong> comparaisons malaisées.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Nous avons revu 22 ostéotomies<br />
du calcanéum opérées selon la technique de Dwyer réalisée entre<br />
1972 et 2002. La technique était une ostéotomie de fermeture<br />
pratiquée par voie latérale. Le recul moyen était de 10 ans (1 à 30<br />
ans). Les patients étaient âgés de8à55ans. L’évaluation a comporté<br />
deux volets, un objectif et un subjectif conformément au<br />
Rating system of Laaveg et Panseti (1980). Les indications<br />
étaient : pied creux neurologique (13 cas) dont 5 unilatéraux et 4<br />
bilatéraux ; pied creux varus équin dans le cadre de séquel<strong>les</strong> de<br />
pied bots (2 cas) ; varus idiopathiques de l’arrière-pied avec instabilité<br />
de la cheville (5 cas) ; varus post-traumatique, séquel<strong>les</strong> de<br />
syndrome <strong>des</strong> loges (2 cas).<br />
DISCUSSION. L’ostéotomie de Dwyer est rarement isolée et<br />
fréquemment associée à d’autres types d’interventions (transferts<br />
et allongements tendineux - intervention sur l’avant-pied et sur <strong>les</strong><br />
orteils) ce qui rend son évaluation d’autant plus difficile. Notre<br />
étude n’a pas pour vocation de tirer <strong>des</strong> conclusions définitives<br />
mais de comparer nos indications et nos résultats aux étu<strong>des</strong> déjà<br />
réalisées.<br />
CONCLUSION. L’ostéotomie de Dwyer apparaît efficace dans<br />
la correction du varus constitutionnel lorsqu’elle répond à une<br />
technique rigoureuse (importance du site de l’ostéotomie et de la<br />
résection osseuse réalisée). De plus, elle entraîne peu de complications.<br />
La consolidation est habituellement toujours obtenue.<br />
Elle reste pour nous une excellente indication en association avec<br />
une instabilité de la cheville où elle corrige de façon simple et<br />
efficace le varus constitutionnel tant que celui ci est modéré. C’est<br />
une bonne solution lors <strong>des</strong> reprises de pied bot associées à <strong>des</strong><br />
libérations aponévrotiques et tendineuses. Dans <strong>les</strong> pieds creux<br />
neurologiques, <strong>les</strong> résultats sont insuffisants lorsqu’il existe un<br />
déséquilibre tendineux résiduel ou évolutif dans le cadre de la
3S64 78 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
maladie. Il peut s’agir toutefois d’une solution d’attente chez le<br />
jeune enfant qui bénéficiera plus tard d’un geste d’arthrodèse.<br />
*T. Leemrijse, Service d’Orthopédie et Traumatologie de<br />
l’Appareil Locomoteur, Cliniques Universitaires Saint Luc,<br />
Université Catholique de Louvain, 10, avenue Hippocrate,<br />
1200 Bruxel<strong>les</strong>, Belgique.<br />
89 L’ostéotomie valgisante de Dwyer<br />
dans le traitement <strong>des</strong> instabilités<br />
chroniques de la cheville sans laxité<br />
évidente : à propos de 15 cas<br />
J. CAZAL*, Y. TOURNÉ, D.SARAGAGLIA<br />
INTRODUCTION. L’instabilité chronique de la cheville est la<br />
plupart du temps en relation avec une laxité latérale de l’articulation<br />
tibio-talienne. Cependant, il arrive que <strong>les</strong> clichés dynamiques<br />
soient négatifs et que l’arrière-pied présente un morphotype en<br />
varus. Dans ces cas-là, il semble logique de proposer une ostéotomie<br />
type Dwyer de valgisation du calcaneus. L’objectif de ce<br />
travail était de revoir <strong>les</strong> patients opérés d’une telle ostéotomie<br />
entre 1992 et 2000.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Il s’agissait de 15 patients, 9<br />
hommes et 6 femmes, qui se plaignaient d’une instabilité chronique<br />
de la cheville sans laxité évidente. <strong>Tous</strong> avaient un varus de<br />
l’arrière pied qui était en moyenne de 5° (3 à 10°). Treize étaient<br />
<strong>des</strong> sportifs dont 8 de compétition. Soixante pour cent avaient<br />
présenté <strong>des</strong> accidents d’instabilité au court d’une activité sportive.<br />
Parmi <strong>les</strong> lésions associées, deux, avaient un syndrome fissuraire<br />
<strong>des</strong> tendons fibulaires, un, une lésion ostéochondrale du<br />
dôme talien, un autre, une maladie de Haglund et deux autres<br />
avaient un pied creux de stade II. <strong>Tous</strong> ont bénéficié d’une ostéotomie<br />
de Dwyer de fermeture externe fixée la plupart du temps par<br />
une plaque 1/3 à 2 trous, 2 vis.<br />
Pour ce qui concerne <strong>les</strong> gestes associés, ont été réalisées : une<br />
ligamentoplastie latérale, deux ostéotomies de relèvement de M1,<br />
une régularisation d’une lésion ostéochondrale du dôme talien,<br />
une ostéotomie de Zadek, et une arthrolyse antérieure. <strong>Tous</strong> <strong>les</strong><br />
patients ont été revus cliniquement et radiologiquement par un<br />
chirurgien indépendant de l’opérateur.<br />
RÉSULTATS. Le recul était de 3,5 ans (1 à 9 ans) avec une<br />
déviation standard de 2,5 ans. Nous n’avons pas retrouvé de complication<br />
hormis une nécrose cutanée chez le patient qui a eu dans<br />
le même temps opératoire ostéotomie et ligamentoplastie. L’instabilité<br />
a disparu dans tous <strong>les</strong> cas. Dix opérés souffraient de<br />
douleurs épisodiques peu invalidantes dont 50 % au court d’activités<br />
sportives. Onze (70 %) avaient repris leurs activités sportives<br />
dans un délai moyen de 8 mois (3 à 36 mois) et 33 % à leur niveau<br />
antérieur. Le score de Kitaoka moyen était de 92 (85 à 100) et 80 %<br />
<strong>des</strong> opérés étaient satisfaits ou très satisfaits.<br />
CONCLUSION. L’ostéotomie valgisante de Dwyer donne <strong>des</strong><br />
résultats tout à fait satisfaisants dans <strong>les</strong> instabilités chroniques de<br />
la cheville sans laxité évidente et avec varus de l’arrière pied. Si un<br />
geste ligamentaire complémentaire semble nécessaire, il est pré-<br />
férable de le réaliser dans un deuxième temps opératoire pour ne<br />
pas s’exposer à une nécrose cutanée.<br />
*J. Cazal, Service de Chirurgie Orthopédique et de<br />
Traumatologie du Sport, CHU de Grenoble, Hôpital Sud,<br />
BP 185, 38042 Grenoble Cedex 09.<br />
90 Prothèse totale de cheville : étude<br />
rétrospective d’une série continue<br />
et homogène de 26 cas avec un<br />
recul de 5à12ans<br />
E. MEULEY*, T. SIGUIER, P.PIRIOU, C.GARREAU<br />
DE LOUBRESSE, T.JUDET<br />
INTRODUCTION. L’objet de ce travail était l’évaluation <strong>des</strong><br />
résultats cliniques et radiologiques à moyen terme d’une série<br />
homogène et continue de PTC de troisième génération (ressurfaçage,<br />
cylindrique, sans ciment, à trois composants).<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. De mars 1990 à juin 1996, 26<br />
patients âgés de 57 ans (32-73) ont été traités par prothèse type<br />
New-Jersey L.C.S (5 cas) puis Buechel-Pappas (21 cas).<br />
L’étiologie post traumatique a représenté la majorité <strong>des</strong> indications<br />
(21 cas). L’amplitude articulaire préopératoire moyenne<br />
était de 17°. Le résultat fonctionnel a été apprécié selon le score<br />
AOFAS. L’analyse radiographique a concerné le positionnement<br />
prothétique et sa stabilité dans le temps, la pièce intermédiaire,<br />
l’interface os-prothèse, la trame osseuse et <strong>les</strong> ossifications périprothétiques.<br />
RÉSULTATS. Les complications per et postopératoires étaient :<br />
5 fractures malléolaires, un hématome, un retard de cicatrisation<br />
cutanée. 2 instabilités de la pièce intermédiaire et 1 conflit malléolaire<br />
interne nécessitant une ré intervention avec conservation de<br />
l’implant.Au recul moyen de 7 ans, 2 patients étaient décédés et un<br />
perdu de vue. Trois ont eu une arthrodèse pour échec de fixation<br />
initiale à 2 ans pour mobilisation secondaire talienne à 7 ans et<br />
pour infection secondaire à 8 ans de l’arthroplastie. L’évaluation<br />
<strong>des</strong> 20 cas restants : le scoreAOFAS était mauvais dans 2 cas (dont<br />
1 usure patente du patin), moyen dans 2, bon dans 16. L’amplitude<br />
articulaire moyenne au recul était de 24°. Radiologiquement, il<br />
n’existait pas de modifications significatives de positionnement<br />
<strong>des</strong> pièces tibia<strong>les</strong> et taliennes. L’ancrage de la pièce tibiale était de<br />
type fibreux dans la moitié <strong>des</strong> cas, de type osseux dans l’autre<br />
moitié <strong>des</strong> cas. Un aspect de macro-géo<strong>des</strong> a été observé sous la<br />
pièce talienne chez 4 patients. L’existence d’ossifications périprothétiques<br />
évolutives concernait la majorité <strong>des</strong> patients.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. L’insuffisance de l’ancillaire<br />
de cette prothèse et sa conception ancienne expliquent la<br />
fréquence <strong>des</strong> fractures malléolaires et le niveau <strong>des</strong> résultats fonctionnels<br />
qui justifie <strong>les</strong> tentatives d’amélioration <strong>des</strong> prothèses. La<br />
stabilité <strong>des</strong> résultats observés dans la série présentée avec un recul<br />
allant jusqu’à 12 ans est pour nous un argument pour proposer<br />
dans certains cas l’indication de prothèse comme alternative à<br />
l’arthrodèse ce d’autant que la reprise par arthrodèse, au prix d’une<br />
greffe iliaque, ne pose pas de problème particulier. Toutefois,<br />
l’observation de manifestations radiologiques à type d’ossifications<br />
péri-prothétiques ou de résorption osseuse principalement
sous l’implant talien justifient la poursuite de la surveillance de<br />
cette cohorte.<br />
*E. Meuley, Hôpital Raymond-Poincaré, 92380 Garches.<br />
91 Suivi prospectif d’une série homogène<br />
et continue de 42 prothèses<br />
tota<strong>les</strong> de cheville<br />
N. GRAVELEAU*, P. PIRIOU, C.GARREAU DE<br />
LOUBRESSE, T.JUDET<br />
INTRODUCTION. Le remplacement prothétique de la cheville<br />
reste controversé. Les implants dits de troisième génération peu<br />
invasifs, moins contraints du fait d’un troisième composant et non<br />
cimentés ont amélioré <strong>les</strong> résultats cliniques et de la survie à<br />
moyen terme <strong>des</strong> prothèses et permettent d’en discuter l’indication<br />
comme alternative à l’arthrodèse dans certaines situations. Les<br />
nouvel<strong>les</strong> évolutions de concept et de <strong>des</strong>sin, , visant à pallier <strong>les</strong><br />
aléas et <strong>les</strong> insuffisances de résultats, imposent une validation<br />
précoce par un suivi clinique et radiologique prospectif. C’est<br />
l’objet de cette présentation de résultats à moyen terme. Notre<br />
étude fait le point sur <strong>les</strong> résultats de la prothèse SALTO chez <strong>les</strong><br />
42 premiers patients opérés dans notre service.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Suivi prospectif d’une série<br />
homogène et continue de 42 prothèses SALTO posées de février<br />
1997 à décembre 2000 et revues avec un recul de 2à6ans.<br />
L’implant utilisé a un <strong>des</strong>sin anatomique reproduisant l’asymétrie<br />
du dôme talien, un insert en poly-éthylène mobile, un ressurfaçage<br />
fibulaire optionnel, une stabilisation primaire et à distance optimisées<br />
par le <strong>des</strong>sin et le revêtement <strong>des</strong> pièces. Toutes <strong>les</strong> données<br />
ont été colligées en temps réel dans un dossier informatisé permettant<br />
d’établir un score AOFAS, et l’analyse métrologique <strong>des</strong><br />
radiographies a été faite après numérisation (RX faces, profil et<br />
dynamiques) étudiant précision de pose, stabilité <strong>des</strong> implants et<br />
cinématique de la prothèse. Il existait une prédominance d’arthrose<br />
post-traumatiques (29 cas). L’âge moyen était de 54 ans (30-<br />
79).<br />
RÉSULTATS. Aucun patient n’était perdu de vue. Trois repris<br />
ont été par arthrodèse (2 douleurs persistantes et 1 sepsis). Le score<br />
clinique était excellent ou bon dans 88 % <strong>des</strong> cas. Le score clinique<br />
moyen de 20,5 points en préopératoire était à 70 au recul. L’analyse<br />
radiologique a permis de valider la précision de l’ancillaire de<br />
pose et n’a pas montré de mobilisation significative <strong>des</strong> implants<br />
avec le temps. Il n’y a pas eu d’échec lié a la pose d’un implant<br />
malléolaire latéral (n = 12). Les mobilités radiologiques moyenne<br />
de cheville sont passées de 15,2° à 23°. Des évolutions de la trame<br />
osseuse péri prothétique sont constatées.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. La qualité <strong>des</strong> résultats<br />
obtenus avec la prothèse étudiée et leur stabilité à court et moyen<br />
terme permet d’en discuter l’indication au moins dans <strong>les</strong> cas ou<br />
<strong>les</strong> conditions anatomiques loca<strong>les</strong> ou régiona<strong>les</strong> font craindre un<br />
mauvais résultat d’une arthrodèse. Le niveau d’amélioration fonctionnelle,<br />
exceptionnellement totale, reste difficile à prévoir et il<br />
est impératif de poursuivre le suivi radio-clinique de ces patients.<br />
*N. Graveleau, Hôpital Raymond-Poincaré, 92380 Garches.<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S65<br />
92 Hallux valgus traité par ostéotomie<br />
bipolaire de Schnepp : à propos de<br />
19 cas avec 3 ans de recul<br />
S. NAUDI*, S. NAUDI, P.LESAGE, C.MAYNOU,<br />
H. MESTDAGH<br />
INTRODUCTION. Dix-neuf hallux valgus ont été traités par<br />
ostéotomie bipolaire du premier métatarsien et libération externe<br />
de la première articulation métatarse phalangienne. <strong>Tous</strong> <strong>les</strong><br />
patients présentaient une orientation anormale de la surface articulaire<br />
distale du métatarsien (DMMA élevé). Cette étude avait<br />
pour but d’évaluer <strong>les</strong> résultats de l’ostéotomie bipolaire de Schnepp.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Onze femmes et trois hommes<br />
ont été opérés dans le service entre 1992 et 2001. <strong>Tous</strong> <strong>les</strong> patients<br />
ont été revus par un même praticien, dans le cadre d’une étude<br />
rétrospective. L’âge moyen <strong>des</strong> patients était de 56 ans.<br />
Avant l’intervention, le valgus métatarsophalangien était en<br />
moyenne de 39°6, le metatarsus varus était de 17°8 et le DMMA de<br />
21°1. L’angle préopératoire d’ouverture du pied était en moyenne<br />
de 30°.<br />
RÉSULTATS. Ils ont été appréciés avec un recul moyen de trois<br />
ans, et selon <strong>les</strong> critères de Groulier qui prennent en compte la<br />
correction de la déformation, <strong>les</strong> troub<strong>les</strong> statiques et l’activité<br />
fonctionnelle.<br />
Lors de la révision de la série, l’étude radiologique notait un<br />
valgus métatarsophalangien moyen de 20°7, un metatarsus varus<br />
de 10°3, et un DMMA de 5°3. La largeur de l’éventail métatarsien<br />
était en moyenne de 23° après l’intervention. L’articulation métatarsophalangienne<br />
était congruente et indemne de tout signe<br />
d’arthrose dans 52 % <strong>des</strong> cas.<br />
Les résultats globaux étaient excellents ou bons dans 57,5 % <strong>des</strong><br />
cas, passab<strong>les</strong> dans 32 % ; <strong>des</strong> cas et mauvais dans 10,5 % <strong>des</strong> cas.<br />
DISCUSSION. Si <strong>les</strong> résultats de notre série sont mo<strong>des</strong>tes, il<br />
faut cependant garder à l’esprit que tous <strong>les</strong> patients entraient dans<br />
le cadre d’hallux valgus sévères. L’ostéotomie bipolaire a permis<br />
de corriger à la fois le valgus phalangien, le metatarsus varus et un<br />
DMMA élevé, ce que ne permet aucune autre intervention. L’indication<br />
de cette intervention semble donc se justifier dans <strong>les</strong> cas où<br />
DMMA dépasse : 15° et où le metatarsus varus est important.<br />
Il est apparu dans notre série que <strong>les</strong> mauvais résultats s’observaient<br />
en cas d’incongruence articulaire, de signes de dégradation<br />
arthrosique ou de chirurgie de reprise.<br />
CONCLUSION. L’ostéotomie bipolaire du premier métatarsien<br />
mérite de garder sa place dans le traitement <strong>des</strong> hallux valgus<br />
sévères à DMMA élevé.<br />
L’arthrodèse métatarsophalangienne reste une intervention de<br />
sauvetage dans <strong>les</strong> cas présentant en outre une articulation non<br />
congruente ou arthrosique.<br />
*S. Naudi, Service d’Orthopédie,<br />
Hôpital Roger-Salengro, 59037 Lille Cedex.
3S66 78 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
93 Résultats à long terme du traitement<br />
<strong>des</strong> nécroses <strong>des</strong> têtes métatarsiennes<br />
(maladie de Frieberg)<br />
par ostéotomie de Gauthier<br />
F. ROGÉ*, G. CURVALE, A.ROCHWERGER,<br />
P.-O. PINELLI<br />
INTRODUCTION. L’ostéonécrose <strong>des</strong> têtes métatarsiennes est<br />
source de métatarsalgies statiques apparaissant habituellement<br />
dans <strong>des</strong> conditions de surcharge localisée. La technique de Gauthier,<br />
décrite en 1974, consiste en une ostéotomie de flexion dorsale<br />
à résection cunéiforme de la zone nécrotique. La littérature ne<br />
fait habituellement mention que <strong>des</strong> résultats à moyen terme.<br />
Notre but est d’en évaluer <strong>les</strong> conséquences à long terme.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Nous avons revu cliniquement et<br />
radiologiquement une courte série homogène de 10 patients (9<br />
femmes et un 1 homme) qui présentaient initialement une nécrose<br />
habituellement du 3 e métatarsien, responsable d’une douleur<br />
mécanique. Un patient présentait une arthrose sur le versant phalangien.<br />
8 patients présentaient un hallux valgus associé, asymptomatique<br />
qui a été respecté. Le recul moyen à la révision est de 9,<br />
5 ans (27 mois à 19 ans).<br />
RÉSULTATS. L’articulation métatarso-phalangienne était<br />
indolore chez tous <strong>les</strong> patients. La flexion plantaire moyenne était<br />
de 25°, l’extension est libre, sans limitation notable. L’analyse<br />
radiographique n’a retrouvé ni de récidive d’ostéochondrite, ni<br />
d’évolution arthrosique. La hauteur de l’interligne articulaire (rapportée<br />
à la longueur du sésamoïde externe) présentait un gain<br />
postopératoire pour l’ensemble <strong>des</strong> patients.<br />
DISCUSSION. Les résultats à court et moyen terme de l’opération<br />
de Gauthier sont connus pour être régulièrement bons, restituant<br />
un interligne métatarso-phalangien de bonne qualité, mais<br />
sont marqués par une habituelle limitation initiale de la flexion<br />
dorsale. Cette courte série avec un recul moyen important montre<br />
que l’amplitude articulaire en flexion dorsale se normalise par la<br />
suite et qu’il n’y a pas de récidive de nécrose ni d’évolution arthrosique.<br />
Ce résultat s’explique par la diminution <strong>des</strong> contraintes<br />
articulaires apportée par l’effet accourcissant antéro-postérieur et<br />
celui de relèvement de la tête métatarsienne. Même s’il n’y a pas<br />
eu d’aggravation de notre cas présentant une arthrose globale de<br />
l’articulation, cette ostéotomie trouve probablement ses limites à<br />
un stade avancé de la maladie où elle ne peut restituer un cartilage<br />
phalangien proximal sain, celui-ci était préalablement arthrosique.<br />
La correction chirurgicale <strong>des</strong> déformations associées du premier<br />
rayon est à discuter car par cas : sur <strong>les</strong> 8 hallux valgus préopératoires<br />
asymptomatiques, 3 le sont restés et 5 se sont aggravés,<br />
dont 2 ont été opérés.<br />
CONCLUSION. Les résultats initiaux régulièrement satisfaisants<br />
de l’ostéotomie de Gauthier pour nécrose <strong>des</strong> têtes métatarsiennes<br />
se confirment sur le long terme et s’améliorent avec le<br />
temps en terme de mobilité, ce qui en fait une technique de choix<br />
dans cette indication.<br />
*F. Rogé, Service d’Orthopédie, Hôpital de la Conception,<br />
147, boulevard Baille, 13385 Marseille Cedex 5.<br />
94 Prise en charge <strong>des</strong> lésions infectieuses<br />
de l’avant-pied sur neuropathie<br />
par arthrodèse tibiocalcanéenne<br />
montée par fixateur<br />
d’Ilizarov : à propos de 10 cas<br />
C. DAUZAC*, P. GUILLON, L.SCHMIDER,<br />
C. MEUNIER, P.MOINET, J.-M. CARCOPINO<br />
INTRODUCTION. Les lésions infectieuses de l’avant-pied sur<br />
neuropathie sont dans l’immense majorité <strong>des</strong> cas la conséquence<br />
de maux perforants plantaires chez le diabétique. Lorsque le traitement<br />
conservateur de ces lésions n’est plus possible, il convient<br />
de bien choisir le niveau d’amputation qui traitera le problème de<br />
façon radicale. Ce travail se propose d’évaluer le résultat de 10<br />
arthrodèses tibio-calcanéennes dont l’originalité est d’être montée<br />
par fixateur externe d’Ilizarov.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Neuf patients ont bénéficié de<br />
cette technique entre 1991 et 2002. La population était majoritairement<br />
masculine (7 hommes). La moyenne d’âge était de 65 ans.<br />
Huit patients étaient diabétiques et 7 d’entre eux présentaient <strong>des</strong><br />
maux perforants plantaires compliqués. Deux mala<strong>des</strong> avaient une<br />
atteinte bilatérale. Il a donc été réalisé 11 arthrodèses. L’intervention<br />
débutait par une désarticulation de l’interligne de Chopard et<br />
une astragalectomie. Après avoir effectué une section haute de la<br />
malléole externe, le tibia était coupé au ras de l’articulation. La<br />
coupe calcanéenne était verticale juste en arrière du sinus du tarse.<br />
Après avoir verticalisé le calcanéum, <strong>les</strong> deux tranches de section<br />
étaient mises en contact. L’arthrodèse était maintenue par un montage<br />
circulaire type Ilizarov comprenant deux anneaux dans le<br />
tibia et un dans le calcanéum.<br />
RÉSULTATS. Dix arthrodèses ont pu être revues avec un recul<br />
moyen de 20 mois. Nous avons obtenu 7 bons résultats et 3 échecs<br />
(2 nécroses du moignon et une suppuration grave). <strong>Tous</strong> <strong>les</strong> cas<br />
favorab<strong>les</strong> ont fusionné leur arthrodèse en 5 mois en moyenne.<br />
Le type de diabète, l’atteinte rénale, la durée d’évolution <strong>des</strong><br />
lésion, l’existence de lésions graves controlatéra<strong>les</strong> et le type de<br />
germes semblaient influencer <strong>les</strong> résultats.<br />
DISCUSSION. Les alternatives à l’intervention de Pirogoff<br />
sont l’amputation de Chopard, associée ou non à une arthrodèse<br />
sous-talienne, et l’amputation de Syme. La technique utilisée dans<br />
la série offre plusieurs avantages. Le fixateur externe circulaire<br />
évite le classique vissage en croix dans une ambiance septique.<br />
Les propriétés mécaniques du fixateur d’Ilizarov favorisent la<br />
cicatrisation et la fusion osseuse. Enfin, la verticalisation du calcanéum<br />
permet d’obtenir un moignon long et d’éviter une cicatrice<br />
trop antérieure, source de conflit avec l’orthèse.<br />
CONCLUSION. Cette technique chirurgicale permet de traiter<br />
radicalement <strong>des</strong> infections ostéo-articulaires proxima<strong>les</strong> de<br />
l’avant pied notamment chez le diabétique. Ses indications sont<br />
rares et réservées aux lésions non accessib<strong>les</strong> à l’amputation transmétatarsienne.<br />
Cette arthrodèse n’est possible que si la coque<br />
talonnière est saine. Elle permet d’obtenir un moignon long, stable,<br />
indolore et facilement appareillable.<br />
*C. Dauzac, Service d’Orthopédie,<br />
Centre Hospitalier Intercommunal le Raincy-Montfermeil,<br />
10, rue du Général-Leclerc, 93370 Montfermeil.
95 Apport de la tendinoscopie dans la<br />
pathologie tendineuse de la cheville<br />
: étude préliminaire à propos<br />
de 22 cas<br />
D. CHAUVEAUX*, V. SOUILLAC, O.LAFFENETRE,<br />
G. NOURISSAT<br />
INTRODUCTION. L’endoscopie représente maintenant une<br />
alternative à la chirurgie à foyer ouvert tant sur le plan diagnostique<br />
que thérapeutique pour <strong>les</strong> pathologies tendineuses de la cheville<br />
grâce aux travaux de Van Dijk débutés en 1994.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Depuis janvier 2000, selon une<br />
technique légèrement modifiée et utilisation exclusive d’un optique<br />
de 4,5, 22 tendinoscopies, chez 20 patients (âge moyen 34,7<br />
ans avec <strong>des</strong> extrêmes de 20 et 59 ans) présentant 16 fois <strong>des</strong><br />
antécédents post-traumatiques, ont été réalisées sous bloc nerveux<br />
périphérique, pour l’exploration <strong>des</strong> tendons, fibulaires (15), tibial<br />
postérieur (6), tibial antérieur (1), et ont bénéficié d’un suivi prospectif<br />
d’au moins 6 mois (extrêmes 6 et 30 mois). En préopératoire,<br />
tous <strong>les</strong> patients présentaient <strong>des</strong> douleurs plus ou moins<br />
bien systématisées, avec signes d’appel tendineux et 15 avaient<br />
bénéficié soit d’explorations isolées par échographie (4), IRM (7),<br />
scanner (1), ou associées IRM + échographie (3) ne retrouvant<br />
dans 7 cas aucune anomalie.<br />
RÉSULTATS. En peropératoire, la présence d’adhérences péritendineuses<br />
a été retrouvée 18 fois avec réaction inflammatoire<br />
99 Résultats à moyen terme <strong>des</strong><br />
arthrodèses tibio-astragaliennes<br />
S. DOJCINOVIC*, R. MAES, M.DELMI<br />
INTRODUCTION. Vingt-sept arthrodèses de cheville effectuées<br />
dans notre établissement de janvier 1990 à mars 2001 ont été<br />
revus rétrospectivement afin de juger à moyen terme le devenir de<br />
cette intervention chirurgicale. Le nombre moyen d’interventions<br />
avant l’arthrodèse de cheville se montait à 1,5. Le recul moyen<br />
était de 7 ans.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Il s’agissait de 21 arthroses<br />
post-traumatiques, 3 séquel<strong>les</strong> d’arthrites septiques, 2 cas de<br />
poliomyélite et un cas de polyarthrite rhumatoïde. Quarantequatre<br />
pour cent <strong>des</strong> patients présentaient une arthrose préalable<br />
de l’articulation sous-astragalienne. Vingt et un patients ont béné-<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S67<br />
Séance du 11 novembre après-midi<br />
CHEVILLE/PIED<br />
nécessitant une résection dans 13 cas. Une lésion propre du tendon<br />
a été retrouvée 7 fois : (fissure (2), dilacération superficielle (2),<br />
induration (2), strangulation (1)) et a exigé un geste spécifique à<br />
l’aide de pinces ou d’une instrumentation motorisée. Dans un cas,<br />
aucune explication n’a pu être apportée à l’origine <strong>des</strong> douleurs.<br />
En postopératoire, 17 patients ont présenté une disparition<br />
totale de la douleur maintenue durant au moins 6 mois. Au recul<br />
maximum, un seul patient n’a pu être revu et 12 continuent à<br />
présenter une disparition totale de la symptomatologie algique,<br />
mais la réapparition de symptômes associés (craquements, gonflement)<br />
a été notée dans 5 cas. Au final, 4 patients se déclarent très<br />
satisfaits, 8 satisfaits, 4 déçus et 3 sont mécontents qui n’ont présenté<br />
aucune amélioration.Aucune aggravation par rapport à l’état<br />
initial et aucune complication en rapport direct avec la méthode<br />
n’ont été observées.<br />
CONCLUSION. Ces résultats, reflet de la première expérience<br />
française, sont donc inférieurs à ceux de Van Dijk qui rapporte 80<br />
% de bons résultats sur 85 tendinoscopies chez 70 patients mais<br />
permettent de confirmer l’intérêt de cette technique dans <strong>les</strong> ténosynovites,<br />
<strong>les</strong> adhérences et <strong>les</strong> ruptures partiel<strong>les</strong> <strong>des</strong> tendons de<br />
la cheville, pas toujours objectivées par imagerie et d’envisager<br />
son évaluation définitive à la faveur de séries plus étoffées et mieux<br />
sélectionnées.<br />
*D. Chauveaux, Service de Chirurgie Orthopédique et<br />
Traumatologique, CHU Pellegrin, Tripode 6 e étage,<br />
place Amélie-Raba-Léon, 33076 Bordeaux Cedex.<br />
ficié d’une voie trans-fibulaire, 5 patients ont un fixateur externe et<br />
une patiente a eu une fixation avec une plaque 90 LC-DCP 4.5.<br />
RÉSULTATS. La consolidation a été acquise au bout de 13<br />
semaines. Nous avons déploré 3 nécroses cutanées sur <strong>les</strong> abords<br />
externes (11 %), deux infections superficiel<strong>les</strong> (7 %), un axonotmesis<br />
du nerf tibial postérieur (3 %) et un cas de pseudarthrose<br />
(3 %) ayant nécessité une reprise chirurgicale avec mise en place<br />
d’un clou transplantaire. Selon la classification de l’AOFAS, le<br />
score fonctionnel moyen à la révision était passé de 42 à 88,4 sur<br />
92. 88 % <strong>des</strong> patients étaient contents de l’intervention.A terme 75<br />
% <strong>des</strong> patients présentaient <strong>des</strong> signes d’arthrose sousastragalienne,<br />
évolutive. Trois patients étaient symptomatiques.<br />
CONCLUSION. L’arthrodèse de cheville reste une bonne intervention<br />
pour <strong>les</strong> arthroses symptomatiques de cheville bien qu’elle<br />
accélère à long terme l’apparition d’une arthrose dans <strong>les</strong> articulations<br />
sous-jacentes.<br />
*S. Dojcinovic, Hôpital Orthopédique de la Suisse Romande,<br />
5, avenue Pierre-Decker, 1005 Lausanne, Suisse.
3S68 78 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
100 Conséquence de l’arthrodèse tibiotalienne<br />
sur la cinématique et la<br />
cinétique du pied durant la marche<br />
F. SIRVEAUX*, C. BEYAERT, O.ROCHE,<br />
J. PAYSANT, J.-M. ANDRÉ, D.MOLÉ<br />
INTRODUCTION. Le but de cette étude était d’analyser <strong>les</strong><br />
perturbations de la dynamique du pied secondaires à l’arthrodèse<br />
tibio-talienne et <strong>les</strong> mécanismes d’adaptation induits par le chaussage.<br />
PATIENTS ET MÉTHODE. Une analyse tridimensionnelle de<br />
la marche a été effectuée (système Vicon 370) chez 10 patients<br />
porteurs d’une arthrodèse tibio-talienne fixée en position neutre et<br />
chez 10 sujets témoins appariés. La marche était enregistrée dans<br />
trois conditions : pieds nus, avec chaussures à vitesse de confort et<br />
avec chaussures à vitesse rapide. Au moment du lever du talon ont<br />
été mesurées dans le plan sagittal l’inclinaison du tibia par rapport<br />
au sol, la flexion du genou, l’angle entre tibia et avant-pied. La<br />
position de la force de réaction du sol (FRS) par rapport à la<br />
cheville a été mesurée durant la phase d’appui et au moment du<br />
lever du talon. Les comparaisons statistiques ont porté sur le côté<br />
arthrodésé, le côté controlatéral et le groupe témoin.<br />
RÉSULTATS. Le lever du talon était significativement plus précoce<br />
du côté arthrodésé par rapport au côté controlatéral et au<br />
groupe témoin. Au moment du lever du talon, le genou était en<br />
extension complète dans <strong>les</strong> trois groupes. La FRS se déplaçait<br />
plus précocement vers l’avant mais était plus postérieure lors du<br />
lever précoce du talon du côté arthrodésé par rapport au côté<br />
controlatéral et au groupe témoin. Le port de chaussures a permis,<br />
du côté arthrodésé, de retarder le lever du talon et d’augmenter<br />
l’inclinaison du tibia du moment du lever du talon, de diminuer la<br />
vitesse de déplacement antérieure de la FRS. Cependant la FRS<br />
restait postérieure au moment du lever du talon par rapport au<br />
groupe témoin. L’augmentation de la vitesse de marche entraîne,<br />
du côté arthrodésé, un lever plus précoce du talon associé dans le<br />
même temps à une réduction de l’inclinaison antérieure du tibia et<br />
à une position plus postérieure de la FRS.<br />
DISCUSSION. Le lever précoce du talon du côté arthrodésé<br />
permet de poursuivre l’inclinaison antérieure du tibia et d’augmenter<br />
la longueur du pas. Cependant, il survient alors que la FRS<br />
n’a pas encore atteint la métatarsophalangienne, augmentant ainsi<br />
<strong>les</strong> contraintes sur l’arrière pied et le médio-pied. Le port de chaussure<br />
permet d’améliorer <strong>les</strong> paramètres cinématiques du pied et<br />
diminue <strong>les</strong> contraintes au niveau <strong>des</strong> articulations sous jacentes à<br />
l’arthrodèse. L’augmentation de la vitesse aggrave <strong>les</strong> perturbations<br />
de la dynamique du pied lors de la marche.<br />
*F. Sirveaux, Clinique de Traumatologie et d’Orthopédie,<br />
49, rue Hermite, 54052 Nancy Cedex.<br />
101 Analyse opto-électronique de la<br />
marche après arthrodèse<br />
métatarso-phalangienne de l’hallux<br />
D. GIRARD*, L. GALOIS, F.PFEFFER,<br />
D. MAINARD, J.-P. DELAGOUTTE<br />
INTRODUCTION. Deux questions ont motivé l’analyse optoélectronique<br />
de la marche après arthrodèse métatarsophalangienne<br />
de l’hallux : Quel<strong>les</strong> sont dans <strong>les</strong> trois plans de<br />
l’espace <strong>les</strong> modifications observées lors d’un cycle de marche sur<br />
terrain plat ? L’essentiel de la compensation de l’arthrodèse<br />
s’effectue-t’il au niveau talo-crural ou interphalangien ?<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Notre série comprend 12<br />
patients (10 femmes et 2 hommes, dont l’âge moyen est de 60,7<br />
ans). Neuf patients ont bénéficié d’une arthrodèse unilatérale et<br />
trois d’une arthrodèse bilatérale. L’examen opto-électronique<br />
était pratiqué pieds nus, le patients étant en sous-vêtements et<br />
muni de 27 mires, dont une mire miniaturisée située à l’extrémité<br />
distale de chacun <strong>des</strong> hallux. Trois enregistrements vali<strong>des</strong> étaient<br />
retenus.<br />
RÉSULTATS. Les paramètres généraux ainsi que <strong>les</strong> valeurs<br />
cinétiques et cinématiques de la marche n’étaient pas modifiés<br />
(hormis une diminution non significative de la dorsiflexion maximale<br />
de la cheville). Ont été mis en évidence du côté arthrodésé :<br />
une diminution significative de la force de propulsion dans <strong>les</strong><br />
plans antéro-postérieur et vertical ; un décollement significativement<br />
plus tardif du talon ; le passage systématique de la force de<br />
réaction du sol en avant de l’articulation métatarso-phalangienne<br />
(jamais du côté sain).<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. Nous pouvons proposer<br />
une explication cohérente à ces différentes observations : il s’agit<br />
d’une modification de la cinétique du roulement s’effectuant sous<br />
la tête du premier métatarsien. Lorsque le pied est à plat sur le sol,<br />
au cours du roulement autour de la cheville, le transfert du poids du<br />
corps se fait de façon plus précoce et massive vers l’avant du pied.<br />
Alors que chez le sujet sain il se situe sous l’articulation métatarsophalangienne<br />
de l’hallux, chez tous nos patients l’essentiel du<br />
poids du corps se situe sous l’articulation interphalangienne de<br />
l’hallux. Lorsque le roulement autour de la cheville est terminé, le<br />
roulement autour de l’articulation interphalangienne peut alors<br />
s’effectuer. Le centre du roulement étant plus distal, <strong>les</strong> patients<br />
ont tendance à décoller le talon plus tardivement. Lors de la phase<br />
de propulsion, l’existence d’un bras de levier plus important limite<br />
la force de propulsion expliquant la valeur moindre du pic de<br />
propulsion du côté arthrodésé.<br />
Grâce à la présence <strong>des</strong> mires situées à l’extrémité distale de<br />
l’hallux, nous avons pu montrer que l’essentiel de la compensation<br />
de l’arthrodèse se fait au niveau de l’articulation interphalangienne,<br />
exposant cette dernière à la dégénérescence arthrosique.<br />
*D. Girard, Secrétariat du service COT, Hôpital Central,<br />
29, avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny,<br />
54035 Nancy Cedex.
102 Innervation du muscle long extenseur<br />
de l’hallux : étude anatomique<br />
et application dans <strong>les</strong> fractures de<br />
jambe<br />
Z. BELKHEYAR*, A.-M. ABOU-CHAAYA,<br />
A. OUESLATI, E.CHAVANNES, P.COTTIAS<br />
INTRODUCTION. La paralysie isolée du long extenseur de<br />
l’hallux est une complication rare dans <strong>les</strong> suites <strong>des</strong> fractures de la<br />
jambe. Elle peut dans certains cas orienter vers le diagnostic erroné<br />
d’un syndrome <strong>des</strong> loges ou d’une incarcération musculaire.<br />
ÉTUDE ANATOMIQUE. Nous avons réalisé une dissection sur<br />
10 cadavres frais. Le muscle long extenseur de l’hallux est innervé<br />
par une branche du nerf fibulaire profond, qui naît à 15 cm de<br />
l’interligne talo-crural ce dernier est directement au contact du<br />
périoste de la diaphyse tibiale. Dans cette localisation, cette branche<br />
peut être directement sectionnée lors du traumatisme ou lors<br />
<strong>des</strong> manœuvres de réduction et d’alésage.<br />
CAS CLINIQUE. Un de nos patients, âgé de 30 ans, avait eu<br />
une fracture du 1/3 moyen de la jambe traitée par enclouage<br />
centro-medullaire. Nous avions constaté dans <strong>les</strong> suites opératoires<br />
une paralysie isolée de l’extenseur de l’hallux. Le caractère<br />
neurogène isolé de cette paralysie a été confirmée par une exploration<br />
éléctomyographique.<br />
CONCLUSION. Cette observation est intéressante car elle<br />
illustre l’atteint directe de l’innervation du muscle long extenseur<br />
de l’hallux, une étiologie qui, à notre connaissance, n’avait fait<br />
l’objet d’aucune <strong>des</strong>cription auparavant.<br />
*Z. Belkheyar, CHG Saint-Denis,<br />
2, rue du Docteur-Delafontaine, 93205 Saint-Denis.<br />
103 Arthrodèse sous-talienne miniinvasive<br />
par évidement comblement<br />
du sinus du tarse : à propos<br />
de 55 cas<br />
H. LELIEVRE*, J.-F. LELIEVRE, M.KASSAB<br />
INTRODUCTION. Les arthrodèses sous-taliennes ont un taux<br />
de fusion de 94 %. El<strong>les</strong> présentent un risque cutané et neurologique<br />
superficiel non négligeable. Nous réalisons depuis 1985 une<br />
arthrodèse partielle par évidemment comblement du sinus du tarse<br />
par un mini-abord. Cette technique permet elle de diminuer la<br />
morbidité tout en conservant un taux de fusion maximal ?<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Nous avons revu <strong>les</strong> dossiers de<br />
52 patients (55 arthrodèses) opérés par le même opérateur. <strong>Tous</strong> <strong>les</strong><br />
patients ont été remis en charge immédiatement dans une botte de<br />
marche pour une durée de 10 semaines. Nous avons étudié la<br />
vitesse de fusion, l’axe de l’arrière-pied, la survenue de complications<br />
et le devenir fonctionnel (score de Kitaoka).<br />
RÉSULTATS. Une seule arthrodèse n’était pas fusionnée à la<br />
dixième semaine. Une nécrose cutanée a été notée chez un patient<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S69<br />
ayant nécessité un abord extensif pour d’autres gestes chirurgicaux.<br />
On a retrouvé une infection superficielle et une algodystrophie.<br />
Six pieds avaient un défaut d’axe résiduel en postopératoire<br />
secondaire à une irréductibilité de la déformation en préopératoire.<br />
Le score fonctionnel moyen en préopératoire était de 39/100 et de<br />
86/94 en postopératoire.<br />
CONCLUSION. Cette technique donne d’excellents résultats<br />
avec une morbidité minimale mais ne peut être proposée que s’il<br />
n’y a pas de désaxation irréductible en préopératoire.<br />
*H. Lelievre, Service d’Orthopédie et Traumatologie,<br />
CHU Pitié Salpétrière, 47-83, boulevard de l’Hôpital,<br />
75651 Paris Cedex 13.<br />
104 Résultats à long terme du traitement<br />
du pied plat valgus réductible<br />
de l’adulte par arthrodèse médiotarsienne<br />
: à propos de 22 cas<br />
V. STAQUET*, X. CASSAGNAUD, P.BAROUK,<br />
S. AUDEBERT, C.MAYNOU, H.MESTDAGH<br />
INTRODUCTION. Dans le traitement chirurgical du pied plat<br />
valgus réductible de l’adulte, l’arthrodèse médiotarsienne assure<br />
l’indolence et la correction de la déformation. Le but du travail<br />
était l’évaluation radio-clinique <strong>des</strong> résultats de cette intervention.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. L’étude rétrospective portait sur<br />
22 pieds plats valgus réductib<strong>les</strong> (stade 2 de Johnson) chez 19<br />
patients (11 hommes, 8 femmes), âgés en moyenne l de 43 ans<br />
(15-75).<br />
La révision clinique évaluait la douleur, la fonction et <strong>les</strong> mobilités<br />
selon <strong>les</strong> barèmes de l’AOFAS et de Mann. Sur <strong>les</strong> radiographies<br />
de face et de profil en charge avec cerclage de Meary, étaient<br />
appréciés l’angle de Djian, l’alignement talo-métatarsien, la pente<br />
talienne, le valgus calcanéen et le stade arthrosique <strong>des</strong> articulations<br />
voisines.<br />
RÉSULTATS. Le recul moyen était de 88 mois (de 6 à 243<br />
mois). Deux pseudarthrodèses avaient évolué favorablement après<br />
greffe spongieuse. Le score de Kitaoka était de 73,5 points/94 (de<br />
53 à 94). La douleur et la fonction passaient respectivement de 2,8<br />
à 1,1/4 pts) et de 3, 5 à 1,6 points (/4 pts) sur <strong>les</strong> échel<strong>les</strong> de Mann.<br />
Seule la mobilité en flexion/extension restait inchangée.<br />
Le pied était axé dans 68 % <strong>des</strong> cas (7,5 pts). Si <strong>les</strong> valeurs<br />
moyennes de la pente talienne et de la divergence talo-calcanéenne<br />
étaient normalisées, il persistait un défaut de correction de l’angle<br />
de Djian et une cassure de la ligne, de Meary dans, respectivement,<br />
68 % et 41 % <strong>des</strong> cas. Le valgus calcanéen était réduit de 6,6°<br />
(16,6° à 10°), 86 % <strong>des</strong> pieds restaient plats au podoscope.<br />
Dans 50 % <strong>des</strong> cas, <strong>les</strong> articulations voisines présentaient une<br />
progression de la dégénérescence arthrosique avec retentissement<br />
clinique dans un seul, cas (4,5 %).<br />
Subjectivement, <strong>les</strong> patients étaient très satisfaits ou satisfaits<br />
avec réserves mineures dans 73 % <strong>des</strong> cas ; aucun patient n’était<br />
mécontent. Objectivement, 68 % <strong>des</strong> résultats étaient excellents ou<br />
bons.
3S70 78 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. Nos résultats sur la douleur,<br />
la fonction, la mobilité, <strong>les</strong> complications et le taux de satisfaction<br />
restent comparab<strong>les</strong> à ceux de la littérature (Mann, Baxter,<br />
Steinhäuser).<br />
L’arthrodèse médiotarsienne est efficace sur la douleur et permet<br />
une récupération fonctionnelle satisfaisante sans morbidité<br />
supérieure à une simple arthrodèse talo-naviculaire (Harper).<br />
Néanmoins, si le pied est axé dans la majorité <strong>des</strong> cas, la restauration<br />
de la voûté plantaire reste cliniquement et radiographiquement<br />
limitée.<br />
L’hypermobilité compensatrice vraissemblable <strong>des</strong> articulations<br />
adjacentes crée <strong>des</strong> remaniements arthrosiques modérés et<br />
asymptomatiques plus de 7 ans après l’intervention.<br />
*V. Staquet, Service d’Orthopédie,<br />
Hôpital Roger-Salengro, 59037 Lille Cedex.<br />
105 Instabilité de cheville avec lésion<br />
démontrée en IRM de l’articulation<br />
sous-talienne : résultat de l’intervention<br />
de Castaing dans une série<br />
de 46 cas<br />
O. JARDE*, S. MASSY, G.BOULU, G.ALOVOR,<br />
A. DAMOTTE<br />
INTRODUCTION. Les auteurs rapportent une série de 46 cas<br />
d’instabilité de l’articulation sous-talienne isolée ou associée à<br />
une atteinte de la tibio-tarsienne, traitée par une ligamentoplastie<br />
selon la méthode de Castaing de 1988 à 1999.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. En pré-opératoire, <strong>les</strong> symptômes<br />
étaient : une instabilité, un dérobement du pied, <strong>des</strong> entorses à<br />
répétition et <strong>des</strong> douleurs. Un syndrome du sinus du tarse était<br />
retrouvé dans 39 % <strong>des</strong> cas. Les 46 patients avaient bénéficié d’une<br />
IRM et cet examen retrouvait <strong>des</strong> lésions du ligament en haie dans<br />
tous <strong>les</strong> cas. Les résultats ont été appréciés selon le score de Kitoaka.<br />
RÉSULTATS. L’instabilité en post-opératoire avec un recul<br />
moyen de 5,7 ans avait disparu dans 80 % <strong>des</strong> cas. La douleur avait<br />
disparu dans 63 % <strong>des</strong> cas. L’examen montrait une diminution de<br />
la mobilité de l’articulation sous-talienne en inversion dans 43 %<br />
<strong>des</strong> observations avec <strong>des</strong> valeurs comprises entre 50 et 70 % par<br />
rapport au pied controlatéral mais sans retentissement fonctionnel<br />
notable. Trois patients présentaient <strong>des</strong> signes radiologiques<br />
d’arthrose débutante sur le pied opéré. Les résultats globaux<br />
étaient très bons dans 82 % <strong>des</strong> cas, moyen dans 11 %, moyen et<br />
mauvais dans 7 %. L’indice de satisfaction <strong>des</strong> patients était de<br />
87 %.<br />
DISCUSSION. L’étude de cette série montre une corrélation<br />
entre un indice de masse corporelle supérieur à 26 kg/m 2 ou une<br />
laxité constitutionnelle et <strong>les</strong> résultats moyens ou mauvais. Par<br />
ailleurs, plus le délai entre le premier épisode d’entorse et la prise<br />
en charge chirurgicale de l’instabilité résiduelle est long, moins<br />
bon est le résultat final. La comparaison <strong>des</strong> résultats de notre<br />
technique aux autres ligamentoplastie montre <strong>des</strong> résultats comparab<strong>les</strong>.<br />
CONCLUSION. L’intervention de Castaing a <strong>des</strong> résultats<br />
comparab<strong>les</strong> aux autres techniques de ligamentoplastie. La réparation<br />
directe <strong>des</strong> ligaments de l’articulation sous-talienne doit<br />
néanmoins être privilégiée dans un premier temps en réservant la<br />
ligamentoplastie de Castaing aux échecs de la réparation.<br />
*O. Jarde, CHU Nord, place Victor-Pauchet,<br />
80054 Amiens Cedex 1.<br />
106 Greffes ostéochondra<strong>les</strong> autologues<br />
du dôme talien : à propos de<br />
36 cas de mosaicplastyT<br />
G. VERSIER*, P. CHRISTEL, C.BURES, P.DJIAN,<br />
Y. SERRE<br />
INTRODUCTION. Les greffes ostéochondra<strong>les</strong> autologues<br />
selon la technique de la mosaicplastyt sont utilisées depuis une<br />
dizaine d’années pour traiter <strong>les</strong> pertes de substances ostéocartilagineuses<br />
en zone portante. El<strong>les</strong> ont l’avantage de pouvoir<br />
réparer ces lésions par du cartilage hyalin. L’application de cette<br />
technique aux lésions du dôme du talus est plus récente, elle<br />
découle <strong>des</strong> bons résultats obtenus sur le genou. Le but de cette<br />
étude est d’évaluer rétrospectivement <strong>les</strong> résultats obtenus sur 36<br />
patients porteurs d’une perte de substance du dôme talien opérés<br />
de la cheville entre juin 1997 et (septembre 2001 selon la technique<br />
décrite par L.Hangody, et l’apport de l’ostéotomie malléolaire.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Les patients âgés de 17 à 53 ans,<br />
tous gênés par leur cheville, ont été regroupés à partir de 3 centres<br />
différents. Les trois chirurgiens étaient seniors et avaient déjà une<br />
expérience de la technique de la mosaicplastyt sur le genou. Pour<br />
toutes <strong>les</strong> opérations, l’instrumentation utilisée était le système<br />
Acufex Mosaicplastyt du laboratoire Smith-Nephew. L’abord de<br />
la cheville s’est fait rarement par arthrotomie directe, le plus souvent<br />
par ostéotomie de la malléole interne ou externe. Les greffons<br />
ont été prélevés avec l’accord préalable du patient sur une zone<br />
articulaire non portante du genou homolatéral. Les résultats ont été<br />
évalués à l’aide de la fiche de l’international Cartilage Repair<br />
Society modifiée pour la cheville. L’analyse statistique a été effectuée<br />
à l’aide du programme informatique Epi Info 6.0.<br />
RÉSULTATS. La profondeur <strong>des</strong> lésions était toute de grade III<br />
ou IV ICRS. Il s’agissait de 21 ostéochondrites disséquantes, 13<br />
avulsions chondra<strong>les</strong> ou ostéo-chondra<strong>les</strong> et 2 nécroses du dôme.<br />
Afin de pouvoir accéder correctement aux lésions, 27 cas ont<br />
nécessité une ostéotomie de la malléole interne et 6 cas une ostéotomie<br />
de la malléole externe. La greffe a utilisé en moyenne 3<br />
greffons par patient.Après un recul moyen de 18 mois, <strong>les</strong> résultats<br />
ont été jugés excellents ou bons dans 81 % <strong>des</strong> cas (grade I et II<br />
ICRS). Quatorze pour cent <strong>des</strong> patients rapportaient <strong>des</strong> douleurs<br />
peu invalidante du genou. Toutes <strong>les</strong> ostéotomies malléolaires ont<br />
consolidé sans problème. Aucun patient n’a été aggravé.<br />
DISCUSSION. La technique est à réserver à <strong>des</strong> patients jeunes<br />
et symptomatiques. Malgré <strong>des</strong> gestes ; plus traumatisants que lors<br />
de technique traditionnelle, elle permet d’obtenir en apportant du<br />
cartilage hyalin, <strong>des</strong> résultats plus satisfaisants à court et moyen<br />
terme ; sur le plan anatomique, histologique et fonctionnel. L’utilisation<br />
de l’ostéotomie malléolaire interne ou externe s’impose
sans risque majeur. C’est l’unique moyen de bien exposer <strong>les</strong><br />
lésions, en particulier cel<strong>les</strong> qui sont postérieures. La morbidité du<br />
site donneur, bien que non significativement prouvée dans notre<br />
série, semble être le seul point à surveiller.<br />
CONCLUSION. La greffe ostéo-chondrale autologue par<br />
mosaicplastyt est une technique validée pour la cheville. L’ostéotomie<br />
malléolaire a montré son importance pour sa bonne réalisation.<br />
Une étude à long terme sera nécessaire pour évaluer la stabilité<br />
<strong>des</strong> résultats, l’éventuelle morbidité du site donneur, et le rôle<br />
préventif dans l’arthrose de cette technique.<br />
*G. Versier, Service d’Orthopédie, Hôpital Begin,<br />
69, avenue de Paris, 94160 Saint-Mandé.<br />
107 Évaluation d’une consultation multisites<br />
en chirurgie de la cheville et du<br />
pied<br />
T. CRAVIARI*, J.-L. BESSE, G.CURVALE,<br />
M. MAESTRO, Y.TOURNÉ<br />
INTRODUCTION. Il s’agit d’un travail prospectif de tentative<br />
de collaboration inter-hospitalière dans le domaine de la chirurgie<br />
du pied et de la cheville répondant aux volontés <strong>des</strong> tutel<strong>les</strong>. Cette<br />
collaboration a été organisée entre un chirurgien demandeur et<br />
quatre référents régionaux spécialistes de la cheville et du pied, de<br />
façon à évaluer <strong>les</strong> concordances et différences <strong>des</strong> avis <strong>des</strong><br />
experts.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Les patients pour <strong>les</strong>quels un<br />
avis a été demandé ont été sélectionnés par le chirurgien demandeur<br />
en fonction <strong>des</strong> difficultés diagnostiques et/ou de difficultés<br />
d’indication thérapeutique. Les avis aux référents ont été deman-<br />
108 Un nouvel implant pour <strong>les</strong> fractures<br />
de l’humérus proximal : la plaque à<br />
corbeille. Étude expérimentale<br />
M. EHLINGER*, P. GICQUEL, P.CLAVERT,<br />
F. BONNOMET, J.-F. KEMPF<br />
INTRODUCTION. Une étude comparant trois systèmes<br />
d’ostéosynthèse <strong>des</strong> fractures de l’humérus proximal a permis<br />
d’élaborer un implant rigide extra-médullaire : la plaque à corbeille.<br />
Celle-ci tire son originalité de la fixation <strong>des</strong> tubérosités par<br />
un système de griffes, associé ou non à un verrouillage de la vis<br />
centrale céphalique.<br />
Le but de ce travail est triple : vérifier la résistance du prototype,<br />
évaluer l’apport <strong>des</strong> griffes et l’intérêt du verrouillage.<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S71<br />
Séance du 11 novembre après-midi<br />
TRAUMATOLOGIE<br />
dés par courrier électronique. L’observation et le bilan radiographique<br />
ont été protocolisés selon <strong>les</strong> pathologies. Le choix de la<br />
prise en charge finale a été pris par le chirurgien demandeur.<br />
RÉSULTATS. Sur 450 patients vu en pathologie du pied et de la<br />
cheville 30 dossiers ont été adressés aux experts. Les pathologies<br />
en causes touchaient l’avant-pied (46 %), le médio-pied (16 %),<br />
l’arrière-pied (7 %), la cheville (31 %). Le délai moyen de réponse<br />
aux dossiers était de 11 jours (1-60 jours). Les experts ont répondu<br />
à tous <strong>les</strong> dossiers (120 réponses), mais 4 fois (3 %) ils n’ont pu se<br />
prononcer. L’indice d’accord diagnostique entre <strong>les</strong> experts était<br />
de 3,2/4, l’indice d’accord concernent <strong>les</strong> indications thérapeutiques<br />
entre <strong>les</strong> experts était de 2,6/4. L’indice d’accord entre la<br />
thérapeutique proposée au patient et celle proposée par <strong>les</strong> référents<br />
était de 2,6/3.<br />
DISCUSSION. Dans cette étude sont analysés <strong>les</strong> avantages<br />
pour <strong>les</strong> patients, la responsabilité <strong>des</strong> référents et du chirurgien<br />
demandeur ainsi que le problème de la rémunération de ce mode<br />
de fonctionnement. Comparé aux autres technologies le courrier<br />
électronique s’est imposé du fait de sa simplicité, de son faible<br />
coût et de la qualité <strong>des</strong> images transférées. Ce travail montre du<br />
fait de la concordance <strong>des</strong> avis que l’aide d’un référent dans la<br />
pathologie du pied est très certainement utile et possible par téléexpertise.<br />
Plus encore le recourt à plusieurs référents augmente la<br />
précision de part la complémentarité <strong>des</strong> réponses données et facilite<br />
la prise en charge <strong>des</strong> cas diffici<strong>les</strong>. Il est également souligné<br />
l’importance de la connaissance mutuelle de différents collaborateurs.<br />
CONCLUSION. Ce travail est la première étape en vue de la<br />
mise en place d’un réseau de soins en pathologie du pied et de la<br />
cheville. Cela pourrait permettre de proposer une prise en charge<br />
graduée de cette pathologie.<br />
*T. Craviari, Hôpital de Gap,<br />
place Auguste-Muret, 05000 Gap.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Nous rapportons l’étude expérimentale<br />
du prototype, comparé à un implant connu (plaque Maconor2),<br />
par 2 séries de tests mécaniques statiques sur une machine<br />
Instrum. Ces tests sont réalisés sur 20 pièces anatomiques congelées<br />
de DMO connue, utilisant un modèle de fracture à quatre<br />
fragments. Au hasard cinq groupes ont été formés et un implant a<br />
été attribué à chacun. Les premiers tests (3 groupes) sont réalisés<br />
en compression axiale, reproduisant l’abduction dans le plan de<br />
l’omoplate, analysant le comportement mécanique global du prototype<br />
et évaluant le système de verrouillage. Les seconds tests (2<br />
groupes) réalisés en traction, analysent le comportement <strong>des</strong> tubérosités<br />
fixées. Les montages sont évalués par mesure de la résistance<br />
mécanique jugée sur la charge limite notée à l’inflexion de la<br />
courbe contrainte/déformation, ainsi que sur la rigidité notée par la<br />
pente.<br />
RÉSULTATS. La première étude montre que l’implant, amélioré<br />
du système de verrouillage, présente de meilleures caracté-
3S72 78 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
ristiques mécaniques globa<strong>les</strong> sans pourtant qu’apparaisse une<br />
différence. La meilleure tenue <strong>des</strong> tubérosités par <strong>les</strong> griffes, que<br />
laissait présager la première partie, est renforcée par <strong>les</strong> données<br />
de l’observation de la seconde, sans qu’apparaisse néanmoins une<br />
différence.<br />
DISCUSSION. Le prototype amélioré du système de verrouillage<br />
présente une résistance mécanique équivalente à l’élément<br />
de référence. L’intérêt du verrouillage n’a pu être établi,<br />
même s’il est pressenti sur l’amélioration de la tolérance au chargement<br />
par une meilleure répartition <strong>des</strong> contraintes. L’apport du<br />
système de griffes n’est pas démontré, même si l’observation<br />
confirme <strong>les</strong> espoirs portés. Les données de l’observation et de la<br />
littérature concernant la biomécanique de l’épaule, suggèrent que<br />
<strong>des</strong> tests réalisés sur une plus grande série auraient permis de<br />
mettre en évidence une différence. Le faible effectif est la plus<br />
importante limite de notre étude.<br />
CONCLUSION. La comparaison <strong>des</strong> résultats <strong>des</strong> résistances<br />
mécaniques avec <strong>les</strong> contraintes théoriques de la littérature exercées<br />
sur l’humérus proximal montre que le prototype est adapté,<br />
permettant une mobilisation postopératoire immédiate. Une étude<br />
clinique prospective est en cours dans notre service.<br />
*M. Ehlinger, Département d’Orthopédie et de Traumatologie,<br />
CHU de Hautepierre, avenue Molière, 67000 Strasbourg.<br />
109 Traitement <strong>des</strong> instabilités acromioclaviculaires<br />
chroniques par résection<br />
du 1/4 externe de la clavicule et<br />
ligamentoplastie coraco-claviculaire<br />
par le ligament acromio-coracoïdien<br />
prélevé par acromioplastie<br />
E. TATON*, J.-C. LE HUEC<br />
INTRODUCTION. Ce travail est réalisé dans le but de proposer<br />
un traitement chirurgical de réalisation simple et efficace au long<br />
terme dans <strong>les</strong> instabilités acromio-claviculaires chroniques et<br />
symptomatiques.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Les dissections de 10 cadavres<br />
et 20 épau<strong>les</strong> précisent la biométrie du ligament acromiocoracoïdien<br />
(LAC), ses possibilités de mobilisation et fixation<br />
claviculaire et sa résistance à la rupture calculée en utilisant un<br />
instrument dynamométrique.<br />
La technique proposée s’apparente à la reconstruction selon<br />
Weaver-Dunn modifiée par Bircher. Une acromioplastie désinsère<br />
le LAC et le porte par retournement sur une tranche de résection<br />
claviculaire distale avant de le fixer par vissage ou haubanage.<br />
RÉSULTATS. La taille de la tranche de section d’acromioplastie<br />
varie entre 18 et 25 mm de diamètre. Le LAC est d’aspect<br />
quadrilatéral avec en moyenne 37,7 mm de longueur antérieure<br />
pour 25,6 mm postérieure, 16 mm de largeur médiale (coracoïdienne)<br />
pour 22,3 mm de latérale et 1,55 mm d’épaisseur. L’angle<br />
de retournement du LAC pour se fixer sur une tranche claviculaire<br />
de 10,8 mm de haut sur 21,8 mm de profondeur est en moyenne de<br />
68. La distance coraco-claviculaire est comprise entre 15,7 mm et<br />
50,1 mm. La force de rupture moyenne du LAC est mesurée à<br />
11,5 daN.<br />
DISCUSSION. L’évolution arthrosique post-traumatique de<br />
l’articulation acromio-claviculaire instable impose une résection<br />
du 1/4 distal de la clavicule selon la technique de Baccarani qui<br />
doit être complétée par un geste de stabilisation. La technique de<br />
Weaver-Dunn semble insuffisante pour traiter <strong>les</strong> instabilités chroniques<br />
stade IV et V de Rockwood. La distance entre le bord<br />
antérieur de la coracoïde et le bord postérieur de la clavicule est à la<br />
portée de la longueur ligamentaire acromio-coracoïdienne et la<br />
marge disponible permet le réglage de la mise en tension avant la<br />
fixation qui peut se faire préférentiellement par un haubanage ou<br />
un vissage 3,5 sur rondelle avec une compression et une stabilité<br />
satisfaisante et une bonne résistance à l’arrachement.<br />
CONCLUSION. La biométrie du LAC et la largeur <strong>des</strong> tranches<br />
d’acromioplastie et d’ostéotomie claviculaire offrent de nombreuses<br />
possibilités de réglages et de fixation permettant de s’adapter à<br />
la morphologie de chacun avec une bonne compression et une<br />
solidité laissant présumer d’excellents résultats à long terme.<br />
*E. Taton, Service de Chirurgie Orthopédique et<br />
Traumatologie, Hôpital d’Instruction <strong>des</strong> Armées<br />
Robert-Picqué, 351, route de Toulouse,<br />
33998 Bordeaux Armées.<br />
110 Fractures acétabulaires : étude<br />
radio-clinique rétrospective de 136<br />
patients avec un recul moyen de 16<br />
ans<br />
L. BOULARD*, B.-E. ELIAS, O.FORTERRE,<br />
P. CLAPPAZ, F.GIVRY, P.GARBUIO<br />
INTRODUCTION. Les fractures de l’acétabulum dont le traitement<br />
est bien codifié sont pourvoyeuses d’arthrose et <strong>les</strong> séries à<br />
plus de dix ans de recul sont rares. Les auteurs rapportent une série<br />
de 136 fractures de l’acétabulum revues avec un recul moyen de 16<br />
ans.<br />
MATÉRIEL. Cinq cent cinquante-quatre fractures de l’acétabulum<br />
ont été traitées entre 1972 et 1996. Cent trente-six patients ont<br />
été revus par un opérateur indépendant. La fracture était classée<br />
selon Judet et Letournel. La réduction était évaluée grâce à <strong>des</strong><br />
clichés du bassin de face et de trois-quarts selon <strong>les</strong> critères du<br />
symposium de la <strong>Sofcot</strong> de novembre 1981. <strong>les</strong> paramètres per et<br />
post-opératoires (saignement, complications) étaient notés.<br />
L’évolution fonctionnelle de la hanche était appréciée par <strong>les</strong> critères<br />
de Merle d’Aubigné.<br />
RÉSULTATS. Trente-huit pour cent <strong>des</strong> fractures ont été traitées<br />
orthopédiquement. Quarante et un pour cent étaient non<br />
déplacées, 54 % peu déplacées et 5 % présentaient une contreindication<br />
à la chirurgie. La réduction a été obtenue dans 28 % <strong>des</strong><br />
fractures déplacées. Soixante et onze pour cent <strong>des</strong> patients traités<br />
orthopédiquement avaient un très bon ou bon résultat. Soixantedeux<br />
pour cent <strong>des</strong> fractures ont été opérées. Une réduction anatomique<br />
a été obtenue dans 80 % <strong>des</strong> cas. Les principa<strong>les</strong> complications<br />
étaient la lésion du nerf sciatique (14 %), <strong>les</strong> ossifications<br />
hétérotopiques (18 %) l’infection (5 %) et <strong>les</strong> vis intra-articulaires
(5 %). Soixante-neuf pour cent avaient un très bon ou bon résultat<br />
à long terme. Dix-neuf pour cent ont été opérés d’une prothèse<br />
totale de hanche avec un délai moyen de 8 ans. Les facteurs significativement<br />
liés à un mauvais résultat (p < 0,05) étaient l’âge, la<br />
luxation postérieure et l’expérience du chirurgien. Il existait une<br />
bonne corrélation entre le score fonctionnel et la présence d’une<br />
coxarthrose radiologique.<br />
DISCUSSION. Aucune série n’est rapportée dans la littérature<br />
avec un si grand recul. Pour <strong>les</strong> patients opérés, le pourcentage de<br />
très bons et bons résultats est inférieur aux autres séries malgré le<br />
pourcentage élevé de réduction anatomique. Celle-ci n’est donc<br />
pas la seule garante d’un bon résultat à long terme. Les autres<br />
facteurs pronostiques retrouvés dans la littérature sont la fracture<br />
de la tête fémorale, le type de fracture et la qualité de la réduction.<br />
Le recul important reste un facteur essentiel pour évaluer de façon<br />
pertinente la chirurgie articulaire.<br />
*L. Boulard, Service de Traumatologie-Orthopédie,<br />
Hôpital Jean-Minjoz, 25030 Besançon Cedex.<br />
111 Une nouvelle technique de fixation<br />
sacro-iliaque dans <strong>les</strong> ruptures<br />
traumatiques de l’anneau pelvien<br />
E. HOFFMANN*, N. LEVASSOR, L.RILLARDON,<br />
G. LAVELLE, P.GUIGUI<br />
INTRODUCTION. Les ruptures de l’anneau pelvien avec instabilité<br />
verticale et horizontale (type C de la classification de Tile)<br />
sont <strong>des</strong> indications classiques à une stabilisation chirurgicale <strong>des</strong><br />
lésions postérieures et parfois antérieures. Si <strong>les</strong> modalités de la<br />
fixation antérieure sont peu discutées, en revanche, de nombreuses<br />
techniques de fixation postérieure ont été décrites : vissage sacroiliaque<br />
à foyer ouvert ou percutané sous contrôle scopique ou<br />
tomodensitométrique, plaque antérieure sacro-iliaque, barre<br />
sacrée en compression s’appuyant latéralement sur <strong>les</strong> deux massifs<br />
iliaques postérieurs, fixation sacro-iliaque utilisant une vis<br />
sacrée et s’appuyant latéralement sur l’aile iliaque selon la technique<br />
de Galveston etc.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Nous proposons une nouvelle<br />
technique de fixation sacro-iliaque dans le traitement <strong>des</strong> ruptures<br />
de l’anneau pelvien associant une instabilité verticale et horizontale<br />
(type C de la classification de Tile). Cette technique de fixation<br />
présente l’originalité d’un contrôle <strong>des</strong> déplacements verticaux<br />
tout en autorisant, si besoin est, un certain degré de mobilité dans le<br />
plan horizontal afin de faciliter la réduction <strong>des</strong> lésions antérieures.<br />
Cette technique comporte la mise en place de 2 vis sacrées,<br />
l’une en S1 et l’autre en S2, et de 2 vis iliaques. Les vis iliaques<br />
sont insérées dans la crête iliaque postérieure à travers 2 connecteurs<br />
sacro-iliaques placés sur la tige reliant <strong>les</strong> 2 vis sacrées. La<br />
mise en butée <strong>des</strong> 2 connecteurs sur <strong>les</strong> têtes de vis permet un<br />
contrôle <strong>des</strong> déplacements verticaux. Si besoin est, l’absence de<br />
fixation <strong>des</strong> connecteurs sur <strong>les</strong> tiges autorise un certain degré de<br />
mobilité de l’hémi-bassin concerné dans le plan horizontal.<br />
RÉSULTATS. Cette technique a été utilisée à 4 reprises, <strong>les</strong><br />
réductions obtenues ont été anatomiques, aucune mobilisation<br />
secondaire du matériel d’ostéosynthèse ni aucun déplacement<br />
secondaire n’ont été constatés. La qualité de la fixation ainsi obte-<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S73<br />
nue autorise une reprise rapide de la position assise et une reprise<br />
précoce de la marche en appui complet. Ce type de fixation ne<br />
s’adresse qu’aux fractures de type C12 de la classification de Tile.<br />
*E. Hoffmann, Hôpital Beaujon,<br />
100, boulevard du Général-Leclerc, 92110 Clichy.<br />
112 Montage sacro-iliaque par vis polyaxia<strong>les</strong><br />
assisté par ordinateur pour<br />
pseudarthrose du sacrum<br />
J. DELÉCRIN*, F. GOUIN, N.PASSUTI<br />
INTRODUCTION. Certaines fractures du bassin à lésions postérieures<br />
par cisaillement peuvent être particulièrement instab<strong>les</strong><br />
et poser le problème d’une ostéosynthèse solide. Ces difficultés<br />
d’ostéosynthèse ont conduit à <strong>des</strong> montages comme le pontage <strong>des</strong><br />
2 articulations sacro-iliaques et la prise sur <strong>les</strong> pédicu<strong>les</strong> vertébraux,<br />
c’est à dire à ponter <strong>des</strong> articulations intactes. A partir d’un<br />
cas particulièrement instable de pseudarthrose d’une fracture<br />
déplacée passant par un pédicule de S1 et <strong>les</strong> trous sacrés associée<br />
à une large disjonction de la symphyse pubienne nous rapportons<br />
une technique originale d’ostéosynthèse basée sur l’assistance<br />
informatisée à partir d’images scanner.<br />
OBSERVATION. L’instabilité de l’hémibassin était à l’origine<br />
de pubalgies et d’une mobilité du foyer de pseudarthrose, mobilité<br />
responsable d’une sciatique S1 et de l’impossibilité de s’asseoir.<br />
La fracture et le déplacement n’avaient pas pu être initialement<br />
traités du fait de lésions viscéra<strong>les</strong> ouvertes associées ayant nécessité<br />
la réalisation d’une colostomie définitive et un long séjour en<br />
réanimation. Le problème technique était de stabiliser avec une<br />
ostéosynthèse postérieure ne pouvant pas utiliser le pédicule de S1<br />
et étant suffisamment rigide pour compenser l’impossibilité<br />
d’ostéosynthèse antérieure de la symphyse pubienne.<br />
TECHNIQUE OPÉRATOIRE. La technique originale a été de<br />
ponter le foyer de pseudarthrose transversalement à sa direction<br />
avec 2 barres d’ostéosynthèse rachidienne de type CD s’appuyant<br />
du côté sain sur 2 vis polyaxia<strong>les</strong> en S1 (dans le pédicule et l’aileron)<br />
et du côté de la pseudarthrose, sur 2 vis polyaxia<strong>les</strong> dans l’aile<br />
iliaque enfilant l’espace entre <strong>les</strong> cortica<strong>les</strong> interne et externe. Le<br />
montage était complété par 2 vis trans-ilio-sacrées passant par S1<br />
et S2 avec au préalable un démontage/avivement de la pseudarthrose.<br />
DISCUSSION. L’image virtuelle <strong>des</strong> instruments sur <strong>les</strong> images<br />
scanner, nous a permis de placer avec précision <strong>les</strong> 2 vis dans<br />
l’aile iliaque entre <strong>les</strong> 2 tab<strong>les</strong> osseuses sur un long trajet et de<br />
positionner en percutané en minimisant le risque neurologique, <strong>les</strong><br />
2 vis trans-ilio-sacrées en S1 et S2 sur cette fracture déplacée et<br />
enfin d’aviver la pseudarthrose jusqu’au bord antérieur du sacrum.<br />
Le montage final associait donc 4 vis et 2 barres à la partie postérieure<br />
du sacrum et 2 vis à la partie antérieure avec possibilité de<br />
compression perpendiculaire au foyer de pseudarthrose tout en<br />
respectant le rachis et l’articulation sacro-iliaque controlatérale. A<br />
5 ans de recul, le patient ne ressent que <strong>des</strong> dysesthésies et peut<br />
s’asseoir et marcher avec peu de limitation.
3S74 78 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
CONCLUSION. Ce cas particulier illustre la possibilité d’évoluer<br />
vers de nouvel<strong>les</strong> ostéosynthèses au moyen de l’assistance<br />
informatisée.<br />
*J. Delécrin, Service d’Orthopédie,<br />
CHU Hôtel Dieu, 44093 Nantes Cedex 1.<br />
113 Traumatologie assistée par ordinateur<br />
T. GAUTHERON*, M. COUTIER, S.BENJELLOUN,<br />
L. CHARDIN<br />
INTRODUCTION. Nous rapportons <strong>les</strong> résultats d’une étude<br />
utilisant la fluoronavigation pour réaliser la visée distale <strong>des</strong> clous<br />
de tibia ou de fémur, ainsi que le vissage <strong>des</strong> fractures cervica<strong>les</strong> de<br />
l’adulte et nous comparons la durée de l’exposition aux rayons X<br />
avec la visée dite mains libres.<br />
MATÉRIEL. Parmi une cohorte de 220 patients, 32 ont été<br />
retenus de manière aléatoire pour réaliser le geste de visée distale<br />
ou cervicale avec l’aide de la fluoronavigation : 22 clous de tibia, 3<br />
clous de fémur et 7 vissages du col fémoral.<br />
MÉTHODES OPÉRATOIRES. Le système de navigation chirurgicale<br />
ION (Medtronic) a été utilisé, basé sur la reconnaissance<br />
par l’ordinateur de la position dans l’espace de la situation du<br />
malade, de l’amplificateur de brillance et de l’instrument ; l’information<br />
étant transmise par une caméra optique.<br />
RÉSULTATS. Nous avons évalué la durée opératoire globale et<br />
la durée d’exposition aux rayons X rapportées au type de fracture.<br />
La durée de fluoroscopie varie de 0,6 à 1,4 minutes pour un<br />
enclouage tibial en technique conventionnelle, à 0,5 à1minute<br />
avec la fluoronavigation. Pour le triple vissage le temps de fluoroscopie<br />
passe de 1 minute à 25 secon<strong>des</strong>. Soixante-treize vis au total<br />
ont été insérées : 72 en bonne position, car dans un cas le patient<br />
avait bougé en cours d’intervention. Il n’y a pas de complication<br />
nosocomiale ni de syndrome <strong>des</strong> loges.<br />
DISCUSSION. L’exposition répétée aux rayons X peut constituer<br />
un facteur limitant l’utilisation de l’enclouage verrouillé.<br />
L’équipe chirurgicale n’a besoin que d’un temps limité pour maîtriser<br />
l’installation du matériel et la connaissance du logiciel. Au<br />
cours de cette première phase la durée d’utilisation aux rayons X<br />
déjà faible est diminuée par deux alors que l’insertion de chaque<br />
vis était contrôlée ce qui avec l’expérience ne devient plus nécessaire.<br />
Des évolutions du logiciel permettront de contrôler <strong>les</strong> axes de<br />
rotation du membre et d’éviter <strong>les</strong> inégalités de longueur.<br />
CONCLUSION. La fluoronavigation en traumatologie ne constitue<br />
pas un gadget pour <strong>des</strong> images virtuel<strong>les</strong> inuti<strong>les</strong>, mais<br />
apporte une sécurité pour le malade et l’équipe opératoire.<br />
Cette étude montre que <strong>les</strong> patients bénéficient d’une chirurgie<br />
« mini-invasive » moins irradiante et une insertion plus précise <strong>des</strong><br />
vis de verrouillage pour éviter une rupture du matériel. Les développements<br />
futurs devraient permettre d’améliorer la qualité <strong>des</strong><br />
résultats anatomiques <strong>des</strong> enclouages verrouillés, d’en étendre <strong>les</strong><br />
indications et de rendre l’utilisation plus bénéfique pour le patient<br />
et le chirurgien.<br />
*T. Gautheron, Service d’Orthopédie, Centre Hospitalier,<br />
rue de l’École-<strong>des</strong>-Mines, 73600 Moutiers.<br />
114 Utilisation du clou gamma long<br />
dans <strong>les</strong> fractures sous trochantériennes<br />
complexes : étude prospective<br />
à propos de 50 cas<br />
F. BONNEL*, M. CHAMOUN, P.FAURÉ,<br />
F. DUSSERRE, F.CANOVAS<br />
INTRODUCTION. Les ostéosynthèses <strong>des</strong> fractures complexes<br />
sous-trochantériennes du fémur par plaque vissée sont de réalisation<br />
difficile avec <strong>des</strong> complications fréquentes et <strong>des</strong> résultats<br />
incertains. Pour <strong>les</strong> fractures pathologiques métastatiques traitées<br />
par ostéosynthèse avec ciment, le geste est important et le pronostic<br />
fonctionnel précaire. Notre objectif était de juger l’apport du<br />
clou gamma long (50 cas) dans ces circonstances et d’en évaluer<br />
<strong>les</strong> avantages et <strong>les</strong> inconvénients.<br />
MATÉRIELS ET MÉTHODES. Les 50 clous gamma longs<br />
étaient utilisés chez 23 femmes et 26 hommes suivis sur une<br />
période de 8 mois (min. 4, max. 16). Nous avons implanté 39 clous<br />
gamma longs pour fracture complexe sous-trochantérienne (classification<br />
AO) chez <strong>des</strong> patients âgés de 59 ans en moyenne (min.<br />
19, max. 93) et 11 fractures métastatiques du fémur pour <strong>des</strong><br />
patients âgés de 59 ans (min. 19, max. 93) de localisation trochantéro<br />
diaphysaire. Pour <strong>les</strong> fractures non métastatiques, l’enclouage<br />
était à foyer fermé (28 cas) et avec un abord minima du foyer de<br />
fracture (11 cas). Pour <strong>les</strong> fractures métastatiques, le cancer primitif<br />
était connu dans <strong>les</strong> 11 cas. L’enclouage était préventif (6 cas) et<br />
après fracture (5 cas). Les lésions étaient plurifoca<strong>les</strong> (3 cas).<br />
Quarante-trois paramètres ont été analysés (position de la vis cervicale<br />
dans <strong>les</strong> quatre quadrants du col fémoral, cliniques et radiographiques).<br />
RÉSULTAT. Pour <strong>les</strong> 39 fractures, la réduction de la fracture<br />
était anatomique (24 cas) et avec écart inter fragmentaire (15 cas).<br />
La position du clou cervical était correcte (34 cas), quadrant antéro<br />
supérieur (3 cas), postéro supérieur (1 cas), inféro postérieur 1 cas.<br />
La remise en charge était effective à partir de 1,5 mois en moyenne<br />
La consolidation avec appui total était obtenueà4mois(max.8).<br />
Les complications mécaniques étaient : migration de la vis céphalique<br />
(4 cas), rupture <strong>des</strong> clavettes verrouillage (9 cas), rupture du<br />
clou (1 cas), pseudarthrose (2 cas). Pour <strong>les</strong> 11 fractures pathologiques<br />
(survie maximum 16 mois), l’indolence était obtenue dans<br />
tous <strong>les</strong> cas. La remise en charge avec cannes était possible dans 7<br />
cas et impossible dans 4 cas. Nous n’avons observé aucun démontage.<br />
Les résultats sont comparab<strong>les</strong> aux ostéosynthèses associées<br />
au ciment.<br />
DISCUSSION. Pour <strong>les</strong> factures pathologiques, cette ostéosynthèse<br />
peu choquante était très efficace sur la douleur. Pour <strong>les</strong><br />
autres fractures sous-trochantériennes complexes le foyer fermé<br />
intégral n’est pas toujours réalisable.
CONCLUSION. Le faible nombre de complications mécaniques<br />
observées nous a convaincus de son utilisation à condition<br />
d’une technique rigoureuse.<br />
*F. Bonnel, Service Orthopédie III,<br />
Hôpital Lapeyronie, CHU Montpellier,<br />
avenue du Doyen-Gaston-Giraud, 34000 Montpellier.<br />
115 Atteinte de la fonction sexuelle<br />
masculine lors <strong>des</strong> enclouages<br />
centro-médullaire <strong>des</strong> fractures du<br />
fémur<br />
G. GIORDANO*, R. MALLET, J.-L. TRICOIRE,<br />
A. NEHME, P.CHIRON, J.PUGET<br />
OBJECTIFS. Nous avons évalué <strong>les</strong> atteintes de la fonction<br />
sexuelle masculine après utilisation de la table orthopédique lors<br />
de l’enclouage centro-médullaire <strong>des</strong> fractures diaphysaires fémora<strong>les</strong><br />
prises en charge entre 1995 et 2001. Il s’agissait d’évaluer la<br />
fréquence de ces atteintes et de dégager d’éventuels facteurs favorisants<br />
dans la technique utilisée.<br />
POPULATION ET MÉTHODES. La fonction sexuelle a été<br />
évaluée par auto-questionnaire avec l’Index International de la<br />
fonction érectile (IIEF). Cent neuf patients, de 20 à 50 ans, traités<br />
dans le service d’orthopédie traumatologie de 1995 et 2001, ont<br />
été contactés par courrier. Le test de Mann et Whitney a été utilisé<br />
pour <strong>les</strong> variab<strong>les</strong> quantitatives, le t de Student pour <strong>les</strong> classes.<br />
RÉSULTATS. Cinquante-cinq patients ont répondus, 7 ont<br />
refusé et 3 sont décédés (taux de réponses de 81,8 %). Les valeurs<br />
de fonction érectile (score EF) ont été regroupés en deux classes<br />
(EF < 22, & #8805 ;22), selon Cappelleri. Dix-neuf patients présentent<br />
une dysfonction érectile. Ces atteintes ne semblent pas<br />
dépendre de l’âge, du poids et de la taille <strong>des</strong> patients. La durée<br />
opératoire ne varie pas de manière significative entre <strong>les</strong> deux<br />
groupes.<br />
CONCLUSION. Cette étude met en évidence une augmentation<br />
<strong>des</strong> lésions iatrogènes retentissant sur la fonction érectile<br />
masculine lors de l’utilisation de la table orthopédique chez <strong>les</strong><br />
patients opérés en l’absence de réinjection de curare en cours<br />
d’intervention. Par ailleurs, la fréquence de ces lésions diminue<br />
significativement si cette chirurgie est réalisée par un chirurgien<br />
senior.<br />
*G. Giordano, Service de Traumatologie Orthopédie,<br />
CHU de Rangueil, 1, avenue Jean-Poulhès,<br />
31054 Toulouse Cedex 4.<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S75<br />
116 Fracture du fémur proximal sur prothèse<br />
: intérêt d’une reprise prothétique<br />
d’emblée<br />
S. MADOUGOU*, M. VILALBA, A.SBIHI,<br />
A. ROCHWERGER, G.CURVALE<br />
INTRODUCTION. Les fractures du fémur sur arthroplastie de<br />
hanche sont de prise en charge parfois difficile. Leur fréquence est<br />
estimée entre 1 et 3 %. Le but de ce travail était d’évaluer le résultat<br />
clinique et radiographique à distance de leur prise en charge et<br />
d’approcher selon le type de fracture <strong>les</strong> facteurs prédictifs de<br />
complications ultérieures afin d’en tenir compte dans <strong>les</strong> indications<br />
thérapeutiques.<br />
MATÉRIELS ET MÉTHODES. Nous avons colligé, depuis<br />
1985, 29 dossiers de patients (17 femmes et 12 hommes de 73,3<br />
ans d’âge moyen) victimes d’une fracture du fémur autour de leur<br />
implant. Par définition, <strong>les</strong> fractures peropératoires ont été<br />
exclues. Deux examinateurs indépendants ont réuni <strong>les</strong> données<br />
épidémiologiques, thérapeutiques et d’imagerie <strong>des</strong> patients,<br />
classé ces fractures selon la cotation de Vancouver, étudié <strong>les</strong><br />
traitements mis en œuvre et analysé <strong>les</strong> résultats postopératoires<br />
cliniquement et radiologiquement au recul moyen de 24 mois (6 à<br />
140 mois).<br />
RÉSULTATS. Quatre-vingt-quatre pour cent <strong>des</strong> fractures (n =<br />
31) succédaient à une chute. Six patients avaient un antécédent de<br />
reprise de prothèse. Cinq cas sont survenus en regard d’une zone<br />
de faib<strong>les</strong>se non protégée. Les fractures étaient trochantériennes (n<br />
= 9), périprothétiques (n = 18) ou sous la tige (n = 2). Le traitement<br />
fut orthopédique non sanglant 11 fois. Il y eut 9 ostéosynthèses<br />
isolées et 11 reprises prothétiques d’emblée. Les résultats furent<br />
évalués selon le score de Beals tenant compte de la stabilité et de la<br />
qualité de la fixation de l’implant, de la consolidation, et de la<br />
réaxation de la fracture. Il y eut 2 excellents, 1 bon et 4 mauvais<br />
résultats pour <strong>les</strong> fractures du grand trochanter. Lorsque le trait<br />
était autour de la tige il y eut 9 excellents, 4 bons et 4 mauvais<br />
résultats. Les fractures du petit trochanter (n = 4) ont donné 2<br />
excellents résultats et 2 bons. Les fractures situées sous l’extrémité<br />
inférieure de la tige (n = 2) ont abouti à deux bons résultats. Un cas<br />
d’infection profonde avérée est à déplorer.<br />
DISCUSSION. Nos traitements orthopédiques ont donné à<br />
types fracturaires superposab<strong>les</strong> <strong>des</strong> mauvais résultats (6/11)<br />
contrairement aux reprises d’emblée (2/11) et aux ostéosynthèses<br />
(1/9). Nombre de <strong>des</strong>cellements ont été sous évalués conduisant à<br />
un échec du traitement orthopédique.<br />
CONCLUSION. Lors d’une fracture du fémur proximal sur<br />
prothèse, toute suspicion de <strong>des</strong>cellement préalable, en particulier<br />
s’il s’agit d’une tige cimentée, doit inciter à envisager une reprise<br />
de la prothèse plutôt qu’un traitement orthopédique ou une ostéosynthèse<br />
simple.<br />
*S. Madougou, Service d’Orthopédie,<br />
Hôpital de la Conception, 145, boulevard Baille,<br />
13385 Marseille Cedex.
3S76 78 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
118 Comparaison <strong>des</strong> résultats fonctionnels<br />
après arthrodèse glénohumérale<br />
en cas de paralysie totale<br />
et de paralysie partielle du plexus<br />
brachial de l’adulte<br />
M. CHAMMAS*, J.-N. GOUBIER, B.COULET,<br />
G. MEYER ZU RECKENDORF, M.-N. THAURY,<br />
Y. ALLIEU<br />
INTRODUCTION. Les performances fonctionnel<strong>les</strong> de<br />
l’arthrodèse d’épaule ont été évaluées afin d’en préciser <strong>les</strong> indications<br />
dans le traitement <strong>des</strong> séquel<strong>les</strong> <strong>des</strong> paralysies posttraumatiques<br />
du plexus brachial de l’adulte et d’en comparer <strong>les</strong><br />
résultats entre <strong>les</strong> paralysies partiel<strong>les</strong> et tota<strong>les</strong>.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Vingt-sept patients opérés<br />
d’une arthrodèse gléno-humérale pour séquel<strong>les</strong> de paralysies<br />
post-traumatiques du plexus brachial ont été revus. Il s’agit de 11<br />
cas de paralysie radiculaire supérieure (C5, C6 et C5, C6, C7) et de<br />
16 cas de paralysie totale. <strong>Tous</strong> <strong>les</strong> patients avaient récupéré une<br />
flexion active du coude. Chez 11 patients, existait un échec de<br />
réinnervation de l’épaule. Avant l’arthrodèse, 22 patients n’utilisaient<br />
pas leur membre supérieur parétique. Le délai moyen entre<br />
chirurgie nerveuse directe et arthrodèse a été de 30 mois dans <strong>les</strong><br />
paralysies partiel<strong>les</strong> et de 20 mois dans <strong>les</strong> paralysies tota<strong>les</strong>.<br />
L’arthrodèse a été réalisée à l’aide d’une ostéosynthèse par vissage<br />
gléno-huméral, associée dans 21 cas à un fixateur externe.<br />
RÉSULTATS. Le recul postopératoire moyen est de 70 mois. Il<br />
y a eu 2 cas de pseudarthrose gléno-humérale, consolidées après<br />
reprise chirurgicale et trois cas de fracture humérale survenus au<br />
cours <strong>des</strong> 6 premiers mois postopératoires. Les 6 patients porteurs<br />
de douleurs dues à la subluxation inférieure de l’épaule ont été<br />
améliorés. Il n’a pas été retrouvé de différence significative entre<br />
<strong>les</strong> deux groupes en termes de position d’arthrodèse, de mobilité<br />
active postopératoire (60 de flexion, 60 d’abduction, 45 de rotation<br />
interne, 7à-9derotation externe). Des différences significatives<br />
ont été retrouvées en terme de force de l’épaule au profit <strong>des</strong><br />
paralysies supérieures (11 kgf versus 7 kgf en flexion, 12 kgf<br />
versus 7 kgf en abduction, 6 kgf versus 2 kgf en rotation externe et<br />
11 kgf versus 4 kgf en rotation interne). Il en est de même dans <strong>les</strong><br />
possibilités d’excursion de la main. Ces différences sont corrélées<br />
statistiquement à la force du muscle grand pectoral.<br />
CONCLUSION. L’arthrodèse gléno-humérale représente une<br />
intervention fonctionnellement utile chez <strong>les</strong> patients porteurs <strong>des</strong><br />
séquel<strong>les</strong> de paralysies du plexus brachial supraclaviculaires<br />
même en cas de main paralytique. Cette intervention permet, en<br />
outre, de reporter la réinnervation chirurgicale vers d’autres fonctions,<br />
comme celle de la main. La force de l’épaule et <strong>les</strong> possibi-<br />
Séance du 11 novembre après-midi<br />
ÉPAULE<br />
lités d’excursion de la main sont directement corrélées à la force<br />
du muscle grand pectoral.<br />
*M. Chammas, Service de Chirurgie Orthopédique 2<br />
et Chirurgie de la Main, Hôpital Lapeyronie,<br />
371, avenue du Doyen-Gaston-Giraud,<br />
34295 Montpellier Cedex 5.<br />
119 L’arthrodèse scapulo-humérale<br />
dans l’épaule non neurologique :<br />
quelle place en 2003 ?<br />
F. LACOMBE*, B. COULET, M.CHAMMAS,<br />
Y. ALLIEU<br />
INTRODUCTION. L’arthrodèse scapulo-humérale trouve sa<br />
principale justification dans <strong>les</strong> paralysies du plexus brachial. Elle<br />
reste par contre une intervention d’indication controversée et limitée<br />
dans le cadre <strong>des</strong> étiologies non neurologiques. Nous rapportons<br />
une série de 9 arthrodèses d’épaule suite à <strong>des</strong> étiologies non<br />
neurologiques, afin de déterminer et préciser la place de cette<br />
intervention de nos jours.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Il s’agit d’une série de 9<br />
patients, 6 hommes et 3 femmes d’âge moyen 48 ans (23-89). Le<br />
côté opéré a été 3 fois le côté dominant et 6 fois le non dominant.<br />
Sept <strong>des</strong> patients avaient eu au moins une intervention chirurgicale<br />
au préalable.<br />
L’arthrodèse a été réalisée une fois pour une réaction à corps<br />
étranger sur tendon prothétique de coiffe, 3 fois pour ostéonécrose<br />
céphalique post traumatique, 3 fois pour omarthrose excentrée<br />
avec rupture massive de coiffe, et 2 fois pour omarthrose avec<br />
instabilité multidirectionnelle. Dans tous <strong>les</strong> cas, sauf un, l’arthrodèse<br />
a été réalisée par voie postérieure avec pour ostéosynthèse un<br />
vissage interne associé à un fixateur externe laissé en place en<br />
moyenne 2 mois et demi.<br />
RÉSULTATS. Résultats subjectifs : tous <strong>les</strong> patients, sauf un,<br />
étaient satisfaits du résultat de l’intervention (le motif de satisfaction<br />
portant essentiellement sur la disparition <strong>des</strong> douleurs).<br />
Résultats objectifs : <strong>les</strong> mobilités actives étaient de 65 en<br />
flexion, 65 en abduction, 50 en rotation interne (la position<br />
moyenne de l’arthrodèse étant de 20 en flexion, 25 en abduction et<br />
30 en rotation interne). Deux groupes ont été individualisés pour<br />
l’analyse du score de Constant absolu. Le score a été amélioré de<br />
16 points (24 à 40) pour le groupe <strong>des</strong> omarthroses sans instabilité<br />
(le score de la douleur passant de 3 à 13) et diminué de 14 points<br />
(66 à 52) pour le groupe avec instabilité (imputable à la baisse <strong>des</strong><br />
mobilités, le score moyen <strong>des</strong> mobilités passant de 38 à 14). Parmi<br />
<strong>les</strong> complications, on retrouvait une paralysie radiale, une pseudarthrodèse,<br />
et un œdème déclive du membre supérieur.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. L’arthrodèse d’épaule<br />
n’est pas qu’une intervention dont <strong>les</strong> objectifs sont limités à
l’obtention de l’indolence et de la stabilité. Elle doit pouvoir assurer<br />
une récupération fonctionnelle utile (main bouche, main périnée<br />
et pince thoraco-brachiale). Sa place se situe donc là où<br />
l’arthroplastie prothétique trouve ses limites (arthrites infectieuses,<br />
omarthrose évoluée chez le sujet jeune et <strong>les</strong> échecs de traitement<br />
<strong>des</strong> instabilités multidirectionnel<strong>les</strong>). Sa prédictibilité et sa<br />
constance en terme de résultats, nous font pencher pour ce type<br />
d’intervention dans ces indications qui restent rares.<br />
*F. Lacombe, Service d’Orthopédie 2, Hôpital Lapeyronie,<br />
371, avenue du Doyen-Gaston-Giraud,<br />
34295 Montpellier Cedex 5.<br />
120 La normalité de l’épaule chez <strong>les</strong><br />
sujets âgés de plus de 75 ans :<br />
étude sur 180 cas<br />
M. SCARLAT*<br />
INTRODUCTION. Le but de cette étude est de définir la normalité<br />
de l’épaule <strong>des</strong> patients âgés de plus de 75 ans, et de chercher<br />
<strong>des</strong> corrélations entre la fonction articulaire de l’épaule, l’état<br />
mental et l’état général de santé.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Cent quatre-vingt sujets âgés de<br />
75 ans ou plus, sans antécédents chirurgicaux au niveau <strong>des</strong> épau<strong>les</strong><br />
ou dans <strong>les</strong> régions voisines (mammaire, axillaire, coude) ont<br />
été évalués par un bilan de la mobilité <strong>des</strong> épau<strong>les</strong> (ratio de flexibilité),<br />
de la force musculaire de la coiffe <strong>des</strong> rotateurs (échelle de<br />
Mayo) et avec une recherche <strong>des</strong> mouvements anormaux. L’index<br />
de Quételet pour la corpulence (IMC) à été calculé pour chaque<br />
cas. Les sujets ont répondu à un questionnaire d’auto - évaluation<br />
pour la fonction de l’épaule « Simple Shoulder Test » (SST) et le<br />
score de Constant a été calculé pour chaque épaule. Le bilan de la<br />
dépression gériatrique a été effectué avec le test de Beck. Lorsque<br />
la fonction articulaire était altérée, ont été réalisés un examen<br />
radiologique standard et une échographie.<br />
RÉSULTATS. Seulement 44 % <strong>des</strong> épau<strong>les</strong> étudiés sont libres<br />
de pathologies. 56 % <strong>des</strong> sujets dans cette série présentent <strong>des</strong><br />
lésions cliniquement muettes ou qui ne <strong>les</strong> dérangent pas dans <strong>les</strong><br />
activités journalières (ruptures de coiffe, arthrose, raideurs).<br />
L’épaule dominante présente 56,4 % <strong>des</strong> ruptures de la coiffe.<br />
13,9 % <strong>des</strong> sujets présentent de l’omarthrose dégénérative bilatérale<br />
et 23,3 % — <strong>des</strong> raideurs bilatéra<strong>les</strong>. Les pathologies associés<br />
sont nombreuses : cardio-vasculaires (33 %), pulmonaires<br />
(28 %), digestives (25,6 %), diabète (12,2 %), néoplasies<br />
(10,6 %). 18,3 % <strong>des</strong> sujets sont dépressifs et 14,4 % sont traités<br />
pour dépression. La mobilité et la force <strong>des</strong> épau<strong>les</strong> varient en<br />
fonction de l’index corporel et de l’état nutritionnel. Les patients<br />
maigres (IMC < 20) présentent plus souvent <strong>des</strong> lésions de la<br />
coiffe <strong>des</strong> rotateurs. Les patients corpulents (IMC > 29,9) présentent<br />
plus d’arthrose et <strong>des</strong> raideurs. 76,8 % <strong>des</strong> sujets sont satisfaits<br />
de la fonction articulaire de leurs épau<strong>les</strong>. La demande de soins et<br />
examens est plus importante chez <strong>les</strong> dépressifs.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. Les sujets très âgés ont une<br />
fonction de l’épaule compatible avec une vie normale, correspondant<br />
à la demande fonctionnelle propre au 4 e âge. La fonction de<br />
l’épaule est corrélée avec le score de santé, avec l’index corporel et<br />
avec l’état mental. Il conviendrait d’évaluer avec prudence <strong>les</strong><br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S77<br />
épau<strong>les</strong> <strong>des</strong> sujets âgés, car leur fonction, même altérée, est souvent<br />
compatible avec <strong>des</strong> raideurs modérés, avec arthrose et avec<br />
<strong>des</strong> ruptures de la coiffe <strong>des</strong> rotateurs, sans que cela aboutisse sur<br />
un geste thérapeutique.<br />
*M. Scarlat, Clinique Saint-Michel,<br />
place du 4-Septembre, 83100 Toulon.<br />
121 Résultats à long terme de l’acromioplastie<br />
sous arthroscopie dans <strong>les</strong><br />
ruptures transfixiantes de la coiffe<br />
<strong>des</strong> rotateurs<br />
O. GOSSELIN*, F. SIRVEAUX, O.ROCHE,<br />
E. VILLANUEVA, C.MARCHAL, D.MOLÉ<br />
INTRODUCTION. Le but de cette étude était de connaître <strong>les</strong><br />
conséquences fonctionnel<strong>les</strong> à long terme de l’acromioplastie<br />
sous arthroscopie dans <strong>les</strong> ruptures transfixiantes de la coiffe,<br />
d’évaluer l’efficacité <strong>des</strong> gestes complémentaires (ténotomie du<br />
biceps, extension de la résection au niveau acromio-claviculaire),<br />
et de juger de l’évolution <strong>des</strong> lésions anatomiques.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. De 1988 à 1994, 141 ruptures<br />
transfixiantes de la coiffe <strong>des</strong> rotateurs ont été traitées par acromioplastie<br />
sous arthroscopie. Quatre-vingt-huit patients, d’un âge<br />
moyen de 60 ans, ont fait l’objet d’une révision clinique, radiographique<br />
et échographique à plus de 8 ans de recul. Le score de<br />
Constant moyen préopératoire était de 48,5 points. La rupture<br />
intéressait uniquement le supra-épineux dans 18 cas, le supra et<br />
l’infra épineux dans 40 cas, le supra-épineux et le subscapulaire<br />
dans 10 cas, et <strong>les</strong> trois tendons dans 20 cas. L’extension coronale<br />
retrouvait une rupture distale dans 4 cas, intermédiaire dans 52 cas,<br />
et rétractée à la glène dans 32 cas. L’acromioplastie systématique<br />
a été associée dans 36 cas à une ténotomie du chef long du biceps<br />
brachial et dans 44 cas étendue au niveau acromio-claviculaire.<br />
RÉSULTATS. Au recul moyen de 10,7 ans (8-13,5), le score de<br />
Constant moyen à la révision était de 60 points. Le résultat clinique<br />
a été jugé excellent ou bons dans 39,7 % <strong>des</strong> cas, moyens dans<br />
45,5 % et mauvais dans 14,8 %. 62,5 % <strong>des</strong> patients sont très<br />
satisfaits ou satisfaits. La hauteur de l’espace sous-acromial est<br />
passé de 5,19 mm à 4,3 mm. L’effet antalgique de la ténotomie du<br />
biceps était significatif lorsque l’espace acromiohuméral initial<br />
était inférieur à 5 mm. Ce geste n’a entraîné aucune variation<br />
significative sur la hauteur sous acromiale ou sur l’apparition<br />
d’une arthrose au recul. L’extension de la résection au niveau<br />
acromio-claviculaire a permis de diminuer significativement <strong>les</strong><br />
douleurs à la révision. L’évaluation échographique a montré une<br />
stabilité de la taille de la rupture dans 83,8 % <strong>des</strong> cas. Les résultats<br />
sont significativement moins bons quand la rupture initiale était<br />
étendue au subscapulaire ou intéressait <strong>les</strong> trois tendons.<br />
CONCLUSION. Les résultats cliniques de l’acromioplastie<br />
dans <strong>les</strong> ruptures transfixiantes sont stab<strong>les</strong> à long terme. La réalisation<br />
d’une ténotomie du biceps améliore le résultat antalgique de<br />
manière significative principalement si l’espace sous-acromial est<br />
inférieur à 5 mm en préopératoire sans entraîner de dégradation<br />
radiologique significative. L’extension de la résection au niveau
3S78 78 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
acromio-claviculaire doit être systématique en cas de douleurs<br />
acromio-claviculaires préopératoires et/ou d’anomalies radiologiques.<br />
*O. Gosselin, Clinique de Traumatologie et d’Orthopédie,<br />
49, rue Hermite, 54052 Nancy Cedex.<br />
122 Influence de l’arthrose acromioclaviculaire<br />
sur <strong>les</strong> résultats <strong>des</strong><br />
acromioplasties arthroscopiques<br />
S. MENAGER*, H. MESTDAGH, C.MAYNOU,<br />
X. CASSAGNAUD<br />
INTRODUCTION. Les résultats <strong>des</strong> acromioplasties restent<br />
grevés de 10 à 20 % d’échecs. Ceux-ci peuvent selon nous s’expliquer<br />
par la présence d’une arthrose acromio-claviculaire. Notre<br />
but est de mettre en évidence une influence délétère de cette<br />
atteinte sur <strong>les</strong> résultats de cette intervention.<br />
MATÉRIEL. Nous avons analysé 103 acromioplasties arthroscopiques<br />
réalisées chez 100 patients qui présentaient une tendinopathie<br />
non rompue non calcifiée. Sept cas ont été exclus, restent 96<br />
cas, dont 63 femmes et 33 hommes. L’âge moyen à l’intervention<br />
est de 48,2 ans et le recul moyen de 3,8 ans Sur <strong>des</strong> critères<br />
scanographiques ces patients furent répartis en 2 groupes : le<br />
groupe1, exempt d’arthrose acromio-claviculaire (66 personnes)<br />
et le groupe2, porteur d’arthrose (30 personnes).<br />
MÉTHODES. Chaque patient a été revu cliniquement. Le scanner<br />
a permis le diagnostic d’arthrose et une classification en 4<br />
sta<strong>des</strong> de 0à3.Lesrésultats ont été évalué par la satisfaction<br />
subjective et le score de Constant.<br />
RÉSULTATS. Subjectivement, <strong>les</strong> 3/4 <strong>des</strong> patients du groupe1<br />
sont satisfaits, contre seulement le 1/3 dans le groupe 2. Ces résultats<br />
sont confirmés objectivement par le score de Constant postopératoire<br />
avec une moyenne de 76 pour le groupe1 contre 68 pour<br />
le groupe2 (et respectivement 93,5 % contre 83 % après pondération)<br />
; en fonction du score pondéré <strong>les</strong> résultats sont donc excellents<br />
ou bons pour 84,84 % <strong>des</strong> cas dans le groupe1 contre 43 %<br />
<strong>des</strong> cas dans le groupe 2.<br />
DISCUSSION. Nos résultats sont identiques à ceux de la littérature<br />
et nous apportons une preuve scientifique de l’influence de<br />
l’arthrose acromio-claviculaire dans <strong>les</strong> échecs de cette intervention.<br />
En effet <strong>les</strong> résultats du groupe1 sont nettement meilleurs que<br />
ceux du groupe2, prouvant de manière statistique une idée répandue<br />
: l’arthrose acromio-claviculaire obère significativement <strong>les</strong><br />
résultats <strong>des</strong> acromioplasties. De plus il est intéressant de noter<br />
que sur <strong>les</strong> 7 cas exclus (pour résection de l’articulation en cause),<br />
6 présentent <strong>des</strong> résultats satisfaisant.<br />
CONCLUSION. Ces résultats confirment l’influence néfaste de<br />
l’arthrose acromio-claviculaire sur <strong>les</strong> résultats <strong>des</strong> acromioplasties.<br />
La voie semble ouverte pour une étude prospective visant à<br />
établir l’effet de la résection acromio-claviculaire simultanée sur<br />
ces mêmes résultats, afin de proposer une démarche thérapeutique<br />
cohérente à ces patients.<br />
*S. Menager, Service Orthopédie A,<br />
Hôpital Roger-Salengro, CHRU de Lille.<br />
123 Réparation arthroscopique du<br />
supraspinatus : le tendon cicatriset-il<br />
vraiment ?<br />
P. BOILEAU*, N. BRASSART, M.CARLES,<br />
C. TROJANI, J.-S. COSTE<br />
HYPOTHÈSE. Le taux de cicatrisation tendineuse <strong>des</strong> ruptures<br />
transfixiantes du supraspinatus après réparation arthroscopique<br />
est équivalent à celui obtenu par <strong>les</strong> techniques de chirurgie<br />
ouverte, rapporté dans la littérature.<br />
TYPE D’ÉTUDE. Cohorte prospective.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Soixante-cinq patients présentant<br />
une rupture transfixiante du supraspinatus, réparés sous<br />
contôle arthroscopique, ont été revus avec un recul moyen de 19<br />
mois (12-43). L’âge <strong>des</strong> patients était de 59,5 ans (28-79 ans). La<br />
suture os-tendon était réalisée à l’aide de sutures résorbab<strong>les</strong> et<br />
d’ancres auto-bloquantes, placées à la face latérale de l’humérus.<br />
La réparation était protégée par une attelle d’abduction pendant 6<br />
semaines. Quarante et un patients (63 %) ont accepté de réaliser un<br />
arthro-scanner, pratiqué entre 6 mois et 2 ans après l’intervention,<br />
afin de contrôler la cicatrisation tendineuse.<br />
RÉSULTATS. Quatre-vingt-quatorze pour cent <strong>des</strong> patients<br />
étaient satisfaits ou très satisfaits du résultat. Le score de Constant<br />
était de 51,6 (& #61617 ; 10,6) points en préopératoire et 80,2 (&<br />
#61617 ; 13,2) points au dernier recul (p < 0,001). Le contrôle<br />
arthro-scanner a démontré que la coiffe <strong>des</strong> rotateurs était cicatrisée<br />
et étanche dans 70 % <strong>des</strong> cas (29/41) ; le supraspinatus n’était<br />
pas cicatrisé sur le trochiter dans 8 cas (25 %) et partiellement<br />
cicatrisé dans 2 cas (5 %). La taille du défect tendineux résiduel<br />
était inférieure à la rupture initiale dans tous <strong>les</strong> cas sauf un. Le<br />
taux de satisfaction et la fonction <strong>des</strong> patients n’étaient pas significativement<br />
différents, que le tendon soit cicatrisé (Constant =<br />
81,3/100, satisfaction = 93 %) ou qu’il persiste un defect tendineux<br />
résiduel (Constant = 77,5/100, satisfaction = 92 %). La force<br />
<strong>des</strong> épau<strong>les</strong> où le tendon était cicatrisé (6 kg & #61617 ; 1,9) était<br />
meilleure que cel<strong>les</strong> où le tendon n’avait pas cicatrisé (4,5 kg &<br />
#61617 ; 2,8) ; cependant, la différence n’était pas significative.<br />
Facteurs affectant la cicatrisation tendineuse : âge > 65 ans (seulement<br />
43 % de cicatrisation, p = 0,02), et <strong>les</strong> larges ruptures.<br />
CONCLUSION. La réparation arthroscopique de la rupture isolée<br />
du supraspinatus aboutit à un taux de cicatrisation tendineuse<br />
de 70 % contrôlé par arthro-scanner. Ce taux est équivalent à celui<br />
<strong>des</strong> séries historiques de réparation à ciel ouvert. Les patients agés<br />
de plus de 65 ans ont un taux de ciatrisation tendineuse significativement<br />
inférieur. L’absence de cicatrisation tendineuse ne compromet<br />
pas le résultat fonctionnel et subjectif, malgré une force<br />
diminuée.<br />
*P. Boileau, Service de Chirurgie Orthopédique,<br />
Hôpital de l’Archet 2,<br />
151, route de Saint-Antoine-de-Ginestière,<br />
06202 Nice.
124 Traitement <strong>des</strong> tendinopathies calcifiantes<br />
de la coiffe <strong>des</strong> rotateurs<br />
par acromioplastie systématique<br />
D. BENZAQUEN*, C. MAYNOU, O.LE RUE,<br />
H. MESTDAGH<br />
INTRODUCTION. Cette étude évalue le rôle respectif de<br />
l’acromioplastie et du curetage de calcifications dans le traitement<br />
arthroscopique <strong>des</strong> tendinopathies calcifiantes de la coiffe <strong>des</strong><br />
rotateurs.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Nous avons revu 41 tendinopathies<br />
calcifiantes avec un recul moyen de 42 mois. N’ont été<br />
inclues que <strong>les</strong> calcifications vraies avec 12 mois de recul minimum.<br />
<strong>Tous</strong> <strong>les</strong> patients ont bénéficié d’une acromioplastie et 13<br />
patients d’un curetage de la calcification. L’examen clinique a<br />
recherché un conflit sous-acromial et une souffrance <strong>des</strong> tendons<br />
de la coiffe. Un score de CONSTANT pondéré a été établi de<br />
manière à trier <strong>les</strong> résultats en excellents, bons, moyens et mauvais.<br />
La satisfaction <strong>des</strong> patients a été évaluée sur trois questions<br />
subjectives. À l’aide de clichés radiographiques de face et de profil<br />
de Lamy, nous avons recherché <strong>des</strong> calcifications persistantes,<br />
nous avons quantifié la résection acromiale en étudiant l’évolution<br />
de la hauteur sous-acromiale, de la flèche acromiale et du type<br />
d’acromion selon Bigliani. Une échographie à été réalisé à la<br />
recherche de lésions de la coiffe, classant ainsi <strong>les</strong> coiffes en norma<strong>les</strong>,<br />
atrophiques ou rompues.<br />
RÉSULTATS. Les résultats ont été soumis à une analyse statistique.<br />
Le Constant moyen passait de 55 à 80 points, soit 88 %<br />
d’excellents et bons résultats (Constant pondéré > 85 %). Aucune<br />
différence significative n’a été retrouvée en cas de curetage de la<br />
calcification (p > 0,1). Les patients mobilisés rapidement présentaient<br />
un meilleur résultat (p < 0,005). L’évaluation subjective<br />
retrouvait 88 % de patients très satisfaits et satisfaits. Ces résultats<br />
n’étaient pas corrélés au délai de révision, ils étaient donc stab<strong>les</strong><br />
dans le temps. Le stade préopératoire de la calcification n’influençait<br />
pas ces résultats, par contre la persistance de calcifications (9<br />
cas) influençait ces résultats à la baisse, cependant, 80 % <strong>des</strong> calcifications<br />
non curetées se résorbaient après l’acromioplastie. Le<br />
type d’acromion influençait le résultat à la baisse en cas de non<br />
planéité de celui-ci (type II ou III). L’importance de la correction<br />
acromiale influençait significativement <strong>les</strong> résultats, le Constant<br />
augmentant proportionnellement à la hauteur sous-acromiale et<br />
inversement à la flèche acromiale. L’échographie a montré 2 coiffes<br />
rompues mais sur <strong>des</strong> sujets âgés donc probablement dégénératives.<br />
CONCLUSION. Le curetage de la calcification n’apporte donc<br />
rien à l’acromioplastie isolée et de bonne qualité. Le stade de la<br />
calcification n’intervient pas dans l’indication du curetage. De<br />
plus, il semble que le conflit soit en partie responsable de la persistance<br />
<strong>des</strong> calcifications puisque 80 % d’entre el<strong>les</strong> disparaissent<br />
après acromioplastie isolée.<br />
*D. Benzaquen, Hôpital Roger-Salengro,<br />
service Orthopédie A, 59037 Lille Cedex.<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S79<br />
125 Les réparations <strong>des</strong> ruptures du<br />
subscapularis isolées ou associées<br />
à une rupture du supraspinatus<br />
sans lésion de l’infraspinatus :<br />
résultats fonctionnels et radiologiques<br />
avec un recul moyen de 9 ans<br />
(de6à15ans)<br />
L. DE ABREU*, D. GOUTALLIER<br />
INTRODUCTION. Les résultats du traitement chirurgical <strong>des</strong><br />
ruptures du subscapularis sont connus à court terme. Le but de<br />
l’étude est de connaître l’évolution à long terme de 21 ruptures<br />
transfixiantes du subscapularis traitées chirurgicalement.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Les critères d’inclusion étaient<br />
une rupture du subscapularis (21), isolée (9) ou associée à une<br />
rupture du supraspinatus (11), sans lésion de l’infraspinatus. Les<br />
subscapularis ont été 15 fois réinsérés en trans-osseux et 6 fois<br />
traités par un lambeau de trapèze. Les supraspinatus ont été réparés<br />
par suture transosseuse. Les résultats fonctionnels (selon Constant)<br />
ont été évalués en préopératoire,à1et3ans, et au recul final<br />
de9ans(de6à15ans), ainsi que l’évolution, radiologique (distance<br />
sous acromiale, arthrose selon Samilson, subluxation antérieure<br />
de la tête numérale). La dégénérescence graisseuse (DG)<br />
musculaire de la coiffe a été évaluée sur <strong>des</strong> scanners en préopératoire<br />
et au recul final. La continuité de la coiffe a été contrôlée à un<br />
an par arthroscanner et au recul maximum par échographie.<br />
RÉSULTATS. Le Constant non pondéré était à 45,2 (12-93,5)<br />
en préopératoire, 67,5 (20-95)à1et3ansderecul et 59,45 (20-95)<br />
au recul final. Au recul final le Constant était statistiquement amélioré<br />
par rapport au préopératoire (amélioration de la douleur).<br />
Une seule rupture itérative (supraspinatus réparé) était constatée.<br />
Six subluxations antérieures étaient notées au recul final (une<br />
préexistait en préopératoire). La distance sous acromiale était restée<br />
stable (9,5 mm). Il yaeuquatorze évolutions arthrosiques<br />
gléno-huméra<strong>les</strong> (2 fois Samilson 3), dont 8 de novo. La DG <strong>des</strong><br />
subscapularis réparés était passée en moyenne de 0,8 (0-4) en<br />
préopératoire à 1,64 (l-4) au recul final. La DG <strong>des</strong> subscapularis<br />
non réparés traités par lambeau de trapèze s’était aggravée (2,2 à<br />
2,7). Les DG <strong>des</strong> supra et infraspinatus (0,5 en préopératoire)<br />
s’étaient en moyenne aggravés de 1 stade. Au recul maximum <strong>les</strong><br />
résultats du Constant étaient moins bons si une subluxation antérieure<br />
de la tête humérale existait (p = 0,013). L’apparition de la<br />
subluxation antérieure de la tête humérale était corrélée à l’importance<br />
de la DG préopératoire du subscapularis (valeur charnière<br />
entre 1,5 et 2 (p = 0,01)). Il existait une corrélation entre l’augmentation<br />
de la DG de l’infraspinatus et l’existence d’une subluxation<br />
antérieure de la tête humérale. Parmi <strong>les</strong> lambeaux de trapèze, <strong>les</strong> 2<br />
seuls bons résultats (Constant à 74 et 75) avaient une DG du<br />
subscapularis préopératoire inférieure ou égal à 1,5.<br />
CONCLUSION. Les résultats fonctionnels et radiologiques <strong>des</strong><br />
réparations ou de la chirurgie palliative par lambeau de trapèze <strong>des</strong><br />
ruptures du subscapularis associés ou non à une lésion du supraspinatus<br />
ne sont satisfaisants que si la DG préopératoire du subscapularis<br />
est faible (≤ 1,5).<br />
*L. De Abreu, Hôpital Henri-Mondor,<br />
51, avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, 94010 Créteil.
3S80 78 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
126 Arthropathies avec rupture massive<br />
de la coiffe <strong>des</strong> rotateurs : aspects<br />
morphologiques et conséquences<br />
thérapeutiques<br />
L. FAVARD*, F. SIRVEAUX, D.HUGUET,<br />
D. OUDET, D.MOLÉ<br />
INTRODUCTION. Dans le cadre du traitement chirurgical <strong>des</strong><br />
arthropathies avec rupture massive de la coiffe <strong>des</strong> rotateurs, <strong>les</strong><br />
aspects morphologiques préopératoires sont importants à analyser<br />
pour le planning opératoire. Or, ces caractéristiques morphologiques<br />
variées sont mal connues. Le but de cette étude en a été<br />
l’analyse et l’étude <strong>des</strong> conséquences techniques qui en découlent.<br />
MATÉRIELS ET MÉTHODES. Ont été inclus <strong>les</strong> patients<br />
ayant une arthropathie avec rupture massive de la coiffe <strong>des</strong> rotateurs<br />
et un bilan clinique et radiographique pré opératoire complet.<br />
Les critères analysés ont été l’aspect de l’acromion, l’aspect de<br />
l’humérus, et l’aspect de la glène.<br />
RÉSULTATS. Cent quarante-deux patients représentants 148<br />
épau<strong>les</strong> ont été inclus. L’acromion était fracturé ou lysé dans 13<br />
cas, aminci avec empreinte de la tête dans 37 cas, normal dans 70<br />
cas, hypertrophique dans 16 cas. L’humérus présentait <strong>des</strong> signes<br />
de nécrose dans 31 cas et un effacement du trochiter dans 77 cas.<br />
127 Le suivi <strong>des</strong> PTH : le recueil <strong>des</strong><br />
échecs est-il une bonne méthode ?<br />
Expérience de l’AVIO 1996-2000<br />
S. TERVER*, S. CHARBONNEL, P.GIOGHIET LES<br />
MEMBRES DU GROUPE DE L’AVIO<br />
INTRODUCTION. Le suivi <strong>des</strong> PTH est un sujet d’intérêt mais<br />
il pose de nombreux problèmes techniques et logistiques. L’analyse<br />
de l’expérience du recueil systématique <strong>des</strong> reprises de PTH<br />
permet de voir l’intérêt et <strong>les</strong> limites d’une telle méthode.<br />
MÉTHODE. Pendant 5 ans, une centaine de chirurgiens (français,<br />
belges et espagnols) ont volontairement participé à l’AVIO :<br />
pour cela ils ont rempli, lors de toutes leurs reprises de PTH, une<br />
fiche simple renseignant sur le patient, la cause de la reprise, la<br />
prothèse enlevée, l’état de celle-ci et de l’os. Centralisées en une<br />
banque unique de données ces fiches ont permis un travail d’analyse<br />
statistique.<br />
MATÉRIEL. Plus de 3 000 fiches ont ainsi pu être recueillies.<br />
L’analyse de près de 3000 d’entre-el<strong>les</strong> a permis d’obtenir <strong>des</strong><br />
renseignements sur <strong>les</strong> patients repris (sexe, âge, côté...) mais<br />
aussi sur <strong>les</strong> durées de vie <strong>des</strong> prothèses reprises, <strong>les</strong> causes prin-<br />
Séance du 12 novembre matin<br />
HANCHE<br />
L’usure glénoïdienne a été classée en quatre sta<strong>des</strong> : E0 (51 cas)<br />
pour une glène normale, E1 (32 cas) pour une glène usée de façon<br />
centrée, E2 (46 cas) pour une glène biconcave, E3 (13 cas) pour<br />
une glène avec une grande usure à concavité supérieure. Les 148<br />
épau<strong>les</strong> ont été traitées par 80 prothèses inversées et 68 prothèses<br />
non contraintes. L’évolution <strong>des</strong> prothèses non contraintes s’est<br />
faite vers une ascension progressive de la tête dans 63 % <strong>des</strong> cas<br />
avec usure de la voûte et de la glène. Une détérioration clinique a<br />
conduit à une reprise dans 2 cas. Les prothèses non contraintes<br />
mises en place en regard d’une glène E2 ont obtenu un score de<br />
Constant significativement plus bas (p < 0,05) que <strong>les</strong> autres.<br />
L’évolution <strong>des</strong> prothèses contraintes a vu l’apparition d’une<br />
encoche dans le pilier de l’omoplate dans 65 % <strong>des</strong> cas. L’apparition<br />
de cette encoche est apparue significativement favorisée par<br />
une glène de type E2 ou E3 en préopératoire. L’aspect préopératoire<br />
de l’humérus a été sans influence sur <strong>les</strong> résultats cliniques et<br />
radiologiques.<br />
DISCUSSION. Un acromion aminci ou lysé associé à une glène<br />
de type E2 constitue une mauvaise indication pour la mise en place<br />
d’une prothèse non contrainte. Dans ces conditions il vaut mieux<br />
poser une prothèses inversée en veillant à ne pas orienter la glénosphère<br />
vers le haut ce qui peut être techniquement difficile. Seuls <strong>les</strong><br />
acromion normaux ou épaissis et <strong>les</strong> glènes E1 semblent constituer<br />
une bonne indication aux prothèses non contraintes.<br />
*L. Favard, Service d’Orthopédie 1,<br />
CHU Trousseau, 37044 Tours Cedex.<br />
cipa<strong>les</strong> de reprises, <strong>les</strong> anomalies observées sur <strong>les</strong> pièces, et <strong>les</strong><br />
relations entre ces différents points.<br />
RÉSULTATS. Les causes principa<strong>les</strong> ont été séparées en deux<br />
catégories : <strong>les</strong> causes précoces (luxations, infection, douleurs...)<br />
et <strong>les</strong> causes tardives (<strong>des</strong>cellement, lyse osseuse, luxation...). Les<br />
reprises directement liées à un défaut du matériel ne dépassent pas<br />
5 % par contre ce défaut existe, lors de la reprise, dans 75 % <strong>des</strong><br />
cas.<br />
DISCUSSION. Ce travail a donné <strong>des</strong> renseignements intéressants<br />
sur <strong>les</strong> PTH reprises et <strong>les</strong> patients que cela concernait ainsi<br />
que sur <strong>les</strong> problèmes techniques limitants. En revanche, il n’a pu<br />
donner d’indication significative sur <strong>les</strong> résultats <strong>des</strong> prothèses<br />
el<strong>les</strong>-même par manque de données sur <strong>les</strong> prothèses implantées<br />
de première intention. Ce recueil systématique s’est par ailleurs<br />
heurté à de nombreux facteurs d’échec : irrégularité <strong>des</strong> envois,<br />
imprécision <strong>des</strong> renseignements, difficultés de reconnaissance de<br />
la pièce enlevée etc....<br />
CONCLUSION. Le recueil systématique <strong>des</strong> échecs de technique<br />
peut faire avancer la connaissance sur la technique mais il ne<br />
permet pas de l’évaluer « en soi ».<br />
*S. Terver, 2 e HE, Hôpital Gabriel-Montpied,<br />
BP 69, 63003 Clermont-Ferrand.
128 Évaluation prospective <strong>des</strong> taux<br />
sériques de cobalt, chrome et titane<br />
après implantation de prothèses<br />
tota<strong>les</strong> de hanche utilisant le couple<br />
métal métal<br />
J.-Y. LAZENNEC*, J. POUPON, G.SAILLANT<br />
INTRODUCTION. La cinétique <strong>des</strong> taux sériques de cobalt et<br />
de chrome après prothèse métal métal est mal connue. La corrélation<br />
avec la surveillance clinique et radiologique est peu documentée.<br />
Cette étude prospective analyse parallèlement la cinétique <strong>des</strong><br />
taux sériques du cobalt, du chrome et du titane afin de suivre <strong>les</strong><br />
comportements de l’implant fémoral et du couple de friction.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Deux cent quatre-vingt-deux<br />
patients ont été retenus dans le protocole (suivi 24-72 mois) (pas<br />
de supplémentation en vitamine B12, d’exposition professionnelle,<br />
d’insuffisance rénale initiale). Les mêmes implants cimentés<br />
ont toujours été utilisés : tige fémorale titane, couple Métasuly<br />
têtes 28 mm.<br />
Les prélèvements ont été réalisés en préopératoire, puis 3, 6 et<br />
12 mois après l’intervention, puis chaque année (questionnaire<br />
d’activité systématique). La limite de détection <strong>des</strong> taux sériques<br />
de cobalt et de chrome est de 1 nmol/l (environ 0,05 µg/l) et de<br />
30 nmol/l (1,4 µg/l) pour le titane.<br />
RÉSULTATS. Les complications principa<strong>les</strong> ont été 2 conflits et<br />
2 <strong>des</strong>cellements fémoraux.<br />
Quatre types de cinétiques sériques sont individualisés pour le<br />
cobalt et le chrome (fréquence décroissante) : 1) type I, taux initiaux<br />
faib<strong>les</strong> (< 50 nmol/l), pas de variation ; 2) type II, taux initiaux<br />
élevés (> 50 nmol/l), décroissance ; 3) type III, taux initiaux<br />
faib<strong>les</strong>, augmentation progressive ; 4) type IV, taux initiaux élevés<br />
et même élévation avec le temps.<br />
Les prothèses bilatéra<strong>les</strong> présentent une évolution spécifique<br />
avec élévation <strong>des</strong> taux après la deuxième implantation. Les taux<br />
sériques sont rapidement revenus à la normale après révision de<br />
deux conflits. Des taux élevés de titane ont été corrélés avec <strong>les</strong><br />
problèmes fémoraux non détectés initialement sur le bilan radiologique.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. La corrélation entre <strong>les</strong><br />
taux de cobalt sérique et l’usure est difficile. Aucune évolution<br />
spécifique n’a été notée après luxation. L’étude cinétique a permis<br />
de dégager une possible signification pronostique : <strong>les</strong> groupes 1<br />
(« silence métallurgique ») et 2 (« rodage » ?) correspondent à <strong>des</strong><br />
évolutions a priori favorab<strong>les</strong> ; le type 3 est difficile à interpréter<br />
(conflit méconnu, corps étranger, décoaptation articulaire ou<br />
reprise nette de l’activité) ; le type 4 doit faire rechercher une usure<br />
prématurée ou un problème biologique (en dehors <strong>des</strong> cas de prothèses<br />
bilatéra<strong>les</strong>). L’évaluation simultanée <strong>des</strong> taux de cobalt et<br />
de titane est importante pour détecter <strong>des</strong> problèmes d’interfaces<br />
tête col et/ou un <strong>des</strong>cellement fémoral.<br />
*J.-Y. Lazennec, Département de Chirurgie Orthopedique,<br />
Hôpital Pitié-Salpêtrière, 83, boulevard de l’Hôpital,<br />
75013 Paris.<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S81<br />
129 Courbure rachidienne sagittale et<br />
luxations précoces après reprise de<br />
prothèse totale de hanche : à propos<br />
d’une analyse prospective de<br />
49 reprises de prothèse totale<br />
E. DE THOMASSON*, C. MAZEL, O.GUINGAND,<br />
R. TERRACHER<br />
OBJECTIF. La survenue d’une luxation post opératoire après<br />
reprise de prothèse totale de hanche (RPTH) est une complication<br />
fréquente. Si certains facteurs de risque ont été bien identifiés<br />
(pseudarthrose du grand trochanter, antécédents de luxation récidivante<br />
ou infect Leux, interventions multip<strong>les</strong>), le rôle <strong>des</strong> modifications<br />
morphologiques du rachis est moins bien précisé. Le but<br />
de cette étude prospective était du préciser son rôle dans la survenue<br />
<strong>des</strong> luxations post opératoires.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Quarante-neuf patients opérés<br />
d’une RPTH entre septembre 2000 et mars 2002 ont été évalués<br />
prospectivement. <strong>Tous</strong> ont bénéficié en pré opératoire d’un bilan<br />
radiologique rachidien permettant d’évaluer la statique lombopelvienne<br />
selon <strong>les</strong> critères morphologiques de Legaye et Duval<br />
Beaupère et d’une fiche clinique informatisée permettant la saisie<br />
de données pré, per ou post opératoires incluant <strong>les</strong> facteurs de<br />
risques habituels de luxations, qu’ils soient liés au terrain ou à la<br />
technique utilisée. Cinq patients ont présenté une luxation postopératoire,<br />
malgré l’absence apparente de défauts de positionnement<br />
<strong>des</strong> implants.<br />
La valeur moyenne de la pente sacrée était significativement<br />
différente (p = 0,006) chez <strong>les</strong> patients s’étant luxés en comparaison<br />
de ceux indemnes de luxation. Cette différence restait significative<br />
(p = 0,017) si on limitait l’étude aux 33 patients ne présentant<br />
aucun facteur de risque associé de luxation post opératoire.<br />
(Antécédents de luxation récidivante ou infectieux, ou d’intervention<br />
multip<strong>les</strong>, pseudarthrose serrée du grand trochanter).<br />
DISCUSSION. Notre étude démontre le rôle de la morphologie<br />
lombaire dans la survenue <strong>des</strong> luxations post opératoires. Elle<br />
intervient en modifiant la statique pelvienne et donc <strong>les</strong> repères de<br />
pose <strong>des</strong> implants habituellement utilisés mais aussi en diminuant<br />
l’amplitude du bassin lors <strong>des</strong> passages de la position assise à la<br />
position debout, qui doit être compensée par une plus grande<br />
amplitude de la hanche, en particulier en extension.<br />
*E. De Thomasson, IMM, 42, boulevard Jourdan, 75014 Paris.<br />
130 Variabilité intra et interobservateur<br />
pour la mesure de l’usure <strong>des</strong> prothèses<br />
tota<strong>les</strong> de hanche avec le<br />
système Imagika<br />
D. TOURRAINE*, N. POILBOUT, P.RACINEUX,<br />
J.-L. TOULEMONDE, P.MASSIN<br />
INTRODUCTION. Nous avons testé la fiabilité du système de<br />
lecture informatisé <strong>des</strong> radiographies « Imagika » pour mesurer
3S82 78 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
l’usure linéaire <strong>des</strong> prothèses tota<strong>les</strong> de hanche sur <strong>des</strong> clichés du<br />
bassin de face.<br />
MATÉRIEL. Des lectures d’usure ont été effectuées sur <strong>des</strong><br />
prothèses tota<strong>les</strong> de hanche sans ciment (20) et sur <strong>des</strong> prothèses<br />
tota<strong>les</strong> de hanche cimentées (19), basées sur la distance séparant<br />
<strong>les</strong> centres de la cupule cotyloïdienne et de la bille fémorale. Le<br />
système délivre <strong>des</strong> mesures au centième de millimètre, qui ont été<br />
arrondies au dixième de millimètre le plus proche. Avec <strong>les</strong> prothèses<br />
sans ciment, le centre de la cupule cotyloïdienne a été<br />
retrouvé automatiquement sur <strong>les</strong> radiographies digitalisées à partir<br />
du contour de la cupule métallique cotyloïdienne. Avec <strong>les</strong><br />
cupu<strong>les</strong> cimentées, le centre de la cupule a été déterminé à partir de<br />
5 points situés sur l’ellipse métallique incluse à la circonférence du<br />
polyéthylène. Le logiciel place automatiquement le point cliqué<br />
par l’examinateur sur la zone immédiatement adjacente de plus<br />
fort contraste.<br />
MÉTHODE. Cinq examinateurs ont lu successivement <strong>les</strong><br />
radiographies à 2 reprises à 15 jours d’intervalle : un interne en<br />
début d’internat, un interne d’orthopédie, un radiologue, un senior<br />
chirurgien traumatologue, un senior chirurgien spécialiste de la<br />
hanche. Les résultats ont été comparés de façon à déterminer la<br />
variabilité inter et intra-observateur <strong>des</strong> mesures.<br />
RÉSULTAT. La variabilité intra-observateur était assez réduite<br />
puisque l’écart type à 5 % d’erreur allait de un dixième de millimètre<br />
à 6 dixièmes de millimètres pour 4 examinateurs, mais il est<br />
montéà2millimètres pour le dernier examinateur. Les examinateurs<br />
<strong>les</strong> plus jeunes ont obtenu la meilleure reproductibilité, de<br />
l’ordre du dixième de millimètre. En revanche, la variabilité interobservateur<br />
était mauvaise avec <strong>des</strong> écarts-types de plusieurs millimètres<br />
pour un risque 5 %. Si l’on compare <strong>les</strong> deux examinateurs<br />
ayant obtenu <strong>les</strong> meilleures performances de lecture, <strong>les</strong><br />
écarts-types <strong>des</strong> mesures atteignent3à4millimètres.<br />
DISCUSSION. La précision <strong>des</strong> mesures est supérieure pour <strong>les</strong><br />
cupu<strong>les</strong> cimentées. Par contre, avec <strong>les</strong> cupu<strong>les</strong> sans ciment, le<br />
pourtour de la tête est parfois difficile distinguer même avec le<br />
système d’optimisation du contraste, et <strong>des</strong> écarts de mesure de<br />
l’ordre du millimètre sont constatés.<br />
CONCLUSION. Il ressort de nos résultats que la reproductibilité<br />
<strong>des</strong> mesures avec le système Imagika n’est pas suffisante pour<br />
étudier l’usure <strong>des</strong> prothèses tota<strong>les</strong> de hanche, pour laquelle une<br />
précision de l’ordre du dixième de millimètre est requise.<br />
*D. Tourraine, Département de Chirurgie Osseuse,<br />
CHU d’Angers, 4, rue Larrey, 49033 Angers Cedex 01.<br />
131 Suivi à 5 ans d’une banque de tissus<br />
osseux et de plus de 25 000<br />
greffons implantés<br />
J. CATON*, S. EYRARD, L. BARNOUIN<br />
INTRODUCTION. La chirurgie prothétique de la hanche<br />
(150 000 PTH en France dont 10 à 12 % de reprises) a nécessité la<br />
mise à disposition pour utilisation immédiate de greffes osseuses.<br />
Les exigences de traçabilité et de sécurité <strong>des</strong> greffons ont entraîné<br />
la disparition <strong>des</strong> banques personnel<strong>les</strong> et la création de banques<br />
de tissus validées : TBF, autorisée par l’AFSSAPS en janvier<br />
2001, a débuté son activité en 1992, recueillant <strong>des</strong> Têtes Fémora<strong>les</strong><br />
(TF) prélevées lors <strong>des</strong> arthroplasties de hanche.<br />
MATÉRIEL. L’activité de recueil a réellement augmenté<br />
depuis 5 ans. En 2002, 5004 TF ont été prélevées dans 126 établissements<br />
hospitaliers publics ou privés. Les rejets de TF pour causes<br />
réglementaires, sanitaires (sélection clinique et biologique) et<br />
de qualité de prélèvement ont été stable autour de 20 % de 1997 à<br />
2002. Les rejets pour cause d’origine socio-clinique varient de 3 à<br />
5 % : cancers, antécédents transfusionnels, maladie de système<br />
et/ou notion de maladie neuro-dégénérative, traitement par <strong>des</strong><br />
corticoï<strong>des</strong> au long cours, notion de risque infectieux, viral essentiellement<br />
(par ordre décroissant). Le rejet secondaire à l’impossibilité<br />
de réaliser <strong>les</strong> analyses biologiques réglementaires a évolué<br />
de3à6%:hémolyse, quantité insuffisante pour <strong>les</strong> dosages ou<br />
pour conservation de la sérothèque, ALAT indosab<strong>les</strong>. Le rejet<br />
pour cause biologique a diminué de 16 % à 9 % : taux d’ALAT,<br />
sérologies évoquant un risque d’infection récente ou ancienne :<br />
hépatite B, hépatite C, syphilis, HIV, HTLV (par ordre décroissant).<br />
TRAITEMENT. Les TF sont traitées chimiquement (inactivation<br />
virale et prions), mécaniquement (production de copeaux,<br />
blocs spongieux, coins, TF entière avec ou sans col), radiostérilisées<br />
et lyophilisées.<br />
RÉSULTATS. Soixante pour cent <strong>des</strong> greffons sont utilisés dans<br />
<strong>les</strong> arthroplasties de hanche majoritairement lors <strong>des</strong> reprises<br />
(80 %) (1,4 greffons en moyenne, têtes entière et blocs, plus<br />
récemment copeaux) 8,5 % pour <strong>des</strong> arthroplasties du genou,<br />
11,5 % pour arthrodèses rachidiennes (blocs), 11 % pour <strong>des</strong> fractures<br />
(par ordre décroissant : fémur, tibia distal, plateau tibial,<br />
cheville, pied, épaule, bras, autres) 4 % pour pseudarthroses, 5 %<br />
pour <strong>des</strong> ostéotomies (bloc ou coins d’ostéotomie).<br />
CONCLUSION. Actuellement, de plus en plus de greffons sont<br />
utilisés pour <strong>les</strong> ostéotomies et <strong>les</strong> arthrodèses vertébra<strong>les</strong>. Les<br />
copeaux sont en augmentation d’utilisation. Nous travaillons<br />
actuellement sur une pâte d’os spongieux avec une association de<br />
substitut calcique.<br />
*J. Caton, Clinique Emilie-de-Vialar,<br />
116, rue Antoine-Charial, 69003 Lyon.<br />
132 Transformation de phase dans <strong>les</strong><br />
têtes Zircone après PTH : mythe ou<br />
réalité ?<br />
J. CATON*, J.-P. BOURALY, P.REYNAUD,<br />
Z. MERABET<br />
INTRODUCTION. De 1985 à 2001, près de 400 000 têtes Zircone<br />
ont été implantées pour <strong>des</strong> prothèses tota<strong>les</strong> de hanches. En<br />
France, à la suite d’un taux anormal de ruptures, portant sur 2 lots<br />
en cuisson four TH, la fabrication <strong>des</strong> têtes Zircone a été interrompue<br />
au mois d’août 2001.A la suite <strong>des</strong> travaux deAllain et al., une<br />
autre polémique s’est installée sur <strong>les</strong> têtes Zircone, avec un taux<br />
d’usure anormal, secondaire selon <strong>les</strong> auteurs : « a une augmentation<br />
de la rugosité de la tête par transformation de phase avec<br />
arrachage de grains ». Hypothèse corroborée par la publication
d’Haraguchi (2001) à propos de 3 têtes explantées. Nous avons<br />
voulu vérifier cette hypothèse.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. En 2002, nous avons explanté 3<br />
têtes Zircone 22,2 Prozyr pour luxation récidivante que nous avons<br />
comparées à 1 tête Zircone neuve et à 1 tête alumine diamètre 28,<br />
également explantée à l’occasion d’un <strong>des</strong>cellement de prothèse,<br />
et à 1 tête alumine neuve avec le même protocole qu’Haraguchi.<br />
RÉSULTAT. Le pourcentage de Zircone monoclinique retrouvé<br />
a toujours été très faible et inférieur à 10 %(3 à 10 %) sur <strong>les</strong> têtes<br />
explantées. Le taux de rugosité, est resté également très faible avec<br />
un Ra de 0,01 µm qu’il s’agisse <strong>des</strong> têtes Zircone ou Céramique,<br />
neuves ou explantées, sans déchaussement de grain et sans modification<br />
notable de structure, la taille moyenne <strong>des</strong> grains <strong>des</strong> têtes<br />
fémora<strong>les</strong> restant conforme à la norme ISO 13 356 (1997).<br />
DISCUSSION. Clarke (2003) a, sur 23 têtes Zircone explantées,<br />
sélectionné 3 têtes à 2,8 et 10 ans de recul pour étude. Les<br />
têtesà2et10ansn’ont pas montré de transformation de phase ni<br />
de lésions de surface. Sur la tête explantée à 8 ans a été retrouvée<br />
une transformation de phase monoclinique importante. Dans notre<br />
étude, sur <strong>les</strong> 3 têtes prélevées nous n’avons pas retrouvé de transformation<br />
significative de phase monoclinique, puisque celle-ci<br />
reste inférieure à 10 % sans arrachage de grain ni d’augmentation<br />
de la rugosité. Il est possible que le comportement <strong>des</strong> têtes Zircone<br />
22,2 soit différent <strong>des</strong> têtes Zircone 28, tant en ce qui<br />
concerne <strong>les</strong> fractures (puisque aucune fracture en tête 22,2 n’a été<br />
relevée après la cuisson en fours TH), et la transformation de phase<br />
en monoclinique.<br />
CONCLUSION. L’enjeu est important pour tous <strong>les</strong> patients<br />
porteurs de PTH avec tête Zircone. Il est bien évident que la<br />
surveillance doit se poursuivre. Dans l’immédiat et à moyen<br />
terme, nous pouvons conclure que le taux de phase monoclinique<br />
est faible sur <strong>les</strong> têtes Zircone explantées et permet de supposer<br />
une bonne qualité de fabrication <strong>des</strong> têtes notamment en ce qui<br />
concerne <strong>les</strong> diamètres 22,225 mm.<br />
*J. Caton, Clinique E. De Vialar,<br />
116, rue A. Charial, 69003 Lyon.<br />
133 Intérêt de la ligature de l’artère circonflexe<br />
médiale de la cuisse sur le<br />
saignement per et postopératoire<br />
dans la chirurgie prothétique de<br />
hanche<br />
P. CHIRON*, F. FABIÉ, G.GIORDANO,<br />
J.-L. TRICOIRE, J.PUGET<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Deux séries de 35 prothèses tota<strong>les</strong><br />
de hanche opérées par voie postérieure, par le même chirurgien<br />
ont été comparées ; l’une correspond à <strong>des</strong> mala<strong>des</strong> opérés en 1999<br />
et l’autre à <strong>des</strong> mala<strong>des</strong> opérés en 2001 avec ligature systématique<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S83<br />
de l’artère circonflexe postérieure (circonflexe médiale). Le<br />
modèle de prothèse utilisé est en tous <strong>les</strong> cas le même : une tige de<br />
type omnicase et un cupule de type Schuster (Centerpulse) ou un<br />
cupule en polyéthylène. Cette série comprend <strong>des</strong> prothèses avec<br />
(37) et sans ciment (32) et une prothèse hybride. De manière<br />
rétroactive, ont été analysés le saignement per et post-opératoire,<br />
l’hématocrite pré et postopératoire immédiat, le nombre de culots<br />
sanguins passés en peropératoire et en postopératoire. La comparaison<br />
de ces différents chiffres nous permet d’évaluer l’importance<br />
du saignement peropératoire et postopératoire. Les résultats<br />
ont fait l’objet d’une analyse statistique. Technique : Par voie postérieure<br />
avant section <strong>des</strong> musc<strong>les</strong> pelvitrochanteriens, <strong>les</strong> fibres<br />
du muscle quadratus femoris sont dissociées au niveau de leur tiers<br />
supérieur. L’artère se dirige de bas en haut et d’arrière en avant<br />
vers le bord postérieur du grand trochanter difficilement repérable<br />
dans un amas graisseux. Elle est liée à ce niveau avec ses veines<br />
satellites. La ligature de l’artère diminue le premier temps hémorragique<br />
lors de la section <strong>des</strong> musc<strong>les</strong> pelvitrochanteriens et de la<br />
capsule. De même, il semble que la section du col du fémur ellemême<br />
soit moins hémorragique ainsi que la préparation du grand<br />
trochanter dans sa partie proximale.<br />
RÉSULTATS. Le saignement per et postopératoire exprimé en<br />
ml est significativement diminué par la ligature de l’artère circonflexe<br />
postérieure et de ses deux veines satellites. Le saignement<br />
moyen peropératoire est diminué de plus de moitié. Six <strong>des</strong> 35<br />
patients qui n’ont pas eu de ligature de l’artère ont saigné plus de<br />
600 cc au cours de l’intervention. De tels saignements ne se sont<br />
jamais reproduits depuis que l’artère est liée. L’hématocrite postopératoire<br />
est significativement plus haut dans le groupe « artère<br />
liée » et le delta d’hématocrite qui correspond à la différence entre<br />
l’Ht pré et postopératoire est plus faible. Parallèlement, la quantité<br />
de sang transfusée est moins importante. Avec cette technique, la<br />
quantité de sang transfusée en peropératoire est divisée par 7 et la<br />
transfusion postopératoire est devenue marginale. Enfin, il est<br />
intéressant de noter que pour <strong>les</strong> variab<strong>les</strong> étudiées, le mode de<br />
fixation de l’implant n’influence pas le saignement.<br />
DISCUSSION. La technique habituelle sans ligature de l’artère<br />
circonflexe postérieure ne conduit pas toujours à un saignement<br />
opératoire important. Il est tout à fait possible de réaliser une<br />
arthroplastie totale de hanche avec un saignement inférieur à 200<br />
cc. La réalisation de la ligature de l’artère circonflexe postérieure<br />
conduit beaucoup plus régulièrement à un saignement de faible<br />
importance qui justifie l’absence de l’utilisation du sang récupéré<br />
en per-opératoire, voire de transfusion sanguine postopératoire. Le<br />
geste technique est simple, rapide et reproductible. Sa réalisation<br />
n’entraîne pas de complication particulière. La simple coagulation<br />
au bistouri électrique, n’est souvent pas suffisante si l’on tient<br />
compte du calibre de ces vaisseaux et de la présence <strong>des</strong> veines non<br />
accessible à une coagulation efficace. En per opératoire le saignement<br />
du à la section de l’artère circonflexe est sous évalué en<br />
raison de la striction en position de rotation interne forcée ;<br />
l’hémostase après section est rendue difficile par la rétraction du<br />
segment proximal, sous <strong>les</strong> musc<strong>les</strong>.<br />
*P. Chiron, Service d’Orthopédie, CHU Rangueil,<br />
1, avenue Jean-Poulhès, 31403 Toulouse Cedex.
3S84 78 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
134 Facteurs cliniques et radiologiques<br />
influençant le résultat précoce<br />
d’une prothèse de resurfaçage de la<br />
hanche métal/métal<br />
P.E. BEAULE*, M. LEDUFF, F.DOREY,<br />
H. AMSTUTZ<br />
INTRODUCTION. Le but de cette étude était d’évaluer <strong>les</strong><br />
facteurs cliniques et radiologiques influençant le résultat précoce<br />
d’une prothèse de re surfaçage de la hanche chez l’adulte jeune.<br />
MATÉRIELS ET MÉTHODES. Parmi <strong>les</strong> 119 prothèses de<br />
resurfaçage hybri<strong>des</strong> à frottement métal/métal réalisées chez <strong>des</strong><br />
patient âgés de 40 ans ou moins, 94 ont été incluses avec un recul<br />
minimal de 2 ans ou un échec. L’âge moyen <strong>des</strong> patients était de<br />
34,2 ans (15 à 40). 71 % d’hommes. 14 % avaient déjà eu une<br />
intervention sur la hanche. Un indice de risque (SARI) a été développé<br />
à partir de l’indice de Chandler.<br />
RÉSULTATS. Le recul moyen de la série était de 3 ans (2 à 5<br />
ans). Les items du score UCLA ont été améliorés : douleur 3,1<br />
versus 9,2 ; marche 5,8 versus 9,4 (p = 0,00). Trois hanches ont été<br />
reprises par prothèse totale à un recul moyen de 27 mois (2 à 50), et<br />
10 patients présentaient <strong>des</strong> modifications radiologiques notab<strong>les</strong>.<br />
Les score d’indices pour ces 13 hanches versus <strong>les</strong> 47 autres<br />
étaient : 4,7 versus 2,6 pour le score SARI (p = 0,000) et 2,6 versus<br />
2,8 pour le score de Chandler (p = 0,358). Il n’existait aucune<br />
corrélation avec la mécanique de la reconstruction, la fonction, la<br />
marche ou la cotation. Une implantation en valgus de la pièce<br />
fémorale et le bras de levier externe étaient négativement corrélés<br />
(r = 0,39, p < 0,001).<br />
DISCUSSION. Si le score SARI était > 3, le risque relatif de<br />
complications précoces était 12 fois plus grand qu’en cas de le<br />
score SARI est < ou égale à 3. En raison de la fixation distincte de<br />
l’implant fémoral, une note de 2 dans le score SARI a été attribué<br />
à la présence d’un kyste dans la tête fémorale et à un poids < 82 kg<br />
(plus le poids était petit, plus l’implant était petit, r = 0,60). L’utilisation<br />
de cet indice pourrait améliorer la sélection <strong>des</strong> patients<br />
dans le but de définir le rôle que pourrait jouer l’arthroplastie de<br />
resurfaçage dans le traitement de la coxarthrose.<br />
*P.E. Beaule, Joint Replacement Institute at Orthopaedic<br />
Hospital, 2400 South Flower Street,<br />
Los Ange<strong>les</strong>, CA 90007, Etats-Unis.<br />
135 Cupule jumelées hybri<strong>des</strong> à couple<br />
de frottement métal sur métal pour<br />
le traitement de la nécrose de la tête<br />
fémorale<br />
P.E. BEAULE*, M. LEDUFF, H.AMSTUTZ<br />
INTRODUCTION. Le traitement de la nécrose de la tête fémorale<br />
pour <strong>les</strong> sta<strong>des</strong> Ficat III et IV est toujours un problème majeur<br />
et sujet de controverse, en raison du jeune âge <strong>des</strong> patients et <strong>des</strong><br />
résultats décevants <strong>des</strong> prothèses tota<strong>les</strong> de hanche (PTH). Cette<br />
étude présente notre expérience avec <strong>les</strong> cupule jumelées (CJ)<br />
hybri<strong>des</strong> (scellées sur le versant fémoral et non-scellées sur le<br />
versant acétabulaire) à couple de frottement métal sur métal pour<br />
déterminer <strong>les</strong> mécanismes menant à la reprise ainsi que <strong>les</strong> résultats<br />
cliniques à moyen terme.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Cinquante-quatre hanches<br />
atteintes d’ostéonécrose traitées par cupu<strong>les</strong> jumelées à notre institution<br />
furent étudiées avec un recul minimum de 2 ans. L’âge<br />
moyen <strong>des</strong> patients était de 40,4 ans (16 à 56) avec 13 % de<br />
femmes et 87 % d’hommes. Les hanches furent évaluées selon le<br />
score de Ficat (13 % stade III, et 87 % stade IV). Trente-trois pour<br />
cent <strong>des</strong> hanches avaient subi une opération préalable.<br />
RÉSULTATS. Le recul moyen était de 4,4 ans (2,1 à 6,8). Quatre<br />
hanches furent reprises : 3 pour déscellement fémoral après une<br />
durée moyenne de 46,3 mois, et une pour fracture de la paroi de<br />
l’acétabulum immédiatement après l’opération. Les scores<br />
moyens de la grille d’évaluation UCLA montraient une amélioration<br />
de 3,3 à 9,3 pour la douleur, 5,5 à 9,7 pour la marche, 5,0 à 9,4<br />
pour le fonctionnement, et 4,2 à 7,2 pour l’activité. Les composants<br />
physiques et mentaux du questionnaire SF-12 montrent un<br />
retour à une qualité de vie normale en comparaison à la population<br />
générale <strong>des</strong> Etats-Unis.<br />
DISCUSSION. Bien qu’il soit encore trop tôt pour spéculer sur<br />
l’efficacité à long terme <strong>des</strong> CJ à couple de frottement métal sur<br />
métal pour de jeunes patients atteints d’ostéonecrose de la hanche,<br />
<strong>les</strong> résultats cliniques sont encourageants. Cette prothèse représente<br />
une alternative à la cupule ajustée dans <strong>les</strong> cas où le cartilage<br />
acétabulaire est endommagé exposée alors à <strong>des</strong> résultats inférieurs.<br />
Si nécessaire, le composant acétabulaire peut-être retenu<br />
lors de la conversion à une PTH, sans effet néfaste sur ses résultats<br />
cliniques.<br />
*P.E. Beaule, Joint Replacement Institute at Orthopaedic<br />
Hospital, 2400 South Flower Street,<br />
Los Ange<strong>les</strong>, CA 90007, Etats-Unis.
136 Le débridement arthroscopique<br />
dans le traitement <strong>des</strong> gonarthroses<br />
avérées chez <strong>les</strong> mala<strong>des</strong> âgés<br />
de plus de cinquante ans<br />
C. PUIG ABBS*, P. JIMENEZ, J.L. PARRA,<br />
J. FENOLLOSA<br />
INTRODUCTION. Le rôle de l’arthroscopie dans le traitement<br />
de l’arthropathie dégénérative du genou est encore controversé.<br />
L’objectif de cette étude est d’évaluer l’efficacité du débridement<br />
arthroscopique, et d’établir son indication, lors du traitement <strong>des</strong><br />
gonarthroses dans <strong>les</strong> patients âgés de plus de 50 ans.<br />
MATÉRIEL. Cent quatre-vingt-douze patients (72 hommes,<br />
120 femmes) avec un âge moyen de 59 ans (51-75) ont bénéficié<br />
d’un débridement arthroscopique entre 1994 et 2002. Les antécédents<br />
ont été notés, en particulier <strong>les</strong> pathologies graves contreindiquant<br />
une chirurgie majeure, et <strong>les</strong> traumatismes précédents<br />
<strong>des</strong> membres inférieurs, spécialement ceux atteignant le même<br />
genou. L’activité et le poids <strong>des</strong> mala<strong>des</strong> ont aussi été considérés.<br />
MÉTHODES. Le bilan préopératoire incluait un examen clinique<br />
avec une évaluation fonctionnelle (Freeman), et une étude<br />
radiologique permettant de classer le degré d’arthrose (initiale,<br />
modérée ou avancée) et de mesurer l’axe du genou. Dans tous <strong>les</strong><br />
cas, nous avons réalisé un lavage articulaire associé aux différents<br />
gestes du débridement. La chondropathie était évaluée selon la<br />
classification de Marshall. Lors du suivi une nouvelle évaluation<br />
fonctionnelle était réalisée, de même qu’une appréciation subjective.<br />
RÉSULTATS. 5,2 % présentaient une pathologie grave et 9,3 %<br />
avaient été opérés de ce même genou. 82 % souffraient d’une<br />
arthrose modérée, dans la majorité <strong>des</strong> cas tricompartimentale.<br />
92 % <strong>des</strong> genoux avaient une condropathie degré II ou III.Avec un<br />
recul moyen de 28 mois (5-108), l’évaluation fonctionnelle<br />
moyenne est passée de 69,4/110 en préopératoire à 89,5/110 en<br />
postopératoire. 75,4 % <strong>des</strong> patients se sont déclarés améliorés. En<br />
moyenne, le suivi fut de 28 mois (5-108). Cinq patients seulement<br />
ont nécessité une arthroplastie ultérieure. Les mauvais résultats<br />
s’associaient à la présence d’une chondropathie degré III ou IV<br />
selon Marshall sur <strong>les</strong> trois compartiments, ainsi qu’à l’existence<br />
<strong>des</strong> antécédents mentionnés. L’âge n’était pas corrélé à un mauvais<br />
résultat.<br />
DISCUSSION. Nous avons étudié une population avec arthrose<br />
avérée ayant été soumis à un traitement peu agressif avec un but<br />
principalement palliatif. Seulement 2,6 % <strong>des</strong> patients ont subi<br />
une arthroplastie totale ultérieure. L’amélioration fonctionnelle<br />
est évidente, principalement par réduction de la douleur. La grande<br />
majorité <strong>des</strong> patients sont satisfaits du résultat obtenu, ne nécessitant<br />
qu’un traitement médical occasionnel. Les résultats médiocres<br />
sont observés chez <strong>les</strong> patients avec une gonarthrose trop<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S85<br />
Séance du 12 novembre matin<br />
GENOU<br />
avancée et ne pouvant pas bénéficier d’une arthroplastie totale de<br />
genou par <strong>des</strong> raisons médica<strong>les</strong>.<br />
*C. Puig Abbs, Servicio COT, Hospital Dr. Peset,<br />
90, Av. Gaspar Aguilar, 46017 Valencia, Espagne.<br />
137 Description d’une technique originale<br />
de réalisation en « va et vient »<br />
<strong>des</strong> voies d’abord arthroscopiques<br />
postérieures<br />
O. CHARROIS*, S. LOUISIA, P.BEAUFILS<br />
INTRODUCTION. Les voies postérieures sont habituellement<br />
réalisées alternativement sous le contrôle visuel de l’optique introduite<br />
par une <strong>des</strong> voies antérieures et glissé dans l’échancrure vers<br />
le compartiment postérieur controlatéral. Ces deux voies postérieures<br />
« croisées » permettent d’accéder à la partie postérieure<br />
<strong>des</strong> ménisques et aux coques condyliennes mais leur obliquité et<br />
l’existence d’une cloison sagittale séparant <strong>les</strong> compartiments<br />
postérieurs limitent l’accès visuel et instrumental à la partie postérieure<br />
de la cavité articulaire. Le but de ce travail est de décrire<br />
une technique originale de réalisation en « va et vient » <strong>des</strong> voies<br />
arthroscopiques postérieures permettant de créer un espace accessible<br />
en arrière du pivot central.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. La voie postéro-médiale est réalisée<br />
de façon classique. Par cette voie, l’optique est introduite<br />
permettant de visualiser le ligament croisé postérieur et la cloison<br />
postérieure au contact de laquelle il est poussé. L’optique est<br />
remplacée par un mandrin mousse qui perfore cette cloison<br />
au-<strong>des</strong>sus du ligament croisé postérieur, pénétrant dans le compartiment<br />
latéral. Le mandrin est poussé contre la paroi articulaire<br />
postéro-latérale, déterminant le point d’entrée correspondant. Un<br />
couteau motorisé est introduit dans l’extrémité de la canule puis<br />
ramené dans le compartiment médial. La cloison postérieure est<br />
réséquée ce qui crée un espace postérieur unique dans lequel il est<br />
possible de travailler sous contrôle permanent de la vue. Par une<br />
étude anatomique nous avons étudié le rapport entre <strong>les</strong> éléments<br />
nob<strong>les</strong> du creux poplité et <strong>les</strong> différents instruments durant la<br />
réalisation de cette intervention. Quinze patients souffrant de<br />
synovite villo-nodulaire ont eu une synovectomie exclusivement<br />
arthroscopique utilisant cette voie d’abord.<br />
RÉSULTATS. Nous n’avons constaté aucune complication<br />
vasculo-nerveuse ni récidive à moyen terme. Le confort <strong>des</strong> suites<br />
opératoires a été très supérieur à celui <strong>des</strong> synovectomies réalisées<br />
par arthrotomie.<br />
DISCUSSION. Cette technique difficile nécessite une bonne<br />
compréhension du positionnement <strong>des</strong> différents éléments anatomiques<br />
du creux poplité proches de la partie postérieure de l’articulation.<br />
Cet abord postérieur combiné, en facilitant l’accès à la<br />
partie postérieure de la cavité articulaire du genou, permet une<br />
approche nouvelle du ligament croisé postérieur et élargie <strong>les</strong>
3S86 78 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
indications de la synovectomie arthroscopique en permettant une<br />
résection plus complète, mais ne permet pas l’accès aux replis sous<br />
méniscaux ni à l’articulation fibulo-tibiale.<br />
*O. Charrois, Service d’Orthopédie Traumatologie,<br />
Hôpital André-Mignot, 177, rue de Versail<strong>les</strong>,<br />
78150 Le Chesnay.<br />
138 Lésions ménisca<strong>les</strong> : confrontation<br />
IRM-arthroscopie à propos de 188<br />
ménisques<br />
L.-D. DURANTHON*, C. CHAROUSSET,<br />
L. BELLAICHE, H.ROBIN, J.-B. ELIS<br />
Le but de cette étude est de comparer <strong>les</strong> lésions ménisca<strong>les</strong><br />
observées en arthroscopie aux <strong>des</strong>criptions IRM.<br />
L’IRM a toujours été relue sans tenir compte <strong>des</strong> <strong>des</strong>criptions<br />
arthroscopiques, par un seul opérateur. Il a été étudié pour chaque<br />
ménisque : l’existence ou non d’une lésion, la topographie de la<br />
lésion et la lésion principale selon la classification de Trillat.<br />
188 ménisques ont été étudiés chez 94 patients. Il y avait 90<br />
ménisques sains en arthroscopie et 89 en IRM soit une spécificité<br />
de 98,9 %, et 98 lésions ménisca<strong>les</strong> en arthroscopie pour 95 en<br />
IRM, soit une sensibilité de 96,6 %. Le ménisque interne était lésé<br />
78 fois, le ménisque externe 20 fois. L’arthroscopie et l’IRM<br />
retrouvent le même type de lésion principale dans 62 cas sur 98,<br />
répertorié en 47 sur 78 pour le ménisque interne et 15 sur 20 pour<br />
le ménisque externe. Notamment 25 sur 29 lésions horizonta<strong>les</strong><br />
étaient reconnues à l’IRM, mais une seule lésion radiale du ménisque<br />
interne était vue à l’IRM sur 7 cas diagnostiqués en arthroscopie.<br />
La topographie était concordante dans 18 cas sur 98. L’IRM<br />
majorait la taille de la lésion dans 54 cas sur 98.<br />
L’IRM reste l’examen complémentaire de référence dans le<br />
diagnostic <strong>des</strong> lésions ménisca<strong>les</strong>, avec une forte sensibilité et<br />
spécificité. Néanmoins en ce qui concerne la <strong>des</strong>cription anatomique<br />
précise de la lésion, la concordance entre l’IRM et l’arthroscopie<br />
est moindre. Certaines lésions semblent plus faci<strong>les</strong> à mettre<br />
en évidence, en particulier <strong>les</strong> lésions horizonta<strong>les</strong>, d’autre plus<br />
diffici<strong>les</strong> notamment <strong>les</strong> lésions radia<strong>les</strong>.<br />
*L.-D. Duranthon, Clinique <strong>des</strong> Lilas,<br />
41, avenue du Maréchal-Juin, 93260 Les Lilas.<br />
139 Évaluation à long terme du syndrome<br />
du cyclope traité par arthrolyse<br />
arthroscopique<br />
J. BARTH*, N. GRAVELEAU, O.SIEGRIST,<br />
P. CHAMBAT<br />
INTRODUCTION. Le syndrome du cyclope est une complication<br />
survenant après ligamentoplastie du ligament croisé antérieur,<br />
caractérisée par un flexum, isolé ou associé à <strong>des</strong> douleurs antérieures,<br />
<strong>des</strong> craquements, <strong>des</strong> hydarthroses survenant typiquement<br />
à l’effort. Le diagnostic est confirmé par l’IRM. Le traitement est<br />
arthroscopique : excision du nodule éventuellement associée à une<br />
plastie osseuse de l’échancrure si le flexum persiste.<br />
Dans la littérature, on rapporte <strong>des</strong> résultats à court terme plutôt<br />
décevants. Nous nous sommes donc intéressés au devenir à long<br />
terme.<br />
MATÉRIEL. De janvier 1992 à décembre 1994, ont été opérés<br />
835 patients par plastie-os-tendu. Trente-six ont été secondairement<br />
opérés pour un syndrome du cyclope (4,3 %). L’âge moyen<br />
lors de la reprise était de 26,2 ans (16 à 43 ans). Il s’agissait<br />
principalement de sujets sportifs. Vingt-trois patients (63,9 %) ont<br />
été revus en consultation et 6 (16,7 %) contactés par téléphone. Le<br />
délai moyen de révision était de 9 ans (min : 8 ans, max : 10 ans).<br />
MÉTHODE. Les patients ont été revus avec la fiche IKDC 1999<br />
(évaluation subjective et examen clinique) et une laximétrie au KT<br />
1000. Nous avons étudié également l’évolution de la symptomatologie<br />
propre au cyclope.<br />
RÉSULTATS. Nous avons observé 2 reruptures (6,9 %). Le<br />
score IKDC subjectif final moyen était de 81,6 points. La moitié<br />
<strong>des</strong> patients avaient de bons résultats (supérieurs à 82 points). En<br />
revanche, l’autre moitié présentaient un score décevant (entre 50 et<br />
80 points). Le score IKDC objectif final était : A = 17,4 % ; B =<br />
65,2 % ; C = 8,7 % ; D = 8,7 %. Treize patients avaient une symptomatologie<br />
persistante de cyclope syndrome (44,8 %). Quatorze<br />
patients gardaient une limitation <strong>des</strong> amplitu<strong>des</strong> articulaires (48,3<br />
%). Quinze patients avaient diminué leur niveau d’activité physique<br />
(51,7 %).<br />
DISCUSSION. L’origine du cyclope est un sujet de controverse.<br />
Il est difficile d’évaluer le risque de rupture itérative, étant<br />
donnée la faible population et le délai de reprise est long dans cette<br />
étude.<br />
CONCLUSION. Le syndrome du cyclope ne semble pas un<br />
facteur de risque pour la laxité mais un facteur de morbidité non<br />
négligeable même 10 ans après. Il semble important de ne pas<br />
tarder à réopérer, afin d’éviter que le genou ne s’installe dans une<br />
spirale de souffrance chronique. L’intérêt du « flexum postopératoire<br />
» qui a autrefois été recommandé n’est plus justifié.<br />
*J. Barth, Clinique Sainte-Anne-Lumière,<br />
85, court Albert-Thomas, 69003 Lyon.<br />
140 Séquel<strong>les</strong> de méniscectomie<br />
externe : intérêt de la médialisation<br />
de la tubérosité tibiale<br />
P. TOUCHARD*, E. DEHOUX, E.FOURATI,<br />
K. MADI, C.MENSA, P.SÉGAL<br />
Classiquement rapportés, <strong>les</strong> remaniements dégénératifs<br />
fémoro-tibiaux après méniscectomie résultent de mécanismes biomécaniques<br />
différents selon le compartiment considéré. Si<br />
l’atteinte du compartiment interne, plus fréquente, traduit l’augmentation<br />
<strong>des</strong> contraintes cartilagineuses ponctuel<strong>les</strong> en compression<br />
dans un compartiment congruent, l’atteinte du compartiment<br />
externe résulte quant à elle de la majoration de l’instabilité relative<br />
d’une structure dévolue à la mobilité. Après méniscectomie<br />
externe, la cinétique fémoro-tibiale est perturbée par atteinte de
l’articulation ménisco-tibiale siège du glissement, aboutissant à<br />
une instabilité horizontale source d’effet came générateur d’arthrose<br />
et expliquant la survenue de ces décompensations externes en<br />
l’absence de genu valgum.<br />
Sur la base <strong>des</strong> travaux de Grammont et Rudy, nous avons<br />
proposé de limiter cette instabilité horizontale et de transférer une<br />
partie <strong>des</strong> contraintes vers le compartiment interne à l’aide d’une<br />
médialisation de la tubérosité tibiale.<br />
Dix-huit patients, d’âge moyen 44 ans, ont été pris en charge<br />
pour <strong>des</strong> atteintes dégénératives invalidantes, sans désaxation<br />
majeure (HKA moyen 181), en moyenne 10 ans après méniscectomie<br />
externe. Des remaniements dégénératifs externes étaient<br />
constatés sur <strong>les</strong> clichés de face dans 30 % <strong>des</strong> cas et sur 57 % <strong>des</strong><br />
clichés en schuss ; 5 patients présentaient <strong>des</strong> remaniements débutants<br />
du compartiment interne et une atteinte fémoro-patellaire<br />
était constatée dans 53 % <strong>des</strong> cas.<br />
L’atteinte du compartiment externe a été confirmée par l’exploration<br />
articulaire systématique et une chondropathie fémoropatellaire<br />
a été constatée à 8 reprises. La transposition de la tubérosité<br />
a été associée dans tous <strong>les</strong> cas à une section de l’aileron<br />
rotulien externe et à la remise en tension du plan interne.<br />
Dans 88 % <strong>des</strong> cas, <strong>les</strong> suites opératoires ont été simp<strong>les</strong>,<br />
l’appui soulagé avec attelle de Zimmer étant maintenu 21 jours.<br />
Les résultats fonctionnels ont été appréciés à partir <strong>des</strong> dossiers<br />
avec un recul moyen de 28 mois. Onze patients ont bénéficié d’un<br />
nouvel examen clinique et radiologique (recul moyen 34 mois). La<br />
symptomatologie douloureuse a été améliorée dans 88 % <strong>des</strong> cas<br />
permettant une reprise durable <strong>des</strong> activités professionnel<strong>les</strong> à<br />
partir du 3 e mois (4 genoux complètement oubliés). Sur le plan<br />
radiographique, l’intervention a permis d’obtenir, au recul moyen<br />
de 34 mois, une stabilisation <strong>des</strong> lésions cartilagineuses externes<br />
sans retentissement sur le compartiment interne.<br />
Ces résultats nous incitent à poursuivre notre attitude thérapeutique<br />
en réservant cette technique aux cas de décompensation<br />
externe symptomatique, sans désaxation importante en valgus,<br />
chez <strong>des</strong> patients jeunes.<br />
*P. Touchard, Service d’Orthopédie-Traumatologie,<br />
CHRU de Reims, Hopital Maison-Blanche,<br />
45, rue Cognacq-Jay, 51100 Reims.<br />
141 F<strong>les</strong>sum du genou par rétraction<br />
<strong>des</strong> ischio-jambiers chez l’adulte<br />
cérébrolésé : à propos d’une série<br />
de 37 patients traités par ténotomie<br />
distale <strong>des</strong> ischio-jambiers<br />
J.-N. MARTIN*, P. DENORMANDIE, G.SORRIAUX,<br />
O. DIZIEN, T.JUDET<br />
INTRODUCTION. Bien que la rétraction <strong>des</strong> ischio-jambiers<br />
soit une complication fréquente de l’hypertonie spastique, très peu<br />
de séries ont été publiées chez l’adulte. L’objectif de ce travail est<br />
d’évaluer <strong>les</strong> résultats <strong>des</strong> modalités thérapeutiques proposées :<br />
ténotomies dista<strong>les</strong> <strong>des</strong> ischiojambiers et utilisation du fixateur<br />
externe en cas de f<strong>les</strong>sum important.<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S87<br />
MATÉRIEL. La série rétrospective porte sur 37 adultes cérébrolés<br />
présentant 59 f<strong>les</strong>sum du genou. Le f<strong>les</strong>sum moyen était de<br />
69° (20-130) avec un secteur de mobilité moyen de 61° (10-100).<br />
Des déformations <strong>des</strong> articulations sus et sous-jacentes étaient<br />
présentes chez 82 % <strong>des</strong> patients. Dans 22 cas le f<strong>les</strong>sum du genou<br />
était bilatéral.<br />
MÉTHODE. Le geste comprenait <strong>des</strong> ténotomies simp<strong>les</strong> du<br />
couturier, du demi-tendineux et du droit interne et <strong>des</strong> allongements<br />
du semi-membraneux et du biceps. La désinsertion <strong>des</strong><br />
jumeaux, la section <strong>des</strong> coques postérieures et de l’aponévrose<br />
postérieure étaient associées au cas par cas. Il n’a jamais été nécessaire<br />
de sectionner le ligament croisé postérieur.<br />
L’immobilisation post-opératoire a été réalisée par attelle de<br />
Zimmer en cas de f<strong>les</strong>sum modéré et par fixateur externe fémorotibial<br />
en cas de déformation importante. Une rééducation postopératoire<br />
pluri-quotidienne était appliquée dans tous <strong>les</strong> cas.<br />
RÉSULTATS. Après un recul moyen de 641 jours, le f<strong>les</strong>sum<br />
résiduel moyen était de 6° (0-40°) et le secteur moyen de mobilité<br />
de 111°. <strong>Tous</strong> <strong>les</strong> genoux étaient stab<strong>les</strong>. Trois désunions cutanées<br />
ont nécessité une reprise chirurgicale. L’objectif fonctionnel, établi<br />
en préopératoire, a toujours été atteint ou dépassé.<br />
DISCUSSION. Quand une immobilisation post-opératoire est<br />
nécessaire, le fixateur externe limite <strong>les</strong> risques cutanés et facilite<br />
la rééducation. II semble ainsi supérieur aux plâtres successifs.<br />
Contrairement à d’autres auteurs, la section du ligament croisé<br />
postérieur ne nous semble pas nécessaire.<br />
CONCLUSION. Les ténotomies dista<strong>les</strong> <strong>des</strong> ischio-jambiers<br />
associées à une immobilisation post-opératoire par fixateur<br />
externe en cas de f<strong>les</strong>sum important sont une technique fiable et<br />
efficace dans le traitement <strong>des</strong> f<strong>les</strong>sum du genou de l’adulte cérébrolésé.<br />
*J.-N. Martin, Service d’Orthopédie,<br />
Hôpital Raymond-Poincaré, 92380 Garches.<br />
142 Fabrication d’un néocartilage in<br />
vitro par la culture en 3 dimensions<br />
de chondrocytes au sein de gels de<br />
collagène<br />
L. GALOIS*, S. HUTASSE, M.-C. RONZIERE,<br />
D. MAINARD, D.HERBAGE, A.-M. FREYRIA<br />
INTRODUCTION. Le cartilage lésé possède <strong>des</strong> capacités de<br />
réparation très limitées. La bioingénierie tissulaire représente<br />
aujourd’hui une alternative particulièrement intéressante dans la<br />
réparation <strong>des</strong> lésions cartilagineuses observées lors de traumatismes<br />
articulaires ou lors d’ostéochondrites disséquantes. Ce travail<br />
a pour but de synthétiser in vitro à partir de chondrocytes primaires<br />
cultivés en gels de collagène un néocartilage qui pourra être réimplanté<br />
dans la lésion cartilagineuse.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Les chondrocytes sont extraits<br />
par digestion enzymatique du cartilage de pieds de veau âgés de<br />
moins de six mois et ensemencés à raison de 2 millions de cellu<strong>les</strong><br />
dans <strong>des</strong> gels de collagène placés dans <strong>des</strong> boîtes multipuits et<br />
recouverts de milieu de culture (1 ml). Le collagène utilisé est du
3S88 78 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
collagène de type I issu de broyat de peau de veau à la concentration<br />
finale de 1,25 mg/ml. Le milieu de culture utilisé associe un<br />
mélange volume à volume de RPMI1640 et de NCTC 109. Ce<br />
mélange est supplémenté avec 10 % de sérum bovin fœtal,<br />
100 U/ml pénicilline, 100 mg/ml streptomycine et 250 ng/ml<br />
d’amphotéricine B). La prolifération cellulaire est appréciée par<br />
méthode fluorimétrique et la synthèse de glycosaminoglycanes<br />
(sGAG) par dosage colorimétrique. Une étude histologique (coloration<br />
en Safranine O) et immunohistochimique (collagènes de<br />
type I et II) sont effectuées pour suivre la synthèse <strong>des</strong> constituants<br />
de la matrice. Enfin, l’expression de gènes d’intérêt codant pour<br />
certaines protéines matriciel<strong>les</strong> (collagènes Ia 2 et a1, II, X, agrécane<br />
et MMP13) est étudiée grâce aux techniques de biologie<br />
moléculaire (RT-PCR).<br />
RÉSULTATS. Le phénotype chondrocytaire est conservé. Le<br />
collagène de type II ainsi que l’agrécane restent exprimés et<br />
l’expression du collagène de type I n’augmente pas au cours de la<br />
culture. Une synthèse progressive de sGAG est observée ainsi<br />
qu’une prolifération cellulaire modérée. La répartition <strong>des</strong> cellu<strong>les</strong><br />
au sein du gel apparaît homogène et leur morphologie reste arrondie<br />
pendant toute la durée de l’étude. Des dépôts de collagène de<br />
type II sont visib<strong>les</strong> dès le 9 e jour de culture en périphérie <strong>des</strong><br />
cellu<strong>les</strong> dans <strong>les</strong> zones de forte densité cellulaire puis augmentent<br />
au fil du temps.<br />
DISCUSSION. Nos résultats in vitro montrent que la culture en<br />
3 dimensions de chondrocytes au sein de gels de collagène permet<br />
la construction d’une matrice extracellulaire et la conservation du<br />
phénotype chondrocytaire pendant la période de culture.<br />
CONCLUSION. La matrice collagénique offre un environnement<br />
propice à la formation d’un cartilage artificiel fonctionnel<br />
par le chondrocyte et ouvre <strong>des</strong> perspectives prometteuses pour la<br />
réparation <strong>des</strong> lésions cartilagineuses.<br />
*L. Galois, Service de Chirurgie Orthopédique et<br />
Traumatologique (COT), 29, avenue du<br />
Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, CO n o 34,<br />
54035 Nancy Cedex.<br />
143 Greffe de chondrocytes autologues<br />
dans le traitement <strong>des</strong> lésions cartilagineuses<br />
du genou : résultats à<br />
plus de 4 ans<br />
W. VAN HILLE*, C. LUTZ, J.-C. POULHÈS,<br />
J.-H. JAEGER<br />
INTRODUCTION. La réparation <strong>des</strong> lésions cartilagineuses<br />
étendues du genou par greffe de chondrocytes autologues apparaît<br />
être une solution prometteuse. Nous rapportons dans cette étude<br />
préliminaire et rétrospective <strong>les</strong> résultats de 15 greffes de chondrocytes<br />
autologues au recul maximum de 4,1 ans.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. De septembre 1996 à décembre<br />
2000, 15 transplantations de chondrocytes autologues ont été réalisées<br />
chez 15 patients (13 hommes, 2 femmes) de 29,1 ans d’âge<br />
moyen (14,2-46,5) selon le procédé Carticel du laboratoire Genzyme<br />
Tissue Repair. Il s’agissait de 10 lésions chondra<strong>les</strong> traumatiques<br />
et de 5 ostéochondrites disséquantes. Ces lésions étaient<br />
localisées aux condy<strong>les</strong> fémoraux dans 14 cas (12 CI et 2 CE) et à<br />
la rotule dans 1 cas. La surface moyenne du défect était de 6 cm 2<br />
(3-15) et toutes <strong>les</strong> lésions étaient de grade ICRS 3 ou 4. La<br />
procédure chirurgicale a été appliquée selon la technique décrite<br />
par Brittberg et coll. Un prélèvement cartilagineux était adressé à<br />
Cambridge (USA) pour mise en culture. La réimplantation, toujours<br />
effectuée par arthrotomie, était réalisée en moyenne 12<br />
semaines (3,5 à 29) après le prélèvement. Les résultats cliniques et<br />
para-cliniques au dernier recul ont été comparés aux renseignements<br />
pré-opératoires en utilisant : la fiche d’évaluation de l’ICRS<br />
et <strong>les</strong> scores Tegner, IKDC, Cincinnati modifié et Lysholm. Un<br />
suivi régulier par radiographies, IRM ou arthro-scanner a été<br />
effectué.<br />
RÉSULTATS. Le recul moyen lors de la révision est de 2,5 ans<br />
(1,2-4,1). Les scores IKDC subjectif, Cincinnati modifié et Lysholm<br />
progressent respectivement de 38,3 (9-46) à 71,3 (24-98), de<br />
31,6 (18-69) à 58,4 (26-97) et de 41,9 (13-61) à 81,3 (29-100).<br />
Selon cette dernière classification, on obtient 10 excellents ou<br />
bons résultats, 4 moyens et 1 mauvais. Par contre le niveau d’activité<br />
selon <strong>les</strong> scores ICRS et Tegner diminue à la révision : scores<br />
moyens préopératoires respectivement de 2,2 (1-3) et de 7,4 (5-10)<br />
qui régressent à 2,8 (2-4) et 5,2 (2-7) au dernier recul.<br />
DISCUSSION. Il est difficile de comparer nos résultats à ceux<br />
publiés dans la littérature compte tenu du faible nombre de<br />
patients. Si l’amélioration clinique et fonctionnelle apparaît significative,<br />
on constate dans notre expérience, une diminution globale<br />
du niveau d’activité sportive au recul maximal.<br />
CONCLUSION. La greffe de chondrocytes autologues apparaît<br />
être une technique d’avenir de réparation <strong>des</strong> lésions cartilagineuses.<br />
L’utilisation de transplants de deuxième génération avec <strong>des</strong><br />
chondrocytes inclus dans une matrice solide devrait faciliter leur<br />
implantation chirurgicale et améliorer <strong>les</strong> résultats.<br />
*W. Van Hille, Service d’Orthopédie, du Rachis et de<br />
Traumatologie du Sport, Pavillon Chirurgical B,<br />
1, place de l’Hôpital, 67091 Strasbourg Cedex.<br />
144 Réparation <strong>des</strong> lésions ostéocartilagineuses<br />
par greffe de chondrocytes<br />
autologues inclus dans un<br />
biomatériau<br />
C. BUSSIÈRE*, T. AÏT SI SELMI, P.CHAMBAT,<br />
L. LAGANIER, S.HUTASSE, P.NEYRET<br />
INTRODUCTION. L’association de chondrocytes autologues<br />
et d’un biomatériau présente l’avantage de faciliter la fixation <strong>des</strong><br />
cellu<strong>les</strong> greffées et de simplifier le geste opératoire. Pour évaluer la<br />
faisabilité, la tolérance et l’efficacité du produit Cartipatcht, une<br />
étude de phase IIb est en cours.<br />
MATÉRIEL. Du cartilage (200 à 500 mg) est prélevé par arthroscopie<br />
sur <strong>les</strong> bords externes de la trochlée ou dans l’espace<br />
intercondylien du genou lésé. Après digestion enzymatique, <strong>les</strong><br />
chondrocytes libérés sont cultivés en monocouche en présence de<br />
sérum autologue. Le nombre de cellu<strong>les</strong> nécessaires atteint 107 par<br />
ml, <strong>les</strong> chondrocytes sont mis en suspension dans une solution<br />
d’agarose et d’alginate. Avant gélification, la suspension est cou-
lée dans <strong>des</strong> mou<strong>les</strong> afin d’obtenir <strong>des</strong> greffons de 10, 14 ou 18 mm<br />
de diamètre selon la conformation de la lésion évaluée par IRM et<br />
par l’arthroscopie de prélèvement. Un ancillaire spécifique permet<br />
de préparer une ou <strong>des</strong> logettes <strong>des</strong>tinées à accueillir <strong>les</strong> greffons<br />
en press-fit. El<strong>les</strong> sont juxtaposées afin de couvrir au mieux la<br />
surface de la lésion.<br />
MÉTHODE. Dix-neuf patients âgés de 16 à 50 ans présentant<br />
une seule lésion ostéochondrale ou une ostéochondrite dissécante<br />
du condyle fémoral mais indemnes de toute autre affection du<br />
genou sont inclus dans l’essai. La greffe est réalisée par athrotomie.<br />
Les visites de suivi sont prévues en pré-opératoire puis à 3, 6,<br />
12 et 24 mois post-greffe. Le critère principal d’évaluation est basé<br />
sur l’amélioration du score d’évaluation IKDC (idem ICRS) sur 24<br />
mois. Les critères secondaires d’évaluation sont une IRM et une<br />
arhroscopie de contrôle associée à une biopsie du tissu de réparation<br />
réalisées à 24 mois.<br />
147 Reconstruction acétabulaire par<br />
allogreffe impactée morcelée et<br />
anneau de soutien non cimenté<br />
J.-N. ARGENSON*, X. FLECHER, S.PARRATTE,<br />
J.-M. AUBANIAC<br />
INTRODUCTION. La technique de greffe morcelée impactée<br />
appliquée aux cupu<strong>les</strong> hémisphériques non cimentées, pose le<br />
problème de leur stabilité primaire en cas de défects osseux étendus.<br />
Un centre de rotation haut situé avec mégacupule expose à<br />
une perte osseuse additionnelle, et un col extralong. Le but de notre<br />
étude était de décrire l’utilisation de greffes morcelées impactées<br />
associées à un anneau de soutien non cimenté, avec reposition du<br />
centre de rotation.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Les greffons morcelés et<br />
impactés dans l’acétabulum comblent <strong>les</strong> pertes de substance. La<br />
stabilité primaire de l’anneau couvert d’hydroxyapatite est assurée<br />
par le « press-fit », <strong>les</strong> vis axia<strong>les</strong> et la patte supérieure. Le crochet<br />
distal au niveau du trou obturateur assure la reposition du centre de<br />
rotation. L’étude porte sur 103 cas de reconstruction acétabulaire<br />
dont 34 pour <strong>des</strong>cellement aseptique et perte de substance acétabulaire<br />
de type 2 et 3 avec une évaluation clinique et radiographique<br />
réalisée avec un recul de5à12ans.<br />
RÉSULTATS. L’âge moyen <strong>des</strong> patients était de 58 ans et leur<br />
poids moyen de 64 kg. Le score de Harris est passé de 53 points en<br />
préopératoire à 88 points au recul. Sur le plan radiographique<br />
aucune migration de cupule n’a été notée selon Massin, et le centre<br />
de rotation selon Pierchon était anatomique dans 66 % en horizontal<br />
et 44 % en vertical. Deux liserés ont été notés en zone 2, et<br />
l’usure moyenne du polyéthylène était de 0,015 mm par an.<br />
L’intégration de la greffe selon Conn montrait un aspect identique<br />
à l’hôte dans 84 % et une disparition de l’interface dans 67 %.<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S89<br />
Séance du 12 novembre matin<br />
HANCHE<br />
RÉSULTATS. Les premières interventions ont nécessité moins<br />
d’une heure d’intervention. Les patients concernés ont suivi le<br />
protocole de rééducation, mobilisation passive et mise en charge<br />
progressive, sans gêne particulière. Aucun défaut de tolérance n’a<br />
été mis en avant (inflammation, adhérence...).<br />
DISCUSSION. Le temps opératoire nécessaire à la greffe est<br />
fortement réduit par rapport à une greffe de chondrocytes classique<br />
(ACI). De plus, elle permet d’éliminer la phase de suture du<br />
périoste et surtout garantit une répartition homogène <strong>des</strong> cellu<strong>les</strong><br />
greffées dans la lésion.<br />
CONCLUSION. L’évaluation à court terme <strong>des</strong> premiers<br />
patients est à l’heure actuelle très encourageante. Les premiers<br />
résultats d’efficacité de ce produit (Cartipatcht) sont attendus au<br />
cours <strong>des</strong> prochains mois.<br />
*C. Bussière, Centre Livet,<br />
8, rue <strong>des</strong> Margnol<strong>les</strong>, 69300 Caluire.<br />
Trois luxations ont été traitées sans changement d’implant et deux<br />
reprises ont été réalisées pour infection.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. Plusieurs étu<strong>des</strong> théoriques<br />
et cliniques ont montré qu’un centre de rotation haut situé<br />
augmentait <strong>les</strong> forces exercées sur <strong>les</strong> implants, et diminuait la<br />
force <strong>des</strong> abducteurs. Les résultats obtenus dans cette série avec un<br />
recul maximum de 12 ans nous poussent à étendre <strong>les</strong> indications<br />
de cette technique non cimentée associant reposition du centre de<br />
rotation, stabilité de la fixation et restauration du capital osseux.<br />
Les limites sont <strong>les</strong> <strong>des</strong>tructions osseuses avec rupture de continuité<br />
de l’anneau pelvien.<br />
*J.-N. Argenson, Service de Chirurgie Orthopédique,<br />
Hôpital Sainte-Marguerite, 270, boulevard de<br />
Sainte-Marguerite, 13009 Marseille.<br />
148 Traitement <strong>des</strong> <strong>des</strong>cellements acétabulaires<br />
de stade III de la classification<br />
de la SO.F.C.O.T. par utilisation<br />
de l’armature de soutien de<br />
Kerboull : étude rétrospective continue<br />
de 54 cas avec un recul minimal<br />
de 5 ans<br />
C. CHARPENAY*, Y. JULIEN, L.DEVILLIERS,<br />
V. PIBAROT, M.-H. FESSY, J.BEJUI-HUGUES<br />
INTRODUCTION. Les révisions acétabulaires sont devenues<br />
de véritab<strong>les</strong> gageures du fait de l’importance <strong>des</strong> déficits osseux<br />
rencontrés dans <strong>les</strong> sta<strong>des</strong> III de la classification de la SO.F.C.O.T.<br />
Nombre d’échecs par <strong>des</strong>cellements sont expliqués par <strong>des</strong>
3S90 78 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
contraintes mécaniques trop importantes sur <strong>les</strong> greffes osseuses<br />
ou par une restitution inadéquate du centre de rotation de la hanche.<br />
Le but de cette étude était d’évaluer <strong>les</strong> résultats à moyen<br />
terme de l’armature de Kerboull qui permet un recentrage anatomique<br />
de la hanche et une mise en charge progressive <strong>des</strong> greffons<br />
osseux.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Il s’agit d’une étude rétrospective<br />
sur une série continue de 54 révisions acétabulaires pour <strong>des</strong>cellement<br />
de stade III entre 1989 et 1996. Toutes ont bénéficié<br />
d’une armature de Kerboull. Les patients ont été suivis cliniquement<br />
par la cotation de Postel Merle d’Aubigné, et radiologiquement<br />
par de clichés standards du bassin afin d’objectiver la survenue<br />
d’un <strong>des</strong>cellement itératif ou d’une faillite de l’arthroplastie.<br />
La courbe de survie actuarielle a été traitée par le Log Rank test.<br />
RÉSULTATS. Le sexe-ratio était de 62 % de femmes. L’âge<br />
moyen était de 62,3 ans pour <strong>des</strong> extrêmes allant de 33 à 87 ans. Il<br />
s’agissait de la première révision pour 78 % <strong>des</strong> cas et d’une<br />
révision itérative pour 22 % <strong>des</strong> patients. Le score de Postel Merle<br />
d’Aubigné était de 9,18 points en préopératoire, 12,3 points en<br />
postopératoire, 15,6 points à un an, 15,5 points à cinq ans, et de<br />
14,8 points au recul maximal. Les luxations représentent la complication<br />
la plus fréquemment rencontrée, avec 55 % <strong>des</strong> cas sur<br />
obliquité de cupule supérieure à 46. Les greffes ont été considérées<br />
radiologiquement intégrées dans 58 % <strong>des</strong> cas. Nous ne déplorons<br />
que 5,5 % d’échecs par migration et 13,8 % par rupture <strong>des</strong> vis<br />
supérieures. Le taux de survie actuarielle était de 97,4 % à trois<br />
ans, 94,7 % à quatre ans, 89,2 % à cinq ans et 73 % à sept et dix ans<br />
de recul.<br />
CONCLUSION. Les auteurs recommandent cette armature<br />
pour le traitement <strong>des</strong> <strong>des</strong>cellements acétabulaires de stade III en<br />
raison de ses bons résultats à court, moyen et long terme, tant sur le<br />
plan clinique que radiologique.<br />
*C. Charpenay, CHU de Dijon, Hôpital Général,<br />
3, rue du Faubourg-Raines, 21000 Dijon.<br />
149 Usure du polyéthylène à 10 ans<br />
dans l’arthroplastie totale de hanche<br />
: influence de l’offset fémoral<br />
J.-C. DURAND*, R. LIMOZIN, J.-M. SEMAY,<br />
M.-H. FESSY<br />
INTRODUCTION. L’usure du polyéthylène, dans <strong>les</strong> arthroplasties<br />
tota<strong>les</strong> de hanche, reste le facteur limitant le plus important,<br />
dans la durée de vie <strong>des</strong> implants. De nombreux facteurs<br />
prédictifs sont parfaitement connus, mais le positionnement <strong>des</strong><br />
pièces articulaires a peu fait l’objet d’étude. Le propos de l’étude<br />
est de corréler l’usure du polyéthylène, au positionnement <strong>des</strong><br />
implants fémoraux et cotyloïdiens, et en particulier à l’offset<br />
fémoral.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Soixante-six patients, ayant<br />
bénéficié, d’une arthroplastie totale de hanche pour coxarthrose ou<br />
ostéonécrose, ont été revus avec un recul moyen de 10,8 ans (4<br />
hanches bilatéra<strong>les</strong>). Les clichés radiographiques du bassin de face<br />
ont été numérisés en préopératoire, postopératoire immédiat (1<br />
mois) et à 10 ans. La méthode EBRA permet d’homogénéiser <strong>les</strong><br />
différentes radiographies. Un logiciel informatique a retracé <strong>les</strong><br />
différents axes de mesure souhaités. L’usure à 10 ans, l’offset<br />
fémoral, l’excentration ou la médialisation de la cupule, l’ascension<br />
ou l’abaissement et l’inclinaison de la cupule ont été mesurés.<br />
RÉSULTATS. L’usure moyenne du polyéthylène est de 1,23<br />
mm à 10 ans, avec une usure linéaire de 0,11 mm/année. L’offset<br />
fémoral préopératoire a été restitué dans 71,4 % <strong>des</strong> cas. Par analyse<br />
de régression simple, seule la latéralisation de l’implant fémoral<br />
était corrélée à une minoration de l’usure du polyéthylène à 10<br />
ans. L’usure à 10 ans passait de 1,26 mm pour une restitution de<br />
l’offset préopératoire inférieure à 98 %, à 1,13 mm pour une restitution<br />
supérieure à 102 %.<br />
DISCUSSION. L’informatique et le numérique ont permis une<br />
plus grande précision dans la mesure <strong>des</strong> taux d’usure. Les taux<br />
d’usure, retrouvés dans la littérature, sont de l’ordre de 0,1 à<br />
0,15 mm/an. Un offset fémoral restitué est le garant d’une usure<br />
moindre car la résultante <strong>des</strong> forces dans l’articulation diminue, de<br />
même que <strong>les</strong> contraintes appliquées sur <strong>les</strong> composants et la<br />
stabilité de la hanche augmente. De nombreux facteurs interviennent<br />
dans la production de débris d’usure et la restitution correcte<br />
du centre de rotation de la hanche n’est qu’un <strong>des</strong> éléments permettant<br />
de diminuer cette usure.<br />
CONCLUSION. L’usure de l’étude n’est pas excessive. Parmi<br />
<strong>les</strong> paramètres positionnels, seul l’offset fémoral influence, de<br />
manière bénéfique, l’usure du polyéthylène. Ceci souligne l’intérêt<br />
d’avoir à disposition, une large variété d’implants, pour faire<br />
face aux nombreuses variations morphologiques anatomiques du<br />
fémur.<br />
*J.-C. Durand, Service de Chirurgie Orthopédique et<br />
Traumatomogique, Hôpital Bellevue, CHRU de Saint-Etienne,<br />
boulevard Pasteur, 42055 Saint-Etienne Cedex 2.<br />
150 Analyse de survie à 20 ans d’une<br />
cohorte de 104 prothèses tota<strong>les</strong> de<br />
hanche cimentées à couple de frottement<br />
alumine/alumine<br />
M.-A. ROUSSEAU*, M.-A. ROUSSEAU, S.LE<br />
MOUEL, D.GOUTALLIER, S.VAN DRIESSCHE<br />
INTRODUCTION. L’alumine est une céramique bio-inerte utilisée<br />
dans l’arthroplastie totale de hanche comme alternative au<br />
couple métal/polyéthylène dont <strong>les</strong> débris d’usure sont responsab<strong>les</strong><br />
d’ostéolyses massives et de <strong>des</strong>cellements. Ce travail rétrospectif<br />
concerne la combinaison d’implants Ceraver : fémorale en<br />
titane lisse cimentée, tête alumine 32 mm, et cupule alumine<br />
cimentée.<br />
MATÉRIEL. Entre décembre 1979 et février 1983, 104 prothèses<br />
tota<strong>les</strong> ont été réalisées chez 81 patients d’âge moyen 57,8 ans<br />
(23,1 à 70,9 ans). L’indication principale était une coxarthrose<br />
primitive (71 cas).<br />
MÉTHODE. L’évaluation clinique a été faite par questionnaire<br />
selon le score de Postel Merle d’Aubigné. L’analyse du suivi<br />
radiologique a permis d’établir <strong>les</strong> courbes de survie actuariel<strong>les</strong><br />
selon <strong>les</strong> critères de <strong>des</strong>cellement radiologique de Harris pour la
cupule et de Massin pour la pièce fémorale. L’ostéolyse périprothétique<br />
fémorale et acétabulaire a été étudiée. Les prélèvements<br />
histologiques lors <strong>des</strong> réinterventions ont été analysés.<br />
RÉSULTATS. Six hanches suppurées n’ont pas été prises en<br />
compte. Les scores cliniques <strong>des</strong> 98 autres prothèses au dernier<br />
recul étaient : excellents 34, très bons 21, bons 16, passab<strong>les</strong> 21 et<br />
mauvais 6. Le recul moyen était de 11 ans et atteignait 18 ans pour<br />
38 arthroplasties. Une fracture de tête alumine, 24 <strong>des</strong>cellements<br />
aseptiques radiologiques certains de la cupule, 12 <strong>des</strong>cellements<br />
radiologiques probab<strong>les</strong> de la cupule et 3 <strong>des</strong>cellements radiologiques<br />
certains de fémur ont été recensés.Vingt-trois hanches ont été<br />
réopérées avec remplacement de 23 coty<strong>les</strong>, 12 têtes et 1 tige<br />
fémora<strong>les</strong>. L’usure radiologique n’était pas mesurable. Nous<br />
n’avons pas retrouvé d’ostéolyse radiologique massive. L’examen<br />
histologique <strong>des</strong> prélèvement per-opératoires s’est révélé normal<br />
pour toutes <strong>les</strong> reprises (réaction à corps étrangers très modérée<br />
aspécifique). Hors suppuration, l’estimateur actuariel de survie à<br />
20 ans sans reprise chirurgicale était de 61,4 % (57,1 % pour le<br />
critère de <strong>des</strong>cellement radiologique de la cupule et 95,2 % pour le<br />
critère de <strong>des</strong>cellement radiologique de l’implant fémoral).<br />
DISCUSSION. Cette étude confirme la bio-tolérance à long<br />
terme du couple alumine-alumine et ce malgré la mauvaise tenue<br />
de la cupule alumine cimentée. Elle confirme également la bonne<br />
tenue de l’implant fémoral en titane lisse cimenté.<br />
CONCLUSION. Il convient d’améliorer l’ancrage de la cupule<br />
pour utiliser le couple de frottement alumine-alumine qui<br />
n’entraine ni ostéolyse, ni réaction histologique.<br />
*M.-A. Rousseau, Service de Chirurgie Orthopédique,<br />
Hôpital Henri-Mondor,<br />
51, avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny,<br />
94010 Créteil Cedex.<br />
151 Étude rétrospective à 10 ans de<br />
recul du couple cupule Alizé tige<br />
Aura<br />
F. CHALENCON*, J.-P. FAYARD, R.LIMOZIN,<br />
G. GRESTA<br />
INTRODUCTION. Nous rapportons une série rétrospective<br />
continue de 98 prothèses tota<strong>les</strong> de hanche associant <strong>des</strong> implants<br />
sans ciment : tige Aura et cupule Alizé revêtus d’hydroxyapatite<br />
avec un recul moyen de 9,6 ans. Le but étant l’étude de la stabilité<br />
<strong>des</strong> implant et de l’usure.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Quatre-vingt-dix-huit dossiers<br />
de prothèses tota<strong>les</strong> de hanche implantées entre janvier 1991 et<br />
janvier 1992 ont été revus : 60 femmes et 38 hommes opérés par le<br />
même chirurgien : cupule Alizé et tige Aura sans ciment. La<br />
moyenne d’âge <strong>des</strong> opérés était de 66,5 ans (30-85). Le recul<br />
moyen lors de l’analyse est de 9,67 ans. Nous avons évalué à terme<br />
56 dossiers, nous avons 17 décédés, 13 perdus de vue, 9 suivis<br />
impossib<strong>les</strong> et 3 ablations de tige (3,1 %). Il s’agissait d’une première<br />
intervention dans tous <strong>les</strong> cas. Cliniquement, <strong>les</strong> patients ont<br />
été évalués selon le score PMA et par questionnaire d’autoévaluation.<br />
Radiologiquement nous avons cherché à apprécier la stabilité<br />
(bascule, déplacement de l’implant) et l’usure <strong>des</strong> implants par <strong>des</strong><br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S91<br />
mesures informatisées sur <strong>des</strong> radiographies successives numérisées<br />
en utilisant le logiciel MetrOs. Nous avons aussi recherché<br />
<strong>des</strong> signes radiologiques qualitatifs de réaction osseuse au contact<br />
<strong>des</strong> implants.<br />
RÉSULTATS. Le score PMA global évoluait de 11,96 en<br />
moyenne en préopératoire à 17,42 au contrôle intermédiaire à 5<br />
ans pour diminuer à 15,67 au recul. Quatre-vingt-quatorze pour<br />
cent <strong>des</strong> patients étaient satisfaits à 5 ans (92 hanches) et 98,3 %<br />
<strong>des</strong> patients revus à 10 ans (56 hanches) l’étaient. Nous déplorons<br />
deux fractures de tête céramique après chute directe sur le grand<br />
trochanter (qui ont donné lieu à changement de l’implant fémoral,<br />
de la tête et du polyéthylène). Nous avons eu une fracture sous<br />
prothèse ayant nécessité le changement de la tige. L’analyse <strong>des</strong><br />
radiographies n’a pas montré de condensation anormale ou de<br />
liseré. Les mesures radiographiques avec MetrOs ont été réalisées<br />
sur 52 dossiers complets : l’usure moyenne était de 0,77 mm à 10<br />
ans (0,16 mm-2,24 mm) ; l’usure et l’enfoncement (0,78 mm) de la<br />
tige étaient significativement corrélés au contrôle à 10 ans tandis<br />
que l’inclinaison de la tige restait négligeable.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. Cette étude radio-clinique<br />
nous démontre que <strong>les</strong> implants recouverts d’hydroxyapatite utilisés<br />
sont stab<strong>les</strong> dans le temps. Les résultats cliniques sont satisfaisants<br />
avec une petite régression du PMA du fait du vieillissement<br />
de la cohorte. Les mesures radiographiques ont été rigoureuses<br />
utilisant un outil précis et sont très rassurantes. Nous comparons<br />
nos résultats à ceux <strong>des</strong> séries utilisant <strong>des</strong> implants comparab<strong>les</strong>.<br />
*F. Chalencon, Clinique Mutualiste, 3, rue le Verrier,<br />
42013 Saint-Etienne Cedex 02.<br />
152 Ostéolyse acétabulaire <strong>des</strong> prothèses<br />
de hanche non cimentées<br />
G. ASENCIO*, P. MARCHAND, R.BERTIN,<br />
B. MEGY, P.KOUYOUMDJIAN, S.HACINI,<br />
P.-P. MILL<br />
INTRODUCTION. L’ostéolyse est une <strong>des</strong> préoccupations de<br />
l’évolution <strong>des</strong> prothèses de hanche (PTH) non cimentées. Le but<br />
de cette étude était d’évaluer, à partir d’une série de 228 PTH<br />
ABG-1, son incidence et ses facteurs contributifs.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. La série comporte 228 PTH<br />
ABG-1 non cimentées, anatomiques et revêtues d’hydroxyapatite<br />
posées chez 210 patients. L’âge moyen était de 62,2 ans, pour 116<br />
femmes et 112 hommes. L’étiologie était : coxarthrose primitive<br />
(53,6 %), nécrose primitive (21,5 %), coxarthrose posttraumatique<br />
(11,8 %), coxite rhumatismale (8,3 %), dysplasie<br />
(4,8 %). Le couple de frottement comportait : 200 coup<strong>les</strong><br />
Zirconium- polyéthylène (87,7 %) et 28 métal- polyéthylène<br />
(12,3 %). Cent soixante-trois patients furent revus avec un recul<br />
moyen de 88,6 mois et minimum de 60 mois (37 étaient décédés<br />
exempts de reprise, 28 étaient perdus de vue (12,3 %), 17 avaient<br />
été repris chirurgicalement).<br />
Sur <strong>les</strong> radiographies numérisées, l’ostéolyse a été évaluée<br />
selon la classification de Delee-Charnley à laquelle a été rajoutée<br />
une 4 e zone rétro-acétabulaire ; l’usure du polyéthylène a été<br />
mesurée à l’aide du logiciel Imagika reprenant la méthode décrite<br />
par Martell.
3S92 78 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
RÉSULTATS. Les 17 reprises de cupule (8,5 % <strong>des</strong> cas) étaient<br />
relatives à une instabilité (4 cas), un <strong>des</strong>cellement (4 cas), une<br />
ostéolyse (4 cas), un sepsis (3 cas), une boiterie (1 cas) et une<br />
douleur de hanche (1 cas). La survie globale de l’implant était de<br />
92,1 % <strong>des</strong> cas et la survie relative aux <strong>des</strong>cellements et ostéolyses<br />
(échecs) était de 96,1 % <strong>des</strong> cas. L’usure moyenne au dernier recul<br />
était de 1,26 mm soit une moyenne annuelle de 0,17 mm (0,04 à<br />
0,69 mm/an). Une ostéolyse acétabulaire fut retrouvée dans<br />
41,6 % <strong>des</strong> cas, préférentiellement en zone 1 de Delee-Charnley,<br />
mais pouvant être présente dans toutes <strong>les</strong> zones. La surface<br />
moyenne estimée était de 223 mm 2 . Les facteurs possib<strong>les</strong><br />
d’ostéolyse analysés étaient : l’étiologie, l’âge, le sexe, le niveau<br />
d’activité, l’index de masse corporelle, la classification ABC de<br />
Charnley, l’existence de géo<strong>des</strong> acétabulaires préopératoires, la<br />
taille de la cupule et l’épaisseur du polyéthylène, la position du<br />
rebord de l’insert, l’angle d’inclinaison de la cupule, le mode de<br />
fixation complémentaire, le couple de frottement, l’offset et<br />
l’usure du polyéthylène. Une relation statistiquement significative<br />
a été mise en évidence entre l’ostéolyse et : la classification de<br />
Charnley (p = 0,012), la présence de géo<strong>des</strong> acétabulaires préopératoires<br />
(p = 0,0034), l’angle d’inclinaison de la cupule (p =<br />
0,035), la taille de la cupule (p = 0,042), l’épaisseur du polyéthylène<br />
(p < 0,01), l’utilisation d’une fixation complémentaire (p =<br />
0,048) et l’usure du polyéthylène (p = 0,0011). Nous n’avons<br />
paradoxalement trouvé de relation avec le sexe, l’âge, l’index de<br />
masse corporelle et <strong>les</strong> autres facteurs.<br />
DISCUSSION. L’analyse de notre série retrouve comme causes<br />
déterminantes de l’ostéolyse : le délai, l’épaisseur du polyéthylène,<br />
l’usure du polyéthylène, le couple Zirconium-polyéthylène.<br />
L’usure, importante est vraisemblablement non seulement le fait<br />
du couple Zirconium-polyéthylène, mais aussi de la qualité du<br />
polyéthylène, de l’instabilité de l’insert. La diffusion de l’ostéolyse<br />
est favorisée par <strong>les</strong> orifices de la cupule de première génération,<br />
éliminés sur <strong>les</strong> cupu<strong>les</strong> ABG-2.<br />
*G. Asencio, Service de Chirurgie Orthopédique et<br />
Traumatologique, 5, rue Hoche, 30000 Nimes.<br />
153 Prothèse totale de hanche sans<br />
ciment avec couple de frottement<br />
métal/métal chez <strong>des</strong> sujets de<br />
moins de 50 ans : résultat d’une<br />
série prospective au recul minimal<br />
de 5 ans<br />
H. MIGAUD*, A. JOBIN, P.LAFFARGUE,<br />
F. GIRAUD, Y.PINOIT, A.DUQUENNOY<br />
INTRODUCTION. Les prothèses tota<strong>les</strong> de hanche (PTH)<br />
implantées chez <strong>des</strong> sujets jeunes et actifs sont exposées à l’usure<br />
précoce du polyéthylène ce qui peut justifier le recours à <strong>des</strong><br />
coup<strong>les</strong> de frottement alternatifs. Le but de cette étude était de<br />
préciser le devenir du couple métal/métal en arthroplastie primaire<br />
chez <strong>des</strong> sujets de moins de 50 ans.<br />
PATIENTS ET MÉTHODES. Entre 1995 et 1998 trente-neuf<br />
PTH comportant un couple métal/métal ont été implantées sans<br />
ciment et consécutivement chez <strong>des</strong> 30 patients âgés en moyenne<br />
de 39 ans (23-50 ans) (9 cas bilatéraux). Il s’agissait d’implants<br />
sans ciment avec traitement de surface sans hydroxyapatite et d’un<br />
couple en 28 mm de diamètre. L’indication de la prothèse était une<br />
nécrose dans 20 cas, une arthrose dans 19 cas dont une majorité de<br />
séquel<strong>les</strong> de dysplasie. Quatre-vingt-quatre pour cent <strong>des</strong> patients<br />
étaient classés au niveau 4 ou 5 selon Devane indiquant la pratique<br />
d’un travail lourd et/ou d’une activité sportive. Les critères<br />
d’inclusion étaient : 1) un âge inférieur à 50 ans, 2) une activité<br />
importante (profession et/ou sport), 3) une coxarthrose ou une<br />
nécrose. Les patients ont été inclus et suivis prospectivement. Un<br />
dosage sérique du cobalt a été pratiqué au recul. Aucun patient n’a<br />
été perdu de vue.<br />
RÉSULTATS. Le score de Merle d’Aubigné passait de<br />
12,8 ± 2,2 (7 à 15) avant l’intervention à 17,2 ± 1 (14 à 18) au recul<br />
de 5,1 ans (5 à 6,3). Aucune douleur de cuisse n’était observée,<br />
deux patients avaient <strong>des</strong> douleurs inguina<strong>les</strong> modérées en rapport<br />
avec un conflit entre la cupule et l’ilio-psoas. <strong>Tous</strong> <strong>les</strong> patients ont<br />
repris l’appui complet au quatrième jour post-opératoire, sauf trois<br />
qui l’ont repris à 6 semaines en raison d’une greffe acétabulaire<br />
d’augmentation. Aucune migration d’implant n’a été constatée et<br />
tous <strong>les</strong> implants avaient <strong>des</strong> signes radiographiques d’ostéointégration.Aucune<br />
luxation post-opératoire n’a été observée.Aucune<br />
ostéolyse n’a été identifiée notamment chez <strong>les</strong> 8 patients qui<br />
avaient un cobalt sérique augmenté (4 cas bilatéraux) et pour <strong>les</strong>quels<br />
aucun facteur favorisant n’a été statistiquement identifié.<br />
CONCLUSION. Les résultats observés au recul de 5 ans suggèrent<br />
que le couple métal/métal de deuxième génération représente<br />
une alternative fiable lorsqu’une indication de PTH est envisagée<br />
chez un sujet jeune et/ou avec un niveau d’activité élevé. Le<br />
suivi à plus long terme de cette cohorte de sujets à risque élevé<br />
d’usure est indispensable pour confirmer ces données encourageantes.<br />
*H. Migaud, Service d’Orthopédie C, Hôpital Salengro,<br />
CHRU de Lille, 59037 Lille Cedex.<br />
154 Arthroplastie totale de hanche<br />
Charnley-Kerboull chez <strong>les</strong> patients<br />
âgés de moins de 50 ans : résultats<br />
à long terme<br />
L. KERBOULL*, M. HAMADOUCHE,<br />
J.-P. COURPIED, M.KERBOULL<br />
INTRODUCTION. Le but de cette étude rétrospective était<br />
d’évaluer <strong>les</strong> résultats cliniques et radiologiques de l’arthroplastie<br />
totale de hanche Charnley-Kerboull réalisée chez <strong>des</strong> patients âgés<br />
de moins de 50 ans. Les facteurs susceptib<strong>les</strong> d’influencer l’usure<br />
et la pérennité de la fixation ont été recherchés.<br />
MATÉRIELS ET MÉTHODES. Parmi <strong>les</strong> 2804 arthroplasties<br />
réalisées chez <strong>des</strong> patients âgés de moins de 50 ans entre 1975 et<br />
1995, 287 ont été sélectionnées par randomisation (10 % <strong>des</strong><br />
patients opérés chaque année). El<strong>les</strong> concernaient 222 patients<br />
(144 femmes et 78 hommes) âgés en moyenne de 40,1 ± 8 ans (15<br />
à 50 ans). Toutes <strong>les</strong> arthroplasties ont été réalisées par voie transtrochantérienne.<br />
Les implants utilisés étaient dans tous <strong>les</strong> cas de<br />
type Charnley-Kerboull cimentés utilisant un couple de frottement
métal-polyéthylène. L’évaluation fonctionnelle <strong>des</strong> résultats a été<br />
effectuée selon le score de Merle d’Aubigné. L’usure de la cupule<br />
a été mesurée selon la technique de Chevrot. Enfin une analyse de<br />
survie a été effectuée selon la méthode actuarielle.<br />
RÉSULTATS. Lors de la dernière évaluation, 155 patients (210<br />
hanches) étaient toujours vivants et n’avaient pas subi de reprise au<br />
recul moyen de 16,1 ± 4,6 ans, 23 patients (25 hanches) avaient été<br />
repris sur le versant cotyloïdien et/ou fémoral, 10 patients (10<br />
hanches) étaient décédés, et 34 patients (42 hanches) étaient perdus<br />
de vue. Le score fonctionnel moyen pré-opératoire était de<br />
9,6 ± 2,5 (9-15) versus 17,2 ± 0,8 (9-18) au dernier recul (test <strong>des</strong><br />
rangs de Wilcoxon, p < 0,001). Sur le versant acétabulaire, un<br />
<strong>des</strong>cellement était certain pour 15 cupu<strong>les</strong> et potentiel pour 24. Sur<br />
le versant fémoral, un <strong>des</strong>cellement était certain pour 12 implants<br />
et potentiel pour 4. Vingt cinq hanches ont été reprises, dont 17<br />
pour <strong>des</strong>cellement aseptique. Le taux d’usure moyen était de<br />
0,12 ± 0,21 mm/an (0 à 2,23). Parmi <strong>les</strong> 287, 196 hanches présentaient<br />
un taux d’usure de 0,1 mm/an (moyenne 0,02 mm/an) et 91<br />
un taux d’usure anormalement élevé (moyenne 0,28 mm/an). Le<br />
taux de survie cumulée, en définissant l’échec comme la reprise,<br />
était de 85,4 ± 5,0 % à 20 ans (intervalle de confiance à 95 %<br />
compris entre 78,4 et 92,4 %). Parmi <strong>les</strong> facteurs testés, seul un<br />
taux d’usure anormalement élevé (> 0,1 mm/an) était prédictif<br />
d’un échec.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. Les résultats de cette série<br />
permettent de conclure que l’arthroplastie totale de hanche<br />
Charnley-Kerboull reste la meilleure solution chez <strong>les</strong> patients<br />
jeunes en terme de survie <strong>des</strong> implants.<br />
*L. Kerboull, Service A de Chirurgie Orthopédique et<br />
Réparatrice de l’Appareil Locomoteur,<br />
CHU Cochin Port-Royal (AP-HP),<br />
27, rue du Faubourg-Saint-Jacques, 75014 Paris.<br />
155 Arthroplastie totale de hanche<br />
cimentée sur fracture de l’acétabulum<br />
: résultats à cinq ans minimum<br />
de recul<br />
F. BAQUE*, H. MOUSSA, J.-P. COURPIED<br />
INTRODUCTION. Le but de cette étude rétrospective était<br />
d’évaluer <strong>les</strong> résultats à 5 ans minimum de recul d’une série conti-<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S93<br />
nue d’arthroplasties tota<strong>les</strong> de hanche réalisées sur fracture de<br />
l’acétabulum.<br />
MATÉRIELS ET MÉTHODES. La série comportait 53 arthroplasties<br />
réalisées entre janvier 1980 et décembre 1995 chez 53<br />
patients (16 femmes et 37 hommes) âgés en moyenne de 53,1<br />
(24-84 ans). La fracture initiale concernait une paroi 18 fois, une<br />
colonne 7 fois, <strong>les</strong> deux colonnes 6 fois ; il s’agissait d’une fracture<br />
complexe 11 fois, et elle était inconnue pour <strong>les</strong> 11 hanches restantes.<br />
Le traitement de la fracture avait été orthopédique pour 23<br />
hanches et 30 fois chirurgical. Le délai moyen entre la fracture et<br />
l’arthroplastie était de 16,4 ± 10,8 ans. Les implants utilisés<br />
étaient dans tous <strong>les</strong> cas de type Charnley-Kerboull cimentés utilisant<br />
un couple de frottement métal-polyéthylène. L’évaluation<br />
fonctionnelle <strong>des</strong> résultats a été effectuée selon le score de Merle<br />
d’Aubigné. Enfin une analyse de survie a été effectuée selon la<br />
méthode actuarielle.<br />
RÉSULTATS. Lors de l’évaluation au recul minimum de 5 ans,<br />
33 patients étaient toujours vivants et n’avaient pas subi de reprise<br />
au recul moyen de 12,4 ± 3,8 ans (7 à 21 ans), 6 patients avaient été<br />
repris sur le versant acétabulaire et/ou fémoral, 5 patients étaient<br />
décédés, et 7 patients étaient perdus de vue. Les reprises ont toujours<br />
été réalisées pour usure de la cupule associée à une ostéolyse<br />
péri-acétabulaire. Le score fonctionnel moyen préopératoire était<br />
de 10,6 ± 2,5 (5-15) versus 16,2 ± 2,8 (8-18) au dernier recul (test<br />
<strong>des</strong> rangs de Wilcoxon, p < 0,0001). Le taux de survie cumulée, en<br />
définissant l’échec comme la reprise, était de 73,8 ± 10,6 % à 15<br />
ans (intervalle de confiance à 95 % compris entre 53,0 et 94,7 %).<br />
Le taux de survie cumulée à 15 ans en définissant l’échec comme<br />
la reprise, était de 90,3 ± 6,5 % (intervalle de confiance à 95 %<br />
compris entre 77,6 et 100 %) pour <strong>les</strong> hanches dont la fracture<br />
avait été traitée orthopédiquement versus 66,5 ± 14,5 % (intervalle<br />
de confiance à 95 % compris entre 38,1 et 94,9 %) pour <strong>les</strong><br />
hanches dont la fracture avait été traitée chirurgicalement. La différence<br />
avec <strong>les</strong> effectifs disponib<strong>les</strong> n’était pas significative<br />
(Logrank, p = 0,69).<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. Les résultats de cette série<br />
confirment que le risque d’échec mécanique d’une arthroplastie<br />
totale de hanche sur fracture de l’acétabulum est important à long<br />
terme.<br />
*F. Baque, Service A de Chirurgie Orthopédique et Réparatrice<br />
de l’Appareil Locomoteur, CHU Cochin Port Royal (AP-HP),<br />
27, rue du Faubourg-Saint-Jacques, 75014 Paris.
3S94 78 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
156 Fracture réductionnelle iatrogène<br />
du col fémoral : à propos de 4<br />
observations<br />
M.H. SY*, C. KINKPE, P.DAKOURÉ, C.DIÉMÉ,<br />
A. SANÉ, A.NDIAYE, A.DANSOKHO, S.SEYE<br />
INTRODUCTION. La fracture-luxation postérieure de la tête<br />
fémorale constitue une lésion traumatique rare de la hanche. La<br />
réduction de la luxation reste une urgence traumatologique. La<br />
réintroduction de la tête fémorale dans la cavité acétabulaire peut<br />
être marquée par une incoercibilité, une irréductibilité, une instabilité<br />
et plus rarement par une fracture accidentelle du col fémoral.<br />
Cette complication a été relevée chez 4 de nos patients. Elle est<br />
étudiée dans sa fréquence, son mécanisme et ses mesures thérapeutiques<br />
préventives.<br />
MATÉRIEL D’ÉTUDE. Soixante-dix luxations et fractureluxations<br />
de hanche ont été suivies dans le service entre mars 1997<br />
et février 2003. Parmi el<strong>les</strong>, 14 luxations de hanche comportant<br />
une fracture de la tête ont été notées. La réduction de 4 d’entreel<strong>les</strong><br />
s’est compliquée d’une fracture du col fémoral. El<strong>les</strong> ont<br />
concerné 4 hommes agés en moyenne de 49,7 ans conducteur ou<br />
passager victime d’accident de la circulation. La fracture-luxation<br />
initiale était un Pipkin I ou un Brumback 1A (1 fois) et un Pipkin II<br />
ou un Brumback 2A (3 fois). La réduction première de la luxation<br />
a été effectuée en urgence sous anesthésie générale par un orthopédiste<br />
(1 fois) et un chirurgien généraliste d’un hôpital régional (3<br />
fois). Le traitement de cette complication a été arthroplastique 3<br />
fois et 1 fois par embrochage.<br />
MÉTHODES. L’étude était rétrospective sur dossiers comportant<br />
une observation clinique, une imagerie médicale avant et<br />
après réduction. Les lésions radiologiques étaient classées selon<br />
Pipkin et selon Brumback.<br />
RÉSULTATS. La fracture du col était sous capitale à 4,0 cm en<br />
moyenne du petit trochanter (extrêmes 3,5 et 4,5 cm). La tête est<br />
restée accrochée au-<strong>des</strong>sus et en arrière du toit avec une rotation<br />
d’au moins 90. Le fragment resté dans l’acétabulum était déplacé 2<br />
fois. La fracture-luxation de la tête était associée dans un cas à une<br />
fracture de la paroi postérieure de l’acétabulum.<br />
DISCUSSION. Une telle complication résulterait d’une<br />
manœuvre de réduction brutale et inapropriée. Le mécanisme de la<br />
fracture du col associerait une rétention capsulo-musculaire de<br />
tête fémorale à un accrochage du défect céphalique sur le bord<br />
tranchant du toît de l’acétabulum au moment de la réduction.<br />
CONCLUSION. La fracture réductionnelle du col fémoral<br />
transforme en Pipkin III ou Brumback IIIB la fracture-luxation de<br />
la tête fémorale. Elle réalise une complication iatrogène grave. La<br />
prévention passerait par une manœuvre de réduction lente, progressive,<br />
atraumatique entre <strong>les</strong> mains d’un orthopédiste prudent.<br />
*M.H. Sy, CHU le Dantec, BP 15551, Dakar-Fann, Sénégal.<br />
Séance du 12 novembre matin<br />
TRAUMATOLOGIE<br />
157 Syndrome chronique d’effort de<br />
loge de l’avant-bras : à propos de<br />
10 cas dont 9 opérés<br />
J.-L. POLARD*, G. KERHOUSSE, J.-M. HAMON,<br />
L. ZABÉE, P.ROCHCONGAR, J.-L. HUSSON<br />
Les syndromes de loge chroniques de l’avant-bras sont classiquement<br />
rares. Il est néanmoins probable qu’ils soient en fait plus<br />
souvent méconnus qu’authentiquement exceptionnels : le syndrome<br />
de loge aux membres supérieurs est bien connu mais associé<br />
dans l’esprit du médecin non spécialiste au caractère aigu du<br />
syndrome de Wolkmann. Le -syndrome de loge chronique ou<br />
« syndrome sub-aigu <strong>des</strong> loges » est également bien connu, mais<br />
souvent associé au syndrome d’effort <strong>des</strong> membres inférieurs chez<br />
<strong>les</strong> sportifs.<br />
L’association au syndrome de loge de l’avant-bras et syndrome<br />
chronique de loge est de <strong>des</strong>cription plus récente puisque la première<br />
publication semble revenir à Tompkins en 1977.<br />
Depuis, <strong>des</strong> publications éparses ont vu le jour rapportant chaque<br />
fois un très faible nombre de cas.<br />
Nous rapportons ici, au travers de notre expérience personnelle<br />
de 10 cas opérés avec un recul minimal de 6 mois. Comparée à une<br />
revue de la littérature, l’analyse de notre série permet d’expliciter<br />
<strong>les</strong> aspects cliniques, diagnostiques et <strong>les</strong> particularités thérapeutiques<br />
<strong>des</strong> syndromes chroniques d’effort <strong>des</strong> loges de l’avantbras.<br />
Il est probable qu’une meilleure connaissance de cette pathologie<br />
conduise à une prise en charge plus précoce et plus chirurgicale<br />
<strong>des</strong> sportifs invalidés par ces symptômes bien connus du monde<br />
<strong>des</strong> moto crossman sous le terme de « tétanisation <strong>des</strong> bras » ou<br />
d’armpump.<br />
*J.-L. Polard, Service d’Orthopédie A, CHU Hôtel-Dieu,<br />
2, rue de l’Hôtel-Dieu, 35064 Rennes Cedex.<br />
158 Suture percutanée <strong>des</strong> ruptures<br />
fraîches du tendon d’Achille : série<br />
initiale<br />
J.-L. ROUVILLAIN*, C. DIB, O.LABRADA,<br />
H. PASCAL-MOUSSELARD, O.DELATTRE,<br />
D. RIBEYRE<br />
INTRODUCTION. Le traitement orthopédique <strong>des</strong> ruptures du<br />
tendon d’Achille a été bien codifié par Rodineau. Il consiste en une<br />
immobilisation en équin pendant 8à12semaine sans appui. Le<br />
taux de re-rupture varie entre 10 et 20 %. La chirurgie conventionnelle<br />
donne <strong>des</strong> taux très faible de re-rupture, mais par contre<br />
présente 10 à 20 % de complications cutanées. Moller et al. en
2001, ont réalisé une étude prospective entre traitement chirurgical<br />
et fonctionnel incluant 112 patients avec un suivi de 2 ans. Le taux<br />
de re-rupture était respectivement de 1,7 % contre 20,8 % avec le<br />
traitement fonctionnel. La technique de suture percutanée avec le<br />
Ténoligt, n’élimine pas totalement <strong>les</strong> problèmes cutanés, et a<br />
comme inconvénient son coût financier. Le procédé Achillon se<br />
veut une technique mini invasive qui ne semble pas très simple a<br />
réaliser. De nombreuses autres techniques ont été publiées, utilisant<br />
un fixateur externe (Nada, 1985) un arthroscope en souscutané<br />
(Aldam, 1989), ou une mini-incision transversale (Thermann,<br />
2001). La plus ancienne <strong>des</strong> techniques véritablement<br />
percutanées publiée est celle de Ma et Griffith en 1977. Lim et al.<br />
en 2001, ont réalisé un étude prospective entre chirurgie conventionnelle<br />
et traitement percutané selon la technique de Ma et Griffith<br />
sur 66 patients revu à6mois. L’immobilisation a été en<br />
moyenne de 12,4 semaines. Il yaeu7infections (21 %) dans la<br />
série chirurgicale contre 3 cas de nodu<strong>les</strong> douloureux (9 %) dans la<br />
série percutanée, et une paresthésie du nerf sural.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. La technique percutanée que<br />
nous utilisons est dérivée de la technique de Ma et Griffith. Le but<br />
de cette technique percutanée est d’obtenir rapidement et facilement<br />
une suture solide et peu onéreuse réalisable de plus sous<br />
anesthésie locale. Nous avons mis au point une aiguille spéciale<br />
comportant un chas permettant d’utiliser le fil de suture que l’on<br />
souhaite.Au début de notre expérience nous avons utilisé un fil non<br />
résorbable (Ethicont N 1), puis devant la gène ressentie par le<br />
nodule sous-cutané douloureux du au fil, nous sommes passés au<br />
fil résorbable passé en double (Vicryl n 2). Nous réalisons cette<br />
suture en décubitus ventral sous anesthésie locale, une botte plâtrée<br />
en équin en maintenue pendant trois semaines, puis remplacée<br />
par un plâtre plus proche de 90° avec talonnette pendant encore 3<br />
semaines avec appui autorisé. De 1999 à 2002, nous avons réalisé<br />
43 cas (28 H, 15 F), d’âge moyen 51 ans.<br />
RÉSULTATS. Les seu<strong>les</strong> complications observées sont une<br />
infection superficielle, un nodule sous-cutané douloureux, et une<br />
thrombophlébite surale. Nous n’avons aucune re-rupture et aucun<br />
névrome du nerf sural.<br />
DISCUSSION. Les contre-indications à cette technique sont <strong>les</strong><br />
ruptures anciennes, <strong>les</strong> re-ruptures, et <strong>les</strong> ruptures trop près de<br />
l’insertion calcanéenne.<br />
CONCLUSION. Cette technique est de réalisation très facile,<br />
elle est peu onéreuse, la suture est solide permettant <strong>des</strong> suites<br />
rapi<strong>des</strong> sans complications cutanées.<br />
*J.-L. Rouvillain, CHU La Meynard, BP 632,<br />
97261 Fort-de-France, Martinique.<br />
159 Traitement <strong>des</strong> ruptures spontanées<br />
du tendon d’Achille par une<br />
technique de suture percutanée au<br />
fil résorbable<br />
E. TATON*, I. BENEZIS, P.BOIREAU,<br />
F. RAZANABOLA, T.FABRE, A.DURANDEAU<br />
INTRODUCTION. La suture percutanée du tendon d’Achille<br />
présente une excellente alternative entre la chirurgie ouverte expo-<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S95<br />
sée aux complications cutanées et septiques et le long traitement<br />
orthopédique aux résultats grevés de récidives. Nous proposons<br />
une technique personnelle de suture percutanée en nous appuyant<br />
sur une série de 76 patients.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Soixante-seize patients dont 17<br />
femmes, d’un âge moyen de 41 ans (22 à 66 ans) ont été opérés<br />
d’une rupture récente du tendon d’Achille entre 1998 et 2002.<br />
L’intervention réalisée sous anesthésie locale et en ambulatoire<br />
consistait à effectuer une suture percutanée par deux points en<br />
cadre avec du fil tressé résorbable monté sur une aiguille. Les<br />
patients étaient immobilisés en moyenne durant 3 semaines. Ils ont<br />
été évalués grâce aux scores de Thermann modifiés par McComis<br />
complétés par un test objectif au Cybex à 30 et 60/sec pour étudier<br />
le pic de couple, la puissance et le travail maximal possible suivis<br />
de 30 cyc<strong>les</strong> à 120/sec évaluant la fatigabilité musculaire.<br />
RÉSULTATS. Le suivi moyen a été de 35 mois (10 à 66 mois).<br />
Les scores d’évaluation notés sur 100 permettent de retrouver 73<br />
excellents et bons résultats et 3 mauvais résultats. La durée opératoire<br />
moyenne a été de 15 minutes sans complication immédiate.<br />
La reprise de l’appui précoce a été autorisée à J1 (J1 à J20),<br />
l’activité professionnelle reprise à J40 (8 à 100 jours) alors que <strong>les</strong><br />
activités sportives n’ont été effectuées qu’à 6 mois (4 à8mois).<br />
Les amplitu<strong>des</strong> articulaires de la cheville sont symétriques et<br />
aucune douleur gênante n’a été retrouvée pour 73 patients. La<br />
circonférence du mollet est inférieure de 2 cm par rapport au côté<br />
controlatéral (0,5 à3cm).Nousretrouvons deux récidives et un<br />
mauvais résultat. La diminution de la force musculaire du triceps<br />
opéré n’est jamais supérieure à 35 % par rapport au côté sain dans<br />
<strong>les</strong> tests effectués sur Cybex.<br />
DISCUSSION. Les évaluations objectives sur Cybex sont étroitement<br />
corrélées aux résultats obtenus avec la classification de<br />
McComis. Cette technique qui ne nécessite pas l’ablation du matériel<br />
est parfaitement reproductible dans un cadre de chirurgie<br />
ambulatoire sous anesthésie locale. Cette technique, de faible<br />
coût, reste contre-indiquée pour <strong>des</strong> sutures tardives, <strong>des</strong> reprises<br />
ou en cas de rupture très distale.<br />
CONCLUSION. Les très bons résultats obtenus dans cette série<br />
invitent à traiter <strong>les</strong> ruptures spontanées récentes du tendon<br />
d’Achille par cette méthode percutanée de faible coût et à en<br />
diffuser l’utilisation.<br />
*E. Taton, Service Orthopédie et Traumatologie,<br />
CHU Bordeaux, place Amélie-Raba-Léon, 33076 Bordeaux.<br />
160 Traitement <strong>des</strong> ruptures du tendon<br />
calcanéen par matériel biorésorbable<br />
P. DELPONTE*<br />
INTRODUCTION. Ce travail a permis de dégager <strong>les</strong> avantages<br />
de la suture percutanée du tendon d’Achille selon une technique<br />
améliorée par matériel entièrement résorbable.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Trente cas de ruptures souscutanées<br />
ont été opérées dans <strong>des</strong> délais variant de2à10jours avec<br />
<strong>des</strong> extrêmes de 24 heures à 7 semaines. La technique comportait<br />
l’utilisation d’une suture percutanée par 4 fils résorbab<strong>les</strong> montés
3S96 78 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
en V, ancrés dans le calcanéum et, après mise en équin du pied,<br />
bloqués sur le fragment proximal par 2 boutons biorésorbab<strong>les</strong>.<br />
Suites opératoires : la mise en appui était immédiate et progressive<br />
sous couvert d’une attelle amovible et réglable. La rééducation<br />
activo passive est autorisée d’emblée. Le matériel était laissé définitivement<br />
en place. Il disparaît au-delà du 3 e mois.<br />
RÉSULTATS. Le recul s’échelonnait de 24à8mois. La cicatrisation<br />
cutanée a été excellente, la tolérance du matériel parfaite<br />
(seule doléance une douleur calcanéenne transitoire dans <strong>les</strong> tous<br />
premiers cas). Les résultats objectifs ont été comparab<strong>les</strong> à ceux<br />
obtenus par la suture conventionnelle avec diminution significative<br />
du risque de complications cutanées et neurologiques. Il n’a<br />
pas été constaté de rupture itérative dans la série. Les contrô<strong>les</strong> par<br />
échographie et IRM ont confirmé la cicatrisation précoce, la qualité<br />
tendineuse et la disparition du matériel dans <strong>des</strong> délais conformes<br />
aux attentes. Les résultats subjectifs étaient excellents.<br />
DISCUSSION. Si à terme, <strong>les</strong> résultats de cette série sont comparab<strong>les</strong><br />
à ceux obtenus avec la suture percutanée utilisée antérieurement,<br />
on note surtout une nette amélioration <strong>des</strong> suites et une<br />
diminution très significative <strong>des</strong> complications cutanées et neurologiques<br />
signalées dans <strong>les</strong> autres séries. Il faut également souligner<br />
l’absence très encourageante de rupture itérative. Les avantages<br />
sont encore plus réels face à la chirurgie ouverte et la solidité<br />
accrue du système autorise une rééducation fonctionnelle très proche<br />
de celle utilisée par <strong>les</strong> tenants du traitement non opératoire.<br />
Les limites à l’indication semblent être <strong>les</strong> ruptures traitées au delà<br />
de la 3 e semaine, ainsi que <strong>les</strong> désinsertions calcanéennes vraies.<br />
CONCLUSION. Il semble bien que cette technique améliore le<br />
confort du b<strong>les</strong>sé et son suivi, tout en le sécurisant dans sa rééducation.<br />
*P. Delponte, Clinique Bon Secours,<br />
67, bis avenue du Maréchal-Foch, 43000 Le-Puy-en-Velay.<br />
161 Les lésions fissuraires du long fléchisseur<br />
de l’hallux : à propos de 7<br />
cas<br />
E. TOULLEC*, L.-S. BAROUK<br />
INTRODUCTION. Les lésions fissuraires du long fléchisseur<br />
de l’hallux sont souvent méconnues car de diagnostic uniquement<br />
clinique, aucune imagerie n’ayant pu visualiser la lésion. L’objectif<br />
de ce travail est donc de préciser <strong>les</strong> signes cliniques ayant<br />
conduit à une exploration chirurgicale avec suture du tendon, seule<br />
solution thérapeutique efficace.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. La lésion du long fléchisseur de<br />
l’hallux peut se rencontrer suite à un traumatisme de type entorse<br />
de cheville, choc sur le bord médial du pied ou chute d’une hauteur.<br />
La lésion siège soit au niveau de la gouttière rétro-talienne (1 cas),<br />
soit au niveau du nœud de Henry, poulie de fixation <strong>des</strong> tendons<br />
fléchisseurs commun <strong>des</strong> orteils et long fléchisseur de l’hallux<br />
sous l’os naviculaire (6 cas) et se traduit par une douleur exquise à<br />
l’endroit de la lésion. La mobilisation de l’hallux réveille en général<br />
la douleur, expliquant l’impossibilité à courir ou à se mettre sur<br />
la pointe <strong>des</strong> pieds. Les explorations par échographie et résonance<br />
magnétique nucléaire se sont toutes révélées négatives. Devant la<br />
persistance de la douleur malgré de multip<strong>les</strong> traitements médicaux<br />
(anti-inflammatoires, infiltrations, orthèse plantaire avec<br />
voute de maintien médiale, immobilisation plâtrée), la solution<br />
chirurgicale a permis dans tous <strong>les</strong> cas une cédation de la douleur et<br />
la reprise <strong>des</strong> activitésà3moisenmoyenne. Le traitement consiste<br />
en une suture du tendon associée en rétro-talien à une régularisation<br />
de la gouttière du tendon si nécessaire et au niveau sousnaviculaire,<br />
à une section du nœud de Henry et de l’anastomose<br />
<strong>des</strong> fléchisseur. Une immobilisation plâtrée est ensuite recommandéepour4à6semaines.<br />
CONCLUSION. Devant une douleur du carrefour postérieur ou<br />
sous-naviculaire, l’examen du long fléchisseur de l’hallux doit être<br />
systématiquement réalisé à la recherche d’une fissuration qui indique<br />
un traitement chirurgical de suture tendineuse. Nous espérons<br />
qu’à l’avenir une imagerie nous permettra de nous confirmer le<br />
diagnostic avant le geste chirurgical.<br />
*E. Toullec, Polyclinique du Tondu,<br />
151, rue du Tondu, 33000 Bordeaux.<br />
162 Résultats à 6 ans de recul moyen<br />
de 80 fractures thalamiques du calcanéum<br />
opérées par plaques 1/4 de<br />
tube montées en triangulation<br />
H. VOUAILLAT*, D. SARAGAGLIA, Y.TOURNÉ<br />
INTRODUCTION. L’objectif de ce travail était d’évaluer <strong>les</strong><br />
résultats cliniques et radiologiques de 80 fractures thalamiques du<br />
calcanéum opérées entre octobre 1990 et mai 1999 et ostéosynthèsées<br />
par plaques 1/4 de tube montées en triangulation.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Il s’agissait de 73 patients (7<br />
fractures bilatéra<strong>les</strong>), 56 hommes et 17 femmes âgés de 39,6 ans en<br />
moyenne (15 à 67). Nous avons retrouvé dans 34 cas un accident<br />
domestique (46,6 %) à l’origine de la fracture, dans 19 cas (26 %)<br />
un accident de sport, dans 14 cas (19,2 %) un accident du travail et<br />
dans 6 cas (8,2 %) un accident de la voie publique. Nous avons<br />
colligé, selon la classification de Duparc, 2 sta<strong>des</strong> 2, 17 sta<strong>des</strong> 3, 51<br />
sta<strong>des</strong> 4 et 10 sta<strong>des</strong> 5. La majorité <strong>des</strong> patients a été opérée par <strong>des</strong><br />
chirurgiens juniors qui ont réalisé 7 montages en « accent circonflexe<br />
» et 73 montages en « triangle fermé ». 42 opérés (47 fractures<br />
soit un taux de révision de 58,8 %) ont pu être revus cliniquement<br />
(critères de la SOFCOT et de l’AOFAS) et radiologiquement<br />
pour apprécier la stabilité du montage (angle de<br />
Boëhler et angle astragalo-thalamique) et l’arthrose éventuelle.<br />
RÉSULTATS. Le recul moyen était de 6 ans (1,5 à 11,5 ans).<br />
Nous avons retrouvé très peu de complications : 4 retards de cicatrisation<br />
(5 %), 5 algodystrophies (6,3 %) et 2 infections (2,5 %)<br />
une à staphylocoque doré méthi-S et une autre à Coriné Bactérium<br />
Bovis.<br />
En ce qui concerne <strong>les</strong> résultats subjectifs 93,5 % <strong>des</strong> patients se<br />
disaient satisfaits ou très satisfaits de l’intervention. L’angle de<br />
Boëlher à la révision était de 25,7 ± 11 (0 à 63) soit une perte<br />
angulaire de 4,7 ± 6,7. L’interligne subtalien était normal ou presque<br />
normal dans 46,8 % et arthrosique (pincé ou disparu) dans<br />
53,2 % <strong>des</strong> cas. Le score fonctionnel de Kitaoka (AOFAS) était en<br />
moyenne de 73,2 points avec 44,7 % de résultats excellents et bons
et 44,8 % de résultats moyens. Pour ce qui est du score de la<br />
SOFCOT nous avons retrouvé 63,8 % de résultats TB, B, AB et<br />
10,6 % de résultats moyens ; à noter parmi <strong>les</strong> 25,5 % de résultats<br />
mauvais, 3 arthrodèses subtaliennes secondaires. Il faut signaler<br />
également que 86 % <strong>des</strong> patients ont repris leur travail antérieur et<br />
que 63 % <strong>des</strong> patients sportifs ont pu reprendre le sport.<br />
CONCLUSION. L’ostéosynthèse <strong>des</strong> fractures du calcanéum<br />
par plaques 1/4 de tube montées en triangulation est un montage<br />
stable (peu de perte secondaire de l’angle de Boëhler), peu encombrant<br />
(peu de nécroses cutanées) et qui donne <strong>des</strong> résultats subjectifs<br />
très satisfaisants. Les résultats objectifs peuvent paraître décevants,<br />
mais ils sont plus en relation avec la gravité de la fracture<br />
(76 % de sta<strong>des</strong> 4 et 5) qu’avec le type de montage.<br />
*H. Vouaillat, Service de Chirurgie Orthopédique et de<br />
Traumatologie du Sport, CHU de Grenoble, Hôpital Sud,<br />
BP 185, 38042 Grenoble Cedex 09.<br />
163 Traitement <strong>des</strong> fractures du processus<br />
latéral du talus : résultats d’une<br />
série de 7 cas opérés avec un suivi<br />
moyen de 6 ans<br />
R. MAES*, S. DOJCINOVIC, M.DELMI, R.PETER,<br />
P. HOFFMEYER<br />
INTRODUCTION. La fracture du processus latéral du talus est<br />
une lésion rare. Le diagnostic peut être manqué dans 50 % <strong>des</strong> cas.<br />
Elle est souvent confondue avec une entorse grave de la cheville.<br />
Jusque dans <strong>les</strong> années 70, moins de 60 cas ont été dénombrés dans<br />
la littérature. Avec l’ère du snow-board, 74 nouveaux cas ont été<br />
publiés.<br />
Nous rapportons <strong>les</strong> résultats d’une série rétrospective de 7 cas<br />
opérés de 1990 à 2001.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Cette étude décrit <strong>les</strong> différents<br />
mécanismes de survenue <strong>des</strong> fractures du processus latéral du talus<br />
et propose un algorithme thérapeutique. <strong>Tous</strong> <strong>les</strong> patients ont été<br />
revus en consultation. Ils ont été évalués à l’aide de l’échelle<br />
« arrière-pied » de l’A.O.F.A.S. et <strong>des</strong> radiographies du pied (une<br />
incidence antéro-postérieure de la cheville, une incidence de profil<br />
et de 3/4 du pied, et <strong>des</strong> incidences de Broden). Les résultats ont été<br />
classés comme excellent, moyen ou mauvais. L’âge moyen était<br />
de 33 ans (20-51 ans). Le recul moyen était de 6 ans (1-12 ans). La<br />
fracture était survenue au cours d’un accident de snow-board, trois<br />
accidents de moto, une défenestration et deux accidents d’escalade.<br />
Le mécanisme lésionnel était l’éversion forcée dans un cas et<br />
un traumatisme à haute énergie dans 6 cas. Quatre patients présentaient<br />
une fracture de type 2 et trois patients, une fracture de type 3<br />
selon la classification de Hawkins. Le délai entre l’accident et le<br />
diagnostic était inférieur à 15 jours sauf dans un cas où il était de 10<br />
mois. Les lésions associées comprenaient 2 luxations subtaliennes,<br />
1 fracture du col du talus, 1 fracture de la malléole interne et 1<br />
fracture ouverte du premier cunéiforme. L’opération a consisté en<br />
une ostéosynthèse <strong>des</strong> fragments sans exérèse dans 4 cas, une<br />
exérèse <strong>des</strong> petits fragments associés à une ostéosynthèse <strong>des</strong> gros<br />
fragments dans 2 cas, et une ostéotomie d’un cal vicieux du processus<br />
latéral du talus dans 1 cas. La durée de décharge était de 6<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S97<br />
semaines sauf dans 1 cas de luxation subtalienne où la broche<br />
calcanéo-talienne fut retirée à la 8 e semaine post-opératoire.<br />
RÉSULTATS. Parmi <strong>les</strong> complications, on a constaté une infection<br />
superficielle traitée par antibiotique et deux arthroses subtaliennes<br />
avec un recul de plus de 10 ans. Le score global moyen était<br />
de 85. Le résultat fut considéré comme excellent dans 6 cas et<br />
mauvais dans 1 cas.<br />
DISCUSSION. La revue de la littérature montre que la fracture<br />
du processus latéral du talus représente 1 % de toutes <strong>les</strong> lésions de<br />
la cheville. Cinq mécanismes sont décrits dans la littérature. Les<br />
deux mécanismes <strong>les</strong> plus fréquents sont l’inversion de la cheville<br />
en dorsiflexion et le traumatisme à haute énergie. Les trois autres<br />
mécanismes sont l’éversion, le coup direct et la fracture de stress.<br />
Les conséquences d’une mauvaise prise en charge sont multip<strong>les</strong> :<br />
retard de consolidation, pseudarthrose, cal vicieux (1 cas dans<br />
notre série), nécrose avasculaire, instabilité subtalienne, incongruence<br />
articulaire avec risque d’arthrose subtalienne et/ou talofibulaire.<br />
Le traitement de la fracture du processus latéral du talus<br />
dépend du moment du diagnostic, de la taille, de la nature, et du<br />
degré de déplacement de la fracture. L’algorithme thérapeutique,<br />
utilisé à Genève, est le suivant : un traitement orthopédique (botte<br />
plâtrée de repos pendant 6 semaines suivie par de la physiothérapie)<br />
associé à une surveillance <strong>des</strong> plaintes si la fracture a une<br />
dimension inférieureà5mmcarelle est souvent extra articulaire.<br />
Si après ce traitement, le patient continue à présenter <strong>des</strong> gênes, on<br />
réalise l’exérèse du fragment. La fracture, de taille supérieure à 1<br />
cm, est souvent intra articulaire et nécessite un traitement chirurgical<br />
si elle est déplacée de plus de 2 mm. Dans la situation d’un<br />
diagnostic tardif, on peut être amené à réaliser soit une exérèse du<br />
fragment et/ou arthrodèse subtalienne soit une ostéotomie d’un cal<br />
vicieux. Si le diagnostic est précoce et le traitement approprié, <strong>les</strong><br />
résultats, après un suivi moyen de 6 ans, sont excellents.<br />
*R. Maes, 321, chaussée de Bruxel<strong>les</strong>,<br />
6042 Lodelinsart, Belgique.<br />
164 Résultats thérapeutiques à long<br />
terme <strong>des</strong> fractures du pilon tibial :<br />
à propos de 50 fractures à 7 ans de<br />
recul minimum<br />
E. HAVET*, G. ALOVOR, A.GABRION, P.MERTL,<br />
O. JARDE<br />
INTRODUCTION. Les auteurs rapportent une série de 50 fractures<br />
du pilon tibial ostéosynthèsèes et revues à 7 ans de recul<br />
minimum.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Il s’agissait de 28 hommes et 22<br />
femmes, d’âge moyen de 44 ans. Un traumatisme par chute était<br />
retrouvé pour 31 patients. Selon la classification de l’AO, 24 fractures<br />
étaient de type B et 26 de type C. Selon la classification de De<br />
Lestang, 12 fractures étaient simp<strong>les</strong>, 38 étaient complexes (dont<br />
26 complètes). Seize fractures étaient ouvertes et 39 étaient associées<br />
à une fracture de la malléole fibulaire. La plupart <strong>des</strong> ostéosynthèses<br />
ont été réalisées soit par voie antéro-latérale (22 cas)<br />
utilisant alors une plaque prémoulée, soit par voie médiale (11 cas)<br />
utilisant alors une plaque en trèfle. Une autogreffe spongieuse a été
3S98 78 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
utilisée 7 fois. Les patients ont été revus et <strong>les</strong> cotations établies<br />
selon le score de Kitaoka.<br />
RÉSULTATS. Les radiographies comprenaient un cliché de<br />
profil et un cliché de face en légère rotation médiale. Le recul<br />
moyen était de 14 ans. Dix déplacements secondaires ont été relevés.<br />
Les complications tardives comprenaient 14 pseudarthroses<br />
(dont 10 réopérées pour arthrodèse), 6 algoneurodystrophies, 4<br />
cals vicieux réopérés et 1 amputation pour infection.<br />
Au recul maximum, 33 chevil<strong>les</strong> étaient douloureuses (dont 13<br />
permanentes). Vingt-quatre patients présentaient une boiterie<br />
(dont 13 permanentes) limitant le périmètre de marche dans la<br />
moitié <strong>des</strong> cas. Fonctionnellement, l’amplitude de mobilité de<br />
l’articulation talo-crurale était normale pour 20 patients, celle de<br />
l’articulation sub-talaire était normale pour 24 patients. Trentetrois<br />
patients avaient repris leurs activités antérieures. Soixantequatre<br />
pour cent <strong>des</strong> sportifs avaient repris leurs activités au même<br />
niveau. Selon Kitaoka, le score moyen était de 79 points, dont<br />
167 Résultat de la quadricepsplastie de<br />
Mac Intosh renforcée au fascia lata<br />
dans <strong>les</strong> gran<strong>des</strong> laxités antérieures<br />
du genou : à propos de 108 cas<br />
S. JAGER*, D. SARAGAGLIA, C.CHAUSSARD,<br />
H. PICHON, F.JOURDEL<br />
INTRODUCTION. L’objectif de ce travail était d’évaluer <strong>les</strong><br />
résultats fonctionnels et anatomiques de la quadricepsplastie de<br />
Mac Intosh renforcée par un transplant de Fascia lata libre utilisée<br />
pour traiter <strong>les</strong> gran<strong>des</strong> laxités antérieures du genou.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Nous avons considéré comme<br />
une grande laxité, <strong>les</strong> laxités antérieures qui avaient une laxité<br />
différentielle supérieure à 10 mm (Lachman Manuel Maximum au<br />
KT 1000) par rapport au côté opposé et/ou un ressaut explosif coté<br />
à 3 croix et/ou une laxité absolue supérieure ou égale à 20 mm.<br />
Cette étude rétrospective porte sur 108 patients opérés entre 1995<br />
et 1998 par un seul opérateur (DS). La série était composée de 70<br />
hommes et 38 femmes, âgés en moyenne de 29 ± 8,7 ans (15 à 52)<br />
et dont le délai accident-intervention était en moyenne de 38 mois<br />
(2 à 324 mois). 98 pratiquaient un sport avec pivot et contact (47<br />
soit 43,5 %) ou pivot sans contact (51 soit 47,2 %). La laxité<br />
pré-opératoire au KT 1000 (LMM) était en moyenne de 18 ± 3mm<br />
(13 à 30) du côté lésé et de 5,34 ± 1,9 mm du côté sain (15 genoux<br />
exclus du fait d’une rupture contro-latérale du LCA). La laxité<br />
différentielle moyenne était de 12,6 ± 2,3 mm (9 à 21) et dans 44<br />
cas (40,8 %) le ressaut était à 3 croix. Seulement 37 genoux (34 %)<br />
étaient indemnes de toute lésion méniscale.<br />
Les résultats ont été évalués par un chirurgien indépendant de<br />
l’opérateur à l’aide de la fiche IKDC.<br />
Séance du 12 novembre après-midi<br />
GENOU<br />
70 % de bons, 16 % de moyens et 14 % de mauvais. En dehors <strong>des</strong><br />
patients arthrodésés, 24 arthroses ont été retrouvées (dont 10 sta<strong>des</strong><br />
2 et 3) radiologiquement.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. Les bons résultats dépendent<br />
de la réduction peropératoire, aussi bien épiphysaire (pour <strong>les</strong><br />
fractures complètes) que métaphysaire. Cette réduction doit être<br />
maintenue dans le temps par une ostéosynthèse stable et rigide<br />
évitant tout déplacement secondaire à l’origine de cal vicieux<br />
éventuel. Par ailleurs, la sévérité et la complexité initia<strong>les</strong> de la<br />
fracture reste le facteur principal du résultat final. Pour nous, l’utilisation<br />
de la tomodensitométrie permet de mieux définir désormais<br />
cette sévérité et donc de mieux poser <strong>les</strong> indications thérapeutiques.<br />
Les fractures du pilon tibial restent de prise en charge<br />
difficile. Leur parfaite réduction reste le meilleur garant d’un bon<br />
résultat.<br />
*E. Havet, Service de Chirurgie Orthopédique, CHU d’Amiens,<br />
place Victor-Pauchet, 80000 Amiens.<br />
RÉSULTATS. Ils portent sur 71 patients (37 perdus de vue soit<br />
un taux de révision de 65,8 %) dont le recul moyen était de<br />
63,4 ± 12,9 mois (40 à 86). La laxité postopératoire absolue était<br />
en moyenne de 8,9 ± 2,9 mm (2 à 18) et la laxité différentielle de<br />
2,6 ± 2,3 mm (-2 à 8) soit un gain de laxité de 10 mm en moyenne.<br />
73,2 % <strong>des</strong> genoux n’avaient plus de ressaut, 22,6 % avaient une<br />
amorce de ressaut (+) et 4,2 % avaient un ressaut net (++). Le score<br />
IKDC global était en moyenne de 87,3 ± 9,6 (56 à 100). 90 % <strong>des</strong><br />
opérés étaient satisfaits ou très satisfaits de l’intervention. Par<br />
ailleurs, 80,3 % <strong>des</strong> patients avaient pu reprendre le sport à un<br />
niveau identique ou supérieur.<br />
CONCLUSION. La plastie mixte selon Mac Intosh à l’aide de<br />
l’appareil extenseur et renforcée par un transplant de fascia lata<br />
permet de traiter avec efficacité <strong>les</strong> gran<strong>des</strong> laxités antérieures du<br />
genou. Peu d’étu<strong>des</strong> différencient <strong>les</strong> gran<strong>des</strong> laxités <strong>des</strong> petites<br />
laxités. Des étu<strong>des</strong> prospectives randomisées, dans le cadre <strong>des</strong><br />
gran<strong>des</strong> laxités antérieures, sont nécessaires pour confirmer le bien<br />
fondé de cette technique par rapport aux plasties isolées du LCA<br />
sans retour extra-articulaire.<br />
*S. Jager, Service de Chirurgie Orthopédique et de<br />
Traumatologie du Sport, CHU de Grenoble, Hôpital Sud,<br />
BP 185, 38042 Grenoble Cedex 09.<br />
168 Suivi IRM à1et5ansde62greffes<br />
de LCA avec fixation tibiale par vis<br />
résorbable<br />
L. JACQUOT*, T. AÏT SI SELMI, P.NEYRET<br />
INTRODUCTION. Le but de cette étude est d’analyser le devenir<br />
clinique et IRM de greffes de LCA utilisant le tendon rotulien
dont la fixation tibiale est assurée par une vis d’interférence résorbable<br />
en PLA 98 (Phusist).<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Cent quatre-vingt-deux greffes<br />
de LCA ont été réalisées dans notre service entre 1994 et 1997. La<br />
greffe a été isolée dans 85 cas (Kenneth Jones), et associée à une<br />
plastie de Lemaire dans 97 cas. La fixation tibiale a toujours été<br />
assurée par une vis résorbable. Une évaluation clinique et radiologique<br />
a été réalisée avant l’intervention,à1anetà5ans. Sur 110<br />
patients ayant eu une IRM à un an, 62 ont pu avoir une nouvelle<br />
IRM à 5 ans (57 %). Le positionnement tibial antéro-postérieur et<br />
médio-latéral a été évalué sur <strong>les</strong> coupes horizonta<strong>les</strong>. Nous avons<br />
défini une méthode d’évaluation du positionnement fémoral sur<br />
<strong>les</strong> coupes IRM horizonta<strong>les</strong>. L’aspect du greffon a été analysé<br />
selon <strong>les</strong> différentes séquencesà1et5ans.<br />
RÉSULTATS. Il yaeu3échecs (test de Trillat-Lachman arrêt<br />
mou). La laxité différentielle résiduelle moyenne est de 2,6 mm<br />
(Telos). Quatre-vingt-deux pour cent <strong>des</strong> patients ont une activité<br />
sportive intensive ou modérée à 5 ans. Le positionnement tibial a<br />
été bon et très reproductible (ET = 0,06). Cinq positionnements<br />
fémoraux ont été non satisfaisants selon notre technique, sans<br />
relation avec <strong>les</strong> échecs. La vis s’est toujours résorbée à 5 ans.<br />
Deux réactions osseuses à un an ont été relevées, sans rapport avec<br />
la résorption de la vis (1 contusion, 1 algodystrophie). Un rehaussement<br />
périphérique du greffon à un an après injection de Gadolinium<br />
a toujours été noté. A 5 ans, 3 transplants sont apparus<br />
globalement hétérogènes correspondant aux 3 ruptures. Les hétérogénéités<br />
segmentaires n’ont pas eu de signification pathologique.<br />
DISCUSSION. L’évaluation du positionnement fémoral est<br />
difficile en IRM sur <strong>les</strong> coupes sagitta<strong>les</strong>. Notre méthode d’analyse<br />
en coupes horizonta<strong>les</strong> permet une analyse fiable et reproductible.<br />
L’analyse du greffon doit tenir compte du délai après l’intervention,<br />
ainsi que de la séquence utilisée. Il n’y a pas eu de<br />
problème de fixation ou de résorption de la vis.<br />
CONCLUSION. Ce suivi IRM de greffes de LCA permet de<br />
proposer <strong>des</strong> métho<strong>des</strong> d’évaluation du positionnement du transplant,<br />
de suivre l’évolution du greffon, ainsi que confirmer la<br />
fiabilité et l’innocuité de la fixation par un type de vis résorbable.<br />
*L. Jacquot, Centre Livet,<br />
8, rue de Margnol<strong>les</strong>, 69300 Caluire.<br />
169 Étude anatomo-radiologique de<br />
l’insertion fémorale <strong>des</strong> deux faisceaux<br />
du ligament croisé postérieur<br />
F. CLADIÈRE*, J.-L. BESSE, J.-L. LERAT,<br />
B. MOYEN<br />
INTRODUCTION. Le ligament croisé postérieur (LCP), constitué<br />
de deux faisceaux, antéro-latéral (AL) et postéro-médial<br />
(PM), a une insertion fémorale étendue sur trois centimètres en<br />
éventail, laquelle ne peut pas être remplacée par un transplant<br />
unique lors de la reconstruction chirurgicale de ce ligament<br />
rompu. Le but de cette étude a été de définir le centre anatomique<br />
de l’insertion fémorale de chaque faisceau pour déterminer <strong>des</strong><br />
repères précis et reproductib<strong>les</strong> de la position <strong>des</strong> deux tunnels<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S99<br />
osseux pour fixer <strong>les</strong> transplants (un par faisceau) lors de la reconstruction<br />
du LCP.<br />
MATÉRIEL. Un repère métallique a été placé au centre de<br />
l’insertion fémorale <strong>des</strong> deux faisceaux du LCP de dix genoux<br />
cadavériques. A partir d’un logiciel de mesures (Métros) et après<br />
avoir numérisé <strong>les</strong> radiographies de chaque genou, nous avons<br />
déterminé le positionnement <strong>des</strong> faisceaux sur le condyle interne.<br />
La variabilité intra et inter observateurs <strong>des</strong> résultats a été recherchée.<br />
RÉSULTATS. Le faisceau AL est situé à 31,6 + 2,45 %<br />
(47,2 + 6,02 % pour le faisceau PM) du bord antérieur de l’échancrure<br />
ou 41,18 + 2,73 % (54,46 ± 5,07 % pour PM) du bord antérieur<br />
du condyle interne par rapport à la ligne de Blumensaat et à<br />
16,12 + 4,45 % (33,68 ± 7,2 % pour PM) du sommet de l’échancrure.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. Le positionnement idéal,<br />
principalement fémoral <strong>des</strong> insertions du LCP, conditionne <strong>les</strong><br />
résultats cliniques et objectifs de la reconstruction. L’insertion<br />
tibiale est moins étendue avec un positionnement dont la précision<br />
a moins de conséquence biomécanique qu’au niveau fémoral. Le<br />
repérage per-opératoire de l’insertion fémorale idéale peut être<br />
amélioré par l’utilisation de mesures déterminées sur genoux<br />
cadavériques. Les valeurs retrouvées lors de cette étude sont reproductib<strong>les</strong><br />
et se présentent sous forme de rapports de longueur<br />
limitant <strong>les</strong> erreurs liées au morphotype du patient et pouvant<br />
s’intégrer dans un programme de navigation chirurgicale.<br />
*F. Cladière, Service de Chirurgie Orthopédique, Centre<br />
Hospitalier Lyon Sud, bâtiment 3A, 165, chemin du<br />
Grand-Revoyet, 69495 Pierre-Bénite Cedex.<br />
170 Comparaison biomécanique de la<br />
reconstruction du ligament croisé<br />
antérieur par greffe de tendons de<br />
la patte d’oie à un ou deux faisceaux<br />
: une étude cadavérique<br />
A. SBIHI*, G. BELLIER, P.CHRISTEL,<br />
P. COLOMBET, P.DJIAN, J.-P. FRANCESCHI<br />
INTRODUCTION. Le LCA est composé de deux faisceaux<br />
antéro-médial (AM) et postéro-latéral (PL) au rôle biomécanique<br />
distinct. Les techniques classiques de reconstruction du ligament<br />
croisé antérieur (LCA) par greffe à un faisceau ne remplacent que<br />
le faisceauAM. Le contrôle de la laxité du genou après reconstruction<br />
du LCA par greffe à un faisceau ne restaure pas une laxité<br />
physiologique.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. L’étude a été réalisée sur 16<br />
genoux cadavériques appariés avec randomisation de la technique<br />
de reconstruction. La subluxation antérieure du tibia a été mesurée<br />
avec un arthromètre, le Rolimetery, en traction manuelle maximum<br />
sur le genou intact, après section du LCA et après reconstruction<br />
arthroscopique du LCA à un faisceau 4 brins ou deux<br />
faisceaux deux brins en utilisant <strong>les</strong> tendons de la patte d’oie, à<br />
20°, 60° et 90° de flexion. La variation de longueur de chaque<br />
faisceau reconstruit a été mesurée.
3S100 78 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
RÉSULTATS. Pour <strong>les</strong> 16 genoux étudiés avec LCA intact, la<br />
laxité antérieure à 20°, 60° et 90° a été mesurée. Après section du<br />
LCA la laxité augmente de manière significative à tous <strong>les</strong> ang<strong>les</strong><br />
étudiés. L’analyse statistique <strong>des</strong> résultats utilisant aussi bien <strong>les</strong><br />
tests paramétriques que non paramétriques montre l’existence<br />
d’une différence significative de laxité entre LCA sectionné et<br />
LCA reconstruit (greffe à un faisceau) à 20°, 60° et 90° de flexion.<br />
Il existe une différence significative entre LCA intact et LCA<br />
reconstruit à 20° de flexion, la laxité résiduelle étant plus importante<br />
après reconstructionà1faisceau. En revanche, à 60° et 90° il<br />
n’y a pas de différence significative de subluxation antérieure du<br />
tibia que le LCA soit intact ou reconstruit. L’analyse statistique<br />
montre une amélioration significative de laxité entre LCA sectionné<br />
et LCA reconstruit (greffe à deux faisceaux) à 20°, 60° et<br />
90° de flexion mais, sans différence significative de subluxation<br />
antérieure du tibia entre LCA intact et LCA reconstruit à 20°, 60°<br />
et 90° de flexion.<br />
CONCLUSION. La reconstruction du LCA par une greffe à<br />
deux faisceaux permet de rétablir une laxité antérieure similaire à<br />
celle du LCA intact à 20°, 60° et 90° de flexion alors que la<br />
reconstruction à un faisceau ne rétablit une laxité physiologique<br />
qu’à 60° et 90°.<br />
*A. Sbihi, Service de Chirurgie Orthopédique,<br />
Hôpital de la Conception, 147, boulevard Baille,<br />
13005 Marseille.<br />
171 KJ versus DIDT : comparaison de la<br />
morbidité et influence <strong>des</strong> méniscectomies<br />
C. TROJANI*, J.-M. PARISAUX, E.HOVORKA,<br />
J.-S. COSTE, P.BOILEAU<br />
INTRODUCTION. Le but de cette étude était de comparer la<br />
morbidité <strong>des</strong> techniques os-tendon rotulien-os (KJ) et droit<br />
interne-demi tendineux à4faisceaux (DIDT) utilisées comme<br />
greffe de ligament croisé antérieur (LCA), chez <strong>les</strong> patients âgés<br />
de moins de 40 ans et d’évaluer l’influence <strong>des</strong> méniscectomies<br />
réalisées avant, pendant ou après la reconstruction du LCA.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Cent quatorze patients (58 KJ<br />
puis 56 DIDT), opérés entre mars 1997 et mars 2000, ont été<br />
inclus. Les critères d’exclusion étaient : gestes ligamentaires périphériques<br />
ou gestes osseux associés, reprise chirurgicale. La série<br />
est continue avec une évaluation rétrospective par deux chirurgiens<br />
différents de l’opérateur. La série KJ : âge moyen 28 ans,<br />
recul moyen 44 mois, 11 méniscectomies associées. La série<br />
DIDT : âge moyen 27,5 ans, recul moyen 28 mois, 19 méniscectomies<br />
associées. L’évaluation clinique a porté sur le score IKDC,<br />
la laximétrie (KT 2000, Télos) et un bilan radiologique (face,<br />
profil en appui monopodal, schuss).<br />
RÉSULTATS. A la révision (89 patients, soit 78 % <strong>des</strong> cas), il<br />
existait 3 échecs dans chacune <strong>des</strong> séries ; 77 % <strong>des</strong> patients<br />
étaient classés IKDC A ou B. Subjectivement, 90 % <strong>des</strong> patients<br />
considéraient leur genou comme normal ou presque. Quelle que<br />
soit la greffe, <strong>les</strong> résultats étaient significativement meilleurs si le<br />
ménisque était conservé. En cas de ménisque conservé, il n’existait<br />
aucune différence entre KJ et DIDT. Il existait plus de douleurs<br />
antérieures et plus de douleurs à genou après KJ qu’après DIDT ;<br />
mais plus de douleurs postérieures de cuisse après DIDT qu’après<br />
KJ. Le déficit de force en extension était de 14 % en moyenne<br />
après KJ ; le déficit de force en flexion était de 25 % en moyenne<br />
après DIDT.<br />
DISCUSSION. La méniscectomie pré, per ou post reconstruction<br />
du LCA influence négativement le résultat de la greffe, et ce,<br />
quelle que soit la technique utilisée. Si le ménisque est conservé, il<br />
n’existe aucune différence entre KJ et DIDT. KJ et DIDT ont <strong>des</strong><br />
morbidités différentes, mais équivalentes : <strong>les</strong> douleurs sont différentes<br />
(antérieures pour <strong>les</strong> KJ ; postérieures pour <strong>les</strong> DIDT) ; <strong>les</strong><br />
déficits musculaires sont différents (en extension pour <strong>les</strong> KJ, en<br />
flexion pour <strong>les</strong> DIDT).<br />
CONCLUSION. Plus que le choix du transplant pour reconstruire<br />
le LCA, c’est la conservation méniscale qui est un élément<br />
majeur du résultat.<br />
*C. Trojani, Service de Chirurgie Orthopédique,<br />
Hôpital Archet 2, 151, route de Saint-Antoine-de-Ginestière,<br />
06202 Nice.<br />
172 Navigation sans imagerie du ligament<br />
croisé antérieur : à propos de<br />
50 genoux opérés<br />
R. JULLIARD*, S. PLAWESKI, P.CINQUIN<br />
INTRODUCTION. Une plastie du croisé antérieur doit être<br />
implantée de façon aussi anatomique et isométrique que possible<br />
et sans conflit avec l’échancrure. Ceci passe par un bon positionnement<br />
<strong>des</strong> tunnels. Des étu<strong>des</strong> récentes ont montré que leur placement<br />
reste une difficulté clef. Pour essayer de résoudre ce challenge,<br />
nous nous sommes orientés vers la navigation sans<br />
imagerie.<br />
MATÉRIEL. Nous avons élaboré un système de navigation basé<br />
sur le concept du bone morphing lequel repose sur la représentation<br />
sur l’écran d’un modèle statistique du genou. Il utilise un<br />
localisateur optique tridimensionnel qui enregistre <strong>les</strong> positions<br />
relatives de cinq corps rigi<strong>des</strong> équipés de capteurs rétroréfléchissants<br />
fixés un sur le fémur, un sur le tibia, un sur le palpeur,<br />
un sur le viseur fémoral et le cinquième sur le viseur tibial.<br />
MÉTHODES. Technique opératoire (sous arthroscopie) :bone<br />
morphing ; navigation de l’orifice articulaire du tunnel tibial sous<br />
forme d’un cercle de centre T pour lequel l’ordinateur <strong>des</strong>sine sur<br />
l’échancrure la carte d’isométrie fémorale correspondante ; sur<br />
cette carte d’isométrie, le chirurgien navigue le centre F de l’orifice<br />
articulaire du tunnel fémoral ; fixation du transplant ; l’ordinateur<br />
recherche l’existence d’un conflit transplant-échancrure et<br />
indique où une éventuelle plastie de l’échancrure est nécessaire.<br />
Méthode d’évaluation : comparaison chiffrée entre <strong>les</strong> points T<br />
et F indiqués par l’ancillaire conventionnel et par l’ordinateur ;<br />
comparaison entre la fréquence <strong>des</strong> plasties de l’échancrure en<br />
chirurgie conventionnelle et en chirurgie naviguée.<br />
RÉSULTATS. Le système de navigation a été utilisé 50 fois. Les<br />
points T navigués ont été antérieurs et médialisés par rapport à<br />
ceux indiqués par l’ancillaire conventionnel. En conventionnel,
dans un genou donné, l’anisométrie d’une fibre centrale peut<br />
varier, selon le point F permis par l’ancillaire, de 3 à 13 mm :<br />
l’ordinateur optimise ce positionnement. Ilyaeumoins de5%de<br />
plasties de l’échancrure en chirurgie naviguée et plus de 50 % en<br />
chirurgie conventionnelle.<br />
DISCUSSION. Le bone morphing permet de naviguer : l’opérateur<br />
voit sur l’écran le genou qu’il opère. L’ordinateur permet<br />
d’optimiser le placement <strong>des</strong> tunnels. Mais ce n’est pas lui qui<br />
indique leur siège : ils sont navigués et décidés par le chirurgien.<br />
L’ordinateur peut montrer en temps réel le bénéfice qu’il apporte<br />
par rapport aux ancillaires conventionnels en termes de positionnement<br />
<strong>des</strong> tunnels.<br />
*R. Julliard, Clinique Mutualiste, 8, rue Docteur-Calmette,<br />
38028 Grenoble Cedex.<br />
173 Reconstruction du ligament croisé<br />
antérieur assistée par ordinateur :<br />
technique utilisant la fluoroscopie<br />
I. BENAREAU*, R. TESTAT, J.-L. LERAT,<br />
B. MOYEN<br />
INTRODUCTION. De nombreuses étu<strong>des</strong> montrent que <strong>les</strong><br />
résultats de la reconstruction du Ligament CroiséAntérieur (LCA)<br />
sont influencés par le positionnement du transplant. Nous avons<br />
fait le choix d’un positionnement anatomique du transplant. Dans<br />
le but d’optimiser ce positionnement nous avons développé un<br />
système de navigation avec imagerie per-opératoire utilisant la<br />
fluoroscopie.<br />
MATÉRIEL. Trente-cinq patients ont été opérés à l’aide d’une<br />
technique chirurgicale de reconstruction du LCA assistée par ordinateur.<br />
La technique de navigation employée utilise un amplificateur<br />
de brillance qui est relié à un ordinateur qui est équipé d’un<br />
logiciel d’acquisition et de traitement de l’image permettant de<br />
capturer l’image de l’amplificateur de brillance (genou de profil).<br />
MÉTHODE. La technique chirurgicale est réalisée sous arthroscopie,<br />
le chirurgien met en place <strong>des</strong> repères fémoral (mini-vis)<br />
et tibial (broche) au niveau <strong>des</strong> positionnement qu’il estime<br />
idéaux. Puis, avant de percer <strong>les</strong> tunnels, il réalise un contrôle avec<br />
l’amplificateur de brillance. L’image obtenue est captée par l’ordinateur,<br />
traitée, puis l’ordinateur précise le positionnement théorique<br />
anatomique <strong>des</strong> insertions tibia<strong>les</strong> et fémora<strong>les</strong> du LCA. Le<br />
positionnement est alors soit validé soit modifié puis re-contrôlé.<br />
L’analyse du positionnement est réalisée sur <strong>les</strong> radiographies<br />
postopératoires (genoux de profil), cel<strong>les</strong>-ci sont traitées par un<br />
ordinateur, la mesure du positionnement est effectuée par rapport<br />
au centre anatomique de l’insertion du LCA. L’analyse statistique<br />
utilise un test non paramétrique (test de Wilcoxon) après avoir<br />
procédé à l’appariement selon l’age et le sexe de nos 35 patients<br />
avec 35 patients opérés sans technique de navigation.<br />
RÉSULTATS. L’utilisation d’une assistance au positionnement<br />
permet d’obtenir un écart entre le centre du transplant et le point<br />
théorique idéal d’en moyenne 7,7 ± 1,9 mm sans assistance contre<br />
5,1 ± 1,3 mm avec assistance.<br />
DISCUSSION. La comparaison <strong>des</strong> résultats par <strong>les</strong> tests statistiques<br />
adaptés (statistique W de Wilcoxon pour séries appariées<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S101<br />
d’effectifs réduits) retrouve une différence significative (p =<br />
0,001) de répartition entre <strong>les</strong> deux séries. Ces résultats mettent<br />
donc en évidence une précision et une reproductibilité améliorée<br />
dans le groupe opéré avec la technique de navigation.<br />
CONCLUSION. Cette technique permet au chirurgien d’obtenir<br />
une excellente précision de positionnement du transplant en<br />
augmentant la reproductibilité de leur positionnement. Les inconvénients<br />
de cette technique sont au nombre de deux : l’allongement<br />
de la durée opératoire (en moyenne de 15 ± 7 minutes) et<br />
l’irradiation. Mais cette technique est simple, facile d’utilisation et<br />
présente un coût de reviens faible.<br />
*I. Benareau, Centre Hospitalier Lyon-Sud, 165, chemin du<br />
Grand-Revoyet, 69495 Pierre-Bénite Cedex.<br />
174 Reconstruction <strong>des</strong> 2 ligaments<br />
croisés dans <strong>les</strong> cas chroniques<br />
avec un transplant unique provenant<br />
du système extenseur : catamnèse<br />
à propos de 24 cas<br />
J.-L. LERAT*<br />
Le procédé décrit en 1986 dans la Revue de Chirurgie Orthopédique<br />
a été utilisé pour 24 genoux depuis 1982.<br />
TECHNIQUE OPÉRATOIRE. Une seule incision antérieure de<br />
18 cm. Le transplant, qui a 28 cm de long, comporte le tiers interne<br />
du tendon rotulien, une baguette rotulienne et le tendon quadricipital.<br />
Le bloc rotulien est fixé dans un tunnel sous le massif <strong>des</strong><br />
épines, le tendon rotulien reconstruit le LCP, le tendon quadricipital<br />
reconstruit le LCA, il traverse le condyle externe et son prolongement<br />
va jusqu’au Gerdy. L’os est bloqué mais on peut mettre<br />
une vis. Depuis la <strong>des</strong>cription originale, on a ajouté un 2 e faisceau<br />
à la plastie externe en la dédoublant, une bandelette allant du<br />
condyle vers l’arrière du tibia (6 cas). On peut faire 2 faisceaux au<br />
LCP. Le tunnel peut être oblique en haut pour faciliter le passage<br />
du transplant derrière le tibia (il faut un transplant de 30 cm).<br />
Durée : 177 ± 39 min.<br />
LA SÉRIE. Vingt-quatre genoux (75 % d’hommes) ont été opérés<br />
(13 droits, 3 bilatéraux). Les accidents étaient survenus à<br />
23 ± 6 ans, 7 fois sur routeau sport et un au travail. Le mécanisme<br />
était inconnu 19 fois. Le délai avant opération était de 35 ± 41<br />
mois. Quatorze genoux avaient déjà subi <strong>des</strong> opérations (5 sutures,<br />
5 ligaments artificiels, 2 LCA). Trois avaient <strong>des</strong> paralysies du nerf<br />
péronier. Le tiroir antérieur radiologique en mm était respectivement,<br />
au compartiment interne et externe de : 12 ± 4et18± 5etle<br />
tiroir postérieur de : 17 ± 4et12± 6. La laxité externe était importante<br />
17 fois, la laxité interne 7 fois et mixte 11 fois. Le recurvatum<br />
était anormal 5 fois. On a ajouté <strong>des</strong> gestes spécifiques en fonction<br />
de la laxité : 3 retensions de l’insertion du ligament externepoplité,<br />
3 retensions de la capsule postérieure au fémur, 7 retensions<br />
internes au fémur. Une suture méniscale et 4 régularisations.<br />
On a mobilisé <strong>les</strong> genoux et autorisé l’appui avec une attelle, sauf<br />
en cas de reconstruction fragile ou d’ostéotomie associée (5 cas).<br />
RÉSULTATS. Au recul moyen de 4,5 ans (1-20), la flexion était<br />
de 130 ± 11 et <strong>les</strong> résultats fonctionnels étaient convenab<strong>les</strong>, sauf<br />
dans 3 cas, avec reprise de l’activité professionnelle, mais peu
3S102 78 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
d’activité sportive. Aucun patient ne dit regretter cette opération.<br />
Le gain moyen sur le tiroir antérieur n’était que de 5 mm dans <strong>les</strong> 2<br />
compartiments et sur le tiroir postérieur, de 6 mm en dedans et de<br />
3 mm en dehors. La laxité périphérique a été mieux corrigée.<br />
DISCUSSION. La littérature est muette sur la reconstruction<br />
<strong>des</strong> croisés au stade chronique.<br />
Notre expérience, même si elle est limitée, a le mérite d’avoir 20<br />
ans de recul. Les enseignements sont précieux et on peut améliorer<br />
<strong>les</strong> résultats en faisant 2 faisceaux au LCP, en multipliant <strong>les</strong> gestes<br />
périphériques en particulier 2 plasties du côté externe et <strong>des</strong> plasties<br />
internes et en faisant <strong>des</strong> ostéotomies.<br />
CONCLUSION. Les cas de rupture ancienne <strong>des</strong> 2 croisés sont<br />
rares et leur prise en charge n’est pas codifiée. Plutôt que de faire<br />
<strong>des</strong> reconstructions <strong>des</strong> 2 croisés avec <strong>des</strong> transplants et <strong>des</strong> incisions<br />
distincts, comme cela est possible avec <strong>des</strong> techniques classiques,<br />
on a proposé une technique avec une voie d’abord, un seul<br />
transplant et <strong>des</strong> plasties périphériques en fonction de l’analyse<br />
radiologique de la laxité.<br />
*J.-L. Lerat, Centre Hospitalier Lyon-Sud,<br />
165, chemin du Grand-Revoyet, 69495 Pierre-Bénite Cedex.<br />
175 Ligamentoplastie synthétique dans<br />
<strong>les</strong> lésions récentes isolées ou<br />
combinées du ligament croisé postérieur<br />
: à propos de 14 cas<br />
P. BRUNET*, O. CHARROIS, P.BOISRENOULT,<br />
R. DEGEORGES, P.BEAUFILS<br />
INTRODUCTION. Le traitement <strong>des</strong> lésions récentes du ligament<br />
croisé postérieur (LCP) est mal codifié. Les éléments décisionnels<br />
pour une éventuelle chirurgie sont l’âge, l’activité,<br />
l’importance de la laxité et l’existence de lésions combinées. La<br />
réparation du LCP peut faire appel à la suture, la reconstruction par<br />
autogreffe ou allogreffe, ou une plastie synthétique. Le but de cette<br />
étude était d’analyser <strong>les</strong> résultats de la reconstruction synthétique<br />
dans <strong>les</strong> gran<strong>des</strong> laxitées fraîches isolées ou combinées du LCP<br />
(tria<strong>des</strong>, penta<strong>des</strong> ou luxations). Hypothèse : le ligament synthétique<br />
sert de tuteur à la cicatrisation dirigée du ligament rompu.<br />
MATÉRIEL. Quatorze patients consécutifs (âge moyen 27 ans,<br />
1 femme et 13 hommes) ont été revus rétrospectivement : 3 ruptures<br />
isolées du LCP (laxité > 15 mm), 6 laxités combinées (médiale<br />
ou latérale) et 5 luxations. La laxité postérieure moyenne était de<br />
24 mm.<br />
MÉTHODE. L’intervention a été réalisée entre le 3 e et 50 e jour,<br />
7 fois par arthroscopie, 7 fois par arthrotomie. Le ligament synthétique<br />
était le LARS (ligament polyester), (diamètre 6 ou 8 mm-1<br />
ou 2 faisceaux). Toutes <strong>les</strong> lésions associées ont été réparées dans<br />
le même temps à l’exception d’un LCA et d’un PAPE opérés<br />
secondairement. Le recul moyen est de 36 mois (10-88 mois). <strong>Tous</strong><br />
<strong>les</strong> patients ont été revus à l’exception d’un patient contacté par<br />
questionnaire. Les genoux ont été évalués selon l’IKDC et la laxité<br />
mesurée par Telos.<br />
RÉSULTATS. Cinq raideurs du genou ont nécessité une mobilisation<br />
ou une arthrolyse arthroscopique. Une rupture secondaire<br />
objectivée en arthroscopie est survenue à distance à l’occasion<br />
d’un nouveau traumatisme. Subjectivement, 2 patients étaient très<br />
satisfaits, 8 satisfaits, 3 déçus. Les mobilités fina<strong>les</strong> étaient :<br />
6/0/130. Un tiroir postérieur clinique direct était présent dans 12<br />
cas : la différentielle au Telos était mesuré à8mm(24mmen<br />
préopératoire). Le score IKDC global était : A : 0 ; B : 7 ; C : 3 ;<br />
D : 2. La persistance d’une laxité postérieure était l’élément péjoratif<br />
du score. Les résultats étaient moins bons sur tous <strong>les</strong> items<br />
pour <strong>les</strong> laxités postéro-latéra<strong>les</strong>. Il n’y avait pas de différence<br />
entre 1 ou 2 faisceaux.<br />
DISCUSSION. Nous n’avons pas observé de morbidité propre<br />
au ligament synthétique (synovite, rupture spontanée). Le gain sur<br />
la laxité postérieure est très important. Les résultats dépendent <strong>des</strong><br />
lésions associées en particulier latéra<strong>les</strong> (raideur, score IKDC)<br />
plus que de la technique de réparation du LCP. Le ligament synthétique<br />
semble avoir joué son rôle de tuteur : 1 faisceau unique et<br />
de diamètre 6 mm est suffisant.<br />
CONCLUSION. Cette technique qui épargne le capital tendineux,<br />
nous paraît pouvoir être proposée dans <strong>les</strong> gran<strong>des</strong> laxités<br />
récentes du LCP. Un suivi à plus long terme est nécessaire pour<br />
confirmer la stabilisation de la laxité.<br />
*P. Brunet, Service de Chirurgie Orthopédique,<br />
Hôpital André-Mignot, 177, rue de Versail<strong>les</strong>,<br />
78150 Le Chesnay.<br />
176 Fiabilité de l’arthromètre KT1000<br />
dans la mesure de la laxité antérieure<br />
du genou : analyse comparative<br />
avec le Telos portant sur 147<br />
patients<br />
P. BOYER*, P. DJIAN, P.CHRISTEL<br />
INTRODUCTION. Le but de cette étude est de comparer la<br />
fiabilité et la reproductibilité <strong>des</strong> mesures de laxité antérieure du<br />
genou réalisées à l’arthromètre KT1000 (Medmetric) et radiologiquement<br />
au Telos. Ce dernier a été pris comme référence.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Les critères d’inclusion étaient<br />
une laxité antérieure différentielle préopératoire inférieure à 10<br />
mm, un genou controlatéral sain, une chirurgie intra-articulaire.<br />
Entre le 1/01/2000 et le 31/10/2001, 147 patients ont été opérés<br />
d’une laxité antérieure par un transplant libre. Pour chaque patient,<br />
<strong>les</strong> mesures ont été faites sur <strong>les</strong> deux genoux en comparatif avant<br />
et au recul moyen de 16 mois après reconstruction du LCA. Le<br />
KT1000 a été mesuré à 67N, 89N, 134N et en mode manuel<br />
maximum. Le Telos a été réalisé à 150 newtons selon <strong>les</strong> recommandations<br />
du fabriquant. Une mesure de laxité différentielle<br />
supérieure ou égale à3mmétait retenue comme pathologique<br />
pour le KT1000 et à5mmpour le Telos. Nous avons également<br />
évalué la reproductibilité intra-observateur expérimenté aux deux<br />
appareils sur <strong>les</strong> 147 genoux sains par <strong>des</strong> mesures de la laxité en<br />
pré et postopératoire.<br />
RÉSULTATS. La laxité différentielle moyenne préopératoire au<br />
KT1000 était de 4,2 ± 2,4 mm à 89N et de 6,3 ± 3,1 mm en mode<br />
manuel maximum. Au Telos, elle était de 7,7 ± 3,4 mm. La laxité<br />
différentielle moyenne postopératoire au KT1000 était de
2,4 ± 2,2 mm à 89N et de 2,6 ± 2,5 mm en mode manuel maximum.Au<br />
Telos, elle était de 3 ± 3,6 mm. La dispersion <strong>des</strong> valeurs<br />
au Telos est plus importante que celle mesurée au KT1000 avec<br />
p < 0,03. La sensibilité au Telos est de 72 % avec 28 % de faux<br />
négatifs.Avec le KT1000, la sensibilité s’améliore avec l’augmentation<br />
de la traction. Elle est de 65 % à 89N, 73 % à 134N et de<br />
92 % en mode manuel maximum. Pour un genou sain, <strong>les</strong> mesures<br />
de laxité antérieure par un observateur expérimenté sont reproductib<strong>les</strong><br />
au KT1000 avec p = 0,04 et kappa = 7,8.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. Les résultats de la sensibilité<br />
et de la reproductibilité ainsi que la faible dispersion <strong>des</strong><br />
valeurs concluent à la fiabilité du KT1000 dans l’analyse de la<br />
laxité antérieure du genou. Son utilisation en routine est recommandée<br />
compte-tenu du bon rapport bénéfice-coût. En revanche la<br />
faible sensibilité et le nombre de faux négatifs amènent à s’interroger<br />
sur le choix du Telos comme technique de référence.<br />
*P. Boyer, Service d’Orthopédie et de Traumatologie,<br />
Hôpital Bichat, 46, rue Henri-Huchard, 75018 Paris.<br />
177 Les ruptures bilatéra<strong>les</strong> du ligament<br />
croisé antérieur<br />
N. GRAVELEAU*, B. SONNERY-COTTET,<br />
J.-P. HAGER, J.BARTH, P.CHAMBAT<br />
INTRODUCTION. Les ruptures bilatéra<strong>les</strong> du LCA sont classiquement<br />
décrites comme pouvant émailler <strong>les</strong> suites d’une première<br />
rupture. Peu de séries font état <strong>des</strong> mécanismes de leur<br />
survenue, de leur fréquence et <strong>des</strong> facteurs morphologiques prédisposants.<br />
MATÉRIEL. Notre étude rétrospective sur la période 1984-<br />
2001, porte sur 3 722 ligamentoplasties du LCA, dont 148 patients<br />
opérés <strong>des</strong> 2 côtés. Dans ce groupe, nous avons détaillé <strong>les</strong> caractéristiques<br />
de la population, <strong>les</strong> délais entre <strong>les</strong> ruptures et <strong>les</strong> actes<br />
chirurgicaux, le type de pratique sportive et nous nous sommes<br />
intéressés à la mesure radiologique de la pente tibiale.<br />
RÉSULTATS. La fréquence estimée de ces ruptures bilatéra<strong>les</strong><br />
est de 4 %. Nous avons noté pour cette association lésionnelle :<br />
une prédominance masculine (60 %), un âge moyen de 21 ans<br />
(± 5,5 ans) lors de la première rupture, plus précoce chez <strong>les</strong> femmes,<br />
et de 24,5 ans pour la seconde rupture (± 6,5 ans), une pratique<br />
dominante <strong>des</strong> sports en pivot sans contact (56 %) et de compétition.<br />
Le délai entre <strong>les</strong> deux ruptures du LCA était de 48 mois<br />
en moyenne. Le taux de rupture controlatérale était de 16 % au<br />
cours de la première année postopératoire et de 40 % après 3 ans.<br />
La pente tibiale moyenne était de 9,91 (± 2,87) contre 6,8 (± 1,87)<br />
dans une population de référence.<br />
DISCUSSION. Nous confirmons <strong>les</strong> données de la littérature<br />
sur la fréquence, l’âge jeune de survenue en particulier chez la<br />
femme, le délai court entre <strong>les</strong> deux ruptures et le type de pratique<br />
sportive. Le taux élevé de ruptures controlatéra<strong>les</strong> au cours de la<br />
première année est préoccupant. Les hypothèses évoquées sont<br />
une perte de confiance dans le genou opéré avec report <strong>des</strong> sollicitations<br />
sur le genou controlatéral mais aussi une désadaptation du<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S103<br />
genou sain à la pratique sportive. Un travail proprioceptif bilatéral<br />
au cours de la rééducation, un respect <strong>des</strong> délais de reprise du sport<br />
ainsi qu’un bon contrôle de la laxité par une plastie « anatomique »<br />
apparaissent comme <strong>les</strong> facteurs préventifs de la rupture controlatérale.<br />
Si le rôle favorisant de l’étroitesse de l’échancrure intercondylienne<br />
a été établi dans la littérature, nous montrons qu’une<br />
pente tibiale importante doit également être prise en considération.<br />
CONCLUSION. La fréquence de ces ruptures bilatéra<strong>les</strong> du<br />
LCA doit inciter à la recherche de facteurs prédisposants, à adapter<br />
le programme de rééducation et à informer le patient de ce risque.<br />
Nous pourrions ainsi diminuer l’incidence de cette complication<br />
relativement fréquente.<br />
*N. Graveleau, Secrétariat du Docteur Pierre Chambat,<br />
12, cours Albert-Thomas, 69003 Lyon.<br />
178 Traitement <strong>des</strong> tendinopathies rotuliennes<br />
chez <strong>les</strong> sportifs<br />
M. ZRIG*, T. AMMARI, H.ANNABI, M.R.CHÉRIF,<br />
M. TRABELSI, M.M’BAREK, H.BEN HASSINE,<br />
M. MONGI<br />
INTRODUCTION. La tendinopathie rotulienne est une pathologie<br />
fréquente qui guérit dans la majorité <strong>des</strong> cas par un traitement<br />
fonctionnel si elle est prise en charge à la phase de début.<br />
MATÉRIELS ET MÉTHODES. Les auteurs rapportent l’expérience<br />
de treize sportifs de haut niveau opérés pour une tendinopathie<br />
rotulienne chronique dans une étude rétrospective. La radiographie,<br />
l’échographie et l’IRM ont visualisé <strong>les</strong> tendons<br />
pathologiques. Ainsi quatre <strong>des</strong> patients souffraient d’une tendinopathie<br />
d’insertion, <strong>les</strong> neuf autres d’une tendinopathie du corps<br />
du tendon rotulien. Six patients avaient un conflit fémoro patellaire<br />
associé qui a bien été objectivé par l’arthro scanner. L’indication<br />
chirurgicale a été posée devant un handicap sportif total (stade<br />
III-bis de Blazina) après échec du traitement fonctionnel. Le traitement<br />
chirurgical consistait en un peignage systématique du tendon<br />
avec résection <strong>des</strong> lésions dégénératives. Les quatre patients<br />
porteurs d’une tendinopathie d’insertion ont bénéficié d’une<br />
résection de la pointe de la rotule. Les six patients qui avaient un<br />
conflit fémoro patellaire ont eu une libération externe associée<br />
dans un cas plus sévère à une translation avancement de la tubérosité<br />
tibiale antérieure.<br />
RÉSULTATS. Les résultats ont été jugés bons dans cinq cas et<br />
très bons dans huit cas avec un recul moyen actuel à 36 mois.<br />
DISCUSSION. La place de l’échographie, premier et souvent<br />
seul examen à demander dans une tendinopathie rotulienne chronique,<br />
est indéniable dans le diagnostic et le suivi postopératoire.<br />
L’IRM doit être gardée pour <strong>les</strong> cas chirurgicaux ou posant un<br />
problème diagnostique. Les bénéfices du traitement chirurgical ne<br />
sont plus à démontrer lorsque, initialement, l’indication a bien été<br />
posée. Il nous paraît logique et nécessaire de traiter dans le même<br />
temps opératoire le conflit fémoro patellaire.<br />
*M. Zrig, Service d’Orthopédie, Hôpital Aziza Othmana,<br />
place de la Kasba, 1008 Tunis, Tunisie.
3S104 78 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
180 Lésions par blast de la première<br />
commissure : classifications et stratégie<br />
thérapeutique<br />
B. COULET*, M. CHAMMAS, F.LACOMBE,<br />
P.-A. DAUSSIN, Y.ALLIEU<br />
INTRODUCTION. Les lésions de la main par blast résultent le<br />
plus souvent de manipulations artisana<strong>les</strong> de mélanges explosifs<br />
instab<strong>les</strong>. Le blast induit <strong>des</strong> lésions majeures de la première commissure.<br />
Cette étude a pour but de définir une classification de ces<br />
lésions débouchant sur une stratégie thérapeutique.<br />
MATÉRIEL. De 1998 à 2002, nous avons pu prendre en charge<br />
9 mains (dominantes 5/9) de blast chez 8 patients d’âge moyen 24<br />
ans. L’étiologie était 5 fois la fabrication artisanale de pétards et 4<br />
fois la manipulation de munition.<br />
MÉTHODE. Cinq mains présentaient une amputation du pouce<br />
associée dans 3 cas à celle de l’index voire du médius. Seul 1 pouce<br />
a pu être revascularisé avec succès. Deux amputations proxima<strong>les</strong><br />
du pouce ont bénéficié d’un transfert d’orteil de type twisted toe.<br />
Chez un de ces patients, le transfert avait été préparé par une<br />
translocation de M2 sur M1 manchonnée par un lambeau inguinal.<br />
Deux patients ont nécessité une reconstruction composite ostéocutanée<br />
de M1 en utilisant l’index comme doigt banque. Enfin, un<br />
cas présentait <strong>des</strong> lésions limitées aux parties mol<strong>les</strong>.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. Les mains de blast associent<br />
: lésions étendues <strong>des</strong> téguments, atteinte vasculaire diffuse<br />
rendant <strong>les</strong> revascularisations aléatoires, lésions combinées <strong>des</strong><br />
musc<strong>les</strong> thénariens et de l’articulation TM conduisant spontanément<br />
à une fermeture secondaire de la première commissure. Nous<br />
distinguons ainsi 3 grands sta<strong>des</strong> lésionnels : stade 1, lésions seulement<br />
musculaires et cutanées. Après l’ouverture de la première<br />
commissure par un brochage M1-M2 la couverture est assurée par<br />
un lambeau de type inter-osseux postérieur, voire une greffe cutanée<br />
; stade 2, lésions ostéo-articulaires : à <strong>des</strong> pertes de substance<br />
osseuse touchant M1 et P1 s’associent de fréquentes dislocations<br />
de la TM. La reconstruction osseuse utilisera souvent l’index<br />
comme « doigt banque » amputaté distalement ou siège de lésions<br />
majeures ; stade 3, amputation ou dévascularisation du pouce, ces<br />
cas posent le problème de la reconstruction du pouce. En cas<br />
d’amputations dista<strong>les</strong> en aval de la MP, seront proposés un allongement<br />
de M1 ou un transfert d’orteil classique. En cas d’amputations<br />
proxima<strong>les</strong>, il faudra préalablement reconstruire M1 et son<br />
enveloppe cutanée par une translocation de M2 manchonnée dans<br />
un lambeau inter-osseux ou inguinal, suivie d’un transfert du<br />
second orteil ou d’un twisted toe. Les translocations sont à ce stade<br />
rendues diffici<strong>les</strong> car l’index est très souvent lésé et <strong>les</strong> téguments<br />
cicatriciels.<br />
*B. Coulet, Service de Chirurgie Orthopédique 2 et Chirurgie<br />
de la Main, CHU Lapeyronie, 34295 Montpellier Cedex 5.<br />
Séance du 12 novembre après-midi<br />
MAIN/POIGNET<br />
181 Le score radiologique initial de gravité<br />
ou SRIG : un bon moyen d’évaluation<br />
pronostique <strong>des</strong> fractures du<br />
poignet<br />
S. REIG*, P. GIOGHI, F.PRUNARETY,<br />
B. FORTUNATO, S.TERVER<br />
INTRODUCTION. Il est reconnu qu’aucune classification <strong>des</strong><br />
fractures de l’extrémité inférieure du radius n’a de valeur pronostique.<br />
Nous proposons un index de gravité basé sur la seule lecture<br />
<strong>des</strong> clichés radiologiques initiaux. Nous avons voulu tester si <strong>les</strong><br />
cinq critères radiographiques retenus sont significativement liés<br />
au résultat final. (fonctionnel, radiologique et subjectif).<br />
MATÉRIEL. L’étude porte sur 86 patients avec 91 poignets<br />
fracturés hospitalisés de janvier 1998 à mars 2000.<br />
MÉTHODE. Le score radiologique initial de gravité est un<br />
score noté sur 20 qui étudie cinq critères : comminution (étendue,<br />
aspect et localisation), impaction spongieuse (métaphysaire, épiphysaire<br />
ou <strong>les</strong> deux), fracture de l’ulna (localisation), lésion de la<br />
RUD (déviation à fracture sévère), lésions du carpe et <strong>des</strong> ligaments.<br />
Chaque item est noté de 0à4.Plus le SRIG est élevé, plus la<br />
fracture est grave. Les radiographies initia<strong>les</strong> et/ou <strong>les</strong> clichés en<br />
traction sont minutieusement analysés. La fiabilité intra et inter<br />
observateur a été prouvée. Pour pouvoir évaluer la signification<br />
pronostique du SRIG, le résultat final a été codifié suivant quatre<br />
critères : mobilité (flexion palmaire et dorsale, inclinaison radiale<br />
et ulnaire, pronosupination), radiographie finale (bascu<strong>les</strong> fronta<strong>les</strong><br />
et sagitta<strong>les</strong>, index RUD), résultat subjectif (très bon, bon,<br />
moyen ou mauvais), arthrose (une deux ou trois facettes atteintes).<br />
Le score obtenu est aussi noté sur 20 (plus le score est élevé, plus<br />
le résultat est mauvais).<br />
RÉSULTATS. La série a permis de trouver une relation statistiquement<br />
significative entre le score radiologique initial de gravité<br />
et la cotation finale du résultat.<br />
DISCUSSION. L’analyse précise a fait apparaître d’autres corrélations<br />
significatives avec le SRIG : ouverture cutanée et accident<br />
du travail sont généralement liés à de mauvais scores initiaux.<br />
Aucune relation statistiquement significative avec le sexe, l’âge,<br />
<strong>les</strong> accidents de haute ou basse énergie, <strong>les</strong> lésions associées du<br />
membres supérieur, <strong>les</strong> poly-traumatismes, l’ostéoporose et<br />
l’algodystrophie. Le résultat final quant à lui est lié statistiquement<br />
et logiquement à l’âge, l’ostéoporose, aux fractures ouvertes, mais<br />
aussi à l’algodystrophie et au degré de déplacement secondaire.<br />
CONCLUSION. Cette étude a permis de valider un score pronostique<br />
de gravité <strong>des</strong> fractures de l’extrémité inférieure du<br />
radius. Ce score est calculé uniquement sur <strong>des</strong> radiographies<br />
initia<strong>les</strong> simp<strong>les</strong> et/ou en traction. L’intérêt d’un tel score est de<br />
permettre de moduler l’agressivité du traitement que l’on propo-
sera au patient compte tenu bien sûr de leur âge et de leur demande<br />
fonctionnelle.<br />
*S. Reig, Service d’Orthopédie 2 HE, CHU,<br />
place Henri-Dunant, 63000 Clermont-Ferrand.<br />
182 Fractures du poignet par compression<br />
flexion : 96 cas revus avec un<br />
recul moyen de 5 ans<br />
A. COULIBALY*, B. DOUMANE, C.CADU,<br />
L. PIDHORZ<br />
INTRODUCTION. Les publications concernant <strong>les</strong> fractures<br />
par compression flexion sont anciennes et rarement individualisées<br />
en tant que tel<strong>les</strong>. Faisant l’objet d’un consensus sur leur<br />
traitement par plaque antérieure, leur pronostic est considéré<br />
comme bon. Nous nous proposons, dans une série rétrospective,<br />
d’en revoir la classification et d’analyser <strong>les</strong> résultats du traitement<br />
chirurgical.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. De janvier 1983 à novembre<br />
2001, 96 fractures de l’extrémité inférieure du radius à déplacement<br />
antérieur ont été traitées. Il s’agissait de 95 patients (50<br />
hommes, 45 femmes), de 42,7 ans d’âge moyen (15-88). La fracture<br />
était survenue 52 fois après un accident de la voie publique, 27<br />
patients présentaient <strong>des</strong> lésions associées. Les classifications de<br />
Castaing et Cauchoix ont été modifiées pour tenir compte dans <strong>les</strong><br />
fractures margina<strong>les</strong> antérieures simp<strong>les</strong> ou complexes (types I et<br />
II) de l’importance du fragment par rapport au milieu de la glène<br />
radiale sur <strong>les</strong> radiographies de profil et sur <strong>les</strong> clichés de face de<br />
l’atteinte associée ou non <strong>des</strong> bords du radius. La fracture de<br />
Goyrand représentait le type III, tandis que le type IV associait à<br />
cette fracture un ou plusieurs traits articulaires.<br />
Ainsi, avons nous retrouvé : 43 fractures margina<strong>les</strong> antérieures<br />
dont 27 de type II emportaient plus de 50 % de la surface articulaire,<br />
53 fractures de Goyrand pures (25 cas) ou complexes (28<br />
cas). 90 plaques ont été posées, associées 17 fois à une synthèse<br />
complémentaire. Les résultats ont tenu compte <strong>des</strong> critères cliniques<br />
de Laulan et radiologiques de Mouilleron.<br />
RÉSULTATS. La consolidation, constamment obtenue, s’est<br />
faite sans modification de la synthèse initiale, 85 fois. Il s’agissait<br />
de 49 hommes et 35 femmes d’âge moyen 40,7 ans (20-87). Les<br />
fractures de type I/II étaient retrouvées 40 fois, une fracture de<br />
Goyrand simple 23 fois, comminutive 22 fois. Au 3 e mois, la<br />
réduction était bonne dans 57 cas (67 %), moyenne dans 23 cas et<br />
mauvaise dans 5 cas. Onze déplacements secondaires sont survenus<br />
chez 8 femmes, 3 hommes d’âge moyen de 57,7 ans. Il s’agissait<br />
de 4 fractures de type I/II et de 7 fractures de Goyrand dont 6<br />
complexes. L’ostéosynthèses par plaque retenue 8 fois avait du<br />
être complétée par brochage ou fixateur. La réduction radiologique<br />
était bonne dans 2 cas (18 %), moyenne dans 3 cas et mauvaise<br />
dans 6 cas (55 %). Vingt-cinq patients (30 %) ont présenté <strong>des</strong><br />
séquel<strong>les</strong> à type de douleurs résiduel<strong>les</strong> (10 cas), de 7 syndromes<br />
du canal carpien, 4 raideurs du poignet ou <strong>des</strong> doigts, de 3 arthroses<br />
radio carpiennes et d’un névrome du rameau palmaire cutané.<br />
Au recul moyen de 61 mois (12-204 mois), 70 fractures ont un bon<br />
résultat clinique objectif, 78 fractures ne présentent aucune dou-<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S105<br />
leur. L’aspect radiographique est bon 64 fois, moyen 18 fois, mauvais<br />
5 fois.<br />
DISCUSSION. Grâce à une meilleure interprétation radiologique,<br />
<strong>les</strong> sta<strong>des</strong> II et IV, source de 3 déplacements secondaires sur 4<br />
peuvent dépistés et faire l’objet d’emblée d’une synthèse complémentaire<br />
par broches ou fixateur associée à une plaque antérieure<br />
de préférence prémoulée. Dans <strong>les</strong> autres cas, la réduction initiale<br />
s’avère satisfaisante dans 67 % <strong>des</strong> cas expliquant la bonne tolérance<br />
fonctionnelle obtenue sur le plan subjectif (89 %) et objectif<br />
(80 %). Cette série se caractérise par la rareté <strong>des</strong> séquel<strong>les</strong> et <strong>des</strong><br />
complications : poignet douloureux dans 10 % <strong>des</strong> cas, dont 2<br />
certainement secondaires à une algodystrophie.<br />
CONCLUSION. Une bonne interprétation <strong>des</strong> clichés radiologiques<br />
permet de présumer <strong>des</strong> difficultés de la réduction et<br />
d’ajouter à la plaque antérieure une synthèse complémentaire dans<br />
<strong>les</strong> types II et IV.<br />
*A. Coulibaly, Service d’Orthopédie et Traumatologie, CHU,<br />
4, rue Larrey, 49033 Angers Cedex 01.<br />
183 Brochage mixte trans-styloïdien et<br />
intrafocal dans <strong>les</strong> fractures de<br />
Pouteau-Col<strong>les</strong> : avantage sur la<br />
stabilité postopératoire comparativement<br />
à un brochage intrafocal<br />
simple<br />
R. GRAVIER*, X. FLECHER, S.PARRATTE,<br />
P. RAPAIE, J.-N. ARGENSON<br />
INTRODUCTION. Les fractures du poignet concernent souvent<br />
<strong>des</strong> personnes agées qui présentent <strong>des</strong> fractures instab<strong>les</strong> et<br />
qui ne peuvent supporter <strong>des</strong> traitements lourds. Ces fractures sont<br />
habituellement traitées par embrochage percutané intra-focal de<br />
type Kapandji. Le but de cette étude est de comparer ce traitement<br />
classique <strong>des</strong> fractures instab<strong>les</strong> extra articulaires du quart inférieur<br />
du radius à déplacement postérieur à une technique modifiée<br />
d’embrochage.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Cette étude radiologique prospective<br />
randomisée concerne 2 groupes de patients agés de 30 à 75<br />
ans ayant été hospitalisé pour le traitement chirurgical d’une fracture<br />
de Pouteau-Col<strong>les</strong>. Dans le premier groupe, tous <strong>les</strong> patients<br />
ont été traités par embrochage intra-focal classique avec une ou<br />
deux broches dorsa<strong>les</strong> et une broche externe (groupe K), et dans le<br />
deuxième groupe tous <strong>les</strong> patients ont été traités par embrochage<br />
avec une ou deux broches intra-foca<strong>les</strong> dorsa<strong>les</strong> alors que la troisième<br />
broche était mise en trans-focale (groupe KM). La prise en<br />
charge préopératoire, le mode d’anesthésie, <strong>les</strong> suites postopératoires<br />
(délai d’immobilisation de 21 jours, ablation <strong>des</strong> broches au<br />
45 e jour) étaient identiques dans <strong>les</strong> 2 groupes. Sur le plan radiologique<br />
ont été étudiés à J1, J21, J45 et au dernier recul <strong>les</strong> repères<br />
anatomiques suivants : inclinaison radiale de face et de profil,<br />
ligne bi-styloïdienne.<br />
RÉSULTATS. Le groupe K comportait 49 patients d’âge moyen<br />
45 ans et le groupe KM 46 patients d’âge moyen 54 ans. Aucune<br />
différence statistique n’a été retrouvée concernant l’âge, le sexe, le
3S106 78 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
côté et le type de fracture entre <strong>les</strong> 2 groupes. L’inclinaison radiale<br />
de face était respectivement de 19,2 (10 à 27) pour le groupe KM et<br />
de 23,2 (19 à 30) pour le groupe K. L’inclinaison radiale de profil<br />
était de 0 (-11 à 20) pour le groupe KM et de -5,7 (-25 à 2) pour le<br />
groupe K et la proportion de lignes bistyloïdiennes considéreés<br />
satisfaisantes était comparable dans <strong>les</strong> deux groupes.<br />
DISCUSSION ET CONCULSION. L’embrochage intra-focal<br />
peut montrer certaines limites dans le maintien de la réduction<br />
jusqu’à obtention de la consolidation. La technique de Kapandji<br />
modifiée avec l’emploi d’une broche trans-styloïdienne semble<br />
permettre une meilleure stabilisation <strong>des</strong> fractures instab<strong>les</strong> du<br />
quart inférieur du radius, en particulier dans la population plus<br />
âgée, qui supporte mal <strong>des</strong> traitements chirurgicaux. Cette étude<br />
préliminaire nécessite néanmoins une étude radioclinique sur un<br />
plus grand nombre de patients pour confirmer ces résultats.<br />
*R. Gravier, Service de Chirurgie Orthopédique,<br />
Hôpital Sainte Marguerite, 270, boulevard de<br />
Sainte-Marguerite, 13009 Marseille.<br />
184 Conflit ulno-lunaire posttraumatique<br />
: place de l’arthroscopie<br />
C. MATHOULIN*, A. PAGNOTTA<br />
INTRODUCTION. Les conflits ulno-lunaires secondaires à <strong>des</strong><br />
séquel<strong>les</strong> de fractures du radius sont dus à l’inversion de l’index<br />
radio-ulnaire distal par raccourcissement relatif du radius avec un<br />
conflit entre la tête de l’ulna et la face articulaire proximale du<br />
semi-lunaire entraînant une altération <strong>des</strong> surfaces cartilagineuses.<br />
L’arthroscopie du poignet permet souvent le diagnostic et le<br />
traitement de façon peu invasive.<br />
MATÉRIEL. Nous avons une série de 32 patients. Il s’agissait<br />
de 15 hommes pour 17 femmes. L’âge moyen était de 66 ans (entre<br />
45 et 82 ans). Il s’agissait toujours de séquel<strong>les</strong> de fractures du 1/4<br />
inférieur du radius avec tassement dans l’axe. La variance ulnaire<br />
était en moyenne de 2,7 mm (entre 2 et 5 mm). Le délai entre la<br />
fracture initiale et la résection arthroscopique était de 9 mois (entre<br />
2 et 26 mois). Les douleurs étaient toujours présentes,<br />
permanentes-modérées dans 19 cas et invalidantes dans 13 cas. La<br />
force musculaire était globalement diminuée de plus de la moitié<br />
par rapport au côté opposé. Les mobilités étaient déjà limitées du<br />
fait du cal vicieux souvent associé à la suite de ces fractures du 1/4<br />
inférieur du radius.<br />
MÉTHODE. Les patients étaient opérés sous garrot pneumatique<br />
et anesthésie loco-régionale en chirurgie ambulatoire. L’arthroscope<br />
est mis en place par une entrée 3-4 radio carpienne permettant<br />
l’exploration de l’articulation. Le traitement chirurgical<br />
consiste en une résection partielle distale de la tête ulnaire à l’aide<br />
d’une fraise pénétrant par une entrée 6R radio carpienne. La mobilité<br />
du poignet était libre dans tous <strong>les</strong> cas.<br />
RÉSULTAT. Notre recul moyen est de 39 mois (entre 18 et 54<br />
mois). La récupération de la mobilité a été immédiate dans tous <strong>les</strong><br />
cas avec la persistance de douleurs au niveau de l’articulation<br />
radio-ulnaire dans 2 cas. Dans 26 cas, <strong>les</strong> douleurs pré-opératoires<br />
ont disparu en post-opératoire immédiat. La force musculaire a<br />
augmenté par rapport au pré-opératoire mais n’est jamais revenu<br />
au niveau du côté sain.<br />
CONCLUSION. Le traitement arthroscopique du conflit ulnolunaire<br />
a fait la preuve de son efficacité et de son innocuité. Il doit<br />
néanmoins être réservé à <strong>des</strong> inversions de l’index radio-ulnaire<br />
distal inférieures à 5 mm. En cas de variances ulnaires plus importantes,<br />
nous préférons l’ostéotomie de raccourcissement de l’ulna.<br />
Les autres techniques seront réservées dans <strong>les</strong> cas où l’articulation,<br />
radio-ulnaire distale est altérée.<br />
*C. Mathoulin, Clinique Jouvenet,<br />
6, Square Jouvenet, 75016 Paris.<br />
185 Résultats à 4 ans du traitement<br />
d’une série de 16 luxations transscapho-rétrolunaires<br />
du carpe<br />
récentes<br />
S. SLIMANI*, S. BARBARY, P.PASQUIER, F.DAP,<br />
G. DAUTEL<br />
INTRODUCTION. Les luxations trans-scapho-rétrolunaires<br />
représentent la plus fréquente <strong>des</strong> dislocations périlunaire du carpe<br />
(65 % selon Herzberg) dont le traitement reste controversé. Le but<br />
de cette étude est d’analyser <strong>les</strong> résultats fonctionnels d’une série<br />
homogène de 15 patients traités par réduction et ostéosynthèse à<br />
ciel ouvert.<br />
MATÉRIELS ET MÉTHODES. C’est une étude rétrospective<br />
sur 15 hommes, d’âge moyen 34 ans, avec un recul moyen de 4 ans.<br />
L’évaluation clinique est réalisée grâce au clinical scoring chart<br />
(Cooney). L’analyse radiographique est effectuée sur <strong>les</strong> deux<br />
poignets, en statique et en dynamique. Les luxations regroupent : 9<br />
cas de type I, 5 de type IIa et 1 de type III selon la classification<br />
d’Alnot. Les fractures du scaphoïde regroupent : 13 cas de type III<br />
et IV, 2 de type II. L’abord fut dorsal 6 fois, antero externe 4 fois et<br />
double 5 fois. Sept fois, le canal carpien a été ouvert. La fracture du<br />
scaphoïde fut brochée 11 fois, vissée 4 fois associé à une greffe<br />
corticospongieuse 5 fois. Le carpe fut synthesé 7 fois par brochage<br />
scapho-lunaire, 7 fois par brochage luno-triquetral, 3 fois par un<br />
brochage radio-lunaire.<br />
RÉSULTATS. Le score moyen est de 70 % ± 20 avec une<br />
flexion moyenne à 50 ± 17 et 54 ± 20 en extension. La poigne au<br />
Jamar est de 32/45 ± 11. Le pince pouce-index est à 14 ± 5,1. La<br />
douleur est négligeable dans 33 % <strong>des</strong> cas, invalidante dans 17 %<br />
<strong>des</strong> cas. Les douleurs climatiques existent dans 50 % <strong>des</strong> cas.<br />
L’activité professionnelle fut reprise dans 75 % <strong>des</strong> cas. L’analyse<br />
radiographique retrouve : Une ostéonécrose du lunatum, 2 du pôle<br />
proximal du scaphoïde et 3 pseudarthroses du scaphoïde, 4 arthroses<br />
radio carpiennes, 1 SLAC (scapho lunate <strong>les</strong>ion advanced<br />
collaps) et2SNAC(scaphoid non union advanced collaps).<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. Nos résultats sont modérément<br />
inférieurs aux séries de la littérature dans l’évaluation de la<br />
mobilité. En revanche<strong>les</strong> séquel<strong>les</strong> douloureuses, la durée d’arrêt<br />
de travail et le pourcentage de reclassement professionnel sont<br />
identiques aux chiffres de la littérature. Notre étude montre <strong>des</strong><br />
résultats radiographiques favorab<strong>les</strong> avec 13 % d’arthrose radio<br />
carpienne (38 % <strong>des</strong> cas pour Herzberg en 12/2002 au recul de 96
mois). La stabilité de l’ostéosynthèse du scaphoïde reste capitale<br />
(2 pseudarthroses sur 4 ostéosynthèses par mono-broche). Une<br />
nouvelle analyse à distance sera intéressante pour apprécier le<br />
potentiel arthrogène.<br />
*S. Slimani, Service de Chirurgie Plastique et Reconstructrice<br />
de l’Appareil Locomoteur, CHU de Nancy,<br />
Hôpital Jeanne-d’Arc, 54000 Nancy.<br />
186 Greffes ostéo-cartilagineuses scaphoïdiennes<br />
: résultats préliminaires<br />
D. LEPAGE*, L. OBERT, F.GIVRY, P.CLAPPAZ,<br />
P. GARBUIO, Y.TROPET<br />
OBJECTIF. Les auteurs rapportent leur expérience <strong>des</strong> autogreffes<br />
ostéochondra<strong>les</strong> costa<strong>les</strong> au niveau du scaphoïde dans le<br />
traitement de l’arthrose radio-scaphoïdienne, compliquant une<br />
pseudarthrose ou une dissociation scapho-lunaire chronique.<br />
MATÉRIEL. Neuf patients ont bénéficié de cette technique<br />
entre 1994 et 2001 (8 hommes, 1 femme), âge moyen 45 ans<br />
(26-62 ans).<br />
TECHNIQUE. Les 2/3 proximaux du scaphoïde sont excisés.<br />
Une greffe ostéo-cartilagineuse est prélevée sur la 9 e côte adaptée<br />
après remodelage à la cavité de scaphoïdectomie puis, fixée à la<br />
base du scaphoïde par une broche de Kirchner.<br />
RÉSULTATS. Le recul moyen à la révision est de 2,5 ans. <strong>Tous</strong><br />
<strong>les</strong> patients ont été améliorés de façon importante de leurs douleurs.<br />
La force est de 80 % en moyenne par rapport au côté non<br />
opéré. Le secteur moyen de mobilité du poignet en flexion extension<br />
est de 91° (70°-150°).<br />
CONCLUSION. Cette technique dont <strong>les</strong> premiers résultats<br />
sont encourageants en terme de restauration de la force et de la<br />
mobilité du poignet est une alternative intéressante aux techniques<br />
conventionnel<strong>les</strong>.<br />
*D. Lepage, Service de Traumatologie, CHU Jean-Minjoz,<br />
4, boulevard Fleming, 25000 Besançon.<br />
187 Étude rétrospective de 58 pseudarthroses<br />
du scaphoïde carpien<br />
traitées par greffe corticospongieuse<br />
simple au recul de 106<br />
mois<br />
C. CHANTELOT*, C. FREBAULT, M.LIMOUSIN,<br />
G. ROBERT, H.MIGAUD, C.FONTAINE<br />
INTRODUCTION. Le but de cette étude rétrospective était de<br />
préciser : <strong>les</strong> facteurs influençant <strong>les</strong> résultats <strong>des</strong> greffes corticospongieuse<br />
pour le traitement <strong>des</strong> pseudarthroses du scaphoïde<br />
carpien afin d’en préciser <strong>les</strong> indications idéa<strong>les</strong>.<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S107<br />
PATIENTS ET MÉTHODES. Entre 1984 et 1999, 103 patients<br />
ont bénéficié d’une greffe de ce type dans notre institution, mais<br />
seulement 57 ont été revus et analysés (58 pseudarthroses). Le<br />
recul moyen était de 106 mois. L’âge moyen était de 36 ans. Pour<br />
45 patients, la pseudarthrose faisait suite à une méconnaissance du<br />
diagnostic. Selon la classification de Schernberg, la localisation<br />
<strong>des</strong> pseudarthroses était 11 fois en zone II, 40 fois en zone III et 7<br />
fois en zone IV. Le temps écoulé entre la fracture et la prise en<br />
charge était en moyenne de 35 mois. Les sta<strong>des</strong> de pseudarthrose<br />
se répartissaient (classification Alnot) en : Stade I (13), Stade IIA<br />
(20), Stade IIB (22), Stade IIIA (2) et Stade IIIB (1). La prise de<br />
greffe a été réalisée 50 fois au dépend du bassin. Une ostéosynthèse<br />
était associée à la greffe 33 fois sur <strong>les</strong> 58 cas. L’immobilisation<br />
post-opératoire était en moyenne de 2,7 mois. La consolidation<br />
a été obtenue en moyenne au bout de 3 mois.<br />
RÉSULTATS. Trente-six patients étaient très satisfaits, 18 satisfaits<br />
et 4 non satisfaits. Vingt-sept patients ont présenté <strong>des</strong> douleurs<br />
importantes sur la prise de greffe lorsque celle était pratiquée<br />
sur le bassin (50 cas). La mobilité du poignet était en moyenne de<br />
56,2 en flexion, 56 en extension, 83 en supination, pronation 83, 11<br />
en inclinaison radiale, 32,7 en inclinaison ulnaire. L’opposition du<br />
pouce était en moyenne de 9,4/10 et la contre-opposition en<br />
moyenne de 4. L’indice de hauteur du carpe était en moyenne de<br />
0,547. L’angle radio-lunaire était en moyenne de 4,8. Vingt poignets<br />
avaient une déformation en DISI. Trente-six patients (62 %)<br />
ne présentaient pas ou peu d’arthrose. Le taux de consolidation<br />
était de 81 %, mais 11 pseudarthroses n’ont pas consolidé dont 7<br />
nécroses du pôle proximal. L’absence de correction d’une déformation<br />
en DISI au moment de la greffe favorisait l’apparition<br />
d’une arthrose radio-carpienne. L’existence d’une nécrose associée<br />
favorisait la persistance de la pseudarthrose. L’utilisation<br />
conjointe d’une ostéosynthèse n’améliorait pas le taux de consolidation.<br />
DISCUSSION. Le traitement <strong>des</strong> pseudarthrose du scaphoïde<br />
par greffe cortico-spongieuse reste un traitement de choix assurant<br />
81 % de consolidation. La prise de greffe doit se faire sur l’épiphyse<br />
radiale afin de limiter <strong>les</strong> séquel<strong>les</strong> douloureuses. Cette<br />
intervention peut être pratiquée en cas de déformation en DISI<br />
sous peine de corriger celle-ci, mais on doit lui préférer <strong>les</strong> greffes<br />
vascularisées en cas de nécrose du pole proximal du scaphoïde.<br />
*C. Chantelot, Service d’Orthopédie B,<br />
Hôpital Roger-Salengro, CHRU de Lille, 59037 Lille.<br />
188 Revascularisation du semi lunaire<br />
dans <strong>les</strong> nécroses de Kienböck par<br />
un greffon osseux vascularisé en<br />
îlot prélevé sur la face antérieure du<br />
radius : résultat après trois ans<br />
minimum de recul<br />
C. MATHOULIN*, A. GALBIATTI, M.HAERLE<br />
INTRODUCTION. Nous rapportons notre expérience de l’utilisation<br />
d’un greffon osseux vascularisé prélevé sur la face antérieure<br />
du radius pour le traitement de la maladie de Kienböck avec<br />
un recul moyen de 67 mois et minimum de 3 ans.
3S108 78 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
MATÉRIEL. Nous avons traité 22 patients porteurs d’une maladie<br />
de Kienböck. Il s’agissait de 8 femmes pour 14 hommes. L’âge<br />
moyen était de 31,4 ans (entre 18 et 63 ans). La douleur était<br />
toujours présente, invalidante dans 19 cas. Après la réalisation<br />
d’une tomodensitométrie et d’une IRM systématique dans tous <strong>les</strong><br />
cas et selon la classification de BÜCHLER, nous avions 8 stade II,<br />
10 stade IIIA et 4 stade IIIB.<br />
MÉTHODE. L’artère transverse antérieure du carpe naît de<br />
l’artère radiale et vascularise la partie interne de l’épiphyse<br />
radiale. Par la même voie d’abord antérieur il était possible prélever<br />
le greffon osseux pédiculé sur cette artère et de le placer dans le<br />
semi-lunaire pour revascularisation. Un raccourcissement du<br />
radius était réalisé dans tous <strong>les</strong> cas ainsi qu’une immobilisation<br />
jusqu’à consolidation du radius.<br />
RÉSULTATS. Notre recul moyen est de 67 mois (entre 36 et 104<br />
mois). Les douleurs ont totalement disparu dans 20 cas. Deux cas<br />
présentaient encore <strong>des</strong> douleurs modérées tolérab<strong>les</strong>. La mobilité<br />
moyenne active était supérieure à 71°. Le délai moyen de retour à<br />
ces activités antérieures était de 3,5 mois. La réalisation d’une<br />
IRM post opératoire, à plus de 8 mois en moyenne, a montré 16<br />
revascularisations complète du semi lunaire, 5 stabilisations <strong>des</strong><br />
lésions et 1 échec qui a nécessité un geste palliatif secondaire.<br />
Nous avons eu 4 retards de consolidation de l’ostéotomie du radius<br />
et une algoneurodystrophie. Il y avait une corrélation directe entre<br />
le stade de la maladie de Kienböck et le résultat final.<br />
CONCLUSION. L’utilisation d’une greffe osseuse vascularisée<br />
prélevée sur la face antérieure du radius pour la revascularisation<br />
du semi-lunaire associée à un raccourcissement du radius, a<br />
donné <strong>des</strong> résultats encourageants. Une étude à plus long terme<br />
sera nécessaire.<br />
*C. Mathoulin, Clinique Jouvenet,<br />
6, Square Jouvenet, 75016 Paris.<br />
189 Trapézectomie totale et ligamentoplastie<br />
de stabilisation du premier<br />
rayon sous arthroscopie : étude<br />
cadavérique sur 12 sujets<br />
S. DURAND*, P. THOREUX, O.GAGEY,<br />
A.-C. MASQUELET<br />
INTRODUCTION. L’arthrose trapézo-métacarpienne est une<br />
pathologie fréquente chez la femme après 50 ans. Le traitement<br />
devient chirurgical après échec d’un traitement médical bien<br />
conduit. Lorsque le stock osseux trapézien est insuffisant pour<br />
envisager la mise en place d’une prothèse totale, la trapézectomie<br />
totale permet de supprimer le conflit douloureux. Elle est le plus<br />
souvent associée à une ligamentoplastie de stabilisation du premier<br />
rayon. Le but de cette étude est de démontrer la faisabilité de<br />
cette intervention sous arthroscopie et d’en préciser la technique et<br />
<strong>les</strong> limites.<br />
MATÉRIEL. L’étude a été réalisée sur 12 cadavres, il s’agissait<br />
de 11 femmes et 1 homme, l’âge moyen était de 85 ans. Un bilan<br />
radiographique a été réalisé systématiquement pour confirmer<br />
l’arthrose trapézo-métacarpienne. Nous avons utilisé le matériel<br />
habituel pour l’arthroscopie du poignet (optique de 2,7 mm, minishaver).<br />
MÉTHODE. Nous avons réalisé deux voies d’abords au niveau<br />
de l’articulation trapézo-métacarpienne de part et d’autre du tendon<br />
abductor pollicis longus. La trapézectomie totale a été réalisée<br />
au minishaver de distal en proximal. Une bandelette tendineuse de<br />
6à7cmauxdépens de l’abductor pollicis longus a été prélevée à<br />
l’aide d’une contre-incision proximale. Cette bandelette insérée<br />
sur la base du premier métacarpien est passée sous contrôle arthroscopique<br />
au travers de deux tunnels osseux réalisés au niveau de<br />
la base <strong>des</strong> premiers et deuxièmes métacarpiens puis fixée à la base<br />
du deuxième métacarpien. Le temps opératoire a été évalué. Un<br />
bilan radiographique postopératoire ainsi qu’un contrôle à ciel<br />
ouvert ont été systématiquement réalisé permettant d’évaluer la<br />
qualité de la résection osseuse.<br />
RÉSULTATS. La trapézectomie totale et la ligamentoplastie de<br />
stabilisation sous arthroscopie ont pu être réalisée dans tous <strong>les</strong> cas<br />
et évaluée par contrôle radiographique et à ciel ouvert. Aucune<br />
lésion d’éléments nob<strong>les</strong> n’a été constatée.<br />
DISCUSSION. Par abord mini-invasif, la trapézectomie associée<br />
à une ligamentoplastie de stabilisation est réalisable et nécessite<br />
un certain apprentissage. Nous n’avons pas constaté de morbidité<br />
particulière liée à l’intervention malgré notamment <strong>les</strong><br />
rapports intimes avec la branche sensitive du nerf radial <strong>des</strong>tinée<br />
au pouce.<br />
CONCLUSION. Les résultats de cette étude préliminaire nous<br />
encouragent à débuter une étude clinique qui devra prouver <strong>les</strong><br />
avantages de cette technique en terme de morbidité et de coût<br />
socio-économique.<br />
*S. Durand, Service de Chirurgie Orthopédique et<br />
Traumatologique, Hôpital Avicenne, 115, route de Stalingrad,<br />
93009 Bobigny.<br />
190 Évaluation fonctionnelle après<br />
arthrodèse bilatérale <strong>des</strong> poignets<br />
pour arthropathie inflammatoire<br />
G. PRODHOMME*, C. CHANTELOT, T.AIHONNOU,<br />
F. GIRAUD, C.FONTAINE<br />
INTRODUCTION. L’arthrodèse est un traitement classique du<br />
poignet rhumatoïde. En cas d’atteinte sévère bilatérale, l’arthrodèse<br />
bilatérale entre en concurrence avec l’arthrodèse unilatérale<br />
associée à une prothèse controlatérale. Nous souhaitions donc<br />
connaître le résultat fonctionnel d’une arthrodèse bilatérale.<br />
MATÉRIEL. Cette étude rétrospective portait sur 7 patients (1<br />
homme, 6 femmes), d’âge moyen 46 ans (28-69) ayant bénéficié<br />
d’une arthrodèse totale bilatérale <strong>des</strong> poignets pour arthropathie<br />
inflammatoire (6 PR, 1 arthrite chronique juvénile). Le recul<br />
moyen était de 5 ans.<br />
MÉTHODES. La révision fut clinique et radiographique :<br />
goniométrie <strong>des</strong> membres supérieurs, Jebsen hand function test<br />
(questionnaire fondé sur <strong>les</strong> activités de la vie quotidienne),<br />
mesure de la force de préhension en poigne et en pince et évaluation<br />
<strong>des</strong> résultats d’après Buck-Gramcko/Lohmann.
RÉSULTATS. La position obtenue après arthrodèse était en<br />
moyenne de 2° en flexion [(-5°)-(+10°)] et 6° d’inclinaison ulnaire<br />
[(– 5°)-(+ 20°)]. Dans tous <strong>les</strong> cas, la fusion radiologique était<br />
obtenue. Au recul, nous avons observé : 3 reprises d’activité professionnelle,<br />
1 reclassement Cotorep, 1 patiente en invalidité, une<br />
femme au foyer et une retraitée. Le Jebsen hand test montrait que<br />
nos patients réalisaient 32 <strong>des</strong> 49 gestes (65 %). Pour <strong>les</strong> activités<br />
quotidiennes, nous avons 3 résultats excellents, 2 bons et 2<br />
moyens. Le test de Buck-Gramcko/Lohmann montrait un résultat<br />
moyen de 6,8/10 [2-10], qui correspond à un bon résultat. <strong>Tous</strong> <strong>les</strong><br />
patients étaient satisfaits de l’intervention.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. Les gestes de la vie quotidienne<br />
paraissaient réalisab<strong>les</strong> après arthrodèse bilatérale <strong>des</strong> poignets,<br />
l’hygiène périnéale était possible chez 5 de nos patients.<br />
Seuls <strong>les</strong> travaux de force et de finesse étaient déficients en raison<br />
d’une appréhension et d’un manque de dextérité fine. Les mauvais<br />
résultats peuvent être imputés aux déformations <strong>des</strong> métacarpophalangiennes<br />
et à la diminution de la force de préhension. En<br />
effet, nous avons observé une diminution de la force de préhension<br />
d’environ 80 % par rapport à une mesure chez une population<br />
représentative de polyarthritiques non opérés. L’arthrodèse bilatérale<br />
est une alternative valable à l’arthroplastie bilatérale ou à<br />
l’association prothèse-arthrodèse. Elle n’expose pas aux complications<br />
mécaniques <strong>des</strong> arthroplasties.<br />
*G. Prodhomme, Service d’Orthopédie B,<br />
Hôpital Roger-Salengro, CHRU de Lille, 59037 Lille Cedex.<br />
191 Étude radio-clinique de l’instabilité<br />
du moignon proximal de l’ulna<br />
après l’intervention de Sauvé-<br />
Kapandji : à propos de quatorze cas<br />
P. BRUNET*, G. MOINEAU, M.LIOT,<br />
A. BURGAUD, F.DUBRANA, D.LE NEN<br />
INTRODUCTION. L’intervention de Sauvé-Kapandji est fréquemment<br />
pratiquée pour traiter <strong>les</strong> lésions dégénératives posttraumatiques<br />
de l’articulation radio-ulnaire distale. Peu de séries<br />
de la littérature s’intéressent spécifiquement au moignon proximal<br />
de l’ulna. Le but de cette étude originale radio-clinique a été d’étudier<br />
le comportement dynamique du moignon proximal de l’ulna.<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S109<br />
MATÉRIEL. Il s’agit d’une série rétrospective de 14 patients (4<br />
femmes, 10 hommes), d’âge moyen 48 ans, opérés entre janvier<br />
1991 et mars 2002. <strong>Tous</strong> présentaient une atteinte posttraumatique<br />
de l’articulation radio-ulnaire distale.<br />
MÉTHODE. L’intervention a été réalisée en moyenne 12 mois<br />
après le traumatisme initial. La résection ulnaire était en moyenne<br />
de 11 mm et était réalisée la plus distale possible. Le carré pronateur<br />
n’était pas avancé dans le foyer de pseudarthrose. La rééducation<br />
de la pronosupination a été débutée immédiatement.<br />
Les patients ont été tous revus en consultation et examinés. Un<br />
protocole radiologique comprenant <strong>des</strong> clichés statiques et dynamiques<br />
a été conçu et réalisé.<br />
RÉSULTATS. Les patients ont été revus au recul moyen de 5 ans<br />
et 2 mois. Deux complications ont été relevées : une consolidation<br />
de la pseudarthrose intentionnelle de l’ulna et une pseudarthrodèse<br />
de l’articulation radio-ulnaire distale. Le délai de reprise de l’activité<br />
initiale était en moyenne de 9 mois. Deux patients n’ont pu<br />
reprendre leur activité antérieure. Sept patients se plaignaient de<br />
douleurs mécaniques sur le site de résection ulnaire. Trois patients<br />
signalaient un claquement au bord ulnaire du poignet et deux<br />
patients un véritable ressaut du moignon ulnaire lors de la pronosupination.<br />
Cliniquement, il existait dans tous <strong>les</strong> cas une instabilité<br />
du moignon ulnaire dans le plan sagittal. Dans 3 cas, il existait<br />
également une instabilité du moignon dans le plan frontal. L’étude<br />
radiographique a confirmé l’instabilité dans le plan sagittal dans<br />
tous <strong>les</strong> cas. Aucune instabilité dans le plan frontal n’a été confirmée<br />
par <strong>les</strong> clichés dynamiques.<br />
DISCUSSION. Bien que moins importante que dans l’intervention<br />
de Darrach, l’instabilité du moignon ulnaire proximal est la<br />
principale complication de l’intervention de Sauvé-Kapandji. La<br />
préservation <strong>des</strong> structures stabilisant le moignon ulnaire distal<br />
semble primordiale : périoste, membrane interosseuse, extenseur<br />
ulnaire du carpe, carré pronateur. Notre attitude de résection la<br />
plus courte et la plus distale possible ne permet pas d’éviter un<br />
certain degré d’instabilité, qui est cependant très bien toléré.<br />
CONCLUSION. L’intervention de Sauvé-Kapandji donne <strong>des</strong><br />
résultats très satisfaisants sur <strong>les</strong> douleurs et la mobilité. <strong>Tous</strong> <strong>les</strong><br />
patients semblent présenter une instabilité du moignon ulnaire<br />
distal qui est en règle bien tolérée ; cependant, dans un cas, elle a<br />
conduit à une intervention secondaire de stabilisation. Cette instabilité<br />
reste un problème non résolu car même une technique rigoureuse<br />
ne semble pouvoir la prévenir.<br />
*P. Brunet, Service d’Orthopédie-Traumatologie,<br />
CHU de Brest, Hôpital de La Cavale-Blanche, boulevar<br />
Tanguy-Prigent, 29200 Brest Cedex.
3S110 78 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
192 Le flux laminaire horizontal intégral<br />
avec reprise : le dispositif le plus<br />
favorable à la chirurgie orthopédique<br />
et traumatologique<br />
P. VICHARD*, L. OBERT<br />
INTRODUCTION. Très minoritaire en France, et notamment<br />
dans notre spécialité, ce type d’installation comprend une surface<br />
d’émission du flux occupant la totalité d’une paroi latérale avec<br />
reprise du côté opposé. En 1980, deux sal<strong>les</strong> à flux laminaire<br />
horizontal intégral avec reprise ont été installées au bénéfice de<br />
notre spécialité dans un hôpital neuf.<br />
OBJECTIFS. 1. Résoudre le problème de l’aérobiocontamination<br />
de nos locaux opératoires aseptiques (en dehors d’un Unité<br />
d’isolement complet <strong>des</strong> septiques). 2. Permettre une utilisation<br />
intensive de ces deux sal<strong>les</strong> d’opérations, en sachant que l’effectif<br />
<strong>des</strong> sal<strong>les</strong> dévolues était de 2,5 sal<strong>les</strong> aseptiques pour 90 lits et<br />
environ 400 000 K/an. 3. Permettre une disposition <strong>des</strong> personnels<br />
et <strong>des</strong> matériels plus favorable qu’avec un flux vertical, où la<br />
surface opératoire reste exiguë, où <strong>les</strong> risques d’empoussièrement<br />
sont plus importants, dont <strong>les</strong> indications nous paraissent particulières<br />
(orthopédie ciblée : hanche par exemple). De plus, il nous<br />
paraît intéressant d’assurer <strong>les</strong> réparations en dehors de l’enceinte<br />
opératoire, ce qui est <strong>les</strong> cas avec l’installation qui nous a été<br />
proposée par Luwa (Zurich, CH).<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Ces deux sal<strong>les</strong> ont chacune <strong>les</strong><br />
dimensions suivantes : surface : 34 m 2 , volume : 99 m 3 . La totalité<br />
d’une <strong>des</strong> parois (à l’opposé de l’entrée <strong>des</strong> opérés et du chirurgien)<br />
émet le flux. A l’opposé, du côté <strong>des</strong> portes, une reprise est<br />
effectuée avec recyclage. La vitesse est supérieure à<br />
0,25 m/seconde, ce qui maintient la laminarité dans l’ensemble de<br />
la salle (anémomètre). Le degré hygrométrie est contrôlable. La<br />
filtration concerne <strong>des</strong> particu<strong>les</strong> de 0,2 mm minium. La température<br />
est maintenue à 20° maximum. Six cent renouvellements sont<br />
effectués par heure. La surpression est maintenue en permanence,<br />
mesurée par manomètre, elle peut être contrôlée en première<br />
approximation, tous <strong>les</strong> jours, par <strong>des</strong> moyens artisanaux.<br />
RÉSULTATS. 1. Contrôle aérauliques (par une Infirmière non<br />
spécialisée). L’utilisation intensive se maintenant depuis plus de<br />
15 ans, le contrôle <strong>des</strong> paramètres a eu lieu, après l’installation, et<br />
depuis tous <strong>les</strong> 6 mois (hors activité). Le matériel essentiel est un<br />
compteur de particu<strong>les</strong> (gradué en pieds cubes) qui nous situe à <strong>des</strong><br />
taux toujours inférieurs à ceux de classe 100 (Fed US 209 D). Les<br />
anomalies observées à plusieurs reprises (ascension localisée <strong>des</strong><br />
particu<strong>les</strong>) révélant <strong>des</strong> dysfonctionnements <strong>des</strong> filtres. Les zones<br />
« à trous » ont été supprimées grâce à un changement <strong>des</strong> filtres.<br />
Les autres paramètres se sont maintenus sans problème, en dehors<br />
d’une <strong>des</strong> deux sal<strong>les</strong> où, compte-tenu de la vitesse jugée insuffisante,<br />
en bout de salle, et de la surpression prise en défaut, il a fallu<br />
réaménager l’émission du flux et revoir l’occlusion <strong>des</strong> portes,<br />
avec <strong>des</strong> contrô<strong>les</strong> ultérieurs favorab<strong>les</strong>. Les mesures en activité<br />
ont été trop peu systématiques pour être prises en considération.<br />
Séance du 12 novembre après-midi<br />
HANCHE<br />
2. Le taux <strong>des</strong> infections cliniques associé à ces sal<strong>les</strong> a été<br />
maintenu très bas comme l’indiquent <strong>les</strong> chiffres fournis. Mais<br />
l’antibiothérapie prophylactique a toujours été associée.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. Les objectifs qui ont tous<br />
été atteints nous incitent à conserver ce conditionnement, bien<br />
supérieur au flux vertical, et à en équiper nos sal<strong>les</strong> d’interventions<br />
ultérieures.<br />
*P. Vichard, Service de Chirurgie Orthopédique<br />
Traumatologique et Plastique, CHU, Hôpital Jean-Minjoz,<br />
25030 Besançon Cedex.<br />
193 Le contrôle qualité en chirurgie.<br />
Application à la chirurgie assitée<br />
par ordinateur<br />
R. NIZARD*, R. PORCHER, P.RAVAUD,<br />
E. VANGAVER, L.SEDEL<br />
INTRODUCTION. L’évaluation <strong>des</strong> techniques chirurgica<strong>les</strong><br />
reste la règle avant leur diffusion. Habituellement cette évaluation<br />
est calquée sur l’évaluation <strong>des</strong> médicaments et fait appel aux<br />
essais randomisés. Toutefois, il existe une dimension qui n’est pas<br />
explorée par ce type d’essai qui est le contrôle qualité. Le but de ce<br />
travail est de montrer l’intérêt d’une technique d’évaluation qui<br />
prend en compte la capacité à contrôler l’acte chirurgical et de<br />
déterminer si cette technique est fiable, reproductible et contrôlée.<br />
Cette méthode d’évaluation a été appliquée à l’évaluation d’une<br />
technique de chirurgie assistée par ordinateur pour la prothèse<br />
totale de genou.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Soixante-dix-huit genoux ont<br />
été opérés à l’aide d’une technique de chirurgie assistée par ordinateur<br />
basée sur une reconstruction en trois dimensions <strong>des</strong> os. Le<br />
critère de jugement principal était l’axe mécanique entre centre de<br />
la tête fémorale et centre de le cheville. L’objectif à atteindre était<br />
d’avoir un axe mécanique compris entre 3 de varus et 3 de valgus.<br />
Les axes ont été mesurés de façon continue par un opérateur indépendant.<br />
A partir de ces données, au fur et à mesure <strong>des</strong> interventions<br />
une courbe de type Cusum a été construite et un test a été<br />
réalisé après chaque intervention pour déterminer si la procédure<br />
était sous contrôle et que l’essai pouvait être poursuivi. La même<br />
méthode a été appliquée sur le positionnement individuel <strong>des</strong><br />
implants fémoraux et tibiaux en fixant comme limite sur le cliché<br />
de face 2 autour de la perpendiculaire à l’axe mécanique.<br />
RÉSULTATS. Quatre-vingt-onze pour cent <strong>des</strong> genoux avaient<br />
un axe mécanique compris entre 3 de valgus et 3 de varus. La<br />
courbe d’évaluation continue a montré que la procédure était en<br />
permanence sous contrôle. Il existait une courbe d’apprentissage<br />
qui se stabilisait après 27 genoux. L’évaluation individuelle <strong>des</strong><br />
implants montrait qu’une tendance au valgus sur le fémur au cours<br />
du temps était compensée par une tendance au varus sur le tibia.
DISCUSSION. Les procédures industriel<strong>les</strong> de contrôle qualité<br />
sont bien établies et largement utilisées. L’ambition de ce travail a<br />
été d’appliquer le même schéma à une procédure chirurgicale.<br />
Avant la réalisation d’une étude randomisée, ce type d’évaluation<br />
permet d’affirmer que la procédure est sous contrôle et que l’utilisation<br />
dans ces conditions d’une technique innovante ne fait pas<br />
courir de risques indus aux patients.<br />
*R. Nizard, Hôpital Lariboisière,<br />
2, rue Ambroise-Paré, 75010 Paris.<br />
194 Amélioration du positionnement<br />
<strong>des</strong> cupu<strong>les</strong> de prothèses tota<strong>les</strong> de<br />
hanche avec un nouveau guide<br />
mécanique<br />
S. ECHEVERRI*, P.-F. LEYVRAZ, P.-Y. ZAMBELLI,<br />
M. DUTOIT, B.JOLLES<br />
INTRODUCTION. La luxation est la complication à courtterme<br />
la plus fréquente après la mise en place d’une prothèse totale<br />
de hanche (PTH). Différentes stratégies sont utilisées pour limiter<br />
l’influence <strong>des</strong> facteurs techniques et notamment chirurgicaux. La<br />
position de l’implant acétabulaire est un facteur clé, tant au niveau<br />
de son angle d’antéversion que de son angle d’abduction. L’objectif<br />
de ce travail était de connaître la précision, la reproductibilité et<br />
la facilité d’utilisation d’un nouveau guide mécanique pour le<br />
positionnement de la cupule lors <strong>des</strong> arthroplasties tota<strong>les</strong> de hanche.<br />
MATÉRIEL. Après calcul de la taille de l’échantillon nécessaire<br />
(puissance de 90 %, erreur de type I de 5 %), 310 cupu<strong>les</strong> de<br />
hanche, type press-fit, ont été impactés dans un modèle plastique<br />
anatomique du bassin par 5 chirurgiens posant régulièrement <strong>des</strong><br />
PTH.<br />
MÉTHODES. Utilisant la direction constante de la gravité<br />
comme référence, un nouveau guide mécanique a été conçu. Sa<br />
précision, sa reproductibilité et sa facilité d’utilisation dans le<br />
positionnement d’un implant acétabulaire ont été comparés au<br />
guide mécanique de Müller lors de l’implantation in vitro de 310<br />
cupu<strong>les</strong> par voie d’abord postéro-latérale ne laissant visible que le<br />
champ opératoire habituel.<br />
RÉSULTATS. L’erreur de positionnement de la cupule en antéversion,<br />
par rapport à une référence fixée à 15, était en moyenne de<br />
10,4 (étendue 3 à 21, écart-type 5,0) pour le guide de Müller et de<br />
0,4 (étendue 1à3,écart-type 0,7) pour le nouveau guide. Pour<br />
l’angle d’abduction de la cupule, par rapport à une référence fixée<br />
à 45, ces valeurs étaient respectivement de -4,7 (étendue7à–11,<br />
écart-type 2,3) pour le guide de Müller et de 0,3 (étendue 0à3,<br />
écart-type 0,5) pour le nouveau guide. Les temps moyens de positionnement<br />
de la cupule étaient comparab<strong>les</strong> pour <strong>les</strong> deux gui<strong>des</strong><br />
(moyenne de 6s pour le guide de Müller et 5 s pour le nouveau<br />
guide).<br />
DISCUSSION. La précision et la reproductibilité du positionnement<br />
de la cupule obtenues avec le nouveau guide sont meilleures<br />
que cel<strong>les</strong> obtenues avec <strong>les</strong> gui<strong>des</strong> mécaniques actuellement<br />
disponib<strong>les</strong> sur le marché (p < 0,00001 avec le guide de Müller).<br />
El<strong>les</strong> sont de plus comparab<strong>les</strong> aux valeurs trouvées dans <strong>les</strong> étu-<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S111<br />
<strong>des</strong> in vitro menées avec <strong>les</strong> systèmes de chirurgie assistés par<br />
ordinateur. L’utilisation du nouveau guide de positionnement s’est<br />
aussi montrée simple et rapide.<br />
CONCLUSION. Les excellents résultats obtenus par ce nouveau<br />
guide mécanique en terme de positionnement <strong>des</strong> cupu<strong>les</strong> <strong>des</strong><br />
PTH devront être confirmés par <strong>des</strong> étu<strong>des</strong> in vivo.<br />
*S. Echeverri, c/o Dr B. Jol<strong>les</strong>, Hôpital Orthopédique de la<br />
Suisse Romande, 4, avenue Pierre-Decker,<br />
1005 Lausanne, Suisse.<br />
195 Prévention <strong>des</strong> ossifications périprothétiques<br />
par le Célécoxib<br />
L. VASTEL*, N. ROSENCHER, J.-P. COURPIED<br />
INTRODUCTION. Les ossifications péri-prothétiques sont une<br />
complication fréquente, parfois grave au plan fonctionnel <strong>des</strong><br />
arthroplasties tota<strong>les</strong> de hanche. Les anti-inflamatoires non stéroïdiens<br />
(AINS) en constituent une prévention efficace mais non<br />
dénuée de morbidité. Le but de cette étude était d’évaluer l’efficacité<br />
d’un anti-Cox2, le célécoxib, dans cette indication.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Quarante-deux patients opérés<br />
pour arthroplastie totale et présentant une contre indication relative<br />
(toujours digestive) aux AINS ont reçu du Célécoxib (Celebrexy),<br />
200 mgx2/24 heures, débuté la veille de l’intervention et<br />
poursuivi au moins 5 jours. Quarante-deux patients témoins ont<br />
été sélectionnés, de même âge (± 3 ans), de même sexe, opérés<br />
pour la même étiologie, par un chirurgien d’expérience équivalente.<br />
La prévention <strong>des</strong> ossifications étaient assuré par Kétoprofène<br />
(Profénidy) 50mg× 4/24 h pendant deux jours puis 150<br />
mg × 2 pdt 5 jours. La voie d’abord, la prothèse implantée, et <strong>les</strong><br />
autres traitements adjuvants étaient identiques dans <strong>les</strong> deux groupes.<br />
Les ossifications ont été analysées sur <strong>des</strong> clichés à3mois<br />
minimum puis au plus long recul. La classification de Brooker a<br />
été utilisée. Un test exact de Fisher a été utilisé pour la comparaison<br />
statistique <strong>des</strong> fréquences d’ossifications.<br />
RÉSULTATS. Les deux groupes comprenaient 31 femmes et 11<br />
hommes, l’âge moyen était identique dans <strong>les</strong> deux groupes (67,12<br />
vs 67,12 ans). Le recul moyen d’observation était sensiblement<br />
identique (8,44 mois vs 8,6 mois). L’étiologie était : 30 fois une<br />
coxarthrose primitive, 9 fois une coxarthrose sur dysplasie, une<br />
fois une séquelle d’arthrite infantile, et deux fois une reprise de<br />
prothèse totale. Deux patients dans chaque groupe ont interrompu<br />
le traitement (entre J2 et J4) du fait d’une intolérance. Aucun<br />
hématome significatif n’a été noté dans <strong>les</strong> deux groupes. Aucune<br />
ossification de grade supérieur à 2 n’a été observée. Le taux d’ossification<br />
global était de 42,5 % dans le groupe témoin, 48,6 % dans<br />
le groupe celécoxib. Le taux d’ossifications de grade 2 était de 8 %<br />
dans le groupe Célécoxib, versus 12 % dans le groupe témoin. Ces<br />
fréquences ne sont pas significativement différentes (test exact de<br />
Fisher = 0,6 NS).<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. Dans cette étude, le Célécoxib<br />
a démontré une efficacité équivalente pour la prévention <strong>des</strong><br />
ossifications péri-prothétiques à un protocole de référence utilisant<br />
le Kétoprofène (Profénidy). Cette perspective est intéressante<br />
dans l’hypothèse probable d’une morbidité moindre pour <strong>les</strong>
3S112 78 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
anti-inflammatoires anti-cox2, permettant l’emploi d’une prévention<br />
systématique couplée avec le protocole antalgique.<br />
*L. Vastel, Hôpital Cochin,<br />
27, rue du Faubourg-Saint-Jacques, 75014 Paris.<br />
196 Problèmes étiopathogéniques et<br />
thérapeutiques posés par <strong>les</strong> douleurs<br />
antérieures de hanches explorées<br />
par mini-arthrotomie vidéoassistée<br />
F. GOUIN*, C. BAUDRY, N.CHALINE,<br />
J.-M. BERTHELOT<br />
INTRODUCTION. Les douleurs antérieures de hanche posent<br />
de diffici<strong>les</strong> problèmes diagnostiques et thérapeutiques. Plusieurs<br />
hypothèses diagnostiques sont actuellement en débat sur leur origine,<br />
où sont évoqués <strong>les</strong> kystes sous-chondraux, <strong>les</strong> problèmes de<br />
labrum et <strong>les</strong> conflits osseux antérieurs ou « impigments », ces<br />
différentes entités pouvant être associées. Nous rapportons dans ce<br />
travail <strong>les</strong> constations opératoires de 13 cas, confrontées aux données<br />
cliniques et d’imagerie pour essayer d’éclairer <strong>les</strong> facteurs<br />
étiopathogéniques de ces douleurs et <strong>les</strong> possibilités thérapeutiques.<br />
MATÉRIEL. Treize mini-arthrotomies vidéo assistées selon<br />
une technique originale ont été réalisées chez <strong>des</strong> patients présentant<br />
un syndrome douloureux antérieur de hanche. Le bilan préopératoire<br />
comprenait un bilan clinique, radiographique et une imagerie<br />
par IRM et/ou arthroscanner éliminant une cause extraarticulaire<br />
et suggérant une lésion du bord supéro-médial de la<br />
hanche (rebord cotyloïdien et/ou labrum).<br />
RÉSULTATS ET DISCUSSION. La clinique était peu contributive<br />
en dehors <strong>des</strong> rares cas post-traumatiques (2 cas sur 13).<br />
Quatre cas étaient <strong>des</strong> lésions isolées du labrum, sans lésions<br />
osseuses associées, pour <strong>les</strong>quels il n’y avait aucun argument pour<br />
un conflit osseux antérieur sur <strong>les</strong> données préopératoires. Un<br />
geste de régularisation du labrum a amélioré <strong>les</strong> patients dans <strong>les</strong> 4<br />
cas. Une chondropathie isolée de la tête fémorale a été très partiellement<br />
améliorée. Les 8 autres cas associaient <strong>des</strong> lésions du<br />
labrum à une empreinte sur la tête fémorale, <strong>des</strong> géo<strong>des</strong> ou ostéophytes<br />
à la jonction antérieure tête-col, ou <strong>des</strong> géo<strong>des</strong> acétabulaires<br />
ou l’association de ces trois lésions. Ces dossiers posent le<br />
difficile problème de la lésion initiale responsable de ces<br />
tableaux : soit un conflit mécanique antérieur avec effet came et<br />
désinsertion secondaire du labrum par microtraumatismes, 5 de<br />
nos dossiers ont une jonction tête-col insuffisamment concave ou<br />
ostéophytique qui plaiderait en faveur de cette étiologie ; soit une<br />
lésion initiale du labrum responsable de géo<strong>des</strong> sous-chondra<strong>les</strong><br />
acétabulaires par la désinsertion, 3 de nos dossiers sont compatib<strong>les</strong><br />
avec cette hypothèse, en particulier par l’absence d’anomalie<br />
fémorale (pas de géo<strong>des</strong>, jonction tête-col normale).<br />
CONCLUSION. La mini-arthrotomie vidéo assistée de hanche<br />
permet un bilan articulaire complet et <strong>des</strong> gestes thérapeutiques<br />
faci<strong>les</strong>. Les lésions isolées du labrum sont rares, el<strong>les</strong> s’accompagnent<br />
le plus souvent de remaniements du bord antéro-supérieur<br />
de l’acétabulum. La responsabilité primitive du labrum ou d’une<br />
came antérieure est difficile à affirmer chez ces patients souvent<br />
vus à un stade avancé. Une meilleure connaissance de l’étiopathogénie<br />
<strong>des</strong> douleurs antérieures de hanche s’impose pour proposer<br />
un traitement adapté et efficace.<br />
*F. Gouin, Service d’Orthopédie, CHU Hôtel Dieu,<br />
44093 Nantes Cedex 1.<br />
197 Traitement conservateur chirurgical<br />
de l’ostéonécrose de la tête fémorale<br />
chez l’adulte drépanocytaire : à<br />
propos de l’évolution entre 2 et 10<br />
ans de 21 cas traités par foragebiopsie<br />
et 3 cas par ostéotomie<br />
fémorale<br />
M. MUKISI-MUKAZA*, A. FALÉMÉ, J.-L. CÉOLIN,<br />
M. ROUDIER, C.LE TURDU-CHICOT,<br />
Y. SAMUEL-LEBORGNE<br />
INTRODUCTION. La fragilité du patient drépanocytaire aux<br />
interventions chirurgica<strong>les</strong>, sa susceptibilité aux infections, <strong>les</strong><br />
résultats incertains du traitement orthopédique et <strong>les</strong> complications<br />
mécaniques ou infectieuses <strong>des</strong> arthroplasties tota<strong>les</strong> de hanche<br />
chez l’adulte, nous ont fait adopter l’orientation de dépistage<br />
systématique et d’un traitement chirurgical conservateur précoce<br />
de l’ostéonécrose de la tête fémorale (ONTF). Deux techniques<br />
chirurgica<strong>les</strong> conservatrices ont été retenues pour traiter l’ONTF<br />
drépanocytaire : le forage simple et l’ostéotomie fémorale.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Entre 1993 et 1999, sur 248<br />
patients drépanocytaires adultes examinés au cours de notre étude,<br />
69 patients présentent une ONTF évolutive et non évolutive : 1 cas<br />
au stade I, 42 cas au stade II, 16 cas au stade III, et 10 cas au stade<br />
IV. Notre observation repose sur 16 patients drépanocytaires (7 SS<br />
et 8 SC et 1 S-bêta-thal, dont 7 hommes et 9 femmes, âgés de 15<br />
ans à 44 ans). Ces patients présentaient 24 atteintes évolutives <strong>des</strong><br />
hanches. Le forage-biopsique simple a été indiqué pour une ostéochondrite<br />
de la hanche (1 cas) ; une ONTF au stade I, 13 cas au<br />
stade II3 cas au stade III débutant et 3 cas au stade III avancé. Ces<br />
trois cas d’ONTF au stade III avancé ont bénéficié d’un forage<br />
pour deux indications particulières : mauvais état général et douleur<br />
invalidante. L’ostéotomie fémorale de flexion a été réalisée<br />
pour <strong>les</strong> 3 derniers cas au stade III avec affaissement polaire localisé.<br />
Au total, nous avons réalisé 3 ostéotomies fémora<strong>les</strong> et 21<br />
forages simp<strong>les</strong> de la tête fémorale. La durée moyenne de l’évolution<br />
postopératoire est de 6 ans (minimum : 2 ans, maximum : 10<br />
ans).<br />
RÉSULTATS. L’évaluation <strong>des</strong> résultats cliniques a été adaptée<br />
à partir de celle de Merle d’Aubigné. Sur 24 hanches, 20 hanches<br />
ont une évolution favorable (soit 83 %).<br />
CONCLUSION. L’ONTF drépanocytaire nécessitant une prise<br />
en charge chirurgicale est celle dont <strong>les</strong> têtes fémora<strong>les</strong> présentent<br />
<strong>des</strong> modifications récentes et évolutives de la trame osseuse<br />
(ostéolyse, géo<strong>des</strong>) et <strong>des</strong> contours céphaliques associés ou non à<br />
la douleur. L’évolution, après forage et ostéotomie, montre une<br />
conservation de la sphéricité de la tête fémorale pour <strong>les</strong> lésions
d’ONTF traitées précocement par forage aux sta<strong>des</strong> I, II. Le stade<br />
III de l’ONTF avec décrochage bipolaire reste l’indication d’une<br />
ostéotomie fémorale. Ce traitement conservateur constitue une<br />
prévention <strong>des</strong> complications arthrosiques. Il nous a permis de<br />
repousser la pose d’une prothèse totale <strong>des</strong> hanches chez <strong>des</strong> sujets<br />
drépanocytaires jeunes.<br />
*M. Mukisi-Mukaza, Service d’Orthopédie et Traumatologie,<br />
Centre Caribéen de la Drépanocytose/Guadeloupe,<br />
INSERM 458, CHU Pointe-à-Pitre, Guadeloupe.<br />
198 Arthroplastie totale de hanche<br />
après ostéotomie fémorale<br />
C. NICH*, P. ANGOTTI, P.BIZOT, E.VAN GAVER,<br />
J. WITVOET, L.SEDEL, R.NIZARD<br />
INTRODUCTION. L’arthroplastie totale de hanche pour échec<br />
d’ostéotomie fémorale est grevée d’un fort risque de complications<br />
et ses résultats sont controversés. Le but de ce travail rétrospectif<br />
était d’en évaluer <strong>les</strong> difficultés et <strong>les</strong> résultats.<br />
MATÉRIELS ET MÉTHODES. De mars 1974 à janvier 1995,<br />
68 patients (82 hanches), dont 51 femmes et 17 hommes, d’âge<br />
moyen 59 ans ± 11,5 (32-84 ans), ont été opérés. Les indications<br />
initia<strong>les</strong> étaient principalement une dysplasie acétabulaire et/ou<br />
fémorale (47 cas), ou une séquelle de luxation congénitale (21<br />
cas). Le délai moyen entre l’ostéotomie et l’arthroplastie était de<br />
13,8 ± 8,4 ans (10 mois-45 ans). Les implants utilisés étaient une<br />
tige en alliage de titane (Ceraver Osteal) cimentée, associée à une<br />
cupule en alumine (66 cas) ou en polyéthylène (16 cas). Le couple<br />
de frottement était alumine-alumine dans 67 cas (81 %). L’évaluation<br />
fonctionnelle <strong>des</strong> résultats a été effectuée selon le score de<br />
Merle d’Aubigné. L’évaluation radiologique a comporté l’étude<br />
<strong>des</strong> liserés, et <strong>des</strong> taux d’usure. Enfin, une analyse de survie a été<br />
effectuée selon la méthode actuarielle.<br />
RÉSULTATS. Un patient (1 hanche) a été perdu de vue. Treize<br />
patients (14 hanches) sont décédés d’affections intercurrentes. Six<br />
hanches ont été reprises pour <strong>des</strong>cellement aseptique (cupule isolée<br />
dans 5 cas, bipolaire dans 1 cas) à 8,5 ans en moyenne (4,5-12<br />
ans).Vingt-deux complications peropératoires (27 %) ont été relevées,<br />
dont 18 fractures ou fausses routes fémora<strong>les</strong> et 4 effractions<br />
de l’arrière-fond. Les autres complications regroupaient une luxation<br />
postopératoire isolée, 2 paralysies sciatiques avec récupération<br />
partielle, et une pseudarthrose du grand trochanter opérée.<br />
Aucune complication septique n’a été notée. Au recul maximal de<br />
11,8 ± 4,7ans (5,4-20 ans), le score fonctionnel moyen était de<br />
16,5 (15-18) versus 9,9 (3-14) en préopératoire (p < 0,05). Aucun<br />
liseré fémoral n’était observé alors qu’un liseré complet était<br />
apparu pour 11 cupu<strong>les</strong>, dont 6 en alumine massive cimentée. En<br />
considérant l’échec comme la reprise pour <strong>des</strong>cellement aseptique,<br />
le taux de survie cumulée à 12 ans (intervalle de confiance<br />
95 %) était de 82 % (67 à 96 %) pour la cupule et de 98 % (92 à<br />
99,7 %) pour la tige.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. Les résultats de ce travail<br />
confirment le risque élevé de complications peropératoires de<br />
l’arthroplastie totale de hanche pour échec d’ostéotomie fémorale.<br />
Les modifications architectura<strong>les</strong> exposent aux difficultés techniques.<br />
La survie <strong>des</strong> implants semble peu affectée par l’intervention<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S113<br />
antérieure, mais <strong>les</strong> résultats fonctionnels sont légèrement inférieurs<br />
à ceux <strong>des</strong> arthroplasties primaires.<br />
*C. Nich, Service de Chirurgie Orthopédique et<br />
Traumatologique, Hôpital Lariboisière,<br />
2, rue Ambroise-Paré, 75010 Paris.<br />
199 Arthroplastie bilatérale de hanche<br />
en un temps : résultats et étude de<br />
la qualité de vie<br />
C. NICH*, P. DEKEUWER, E.VAN GAVER,<br />
P. BIZOT, R.NIZARD, L.SEDEL<br />
INTRODUCTION. L’objectif de cette étude était d’évaluer <strong>les</strong><br />
résultats et la qualité de vie (QDV) <strong>des</strong> patients après arthroplastie<br />
bilatérale de hanche réalisée au cours d’un même temps opératoire.<br />
MATÉRIELS ET MÉTHODES. Soixante-et-un patients (28<br />
femmes, 33 hommes), opérés entre novembre 1989 et février<br />
2002, âgés en moyenne de 42 ± 14 ans (13-76 ans) ont été revus.<br />
Les indications étaient une coxarthrose primitive (24 cas), une<br />
coxarthrose secondaire dans 31 cas, dont 25 ostéonécroses aseptiques,<br />
et une origine rhumatismale (6 cas). Les implants (Ceraver<br />
Osteal) étaient cimentés (50 tiges, 11 cupu<strong>les</strong>) ou recouverts<br />
d’hydroxyapatite (72 tiges, 111 cupu<strong>les</strong>). Le couple de frottement<br />
était un couple alumine-alumine dans tous <strong>les</strong> cas. L’évaluation<br />
fonctionnelle a été effectuée selon le score de Merle d’Aubigné.<br />
L’évaluation de la QDV a été effectuée pour 27 patients en prospectif<br />
selon <strong>les</strong> scores SF-36 et WOMAC, en préopératoire puis<br />
tous <strong>les</strong> 3 mois.<br />
RÉSULTATS. Aucun patient n’a été perdu de vue. Les complications<br />
comprenaient 2 fractures fémora<strong>les</strong> peropératoires traitées<br />
par cerclage, une luxation précoce isolée, 3 complications<br />
thrombo-emboliques dont une embolie pulmonaire. Une reprise<br />
unipolaire a été nécessaire dans 1 cas pour <strong>des</strong>cellement acétabulaire<br />
aseptique à 6,5 ans de recul et un lavage chirurgical a été<br />
réalisé dans un autre cas pour une infection. Le saignement peropératoire<br />
moyen était de 1529 ± 451 ml (540-2 550 ml). La durée<br />
moyenne d’hospitalisation était de 13 ± 2,5 jours (8-22 jours). Au<br />
recul moyen de 49 ± 33 mois (12-162 mois), le score fonctionnel<br />
moyen était de 17,8 ± 0,5 (16-18) versus 10 ± 2,7 (3-14) en préopératoire<br />
(p < 0,05). Quatre-vingt-dix-huit pour cent <strong>des</strong> cas<br />
avaient un résultat clinique jugé très bon ou excellent. L’usure<br />
radiologique est demeurée indétectable. Un liseré complet est<br />
apparu autour d’une cupule cimentée. L’amélioration <strong>des</strong> scores<br />
de qualité de vie a été significative (p = 0,001) dès le 3 e mois<br />
postopératoire dans <strong>les</strong> domaines « social », « physique » et<br />
« douleur », notamment chez <strong>les</strong> hommes (p < 0,05).<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. L’arthroplastie bilatérale<br />
de hanche en un temps n’est pas admise par tous <strong>les</strong> auteurs. Il<br />
s’agit d’une technique exigeante, dont <strong>les</strong> inconvénients sont<br />
l’augmentation <strong>des</strong> temps opératoires et <strong>des</strong> pertes sanguines, avec<br />
une morbidité parfois élevée. Cependant, elle permet de traiter en<br />
une procédure unique une coxopathie bilatérale, souvent chez <strong>des</strong><br />
sujets jeunes. L’utilisation d’un couple de frottement aluminealumine<br />
et d’implants non cimentés est ici particulièrement indi-
3S114 78 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
quée. Les résultats de ce travail valident l’efficacité de cette technique<br />
et l’amélioration rapide de la QDV <strong>des</strong> patients.<br />
*C. Nich, Service de Chirurgie Orthopédique et<br />
Traumatologique, Hôpital Lariboisière,<br />
2, rue Ambroise-Paré, 75010 Paris.<br />
200 Injection veineuse de ciment lors du<br />
scellement de la tige fémorale d’une<br />
prothèse totale de hanche<br />
C. CADU*, A. COULIBALY, P.ABRAHAM,<br />
B. DOUMANE, L.PIDHORZ<br />
INTRODUCTION. L’injection de ciment dans la circulation<br />
veineuse est un incident rarement rapporté qui pose de nombreuses<br />
interrogations sur ses conditions de survenue, sa signification et<br />
son rôle éventuel dans la maladie thrombo-embolique. Elle peut<br />
être confondue avec l’extravasation de ciment par le trou nourricier<br />
fémoral mais doit être différenciée de l’effraction de ciment<br />
hors de la diaphyse fémorale telle qu’on peut la rencontrer après<br />
fissure lors de la préparation du canal médullaire. L’étude de 2<br />
observations nous permet d’envisager ces différents points.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Deux patients : 1 femme et un<br />
homme âgés respectivement de 81 et 64 ans ont été opérés d’une<br />
prothèse totale de hanche, scellée sur le versant fémoral. L’intervention<br />
a consisté, après préparation du fémur, à aléser distalement<br />
le canal médullaire. Celui ci était ensuite rincé, brossé, drainé<br />
et obturé par un bouchon biorésorbable. Après injection à la seringue<br />
d’un ciment basse viscosité (palacos gentalliné), la tige était<br />
scellée. Aucun incident opératoire n’était signalé par l’anesthésiste.<br />
Les 2 patients étaient soumis à une prévention anticoagulante<br />
par HBPM pour 3 semaines. Des radiographies de contrôle<br />
étaient faites avant la sortie de la salle d’opération, à J7, 3 mois et<br />
1 an. Un écho-Doppler était réalisé à titre systématique à J7.<br />
RÉSULTATS. Une image radiologique anormale était notée<br />
dans chacune de ces observations signalée par l’injection sur 11<br />
cm de la veine fémorale profonde homologue dans un cas et<br />
l’injection sur 3 cm de la veine nourricière dans le second cas. Ce<br />
dernier devait se compliquer d’une phlébite surale bilatérale dépistée<br />
par l’échodoppler, qui justifiait le renforcement <strong>des</strong> anticoagulants.<br />
Ces images persistaient inchangées lors <strong>des</strong> contrô<strong>les</strong> successifs<br />
radiologiques et d’échodoppler.<br />
DISCUSSION. La vascularisation de la diaphyse fémorale est<br />
assurée par <strong>les</strong> vaisseaux nourriciers qui se drainent dans la veine<br />
fémorale profonde. L’introduction d’une tige fémorale et son scellement,<br />
en augmentant la pression intramédullaire, favorisent le<br />
passage <strong>des</strong> particu<strong>les</strong> (fragments osseux, graisse, ciment ?) dans<br />
<strong>les</strong> veines efférentes, la veine cave inférieure et <strong>les</strong> cavités droites.<br />
Cette migration très fréquente est soulignée par de nombreux<br />
auteurs après échographie transoesophagienne ou échographie<br />
fémorale. Les images rapportées confirmeraient l’implication du<br />
ciment dans ces phénomènes ; el<strong>les</strong> pourraient expliquer <strong>les</strong> anomalies<br />
pulmonaires notées dans 76 % <strong>des</strong> 33 décès survenus en<br />
cours de cimentation pour Keret et Reis.<br />
CONCLUSION. L’injection de ciment dans la circulation veineuse<br />
est un phénomène rare qui soulève de nombreuses interro-<br />
gations sur sa physiopathologie et sur son rôle dans la survenue de<br />
la maladie thrombo-embolique. Elle amène aussi à s’interroger sur<br />
<strong>les</strong> techniques modernes de cimentation.<br />
*C. Cadu, Service d’Orthopédie Traumatologie, CHU,<br />
4, rue Larrey, 49033 Angers Cedex 01.<br />
201 Arthroplastie totale de hanche et<br />
maladie osseuse de Paget<br />
O. GUYEN*, G. VAZ, P.VALLESE, J.-P. CARRET,<br />
J. BEJUI-HUGUES<br />
INTRODUCTION. La coxopathie pagétique est une complication<br />
fréquente de la maladie osseuse de Paget. A partir d’une étude<br />
rétrospective multicentrique, nous analysons <strong>les</strong> difficultés périopératoires<br />
et <strong>les</strong> résultats <strong>des</strong> arthroplasties tota<strong>les</strong> de hanche<br />
chez ces patients pagétiques.<br />
MATÉRIEL. Trente-neuf prothèses tota<strong>les</strong> de hanche ont été<br />
implantées entre 1979 et 1998 chez 35 patients présentant une<br />
coxopathie pagétique (4 atteintes bilatéra<strong>les</strong>). La série comporte<br />
20 hommes et 15 femmes, de 55 à 86 ans (âge moyen 74 ans).<br />
MÉTHODES. Les statuts pré et postopératoires ont été évalués<br />
selon le score de Harris, et d’après le bilan radiologique. Les<br />
difficultés opératoires ont été analysées d’après le temps opératoire,<br />
<strong>les</strong> pertes sanguines, et <strong>les</strong> données du compte-rendu opératoire.<br />
Sur <strong>les</strong> 35 patients, 24 (3 décédés, 8 perdus de vue) ont pu être<br />
revus avec un délai moyen de 62 mois.<br />
RÉSULTATS. Le score de Harris préopératoire moyen était de<br />
46 sur 100 (18 à 67). Dix-huit patients présentaient une inégalité de<br />
longueur <strong>des</strong> membres inférieurs, 9 un flexum de hanche associé à<br />
une rotation externe, et 7 une coxa vara. Vingt-neuf patients ont<br />
reçu un traitement anti-ostéoclastique préopératoire. Vingt cupu<strong>les</strong><br />
scellées et 19 non scellées ont été implantées. Trente et une<br />
tiges fémora<strong>les</strong> ont été scellées et 8 non scellées. En moyenne, la<br />
durée opératoire était de 130 minutes et la perte sanguine de 830<br />
cc. Des difficultés à luxer la tête fémorale, un os remanié et scléreux<br />
(fractures du grand trochanter, difficultés au fraisage, canal<br />
médullaire fémoral étroit), effet came lié à l’hypertrophie osseuse<br />
et hémorragies ont été rapportés. Quatre thromboses veineuses,<br />
une embolie pulmonaire, un hématome du psoas et 3 luxations ont<br />
été notés. A la révision, <strong>les</strong> résultats cliniques étaient excellents<br />
dans 13 cas (48 %), bons dans 8 cas (29 %), passab<strong>les</strong> dans 2 cas<br />
(7 %), et mauvais dans 4 cas (16 %). Une révision prothétique a été<br />
nécessaire pour 4 patients (15 %) à un délai moyen de 71 mois. Les<br />
implants étaient scellés au niveau du pelvis et du fémur dans 3 cas,<br />
et non scellés dans un cas.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. La chirurgie prothétique<br />
de la hanche chez <strong>les</strong> patients pagétiques est difficile et expose à<br />
<strong>des</strong> complications post-opératoires. Un contrôle préalable de la<br />
maladie sur le plan médical est nécessaire pour limiter le risque<br />
hémorragique. Dans notre série, <strong>les</strong> mo<strong>des</strong> de fixation sont très<br />
variés, et font apparaître que <strong>les</strong> résultats <strong>des</strong> implants non scellés<br />
sur os pagétique sont comparab<strong>les</strong> à ceux <strong>des</strong> implants scellés.<br />
*O. Guyen, Pavillon T, Hôpital Edouard-Herriot,<br />
5, place d’Arsonval, 69437 Lyon Cedex 03.
202 Optimisation de l’analyse radiologique<br />
du positionnement acétabulaire<br />
<strong>des</strong> prothèses de hanche : analyse<br />
d’une série de 46 cas et déductions<br />
pratiques<br />
J.-Y. LAZENNEC*, M. GORIN, B.ROGER,<br />
G. SAILLANT<br />
INTRODUCTION. Les incertitu<strong>des</strong> de positionnement de la<br />
cupule acétabulaire sont mises en cause dans certains dysfonctionnement<br />
<strong>des</strong> prothèses tota<strong>les</strong> de hanche (PTH). L’analyse classique<br />
de l’antéversion par tomodensitométrie présente <strong>des</strong> limites.<br />
La réalisation de coupes intégrant <strong>les</strong> positions à risque permet une<br />
meilleure approche diagnostique.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Quarante-six PTH ont été étudiées<br />
pour 17 situations de conflit postérieur avéré (12 cas de<br />
subluxation antérieure en position debout, 5 cas de luxation vraie)<br />
et pour 29 situations de conflit antérieur (16 cas de subluxation<br />
postérieure, 13 cas de luxations avérées). Deux groupes de 70<br />
hanches vierges puis de 56 PTH sans problème fonctionnel ont été<br />
comparés. Le positionnement de l’acétabulum a été étudié par <strong>des</strong><br />
coupes tomodensitométriques optimisées reconstituant <strong>les</strong> plans<br />
d’analyse pour <strong>les</strong> positions debout, assis et couché. La référence<br />
<strong>des</strong> plans de coupe a été donnée par l’angle de bascule du sacrum<br />
mesuré sur <strong>des</strong> radios de profil du sujet dans ces positions ; <strong>les</strong><br />
mesures tomodensitométriques d’antéversion optimisées ont été<br />
comparées à cel<strong>les</strong> <strong>des</strong> mesures classiques. Aucun patient présentant<br />
une antéversion fémorale anormale et/ou un bassin oblique<br />
et/ou une inégalité de longueur de plus de 10 mm n’a été retenu<br />
dans cette série. L’inclinaison frontale <strong>des</strong> implants acétabulaires<br />
était comprise entre 40° et 50°.<br />
RÉSULTATS. Dans la série témoin <strong>des</strong> hanches vierges, l’antéversion<br />
acétabulaire varie : 19,2 par mesure conventionnelle, 15,7<br />
en position debout 31 en position assise. Dans la série témoin <strong>des</strong><br />
PTH sans problème, l’antéversion mesurée est différente : 21,3<br />
par mesure conventionnelle, 24,1 en position debout, 35,8 en position<br />
assise. Dans le groupe <strong>des</strong> PTH avec conflit postérieur, 14/17<br />
cas ne sont pas expliqués par la mesure conventionnelle, la mesure<br />
optimisée permet de comprendre 12 de ces cas (excès d’antéversion<br />
en position debout et/ou couchée). Dans le groupe <strong>des</strong> PTH<br />
avec conflit antérieur, 18/29 cas ne sont pas expliqués par la<br />
mesure conventionnelle, la mesure optimisée permet de comprendre<br />
17 cas (défaut d’antéversion en position assise).<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. Les modifications d’orientation<br />
du bassin entre <strong>les</strong> positions debout et assise modifient<br />
l’antéversion réelle de la cupule. En particulier, <strong>les</strong> sujets prothésés<br />
présentent une tendance spontanée à la bascule postérieure du<br />
bassin liée au vieillissement du tronc. Cet élément doit être pris en<br />
compte pour l’analyse <strong>des</strong> dysfonctionnements majeurs ou<br />
mineurs <strong>des</strong> PTH.<br />
*J.-Y. Lazennec, Hôpital Pitié-Salpétrière,<br />
83, boulevard de l’Hôpital, 75013 Paris.<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S115<br />
203 Une cause majeure de reprise de<br />
prothèses tota<strong>les</strong> de hanche : la<br />
luxation. Étude statistique <strong>des</strong> facteurs<br />
d’échec <strong>des</strong> PTH à partir de<br />
près de 3000 dossiers de l’AVIO<br />
collectés sur cinq ans<br />
P. GIOGHI*, F. PRUNARETY, S.REIG,<br />
S. CHARBONNEL, S.TERVER<br />
INTRODUCTION. L’instabilité est une cause majeure de<br />
reprise <strong>des</strong> arthroplasties tota<strong>les</strong> de hanche, troisième cause de<br />
reprise (5 %) derrière le <strong>des</strong>cellement aseptique (75,7 %) et le<br />
sepsis (7,2 %) selon le registre suédois 2000. Le taux de luxations<br />
étant cependant très variable selon <strong>les</strong> séries. A partir de l’étude<br />
statistique de près de 3000 fiches de reprises de PTH, <strong>les</strong> auteurs<br />
étudient <strong>les</strong> facteurs d’échec <strong>des</strong> arthroplasties tota<strong>les</strong> de hanche<br />
en fonction <strong>des</strong> caractéristiques <strong>des</strong> patients.<br />
MATÉRIEL. L’AVIO, association pour la vigilance en matière<br />
d’implants orthopédique, créée en 1994 dans le but d’évaluer <strong>les</strong><br />
facteurs d’échec <strong>des</strong> PTH en France, fournit <strong>des</strong> statistiques sur <strong>les</strong><br />
reprises de prothèse. Une centaine de chirurgiens répartis sur toute<br />
la France ont rempli une fiche à chaque reprise pendant 5 ans<br />
(septembre 1994-septembre 1999). Ainsi, 2926 fiches ont été analysées.<br />
MÉTHODE. Les données liées au patient (sexe, côté, numéro<br />
de reprise, âge à la pose, âge à l’ablation, étiologie de la PTH,<br />
motifs de reprise, durée de la PTH) ont été croisées entre el<strong>les</strong>.<br />
L’étude statistique, réalisée par une statisticienne professionnelle<br />
dans le cadre d’un contrat avec l’AVIO, utilise <strong>les</strong> tests du Chi 2 et<br />
<strong>des</strong> tests non paramétriques. Les résultats statistiquement significatifs<br />
ont été comparés aux données de la littérature. Cette communication<br />
reprend <strong>les</strong> résultats concernant la luxation de prothèse<br />
de hanche comme motif de reprise.<br />
RÉSULTATS. Les reprises de PTH pour luxation représentent<br />
9,2 % <strong>des</strong> cas. La luxation devient le premier motif de reprise dans<br />
<strong>les</strong> reprises itératives et surtout le principal motif de reprise <strong>des</strong><br />
prothèses posées après 70 ans (20,6 %). Dans ce groupe de sujets<br />
âgés, 72,8 % <strong>des</strong> prothèses étaient mises en place pour coxarthrose.<br />
DISCUSSION. Ce qui est tout à fait original dans cette étude et<br />
non retrouvé avec certitude dans la littérature est de voir apparaître<br />
la luxation comme le principal motif de reprise après 70 ans, avant<br />
le <strong>des</strong>cellement aseptique acétabulaire. Bien que déjà évoqué par<br />
Charnley en 1979, de très rare étu<strong>des</strong> (Newington 1990, Ekelund<br />
1992) ont étudié le lien entre l’âge et le taux de luxation.<br />
CONCLUSION. Les facteurs liés au patient jouent un rôle<br />
considérable dans la stabilité <strong>des</strong> PTH. Après 70 ans, la luxation<br />
devient le principal motif de reprise ce qui est largement à prendre<br />
en considération dans notre population vieillissante. Cette étude<br />
pourrait nous amener à modifier nos choix thérapeutiques après 70<br />
ans.<br />
*P. Gioghi, Service de Chirurgie Orthopédique et<br />
Traumatologique, CHU de Clermont-Ferrand,<br />
place Henri-Dunant, 63000 Clermont-Ferrand.
3S116 78 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
204 Activité ostéo-régénératrice de la<br />
cellule souche mésenchymateuse<br />
murine de moelle osseuse : perspective<br />
dans <strong>les</strong> réparations <strong>des</strong><br />
pertes de substances osseuses<br />
F. GINDRAUX, L. OBERT, P.HERVÉ,<br />
F. DESCHASEAUX<br />
INTRODUCTION. La Cellule Souche Mésenchymateuse<br />
(CSM) de Moelle Osseuse (MO) est une cellule souche ostéochondrogénique<br />
qui se caractérise in vitro par sa capacité à générer<br />
<strong>des</strong> « Unités Formant <strong>des</strong> Colonies de type fibroblastique » (CFUf).<br />
L’activité régénératrice de la CSM permet d’envisager la réparation<br />
<strong>des</strong> pertes de substances osseuses étendues. Une méthode<br />
d’isolement spécifique de la CSM humaine, basée sur l’expression<br />
de la molécule membranaire VLA1 (very late antigen 1) a été<br />
élaborée dans le laboratoire en vue de son utilisation en thérapie<br />
cellulaire. Les cellu<strong>les</strong> VLA1+ triées, générent en culture 100 %<br />
<strong>des</strong> CFU-f, et contiennent donc la totalité <strong>des</strong> CSM. La méthode<br />
d’isolement <strong>des</strong> CSM a été adaptée à la souris pour élaborer un<br />
modèle in vivo.<br />
MATÉRIELS ET MÉTHODES. Les cellu<strong>les</strong> VLA-1+ sont isolées<br />
par tri direct à partir de MO de souris ma<strong>les</strong> BALB/cByJ@Ico<br />
et C57BL/6J@Ico. Les cellu<strong>les</strong> de MO totale, VLA1+ et VLA1sont<br />
soumises à <strong>des</strong> tests de caractérisation in vitro : i) l’expression<br />
de marqueurs spécifiques de cellu<strong>les</strong> souches est déterminée par<br />
cytométrie en flux, ii) l’Efficacité de Clonage (EC = nombre de<br />
CFU-f obtenu pour 105 cellu<strong>les</strong> ensemencées) est évaluée après 10<br />
jours de culture. Les cellu<strong>les</strong> VLA-1+ non testées in vitro sont<br />
cryoconservées pour être utilisées ultérieurement in vivo. Ala<br />
décongélation, <strong>les</strong> cellu<strong>les</strong> VLA1+ d’origine BALB/c sont caractérisées<br />
in vitro comme décrit précédemment et injectées en intraveineuse<br />
chez <strong>des</strong> souris BALB/c femel<strong>les</strong>. Après 3 mois, <strong>les</strong><br />
souris receveuses sont sacrifiées, et <strong>les</strong> cellu<strong>les</strong> injectées (chromosomesY+)<br />
ou leur progénie sont recherchées dans différents tissus<br />
par hybridation in situ fluorescente.<br />
RÉSULTATS. Les cellu<strong>les</strong> VLA1+ obtenues par tri expriment<br />
<strong>les</strong> marqueurs spécifiques de cellu<strong>les</strong> souches (CD34, Sca1). La<br />
culture <strong>des</strong> fractions VLA1+ et VLA1- montrent que toutes <strong>les</strong><br />
CFU-f sont retrouvées dans la fraction VLA1+. Dans la souche<br />
BALB/c, le tri permet d’enrichir d’un facteur 10 le nombre de<br />
CFU-f par rapport à la MO totale. L’enrichissement dans la souche<br />
C57 n’étant que de 2, la souche BALB/c est donc choisie pour<br />
l’étude in vivo. Par ailleurs, la cryoconservation n’altère pas l’EC<br />
<strong>des</strong> cellu<strong>les</strong> VLA1+ ni l’expression de leurs marqueurs spécifiques.<br />
Les auteurs rapportent <strong>les</strong> résultats in vivo.<br />
CONCLUSION. Comme chez l’humain, le tri spécifique <strong>des</strong><br />
CSM peut être appliqué à la MO murine. La souris semble donc<br />
Séance du 12 novembre après-midi<br />
RECHERCHE APPLIQUÉE/GENOU<br />
être un bon modèle pour la recherche pré-clinique sur la reconstitution<br />
osseuse.<br />
*F. Gindraux, Etablissement Français du Sang Bourgogne<br />
Franche-Comté, Site de l’IETG, 240, route de Dôle,<br />
25000 Besançon.<br />
205 Étude de la biocompatibilité d’une<br />
matrice osseuse humaine traitée<br />
avec <strong>des</strong> cellu<strong>les</strong> stroma<strong>les</strong><br />
S. BOISGARD*, H. SILBERT, M.BERGER,<br />
J.-P. LEVAI<br />
INTRODUCTION. L’allogreffe osseuse semble pouvoir être<br />
optimisée par la mise en place in situ de cellu<strong>les</strong> stroma<strong>les</strong> potentiellement<br />
évolutives vers la lignée osseuse. Le but de cette étude<br />
est de tester la biocompatibilité de cellu<strong>les</strong> d’origine stromale et un<br />
support allogénique osseux humain traité, et leur potentialité.<br />
MATÉRIELS ET MÉTHODES. Le support osseux était une<br />
allogreffe humaine de tête fémorale, prélevée lors de PTH. El<strong>les</strong><br />
ont été sécurisées par une banque de tissus, puis traitées par le<br />
procédé Osteopurey. Le stroma cellulaire d’origine humaine a été<br />
prélevé lors d’intervention de chirurgie cardiaque au niveau de la<br />
sternotomie. L’étude a été effectuée in vitro, en atmosphère stérile,<br />
en incubateur. Différentes molécu<strong>les</strong> d’adhésion ont été utilisées :<br />
collagène, gélatine, fibronectine, sérum humain AB, un milieu<br />
sans molécule d’adhésion sans support osseux a été utilisé. L’évaluation<br />
qualitative a été effectuée au microscope en appréciant<br />
l’adhésion <strong>des</strong> cellu<strong>les</strong> stroma<strong>les</strong>, et l’absence de différences morphologiques<br />
entre <strong>les</strong> cellu<strong>les</strong> stroma<strong>les</strong> cultivées in vitro et cel<strong>les</strong><br />
retrouvées dans la moelle osseuse. L’évaluation quantitative <strong>des</strong><br />
cellu<strong>les</strong> a été effectuée par comptage au 24, 32, 48 et 64 e jours. La<br />
capacité fonctionnelle de ces nouvel<strong>les</strong> cellu<strong>les</strong> stroma<strong>les</strong> cultivées,<br />
a ensuite été évaluée en ensemençant <strong>des</strong> cellu<strong>les</strong> médullaires<br />
CD 34+ à J0 et en comptant le nombre de CFC produites à J45<br />
(LTC IC1). Cette souche de LTC IC1, est remise en culture avec <strong>les</strong><br />
différents milieux et de nouveau évalué à J45 (LTC IC2).<br />
RÉSULTATS. Les premières observations microscopiques ont<br />
montrés que <strong>les</strong> cellu<strong>les</strong> stroma<strong>les</strong> s’orientaient de façon naturelle<br />
dans l’architecture osseuse sans rejet particulier, et qu’el<strong>les</strong> gardaient<br />
leur propriété d’adhésion entre el<strong>les</strong> et avec le substrat<br />
osseux. La numération <strong>des</strong> cellu<strong>les</strong> montre une augmentation de<br />
prolifération pour <strong>les</strong> cellu<strong>les</strong> stroma<strong>les</strong> cultivées sur un support<br />
osseux par rapport à l’absence de support. Les cultures stroma<strong>les</strong><br />
sont favorisées par l’utilisation d’os et <strong>des</strong> milieux collagène, gélatine,<br />
fibronectine. Mais <strong>les</strong> cultures en LTCI2 mettent en évidence<br />
la meilleure performance du milieu os et gélatine.<br />
DISCUSSION. La prolifération de cellu<strong>les</strong> stroma<strong>les</strong> au<br />
contact de l’allogreffe met en évidence, la biocompatibilité cellu<strong>les</strong><br />
stroma<strong>les</strong>/allogreffe traitée. Après 12 semaines d’incubation,<br />
<strong>les</strong> premiers comptages tendent à prouver que <strong>les</strong> cellu<strong>les</strong> stroma-
<strong>les</strong> cultivées in vitro sur le substrat osseux humain ont conservé<br />
leur potentiel fonctionnel et permettent la prolifération de certaines<br />
cellu<strong>les</strong> participant à l’ostéogenèse. Il faut rechercher <strong>les</strong> capacités<br />
de ces cellu<strong>les</strong> à induire une lignée ostéoblastique, pour<br />
permettre une ostéogenèse du greffon in situ.<br />
*S. Boisgard, Service de Chirurgie Orthopédique et<br />
Traumatologique I, Hôpital G. Montpied,<br />
CHU de Clermont-Ferrand, BP 69,<br />
63003 Clermont-Ferrand Cedex 01.<br />
206 Stimulations <strong>des</strong> cellu<strong>les</strong> souches<br />
mésenchymateuses in vivo dans un<br />
modèle animal de régénération du<br />
tissu squelettique<br />
D. MOUKOKO*, D. POURQUIER, A.DIMÉGLIO<br />
INTRODUCTION. La régénération du tissu squelettique, dans<br />
la réparation fracturaire, tout comme sa morphogenèse, passe par<br />
<strong>des</strong> phases communes de prolifération et de différenciation cellulaire.<br />
L’origine <strong>des</strong> précurseurs cellulaires mésenchymateux est<br />
multiple. Ceux-ci ont été identifiés au niveau médullaire, dans la<br />
couche profonde du périoste et de l’endoste. Plus récemment,<br />
l’existence de cellu<strong>les</strong> souches circulantes multipotentes a été<br />
démontrée dans la circulation générale. Leur contribution au processus<br />
de régénération squelettique a été suspectée. L’expérimentation<br />
que nous présentons permet de visualiser <strong>des</strong> phénomènes<br />
de différenciation multidirectionnelle d’éléments précurseurs<br />
mésenchymateux dans un modèle animal de régénération squelettique.<br />
MATÉRIEL. Un protocole de chirurgie expérimentale, étudiant<br />
<strong>les</strong> processus de régénération du tissu squelettique est développé<br />
chez le lapin New Zealand. Dix-huit animaux ont été opérés.<br />
MÉTHODE. Un lambeau de périoste vascularisé est transféré<br />
sur la face interne d’un genou. Il y est fixé afin d’être soumis aux<br />
contraintes de flexion et d’extension lors de la déambulation spontanée<br />
de l’animal.Aucune lésion n’est occasionnée à l’articulation<br />
ni aux segment osseux adjacents. L’animal est laissé libre de<br />
déambuler en période postopératoire. Des coupes histologiques<br />
standards sont réalisées sur la région du régénérat et de l’articulation<br />
du genou receveur après sacrifice de l’animal de deux jours à<br />
huit semaines.<br />
RÉSULTAT. Dès <strong>les</strong> temps précoces, une zone d’influence du<br />
lambeau est identifiée dans l’environnement où il a été apposé.<br />
Celle-ci concerne la moelle <strong>des</strong> régions métaphysaires, <strong>les</strong> musc<strong>les</strong><br />
environnants, la cavité articulaire, <strong>les</strong> ménisques. Dans chacun<br />
de ces sites, une prolifération cellulaire est notée. Elle s’associe<br />
à une différenciation d’éléments précurseurs dans de multip<strong>les</strong><br />
directions <strong>des</strong> lignées mésenchymateuses. Ainsi une production<br />
osseuse cartilagineuse, fibreuse et même musculaire est notée dans<br />
la cavité médullaire, dans <strong>les</strong> ménisque, et dans l’espace libre<br />
articulaire. Des marquage immuno histo chimiques permettent de<br />
démontrer la contribution de cellu<strong>les</strong> souches mésenchymateuses,<br />
dont un pool circulant est visualisé.<br />
DISCUSSION. Ces travaux sont en concordance avec la<br />
démonstration récente, dans de multip<strong>les</strong> champs de la biologie,<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S117<br />
de la contribution <strong>des</strong> cellu<strong>les</strong> souches aux processus cicatriciels<br />
généraux, ainsi qu’au turnover physiologique <strong>des</strong> tissus sains.<br />
CONCLUSION. Le fort potentiel reconnu <strong>des</strong> cellu<strong>les</strong> souches<br />
multipotentes dans <strong>les</strong> processus de réparation et de régénération<br />
tissulaire ouvre <strong>des</strong> portes importantes à la thérapie cellulaire ainsi<br />
qu’à l’ingénierie tissulaire. La démonstration de processus physiologiques<br />
in vivo, mettant à contribution un pool cellulaire endogène<br />
concerne tous <strong>les</strong> champs médicaux et chirurgicaux du traitement<br />
de l’appareil musculosquelettique.<br />
*D. Moukoko, Service d’Orthopédie Pédiatrique,<br />
CHU Lapeyronie, 191, avenue Doyen-Gaston-Giraud,<br />
34295 Montpellier.<br />
207 Autogreffe corticale de fémur stérilisée<br />
à l’autoclave : résultats à7ans<br />
de recul<br />
J.-L. ROUVILLAIN*, T. NAVARRE,<br />
H. PASCAL-MOUSSELARD, O.DELATTRE,<br />
D. RIBEYRE<br />
INTRODUCTION. Le traitement de gran<strong>des</strong> pertes de substance<br />
osseuses pose encore de gran<strong>des</strong> difficultés de reconstruction.<br />
Dans <strong>les</strong> tumeurs osseuses, <strong>les</strong> prothèses massives de résection<br />
permettent rapidement de redonner une architecture et une<br />
fonction satisfaisante. De nombreuses publications rapportent<br />
l’utilisation d’autogreffe corticale stérilisée à l’autoclave dans le<br />
traitement <strong>des</strong> tumeurs osseuses, mais seu<strong>les</strong> deux publications<br />
anciennes (1961) ont utilisé ce procédé dans le traitement <strong>des</strong><br />
gran<strong>des</strong> pertes de substance osseuses en traumatologie <strong>des</strong> membres.<br />
CAS CLINIQUE. Un jeune homme de 17 ans est transféré par<br />
avion d’une île voisine après un accident de moto. Il présentait une<br />
fracture ouverte stade 2 de Cauchoix de l’extrémité inférieure du<br />
fémur avec une perte de substance osseuse totale de 11 cm. Le<br />
segment diaphyso-métaphysaire complet, retrouvé sur la chaussée,<br />
a été apporté dans un sachet. En urgence un parage a été réalisé<br />
avec fermeture cutanée complète et mise en traction transcalcanéenne.<br />
Le fragment cortical fémoral a été nettoyé, puis stérilisé à<br />
l’autoclave avec un cycle à 121 degrés Celsius pendant 20 minutes<br />
à 1,3 bars. Vingt jours après, l’ostéosynthèse a été réalisée par une<br />
grande lame plaque à 95° de Müller par voie externe. Le segment<br />
cortical remis en place a permis de retrouver exactement la longueur,<br />
l’axe et la rotation du membre. La rééducation a été commencée<br />
immédiatement. L’appui total a été autorisé à trois mois, et<br />
<strong>les</strong> sports nautiques (planche à voile, surf)à6mois. La récupération<br />
de la mobilité a été complète pour atteindre talon-fesse.<br />
L’extension est normale et symètrique en actif et en passif sans<br />
récurvatum.<br />
RÉSULTATS. Des radiographies successives en postopératoires,<br />
à 1,5 mois, 4 mois, un an, 2 ans, 3 ans, 6 ans et 7 ans ont montré<br />
une excellente incorporation de la greffe, avec à 2 ans une consolidation<br />
et une incorporation complète <strong>des</strong> foyers diaphysaire et<br />
métaphysaire. A 7 ans, vu l’absence de résorption de la greffe,<br />
l’ablation de la plaque a été réalisée. Une biopsie de la zone métaphysaire<br />
a montrée une structure osseuse normale.
3S118 78 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. Il est exceptionnel de pouvoir<br />
recourir à ce traitement, mais il a permis de retrouver une<br />
fonction totalement normale, ce qui est rarement le cas après traitement<br />
d’une perte de substance osseuse si importante.<br />
*J.-L. Rouvillain, CHU La Meynard, BP 632,<br />
97261 Fort-de-France, Martinique.<br />
208 Traitement <strong>des</strong> fractures supracondyliennes<br />
périprothétiques du<br />
genou par allogreffe de fémur distal<br />
et prothèse totale de genou<br />
M. KASSAB*, P. ZALZAL, G.M.S. AZORES,<br />
A. PRESMANN, B.LIBERMAN, A.E. GROSS,<br />
J.-F. DUBOUSSET<br />
INTRODUCTION. La prévalence <strong>des</strong> fractures supracondyliennes<br />
au <strong>des</strong>sus d’une prothèse totale de genou (PTG) est en nette<br />
augmentation du fait de l’âge croissant <strong>des</strong> patients opérés et du<br />
nombre grandissant d’implants posés.<br />
Les auteurs rapportent <strong>les</strong> résultats fonctionnels d’une série de<br />
13 patients traités par greffon fémoral distal (GFD) associé à une<br />
prothèse de reprise de genou.<br />
MATÉRIEL. De 1990 à 2001, treize patients (12 femmes et 1<br />
homme), dont l’âge moyen était de 65 ans (24-93), ont été traités<br />
par GFD associé à une PTG. Toutes <strong>les</strong> fractures, de type III selon<br />
la classification de Lewis et al., comportaient une ostéoporose<br />
sévère associée à un <strong>des</strong>cellement de la pièce fémorale. Avant la<br />
survenue de la fracture, <strong>les</strong> patients avaient eu en moyenne 2<br />
interventions (1-4). La fracture est survenue 9 fois à la suite d’une<br />
chute, trois fois au décours d’un traumatisme mineur et une fois<br />
lors d’une mobilisation sous anesthésie générale.<br />
MÉTHODES. Les résultats fonctionnels ont été obtenus à partir<br />
d’une base de donnée prospective. Un score fonctionnel de HSS<br />
modifié a été réalisé pour tous <strong>les</strong> patients ainsi qu’un questionnaire<br />
de qualité de vie et de santé type SF-36. L’évaluation radiographique<br />
de la consolidation osseuse et de la stabilité <strong>des</strong><br />
implants a été réalisée par 2 observateurs indépendants (kappa =<br />
0.75, p = 0.02).<br />
RÉSULTATS. Au recul moyen de 60 mois (12-144), le score<br />
HSS moyen était de 75 (64-86). La flexion moyenne du genou était<br />
de 100° (50-115). Un patient a été amputé suite à une infection.<br />
Selon notre classification, 7 patients ont eu un bon ou excellent<br />
résultat fonctionnel, 4 un résultat moyen et 2 patients un mauvais<br />
résultat. Dans 9 cas, <strong>les</strong> radiographies n’ont montré aucun signe de<br />
<strong>des</strong>cellement et dans 3 cas, il existait une résorption osseuse périprothétique<br />
mineure ou modérée.<br />
DISCUSSION. Le traitement <strong>des</strong> fractures périprothétiques du<br />
genou constitue un challenge thérapeutique. L’ostéoporose et la<br />
comminution associées rendant difficile l’obtention d’une ostéosynthèse<br />
stable par <strong>les</strong> moyens conventionnels. Une alternative<br />
aux prothèses massives de genou réside dans l’utilisation d’une<br />
prothèse composite comportant un GFD et une prothèse standard<br />
de reprise. En effet, cette technique permet la restauration du<br />
capital osseux par la consolidation osseuse et constitue une désescalade<br />
thérapeutique.<br />
CONCLUSION. Malgré le risque infectieux, nous pensons que<br />
l’utilisation d’une prothèse composite constitue une option intéressante<br />
dans le traitement <strong>des</strong> fractures supracondyliennes périprothétiques<br />
du genou.<br />
*M. Kassab, Service d’Orthopédie, Hôpital Pitié-Salpétrière,<br />
83, boulevard de l’Hôpital, 75013 Paris.<br />
209 L’ostéotomie de valgisation assistée<br />
par ordinateur dans le genu<br />
varum arthrosique : résultats de la<br />
correction axiale à partir d’une<br />
étude cas-témoin de 56 cas<br />
D. SARAGAGLIA*, P. PRADEL, C.CHAUSSARD<br />
L’objectif de ce travail était d’évaluer <strong>les</strong> résultats sur l’axe<br />
mécanique de 28 ostéotomies de valgisation assistées par ordinateur<br />
(groupe A) et de <strong>les</strong> comparer à 28 ostéotomies réalisées par<br />
une technique classique (groupe B) et tirées au sort parmi une<br />
population de 140 ostéotomies réalisées entre janvier 1997 et<br />
décembre 2000.<br />
MATÉRIEL. Les populations étaient comparab<strong>les</strong> en ce qui<br />
concerne l’âge, le sexe, le côté, le degré de l’arthrose (sta<strong>des</strong><br />
d’Ahlback modifiés) et la déformation axiale en varus (groupe A :<br />
173,3° ± 3,80°-160° à 178°, groupe B : 172,8° ± 3,18°-164° à<br />
178°) mesurée sur une pangonométrie (angle HKA).<br />
MÉTHODES. Il s’agissait, dans 52 cas, d’une ostéotomie<br />
tibiale d’ouverture interne fixée par une cale de phosphate tricalcique<br />
(Biosorbt) et d’une plaque en T de l’instrumentation AO, et<br />
dans 4 cas (2 dans le groupe A et 2 dans le groupe B) d’une double<br />
ostéotomie tibiale (ouverture interne) et fémorale (fermeture<br />
externe) en raison d’un genu varum supérieur à 15°. La technique<br />
classique comportait une planification préopératoire simulant<br />
l’hypercorrection souhaitée et un contrôle peropératoire à l’aide<br />
d’un fil après avoir repéré le centre de la tête fémorale à l’aide d’un<br />
amplificateur de brillance. La technique assistée par Orthopilott<br />
comportait également une planification préopératoire, mais le<br />
contrôle peropératoire était assuré par l’ordinateur après acquisitions<br />
<strong>des</strong> centres de la hanche, du genou et de la cheville. L’objectif<br />
de l’intervention était d’obtenir un axe mécanique compris entre<br />
182 et 186°. <strong>Tous</strong> <strong>les</strong> genoux ont été évalués par une pangonométrie<br />
au 3 e mois postopératoire pour vérifier la correction axiale.<br />
RÉSULTATS. Dans le groupe A, l’angle HKA moyen postopératoire<br />
était de 183,4° ± 0,99 (181 à 185°) et dans le groupe B de<br />
184° ± 2,28 (181 à 189°). Par ailleurs, l’objectif a été atteint dans<br />
96 % <strong>des</strong> cas pour le groupe A et dans 71 % <strong>des</strong> cas pour le groupe<br />
B soit une différence statistiquement significative aussi bien dans<br />
l’absolu (p = 0,0248) que dans la comparaison <strong>des</strong> écarts-types (p<br />
= 0,0015).<br />
CONCLUSION. Les ostéotomies de valgisation assistées par<br />
Orthopilott sont tout à fait possib<strong>les</strong> et d’une reproductibilité<br />
remarquable. Entre nos mains, l’Orthopilott a permis d’atteindre<br />
plus facilement l’objectif que l’on s’était fixé en préopératoire. La<br />
méthode cinématique pour l’acquisition <strong>des</strong> centres de la hanche,<br />
du genou et de la cheville associée à la palpation de points extraarticulaires<br />
remarquab<strong>les</strong> est une excellente méthode permettant
de se passer de toute palpation intra-articulaire susceptible de<br />
compliquer le geste opératoire.<br />
*D. Saragaglia, Service de Chirurgie Orthopédique et de<br />
Traumatologie du Sport, CHU de Grenoble, Hôpital Sud, BP<br />
185, 38042 Grenoble Cedex 09.<br />
210 Ostéotomie tibiale d’addition par<br />
allogreffes cortico-spongieuses<br />
déshydratées : résultats à long<br />
terme<br />
J.-L. SANOUILLER*, P. CARTIER<br />
Le développement de la chirurgie prothétique du genou a<br />
conduit de nombreux chirurgiens à reconsidérer leur technique<br />
d’ostéotomie tibiale de valgisation.<br />
Les procédures par soustraction, source de cal vicieux épiphysaire<br />
et d’interligne oblique sont progressivement supplantées par<br />
<strong>les</strong> techniques d’ouverture plus anatomiques.<br />
Le comblement de la perte de substance osseuse créée par<br />
l’ostéotomie est le plus souvent réalisé par une autogreffe iliaque,<br />
source de co-morbidité au niveau du site de prélèvement, ou un<br />
matériau inerte non réhabitable.<br />
Pour ces raisons, nous utilisons depuis 11 ans, <strong>des</strong> allogreffes<br />
cortico-spongieuses déshydratées respectant la trame collagénique<br />
et dont <strong>les</strong> propriétés mécaniques et <strong>les</strong> temps de réhabitation<br />
sont proches de ceux <strong>des</strong> autogreffes sans en comporter <strong>les</strong> inconvénients<br />
liés au prélèvement. Après réalisation d’un trait d’ostéotomie<br />
horizontal supratubérositaire, <strong>les</strong> allogreffes tricortica<strong>les</strong><br />
sont façonnées sur le site opératoire et implantées sans impaction.<br />
L’ostéosynthèse est assurée par <strong>des</strong> agrafes ou une plaque vissée.<br />
La stabilité mécanique a toujours été obtenue dans <strong>les</strong> délais<br />
habituels autorisant une remise en charge au 40 e jour postopératoire.<br />
Vingt patients opérés il y a plus de 9 ans ont été convoquées pour<br />
cette étude.<br />
Deux sont décédés pendant le déroulement de l’étude.<br />
Un seul a été réopéré par prothèse tri-compartimentaire 7 ans<br />
après l’ostéotomie.<br />
Aucune complication locale ou générale n’a été observée à<br />
court et long terme.<br />
La réhabitation radiologique a été obtenue entre 12 et 24 mois<br />
autorisant l’ablation du matériel d’ostéosynthèse et la réalisation<br />
de biopsies osseuses attestant cette réhabitation. Des gonométries<br />
de contrôle à 45 jours et un an ont permis de valider la fiabilité de<br />
la technique par rapport à l’objectif biomécanique souhaité et de<br />
confirmer l’absence de perte de correction.<br />
Cette technique fiable et simple présente ainsi de nombreux<br />
avantages :<br />
− Simplification et allégement du geste chirurgical.<br />
− Stabilité mécanique immédiate.<br />
− Absence de complication liée au matériau de comblement<br />
utilisé.<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S119<br />
− Réhabitation radiologique constante et prouvée histologiquement.<br />
CONCLUSION. La qualité <strong>des</strong> résultats obtenus à long terme<br />
en fait une alternative raisonnable à l’usage d’une autogreffe iliaque.<br />
Elle doit être préférée aux matériaux inertes non réhabitab<strong>les</strong> et<br />
aux hétérogreffes source de complications propres (instabilité<br />
mécanique, lyse pseudoseptique).<br />
*J.-L. Sanouiller, Clinique <strong>des</strong> Lilas,<br />
41, avenue du Maréchal-Juin, 93260 Les Lilas.<br />
211 Évaluation radiographique <strong>des</strong><br />
ostéotomies tibia<strong>les</strong> de valgisation<br />
par ouverture interne ostéosynthésées<br />
par plaque de Puddu<br />
T. AMMARI*, P. BOISRENOULT, P.BEAUFILS<br />
INTRODUCTION. Le but de ce travail était l’évaluation radiologique<br />
<strong>des</strong> modifications architectura<strong>les</strong> du genou induites après<br />
ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne ostéosynthèsée<br />
par plaque de Puddu.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Quarante trois patients (45<br />
genoux) opérés entre 1999 et 2002 ont été revus de manière rétrospective.<br />
L’ostéotomie avait été réalisée pour une gonarthrose<br />
fémoro-tibiale médiale dans 39 cas, une laxité dans 3 cas et une<br />
association <strong>des</strong> deux pathologies dans 3 cas. Il s’agissait de 16<br />
femmes et 27 hommes d’âge moyen de 55 ans (22-73). Les radiographies<br />
de genoux standards (face et de profil à 30t de flexion) et<br />
<strong>les</strong> télémétries, réalisées en préopératoires et à la consolidation ont<br />
été analysées par deux observateurs indépendants (un junior, un<br />
senior). Les paramètres mesurés ont été : l’axe mécanique (angle<br />
HKA), l’existence d’un varus épiphysaire et sa correction, la hauteur<br />
rotulienne (indice de Caton-Deschamps), la pente tibiale. La<br />
valeur seuil de5%aétéretenue pour l’analyse statistique.<br />
RÉSULTATS. Les complications comportaient deux cas de<br />
pseudarthrose ayant nécessité une reprise chirurgicale. Les mesures<br />
étaient reproductib<strong>les</strong> entre <strong>les</strong> deux observateurs (p > 0,5).<br />
L’angle HKA moyen, à consolidationétait de 183,53 ± 2,28° pour<br />
un angle de correction prévu de 184,14 ± 0,93t (p = 0,0112).<br />
L’ostéotomie a permis la correction d’un varus constitutionnel<br />
dans 25/36 cas (p = 0,014). En l’absence de varus constitutionnel<br />
(9 cas), une obliquité de l’interligne tibio-talien a été observée<br />
dans 5 cas. La hauteur rotulienne préopératoire était de 0,86 ± 0,13<br />
contre 0,69 ± 0,16 en postopératoire, avec une différence statistiquement<br />
significative (p = 0,021). Le positionnement de la plaque<br />
sur la face interne de la métaphyse était postérieur dans 28 cas et<br />
moyen dans 17 cas, mais il n’existait pas de retentissement sur la<br />
pente tibiale lié au positionnement de la plaque (p = 0,175).<br />
DISCUSSION. L’ostéotomie tibiale d’ouverture interne ostéosynthèsée<br />
par plaque de Puddu, nous a permis : de réaliser la<br />
correction angulaire souhaitée en préopératoire et son maintien<br />
jusqu’à consolidation ; de corriger un varus constitutionnel existant,<br />
élément important pouvant conditionner l’équilibrage ligamentaire<br />
en cas de réalisation secondaire d’une prothèse totale de
3S120 78 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
genou. Dans notre série, la modification de la pente postérieure<br />
liée à la position de la plaque n’a pas été retrouvée contrairement à<br />
<strong>des</strong> travaux précédents. Il existait en revanche, un fort abaissement<br />
de la hauteur rotulienne.<br />
*T. Ammari, Service d’Orthopédie, Hôpital André-Mignot,<br />
177, rue de Versail<strong>les</strong>, 78150 Le Chesnay.<br />
212 Implantation mini-invasive d’une<br />
prothèse unicompartimentale de<br />
genou avec un système de navigation<br />
sans image : étude de faisabilité<br />
J.-Y. JENNY*, C. BOÉRI<br />
La qualité d’implantation est un facteur pronostique important<br />
de la survie à long terme <strong>des</strong> prothèses unicompartimenta<strong>les</strong> de<br />
genou. Les techniques mini-invasives permettent une rééducation<br />
plus rapide, au prix d’une diminution potentielle de cette qualité.<br />
Les systèmes de navigation pourraient éviter cet écueil. Les<br />
auteurs ont analysé une série préliminaire de vingt cas (groupe A)<br />
chez <strong>les</strong>quels une prothèse unicompartimentale fémorotibiale<br />
médiale (prothèse Searcht, Aesculap, Tuttlingen, RFA) a été<br />
implantée avec le système de navigation sans image OrthoPilott<br />
(Aesculap, Tuttlingen, RFA). Ce système utilise une analyse cinématique<br />
et anatomique peropératoire pour définir dans l’espace <strong>les</strong><br />
axes mécaniques du fémur et du tibia, axes sur <strong>les</strong>quels sont alignés<br />
<strong>les</strong> gui<strong>des</strong> de coupe fémoraux et tibiaux. Cette série a été<br />
comparée à une série historique rétrospective de 60 cas (groupe B)<br />
chez <strong>les</strong>quels la même prothèse a été implantée avec le même<br />
système de navigation mais avec un abord conventionnel imposant<br />
une subluxation fémoropatellaire. La qualité de l’implantation a<br />
été étudiée sur <strong>des</strong> télémétries du membre inférieur de face et de<br />
profil en mesurant <strong>les</strong> ang<strong>les</strong> suivants : angle fémorotibial mécanique<br />
de face, orientation de la prothèse tibiale de face et de profil,<br />
orientation de la prothèse fémorale de face et de profil, niveau<br />
vertical de l’interligne prothétique par rapport à l’interligne<br />
conservé.<br />
L’angle mécanique fémorotibial de face était dans la plage souhaitée<br />
dans 16 cas du groupe A (80 %) et 48 cas du groupe B (80<br />
%). Le composant fémoral était implanté de façon optimale chez<br />
18 cas du groupe A (90 %) et 54 cas du groupe B (90 %). Le<br />
composant tibial était implanté de façon optimale chez 17 cas du<br />
groupeA (85 %) et 53 cas du groupe B (88 %). Treize prothèses du<br />
groupe A (65 %) et 37 prothèses du groupe B (62 %) étaient<br />
implantées de façon optimale pour tous <strong>les</strong> critères étudiés. La<br />
longueur de l’incision variait de 7à10cmdans le groupe A.<br />
Aucune différence n’était significative.<br />
Le système de navigation utilisé permet une implantation très<br />
précise d’une prothèse unicompartimentale médiale du genou à la<br />
fois par la technique naviguée conventionnelle et par la technique<br />
mini-invasive. L’utilisation de la technique mini-invasive n’a pas<br />
diminué la qualité radiographique de l’implantation en comparaison<br />
de la technique naviguée conventionnelle. Cette technique<br />
pourrait définir la technique de référence pour l’implantation<br />
d’une prothèse unicompartimentale du genou.<br />
*J.-Y. Jenny, Centre de Traumtologie et d’Orthopédie,<br />
10, avenue Baumann, 67400 Illkirch.<br />
213 Arthroplastie unicompartimentale<br />
du genou par voie d’abord conventionnelle<br />
ou mini voie d’abord<br />
J.-N. ARGENSON*, X. FLECHER, A.FIGUIRA,<br />
J.-M. AUBANIAC<br />
INTRODUCTION. L’implantation d’une prothèse unicompartimentale<br />
(PUC) par une courte voie d’abord a été proposée afin<br />
d’améliorer la rapidité de récupération post-opératoire. Or la survie<br />
à long terme est très dépendante de la qualité d’implantation de<br />
la prothèse. Le but de cette étude est d’évaluer d’une part la qualité<br />
d’implantation radiographique et d’autre part la rapidité de récupération<br />
après arthroplastie unicompartimentale réalisée par mini<br />
voie d’abord ou voie d’abord conventionnelle.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Une série continue représentant<br />
<strong>les</strong> 25 premiers cas de PUC implantées par mini voie d’abord<br />
(groupe 1) a été comparée avec un groupe homogène apparié au<br />
sein d’une série de 145 PUC implantées par voie d’abord identique<br />
à celle d’une prothèse totale du genou (groupe 2). Les groupes<br />
étaient comparab<strong>les</strong> concernant le sexe, le poids, la taille et l’âge<br />
<strong>des</strong> patients. La même PUC interne cimentée avec embase tibiale<br />
métallique a été implantée dans <strong>les</strong> deux groupes. Sur le plan<br />
radiographique ont été mesurés en postopératoire l’axe mécanique<br />
global, l’angle d’implantation fémoral et tibial, et la pente tibiale<br />
postérieure.<br />
RÉSULTATS. Il n’a pas été retrouvé de différence significative<br />
pour l’axe mécanique (respectivement 3,6t et 4,7t) pour <strong>les</strong> groupes<br />
1 et 2, l’angle d’implantation tibial (87t et 88t), la pente<br />
tibiale postérieure (2,6t et 2t). L’angle d’implantation fémoral<br />
était également comparable (2,3t et 2,9t) à l’exception d’un cas<br />
divergent à 9t dans le groupe 1. Les délais d’hospitalisation, d’utilisation<br />
<strong>des</strong> cannes et de retour aux exercices actifs étaient significativement<br />
plus courts dans le groupe 1. Les pertes sanguines<br />
respectivement 222 et 244 ml, le niveau de douleur post-opératoire<br />
sur échelle analogique, et la flexion complète à un an de l’intervention<br />
étaient comparab<strong>les</strong>.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. La différence essentielle<br />
de technique entre <strong>les</strong> deux groupes est l’absence d’éversion de la<br />
rotule et de rupture de continuité de l’appareil extenseur dans la<br />
mini voie d’abord. Ceci explique probablement la récupération<br />
plus rapide de la fonction et <strong>des</strong> activités dans ce groupe. Le cas de<br />
divergence fémoral important noté dans ce groupe doit inciter à<br />
une vigilance accrue pour la position <strong>des</strong> gui<strong>des</strong> de coupe spécifiques<br />
à cette courte voie d’abord. Pour que <strong>les</strong> résultats à long terme<br />
<strong>des</strong> PUC implantées par mini voie d’abord soient comparab<strong>les</strong> à<br />
ceux publiés avec une voie d’abord conventionnelle, <strong>les</strong> mêmes
critères de sélection <strong>des</strong> patients et d’implantation prothétique<br />
doivent être réunis.<br />
*J.-N. Argenson, Service de Chirurgie Orthopédique,<br />
Hôpital Sainte-Marguerite, 270, boulevard de<br />
Sainte-Marguerite, 13009 Marseille.<br />
214 Prothèses unicompartimenta<strong>les</strong> du<br />
genou type Alpina : évaluation prospective<br />
à5ans<br />
R. LIMOZIN*, J.-P. FAYARD, L.DUPRÉ-LATOUR,<br />
F. CHALENCON<br />
INTRODUCTION. La réputation <strong>des</strong> prothèses unicompartimenta<strong>les</strong><br />
(PUC) a souffert « d’erreurs de jeunesse », toutefois<br />
dans <strong>des</strong> limites d’indication et de réalisation précises elle donne<br />
d’excellents résultats pour une faible morbidité. Nous avons évalué<br />
<strong>les</strong> résultats cliniques et radiologiques à 5 ans de la prothèse<br />
Alpina-Uni.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Cinquante-huit PUC dont 88 %<br />
internes ont été posées en 1995 par 2 opérateurs différents, l’analyse<br />
radiologique a été réalisée par un observateur indépendant. La<br />
population d’âge moyen de 72 ans a été suivieà3mois,1anet5<br />
ans avec une évaluation clinique (score de la Knee Society (KSS))<br />
et radiologique. Les indications concernaient <strong>des</strong> gonarthroses<br />
latéralisées non disloquées essentiel<strong>les</strong>, nécrotiques et posttraumatiques.<br />
Quatre-vingt-dix pour cent <strong>des</strong> implants ont été<br />
cimentés. <strong>Tous</strong> <strong>les</strong> résultats et leur évolution ont été traités avec le<br />
logiciel SPSS.<br />
RÉSULTATS. Cinquante et un patients ont été revus à 5 ans, 4<br />
sont décédés, nous déplorons un perdu de vue et 2 échecs précoces<br />
(une rupture secondaire de LCA, un enfoncement antérieur<br />
d’embase tibiale). La survie à 70 mois est de 95 %. Le KSS a été<br />
significativement amélioré (+ 61, p < 0,001) et reste stable au<br />
cours du suivi. La flexion moyenne à 5 ans est de 131°. L’analyse<br />
radiologique est rassurante : aucune dégradation du compartiment<br />
controlatéral ou de la fémoro-patellaire, aucun <strong>des</strong>cellement ou<br />
migration d’implant, pas d’usure anormale du polyéthylène. Il<br />
existait 17 % de liserés non évolutifs, inférieurs à 1 mm. La pente<br />
tibiale moyenne était de 5°. Il n’existait aucune différence significative<br />
entre <strong>les</strong> inclinaisons épiphysaires fémorotibia<strong>les</strong> préopératoires<br />
et postopératoires aux différentes révisions. L’axe fémorotibial<br />
mécanique (HKA) était significativement amélioré par<br />
l’intervention (p < 0,001), stable au cours du suivi, laissant persister<br />
une hypocorrection moyenne entre 1 et 5°.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. Les conclusions du symposium<br />
de la SOFCOT de 1995 ont souligné l’importance <strong>des</strong><br />
indications et du positionnement précis <strong>des</strong> implants dans la prévention<br />
<strong>des</strong> échecs précoces. L’ancillaire de l’Alpina-Uni a permis<br />
de reproduire avec précision dans <strong>les</strong> coupes <strong>les</strong> inclinaisons épiphysaires<br />
fémora<strong>les</strong> et tibia<strong>les</strong> préopératoires permettant de restaurer<br />
l’anatomie initiale, la correction de l’HKA ne s’expliquant<br />
que par correction de l’usure. Ceci peut expliquer le faible taux de<br />
<strong>des</strong>cellement et d’usure de cette série. Le remplacement unicompartimental<br />
constitue une excellente indication chez le sujet âgé du<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S121<br />
fait de sa faible morbidité. Les résultats à moyen terme sont encourageants,<br />
il nous reste à évaluer leur longévité après 10 ans.<br />
*R. Limozin, Clinique Mutualiste, 3, rue le Verrier,<br />
42013 Saint-Etienne.<br />
215 Prothèses fémoro-patellaires isolées<br />
: analyse <strong>des</strong> résultats à long<br />
terme<br />
J.-L. SANOUILLER*, P. CARTIER<br />
Entre 1974 et 1991, sur 115 prothèses- fémoro patellaires<br />
cimentées type Bechtol-Blazina implantées, 59 ont été revues.<br />
Quarante et une femmes et neuf hommes (9 cas bilatéraux), d’âge<br />
moyen 60 ans. Le recul moyen est de 10 ans (extrêmes 6-16 ans).<br />
L’étiologie principale était l’arthrose primitive (82 %), suivie<br />
par la chondrocalcinose 6 %, la chondromalacie 7 % et l’arthrose<br />
secondaire 5 %. Dix huit genoux avaient déjà subi une intervention,<br />
14 fois fémoro-patellaire et 4 fois fémoro-tibiale.<br />
Les interventions associées ont consisté en 15 transferts tubérositaires,<br />
2 ostéotomies tibia<strong>les</strong> et une remise en tension de l’aileron<br />
interne.<br />
L’évaluation par la cotation de la Société Internationale du<br />
Genou, a objectivé 91 % de bons et excellents résultats et 9 % de<br />
résultats insuffisants, tant en ce qui concerne le score du genou<br />
opéré que la fonction. Le taux de survie à 10 ans calculé selon la<br />
méthode actuarielle est de 84,4 %. Il chute de 91,1 % à 75,5 %<br />
entre la 9 e et la 11 e année par détérioration fémoro tibiale. Ni<br />
phlébite, ni infection ni <strong>des</strong>cellement prothétique n’ont été notés.<br />
Les causes d’échec ont été beaucoup plus souvent fémorotibia<strong>les</strong><br />
(8 détériorations) que fémoro patellaires (2 ressauts et 3<br />
syndromes douloureux para-patellaires externes). Treize réinterventions<br />
ont été nécessaires : 8 arthroplasties tricompartimentaires,<br />
1 changement d’orientation de la pièce trochléenne,<br />
3 libérations de l’aileron rotulien externe et une<br />
démaquetisation. La sédation totale ou sub-totale <strong>des</strong> douleurs a<br />
été obtenue dans 80 % <strong>des</strong> cas, l’angle de flexion moyen était de<br />
123 degrés et la fonction dans <strong>les</strong> escaliers a été jugée normale<br />
dans 91 % <strong>des</strong> cas. <strong>Tous</strong> <strong>les</strong> genoux étaient stab<strong>les</strong>. Sur le plan<br />
radiologique, n’ont été observés que 6 remodelés du polyéthylène<br />
et un cas d’usure notable associé à une dégradation fémoro-tibiale<br />
importante. Cette absence d’usure significative est à notre avis<br />
essentiellement due à l’absence de support métal Back sous le<br />
polyéthylène rotulien.<br />
Il ressort de notre étude <strong>les</strong> indications suivantes :<br />
− indications idéale : l’arthrose fémoro-patellaire isolée sur<br />
dysplasie.<br />
− indications relative : l’arthrose fémoro patellaire évoluée sur<br />
membre présentant une déviation axiale sans retentissement<br />
fémoro tibiale clinique ou radiologique (Shuss). Dans ce cas la<br />
prothèse fémoro patellaire permet de retarder la mise en place<br />
d’une prothèse tri-compartimentaire chez <strong>les</strong> patients d’âge<br />
moyen.<br />
Les contre-indications principa<strong>les</strong> sont la chondromalacie rotulienne,<br />
la chondrocalcinose, la rotule basse et l’existence d’une<br />
atteinte fémoro-tibiale associée.
3S122 78 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
CONCLUSION. Les résultats à long terme cliniques et radiologiques<br />
de l’arthroplastie fémoro-patellaire en font l’intervention<br />
de choix dans le traitement <strong>des</strong> arthroses fémoro-patellaires isolées<br />
et évoluées sur membre normo-axé pour <strong>les</strong>quel<strong>les</strong> un geste<br />
conservateur ne peut être envisagé ou a déjà échoué. Efficace sur la<br />
douleur et la stabilité du genou, cette intervention de réalisation<br />
SÉANCE PROFESSIONNELLE<br />
217 Le point sur l’E.P.P.<br />
(Évaluation <strong>des</strong> Pratiques Professionnel<strong>les</strong>)<br />
délicate doit faire appel à <strong>des</strong> implants congruents pour éviter <strong>les</strong><br />
problèmes d’instabilité prothétique et de ressaut patellaire.<br />
*J.-L. Sanouiller, Clinique <strong>des</strong> Lilas,<br />
41, avenue du Maréchal-Juin, 93260 Les Lilas.<br />
J. CATON<br />
Président du SNCO (Lyon)<br />
Quels sont <strong>les</strong> grands principes de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et du décret n° 99-1130 du 28 décembre 1999 ?<br />
Le décret rappelle que l’évaluation <strong>des</strong> pratiques professionnel<strong>les</strong> a pour finalité l’amélioration de la qualité <strong>des</strong> soins. Cette évaluation<br />
concerne tous <strong>les</strong> médecins exerçant la médecine dans le cadre libéral, généralistes et spécialistes.<br />
L’engagement dans la démarche est volontaire. Les médecins engagés dans l’évaluation sont <strong>les</strong> seuls <strong>des</strong>tinataires <strong>des</strong> conclusions. Ils<br />
reçoivent l’aide de confrères habilités qui accompagnent la démarche d’évaluation de leurs pairs.<br />
Il est prévu deux types d’évaluation : l’évaluation individuelle et l’évaluation collective.<br />
La responsabilité de l’organisation de l’évaluation <strong>des</strong> pratiques professionnel<strong>les</strong> repose sur <strong>les</strong> collèges (généralistes et spécialistes)<br />
constituant <strong>les</strong> Unions Régiona<strong>les</strong> <strong>des</strong> Médecins Libéraux (URML). L’ANAES apporte son concours en termes de méthode et d’outil<br />
d’évaluation. L’évaluation <strong>des</strong> pratiques professionnel<strong>les</strong> est menée à partir de gui<strong>des</strong> élaborés ou validés par l’ANAES qui sont <strong>les</strong><br />
référentiels.<br />
Les unions (URML) recrutent <strong>les</strong> médecins habilités à l’évaluation et <strong>les</strong> rémunèrent, l’ANAES assurant leur formation initiale et<br />
continue, et conduisant leur propre auto-évaluation. L’ANAES aide à l’élaboration et valide <strong>les</strong> gui<strong>des</strong> d’évaluation et <strong>les</strong> référentiels<br />
permettant ainsi aux médecins habilités d’accompagner <strong>les</strong> professionnels.<br />
L’évaluation <strong>des</strong> Pratiques Professionnel<strong>les</strong> permet de porter une appréciation sur la qualité <strong>des</strong> pratiques de soins, de faire <strong>des</strong><br />
recommandations pour <strong>les</strong> améliorer, c’est une incitation.<br />
La plupart <strong>des</strong> Unions régiona<strong>les</strong> se sont déjà engagées dans ce processus.<br />
Un groupe de travail commun a été constitué entre <strong>les</strong> Unions Professionnel<strong>les</strong> <strong>des</strong> Médecins Libéraux et l’ANAES pour assurer le suivi<br />
de cette évaluation.<br />
La fédération de Chirurgie Orthopédie, qui regroupe la SO.F.C.O.T., le Syndicat (SNCO) et le Collège est en cours d’élaboration de<br />
4 référentiels de la spécialité portant sur le contenu du compte rendu opératoire (CRO). Le CRO d’une PTH, la fracture de l’extrémité<br />
supérieure du radius chez l’adulte et la fracture de l’extrémité supérieure du radius chez l’enfant.<br />
Assurances professionnel<strong>les</strong> : Loi Kouchner, Loi About, ONIAM<br />
(Office National d’Indemnisation <strong>des</strong> Accidents Médicaux). Où en sommes-nous ?<br />
J. CATON<br />
Secrétaire Général du SNCO<br />
De récents arrêts de la Cour de cassation, la loi Kouchner du 4 mars 2002 ainsi que la loi About du 30 décembre 2002 ont grandement<br />
modifié l’environnement judiciaire de l’exercice médical en France.<br />
Traditionnellement, en droit français, le médecin était responsable de sa faute professionnelle lorsque le patient, ou sa famille s’il décédait,<br />
établissait une faute, un dommage subit, un lien de causalité entre la faute et le dommage.<br />
La jurisprudence a évolué depuis une vingtaine d’années avec une tendance protectrice <strong>des</strong> intérêts du patient, la loi Kouchner du 4 mars<br />
2002 a tenu compte de cette évolution, en renversant purement et simplement <strong>les</strong> obligations respectives du médecin et du patient en matière<br />
de preuves.<br />
En effet, jusqu’à une période récente, nous étions sur la notion que le médecin français doit donner <strong>des</strong> soins consciencieux dévoués et<br />
fondés sur <strong>les</strong> données acquises de la science.<br />
De nombreux arrêts de la Cour de cassation ont transformé ce qui n’était qu’une obligation de moyens en une véritable obligation de<br />
résultats, notamment en ce qui concerne <strong>les</strong> infections nosocomia<strong>les</strong>. En effet, depuis un arrêt de 1951 la Cour de cassation juge en<br />
permanence, sauf pour la chirurgie esthétique que la preuve du défaut d’information, incombe au patient. En 1997, un revirement de la<br />
jurisprudence a modifié totalement la relation médecin-patient, notamment en ce qui concerne l’obligation particulière d’information<br />
vis-à-vis du patient. Selon l’arrêt Hedreul, il incombe au médecin de prouver qu’il a exécuté cette obligation.<br />
La question délicate a été de définir jusqu’où la preuve de l’information sur <strong>les</strong> risques devait être apportée. Un arrêt du 5 octobre 1998 de<br />
la Cour de cassation a supprimé le critère de fréquence pour ne retenir que le critère de gravité, le médecin devant informer sur <strong>les</strong> risques<br />
graves et même exceptionnels.
La loi Kouchner du 4 mars a élargi encore le champ d’application de l’obligation d’informer en cumulant <strong>les</strong> critères de fréquence et de<br />
gravité <strong>des</strong> risques encourus et renversé définitivement la preuve de la charge qui incombe désormais aux professionnels ou à l’hôpital public<br />
ou privé. Par ailleurs, la loi Kouchner a également déclaré systématiquement <strong>des</strong> établissements de santé responsab<strong>les</strong> <strong>des</strong> dommages<br />
résultant d’infections nosocomia<strong>les</strong> sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. Il a résulté de tout cela que de nombreux assureurs<br />
ont menacé de se retirer du marché, la loi Kouchner créant par ailleurs un Office National d’indemnisation <strong>des</strong> infections nosocomia<strong>les</strong><br />
l’ONIAM, prenant en charge <strong>les</strong> patients présentant un taux d’incapacité permanent, inférieur ou égal à 25 % ou un arrêt de travail supérieur<br />
ou égal à six mois.<br />
Le 30 décembre 2002, la loi About est venue compléter la loi Kouchner créant également un grand trouble au niveau assuranciel, puisque<br />
du fait de l’article 5 de cette loi, lorsqu’un praticien change d’assurance, son passif est repris par la nouvelle assurance. Tout ceci a abouti à<br />
une augmentation considérable <strong>des</strong> primes d’assurance, parfois multipliées par dix pour <strong>les</strong> orthopédistes. C’est pour cette raison que le<br />
SNCO s’est rapproché <strong>des</strong> URML pour modifier ces lois.<br />
218 Technique originale de reprise<br />
fémorale en cas de combinaison<br />
d’une perte de substance osseuse<br />
et d’une déformation fémorale<br />
F. BONNOMET*, F. GIRAUD, C.CHANTELOT,<br />
Y. PINOIT, J.-F. KEMPF, H.MIGAUD<br />
INTRODUCTION. La révision d’une prothèse fémorale peut<br />
être difficile lorsque sont associées perte de substance osseuse et<br />
déformation fémorale, en particulier, lorsque cette déformation<br />
interdit l’implantation d’une prothèse longue alors que la sévérité<br />
de la perte de substance en justifierait l’utilisation. Nous décrivons<br />
une technique originale permettant de résoudre simultanément ces<br />
deux problèmes et rapportons <strong>les</strong> résultats préliminaires à propos<br />
de 5 cas.<br />
PATIENTS ET MÉTHODES. La technique, appliquées chez 5<br />
patients, consiste en une ou plusieurs ostéotomies étagées (pour<br />
corriger la déformation dans un ou plusieurs plans), fixées par un<br />
implant fémoral verrouillé. Une fémorotomie a été associée dans 4<br />
cas pour faciliter l’ablation <strong>des</strong> implants précédents, consitutant<br />
alors une <strong>des</strong> ostéotomies de correction. Dans un cas, une pseudarthrose<br />
de grand trochanter fut traitée par plaque autogreffe. Il<br />
s’agissait de 3 homes et d’une femme d’âge moyen 72 ans (65 à 83<br />
ans). Selon le score de la SOFCOT la perte de substance fémorale<br />
était de grade II quatre fois et une fois de grade III. <strong>Tous</strong> <strong>les</strong> fémurs<br />
avaient une déformation en varus (en moyenne de 21° (16° à 40°),<br />
et deux fémurs associaient une déformation de f<strong>les</strong>sum de 40° et<br />
45°. L’ostéotomie de correction diaphysaire était simple 4 fois et à<br />
double étage une fois. L’implant fémoral verrouillé était de 250<br />
mm trois fois et deux fois de 300 mm.<br />
RÉSULTATS. Le recul moyen était de 3,5 ans (0,5 à 5 ans). Un<br />
patient est décédé précocement à 6 mois à la suite d’une autolyse.<br />
Le score de Merle d’Aubigné moyen est passé de 9,4 (7 à 11) à 16,4<br />
(15 à 18). La pseudoarthrose trochantérienne et toutes <strong>les</strong> ostéotomies<br />
ont consolidé en 3à4moissauf une pseudoarthrose de<br />
l’ostéotomie diaphysaire assez bien tolérée (PMA à 16) (cas sans<br />
fémorotomie pour lequel il n’y avait pas eu de recalibrage du<br />
fémur proximal). Dans <strong>les</strong> cas consolidés, un remodelage et/ou<br />
une reconstruction spontanée du fémur ont été observés sans<br />
qu’aucune greffe n’ait été utilisée pour la reconstruction diaphy-<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S123<br />
Séance du 13 novembre matin<br />
HANCHE<br />
saire.Aucun aspect de « stress-shielding » n’a été observé pour <strong>les</strong><br />
patients au recul important, alors que ces tiges non cimentées<br />
avaient une fixation distale assurée par le verrouillage et qu’el<strong>les</strong><br />
ne possédaient aucun traitement de surface.<br />
CONCLUSIONS. Cette technique proposée dans cette indication<br />
spécifique permet de résoudre le double problème de la fixation<br />
et de correction de la déformation tout en autorisant une<br />
reconstruction spontanée autour d’un implant non cimenté verrouillé.<br />
Le recours à une fémorotomie est conseillé pour permettre<br />
de recalibrer et de stabiliser le fémur proximal contre la tige. Un<br />
plus long recul est nécessaire pour connaître la pérennité de cette<br />
reconstruction spontanée. Cependant une désescalade peut facilement<br />
être envisagée sur ces implants non réhabitab<strong>les</strong> se comportant<br />
comme une ostéosynthèse centro-medullaire verrouillée.<br />
*F. Bonnomet, Service d’Orthopédie,<br />
Hôpital de Hautepierre, 67098 Strasbourg Cedex.<br />
219 Prise en charge <strong>des</strong> <strong>des</strong>cellements<br />
fémoraux par tige longue cimentée :<br />
à propos d’une série de 135 cas<br />
avec analyse actuarielle à 14 ans<br />
O. GOSSELIN*, O. ROCHE, F.SIRVEAUX,<br />
E. VILLANUEVA, M.DE GASPERI, D.MOLÉ<br />
INTRODUCTION. En 1988, <strong>les</strong> conclusions du symposium de<br />
la SOFCOT semblaient condamner l’utilisation d’implants cimentés<br />
dans <strong>les</strong> reprises <strong>des</strong> <strong>des</strong>cellements fémoraux. Onze ans plus<br />
tard, lors du symposium de 1999, Vidalain démontrait que la<br />
cimentation demeurait une alternative raisonnable. Le but de cette<br />
étude rétrospective était d’estimer <strong>les</strong> résultats, à long terme, <strong>des</strong><br />
reprises par tige longue cimentée sans reconstruction du stock<br />
osseux.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. De 1987 à 1995, 135 patients<br />
(135 hanches) ont été pris en charge selon cette technique. Quatrevingt-quinze<br />
dossiers ont pu être exploités (15 patients perdus de<br />
vue et 25 patients décédés). Il s’agissait de 66 femmes et 29 hommes<br />
; l’âge moyen était de 70 ans à la reprise (42-86). Le score<br />
fonctionnel pré-opératoire (PMA) était de 8/18. Les implants<br />
fémoraux en place étaient cimentés dans 80 % <strong>des</strong> cas, non cimen-
3S124 78 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
tés dans 20 % <strong>des</strong> cas. Selon <strong>les</strong> critères de la SOFCOT, 65 % <strong>des</strong><br />
<strong>des</strong>cellements étaient de stade 2, 29,5 % de stade 3. Il s’agissait de<br />
<strong>des</strong>cellements aseptiques ; tous <strong>les</strong> patients ont été pris en charge<br />
selon la même technique : dépose-repose <strong>des</strong> deux versants prothétiques,<br />
utilisation au fémur d’une tige longue cimentée sans<br />
greffe associée.<br />
RÉSULTATS. Le recul moyen était de 8 ans (60-157 mois).<br />
Trente-neuf pour cent <strong>des</strong> patients ont présenté <strong>des</strong> complications<br />
postopératoires précoces. Le score fonctionnel moyen à la révision<br />
est de 14,8/18 avec 62,4 % de résultats considérés comme TB et<br />
B : l’âge, la restitution du centre de rotation, la qualité de la cimentation<br />
et l’adéquation dimensionnelle tige/fémur ont influencé de<br />
façon significative le résultat. A l’analyse radiographique, un<br />
liseré évolutif ou complet est présent dans 32 % <strong>des</strong> cas ; seu<strong>les</strong><br />
36 % <strong>des</strong> tiges fémora<strong>les</strong> sont exemptes de tout liseré. L’analyse<br />
actuarielle du taux de survie cumulée en prenant comme critère<br />
d’échec toute reprise chirurgicale retrouve un taux de survie de<br />
87 % à 14 ans ; ce taux chute à 65,5 % si l’on inclut <strong>les</strong> <strong>des</strong>cellements<br />
radiographiques certains.<br />
CONCLUSION. L’utilisation d’une tige longue cimentée dans<br />
<strong>les</strong> reprises de PTH donne <strong>des</strong> résultats fonctionnels acceptab<strong>les</strong> à<br />
long terme, résultats altérés de façon significative par toute imperfection<br />
technique. Ce type d’implant, condamnant tout espoir de<br />
restauration du stock osseux, doit être réservé aux sujets âgés pour<br />
<strong>les</strong>quels un geste chirurgical plus « ambitieux » semble risqué.<br />
Clinique de Traumatologie et d’Orthopédie,<br />
49, rue Hermite, 54052 Nancy Cedex.<br />
220 Tiges verrouillées dans <strong>les</strong> reprises<br />
de PTH : résultats selon <strong>les</strong> modalités<br />
de fixation<br />
F. LANGLAIS*, M. PORTILLO, J.-C. LAMBOTTE,<br />
M. ROPARS, H.THOMAZEAU<br />
INTRODUCTION. Une série continue de 32 tiges verrouillées<br />
à métaphyse recouverte d’HA a été revue avec un recul maximum<br />
de 5 ans pour juger de l’influence <strong>des</strong> modalités de fixation distale<br />
(diaphysaire) et métaphysaire sur <strong>les</strong> résultats cliniques et radiologiques<br />
(fixation diaphysaire distale : serrée ou modérée ? recouvrement<br />
d’HA : complet ou métaphysaire seul ? voie d’abord : par<br />
volet ou endofémorale ?).<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Ces tiges ont été utilisées pour<br />
traiter <strong>des</strong> ostéolyses fémora<strong>les</strong> souvent importantes (35 % de<br />
<strong>des</strong>cellement fémoral de stade SOFCOT 3 et 4), avec également<br />
<strong>des</strong> ostéolyses acétabulaires importantes (59 % d’ostéolyses segmentaires<br />
et 47 % de reprises avec allogreffes structura<strong>les</strong>). Dixneuf<br />
tiges étaient implantées par volet fémoral et 13 par voie<br />
endofémorale. Vingt-six tiges étaient verrouillées par vis. Pour<br />
étudier l’influence du mode de fixation sur <strong>les</strong> résultats cliniques et<br />
radiologiques, la « régénération » métaphysaire a été étudiée,<br />
ainsi que l’ancrage diaphysaire per opératoire. Cet ancrage a été<br />
considéré comme « serré » lorsque l’endoste et la tige étaient en<br />
contact sur une hauteur de plus de 40 mm, et que la différence de<br />
diamètre entre l’endoste et la tige était d’1 mm ou moins.<br />
L’ancrage était « modéré » lorsque la hauteur de contact était inférieure<br />
à 40 mm ou la différence de diamètre endoste — tige supérieureà2mm.<br />
RÉSULTATS. Les résultats sont encourageants, avec une fonction<br />
clinique moyenne (PMA) à 15/18, et une fixation diaphysaire<br />
de la prothèse stable dans 31 cas (une seule migration d’environ 1<br />
cm avec recalage secondaire, survenant sur un cas non verrouillé).<br />
Ilyaeupeudecomplications : pas d’infection, 1 luxation isolée,<br />
aucune rupture de vis mais 3 changements de vis trop longues, 1<br />
pseudarthrose trochantérienne non réopérée. Dans <strong>les</strong> 22 cas ayant<br />
un recul de plus d’un an, la fixation diaphysaire de la tige était<br />
complète (aucun liseré ostéolytique), une ligne de densification<br />
osseuse était observée distalement dans 10 cas (notamment ceux<br />
ayant l’ancrage le moins important). Il semblait exister une régénération<br />
osseuse autour de la métaphyse HA dans 50 % <strong>des</strong> cas, et<br />
il n’y avait aucune ostéolyse secondaire. Cette « régénération » ne<br />
semblait pas différente entre <strong>les</strong> volets et <strong>les</strong> voies endofémora<strong>les</strong>.<br />
Elle était identique, que l’ancrage diaphysaire distal soit serré<br />
(63 % <strong>des</strong> cas) ou modéré. Il n’y avait pas de résorption métaphysaire<br />
par stress shielding, même lorsque la tige était distalement<br />
recouverte d’HA.<br />
CONCLUSION. De bons résultats semblent pouvoir être obtenus<br />
à moyen terme par ce type de prothèse, avec une fixation<br />
distale courte (60 mm ?), limitant l’escalade diaphysaire, et sans<br />
recours systématique au volet fémoral.<br />
*F. Langlais, CHU Hôpital Sud, 16, boulevard de Bulgarie,<br />
BP 90437, 35203 Rennes Cedex 2.<br />
221 Reprise <strong>des</strong> PTH <strong>des</strong>cellées par<br />
tige fémorale verrouillée « Ultime<br />
» : à propos de 78 cas avec un<br />
recul moyen de 4 ans<br />
E. HAVET*, J. BERTHELET, A.GABRION,<br />
P. MERTL, M.DE LESTANG<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Les auteurs rapportent une série<br />
de 78 révisions de prothèse de hanche par la tige verrouillée<br />
« Ultime ». Il s’agissait de <strong>des</strong>cellement aseptique pour 88 % <strong>des</strong><br />
cas, de <strong>des</strong>cellement septique pour 12 %. Dix-sept pour cent<br />
étaient associés à une fracture. Le score PMA préopératoire<br />
moyen était de 10,2 points. Selon la classification de Vives-<br />
SOFCOT, 29 % <strong>des</strong> <strong>des</strong>cellements étaient de stade 1, 37 % de<br />
stade 2, 24 % de stade 3 et 10 % de stade 4. Les fractures étaient<br />
associées à un <strong>des</strong>cellement dans tous <strong>les</strong> cas. Cinquante-sept<br />
volets fémoraux et 14 trochantérotomies ont été réalisées. Les 8<br />
premiers patients de cette série ont bénéficié d’une allogreffe<br />
osseuse (greffons morcelés impactés). Dans la plupart <strong>des</strong> cas, la<br />
reprise de l’appui a été autorisée à la première semaine. Les<br />
patients ont été revus et évalués selon le score de Postel Merle<br />
d’Aubigné. Les radiographies de face et de profil ont évalué <strong>les</strong><br />
zones de contact tige-os, ainsi que <strong>les</strong> épaisseurs cortica<strong>les</strong> à trois<br />
niveaux différents.<br />
RÉSULTATS. Les complications précoces ont été une phlébite<br />
et 5 hématomes superficiels. Les complications tardives ont été 6<br />
luxations, 2 fractures de tige et 3 infections profon<strong>des</strong>. Au recul,<br />
81 % <strong>des</strong> <strong>des</strong>cellements aseptiques, 77 % <strong>des</strong> <strong>des</strong>cellements septiques<br />
et 70 % <strong>des</strong> fractures sur tige avaient un score PMA coté bon<br />
à excellent avec un gain moyen respectif de 4, 5 et 1 points. La<br />
reconstruction osseuse était plus marquée sur la corticale interne
(de 2 à 4,4 mm en moyenne) et le contact tige-os était augmenté<br />
dans <strong>les</strong> deux tiers supérieurs de la tige. Aucun bénéfice n’a été<br />
observé avec <strong>les</strong> allogreffes. Par ailleurs, 28 % <strong>des</strong> patients présentaient<br />
<strong>des</strong> douleurs de cuisse pour <strong>les</strong>quel<strong>les</strong> aucune relation n’a pu<br />
être établie avec <strong>les</strong> données cliniques <strong>des</strong> patients ou <strong>les</strong> caractéristiques<br />
<strong>des</strong> implants. La moitié de ces patients ont été réopérés<br />
pour « désescalade ».<br />
CONCLUSION. Dans cette série, l’amélioration fonctionnelle<br />
est similaire aux quelques séries publiées. Le volet fémoral associé<br />
facilite le geste chirurgical et diminue <strong>les</strong> complications peropératoires.<br />
La prothèse « Ultime » répond aux objectifs fixés par son<br />
concepteur que sont la stabilité primaire et surtout la reconstruction<br />
osseuse, autorisant ainsi une éventuelle désescalade.<br />
*E. Havet, Service de Chirurgie Orthopédique,<br />
Centre Hospitalier Universitaire, 80000 Amiens.<br />
222 La technique Exeter : résultats<br />
après reprise de prothèse de hanche<br />
pour <strong>des</strong>cellement fémoral (à<br />
propos de 18 cas)<br />
P. OGER*, G. VIGUIE, P.BOISRENOULT,<br />
P. BEAUFILS<br />
INTRODUCTION. Notre but était de présenter <strong>les</strong> résultats<br />
cliniques et radiologiques de notre expérience de la technique<br />
d’Exeter dans <strong>les</strong> reconstructions fémora<strong>les</strong> lors <strong>des</strong> reprises de<br />
prothèses de hanche.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Dix-huit patients (18 hanches),<br />
opérés entre 1994 et 2001, ont été revus au recul moyen de 3,5 ans<br />
(1-7,5 ans). L’âge moyen était de 67,2 ans (27-78 ans). Il s’agissait<br />
de 17 <strong>des</strong>cellements aseptiques, et d’un <strong>des</strong>cellement septique. Le<br />
défect fémoral était coté 6 fois sta<strong>des</strong> II et 12 fois sta<strong>des</strong> III (classification<br />
SOFCOT). Le score PMA moyen préopératoire était de<br />
13,06 [douleur : 3,4 (2 à 5) ; mobilité : 5,9 ; fonction : 3,8 (2 à 6)].<br />
L’évaluation postopératoire comportait l’analyse <strong>des</strong> complications,<br />
le score PMA, et radiographiquement, la recherche de liserés,<br />
l’aspect <strong>des</strong> greffons et <strong>des</strong> cortica<strong>les</strong> (classification de Gie).<br />
La migration prothétique était mesurée par la méthode EBRA-<br />
FCA. Une seuil de 5 % a été choisit pour l’analyse statistique.<br />
RÉSULTATS. Cinq complications ont été notées : 3 fractures<br />
du grand trochanter, un déficit ischiatique sensitivo-moteur<br />
(fausse route fémorale), une fracture sous prothèse à 4,5 mois<br />
(brèche corticale). Le score PMA moyen global final était à 17<br />
[douleur : 5,4 (3 à 6) ; mobilité : 6 ; fonction : 5,6 (4 à 6)]. Radiographiquement,<br />
il existait dans 13 cas, un épaississement cortical<br />
avec incorporation <strong>des</strong> greffons et apparition de travées osseuses,<br />
dans 3 cas une incorporation isolée <strong>des</strong> greffons, et 1 cas d’épaississement<br />
cortical isolé. Un cas n’était pas analysable (treillis<br />
métallique). L’analyse EBRA a été utilisée dans 14 cas. Après <strong>les</strong><br />
lésions de stade II, la médiane de l’enfoncement était de 2,8 mm<br />
(1,55 mm à 6,25 mm) contre respectivement 6,5 mm (2,1 à 8,7<br />
mm) dans <strong>les</strong> sta<strong>des</strong> III [non significatif (p = 0,35)].<br />
DISCUSSION. La technique Exeter est une <strong>des</strong> solutions aux<br />
pertes de substance fémora<strong>les</strong> lors <strong>des</strong> reprises de PTH. Elle nous<br />
a permis de bons résultats cliniques (PMA global final 17 vs 13).<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S125<br />
Radiologiquement, dans la majorité <strong>des</strong> cas, il existait une bonne<br />
intégration de la greffe sans signe de <strong>des</strong>cellement. Les enfoncements<br />
prothétiques (méthode EBRA : méthode de référence)<br />
étaient légèrement supérieurs aux résultats publiés, sans corrélation<br />
entre enfoncement et stade lésionnel initial, ou avec le résultat<br />
clinique.<br />
CONCLUSION. La technique Exeter est fiable et efficace, elle<br />
représente une réelle désescalade par rapport aux autres techniques<br />
en cas de perte osseuse fémorale.<br />
*P. Oger, Service d’Orthopédie Traumatologie,<br />
Hôpital André-Mignot, 177, rue de Versail<strong>les</strong>,<br />
78150 Le Chesnay.<br />
223 Reprise fémorale de prothèse totale<br />
de la hanche par tige sans ciment<br />
sur mesure<br />
J. TABUTIN*, D. VANDEVELDE, J.-L. CHATELAN,<br />
P. ESSIG<br />
INTRODUCTION. Cette étude rétrospective multicentrique<br />
essaie de cerner <strong>les</strong> indications <strong>des</strong> reprises fémora<strong>les</strong> par implant<br />
sans ciment sur mesure.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Nous avons colligé <strong>les</strong> dossiers<br />
<strong>des</strong> implants fémoraux de reprise sur mesure sans ciment utilisés<br />
par <strong>les</strong> membres de notre groupe de travail et <strong>des</strong> chirurgiens ayant<br />
une certaine expérience de cet implant entre 1989 et 2001. Vingttrois<br />
mala<strong>des</strong> ont été opérés (13 hommes, 10 femmes) d’âge<br />
moyen 50,1 ans (entre 24 et 81 ans). Il s’agissait de la première<br />
reprise pour 14 cas, 2 e pour6et3 e pour 2. Le recul moyen était de<br />
35,4 mois. L’implant était recouvert d’hydroxyapatite en zone<br />
proximale avec un verrouillage distal optionnel sauf dans <strong>les</strong> premiers<br />
cas. Cet implant n’était utilisé que lorsque <strong>les</strong> calques <strong>des</strong><br />
implants usuels ne convenaient pas. L’acquisition <strong>des</strong> données<br />
était faite lors d’un examen tomodensitométrique avec un appareil<br />
préalablement calibré, la difficulté était de délimiter l’os résiduel<br />
par rapport au ciment ou à l’implant précédent. Plusieurs échanges<br />
d’information entre l’ingénieur et le chirurgien étaient nécessaires<br />
pour définir forme et ancrage de la tige.<br />
Le suivi clinique était réalisé à interval<strong>les</strong> réguliers, chiffré<br />
selon la cotation de Postel Merle d’Aubigné. Le suivi radiologique<br />
s’intéressait surtout à l’absence d’enfoncement et de liseré.<br />
RESULTATS. Le score PMA est passé de 9,6 (allant de6à14:<br />
2,4 ; 4,26 ; 2,91) à 14 (allant de8à18:4,61 ; 5,05 ; 4,25). Parmi<br />
<strong>les</strong> complications : 3 mala<strong>des</strong> ont présenté une luxation dont une a<br />
nécessité un changement de cupule et l’autre un changement de<br />
col. Un enfoncement précoce de pièce fémorale a nécessité une<br />
reprise. Un enfoncement tardif à 13 ans a également été repris de<br />
façon simple (équivalent d’un stade I SOFCOT).<br />
DISCUSSION. Les échecs précoces sont liés à l’importance <strong>des</strong><br />
lésions osseuses initia<strong>les</strong> (ou plutôt à leur sous-estimation) et au<br />
défaut de stabilisation distale initiale, <strong>les</strong> tardifs à l’absence de<br />
revêtement bioactif. Nous n’avons pas l’expérience <strong>des</strong> greffes par<br />
impaction.<br />
Les indications d’implant sur mesure sont rares (moins de 2 %<br />
de nos reprises) réparties en 4 famil<strong>les</strong> :
3S126 78 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
− extramédullaire (col très long/varus) l’implant évite l’usage<br />
<strong>des</strong> bou<strong>les</strong> manchonnées,<br />
− extrapolation (fémur trop petit ou trop gros) : implant de<br />
forme habituelle mais sous ou sur-dimensionné,<br />
− dysmorphies (courbure excessive, séquel<strong>les</strong> d’ostéotomie ou<br />
de fracture, métaphyse étroite avec diaphyse large),<br />
− comblement de perte de substance (en zone d’appui).<br />
CONCLUSION. L’avantage de ce type d’implant est le choix<br />
de l’ancrage et la simplification du geste opératoire. Il représente<br />
presque la seule possibilité technique dans certains cas complexes.<br />
Mais il nécessite une étroite concertation avec l’ingénieur (véritable<br />
intervention virtuelle) et son prix impose de ne l’utiliser qu’à<br />
bon escient.<br />
*J. Tabutin, Centre Hospitalier,<br />
15, avenue <strong>des</strong> Broussail<strong>les</strong>, 06401 Cannes Cedex.<br />
224 Tige fémorale de reprise anatomique<br />
avec revêtement hydroxyapatite<br />
complet : 75 cas avec un recul<br />
médian de 4 ans<br />
J. SYNAVE*, P. ROSSET, P.BURDIN, L.FAVARD<br />
INTRODUCTION. Le but de ce travail était d’apprécier par une<br />
étude rétrospective l’ostéofixation et la survie d’une tige fémorale<br />
longue, sur mesure, à revêtement d’hydroxyapatite complet, non<br />
verrouillable dans <strong>les</strong> changements d’implant fémoral.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. De 1990 à 1999, 89 tiges ont été<br />
implantées pour une reprise d’arthroplastie totale de hanche et 75<br />
hanches, ont été analysées au recul moyen et médian de 4 ans (1 à<br />
10 ans). L’évaluation radiologique analysait l’importance <strong>des</strong><br />
dégâts osseux, l’ostéofixation et la migration de l’implant. Toutes<br />
<strong>les</strong> mesures ont été effectuées sur la radiographie standard de face<br />
en post-opératoire immédiat et à la révision.<br />
RÉSULTATS. La reprise était effectuée dans 75 % pour un<br />
<strong>des</strong>cellement aseptique, 12 % pour un <strong>des</strong>cellement septique,<br />
11 % pour une fracture, et 2 % pour instabilité. La <strong>des</strong>truction<br />
correspondait à un stade I SOFCOT dans 36 %, stade II 44 %,<br />
stade III 17 %, et 3 % non évaluab<strong>les</strong>. La voie d’abord était une<br />
fémorotomie dans 60 %, une trochantérotomie 32 %, et une voie<br />
endofémorale 8 %. Il y avait 18 % de fractures per-opératoires,<br />
4,8 % d’infections post-opératoires et 2,4 % de luxations. A la<br />
révision, le score de Postel et Merle d’Aubigné était de 15,3 et le<br />
Harris Hip Score de 77,9. Des douleurs de cuisse étaient présentes<br />
dans 4 %. La fixation osseuse était jugée complète dans 48 % <strong>des</strong><br />
cas, partielle mais supérieure à 50 % de contact dans 36 % et non<br />
interprétable dans 16 %. Une reconstruction métaphysaire complète<br />
était présente dans 8 %. Une allogreffe morcelée était utilisée<br />
dans 89 %. Entre le postopératoire et la révision, 16 % <strong>des</strong> tiges<br />
s’étaient enfoncées, en moyenne de 11 mm. Cinq pour cent <strong>des</strong><br />
tiges ont été enlevées pour infection et 1 seule (1,3 %) pour non<br />
fixation. A 5 ans, 95 % <strong>des</strong> tiges étaient encore en place et 80 % à<br />
10 ans, en incluant <strong>les</strong> ablations pour infection. Toutes <strong>les</strong> reprises<br />
pour <strong>des</strong>cellement septique avaient <strong>des</strong> résultats cliniques et radiologiques<br />
comparab<strong>les</strong> au reste de la série, et n’ont pas présenté de<br />
complication infectieuse par la suite.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. Ces résultats confirment<br />
l’intérêt <strong>des</strong> tiges sans ciment dans <strong>les</strong> changements par rapport<br />
aux reprises avec tiges cimentées qui ont un taux de reprise de<br />
10 % à 5 ans (SOFCOT 1999). Le revêtement hydroxyapatite en<br />
totalité permet d’améliorer la fixation distale de la tige en zone<br />
saine sans compromettre la fixation proximale secondaire, autorisant<br />
<strong>des</strong> reconstructions osseuses métaphysaires spontanées. Ceci<br />
explique peut être aussi le faible taux de douleur de cuisse. La<br />
modularité et le verrouillage pourraient améliorer la fixation primaire<br />
et limiter <strong>les</strong> enfoncements.<br />
*J. Synave, Services d’Orthopédie 1 et 2,<br />
Centre Hospitalier Universitaire, 37044 Tours Cedex.<br />
225 Résultats de la prothèse totale de<br />
hanche cimentée autobloquante de<br />
Müller avec tête de 28 mm au recul<br />
moyen de 10 ans (9-12)<br />
S. BOISGARD*, P. FAURE, P.ETIENNE MOREAU,<br />
J.-P. LEVAI<br />
INTRODUCTION. Le but de cette étude était d’évaluer à 10 ans<br />
de recul la PTH cimentée autobloquante Müller, à tête de 28 mm.<br />
MATÉRIEL. De mai 1988 à mai 1990, 187 prothèses cimentées<br />
(technique de deuxième génération) ont été implantées, par voie<br />
transglutéale, pour coxarthrose. Il s’agissait dans tous <strong>les</strong> cas :<br />
d’un implant fémoral à tige droite en Protasul 10 avec tête modulaire<br />
diamètre 28 et d’une cupule en polyéthylène stérilisée aux<br />
rayons gamma. A 10 ans de recul, sur <strong>les</strong> 187 implants : 64 correspondaient<br />
à <strong>des</strong> patients décédés, 24 à <strong>des</strong> patients contactés par<br />
téléphone (ils avaient tous gardé leurs implants), 9 ont été perdus<br />
de vue, 90 implants chez 82 patients on été revus. Il s’agissait de 42<br />
femmes et de 49 hommes, d’un âge moyen de 65 ans.<br />
MÉTHODE. Les résultats cliniques ont été appréciés selon la<br />
classification de Merle d’Aubigné. Radiologiquement ont été évalués<br />
<strong>les</strong> liserés, <strong>les</strong> granulomes, la migration, l’usure et <strong>les</strong> ossifications.<br />
RÉSULTATS. Sur <strong>les</strong> 187 cas, deux patients ont nécessité une<br />
reprise : un pour infection et l’autre pour une luxation post traumatique.<br />
Sur <strong>les</strong> 82 patients revus à 10 ans de recul, le score de<br />
Merle était de 16,85 (92 % de bons et très bon résultats). Radiologiquement,<br />
au niveau acétabulaire, il a été retrouvé : 9 liserés<br />
supérieurs à1mmévolutifs entre 5 et 10 ans, avec une fois une<br />
migration et deux fois une ostéolyse, dans <strong>les</strong> trois cas une l’usure<br />
était supérieure à 2 mm. Au niveau du fémur, il a été noté une<br />
ostéolyse en zone 3 et 4, et quatre raréfactions osseuses en zone 7.<br />
La pénétration linéaire de la tête fémorale dans la cupule était de<br />
0,08 mm/an. Des ossifications de stade 3 de Brooker ont été retrouvées<br />
chez 27 % <strong>des</strong> hommes et 14 % <strong>des</strong> femmes.<br />
DISCUSSION. Les résultats cliniques sont comparab<strong>les</strong> aux<br />
autres séries de prothèses cimentées. A 10 ans de recul, <strong>les</strong> <strong>des</strong>cellements<br />
potentiels sont plus fréquents au niveau acétabulaire, avec<br />
<strong>des</strong> lisérés évolutifs toujours présents à la 5 e année ; et une usure<br />
du polyéthylène qui ne s’accompagne pas toujours d’ostéolyse ou<br />
de granulome, alors que <strong>les</strong> ostéolyses et <strong>les</strong> granulomes sont<br />
toujours associés à une usure supérieure à 2 mm. De plus, il
n’existe pas de parallélisme anatomo-clinique, ces anomalies<br />
radiologiques n’ayant pas entraîné de modifications <strong>des</strong> résultats<br />
fonctionnels du patient. La prévention <strong>des</strong> ossifications, semble<br />
devoir être conseillée surtout chez l’homme.<br />
*S. Boisgard, Service de Chirurgie Orthopédique et<br />
Traumatologique I, Hôpital G. Montpied,<br />
CHU de Clermont-Ferrand, BP 69,<br />
63003 Clermont-Ferrand Cedex 01.<br />
226 Pièces fémora<strong>les</strong> cimentées mates<br />
versus polies : résultats à dix ans<br />
minimum de recul<br />
M. HAMADOUCHE*, N. LEFEVRE, L.KERBOULL,<br />
M. KERBOULL, J.-P. COURPIED<br />
INTRODUCTION. Certains auteurs ont indiqué que le primum<br />
movens du <strong>des</strong>cellement d’une pièce fémorale cimentée était lié à<br />
la décohésion de l’interface ciment-implant. Dans ces conditions,<br />
une amélioration de cette interface a été recherchée via l’introduction<br />
d’une rugosité de surface de la pièce fémorale. Le but de cette<br />
étude prospective était d’évaluer <strong>les</strong> résultats à 10 ans minimum de<br />
recul d’une série continue d’arthroplasties tota<strong>les</strong> de hanche en<br />
fonction de l’état de surface de l’implant fémoral.<br />
MATÉRIELS ET MÉTHODES. Entre janvier 1988 et décembre<br />
1989, 311 arthroplasties tota<strong>les</strong> ont réalisées chez 286 patients<br />
âgés en moyenne de 63,6 ± 11,8 ans (26-91 ans). Toutes <strong>les</strong> interventions<br />
ont été réalisées par voie transtrochantérienne par deux<br />
opérateurs seniors. L’implant fémoral existait selon deux configurations<br />
: 166 pièces mattes à section plutôt ronde dont le Ra était de<br />
3 mm (CMK3, Vecteur Orthopédique) et 145 pièces polies à section<br />
quadrangulaire (MKIII, Stryker Howmedica) dont le Ra était<br />
de 0,4 mm. Les données préopératoires étaient comparab<strong>les</strong> pour<br />
<strong>les</strong> deux groupes. L’évaluation fonctionnelle <strong>des</strong> résultats a été<br />
effectuée selon le score de Merle d’Aubigné. Enfin, une analyse de<br />
survie a été effectuée selon la méthode actuarielle.<br />
RÉSULTATS. Lors de l’évaluation au recul minimum de 10 ans,<br />
187 patients (204 hanches) étaient toujours vivants et n’avaient pas<br />
subi de reprise au recul moyen de 11,7 ± 2,5 ans (10 à 14 ans), 15<br />
patients (15 hanches) avaient été repris sur le versant acétabulaire<br />
et/ou fémoral, 54 patients (58 hanches) étaient décédés, et 30<br />
patients (34 hanches) étaient perdus de vue. Le score fonctionnel<br />
moyen préopératoire était de 11,2 ± 2,5 (4-16) versus 17,5 ± 0,5<br />
(10-18) au dernier recul (test <strong>des</strong> rangs de Wilcoxon, p < 0,001).<br />
Le taux de survie cumulée à 13 ans en définissant l’échec comme<br />
le <strong>des</strong>cellement radiologique de la pièce fémorale, était de 78,9 ±<br />
5,8 % (intervalle de confiance à 95 % compris entre 67,6 et<br />
90,3 %) pour <strong>les</strong> implants mattes versus 97,3 ± 2,6 % (intervalle<br />
de confiance à 95 % compris entre 92,2 et 100 %) pour <strong>les</strong> implants<br />
polis. La différence était significative (logrank, p < 0,001).<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. Les résultats de cette série<br />
indiquent que la survie radiologique <strong>des</strong> pièces fémora<strong>les</strong> cimentées<br />
mattes était significativement inférieure à long terme comparativement<br />
aux pièces polies. L’augmentation de l’adhérence de<br />
l’implant fémoral au ciment a été probablement à l’origine d’une<br />
augmentation <strong>des</strong> contraintes de cisaillement à l’interface<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S127<br />
os-ciment. L’influence respective de la section et de l’état de surface<br />
reste à déterminer.<br />
*M. Hamadouche, Service A de Chirurgie Orthopédique et<br />
Réparatrice de l’Appareil Locomoteur,<br />
CHU Cochin-Port-Royal (AP-HP),<br />
27, rue du Faubourg-Saint-Jacques, 75014 Paris.<br />
227 Devenir <strong>des</strong> tiges fémora<strong>les</strong> anatomiques<br />
sans ciment revêtues<br />
d’hydroxyapatite<br />
P. MARCHAND*, G. ASENCIO, R.BERTIN,<br />
B. MEGY, P.KOUYOUMDJIAN, S.HACINI,<br />
P.-P. MILL<br />
INTRODUCTION. Le but de cette étude est d’évaluer le comportement<br />
à moyen terme de 228 tiges fémora<strong>les</strong> ABG-1 sans<br />
ciment au recul minimum de 5 ans.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. La série comportait 228 prothèses<br />
tota<strong>les</strong> de hanche ABG-1 (cotyle et fémur) non cimentées,<br />
anatomiques et revêtues d’hydroxyapatite posées chez 210<br />
patients. L’âge moyen était de 62,2 ans avec 116 femmes pour 112<br />
hommes. L’étiologie était : coxarthrose primitive (53,6 %),<br />
nécrose primitive (21,5 %), coxarthrose post-traumatique<br />
(11,8 %), coxite rhumatismale (8,3 %), dysplasie (4,8 %). Le couple<br />
de frottement comportait 200 associations Zirconiumpolyéthylène<br />
(87,7 %) et 28 associations métal-polyéthylène<br />
(12,3 %). Cent soixante-trois patients furent revus avec un recul<br />
moyen de 88,6 mois et minimum de 60 mois [37 étaient décédés<br />
exempts de reprise, 28 étaient perdus de vue (12,3 %), 17 avaient<br />
été repris chirurgicalement]. L’analyse clinique a été réalisée à<br />
l’aide <strong>des</strong> scores de Postel-Merle d’Aubigné (PMA) et du Harris<br />
Hip Score (HHS). Sur <strong>les</strong> radiographies scannées, nous avons<br />
utilisé <strong>les</strong> scores de Engh-Massin et ARA fémur de l’AGORA ;<br />
l’ostéolyse a été évaluée selon la classification de Gruen.<br />
RÉSULTATS. Les 17 reprises fémora<strong>les</strong> étaient relatives à un<br />
<strong>des</strong>cellement aseptique (4 cas), une fracture du fémur (4 cas), un<br />
sepsis (3 cas), une instabilité (3 cas), une douleur (2 cas), une<br />
boiterie (1 cas). La survie globale était de 92,5 % <strong>des</strong> cas à 88,6<br />
mois, et la survie relative au <strong>des</strong>cellement, de 98,2 % <strong>des</strong> cas.<br />
Cliniquement à la révision, le score moyen PMA était de 17,3 et<br />
92,7 % <strong>des</strong> patients avaient un résultat excellent ou bon avec un<br />
score supérieur à 14. le score HHS moyen était de 96,4. Quatrevingt-six<br />
pour cent <strong>des</strong> patients ne conservaient aucune douleur de<br />
hanche. Radiologiquement, 122 tiges ont été évaluées au dernier<br />
recul : selon la classification de Engh-Massin, 104 cas présentaient<br />
une réhabitation osseuse confirmée (85,2 %), 15 cas<br />
(12,3 %) une réhabitation suspectée, 2 cas une encapsulation<br />
fibreuse et 1 cas une instabilité de l’implant. Le score ARA fémur<br />
était jugé bon ou excellent dans 70,5 % <strong>des</strong> cas, moyen dans<br />
13,1 %, mauvais dans 16,4 % <strong>des</strong> cas. Une hypertrophie corticale<br />
réactionnelle en zones 2-3 ou 5-6 de Gruen a été observée dans<br />
27,9 % <strong>des</strong> cas, non corrélée à une douleur clinique. El<strong>les</strong> étaient<br />
par contre associées dans plus de la moitié <strong>des</strong> cas à une anomalie<br />
de positionnement dans le plan frontal ou à un surdimensionnement<br />
de la tige. Nous n’avons noté qu’un seul pié<strong>des</strong>tal incomplet<br />
et aucun stress-shielding proximal extensif. Une ostéolyse fémo-
3S128 78 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
rale très limitée (surface moyenne estimée à 145 mm 2 ) a été retrouvée<br />
en zones 1 et 7 dans 21,3 % <strong>des</strong> cas ; aucune ostéolyse distale<br />
n’a été observée.<br />
DISCUSSION. Les données présentées confirment le très bon<br />
comportement à moyen terme <strong>des</strong> tiges anatomiques et revêtues<br />
d’hydroxyapatite. Ce revêtement métaphysaire agit comme une<br />
véritable barrière empêchant la diffusion diaphysaire <strong>des</strong> particu<strong>les</strong><br />
d’usure. La migration <strong>des</strong> tiges est minime de l’ordre du millimètre<br />
et ne s’étend pas au delà de la première année. Il se produit<br />
avec le temps une réaction osseuse endocorticale métaphysaire<br />
trabéculaire constante, témoin de la transmission <strong>des</strong> contraintes<br />
de la portion proximale de l’implant revêtue d’hydroxyapatite au<br />
fémur.<br />
*P. Marchand, Service de Chirurgie Orthopédique et<br />
Traumatologique, 5, rue Hoche, 30900 Nîmes.<br />
228 Étude épidémiologique d’une<br />
cohorte de 877 arthroplasties tota<strong>les</strong><br />
de hanche à couple polyéthylène<br />
zircone : analyse <strong>des</strong> faillites à<br />
7 ans de recul moyen<br />
P. PIRIOU*, C. GARREAU DE LOUBRESSE,<br />
P. DENORMANDIE, T.JUDET<br />
INTRODUCTION. Les auteurs dans le cadre d’un suivi prospectif<br />
en matière de prothèse totale de la hanche rapportent ici leur<br />
expérience concernant l’utilisation d’un couple polyéthylènezircone<br />
entre <strong>les</strong> années 87 et 97. L’utilisation de ce couple visait à<br />
réduire l’usure in vivo du fait <strong>des</strong> excellentes qualités tribologiques<br />
de cette céramique.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Huit cent soixante-dix-sept PTH<br />
réalisées durant la période 87-97 sont suivies avec un recul moyen<br />
de 7 ans. Il s’agit toujours de tiges fares (titane) ou isofares (acier)<br />
en face d’une cupule cimentéE ou non de diamètre interne 26 mm<br />
ou 28 mm. En ce qui concerne le type de zircone utilisé, il s’agissait<br />
de Zircone Y-TZP, c’est à dire de zircone polycristallin en<br />
phase tétragonale, stabilisé par l’adjonction d’oxyde d’Yttrium, de<br />
marque Prozyr. L’âge moyen <strong>des</strong> patients était de 58 ans (17-87).<br />
Le poids moyen était de 70 kg (40-125) et la taille moyenne de 167<br />
cm (140-196). Le sexe ratio était de 1,3.<br />
RÉSULTAT. L’analyse de la survie globale de cette cohorte en<br />
utilisant la méthode de Kaplan Meier est à treize ans de 60 % avec<br />
IC (5 %) = 55 % à 65 %. Le nombre total de prothèses révisées<br />
toutes causes confondues (infections comprises) était de 118. A<br />
notre connaissance, sur l’ensemble de cette cohorte, un patient a<br />
présenté une rupture de la tête en zircone. L’analyse radiologique<br />
dégage un mode de faillite particulier qui est le <strong>des</strong>cellement acétabulaire<br />
isolé. L’analyse comparative de ce mode de <strong>des</strong>cellement<br />
pour <strong>les</strong> 785 têtes de diamètre 26 et <strong>les</strong> 92 têtes de diamètre 28 n’est<br />
pas significative en utilisant un test de Log rank. L’étude de la<br />
survie en prenant comme événement la reprise chirurgicale pour<br />
échec acétabulaire isolé est à 13,5 ans de 74 % avec IC (5 %) = 68<br />
à 80 % confirmant ainsi un mode de faillite particulier de ce couple.<br />
DISCUSSION. Une étude préalable nous avait montré une<br />
absence de supériorité de la zircone in vivo quant à la réduction de<br />
l’usure par rapport à <strong>des</strong> têtes métalliques chez <strong>des</strong> sujets jeunes.<br />
Ces résultats purement épidémiologiques montrent de façon formelle<br />
le caractère délétère de la zircone contrairement aux bénéfices<br />
tribologiques attendus. Les auteurs n’ont pas d’explication<br />
physico-chimique à ces faillites, <strong>les</strong> résultats anatomopathologiques<br />
étant aspécifiques, mais le constat d’échec<br />
s’impose.<br />
CONCLUSION. Fort de ces constatations, <strong>les</strong> auteurs ont abandonné<br />
l’utilisation de cette céramique depuis <strong>les</strong> années 97.<br />
*P. Piriou, Hôpital Raymond-Poincaré,<br />
104, boulevard Raymond-Poincaré, 92380 Garches.<br />
229 Changement de tête fémorale au<br />
cours d’une réintervention : comment<br />
apprécier en peropératoire <strong>les</strong><br />
qualités d’un cône morse ?<br />
P. HERNIGOU*, P. PERNOD<br />
INTRODUCTION. Le cône morse a été introduit dans l’industrie<br />
dès 1880 et en orthopédie dans la décennie 1970-1980. Il<br />
permet le changement de la tête tout en conservant la pièce fémorale.<br />
Cette étude précise à quelle condition un cône implanté<br />
depuis plusieurs années peut accepter une nouvelle tête fémorale<br />
en céramique ou en métal.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Les têtes et cônes correspondant<br />
de 30 prothèses enlevées après une implantation moyenne de 9 ans<br />
(5 à 16 ans) ont été analysés à l’œil nu, comme pourrait le faire un<br />
chirurgien au cours d’une réintervention. Puis de nouvel<strong>les</strong> têtes<br />
fémora<strong>les</strong> ont été implantées sur ces anciens cônes. Les implantations<br />
ont été répétitives, tout d’abord dans <strong>des</strong> conditions idéa<strong>les</strong>,<br />
puis non idéa<strong>les</strong> (débris biologiques placés sur le cône). La force<br />
nécessaire pour désolidariser la tête du cône a été comparée à celle<br />
qui avait été utilisée pour l’impaction <strong>des</strong> têtes en partant du principe<br />
que plus la force de désassemblage est faible, plus le risque de<br />
micro-mobilité et de fracture de fatigue est grand. Les résultats<br />
qualitatifs de l’analyse morphologique à l’œil nu (tête et cône) ont<br />
été ensuite comparés aux données quantitatives <strong>des</strong> forces.<br />
RÉSULTATS. Le cône laisse une empreinte sur la tête fémorale.<br />
Elle n’est facilement visible que sur <strong>les</strong> têtes en alumine (couleur<br />
blanche). Une empreinte normale est un anneau régulier et circulaire.<br />
Dans le cas contraire, l’empreinte a été considérée comme<br />
anormale (5 cas sur 30 dans cette étude). Les anomalies sur <strong>les</strong><br />
cônes (titane ou chrome/cobalt) peuvent être de deux types : soit<br />
visib<strong>les</strong> à l’œil nu (le plus souvent corrosion), soit non visib<strong>les</strong> à<br />
l’œil nu et retrouvées au microscope ou à forte loupe. Lorsque le<br />
cône était d’aspect normal à l’œil nu et que la tête avait une<br />
empreinte normale, la force (entre 320 et 1 260 Newtons) pour<br />
désolidariser une tête neuve de l’ancien cône était corrélée linéairement<br />
(R = 0,921 ; p < 0,01) à la force utilisée pour l’assemblage<br />
(entre 345 et 2 345 Newtons), que cette tête soit en céramique ou<br />
métallique. Cette force de désassemblage ne varie pas au cours<br />
d’essais successifs lorsque qu’il n’existe pas de débris biologiques<br />
cellulaires sur ce dernier. Elle diminue significativement
(p < 0,05), si l’on place au contact du cône <strong>des</strong> débris cellulaires,<br />
du sang ou de la graisse. Si le cône est essuyé avec une compresse<br />
après avoir été placé en présence de débris cellulaires, la force de<br />
désimpaction redevient normale. La force nécessaire pour désolidariser<br />
une tête neuve (en céramique ou en métal) était significativement<br />
(p < 0,01) diminuée par rapport à la force d’impaction<br />
s’il existait sur la tête implantée précédemment une empreinte<br />
anormale ou si le cône présentait <strong>des</strong> anomalies visib<strong>les</strong> à l’œil nu.<br />
Quelle que soit la force d’impaction, la fixation <strong>des</strong> têtes métalliques<br />
est toujours supérieure à celle <strong>des</strong> têtes en alumine. La force<br />
nécessaire pour désolidariser une tête alumine du cône morse<br />
230 Étude prospective du confort postopératoire<br />
après intervention de<br />
Bankart conventionnelle en chirurgie<br />
ambulatoire<br />
V. MOLINA*, O. GAGEY, C.COURT, J.LANGLOYS<br />
INTRODUCTION. L’intervention de Bankart est une opération<br />
chirurgicale largement étudiée dans la littérature. Elle est reconnue<br />
pour avoir peu de complications postopératoires. Le but de ce<br />
travail est d’étudier le confort <strong>des</strong> opérés après intervention de<br />
Bankart en chirurgie ambulatoire pour valider la faisabilité de celle<br />
ci.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Trente patients ont été opérés<br />
entre juin 2001 et décembre 2002 par le même chirurgien dans<br />
l’unité de chirurgie ambulatoire. Il y avait 28 hommes et 2 femmes,<br />
l’âge moyen était de 28 ans. La douleur a été évaluée grâce à une<br />
échelle analogique (EVA), à l’arrivée en salle de soins postopératoires<br />
(SSPI) : (D0), à la sortie de SSPI : (D1),àJ1partéléphone :<br />
(D2) et à J7 en consultation : (D3). A J1 et à J7, il était en outre<br />
demandé à chaque patient s’il aurait préféré rester une nuit à<br />
l’hôpital.<br />
Le protocole d’anesthésie générale était identique pour tous <strong>les</strong><br />
opérés. L’analgésie peropératoire comportait une perfusion d’une<br />
demi-heure associant Néfopam (Acupant) 20 mgpropacetamol<br />
(Prodafalgant) 2gouparacetamol (Perfalgant) 1Getketoprofene<br />
(Profenidt) 100 mg en l’absence de contre-indication. En<br />
SSPI de la morphine 3 mg IV était administrée en bolus jusqu’à ce<br />
qu’un score de moins de 4/10 soit obtenu, avec relais oral par<br />
association de paracetamol et codéine. Le traitement à domicile<br />
était assuré par ketoprofene 200 mg par jour et paracétamol +<br />
Codeine.<br />
RÉSULTATS. La seule complication a été une thrombose veineuse<br />
superficielle du membre supérieur diagnostiquée à J 15. Il<br />
n’y a pas eu d’hématome postopératoire ni d’infection. Un opéré<br />
est resté hospitalisé la première nuit en raison d’un malaise vagal<br />
survenu au moment de la sortie, l’évaluation de la douleur était<br />
identique à celle <strong>des</strong> autres patients. Les résultats de l’évaluation<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S129<br />
Séance du 13 novembre matin<br />
ÉPAULE<br />
ancien est plus importante si le métal est du titane (par rapport au<br />
chrome/cobalt).<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. Des anomalies doivent<br />
être recherchées à l’œil nu en peropératoire sur <strong>les</strong> têtes fémora<strong>les</strong><br />
et sur <strong>les</strong> cônes morses avant d’envisager la réimplantation d’une<br />
tête en céramique ou d’une tête métallique sur une pièce fémorale<br />
laissée en place. L’étude précise <strong>les</strong> risques éventuels, en fonction<br />
<strong>des</strong> différentes têtes, de la nature du métal de la prothèse et de<br />
l’aspect de surface du cône morse.<br />
*P. Hernigou, Hôpital Henri-Mondor, 51, avenue du<br />
Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, 94010 Créteil.<br />
de la douleur étaient <strong>les</strong> suivants : D1 2 (5,0), D2 : 1 (3, 0). IL n’y<br />
a donc eu aucun échec en ce qui concerne le confort post opératoire.<br />
Aucun <strong>des</strong> autres patients n’aurait souhaité être hospitalisé<br />
24 h.<br />
DISCUSSION. Une seule série de 25 cas a été publiée à propos<br />
<strong>des</strong> résultats en termes de confort et coût de l’intervention de<br />
Bankart en ambulatoire. Les patients ont été opérés sous bloc inter<br />
scalénique. Trois patients sur 25 auraient souhaiter passer une nuit<br />
à l’hôpital à cause de la douleur. Peut être est-ce du à un effet<br />
« rebond » de la douleur à la levée du bloc. L’absence de drainage<br />
n’a entraîné aucun hématome, confirmant une étude préalable non<br />
publiée dans la quelle 50 patients consécutifs avaient été opérés en<br />
hospitalisation classique sans drainage. Seul un patient avait eu un<br />
hématome sous-cutané d’évolution spontanément favorable. Ces<br />
résultats suggèrent qu’il est possible d’obtenir un confort postopératoire<br />
tout à fait correct et nous poussent à continuer à opérer <strong>les</strong><br />
patients d’un Bankart en ambulatoire.<br />
*V. Molina, Service d’Orthopédie, CHU Bicêtre,<br />
78, rue du Général-Leclerc, 94270 Le Kremlin-Bicêtre.<br />
231 Le long biceps « en sablier » ou<br />
long biceps piégé : une autre cause<br />
de douleur et de blocage de<br />
l’épaule<br />
P. BOILEAU*, P.M. AHRENS, C.TROJANI,<br />
J.-S. COSTE, B.CORDÉRO, P.ROUSSEAU<br />
INTRODUCTION. Nous rapportons une nouvelle entité pathologique<br />
affectant la longue portion du biceps (LPB) au cours de<br />
laquelle le tendon hypertrophié se trouve piégé dans l’articulation<br />
lors de l’élévation, ce qui est à l’origine de douleurs et d’un blocage<br />
de l’épaule.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Vingt et un patients ont été<br />
identifiés, comme présentant une hypertrophie de la portion intraarticulaire<br />
de la LPB et incarcération du tendon lors de l’élévation.
3S130 78 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
Le diagnostic a été confirmé au cours d’une intervention à ciel<br />
ouvert (14 cas) ou au cours d’une arthroscopie (7 cas). <strong>Tous</strong> <strong>les</strong> cas<br />
ont été diagnostiqués en présence d’une rupture de la coiffe associée.<br />
<strong>Tous</strong> <strong>les</strong> patients ont été traités par excision de la portion<br />
intra-articulaire du biceps et traitement approprié <strong>des</strong> lésions de la<br />
coiffe.<br />
RÉSULTATS. <strong>Tous</strong> <strong>les</strong> patients présentaient <strong>des</strong> douleurs antérieures<br />
de l’épaule et un déficit de l’élévation antérieure du fait de<br />
l’incarcération du tendon. Un test dynamique peropératoire,<br />
consistant à élever le bras avec le coude tendu, permettait d’objectiver<br />
le tendon piégé dans l’articulation dans tous <strong>les</strong> cas. Ce test<br />
entraîne une plicature puis une incarcération du tendon entre la tête<br />
humérale et la glène (« test du sablier »). L’excision du tendon,<br />
après ténodèse (19 cas) ou ténotomie bipolaire (2 cas), permettait<br />
une récupération immédiate de l’élévation passive complète. Le<br />
score de Constant passait de 38 points en préopératoire à 76 points<br />
à la dernière révision.<br />
DISCUSSION. Le long biceps « en sablier » est causé par<br />
l’hypertrophie de la portion intra-articulaire du tendon qui devient<br />
incapable de glisser dans la gouttière bicipitale lors de l’élévation<br />
du bras. Un déficit de l’élévation passive de 10 à 20 degrés, une<br />
douleur au niveau de la gouttière bicipitale et <strong>des</strong> images de tendon<br />
hypertrophié en imagerie peuvent aider au diagnostic. Le long<br />
biceps « en sablier » ne doit pas être confondu avec une capsulite<br />
rétractile. Le diagnostic définitif est fait lors de la chirurgie grâce<br />
au test du sablier montrant la plicature et l’incarcération du tendon<br />
au cours de l’élévation du bras coude en extension. La ténotomie<br />
simple ne permet pas de résoudre ce blocage mécanique de<br />
l’épaule. L’excision de la portion intra-articulaire du tendon, après<br />
ténotomie bipolaire ou ténodèse, doit être réalisée.<br />
CONCLUSION. Le long biceps « en sablier » doit être recherché<br />
de principe, en cas de douleur antérieure de l’épaule persistante<br />
et inexpliquée, associée à un déficit de l’élévation antérieure.<br />
*P. Boileau, Service de Chirurgie Orthopédiqe et<br />
Traumatologie du Sport, Hôptal Archet 2,<br />
151, route de Saint-Antoine-de-Ginestière, 062002 Nice.<br />
232 La ténotomie du tendon du long<br />
biceps sous arthroscopie : résultats<br />
à long terme<br />
L. NOVÉ-JOSSERAND*, A. BOULAHIA,<br />
L. NEYTON, G.WALCH<br />
INTRODUCTION. Le traitement <strong>des</strong> ruptures massives de la<br />
coiffe avec pincement sous-acromial reste sujet à discussion.<br />
Considérant que, dans la plupart <strong>des</strong> cas, <strong>les</strong> ruptures spontanées<br />
du long biceps amènent un soulagement de la douleur ; considérant<br />
que l’arthrose sous-acromiale est bien supportée dans nombre<br />
de cas ; nous avons proposé de réaliser une ténotomie du long<br />
biceps sous arthroscopie, dans ce type d’indication, dans le but de<br />
soulager la douleur. Nous en rapportons ici <strong>les</strong> résultats à long<br />
terme.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Entre 1988 et 1999, 307 ténotomies<br />
arthroscopiques du long biceps ont été réalisées pour ruptures<br />
non réparab<strong>les</strong> de la coiffe <strong>des</strong> rotateurs (ruptures massives,<br />
sujets âgés ou non motivés). Ce geste était isolé dans 64 % <strong>des</strong> cas<br />
et associé à une acromioplastie dans 36 % <strong>des</strong> cas. <strong>Tous</strong> <strong>les</strong><br />
patients avaient eu un traitement médical préalable. L’âge moyen à<br />
l’intervention était de 64,3 ans. L’espace sous-acromial préopératoire<br />
moyen était de 6,6 mm. La lésion tendineuse était une rupture<br />
isolée du supraspinatus dans 31 % <strong>des</strong> cas, de 2 tendons dans<br />
44,6 %, de 3 tendons dans 21,8 % et du subscapularis isolé dans<br />
2,6 %. Le recul moyen était de 57 mois (24 à 168 mois).<br />
RÉSULTATS. Le score Constant augmentait de 48,4 points à<br />
67,6 points (p < 0,001) et 86,5 % <strong>des</strong> patients étaient satisfaits ou<br />
très satisfaits. Neuf patients (2,9 %) ont été réopéré pour réparation<br />
secondaire de la coiffe (3 cas) ou pour prothèse totale inversée<br />
pour cuff tear arthropathy (6 cas). L’espace sous-acromial postopératoire<br />
diminue en moyenne de 1,3 mm en relation avec l’augmentation<br />
du délai postopératoire (p < 0,000). L’arthrose glénohumérale<br />
(Samilson) augmente de 38 % à 67 % <strong>des</strong> cas en<br />
postopératoire. L’association d’une acromioplastie améliore le<br />
résultat objectif et subjectif uniquement dans le groupe <strong>des</strong> ruptures<br />
isolées du supraspinatus. La taille de la rupture et la dégénérescence<br />
graisseuse <strong>des</strong> musc<strong>les</strong> de la coiffe a une influence statistique<br />
sur le résultat fonctionnel et radiologique (p < 0,001) alors que<br />
le délai postopératoire n’a d’influence que sur le résultat radiologique<br />
(p < 0,001).<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. Cette intervention simple,<br />
facile permet de soulager la douleur de repos et notamment la<br />
douleur nocturne. Elle est ainsi recommandée devant une rupture<br />
massive de la coiffe avec pincement de l’espace sous-acromial,<br />
chez <strong>des</strong> patients âgés ou peu motivés dont la douleur résiste au<br />
traitement médical. Cette intervention ne permet pas la récupération<br />
de la mobilité ou de la force.<br />
*L. Nové-Josserand, Clinique Sainte-Anne-Lumière,<br />
85, cours Albert-Thomas, 69003 Lyon.<br />
233 Influence de l’incongruence entre<br />
implant huméral et glénoïdien sur<br />
<strong>les</strong> déformations osseuses périglénoïdiennes<br />
et sur le déplacement<br />
d’implants glénoïdiens cimentés :<br />
étude expérimentale in vitro sur<br />
scapulas cadavériques prothésées<br />
J. GRIMBERG*, N. MAUREL, A.DIOP, O.GAGEY<br />
INTRODUCTION. Dans <strong>les</strong> prothèses tota<strong>les</strong> d’épaule, il<br />
n’existe pas de consensus sur l’incongruence idéale entre tête<br />
humérale prothétique et implant glénoïdien. Certaines publications<br />
récentes semblent retrouver un taux de liserés périglénoïdiens<br />
plus faible en cas d’incongruence supérieure à 5,5 mm. Le<br />
but de cette expérimentation in vitro était d’étudier l’influence<br />
d’une modification de la congruence entre tête humérale prothétique<br />
et implant glénoïdien sur <strong>les</strong> déformations osseuses périglénoïdiennes<br />
de scapulas cadavériques prothésées et sur la mobilité<br />
<strong>des</strong> implants glénoïdiens.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Cinq scapulas de sujets âgés de<br />
76 à 91 ans au moment de leur décès ont été prélevées et implan-
tées avec 5 implants glénoïdiens à quille cimentés de rayon de<br />
courbure identique. Cinq bil<strong>les</strong> métalliques de rayons différents<br />
simulaient une incongruence « tête humérale »-implant glénoïdien<br />
variant de 0 (congruence parfaite)à6mm(0,2, 4,5 et 6 mm).<br />
Le protocole de mise en charge comprenait une précharge de 400<br />
Newtons suivant un axe normal à l’implant glénoïdien et un mouvement<br />
imposé de translation postéro-antérieure puis inférosupérieur<br />
de 2,5 mm. La force nécessaire pour imposer le déplacement<br />
en translation, <strong>les</strong> déformations osseuses<br />
périglénoïdiennes ainsi que le déplacement de l’implant prothétique<br />
par rapport à la glène osseuse étaient respectivement mesurés<br />
pendant l’essai par la machine de traction-compression, par <strong>des</strong><br />
jauges de déformation et par deux caméras CCD selon un protocole<br />
déjà publié.<br />
RÉSULTATS. L’augmentation de l’incongruence diminue <strong>les</strong><br />
forces nécessaires au déplacement <strong>des</strong> bil<strong>les</strong> métalliques, diminue<br />
<strong>les</strong> déformations osseuses périglénoïdiennes autour <strong>des</strong> zones de<br />
chargement et diminue l’importance du déplacement prothétique<br />
en regard de la zone de charge.<br />
DISCUSSION. Les limites de cette expérimentation sont d’une<br />
part le faible nombre d’implants testés qui ne permet aucune<br />
conclusion statistique quant à la réalité et l’importance <strong>des</strong> différences<br />
retrouvées, d’autre part le fait que <strong>les</strong> conditions du protocole<br />
ne sauraient reproduire exactement <strong>les</strong> conditions de travail<br />
d’une articulation prothésée. Néanmoins, ces résultats semblent<br />
aller dans le sens d’une tolérance osseuse et prothétique plus<br />
importante lorsque la congruence tête humérale-implant glénoïdien<br />
diminue. Ils pourraient contribuer à expliquer la moindre<br />
survenue de liserés glénoïdiens retrouvée in vivo dans une situation<br />
de congruence similaire.<br />
CONCLUSION. Ces résultats laissent penser qu’une certaine<br />
incongruence dans <strong>les</strong> prothèses tota<strong>les</strong> d’épaule pourrait permettre<br />
de diminuer le risque d’apparition de liserés périprothétiques. Il<br />
reste à définir par d’autres expérimentations in vivo et in vitro<br />
l’incongruence « idéale ».<br />
*J. Grimberg, Clinique <strong>des</strong> Lilas,<br />
41, avenue du Maréchal-Juin, 93260 Les Lilas.<br />
234 Prothèses d’épaule pour omarthrose<br />
centrée versus prothèse<br />
d’épaule pour fracture : comparaison<br />
de la fixation de la tige humérale<br />
C. TROJANI*, P. BOILEAU, J.-S. COSTE,<br />
G. WALCH<br />
INTRODUCTION. L’objectif de cette étude était d’évaluer la<br />
qualité de la fixation d’une tige humérale prothétique cimentée.<br />
Nous avons analysé l’incidence et l’influence <strong>des</strong> liserés et <strong>des</strong>cellements<br />
huméraux après implantation d’une prothèse d’épaule en<br />
fonction de l’étiologie (fractures versus omarthrose centrée) et du<br />
statut glénoïdien (prothèse totale versus huméral simple).<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Au sein d’une étude rétrospective<br />
multicentrique incluant 1842 prothèses d’épaule de première<br />
intention revues avec un recul moyen de 5 ans (2 à 10 ans), nous<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S131<br />
avons isolé <strong>les</strong> patients dont le diagnostic initial était une fracture<br />
de l’extrémité supérieure de l’humérus (300 cas) et une omarthrose<br />
centrée (767 cas). Toutes <strong>les</strong> tiges implantées pour fracture<br />
étaient cimentées. Dans <strong>les</strong> omarthroses, on retrouvait 610 prothèses<br />
tota<strong>les</strong> et 157 prothèses huméra<strong>les</strong> simp<strong>les</strong> ; 752 tiges étaient<br />
cimentées et 15 implantées sans ciment. <strong>Tous</strong> <strong>les</strong> patients ont été<br />
revus selon le score de Constant et avec un bilan radiographique<br />
(face et profil au minimum).<br />
RÉSULTATS. Concernant <strong>les</strong> tiges huméra<strong>les</strong> cimentées,<br />
l’incidence <strong>des</strong> liserés et <strong>des</strong>cellements radiographiques était<br />
significativement plus élevée dans <strong>les</strong> fractures (40 % et 10 %) que<br />
dans l’omarthrose centrée (14 % et 1 %). Liseré et <strong>des</strong>cellement<br />
radiographique n’influençaient pas le résultat fonctionnel dans<br />
l’omarthrose centrée, mais péjoraient significativement le résultat<br />
final dans <strong>les</strong> fractures. Dans <strong>les</strong> fractures, l’incidence <strong>des</strong> liserés<br />
était corrélée à la migration <strong>des</strong> tubérosités. Dans l’omarthrose, il<br />
n’existait pas de différence entre prothèse totale et prothèse humérale<br />
simple en terme de liseré ou <strong>des</strong>cellement mais le résultat<br />
fonctionnel <strong>des</strong> prothèses tota<strong>les</strong> était significativement meilleur.<br />
CONCLUSION. La fixation de l’implant huméral par le ciment<br />
reste la technique de référence dans <strong>les</strong> prothèses d’épaule implantées<br />
pour omarthrose centrée. Cependant, la fixation par le ciment<br />
est décevante dans <strong>les</strong> cas de fractures : le défaut de fixation de la<br />
tige humérale est corrélé à la migration <strong>des</strong> tubérosités. Dans<br />
l’omarthrose, il n’existe pas plus de liserés en cas de prothèse<br />
totale, dont <strong>les</strong> résultats fonctionnels sont meilleurs.<br />
*C. Trojani, Service de Chirurgie Orthopédique,<br />
Hôpital Archet 2, 151, route de Saint-Antoine-de-Ginestière,<br />
06202 Nice.<br />
235 Résultats <strong>des</strong> prothèses d’épaule<br />
dans l’ostéonécrose aseptique et<br />
non traumatique de la tête humérale<br />
P. MANSAT*, L. HUZER, M.MANSAT,<br />
Y. BELLUMORE, M.RONGIÈRES, P.BONNEVIALLE<br />
L’ostéonécrose aseptique et non traumatique de la tête humérale<br />
demeure une pathologie peu fréquente. L’arthroplastie reste le<br />
traitement de choix lorsque la tête humérale a perdu sa sphéricité.<br />
Le but de ce travail est d’en évaluer à 7 ans de recul moyen <strong>les</strong><br />
résultats cliniques et radiographiques à partir d’une série monocentrique<br />
et continue portant sur 19 épau<strong>les</strong>.<br />
Douze femmes et 5 hommes, d’âge moyen 56 ans ont été traités<br />
par prothèse d’épaule pour ostéonécrose de la tête humérale. Sept<br />
patients présentaient une ostéonécrose quadripolaire : deux<br />
avaient 4 prothèses (2 épau<strong>les</strong> + 2 hanches), trois, 3 prothèses (1<br />
épaule + 2 hanches) et deux, 2 prothèses (1 épaule + 1 hanche).<br />
L’ostéonécrose était idiopathique dans 6 cas, liée à la prise de<br />
corticoï<strong>des</strong> dans 10, à une radiothérapie dans 2, et à une maladie de<br />
Gaucher dans un. Selon la classification d’Arlet et Ficat, il s’agissait<br />
d’un stade III dans 3 cas, IV dans 13 etV dans 3. La coiffe était<br />
rompue dans 2 cas. Quatorze prothèses huméra<strong>les</strong> simp<strong>les</strong> et 5<br />
prothèses tota<strong>les</strong> d’épaule ont été implantées.<br />
Avec un recul moyen de 7 ans (2-12 ans), <strong>les</strong> résultats selon Neer<br />
étaient excellents 7 fois, satisfaisants 9 fois, et non satisfaisants 3
3S132 78 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
fois. Quatre-vingt-neuf pour cent <strong>des</strong> patients étaient satisfaits de<br />
leur intervention. Selon Constant, la douleur était passée de 1,5 à<br />
11,5 points, l’activité de 7,2 à 14,6 points, et la mobilité de 15 à 27<br />
points. L’élévation antérieure active était en moyenne de 120, la<br />
rotation externe de 34, et la rotation interne au niveau de L3. Le<br />
score de Constant était égal à 58 pour un score pondéré de 78 %. Il<br />
n’existait pas de liséré autour de l’implant huméral, mais un liseré<br />
complet était présent autour de 2 implants glénoïdiens dont un était<br />
radiographiquement <strong>des</strong>cellé. Dans 2 cas, il existait une glénoïdite<br />
avec usure de la glène. Aucune révision chirurgicale n’a été effectuée<br />
à ce jour.<br />
La prothèse d’épaule dans l’ostéonécrose de la tête humérale<br />
donne <strong>des</strong> résultats satisfaisants, avec disparition de la douleur<br />
dans plus de 80 % <strong>des</strong> cas. Cependant, <strong>les</strong> épau<strong>les</strong> restent souvent<br />
limitées en raison d’une raideur préopératoire souvent importante.<br />
Les résultats ont été d’autant meilleurs que la durée d’évolution<br />
préopératoire était limitée, que la douleur préopératoire n’était pas<br />
trop sévère, que la mobilité préopératoire était conservée, et qu’il<br />
ne s’agissait pas d’une ostéonécrose post-radique qui dans notre<br />
série obtenait <strong>les</strong> plus mauvais résultats.<br />
*P. Mansat, Service d’Orthopédie Traumatologie,<br />
CHU Purpan, place du Docteur-Baylac, 31059 Toulouse.<br />
236 Étude le l’influence du <strong>des</strong>sin <strong>des</strong><br />
implants glénoïdiens sur le comportement<br />
osseux de l’omoplate par la<br />
méthode de modélisation par éléments<br />
finis<br />
P. MANSAT*, D. LACROIX, P.SWIDER,<br />
M. MANSAT<br />
La méthode de modélisation par éléments finis permet d’appréhender<br />
le comportement d’une structure à la mise en charge. Nous<br />
avons utilisé cette méthode pour évaluer l’influence du <strong>des</strong>sin de<br />
différents implants glénoïdiens sur le comportement d’une scapula<br />
arthrosique.<br />
Dans le cadre d’un bilan pré-prothèse, un examen tomodensitométrique<br />
d’une épaule arthrosique a été réalisé chez une patiente<br />
de 76 ans. Deux implants glénoïdiens en polyéthylène ont été<br />
évalués : un implant avec une quille triangulaire et le même<br />
implant avec <strong>des</strong> plots. Une reconstruction tridimensionnelle de la<br />
cavité glénoïdale avec <strong>les</strong> implants a ensuite été obtenue puis<br />
maillée par la méthode <strong>des</strong> éléments finis. Trois charges ont été<br />
appliquées sur le modèle : centrée pour reproduire le cas idéal<br />
d’une prothèse stable avec un environnement tendino-musculaire<br />
normal, et excentrées pour simuler un déficit de la coiffe <strong>des</strong><br />
rotateurs ou une instabilité de la prothèse.<br />
Avec la charge centrée, <strong>les</strong> contraintes sont restées faib<strong>les</strong>,<br />
autour de 7 MPa, au niveau de l’interface entre la quille et la cavité<br />
glénoïdale. Les charges excentrées ont entraîné <strong>des</strong> pics de<br />
contraintes sur <strong>les</strong> bords <strong>des</strong> implants glénoïdiens directement<br />
sous la zone de mise en charge et en bout de quille au niveau de<br />
l’interface os-ciment atteignant 20 MPa. L’implant avait tendance<br />
à se fléchir dans la direction antéro-postérieure entraînant <strong>des</strong><br />
contraintes en cisaillement plus élevées au niveau de la partie<br />
postérieure de la cavité glénoïdale. Ces contraintes ont été responsab<strong>les</strong><br />
de micro-mouvements au niveau de l’interface ciment-os.<br />
Aucune différence significative n’a été retrouvée entre l’implant à<br />
quille et l’implant à plots.<br />
L’application de charge, de manière excentrique, sur un implant<br />
glénoïdien semble péjorative pour la survie à long terme de<br />
l’implant, le niveau <strong>des</strong> contraintes atteignant <strong>des</strong> valeurs supérieures<br />
aux limites de rupture en fatigue du ciment. Les pics de<br />
contrainte étaient situés au niveau du bord postérieur de la couche<br />
de ciment en raison du faible espace disponible entre l’implant et<br />
l’os cortical au niveau de la partie postérieure de la scapula arthrosique.<br />
En effet dans ce cas, l’extrémité de la quille ou <strong>des</strong> plots<br />
avait tendance à rentrer en contact avec la corticale postérieure de<br />
la scapula. Lors de la mise en place d’une prothèse totale d’épaule,<br />
il semble donc plus important de tenir compte de la géométrie et<br />
<strong>des</strong> propriétés mécaniques de la scapula que du <strong>des</strong>sin <strong>des</strong> différents<br />
implants glénoïdiens.<br />
*P. Mansat, Service d’Orthopédie Traumatologie,<br />
CHU Purpan, place du Docteur-Baylac, 31059 Toulouse.<br />
237 Descellement de glène prothétique<br />
: influence de la tension du<br />
sous-scapulaire et de la rétroversion<br />
glénoïdienne<br />
A. FARRON*, P. BUECHLER, M.DUTOIT<br />
INTRODUCTION. Les causes du <strong>des</strong>cellement glénoïdien sont<br />
multi-factoriel<strong>les</strong> (<strong>des</strong>sin de l’implant, technique chirurgicale,<br />
caractéristiques osseuses et <strong>des</strong> parties mol<strong>les</strong>). Cette étude biomécanique<br />
a pour but d’évaluer <strong>les</strong> conséquences de 2 problèmes<br />
cliniques fréquemment rencontrés lors d’arthroplasties d’épaule :<br />
la tension du sous-scapulaire et la rétroversion glénoïdienne.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Nous avons développé un<br />
modèle d’épaule tridimensionnel, qui inclut la coiffe <strong>des</strong> rotateurs.<br />
Une prothèse totale a été numériquement implantée dans le<br />
modèle. La prothèse humérale, imitant <strong>les</strong> implants adaptab<strong>les</strong> de<br />
3 e génération, comprend une tige et une portion de sphère métalliques,<br />
permettant ainsi la reconstruction anatomique de l’humérus<br />
proximal. La glène, constituée de polyéthylène et cimentée à<br />
l’os, possède une quille centrale et un fond plat. Deux tensions du<br />
sous-scapulaire (normale et doublée) et deux positions de glène<br />
(0° et 20° de rétroversion) ont été testées. Des mouvements de<br />
rotation externe (0-40°) et interne (0-60°) ont été simulés. Nous<br />
avons calculé <strong>les</strong> déplacements du point de contact gléno-huméral,<br />
<strong>les</strong> forces et pressions articulaires, <strong>les</strong> stress intra-osseux glénoïdiens<br />
ainsi que <strong>les</strong> micro-mouvements aux interfaces os-cimentimplant.<br />
RÉSULTATS. La tension du sous-scapulaire provoque une augmentation<br />
<strong>des</strong> forces et pressions articulaires, associée à une translation<br />
postérieure modérée du point de contact gléno-huméral. La<br />
rétroversion induit un déplacement postérieur plus marqué du<br />
point de contact, conduisant à une augmentation significative <strong>des</strong><br />
contraintes intra-osseuses glénoïdiennes et <strong>des</strong> micromouvements<br />
aux interfaces. L’association de la tension du sousscapulaire<br />
à la rétroversion glénoïdienne provoque une concentra-
tion importante <strong>des</strong> stress dans la partie postérieure de la glène et<br />
une augmentation de tous <strong>les</strong> micromouvements.<br />
CONCLUSION. La tension du sous-scapulaire et la rétroversion<br />
de l’implant glénoïdien ont <strong>des</strong> conséquences biomécaniques<br />
importantes, susceptib<strong>les</strong> de favoriser un <strong>des</strong>cellement de la glène.<br />
La correction de ces deux paramètres doit faire l’objet d’une attention<br />
particulière lors d’arthroplastie d’épaule.<br />
*A. Farron, 4, avenue Pierre-Decker, 1005 Lausanne, Suisse.<br />
238 L’arthroplastie glissement de coude<br />
GUEPAR : à propos de 20 cou<strong>des</strong><br />
rhumatoï<strong>des</strong><br />
J.-Y. ALNOT*, C. HEMON, R.EL ABIAD,<br />
E. MASMEJEAN ET LE GUEPAR<br />
INTRODUCTION. Les auteurs ont réalisé une étude rétrospective<br />
portant sur 20 prothèses tota<strong>les</strong> de coude GUEPAR humérocubitale<br />
et huméro-radiale (G3) implantées chez 19 patients<br />
atteints de polyarthrite rhumatoïde et 1 patient avec une association<br />
rhumatisme psoriasique ; polyarthrite rhumatoïde.<br />
Il s’agit d’une prothèse anatomique, métal-polyéthylène respectant<br />
le valgus physiologique, avec une prothèse droite et une<br />
prothèse gauche et 2 tail<strong>les</strong> petit et grand modèle. A côté de la<br />
prothèse huméro-cubitale, une prothèse de tête radiale est maintenant<br />
associée et comporte une tige métallique intra médullaire et<br />
une cupule mobile en polyéthylène avec plusieurs tail<strong>les</strong>.<br />
MATERIEL ET MÉTHODES. Sur <strong>les</strong> 20 prothèses mises en<br />
place de 1997 à 2001, dans 4 cas, il s’agissait de prothèses de 1 ère<br />
génération sans association avec une prothèse de tête radiale ayant<br />
développé à3ou4ansderecul une instabilité en valgus avec<br />
détérioration du polyéthylène de la pièce cubitale, nécessitant une<br />
reprise chirurgicale par une nouvelle prothèse GUEPAR associée<br />
à une prothèse de tête radiale avec 2 bons résultats et 2 échecs<br />
repris par prothèse semi-contrainte. Dans 16 cas d’étiologie rhumatoïde,<br />
une prothèse G3 huméro-cubitale associée à une prothèse<br />
de tête radiale a été mise en place, avec un recul moyen de 2 ans et<br />
ce sont ces 16 prothèses qui font essentiellement l’objet de cette<br />
étude. La voie d’abord postérieure avec section enV inversée large<br />
du triceps et la technique chirurgicale préconisées par <strong>les</strong> promoteurs<br />
sont détaillées. Les patients souffraient tous de douleurs<br />
sévères ou modérées, mais permanentes et le score de la Mayo<br />
Clinic de 1992 incluant <strong>les</strong> gestes de la vie courante, était de 33<br />
points sur 100.<br />
Sur le plan radiographique, 7 cou<strong>des</strong> étaient grade Larsen III et<br />
9 grade IV ou 7 grade IIIa et 9 grade IIIb selon la classification de<br />
Larsen modifiée Mayo Clinic.<br />
RÉSULTATS ET CONCLUSION. <strong>Tous</strong> <strong>les</strong> patients ont été<br />
revus avec un recul moyen de 2 ans (5 ans à 1 an) le score de la<br />
Mayo Clinic est passé de 33 à 90, avec 15 cou<strong>des</strong> jugés excellents<br />
et 1 moyen. Les auteurs précisent <strong>les</strong> indications <strong>des</strong> prothèses<br />
tota<strong>les</strong> de coude dans la polyarthrite rhumatoïde et si <strong>les</strong> prothèses<br />
semi-contraintes sont uti<strong>les</strong> et nécessaires dans certaines <strong>des</strong>tructions<br />
massives, il n’en reste pas moins que <strong>les</strong> prothèses glissement<br />
peu ou pas contrainte, comme la prothèse GUEPAR, font partie de<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S133<br />
l’évolution, comme cela a été le cas pour <strong>les</strong> prothèses de genoux<br />
et l’on peut espérer <strong>des</strong> résultats plus stab<strong>les</strong> à long terme.<br />
*J.-Y. Alnot, Hôpital Bichat,<br />
46, rue Henri-Huchard, 75877 Paris.<br />
239 Arthrolyse du coude par voie transhumérale<br />
: à propos d’une série de<br />
13 cas<br />
B. COULET*, M. CHAMMAS, B.MARTIN,<br />
F. BUSCAYRET, Y.ALLIEU<br />
INTRODUCTION. Le choix de la voie d’abord est un temps<br />
essentiel de toute arthrolyse du coude. Elle doit permettre l’accès à<br />
toutes lésions à l’origine de la raideur, tout en restant la moins<br />
délabrante possible. Nous rapportons dans cette étude <strong>les</strong> résultats<br />
d’arthrolyses du coude par voies trans-huméra<strong>les</strong> respectant <strong>les</strong><br />
formations latéra<strong>les</strong>.<br />
MATÉRIEL. Treize arthrolyses trans-huméra<strong>les</strong> réalisées de<br />
1996 à 2002 ont été revues rétrospectivement avec un recul moyen<br />
de 18 mois (6 à 63 mois). La moyenne d’âge au moment de la<br />
chirurgie est de 44 ans. L’étiologie de la raideur était 5 fois posttraumatique<br />
et 8 fois dégénérative. Il s’agissait selon la SOFCOT<br />
de 2 formes sévères, 10 modérées et 1 minime.<br />
MÉTHODES. L’arthrolyse a été réalisée par voie postérieure<br />
trans-tricipitale. Après libération de la fossette et du bec olécranien,<br />
l’apophyse coronoïde et la capsule antérieure sont libérées<br />
grâce à une fenêtre osseuse trans-humérale. Deux patients ont<br />
bénéficié dans le même temps d’une transposition du nerf ulnaire.<br />
La rééducation a débuté en postopératoire immédiat pendant une<br />
durée moyenne de 17 semaines.<br />
RÉSULTATS. A la révision, l’extension active du coude était<br />
passée de – 39 ± 9à–21± 9 et la flexion de 109 ± 14 à 129 ± 7, ce<br />
qui correspond à une augmentation du volant de mobilité de<br />
38 ± 14 (+ 36 %) (préopératoire : 70 ; postopératoire : 108). Ce<br />
gain en mobilité est superposable dans <strong>les</strong> deux groupes étiologiques<br />
post-traumatique et dégénératif. La douleur évaluée par une<br />
échelle analogique de 0 à 10, est passée en moyenne de 3,2 ± 1,3 à<br />
2,4 ± 2,0 en cas de raideur post-traumatique et de 7,4 ± 1,3 à<br />
4,1 ± 2 dans <strong>les</strong> formes dégénératives. Nous déplorons un cas<br />
d’irritation postopératoire du nerf ulnaire partiellement régressif.<br />
DISCUSSION. L’arthrolyse trans-humérale permet une libération<br />
postérieure et antérieure du coude tout en préservant <strong>les</strong> formations<br />
latéra<strong>les</strong>. Cette technique paraît très efficace en cas de<br />
blocage osseux olécraniens, de rétractions capsulaires postérieures<br />
et antérieures ainsi que butée antérieure coronoïdienne. En cas<br />
d’étiologie dégénérative, l’indolence est obtenue dans 70 % <strong>des</strong><br />
cas.<br />
CONCLUSION. L’arthrolyse trans-humérale du coude initialement<br />
proposée en cas de coude dégénératif, est une technique<br />
transposable aux raideurs post-traumatiques, à condition qu’el<strong>les</strong><br />
soient modérées, sans limitation de la prono-supination, ni atteinte
3S134 78 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
patente <strong>des</strong> ligaments latéraux. Les séquel<strong>les</strong> de fractures de la<br />
palette humérale en sont <strong>les</strong> meilleures indications.<br />
*B. Coulet, Service de Chirurgie Orthopédique 2 et Chirurgie<br />
de la Main, CHU Lapeyronie, 34295 Montpellier Cedex 5.<br />
240 La prothèse de tête radiale GUE-<br />
PAR dans <strong>les</strong> fractures récentes et<br />
anciennes : à propos d’une série de<br />
22 cas<br />
V. KATZ*, J.-Y. ALNOT, P.HARDY<br />
INTRODUCTION. Les auteurs ont revus rétrospectivement <strong>les</strong><br />
résultats de 22 patients opérés pour fractures récentes et anciennes<br />
de la tête radiale par la prothèse GUEPAR, prothèse à cupule<br />
métallique mobile dérivant de la prothèse totale de coude à glissement<br />
GUEPAR.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Parmi <strong>les</strong> 22 patients, 18 ont été<br />
opérés en urgence et 4 secondairement. L’âge moyen était de 41<br />
ans et le recul est de 18 mois. Les patients ont été revus sur <strong>des</strong><br />
critères cliniques permettant de calculer le score de la Mayoclinic.<br />
Les fractures étaient <strong>des</strong> fractures tota<strong>les</strong> ou <strong>des</strong> fractures cervica<strong>les</strong><br />
désengrenées et dans 72 % <strong>des</strong> cas il existait une luxation du<br />
coude associée. Lors de l’intervention la coronoïde a été synthésée<br />
dans 1 cas, l’olécrane dans un cas et le plan ligamentaire interne a<br />
été réparé dans 5 cas. Un bilan précis du cartilage du condyle<br />
huméral était un préliminaire à la pose de la prothèse. Les auteurs<br />
insistent également sur l’importance du bon positionnement de la<br />
prothèse en hauteur.<br />
RÉSULTATS. Aucune complication n’est à déplorer. Les<br />
patients opérés en urgence ont eu un bon résultat avec un score de<br />
la Mayoclinic moyen de 83/100, une force moyenne de 75 %, de<br />
bonnes mobilités avec notamment une pronation de 77° et une<br />
supination de 79°, <strong>des</strong> cou<strong>des</strong> stab<strong>les</strong> et l’absence de problème au<br />
poignet.<br />
Les patients opérés secondairement ont eu de moins bons résultats,<br />
notamment en ce qui concerne <strong>les</strong> mobilités (pronation 44° et<br />
supination 54°). L’index radio-ulnaire distal n’a pas été non plus<br />
parfaitement restauré. Enfin, 4 patients ont eu une arthrolyse pour<br />
limitation de la flexion/extension dont 3 parmi <strong>les</strong> patients opérés<br />
secondairement.<br />
DISCUSSION. La résection de la tête radiale qui est une alternative<br />
dans <strong>les</strong> fractures complexes entraîne inconvénients. Le<br />
premier est de déstabiliser le coude en valgus en cas d’atteinte du<br />
plan ligamentaire interne et le deuxième est d’entraîner une ascension<br />
du radius en cas d’atteinte de la membrane interosseuse. La<br />
synthèse qui est l’autre alternative, est difficile et ne donne pas de<br />
bons résultats, ni dans la littérature, ni dans notre expérience (nous<br />
avons comparé la série de prothèses à une série de 20 synthèses<br />
pour <strong>des</strong> fractures équivalentes).<br />
La prothèse semble être la bonne solution : elle stabilise le<br />
coude, empêche l’ascension du radius, permet une rééducation<br />
précoce et donne de bons résultats subjectifs notamment dans <strong>les</strong><br />
cas vus en urgence.<br />
*V. Katz, Hôpital Bichat, 46, rue Henri-Huchard, 75877 Paris.<br />
241 Évaluation du risque infectieux<br />
(infections profon<strong>des</strong>) pour une<br />
série continue de 790 prothèses<br />
tota<strong>les</strong> de hanche en première<br />
intention dans un centre hospitalier<br />
universitaire<br />
A. GABRION*, E. HAVET, M.EVAILLARD,<br />
J. VERNOIS, P.MERTL, M.DE LESTANG<br />
INTRODUCTION. Les infections profon<strong>des</strong> du site opératoire<br />
représentent une complication rare mais redoutable <strong>des</strong> implantations<br />
de prothèse de hanche en première intention. Les données<br />
françaises concernant ces infections sont rares. Nous présentons<br />
dans cette étude l’incidence, <strong>les</strong> caractéristiques et <strong>les</strong> facteurs de<br />
risque potentiels de ces infections à partir d’une série continue de<br />
790 prothèses tota<strong>les</strong> de hanche réalisées en première intention<br />
dans un même centre universitaire.<br />
MÉTHODE. <strong>Tous</strong> <strong>les</strong> patients opérés de novembre 95 à mai 99<br />
ont été inclus. Des données démographiques, cliniques, thérapeutiques<br />
et <strong>des</strong> données concernant l’intervention ont été recueillies.<br />
L’infection profonde était définie par la mise en évidence de<br />
micro-organismes sur au moins deux prélèvements peropératoires<br />
réalisés lors d’une reprise chirurgicale. Le suivi <strong>des</strong> patients était<br />
compris entre 1 mois et 4 ans. L’étude <strong>des</strong> facteurs de risques<br />
potentiels a été réalisée par analyse univariée. Les test du khi-deux<br />
et exact de Fisher ont été utilisés.<br />
RÉSULTATS. L’incidence globale était de 1,77 infections profon<strong>des</strong><br />
pour 100 interventions (intervalle de confiance à 95 %<br />
[0,84-2,7]). Le délai de survenue était compris entre 14 jours et 32<br />
mois. Onze infections ont été mises en évidence lors de la première<br />
année de suivi et trois après un an. Deux facteurs de risque ont été<br />
identifiés : l’absence d’antibioprophylaxie systémique (risque<br />
relatif = 4,74 ; p = 0,03) et un écoulement <strong>des</strong> redons après 48<br />
heures (risque relatif = 3,62 ; p = 0,02). Les autres variab<strong>les</strong> associées<br />
à l’infection avec un risque relatif supérieur à 2 étaient l’obésité,<br />
une corticothérapie et la survenue d’un hématome ou d’un<br />
problème cicatriciel postopératoire.<br />
CONCLUSION. L’incidence retrouvée dans notre étude est<br />
légèrement supérieure à ce qui est décrit habituellement dans <strong>les</strong><br />
étu<strong>des</strong> étrangères. Cette étude nous a poussé à réactualiser <strong>les</strong><br />
protoco<strong>les</strong> de préparation cutanée préopératoire et à codifier<br />
l’antibioprophylaxie.<br />
*A. Gabrion, Service de Chirurgie Orthopédique et<br />
Traumatologique, CHU Nord, 80000 Amiens.
242 Technique conventionnelle d’implantation<br />
<strong>des</strong> prothèses tota<strong>les</strong> de<br />
genou et navigation informatisée :<br />
analyse comparative à court terme<br />
de deux séries appariées totalisant<br />
156 prothèses<br />
E. VAN GAVER*, R. NIZARD, C.NICH, L.SEDEL<br />
INTRODUCTION. Les matériels ancillaires classiques pour<br />
l’implantation d’une prothèse totale de genou (PTG) sont perfectib<strong>les</strong>.<br />
L’utilisation d’une chirurgie assistée par ordinateur pourrait<br />
améliorer la qualité technique de l’implantation. Le but de cette<br />
étude est de comparer sur une série appariée <strong>les</strong> résultats <strong>des</strong> PTG<br />
implantées conventionnellement et cel<strong>les</strong> implantées avec un système<br />
de chirurgie assistée par ordinateur.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Soixante-dix-huit prothèses<br />
implantées avec un système de chirurgie assistée par ordinateur<br />
basé sur une reconstruction scanner 3D du membre inférieur ont<br />
été appariées à 78 prothèses implantées conventionnellement par<br />
un opérateur très entraîné. Les genoux ont été appariés sur le sexe,<br />
l’étiologie la voie d’abord et la déviation axiale. Il n’y avait pas<br />
avant l’intervention de différence entre <strong>les</strong> deux groupes pour ces<br />
variab<strong>les</strong>. Les genoux opérés de façon conventionnelle l’ont été en<br />
utilisant un système de visée intra-médullaire. Les genoux opérés<br />
sous assistance l’ont été à l’aide du système Navitrackt. Le système<br />
prothétique utilisé était le même dans <strong>les</strong> deux séries (Wallaby).<br />
Les mesures ont été réalisées par un opérateur indépendant<br />
sur <strong>des</strong> gonométries en charge en appui bipodal. L’axe fémorotibial<br />
a été mesuré ainsi que la position individuelle <strong>des</strong> composants<br />
fémoraux et tibiaux.<br />
RÉSULTATS. Quatre-vingt-onze pour cent <strong>des</strong> genoux opérés<br />
avec le système de chirurgie assisté par ordinateur étaient dans <strong>des</strong><br />
valeurs comprises entre 3 de varus et 3 de valgus. Cinquante-neuf<br />
pour cent étaient dans ce cas pour <strong>les</strong> genoux opérés conventionnellement.<br />
La différence était très significative (p < 0,0001).L’analyse<br />
<strong>des</strong> composants fémoraux et tibiaux pris individuellement ne<br />
montrait pas de différence significative.<br />
DISCUSSION. Les résultats <strong>des</strong> PTG sont dépendants en partie<br />
de la technique opératoire. L’objectif a été atteint plus souvent<br />
avec le système de chirurgie assistée qu’il ne l’a été avec la technique<br />
conventionnelle. La navigation pourrait être utile dans la<br />
réussite d’un objectif technique à court terme, son intérêt sur le<br />
résultat à moyen ou long terme reste à démontrer.<br />
*E. van Gaver, Service d’Orthopédie, HIA Percy,<br />
avenue Henri-Barbusse, 92150 Clamart.<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S135<br />
Séance du 13 novembre matin<br />
GENOU<br />
243 Arthroplastie totale du genou avec<br />
instrumentation conventionelle ou<br />
assistée par ordinateur<br />
L. LINO*, J.-N. ARGENSON, X.FLECHER,<br />
J.-M. AUBANIAC<br />
INTRODUCTION. La majorité <strong>des</strong> reprises de prothèse totale<br />
du genou survenant avant la cinquième année, la première cause<br />
est la malposition prothétique. L’introduction de la chirurgie assistée<br />
par ordinateur est présentée comme une technique permettant<br />
d’augmenter la précision d’implantation. Le but de cette étude est<br />
d’évaluer la qualité radiologique d’implantation d’une prothèse<br />
totale du genou avec assistance par ordinateur en comparaison<br />
d’une implantation avec instrumentation conventionelle.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Une étude prospective randomisée<br />
a été réalisée sur un total de 82 patients répartis entre instrumentation<br />
conventionelle (groupe 1) et assistée par ordinateur<br />
(groupe 2). Les deux groupes étaient comparab<strong>les</strong> pour l’âge, le<br />
sexe, l’indice de masse corporelle, le côté et l’angle fémoro-tibial<br />
préopératoire (HKA). <strong>Tous</strong> <strong>les</strong> patients ont été opérés par le même<br />
chirurgien avec la même prothèse postéro-stabilisée cimentée. Sur<br />
le plan radiographique ont été mesurés l’angle HKA, l’angle teta<br />
entre axes mécanique et anatomique fémoral, l’angle d’implantation<br />
fémoral et tibial, la pente tibiale postérieure. Toutes <strong>les</strong> mesures<br />
ont été réalisées par un observateur indépendant ne connaissant<br />
pas le caractère navigué ou non.<br />
RÉSULTATS. Aucune différence statistiquement significative<br />
n’a été retrouvée pour l’angle HKA 177,5 dans le groupe 1 et 179,2<br />
dans le groupe 2 (p = 0,13) ; l’angle teta 6 dans le groupe 1 et 5,9<br />
dans le groupe 2 (p = 0,78) ; l’angle d’implantation fémoral 90,3<br />
pour le groupe 1 et 90 pour le groupe 2 (p = 0,74) ; la pente tibiale<br />
postérieure 3,5 dans le groupe 1 et 3,15 dans le groupe 2 (p = 0,65).<br />
Il existait une différence statistiquement significative pour l’angle<br />
tibial qui était de 87,3 pour le groupe 1 et de 89 pour le groupe 2 (p<br />
= 0,012).<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. Cette étude montre une<br />
amélioration significative pour le groupe navigué de la position de<br />
face de l’implant tibial et aucune différence pour le composant<br />
fémoral. Ceci peut être lié au guide de coupe utilisé, permettant<br />
plus de possibilités d’ajustement peropératoire pour le tibia. Les<br />
pertes sanguines étaient équivalentes dans <strong>les</strong> deux groupes (503<br />
ml), le temps opératoire plus long dans le groupe navigué (18<br />
minutes).En conclusion, il paraît important de pouvoir disposer de<br />
gui<strong>des</strong> de coupe spécifiquement adaptés à la chirurgie assistée par<br />
ordinateur et de réduire le temps opératoire.<br />
*L. Lino, Service de Chirurgie Orthopédique,<br />
Hôpital Sainte-Marguerite, 270, Bd de Sainte-Marguerite,<br />
13009 Marseille.
3S136 78 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
244 Apport de la chirurgie assistée par<br />
ordinateur dans l’arthroplastie<br />
totale du genou : à propos de 50<br />
cas<br />
S. POULAIN*, A. SAUTET<br />
INTRODUCTION. L’obtention d’un axe fémorotibial mécanique<br />
de 180° dans le plan frontal est un <strong>des</strong> objectifs biomécaniques<br />
de l’arthroplastie de genou. Une angulation frontale supérieure ou<br />
égale à 7° étant un facteur pronostique péjoratif pour la survie de<br />
l’implant. L’apparition de systèmes de navigation pour assister le<br />
chirurgien lors de la pose de ces prothèses a permis de découvrir de<br />
nouveaux concepts : goniométrie dynamique, étude chiffrée de la<br />
balance ligamentaire. Le but de cette étude était d’apprécier<br />
l’influence du positionnement en rotation de l’implant fémoral et<br />
sa variation lors de la flexion.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Nous avons revu 50 dossiers de<br />
patients opérés entre octobre 2001 et décembre 2002 d’une prothèse<br />
totale de genou assistée par ordinateur (système Orthopilot).<br />
Nous avons étudié <strong>les</strong> modifications de l’axe fémorotibial à 0°,<br />
30°, 60° et 90° avant <strong>les</strong> coupes osseuses, après <strong>les</strong> coupes tibia<strong>les</strong><br />
et en fin d’intervention avec <strong>les</strong> pièces définitives scellées.<br />
RÉSULTATS. La population, d’âge moyen 70 ans, se répartissait<br />
en dix-sept genu valgum et trente trois genu varum. L’axe<br />
fémorotibial moyen en fin d’intervention, implants définitifs en<br />
place, était de 0° en extension avec une balance ligamentaire équilibrée<br />
(± 2°) et le plus souvent une augmentation du varus à 30°,<br />
60° et 90° de flexion.<br />
DISCUSSION. La rotation externe de la pièce fémorale n’a pas<br />
été systématique. Certains genoux normo-axés en extension après<br />
la coupe tibiale présentaient un varus en flexion important probablement<br />
dû à une rotation externe de leur épiphyse fémorale.<br />
A contrario, <strong>les</strong> genoux qui présentaient une rotation interne de<br />
leur épiphyse fémorale, quelle qu’en soit la cause, avaient tendance<br />
à présenter un valgus lors de la flexion. La prise en charge de<br />
ces deux morphotypes de genoux par une rotation externe systématique<br />
de l’implant fémoral ne pouvait se faire qu’au détriment<br />
de la balance ligamentaire pour certains d’entre eux.<br />
CONCLUSION. L’avènement de la navigation comme assistance<br />
à la pose de prothèse de genou a permis de découvrir de<br />
nouveaux concepts comme la goniométrie dynamique. Celle-ci a<br />
permis d’étudier l’axe fémorotibial en flexion, position dans<br />
laquelle travaille le genou lors de la marche. Cette étude nous a<br />
montré que la rotation externe systématique de l’implant fémoral<br />
dans la pose <strong>des</strong> PTG n’est pas adaptée à tous <strong>les</strong> patients.<br />
*S. Poulain, Service d’Orthopédie, Hôpital Saint-Antoine,<br />
184, rue du Faubourg-Saint-Antoine, 75012 Paris.<br />
245 Équilibrage ligamentaire <strong>des</strong> prothèses<br />
tota<strong>les</strong> de genou sur genu<br />
varum<br />
P.-P. MILL*, G. ASENCIO, P.MARCHAND,<br />
P. KOUYOUMEDJIAN, S.HACINI, R.BERTIN,<br />
B. MEGY<br />
Le but de cette étude était de valider la technique la plus fiable<br />
pour l’obtension de l’isométrie ligamentaire du genou en flexion.<br />
MÉTHODE. La série était prospective et comprenait 57<br />
gonarthroses sur genu varum, opérés par le même chirurgien avec<br />
mise en place d’une prothèse Interax (Howmédica) non cimentée<br />
et non postérostabilisée. Le varus fémoro-tibial moyen préopératoire<br />
était de 8,23°. Les repères utilisés en peropératoire comprenaient<br />
la ligne condylienne postérieure, la ligne biépicondylienne<br />
et la ligne de Whiteside. Parallèlement, l’équilibre ligamentaire<br />
était évalué avec un tenseur à mesure angulaire (tenseur Derby).<br />
RÉSULTATS. Le premier temps comportait un équilibrage du<br />
genou en extension. La rétraction interne moyenne initiale mesurée<br />
avec le tenseur était de 3,6°. Un relachement de la concavité<br />
était réalisée dans 62 % <strong>des</strong> cas avec une rétraction résiduelle<br />
moyenne de 1. Le deuxième temps comportait l’évaluation du<br />
déséquilibre en flexion à 90°. Selon <strong>les</strong> repères anatomiques, la<br />
ligne condylienne postérieure (LCP) était parallèle à la ligne biépicondylienne<br />
(LBEC) dans 22 % <strong>des</strong> cas et perpendiculaire à la<br />
ligne de Whiteside (LW) dans 26 % <strong>des</strong> cas. Il existait une faible<br />
angulation respectivement dans 28 et 30 % <strong>des</strong> cas et une forte<br />
angulation dans 50 et 44 % <strong>des</strong> cas. Il existait donc une forte<br />
corrélation en peropératoire entre ces deux repères anatomiques. Il<br />
n’existait par contre pas de corrélation entre ces deux repères et le<br />
varus radiologique initial. L’évaluation par le tenseur retrouvait<br />
une rétraction interne moyenne en flexion de 2,96. La corrélation<br />
entre <strong>les</strong> mesures anatomiques et le tenseur ligamentaire était très<br />
significative. Lorsque la ligne biépicondylienne était parallèle à la<br />
ligne condylienne postérieure, la rétraction interne mesurée avec<br />
le tenseur était en moyenne de 1,12. Lorsqu’il existait une faible<br />
angulation, la mesure était de 2,25. Lorsque l’angulation était<br />
forte, la mesure était de 4,4 en moyenne. Nous avons fait <strong>les</strong><br />
mêmes constatations avec la ligne de Whiteside. La rotation<br />
externe de la coupe fémorale antéropostérieure était ensuite guidée<br />
par ces différentes mesures. Elle était de 2,6 en moyenne<br />
(extrêmes 0 et 6). La rétraction interne résiduelle mesurée par le<br />
tenseur était alors significativement améliorée, n’étant plus que de<br />
0,4 en moyenne (extrêmes -2 et 2).<br />
DISCUSSION. Après équilibrage ligamentaire en extension un<br />
déséquilibre existe fréquemment en flexion (dans 62 % <strong>des</strong> cas de<br />
la série). Ce dernier est indépendant de la valeur préopératoire du<br />
varus. Il est corrigé par la mise en rotation externe de l’implant<br />
fémoral dont la valeur est appréciée approximativement par <strong>les</strong><br />
repères anatomiques. Elle est mesurée pour nous de façon plus<br />
précise par le tenseur ligamentaire Derby.<br />
*P.-P. Mill, Service de Chirurgie Orthopédique,<br />
Hôpital G. Doumergue, 30000 Nîmes.
246 Incidence du f<strong>les</strong>sum préopératoire<br />
sur <strong>les</strong> résultas <strong>des</strong> prothèses tota<strong>les</strong><br />
de genou<br />
C. BUSSIÈRE*, L. JACQUOT, P.NEYRET, T.AÏT<br />
SI SELMI, E.SERVIEN<br />
INTRODUCTION. Une <strong>des</strong> difficultés techniques dans<br />
l’implantation prothétique totale du genou est la présence préopératoire<br />
d’une raideur ou d’un f<strong>les</strong>sum. Ce dernier est un <strong>des</strong> signes<br />
d’arthrose évoluée ou d’arthrite rhumatismale. Nous nous sommes<br />
intéressés à décrire <strong>les</strong> spécificités de technique de pose <strong>des</strong> PTG<br />
en cas de f<strong>les</strong>sum, et d’en analyser <strong>les</strong> résultats à long terme.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Nous disposons d’une série<br />
continue de 826 PTG postéro-stabilisées (HLS) mises en place<br />
depuis 1988 (suivies de manière prospective depuis 1995). Nous<br />
avons défini trois groupes selon le degré de f<strong>les</strong>sum préopératoire<br />
(groupe I de 0 à 10°, groupe II de 11 à 20° et groupe III au-delà de<br />
20°). Nous avons réalisé une évaluation sur la technique opératoire<br />
propre, puis l’analyse à long terme radioclinique en utilisant <strong>les</strong><br />
scores IKS.<br />
RÉSULTATS. Nous n’observons pas de différence significative<br />
clinique objective ou subjective, ainsi que radiographique, dans<br />
<strong>les</strong> deux premiers groupes (I et II). Les résultats semblent moins<br />
bons en cas de f<strong>les</strong>sum supérieur à 20, mais l’analyse statistique<br />
n’est pas possible.<br />
DISCUSSION. Cette étude permet de décrire la programmation<br />
spécifique préopératoire, puis <strong>les</strong> séquences opératoires propres à<br />
l’implantation d’une PTG avec f<strong>les</strong>sum. Les résultats de notre<br />
série ne permettent pas de distinguer de différences à long terme en<br />
cas de f<strong>les</strong>sum inférieur à 20°.Au-delà, <strong>les</strong> techniques de libération<br />
osseuses ou ligamentaires influent sur <strong>les</strong> résultats, moins bons. La<br />
postéro stabilisation permet une libération du LCP afin d’améliorer<br />
<strong>les</strong> récupérations articulaires.<br />
CONCLUSION. La programmation préopératoire d’une PTG<br />
doit bien évidemment tenir compte <strong>des</strong> déformations osseuses, mais<br />
également <strong>des</strong> amplitu<strong>des</strong> articulaires préopératoires. En cas de f<strong>les</strong>sum,<br />
la technique opératoire doit être adaptée. Ceci permet un positionnement<br />
<strong>des</strong> implants et une mobilité articulaire performants.<br />
*C. Bussière, Centre Livet,<br />
8, rue de Margnol<strong>les</strong>, 69300 Caluire.<br />
247 Restitution de l’interligne articulaire<br />
dans <strong>les</strong> reprises de prothèse totale<br />
de genou ou « équilibrage osseux »<br />
T. AÏT SI SELMI*, J. CHOUTEAU, M.KOUBAA,<br />
P. NEYRET<br />
Les reprises de prothèse totale de genou par prothèses à glissement<br />
comportent de nombreuses difficultés techniques. L’un <strong>des</strong><br />
principaux objectifs est de restaurer le niveau de l’interligne articulaire<br />
pour faire correspondre <strong>les</strong> espaces en flexion et en extension<br />
et pour respecter la hauteur rotulienne. Ceci est difficile en<br />
raison de la perte osseuse qui modifie <strong>les</strong> repères habituels. Le<br />
problème essentiel est de trouver une correspondance entre la<br />
programmation préopératoire et la réalisation peropératoire. Nous<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S137<br />
proposons une méthode simple pour réaliser cet objectif. La détermination<br />
de la hauteur de l’interligne se fait indirectement par la<br />
mesure de la longueur de chacun <strong>des</strong> segments du membre inférieur<br />
le long <strong>des</strong> axes mécaniques. Restituer la longueur respective<br />
du fémur et du tibia permet de retrouver la hauteur originelle de<br />
l’interligne. C’est un véritable équilibrage osseux tant il est vrai<br />
que dans un contexte de reprise <strong>les</strong> gestes d’équilibrage ligamentaire<br />
sont limités.<br />
La technique chirurgicale consiste à forer deux trous de mèche<br />
4,5 sur la corticale antérieure du fémur et du tibia à une distance<br />
connue de l’interligne (entre 8 et 10 cm) avant l’ablation <strong>des</strong><br />
implants. Une fois <strong>les</strong> pièces d’essai mise en place, la distance à<br />
l’interligne de chaque segment osseux est vérifiée et <strong>les</strong> composants<br />
prothétiques adaptés.<br />
La mesure de l’interligne est dépendante du tibia et du fémur.<br />
Elle a été évaluée par comparaison de la longueur <strong>des</strong> segments de<br />
membre (fémur et tibia) avant et après l’intervention. Une série<br />
continue de 26 cas a été mesurée. Les goniométries pré et postopératoires<br />
ont été utilisées en s’aidant de la longueur de la fibula<br />
controlatérale pour s’affranchir <strong>des</strong> agrandissements. La différence<br />
moyenne de longueur avant et après l’intervention était de<br />
1,15 mm pour le tibia et de 2,01 mm pour le fémur.<br />
La restitution de la longueur fémorale a toujours été possible. La<br />
tendance est globalement d’allonger le membre. Ceci est habituel<br />
et attribuable à l’équilibrage ligamentaire lors de l’intervention<br />
préalable. La restitution de l’interligne n’est pas toujours possible<br />
ou souhaitable. La méthode du trou repère est utile et fiable pour<br />
localiser et restituer l’interligne souhaité par le chirurgien. Elle est<br />
la clé de la restitution <strong>des</strong> espaces symétriques en flexion et en<br />
extension en conservant la longueur de chaque segment de membre,<br />
réalisant un équilibrage osseux.<br />
*T. Aït Si Selmi, Centre Livet,<br />
8 rue de Margnol<strong>les</strong>, 69300 Caluire.<br />
248 Faut-il sacrifier le ligament croisé<br />
postérieur dans <strong>les</strong> prothèses tota<strong>les</strong><br />
de genou ? A propos de 500<br />
PTG conservant le LCP avec un<br />
recul moyen de 7 ans<br />
J. WITVOET*, Y. MASSE, R.NIZARD, D.HUTEN,<br />
B. AUGEREAU, J.-H. AUBRIOT ET LE GROUPE<br />
GUEPAR<br />
INTRODUCTION. À l’heure où <strong>les</strong> prothèses tota<strong>les</strong> du genou<br />
(PTG) à plateau tibial ultra-congruent ou à plateau mobile sont à la<br />
mode, faut-il pour autant abandonner <strong>les</strong> PTG à plateau fixe préservant<br />
le ligament croisé postérieur (LCP) ? Nous avons analysé<br />
<strong>les</strong> résultats de 500 PTG Wallaby I‚ conservant le LCP et présentant<br />
<strong>des</strong> condy<strong>les</strong> fémoraux asymétriques et divergents avec un<br />
plateau tibial fixe également asymétrique, avec un recul moyen de<br />
7 ans (1 à 10 ans).<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Il s’agit d’une étude prospective,<br />
multicentrique incluant <strong>des</strong> chirurgiens séniors et juniors.<br />
L’âge moyen <strong>des</strong> patients était de 70,11 ans, 91,4 % présentaient<br />
une arthrose primitive ou secondaire. Cent trente genoux avaient<br />
eu une intervention préalable dont 40 ostéotomies essentiellement
3S138 78 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
tibia<strong>les</strong> et 18 reprises de prothèses uni ou tota<strong>les</strong>. L’IKS genou<br />
moyen préopératoire était de 26,11 points et l’IKS fonction moyen<br />
de 29,54 points. 11,26 % <strong>des</strong> genoux étaient axés en préopératoire,<br />
27,16 % en valgus ≥ à 4 et 61,56 % en varus ≥ à 3. Pratiquement<br />
toutes <strong>les</strong> pièces tibia<strong>les</strong> et rotuliennes étaient cimentées. 5,8 %<br />
<strong>des</strong> pièces fémora<strong>les</strong> n’étaient pas cimentées. Toutes <strong>les</strong> rotu<strong>les</strong><br />
sauf 4 étaient prothésées. Ilyaeu2infections précoces, 1 paralysie<br />
du SPE et 12 problèmes de cicatrisation cutanée. Cinquantetrois<br />
genoux (10,6 %) ont eu une mobilisation sous anesthésie<br />
générale.<br />
RÉSULTATS. Vingt-deux patients ont été perdus de vue (15) ou<br />
décédés (7) avant un an. Parmi <strong>les</strong> 478 genoux suivis de1à10ans,<br />
ilyaeu6infections tardives (1,25 %), 1 seul <strong>des</strong>cellement aseptique<br />
bipolaire (0,2 %), 25 fractures de rotule (5,23 %) dont 3<br />
seulement ont nécessité une intervention (2 cerclages, 1 ablation<br />
de prothèse), 3 fractures fémora<strong>les</strong> péri prothétiques sans conséquences<br />
sur le résultat clinique et radiologique, 1 rupture traumatique<br />
du ligament collatéral médial et 2 ruptures secondaires du<br />
LCP sans conséquence clinique. Il n’y a pas eu de reprise pour<br />
instabilité, ce qui est pourtant une cause fréquente de reprise d’une<br />
PTG. L’IKS genou moyen postopératoire était de 90,6 points et<br />
l’IKS fonction de 59,7 points en raison essentiellement de l’âge<br />
<strong>des</strong> patients et de co-morbidités. Le pourcentage de survieà8ans<br />
(suivant Kaplan-Meier) était de 98,2 % (intervalle de confiance à<br />
95 % : 99,4-96,9 %) quelle que soit la raison de la révision de la<br />
prothèse et de 99,2 % (intervalle de confiance à 95 % : 100D<br />
98,4 %) si la révision était d’origine mécanique. Radiologiquement,<br />
plus de 70 % <strong>des</strong> genoux étaient alignés (entre 3° de valgus<br />
et 2° de varus) et plus de 90 étaient compris entre 5° de valgus et 5°<br />
de varus. Bien qu’il soit difficile de mesurer radiologiquement<br />
l’usure du polyéthylène, il n’y a qu’un seul cas d’usure > à2<br />
millimètres avec ostéolyse sur 50 cas pris au hasard parmi <strong>les</strong><br />
genoux ayant plus de 7 ans de recul.<br />
CONCLUSION. Cette étude, comme celle d’autres auteurs<br />
conservant le LCP, montre que la conservation du LCP limite le<br />
risque d’instabilité, permet d’obtenir d’excellents résultats cliniques<br />
et radiologiques sans usure importante du polyéthylène, ce<br />
qui laisser espérer que ces bons résultats se maintiendront dans<br />
l’avenir.<br />
*J. Witvoet, 2, square La Fontaine, 75016 Paris.<br />
249 La PTG dans l’arthrite juvénile idiopathique<br />
(AJI) : difficultés techniques<br />
et solutions<br />
M. BERCOVY*, L. N’GUYEN, C.GLORION,<br />
P. TOUZET<br />
Nous exposons <strong>les</strong> problèmes techniques rencontrés pour le<br />
remplacement prothétique <strong>des</strong> genoux dans l’AJI. La caractéristique<br />
de cette maladie est d’entraîner une <strong>des</strong>truction articulaire à un<br />
stade précoce de la croissance.<br />
Trente et une PTG ont été implantées chez 17 patients avec un<br />
niveau de handicap majeur : Steinbrocker (ST) II (30 %), ST III<br />
(30 %) et ST IV (40 %). L’âge moyen au moment de l’intervention<br />
était de 20 ans (extrêmes : 14 et 29 ans).<br />
Les difficultés techniques étaient liées à l’association : 1/De<br />
déformations multidirectionnel<strong>les</strong>, généralement en valgus = 16<br />
(5-30) (30 % <strong>des</strong> cas) ; associé à une rotation externe = 20 (5-50) ;<br />
ainsi qu’une déformation sagittale avec flexum = 31 (5-60) ; avec<br />
luxation externe ou postérieure du tibia. 2/De limitation <strong>des</strong> amplitu<strong>des</strong><br />
articulaires : mobilité = 71 (0-115). 3/De déformations<br />
extra-articulaires, flexum ou rotation vicieuse <strong>des</strong> hanches ; cal<br />
vicieux fémoral ou tibial. 4/De dysplasie majeure <strong>des</strong> condy<strong>les</strong> par<br />
défaut de croissance (3/31) ou par nécrose (3/31). 5/De rotu<strong>les</strong> en<br />
position basse (100 %) et subluxation. 6/D’une fragilité osseuse et<br />
cutanée liée à la corticothérapie. 7/De la persistance du cartilage<br />
de croissance 4 fois.<br />
Nous avons cherché à implanter la prothèse la plus adaptée à<br />
chaque situation en privilégiant la prothèse la moins contrainte<br />
possible.<br />
Nous avons ainsi pu utiliser 15 prothèses à plateaux mobi<strong>les</strong><br />
(PM) dont 5 PTG à glissement pur et 10 PTG postérostabilisées à<br />
PM et 16 prothèses à charnière dont 2 rotatoires. Trente PTG sur<br />
<strong>les</strong> 31 avaient <strong>des</strong> dimensions spécia<strong>les</strong>.<br />
De nos différentes approches techniques, nous pouvons tirer <strong>les</strong><br />
conclusions suivantes : correction <strong>des</strong> déformations extra articulaires<br />
par PTH, ténotomies et traction préalab<strong>les</strong>, ou bien ostéotomies<br />
contemporaines de la PTG ; abord premier et contrôle<br />
vasculo-nerveux (SPE) préalable ; reconstruction par autogreffe<br />
en cas de perte de substance condylienne ou trochléenne ; dissection<br />
sous périostée conservant <strong>les</strong> ligaments latéraux à la recherche<br />
d’un équilibre ligamentaire lorsque cela était envisageable afin<br />
d’implanter la prothèse la moins contrainte possible ; non cimentage<br />
<strong>des</strong> implants, surtout lorsque l’os avait une consistance<br />
« molle » ou « graisseuse » ; non resurfaçage rotulien lorsqu’il y<br />
avait un risque de surépaissir une rotule basse et subluxée.<br />
*M. Bercovy, Clinique Les Fontaines,<br />
54, boulevard Aristide-Briand, 77000 Melun.<br />
250 Prothèses tota<strong>les</strong> du genou infectées<br />
: à propos de 179 cas<br />
T. BAUER*, P. PIRIOU, L.LHOTELLIER,<br />
P. LECLERC, P.MAMOUDY, A.LORTAT-JACOB<br />
INTRODUCTION. Les auteurs rapportent <strong>les</strong> résultats d’une<br />
étude sur la prise en charge <strong>des</strong> infections de prothèses tota<strong>les</strong> du<br />
genou. Le but était d’analyser <strong>les</strong> différentes options thérapeutiques<br />
et de trouver <strong>des</strong> facteurs prédictifs de guérison d’une infection<br />
sur prothèse totale du genou.<br />
MATÉRIEL. Il s’agit d’une étude rétrospective multicentrique<br />
continue de 179 cas d’infections sur prothèse de genou.<br />
MÉTHODES. Il yaeu77casdechangement de PTG en 2<br />
temps, 30 cas de changement en 1 temps, 26 cas de synovectomie,<br />
36 cas d’arthrodèse et 9 cas d’amputation. Le recul minimum était<br />
de 2 ans. Pour chaque cas, le résultat sur la guérison de l’infection<br />
et le résultat fonctionnel ont été évalués. Des tests statistiques non<br />
paramétriques ont été utilisés pour comparer <strong>les</strong> différents résultats.<br />
RÉSULTATS. Le recul moyen est de 41,2 mois. On retrouve<br />
17 % de décès dans <strong>les</strong> 2 premières années après la prise en charge.
La guérison a été obtenue dans deux tiers <strong>des</strong> cas de changement<br />
de prothèse (en 1 ou 2 temps) et dans 54 % <strong>des</strong> cas de synovectomie.<br />
L’arthrodèse n’a permis la guérison qu’une fois sur deux. Les<br />
germes retrouvés étaient <strong>des</strong> staphylocoques dans 65 % <strong>des</strong> cas.<br />
Les résultats fonctionnels <strong>des</strong> changements de prothèse en 2 temps<br />
ont été moins bons en cas de relèvement de la tubérosité tibiale<br />
antérieure, d’atteinte de l’appareil extenseur ou de nécessité de<br />
lambeau de couverture (p < 0,05). On ne retrouve pas de différence<br />
significative entre <strong>les</strong> résultats fonctionnels <strong>des</strong> changements<br />
en 1 ou 2 temps. Quatre-vingt-quinze pour cent <strong>des</strong> synovectomies<br />
réalisées avant 16 jours ont guéri alors que 95 % <strong>des</strong><br />
synovectomies réalisées après 56 jours ont récidivé. Les arthrodèses<br />
réalisées en cas de perte de substance osseuse importante ont<br />
échoué. Parmi <strong>les</strong> échecs d’arthrodèse, 50 % <strong>des</strong> cas étaient <strong>des</strong><br />
échecs mécaniques et <strong>les</strong> autres cas étaient <strong>des</strong> récidives septiques.<br />
DISCUSSION. Les auteurs discutent <strong>les</strong> résultats et <strong>les</strong> indications<br />
<strong>des</strong> différents traitements lors d’une infection de prothèse<br />
totale du genou. Ils analysent, pour chaque option thérapeutique,<br />
<strong>les</strong> facteurs permettant d’espérer la guérison et le meilleur résultat<br />
fonctionnel.<br />
CONCLUSION. Le traitement d’une infection survenant sur<br />
une prothèse totale de genou doit permettre la guérison et maintenir<br />
un état fonctionnel satisfaisant, ce qui est souvent difficile à<br />
réaliser. Ce n’est parfois qu’après <strong>des</strong> interventions lour<strong>des</strong> et<br />
mutilantes que la guérison peut être obtenue, ce qui doit pouvoir<br />
être évité grâce à une prise en charge précoce et adaptée.<br />
*T. Bauer, Service de Chirurgie Orthopédique,<br />
Hôpital Ambroise-Paré, 9, avenue Char<strong>les</strong>-de-Gaulle,<br />
92104 Boulogne Cedex.<br />
251 Influence de la correction angulaire<br />
postopératoire sur l’usure du polyéthylène<br />
et la récidive de la déformation<br />
à long terme dans <strong>les</strong> prothèses<br />
unicompartimenta<strong>les</strong><br />
P. HERNIGOU*, G. DESCHAMPS<br />
INTRODUCTION. L’hypo-correction postopératoire est<br />
recommandée dans <strong>les</strong> prothèses unicompartimenta<strong>les</strong>. Les effets<br />
à long terme de cette hypo-correction sur l’usure du polyéthylène<br />
et sur le risque de récidive de la déformation initiale n’ont jusqu’ici<br />
pas été évalués. Cette étude précise, sur <strong>des</strong> prothèses unicompartimenta<strong>les</strong><br />
implantées depuis plus de 14 ans (entre 14 et 22 ans)<br />
l’influence de l’hypo-correction sur l’usure du polyéthylène et le<br />
risque de récidive de la déformation.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Quarante prothèses unicompartimenta<strong>les</strong><br />
comportant un plateau polyéthylène plan sans métal<br />
back ont été évaluées au recul maximum avec <strong>des</strong> radiographies<br />
effectuées sous contrôle scopique de manière à obtenir un rayon<br />
tangentiel au plateau en polyéthylène. Cette radiographie a permis<br />
d’apprécier la pénétration du composant fémoral dans le polyéthylène.<br />
Une goniométrie effectuée au dernier recul a été comparée à<br />
la goniométrie effectuée en postopératoire et a permis de mesurer<br />
la récidive de la déformation. Seu<strong>les</strong> <strong>les</strong> prothèses unicompartimenta<strong>les</strong><br />
ayant un croisé antérieur présent au moment de l’implan-<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S139<br />
tation ont été retenues pour l’étude afin d’éliminer <strong>les</strong>, usures<br />
possib<strong>les</strong> en relation avec l’absence de croisé antérieur.<br />
RÉSULTATS. Il existe une relation significative (p < 0,05)<br />
entre le varus postopératoire résiduel et la vitesse de pénétration du<br />
composant fémoral dans le polyéthylène. L’usure moyenne du<br />
polyéthylène était de 0,15 mm par an pour <strong>les</strong> prothèses unicompartimenta<strong>les</strong><br />
ayant un varus postopératoire inférieur à 10°. Elle<br />
est de 0,25 mm par an en moyenne pour <strong>les</strong> prothèses unicompartimenta<strong>les</strong><br />
ayant un varus postopératoire supérieur à 10°.<br />
Il existe aussi une corrélation (p < 0,01) entre la récidive de la<br />
déformation (différence entre la goniométrie au recul maximum et<br />
la goniométrie postopératoire) et le varus postopératoire. La récidive<br />
moyenne de la déformation est de 5° au recul maximum (de 2<br />
à 10°). Cette récidive de la déformation est corrélée à la pénétration<br />
du composant fémoral dans le polyéthylène. Schématiquement,<br />
une usure ou une pénétration de 1 mm correspond en<br />
moyenne à une récidive de la déformation de 2°. Enfin, la récidive<br />
de la déformation et la vitesse de pénétration du composant fémoral<br />
dans le polyéthylène sont aussi d’autant plus importants que<br />
l’épaisseur du polyéthylène est faible (p < 0,05).<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. Si l’hypo-correction apparaît<br />
souhaitable dans <strong>les</strong> prothèses unicompartimenta<strong>les</strong>, celle-ci<br />
doit rester modérée. En effet, un varus postopératoire trop important<br />
expose à une usure du polyéthylène plus rapide et à une<br />
récidive de la déformation. Par ailleurs, même pour <strong>les</strong> petites<br />
hypo-corrections, la correction achevée en postopératoire immédiat<br />
ne reste pas constante et la déformation en varus tend à récidiver.<br />
Ce phénomène protège sans doute le compartiment fémorotibial<br />
controlatéral mais expose à l’usure et au risque de<br />
<strong>des</strong>cellement à long terme.<br />
*P. Hernigou, Hôpital Henri-Mondor,<br />
51, avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny,<br />
94010 Créteil.<br />
252 Étude par DEXA de la redistribution<br />
de la minéralisation sous l’embase<br />
tibiale d’une prothèse totale de<br />
genou : à propos de 38 cas avec 5<br />
ans de recul minimum<br />
C. LAUTRIDOU*, C. HULET, J.-P. SABATIER,<br />
G. BURDIN, F.MENGUY, C.VIELPEAU<br />
INTRODUCTION. Après implantation d’une prothèse totale<br />
de genou pour arthrose, il se produit une déminéralisation précoce<br />
de l’épiphyse tibiale supérieure et une modification de la répartition<br />
de la DMO (densité minérale osseuse) dans <strong>les</strong> deux compartiments.<br />
L’évolution à long terme n’est pas connue à ce jour. Nous<br />
rapportons <strong>les</strong> résultats de 38 prothèses étudiées prospectivement<br />
et suivies par densitométrie avec un recul minimum de 5 ans.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Trente-huit prothèses, implantées<br />
pour gonarthrose primaire, ont été étudiées de façon prospective<br />
(âge moyen 70 + 4 ans, 60 % femmes). Toutes ont été évaluées<br />
cliniquement (IKS), radiologiquement (HKA) et par ostéodensitométrie<br />
avant la chirurgie, à6mois, 1 an, 2 ans et 5 ans. La<br />
densitométrie du col fémoral a aussi été faite avant l’intervention
3S140 78 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
et à 5 ans pour évaluer la variation du statut minéral osseux de<br />
chaque patient. Chaque genou a été mesuré par la méthode DEXA<br />
en incidence antéro-postérieure. 7 zones ont été définies autour de<br />
l’implant tibial, notamment 2 sous chaque plateau médial et latéral<br />
et 1 sous la quille. Nous avons étudié l’évolution de chaque zone<br />
dans le temps. Un degré de signification a 0,05 a été utilisé. La<br />
reproductibilité inter et intra observateur était de 2,9 % et 2,8 %.<br />
RÉSULTATS. A 5 ans de recul, le score IKS fonction moyen est<br />
de 85 + 19 et le score genou est de 91 + 8. L’axe mécanique moyen<br />
estde180+2avecunerépartition symétrique. Il n’existe pas de<br />
liseré évolutif. La DMO du col fémoral homolatéral n’a pas significativement<br />
varié (0,763 g/cm 2 à l’inclusion contre 0,750 g/cm 2 5<br />
ans plus tard) contrairement à l’évolution naturelle qui se produit<br />
dans une population de référence (femmes : – 4,5 %, hommes :<br />
– 2,4 %). Au genou, au cours <strong>des</strong> 5 premières années, il existe une<br />
diminution significative de la DMO moyenne <strong>des</strong> 7 zones (11,6 %,<br />
p < 0,0001). La DMO moyenne est de 0,936 g/cm 2 à l’inclusion,<br />
0,863 g/cm 2 à 6 mois), 0,823 g/cm 2 à 5 ans. La DMO diminue très<br />
nettement entre 0 et 6 mois (- 6,51 %, p < 0,0001), moins fortement<br />
jusqu’à la fin de la première année (– 3 %) puis décroît<br />
doucement de façon régulière et progressive, entre 1 an et 5 ans, de<br />
façon non significative. L’étude <strong>des</strong> 7 zones montre une différence<br />
d’évolution de la DMO entre <strong>les</strong> zones média<strong>les</strong>, latéra<strong>les</strong> et sous<br />
la quille. Les 2 zones média<strong>les</strong> diminuent significativement de<br />
6,33 % et 6,18 %, surtout pendant la première année (– 2,06 % et<br />
– 2,09 %), et de façon plus modérée entre 1 et 5 ans (- 1,6 %, - 2,65<br />
%). Les zones latéra<strong>les</strong> ont une baisse moyenne de DMO plus<br />
importante (– 10,50 %, – 8,92 %) entre 0 et 5 ans, : – 8,57 %,<br />
– 6,45 % au cours de la première année et ensuite en pente très<br />
douce. C’est sous la quille que la perte de DMO est la plus importante<br />
: – 14,3 % à 5 ans. Là encore entre 0 et 6 mois la perte est<br />
grande : – 8,09 %. Elle atteint – 12,74 % à 1 an puis elle n’évolue<br />
presque plus : – 1 à – 2 % entre 1 et 5 ans de recul.<br />
CONCLUSION. 1) Le remodelage osseux sous l’embase tibiale<br />
d’une PTG est précoce. Il se fait dans la première année (<strong>les</strong> 6<br />
premiers mois surtout) ensuite la DMO suit une évolution progressive<br />
et très modérée). 2) Le remodelage est plus important en DH<br />
qu’en DD. (bon réalignement mais persistance de contraintes varisantes<br />
avec une plus grande sollicitation médiale et une moindre<br />
sollicitation latérale. 3) C’est sous la quille que la perte de DMO<br />
est la plus importante. 4) La DMO du col reste stable contrairement<br />
à l’évolution attendue dans une population de référence.<br />
*C. Lautridou, Département d’Orthopédie,<br />
CHU de Caen, 14033 Caen Cedex.<br />
253 Sept ans d’utilisation <strong>des</strong> céramiques<br />
de synthèse en chirurgie de<br />
reprise <strong>des</strong> prothèses tota<strong>les</strong> de<br />
hanche<br />
C. SCHWARTZ*, P. LECESTRE, P.FRAYSSINET<br />
INTRODUCTION. Les reprises chirurgica<strong>les</strong> <strong>des</strong> prothèses<br />
tota<strong>les</strong> de hanches (PTH) sont <strong>des</strong> interventions fréquentes et le<br />
comblement <strong>des</strong> pertes de substance osseuse est devenu de ce fait<br />
un problème quotidien. La morbidité et la faible disponibilité <strong>des</strong><br />
autogreffes en font une mauvaise indication dans ce type de chirurgie.<br />
L’inquiétude suscitée par le devenir à long terme de certaines<br />
allogreffes et la quasi disparition <strong>des</strong> xénogreffes ont fait que<br />
l’utilisation <strong>des</strong> céramiques de synthèse s’est beaucoup développée<br />
ces dernières années.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Nous utilisons deux céramiques<br />
biphasées de phosphate de calcium (BCP) dans la chirurgie<br />
de reprise de PTH depuis octobre 1996. La première nommée se<br />
présente sous forme de granulés quadrangulaires de quelques mm<br />
de côté et est composé de 55 % d’hydroxyapatite (HA) et de 45 %<br />
de phosphate tricalcique (TCP). Elle a <strong>des</strong> pores d’environ 400<br />
microns de diamètre, une porosité globale, totalement interconnectée,<br />
de 60 %. Son indication est le remplissage de vi<strong>des</strong> osseux.<br />
La seconde BCP est composée de 65 % d’HA et de 35 % de TCP,<br />
avec <strong>des</strong> pores de taille plus petite (200 microns), une porosité non<br />
totalement interconnectée et de ce fait une résistance en compression<br />
entre 20 et 30 MPa ; elle a donc une indication de soutien<br />
mécanique, en plus du remplissage. Soixante-six fémurs et 75<br />
acétabulum reconstruits avec ces substituts ont ainsi pu être revus<br />
avec un recul de3à7ans. Les granulés seuls sont utilisés dans <strong>les</strong><br />
pertes de substance cavitaires, soit <strong>les</strong> géo<strong>des</strong> acétabulaires et <strong>les</strong><br />
pertes de substance osseuse fémorale, mais aussi le long <strong>des</strong> ostéotomies<br />
d’abord et <strong>des</strong> fractures éventuel<strong>les</strong>. Dans <strong>les</strong> pertes osseuses<br />
de l’acétabulum de stade II et de certains sta<strong>des</strong> III, nous<br />
utilisons préférentiellement <strong>des</strong> cupu<strong>les</strong> sans ciment de grande<br />
taille, de type impactées, appuyées sur l’os restant ; lorsque cela<br />
n’est plus possible, dans <strong>les</strong> pertes de substances segmentaires<br />
plus importantes <strong>des</strong> sta<strong>des</strong> III et IV, la reconstruction est faite avec<br />
<strong>des</strong> anneaux de soutien ancrés dans le trou obturateur et appuyés<br />
sur <strong>des</strong> disques ou autres formes de la deuxième céramique, plus<br />
dense, ce qui permet la mise en charge immédiate. Cette deuxième<br />
BCP est également très utile lorsque <strong>les</strong> cortica<strong>les</strong> fémora<strong>les</strong> sont<br />
trop fines pour supporter seu<strong>les</strong> l’ostéosynthèse par cerclage de la<br />
voie d’abord trans-fémorale, grâce à la résistance à la compression<br />
de ce substitut.<br />
RÉSULTATS ET DISCUSSION. Aucun problème biologique<br />
n’a été rencontré. Deux échecs mécaniques acétabulaires et cinq<br />
au fémur sont à déplorer, secondaires à <strong>des</strong> erreurs techniques ou<br />
de choix d’implants. Les contrô<strong>les</strong> radiologiques montrent une<br />
intégration <strong>des</strong> substituts en contact avec le site receveur. Les<br />
granulés se résorbent progressivement ; la densité centrale de la<br />
céramique plus dense reste à peu près inchangée à cinq ans, alorsque<br />
par contre sa périphérie est progressivement résorbée. Sur le<br />
plan histologique, l’intégration de ces deux BCP est prouvée par<br />
l’étude de biopsies.<br />
CONCLUSION. Malgré un recul encore moyen, de 7 ans, on<br />
peut affirmer que <strong>les</strong> BCP sont une alternative intéressante dans la<br />
chirurgie de reprise <strong>des</strong> PTH. Dans notre expérience, ces céramiques<br />
apparaissent sûres et efficientes dans le respect <strong>des</strong> indications<br />
et <strong>des</strong> techniques classiques de ces reprises.<br />
*C. Schwartz, Service d’Orthopédie et de Traumatologie,<br />
Hôpital Pasteur, 68024 Colmar Cedex.