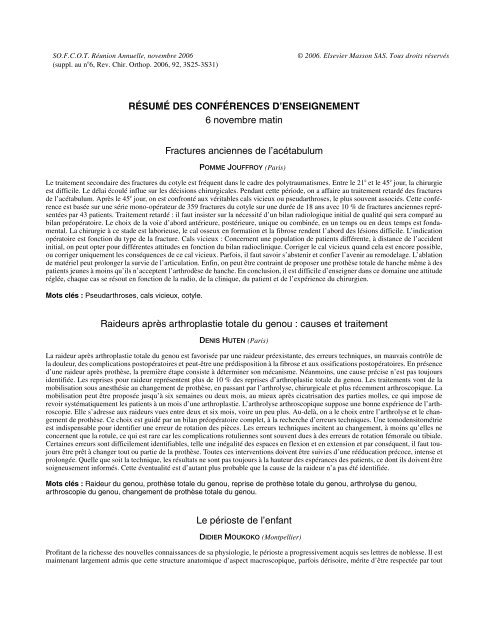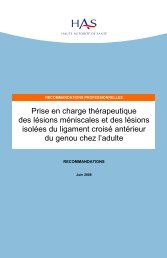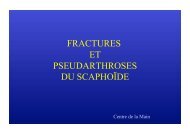les résumés des communications particulières - Sofcot
les résumés des communications particulières - Sofcot
les résumés des communications particulières - Sofcot
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
SO.F.C.O.T. Réunion Annuelle, novembre 2006 © 2006. Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés<br />
(suppl. au n o 6, Rev. Chir. Orthop. 2006, 92, 3S25-3S31)<br />
RÉSUMÉ DES CONFÉRENCES D’ENSEIGNEMENT<br />
6 novembre matin<br />
Fractures anciennes de l’acétabulum<br />
POMME JOUFFROY (Paris)<br />
Le traitement secondaire <strong>des</strong> fractures du cotyle est fréquent dans le cadre <strong>des</strong> polytraumatismes. Entre le 21 e et le 45 e jour, la chirurgie<br />
est difficile. Le délai écoulé influe sur <strong>les</strong> décisions chirurgica<strong>les</strong>. Pendant cette période, on a affaire au traitement retardé <strong>des</strong> fractures<br />
de l’acétabulum. Après le 45 e jour, on est confronté aux véritab<strong>les</strong> cals vicieux ou pseudarthroses, le plus souvent associés. Cette conférence<br />
est basée sur une série mono-opérateur de 359 fractures du cotyle sur une durée de 18 ans avec 10 % de fractures anciennes représentées<br />
par 43 patients. Traitement retardé : il faut insister sur la nécessité d’un bilan radiologique initial de qualité qui sera comparé au<br />
bilan préopératoire. Le choix de la voie d’abord antérieure, postérieure, unique ou combinée, en un temps ou en deux temps est fondamental.<br />
La chirurgie à ce stade est laborieuse, le cal osseux en formation et la fibrose rendent l’abord <strong>des</strong> lésions difficile. L’indication<br />
opératoire est fonction du type de la fracture. Cals vicieux : Concernent une population de patients différente, à distance de l’accident<br />
initial, on peut opter pour différentes attitu<strong>des</strong> en fonction du bilan radioclinique. Corriger le cal vicieux quand cela est encore possible,<br />
ou corriger uniquement <strong>les</strong> conséquences de ce cal vicieux. Parfois, il faut savoir s’abstenir et confier l’avenir au remodelage. L’ablation<br />
de matériel peut prolonger la survie de l’articulation. Enfin, on peut être contraint de proposer une prothèse totale de hanche même à <strong>des</strong><br />
patients jeunes à moins qu’ils n’acceptent l’arthrodèse de hanche. En conclusion, il est difficile d’enseigner dans ce domaine une attitude<br />
réglée, chaque cas se résout en fonction de la radio, de la clinique, du patient et de l’expérience du chirurgien.<br />
Mots clés : Pseudarthroses, cals vicieux, cotyle.<br />
Raideurs après arthroplastie totale du genou : causes et traitement<br />
DENIS HUTEN (Paris)<br />
La raideur après arthroplastie totale du genou est favorisée par une raideur préexistante, <strong>des</strong> erreurs techniques, un mauvais contrôle de<br />
la douleur, <strong>des</strong> complications postopératoires et peut-être une prédisposition à la fibrose et aux ossifications postopératoires. En présence<br />
d’une raideur après prothèse, la première étape consiste à déterminer son mécanisme. Néanmoins, une cause précise n’est pas toujours<br />
identifiée. Les reprises pour raideur représentent plus de 10 % <strong>des</strong> reprises d’arthroplastie totale du genou. Les traitements vont de la<br />
mobilisation sous anesthésie au changement de prothèse, en passant par l’arthrolyse, chirurgicale et plus récemment arthroscopique. La<br />
mobilisation peut être proposée jusqu’à six semaines ou deux mois, au mieux après cicatrisation <strong>des</strong> parties mol<strong>les</strong>, ce qui impose de<br />
revoir systématiquement <strong>les</strong> patients à un mois d’une arthroplastie. L’arthrolyse arthroscopique suppose une bonne expérience de l’arthroscopie.<br />
Elle s’adresse aux raideurs vues entre deux et six mois, voire un peu plus. Au-delà, on a le choix entre l’arthrolyse et le changement<br />
de prothèse. Ce choix est guidé par un bilan préopératoire complet, à la recherche d’erreurs techniques. Une tomodensitométrie<br />
est indispensable pour identifier une erreur de rotation <strong>des</strong> pièces. Les erreurs techniques incitent au changement, à moins qu’el<strong>les</strong> ne<br />
concernent que la rotule, ce qui est rare car <strong>les</strong> complications rotuliennes sont souvent dues à <strong>des</strong> erreurs de rotation fémorale ou tibiale.<br />
Certaines erreurs sont difficilement identifiab<strong>les</strong>, telle une inégalité <strong>des</strong> espaces en flexion et en extension et par conséquent, il faut toujours<br />
être prêt à changer tout ou partie de la prothèse. Toutes ces interventions doivent être suivies d’une rééducation précoce, intense et<br />
prolongée. Quelle que soit la technique, <strong>les</strong> résultats ne sont pas toujours à la hauteur <strong>des</strong> espérances <strong>des</strong> patients, ce dont ils doivent être<br />
soigneusement informés. Cette éventualité est d’autant plus probable que la cause de la raideur n’a pas été identifiée.<br />
Mots clés : Raideur du genou, prothèse totale du genou, reprise de prothèse totale du genou, arthrolyse du genou,<br />
arthroscopie du genou, changement de prothèse totale du genou.<br />
Le périoste de l’enfant<br />
DIDIER MOUKOKO (Montpellier)<br />
Profitant de la richesse <strong>des</strong> nouvel<strong>les</strong> connaissances de sa physiologie, le périoste a progressivement acquis ses lettres de nob<strong>les</strong>se. Il est<br />
maintenant largement admis que cette structure anatomique d’aspect macroscopique, parfois dérisoire, mérite d’être respectée par tout
3S26 81 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
geste chirurgical orthopédique. Jusqu’à un passé extrêmement récent, sa physiologie et en particulier son potentiel ostéogénique étaient<br />
l’objet de fortes controverses. Désormais, la fonction biologique du périoste n’est plus contestable. Bien au contraire, elle apparaît s’étendre<br />
au-delà d’une simple fonction ostéogénique. Le périoste est un acteur de la formation de l’os mais aussi de sa résorption. Il permet<br />
ainsi d’équilibrer l’architecture et la morphologie squelettique. Son potentiel de production tissulaire ne se limite pas à l’os. Il est en<br />
mesure de contribuer à <strong>des</strong> productions tissulaires de nature squelettique qui concernent aussi bien <strong>les</strong> tissus fibreux tendineux et ligamentaires<br />
que <strong>les</strong> tissus cartilagineux. Ces constatations récentes suscitent <strong>des</strong> espoirs très riches quant à de futures applications cliniques<br />
dans le cadre de la régénération tissulaire in vivo ou in vitro. C’est en cours de croissance que le périoste présente son maximum de potentiel<br />
biologique et mécanique. Il contribue intensément à la croissance osseuse sous toutes ses formes, aussi bien en longueur qu’en<br />
volume, tout en contrôlant la morphologie osseuse globale. Il intervient dans toutes <strong>les</strong> phases de la consolidation <strong>des</strong> fractures ainsi que<br />
dans tous <strong>les</strong> processus de réparation <strong>des</strong> agressions osseuses, infectieuses ou tumora<strong>les</strong>. Il justifie pleinement l’intérêt qu’on lui porte<br />
dans la physiologie et la pathologie de l’enfant. Nous évoquerons ici le passé, le présent et même l’avenir du périoste en espérant susciter<br />
la curiosité qui permettra de dévoiler un peu plus <strong>les</strong> secrets qu’il cache sous l’aspect mo<strong>des</strong>te d’une fine membrane qui enveloppe l’os.<br />
Mots clés : Périoste, enfant, régénération tissulaire mésenchymateuse.<br />
Correction <strong>des</strong> déséquilibres sagittaux et frontaux du rachis<br />
par ostéotomie rachidienne ou du bassin<br />
PIERRE ROUSSOULY (Lyon)<br />
Le traitement chirurgical <strong>des</strong> gran<strong>des</strong> cyphoses par ostéotomie rachidienne a longtemps été considéré, à juste raison, comme dangereux.<br />
L’ostéotomie d’ouverture antérieure décrite par Smith-Petersen se soldait par de très nombreuses complications parfois mortel<strong>les</strong>.<br />
Les ostéotomies multi-étagées proposées par Zielke, puis l’ostéotomie transpédiculaire de fermeture postérieure, ont amélioré très nettement<br />
le pronostic de cette chirurgie. Dans le même temps, <strong>les</strong> ostéotomies du bassin pour la même indication restaient très confidentiel<strong>les</strong>.<br />
Alors que <strong>les</strong> premières ostéotomies s’adressaient à la spondylarthrite ankylosante, leurs indications se sont étendues à toutes<br />
<strong>les</strong> déformations en cyphoscoliose enraidie qu’el<strong>les</strong> soient primitives ou iatrogéniques. Les ostéotomies lombaires pluri-étagées ont<br />
leur meilleure indication lorsque <strong>les</strong> disques en avant sont mobi<strong>les</strong>. Leur rendement angulaire est fonction du nombre de niveaux d’ostéotomies.<br />
Les ostéotomies transpédiculaires lombaires peuvent corriger <strong>des</strong> déformations aussi bien sagitta<strong>les</strong> que fronta<strong>les</strong>. El<strong>les</strong><br />
autorisent au maximum un angle de correction de 40°. El<strong>les</strong> trouvent leur meilleure indication sur <strong>les</strong> rachis rai<strong>des</strong> avec ankylose à<br />
360°. Le taux de pseudarthrose et de perte de correction n’est pas négligeable. Les ostéotomies d’ouverture antérieure du bassin s’inspirent<br />
d’une technique de double ostéotomie de Salter. El<strong>les</strong> sont plutôt indiquées sur <strong>les</strong> cyphoses très basses lombosacrées <strong>des</strong> spondyloptoses<br />
en particulier. Les stratégies de correction faisaient appel à <strong>des</strong> repères cervicocéphaliques et à leur possibilité de<br />
réalignement par rapport à la verticale. L’apport de la compréhension du rôle du bassin dans l’équilibre sagittal nous a conduits à élaborer<br />
une stratégie de correction prenant en compte à la fois la correction de la déformation du rachis et son retentissement sur l’orientation<br />
du bassin, dans <strong>les</strong> ostéotomies rachidiennes. Les indications croissantes de chirurgie de redressement de rachis enraidis doivent<br />
faire entrer ces ostéotomies dans l’arsenal thérapeutique d’un chirurgien du rachis. Il faut toutefois bien comprendre la stratégie mécanique<br />
et maîtriser <strong>les</strong> techniques chirurgica<strong>les</strong> pour limiter <strong>les</strong> complications qu’el<strong>les</strong> peuvent entraîner.<br />
Mots clés : Ostéotomie transpédiculaire, ostéotomie de Smith-Petersen, ostéotomie du bassin, équilibre sagittal, cyphose,<br />
spondylarthrite ankylosante.<br />
Stratégies dans <strong>les</strong> reprises de prothèse totale de hanche<br />
JEAN PUGET (Toulouse)<br />
La chirurgie de révision prothétique nous impose d’évaluer, pour sa mise en œuvre, plusieurs paramètres qui ne concernent pas que<br />
ceux de l’acte chirurgical. De plus, toutes <strong>les</strong> situations chirurgica<strong>les</strong> ne sont pas comparab<strong>les</strong> et nous avons à adapter notre réponse<br />
au cas particulier dont nous avons la charge. Heureusement, si nous acceptons d’utiliser un guide de conduite, nous pouvons rattacher<br />
le problème ou ses différentes étapes à un petit nombre de cas typiques référencés. Le propos de ce travail est de présenter la démarche<br />
qui mène au temps de l’indication chirurgicale puis de détailler <strong>les</strong> différentes étapes que l’on doit intégrer dans la planification. Celleci<br />
conduit aux différents choix, de l’approche chirurgicale, du type de reconstruction et <strong>des</strong> implants <strong>les</strong> plus adaptés. Nous devons<br />
tenir compte de l’état général de notre patient, de la prothèse initiale et de l’évaluation la plus précise possible du stock osseux. Ces<br />
différents paramètres nous donnent une vision assez claire du contrat à remplir. Mais nous devons garder à l’esprit la possibilité, en<br />
peropératoire, de trouver ou de créer une situation nouvelle différente de celle que nous avions prévue. La planification doit intégrer<br />
ces évènements fortuits afin de ne pas être désemparé face à une situation nouvelle. Pour conclure, nous résumons <strong>les</strong> différentes situations<br />
auxquel<strong>les</strong> s’appliquent <strong>les</strong> solutions aujourd’hui <strong>les</strong> plus utilisées. Dans ce guide de bonne pratique, nous rappelons, à chaque<br />
étape, <strong>les</strong> alternatives <strong>les</strong> plus fréquentes qui viennent compliquer une situation pourtant planifiée, ceci afin d’être préparé à ces éventualités<br />
et d’être apte à trouver une issue à ces situations imprévues. Durant toute cette approche, nous ne devons pas oublier que nous
RÉSUMÉ DES CONFÉRENCES D’ENSEIGNEMENT 3S27<br />
prenons à charge le plus souvent <strong>des</strong> patients fragi<strong>les</strong> pour <strong>les</strong>quels le bénéfice-risque doit être largement discuté avec eux ou leurs<br />
proches avant de prendre toute décision chirurgicale. Si nous appliquons ces règ<strong>les</strong>, nous développons alors une véritable stratégie nécessitée<br />
par cette chirurgie de révision qui n’est jamais anodine et dont la fréquence augmente jusqu’à devenir presque quotidienne.<br />
Mots clés : Révision PTH, reconstruction hanche, reprise PTH, stratégie de reprise.<br />
Luxations traumatiques récentes du genou chez l’adulte<br />
PHILIPPE BOISRENOULT (Versail<strong>les</strong>)<br />
Les luxations traumatiques du genou sont <strong>des</strong> lésions rares engageant le pronostic fonctionnel et parfois de conservation du membre.<br />
Si le diagnostic, en cas de genou encore luxé lors du premier examen, ne pose en général pas de problème, il faut garder à l’esprit<br />
l’existence de luxations réduites spontanément. Dans ces cas, <strong>les</strong> circonstances de l’accident ainsi que l’examen clinique et radiologique<br />
doivent faire redresser le diagnostic. La gravité <strong>des</strong> lésions est initialement liée à l’existence dans 20 % <strong>des</strong> cas de lésions vasculaires<br />
qui doivent bénéficier d’une prise en charge multidisciplinaire en urgence avec réduction de la luxation et réparation <strong>des</strong> lésions<br />
vasculaires. Le pronostic de conservation du membre tient à la rapidité de la revascularisation qui doit être assurée dans <strong>les</strong> huit heures<br />
suivant le début de l’ischémie. Les lésions neurologiques peuvent entraîner <strong>des</strong> séquel<strong>les</strong> à long terme mais ne nécessitent pas de traitement<br />
spécifique en urgence. La réduction de la luxation est toujours une urgence, et <strong>les</strong> formes ouvertes ou irréductib<strong>les</strong> par incarcérations<br />
doivent être opérées en urgence. Le genou est alors immobilisé et un bilan secondaire par IRM aide à préciser <strong>les</strong> lésions<br />
ligamentaires et intra-articulaires associées. La prise en charge secondaire <strong>des</strong> lésions ligamentaires est actuellement le plus souvent<br />
chirurgicale, pratiquée en urgence différée autour de la 2 e semaine post-traumatique, en tout cas avant la 6 e semaine. La reconstruction<br />
ligamentaire s’appuie sur la classification clinique de la luxation, l’examen ligamentaire peropératoire et <strong>les</strong> données de l’IRM. Les<br />
résultats de cette chirurgie semi-précoce sont meilleurs que ceux du traitement orthopédique. Mais il s’agit d’une chirurgie difficile,<br />
qui ne doit pas être pratiquée en l’absence d’une formation suffisante à la chirurgie ligamentaire du genou. Ses objectifs premiers sont<br />
de restituer un genou pour la vie courante et non un genou normal permettant la pratique <strong>des</strong> sports. Les éléments pronostiques sont,<br />
en dehors de la chirurgie, l’âge du patient, une éventuelle obésité, l’existence de lésions associées vasculaires, nerveuses, osseuses, le<br />
mécanisme du traumatisme (meilleur après lésion à basse vélocité que dans <strong>les</strong> lésions à haute vélocité) et la qualité du programme de<br />
réadaptation.<br />
Mots clés : Luxation, genou, adulte.<br />
La maladie exostosante<br />
PHILIPPE WICART (Paris)<br />
La maladie exostosante est caractérisée par le développement de tumeurs bénignes : exostoses ou ostéochondromes qui peut concerner<br />
tout le squelette dont la croissance se fait sur le mode enchondral. Il s’agit d’une pathologie génétique autosomique dominante, entraînant<br />
une perturbation de la prolifération et de la maturation <strong>des</strong> chondrocytes dans <strong>les</strong> zones de croissances et sur leur versant métaphysaire.<br />
Les progrès récents réalisés dans la connaissance génétique de cette affection n’ont pas à l’heure actuelle d’application<br />
pratique diagnostique ou thérapeutique. L’évolution pendant l’enfance est caractérisée par l’apparition <strong>des</strong> premières exostoses permettant<br />
le diagnostic de la maladie généralement vers l’âge de 2 ou 3 ans, puis par le développement de ces dernières tant en nombre<br />
qu’en volume. Une fois la fin de croissance atteinte, ces exostoses sont, en principe, quiescentes. Sous une apparente simplicité, il s’agit<br />
en fait d’une affection chronique, complexe avec apparition lente et progressive de différentes complications qui peuvent engager le<br />
pronostic fonctionnel ou vital. La complication la plus fréquente est mécanique. Les exostoses entraînent <strong>des</strong> phénomènes douloureux<br />
par conflit avec <strong>les</strong> structures péri-articulaires, deviennent gênantes par leur volume et retentissent sur <strong>les</strong> mobilités articulaires. Les<br />
autres complications sont essentiellement dues au retentissement sur la croissance qui est fréquemment perturbée par le développement<br />
<strong>des</strong> exostoses. Ces patients ont habituellement une légère diminution de la croissance staturale et <strong>des</strong> anomalies morphologiques <strong>des</strong><br />
membres. Les déformations antibrachia<strong>les</strong> sont fréquentes avec la constitution d’une main bote. De même, <strong>les</strong> troub<strong>les</strong> de croissance<br />
du squelette jambier donnent souvent <strong>des</strong> inégalités de longueurs et <strong>des</strong> déviations axia<strong>les</strong> le plus souvent en valgus. Le développement<br />
<strong>des</strong> exostoses peut aussi entraîner <strong>des</strong> compressions vasculaires, nerveuses (médullaires ou périphériques), qu’il ne faut pas méconnaître.<br />
À l’âge adulte, le risque principal est la transformation maligne d’une exostose en chondrosarcome, imposant une surveillance régulière<br />
clinique et radiologique. Toute exostose qui augmente de volume et/ou qui devient douloureuse doit faire l’objet d’une exérèse<br />
large sans délais. Ces interventions réalisées précocement et selon <strong>les</strong> principes de la chirurgie oncologique peuvent être curatives pour<br />
<strong>des</strong> tumeurs qui sont le plus souvent de bas gra<strong>des</strong>. L’ensemble de ces complications potentiel<strong>les</strong> justifie une prise en charge spécialisée<br />
de ces patients d’abord par <strong>des</strong> orthopédiatres puis dans <strong>des</strong> services d’orthopédie adulte par <strong>des</strong> équipes connaissant cette pathologie.<br />
Mots clés : Maladie exostosante, maladie <strong>des</strong> exostoses multip<strong>les</strong>, multiple cartilaginous exostosis,<br />
maladie de Bessel-Hagen, ostéochondrome, déformations ostéo-articulaires, chondrosarcome.
3S28 81 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
Fractures thoraciques et lombaires sans trouble neurologique<br />
JEAN-MARC VITAL (Bordeaux)<br />
Par définition, nous nous intéresserons aux lésions traumatiques s’étendant <strong>des</strong> vertèbres T1 à L5 comprises et non compliquées de trouble<br />
neurologique. El<strong>les</strong> peuvent être divisées en trois groupes : fractures thoraciques hautes allant de T1 à T10, fractures thoracolombaires<br />
allant de T11 à L2, de loin <strong>les</strong> plus fréquentes, et fractures lombaires basses s’étendant de L2 à L5. Les classifications de ces lésions ne<br />
doivent pas être un catalogue exhaustif, mais el<strong>les</strong> doivent chercher à préciser l’instabilité immédiate et secondaire de la lésion, le risque<br />
évolutif et donc, <strong>les</strong> indications thérapeutiques. El<strong>les</strong> vont se baser sur <strong>les</strong> données <strong>des</strong> clichés simp<strong>les</strong>, de la tomodensitométrie et de plus<br />
en plus, de l’imagerie par résonance magnétique (IRM). Les classifications de Denis et de Magerl sont <strong>les</strong> plus connues : la première a<br />
une faible valeur pronostique avec un groupe dit de burst fractures très hétérogène ; la seconde est complexe mais plus prédictive en termes<br />
d’instabilité et de traitement à appliquer. Il faut rappeler la classification de Laulan qui grâce à la notion de pivot permet de reconnaître<br />
<strong>les</strong> lésions avec distraction postérieure qui sont justement bien mises en exergue dans la classification de Vaccaro, dernière publiée<br />
et qui utilise très régulièrement <strong>les</strong> données de l’IRM. Le bilan radiographique comprend <strong>les</strong> clichés simp<strong>les</strong> évaluant sur le profil <strong>les</strong><br />
cyphoses vertébrale, locale et régionale et surtout, l’angulation régionale traumatique (ART) qui tient compte <strong>des</strong> cyphoses régiona<strong>les</strong><br />
norma<strong>les</strong> variant selon le niveau rachidien touché. De face, on appréciera un éventuel écart interpédiculaire qui signe une compression<br />
de la colonne moyenne ou un écart interépineux qui signe une distraction ligamentaire postérieure. De face comme de profil, on pourra<br />
noter une translation significative au-delà de 3 mm. La tomodensitométrie permet une analyse précise de l’arc postérieur et de la comminution<br />
corporéale. L’IRM est très sensible pour <strong>les</strong> microfractures de l’os spongieux et surtout, pour l’analyse <strong>des</strong> ligaments postérieurs<br />
et <strong>des</strong> disques qui sont moins exposés que <strong>les</strong> plaques cartilagineuses. Parmi <strong>les</strong> métho<strong>des</strong> thérapeutiques, le traitement orthopédique comprend<br />
la méthode fonctionnelle de Magnus appliquée aux tassements bénins, le corset d’emblée et le corset réalisé après posture, cette<br />
dernière permettant un engluement en bonne position avant le corsetage. Un remodelage naturel du rétrécissement canalaire est régulièrement<br />
observé en tomodensitométrie. Le traitement chirurgical est réalisé le plus souvent par voie postérieure pour décomprimer (ce qui<br />
est rare dans le cadre de notre étude) et stabiliser de façon solide mais la plus courte possible. La voie antérieure première est indiquée<br />
dans moins de 10 % <strong>des</strong> cas en cas de fracture en diabolo ou de comminution corporéale majeure. La voie combinée (chirurgie postérieure<br />
et antérieure) est de plus en plus proposée puisque la correction postérieure en lordose entraîne une ouverture antérieure qu’il faut combler<br />
par une greffe secondairement. Elle est pratiquement la règle dans <strong>les</strong> lésions en rotation ou type C de Magerl. Les indications doivent<br />
tenir compte d’un curseur évaluant la proportion <strong>des</strong> lésions osseuses et discoligamentaires : le « tout osseux » peut être traité orthopédiquement<br />
(sauf en cas de grande comminution) et le « tout ligamentaire » est plutôt chirurgical, du fait de la faible propension pour ces<br />
tissus mous à la cicatrisation ou consolidation, contrairement au tissu osseux. L’ART est aussi un élément important de décision dans<br />
l’indication chirurgicale. En termes de résultat, le traitement orthopédique donne de moins bons résultats anatomiques, mais <strong>les</strong> résultats<br />
cliniques sont aussi bons, voire meilleurs et avec moins de complications. Les traitements nouveaux comme l’ostéosynthèse percutanée<br />
ou la vertébroplastie doivent faire leur preuve, mais trouveront une place dans l’arsenal thérapeutique entre traitement orthopédique pur<br />
et traitement chirurgical classique. Chez l’enfant et l’ado<strong>les</strong>cent, <strong>les</strong> lésions dites de la ceinture de sécurité constituent une entité<br />
particulière ; le risque de stérilisation <strong>des</strong> plaques cartilagineuses fera surveiller longtemps ces patients et prolonger le traitement orthopédique<br />
et ce, d’autant qu’ils sont immatures. Les fractures ostéoporotiques font discuter <strong>les</strong> vertébroplasties, voire cyphoplasties pour<br />
diminuer le risque d’effet « cascade ». Enfin, <strong>les</strong> fractures sur colonne rigide sont souvent diffici<strong>les</strong> à diagnostiquer et leur traitement en<br />
règle chirurgical impose <strong>des</strong> ostéosynthèses longues et souvent une greffe antérieure complémentaire. Les pseudarthroses (nonconsolidation<br />
après trois mois) et <strong>les</strong> cals vicieux (fusion en hypercyphose le plus souvent) seront traités chirurgicalement en cas de retentissement<br />
douloureux plus que neurologique. La chirurgie en un temps antérieur peut être discutée en cas de pseudarthrose mobile. Le<br />
double temps qui peut être simultané est le plus souvent proposé. L’ostéotomie au sommet du cal vicieux est une alternative intéressante.<br />
Mots clés : Fractures thoraciques et lombaires, traitement orthopédique, traitement chirurgical, enfant, ostéoporose,<br />
pseudarthrose, cal vicieux.<br />
Fixation <strong>des</strong> prothèses avec ciment acrylique<br />
DOMINIQUE CHAUVEAUX (Bordeaux)<br />
La fixation prothétique par ciment acrylique a fait depuis 40 ans la preuve de son efficacité incontestée et de sa simplicité d’emploi en<br />
permettant d’adapter une prothèse standard à tout volume d’implantation. Toutefois, elle est confrontée actuellement à une utilisation<br />
accrue d’implants sans ciment, principalement au niveau de la hanche. Elle progresse toujours grâce à une gamme plus étendue de ciments<br />
et au perfectionnement <strong>des</strong> techniques de préparation et de conditionnement osseux que le chirurgien doit parfaitement maîtriser.<br />
Une meilleure connaissance de ses aspects biologiques et biomécaniques permet de mieux cerner <strong>les</strong> caractéristiques <strong>des</strong> interfaces osciment<br />
et ciment-prothèse et <strong>les</strong> conditions de l’ostéo-intégration prothétique. Elle montre que le ciment est un matériau adaptatif et évolutif,<br />
qui peut constituer un rempart contre la « maladie <strong>des</strong> particu<strong>les</strong> d’usure » impliquée dans la survenue de l’ostéolyse périprothétique<br />
et <strong>des</strong> <strong>des</strong>cellements et peut jouer un rôle dans la prévention <strong>des</strong> infections grâce à l’éventuel ajout d’antibiotiques. Ses indications<br />
et ses modalités de réalisation, variab<strong>les</strong> suivant <strong>les</strong> localisations articulaires, ne doivent se concevoir qu’en tenant compte du type d’implant,<br />
<strong>des</strong> caractéristiques anatomiques et trophiques de l’os et imposent une technique précise.<br />
Mots clés : Ciment acrylique, fixation prothétique.
RÉSUMÉ DES CONFÉRENCES D’ENSEIGNEMENT 3S29<br />
Allongement <strong>des</strong> membres chez <strong>les</strong> ado<strong>les</strong>cents et <strong>les</strong> adultes jeunes de petite taille<br />
JACQUES CATON (Lyon)<br />
Notre expérience et la sécurité donnée par <strong>les</strong> techniques actuel<strong>les</strong> d’allongement <strong>des</strong> membres inférieurs, notamment la possibilité chez ces<br />
sujets de marcher avec appui avec leurs fixateurs nous ont incités à utiliser ces possibilités thérapeutiques chez certains sujets de petite taille<br />
réclamant un traitement. Ces petites tail<strong>les</strong> sont généralement secondaires à un trouble de la croissance. La croissance de l’homme se déroulant<br />
en plusieurs phases : la croissance fœtale et la croissance postnatale, la croissance est régulée par <strong>des</strong> facteurs nutritionnels, hormonaux, par<br />
<strong>des</strong> facteurs de croissance, <strong>des</strong> facteurs génétiques et <strong>des</strong> facteurs environnementaux. La démarche diagnostique dans <strong>les</strong> petites tail<strong>les</strong>, dont<br />
la définition est pour nous une taille inférieure à -2DS par rapport au standard de croissance de la population normale (163 cm chez l’homme<br />
et 151 cm chez la femme), répond à deux questions : la petite taille est-elle proportionnée ou disproportionnée ? Cette petite taille est-elle<br />
prévisible ? d’origine prénatale ou postnatale ? Cette petite taille aura-t-elle un retentissement psychologique et social entraînant un certain<br />
nombre de mécanismes de défense qui pourront avoir une répercussion à l’âge adulte ? Les techniques utilisées pour le traitement de ces petites<br />
tail<strong>les</strong> lorsqu’une indication opératoire a été portée sont <strong>les</strong> suivantes : technique de Wagner, technique d’Ilizarov, technique de la Callotasi,<br />
allongement par clous centromédullaires d’allongement. La stratégie d’allongement est fonction de la taille initiale, de la pathologie d’origine,<br />
du caractère proportionné ou disproportionné de celle-ci. Deux ou quatre allongements pourront être pratiqués, toujours en fin de croissance,<br />
allongement portant sur <strong>les</strong> deux jambes selon la technique d’Ilizarov ou allongement de quatre segments de membres selon la technique <strong>des</strong><br />
allongements croisés utilisant la technique de la Callotasi au niveau de l’allongement fémoral et allongement tibial controlatéral selon la technique<br />
d’Ilizarov. Les complications sont nombreuses et doivent être classées selon la classification que nous avons adoptée lors du symposium<br />
de la SOFCOT de 1991. De 1984 à 2005, nous avons traité 44 sujets de petites tail<strong>les</strong>, 11 ont été traités selon la technique <strong>des</strong> allongements<br />
croisés, <strong>les</strong> autres selon la technique d’Ilizarov sur <strong>les</strong> deux jambes. Le gain de taille moyen a été de 9,11 cm pour <strong>les</strong> allongements tibiaux<br />
(2 segments) et de 18,5 cm pour <strong>les</strong> allongements croisés (4 segments), <strong>les</strong> complications ont été peu importantes, surtout de catégorie I, presque<br />
plus d’un sujet sur deux ne présente aucune complication après la fin de l’allongement. Les expériences étrangères ont été essentiellement<br />
italiennes, hormis un premier travail de Villarubias, publié en 1988. La série la plus importante publiée étant celle d’Aldegheri de Vérone avec<br />
une majorité d’achondroplases opérés de façon systématique selon la technique de la Callotasi avec quatre allongements et un gain moyen de<br />
16,7 cm. Les patients ayant le moins de complications sont <strong>les</strong> patients achondroplases et ceux présentant le plus de problèmes <strong>les</strong> patientes<br />
opérées pour syndrome de Turner avec un risque de déformation plastique du foyer d’allongement après ablation de l’appareil. Les indications<br />
doivent être posées en fonction de la taille initiale et de la pathologie, notamment de l’état osseux ligamentaire et articulaire, en fonction de<br />
l’état psychologique ou psychiatrique du patient, en fonction de l’environnement familial et professionnel et en fonction de l’âge, en éliminant<br />
<strong>des</strong> indications <strong>les</strong> sujets au squelette fragile ou aux articulations laxes avec attitu<strong>des</strong> vicieuses, <strong>les</strong> pathologies épiphysaires, <strong>les</strong> patients menacés<br />
de troub<strong>les</strong> neurologiques, de lésions viscéra<strong>les</strong> ou de lésions de surcharge pouvant compromettre le pronostic vital. Nous avons également<br />
rejeté, le plus souvent, <strong>les</strong> sujets de plus de 30 ans et <strong>les</strong> fumeurs. Les quatre gran<strong>des</strong> indications sont l’achondroplasie,<br />
l’hypochondroplasie, le syndrome de Turner, <strong>les</strong> petites tail<strong>les</strong> constitutionnel<strong>les</strong>. Il est nécessaire lorsque l’on envisage un allongement de<br />
préserver ou de restituer une harmonie, de rester modéré dans l’importance <strong>des</strong> allongements effectués. Actuellement, <strong>les</strong> indications sont <strong>les</strong><br />
suivantes : allongement isolé <strong>des</strong> deux jambes de 6 à 12 cm pour <strong>les</strong> sujets harmonieux, pour <strong>les</strong> sujets dont la taille est inférieure à 1 m 40 ou<br />
dysharmonieux, nous proposons plus volontiers un allongement <strong>des</strong> quatre segments de membres, 6 à 10 cm sur <strong>les</strong> fémurs et de 7 à 15 cm<br />
sur <strong>les</strong> tibias. Au <strong>des</strong>sus de +2DS, un allongement rentre dans le cadre de la chirurgie cosmétique. À noter qu’en France, <strong>les</strong> résultats de la<br />
campagne nationale de mensuration a révélé que la taille moyenne <strong>des</strong> femmes était de 162,5 cm et celle <strong>des</strong> hommes de 175,6 cm.<br />
Mots clés : Petite taille, croissance, allongements.<br />
Le rachis cervical instable de l’enfant<br />
ISMAT GHANEM (Beyrouth, Liban)<br />
L’instabilité du rachis cervical de l’enfant est une pathologie rare mais non exceptionnelle et dépend de plusieurs facteurs. Bien qu’elle prédomine<br />
au rachis cervical supérieur, tous <strong>les</strong> niveaux peuvent être atteints de l’occiput à T1. Elle peut être aiguë ou chronique, d’origine traumatique,<br />
malformative, dystrophique ou rhumatismale, isolée ou associée à d’autres anomalies. Une bonne connaissance <strong>des</strong> éléments<br />
embryologiques, anatomiques, physiologiques et physiopathologiques permet d’éviter <strong>les</strong> pièges diagnostiques, d’identifier <strong>les</strong> enfants à risque<br />
de développer une instabilité cervicale et d’adapter le traitement.<br />
Mots clés : Instabilité cervicale pédiatrique, subluxation cervicale, subluxation C1-C2, luxation rotatoire C1-C2,<br />
instabilité atlanto-occipitale.<br />
Chirurgie arthroscopique réparatrice de la coiffe <strong>des</strong> rotateurs (sous-scapulaire exclu)<br />
PHILIPPE HARDY (Paris)<br />
Le traitement endoscopique <strong>des</strong> ruptures transfixiantes de la coiffe <strong>des</strong> rotateurs a fait l’objet d’un enthousiasme récent. De nombreuses<br />
étu<strong>des</strong> à court terme ont montré que la réparation endoscopique <strong>des</strong> ruptures transfixiantes de la coiffe <strong>des</strong> rotateurs avait <strong>des</strong> résultats
3S30 81 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
excellents comparab<strong>les</strong> à ceux <strong>des</strong> techniques à ciel ouvert ou mini open. Le choix dépend de nombreux facteurs incluant la demande du<br />
patient, <strong>les</strong> lésions anatomopathologiques de la coiffe <strong>des</strong> rotateurs, et l’expérience chirurgicale du praticien. Il est important de respecter<br />
<strong>les</strong> principes de base de la chirurgie réparatrice de la coiffe <strong>des</strong> rotateurs. L’utilisation d’un contrôle endoscopique ne doit être considérée<br />
que comme une voie d’abord ou un moyen de pratiquer la réparation et non comme un but en soi. Les résultats cliniques et anatomiques<br />
d’une réparation endoscopique de la coiffe <strong>des</strong> rotateurs doivent être au minimum au moins aussi bons que ceux <strong>des</strong> traitements à ciel<br />
ouvert. Il est indéniable que <strong>les</strong> techniques endoscopiques ont pris une part importante en tant qu’alternative aux techniques à ciel ouvert.<br />
Les résultats publiés récemment semblent prometteurs tant sur le plan <strong>des</strong> résultats cliniques qu’anatomiques, <strong>les</strong> techniques endoscopiques<br />
apportent une simplification <strong>des</strong> suites postopératoires en diminuant <strong>les</strong> douleurs postopératoires, et la morbidité du geste chirurgical.<br />
Dans la mesure où le but est d’obtenir la cicatrisation tendineuse, l’évaluation fonctionnelle par un score clinique doit être associée à une<br />
évaluation anatomique de la cicatrisation tendineuse. Le taux d’infections et de raideurs postopératoires <strong>des</strong> techniques entièrement endoscopiques<br />
est inférieur à celui <strong>des</strong> techniques à ciel ouvert, ou mini open. La technique arthroscopique a <strong>des</strong> impératifs qui lui sont propres<br />
et qui l’opposent aux techniques à ciel ouvert : fixation os-tendon à l’aide d’implants, passage <strong>des</strong> points à l’aide d’ancillaires<br />
spécifiques, réalisations de sutures à l’aide d’un pousse-nœuds. Ces impératifs rallongent la courbe d’apprentissage. Cependant, <strong>les</strong> gestes<br />
de libération et de mobilisation <strong>des</strong> tendons de la coiffe peuvent être comparab<strong>les</strong> à ceux réalisés à ciel ouvert. Les indications <strong>des</strong> traitements<br />
arthroscopiques rejoignent cel<strong>les</strong> <strong>des</strong> indications de réparations tendineuses directes à ciel ouvert. Il est probable que dans l’avenir<br />
<strong>les</strong> techniques à ciel ouvert soient réservées aux transferts et avancements musculaires.<br />
Mots clés : Coiffe <strong>des</strong> rotateurs, arthroscopie de l’épaule, réparation endoscopique.<br />
Radiologie interventionnelle en orthopédie et traumatologie<br />
CHRISTIAN VALLÉE (Garches)<br />
Les domaines de l’imagerie interventionnelle en orthopédie et traumatologie sont larges et se développent. Seront envisagés ici, après <strong>des</strong><br />
généralités, <strong>les</strong> principaux types de gestes à but diagnostique ou thérapeutique. Ces interventions concernent aussi bien le rachis que le<br />
squelette périphérique.<br />
Mots clés : Radiologie interventionnelle, rachis, tumeurs, infections, fractures.<br />
Fractures et luxations de la colonne du pouce de l’adulte<br />
PHILIPPE LIVERNEAUX (Strasbourg)<br />
Les conséquences <strong>des</strong> traumatismes ostéoarticulaires de la colonne du pouce peuvent mettre en péril sa fonction d’opposition aux doigts<br />
longs. La restitution de la congruence articulaire et <strong>des</strong> axes de mobilité est essentielle pour éviter <strong>les</strong> complications chroniques : raideur,<br />
instabilité et arthrose. Toutefois, <strong>les</strong> différents étages de la colonne du pouce n’ont pas <strong>les</strong> mêmes propriétés fonctionnel<strong>les</strong> et la réparation<br />
devra tenir compte de ces spécificités. Ainsi, à l’étage trapézométacarpien, qui donne l’orientation de la colonne du pouce, priorité sera<br />
donnée à la mobilité de cette articulation en double selle. La réduction <strong>des</strong> luxations et <strong>des</strong> fractures articulaires de Bennett ou de Rolando<br />
devra être parfaite, au mieux évaluée par <strong>les</strong> incidences radiologiques spécifiques. C’est pourquoi au stade aigu le traitement sera le plus<br />
souvent chirurgical. Au stade chronique, la présence d’arthrose conduira à proposer un traitement radical notamment par trapézectomie,<br />
et en l’absence d’arthrose, <strong>les</strong> ligamentoplasties auront pour but de stabiliser l’articulation tout en conservant sa mobilité. À l’étage métacarpophalangien,<br />
qui donne la force de la colonne du pouce, priorité sera donnée à la stabilité de cette articulation condylienne. Au stade<br />
aigu, en dehors <strong>des</strong> entorses graves <strong>des</strong> ligaments collatéraux dominés par la lésion de Stener dont le traitement est le plus souvent chirurgical,<br />
la plupart <strong>des</strong> lésions seront réduites et traitées orthopédiquement. Au stade d’instabilité résiduelle, en présence ou non d’arthrose<br />
ou de subluxation, l’arthrodèse reste une solution fonctionnelle efficace, car <strong>les</strong> ligamentoplasties n’ont pas fait la preuve de leur supériorité.<br />
Quant aux fractures diaphysaires du métacarpien ou <strong>des</strong> phalanges, el<strong>les</strong> n’ont rien de spécifique et seront prises en charge de la même<br />
manière que cel<strong>les</strong> <strong>des</strong> doigts longs, à la différence près que <strong>les</strong> cals vicieux modérés sont bien mieux tolérés à la colonne du pouce, car<br />
ils sont souvent compensés par la mobilité <strong>des</strong> articulations adjacentes. Enfin, <strong>les</strong> fractures de la deuxième phalange, souvent ouvertes,<br />
devront rétablir le rôle de support de la pulpe et de l’appareil unguéal, essentiel à la sensibilité tactile.<br />
Mots clés : Colonne du pouce, fracture, luxation, Bennett, Rolando.<br />
Traumatologie aiguë de la cheville de l’enfant et de l’ado<strong>les</strong>cent<br />
JEAN LANGLAIS (Besançon)<br />
La traumatologie aiguë de la cheville de l’enfant et de l’ado<strong>les</strong>cent est essentiellement une pathologie sportive. Il s’agit d’une pathologie<br />
de l’amortissement qui est la faillite d’un système anatomique et adaptatif. Anatomie locale où l’on découvre <strong>les</strong> points de faib<strong>les</strong>se de la
RÉSUMÉ DES CONFÉRENCES D’ENSEIGNEMENT 3S31<br />
cheville de l’enfant que sont <strong>les</strong> ligaments et <strong>les</strong> cartilages de croissance. La chaîne d’amortissement postérieure et latérale <strong>des</strong> membres<br />
inférieurs représente l’anatomie régionale. L’anatomie générale étant représentée par le morphotype de l’enfant et l’inadaptation psychomotrice.<br />
Le système adaptatif étant représenté par la connexion avec <strong>les</strong> organes sensoriels et l’interface chaussure-sol qui a son intérêt<br />
essentiellement dans le sport que ces enfants pratiquent intensivement, de plus en plus jeunes, avec un échauffement souvent insuffisant<br />
et un matériel parfois inadapté. Il ne faut pas tomber dans le piège <strong>des</strong> signes d’alerte d’un traumatisme de la cheville qui se rencontrent<br />
surtout chez le petit enfant tel qu’une infection ostéo-articulaire, une affection rhumatismale, un syndrome de maltraitance ou une hémopathie.<br />
Le diagnostic ne pose, en fait guère de problèmes et la radiologie standard avec ses incidences obliques est le plus souvent suffisante.<br />
L’échographie en est à ses balbutiements, mais est déjà l’examen de choix pour le diagnostic d’une entorse de la cheville de l’enfant.<br />
Il ne faut pas hésiter à demander un examen tomodensitométrique dans <strong>les</strong> trois plans de l’espace pour avoir un diagnostic précis qui indiquera<br />
le type, la taille et le déplacement <strong>des</strong> fragments épiphysaires dans le cadre d’une fracture articulaire. Elle permettra de plus de<br />
définir <strong>les</strong> voies d’abord éventuel<strong>les</strong> de la chirurgie. Les indications thérapeutiques doivent être posées en fonction du type anatomique et<br />
du déplacement de la fracture et le traitement sera avant tout orthopédique. Il faut s’attacher à essayer de réduire sous anesthésie générale<br />
le maximum de fractures en n’hésitant pas à <strong>les</strong> immobiliser dans la position inverse du mécanisme de leur survenue. Les fractures articulaires,<br />
en particulier avec un écart interfragmentaire supérieur à deux millimètres doivent être opérées par une technique permettant la<br />
réduction anatomique de la fracture et la contention par vissage épiphysaire adéquat. Nous pensons que le vissage ou le brochage percutané<br />
doivent permettre d’avoir de bons résultats avec une chirurgie micro-invasive. Il faut toujours respecter le cartilage de croissance pour prévenir<br />
<strong>les</strong> risques d’épiphysiodèse et réduire parfaitement la surface articulaire pour éviter une arthrose à long terme. Il faut donc suivre<br />
l’enfant jusqu’à la fin de croissance pour dépister une éventuelle épiphysiodèse qui peut engendrer une inégalité de longueur <strong>des</strong> membres<br />
inférieurs et/ou une désaxation.<br />
Mots clés : Enfant, ado<strong>les</strong>cent, fracture de cheville, entorse de cheville, fracture de Tillaux, fracture de Mac Farland,<br />
fractures triplanes, épiphysiodèse, vissage ou brochage percutané.<br />
Méthodologie en chirurgie orthopédique et traumatologique<br />
RÉMY NIZARD (Paris)<br />
Comme pour beaucoup de traitements non médicamenteux, l’évaluation de la chirurgie orthopédique et traumatologique représente un<br />
défi méthodologique. Toutefois, <strong>les</strong> métho<strong>des</strong> qui permettent de contourner <strong>les</strong> difficultés de la réalisation du gold standard qu’est l’essai<br />
thérapeutique contrôlé randomisé existent. La méthodologie a pour but de contrôler <strong>les</strong> biais quelle que soit leur cause. L’essai thérapeutique<br />
randomisé est le schéma le plus adapté pour évaluer la supériorité d’un traitement sur un autre. L’attribution au hasard du traitement<br />
(randomisation) permet sous certaines conditions de contrôler au mieux <strong>les</strong> facteurs de confusion. Cette randomisation peut être adaptée<br />
compte tenu de la spécificité de l’acte chirurgical (randomisation en grappe, attribution basée sur l’expertise ou randomisation selon<br />
Zelen). L’interprétation de l’essai randomisé fait appel à <strong>des</strong> techniques de calcul simp<strong>les</strong> qui ne nécessitent que <strong>des</strong> connaissances limitées<br />
de statistique. L’essai contrôlé randomisé n’est toutefois pas adapté quand l’effet du traitement est grand, quand on veut connaître la fréquence<br />
d’un événement rare, quand l’essai pose <strong>des</strong> problèmes éthiques, ou quand la généralisation du résultat à une population plus générale<br />
que celle de l’essai pose problème. L’étude de cohorte est, sous certaines conditions, la technique la plus puissante après l’essai<br />
randomisé. Mais el<strong>les</strong> exposent au biais de sélection, à un contrôle suboptimal <strong>des</strong> facteurs de confusion et au risque de taux élevé de perdu<br />
de vue. Les étu<strong>des</strong> cas-témoins peuvent être uti<strong>les</strong> dans le cas de pathologies rares ou quand le temps de latence du développement d’une<br />
maladie est long. Les étu<strong>des</strong> <strong>des</strong>criptives ont leur utilité pour décrire certaines conditions, mais ne permettent pas de conclusion sur le ou<br />
<strong>les</strong> facteurs causals. Un niveau de preuve peut être établi par une étude détaillée de la littérature, le plus fort niveau étant obtenu par la<br />
méta-analyse d’essais randomisés, le plus faible par l’opinion d’expert sans analyse de la littérature ou basée sur <strong>des</strong> hypothèses physiopathologiques.<br />
Mots clés : Méthodologie, essai contrôlé randomisé, niveau de preuve.
SO.F.C.O.T. Réunion Annuelle, novembre 2006 © 2006. Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés<br />
(Suppl. au n o 6, Rev. Chir. Orthop. 2006, 92, 3S34-3S162)<br />
8 Intérêt de l’évaluation <strong>des</strong> lésions<br />
osseuses après un premier épisode<br />
de luxation antérieure<br />
d’épaule dans l’établissement du<br />
risque de récidive : résultats d’une<br />
étude prospective<br />
Jérôme ALLAIN *, Mohamed MSEDDI<br />
INTRODUCTION. Déterminer <strong>les</strong> caractéristiques de la<br />
population à risque de récidive après une première luxation<br />
antéro-interne de l’épaule semble utile pour établir leur prise en<br />
charge thérapeutique afin de limiter le risque d’instabilité chronique.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Nous avons réalisé une étude<br />
prospective incluant 60 patients de moins de 40 ans réduits sous<br />
anesthésie générale puis immobilisés 15 jours coude au corps en<br />
rotation interne suite à une première luxation antéro-interne de<br />
l’épaule. Tous ont eu un bilan radiographique comportant une<br />
incidence de face en rotation interne, neutre et externe et une<br />
incidence de profil glénoïdien selon Bernageau.<br />
RÉSULTATS. Deux patients ont été exclus secondairement et<br />
3 ont été perdus de vue. L’âge moyen était de 25 ans (16-39). À<br />
1 recul de 55 mois (12 à 102) le taux global de récidive de luxation<br />
était de 38 % (21 cas) survenues à un recul moyen de<br />
18 mois (3 à 48). Les récidives tardives étaient fréquentes :<br />
6 patients (29 % <strong>des</strong> récidives) après un délai supérieur à 2 ans.<br />
Prenant comme critère d’échec la récidive, le taux de survie était<br />
de 80 % à 1 an, 67 % à 2 ans et 59 % à 4 ans. Dix patients ont été<br />
opérés au recul pour traiter l’instabilité de l’épaule. Quarante et<br />
une encoches céphaliques de Malgaigne ont été retrouvées. Leur<br />
présence influençait la fréquence <strong>des</strong> récidives : 48,7 % versus<br />
14 % (p = 0,02). Dix fractures du rebord glénoïdien ont été diagnostiquées,<br />
associée à un taux significativement plus élevé de<br />
récidive (90 % versus 29,5 %) (p = 0,0015). En l’absence de<br />
lésion osseuse, le taux de récidive était inférieur à 15 %. Aucun<br />
autre critère n’a semblé modifier le taux de récidive.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. Le taux de récidive de<br />
luxation antérieure de l’épaule <strong>des</strong> sujets de moins de 40 ans<br />
réduits sous anesthésie générale et immobilisés 15 jours est de<br />
38 %. La présence de lésions osseuses huméra<strong>les</strong> et surtout glénoïdiennes<br />
initia<strong>les</strong> influence statistiquement la fréquence <strong>des</strong><br />
récidives. En leur absence, l’évolution vers une instabilité chro-<br />
COMMUNICATIONS<br />
Séance du 6 novembre après-midi<br />
ÉPAULE/COUDE<br />
nique reste rare. Ainsi, l’indication d’une intervention stabilisatrice<br />
dès le premier épisode de luxation semble devoir être<br />
réservée aux patients présentant ce type de lésions. Les récidives<br />
tardives après un premier épisode de luxation sont fréquentes et<br />
prouvent qu’un recul supérieur à 2 ans est indispensable pour<br />
l’évaluation <strong>des</strong> techniques chirurgica<strong>les</strong> stabilisatrices après une<br />
première luxation antérieure.<br />
* Jérôme Allain, Service de Chirurgie Orthopédique,<br />
Hôpital Henri-Mondor, 51,<br />
avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, 94000 Créteil.<br />
9 Diagnostic <strong>des</strong> SLAP lésions par<br />
arthro-scanner d’épaule en abduction/rotation<br />
externe et corrélations<br />
arthroscopiques<br />
Marianne HÉLIX *, Renaud GRAVIER,<br />
Olivier VESIN, Xavier FLECHER,<br />
Jean-Noël ARGENSON<br />
INTRODUCTION. Quinze ans après la <strong>des</strong>cription par Snyder<br />
<strong>des</strong> lésions du bourrelet supérieur de l’épaule et leur dénomination<br />
(SLAP : Superior Labrum Anterior and Posterior), aucun<br />
moyen, clinique ou d’imagerie, ne permet d’en faire le diagnostic<br />
certain. Le diagnostic fiable de SLAP est pour l’instant uniquement<br />
arthroscopique, avec une incidence de 1 à 2 % de SLAP<br />
sur l’ensemble <strong>des</strong> arthroscopies, et de 40 % de SLAP dans <strong>les</strong><br />
stabilisations de lésions de Bankart. En France, l’arthro-scanner<br />
reste l’examen de référence pour le diagnostic de SLAP, mais<br />
avec une sensibilité variant de 0 à 60 %. Le but de ce travail est<br />
d’étudier la valeur diagnostique de l’arthro-scanner et son amélioration<br />
éventuelle en modifiant le positionnement de l’épaule<br />
et <strong>des</strong> plans de coupe.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Cette étude prospective analyse<br />
une série de 61 patients opérés par arthroscopie d’épaule<br />
pour une stabilisation de lésion de Bankart (45 patients), ou pour<br />
une suspicion de SLAP isolée (16 patients). Ces patients ont tous<br />
bénéficié d’un arthro-scanner standard (rotations neutre, interne<br />
et externe), et pour 20 d’entre eux d’un cliché de sensibilisation<br />
en abduction et rotation externe maximale(ABER). Dans cette<br />
position, la traction verticale du long biceps favorise le décollement<br />
du bourrelet supérieur, améliorant sa visualisation.
RÉSULTATS. L’incidence <strong>des</strong> SLAP lésions chez <strong>les</strong> patients<br />
opérés pour stabilisation d’une lésion de Bankart était dans cette<br />
série de 40 %. La sensibilité de l’arthro-scanner conventionnel<br />
pour <strong>les</strong> SLAP était de 24 % pour <strong>les</strong> Bankart et 31 % pour <strong>les</strong><br />
SLAP isolées. En positionnant le membre supérieur en abduction<br />
et rotation externe maximale (ABER), la sensibilité de<br />
l’arthro-scanner était de 87,5 %.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. Les SLAP lésions isolées<br />
sont rares et diffici<strong>les</strong> à diagnostiquer mais leur caractère pathologique,<br />
ainsi que la possibilité d’un traitement efficace ont été démontrés.<br />
Les résultats préliminaires de cette étude montrent qu’il est<br />
possible d’améliorer la sensibilité diagnostique de l’arthro-scanner<br />
en plaçant l’épaule en abduction et rotation externe maximale.<br />
L’avantage de cette méthode réside dans sa reproductibilité et sa<br />
facilité de mise en œuvre. Même si cela n’a pas été retrouvé dans<br />
cette série, un facteur limitant peut être l’appréhension douloureuse<br />
<strong>des</strong> patients rendant difficile le positionnement du bras.<br />
* Marianne Hélix, Service de Chirurgie Orthopédique,<br />
Hôpital Sainte-Marguerite, 270,<br />
boulevard de Sainte-Marguerite, 13009 Marseille.<br />
10 Échec de stabilisation antérieure<br />
de l’épaule à ciel ouvert repris par<br />
Bankart arthroscopique<br />
PASCAL BOILEAU *, Julien RICHOU,<br />
Andréa LISAI, Jean-Christian BALESTRO,<br />
Jean-François GONZALEZ<br />
INTRODUCTION. Le but de cette étude est de rapporter <strong>les</strong><br />
résultats obtenus par <strong>les</strong> Bankart arthroscopiques dans <strong>les</strong> reprises<br />
après échec de stabilisation antérieure de l’épaule à ciel ouvert.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Série continue, rétrospective,<br />
monocentrique de 24 patients présentant une récidive d’instabilité<br />
antérieure de l’épaule (subluxations, luxations ou douleurs) après<br />
chirurgie de stabilisation à ciel ouvert (7 patients avaient déjà été<br />
opérés au préalable 2 fois ou plus). Seize hommes et 8 femmes<br />
d’âge moyen 25 ans. Intervention initiale : 17 butées osseuses<br />
(11 Latarjet, 5 Eden-Hybinette, 1 Trillat), 4 Bankart à ciel ouvert<br />
et 3 renforcements capsulaires croisés. Parmi <strong>les</strong> causes de<br />
l’échec initial, on retrouvait 15 traumatismes et <strong>des</strong> complications<br />
propres aux butées (mauvais positionnement, fracture, pseudarthrose<br />
ou lyse). Une distension capsulo-ligamentaire antéro-inférieure<br />
était constatée dans tous <strong>les</strong> cas. Tous <strong>les</strong> patients ont<br />
bénéficié d’une réinsertion du labrum et d’une retention capsuloligamentaire<br />
sous arthroscopie à l’aide d’ancres et de sutures<br />
résorbab<strong>les</strong>. Une fermeture de l’intervalle <strong>des</strong> rotateurs a été associée<br />
dans 4 cas et une plicature capsulaire inférieure dans 11 cas.<br />
L’ablation <strong>des</strong> vis de butée a été faite sous arthroscopie dans le<br />
même temps pour 7 patients. L’évaluation fonctionnelle a été<br />
faite par 2 examinateurs différents de l’opérateur. Le recul moyen<br />
à la révision était de 37 mois (12 à 72 mois).<br />
RÉSULTATS. Au dernier recul, un patient avait présenté une<br />
récidive d’instabilité sous forme de sub-luxation et deux gardaient<br />
une appréhension antérieure. L’élévation antérieure était<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S35<br />
inchangée, la perte moyenne en RE1 était de 6°. Six patients<br />
avaient repris le sport au même niveau. Tous <strong>les</strong> patients avaient<br />
repris leur activité professionnelle y compris ceux en accident du<br />
travail (5 cas). 85 % étaient très satisfaits ou satisfaits. Le score<br />
subjectif fonctionnel de l’épaule (SSV) était de 75 %, le score de<br />
Duplay de 75 points et le score de Rowe de 67 points. Le nombre<br />
d’interventions préalab<strong>les</strong> n’influençait pas le résultat.<br />
CONCLUSION. La révision <strong>des</strong> échecs de stabilisation de<br />
l’épaule à ciel ouvert par Bankart arthroscopique donne <strong>des</strong><br />
résultats satisfaisants. Les épau<strong>les</strong> sont stab<strong>les</strong> et fonctionnel<strong>les</strong>.<br />
Ces résultats encourageants, même s’ils restent inférieurs aux<br />
résultats obtenus en première intention, nous incitent à poursuivre<br />
notre expérience.<br />
* Pascal Boileau, Service de Chirurgie Orthopédique<br />
et Traumatologie du Sport, CHU de Nice, L’Archet II, 151,<br />
route de Saint-Antoine-de-Ginestière, 06202 Nice.<br />
11 Ruptures du supraspinatus : chirurgie<br />
ouverte versus arthroscopique.<br />
Étude prospective randomisée<br />
Olivier TOUCHARD *, François SIRVEAUX,<br />
Olivier ROCHE, Grégory NAVEZ, Pablo TURELL,<br />
Daniel MOLÉ<br />
INTRODUCTION. La réparation du supraspinatus sous arthroscopie<br />
donne d’excellents résultats fonctionnels mais le taux<br />
de cicatrisation tendineuse, garant d’un résultat durable, n’a<br />
jamais fait l’objet d’étude comparative avec la réparation à ciel<br />
ouvert. Notre travail a pour but de comparer <strong>les</strong> résultats cliniques<br />
et anatomiques <strong>des</strong> deux techniques.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Étude prospective randomisée<br />
menée entre octobre 2003 et janvier 2005. Quatre-vingt-treize<br />
épau<strong>les</strong> (92 patients) ont été opérées d’une rupture chronique du<br />
supraspinatus. Dans trente-cinq cas (groupe I), la réparation a été<br />
réalisée à ciel ouvert (11 tranchées osseuses, 24 avivementssutures)<br />
et dans cinquante-huit cas (groupe II) sous arthroscopie<br />
(46 simp<strong>les</strong> rang, 12 doub<strong>les</strong> rang). L’âge moyen à l’intervention<br />
est de 58 ans (38-74). La douleur postopératoire a été évaluée<br />
par l’échelle visuelle analogique (EVA) à J+0, J+1, J+7, 3 mois<br />
et 1 an ; le score de Constant a été évalué à 3 mois et 1 an ; le<br />
résultat anatomique a été analysé par arthroscanner à 1 an.<br />
RÉSULTATS. Le recul moyen à la dernière révision est de<br />
12 mois (6-19). Le score de Constant préopératoire était en<br />
moyenne de 57 (24-91). Au recul maximal, le score de Constant<br />
est de 79 (50-97). Il n’y a pas de différence significative à 3 mois<br />
et à 1 an entre le groupe I (62-79) et le groupe II (63-79). À<br />
l’arthroscanner, la cicatrisation tendineuse est observée dans<br />
63,5 % <strong>des</strong> cas. Il y a 23,5 % de fuites punctiformes et 13 % de<br />
ruptures itératives. Le résultat anatomique n’influence pas le<br />
résultat fonctionnel. Le taux de coiffes étanches est indépendant<br />
de la technique utilisée (67,5% dans le groupe I, 61 % dans le<br />
groupe II). En revanche, <strong>les</strong> coiffes non étanches ne sont représentées<br />
dans le groupe I que par <strong>des</strong> fuites punctiformes<br />
(32,5 %) alors qu’il y a dans le groupe II 21,5 % de ruptures ité-
3S36 81 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
ratives. La technique arthroscopique a pour principaux avantages<br />
l’atténuation <strong>des</strong> douleurs postopératoires précoces (p < 0,05),<br />
une moindre durée d’hospitalisation (3 jours pour le groupe I,<br />
2 jours pour le groupe II), et une reprise professionnelle plus précoce<br />
(5,3 mois pour le groupe I, 3,7 pour le groupe II).<br />
CONCLUSION. La réparation arthroscopique <strong>des</strong> ruptures du<br />
supraspinatus a d’indéniab<strong>les</strong> avantages en termes de cosmétique,<br />
de morbidité et de rapidité de récupération mais comparativement<br />
à la chirurgie à ciel ouvert elle ne permet pas<br />
d’amélioration du résultat fonctionnel et expose à un risque de<br />
rupture itérative, dont <strong>les</strong> conséquences devront être analysées à<br />
plus long terme.<br />
* Olivier Touchard, Clinique de Traumatologie et d’Orthopédie,<br />
49, rue Hermite, 54052 Nancy Cedex.<br />
12 Traitement chirurgical arthroscopique<br />
<strong>des</strong> lésions tendineuses partiel<strong>les</strong><br />
non transfixiantes de la face<br />
profonde du supraspinatus<br />
Cédric PELEGRI *, Lionel NEYTON,<br />
Nicolas JACQUOT, Christophe TROJANI,<br />
Istvan HOVORKA, Pascal BOILEAU<br />
INTRODUCTION. Le but de ce travail était d’évaluer <strong>les</strong><br />
résultats subjectifs et objectifs du traitement arthroscopique <strong>des</strong><br />
lésions partiel<strong>les</strong> non transfixiantes de la coiffe <strong>des</strong> rotateurs et<br />
de contrôler la cicatrisation grâce à une imagerie. Notre hypothèse<br />
était que l’excision <strong>des</strong> lésions tendineuses partiel<strong>les</strong> significatives<br />
(> 50 %) et leur réinsertion trans-osseuse permettait<br />
d’obtenir une cicatrisation tendineuse.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Quarante-neuf patients consécutifs<br />
(27 hommes et 22 femmes) d’âge moyen 55 ans (36-74)<br />
opérés sous arthroscopie d’une lésion partielle de la face profonde<br />
du supraspinatus entre janvier 1999 et décembre 2003 ont<br />
été revus avec un recul moyen de 32 mois (12-73). Les lésions<br />
associées du long biceps ont été incluses. Une acromioplastie<br />
associée à un débridement (n = 39) ou une suture tendino-tendineuse<br />
(n = 3) a été réalisée pour <strong>les</strong> lésions inférieures à 50 % de<br />
l’épaisseur du tendon. Une acromioplastie associée à une réinsertion<br />
trans-osseuse a été réalisée pour <strong>les</strong> 7 lésions supérieures<br />
à 50 %. Vingt patients (41 %) ont eu un contrôle de la cicatrisation<br />
tendineuse par arthro-scanner, IRM ou arthro-IRM, réalisé<br />
entre 12 et 55 mois postopératoires.<br />
RÉSULTATS. Quatre-vingt-dix pour cent <strong>des</strong> résultats étaient<br />
considérés comme bons ou excellents et 94 % <strong>des</strong> patients<br />
étaient satisfaits du résultat. Le score de Constant absolu passait<br />
de 56,3 à 81,6 points (p < 0,0001) et le score UCLA de 14,8 à<br />
29,5 (p < 0,0001). La prise en charge dans le cadre d’un accident<br />
de travail ou d’une maladie professionnelle constituait un<br />
facteur péjoratif avec un score de Constant au dernier recul<br />
significativement inférieur (p = 0,02). Sur <strong>les</strong> 31 patients exerçant<br />
une activité professionnelle en préopératoire, trois n’ont<br />
pas repris le travail (10 %) ; deux d’entre eux étaient en accident<br />
de travail. Les lésions profon<strong>des</strong> inférieures à 50 % ont été contrôlées<br />
dans 13 cas (9 arthro-scanners, 3 arthro-IRM et 1 IRM),<br />
avec un recul moyen de 24 mois (12-36) ; seulement 4 sur 13<br />
(31 %) avaient cicatrisé. Les 7 lésions profon<strong>des</strong> supérieures à<br />
50 % traitées par excision et réinsertion trans-osseuse ont été<br />
contrôlées (6 arthro-scanners et 1 arthro-IRM) avec un recul<br />
moyen de 17 mois (12-43) ; el<strong>les</strong> étaient toutes cicatrisées.<br />
CONCLUSION. Cette série confirme <strong>les</strong> bons résultats cliniques<br />
de l’acromioplastie sous arthroscopie associée à un débridement<br />
ou une suture tendino-tendineuse <strong>des</strong> lésions profon<strong>des</strong> du<br />
supraspinatus inférieures à 50 % malgré un faible taux de cicatrisation.<br />
Dans <strong>les</strong> lésions profon<strong>des</strong> supérieures à 50 %, l’excision<br />
du tendon pathologique associée à la réinsertion trans-osseuse<br />
permet d’obtenir constamment une cicatrisation tendineuse.<br />
* Cédric Pelegri, Service de Chirurgie Orthopédique<br />
et Traumatologie du Sport, CHU de Nice, L’Archet II, 151,<br />
route de Saint-Antoine-de-Ginestière, 06202 Nice.<br />
13 Résultats anatomiques et fonctionnels<br />
à long terme d’une série de<br />
réparations sans tension de la<br />
coiffe <strong>des</strong> rotateurs avec résection<br />
<strong>des</strong> berges (recul : 8,8 ans)<br />
Jean-Marie POSTEL *, Daniel GOUTALLIER<br />
INTRODUCTION. L’objectif de ce travail était l’analyse du<br />
devenir tardif <strong>des</strong> ruptures réparées selon deux principes : résection<br />
<strong>des</strong> berges tendineuses pathologiques, réinsertion sans tension.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Trente-deux (82 %) <strong>des</strong> 39 réparations<br />
de la coiffe entre 1995 et 1996 ont été revues à 8,8 ans de<br />
recul moyen (6,3 à 9,9). La rupture atteignait 5 fois un tendon,<br />
11 fois deux tendons, 16 fois trois tendons. Neuf translations simp<strong>les</strong><br />
(supra-épineux) et 5 doub<strong>les</strong> translations (supra et infra-épineux)<br />
ont été réalisées. Une évaluation fonctionnelle (selon<br />
Constant), radiologique et scannerienne a été effectuée après 1 à<br />
3 ans et au recul maximum. Un arthroscanner a été fait à 13 mois<br />
en moyenne et une échographie à la révision.<br />
RÉSULTATS. Trois ruptures itératives (9 %) sont notées<br />
(deux fois du supra-épineux, une fois <strong>des</strong> supra et infra-épineux),<br />
dont deux existaient déjà à la première révision. La dégénérescence<br />
graisseuse (DG) musculaire <strong>des</strong> coiffes restées étanches<br />
s’aggrave pendant l’année postopératoire, puis reste stable<br />
(indice de dégénérescence graisseuse (IDG) moyen passant de<br />
0,9 à 1,26). L’arthrose cotée selon Samilson s’aggrave de 2 sta<strong>des</strong><br />
ou plus dans 15 % <strong>des</strong> cas (5 sur 32). L’espace sous-acromial<br />
(ESA) reste stable pour <strong>les</strong> coiffes étanches (8,9 à 8,7 mm)<br />
comme pour <strong>les</strong> rompues (5,7 mm). Le score de Constant non<br />
pondéré moyen passe de 51,6 à 76,2 (amélioration significative<br />
de tous <strong>les</strong> items). Il est stable entre la première et la dernière<br />
révision. Il n’est pas significativement meilleur pour <strong>les</strong> coiffes<br />
étanches (76,8) que pour <strong>les</strong> rompues (70,5).
DISCUSSION. Les facteurs habituels de rupture itérative sont<br />
retrouvés : étendue <strong>des</strong> lésions initia<strong>les</strong> (3 tendons), dégénérescence<br />
musculaire (IDG ≥ 2), pincement sous-acromial<br />
(ESA < 5mm). Pour <strong>les</strong> coiffes restées étanches, l’aggravation de<br />
l’arthrose est corrélée à la DG de l’infra-épineux et du sous-scapulaire<br />
(préopératoire), à l’ESA préopératoire. Le score de Constant<br />
final <strong>des</strong> coiffes étanches est corrélé à la DG de l’infraépineux<br />
et du sous-scapulaire (préopératoire et à la révision).<br />
CONCLUSION. On retient le faible taux de ruptures itératives<br />
y compris tardives et la qualité ainsi que la stabilité <strong>des</strong><br />
résultats fonctionnels. Les rares ruptures itératives ont <strong>des</strong> résultats<br />
équivalents aux meilleures arthrolyses sur ruptures dépassant<br />
le supra-épineux. La DG, facteur pronostique essentiel,<br />
s’aggrave dans l’année qui suit la réparation puis se stabilise, et<br />
parallèlement une indiscutable dégradation arthrosique est<br />
retrouvée dans 15 % <strong>des</strong> cas (mais avec un ESA stable). L’infraépineux<br />
et le sous-scapulaire confirment leur importance.<br />
* Jean-Marie Postel, 95, boulevard Arago, 75014 Paris.<br />
14 Les résultats du lambeau deltoïdien<br />
pour rupture chronique,<br />
rétractée, irréparable de la coiffe<br />
<strong>des</strong> rotateurs avec un recul moyen<br />
de 13,9 ans<br />
Xiong-Wei LU *, Olivier PRETESEILLE,<br />
Hani AKHAVAN, Dominique GAZIELLY<br />
INTRODUCTION. Le traitement <strong>des</strong> ruptures rétractées de la<br />
coiffe <strong>des</strong> rotateurs reste controversé. Le but de cette étude était<br />
d’évaluer le résultat à long terme du lambeau deltoïdien.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Opérés entre 1988 et 1996,<br />
18 patients (20 lambeaux ), âgés en moyenne de 52,3 ans, ont été<br />
revus avec un recul moyen de 13,9 ans ; 16 patients (17 lambeaux)<br />
avaient été revus dans une précédente étude avec un recul moyen<br />
de 47,6 mois. Tous <strong>les</strong> patients avaient une rupture rétractée : susépineux<br />
isolé dans 7 cassus- et sous-épineux 10 cas, sus- et sousépineux<br />
et sous-scapulaire 3 cas. L’indication du lambeau deltoïdien<br />
a été posée pour une gêne persistante après 6 mois de rééducation<br />
qui avait permis la récupération de la mobilité active. Les<br />
patients ont tous été opérés par le même chirurgien. La rééducation<br />
postopératoire a duré en moyenne 9,4 mois. Le résultat a été<br />
évalué en utilisant le score de Constant, l’épaisseur du lambeau<br />
deltoïdien mesurée par échographie (19 cas) et IRM (1 cas), la distance<br />
acromio-humérale et l’arthrose gléno-humérale mesurées<br />
sur la radiographie standard de l’épaule.<br />
RÉSULTATS. Le score de Constant moyen était augmenté de<br />
49,1 en préopératoire à 71,9 points au dernier recul (p < 0,001).<br />
La douleur était améliorée de 5,3 à 13,8 points (p < 0,001), quel<br />
que soit l’état du lambeau deltoïdien. Le score de l’activité quotidienne<br />
était augmenté de 8,6 à 17 points (p < 0,001) ; le score de<br />
la mobilité active était de 30,75 en préopératoire à 33,3 points au<br />
dernier recul (p > 0,05). La force musculaire moyenne était aug-<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S37<br />
mentée de 4,4 en préopératoire à 7,6 points au dernier recul<br />
(p = 0,009). Dans 16 cas (80 %), le test de Jobe était positif, une<br />
fatigabilité musculaire subjective était présentée dans 90 % cas.<br />
Le nombre de ruptures du lambeau deltoïdien est passé de 3 cas<br />
(12 %) dans la première étude à 10 cas (50 %) au dernier recul.<br />
L’épaisseur moyenne <strong>des</strong> lambeaux non-rompus était de<br />
4,15 mm. La distance acromio-humérale a diminué de 6,95 mm<br />
en préopératoire à 3,05 mm au dernier recul (p < 0,00001).<br />
L’arthrose glénohumérale était aggravée du stade moyen 0,6<br />
préoopératoire au stade 2,0 selon la classification du Samilson<br />
(p < 0,0001).<br />
DISCUSSION. Le lambeau deltoïdien garde à long terme un<br />
effet antalgique avec une amélioration de la fonction globale.<br />
Mais il n’a aucun effet sur la récupération de la force musculaire<br />
ni sur le recentrage de la tête humérale. À long terme, 50 % <strong>des</strong><br />
lambeaux a disparu, 70 % <strong>des</strong> cas avaient une arthrose modérée<br />
ou sévère. Ces résultats à long terme du lambeau deltoidïen doivent<br />
être mis en balance avec ceux obtenus avec le même recul<br />
avec un débridement arthroscopique.<br />
* Xiong-Wei Lu, 50, rue Mohe, 201900 Shanghai, Chine.<br />
15 Place du lambeau de Teres Major<br />
dans <strong>les</strong> ruptures étendues de la<br />
coiffe <strong>des</strong> rotateurs<br />
Yves BELLUMORE *, Anthony DOTZIS,<br />
Pierre MANSAT, Paul BONNEVIALLE,<br />
Michel MANSAT<br />
INTRODUCTION. L’échec du traitement fonctionnel d’une<br />
rupture irréparable de la coiffe <strong>des</strong> rotateurs du sujet de moins de<br />
55 ans peut justifier le recours à une chirurgie de transfert musculaire;<br />
la faisabilité du transfert du tendon du muscle Teres<br />
Major sur le tubercule majeur, confirmée par un travail anatomique<br />
réalisé dans le service, était à l’origine d’une expérience clinique<br />
dont nous vous rapportons aujourd’hui <strong>les</strong> résultats.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Treize patients ont été opérés<br />
entre décembre 1992 et décembre 2005. Il s’agissait de 3 femmes<br />
et 10 hommes de 48 ans de moyenne d’âge au moment de<br />
l’intervention. Les patients présentaient une rupture postérosupérieure<br />
de la coiffe <strong>des</strong> rotateurs irréparable avec une dégénérescence<br />
graisseuse avancée. L’évaluation a été effectuée cliniquement<br />
(score de Constant), radiologiquement et pour la<br />
plupart par une IRM et un électromyogramme (EMG).<br />
RÉSULTATS. Douze patients ont été revus, 1 a été perdu de<br />
vue. Le recul moyen était de 6,6 ans (de 1 à 13 ans). L’amélioration<br />
du score de Constant était significative avec un gain moyen<br />
de 21,4 points par rapport aux valeurs préopératoires. Les<br />
patients ont retrouvé une élévation antérieure indolente avec une<br />
faib<strong>les</strong>se persistante. La rotation externe active restait déficitaire.<br />
La réalisation d’un bilan IRM et d’un EMG a permis de<br />
confirmer la fonctionnalité du transfert. Cependant, le bilan<br />
radiographique sensibilisé, n’a pas mis en évidence de recentrage<br />
de la tête humérale qui restait excentrée dans tous <strong>les</strong> cas.
3S38 81 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
Les résultats initiaux favorab<strong>les</strong> se dégradaient avec le temps<br />
avec l’apparition progressive d’une omarthrose 6 à 9 ans après<br />
l’intervention. Aucune complication n’est à déplorer dans cette<br />
série.<br />
DISCUSSION. Ce travail confirme que le transfert du Teres<br />
Major est actif et n’agit pas par effet ténodèse. Les meilleurs<br />
résultats concernent <strong>les</strong> patients présentant une dégénérescence<br />
isolée avancée de l’infraspinatus, ayant une coiffe antérieure et un<br />
Teres Minor fonctionnels. L’objectif du transfert est de pallier la<br />
fonction défaillante d’un muscle : il est moins puissant que le<br />
muscle originel et il est illusoire de vouloir suppléer la coiffe postérieure<br />
par le seul Teres Major. Ainsi, une rupture postéro-supérieure<br />
requiert un double transfert (Latissimus Dorsi + Teres<br />
major).<br />
CONCLUSION. Nous réservons ainsi, le transfert du teres<br />
major aux sujets de moins de 55 ans, motivés et compliants, qui<br />
présentent une épaule douloureuse et déficitaire, avec une rupture<br />
étendue et irréparable de l’infra épineux. Il n’empêche pas<br />
l’évolution vers l’omarthrose, mais semble la ralentir.<br />
* Yves Bellumore, Service d’Orthopédie-Traumatologie,<br />
CHU Toulouse Purpan, place du Docteur-Baylac,<br />
31059 Toulouse Cedex.<br />
16 Transfert du grand dorsal et du<br />
grand rond, isolé ou associé à une<br />
prothèse d’épaule inversée, pour<br />
perte de la rotation externe active<br />
Pascal BOILEAU *, Christopher CHUINARD,<br />
Nicolas JACQUOT, Lionel NEYTON,<br />
Christophe TROJANI,<br />
Jean-François GONZALEZ<br />
INTRODUCTION. L’absence ou la dégénérescence graisseuse<br />
irréversible du sous-épineux et du petit rond dans <strong>les</strong><br />
lésions massives de la coiffe engendre la perte définitive de la<br />
rotation externe de l’épaule. Notre hypothèse était que le transfert<br />
du grand dorsal et du grand rond (GD/GR), isolé ou associé<br />
à une prothèse d’épaule inversée, permettait de restaurer la rotation<br />
externe active.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Quinze patients consécutifs<br />
avec un sous-épineux et un petit rond absents ou avec une dégénérescence<br />
graisseuse sévère (Goutallier stade 3 ou 4) ont bénéficié<br />
de ce transfert musculo-tendineux réalisé en position demiassise<br />
par voie delto-pectorale. Tous <strong>les</strong> patients présentaient une<br />
rotation externe nulle ou négative avec un signe du clairon et du<br />
portillon. Sept patients présentant une perte isolée de rotation<br />
externe due à une rupture massive de la coiffe postéro-supérieure<br />
sans arthrose ont bénéficié d’un transfert musculaire isolé. Le<br />
transfert a été associé à une prothèse inversée chez 8 patients qui<br />
présentaient une perte combinée de la rotation externe et de<br />
l’élévation active : 6 omarthroses excentrées et 2 tumeurs de<br />
l’humérus proximal avec sacrifice de la coiffe. Le recul moyen à<br />
la révision était de 23 mois.<br />
RÉSULTATS. Le transfert musculaire isolé a amené un gain de<br />
27° (p < 0,01) de rotation externe; l’élévation active et la rotation<br />
interne ont été maintenues. Le score de Constant est passé de 35 à<br />
67 points (p < 0,01). L’arthrose n’a pas progressé. Chez <strong>les</strong><br />
patients avec une omarthrose excentrée où le transfert du GR/GD<br />
a été associée à une prothèse inversée, l’élévation active a augmenté<br />
en moyenne de 75° (p = 0,03) et la rotation externe de 28°<br />
(p = 0,03). Le score de Constant est passé de 32 à 62 points<br />
(p = 0,03). Dans <strong>les</strong> tumeurs, le transfert associé à une prothèse<br />
inversée a permis de conserver la rotation externe active et l’élévation.<br />
Tous <strong>les</strong> patients sauf un étaient satisfaits ou très satisfaits.<br />
Aucune complication neuro-vasculaire n’était à déplorer.<br />
CONCLUSION. Le transfert du GD/GR permet de restaurer la<br />
rotation externe active chez <strong>les</strong> patients avec un sous-épineux et un<br />
petit rond infiltrés ou absents. Le transfert modifié, réalisé en position<br />
demi-assise par voie delto-pectorale est moins invasif que le<br />
transfert classique par deux voies d’abord. Le transfert musculaire<br />
du GD/GR associé à la prothèse inversée permet de restaurer à la<br />
fois la rotation externe active et l’élévation active de l’épaule.<br />
* Pascal Boileau, Service de Chirurgie Orthopédique<br />
et Traumatologie du Sport, CHU de Nice, L’Archet II, 151,<br />
route de Saint-Antoine-de-Ginestière, 06202 Nice.<br />
17 Résultats anatomiques à 10 ans<br />
<strong>des</strong> ruptures opérées de la coiffe<br />
<strong>des</strong> rotateurs de l’épaule : à propos<br />
d’une série prospective de 42 cas<br />
Henry COUDANE *, Pascal GLEYZE,<br />
Blaise MICHEL, Hervé LAMARRE, Alain BLUM,<br />
Thierry GEORGE<br />
INTRODUCTION. L’évolution fonctionnelle et anatomique à<br />
long terme <strong>des</strong> ruptures opérées à ciel ouvert de la coiffe de rotateurs<br />
est mal connue ; le but de ce travail était d’étudier l’évolution<br />
<strong>des</strong> patients opérés par l’intermédiaire de critères cliniques<br />
(score de Constant) et d’imagerie (arthroscannographie et échographie)<br />
dans le cadre d’une série prospective longitudinale<br />
mono-centrique.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Quarante-deux patients opérés<br />
à ciel ouvert par le même praticien ont été inclus dans une<br />
cohorte prospective.Au recul de 10 ans, la révision a été réalisée<br />
par le score de Constant, et une imagerie : arthroscannographie<br />
et échographie.<br />
RÉSULTATS. Sur 42 patients inclus dans la cohorte initiale<br />
(18 femmes et 24 hommes), 37 ont été revus avec un bilan<br />
clinique et en imagerie complet. La moyenne d’âge à l’intervention<br />
est de 60,0 ans (40,2-77,4) et de 70,2 ans à la révision<br />
(50,2-87,0). Vingt patients présentaient une rupture isolée du sus<br />
épineux (groupe G1), 11 une rupture du sus et sous-épineux<br />
(groupe G2) et 9 une rupture du sus-épineux, du sous-épineux et<br />
du sous-scapulaire (groupe G3). Le recul moyen à la révision est<br />
de 126 mois (120-135). Le score de Constant à la révision est de<br />
89,4 dans le groupe G1, de 79,0 dans le groupe G2 et de 66,4
dans le groupe G3. Les résultats arthro-scannographiques retrouvent<br />
une coiffe non étanche dans 95 % <strong>des</strong> cas : coiffe normale :<br />
0 cas ; coiffe avec image d’addition intra-tendineuse : 2 cas ; fuites<br />
ponctuel<strong>les</strong> : 12 cas ; fuite importante : 23 cas. L’index de<br />
dégénérescence graisseuse (IDG) montre une dégradation dans<br />
<strong>les</strong> trois groupes G1, G2, G3.<br />
DISCUSSION. Au recul de 10 ans, aucune coiffe n’est normale<br />
après arthro-scanner et l’évolution à long terme <strong>des</strong> coiffes<br />
opérées se fait vers la rupture itérative ; <strong>les</strong> fuites sont statistiquement<br />
moins importantes dans le groupe G1 que dans <strong>les</strong> groupes<br />
G2 et G3. Les bilans échographiques réalisés n’ont pas permis de<br />
retrouver la récidive dans 80 % <strong>des</strong> re-ruptures. Paradoxalement,<br />
90 % <strong>des</strong> patients se déclarent satisfaits du résultat à long terme.<br />
CONCLUSION. Le contrôle anatomique par arthrographie<br />
couplée au scanner montre une récidive de la rupture. De plus,<br />
l’IDG a progressé et ce quels que soient le type et l’étendue de la<br />
rupture initiale : <strong>les</strong> coiffes chirurgicalement étanches après<br />
l’intervention se dégradent progressivement dans la quasi totalité<br />
<strong>des</strong> cas même si l’appréciation subjective du résultat par le patient<br />
reste bonne.<br />
* Henry Coudane, Service ATOL, Hôpital Central,<br />
CHU de Nancy, 29, avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny,<br />
CO 34, 54035 Nancy Cedex.<br />
18 Comparaison <strong>des</strong> renseignements<br />
fournis par l’arthroscanner et<br />
l’arthro-IRM dans <strong>les</strong> ruptures de<br />
coiffe<br />
Didier GODEFROY *, Dominique GAZIELLY,<br />
Benoît ROUSSELIN, Laurent SARAZIN,<br />
Xiong-Wei LU<br />
INTRODUCTION. L’arthroscanner est en France l’examen de<br />
choix dans le bilan préopératoire <strong>des</strong> ruptures de coiffe. Faut-il lui<br />
rester fidèle ou faut-il adopter, comme dans la plupart <strong>des</strong> pays<br />
étrangers, l’arthro-IRM qui est maintenant autorisée en France ?<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Comparaison de l’arthroscanner<br />
et de l’arthro-IRM réalisés chez cinquante patients suspects<br />
de lésion de la coiffe, adressés pour la plupart par un chirurgien<br />
spécialisé dans la pathologie de l’épaule. Après explication <strong>des</strong><br />
motifs du double examen, injection dans la cavité articulaire de<br />
10 ml d’iode et de gadolinium dilué. Réalisation <strong>des</strong> clichés<br />
d’arthrographie, du scanner puis de l’IRM. La relecture <strong>des</strong> examens<br />
a été effectuée à postériori par un radiologue et un chirurgien.<br />
Les examens <strong>des</strong> patients opérés ont été confrontés aux<br />
découvertes opératoires.<br />
RÉSULTATS. Il a été mis en évidence 24 ruptures transfixiantes,<br />
16 ruptures non transfixiantes (8 superficiel<strong>les</strong> et 8 profon<strong>des</strong>),<br />
et 2 désinsertions du subscapulaire. Les 24 ruptures<br />
transfixiantes étaient visib<strong>les</strong> en arthroscanner et en arthro-IRM.<br />
Les renseignements fournis par <strong>les</strong> 2 techniques étaient pratiquement<br />
identiques pour quantifier la rétraction dans le plan frontal.<br />
L’arthro-IRM montrait mieux l’état du tendon rompu. L’arthros-<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S39<br />
canner appréciait plus précisement l’étendue de la rupture dans<br />
le plan sagittal notamment dans l’infra-épineux. La dégénérescence<br />
graisseuse a été quantifiée par <strong>les</strong> 2 techniques. Dans <strong>les</strong><br />
16 ruptures non transfixiantes superficiel<strong>les</strong> ou profon<strong>des</strong>, la<br />
face superficielle de la coiffe était visible en arthro-IRM mais ne<br />
l’était pas en arthroscanner. Huit ruptures partiel<strong>les</strong> de la face<br />
superficielle, étaient visib<strong>les</strong> en arthro-IRM alors que l’arthroscanner<br />
était normal. L’interprétation d’une arthro-IRM a été<br />
impossible en raison de sa mauvaise qualité.<br />
DISCUSSION. L’arthroscanner et l’arthro-IRM sont deux<br />
examens parfaitement adaptés au diagnostic et au bilan préopératoire<br />
<strong>des</strong> ruptures transfixiantes de la coiffe. L’arthroscanner<br />
présente l’avantage d’un coût inférieur et d’une qualité constante.<br />
Dans <strong>les</strong> ruptures non transfixiantes, le produit de contraste<br />
injecté dans l’articulation n’opacifie pas la bourse sousacromiale.<br />
L’arthroscanner ne permet donc pas d’étudier la face<br />
superficielle de la coiffe contrairement à l’arthro-IRM dont la<br />
séquence T2, sensible aux liqui<strong>des</strong> visualise la superficie de la<br />
coiffe lorsqu’il existe un épanchement dans la bourse.<br />
CONCLUSION. L’arthroscanner reste un bon examen à condition<br />
de le réserver aux cas où le caractère transfixiant de la rupture<br />
est absolument certain. Lorsque ce caractère transfixiant<br />
n’est pas certain, l’arthro-IRM est préférable afin de pouvoir<br />
explorer la face superficielle de la coiffe.<br />
* Didier Godefroy, Institut de Radiologie,<br />
31, avenue Hoche,<br />
75008 Paris.<br />
19 Traitement <strong>des</strong> raideurs de l’épaule<br />
par un protocole d’Auto-Rééducation<br />
Volontaire<br />
Pascal GLEYZE *, Hervé LAMARRE,<br />
Nuno GOMES, Christine FUNFSCHILLING<br />
INTRODUCTION. Les auteurs ont souhaité étudier l’intérêt et<br />
l’absence de risques d’une auto-mobilisation au-delà du seuil douloureux<br />
chez <strong>les</strong> patients présentant un enraidissement de l’épaule.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. L’étude a porté sur une série<br />
prospective de 92 patients présentant un enraidissement de l’épaule<br />
(modéré 120°-150° : 26 cas, moyen 60°-120° : 34 cas, sévère<br />
3S40 81 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
+28°, moy. : +60°, sévères & algo. : +77°) et de la RE1 passive de<br />
20° (r. mod. : +14°, moy. : +30°, sévères : +44 pts, algo. : +38 pts).<br />
Le résultat <strong>des</strong> raideurs modérées et moyennes était acquis à 85 %<br />
à 6 semaines (IC à la révision : 97, recul 31 mois 3-72, échecs :<br />
3,5 %). Celui <strong>des</strong> raideurs sévères et <strong>des</strong> algodystr. l’était à 71 % à<br />
6 semaines avec une progression (p < 0,0001) jusqu’à 6 mois pour<br />
un résultat stable (IC : 94, recul moyen de 19,5 mois 15-24,<br />
échecs : 10 %). Il n’y a pas eu d’aggravations. La qualité du résultat<br />
antalgique, fonctionnel et l’augmentation <strong>des</strong> amplitu<strong>des</strong> était<br />
corrélée avec le nombre de mouvements réalisés (4 h/j de J1 à J7<br />
soit 1700 mvts, 2,5 h/j de J8 à J14 soit 360 mvts – p < 0,0001).<br />
20 Bactériologie positive dans <strong>les</strong> discopathies<br />
dégénératives : spondylodiscite<br />
à bas bruit ou contamination ?<br />
Joseph ARNDT *, Xavier CHIFFOLOT,<br />
Ioan BOGORIN, Jean-Paul STEIB<br />
INTRODUCTION. Étude prospective sur la dégénérescence<br />
discale précoce : serait-elle due à une infection <strong>des</strong> disques à bas<br />
bruit ?<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Trente-deux patients (38 disques)<br />
dont 20 femmes, 12 hommes opérés pour discopathies et<br />
mise en place de prothèse de disque dans le service de mai 2004<br />
à février 2006 ont subi la mise en culture de leur disque. Un à<br />
3 prélèvements peropératoires avec mise en culture aérobie et<br />
anaérobie, et une analyse anatomo-pathologique dans 14 cas, ont<br />
été pratiqués sur 21 mois. Nous avons mis en corrélation plusieurs<br />
critères : <strong>les</strong> antécédents chirurgicaux rachidiens et abdominaux,<br />
<strong>les</strong> signes et évolution postopératoire cliniques et<br />
paracliniques (IRM, scanner, discographie).<br />
RÉSULTATS. Dix-sept disques positifs à la culture/38 (4 fois<br />
2 prélèvements positifs/3, 8 fois 1/3 et 5 fois 1/1), dont 6 prélèvements<br />
retrouvant <strong>des</strong> anaérobies (Propionibacterium acnes),<br />
16 <strong>des</strong> aérobies (7 Staphylococcus à coagulase négative, 2 Corynebacterium<br />
minutissimum, 2 Micrococcus sp, 1 Staphylococcus<br />
aureus, 1 Streptococcus intermedius, 1 Enterobacter aerogenes,<br />
1 Rothia dentocariosum). Trois disques positifs à la culture présentaient<br />
un discret infiltrat inflammatoire à l’examen anatomopathologique<br />
/6 prélevés, contre 0/8 pour <strong>les</strong> disques stéri<strong>les</strong> à la<br />
culture. Sur 17 disques infectés, 6 avaient eu une chirurgie antérieure<br />
sur ce disque et 9 une chirurgie abdominale septique,<br />
12 avaient eu une discographie (contre 4/21 chirurgies antérieures<br />
sur ce disque, 8/21 chirurgies abdomina<strong>les</strong> et 13/21 discographies<br />
pour <strong>les</strong> disques non infectés). Quatre <strong>des</strong> onze Modic 1<br />
étaient infectés, 7/10 Modic 2, 6/13 disques noirs. Trois <strong>des</strong> dixsept<br />
prothèses sur disque infecté se sont enfoncées.<br />
DISCUSSION. Les techniques de prélèvement doivent être<br />
rigoureuses, <strong>les</strong> prélèvements deviennent significatifs si 2 sont<br />
positifs sur 3, en <strong>des</strong>sous il peut s’agir de contamination. Propro-<br />
Séance du 6 novembre après-midi<br />
RACHIS<br />
DISCUSSION. L’auto-rééducation, réalisée par un patient<br />
sécurisé, lui permet de lever, à sa mesure, le frein thérapeutique<br />
que représente le respect du seuil douloureux dans la rééducation<br />
de l’épaule.<br />
CONCLUSION. L’auto-mobilisation, même douloureuse,<br />
peut permettre, dans <strong>les</strong> enraidissements de l’épaule, d’obtenir<br />
rapidement un recouvrement fonctionnel et antalgique directement<br />
proportionné au nombre de mouvements réalisés.<br />
* Pascal Gleyze, 2, rue de la Concorde, 68000 Colmar.<br />
nibacterium et staphylococcus, 2 germes cutanés, sont <strong>les</strong> plus<br />
souvent rencontrés. Il faut être attentif aux antécédents chirurgicaux<br />
abdominaux et rachidiens du disque incriminé. Il n’y a pas<br />
de corrélation entre la discographie et <strong>les</strong> disques infectés.<br />
CONCLUSION. On peut se demander si <strong>les</strong> discopathies ne<br />
seraient pas secondaires à <strong>des</strong> infections bactériennes à bas bruit.<br />
Une étude plus standardisée sur un plus grand nombre de cas<br />
pourra nous apporter <strong>les</strong> réponses. Demain, le traitement <strong>des</strong> discopathies<br />
sera peut-être l’antibiothérapie !<br />
* Joseph Arndt, 17A, rue René-Schmitt, 68920 Wintzenheim.<br />
21 Étude <strong>des</strong> facteurs de risque<br />
d’infection du site opératoire (ISO)<br />
après chirurgie du rachis<br />
Thibault LENOIR *, Dominique VANJAK,<br />
Yatt BELLAICHE, Ludovic RILLARDON,<br />
Noelle BENDERSKY, Bruno FANTIN,<br />
Pierre GUIGUI<br />
INTRODUCTION. La production de taux d’infection du site<br />
opératoire (ISO) devient réglementaire en France. Les facteurs<br />
de risque d’ISO sont classiquement déterminés par l’index<br />
NNIS, très général et non spécifique du type de chirurgie. Les<br />
interventions rachidiennes sont à haut risque infectieux, de<br />
0,2 % en chirurgie discale à 5,6 % et concernent une population<br />
très hétérogène. L’objectif de cette étude était d’étudier <strong>les</strong> facteurs<br />
de risque spécifiques à ce type de chirurgie.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Une surveillance <strong>des</strong> ISO chez<br />
tous <strong>les</strong> patients opérés du rachis a été entreprise dans un service<br />
d’orthopédie (56 lits) d’un CHU (600 lits) de décembre 2004 à<br />
juin 2005. Les caractéristiques <strong>des</strong> patients ont été analysées à<br />
l’aide du logiciel « épi info » puis comparées entre patients<br />
infectés (cas) et non infectés (témoins).<br />
RÉSULTATS. Sur 323 patients opérés, 294 patients ont pu<br />
être étudiés : 16 patients se sont infectés, soit un taux à 5,4 %.
Les cas et <strong>les</strong> témoins étaient comparab<strong>les</strong> en termes d’âge<br />
(64 ans), d’IMC (25) et de comorbidités (diabète, corticothérapie,<br />
tabagisme, présence d’escarre). De même, <strong>les</strong> modalités chirurgica<strong>les</strong><br />
ne différaient pas entre <strong>les</strong> 2 groupes : niveau<br />
anatomique d’intervention, antibioprophylaxie, mise en place de<br />
matériel et durée du geste. Les antécédents d’intervention étaient<br />
plus fréquents chez <strong>les</strong> cas infectés (37,5 %) que chez <strong>les</strong><br />
témoins (24,8 %) mais la tendance n’était pas significative. En<br />
revanche, le score ASA (p = 0,023), la provenance d’un autre<br />
hôpital (p = 0,02), l’intervention en urgence (p = 0,012) et l’origine<br />
tumorale de la pathologie (p = 0,03) différaient significativement<br />
entre <strong>les</strong> 2 populations.<br />
DISCUSSION. Cette étude permet de mettre en évidence <strong>des</strong><br />
facteurs de risque d’infection liés à la gravité du patient tels le<br />
score ASA, l’intervention en urgence, la pathologie tumorale et<br />
la provenance d’un autre établissement pouvant refléter la gravité<br />
du terrain ou de la pathologie. Par contre, l’obésité, la mise<br />
en place de matériel d’ostéosynthèse n’apparaissent pas associés<br />
à un risque accru d’infection.<br />
CONCLUSION. La connaissance de facteurs de risque d’ISO<br />
spécifiques de la chirurgie du rachis va permettre d’établir <strong>des</strong><br />
recommandations documentées sur la nécessité d’une antibioprophylaxie<br />
ou du niveau d’asepsie.<br />
* Thibault Lenoir, Service d’Orthopédie, Hôpital Beaujon,<br />
100, boulevard du Général-Leclerc, 92110 Clichy.<br />
22 Tuberculose rachidienne : évolution<br />
de l’imagerie au cours du traitement<br />
et corrélation avec l’évolution<br />
clinique et biologique<br />
Ludovic RILLARDON *, Laurence LE PAGE,<br />
Antoine FEYDY, Veronique DUFOUR,<br />
Bruno FANTIN, Pierre GUIGUI<br />
INTRODUCTION. L’incidence <strong>des</strong> tuberculoses extra-pulmonaires<br />
augmente dans <strong>les</strong> pays industrialisés et la localisation<br />
rachidienne représente 50 % <strong>des</strong> atteintes ostéo-articulaires. Les<br />
examens d’imagerie, IRM et tomodensitométrie (TDM), sont<br />
largement utilisés dans le diagnostic de tuberculose rachidienne.<br />
Cependant, peu de données d’évolution de ces lésions sur l’imagerie<br />
sont disponib<strong>les</strong>. L’objectif de ce travail était d’étudier <strong>les</strong><br />
modifications <strong>des</strong> lésions d’imagerie <strong>des</strong> tuberculoses rachidiennes<br />
au cours du traitement et de <strong>les</strong> comparer à l’évolution clinique<br />
et biologique.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Tous <strong>les</strong> patients hospitalisés de<br />
1997 à 2004 pour une spondylodiscite tuberculeuse ont été<br />
inclus dans cette étude prospective. Le diagnostic était retenu<br />
devant l’association de douleurs rachidiennes, de signes d’imagerie<br />
compatib<strong>les</strong> avec une spondylodiscite ou une spondylite et<br />
d’un examen bactériologique et/ou histologique en faveur d’une<br />
tuberculose. Les données cliniques et biologiques ont été<br />
recueillies initialement, puis tous <strong>les</strong> 3 mois. Tous <strong>les</strong> patients<br />
ont eu une exploration par TDM et IRM. Une IRM en cours de<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S41<br />
traitement et à 12 mois a permis d’apprécier l’évolution radiologique.<br />
RÉSULTATS. Dix-neuf patients ont été inclus. 74 % avaient<br />
<strong>des</strong> signes neurologiques au moment de la prise en charge (syndrome<br />
de compression médullaire 47 %, atteinte radiculaire<br />
42 %). Sur l’IRM initiale, il existait dans tous <strong>les</strong> cas un œdème<br />
du corps vertébral et un abcès para vertébral. Dans 47 % <strong>des</strong> cas,<br />
il existait un abcès intra-discal et dans 82 % une épidurite avec<br />
compression médullaire pour 64 % <strong>des</strong> patients. Un traitement<br />
chirurgical a été effectué pour 12 patients (63 %), 10 fois en raison<br />
de l’atteinte neurologique et 2 fois pour un problème mécanique.<br />
Tous <strong>les</strong> patients ont reçu un traitement antibiotique<br />
pendant 12 mois. L’analyse <strong>des</strong> résultats a été possible pour<br />
15 patients. Tous <strong>les</strong> patients ont été considérés comme guéris au<br />
recul moyen de 25 mois après l’arrêt du traitement. La perte de<br />
poids était corrigée à 6 mois et <strong>les</strong> douleurs se sont atténuées au<br />
cours <strong>des</strong> 9 premiers mois. Au 3 e mois, le syndrome inflammatoire<br />
était normalisé. Sur l’IRM, la totalité <strong>des</strong> abcès épiduraux<br />
avaient disparu à 9 mois et <strong>les</strong> abcès paravertébraux avaient disparu<br />
pour 45 % <strong>des</strong> patients à 3 mois et pour 85 % à 12 mois.<br />
CONCLUSION. Dans la tuberculose rachidienne, <strong>les</strong> anomalies<br />
de signal à l’IRM (15 % d’abcès paravertébral et 25 %<br />
d’œdème corporéal) peuvent persister après un an de traitement<br />
médical efficace. Une IRM de contrôle ne se justifie pas si l’évolution<br />
clinique et biologique est favorable.<br />
* Ludovic Rillardon, Service d’Orthopédie, Hôpital Beaujon,<br />
100, boulevard du Général-Leclerc, 92110 Clichy.<br />
23 Abord antérieur du rachis<br />
lombosacré : étude prospective<br />
comparant la voie trans et la voie<br />
rétropéritonéale<br />
Jérôme ALLAIN *, Alexandre POIGNARD,<br />
Gil<strong>les</strong> MATHIEU<br />
INTRODUCTION. Déterminer comparativement <strong>les</strong> avantages<br />
et inconvénients de la voie trans et de la voie rétropéritonéale<br />
gauche dans l’abord antérieur du rachis lombosacré.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Soixante opérés du rachis lombosacré<br />
ont été répartis prospectivement en 2 groupes selon<br />
l’abord chirurgical utilisé. Le groupe 1 comportait 16 hommes et<br />
14 femmes opérés consécutivement par voie transpéritonéale et<br />
un groupe 15 hommes et 15 femmes opérés consécutivement par<br />
voie voie rétropéritonéale gauche. Chaque groupe comportait<br />
15 arthrodèses pour spondylolisthésis L5S1 et 15 prothèses disca<strong>les</strong><br />
Mobidisc L5S1. Les 2 groupes étaient équivalents en terme<br />
de sexe ratio, d’âge, de taille et de poids. Ont été analysés le<br />
temps nécessaire pour aborder le disque et pour la réalisation de<br />
la discectomie, la qualité du centrage <strong>des</strong> implants, le volume du<br />
saignement per-opératoire, le temps nécessaire pour la fermeture<br />
de l’abord, la survenue de complication vasculaire, urétérale ou<br />
sexuelle ; le délai postopératoire de reprise du transit et l’intensité<br />
<strong>des</strong> douleurs pariéta<strong>les</strong> postopératoires.
3S42 81 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
RÉSULTATS. Le temps nécessaire pour aborder le disque était<br />
de 28’ dans le groupe 1 pour 18’ dans le groupe 2. La discectomie<br />
avait nécessité 42’ dans le groupe 1 pour 30’ dans le groupe 2. Le<br />
centrage <strong>des</strong> implants et le volume du saignement (évalué à<br />
250 cc) étaient équivalents dans <strong>les</strong> 2 groupes. Le temps nécessaire<br />
pour la fermeture de l’abord était de 30’ dans le groupe 1<br />
pour 15’ dans le groupe 2. Aucune complication vasculaire ou<br />
urétérale n’est survenue. Une éjaculation rétrograde est apparue<br />
(groupe 1). Le temps de reprise du transit était de 48 heures dans<br />
le groupe 1 et de 24 heures dans le groupe 2. L’intensité <strong>des</strong> douleurs<br />
pariéta<strong>les</strong> était plus importante dans le groupe 2 jusqu’au<br />
3 e jour postopératoire.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. La chirurgie par voie<br />
antérieure du disque L5S1 (arthrodèse ou arthroplastie) peut être<br />
pratiquée indifféremment par voie trans ou rétropéritonéale.<br />
L’exposition du site opératoire apparaît équivalente, autorisant la<br />
même qualité dans le positionnement <strong>des</strong> implants. En dehors du<br />
délai de reprise du transit et de l’intensité <strong>des</strong> douleurs pariéta<strong>les</strong><br />
pendant <strong>les</strong> 3 premiers jours postopératoire, la morbidité respective<br />
de ces 2 techniques d’abord apparaît équivalente. Toutefois,<br />
la chirurgie par voie intrapéritonéale expose au risque de bri<strong>des</strong><br />
potentiellement responsab<strong>les</strong> de phénomènes occlusifs dans<br />
approximativement 5 à 10 % <strong>des</strong> cas. La voie rétropéritonéale<br />
gauche apparaît donc être une bonne solution pour l’abord antérieur<br />
du rachis lombo-sacré.<br />
* Jérôme Allain,<br />
Service de Chirurgie Orthopédique, Hôpital Henri-Mondor,<br />
51, avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny,<br />
94000 Créteil.<br />
24 Conséquences uro-génita<strong>les</strong> <strong>des</strong><br />
abords antérieurs discaux L4L5 et<br />
L5S1 : enquête préliminaire chez<br />
128 patients<br />
Joël DELÉCRIN *, Pascal GLÉMAIN,<br />
Jérôme ALLAIN, Jacques BEAURAIN,<br />
Jean-Paul STEIB, Hervé CHATAIGNIER,<br />
Lucie AUBOURG<br />
INTRODUCTION. Les abords antérieurs <strong>des</strong> disques L4L5 et<br />
L5S1 peuvent léser le plexus sympathique hypogastrique supérieur<br />
et être à l’origine de complications sexuel<strong>les</strong>. La plus connue,<br />
chez l’homme, est l’éjaculation rétrograde, dont l’incidence<br />
et <strong>les</strong> mécanismes sont controversés. Les conséquences sexuel<strong>les</strong><br />
chez la femme sont mal évaluées. Il en est de même <strong>des</strong> conséquences<br />
urinaires. Pourtant l’innervation sympathique agit en<br />
favorisant la relaxation de la vessie et en augmentant le tonus du<br />
col vésical, ce qui est un facteur de continence. La disparition de<br />
ce tonus pourrait entraîner une hyperactivité vésicale ou une<br />
incontinence urinaire. L’objectif de ce travail préliminaire était<br />
de vérifier s’il y avait bien <strong>des</strong> symptômes urinaires et sexuels<br />
après ce type de chirurgie.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Pour cela, un questionnaire spécifique,<br />
portant sur <strong>des</strong> symptômes sexuels et urologiques, a été<br />
appliqué à une série prospective, continue, de 86 femmes et<br />
42 hommes, répartis dans 5 centres, pour une chirurgie prothétique<br />
discale par abords antérieurs rétro ou trans-péritonéaux. Les<br />
items urologiques portaient sur la pollakiurie, l’envie pressante<br />
et <strong>les</strong> pertes d’urines. Sur le plan sexuel, chez la femme <strong>les</strong> questions<br />
portaient sur la sécheresse vaginale, la douleur et <strong>les</strong> diminutions<br />
<strong>des</strong> sensations sexuel<strong>les</strong>. Chez l’homme, el<strong>les</strong> portaient<br />
sur le volume de l’éjaculation et la douleur.<br />
RÉSULTATS. Sur le plan urologique, 1/3 <strong>des</strong> femmes et 1/4<br />
<strong>des</strong> hommes rapportaient au moins un symptôme. Il s’agissait<br />
d’une pollakiurie dans 25,5 % <strong>des</strong> cas et d’une incontinence<br />
d’urine dans 9,3 % <strong>des</strong> cas chez <strong>les</strong> femmes et, chez <strong>les</strong> hommes,<br />
d’une pollakiurie dans 26,1 % <strong>des</strong> cas. Sur le plan sexuel,<br />
7 % <strong>des</strong> femmes rapportaient une sécheresse vaginale et presque<br />
1/4 au moins un symptôme au niveau vaginal. Chez<br />
l’homme, ont été retrouvé : 7,1 % d’éjaculation rétrograde,<br />
4,7 % de douleur et 7,1 % de diminution de volume de l’éjaculation.<br />
Pour <strong>des</strong> reculs très variab<strong>les</strong>, de 3 mois à 2 ans, il a été<br />
constaté pour certains symptômes une disparition entre 3 mois<br />
et 12 mois ou une persistance à 2 ans.<br />
DISCUSSION. Cette enquête préliminaire met en évidence un<br />
taux de symptômes urologiques et sexuels postopératoires important.<br />
Ce sont certes <strong>des</strong> symptômes mis en évidence par <strong>des</strong> autoquestionnaires<br />
et <strong>des</strong> biais, source plutôt d’une majoration, doivent<br />
être discutés (difficultés de compréhension <strong>des</strong> questions,<br />
patients douloureux chroniques avec confusion <strong>des</strong> sites douloureux<br />
et souvent médication modifiée en postopératoire). Mais la<br />
relative concordance quantitative entre homme et femme plaide<br />
en faveur de l’atteinte commune possible du plexus hypogastrique<br />
supérieur avec autant d’éjaculation rétrograde que de sécheresse<br />
vaginale et <strong>des</strong> taux comparab<strong>les</strong> de troub<strong>les</strong> urologiques.<br />
CONCLUSION. Cette étude confirme bien l’apparition de<br />
troub<strong>les</strong> urinaires en plus <strong>des</strong> conséquences sexuel<strong>les</strong> déjà connues.<br />
Ceci demande une évaluation plus précise, et pourrait justifier<br />
un bilan préopératoire pour dépister <strong>des</strong> patientes à risque,<br />
en particulier en cas d’hyperactivité vésicale ou d’insuffisance<br />
sphinctérienne préexistante.<br />
* Joël Delécrin, Service d’Orthopédie,<br />
CHU Hôtel Dieu, 44093 Nantes.<br />
25 Construction hybride par fusion<br />
L5S1 et prothèse discale L4L5 :<br />
résultats à 3 ans<br />
Stéphane AUNOBLE *, Jean-Char<strong>les</strong> LE HUEC,<br />
Martin RONAI, Yann BASSO,<br />
Clément TOURNIER<br />
INTRODUCTION. Les résultats <strong>des</strong> arthroplasties à deux<br />
niveaux ne sont pas très encourageants dans la littérature récente.<br />
La réalisation d’une fusion à l’étage L5S1 avec une prothèse à<br />
l’étage L4L5 pourrait être un bon compromis.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Quarante-huit patients ont été<br />
inclus prospectivement dans cette étude. La fusion à l’étage L5S1
a été réalisée avec mise en place d’une cage impactée carbone<br />
antérieure remplie d’os spongieux autologue avec fixation par une<br />
plaque antérieure en titane. La prothèse totale de disque utilisée à<br />
l’étage L4L5 était un implant Maverick (Medtronic Memphis<br />
USA). La prothèse A Mav a été implantée dans 28 cas et la prothèse<br />
O Mav, présentant une quille oblique à 35°, a été utilisée<br />
dans 20 cas. L’examen clinique a comporté un score d’Oswestry,<br />
un score visuel analogique pour la lombalgie ainsi qu’un score SF<br />
36, <strong>des</strong> radiographies avec incidences dynamiques et en station<br />
débout, à tous <strong>les</strong> interval<strong>les</strong> de suivi. Les complications ont toutes<br />
été notées.<br />
RÉSULTATS. Quarante-cinq patients ont complété la fiche et<br />
le suivi moyen a été de 16 mois (12 à 31 mois). Il n’y a pas eu de<br />
mise en évidence radiographique de non consolidation à l’étage<br />
L5S1. Un patient présentait <strong>des</strong> calcifications périphériques à<br />
l’étage L4L5 mais était toujours mobile sur <strong>les</strong> radiographies<br />
dynamiques. Un patient a eu un enfoncement du plateau inférieur<br />
de la prothèse dans le corps vertébral de L5 de 5 mm mais était<br />
toujours mobile avec 9° de mobilité. Deux patientes se plaignaient<br />
de la sacro iliaque d’un côté et ont été améliorées par une injection<br />
de stéroïde. La lordose globale, la pente sacrée et la bascule pelvienne<br />
n’ont pas été significativement modifiées. La lordose locale<br />
a été augmentée au niveau L5S1 lors de la mise en place de<br />
l’arthrodèse, passant de 9° à 16,2°. La lordose a été significativement<br />
diminuée en postopératoire à l’étage L3L4 (p < 0,005). Le<br />
score d’Oswestry a été amélioré de 29,6 % (sd 15,2), le score<br />
visuel analogique pour la lombalgie a été amélioré significativement<br />
de 39,1 % (sd 17,4) et le score SF36 a montré une amélioration<br />
significative pour le score mental de 47,6 % et pour le score<br />
physique de 82,3 %. La mobilité à l’étage L4L5 a été mesurée à<br />
8,7° (sd 3,4) avec une moyenne à l’étage L3L4 de 10,2° (sd 2,9).<br />
Le lieu de prélèvement de la crête iliaque était toujours douloureux<br />
avec un score supérieur à 3/10 à 12 mois pour 5 patients.<br />
DISCUSSION. La construction hybride donne un résultat clinique<br />
équivalent aux résultats de l’arthroplastie sur un seul<br />
niveau. La Prodisc ou la Charité ont montré <strong>des</strong> résultats significativement<br />
moins bons lors de la pose sur deux niveaux. La<br />
construction hybride permet donc d’obtenir une bonne fondation<br />
au niveau de la jonction lombo sacrée. L’utilisation de la<br />
BMPrh2 permettra d’éliminer <strong>les</strong> douleurs résiduel<strong>les</strong> du lieu de<br />
prélèvement au niveau de la crête iliaque dans le futur. La construction<br />
hybride est donc un système de traitement <strong>des</strong> lombalgies<br />
chroniques moins onéreux et c’est un compromis plus sûr<br />
pour <strong>les</strong> patients ayant une pathologie sur deux niveaux.<br />
* Stéphane Aunoble, Deterca, Université de Bordeaux 2,<br />
146, rue Léo-Saignat, boîte n47, 33076 Bordeaux.<br />
26 Nouvelle prothèse de disque lombaire<br />
par approche oblique : faisabilité<br />
et analyse du positionnement<br />
Jean-Char<strong>les</strong> LE HUEC *, Stéphane AUNOBLE,<br />
Yann BASSO, Martin RONAI, Clément TOURNIER<br />
INTRODUCTION. La mise en place <strong>des</strong> prothèses de disque<br />
lombaire en L4L5 impose de rétracter <strong>les</strong> vaisseaux. Une étude<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S43<br />
récente de Brau (Spine 2003) a démontré que 57 % <strong>des</strong> patients<br />
avaient une diminution <strong>des</strong> potentiels évoqués sensitifs et une<br />
diminution significative de la saturation en oxygène au niveau du<br />
membre inférieur gauche et un risque de thrombose.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Quarante patients ont eu une<br />
prothèse de disque dans une étude prospective. Trente-huit ont<br />
un implant à l’étage L4L5 parmi <strong>les</strong>quels 22 ont eu une fusion<br />
d’étage L5S1 et une prothèse à l’étage L4L5 et 2 patients ont eu<br />
une fusion à L4L5 et un implant à l’étage L3L4. Une nouvelle<br />
prothèse totale de disque implantable de manière oblique entre<br />
l’aorte et la partie antérieure du muscle psoas gauche a été utilisée.<br />
Les potentiels évoqués moteurs et sensitifs et la saturation<br />
en oxygène du membre inférieur gauche ont été monitorés. La<br />
position <strong>des</strong> implants a été analysée sur <strong>des</strong> radiographies postopératoires<br />
selon <strong>les</strong> critères définis par MC Afee (Spine 2005) et<br />
le Huec (Orthop Clinic North Am 2005).<br />
RÉSULTATS. Il y avait 22 hommes et 18 femmes, d’âge<br />
moyen 42,4 ans. Aucun patient n’a eu une baisse de saturation<br />
en oxygène inférieure à 90 % au niveau du membre inférieur<br />
gauche sauf dans 6 cas ou cette saturation était instable. Aucun<br />
patient n’a eu de perturbation <strong>des</strong> potentiels évoqués moteurs et<br />
sensitifs. Le temps opératoire à été de 85 minutes, ± 17 minutes<br />
pour une chirurgie à un niveau et de 117 minutes ± 21 minutes<br />
pour une chirurgie à deux niveaux. Le positionnement de la prothèse<br />
a été jugé parfait, (moins de 9 % de décalage de face dans<br />
34 cas) et satisfaisant (entre 10 et 19 % de décalage dans 6 cas).<br />
Il n’y a pas eu de complication rapportée sur le plan vasculaire,<br />
artériel ou veineux. Il n’y a pas eu de complication viscérale,<br />
mais un patient a présenté un lymphocèle qui a été traité par drainage<br />
avec un bon résultat, un patient a présenté un hématome du<br />
psoas qui s’est résorbé spontanément sans séquelle et trois<br />
patients ont eu un effet de sympathectomie qui a été résolutif<br />
spontanément à un an de suivi.<br />
CONCLUSION. La prothèse totale de disque avec insertion<br />
oblique permet d’éviter une rétractation excessive <strong>des</strong> vaisseaux<br />
à l’étage L4L5. Ceci rend plus sûr le geste chirurgical.<br />
* Jean-Char<strong>les</strong> Le Huec, Service d’Orthopédie, CHU Pellegrin,<br />
6 e étage, place Amélie-Raba-Léon, 33076 Bordeaux.<br />
27 Étude conceptuelle par modélisation<br />
en éléments finis de la géométrie<br />
<strong>des</strong> prothèses disca<strong>les</strong> à<br />
emboîtement sphérique au rachis<br />
cervical<br />
Marc-Antoine ROUSSEAU *, Xavier BONNET,<br />
Jean-Yves LAZENNEC, Wafa SKALLI<br />
INTRODUCTION. Alors que différents modè<strong>les</strong> de prothèses<br />
sont utilisés en clinique, il existe peu de données biomécaniques<br />
publiées sur l’arthroplastie discale cervicale. Le but de notre travail<br />
était d’étudier l’influence de la géométrie d’une prothèse à<br />
emboîtement sphérique sur <strong>les</strong> mobilités et <strong>les</strong> contraintes dans<br />
une unité fonctionnelle cervicale.
3S44 81 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Avec le logiciel ANSYS, nous<br />
avons réalisé <strong>des</strong> simulations sur un modèle par éléments finis<br />
cervical validé de l’unité C5C6. Les simulations comportaient<br />
l’ablation du ligament vertébral commun postérieur. Le maillage<br />
de l’arthroplastie était paramétré pour faire varier le rayon (petit/<br />
grand) et la position du centre de la prothèse (central ou postérieur).<br />
Les conditions aux limites était <strong>les</strong> suivantes : C6 fixée,<br />
précontrainte C5C6 de 40 N, C5 libre avec application incrémentielle<br />
de moments purs jusqu’à 1,6 Nm. Le déplacement de C5 et<br />
la contrainte dans <strong>les</strong> facettes articulaires ont été recueillis.<br />
RÉSULTATS. Globalement, la rotation en flexion/extension<br />
et l’ensemble <strong>des</strong> mobilités en translation étaient légèrement<br />
augmentés après implantation, surtout lorsque le centre était postérieur<br />
et le rayon était grand. Les rotations en torsion et inclinaison<br />
latérale étaient diminuées. Les contraintes dans <strong>les</strong> facettes<br />
étaient globalement diminuées après implantation sauf en extension<br />
et en inclinaison latérale lorsque le rayon de courbure était<br />
petit et/ou le centre n’était pas postérieur.<br />
DISCUSSION. Les résultats de cette étude conceptuelle ne<br />
sont qu’indicatifs et n’ont de valeur que par comparaison entre<br />
eux, car leur validation expérimentale à partir de la littérature est<br />
faible et indirecte. Cependant, l’intérêt était de faire varier librement<br />
<strong>les</strong> paramètres géométriques de la prothèse et de donner<br />
accès aux efforts internes. Dans <strong>les</strong> conditions expérimenta<strong>les</strong><br />
choisies, la position du centre et le rayon de courbure avaient une<br />
influence cohérente sur le comportement <strong>des</strong> structures.<br />
CONCLUSION. Notre étude améliore notre compréhension<br />
du fonctionnement mécanique théorique <strong>des</strong> prothèses disca<strong>les</strong><br />
au niveau cervical et suggère un positionnement postérieur du<br />
centre de rotation.<br />
* Marc-Antoine Rousseau, LBM – ENSAM,<br />
151, boulevard de l’Hôpital, 75013 Paris.<br />
28 Réduction et arthrodèse circonférencielle<br />
par voie postérieure de<br />
spondylolisthésis sévères<br />
Pedro DOMENECH *, Jesus BURGOS,<br />
Eduardo HEVIA, Pedro GUTIERREZ, Biel PIZA,<br />
Ignaci SAMPERA, Juan RODRIGUEZ-OLAVERRI,<br />
Oscar RIQUELME, Joaquin FENOLLOSA<br />
INTRODUCTION. Cette étude présente <strong>les</strong> résultats de notre<br />
méthode chirurgicale de décompression neurologique, réduction<br />
et arthrodèse circonférentielle par abord postérieur chez <strong>des</strong><br />
patients présentant <strong>des</strong> spondylolisthésis sévères.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Quatorze patients, d’âge moyen<br />
de 24 ans (12-60) présentaient une spondylolisthésis de plus de<br />
50 % de déplacement. Dans ce groupe de patients, l’angle de<br />
glissement était d’une valeur moyenne de 37º et le déplacement<br />
moyen préopératoire était de 74 %. Technique : par voie postérieure<br />
était réalisée la décompression nerveuse et sous contrôle<br />
de la vue étaient mises en place <strong>les</strong> vis pédiculaires en L5 et S1<br />
(dans un cas seulement, l’intervention s’étendait à L4 en raison<br />
d’un spondylolisthésis associé en L4L5). Dans tous <strong>les</strong> autres<br />
cas sauf trois furent ajoutées <strong>des</strong> vis iliaques. L’anneau fibreux<br />
était enlevé complètement, de même que le disque L5-S1 et le<br />
bord arrondi du sacrum. Après avoir mis <strong>les</strong> vis L5 et S1, <strong>des</strong><br />
cages intersomatiques avec greffe (de 3 à 5) étaient introduites.<br />
Avec <strong>les</strong> tiges métalliques où appliquait une lordose aux barres<br />
par modelage, réduisant de cette manière le glissement et finalement,<br />
en serrant <strong>les</strong> vis, on obtenait la lordose finale. Il y eut toujours<br />
monitoring avec potentiels évoqués moteurs et sensitifs et<br />
cathéter épidural. Les radiographies en préopératoire, postopératoire<br />
immédiat et à l’examen final furent étudiées. Les données<br />
cliniques s’obtinrent <strong>des</strong> dossiers cliniques.<br />
RÉSULTATS. Il se produisit une rupture de la dure-mère.<br />
Chez deux patients, une cage se déplaça en avant. Dans un cas,<br />
<strong>les</strong> vis de L5 glissèrent en arrière sans cependant nécessiter nouvel<br />
abord chirurgical. Un patient présenta une infection postopératoire<br />
qui guérit avec nettoyage chirurgical et antibiothérapie.<br />
Après un suivi moyen de 16 mois et minimum de 10 mois,<br />
l’étude radiographique n’a pas montré de pseudarthrose, le<br />
déplacement moyen final fut de 15 % et l’angle de glissement de<br />
5º. Dix patients ne présentaient pas de douleur, ni de limitations<br />
physiques ; deux patients souffraient de gêne lombaire légère et<br />
limitations occasionnel<strong>les</strong> dans <strong>les</strong> activités physiques.<br />
CONCLUSION. La technique de réduction et arthrodèse circonférentielle<br />
par voie postérieure que nous avons utilisée s’est<br />
révélée efficace dans la correction de la déformation et a donné<br />
<strong>des</strong> résultats cliniques excellents.<br />
* Pedro Domenech, Maestro Alonso 109,<br />
03010 Alicante, Espagne.<br />
29 Ostéotomies vertébra<strong>les</strong> postérieures<br />
de soustraction : morbidité et<br />
correction. À propos de 22 cas<br />
Jean-Marie PHILIPPEAU *, Norbert PASSUTI,<br />
Joël DELÉCRIN<br />
INTRODUCTION. Les deux techniques de correction <strong>des</strong><br />
grands déséquilibres sagittaux sont l’ostéotomie corporéale<br />
transpédiculaire et l’ostéotomie vertébrale postérieure de soustraction.<br />
Nous présentons la morbidité et la correction obtenues<br />
dans une série de 22 ostéotomies vertébra<strong>les</strong> de soustraction.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. L’âge moyen à l’intervention<br />
était de 52 ans. Quatorze patients avaient <strong>des</strong> antécédents chirurgicaux<br />
rachidiens, et 15 <strong>des</strong> signes neurologiques préopératoires.<br />
Les déséquilibres sagittaux étaient tous pluri étagés et associés à<br />
un déséquilibre frontal pour 17 d’entre eux. L’ostéotomie a consisté<br />
en une résection isthmique et foraminale à 2 niveaux dans<br />
8 cas, 3 niveaux dans 10 cas, et plus dans 4 cas. Dans 17 cas, la<br />
chirurgie a été réalisée après un temps antérieur de libération.<br />
L’ostéosynthèse a été assurée par une instrumentation rigide dans<br />
tous <strong>les</strong> cas, la pose de cages n’a été réalisée que chez 3 patients.<br />
RÉSULTATS. Les complications peropératoires et postopératoires<br />
immédiates ont été marquées par une fracture de pédicule,
une brèche dure-mérienne, 8 radiculalgies (dont une persistera),<br />
et une paraparésie due à un bas débit postopératoire. Au recul<br />
moyen de plus de 24 mois, il a été noté un démontage précoce,<br />
2 pseudarthrodèses et 2 infections tardives. Les douleurs préopératoires<br />
ont toutes été notablement améliorées. Sur le plan radiographique,<br />
le gain de lordose a été de 26,5° en moyenne. La<br />
pente sacrée postopératoire moyenne était de 38° pour 25° en<br />
préopératoire. La gîte sagittale en T9 a été corrigée de 1,2° en<br />
moyenne et le porte à faux en T9 de plus de 20 mm. La correction<br />
moyenne obtenue par niveau ostéotomisé a été de 8,70° avec<br />
<strong>des</strong> extrêmes allant de 34° à –4°. Les 17 déformations associées<br />
dans le plan frontal ont été améliorées.<br />
DISCUSSION. L’ostéotomie vertébrale de soustraction est<br />
une technique efficace pour la correction globale dans le plan<br />
sagittal, dont le gain est variable selon le nombre et <strong>les</strong> niveaux<br />
ostéotomisés, mais qui permet d’associer une correction dans le<br />
plan frontal. La morbidité reconnue de cette intervention est à<br />
relativiser dans notre série qui comportait <strong>des</strong> patients multi opérés,<br />
<strong>des</strong> corrections arthrodèses étendues, et la persistance d’une<br />
seule radiculalgie. De plus, la morbidité doit être comparée à<br />
celle de l’autre alternative chirurgicale représentée par l’ostéotomie<br />
transpédiculaire.<br />
CONCLUSION. L’ostéotomie vertébrale postérieure de soustraction<br />
représente une alternative à l’ostéotomie corporéale<br />
transpédiculaire, malgré une voie antérieure supplémentaire, surtout<br />
en cas de déformation frontale associée.<br />
* Jean-Marie Philippeau, Service d’Orthopédie,<br />
CHU Nantes, Hôtel Dieu, 44000 Nantes.<br />
30 Dégénérescence <strong>des</strong> niveaux adjacents<br />
à une arthrodèse lombaire<br />
ou lombosacrée et profil postopératoire.<br />
Une étude cas témoin<br />
Frédéric JACQUOT *, Daniel CHOPIN,<br />
Andrei BAKLANOV<br />
INTRODUCTION. Les niveaux adjacents à une arthrodèse<br />
lombaire ou lombosacrée sont à risque de modifications dégénératives<br />
ultérieures. Les modifications radiologiques sont fréquentes,<br />
mais la nécessité d’une intervention est relativement rare. Les facteurs<br />
prédisposant en sont inconnus. Pour déterminer l’influence<br />
<strong>des</strong> facteurs de positionnement sagittal, nous avons réalisé une<br />
étude comparative cas témoin entre patients ayant nécessité une<br />
reprise chirurgicale et patients n’ayant aucun signe de dégénérescence<br />
adjacente, en estimant le risque relatif par l’odds ratio.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Treize patients ont été réopérés<br />
sur une période de 10 ans pour dégénérescence symptomatique<br />
adjacente à une arthrodèse fusionnée. Ces patients ont été comparés<br />
à une population de 35 qui ont eu une arthrodèse lombaire ou lombosacrée<br />
dans la même institution avec un recul comparable et<br />
n’ayant pas de dégénérescence adjacente clinique ni radiologique.<br />
Les paramètres sagittaux ont été mesurés sur <strong>les</strong> profils lombaires<br />
debout faits avant, après l’arthrodèse, et au dernier recul (angulation<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S45<br />
du plateau supérieur de chaque niveau de L1 à L5 par rapport au<br />
sacrum, pente sacrée et incidence). L’aspect pré et postopératoire<br />
<strong>des</strong> disques sus-jacents à l’arthrodèse a été examiné, à la recherche<br />
d’anomalies préexistantes et de modifications postopératoires.<br />
RÉSULTATS. L’âge moyen était de 49,8 ans dans la série et<br />
de 50,6 dans le groupe contrôle. La lordose L5-S1 était significativement<br />
moins importante chez <strong>les</strong> patients réopérés pour dégénérescence<br />
adjacente (13,6°) que dans le groupe contrôle (19,5°,<br />
p = 0,0078). Une lordose L5-S1 postopératoire inférieure à 38 %<br />
de la lordose totale L1-S1 ou inférieure à 30 % de l’angle d’incidence<br />
étaient <strong>des</strong> facteurs de risque significatifs de ré intervention<br />
(risque relatif respectivement 5,75 et 7,27, p = 0,02 et<br />
p = 0,008). Les autres facteurs de risque étaient : Niveau supérieur<br />
de l’arthrodèse en L3 (RR = 3,9), et ouverture antérieure du<br />
disque sus jacent à l’arthrodèse sur <strong>les</strong> radiographies post opératoires<br />
(RR = 3,0). Etiologie, extension au sacrum, lordose totale,<br />
nombre de niveaux fusionnés, et perte de correction au dernier<br />
recul n’étaient pas <strong>des</strong> facteurs de risque significatifs.<br />
CONCLUSION. Une lordose postopératoire insuffisante<br />
absolue ou relative est un facteur de risque de dégénérescence<br />
adjacente symptomatique, en particulier rapportée à l’incidence<br />
sacrée. Ce facteur est le résultat du positionnement de l’instrumentation<br />
en per opératoire et sous le contrôle du chirurgien.<br />
* Frédéric Jacquot, Service de Chirurgie Orthopédique,<br />
Hôpital Saint-Antoine,<br />
184, rue du Faubourg-Saint-Antoine,<br />
75571 Paris Cedex 12.<br />
31 Évolution à long terme <strong>des</strong> disques<br />
adjacents à une arthrodèse rachidienne<br />
instrumentée par matériel<br />
Universal Spine System (USS) en<br />
traumatologie : étude clinique et<br />
IRM de 57 patients à 8 ans de recul<br />
moyen<br />
Pierre BRASSEUR *, Patrick CHATELLIER,<br />
Mostapha BOUSSOUGA, Jean-Louis HUSSON<br />
INTRODUCTION. Les progrès chirurgicaux réalisés dans le<br />
cadre <strong>des</strong> fractures vertébra<strong>les</strong> s’expliquent en partie grâce aux<br />
fixations courtes, segmentaires. Nous utilisons depuis 23 ans le<br />
matériel USS assurant une ostéosynthèse non extensive avec<br />
possibilité de réduction par effet « bras de levier ». Les objectifs<br />
de ce travail étaient de vérifier la fiabilité immédiate et à long<br />
terme du matériel USS dans le cadre <strong>des</strong> traumatismes thoracolombaires<br />
et d’analyser <strong>les</strong> conséquences cliniques et socia<strong>les</strong> au<br />
plus long recul.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Il s’agit d’une étude rétrospective<br />
à long terme portant sur 57 patients victimes d’une fracture<br />
thoracique basse ou lombaire opérés par voie postérieure exclusive<br />
(âge moyen 40 ans – 77 % en activité – 47 % sportifs). Chaque<br />
patient a été revu cliniquement (Franckel). L’analyse
3S46 81 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
radiologique s’est attachée à rechercher <strong>les</strong> déformations initia<strong>les</strong><br />
(Magerl), secondaires et d’éventuel<strong>les</strong> discopathies adjacentes<br />
au montage ou à l’étage greffé – matériel en place ou ôté<br />
(clichés dynamiques et IRM).<br />
RÉSULTATS. Le recul moyen était de 92 mois (min 61max<br />
129). Atteinte majoritaire en T12-L1 (51 %). Vingt-trois<br />
patients étaient déficitaires en préopératoire. À la revue, 80 %<br />
étaient indolores et 77 % avaient un score de Franckel amélioré.<br />
70 % ont repris une activité professionnelle ou sportive à<br />
10 mois de l’accident. L’ablation du matériel a été effectuée chez<br />
30 patients à 18 mois de la chirurgie. La perte vertébrale était<br />
inférieure à 1° (gain absolu de 11°) et la perte régionale était de<br />
7° (données inchangées en présence ou non du matériel). On<br />
retrouvait 9 néocharnières chez 7 patients, toutes étant adjacentes<br />
à un disque arthrodésé. Trente et une IRM ont été<br />
interprétées : 7 dégénérescences disca<strong>les</strong> chez 6 patients dont<br />
une seule adjacente à un disque sain remis en charge.<br />
32 Traitement arthroscopique <strong>des</strong> fractures<br />
<strong>des</strong> plateaux tibiaux : à propos<br />
de 18 patients revus à 38 mois<br />
Alexandre DURAND *, Alain HARISBOURE,<br />
Benoit GIRAUD, Christophe MENSA,<br />
Emile DEHOUX<br />
INTRODUCTION. Les fractures <strong>des</strong> plateaux tibiaux sont<br />
pourvoyeuses d’arthrose et de raideur articulaire. Cette étude<br />
rétrospective avait pour but d’évaluer <strong>les</strong> résultats du traitement<br />
chirurgical sous arthroscopie.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Dix-huit patients ont été inclus<br />
(14 hommes, 4 femmes) d’âge moyen 35 ans. Tous ont été traités<br />
par arthroscopie, pour la réduction, et ostéosynthèse percutanée.<br />
Le type de fracture a été classé selon Schatzker. L’enfoncement<br />
et la séparation ont été mesurés sur <strong>les</strong> radiographies préopératoires<br />
et postopératoires. Treize patients ont bénéficié d’un scanner<br />
préopératoire. Le délai de reprise de la marche, de<br />
rééducation, la survenue de complications ont été mesurés. Dix<br />
patients ont été revus, huit autres ont été interrogés par téléphone.<br />
Les scores de l’IKS et de Rasmussen ont été utilisés.<br />
RÉSULTATS. La fracture concernait 15 fois le plateau tibial<br />
latéral, 3 fois le plateau médial. Selon Schatzker, on retrouvait :<br />
10 types II, 5 types III et 3 types IV. L’enfoncement moyen était<br />
de 9 mm, la séparation de 6 mm. Six fois, nous avons constaté <strong>des</strong><br />
lésions associées. L’ostéosynthèse a été réalisée par vissage percutané.<br />
Chez onze patients, un comblement osseux a été nécessaire<br />
(crête iliaque ou substitut osseux). La séparation était réduite<br />
anatomiquement (moins de 3 mm) dans 100 % <strong>des</strong> cas, et l’enfoncement<br />
dans 94 % <strong>des</strong> cas. Sept patients ont été réopérés (un syndrome<br />
<strong>des</strong> loges, 3 lésions ménisca<strong>les</strong>, une rupture du LCA, une<br />
ostéotomie de valgisation pour un varus de 8°, une reprise pour<br />
Séance du 6 novembre après-midi<br />
GENOU<br />
DISCUSSION. Une grande majorité de patients étaient indolores<br />
au recul, <strong>les</strong> douleurs résiduel<strong>les</strong> pouvant être reliées à<br />
l’encombrement postérieur du matériel ou à l’importance de la<br />
déformation initiale. Le taux de reprise du travail était encourageant<br />
(supérieur chez <strong>les</strong> travailleurs de force). La récupération<br />
neurologique n’était pas négligeable et dépendait du délai de<br />
prise en charge initiale. Le potentiel de réduction et de stabilisation<br />
était excellent.<br />
CONCLUSION. Les avantages de l’USS sont confirmés,<br />
assumant pleinement son rôle de réduction et de stabilité lésionnelle<br />
dans le temps.L’ablation du matériel semble licite lorsque<br />
la fracture est consolidée et la greffe intégrée, permettant de<br />
diminuer la symptomatologie sans modifier <strong>les</strong> pertes angulaires,<br />
et de remettre en charge un éventuel disque sain ponté mais non<br />
greffé, diminuant ainsi <strong>les</strong> dégénérescences disca<strong>les</strong> adjacentes.<br />
* Pierre Brasseur, 2, rue de l’Hôtel-Dieu, 35000 Rennes.<br />
ostéosynthèse insuffisante). Le délai moyen avant rééducation<br />
était de 7 jours, la durée de décharge moyenne était de 82 jours.<br />
Au recul moyen (38,8 mois), le score de Rasmussen était de 27,8<br />
sur 30 et le score IKS global de 85,9 sur 100. La flexion était en<br />
moyenne de 132°, et seuls 2 patients présentaient un déficit<br />
d’extension de 10°. L’enfoncement résiduel était de 0,78 mm.<br />
Trois patients présentaient <strong>des</strong> signes d’arthrose post-traumatique.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. Le taux de complication<br />
n’est pas supérieur à celui <strong>des</strong> séries de la littérature. Le délai de<br />
rééducation est précoce, sans perte de réduction ni augmentation<br />
du taux d’arthrose secondaire. L’utilisation de l’arthroscopie pour<br />
la réduction et l’ostéosynthèse percutanée a permis d’obtenir <strong>des</strong><br />
résultats satisfaisants. L’intérêt de l’arthroscopie est certain concernant<br />
la qualité de la réduction, le traitement <strong>des</strong> lésions associées,<br />
la précocité de la rééducation et le résultat fonctionnel,<br />
même si la survenue d’arthrose à distance reste possible.<br />
* Alexandre Durand, Service d’Orthopédie-Traumatologie,<br />
Hôpital Maison-Blanche, CHU de Reims,<br />
45, rue Cognacq-Jay, 51092 Reims Cedex.<br />
33 Réinsertion de l’épine tibiale antérieure<br />
chez l’adulte : technique arthroscopique<br />
par broche recourbée<br />
Nicolas BONIN *, Laurent JEUNET,<br />
Grégoire LECLERC, Lucas REHBY,<br />
Patrick GARBUIO<br />
INTRODUCTION. Les auteurs rapportent une technique<br />
arthroscopique simple de fixation <strong>des</strong> fractures déplacées de<br />
l’épine tibiale antérieure.
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Cinq adultes, d’âge moyen<br />
25 ans (16 à 41 ans), ont été opérés d’une fracture déplacée de<br />
l’épine tibiale antérieure sous contrôle arthroscopique. Le bilan<br />
lésionnel comprenait toujours un scanner. Selon la classification de<br />
Meyers et Mc Keever, modifiée par Zaricznyj, il y avait deux<br />
lésions de stade 3 et trois fractures comminutives de stade 4. Après<br />
exploration arthroscopique et débridement de la logette d’avulsion,<br />
la réduction de la fracture était effectuée à l’aide d’un viseur tibial.<br />
Grâce au viseur, une broche de 18/10 e de millimètre était insérée<br />
dans le pied du ligament croisé antérieur. Elle était recourbée sur<br />
son dernier centimètre intra-articulaire. Une traction était effectuée<br />
sur la broche jusqu’à la voir se décourber partiellement sur le fragment<br />
réduit. L’autre extrémité était alors recourbée de la même<br />
façon sur la corticale tibiale et sectionnée. La rééducation débutait<br />
le lendemain de l’intervention. L’appui était autorisé sous couvert<br />
d’une attelle pendant trois semaines. Une évaluation clinique et<br />
radiologique a été réalisée au moyen de la fiche IKDC « objective<br />
form ». Une mesure laximétrique par Telos ® a été effectuée. Un<br />
questionnaire IKDC d’évaluation subjective a été complété.<br />
RÉSULTATS. Tous <strong>les</strong> patients ont été revus au recul moyen<br />
de 17 mois (11-26 mois). La fracture a toujours consolidé et le<br />
matériel a toujours été retiré. Au recul, trois patients étaient satisfaits<br />
et deux très satisfaits avec un score IKDC subjectif moyen<br />
de 90/100 (82-98). Aucun ne se plaignait d’instabilité et tous<br />
avait récupéré leur niveau sportif initial. Le score IKDC objectif<br />
était normal (A) pour deux genoux et presque normal (B) pour<br />
trois genoux : deux genoux présentaient un déficit d’extension de<br />
5 degrés, un genou présentait une laxité différentielle de 4 millimètres.<br />
DISCUSSION. Les avulsions de l’épine tibiale antérieure<br />
chez l’adulte sont réputées pour leur mauvais pronostic avec raideur<br />
ou laxité résiduelle. Les avantages de la fixation arthroscopique<br />
sont nombreux. Il persiste néanmoins <strong>des</strong> limites liées aux<br />
difficultés techniques ou à l’insuffisance de stabilisation de fragments<br />
comminutifs. La fixation arthroscopique par broche présente<br />
<strong>les</strong> avantages d’une procédure simple, permettant une mise<br />
en compression élastique stable <strong>des</strong> fragments qui autorise<br />
l’appui et la mobilisation précoce du genou. Cette stabilité peut<br />
expliquer <strong>les</strong> bons résultats de notre courte série.<br />
* Nicolas Bonin, Clinique de la Sauvegarde,<br />
8, avenue Ben-Gourion, 69009 Lyon.<br />
34 Évolution radiologique après une<br />
méniscectomie arthroscopique sur<br />
genou stable : résultats à plus de<br />
21 ans de recul<br />
Pierre ABADIE *, Benoît LEBEL,<br />
Mathieu MICHAUT, Christine LAUTRIDOU,<br />
Bruno LOCKER, Claude VIELPEAU,<br />
Christophe HULET<br />
INTRODUCTION. Par une vitesse de récupération plus<br />
rapide, le bénéfice immédiat après méniscectomie arthroscopique<br />
était bien supérieur à la méniscectomie chirurgicale. Le but<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S47<br />
de ce travail était d’étudier le résultat fonctionnel et radiologique<br />
de 30 méniscectomies arthroscopiques sur genou stable à plus de<br />
20 ans de recul.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Nous avons revu une série<br />
rétrospective de 30 méniscectomies arthroscopiques (29 patients),<br />
24 méniscectomies média<strong>les</strong> et 6 méniscectomies latéra<strong>les</strong>.<br />
L’âge moyen était de 31 ans et 94 % <strong>des</strong> lésions correspondaient<br />
à <strong>des</strong> ménisques traumatiques. 87 % <strong>des</strong> lésions étaient vertica<strong>les</strong><br />
pour l’ensemble <strong>des</strong> 30 cas mais toujours vertica<strong>les</strong> pour <strong>les</strong><br />
lésions du ménisque médial. El<strong>les</strong> atteignaient toujours le segment<br />
postérieur du ménisque médial, et <strong>les</strong> segments postérieur<br />
et moyen du ménisque latéral. Le mur méniscal a toujours pu<br />
être conservé. Il s’agissait exclusivement de méniscectomies<br />
subtota<strong>les</strong>. Le bilan radiologique à la révision était le suivant :<br />
genoux droit et gauche face et profil, défilé fémoro-patellaire à<br />
30° de flexion, orthopangonogramme pour apprécier le morphotype<br />
sur <strong>les</strong> deux genoux, cliché en schuss à 30° de flexion en<br />
appui. Les 29 patients ont été revus cliniquement et radiologiquement<br />
par un examinateur indépendant selon le score IKDC<br />
2000. Le recul moyen était de 21 ans.<br />
RÉSULTATS. Le score IKDC fonctionnel moyen était de<br />
80 + 11 points avec 70 % <strong>des</strong> patients satisfaits qui avaient repris<br />
une activité sportive. Objectivement, il y avait 69 % de sujets<br />
classés A. Une seule reprise pour méniscectomie itérative concernant<br />
une languette postéro latérale résiduelle a été nécessaire.<br />
Nous n’avons observé aucune reprise pour arthrose symptomatique.<br />
La prévalence de l’arthrose était de 25 % (6/24) après méniscectomie<br />
médiale contre 33 % (2/6) après méniscectomie latérale.<br />
CONCLUSION. La méniscectomie partielle à 21 ans de recul<br />
est une intervention très satisfaisante subjectivement, peu morbide,<br />
alors que la dégradation arthrosique radiologique qui apparaît<br />
n’est pas négligeable (25 %). En 2006, la méniscectomie<br />
partielle sur genou stable garde une place entière dans le traitement<br />
<strong>des</strong> lésions ménisca<strong>les</strong> vertica<strong>les</strong> traumatiques du sujet de<br />
moins de 35 ans. La dégradation radiologique qui en résulte doit<br />
nous amener à préserver <strong>les</strong> ménisques chaque fois que cela est<br />
possible.<br />
* Pierre Abadie, Département d’Orthopédie, CHU de Caen,<br />
avenue Côte-de-Nacre, 14033 Caen Cedex.<br />
35 Statut méniscal après réparation<br />
arthroscopique : degré de cicatrisation<br />
par segment, taille résiduelle<br />
de la lésion et raccourcissement<br />
méniscal<br />
Nicolas PUJOL *, Ludovico PANARELLA,<br />
Olivier CHARROIS, Tarik AIT SI SELMI,<br />
Philippe NEYRET, Philippe BEAUFILS<br />
INTRODUCTION. L’objectif de cette étude prospective était<br />
de documenter précisément <strong>les</strong> résultats anatomiques <strong>des</strong> réparations<br />
ménisca<strong>les</strong> par l’arthroscanner et d’évaluer pour la première<br />
fois la diminution en largeur du ménisque réparé.
3S48 81 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Cinquante-trois réparations<br />
ménisca<strong>les</strong> (36 ménisques médiaux, 17 latéraux) ont été étudiées<br />
entre 2002 et 2004 dans 2 centres. Tous <strong>les</strong> patients ayant une<br />
laxité antérieure du genou (58,5 %) ont bénéficié d’une ligamentoplastie<br />
du LCA dans le même temps que la réparation méniscale.<br />
Les patients étaient évalués en préopératoire par IRM.<br />
L’évaluation clinique était effectuée par le score IKDC. Les critères<br />
anatomiques de cicatrisation étaient recherchés par un arthroscanner<br />
à 6 mois postopératoires. Quatre paramètres étaient<br />
évalués et comparés sur l’imagerie pour chaque segment méniscal<br />
atteint : le taux de cicatrisation en surface (Henning), le taux de<br />
cicatrisation par segment atteint, le taux de cicatrisation longitudinale,<br />
<strong>les</strong> dimensions relatives <strong>des</strong> segments méniscaux réparés.<br />
RÉSULTATS. Quatre-vingt-douze pour cent <strong>des</strong> patients<br />
avaient un bon résultat objectif (IKDC A : 28, 21 B, 4 C) ; 58 %<br />
<strong>des</strong> ménisques ont complètement cicatrisé selon <strong>les</strong> critères de<br />
Henning, 24 % partiellement, 18 % ayant une cicatrisation inférieure<br />
à 50 %. Le taux de cicatrisation longitudinale moyen était<br />
de 73,1 +/- 38 % pour <strong>les</strong> ménisques médiaux et latéraux. Les<br />
20 lésions isolées du segment postérieur avaient un taux de cicatrisation<br />
de 59,8 +/- 46 %, significativement inférieur (p < 0,05) à<br />
celui <strong>des</strong> 19 lésions s’étendant du segment postérieur au segment<br />
moyen (79,2 +/- 28 %). Une diminution postopératoire significative<br />
de la taille <strong>des</strong> segments moyens et postérieurs réparés était<br />
observée pour le ménisque médial (10 +/- 1,2 %, p < 0,02), et une<br />
diminution de 15 +/- 14 % de celle du segment moyen du ménisque<br />
latéral (p < 0,01). Ce raccourcissement observé était corrélé<br />
au taux de cicatrisation pour le segment postérieur (p < 0,04). Le<br />
segment postérieur cicatrisait donc moins bien, sauf quand il était<br />
suffisamment raccourci. Par ailleurs, le taux de cicatrisation était<br />
corrélé au résultat clinique subjectif (p = 0,001).<br />
CONCLUSION. Les réparations ménisca<strong>les</strong> arthroscopiques<br />
donnent <strong>des</strong> bons résultats cliniques et anatomiques, sur genou<br />
stable ou stabilisé, pour <strong>les</strong> 2 ménisques, à moyen terme. L’avivement<br />
méniscal et son raccourcissement relatif sont <strong>des</strong> facteurs<br />
importants dans <strong>les</strong> phénomènes de cicatrisation. On<br />
obtient une cicatrisation partielle avec une lésion stable et indolore.<br />
Le raccourcissement méniscal après réparation a pour la<br />
première fois été objectivé.<br />
* Nicolas Pujol, Service d’Orthopédie,<br />
Centre Hospitalier de Versail<strong>les</strong>,<br />
177, rue de Versail<strong>les</strong>, 78157 Le Chesnay Cedex.<br />
36 Étude prospective de la qualité de<br />
vie aprés méniscectomie<br />
Elhadi SARI-ALI *, Mouss KATABI,<br />
Valérie DUMAINE, Christophe BOGGIONE,<br />
Philippe BEAUFILS<br />
INTRODUCTION. Le but de cette étude prospective était<br />
d’évaluer à court terme la qualité de vie après méniscectomie, et<br />
déterminer <strong>les</strong> facteurs pronostiques.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Entre janvier 2002 et janvier<br />
2003, 2 opérateurs seniors ont réalisé 62 méniscectomies chez<br />
62 patients, 48 hommes et 14 femmes âgés de 18,4 à 66,5 ans<br />
(45,4 +/- 10,8). Les patients étaient tous ASA I. La qualité de vie<br />
préopératoire et à 6 mois postopératoires a été évaluée à l’aide de<br />
deux scores IKDC subjectif et SF 36. Les valeurs <strong>des</strong> scores ont<br />
été comparées aux données statistiques de la population générale<br />
de même sexe et même tranche d’âge. Une différence était considérée<br />
comme significative si supérieure à 2 écarts type. Les<br />
résultats IKDC ont été classés en 4 groupes : normal, subnormal,<br />
anormal et très anormal. Un examen clinique a été réalisé aux<br />
mêmes dates. La qualité peropératoire de la méniscectomie a été<br />
évaluée par un indice de satisfaction du chirurgien (0 à 10).<br />
RÉSULTATS. Selon le score SF 36, 42 % <strong>des</strong> patients étaient<br />
améliorés, 55 % identiques et 3 % aggravés. Les patients améliorés<br />
avaient un gain de 29,7 +/- 7, <strong>les</strong> identiques 2 +/- 10, et <strong>les</strong><br />
aggravés une perte de 34,5 +/- 5,4. Le taux d’amélioration était<br />
significativement augmenté si le score SF36 préopératoire était<br />
faible (p < 0,001), et l’impression subjective d’anormalité élevée<br />
(p < 0,015). Selon le score IKDC à 6 mois, 50 % <strong>des</strong> patients<br />
étaient normaux, 3 % subnormaux, 6 % anormaux, 41 % très<br />
anormaux. Le gain absolu était de 30,5 points +/- 19,9. 58 % <strong>des</strong><br />
patients étaient améliorés et 42 % identiques. Le score IKDC pré<br />
et postopératoire était significativement corrélé aux signes méniscaux<br />
(p < 0,04). Le taux d’amélioration était plus élevé en<br />
l’absence de lésions cartilagineuses (p < 0,04) et si l’indice de<br />
satisfaction du chirurgien était élevé (p < 0,03). Le score SF 36<br />
était fortement corrélé au score IKDC en préopératoire (coefficient<br />
0,8 p < 0,001) mais pas en postopératoire (coefficient 0,33).<br />
CONCLUSION. La qualité de vie après méniscectomie<br />
s’améliore chez 58 % <strong>des</strong> patients selon l’IKDC et 42 % selon le<br />
SF 36. Les critères de bon pronostic sont l’impression subjective<br />
d’anormalité, l’absence de lésions cartilagineuses et l’indice de<br />
satisfaction du chirurgien. Le score IKDC est corrélé à la présence<br />
de signes méniscaux.<br />
* Elhadi Sari-Ali, 154, rue de Picpus, 75012 Paris.<br />
37 Description d’une technique arthroscopique<br />
originale de remise en<br />
tension du ligament croisé antérieur<br />
Olivier CHARROIS *, Eric CHEYROU,<br />
Julien REMI, Ludovico PANARELLA,<br />
Philippe BEAUFILS<br />
INTRODUCTION. L’une <strong>des</strong> causes d’échec fonctionnel<br />
d’une ligamentoplastie est la distension, par glissement ou allongement,<br />
d’un transplant correctement positionné. Face à une<br />
telle situation, la proposition thérapeutique classique reste la réalisation<br />
d’une nouvelle ligamentoplastie. Cette technique nécessite<br />
un nouveau prélèvement et sacrifie un transplant dont<br />
l’aspect macroscopique est parfois satisfaisant. Nous proposons<br />
une technique arthroscopique originale de remise en tension du<br />
ligament croisé antérieur dont nous rapportons ici <strong>les</strong> résultats<br />
préliminaires.
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Cette technique chirurgicale a<br />
été utilisée chez 6 patients. Quatre avaient eu au moins une ligamentoplastie,<br />
l’une avait eu une fracture spino bitubérositaire<br />
associée à un soulevement du massif <strong>des</strong> épineuses, le dernier un<br />
décollement épiphysaire de l’insertion du ligament croisé durant<br />
son enfance. Par deux voies arthroscopiques antéro-inférieures<br />
habituel<strong>les</strong>, la continuité du ligament croisé antérieur distendu et<br />
le bon positionnement de ses insertions tibiale et fémorale ont<br />
été vérifiés. Le pied du ligament a été libéré de la fibrose cicatricielle,<br />
puis, à l’aide d’une tréphine centrée sur une broche, une<br />
carotte osseuse a été découpée dans l’axe et en continuité avec le<br />
ligament croisé antérieur. La traction sur cette carotte a permis la<br />
remise en tension du ligament. La carotte repositionnée a alors<br />
été fixée par une vis d’interférence résorbable. Les laxités antérieures<br />
différentiel<strong>les</strong> pré et postopératoires ont été mesurées sur<br />
<strong>des</strong> radiographies du genou de profil fléchi à 20° installé sur un<br />
appareillage de type Telos.<br />
RÉSULTATS. Concernant <strong>les</strong> six patients opérés par cette<br />
technique, nous n’avons constaté aucune complication spécifique.<br />
Aucun n’a signalé d’instabilité au décours de la retente du<br />
ligament croisé. Six mois après la retente ligamentaire le tiroir<br />
antérieur différentiel était de 3,9 mm. Pour <strong>les</strong> quatre patients<br />
ayant eu une évaluation pré et postopératoire la réduction de ce<br />
tiroir était, en moyenne, de 64,4 %. Une seule patiente a eu une<br />
laximétrie au plus long recul (4 ans). Sa valeur était alors de<br />
3,3 mm alors qu’elle était de 2,4 mm au sixième mois.<br />
DISCUSSION. Dans le cas de ligaments croisés, natifs ou<br />
reconstruits, continus, bien positionnés mais détendus, cette<br />
technique originale semble permettre de faire l’économie d’un<br />
transplant ligamentaire. Une validation de cette technique sur<br />
une série plus importante comprenant notamment une évaluation<br />
quantitative à long terme de la laxité sera nécessaire afin de<br />
mieux connaître le devenir de ces ligaments retendus et de préciser<br />
ses indications.<br />
* Olivier Charrois, 59, rue Geoffroy-Saint-Hilaire, 75005 Paris.<br />
38 Importance de la suture méniscale<br />
associée à la greffe du LCA sur<br />
l’avenir du genou<br />
Roméo MÉNARD *, Benoît LEBEL,<br />
Christophe HULET, Gil<strong>les</strong> BURDIN,<br />
Bruno LOCKER, Claude VIELPEAU<br />
INTRODUCTION. La préservation du capital méniscal<br />
médial associé à la greffe du LCA est un moyen efficace pour<br />
limiter la survenue de l’arthrose à moyen et long terme. Le but<br />
de cette étude rétrospective avec un recul moyen de 11 ans est<br />
d’étudier le devenir de 58 sutures du ménisque médial en termes<br />
de survie méniscale et le retentissement sur <strong>les</strong> lésions dégénératives<br />
cartilagineuses dans le compartiment médial.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Cinquante-huit patients (15 femmes<br />
et 43 hommes d’âge moyen de 28 ans (15-54 ans) opérés<br />
d’une laxité antérieure chronique par plastie intra-articulaire du<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S49<br />
LCA, avec une suture du ménisque médial ont été revus avec un<br />
recul moyen de 11 ans (24 à 248 mois). 95 % <strong>des</strong> patients étaient<br />
sportifs dont 80 % pratiquaient un sport en compétition. Tous présentaient<br />
une lésion verticale longitudinale du ménisque médial<br />
qui intéressait le segment postérieur. Quarante-deux sutures ont<br />
été réalisées par arthrotomie postéro-interne, 11 fois une technique<br />
de dedans en dehors a été réalisée et 5 fois le ménisque a été<br />
réparé par une technique arthroscopique tout en dedans. La radiographie<br />
préopératoire retrouvait une atteinte à type de remodelé<br />
interne dans 12 % <strong>des</strong> cas (IKDC B).Tous ont eu une greffe du<br />
LCA sous arthroscopie. L’évaluation <strong>des</strong> résultats a été faite selon<br />
<strong>les</strong> critères cliniques et radiologiques de l’IKDC 2000. La méniscectomie<br />
secondaire a été prise comme critère d’échec et l’évaluation<br />
radiologique (radiographie en schuss) a été faite sur le<br />
bilan radiographique réalisé avant la méniscectomie secondaire.<br />
Le seuil de significativité de l’évaluation statistique retenu a été<br />
de 0,05.<br />
RÉSULTATS. Au recul moyen de 11 ans (24 à 248 mois), le<br />
score IKDC subjectif moyen est de 81 points. Cliniquement, <strong>les</strong><br />
patients sont cotés IKDC A : 48 %, B : 45 %, C : 7 %. La différentielle<br />
manuelle maximale est de : 1,6 + 1 mm. Le taux de<br />
méniscectomie secondaire est de 36 % avec un délai moyen de<br />
6 ans (19-170 mois). El<strong>les</strong> sont toutes survenues après deux ans<br />
d’évolution. L’étude de la courbe de survie de la suture du<br />
ménisque médial montre que 2 ans après la réalisation de la<br />
suture, 94 % <strong>des</strong> ménisques médiaux sont toujours en place. À<br />
10 ans et 15 ans, la probabilité est respectivement de 68 % et<br />
60 % chez <strong>des</strong> patients qui ont conservé une activité sportive.<br />
L’échec de la suture médiale est corrélé avec la taille de la lésion<br />
méniscale (p = 0,031). Radiologiquement, il y avait 6,8 % de<br />
patients classés C et 1,7 % classés D soit un pincement de<br />
l’interligne médial dans moins de 10 % <strong>des</strong> cas. 65,5 % étaient<br />
cotés A et 26 % cotés B.<br />
CONCLUSION. La réparation du ménisque médial associée à<br />
la plastie intra-articulaires du ligament croisé antérieur pour<br />
laxité antérieure chronique évoluée donne de bons résultats à<br />
plus de 10 ans de recul sur l’évolution arthrosique avec moins de<br />
10 % de pincement.<br />
* Roméo Ménard, Département d’Orthopédie,<br />
CHU de Caen, avenue Côte-de-Nacre, 14033 Caen Cedex.<br />
39 Validation d’un système de navigation<br />
sans image pour la ligamentoplastie<br />
du ligament croisé antérieur<br />
Jean-Yves JENNY *, Ludovic SCHNEIDER,<br />
Michel DUPUIS, Cyril BOÉRI<br />
INTRODUCTION. La principale cause d’échec <strong>des</strong> plasties<br />
du ligament croisé antérieur (LCA) est le mauvais positionnement<br />
du transplant. Les systèmes de navigation pourraient permettre<br />
d’éviter de tel<strong>les</strong> erreurs.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Les auteurs utilisent un système<br />
de navigation sans image. Des viseurs navigués permettent de
3S50 81 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
simuler la position <strong>des</strong> tunnels tibial et fémoral. Une broche est<br />
ensuite mise en place sous contrôle du système, puis le tunnel est<br />
foré de façon conventionnelle. Quarante patients ont été opérés<br />
par un transplant libre de ligament patellaire avec un tunnel<br />
fémoral transfixiant foré de dehors en dedans. La position <strong>des</strong><br />
broches-gui<strong>des</strong> par rapport aux repères osseux conventionnels a<br />
été enregistrée par le système. Cette position a été comparée à<br />
celle mesurée sur <strong>les</strong> radiographies postopératoires de face et de<br />
profil et sur un scanner postopératoire, technique considérée<br />
comme référence. Les résultats ont été analysés par comparaison<br />
appariée par un test de Student et le calcul du coefficient de corrélation<br />
avec un seuil de 5 %.<br />
RÉSULTATS. 1) Position médiolatérale du tunnel tibial : il<br />
existait une différence significative entre <strong>les</strong> positions mesurées<br />
par le système de navigation et sur <strong>les</strong> radiographies (p = 0,008).<br />
Toutefois, il existait une bonne corrélation entre ces deux mesures<br />
(p = 0,05). Il n’existait pas de différence significative entre <strong>les</strong><br />
positions mesurées par le système de navigation et le scanner.<br />
2) Position antéropostérieure du tunnel tibial : il n’existait pas de<br />
différence significative entre <strong>les</strong> positions mesurées par le système<br />
de navigation et sur <strong>les</strong> radiographies. Il n’existait pas de<br />
différence significative entre <strong>les</strong> positions mesurées par le système<br />
de navigation et le scanner. 3) Position antéropostérieure du<br />
tunnel fémoral : il n’existait pas de différence significative entre<br />
<strong>les</strong> positions mesurées par le système de navigation et sur <strong>les</strong><br />
radiographies. Il n’existait pas de différence significative entre <strong>les</strong><br />
positions mesurées par le système de navigation et le scanner.<br />
DISCUSSION. Le système de navigation utilisé pourrait<br />
effectivement améliorer la précision du placement <strong>des</strong> tunnels<br />
osseux lors d’une plastie du LCA. La précision du logiciel<br />
encore expérimental est satisfaisante. Le positionnement antéropostérieur<br />
<strong>des</strong> tunnels fémoral et tibial est défini de façon exacte<br />
par rapport à la référence scanographique. Cette étude confirme<br />
également que la mesure du positionnement du transplant<br />
par radiographies standards est entachée d’erreurs parfois importantes.<br />
CONCLUSION. La navigation lors d’une plastie du LCA<br />
pourrait permettre d’améliorer le positionnement du transplant.<br />
* Jean-Yves Jenny, C.T.O., 10 avenue Baumann, 67400 Illkirch.<br />
40 Arthrolyse arthroscopique après<br />
plastie du ligament croisé antérieur<br />
Philippe LANDREAU, Brice ILHARREBORDE<br />
INTRODUCTION. La reconstruction arthroscopique du ligament<br />
croisé antérieur (LCA) est une technique aujourd’hui bien<br />
maîtrisée, même si le type de greffe à utiliser reste controversé.<br />
La raideur postopératoire est une complication fréquente de cette<br />
intervention. Elle peut entraîner un retentissement fonctionnel<br />
majeur, parfois plus important que la gêne préopératoire. Le but<br />
de cette étude est de décrire la technique chirurgicale de l’arthrolyse<br />
arthroscopique, et de proposer une conduite thérapeutique<br />
face aux divers tableaux cliniques rencontrés.<br />
MÉTHODES. Étude rétrospective de 15 cas consécutifs<br />
d’arthrolyses sous arthroscopie effectuées pour <strong>des</strong> raideurs<br />
développées à distance d’une ligamentoplastie du LCA. Le recul<br />
moyen est de 29 mois.<br />
RÉSULTATS. Trois groupes de patients ont été identifiés, en<br />
fonction de l’examen clinique préopératoire et <strong>des</strong> découvertes<br />
peropératoires: syndrome du cyclope (groupe 1), fibrose antérieure<br />
(groupe 2) et fibrose généralisée (groupe 3). Les gains<br />
moyens de mobilité étaient 13,5° dans le groupe 1, 32,5° dans le<br />
groupe 2 et 36° dans le groupe 3, avec un f<strong>les</strong>sum résiduel inférieur<br />
à 5° dans tous <strong>les</strong> cas. Les scores objectifs IKDC ont été<br />
améliorés dans tous <strong>les</strong> cas, autorisant tous <strong>les</strong> patients sauf un à<br />
repratiquer leur sport habituel. Aucune déstabilisation secondaire<br />
n’est survenue et un hématome superficiel a été rapporté.<br />
DISCUSSION. Notre classification est la seule décrite dans la<br />
littérature permettant d’analyser <strong>les</strong> raideurs après ligamentoplasties.<br />
Basée sur la clinique et <strong>les</strong> constatations peropératoires,<br />
elle doit permettre d’établir une stratégie thérapeutique adaptée.<br />
L’arthrolyse arthroscopique a permis d’obtenir <strong>des</strong> gains de<br />
mobilités similaires à ceux obtenus habituellement avec la chirurgie<br />
à ciel ouvert, et ce au prix d’une faible morbidité, sans<br />
jamais avoir eu recourt à un abord du compartiment postérieur.<br />
CONCLUSION. L’arthroscopie est un outil essentiel dans <strong>les</strong><br />
raideurs consécutives aux ligamentoplasties du LCA, permettant<br />
un bilan lésionnel précis et une arthrolyse efficace. Un traitement<br />
chirurgical précoce peut être proposé dès le troisième mois postopératoire<br />
en cas de cyclope, tandis que la période optimale<br />
pour réaliser l’arthrolyse dans <strong>les</strong> groupes 2 et 3 est comprise<br />
entre <strong>les</strong> troisième et sixième mois postopératoires.<br />
* Philippe Landreau, Centre Médico-Chirurgical Paris V,<br />
36, boulevard Saint-Marcel, 75005 Paris.<br />
41 Influence du type de laxité sur <strong>les</strong><br />
résultats <strong>des</strong> laxités postérieures<br />
chroniques opérées par ligamentoplastie<br />
à double faisceaux sous<br />
arthroscopie<br />
Anthony WAJSFISZ *, Pascal CHRISTEL,<br />
Patrick DJIAN<br />
INTRODUCTION. Il s’agit d’une étude prospective et continue<br />
de 42 laxités postérieures chroniques opérées entre 1995 et<br />
2000. L’objectif principal était d’évaluer l’efficacité du traitement<br />
chirurgical sur ces laxités en fonction du type de laxité.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. La série est composée de<br />
32 hommes et 10 femmes âgées de 29 ans en moyenne. L’examen<br />
clinique préopératoire a dénombré 16 laxités postérieures<br />
directes (LPD), 23 laxités postéro-postéro-latéra<strong>les</strong> (LPPL) et 3<br />
laxités postéro-postéro-média<strong>les</strong> (LPPM). Le LCP a toujours été<br />
reconstruit par arthroscopie avec une autogreffe à deux faisceaux.<br />
Les composantes périphériques ont toujours été traités.<br />
Les résultats ont été évalués avec le score IKDC et la laxité pos-
térieure mesurée par <strong>des</strong> clichés radiographiques sous contrainte<br />
(clichés Télos et contraction <strong>des</strong> ischio-jambiers (CIJ)).<br />
RÉSULTATS. Le recul moyen est de 22 mois. L’évaluation<br />
subjective, pour <strong>les</strong> LPD, est passé de 55,6 à 72,8 ; pour <strong>les</strong><br />
LPPL, de 54,4 à 62,4 et pour <strong>les</strong> LPPM de 60 à 86,2. Ces résultats<br />
sont significativement meilleurs pour <strong>les</strong> LPD comparées au<br />
LPPL (p = 0,001). En préopératoire, le score global IKDC pour<br />
<strong>les</strong> LPD était de 8C/8D et il était de 2A/9B/9C au dernier recul ;<br />
pour <strong>les</strong> LPPL, il progressait de 9C/14D à 2A/9B/11C/1D ; et<br />
pour <strong>les</strong> LPPM, il progressait de 2C/1D à 2B/1C. Enfin, la laxité<br />
pour <strong>les</strong> LPD passait de 4 à 2,1 (gain de 47,5 %) au Télos et de 9<br />
à 5,7 (gain de 39,5 %) au CIJ ; pour <strong>les</strong> LPPL, elle passait de 5,4<br />
à 2,3 (gain de 57,5 %) au Telos et de 9,8 à 2,3 (gain de 49 %) au<br />
CIJ ; pour <strong>les</strong> LPPM, elle passait de 4 à 0,5 (gain de 87 %) au<br />
Télos et de 10 à 5,3 (gain de 47 %) au CIJ. Le gain de laxité était<br />
meilleur (p = 0,002) pour <strong>les</strong> LPPL comparativement au LPD. Il<br />
n’existait pas de corrélation entre le score subjectif et la laxité<br />
mesurée au Télos ou au CIJ.<br />
DISCUSSION. Dans la littérature, on ne met pas en évidence<br />
de différence entre la technique à 1 ou 2 faisceaux, cependant<br />
pour la reconstruction à 2 faisceaux, en plus de donner de bons<br />
résultats cliniques, reproduit également mieux l’anatomie. Ceci<br />
explique sans doute <strong>les</strong> bons résultats radiologiques dans <strong>les</strong><br />
LPPL.<br />
CONCLUSION. Les LPD ont un meilleur résultat clinique<br />
que <strong>les</strong> LPPL, en revanche le résultat anatomique semble<br />
meilleur pour <strong>les</strong> LPPL.<br />
* Anthony Wajsfisz, Clinique Nollet,<br />
23, rue Brochant, 75017 Paris.<br />
42 Chondropathie patellaire sur instabilité<br />
antérieure du genou<br />
Antoine OKSMAN *, Vitali DMYTRUK,<br />
Jérôme PROUST, Christian MABIT,<br />
Jean-Louis CHARISSOUX, Jean-Paul ARNAUD<br />
INTRODUCTION. L’instabilité antérieure du genou entraîne<br />
la survenue de lésions ménisca<strong>les</strong> et fémoro-tibia<strong>les</strong>, mais peut<br />
également entraîner <strong>des</strong> lésions ostéochondra<strong>les</strong> patellaires dont<br />
le démembrement reste au second plan. Le but de ce travail était<br />
d’évaluer la survenue de lésions de chondropathies patellaires<br />
chez <strong>les</strong> patients présentant une rupture du LCA, d’en étudier <strong>les</strong><br />
caractéristiques en fonction du délai de laxité et d’en préciser <strong>les</strong><br />
mécanismes lésionnels.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Nous avons revu de manière<br />
rétrospective 250 dossiers de patients âgés en moyenne de 32 ans,<br />
opérés entre 1995 et 2005 d’une laxité antérieure du genou sous<br />
arthroscopie (photographies arthroscopiques, comptes-rendus<br />
opératoires, et fiches de renseignement arthroscopiques). Les<br />
lésions chondra<strong>les</strong> ont été étudiées selon <strong>les</strong> classifications de<br />
Bauer et Jackson et de l’ICRS (International Cartilage Repair<br />
Society). Les analyses statistiques ont été réalisées au moyen du<br />
test de Kruskal Wallis, et du test exact de Fischer.<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S51<br />
RÉSULTATS. Sur <strong>les</strong> 250 dossiers revus, 72 patients (28,8 %)<br />
présentaient une atteinte chondrale patellaire. Le versant latéral<br />
était touché dans 41 cas (56,9 %). Le niveau de hauteur <strong>des</strong><br />
lésions se situait majoritairement au 1/3 moyen de la rotule. Il<br />
s’agissait de lésions superficiel<strong>les</strong> (stade 1 et 5 de Bauer et Jackson<br />
- grade 1 de l’ICRS) dans 66,6 % <strong>des</strong> cas. Nous avons pu<br />
mettre en évidence une aggravation statistiquement significative<br />
du grade ICRS en fonction de la durée de laxité préopératoire.<br />
DISCUSSION. Peu de publications dans la littérature concernent<br />
l’atteinte patellaire lors de laxité antérieure du genou ;<br />
cependant, nos résultats sont comparab<strong>les</strong> aux rares séries<br />
retrouvées. Ces lésions sont parfois présentes avant le traumatisme<br />
ayant entraîné la rupture du LCA, el<strong>les</strong> surviennent<br />
d’autres fois lors de ce traumatisme, mais peuvent également<br />
être en rapport direct avec la laxité antérieure. Les mécanismes<br />
lésionnels associent <strong>des</strong> facteurs ligamentaires, musculaires, et<br />
proprioceptifs.<br />
CONCLUSION. La présence de lésions patellaires est fréquente<br />
en cas de laxité antérieure (28,8 % dans notre série), et<br />
l’augmentation de durée de laxité est responsable d’une aggravation<br />
statistiquement significative de ces lésions. À l’heure<br />
actuelle, la survenue de ces lésions patellaires est moins évaluée,<br />
restant au second plan par rapport aux lésions ménisca<strong>les</strong> et<br />
fémoro-tibia<strong>les</strong>. Cependant, l’histoire naturelle de la rupture du<br />
LCA évolue vers une atteinte de tous <strong>les</strong> compartiments du<br />
genou, et il parait fondamental de prévenir ces lésions, en stabilisant<br />
<strong>les</strong> genoux présentant une laxité antérieure.<br />
* Antoine Oksman, Service d’Orthopédie, CHU Dupuytren,<br />
2, avenue Martin-Luther-King, 87000 Limoges.<br />
43 Arthrite septique après arthroscopie<br />
du genou : facteurs de risques<br />
et conséquences médico-léga<strong>les</strong><br />
Simon MARMOR *, Thierry FARMAN,<br />
Alain LORTAT-JACOB<br />
INTRODUCTION. L’arthrite septique du genou après arthroscopie<br />
est une complication rare mais redoutée qui engage le<br />
pronostic fonctionnel du patient et la responsabilité du chirurgien.<br />
Nous avons tenté d’analyser <strong>les</strong> facteurs de risques et <strong>les</strong><br />
conséquences médico-léga<strong>les</strong> d’une telle complication.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Vingt-deux cas d’arthrite septique<br />
du genou après arthroscopie ont été expertisés lors d’une<br />
procédure médico-légale. Nous avons étudié dans ces dossiers<br />
<strong>les</strong> facteurs de risques liés aux patients et aux procédures périopératoires,<br />
le type de complication et la qualité de sa prise en<br />
charge, ses conséquences cliniques et médico-léga<strong>les</strong>.<br />
RÉSULTATS. La moitié <strong>des</strong> patients était <strong>des</strong> travailleurs<br />
manuels à genoux et 7 genoux avaient déjà été opérés. Les gestes<br />
réalisés consistaient en 7 ligamentoplasties, 9 ménisectomies,<br />
3 arthroscopies lavage, une arthrolyse, une ablation de chondromes<br />
et une section de plicae. Les signes cliniques d’arthrite septique<br />
survenaient après un intervalle libre médian de 8 jours
3S52 81 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
(0-37 j), deux fois après une hémarthrose et une fois après une<br />
brûlure articulaire. Le délai de prise en charge thérapeutique était<br />
de 4,2 j. Dans 10 cas, le retard thérapeutique dépassait 3 jours.<br />
Sept patients avaient reçu <strong>des</strong> corticoï<strong>des</strong> : 3 injections articulaires<br />
peropératoires, 3 postopératoires et une corticothérapie par<br />
voie orale. 3,5 interventions (1-9) supplémentaires étaient nécessaires<br />
pour traiter l’infection et ses séquel<strong>les</strong>. Deux prothèses<br />
tota<strong>les</strong> du genou ont été implantées. Deux patients seulement<br />
étaient indemnes de séquel<strong>les</strong> fonctionnel<strong>les</strong> et cinq patients<br />
avaient un retentissement professionnel définitif. Les conséquences<br />
médico-léga<strong>les</strong> sont une incapacité permanente partielle de<br />
5 % (0-20 %), une incapacité temporaire totale de 120 jours<br />
(40-790 j) et <strong>des</strong> souffrances endurées à 3/7 (0-4,5).<br />
DISCUSSION. Certains facteurs de risques d’infection articulaire<br />
sont liés aux patients (antécédents, comorbidités, activité<br />
45 Voie d’abord antéro-latérale de<br />
type Watson-Jones modifiée, sans<br />
section musculaire : à propos <strong>des</strong><br />
100 premiers cas<br />
Jürg AEBI *<br />
INTRODUCTION. La voie d’abord antéro-latérale de type<br />
Watson-Jones, modifiée par Rottinger en 2003, permet d’implanter<br />
une prothèse totale de hanche en chirurgie mini-invasive<br />
vraie, c’est-à-dire sans aucune section musculaire.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. D’octobre 2004 à octobre 2005,<br />
100 PTH ont été posées par voie antéro-latérale modifiée de Rottinger.<br />
La série comprenait 57 femmes et 43 hommes, l’âge<br />
moyen était de 72,3 ans (42-85), le score ASA était de 1 pour<br />
13 patients, 2 pour 52 patients et 3 pour 35 patients. Selon la classification<br />
de Charnley, il y avait 24 patients A, 65 B et 11 C et le<br />
IMC moyen était de 28 (20-36). Le diagnostic était dans 83 cas<br />
une coxarthrose primitive, dans 9 une dysplasie, dans 6 une<br />
ostéonécrose (ONA), une post-traumatique et un Paget. Le fémur<br />
était classé selon Dorr en 20 types A, 58 types B et 22 types C.<br />
RÉSULTATS. La durée opératoire moyenne a été de 69 min<br />
(45-110), <strong>les</strong> pertes sanguines s’élèvèrent à 418 ml (218-1091) et<br />
la durée d’hospitalisation fut de 7,1 jours (4-13), avec un retour à<br />
domicile pour 87 % <strong>des</strong> opérés. En peropératoire, 4 complications<br />
ont été relevées : 1 fausse route et 3 fractures sans déplacement<br />
de la pointe du grand trochanter, non ostéosynthésées, sans<br />
conséquence fonctionnelle. Il n’y a eu aucune fracture du fémur.<br />
En postopératoire, une luxation récidivante, par rétroversion de<br />
la cupule, a nécessité une reprise chirurgicale à J 60. Aucune<br />
infection, aucune complication neurologique ou vasculaire en<br />
dehors de 8 phlébites sura<strong>les</strong> n’ont été relevées. Le lever a été<br />
autorisé à J1, la marche sans canne dès le contrôle de l’appui<br />
monopodal, c’est-à-dire entre le 4 e et le 15 e jour dans 80 % <strong>des</strong><br />
Séance du 6 novembre après-midi<br />
HANCHE<br />
professionnelle), d’autres à l’environnement périopératoire<br />
(injections intra-articulaires de corticoï<strong>des</strong>, intervention sous<br />
anticoagulants oraux, liquide d’irrigation chauffé). Une fois<br />
l’infection suspectée, une mauvaise gestion du liquide de ponction<br />
par absence d’analyse bactériologique ou attente <strong>des</strong> résultats<br />
retarde la prise en charge diagnostique ou thérapeutique de<br />
cette complication.<br />
CONCLUSION. La diminution du risque infectieux et de ses<br />
conséquences nécessite <strong>des</strong> actes de prévention primaire par<br />
dépistage <strong>des</strong> facteurs de risque et une prévention secondaire par<br />
l’amélioration de la qualité de prise en charge diagnostique et<br />
thérapeutique de l’infection.<br />
* Simon Marmor, Service d’Orthopédie, Hôpital Ambroise-Paré,<br />
9, avenue Char<strong>les</strong>-de-Gaulle, 92100 Boulogne-Billancourt.<br />
cas. L’analyse radiologique a montré 6 cas d’inclinaison du<br />
cotyle supérieure à 55°, 8 varisations dont 5 sous-dimensionnements<br />
du fémur, tous en début d’expérience.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. La rapidité de la récupération<br />
fonctionnelle, la diminution <strong>des</strong> douleurs, l’absence de<br />
restrictions <strong>des</strong> mouvements, et la satisfaction <strong>des</strong> patients justifient<br />
l’utilisation de cette voie, techniquement difficile. La<br />
courbe d’apprentissage est une réalité, avec 15 % de défauts de<br />
pose, tous au début de l’expérience, qui doit éviter <strong>les</strong> obèses, <strong>les</strong><br />
hommes musclés, <strong>les</strong> coxa vara et <strong>les</strong> séquel<strong>les</strong> post-traumatiques.<br />
Actuellement, 95 % <strong>des</strong> arthroplasties de hanche sont réalisées<br />
par cette voie d’abord dans notre institution.<br />
* Jürg Aebi, Clinique du Pont de Chaume,<br />
330, avenue Marcel-Unal, 82017 Montauban.<br />
46 Voies réduites antéro-latérale et<br />
postérieure pour arthroplastie<br />
totale de hanche : analyse comparative<br />
de la qualité de l’exposition<br />
et du positionnement <strong>des</strong> implants<br />
Jean-Michel LAFFOSSE *, Philippe CHIRON,<br />
Franck ACCADBLED, François MOLINIER,<br />
Hocine BENSAFI, Jean PUGET<br />
INTRODUCTION. Les voies d’abord mini-invasives pour<br />
prothèses tota<strong>les</strong> de hanche (PTH) se développent. Si l’exposition<br />
de l’acétabulum est régulièrement aisée, l’exposition fémorale<br />
est plus difficile, source de complications. Nous avons mené<br />
une étude prospective comparant l’exposition et le positionnement<br />
<strong>des</strong> implants mis en place par une voie postérieure réduite<br />
versus une voie antéro-latérale réduite.
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Nous avons inclus 43 PTH<br />
implantées par voie postérieure réduite (groupe MP) et 33 PTH<br />
par voie antéro-latérale réduite (groupe AL). Les deux groupes<br />
étaient comparab<strong>les</strong> en préopératoire (âge, sexe, IMC, étiologies,<br />
scores de Womac et de PMA). Tous <strong>les</strong> patients ont reçu la<br />
même tige non cimentée et une cupule non cimentée. Les<br />
complications peropératoires ont été dénombrées. Le bilan<br />
radiographique pré et postopératoire a permis d’analyser le positionnement<br />
de la tige de face et de profil, le centrage de la cupule<br />
selon la méthode de Pierchon et Migaud et <strong>les</strong> inégalités de longueur<br />
<strong>des</strong> membres inférieurs (ILMI). Le seuil de significativité<br />
retenu a été p < 0,05.<br />
RÉSULTATS. La durée opératoire était significativement plus<br />
courte dans le groupe MP (p = 0,02). Nous avons recensé dans le<br />
groupe MP une effraction corticale externe, et dans le groupe<br />
AL : 4 fractures du grand trochanter et deux fausses-routes reconnues<br />
et corrigées en peropératoire. Nous n’avons pas retrouvé de<br />
différence significative en termes de centrage de la tige fémorale<br />
dans le plan frontal (p = 0,15) ou sagittal (p = 0,63) ni en termes<br />
de centrage de la cupule (p = 0,39). Les ILMI préopératoires,<br />
postopératoires ainsi que la correction réalisée étaient comparab<strong>les</strong><br />
(respectivement p = 0,18, p = 0,37 et p = 0,21).<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. La voie postérieure minimale<br />
devient un standard. L’incision mesure 8 cm. Seuls <strong>les</strong><br />
musc<strong>les</strong> oblique interne et <strong>les</strong> jumeaux sont sectionnés puis réinsérés.<br />
Le fémur est aisément exposé en flexion-adduction-rotation<br />
interne. La voie antéro-latérale minimale, décrite par Bertin<br />
et Röttinger, utilise l’intervalle inter-musculaire entre tenseur du<br />
fascia lata et moyen fessier. Le fémur est exposé en extensionadduction-rotation<br />
externe nécessitant un positionnement précis<br />
d’écarteurs contre-coudés. Ceci impose une courbe d’apprentissage<br />
pour le chirurgien et son aide pour obtenir une exposition<br />
adéquate et acquérir de nouveaux repères. Le positionnement <strong>des</strong><br />
implants et <strong>les</strong> ILMI sont comparab<strong>les</strong>. Cette voie expose à plus<br />
de complications peropératoires (fausses-routes et fractures du<br />
grand trochanter). Cette technique nous semble fiable mais nos<br />
résultats ainsi que <strong>les</strong> manœuvres nécessaires à l’exposition<br />
imposent la prudence chez <strong>les</strong> sujets ostéoporotiques, très enraidis<br />
ou très musclés.<br />
* Jean-Michel Laffosse, Service de Chirurgie Orthopédique,<br />
CHU Rangueil, 1, avenue Jean-Poulhès, TSA 50032,<br />
31059 Toulouse Cedex 9.<br />
47 Résultats d’une planification préopératoire<br />
tomodensitométrique de<br />
prothèse totale de hanche<br />
Gil<strong>les</strong> PASQUIER *, Gildas DUCHARNE,<br />
Alexandre MOUTTET, Ernesto DURANTE,<br />
Jean PLÉ<br />
INTRODUCTION. La planification radiographique qui utilise<br />
essentiellement le cliché de face ne permet qu’une appréciation<br />
approximative <strong>des</strong> problèmes posés par la mise en place d’une<br />
prothèse totale de hanche (PTH). Réaliser une simulation de la<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S53<br />
situation anatomique à corriger en facilitant le choix <strong>des</strong><br />
implants, de leur position et en prévoyant <strong>les</strong> difficultés de<br />
l’intervention est le but d’une planification 3D permise par <strong>les</strong><br />
techniques d’acquisition actuel<strong>les</strong> de tomodensitométrie (TDM).<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Un protocole de planification<br />
3D TDM a été fait de façon standardisée en pré et en postopératoire<br />
sur 50 patients pour apprécier l’intérêt de cette méthode. À<br />
partir de coupes millimétriques du bassin, de la hanche opérée,<br />
du genou, de scoutview de face et de rpofil <strong>des</strong> 2 membres inférieurs<br />
en extension, une reconstruction dans 3 plans orthogonaux<br />
de référence a été réalisée. Les résultats <strong>des</strong> 2 TDM ont été analysés<br />
et comparés, qu’il s’agisse <strong>des</strong> tail<strong>les</strong> de prothèse, de l’inclinaison<br />
acétabulaire, de l’antéversion acétabulaire et fémorale de<br />
la hanche prothésée. L’inclinaison et l’antéversion acétabulaire<br />
de la hanche contro-latérale ont aussi été relevées. Une appréciation<br />
de la longueur <strong>des</strong> membres inférieurs a été faite sur le scoutview<br />
fait de face et de profil couché. Chez ces 50 patients, une<br />
prothèse totale de hanche de première intention a été mise par<br />
voie postérieure en utilisant la même technique opératoire par un<br />
seul opérateur.<br />
RÉSULTATS. Aucune complication postopératoire n’a été<br />
notée dans cette série. Les mesures TDM sont précises et reproductib<strong>les</strong><br />
avec une faible variation aux mesures successives. Les<br />
valeurs moyennes pré et postopératoires <strong>des</strong> critères mesurés sont<br />
très proches, pourtant une analyse cas par cas entre <strong>les</strong> valeurs<br />
pré et postopératoire montre qu’il existe une grande variation de<br />
posotion opératoire de la cupule dans l’acétabulum. La position<br />
de la prothèse fémorale est moins variable. La planification permet<br />
une bonne appréciation du diamètre acétabulaire, ainsi que<br />
de la taille fémorale, elle anticipe bien <strong>les</strong> caractéristiques propres<br />
du patient au niveau du col fémoral, <strong>des</strong> valeurs d’antéversion<br />
fémora<strong>les</strong> et acétabulaire, elle peut donner une valeur de la<br />
longueur <strong>des</strong> membres inférieurs. Elle permet de facilement choisir<br />
de mettre en place une prothèse fémorale à offset important ou<br />
utiliser un col modulaire comme dans notre expérience. En revanche,<br />
cette planification demande un temps plus important qu’une<br />
planification radiographique.<br />
* Gil<strong>les</strong> Pasquier, 17, boulevard Lacordaire, 59100 Roubaix.<br />
48 Incidence de la fermeture capsulaire<br />
et de la conservation du piriformis<br />
sur le taux de luxation après<br />
arthroplastie totale de hanche par<br />
voie postérieure : série comparative<br />
de 196 patients<br />
François PRIGENT *<br />
INTRODUCTION. Incidence sur la luxation prothétique de<br />
hanche d’une voie postérieure associant fermeture de la capsule<br />
articulaire et conservation du muscle piriformis.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Comparaison de deux séries de<br />
98 prothèses de hanche opérées consécutivement par le même
3S54 81 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
opérateur. La première, prospective, utilise une voie postérieure<br />
qui associe respect du piriformis et fermeture capsulaire. La<br />
deuxième, rétrospective, empreinte la même voie avec résection<br />
capsulaire et section du piriformis réinséré sur le grand trochanter.<br />
Sept critères ont été étudiés : âge, poids, durée opératoire,<br />
intégrité du piriformis et qualité de la fermeture capsulaire en fin<br />
d’intervention (dans la série conservatrice), positionnement<br />
radiologique <strong>des</strong> composants, taux de luxation à douze mois.<br />
RÉSULTATS. Les deux séries étaient identiques quant à l’âge<br />
et au poids <strong>des</strong> patients. La durée opératoire était supérieure de<br />
vingt minutes dans la voie « conservatrice » (84 minutes -<br />
62 minutes). Il n’est retrouvé aucune incidence sur le positionnement<br />
radiologique <strong>des</strong> composants entre <strong>les</strong> deux voies. Absence<br />
d’infection et de migration du matériel prothétique. Le taux de<br />
luxation à 12 mois est significativement amélioré par la fermeture<br />
capsulaire associée au respect du piriformis (2,9 % versus 0 %).<br />
DISCUSSION. La restauration du plan capsulaire a fait<br />
l’objet de nombreux travaux. En 1996, Scott au Current concept,<br />
puis Chiu, dans une étude randomisée, recommandent une suture<br />
capsulaire avec une réduction du taux de luxation allant de 4 à<br />
0 % pour l’un et de 2,3 à 0 % pour le second. Les séries de<br />
Goldstein (2,8-0,6 %) et de Dixon (0,4 % pour 255 hanches)<br />
confirment ces résultats. Toutes ces étu<strong>des</strong> font état d’un taux de<br />
luxation inférieur à 1 %. Au niveau musculaire, le piriformis est<br />
un muscle coapteur de la hanche. Lors de la première étape du<br />
mouvement luxant, la hanche fléchie à 90° et mise en adduction,<br />
celui-ci se tend de prés du quart de sa longueur comme le montre<br />
<strong>les</strong> travaux récents de biomécaniques de Snijders. La sectionréinsertion<br />
du piriformis contrôlée par <strong>des</strong> marqueurs radios opaques<br />
fait apparaître un lâchage <strong>des</strong> sutures dans 90 % <strong>des</strong> cas<br />
selon Stahelin. Dans la série présentée, le tendon piriformis est<br />
laissé intact dans 94 % <strong>des</strong> cas.<br />
CONCLUSION. Cette étude souligne l’intérêt d’associer un<br />
lambeau capsulaire réellement suturable à la préservation du<br />
muscle piriformis pour obtenir un hamac à la fois passif et actif,<br />
dans la partie postéro-supérieure de l’articulation, véritable zone<br />
stratégique à « haut risque de luxation ».<br />
* François Prigent, Service d’Orthopédie,<br />
Hôpital de Meulan, 1, rue du Fort, 78250 Meulan.<br />
49 Apport de la double mobilité en<br />
première intention chez <strong>les</strong><br />
patients à risque de luxation<br />
Olivier GUYEN *, Vincent PIBAROT,<br />
Christophe CHEVILLOTTE, Gualter VAZ,<br />
Jean-Paul CARRET, Jacques BÉJUI-HUGUES<br />
INTRODUCTION. Il est clairement établi que le risque de<br />
luxation après arthroplastie totale de la hanche en première<br />
intention est plus important dans certains groupes de population.<br />
Chez ces patients à risque d’instabilité particulièrement<br />
élevé, l’usage d’implants à double mobilité, réputés plus stab<strong>les</strong>,<br />
est une option souvent choisie. Nous avons cherché à éva-<br />
luer l’efficacité de ces implants dans ces situations à haut risque<br />
de luxation.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Nous rapportons l’étude rétrospective<br />
d’une série de 167 prothèses tota<strong>les</strong> de hanche de première<br />
intention chez 163 patients (99 femmes, 64 hommes) à<br />
haut risque de luxation, opérés entre janvier 2000 et décembre<br />
2003. L’âge moyen à l’intervention était de 72 ans (21 à 97 ans).<br />
Dans tous <strong>les</strong> cas, un implant à double mobilité a été utilisé.<br />
84 % de ces patients présentaient au moins deux facteurs de risque<br />
de luxation identifiés.<br />
RÉSULTATS. Vingt-quatre patients sont décédés au cours du<br />
suivi, sans luxation. Parmi eux, deux patients sont décédés<br />
d’embolie pulmonaire, et un d’infection au niveau du site opératoire.<br />
Dans 21 autres cas, la cause du décès était indépendante de<br />
l’intervention. Pour <strong>les</strong> patients survivants, le recul moyen était<br />
de 40,2 mois. Aucune luxation n’a été observée. Le score de<br />
Harris a progressé de 39,6 à 83,4 (p < 0,05). Six hanches ont dû<br />
être réopérées : une pour échec précoce de la fixation de la<br />
cupule (au 8 e jour postopératoire) en raison d’une fracture traumatique<br />
acétabulaire, une pour une migration de l’implant fémoral<br />
non cimenté, une pour une pseudarthrose du grand trochanter,<br />
une pour une fracture périprothétique fémorale, et deux pour<br />
infection profonde. Aucun <strong>des</strong>cellement aseptique acétabulaire<br />
n’a été observé.<br />
CONCLUSION. Les implants à double mobilité représentent<br />
une option thérapeutique efficace dans le cadre de la chirurgie<br />
prothétique de première intention pour prévenir le risque d’instabilité<br />
dans cette population à haut risque de luxation. Toutefois,<br />
devant l’insuffisance de données concernant l’usure du polyéthylène<br />
de l’insert mobile (en particulier au niveau sa convexité),<br />
l’usage de ces implants en première intention doit rester limité à<br />
cette population de sujets à risque.<br />
* Olivier Guyen, Service de Chirurgie Orthopédique,<br />
Pavillon T, Hôpital Edouard-Herriot, place d’Arsonval,<br />
69437 Lyon Cedex 03.<br />
50 La luxation intraprothétique dans la<br />
double mobilité<br />
Philippe ADAM *, Rémi PHILIPPOT,<br />
Frédéric FARIZON, Michel FESSY<br />
INTRODUCTION. La double mobilité est un système qui a<br />
démontré son efficacité pour traiter et prévenir l’instabilité prothétique.<br />
La survie à 10 ans de la cupule est de 95 % (Aubriot,<br />
Philippot). Un <strong>des</strong> écueils du système est l’issue à long terme de<br />
la tête prothétique en dehors de l’insert en polyéthylène rétentif,<br />
réalisant une luxation dite intraprothétique. Le risque de survenue<br />
d’un tel événement est dans la littérature de 2 % à dix ans<br />
(Philippot).<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Nous disposons de 83 observations<br />
de luxation intraprothétique sur <strong>des</strong> cupu<strong>les</strong> de la série<br />
Novae (Serf). Dans 54 observations, nous disposons de l’entier<br />
dossier médical et <strong>des</strong> pièces explantées. Dans 31 cas, la tige
implantée en regard de la cupule était une tige Pro (Serf) ; dans<br />
23 cas, il s’agit d’une tige PF (Serf) avec une géométrie de col<br />
spécifique. Les pièces explantées ont fait l’objet d’une analyse<br />
macroscopique. Les phénomènes d’usure sont confrontés aux<br />
caractéristiques prothétiques.<br />
RÉSULTATS. L’analyse <strong>des</strong> explants montrait qu’il existait<br />
deux mécanismes d’usure différents qui conduisaient au phénomène<br />
de luxation intraprothétique. Dans 25 cas, il existait une<br />
usure homogène et symétrique du listel de rétentivité sur toute sa<br />
circonférence. Dans 29 cas, il existait, associée à l’usure homogène<br />
une usure asymétrique du listel de rétentivité associant une<br />
dépression polaire supérieure (reproduisant la forme de la tête à<br />
la jonction de la concavité et du rebord plan équatorial du polyéthylène)<br />
et une empreinte angulaire polaire inférieure sur le<br />
rebord plan équatorial, provoquée par le balayage du col. Dans la<br />
série <strong>des</strong> PRO, prédomine le phénomène de l’usure asymétrique<br />
(28/29) alors que dans la série <strong>des</strong> PF prédominent <strong>les</strong> mécanismes<br />
d’usure homogène (22/25).<br />
DISCUSSION L’usure homogène s’explique par l’impingement<br />
(effet came) du col prothétique sur le listel de rétentivité.<br />
Cette usure est favorisée par un mauvais rapport tête col. L’usure<br />
asymétrique est la conséquence d’une subluxation progressive<br />
du polyéthylène, secondaire à <strong>des</strong> mécanismes classiques<br />
d’usure linéaire, sur un polyéthylène basculé par la gravité. Un<br />
petit col prothétique ne s’opposerait pas à la bascule et favoriserait<br />
ainsi cette usure, comme dans la série <strong>des</strong> PRO. C’est donc<br />
le col prothétique et ses caractéristiques (diamètre, forme, rugosité)<br />
qui conditionne le mécanisme d’usure de la rétentivité. Les<br />
auteurs proposent un modèle mathématique pour ces deux phénomènes<br />
différents. Ils proposent <strong>des</strong> options pour retarder la<br />
survenue de ce problème.<br />
* Philippe Adam, Service d’Orthopédie, CHU Bellevue,<br />
cours Pasteur, 42055 Saint-Etienne Cedex 2.<br />
51 Restauration de l’offset fémoral et<br />
fonction clinique<br />
Martin LAVIGNE *, Julien GIRARD,<br />
Pascal-André VENDITTOLI, Alain ROY<br />
INTRODUCTION. La restauration de l’offset fémoral joue<br />
un rôle important dans l’arthroplastie totale de hanche (PTH) en<br />
diminuant <strong>les</strong> forces de stress à la cupule et en augmentant la stabilité.<br />
Après un resurfaçage de hanche (RTH), l’offset fémoral<br />
est généralement réduit à cause du positionnement en valgus de<br />
la pièce fémorale. Le but de cette étude était de comparer <strong>les</strong><br />
fonctions cliniques après PTH et RTH en fonction du degré de<br />
restauration de l’offset fémoral.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Cent-cinquante-six patients âgés<br />
de 23 à 65 ans, atteints de coxarthrose, étaient randomisés dans<br />
2 groupes : PTH ou RTH. Toutes <strong>les</strong> interventions étaient réalisées<br />
par une approche postérieure. Les radiographies standardisées<br />
pré et postopératoires étaient analysées et <strong>les</strong> scores<br />
cliniques, la présence d’une boiterie et/ou d’un signe de Trendelenburg<br />
étaient rapportés.<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S55<br />
RÉSULTATS. Cent quatre patients (51 RTH et 53 PTH)<br />
atteints d’une coxarthrose unilatérale étaient analysés. Les données<br />
radiologiques et démographiques pré-opératoires étaient<br />
identiques. Comparé au côté controlatéral, l’offset fémoral augmentait<br />
de 4,85 mm (DS 3,31) pour <strong>les</strong> PTH et diminuait de<br />
3,42 mm (DS 2,12) pour <strong>les</strong> RTH (p < 0,001). Il n’y avait aucune<br />
différence pour <strong>les</strong> scores cliniques : PMA 17,07 points (DS 0,4)<br />
pour <strong>les</strong> PTH et 17 points (DS 0,35) pour <strong>les</strong> RTH, SF-36<br />
101 points (DS 1,25) pour <strong>les</strong> PTH et 100,7 points (DS 1,14) pour<br />
<strong>les</strong> RTH, WOMAC 11,7 (DS 11,4) pour <strong>les</strong> PTH et 9,2 (15,1) pour<br />
<strong>les</strong> RTH. Il n’y avait aucune différence significative de l’incidence<br />
de la boiterie et du signe de Trendelenburg entre <strong>les</strong> 2 groupes.<br />
DISCUSSION. Nous avons observé une diminution significative<br />
de l’offset fémoral après <strong>les</strong> RTH en raison du positionnement<br />
en valgus de la pièce fémorale. Cependant, cette réduction<br />
ne semble pas affecter la fonction clinique et peut même s’avérer<br />
bénéfique (en terme de longévité de l’implant) en entraînant une<br />
force de compression axiale de la pièce fémorale. Les excellents<br />
scores cliniques rapportés après <strong>les</strong> RTH semblent suggérer que<br />
la restauration de l’offset fémoral n’est pas aussi cruciale que<br />
pour <strong>les</strong> PTH.<br />
* Martin Lavigne, Hôpital Maisonneuve-Rosemont,<br />
boulevard de l’Assomption, H1T 2M4 Montréal,<br />
Québec, Canada.<br />
52 Test du sautillement (hop test) et<br />
de la double marche (step test) :<br />
nouveaux tests fonctionnels évaluant<br />
<strong>les</strong> résultats <strong>des</strong> arthroplasties<br />
tota<strong>les</strong> de hanche<br />
Pascal-André VENDITTOLI *, Martin LAVIGNE,<br />
Véronique GODBOUT, Julien GIRARD<br />
INTRODUCTION. Afin d’évaluer le résultat clinique obtenu<br />
après une arthroplastie totale de hanche, <strong>des</strong> questionnaires<br />
subjectifs et <strong>des</strong> tests cliniques spécifiques sont habituellement utilisés.<br />
L’objectif de cette étude était d’évaluer la valeur de 2 nouveaux<br />
tests cliniques : le test du sautillement (hop test) et de la<br />
double marche (step test).<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Nous avons comparé la performance<br />
au hop test (sauts répétitifs sur une jambe) et step test<br />
(monter sur une marche de 20 pouces) de 3 groupes de patients :<br />
99 PTH hybri<strong>des</strong> (approche antéro-latérale), 50 PTH non-cimentées<br />
avec articulation métal-métal de 28 mm (approche postérieure)<br />
et 50 arthroplasties de resurfaçage métal-métal (approche<br />
postérieure). Les hop et step tests furent supervisés et gradés par<br />
un observateur indépendant. Les scores furent corrélés aux scores<br />
cliniques, à la satisfaction du patient, aux paramètres de<br />
reconstruction biomécanique, aux surfaces de contact, à l’approche<br />
chirurgicale, aux types d’implants et aux données démographiques<br />
et cliniques <strong>des</strong> patients.<br />
RÉSULTATS. Les résultats aux hop et step tests étaient significativement<br />
corrélés (p < 0,005) au SF-36, au WOMAC et à
3S56 81 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
l’échelle de Postel Merle d’Aubigné. Il existait une différence<br />
significative (p < 0,005) entre <strong>les</strong> performances <strong>des</strong> 3 groupes<br />
aux hop et step tests. Les meilleurs résultats étaient obtenus dans<br />
le groupe resurfaçage suivi du groupe PTH métal-métal puis du<br />
groupe PTH hybride. Aucune corrélation n’était trouvée selon le<br />
type de surface, l’offset fémoral et/ou le moment d’abduction.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. Ces 2 tests fonctionnels<br />
simp<strong>les</strong> (hop et step tests) montrent une corrélation significative<br />
avec <strong>les</strong> questionnaires validés. Les hop et step tests peuvent<br />
facilement être intégrés dans une évaluation du résultat clinique.<br />
Cependant, d’autres d’investigations sont nécessaires afin de<br />
déterminer la sensibilité et la spécificité de ces tests. Certains<br />
facteurs semblent favoriser un meilleur résultat clinique tels que<br />
<strong>les</strong> têtes de grand diamètre, l’absence de tige fémorale et une<br />
approche chirurgicale postérieure.<br />
* Pascal-André Vendittoli, Hôpital Maisonneuve-Rosemont,<br />
boulevard de l’Assomption, H1T 2M4 Montréal,<br />
Québec, Canada.<br />
53 Peut-on associer <strong>des</strong> composants<br />
fémoraux et acétabulaires provenant<br />
de deux fabricants différents ?<br />
Paolo FILIPPINI *, Alexandre POIGNARD,<br />
Gil<strong>les</strong> MATHIEU, Anis CHOUK, Ali DEMOURA,<br />
Philippe HERNIGOU<br />
INTRODUCTION. Même si <strong>les</strong> recommandations habituel<strong>les</strong><br />
sont d’éviter l’association de composants de marques différentes,<br />
certaines circonstances opératoires amènent à choisir cette<br />
situation. Le but de cette étude était d’analyser la fréquence de<br />
cette situation, <strong>les</strong> bénéfices et <strong>les</strong> inconvénients qui peuvent en<br />
découler pour <strong>les</strong> patients et <strong>les</strong> précautions techniques qui doivent<br />
être éventuellement prises dans ces circonstances.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. L’étude rétrospective était effectuée<br />
sur <strong>les</strong> vingt-cinq dernières années d’un Centre Hospitalo-<br />
Universitaire. Parmi <strong>les</strong> 5443 prothèses de hanche de première<br />
54 Procédure d’aide à la prescription<br />
d’HBPM en post-traumatique<br />
Patrick JOUBERT *<br />
INTRODUCTION. Au cours de la préparation d’un séminaire<br />
de FMC sur la prescription d’HBPM en prévention d’accidents<br />
thrombo-emboliques veineux lors d’un traitement orthopédique,<br />
Séance du 6 novembre après-midi<br />
TRAUMATOLOGIE<br />
intention ou de révision, 834 ont associé une cupule et une pièce<br />
fémorale de marque différente. L’étude a recherché <strong>les</strong> raisons de<br />
ce choix, l’évolution de cette pratique au cours du temps. Les<br />
bénéfices de ce choix pour le patient ont été évalués en comparant<br />
l’évolution clinique <strong>des</strong> patients concernés à <strong>des</strong> groupes témoins<br />
où ce choix n’avait pas été effectué. Les inconvénients potentiels<br />
ont été évalués par <strong>les</strong> complications spécifiques qui découlaient<br />
de ce choix : usure du polyéthylène, problème lié à la compatibilité<br />
du cône morse, corrosion liée à différents métaux.<br />
RÉSULTATS. La fréquence de cette pratique augmente au<br />
cours du temps. Elle était en moyenne 4 fois plus fréquente entre<br />
2000 et 2005 qu’entre 1980 et 1985 sur le lieu d’étude. Les raisons<br />
principa<strong>les</strong> de ce choix sont, en fréquence décroissante :<br />
l’augmentation du nombre de reprises partiel<strong>les</strong> gardant l’un <strong>des</strong><br />
composants (37 %), la prévention <strong>des</strong> luxations avec <strong>des</strong> inserts<br />
acétabulaires dédiés à ce choix (35 %), l’abandon de la fabrication<br />
de certains implants par <strong>les</strong> industriels (21 %). Les bénéfices<br />
d’un tel choix apparaissent évidents dans certaines<br />
circonstances : en cas de luxation récidivante, le changement de<br />
cupule seule pour un modèle rétentif ou à double mobilité a significativement<br />
(p < 0,05) mieux prévenu le risque de luxation (récidive<br />
3 %) qu’un changement de l’orientation <strong>des</strong> implants en<br />
gardant <strong>des</strong> composants de même marque (12 %). L’usure du<br />
polyéthylène n’apparaît pas significativement plus rapide à un<br />
recul de cinq ans lorsque la cupule et l’implant fémoral sont de<br />
marque différente. Le taux de réintervention n’est pas significativement<br />
différent lorsque <strong>les</strong> composants sont de marque différente<br />
sur un recul moyen de cinq ans. Le cône morse, en<br />
revanche, est à l’origine de complications (5 désassemblages) si<br />
<strong>les</strong> implants ne sont pas de même marque.<br />
DISCUSSION. Dans <strong>des</strong> circonstances <strong>particulières</strong> (prévention<br />
d’un risque spécifique, reprise difficile, prothèse ancienne,<br />
malade âgé), cette pratique ne semble pas entraîner de complication<br />
anormalement élevée. Une meilleure transparence <strong>des</strong> industriels<br />
sur leurs normes et une moins grande diversité de certaines<br />
norma<strong>les</strong> devraient être bénéfiques pour <strong>les</strong> patients et <strong>les</strong> chirurgiens.<br />
Cette étude confirme <strong>les</strong> données observées en Angleterre<br />
sur <strong>les</strong> prothèses associant <strong>des</strong> composants de marque différente.<br />
* Paolo Filippini, Service de Chirurgie Orthopédique,<br />
Hôpital Henri-Mondor,<br />
51, avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny,<br />
94000 Creteil.<br />
le besoin d’élaboration d’un arbre décisionnel fiable, pratique et<br />
accepté par tous, est apparu. Les facteurs de risque <strong>des</strong> accidents<br />
thrombo-emboliques veineux sont clairement identifiés. En<br />
revanche, très peu d’étu<strong>des</strong> à niveaux de preuves élevés, sur<br />
l’utilisation <strong>des</strong> HBPM en orthopédie existent : une de niveau 2<br />
et l’étude Medenox, dont certains critères sont extrapolab<strong>les</strong> en<br />
orthopédie.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. 1. Les résultats d’un recueil<br />
épidémiologique d’observation du risque aux sports d’hiver,<br />
constituent la base de donnée mondiale la plus complète (plus de
400 000 cas dans la base de données) sur <strong>les</strong> pathologies qui en<br />
découlent. Un recueil de données est réalisé chaque hiver par une<br />
cinquantaine de médecins (30 stations). Depuis 2004, <strong>des</strong> items<br />
sur <strong>les</strong> HBPM ont été ajoutés et permettent d’analyser nos prescriptions<br />
d’HBPM. 2. Deux cessions de formation sur <strong>les</strong> HBPM<br />
ont été réalisées en 2004 (60 participants). Quatre arbres décisionnels,<br />
fruits du travail et de l’acceptation de chacun <strong>des</strong> participants,<br />
ont été élaborés en sous-groupes à partir d’un arbre test.<br />
Le vote (méthode Delphy) <strong>des</strong> participants a permis de définir un<br />
arbre décisionnel commun.<br />
RÉSULTATS. 1. Dans 19 % <strong>des</strong> cas, <strong>les</strong> médecins du réseau<br />
prescrivent <strong>des</strong> HBPM aux traumatisés du membre inférieur.<br />
81 % <strong>des</strong> prescriptions d’HBPM sont associées à un facteur de<br />
risque de TVP. 65 % <strong>des</strong> prescriptions d’HBPM concernent <strong>les</strong><br />
femmes. La répartition <strong>des</strong> prescriptions d’HBPM par localisation<br />
<strong>des</strong> lésions était 67 % d’entorses et 30 % de fractures. 2. La<br />
réalisation d’un outil d’aide à la décision de prescription<br />
d’HBPM, fondé sur <strong>les</strong> données scientifiques actuel<strong>les</strong> et l’EBM<br />
n’isole, ni ne privilégie aucune problématique, mais <strong>les</strong> regroupe<br />
et <strong>les</strong> hiérarchise. Le schéma retenu s’intéresse d’abord à l’analyse<br />
de la situation et prend ensuite en compte <strong>les</strong> facteurs de risque<br />
avant la décision finale.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. La procédure d’élaboration<br />
de cet arbre décisionnel a été validée par le comité de pilotage<br />
du Renau, d’autres évaluations sont en cours. Elle permettra<br />
d’aider à définir un traitement chirurgical, orthopédique ou fonctionnel<br />
de la lésion. Il conviendra d’évaluer l’influence de la<br />
connaissance de cette procédure sur la façon de prescrire <strong>les</strong><br />
HBPM par <strong>les</strong> médecins du réseau épidémiologique.<br />
* Patrick Joubert, Centre Médical, Le Forum, 74300 Flaine.<br />
55 Fractures de jambe sur <strong>les</strong> pistes<br />
de ski : influence de l’âge et du<br />
niveau<br />
Jean-Dominique LAPORTE *<br />
INTRODUCTION ET OBJECTIF. Un recueil épidémiologique<br />
d’observation du risque aux sports d’hiver a constaté un taux<br />
plus élevé de fracture de jambe lors de la pratique du miniski.<br />
Une étude épidémiologique spécifique a été conduite par ce<br />
réseau dans 3 stations de ski françaises de 1998 à 2004. Le but<br />
de ce travail était de vérifier l’hypothèse que l’âge et l’expérience<br />
ont une influence significative sur l’incidence du risque et<br />
en particulier sur le risque de fracture de jambe.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Les informations médica<strong>les</strong><br />
recueillies par <strong>les</strong> médecins du réseau ont été compilées avec <strong>les</strong><br />
informations démographiques et personnel<strong>les</strong> <strong>des</strong> skieurs b<strong>les</strong>sés,<br />
ainsi que <strong>des</strong> éléments concernant l’équipement. La population<br />
soumise au risque pour chaque sport a été étudiée sur un<br />
échantillon témoin, déterminé par randomisation au pied <strong>des</strong> pistes.<br />
Les résultats ont été comparés à une étude américaine réalisée<br />
dans la station du Vermont, menée dans <strong>les</strong> mêmes<br />
conditions. Les résultats s’apprécient en MDBI (Mean Days<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S57<br />
Between Injuries) qui mesure le risque en taux d’incidence, soit<br />
le nombre de jours de ski entre 2 accidents.<br />
RÉSULTATS. En 7 ans, on n’a observé aucune modification<br />
significative sur la répartition <strong>des</strong> lésions. Les principa<strong>les</strong> pathologies<br />
rencontrées en miniski étaient <strong>les</strong> fractures de jambe et <strong>les</strong><br />
lésions de l’épaule. Les fractures de poignet et lésions de l’épaule<br />
caractérisaient <strong>les</strong> accidents en snowboard et <strong>les</strong> entorses du<br />
genou représentaient près d’1/3 <strong>des</strong> lésions en ski alpin. Dans<br />
tous <strong>les</strong> sports, <strong>les</strong> débutants avaient un taux de risque d’accidents<br />
significativement plus élevé que <strong>les</strong> autres niveaux de pratique.<br />
Le taux de fracture de jambe a été 3 à 4 fois supérieur en miniski<br />
qu’en ski alpin. Pourtant, le taux de fracture de jambe était<br />
approximativement le même chez <strong>les</strong> débutants en miniski et en<br />
ski alpin et le taux de fractures du tibia chez <strong>les</strong> skieurs et miniskieurs<br />
de moins de 16 ans était pratiquement le même.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. Ces résultats démontrent<br />
que pour ce type de lésion <strong>les</strong> taux sont significativement différents<br />
en fonction <strong>des</strong> sports étudiés. Les facteurs « âge » et<br />
« niveau de pratique » sont susceptib<strong>les</strong> d’expliquer une grande<br />
partie de ces différences.<br />
* Jean-Dominique Laporte, Groupe Médical <strong>des</strong> Peric,<br />
8, avenue de Balcère, 66210 Les Ang<strong>les</strong>.<br />
56 Évolution <strong>des</strong> entorses du genou<br />
en ski alpin et réglage <strong>des</strong> fixations<br />
Jean-Dominique LAPORTE *<br />
INTRODUCTION ET OBJECTIF. Les résultats d’un recueil<br />
épidémiologique d’observation du risque aux sports d’hiver<br />
constituent la base de donnée mondiale la plus complète (plus de<br />
400 000 cas dans la base de données à ce jour) sur <strong>les</strong> pathologies<br />
<strong>des</strong> sports d’hiver. Ces résultats sont significatifs dans la<br />
mesure ou une comparaison avec un groupe témoin est possible.<br />
Cela autorise leur utilisation pour orienter <strong>les</strong> campagnes de prévention<br />
et mesurer l’impact <strong>des</strong> actions précédentes. L’évolution<br />
entorses du genou en ski alpin est observée par ce réseau depuis<br />
1998.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Un recueil réalisé par 50 médecins<br />
(dans 30 stations), combiné à l’étude d’une population<br />
témoin permet de dégager chaque saison l’évolution de certains<br />
marqueurs déterminés (type de lésions, gravité, répartition par<br />
sports, âge...). Les résultats s’apprécient en MDBI (Mean Days<br />
Between Injuries) qui mesure le risque en taux d’incidence, soit<br />
le nombre de jours de ski entre 2 accidents.<br />
RÉSULTATS. De 1990 à 2000, on a observé une nette augmentation<br />
<strong>des</strong> entorses du genou en ski alpin. On a constaté que<br />
<strong>les</strong> femmes de plus de 25 ans sont 3,5 fois plus touchées que <strong>les</strong><br />
hommes et cette pathologie a concerné tous <strong>les</strong> niveaux de pratique.<br />
L’hiver dernier, 5,9 millions de skieurs ont engendré près de<br />
109 000 accidents, dont 31 482 entorses du genou et 15 198 ruptures<br />
du LCA.<br />
DISCUSSION. En 2000, une expérimentation française <strong>des</strong><br />
normes de réglage se met en place : elle différencie <strong>les</strong> hommes
3S58 81 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
<strong>des</strong> femmes et prend en compte « <strong>les</strong> petits poids ». La même<br />
année, <strong>les</strong> autorités françaises informent le public de ce problème<br />
de santé public et engagent une campagne de prévention<br />
(spots télévisés et cinématographiques, messages radiophoniques,<br />
édition de brochures...) avec un message simple : « faites<br />
régulièrement régler vos fixations chez un professionnel ». Cette<br />
campagne informe également <strong>les</strong> professionnels du ski et <strong>les</strong><br />
incite à appliquer cette norme par l’envoi de tableaux de réglages<br />
simplifiés.<br />
CONCLUSION. Après 4 années de campagne, la communication<br />
a permis de casser l’augmentation du risque de rupture de<br />
LCA depuis 1992, surtout pendant <strong>les</strong> années de campagne télévisée.<br />
On observe aujourd’hui une stabilisation <strong>des</strong> entorses graves<br />
du genou et une franche diminution <strong>des</strong> entorses du genou.<br />
Parallèlement, on note que <strong>les</strong> skieurs ont pris l’habitude de faire<br />
régler régulièrement leurs fixations. Enfin, même si <strong>les</strong> réglages<br />
très éloignés de la norme sont à présent pratiquement inexistants,<br />
on constate que <strong>les</strong> professionnels du ski n’appliquent que très<br />
peu la norme.<br />
* Jean-Dominique Laporte, Groupe Médical <strong>des</strong> Peric,<br />
8, avenue de Balcère, 66210 Les Ang<strong>les</strong>.<br />
57 Diagnostic de la fracture du processus<br />
coracoïde dans un cabinet<br />
de médecin de montagne : à propos<br />
de 7 cas<br />
Gil<strong>les</strong> MUGNIER *<br />
INTRODUCTION. L’objectif de ce travail était de présenter<br />
le retour d’expérience diagnostique d’un médecin de montagne,<br />
dans la prise en charge en urgence <strong>des</strong> fractures du processus<br />
coracoïde pendant une période de 26 mois.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. La série comportait 7 cas consécutifs<br />
(4 hommes et 3 femmes), âgés en moyenne de 27 ans et<br />
1 mois (extrêmes de 13 à 59 ans), parmi 642 patients ayant consulté<br />
en urgence depuis janvier 2004 pour un traumatisme scapulaire,<br />
dont 161 pour une lésion acromio-claviculaire et 136 pour<br />
une luxation gléno-humérale.<br />
RÉSULTATS. L’étiologie a été un accident sportif dans tous<br />
<strong>les</strong> cas, dont surf <strong>des</strong> neiges (2 fois), ski alpin (3 fois) et VTT<br />
(2 fois). Le mécanisme comportait 6 fois une chute sur le moignon<br />
de l’épaule, et une fois un traumatisme latéral (collision).<br />
Le délai de consultation a été inférieur à 4 heures dans 5 cas, et à<br />
J+1 dans 2 cas. Tous <strong>les</strong> b<strong>les</strong>sés présentaient une douleur à la<br />
palpation du processus coracoïde, mais seulement 3 sur 7 au testing<br />
en antépulsion-supination contrariée. Le diagnostic a été<br />
posé dans tous <strong>les</strong> cas sur au moins une <strong>des</strong> incidences standard<br />
(face, Lamy, associées soit à l’incidence de la sieste dans le<br />
cadre de la pathologie acromio-claviculaire, soit à l’incidence de<br />
Garth dans le cadre de la luxation gléno-humérale) et confirmé<br />
systématiquement sur le profil axillaire qui permet en outre<br />
d’apprécier la localisation et le déplacement présent 5 fois sur 7.<br />
Selon la classification de Saragaglia, nous avons retrouvé<br />
3 décollements épiphysaires chez <strong>des</strong> jeunes de 13 à 16 ans,<br />
1 atteinte de la base, 1 fracture de la portion horizontale et 2 fractures<br />
avulsions de la pointe. En ce qui concerne <strong>les</strong> associations<br />
lésionnel<strong>les</strong>, nous notons 2 fractures non déplacées de la glène<br />
confirmées par le scanner, 3 entorses acromio-claviculaires<br />
(1 stade I, 2 sta<strong>des</strong> II), sans corrélation avec la localisation fracturaire.<br />
Cette lésion survient donc dans 1,5 % <strong>des</strong> épau<strong>les</strong> de<br />
passage et dans quasiment 2 % <strong>des</strong> atteintes acromio-claviculaires<br />
prises en charge en urgence.<br />
CONCLUSION. La fracture du processus est une lésion rare<br />
(1 % <strong>des</strong> traumatismes de l’épaule), mais non exceptionnelle<br />
dans la pratique de la médecine de montagne, d’autant plus qu’il<br />
existe une pathologie de luxation gléno-humérale ou de lésion<br />
acromio-claviculaire. Le diagnostic systématiquement évoqué<br />
devant tout traumatisme de l’épaule par la palpation du processus<br />
coracoïde, est aisément confirmé par l’incidence radiographique<br />
du profil axillaire.<br />
* Gil<strong>les</strong> Mugnier, Cabinet Médical Le Bennevy, 74260 Les Gets.<br />
58 Traitement du doigt en maillet par<br />
orthèse collée : étude rétrospective<br />
de 270 cas<br />
Sybille FACCA *, Oliver KÖRTING,<br />
Stéphanie GOUZOU, Benoit SCHENCK,<br />
Jean NONNENMACHER, Philippe LIVERNEAUX<br />
INTRODUCTION. Le doigt en maillet est une pathologie fréquente<br />
qui semble simple à traiter. Toutefois, <strong>les</strong> résultats objectifs<br />
ne sont pas toujours bons. En effet, la multiplicité <strong>des</strong><br />
techniques et <strong>des</strong> protoco<strong>les</strong> thérapeutiques utilisés témoignent<br />
de la difficulté de cette prise en charge. Ainsi, le but de ce travail<br />
était d’évaluer l’intérêt de la technique de l’orthèse dorsale collée,<br />
utilisée depuis 19 ans dans notre service.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Nous avons revu <strong>les</strong> dossiers de<br />
265 patients avec un total de 270 doigts en maillet suivis dans<br />
notre service entre janvier 2003 et décembre 2005. L’âge moyen<br />
était 42 ans, avec 47 % de femmes, et 58 % de côtés droits. Cent<br />
dix-sept étaient <strong>des</strong> doigts en maillet osseux et dans ce cas le<br />
doigt le plus atteint était l’auriculaire. Le reste, soit 153, correspondaient<br />
à <strong>des</strong> atteintes tendineuses, et dans ce cas le doigt le<br />
plus atteint était le majeur. Le mécanisme vulnérant comprenait<br />
<strong>des</strong> chutes, <strong>des</strong> chocs directs, <strong>des</strong> écrasements, <strong>des</strong> accidents de<br />
sports de ballon, de réfection de lit, <strong>des</strong> accidents de travail. Une<br />
orthèse dorsale thermoformée était maintenue en proximal sur la<br />
deuxième phalange par sa forme en anneau, et en distal sur la<br />
troisième phalange par collage sur la tablette unguéale. Un suivi<br />
régulier de 3,5 consultations en moyenne a permis d’une part de<br />
vérifier l’absence de décollement et d’autre part la bonne tolérance<br />
de l’orthèse. Cette dernière était mise en place en moyenne<br />
pour 8 semaines.<br />
RÉSULTATS. Avec un recul moyen de 18 mois, il n’y avait<br />
pas de déficit d’extension dans 86 % <strong>des</strong> cas. Dans <strong>les</strong> 14 % restant<br />
persistait un défaut d’extension de 17° en moyenne. Les
complications, toutes transitoires, de l’ordre de 5 % <strong>des</strong> cas,<br />
comprenaient quelques cols de cygne régressifs sous appareillage<br />
secondaire, dystrophies unguéa<strong>les</strong>, raideurs de l’interphalangienne<br />
distale. À noter aucun syndrome douloureux<br />
régional complexe de type 1.<br />
CONCLUSION. Notre série démontre que l’utilisation d’une<br />
orthèse dorsale collée est aussi efficace dans le traitement <strong>des</strong><br />
doigts en maillet tendineux qu’osseux. Le traitement chirurgical<br />
a pour nous <strong>des</strong> indications limitées à la subluxation irréductible<br />
après tentative d’orthèse. Par rapport aux autres techniques<br />
orthopédiques, l’orthèse dorsale collée présente 3 avantages<br />
supplémentaires : elle laisse la pulpe utile, permet la mobilisation<br />
de l’interphalangienne proximale, et sa bonne observance.<br />
* Sybille Facca, SOS-Mains Strasbourg-Sud, CTO,<br />
10, avenue Achille-Baumann, 67403 Illkirch.<br />
59 Entorse grave du pouce : opérer<br />
selon la position <strong>des</strong> sésamoï<strong>des</strong><br />
lors <strong>des</strong> clichés en stress<br />
Séverin ROCHET *, David GALLINET,<br />
Laurent OBERT, Daniel LEPAGE,<br />
Patrick GARBUIO, Yves TROPET<br />
INTRODUCTION. L’entorse grave ulnaire du pouce est<br />
devenu une lésion fréquente. Son traitement chirurgical par reinsertion<br />
aux moyens d’ancres est classique, en revanche, il est difficile<br />
parfois de différencier une entorse grave d’une entorse<br />
moyenne qui pourrait être traité orthopédiquement. Rotella et<br />
Urpi ont proposé une nouvelle méthode de diagnostic en montrant<br />
que la perte du parrallèlisme de la ligne <strong>des</strong> sésamoi<strong>des</strong> par<br />
rapport à la tangente à la tête métacarpienne signifiait une lésion<br />
du faisceau principal associée à une lésion du faisceau accessoire.<br />
Partant du principe que l’indication opératoire de ces<br />
entorses est la possible présence d’une lésion de Stener qui<br />
empeche toute cicatrisation, nous avons voulu confirmer l’étude<br />
de Rotella et Urpi et vérifier si toutes <strong>les</strong> lésions de Stener pouvaient<br />
être diagnostiquées par cette méthode.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Quatre-vingt-treize dossiers de<br />
patients opérés dans le service entre 1999 et 2004 ont ainsi été<br />
revus avec calcul <strong>des</strong> angulations sur <strong>les</strong> clichés en stress et<br />
recherche d’une perte du parrallélisme <strong>des</strong> sésamoi<strong>des</strong> par rapport<br />
à la tête du métacarpien. Une dissection sur cadavres a été<br />
également réalisée avec analyse de l’évolution de la ligne <strong>des</strong><br />
sésamoï<strong>des</strong> selon <strong>les</strong> ligaments que nous avons séctionnés.<br />
RÉSULTATS. Les résultats nous ont permis de confirmer <strong>les</strong><br />
travaux de Rotella et Urpi. Les 23 patients qui avaient un effet<br />
Stener en peropératoire avaient tous une perte du parrallélisme<br />
<strong>des</strong> sésamoï<strong>des</strong> par rapport à la tangente à la tête du premier<br />
métacarpien.<br />
DISCUSSION. Nous pensons donc que cette méthode diagnostique<br />
peut être utilisé pour poser l’indication opératoire<br />
puisqu’en opérant seulement <strong>les</strong> patients dont <strong>les</strong> sésamoï<strong>des</strong><br />
suivent la première phalange lors <strong>des</strong> clichés en stress nous som-<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S59<br />
mes à priori certain d’opérer toutes <strong>les</strong> lésions de Stener et tous<br />
<strong>les</strong> patients ayant une lésion <strong>des</strong> deux faisceaux. En utilisant<br />
cette méthode diagnostique, nous n’aurions opérés que 50 % de<br />
nos patients. Cette étude doit évidemment être confirmé par une<br />
nouvelle étude prospective en évaluant à long terme deux groupes<br />
de patients ayant une instabilité mais chez qui la ligne <strong>des</strong><br />
sésamoï<strong>des</strong> reste parrallèle à la tête du métacarpien sur <strong>les</strong> clichés<br />
en stress. Un groupe serait opéré et l’autre serait traité<br />
orthopédiquement afin de s’assurer que chez ces patients le traitement<br />
orthopédique donne le même résultat que le traitement<br />
chirurgical.<br />
* Séverin Rochet, Service de Chirurgie Orthopédique<br />
et Traumatologique, CHU Jean-Minjoz,<br />
2, boulevard Fleming, 25000 Besançon.<br />
60 Intérêt de l’échographie dans la<br />
prise en charge <strong>des</strong> plaies de main<br />
palmaires<br />
Marc SOUBEYRAND *, Geoffroy NOURISSAT,<br />
Christian DUMONTIER, Nabil JOOMAH,<br />
Clément PRADEL, Levon DOURSOUNIAN<br />
Les plaies de main de la face palmaire de la paume et <strong>des</strong><br />
doigts sont à haut risque de lésion neurologique, vasculaire, tendineuse<br />
(fléchisseurs) et <strong>des</strong> gaines. A contrario, la fréquence<br />
<strong>des</strong> plaies dites « blanches » est élevée. L’échographie permet<br />
une étude de grande qualité en termes de résolution spatiale,<br />
d’informativité fonctionnelle (Doppler) et dynamique. La prise<br />
en charge d’une plaie de main, même « blanche » a un coût.<br />
Aucune étude n’a étudié l’intérêt de l’échographie dans le cadre<br />
<strong>des</strong> plaies de main. L’objectif de notre étude était de définir<br />
l’aptitude de l’échographie à réaliser un bilan lésionnel dans ce<br />
contexte, et sa capacité à sélectionner <strong>les</strong> patients nécessitant un<br />
passage au bloc opératoire.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Trente plaies de mains (20 paumes<br />
et 10 doigts). Ont été explorés : 59 tendons fléchisseurs et<br />
leurs gaines, 61 branches artériel<strong>les</strong> et 62 nerfs. Il s’agissait<br />
d’une étude prospective en double aveugle, continue sur une<br />
période de 3 mois. Chaque plaie de main était passée à l’échographie<br />
(le radiologue ignorait le résultat de l’exploration chirurgicale)<br />
puis explorée au bloc opératoire (le chirurgien ignorait<br />
<strong>les</strong> conclusions de l’échographie).<br />
RÉSULTATS. L’échographie peut dans certains cas affirmer<br />
l’inutilité de l’exploration chirurgicale, ou dans d’autres cas son<br />
caractère indispensable. Les nerfs sont <strong>les</strong> structures <strong>les</strong> plus diffici<strong>les</strong><br />
à explorer mais <strong>les</strong> progrès à venir de l’échographie<br />
devraient lever cette limite. Enfin, aucune erreur diagnostique<br />
n’a été commise pour le bilan lésionnels <strong>des</strong> fléchisseurs, et très<br />
peu d’erreurs ont été commises pour le bilan artériel (spécificité<br />
et valeur prédictive positive = 100 %, Sensibilité = 83,3 %).<br />
Enfin, le dépistage de corps étrangers s’est avérée précieuse.<br />
CONCLUSION. L’échographie s’annonce comme un outil<br />
indispensable en chirurgie de la main. Le concept du « tri
3S60 81 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
échographique » <strong>des</strong> plaies palamaires de la main devrait se<br />
développer.<br />
* Marc Soubeyrand, 18, rue Estienne-d’Orves,<br />
93310 Le Pré-Saint-Gervais.<br />
61 Instabilité postéro-latérale du coude :<br />
présentation et prise en charge<br />
Bruno CHEMAMA *, Pierre MANSAT,<br />
Yves BELLUMORE, Michel RONGIÈRES,<br />
Paul BONNEVIALLE, Michel MANSAT<br />
INTRODUCTION. L’instabilité postéro-latérale du coude est<br />
liée à une distension du complexe ligamentaire collatéral latéral<br />
classiquement d’origine traumatique. Aiguë ou chronique, elle se<br />
manifeste par <strong>des</strong> signes d’instabilité. Son traitement repose sur<br />
la suture du complexe ligamentaire ou sa reconstitution par<br />
l’intermédiaire d’une greffe tendineuse. Nous rapportons ici notre<br />
expérience de cette pathologie.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Entre 1999 et 2005, 9 patients<br />
présentant une instabilité postéro-latérale ont été pris en charge.<br />
Il s’agissait de 6 hommes et 3 femmes d’âge moyen 38 ans<br />
(23-55). L’origine était post-traumatique dans tous <strong>les</strong> cas sauf un<br />
où l’instabilité est apparue après une chirurgie d’épicondylite<br />
latérale. Une hyperlaxité était retrouvée chez 2 patients. La<br />
symptomatologie se manifestait par une luxation récidivante dans<br />
5 cas, une subluxation dans un cas, et de simple douleur en extension<br />
et supination dans 3 cas. La mobilité du coude était normale.<br />
L’imagerie confirmait la présence d’une poche de distension postéro-latérale<br />
avec lésion du complexe ligamentaire latéral. En<br />
fonction de l’état ligamentaire peropératoire, 3 réparations directes<br />
selon la technique d’Osborne Cotteril et 6 ligamentoplasties<br />
(5 au long palmaire et 1 avec l’aponévrose du triceps brachial)<br />
ont été effectuées.<br />
RÉSULTATS. Les patients ont pu être revus avec un recul<br />
moyen de 17 mois (6 à 33). Dans tous <strong>les</strong> cas, la sensation d’instabilité<br />
avait disparu et la recherche d’un ressaut postéro-latéral<br />
s’est révélée négative à la révision. Le score moyen postopératoire<br />
de la Mayo Clinic était de 81 points (40 à 100). Le résultat<br />
était défini comme excellent chez 4 patients, bon chez 2,<br />
mo<strong>des</strong>te chez 2 et mauvais chez 1. Huit patients étaient satisfaits<br />
ou très satisfaits et 1 était déçu. Il n’existait pas de différence sur<br />
le résultat objectif et subjectif en fonction du terrain, de l’origine<br />
traumatique ou non, ou du type de réparation. Le facteur pronostic<br />
principal était représenté par l’existence de lésions articulaires<br />
huméro-radia<strong>les</strong> préopératoires à l’origine de la persistance<br />
de douleur postopératoire.<br />
CONCLUSION. Le diagnostic de l’instabilité postéro-latérale<br />
du coude repose sur un bilan clinique rigoureux et une imagerie<br />
précise pour mettre en évidence la lésion du complexe<br />
ligamentaire collatéral latéral. Le traitement repose sur la fermeture<br />
de la poche de distension soit par plicature si le tissu est<br />
de bonne qualité, soit par ligamentoplastie si le tissu est trop<br />
distendu. Le résultat sur la stabilité est le plus souvent favora-<br />
ble, le résultat sur la douleur dépendant de l’état articulaire<br />
préopératoire.<br />
* Bruno Chemama, Service d’Orthopédie-Traumatologie,<br />
CHU Toulouse-Purpan, place du Docteur-Baylac,<br />
31059, Toulouse Cedex.<br />
62 Traitement fonctionnel <strong>des</strong> fractures<br />
de Jones dans la population générale<br />
Jan VAN AAKEN *, Martin BERLI,<br />
Riccardo GAMBIRASIO, Marcus NOGER,<br />
Daniel FRITSCHY, Pierre HOFFMEYER<br />
INTRODUCTION. Le traitement <strong>des</strong> fractures de la base du<br />
5 e métatarsien n’est pas bien codifié dans la littérature. On classifie<br />
<strong>les</strong> fractures de la base du 5 e métatarsien en 3 types : la fracture-avulsion,<br />
située à la pointe du 5 e métatarsien, la fracture de<br />
Jones, située dans la région de l’articulation inter-métatarsienne<br />
et <strong>les</strong> fractures de la diaphyse, situées au-delà de l’articulation<br />
inter-métatarsienne. Les fractures-avulsion (Quill I) sont généralement<br />
traitées de manière fonctionnelle. Nous avons voulu établir<br />
si un traitement fonctionnel peu aussi s’appliquer pour <strong>les</strong><br />
fracture de Jones (Quill II) qui el<strong>les</strong>, sont généralement traitées<br />
par immobilisation et décharge.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Entre octobre 2004 et octobre<br />
2005, nous avons évalué 29 fractures chez 29 patients, situées à<br />
la base du 5ème métatarsien. Nous avons classifié 21 fracturesavulsion<br />
et 8 fractures de Jones. Cinq patients avec <strong>des</strong> fracturesavulsion<br />
ont été perdus de vue. Le groupe avec une fracture de<br />
Jones comportait 6 femmes et 2 hommes d’âge moyen de 53 ans<br />
( 32 à 76 ans). Six de ces patients étaient <strong>des</strong> travailleurs non<br />
manuels, 2 ne travaillaient pas. Le groupe avec une fracture avulsion<br />
comportait 12 femmes et 3 hommes avec un âge moyen de<br />
47,5 ans (16 - 74 ans). Quatre patients étaient <strong>des</strong> travailleurs<br />
manuels, 7 patients sont sans travail. Le traitement a consisté en<br />
une bande élastique, <strong>des</strong> AINS et l’utilisation facultative de cannes.<br />
L’évolution a été suivie de manière prospective. Le résultat a<br />
été mesuré avec le « modified foot score » selon Wiener.<br />
RÉSULTATS. Dans le groupe de la fracture de Jones, l’incapacité<br />
moyenne de travail a été de 4 jours (0 - 10 jours) ; le temps<br />
moyen de consolidation 7,3 semaines. Pour <strong>les</strong> fractures-avulsion,<br />
l’incapacité de travail moyenne a été 20,7 semaines (0 - 44 jours) ;<br />
le temps moyen de consolidation de 7,2 semaines. Le score a été<br />
supérieur à 80 points (bon résultat) pour <strong>les</strong> 2 groupes au contrôle<br />
à 6 semaines. Tous <strong>les</strong> patients étaient asymptomatiques à<br />
12 semaines post-fractures pour <strong>les</strong> fractures de Jones et à 7,2<br />
semaines pour <strong>les</strong> fractures d’avulsion.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. Un traitement fonctionnel<br />
en charge permet d’assurer une consolidation <strong>des</strong> fractures<br />
de Jones dans <strong>les</strong> mêmes délais, voire plus rapidement qu’un<br />
traitement en décharge. Le taux de pseudarthrose est également<br />
inférieur à celui qui est généralement rapporté. Pour <strong>des</strong> fractures-avulsion<br />
et de Jones, nous proposons un traitement symptomatique<br />
en charge selon douleurs.<br />
* Jan Van Aaken, 24, rue Micheli-du-Crest, 1211 Genève, Suisse.
64 Reconstruction de la rétroversion<br />
de la tête humérale suite à une<br />
fracture à 4 fragments de l’extrémité<br />
proximale de l’humérus : une<br />
comparaison de deux techniques<br />
Pierre-Henri FLURIN *, Laurent ANGIBAUD,<br />
Joseph D. ZUCKERMAN, Chris ROCHE,<br />
Thomas W. WRIGHT<br />
INTRODUCTION. La reconstruction de la rétroversion de la<br />
tête est un problème crucial dans le traitement <strong>des</strong> fractures à<br />
4 fragments de l’extrémité proximale de l’humérus. Une reconstruction<br />
inadéquate altère <strong>les</strong> insertions de la coiffe <strong>des</strong> rotateurs,<br />
ainsi que la stabilité et la cinématique de l’articulation glénohumérale.<br />
Une étude anatomique et une simulation numérique<br />
ont été réalisées afin de quantifier la précision de deux métho<strong>des</strong><br />
de détermination de la rétroversion. Technique A : réglage de la<br />
rétroversion en utilisant un angle fixe de 20° relatif au plan épicondylien.<br />
Technique B : réglage de la rétroversion de la tête<br />
humérale en utilisant une tige de prothèse intégrant le déport<br />
antéro-postérieur de la gouttière du long biceps.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Une machine numérique<br />
(MC850 Zeiss) de mesure tridimensionnelle a été utilisée pour<br />
modéliser 49 humérus secs. La gouttière du long biceps était<br />
digitalisée par rapport à un référentiel propre à chaque os, défini<br />
à partir de l’axe intra-médullaire et du plan équatorial de la tête.<br />
Les techniques de rétroversion A et B étaient appliquées dans le<br />
référentiel obtenu pour déterminer mathématiquement la différence<br />
angulaire entre la valeur reproduite et la rétroversion anatomique.<br />
RÉSULTATS. La rétroversion moyenne de la tête par rapport<br />
à l’axe défini par <strong>les</strong> épicondy<strong>les</strong> était de 20,1 - 11,0. La distance<br />
moyenne de la gouttière du long biceps par rapport à l’axe intramédullaire<br />
était de 7,4-1,6 mm. La simulation de reconstruction<br />
de la retroversion de la calotte humérale, à l’aide de ces valeurs<br />
moyennes, a montré que la précision est légèrement supérieure<br />
pour la technique B mais cette différence n’est pas statistiquement<br />
significative : 8,8 et 7,9, respectivement pour <strong>les</strong> techniques<br />
A et B.<br />
DISCUSSION. En utilisant la notion de déport dans le plan<br />
transversal pour définir la position de la gouttière du long biceps,<br />
on note que celle-ci s’étend parallèlement au plan équatorial de<br />
la calotte humérale tout au long de sa course. La position de la<br />
gouttière du long biceps par rapport à l’axe intra-médullaire est<br />
de plus en plus prévisible au long de sa course de proximal en<br />
distal, niveau probable du trait diaphysaire en cas de fracture à<br />
4 fragments.<br />
CONCLUSION. Cette étude indique que la partie distale de la<br />
gouttière du long biceps peut être utilisée comme repère peropératoire<br />
pour la détermination de la rétroversion de la tête humé-<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S61<br />
Séance du 6 novembre après-midi<br />
RECHERCHE APPLIQUÉE<br />
rale suite à une fracture à 4 fragments de l’extrémité proximale<br />
de l’humérus.<br />
* Pierre-Henri Flurin, 9, rue Jean-Moulin,<br />
33700 Bordeaux-Mérignac.<br />
65 Influence de l’incongruence glénohumérale<br />
<strong>des</strong> prothèses tota<strong>les</strong><br />
d’épaule sur <strong>les</strong> déformations<br />
osseuses et le déplacement <strong>des</strong><br />
implants lors de la mise en charge<br />
d’implants prothétiques glénoïdiens<br />
: étude expérimentale sur<br />
scapulas cadavériques<br />
Jean GRIMBERG *, Christophe CHAROUSSET,<br />
Louis-Denis DURANTHON, Amadou DIOP,<br />
Nathalie MAUREL<br />
INTRODUCTION. L’incongruence gléno-humérale intraprothétique<br />
dans <strong>les</strong> prothèses tota<strong>les</strong> d’épaule (la différence de<br />
rayon entre tête humérale et cavité glénoïdienne) est susceptible<br />
d’influencer à long terme la fixation de l’implant glénoïdien. Il<br />
n’existe pas encore de consensus sur l’incongruence idéale entre<br />
tête humérale et implant glénoïdien. Le but de l’étude était<br />
d’analyser in vitro, sur scapulas cadavériques implantées d’une<br />
glène prothétique, l’influence de l’incongruence gléno-humérale<br />
sur : <strong>les</strong> déformations osseuses autour de l’os cortical de la scapula<br />
implantée, <strong>les</strong> forces transversa<strong>les</strong> intra-articulaires, le<br />
déplacement de l’implant.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Cinq glènes prothétiques ont<br />
été cimentées dans cinq scapulas cadavériques. Les scapulas<br />
étaient fixées dans un boîtier métallique. Cinq sphères simulant<br />
une tête humérale prothétique avec une incongruence de 0, 2, 4,<br />
5 et 6 mm produisaient un chargement sur l’implant glénoïdien.<br />
Le chargement se décomposait sous la forme d’une précharge de<br />
392 N et d’une translation imposée de 2,5 mm dans quatre directions<br />
par rapport au centre de l’implant glénoïdien : antérieure,<br />
postérieure, supérieure, inférieure. Les mesures <strong>des</strong> éléments<br />
suivants étaient ensuite réalisées pendant le chargement : force<br />
transversale nécessaire pour produire le déplacement, déformations<br />
autour de l’os cortical de la glène à six endroits différents,<br />
déplacement relatif entre os et implant évalué par deux caméras<br />
CCD.<br />
RÉSULTATS. De manière générale, l’augmentation de<br />
l’incongruence semble diminuer <strong>les</strong> forces transversa<strong>les</strong>, <strong>les</strong><br />
déformations autour de l’os et, sauf pour le chargement antérieur,<br />
<strong>les</strong> déplacements relatifs os-implant. Aucune différence<br />
significative pour <strong>les</strong> items mesurés n’a été retrouvée lorsque
3S62 81 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
l’incongruence passait de 0 à 2 mm. Les différences devenaient<br />
significatives lorsque l’incongruence passait de 0 à 4 mm, puis<br />
variaient peu lorsque l’on passait de 0 à 5 mm et de 0 à 6 mm.<br />
CONCLUSION. Des publications récentes mettent en évidence<br />
une diminution du taux de liseré radiologique à moyen<br />
terme pour <strong>les</strong> prothèses présentant une certaine incongruence.<br />
Notre étude semble montrer une diminution <strong>des</strong> déformations<br />
osseuses, <strong>des</strong> forces transversa<strong>les</strong> et <strong>des</strong> déplacements relatifs<br />
os-implant lorsque l’incongruence gléno-humérale dépasse<br />
4 mm. D’autres étu<strong>des</strong> expérimenta<strong>les</strong> et cliniques restent nécessaires<br />
pour évaluer l’incongruence idéale permettant une répartition<br />
optimale <strong>des</strong> contraintes pour éviter le <strong>des</strong>cellement à long<br />
terme.<br />
* Jean Grimberg, 60, rue de Courcel<strong>les</strong>, 75008 Paris.<br />
66 Application de la thérapie cellulaire<br />
dans <strong>les</strong> lésions nerveuses périphériques<br />
: étu<strong>des</strong> pré-cliniques<br />
Bertrand COULET *, Paul-André DAUSSIN,<br />
Cyril LAZERGES, Fabien LACOMBE,<br />
Francis BACOU, Michel CHAMMAS<br />
INTRODUCTION. La récupération motrice après lésion nerveuse<br />
périphérique est souvent incomplète. Jusqu’à présent la<br />
majorité <strong>des</strong> travaux étaient axés sur la suture nerveuse, nous<br />
nous proposons d’utiliser <strong>les</strong> techniques de thérapie cellulaire<br />
pour augmenter <strong>les</strong> performances fonctionnel<strong>les</strong> du muscle réinnervé.<br />
L’objectif était d’évaluer l’influence de la Thérapie Cellulaire<br />
(TC) sur <strong>les</strong> performances fonctionnel<strong>les</strong> du muscle<br />
réinnervé à court (4 mois) et long terme (14 mois).<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Notre étude a porté sur le muscle<br />
tibialis anterior (TA) de lapin et le transfert de cellu<strong>les</strong> satellites<br />
(CS) autologues cultivées après induction de la régénération<br />
musculaire par injection de cardiotoxine. Dans un premier<br />
groupe, <strong>les</strong> musc<strong>les</strong> ont été évalués 4 mois après l’application du<br />
protocole de TC, dans l’autre 14 mois après. Pour chaque délai,<br />
on a distingué 3 sous-groupes : témoins sains (n = 4), témoins<br />
pathologiques (n = 6) sections-sutures nerveuses, expérimental<br />
(n = 7) sections-sutures nerveuses, à deux mois application d’un<br />
protocole de TC avec apport de CS sur le TA gauche et induction<br />
d’un simple cycle de régénération grâce à la cardiotoxine du côté<br />
droit.<br />
RÉSULTATS. Après réinnervation simple, et évaluation à<br />
4 mois la force maximale (Fmax) du TA ne représentait que<br />
62 % du témoin, l’induction d’un cycle de régénération accroissait<br />
significativement la Fmax de 16,1 % (p = 0,05) et de 25,3 %<br />
(p = 0,05) après apport de CS. À 14 mois, la Fmax après réinnervation<br />
représentait 74 % du témoin et l’induction d’un cycle de<br />
régénération seule ou associée à la TC augmentait la Fmax de<br />
façon significative de respectivement 13 et 18 % (p = 0,05), mais<br />
l’apport de la TC par rapport à la cardiotoxine seule n’était plus<br />
significatif. L’immunohistologie a montré une hypertrophie <strong>des</strong><br />
fibres et de la taille <strong>des</strong> unités motrices.<br />
DISCUSSION. Des similitu<strong>des</strong> existent entre <strong>les</strong> phénomènes<br />
de régénération et de réinnervation musculaire, avec dans <strong>les</strong> deux<br />
cas une activation <strong>des</strong> cellu<strong>les</strong> satellites. Ces phénomènes conduisent<br />
à une hypertrophie compensatrice <strong>des</strong> fibres et à une augmentation<br />
de taille <strong>des</strong> unités motrices. Avec le temps, le bénéfice<br />
lié à l’induction d’un cycle de dégénérescence reste significatif ;<br />
en revanche, le bénéfice lié à l’adjonction de cellu<strong>les</strong> satellites ne<br />
l’est plus. On constate une diminution de la taille <strong>des</strong> fibres et une<br />
réorganisation de la structure du muscle tendant vers le muscle<br />
sain. Ces résultats nous conduisent à envisager <strong>des</strong> applications<br />
cliniques, sur <strong>les</strong> musc<strong>les</strong> thénariens déficitaires, le biceps brachii<br />
en cas de paralysie du plexus brachial, et <strong>les</strong> musc<strong>les</strong> frontières du<br />
tétraplégique en vue d’un programme de chirurgie fonctionnelle.<br />
* Bertrand Coulet, Service de Chirurgie Orthopédique 2<br />
et Chirurgie de la Main, CHU Lapeyronie,<br />
371, avenue du Doyen-Gaston-Giraud,<br />
34295 Montpellier Cedex 5.<br />
67 Rôle <strong>des</strong> cellu<strong>les</strong> souches mésenchymateuses<br />
dans la survenue et<br />
la localisation <strong>des</strong> métastases<br />
osseuses fémora<strong>les</strong><br />
Zohair SELMANI *, Laurent OBERT,<br />
Pierre TIBERGHIEN, Frédéric DESCHASEAUX<br />
INTRODUCTION. Les cellu<strong>les</strong> souches mésenchymateuses<br />
(CSM) de moelle osseuse sont <strong>des</strong> cellu<strong>les</strong> multipotentes capab<strong>les</strong><br />
de se différencier vers <strong>les</strong> lignages chondrocytaires, adipocytaires<br />
et ostéocytaires. Ces cellu<strong>les</strong> régénératrices possèdent<br />
en outre la capacité de moduler la réponse immunitaire en passant<br />
par différents facteurs comme le TGF-, la PGE2, HGF et<br />
l’enzyme IDO. Le but de notre travail a donc été de savoir si au<br />
sein de l’os la présence <strong>des</strong> CSM favoriseraient par leur pouvoir<br />
immunomodulateur le développement de métastases osseuses.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Sur <strong>des</strong> fémurs de patients<br />
ayant subi une pose de prothèse de hanche, nous avons recherché<br />
par deux techniques de tri (par culture et par tri direct sans culture)<br />
la localisation <strong>des</strong> CSM. Cette étude a été réalisée sur trois<br />
parties fémora<strong>les</strong> distinctes : diaphyse, métaphyse et épiphyse.<br />
Les cellu<strong>les</strong> ainsi isolées ont été différenciées in vitro dans <strong>les</strong><br />
trois principa<strong>les</strong> voies de différentiation <strong>des</strong> CSM (ostéocytaire,<br />
chondrocytaire et adipocytaire). Nous avons ensuite réalisé avec<br />
ou sans CSM <strong>des</strong> co-cultures comprenant <strong>des</strong> lymphocytes<br />
(LyT) allogéniques et <strong>des</strong> cellu<strong>les</strong> activatrices présentant <strong>des</strong><br />
antigènes de l’EBV (EBV+). Le rapport du nombre de CSM et<br />
de LyT était de 1 pour 1. La prolifération <strong>des</strong> LyT activés est suivie<br />
par l’incorporation de thymidine tritiée (T H3*).<br />
RÉSULTATS. Quelle que soit la méthode de tri, <strong>les</strong> CSM isolées<br />
ont été montrées comme étant multipotentes. El<strong>les</strong> ont générées<br />
in vitro <strong>des</strong> cellu<strong>les</strong> de type : ostéoblastique (ostéocalcine+,<br />
ostéopontine+, collagène I+), chondroblastique (collagène II+)<br />
et adipocytaire (Nile Red+). Cependant, la grande majorité <strong>des</strong><br />
CSM (95 %) a été localisée au niveau de la métaphyse et rare-
ment au niveau de l’épiphyse ou de la diaphyse. Les cocultures<br />
(LyT-EBV+) réalisées en l’absence de CSM ont montré une<br />
incorporation de T H3* de 40000 cpm. Avec <strong>les</strong> CSM, cette<br />
inorporation n’a été que de 8000 cpm. L’inhibition de prolifération<br />
lymphocytaire par <strong>les</strong> CSM avait donc atteint un maximum<br />
de 80 %.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. Les CSM multipotentes<br />
ont été uniquement retrouvées au niveau de la métaphyse. Par<br />
ailleurs, el<strong>les</strong> ont montré une grande capacité à inhiber la prolifération<br />
<strong>des</strong> LyT en présence d’antigènes activateurs. Cette immunomodulation<br />
<strong>des</strong> CSM et leur localisation préférencielle dans la<br />
métaphyse pourraient expliquer la fréquence <strong>des</strong> métastases<br />
osseuses au niveau du fémur proximal.<br />
* Zohair Selmani, IBCT, IFR133, 240, route de Dole,<br />
25000 Besançon.<br />
68 Ligne de gravité et déformations<br />
sagitta<strong>les</strong> : comparaison avec <strong>des</strong><br />
sujets asymptomatiques<br />
Virginie LAFAGE *, Frank SCHWAB,<br />
Francisco RUBIO, Jean-Pierre FARCY<br />
INTRODUCTION. Les déformations dans le plan sagittal,<br />
qu’el<strong>les</strong> soient pathologiques ou iatrogènes présentent un réel<br />
challenge d’un point de vue thérapeutique. La radiographie est à<br />
ce jour le meilleur moyen pour l’analyse du plan sagittal. La<br />
principale limite de cette méthode réside dans le fait qu’elle ne<br />
permet pas la prise en compte <strong>des</strong> membres inférieurs. L’objectif<br />
de la présente étude était d’évaluer l’impact d’un déséquilibre<br />
sagittal sur la ligne de gravité en regard <strong>des</strong> appuis plantaires<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Cette étude prospective concernait<br />
44 sujets adultes asymptomatiques (âge moyen 44 ans) et<br />
40 sujets présentant <strong>des</strong> déformations dans le plan sagittal uniquement<br />
(âge moyen 65 ans, critères d’inclusion : version<br />
pelvienne > 20° ou plumbline > 5 cm). Les sujets présentant <strong>des</strong><br />
déformations dans le plan frontal ont été exclus. Le sujet étant en<br />
position de confort, <strong>des</strong> radiographies grand axes (face/profil)<br />
étaient obtenues avec acquisition simultanée de la ligne de gravité<br />
(LG) par plateforme de force. La ligne de gravité et la ligne <strong>des</strong><br />
talons (verticale passant par <strong>les</strong> talons) étaient ensuite projetées<br />
sur chaque radiographie afin d’évaluer la position relative de ces<br />
lignes par rapport aux structures anatomiques.<br />
RÉSULTATS. Aucune différence significative entre <strong>les</strong> deux<br />
groupes n’a été démontrée pour <strong>les</strong> paramètres âge, cyphose thoracique<br />
et distance entre ligne de gravité et talons. En accord avec<br />
<strong>les</strong> critères d’inclusion, le groupe avec <strong>des</strong> déformations sagitta<strong>les</strong><br />
présentait une déplacement antérieur de C7 par rapport a S1<br />
(SVA = 8 cm vs 0 cm) et une augmentation de la version pelvienne<br />
(27° vs 13°). Ce groupe présentait de plus une perte de la<br />
lordose lombaire (46° vs 58°), une inclinaison antérieure du tronc<br />
(-3° vs -11°) et une translation de S1 vers <strong>les</strong> talons (-41 mm).<br />
DISCUSSION. Cette étude a permis d’une part de souligner<br />
la relation existante entre la ligne de gravité et <strong>les</strong> appuis plantai-<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S63<br />
res et d’autre part de confirmer le rôle du bassin dans la régulation<br />
de l’équilibre sagittal. En effet, bien que ces 2 groupes<br />
présentaient <strong>des</strong> profils radicalement différents, la position de la<br />
ligne de gravité par rapport aux talons restait inchangée. La<br />
translation postérieure du bassin en regard <strong>des</strong> appuis plantaires<br />
apparaît ainsi comme un mécanisme compensatoire permettant<br />
de conserver une distance fixe LG/talons chez <strong>les</strong> sujets présentant<br />
un déséquilibre sagittal antérieur.<br />
* Virginie Lafage, Maimoni<strong>des</strong> Medical Center 927,<br />
49th Street Brooklyn, New York, 11219, États-Unis.<br />
69 Reproductibilité intra- inter-observateur<br />
dans la détermination de la<br />
position 3D <strong>des</strong> vertèbres cervica<strong>les</strong><br />
in vivo avec le système de stéréoradiographie<br />
EOS<br />
Marc-Antoine ROUSSEAU *,<br />
Sébastien LAPORTE,<br />
Estelle CHAVARY-BERNIER,<br />
Jean-Yves LAZENNEC, Wafa SKALLI<br />
INTRODUCTION. La détermination de la localisation et de<br />
l’orientation <strong>des</strong> vertèbres cervica<strong>les</strong> dans l’espace in vivo est un<br />
enjeu dans l’analyse de la biomécanique cervicale. Le but de<br />
cette étude était de définir la reproductibilité de la mesure de la<br />
position <strong>des</strong> vertèbres cervica<strong>les</strong> inférieures avec le système de<br />
stéréoradiographie EOS.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Vingt sujets sains mâ<strong>les</strong><br />
(21-26 ans) on été utilisés. À partir de radiographies orthogona<strong>les</strong><br />
haute résolution EOS, <strong>les</strong> vertèbres C3 à C7 ont été reconstruites<br />
dans l’espace 3D virtuel par deux fois par deux<br />
observateurs à l’aide d’un logiciel spécifique, par ajustement de<br />
la rétroprojection de vertèbres génériques déformab<strong>les</strong> sur <strong>les</strong><br />
deux images. Les différences de forme <strong>des</strong> vertèbres reconstruites<br />
et <strong>les</strong> erreurs de coordonnée du repère orthonormé associé à<br />
chaque reconstruction ont permis de déterminer la reproductibilité<br />
globale (intervalle de confiance à 95 %) et d’analyser <strong>les</strong> différences<br />
inter- et intra-observateurs (ANOVA).<br />
RÉSULTATS. La reproductibilité pour la forme de la vertèbre<br />
virtuelle était de + 0,49 mm. La reproductibilité de position était<br />
± 0,84 mm, ± 1,42 mm et ± 0,58 mm pour <strong>les</strong> translation selon<br />
X, Y et Z. La reproductibilité d’orientation était de ± 2,53 °,<br />
± 2,34° et ± 3,24° pour <strong>les</strong> rotations autour de X, Y et Z. Il n’y<br />
avait pas de différence significative intra-observateur. Une différence<br />
significative inter-observateur était en moyenne de<br />
0,09 mm pour la forme, de 0,54 mm en translation selon X, de<br />
0,33° et de 0,28° en rotation selon X et Y respectivement.<br />
DISCUSSION. Par rapport aux mesures bidimensionnel<strong>les</strong><br />
habituel<strong>les</strong>, la reproductibilité de l’analyse est très satisfaisante.<br />
La mesure de certaines coordonnées sont observateur – dépendantes<br />
du fait de la reconnaissance manuelle <strong>des</strong> lignes radiologiques,<br />
cependant <strong>les</strong> variations étaient faib<strong>les</strong>. L’absence de
3S64 81 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
différence intra-observateur est importante pour la validation de<br />
l’utilisation du système.<br />
CONCLUSION. Les résultats favorab<strong>les</strong> de notre étude de<br />
reproductibilité permettent d’envisager l’utilisation de la stéréoradiographie<br />
avec le système EOS pour l’analyse fonctionnelle<br />
du rachis cervical inférieur.<br />
* Marc-Antoine Rousseau, LBM – ENSAM, 151,<br />
boulevard de l’Hôpital, 75013 Paris.<br />
70 Quelle est la fiabilité du plan pelvien<br />
antérieur pour guider la pose<br />
d’une cupule avec assistance<br />
informatique ? Variation de son<br />
orientation à propos de 106 cas<br />
Yannick PINOIT *, Olivier MAY, Julien GIRARD,<br />
Tarek ALAEDDINE, Henri MIGAUD,<br />
Philippe LAFFARGUE<br />
INTRODUCTION. Le plan pelvien antérieur ou plan de<br />
Lewinnek est couramment utilisé comme référence pour guider<br />
la navigation d’une prothèse totale de hanche (PTH), considérant<br />
qu’il est globalement vertical en orthostatisme. À notre connaissance,<br />
aucune étude n’a évalué cette hypothèse de même que <strong>les</strong><br />
variations d’orientation auxquel<strong>les</strong> est soumis ce plan en fonction<br />
du sexe, de la position du sujet ou à la suite de l’implantation<br />
d’une PTH.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. L’orientation du plan pelvien<br />
antérieur a été mesurée par rapport à la verticale sur <strong>des</strong> radiographies<br />
de bassin de profil debout de 106 sujets comportant :<br />
1) 82 patients porteurs d’une PTH (40 patients victimes d’une<br />
luxation, et 42 indemnes d’instabilité choisis par tirage au sort,<br />
dont 19 ont bénéficié d’un profil en charge avant l’arthroplastie)<br />
et 24 sujets témoins qui ont bénéficié de clichés de profil couché<br />
et debout pour évaluer <strong>les</strong> modifications d’orientation du pelvis<br />
entre ces deux positions.<br />
RÉSULTATS. L’orientation du plan pelvien antérieur n’était<br />
influencée ni par le sexe, ni par l’âge. Trente-huit pour cent <strong>des</strong><br />
sujets avaient en orthostatisme une orientation du plan pelvien<br />
antérieur en dehors d’une fourchette de + 5° par rapport à la verticale<br />
et 13 % au-delà d’une une fourchette de ± 10°. Le passage<br />
en clinostatisme modifiait significativement l’orientation du plan<br />
pelvien antérieur passant en moyenne de 1,20° à -2,25°, avec<br />
12 sujets présentant une variation de plus de 7°. La mise en place<br />
de la PTH ne modifiait pas significativement l’orientation du<br />
plan pelvien antérieur en orthostatisme sur <strong>les</strong> 19 sujets (<strong>les</strong><br />
variations étaient faib<strong>les</strong> (de -1°±7° [-21° à 8°]), mais el<strong>les</strong><br />
étaient de plus de 5° pour 7 <strong>des</strong> 19 sujets).<br />
DISCUSSION. Le plan pelvien antérieur n’est pas vertical en<br />
orthostatisme pour 38 % <strong>des</strong> sujets avec une marge de ± 10°,<br />
soit environ la moitié de l’antéversion anatomique de l’acétabulum.<br />
Le passage en orthostatisme entraînait une variation significative<br />
de l’orientation du plan pelvien antérieur. Cette source<br />
d’erreur n’est pas intégrée par la plupart <strong>des</strong> systèmes de navigation,<br />
alors qu’elle peut conduire à <strong>des</strong> phénomènes d’effet<br />
came et de luxation.<br />
CONCLUSION. Les variations de l’orientation du plan pelvien<br />
antérieur par rapport à la verticale nous conduisent à penser<br />
qu’il ne s’agit pas d’une référence fiable. À notre connaissance,<br />
il n’y a pas de repère fiable, facilement identifiable pendant<br />
l’intervention et qui permette d’intégrer <strong>les</strong> variations de position<br />
du pelvis. Aussi il nous semble logique de s’affranchir d’un<br />
quelconque plan de référence, et de préférer une approche plus<br />
cinématique pour guider par assistance informatique l’implantation<br />
d’une cupule de PTH.<br />
* Yannick Pinoit, Service de Traumatologie,<br />
Hôpital Salengro, CHRU de Lille, place de Verdun,<br />
59037 Lille Cedex.<br />
71 Évaluation quantitative du handicap<br />
locomoteur par mesure accélérométrique<br />
de la cinématique<br />
pelvienne<br />
Franck DUJARDIN *, Frédéric MOUILHADE,<br />
Maxime LHERMETTE, Xavier SAVATIER,<br />
Jean-Yves ERTAUD, Claire TOURNY-CHOLLET<br />
INTRODUCTION. Pour un adulte sain, la dépense énergétique<br />
au cours de la marche est extrêmement faible. Deux facteurs<br />
sont essentiels à cette minimisation de la dépense énergétique :<br />
l’organisation cinématique <strong>des</strong> membres et l’équilibre dynamique<br />
autour du centre de gravité. Ces deux points sont liés à la trajectoire<br />
tridimensionnelle du centre de gravité, assimilé en première<br />
approximation au bassin qui le contient. Toute affection de<br />
l’appareil locomoteur perturbe cette organisation motrice. Ainsi,<br />
la trajectoire du bassin au cours du mouvement et de la marche<br />
est ainsi apparue susceptible de constituer un indice global d’évaluation<br />
quantitative de la performance locomotrice. L’objectif de<br />
cette étude expérimentale était de vérifier cette hypothèse.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Un dispositif expérimental<br />
embarqué a été développé autour d’un PC INTELTM 486 enfoui<br />
sur carte PC104 et de trois accéléromètres tri-axiaux (ANALOG<br />
DEVICE - ADXL105 – 10mm × 8mm × 5mm). Ce système était<br />
porté par le sujet sur une ceinture autour du bassin permettant<br />
une analyse de la marche avec un minimum de contraintes et sur<br />
un temps d’enregistrement de plusieurs heures. Après acquisition,<br />
<strong>les</strong> données stockées peuvent être transférées par une<br />
liaison parallèle sur un ordinateur personnel où el<strong>les</strong> étaient traitées<br />
et analysées. Les accéléromètres tri-axiaux étaient placés<br />
autour du bassin, deux en regard <strong>des</strong> épines iliaques antéro-supérieures<br />
et un en regard de l’épineuse de la 1 re vertèbre sacrée. Ils<br />
étaient maintenus par une ceinture velcro. L’enregistreur portable<br />
(20 × 12 × 5 cm) se présente comme un petit sac à dos, pour<br />
éviter de gêner le sujet dans ses mouvements. L’intégration<br />
seconde du signal en fonction du temps permet de reconstruire le<br />
trajectoire tridimensionnelle du bassin.
RÉSULTATS. La marche de douze sujets sains a été artificiellement<br />
déformée en plaçant sous un pied une talonnette de 3 cm,<br />
puis de 6 cm, puis en maintenant le genou bloqué par une attelle.<br />
Les mesures accéléromètriques ont permis de retrouver ces perturbations<br />
en amplitude et en temps, objectivant l’assymétrie<br />
droite-gauche artificiellement introduite.<br />
CONCLUSION. Ces résultats montrent que l’accélérométrie<br />
embarquée constitue bien a priori une méthode susceptible de<br />
répondre à l’objectif d’évaluation globale de la performance<br />
locomotrice. Le dispositif embarqué permet une utilisation prolongée<br />
et ambulatoire, susceptible de permettre, notamment, la<br />
quantification objective d’une atteinte locomotrice ou d’un bénéfice<br />
thérapeutique.<br />
* Franck Dujardin, Département d’Orthopédie,<br />
CHU de Rouen, 1, rue de Germont, 76031 Rouen Cedex.<br />
72 Incidence et facteurs de risque <strong>des</strong><br />
évènements thrombo-emboliques<br />
après traumatisme non chirurgical<br />
isolé <strong>des</strong> membres inférieurs<br />
Moussa HAMADOUCHE *,<br />
Christophe ROTHMANN, Nathalie LECOULES,<br />
Eric BOUVAT, Jean-Luc BOSSON,<br />
Philipe RAVAUD, Char<strong>les</strong>-Marc SAMAMA,<br />
Bruno RIOU<br />
INTRODUCTION. Le but de cette étude observationnelle<br />
multicentrique prospective était d’évaluer l’incidence <strong>des</strong> évènements<br />
thrombo-emboliques chez <strong>des</strong> patients traités aux urgences<br />
pour un traumatisme isolé non chirurgical <strong>des</strong> membres<br />
inférieurs, et de déterminer <strong>les</strong> facteurs de risque d’une telle<br />
complication.<br />
73 Traitement chirurgical <strong>des</strong> récidives<br />
de pied bot varus équin par ostéotomie<br />
curviligne du calcanéum<br />
Brice ILHARREBORDE *, Philippe SOUCHET,<br />
Etienne MOREL, Franck FITOUSSI,<br />
Georges-François PENNEÇOT, Keyvan MAZDA<br />
INTRODUCTION. Le traitement chirurgical <strong>des</strong> reprises de<br />
pied bot varus équin (PBVE) est difficile, exposant à de nombreuses<br />
récidives ou hypercorrections. Après l’âge de trois ans, il<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S65<br />
Séance du 6 novembre après-midi<br />
PÉDIATRIE<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Les critères d’inclusion étaient<br />
<strong>les</strong> suivants : âge > 18 ans, traumatisme isolé non chirurgical <strong>des</strong><br />
membres inférieurs sous le genou, délai de consultation aux<br />
urgences < 48 heures, hospitalisation < 24 heures, absence de<br />
signes cliniques de thrombose veineuse lors de la consultation<br />
initiale. La présence d’une thrombose veineuse profonde a été<br />
évaluée par un examen echo-doppler, pratiqué dans <strong>les</strong> 24 heures<br />
suivant la levée de la contention. Le diagnostic de thrombose<br />
veineuse profonde a été confirmé dans tous cas par un groupe<br />
d’experts. Les facteurs de risque évalués comprenaient : âge,<br />
sexe, indice de masse corporelle, antécédents personnels ou<br />
familiaux de maladie thrombo-embolique, pathologies associées,<br />
traitement hormonal, insuffisance veineuse, tabac, type d’immobilisation<br />
(rigide vs non rigide), recommandations pour la marche<br />
(appui interdit, appui partiel, appui complet), sévérité<br />
lésionnelle, et prophylaxie anti-thrombotique.<br />
RÉSULTATS. 3698 patients ont été inclus. Parmi ceux-ci, un<br />
examen écho-Doppler a été obtenu chez 2761 patients (75 %) qui<br />
ont été retenus pour l’analyse <strong>des</strong> résultats. Cette cohorte comportait<br />
1391 hommes et 1358 femmes âgés en moyenne de<br />
40 ± 15 ans. Le diagnostic était une fracture pour 1674 patients<br />
(61 %) et une lésion ligamentaire pour 1087 patients (39 %). Une<br />
thrombose veineuse profonde a été constatée chez 177 patients, et<br />
une embolie pulmonaire non mortelle chez un patient. L’incidence<br />
<strong>des</strong> thromboses veineuses profon<strong>des</strong>, majoritairement dista<strong>les</strong><br />
et asymptomatiques, était de 6,4 % (IC 95 % : 5,5 à 7,4 %).<br />
Une analyse multivariée a permis de mettre en évidence <strong>les</strong> facteurs<br />
de risque suivants : âge supérieur ou égal 50 ans (odds ratio<br />
3,14 ; p < 0,0001), immobilisation rigide (odds ratio 2,70 ;<br />
p < 0,0001), appui non autorisé (odds ratio 4,11 ; p < 0,0015), et<br />
gravité lésionnelle (odds ratio 1,88 ; p < 0,0002). Une analyse<br />
discriminante a permis de mettre en évidence que la variable<br />
« âge » était la seule variable indépendante d’une prophylaxie<br />
anti-thrombotique associée à la survenue d’une thrombose veineuse<br />
profonde.<br />
* Moussa Hamadouche, Service A de Chirurgie Orthopédique,<br />
Hôpital Cochin, 27, rue du Faubourg-Saint-Jacques,<br />
75014 Paris.<br />
est difficile de corriger la rotation médiale de l’articulation subtalaire,<br />
devenue raide et congruente. Cette étude décrit une nouvelle<br />
technique chirurgicale permettant une dérotation entre le<br />
talus et le bloc calcanéo-pédieux, sous l’articulation subtalaire,<br />
et un rétablissement de la divergence talo-calcanéenne (DTC).<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Vingt et une ostéotomies curvilignes<br />
du calcanéum, associées à une libération médio-plantaire,<br />
ont été effectuées chez 20 enfants, d’un âge moyen de 7 ans.<br />
Seize PBVE étaient idiopathiques et 5 d’origine neurologique.<br />
Les enfants ont été évalués cliniquement et radiologiquement en<br />
préopératoire, postopératoire, et au dernier recul (2,8 ans en<br />
moyenne). La DTC était considérée comme le critère principal<br />
d’évaluation du résultat.
3S66 81 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
RÉSULTATS. La DTC a été corrigée dans tous <strong>les</strong> cas, avec<br />
une seule dégradation au dernier recul. L’adduction de l’articulation<br />
talo-naviculaire a été corrigée dans 17 cas sur 18, mais<br />
2 subluxations dorsa<strong>les</strong> du naviculaire, témoignant d’une hypercorrection,<br />
ont été rapportées. Il existait une adduction dans<br />
l’articulation de Chopart dans 15 cas, toujours corrigée en postopératoire<br />
et stable au dernier recul. L’adduction dans l’articulation<br />
de Lisfranc, présente dans 3 cas, a toujours été améliorée mais a<br />
récidivé dans 1 cas, nécessitant une nouvelle reprise chirurgicale.<br />
Il s’agit du seul pied ayant subi une réintervention. Un cavus isolé<br />
a été retrouvé 17 fois, mais la libération médiale et plantaire a permis<br />
sa correction. Un seul pied plat modéré, parfaitement toléré, a<br />
été observé. La DTC n’était pas excessive mais le talus était trop<br />
vertical, avec subluxation dorsale du naviculaire, correspondant<br />
donc plus à un excès de libération qu’à un effet de la dérotation calcanéenne.<br />
Aucune complication infectieuse n’a été notée. Trois<br />
nécroses cutanées sont apparues sur la reprise de voie d’abord<br />
médiale, d’évolution favorable après cicatrisation dirigée.<br />
DISCUSSION. Près de 25 % <strong>des</strong> PBVE opérés récidivent ou<br />
présentent une déformation résiduelle dans la littérature. De nombreux<br />
gestes osseux (cuboide, cunéiforme, métatarse) ou sur <strong>les</strong><br />
parties mol<strong>les</strong> (allongement, libération, transfert) ont été proposés<br />
dans <strong>les</strong> reprises, mais aucun ne modifie de façon stable <strong>les</strong> rapports<br />
entre le talus et le reste du pied. L’ostéotomie curviligne calcanéenne<br />
est la seule à modifier la DTC. L’intervention est<br />
efficace, sans risque, et permet, en association avec la libération<br />
médio plantaire, de corriger la rotation médiale du bloc calcanéopédieux<br />
et rétablir une anatomie satisfaisante du pied.<br />
* Brice Ilharreborde, Service de Chirurgie Orthopédique,<br />
Hôpital Robert-Debré, 48, boulevard Sérurier, 75019 Paris.<br />
74 Étude de la convexité plantaire<br />
chez <strong>des</strong> patients présentant <strong>des</strong><br />
pieds bots varus équins congénitaux<br />
idiopathiques traités<br />
Georgios KOUREAS *, Philippe WICART,<br />
Alice FASSIER, Raphaël SERINGE<br />
INTRODUCTION. La convexité plantaire est une complication<br />
peu étudiée du traitement du pied bot varus équin. L’objectif<br />
était de démontrer le temps de son apparition, localiser l’articulation<br />
qui en est le siège, évaluer l’influence du traitement sur<br />
l’évolution de la convexité et le résultat final.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Étude rétrospective, clinique et<br />
radiologique sur 23 patients dont 14 présentaient un pied bot<br />
varus équin bilatéral et 9 unilatéral sur 8 garçons et 15 fil<strong>les</strong>.<br />
Tous <strong>les</strong> pieds ont été traités initialement par strapping du pied<br />
sur plaquette, immobilisation par attelle fémoropédieuse plus<br />
kinésithérapie.La correction chirurgicale de la convexité plantaire<br />
a été réalisée dans 21 pieds par voie postero-interne comprenant<br />
allongement du tendon d’Achille, tibial posterieur, tibial<br />
antérieur, liberation du nœud fibreux postéro-latéral, capsulotomie<br />
tibio-talienne, talo-naviculaire, brochage de la colonne<br />
interne et 12 par combinaison d’un abord postéro-interne et<br />
externe avec fixation de chaque colonne par une broche. L’examen<br />
clinique, radiologique de face et de profil du pied et <strong>les</strong> photos<br />
ont servi à l’évaluation. Cotation à la naissance selon<br />
Dimeglio. Évaluation du résultat final selon Ghanem et Seringe.<br />
Les chi 2 , coefficient de correlation de Pearson (r) et Student<br />
T-test ont été utilisés pour l’analyse statistique.<br />
RÉSULTATS. Le recul moyen est 15,4 ± 3,7 ans. La majorité<br />
de pieds appartient au group D selon Dimeglio. La convexité<br />
apparaissait entre le 6 e et 12 e mois à l’articulation de Chopart<br />
(r = -0,71). Les colonnes interne et externe se déformaient symétriquement<br />
dans le plan sagittal (r = 0,8). Le traitement chirurgical<br />
a permis de rétablir la concavité de la plante du pied jusqu’à<br />
la maturité (p < 0,001)et d’augmenter la dorsiflexion significativement<br />
p < 0,0029. Le résultat final n’est pas lié aux différents<br />
actes opératoires (chi 2 = 0,56, p > 0,1). Le résultat final est<br />
excellent ou très bon pour 25 pieds (70 %) et moyen ou mauvais<br />
pour 13 pieds (30 %).<br />
DISCUSSION. Le chirurgien orthopédiste ainsi que le kinésithérapeute<br />
doivent tenir compte de cette éventuelle cassure du<br />
médio-pied, <strong>des</strong> formes sévères, lors du traitement. Le brochage<br />
du médio-pied par une broche est probablement suffisant pour<br />
conserver la correction. L’articulation de Lisfranc est rarement le<br />
siège de la déformation.<br />
CONCLUSION. Le traitement par strapping sur plaquettes<br />
concaves ainsi que la ténotomie percutanée du tendon d’Achille<br />
avant le 6 e mois doivent faire l’objet d’une étude afin de démontrer<br />
leur efficacité dans la prévention de la convexité plantaire.<br />
* Georgios Koureas, Service d’Orthopédie Infantile,<br />
Hôpital Saint-Vincent-de-Paul,<br />
74, avenue Denfert-Rochereau, 75014 Paris.<br />
75 Traitement du thorax en entonnoir<br />
par voie endoscopique chez l’enfant<br />
Jean-Luc JOUVE *, Franck LAUNAY,<br />
Elke VIEHWEGER, Yan LEFEVRE, Yan GLARD,<br />
Gérard BOLLINI<br />
INTRODUCTION. Le traitement du thorax en entonnoir par<br />
voie endoscopique représente une méthode simple de correction<br />
<strong>des</strong> formes symétriques. Les auteurs présentent <strong>les</strong> résultats préliminaires<br />
d’une série de 10 cas en termes de faisabilité, complications<br />
et résultats à moyen terme.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. La série comprend 10 patients<br />
âgés de 5 à 16 ans. Il s’agisait de 3 fil<strong>les</strong> et 7 garçons. Dans<br />
2 cas, <strong>les</strong> enfants présentaient une maladie de Marfan avec un<br />
retentissement respiratoire en rapport pour un <strong>des</strong> deux cas avec<br />
une compression de la bronche souche gauche entre le sternum<br />
et le rachis. dans <strong>les</strong> 8 autres cas <strong>les</strong> motivations étaient d’ordre<br />
purement esthétique. L’intervention a été conduite par thoracoscopie<br />
droite avec exclusion pulmonaire dans 9 cas. Le cas présentant<br />
une compression bronchique dans une forme majeure de<br />
maladie de Marfan a été traité par la même technique mais en
soulevant le sternum par une courte incision médiale sous<br />
xyphoïdienne associée. La plaque d’ostéosynthèse a été stabilisée<br />
par un stabilisateur de Nuss dans 6 cas, puis par un cerclage<br />
métallique sur une côte droite dans <strong>les</strong> 4 derniers cas.<br />
RÉSULTATS. Le recul est de 6 mois à 2 ans. Il n’y a pas eu<br />
de complication septique ou cardiaque. Trois pneumothorax<br />
asymptomatiques mineurs ont été observés sur <strong>les</strong> radiographies<br />
postopératoires et ont régressé spontanément. Dans 1 cas, un<br />
drainage postopératoire a été réalisé. Une plaque s’est mobilisée<br />
au 15 e jour et a nécessité une reprise. Depuis cette période, <strong>les</strong><br />
plaques sont fixées par un cerclage sur la côte. Le résultat esthétique<br />
à moyen terme a été jugé comme excellent dans 9 cas et<br />
bon dans 1 cas.<br />
DISCUSSION. Cette série préliminaire confirme <strong>les</strong> travaux<br />
de Nuss notamment la simplicité de la technique et <strong>les</strong> résultats<br />
intéressants à court terme sous réserve qu’il s’agisse d’un pectus<br />
excavatum parfaitement symétrique. L’ablation de matériel<br />
d’ostéosynthèse a été effectuée dans deux cas sans problème particulier<br />
et sans perte de résultat. Le matériel doit théoriquement<br />
être conservé 2 à 3 ans. La stabilité à long terme du résultat est à<br />
juger avec plus de recul.<br />
CONCLUSION. La technique de Nuss paraît d’indication raisonnable<br />
chez l’enfant présentant un pectus excavatum symétrique<br />
médian.<br />
* Jean-Luc Jouve, Service de Chirurgie Orthopédique<br />
et Pédiatrique, Hôpital Timone-Enfants,<br />
boulevard Jean-Moulin, 13385 Marseille Cedex 5.<br />
76 Traitement <strong>des</strong> anomalies costo<br />
vertébra<strong>les</strong> par distracteur costal :<br />
résultats préliminaires<br />
Yan LEFEVRE *, Franck LAUNAY,<br />
Elke VIEHWEGER, Jean-Luc JOUVE,<br />
Gérard BOLLINI<br />
INTRODUCTION. Les malformations rachidiennes majeures<br />
associées à <strong>des</strong> malformations costa<strong>les</strong> sont à l’origine de scolioses<br />
congénita<strong>les</strong> d’évolution parfois sévères par insuffisance respiratoire.<br />
L’utilisation de distracteurs costaux pourrait permettre<br />
un contrôle précoce <strong>des</strong> déformations et une amélioration <strong>des</strong><br />
performances respiratoires. L’objectif de cette étude préliminaire<br />
était d’étudier l’efficacité et <strong>les</strong> complications du traitement de<br />
scolioses congénita<strong>les</strong> malformatives par distraction costale.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Neuf enfants porteurs de dysostoses<br />
spondylo costa<strong>les</strong>, sont actuellement traités par distraction<br />
costale. L’âge moyen lors de la mise en place du distracteur costal<br />
était de 30 mois (limites de 6 à 70 mois), L’indication a toujours<br />
été portée face à une majoration rapide de la courbure<br />
principale. Les paramètres étudiés ont été l’angle de Cobb pour<br />
<strong>les</strong> courbures rachidiennes fronta<strong>les</strong> et sagitta<strong>les</strong>, et la balance<br />
frontale c’est à dire la distance entre la tangente verticale au<br />
sommet de la déformation et la ligne verticale sacrée, ont été<br />
mesurées sur <strong>les</strong> contrô<strong>les</strong> radiographiques successifs.<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S67<br />
RÉSULTATS. Le recul moyen depuis la mise en place est de<br />
trois ans et huit mois. Huit patients sont encore porteurs de leur<br />
distracteur costal et une patiente avait été depuis traitée par<br />
arthrodèse définitive. La valeur moyenne de la courbure thoracique<br />
au moment de la pose était de 48°, avec une contre courbure<br />
thoarco-lombaire moyenne de 22° et une balance frontale de<br />
19 mm. Le délai moyen entre chaque remise en tension est de<br />
19 mois. La différence moyenne entre la mesure avant la mise en<br />
place de la distraction et la mesure au plus long recul était de<br />
deux degrés d’aggravation pour la courbure principale, de 8 mm<br />
de croissance du segment rachidien concerné par la distraction et<br />
de 3 mm d’aggravation de balance frontale. Dans deux cas, <strong>des</strong><br />
côtes se sont fracturées au niveau de appuis costaux, nécessitant<br />
dans un cas une ablation du matériel et dans l’autre un changement<br />
de côte pour la mise en place du crochet concerné. Dans un<br />
cas, le site opératoire s’est surinfecté après remise en tension,<br />
ayant nécessité un lavage chirurgical sans ablation du matériel et<br />
un traitement antibiotique au long cours.<br />
DISCUSSION. La distraction costale apparaît efficace afin de<br />
limiter la progression <strong>des</strong> courbures <strong>des</strong> scolioses congénita<strong>les</strong><br />
dues à <strong>des</strong> malformations costo-vertébra<strong>les</strong> majeures. L’analyse<br />
de ces mêmes données à la fin du traitement par distracteur costal<br />
reste nécessaire pour confirmer l’efficacité de cette technique.<br />
* Yan Lefevre, Service de Chirurgie Orthopédique<br />
et Pédiatrique, Hôpital Timone-Enfants,<br />
boulevard Jean-Moulin, 13385 Marseille Cedex 5.<br />
77 Les lésions vertébro-médullaires<br />
d’origine obstétricale : à propos<br />
d’une série multicentrique de neuf<br />
cas<br />
Raphaël VIALLE *, Claire PIÉTIN-VIALLE,<br />
Brice ILHARREBORDE, Stéphane DAUGER,<br />
Mathieu VINCHON, Christophe GLORION<br />
INTRODUCTION. Les lésions vertébro-médullaires du nouveau-né<br />
survenant lors de l’accouchement sont rares et encore<br />
mal connues. Nous avons colligé neuf cas de tel<strong>les</strong> lésions dont<br />
nous discutons <strong>les</strong> mécanismes de survenue. La conduite à tenir<br />
immédiate et le devenir à moyen et long terme de ces enfants<br />
sont pour nous <strong>les</strong> points importants à développer.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Neuf dossiers cliniques et<br />
radiologiques d’enfants ayant présenté une lésion vertébromédullaire<br />
à la naissance ont été identifiés au moyen d’un questionnaire<br />
adressé aux membres de la Société Française d’Orthopédie<br />
Pédiatrique (SOFOP). Le recueil <strong>des</strong> données a été réalisé<br />
de manière rétrospective. Les données cliniques concernant la<br />
grossesse et l’accouchement ont été relevées. Les éléments cliniques<br />
et iconographiques depuis le diagnostic de lésion vertébromédullaire<br />
jusqu’au dernier recul ont été notés.<br />
RÉSULTATS. La présentation fœtale était céphalique dans<br />
trois cas, par le siège dans quatre cas et par la face dans deux cas.<br />
Le diagnostic de lésion vertébro-médullaire a été fait dans <strong>les</strong>
3S68 81 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
premières heures dans cinq cas. Dans quatre cas, le diagnostic n’a<br />
été suspecté qu’entre le 2 e et le quatrième jour. La lésion vertébro-médullaire<br />
concernait le rachis cervical dans six cas sur neuf.<br />
Trois enfants souffrant d’une tétraplégie flasque due à une lésion<br />
du rachis cervical supérieur sont décédés avant l’âge de six ans.<br />
Les six autres patients n’ont présenté aucune amélioration de leur<br />
statut neurologique de départ. Leur intégration sociale et leur<br />
confort de vie ont été jugés satisfaisants au recul minimum de<br />
5ans.<br />
DISCUSSION. Les lésions vertébro-médullaires peuvent survenir<br />
au décours d’accouchements diffici<strong>les</strong> avec <strong>des</strong> anomalies de<br />
la présentation fœtale entraînant une dystocie. Le cas le plus fréquent<br />
est une présentation par le siège suivie d’une rétention intrautérine<br />
de la tête fœtale. Les manœuvres d’extraction, comportant<br />
une traction parfois violente sur la tête et le cou de l’enfant, peuvent<br />
être responsab<strong>les</strong> de lésions par étirement médullaire. Au<br />
décours de manœuvres obstétrica<strong>les</strong> complexes et d’un accouchement<br />
difficile, le diagnostic de lésion vertébro-médullaire doit être<br />
évoqué devant un enfant hypotonique. Dans ce cas, <strong>des</strong> radiographies<br />
du rachis en totalité de face et de profil, ainsi qu’une IRM<br />
doivent être réalisées pour confirmer le diagnostic.<br />
CONCLUSION. Des lésions vertébro-médullaires peuvent<br />
survenir lors d’une extraction fœtale difficile, notamment en cas<br />
de présentation par le siège avec rétention intra-utérine de la tête<br />
fœtale. Ces situations sont heureusement exceptionnel<strong>les</strong>. Le<br />
pronostic vital de l’enfant reste réservé, surtout en cas de lésion<br />
complète de la moelle cervicale.<br />
* Raphaël Vialle, Service d’Orthopédie Pédiatrique,<br />
Hôpital d’Enfants Armand-Trousseau,<br />
26, avenue du Docteur-Arnold-Netter,<br />
75571 Paris Cedex 12.<br />
78 Fracture de chance chez l’enfant :<br />
analyse <strong>des</strong> lésions par IRM<br />
Jérôme SALES DE GAUZY *, Jean-Luc JOUVE,<br />
Philippe VIOLAS, Anne-Sophie COUTIÉ,<br />
Walid SAYED, Gérard BOLLINI,<br />
Jean-Philippe CAHUZAC<br />
INTRODUCTION. Les fractures de chance sont <strong>des</strong> fractures<br />
horizonta<strong>les</strong> du rachis. El<strong>les</strong> sont dues à un mécanisme de<br />
flexion distraction et surviennent principalement au cours d’un<br />
accident de la circulation avec port d’une ceinture de sécurité<br />
ventrale. Chez l’adulte, plusieurs classifications ont été proposées<br />
en fonction du type de lésion : purement osseuse, ligamentaire<br />
et discale ou mixte. Cependant, chez l’enfant une atteinte<br />
discale semble improbable et il s’agirait plus d’un décollement<br />
physaire. Ceci a été souligné par Rumball et Jarvis qui ont proposé<br />
une classification en 4 types basée sur une analyse radiographique.<br />
Le but de ce travail était d’analyser <strong>les</strong> lésions chez<br />
l’enfant à partir d’IRM.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Il s’agit d’une étude rétrospective<br />
réalisée dans 3 centres de chirurgie pédiatrique et portant sur<br />
13 enfants (9 garcons, 4 fil<strong>les</strong>), âge moyen 8 ans (3-17). Dans<br />
tous <strong>les</strong> cas, il s’agissait d’un accident de la circulation. Le bilan<br />
initial montrait une fracture en flexion distraction située entre<br />
T12 et L4. Dans 7 cas, <strong>des</strong> lésions intra-abdomina<strong>les</strong> étaient présentes.<br />
Un bilan IRM complémentaire initial a été réalisé et analysé<br />
chez tous ces patients.<br />
RÉSULTAT. Au niveau lésionnel, le disque intervertébral présente<br />
un signal normal dans tous <strong>les</strong> cas. Dans 6 cas, on note une<br />
fracture transversale passant par le corps vertébral. Dans 7 cas,<br />
on note un décollement physaire siégeant soit au niveau du plateau<br />
vertébral supérieur, soit au niveau du plateau vertébral inférieur.<br />
Trois types de lésion sont retrouvés en fonction de la<br />
topographie de la lésion par rapport aux pédicu<strong>les</strong> vertébraux.<br />
Type I : lésion postérieure située au <strong>des</strong>sus <strong>des</strong> pédicu<strong>les</strong> (lésion<br />
ligamentaire ou fracture <strong>des</strong> articulaires supérieures) associée à<br />
un décollement physaire du plateau supérieur de la vertèbre.<br />
Type II : fracture horizontale passant par <strong>les</strong> pédicu<strong>les</strong> et le corps<br />
vertébral. Type III : fracture de l’arc postérieur située sous <strong>les</strong><br />
pédicu<strong>les</strong> (isthmes, articulaires inférieures) associée à un décollement<br />
physaire du plateau inférieur de la vertèbre.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. Cette étude confirme<br />
l’absence de lésion du disque intervertébral chez l’enfant. Ceci a<br />
une incidence thérapeutique importante, puisque ces lésions sont<br />
a priori accessib<strong>les</strong> à un traitement orthopédique. Les classifications<br />
proposées chez l’adulte (Denis, Gumley et col, Gertzbein et<br />
Court-Brown) ne sont pas adaptées à l’enfant. La classification<br />
que nous proposons s’oppose à celle de Rumball et Jarvis dans<br />
laquelle le décollement physaire inférieur n’est pas noté.<br />
* Jérôme Sa<strong>les</strong> de Gauzy, Hôpital <strong>des</strong> Enfants,<br />
330, avenue de Grande-Bretagne, 31023 Toulouse Cedex 3.<br />
79 Gibbectomie sous thoracoscopie<br />
dans <strong>les</strong> scolioses idiopathiques de<br />
l’ado<strong>les</strong>cent<br />
Mohsen KARAMI *, Brice ILHARREBORDE,<br />
Etienne MOREL, Franck FITOUSSI,<br />
Georges-François PENNEÇOT, Keyvan MAZDA<br />
INTRODUCTION. La gibbosité thoracique résiduelle est fréquemment<br />
source d’une gêne cosmétique persistante malgré la<br />
correction de la courbure principale. La gibbectomie améliore<br />
sensiblement le résultat fonctionnel du traitement chirurgical.<br />
Elle est le plus souvent pratiquée par voie postérieure au cours<br />
de la chirurgie de correction de la scoliose, au prix d’un décollement<br />
musculo-aponévrotique important. La gibbectomie par thoracotomie<br />
a été décrite par Schuffelberger au cours <strong>des</strong><br />
instrumentations par voie antérieure. Nous rapportons ici notre<br />
expérience de la gibbectomie par thoracoscopie lorsqu’une libération<br />
thoracique préalable était indiquée.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Vingt et un ado<strong>les</strong>cents (âge<br />
moyen 14,9 ans) avec une scoliose idiopathique jugée raide sur le<br />
cliché en traction (réduction < 50 %) ont subi entre 2002 et 2004<br />
une libération antérieure sous endoscopie, associée dans le même<br />
temps à une thoracoplastie, afin de faire disparaître leur gibbosité.
L’angle de Cobb moyen de la courbure principale était de 70° en<br />
préopératoire (60° -85°). Les patients ont été opérés en décubitus<br />
latéral par deux ou trois abords d’un cm sur la ligne axillaire antérieure<br />
ou médiane. Les patients ont été évalués cliniquement et<br />
radiologiquement en préopératoire, en postopératoire et au dernier<br />
recul, avec notamment mesure de la gibbosité en consultation<br />
et clichés de face et de profil sur gran<strong>des</strong> cassettes en position<br />
debout.<br />
RÉSULTATS. Le recul moyen était de 25 mois (23 mois-<br />
32 mois). Le nombre de côtes réséquées était de 5 en moyenne<br />
(de 4 à 7), avec une longueur de résection variant de 2,2 cm à<br />
7 cm (moyenne 4,2 cm). La durée opératoire moyenne du temps<br />
antérieur était 65 minutes (45-108). La hauteur moyenne de la<br />
gibbosité thoracique est passée de 3,6 cm en préopératoire<br />
(de 2,5 à 5,5 cm) à 1,5 cm après l’intervention (de 0,8 à 2 cm).<br />
Sur <strong>les</strong> radiographies, la réduction moyenne de la gibbosité était<br />
de 62 %. Aucune complication peropératoire n’est survenue, et<br />
aucun patient n’a rapporté de douleur postopératoire majeure à la<br />
première consultation, effectuée 30 jours après l’intervention.<br />
CONCLUSION. La thoracoplastie endoscopique est une<br />
technique efficace, répétable et sûre dans <strong>les</strong> scolioses idiopathiques<br />
de l’ado<strong>les</strong>cent. Elle corrige efficacement la gibbosité thoracique<br />
et améliore la gêne esthétique, et doit être proposée le<br />
plus souvent si un temps de libération antérieure est nécessaire<br />
dans la stratégie chirurgicale.<br />
* Mohsen Karami, Service de Chirurgie Orthopédique,<br />
Hôpital Robert-Debré, 48, boulevard Sérurier, 75019 Paris.<br />
80 Résection d´hémivertèbres et<br />
arthrodèse circonférentielle réalisées<br />
par abord postérieur<br />
Pedro DOMENECH *, Jesus BURGOS,<br />
Eduardo HEVIA, Pedro GUTIERREZ, Biel PIZA,<br />
Ignaci SEMPERA, Juan RODRIGUEZ-OLAVERRI,<br />
Joaquin FENOLLOSA<br />
INTRODUCTION. Les résultats de l’hémi-épiphysiodèse et<br />
l’hémi-arthrodèse sont imprévisib<strong>les</strong>. Il existe <strong>des</strong> étu<strong>des</strong> de<br />
résection d’hémivertèbre par voie postérieure isolée associée à<br />
une instrumentation pédiculaire. Nous n’avons pas trouvé de<br />
publications concernant l’association de systèmes de stabilisation<br />
inter somatique par voie postérieure, qui est la technique<br />
que nous présentons dans cette étude. L’objectif était d’analyser<br />
<strong>les</strong> résultats de la résection et l’arthrodèses circonférentielle réalisées<br />
en cas d’hémivertèbres non incarcérées.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Étude rétrospective pour évaluer<br />
<strong>les</strong> résultats de la résection d’hémivertèbres non incarcérées<br />
associant arthrodèse circonférentielle et stabilisation par cage<br />
inter somatique et vis pédiculaires par voie postérieure dans le<br />
même acte chirurgical. Huit patients (4 femmes et 4 hommes)<br />
d’âge compris entre 3 et 32 ans présentant une cypho-scoliose<br />
secondaire à une hémivertèbre subirent une résection de l’hémivertèbre<br />
associée à une arthrodèse postérieure avec vis pédiculai-<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S69<br />
res et cage inter somatique comme éléments de stabilisation. Le<br />
suivi minimum fut de 24 mois et tous <strong>les</strong> patients avaient une<br />
vertèbre non incarcérée : deux en L5, une en L4, une en L2, une<br />
en D7 et une en D5. Après résection de l’hémivertèbre, furent<br />
mises en place <strong>des</strong> vis pédiculaires à deux niveaux au <strong>des</strong>sus et<br />
deux niveaux en <strong>des</strong>sous du niveau de résection, et dans tous <strong>les</strong><br />
cas fut effectuée une stabilisation antérieure par cage avec autogreffe<br />
provenant de la vertèbre extirpée. Il y eut toujours un<br />
monitoring neurophysiologique.<br />
RÉSULTATS. La scoliose préopératoire était de 43º en<br />
moyenne et fut corrigée à 17º en moyenne. La cyphose préopératoire<br />
de 22º était corrigée à 12º. Il n’y eut pas de déséquilibre<br />
postopératoire significatif. Le manque de correction finale fut de<br />
6º dans le plan antéropostérieur et de 9º dans le plan latéral.<br />
Aucun désenclavage d’implants ne fut observé, et dans tous <strong>les</strong><br />
cas, il y eut une consolidation inter somatique ou postéro-latérale.<br />
Un cas souffrit de la section de la racine droite de L2 et un<br />
autre d’une rupture de la dure-mère. Il n’y eut pas d’autre complication<br />
neurologique.<br />
CONCLUSION. Cette étude démontre que la correction<br />
d’une scoliose secondaire à une hémivertèbre isolée est excellente<br />
en utilisant la voie postérieure seule pour réaliser la résection<br />
de l’hémivertèbre et l’arthrodèse circonférentielle, associant<br />
une stabilisation inter somatique par cage et vis pédiculaires.<br />
* Pedro Domenech, Maestro Alonso 109,<br />
03010 Alicante, Espagne.<br />
81 Traitement chirurgical <strong>des</strong> scolioses<br />
congénita<strong>les</strong> par hémivertèbres<br />
: à propos d’une série de<br />
27 cas<br />
Nicolas BONNEVIALLE *, Gorge KNORR,<br />
Aziz ABID, Franck ACCADBLED,<br />
Jean-Philippe CAHUZAC,<br />
Jérôme SALES DE GAUZY<br />
INTRODUCTION. Les scolioses congénita<strong>les</strong> évolutives par<br />
hémivertèbres peuvent être traitées chirurgicalement soit par<br />
résection de l’hémivertèbre, soit par épiphysiodèse convexe. Le<br />
but de ce travail était d’évaluer <strong>les</strong> résultats d’une série d’enfants<br />
opérés entre 1996 et 2004 selon l’une ou l’autre <strong>des</strong> modalités.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Cette série non comparative<br />
comporte 27 hémivertèbres chez 24 enfants. Il s’agit de 19 hémivertèbres<br />
libres, 7 semi-segmentées et 1 incarcérées (classification<br />
de Mc Master). Le traitement a été dans 16 cas une résection<br />
et dans 11 cas une épiphysiodèse. L’âge moyen au moment de<br />
l’intervention était de 50 mois (24-132 mois) et l’angle de Cobb<br />
moyen de 33° (20-75°). La résection a été réalisée pour <strong>des</strong><br />
hémivertèbres comprises entre T12 et le sacrum. La technique a<br />
comporté une double voie d’abord (postérieure et antérieure)<br />
associée à instrumentation par matériel Baby CD en compression.<br />
L’épiphysiodèse a été réalisée pour <strong>des</strong> hémivertèbres thoraciques,<br />
sur 2 niveaux en antérieur et sur 4 niveaux en
3S70 81 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
postérieur. Dans 6 cas, une instrumentation postérieure a été<br />
associée. Dans 5 cas, un plâtre correcteur a été mis en place.<br />
RÉSULTATS. Aucune complication neurologique n’a été<br />
constatée dans cette série. Pour <strong>les</strong> 16 résections, la réduction<br />
moyenne est de 75 % en postopératoire et de 73 % au recul<br />
moyen de 4 ans. Pour <strong>les</strong> 11 cas, d’épiphysiodèse, la correction<br />
moyenne est de 26 % en postopératoire. Au recul moyen de 3 ans,<br />
on note 4 effets épiphysiodèse avec une réduction angulaire de<br />
63 %, 5 effets fusions et 2 aggravations.<br />
DISCUSSION. Cette série ne permet pas de comparer <strong>les</strong><br />
résultats <strong>des</strong> techniques de résection et d’épiphysiodèse puisque<br />
l’indication dépendait de la topographie de la malformation. On<br />
constate que <strong>les</strong> résections réalisées apportent une correction<br />
immédiate importante et durable dans le temps, conformément<br />
aux données de la littérature. Les résultats <strong>des</strong> épiphysiodèses<br />
convexes sont plus aléatoires et surtout très dépendants du potentiel<br />
de croissance controlatéral. De plus, la zone opérée est plus<br />
étendue que dans <strong>les</strong> résections. Cependant, le geste chirurgical<br />
est moins invasif pour le canal médullaire avec comme corollaire<br />
un risque neurologique potentiel moins important.<br />
CONCLUSION. Les scolioses congénita<strong>les</strong> par hémivertèbre<br />
peuvent être traitées soit par résection soit par épiphysiodèse.<br />
Notre préférence va à la résection en zone lombaire et à l’épiphysiodèse<br />
convexe en zone thoracique.<br />
* Nicolas Bonnevialle, Hôpital <strong>des</strong> Enfants,<br />
330, avenue de Grande-Bretagne, 31023 Toulouse Cedex 3.<br />
82 La correction de l’hypocyphose<br />
thoracique par la réduction simultanée<br />
sur 2 tiges dans le traitement<br />
chirurgical <strong>des</strong> scolioses<br />
Jean-Luc CLÉMENT *, Edouard CHAU,<br />
Marie-José VALLADE, Bruno VARÉ,<br />
Catherine HAYEM<br />
INTRODUCTION. Le devenir à long terme <strong>des</strong> scolioses opérées<br />
dépend en partie de la restitution de courbures sagitta<strong>les</strong> satisfaisantes.<br />
Beaucoup d’auteurs ont constaté la correction mo<strong>des</strong>te<br />
de la cyphose thoracique avec <strong>les</strong> instrumentations segmentaires<br />
par tiges et crochets. Les auteurs présentent une méthode de réduction<br />
qui améliore significativement l’hypocyphose thoracique.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Cinquante-trois scolioses thoraciques<br />
idiopathiques (King II, III ou V) opérées entre 2001 et<br />
2004, ont été instrumentées en utilisant <strong>des</strong> ancrages par vis pédiculaires<br />
ou par pinces vertébra<strong>les</strong> auto-stab<strong>les</strong>. Chaque ancrage<br />
présente un axe fileté polyaxial qui le relie à la tige par un connecteur.<br />
Le serrage de l’écrou sur l’axe fileté permet de translater<br />
l’ancrage vers la tige. Le serrage progressif et alternatif de tous<br />
<strong>les</strong> écrous du côté convexe et concave, assure la réduction de la<br />
déformation, réalisant une manœuvre de translation progressive<br />
de l’ensemble <strong>des</strong> ancrages vers <strong>les</strong> 2 tiges.<br />
RÉSULTATS. Toutes courbures confondues, la cyphose thoracique<br />
moyenne était de 18° en pré opératoire et 32° en post opéra-<br />
toire. Pour <strong>les</strong> 16 dos creux (cyphose inférieure ou égale à 10°), la<br />
cyphose passait de 1° en préopératoire à 27°en postopératoire (gain<br />
de 26°) Pour <strong>les</strong> 13 dos plats (cyphose comprise entre 10° et 20°),<br />
la cyphose passait de 17° à 30° (gain de 13°) et pour <strong>les</strong> 24 dos normaux<br />
(cyphose > 20°), la cyphose passait de 30° à 36° (gain de 6°).<br />
Un seul patient a une hypocyphose postopératoire (18°). Tous <strong>les</strong><br />
autres patients ont une cyphose postopératoire normale supérieure<br />
à 20°. Parallèlement, la scoliose était corrigée de 68 % (57°pre op,<br />
18° post op) avec une perte angulaire de 1 % au recul.<br />
DISCUSSION. De nombreux auteurs (Rhee, Takahashi,<br />
Leung, Lee, Betz, Bridwell) ont constaté le gain non significatif,<br />
sur l’hypocyphose thoracique, <strong>des</strong> instrumentations utilisant <strong>des</strong><br />
ancrages par crochets. D’autres auteurs (Lenke, De Jonge) rapportent<br />
<strong>des</strong> améliorations de l’ordre de 7° à 8°, mais seuls 50 %<br />
<strong>des</strong> patients retrouvent une cyphose normale. Les montages par<br />
vis thoraciques (Suk) rapportent <strong>des</strong> gains significativement supérieurs<br />
(19°). Notre technique combine l’utilisation d’ancrages stab<strong>les</strong><br />
tels vis pédiculaires ou pinces vertébra<strong>les</strong> et une réduction<br />
par une manœuvre de translation de tous <strong>les</strong> ancrages simultanément<br />
vers <strong>les</strong> 2 tiges. Les efforts sont ainsi répartis assurant une<br />
translation puissante. Le gain de 26° sur la cyphose thoracique<br />
pour <strong>les</strong> dos creux est supérieur aux chiffres retrouvés dans la littérature.<br />
La réduction simultanée sur 2 tiges est une méthode que<br />
nous proposons pour la correction de l’hypocyphose thoracique<br />
dans le traitement chirurgical <strong>des</strong> scolioses.<br />
* Jean-Luc Clément, Service d’Orthopédie Pédiatrique<br />
et Chirurgie <strong>des</strong> Scolioses, Hôpital Lenval,<br />
57, avenue de la Californie, 06200 Nice.<br />
83 Résultats de la surveillance <strong>des</strong><br />
potentiels évoqués lors de la correction<br />
chirurgicale <strong>des</strong> scolioses :<br />
intérêt de la sonde épidurale.<br />
Étude prospective de 191 cas<br />
Franck ACCADBLED *, Patrice HENRY,<br />
Maxime COURNOT, Jérôme SALES DE GAUZY,<br />
Jean-Philippe CAHUZAC<br />
INTRODUCTION. Les complications neurologiques de la chirurgie<br />
de la scoliose peuvent être gravissimes par leur retentissement<br />
fonctionnel. Pour limiter ce risque, la surveillance <strong>des</strong><br />
potentiels évoqués s’est développée dès <strong>les</strong> années 1980. Nous utilisons<br />
dans le service une technique de surveillance basée sur l’utilisation<br />
d’une sonde épidurale. L’objectif de ce travail était<br />
d’analyser <strong>les</strong> résultats de cette méthode à partir d’une étude prospective.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Cent quatre-vingt-onze patients<br />
ont été opérés d’une scoliose par arthrodèse et instrumentation<br />
postérieure entre novembre 1999 et juillet 2005. La surveillance<br />
neurologique peropératoire était systématique. Elle utilisait une<br />
électrode épidurale permettant à la fois l’enregistrement <strong>des</strong><br />
potentiels évoqués somesthésiques (PES) et la stimulation<br />
médullaire à l’origine <strong>des</strong> potentiels évoqués neurogéniques<br />
(PEN). L’âge moyen <strong>des</strong> patients était de 15 ans (2-27). Ils ont
été séparés en 3 groupes selon l’étiologie de la scoliose : groupe<br />
I (n = 90) idiopathique, groupe II (n = 79) neuromusculaire et<br />
groupe III (n = 22) autres.<br />
RÉSULTATS. La surveillance électrophysiologique a pu être<br />
réalisée dans 98 % <strong>des</strong> cas pour une au moins <strong>des</strong> 4 modalités<br />
possib<strong>les</strong>. Les réponses cortica<strong>les</strong> ont présenté une forte proportion<br />
de faux positifs, en particulier dans le groupe II. Chez<br />
14 patients, <strong>les</strong> réponses PES cortica<strong>les</strong> et sous cortica<strong>les</strong> étaient<br />
absentes d’emblée ou d’amplitude insuffisante. Ils ont pu été surveillés<br />
uniquement grâce à la sonde épidurale par <strong>les</strong> PES<br />
médullaires et/ou <strong>les</strong> potentiels neurogéniques. Douze cas sur<br />
14 étaient issus du groupe II (p < 0,001). Nous n’avons constaté<br />
aucun cas de faux négatif et l’examen neurologique postopératoire<br />
est resté inchangé par rapport à l’examen préopératoire<br />
chez tous <strong>les</strong> patients. Cinq cas ont été considérés vrais positifs<br />
avec détection précoce d’une souffrance médullaire. Une modification<br />
de la stratégie opératoire a permis de prévenir un déficit<br />
neurologique postopératoire. La sensibilité de la méthode était<br />
de 100 % et sa spécificité de 52,69 %.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. Les résultats de notre<br />
étude sont comparab<strong>les</strong> à ceux de la littérature en termes de faisabilité<br />
et de résultats du monitoring à proprement parler. L’utilisation<br />
de la sonde épidurale a permis d’augmenter le nombre de<br />
cas qui ont pu bénéficier du monitoring, en particulier dans le<br />
groupe <strong>des</strong> scolioses neuromusculaires. Notre technique de<br />
monitoring est fiable en pratique clinique. Ainsi, nous ne réalisons<br />
pas de test du réveil systématique.<br />
* Franck Accadbled, Service de Chirurgie Orthopédique<br />
et Traumatologique Infantile, Hôpital <strong>des</strong> Enfants,<br />
330, avenue de Grande-Bretagne, 31059 Toulouse Cedex 9.<br />
84 Nouvelle technique chirurgicale<br />
pour <strong>les</strong> spondylolisthésis de haut<br />
grade<br />
Brice ILHARREBORDE *, Etienne MOREL,<br />
Franck FITOUSSI,<br />
Georges-François PENNEÇOT, Keyvan MAZDA<br />
INTRODUCTION. La prise en charge <strong>des</strong> spondylolisthesis<br />
est principalement conservatrice. Toutefois, <strong>les</strong> patients présen-<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S71<br />
tant un handicap fonctionnel sévère lié à <strong>des</strong> lombalgies, une<br />
radiculopathie ou un trouble de la marche sont candidats à la chirurgie.<br />
Malgré <strong>les</strong> nombreuses techniques décrites, le traitement<br />
<strong>des</strong> spondylolisthesis de haut grade (Meyerding supérieur ou<br />
égal à III) demeure controversé et difficile. L’arthrodèse, protégée<br />
par une instrumentation stable, est l’objectif à atteindre.<br />
Nous décrivons une procédure innovante, évaluée avec un recul<br />
minimum de 2 ans.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. La technique opératoire a été<br />
développée avec l’objectif de satisfaire 5 pré requis: éviter la<br />
réduction progressive préopératoire, restaurer l’équilibre sagittal<br />
du rachis, épargner <strong>les</strong> racines nerveuses, effectuer une arthrodèse<br />
circonférentielle, et ce au moyen d’une seule procédure<br />
effectuée par voie postérieure. La réduction partielle peropératoire,<br />
permise par <strong>des</strong> vis pédiculaires en L4, une fixation intrasacrée<br />
selon la technique modifiée de Jackson et une résection<br />
du dôme sacré, a été obtenue par une manœuvre de rotation du<br />
sacrum dans le plan sagittal. Les résultats cliniques et radiologiques<br />
<strong>des</strong> 6 premiers patients présentant un spondylolisthesis<br />
L5S1 de haut grade opérés par cette technique ont été revus<br />
rétrospectivement.<br />
RÉSULTATS. L’âge moyen <strong>des</strong> patients était de 17 ans. Cinq<br />
patients avaient en préopératoire un sacrum vertical. Leur<br />
cyphose lombosacrée a été réduite de 70° à 110° grâce à l’intervention.<br />
L’angle lombosacré du seul patient qui présentait un<br />
sacrum horizontal est passé de 135° à 120° en postopératoire. La<br />
lordose moyenne était 55° (+/- 10°) après la procédure. La durée<br />
moyenne opératoire était 240 minutes (+/- 10). Aucune complication,<br />
et en particulier aucun déficit neurologique, n’a été rapporté.<br />
La fusion a été obtenue dans tous <strong>les</strong> cas, sans perte de<br />
correction au dernier recul.<br />
DISCUSSION. La technique modifiée de Jackson, multipliant<br />
<strong>les</strong> points d’ancrage sacrés, permet une réduction peropératoire<br />
en effectuant une manoeuvre de rotation sacrée.<br />
L’absence de translation postérieure de L5 et le raccourcissement<br />
lié à la résection du dôme sacré previennent d’éventuel<strong>les</strong><br />
complications neurologiques. La stabilité immédiate procurée<br />
par l’instrumentation autorise une mise en charge précoce non<br />
protégée évitant toute perte d’autonomie. Une arthrodèse circonférentielle<br />
solide a été obtenue, protégée par un équilibre<br />
sagittal pelvi-rachidien restauré. Les résultats préliminaires sont<br />
encourageants, mais doivent être confirmés à long terme sur une<br />
plus grande série.<br />
* Brice Ilharreborde, Service de Chirurgie Orthopédique,<br />
Hôpital Robert-Debré, 48, boulevard Sérurier, 75019 Paris.
3S72 81 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
85 Étude prospective de l’alignement<br />
et de l’équilibrage ligamentaire<br />
d’une PTG à l’aide d’une instrumentation<br />
mécanique non naviguée<br />
Michel BERCOVY *, Laurent LAVAU<br />
INTRODUCTION. La navigation voulant s’imposer comme la<br />
méthode de choix pour améliorer la précision du positionnement<br />
<strong>des</strong> PTG, nous avons voulu évaluer <strong>les</strong> résultats radiologiques<br />
obtenus avec une instrumentation mécanique conventionnelle afin<br />
d’en juger la précision quant à l’alignement dans <strong>les</strong> 3 plans, à<br />
l’équilibrage ligamentaire et aux risques de positionnement aberrant<br />
par hypo ou hypercorrection.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Deux cent soixante-dix patients<br />
ont eu une mesure prospective pré et postopératoire portant sur<br />
<strong>les</strong> radios de face, de profil, défilé FP à 30°, goniométrie et scanner<br />
de mesure de l’antetorsion fémorale et de la torsion tibiale<br />
ainsi qu’une mesure de la laxité frontale et antéro postérieure.<br />
Les paramètres mesurés furent : l’axe mécanique global, l’angle<br />
alfa fémoral, l’angle bêta tibial, l’antétorsion fémorale, la rotation<br />
tibiale, la bascule et la subluxation fémoropatellaire, la congruence<br />
fémoropatellaire, le déport condylien postérieur (offset),<br />
la hauteur rotulienne, la pente tibiale.<br />
RÉSULTATS. Les génuvarum sont corrigés avec un axe<br />
mécanique à 0° +/- 1,6° ; <strong>les</strong> génuvalgum avec un axe final à<br />
1° +/- 2,2°. L’angle A fémoral est de 97° + /- 2°, l’angle B tibial<br />
de 90° +/- 2°, la pente de 5° +/- 2°, la bascule rotulienne de 0° +/<br />
-3°, la subluxation de 0 mm +/- 1 mm. La rotation fémorale est<br />
de 7° +/- 2° ; l’offset condylien est de 0,45. L’équilibrage ligamentaire<br />
objective une laxité frontale inférieure à 3° dans le plan<br />
frontal dans 96,6 % <strong>des</strong> cas et de 4° à 8° dans 3,4 % <strong>des</strong> cas.<br />
DISCUSSION. En comparaison avec <strong>les</strong> résultats obtenus à<br />
l’aide <strong>des</strong> systèmes navigués, <strong>les</strong> résultats moyens restent dans<br />
une fourchette de +/- 2° pour l’ensemble <strong>des</strong> paramètres mesurés.<br />
Néanmoins, l’analyse détaillée laisse apparaître que 5 % <strong>des</strong><br />
génuvarum de plus de 6° en préopératoire et 10 % <strong>des</strong> genu valgum<br />
de plus de 8° gardent un défaut de correction postopératoire<br />
de plus de 4°. De plus, nous avons observé 2 % d’hypercorrections<br />
pouvant entraîner un inconfort à la marche.<br />
CONCLUSION. Cette étude montre que le résultat global<br />
permis par l’ancillaire non navigué reste dans la même précision<br />
moyenne que celui rapporté par <strong>les</strong> auteurs pratiquant la navigation.<br />
L’équilibrage ligamentaire est excellent. Cependant, la<br />
comparaison <strong>des</strong> moyennes ne donne pas une certitude totale sur<br />
la technique la plus précise. Il serait intéressant de comparer plus<br />
spécifiquement <strong>les</strong> échecs par hypo ou hyper correction avec<br />
chacune <strong>des</strong> techniques afin de connaître le meilleur rapport risque/efficacité.<br />
* Michel Bercovy, Clinique <strong>les</strong> Fontaines,<br />
54, boulevard Aristide-Briand, 77000 Melun.<br />
Séance du 7 novembre matin<br />
GENOU<br />
86 Incidence sur la rotule du positionnement<br />
en rotation du composant<br />
fémoral par une dépendance <strong>des</strong><br />
coupes osseuses en flexion et en<br />
extension<br />
Bertrand GALAUD *, Benoît LEBEL,<br />
Gil<strong>les</strong> BURDIN, Mathieu MICHAUT,<br />
Christophe HULET, Claude VIELPEAU<br />
INTRODUCTION. Le réglage de la rotation du composant<br />
fémoral de la prothèse totale de genou est l’objet de controverses.<br />
De nombreux auteurs utilisent la ligne bi-épicondylienne<br />
soit comme référence opératoire, soit pour contrôler la qualité de<br />
la rotation obtenue. Nous utilisons une autre méthode consistant<br />
à reporter en flexion l’espace obtenu en extension puis à rendre<br />
« rectangulaire » l’espace en flexion par <strong>les</strong> coupes antéro-postérieures<br />
grâce à un ancillaire spécifique (Cores ® ). Avec cette<br />
méthode, la position en rotation externe par rapport à la ligne bi<br />
épicondylienne varie de 0 à 6°. L’objectif du présent travail était<br />
d’étudier le retentissement de cette méthode sur l’articulation<br />
fémoro-patellaire.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Cent deux prothèses Jade ® ,<br />
toutes opérées par le même chirurgien, ont été revues rétrospectivement<br />
avec un recul moyen de 7,3 ans + 2 chez 87 patients,<br />
majoritairement <strong>des</strong> femmes, d’un âge moyen de 71 ans<br />
(29-89). Dix-sept avaient déjà eu une ostéotomie, 16 fois tibiale.<br />
Avant l’intervention, le score IKS genou moyen était de 22,4, le<br />
score fonction de 44,1. Soixante-six genoux étaient en genu<br />
varum, 31 en genu valgum et 5 normo axés. La subluxation<br />
moyenne était de 1,5 mm+3,4 (-5 à 12) et la bascule de 7,5°+5<br />
(-2 à 17). Un médaillon rotulien a été scellé 12 fois, au début de<br />
la série. Dans 3 cas, la rotule, non resurfacée, a été complétement<br />
retracée à la scie.<br />
RÉSULTATS. Aucune prothèse n’a été reprise mais un genou<br />
(jeune hémophile) doit l’être prochainement. Le score IKS<br />
genou au recul est de 90,1 (gain 67,7 points) et le score fonction<br />
de 83,5 (gain 39,4 pts). La mobilité moyenne était de 109,17° en<br />
flexion. Deux patients ont un granulome fémoral (dont celle qui<br />
doit être réopérée). Une rotule sur 5 avait une subluxation rotulienne<br />
de plus de 2 mm avec une adaptation au carter fémoral,<br />
sans aucune influence significative sur <strong>les</strong> douleurs résiduel<strong>les</strong>,<br />
la mobilité, ni <strong>les</strong> scores IKS genou et fonction. La bascule rotulienne<br />
était très significativement améliorée (en moyenne<br />
1,5° + 3,4 au plus grand recul). La position de la rotule n’était<br />
pas influencée par l’importance <strong>des</strong> différences de coupes mesurée<br />
<strong>des</strong> condy<strong>les</strong> postérieurs (reflet de la rotation du composant<br />
fémoral).<br />
CONCLUSION. Les résultats cliniques et radiologiques de<br />
cette série confirment qu’il est possible de régler la rotation du<br />
composant fémoral par rapport à l’espace en flexion. Les coupes<br />
fémora<strong>les</strong> postérieures et antérieures sont alors dépendantes <strong>des</strong>
coupes tibiale et fémorale distale sans tenir compte <strong>des</strong> repères<br />
anatomiques fémoraux.<br />
* Bertrand Galaud, Département d’Orthopédie-Traumatologie,<br />
CHU Côte de Nacre, 14033 Caen Cedex.<br />
87 Critères prédictifs du niveau de<br />
contrainte nécessaire lors de la<br />
mise en place d’une prothèse<br />
totale du genou pour genu valgum<br />
de plus de 5° : étude sur 93 cas<br />
François GOUGEON *, Mickael AMZALLAG,<br />
Yannick PINOIT, Julien GIRARD,<br />
Philippe LAFFARGUE, Henri MIGAUD<br />
INTRODUCTION. L’équilibrage ligamentaire lors de la mise<br />
en place d’une prothèse totale (PTG) sur un genu valgum peut<br />
être difficile à obtenir, conduisant certains à proposer de manière<br />
systématique <strong>des</strong> PTG contraintes. On peut tenter de moduler le<br />
niveau de contrainte, en réservant <strong>les</strong> contraintes élevées<br />
lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir un équilibrage satisfaisant :<br />
moins de 5° de laxité frontale résiduelle en extension, pas de<br />
déséquilibre entre <strong>les</strong> laxités en flexion et en extension. Le but de<br />
ce travail était d’identifier <strong>les</strong> critères prédictifs d’utilisation<br />
d’une prothèse contrainte.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Une série consécutive de<br />
93 PTG implantées pour une déformation en valgus de plus de<br />
5° a été analysée rétrospectivement. Sur le pangonogramme de<br />
face en charge, l’angle HKA était en moyenne de 195° (186° à<br />
226°), 36 genoux ayant plus de 15° de valgus et 19 genoux ayant<br />
plus de 20° de valgus. La laxité a été appréciée sur <strong>des</strong> radiographies<br />
en stress au moyen d’un appareil Telos à 100N. Cinquantedeux<br />
genoux avaient une laxité frontale préopératoire de plus de<br />
10°. Quatorze genoux avaient plus de 5° de laxité de la convexité,<br />
21 genoux avaient plus de 10° de laxité de la concavité.<br />
L’analyse statistique comportait <strong>des</strong> analyses univariées, identifiant<br />
<strong>des</strong> facteurs ayant conduit à une contrainte élevée, dont<br />
l’indépendance a été testée par une analyse multivariée. Une<br />
analyse de régression logistique a permis de classer ces facteurs<br />
au moyen <strong>des</strong> odd-ratio.<br />
RÉSULTATS. Une prothèse à contrainte élevée de type CCK a<br />
dû être utilisée pour 26 <strong>des</strong> 93 implantations (<strong>les</strong> autres PTG étant<br />
postéro stabilisées (PS)). Les facteurs préopératoires ayant conduit<br />
à élever la contrainte étaient : 1) la sévérité du valgus selon<br />
l’angle HKA (PS = 193°, CCK = 198°), 2) une pente tibiale<br />
importante (PS = 4,8°, CCK = 6,5°), 3) une faible hauteur patellaire<br />
(indice de Blackburne PS = 0,9, CCK = 0,77), 5) la sévérité<br />
de la laxité en valgus (PS = 2,3°, CCK = 4,3°). Parmi tous ces<br />
facteurs, le seul indépendant était la laxité en valgus (p = 0,0008).<br />
L’étude <strong>des</strong> odd-ratio montrait une probabilité deux fois plus<br />
grande de mettre en place une prothèse à contrainte élevée pour<br />
chaque augmentation de 1° de laxité en valgus.<br />
CONCLUSION. Cette étude démontre que ce n’est pas la<br />
sévérité du valgus qui expose le plus à l’utilisation d’une prothèse<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S73<br />
contrainte, mais la sévérité de la laxité de la convexité. D’autres<br />
facteurs, comme une rotule basse ou une pente tibiale postérieure<br />
élevée, lorsqu’ils sont associés potentialisent cet effet et doivent<br />
mettre en garde le chirurgien sur <strong>les</strong> difficultés d’équilibrage.<br />
* François Gougeon, Service d’Orthopédie D, Hôpital Salengro,<br />
CHRU de Lille, place de Verdun, 59037 Lille Cedex.<br />
88 Arthroplastie totale du genou sur<br />
genu valgum fixé par voie latérale<br />
sans ostéotomie tubérositaire<br />
Denis HUTEN *, Patrick BOYER, Daniel BOUBLIL<br />
et le groupe GUEPAR<br />
Les auteurs rapportent leur expérience de 65 arthroplasties<br />
tota<strong>les</strong> sur valgus fixé de plus de 10° par voie latérale (entre le<br />
vaste latéral et le rectus fémoris) sans détacher la tubérosité<br />
tibiale antérieure. La prothèse sacrifiait le ligament croisé postérieur<br />
(LCP) et la rotule était resurfacée dans tous <strong>les</strong> cas. L’aileron<br />
latéral était laissé ouvert et l’arthrotomie fermée à l’aide<br />
d’un lambeau ménisco-graisseux à pédicule postérieur. Le nerf<br />
fibulaire commun a été libéré trois fois.<br />
Il s’agissait de 60 femmes et 5 hommes âgés en moyenne de<br />
65 ans (40 à 86) présentant 42 arthroses et 23 arthrites rhumatoï<strong>des</strong>.<br />
La déviation en valgus, fixée, était de 14° en moyenne (10 à<br />
29°). En préopératoire, le score IKS était de 28,6 points, le score<br />
fonction de 25,3 points, la flexion de 108,7° et le flexum de 9,5° en<br />
moyenne. La libération du fascia, désinséré du tubercule de Gerdy<br />
en continuité avec l’aponévrose jambière a suffi 57 fois. Le tendon<br />
du poplité et le ligament collatéral latéral n’ont été libérés que<br />
8 fois. Deux souffrances cutanées ont évolué favorablement. Une<br />
luxation fémoro-tibiale a été réduite. Une infection à 5 mois a<br />
nécessité une réimplantation en deux temps. Une paralysie du nerf<br />
fibulaire commun a régressé. Une section du tendon poplité à<br />
8 mois a été nécessaire en raison d’un ressaut douloureux en<br />
flexion. Deux patientes ont présenté une laxité en valgus évolutive,<br />
nécessitant une reprise (un changement de plateau tibial et une prothèse<br />
charnière). Le recul moyen est de 4 ans (de 1 à 9 ans). Au<br />
dernier recul, tous <strong>les</strong> genoux étaient indolores ou presque, la<br />
flexion de 116° (95 à 130°) et le flexum de 3° (0 à 10). Les scores<br />
genou et fonction étaient de 91,7 (38 à 100) et 62,6 (25 à 100) respectivement.<br />
Le genou était aligné (entre 178 et 183°) dans 82 %<br />
<strong>des</strong> cas. La rotule était centrée et non basculée dans 87,5 % <strong>des</strong> cas.<br />
L’abord latéral sans détacher la tubérosité est à lui seul suffisant<br />
pour corriger la désaxation dans la majorité <strong>des</strong> cas. Il<br />
assure le centrage rotulien et respecte la vascularisation rotulienne.<br />
Il procure un accès facile au plan capsulo-ligamentaire<br />
éventuellement rétracté. Le lambeau ménisco-graisseux est un<br />
procédé fiable de fermeture de l’arthrotomie. Une distension préopératoire<br />
importante du plan médial, qui expose à la laxité en<br />
valgus, est la limite de cette technique. Toute désaxation résiduelle<br />
en valgus potentialise cette complication.<br />
* Denis Huten, Service de Chirurgie Orthopédique,<br />
Hôpital Bichat Claude-Bernard, 46, rue Henri-Huchard,<br />
75018 Paris.
3S74 81 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
89 Récupération de la flexion en fonction<br />
du type de prothèse totale du<br />
genou (à conservation du ligament<br />
croisé postérieur, postéro-stabilisé,<br />
à plateau ultra-congruent)<br />
Stéphane PETERS *, Denis HUTEN<br />
et le groupe GUEPAR<br />
Les auteurs comparent la mobilité obtenue avec 3 modè<strong>les</strong><br />
d’une même gamme de prothèses suivies prospectivement : l’un<br />
conservant le ligament croisé postérieur (LCP) (groupe I) et <strong>les</strong><br />
deux autres qui le sacrifient : prothèses postéro-stabilisée<br />
(groupe II) et à plateau ultra-congruent (groupe III). Les patients<br />
ont été sélectionnés dans la base de données afin d’obtenir<br />
3 groupes comparab<strong>les</strong> : gonarthrose sur varus de 15° au plus,<br />
absence d’intervention antérieure, flexion de 110° ou plus, f<strong>les</strong>sum<br />
de 5° au plus, indice de masse corporelle (IMC) inférieur ou<br />
égal à 35. Toutes <strong>les</strong> prothèses ont été pratiquées avec la même<br />
instrumentation par un seul opérateur. La rotule a été resurfacée<br />
dans tous <strong>les</strong> cas. Les protoco<strong>les</strong> de rééducation et d’analgésie<br />
étaient identiques dans <strong>les</strong> 3 groupes. Le groupe I comporte<br />
72 prothèses (1993-1999), le groupe II 61 (1995-2001) et le<br />
groupe III 52 (2001-2004). La mobilité a été mesurée à l’aide<br />
d’un goniomètre à longues branches en se basant sur <strong>les</strong> centres<br />
du genou, du grand trochanter et de la cheville. Les trois populations<br />
n’étaient pas statistiquement différentes en termes d’âge,<br />
sexe, importance du varus, IMC et flexion moyenne: 121,8°<br />
(écart-type :9,7°) pour le groupe I, 121,3° (écart-type :10,6°)<br />
pour le groupe II et 121,6° (écart-type :10,3°) pour le groupe III.<br />
La flexion moyenne à 2 ans <strong>des</strong> trois groupes était respectivement<br />
de 110,3° (écart-type de 9,7°), 122,2° (écart-type de 7,2°)<br />
et 118,4° (écart-type de 9,2°). Il y avait une différence significative<br />
entre <strong>les</strong> groupes I et II et entre <strong>les</strong> groupes I et III mais pas<br />
entre <strong>les</strong> groupes II et III.<br />
La différence moyenne entre la flexion à 24 mois et la flexion<br />
pré-opératoire était respectivement de -11,5° (écart-type de<br />
10,3°) pour le groupe I, 0,9° (écart-type de 11,2°) pour le<br />
groupe II et -2,6° (écart-type de 12,2°) pour le groupe III. Il y<br />
avait une différence significative entre <strong>les</strong> groupes I et II et entre<br />
<strong>les</strong> groupes I et III mais pas entre <strong>les</strong> groupe II et III.<br />
Il n’y avait pas de différence significative entre le nombre de<br />
mobilisations sous anesthésie, le flexum, <strong>les</strong> scores IKS et le<br />
degré de satisfaction à 24 mois dans <strong>les</strong> trois groupes. Le sacrifice<br />
du LCP favorise donc la récupération d’une flexion un peu<br />
meilleure dans une population d’arthroses peu sévères, sans<br />
influencer <strong>les</strong> autres paramètres permettant d’évaluer la qualité<br />
du résultat.<br />
* Stéphane Peters, Service de Chirurgie Orthopédique,<br />
Hôpital Bichat Claude-Bernard, 46, rue Henri-Huchard,<br />
75018 Paris.<br />
90 Résultats comparatifs <strong>des</strong> prothèses<br />
tota<strong>les</strong> de genou posées sur<br />
<strong>des</strong> arthropathies avec genu varum<br />
inférieur à 178° et avec genu valgum<br />
supérieur à 182° avec un<br />
recul moyen de 8,3 ans<br />
Stéphane VAN DRIESSCHE *, Olivier MANICOM,<br />
Daniel GOUTALLIER<br />
INTRODUCTION. Quelle que soit la déformation frontale<br />
préopératoire <strong>des</strong> genoux, on admet que la pose d’une prothèse<br />
totale doit aligner <strong>les</strong> axes mécaniques frontaux fémoraux et<br />
tibiaux. Cette attitude est elle satisfaisante ?<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Parmi <strong>les</strong> prothèses sans contrainte<br />
rotatoire à plateau fixe scellées implantées en première<br />
intention par un opérateur entre 1991 et 1994 pour traiter 9 fois/<br />
10 <strong>des</strong> gonarthroses, 53 l’avaient été sur <strong>des</strong> genu varum inférieurs<br />
à 178° et 30 sur <strong>des</strong> genu valgum supérieurs à 182°. En<br />
préopératoire, il n’existait pas de différence entre <strong>les</strong> deux groupes<br />
sauf pour <strong>les</strong> goniométries et le poids (<strong>les</strong> opérés avec genu<br />
varum étaient plus lourds). Les scores genou IKS et <strong>les</strong> résultats<br />
radiologiques ont été appréciés à un an et au recul maximum<br />
(8,3 + 3 ans). Les goniométries debout ont permis de mesurer <strong>les</strong><br />
ang<strong>les</strong> tibiaux et fémoraux internes (ATI et AFI). Seu<strong>les</strong> <strong>les</strong> variations<br />
supérieures à 2° ont été prises en compte, <strong>les</strong> variations de<br />
l’ATI et de l’AFI définissant <strong>les</strong> <strong>des</strong>cellements <strong>des</strong> implants. Les<br />
index de torsion tibio-fémoraux (ITF) post-prothétiques étaient<br />
connus pour 24 anciens genu varum et 12 anciens genu valgum.<br />
RÉSULTATS. En postopératoire, la désaxation frontale<br />
moyenne était de 178,3° pour <strong>les</strong> PTG sur genu varum et de<br />
179,5 pour cel<strong>les</strong> sur genu valgum. Au recul maximum, <strong>les</strong> prothèses<br />
posées sur genu varum et sur genu valgum avaient <strong>des</strong> scores<br />
genou (76,5 vs 78.3) sans différence statistique. Mais la<br />
détérioration dans le temps du score genou et <strong>des</strong> laxités fronta<strong>les</strong><br />
n’était statistiquement réelle que pour <strong>les</strong> genu varum prothésés<br />
(p = 0,02). Il y avait plus de <strong>des</strong>cellements angulaires <strong>des</strong><br />
implants pour <strong>les</strong> prothèses sur genu varum (22 % vs 6,5 %). La<br />
variation de la désaxation frontale se faisait 9 fois/10 vers le<br />
varus pour <strong>les</strong> PTG sur genu varum et 1 fois/3 vers le valgus pour<br />
cel<strong>les</strong> sur genu valgum. Les 5 prothèses reprises pour <strong>des</strong>cellement<br />
provenaient <strong>des</strong> genu varum.<br />
DISCUSSION. La différence d’évolution <strong>des</strong> PTG sur genu<br />
varum et sur genu valgum pouvait être en rapport avec <strong>des</strong> ITF<br />
post prothétiques différents (respectivement +9 vs -2,3,<br />
p = 0,01). Pour <strong>les</strong> prothèses posées sur genu varum, <strong>les</strong> contraintes<br />
fémoro-tibia<strong>les</strong> internes dues aux ITF positifs devaient<br />
s’ajouter aux contraintes fémoro-tibia<strong>les</strong> internes de varus persistant<br />
provoquant <strong>les</strong> <strong>des</strong>cellements angulaires et l’augmentation<br />
du varus. À l’opposé pour <strong>les</strong> prothèses sur genu valgum <strong>les</strong><br />
contraintes fémoro-tibia<strong>les</strong> externes dues aux ITF négatifs devaient<br />
annihiler <strong>les</strong> contraintes fémoro-tibia<strong>les</strong> internes du léger<br />
varus persistant.<br />
CONCLUSION. Il semble que la pose <strong>des</strong> prothèses sur genu<br />
varum devraient entraîner un valgus dont l’importance devrait<br />
être adaptée à la valeur de l’ITF préopératoire. À l’opposé, un
léger varus pour une prothèse posée sur genu valgum semble<br />
satisfaisant à 8,3 ans de recul.<br />
* Stéphane Van Driessche, Hôpital Privé A. Brillard,<br />
3, avenue Watteau, 94130 Nogent-sur-Marne.<br />
91 Prothèse totale du genou par voie<br />
mini-invasive<br />
Philippe HERNIGOU *, Alexandre POIGNARD,<br />
Gil<strong>les</strong> MATHIEU, Paolo FILIPPINI, Ali DEMOURA,<br />
Anis CHOUK<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Quarante-cinq prothèses tota<strong>les</strong><br />
de genou implantées par mini voie d’abord avec 2 ans de recul,<br />
ont été comparées à un série de 45 prothèses conventionnel<strong>les</strong> :<br />
critères radiologiques, flexion, marche, pratique <strong>des</strong> escaliers et<br />
évaluation fonctionnelle par un test objectif de la force quadricipitale.<br />
La fréquence de germes présents sur le matériel ancillaire<br />
en fin d’intervention a été utilisée comme témoin indirect du contact<br />
<strong>des</strong> ancillaires avec la peau. Une étude in vitro avec artériographie<br />
a précisé la vascularisation cutanée. Les contraintes<br />
exercées sur la peau par <strong>les</strong> écarteurs ont été évaluées par capteurs<br />
de pression. Le nombre de particu<strong>les</strong> métalliques causées par le<br />
frottement <strong>des</strong> scies sur <strong>les</strong> ancillaires a été evalué.<br />
RÉSULTATS. L’incision cutanée du mini-abord ainsi que<br />
l’arthrotomie étaient limitées de 10 à 12 cm. Dans la voie d’abord<br />
classique, l’incision était comprise entre 18 et 25 cm. Il n’a pas été<br />
retrouvé de différence significative entre <strong>les</strong> deux groupes pour<br />
l’axe mécanique du membre (respectivement 3,2° et 1,4° de<br />
varus), l’angle d’implantation tibiale et la pente tibiale. L’angle<br />
d’implantation fémorale était comparable dans <strong>les</strong> deux groupes,<br />
mais avec un écart type plus élevé pour la voie d’abord mini-invasive.<br />
Les pertes sanguines évaluées sur le redon et <strong>les</strong> transfusions<br />
ainsi que la douleur évaluée sur la consommation <strong>des</strong> morphiniques<br />
étaient moins élevées dans le groupe du mini-abord. La<br />
flexion était plus importante à un mois dans le groupe du miniabord,<br />
mais était redevenue similaire à 3 mois. La force quadricipitale<br />
moyenne à un mois était de 350 Newtons avec le mini abord<br />
et de 90 Newtons avec l’incision classique. Aucune nécrose cutanée<br />
n’a été observée dans le mini-abord ; deux souffrances cutanées<br />
ont été observées sur <strong>les</strong> incisions classiques. La<br />
vascularisation cutanée est meilleure avec le mini-abord. Une<br />
diminution de l’incision de 15 cm à 10 cm augmente de 180 % <strong>les</strong><br />
contraintes <strong>des</strong> écarteurs sur la peau. Le nombre de particu<strong>les</strong><br />
métalliques produites par <strong>les</strong> scies est significativement moins<br />
important avec l’ancillaire du mini-abord. En revanche, <strong>les</strong> germes<br />
y sont présents plus souvent.<br />
DISCUSSION. La réduction de la taille de l’incision<br />
n’apporte <strong>des</strong> avantages que pendant une période courte. Elle<br />
n’est cependant pas sans inconvénients : il n’apparaît pas souhaitable<br />
de réduire l’incision à moins de 11 cm.<br />
* Philippe Hernigou, Service de Chirurgie Orthopédique,<br />
Hôpital Henri-Mondor,<br />
51, avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, 94000 Créteil.<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S75<br />
92 Étude comparative <strong>des</strong> résultats<br />
cliniques et radiologiques <strong>des</strong> prothèses<br />
tota<strong>les</strong> de genou implantées<br />
par voie mini-invasive ou<br />
conventionnelle<br />
Sébastien PARRATTE *, Xavier FLECHER,<br />
Jean-Noël ARGENSON<br />
INTRODUCTION. L’objectif de cette étude était de comparer<br />
<strong>les</strong> résultats <strong>des</strong> arthroplasties tota<strong>les</strong> de genou opérées par voie<br />
mini-invasive ou par voie conventionnelle, en terme de récupération<br />
post-opératoire, de résultats fonctionnels et de positionnement<br />
<strong>des</strong> implants.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Une série continue de 43 arthroplasties<br />
tota<strong>les</strong> de genou réalisées par voie mini-invasive (groupe<br />
MIS) a été comparée à une série statistiquement comparable de<br />
67 arthroplasties (groupe T : témoin) réalisées pendant la même<br />
période par voie conventionnelle. Le même implant postéro-stabilisé<br />
cimenté à plateau mobile a été utilisé dans tous <strong>les</strong> cas.<br />
Tous <strong>les</strong> patients ont été opérés par le même opérateur. Les amplitu<strong>des</strong><br />
de flexion ont été mesurées dans <strong>les</strong> deux groupes à 6 et<br />
12 semaines puis à un an post-opératoire. L’évaluation clinique a<br />
été réalisée à l’aide <strong>des</strong> scores IKS fonction et genou à un an postopératoire<br />
dans <strong>les</strong> deux groupes. L’analyse radiographique à un<br />
an de recul comprenait un cliché de face et de profil ainsi qu’une<br />
télémétrie.<br />
RÉSULTATS. L’amplitude moyenne de flexion était respectivement<br />
pour <strong>les</strong> groupes MIS et T de 115 degrés (90°-130°) et 105<br />
degrés (90°-120°) à 6 semaines (p < 0,01), puis de 124 degrés<br />
(110°-135°) et 118 degrés (95°-130°) à 12 semaines (p < 0,05) et<br />
de 128 degrés (110°-145°) et de 129 degrés (95°-145°) (NS) à<br />
1 an. Les scores moyen IKS étaient respectivement dans <strong>les</strong> groupes<br />
MIS et T de 90 points (75-100) et 91 points (43-100) pour le<br />
score fonction (NS) et de 94 points (73-100) et 93 points (42-100)<br />
pour <strong>les</strong> score Genou (NS). L’analyse radiologique a retrouvé respectivement<br />
en moyenne dans le groupe MIS et dans le groupe T<br />
un angle HKA de 179° (182°-174°) et de 178° (187°-171°) (NS),<br />
un angle fémoral de 93° (90°-96°) et de 90° (86°-95°) (NS), un<br />
angle tibial de 86° (82°-89°) et de 87° (80°-92°) (NS), une pente<br />
tibiale postérieure de 6° (0°-10°) et de 4° (0°-9°) (NS).<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. Les résultats de cette<br />
étude rétrospective mettent en évidence une récupération plus<br />
rapide <strong>des</strong> amplitu<strong>des</strong> articulaires avec la technique mini-invasive<br />
sans différence en terme de résultats fonctionnels à un an. Des<br />
étu<strong>des</strong> prospectives comparatives intégrant <strong>des</strong> éléments fonctionnels<br />
et <strong>des</strong> scores de qualité de vie ainsi qu’un suivi radiologique<br />
à long terme <strong>des</strong> implants semblent nécessaire pour<br />
confirmer la fiabilité de la technique.<br />
* Sébastien Parratte, Service de Chirurgie Orthopédique,<br />
Hôpital Sainte-Marguerite,<br />
270, boulevard de Sainte-Marguerite, 13009 Marseille.
3S76 81 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
93 Prothèse totale de genou assistée<br />
par ordinateur avec 2 abords différents<br />
conventionnel et mini-invasif :<br />
étude prospective randomisée et<br />
comparative<br />
Patrice GRAF *, Louis-Philippe AMIOT<br />
INTRODUCTION. L’objectif de cette étude était de vérifier<br />
et de comparer le bénéfice de l’assistance par ordinateur pour la<br />
chirurgie prothétique du genou entre un abord conventionnel<br />
sous le vaste interne avec retournement de la rotule et une voie<br />
d’abord limitée sans luxation de la rotule.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Deux évaluations consécutives<br />
réalisées. La première avec 50 patients opérés par abord conventionnel,<br />
randomisés avec et sans navigation. Les cas navigués<br />
utilisent le logiciel spécifique NK II version 1.1 (Navitrack<br />
Orthosoft, Montréal). La deuxième concerne 70 patients randomisés,<br />
opérés par un abord limité. La version Orthosoft Universal<br />
TKR 2.0 adaptée à la chirurgie mini-invasise est utilisée. Les<br />
mesures radiographiques préopératoires et à six semaines comprennent<br />
l’axe global longitudinal et l’orientation fémorale et<br />
tibiale <strong>des</strong> implants. Les mesures radiographiques étaient réalisées<br />
par un observateur indépendant, aveugle de la randomisation<br />
utilisant le système Imagika (ViewTec, Saint-Maurice,<br />
France). Pour <strong>les</strong> cas navigués, <strong>des</strong> photos d’écran peropératoire<br />
permettent de comparer <strong>les</strong> valeurs affichées et <strong>les</strong> données<br />
radiographiques postopératoires. Les analyses sont réalisées<br />
avec une valeur p de 0,05, statistiquement significative.<br />
RÉSULTATS. Première série conventionnelle. Préopératoire :<br />
axe longitudinal cas non navigués 176,7 ± 9,3° et 174,7 ± 7,2°<br />
cas navigués, sans différence significative pour la moyenne et<br />
l’écart type. Postopératoire : axes respectifs 179,3 ± 3,3° et<br />
178,7 ± 2,6°, avec une réduction significative dans la variable<br />
pour le groupe navigué (p = 0,004 pour le F-test). Groupe non<br />
navigué 79 % <strong>des</strong> implants fémoraux et 79 % <strong>des</strong> implants<br />
tibiaux compris dans la fourchette <strong>des</strong> ± 3° comparés à 100 % et<br />
83 % respectivement pour <strong>les</strong> cas navigués. Deuxième série<br />
mini-invasif : 26 cas non navigués et 15 cas navigués exploités.<br />
Préopératoire : axes respectifs 173,9 ± 5,9° et 175,5 ± 8,1°, sans<br />
différence significative. Postopératoire : scores respectifs<br />
179 ± 5,9° et 180,1 ± 2,2° sans valeur statistique encore en raison<br />
du nombre insuffisant. Cinq cas non navigués avec axe final<br />
hors limite <strong>des</strong> ± 3° comparés à 1 cas navigué.<br />
DISCUSSION. La CAO améliore la précision du geste chirurgical.<br />
Nonobstant une 2 e série encore incomplète, ce bénéfice<br />
semble supérieur dans <strong>les</strong> abords moins invasifs. La fiabilité<br />
radiologique doit être discutée.<br />
CONCLUSION. Pour la pratique chirurgicale actuelle, la<br />
navigation doit être simple, rapide d’utilisation, compatible avec<br />
toutes <strong>les</strong> voies d’abord et fiable dans sa précision. Dans ce contexte,<br />
le système utilisé Orthosoft Universal Knee adapté aux<br />
voies d’abord limitées nous semble satisfaisant.<br />
* Patrice Graf, 21, rue du Restic, 29604 Brest Cedex.<br />
94 Résultats précoces et à moyen<br />
terme <strong>des</strong> prothèses tota<strong>les</strong> de<br />
genou chez l’hémophile à propos<br />
de 30 cas<br />
Philippe BOVIER-LAPIERRE *, Hervé CHAVANE,<br />
Jean-Marc DURAND, Gualter VAZ,<br />
Anne-Marie LIENHART, Jean-Paul CARRET,<br />
Jacques BÉJUI-HUGUES<br />
INTRODUCTION. Le propos de l’étude était d’exposer notre<br />
expérience d’implantation de PTG dans <strong>les</strong> arthropathies hémophiliques<br />
du genou.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Nous avons suivi 24 patients<br />
(30 genoux) porteurs d’une hémophilie sévère qui ont bénéficié<br />
d’une arthroplastie totale de genou dans le service entre 1999 et<br />
2004. L’âge moyen était 40 ans. Tous <strong>les</strong> patients ont bénéficié<br />
en péri-opératoire d’un protocole de substitution en facteur 8 ou<br />
9. Tous ont bénéficié d’une arthroplastie totale du genou (22 prothèses<br />
à glissement et 8 prothèses charnières). Nous avons évalué<br />
la difficulté <strong>des</strong> suites postopératoires immédiates (recours à<br />
la transfusion, complications précoces, durée de séjour...) et <strong>les</strong><br />
résultats à moyen terme (score IKS fonction, amplitu<strong>des</strong> articulaires,<br />
flexum résiduel...) avec un recul moyen de deux ans.<br />
RÉSULTATS. Au niveau <strong>des</strong> complications immédiates, nous<br />
avons observé un cas de nécrose cutanée et un cas de fracture du<br />
condyle interne. Seuls 30 % <strong>des</strong> patients ont été transfusés. La<br />
durée moyenne du séjour était de 17 jours. À moyen terme, on<br />
observe une amélioration de 30 à 50 points du score IKS-fonction<br />
et une diminution très nette et constante <strong>des</strong> douleurs.<br />
Aucun cas de sepsis précoce ou tardif n’a été observé. Dans la<br />
totalité <strong>des</strong> cas de flexum préopératoire, on observe une correction<br />
ou amélioration significative. En revanche, il n’a été observé<br />
une amélioration de la flexion du genou de plus de 20 degrés que<br />
dans 20 % <strong>des</strong> cas.<br />
DISCUSSION. Nous n’avons pas de cas d’infection post opératoire,<br />
y compris pour <strong>les</strong> patients VIH positifs alors que certaines<br />
séries ont un taux de sepsis de 15 %. Sous traitement de<br />
substitution, <strong>les</strong> suites sont globalement simp<strong>les</strong> (durée de séjour<br />
comparable à celle d’une PTG standard). Les résultats à moyens<br />
terme sont bons, avec une amélioration très nette de la fonction,<br />
même si le gain en terme d’amplitude articulaire reste limité.<br />
CONCLUSION. Au prix d’un traitement médical lourd et<br />
coûteux, l’arthroplastie dans <strong>les</strong> arthropathies hémophiliques du<br />
genou, est une intervention comparable à la réalisation d’une<br />
PTG standard et dont le résultat est corrélé à l’importance <strong>des</strong><br />
lésions initia<strong>les</strong>.<br />
* Philippe Bovier-Lapierre, Service de Chirurgie Orthopédique,<br />
Pavillon T, Hôpital Edouard-Herriot, 5, place d’Arsonval,<br />
69437 Lyon cedex 03.
95 Prothèse totale du genou après<br />
échec de prothèse unicompartimentaire<br />
interne : à propos de<br />
33 cas<br />
Gil<strong>les</strong> ESTOUR *, Dominique SARAGAGLIA<br />
INTRODUCTION. Le but de ce travail était d’évaluer <strong>les</strong><br />
résultats cliniques et radiologiques de 33 prothèses tota<strong>les</strong> du<br />
genou (PTG) mises en place entre janvier 1993 et mars 2005<br />
après échec de prothèses unicompartimentaires (PUC) internes.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Nous avons opéré 23 femmes et<br />
10 hommes âgés en moyenne de 78,1 ± 8,42 ans (55-94) au<br />
moment de la révision. Le score IKS moyen préopératoire était,<br />
en ce qui concerne le score fonction, de 43 ± 14,66 points (0-70)<br />
et en ce qui concerne le score genou de 57 ± 13,62 points (0-70).<br />
Le score global était en moyenne de 99 ± 23,76 points (0-130).<br />
Les causes d’échec étaient : 15 <strong>des</strong>cellements tibiaux, 5 <strong>des</strong>cellements<br />
fémoraux, 2 <strong>des</strong>cellements fémoraux et tibiaux, 5 usures<br />
du polyéthylène, 2 arthroses externes, 2 arthroses fémoro-patellaires,<br />
1 laxité avec luxation du polyethylene et un sepsis. Dans<br />
12 cas, la perte de substance tibiale a été comblée par une cale<br />
métallique (2 de 4 mm, 3 de 6 mm et 7 de 8 mm), dans 7 cas, par<br />
une allogreffe (fragment de tête fémorale congelée) et dans 1 cas<br />
par une cale plus une allogreffe. Par ailleurs, nous avons utilisé<br />
19 quil<strong>les</strong> tibia<strong>les</strong> longues et 2 fémora<strong>les</strong>.<br />
RÉSULTATS. Les résultats portent sur 27 cas (5 décédés et<br />
1 perdu de vue). Le recul moyen était de 73 ± 41,7 mois (8-153).<br />
Il n’y a pas eu de complication précoce sauf une raideur qui a<br />
nécessité une mobilisation sous AG au 2 e mois. Nous avons dû<br />
effectuer 4 reprises chirurgica<strong>les</strong> : 2 pour <strong>des</strong>cellement tibial et<br />
2 pour <strong>des</strong>cellement du bouton rotulien. Le score IKS fonction<br />
était en moyenne de 80,4 ± 16 points (40-100), le score genou de<br />
86,3 ± 10,6 points (63-100) et le score global de 166,72 ± 21,3<br />
points (128-200). Nous avons retenu 8 liserés tibiaux (4 inférieurs<br />
à 1 mm et 4 de 2 mm) et 1 liséré fémoral inférieur à 1 mm.<br />
Les 8 allogreffes ont été parfaitement incorporées sans aucune<br />
lyse osseuse. Deux patients seront réopérés prochainement, un<br />
pour <strong>des</strong>cellement tibial (J+8 ans) et un autre pour <strong>des</strong>cellement<br />
fémoral (J+9 ans).<br />
CONCLUSION. Nos résultats sont comparab<strong>les</strong> à ceux de la<br />
littérature. Les résultats <strong>des</strong> reprises de PUC sont moins bons<br />
que ceux d’une prothèse de première intention, équivalents aux<br />
reprises d’ostéotomie et meilleurs que <strong>les</strong> reprises de PTG. Nous<br />
considérons qu’el<strong>les</strong> sont plus faci<strong>les</strong> techniquement que <strong>les</strong><br />
reprises d’ostéotomies et de PTG. Leur particularité est la perte<br />
osseuse tibiale, présente, 20 fois sur 33 (60,5 %) dans notre<br />
série.<br />
* Gil<strong>les</strong> Estour, Service de Chirurgie Orthopédique<br />
et de Traumatologie du Sport, Centre Hospitalier Universitaire<br />
de Grenoble, Hôpital-Sud, avenue de Kimberley,<br />
BP 338, 38434 Echirol<strong>les</strong> Cedex.<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S77<br />
96 Résultats à plus de 5 ans d’une<br />
série prospective de 418 prothèses<br />
postéro-stabilisées<br />
Denis HUTEN *, Yann MASSE, Louis PIDHORZ,<br />
Jacques WITVOET, Bernard AUGEREAU<br />
et le groupe GUEPAR<br />
Nous rapportons <strong>les</strong> résultats d’une série prospective multicentrique<br />
non randomisée de 500 prothèses de genou postérostabilisées<br />
implantées il y a plus de 5 ans, 418 en excluant <strong>les</strong><br />
genoux déjà opérés (ostéotomie tibiale, prothèse partielle, patellectomie).<br />
Il s’agissait de 381 patients (femmes : 75,3 %), âgés<br />
en moyenne de 69,7 ans (24 à 89), de classe B ou C dans 81,1 %.<br />
Les étiologies étaient dominées par l’arthrose (78 %) et à un<br />
moindre degré l’arthrite rhumatoïde (21,6 %). En préopératoire,<br />
le score IKS était de 26,1 points (0 à 77), la flexion de 105,4°, le<br />
flexum de 8° et le score fonction de 28,3 points (0 à 85) en<br />
moyenne. Un tiers <strong>des</strong> genoux était désaxé en valgus (de 10° ou<br />
plus dans 22,2 % <strong>des</strong> cas) et la rotule subluxée ou basculée dans<br />
34,6 % <strong>des</strong> cas. Toutes <strong>les</strong> rotu<strong>les</strong> ont été resurfacées. Le devenir<br />
de 79,5 % <strong>des</strong> genoux est connu à 7 ans de recul ou plus. Les<br />
complications ont été par ordre de fréquence décroissante <strong>les</strong><br />
suivantes : luxation fémoro-tibiale (3,8 %), <strong>des</strong>cellement rotulien<br />
(3,3 %), clunk syndrome (3,3 %), fracture rotulienne<br />
(2,9 %), infection (2,1 %), <strong>des</strong>cellement fémoral et/ou tibial<br />
(1,7 %), désencliquetage du plateau tibial (0,07 %), fracture du<br />
fémur ou du tibia (0,05 %). Le score IKS genou (90,2 points :<br />
15 à 100), la flexion (111,7°), le flexum (2,2°) et le score IKS<br />
fonction (55,1 points : 5 à 100) ont été significativement améliorés<br />
(p < 0,05) par rapport à l’état préopératoire. L’axe mécanique<br />
postopératoire était compris entre 178 et 183° dans 68 % <strong>des</strong> cas,<br />
entre 175 et 185° dans 93 % et la rotule centrée et non basculée<br />
dans 83,6 %. Le taux de reprise, toutes complications confondues<br />
était de 7,4° (environ 1 complication sur deux). Le taux de<br />
survie à 9 ans était de 96,8 % en prenant pour évènement le <strong>des</strong>cellement<br />
aseptique repris (intervalle de confiance : 95 %). La<br />
prothèse postéro-stabilisée procure à moyen terme <strong>des</strong> résultats<br />
satisfaisants au prix de risques spécifiques : luxation et clunk<br />
syndrome. Les luxations, qui ont pratiquement disparu avec<br />
l’expérience, attirent l’attention sur la nécessité d’équilibrer <strong>les</strong><br />
espaces en flexion et extension. El<strong>les</strong> n’ont nécessité une reprise<br />
que dans 37,5 % <strong>des</strong> cas (changement de prothèse : 12,5 % <strong>des</strong><br />
cas). Le clunk syndrome a nécessité plus rarement un traitement<br />
chirurgical qui peut être arthroscopique. Les complications rotuliennes<br />
(<strong>des</strong>cellement, fracture, clunk syndrome) étaient <strong>les</strong> plus<br />
fréquentes de toutes.<br />
* Denis Huten, Service de Chirurgie Orthopédique,<br />
Hôpital Bichat Claude-Bernard, 46, rue Henri-Huchard,<br />
75018 Paris.
3S78 81 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
97 PTG de révision pour complications<br />
aseptiques : 34 cas à plus de<br />
5 ans. Résultats fonctionnels et<br />
évolution de la fixation <strong>des</strong> tiges<br />
diaphysaires<br />
Anthony PATIN *, Patrick BOYER, Denis HUTEN,<br />
Frantz LANGLAIS, Hervé THOMAZEAU<br />
et le groupe GUEPAR<br />
INTRODUCTION. Les objectifs <strong>des</strong> PTG de reprise sont<br />
entre autres la restauration de la morphologie articulaire (niveau<br />
de l’interligne, offset, axe fémoro-tibial), le maintien de la fixation<br />
osseuse, <strong>les</strong> résultats fonctionnels. Cette série continue de<br />
34 cas a été revue avec un recul de 5 à 8 ans, notamment pour<br />
juger de l’évolution de la fixation prothétique.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Les 34 reprises ont été réalisées<br />
pour 30 <strong>des</strong>cellements aseptiques, 3 laxités majeures et<br />
1 raideur. La PTG utilisée se caractérise par un ancillaire permettant<br />
d’équilibrer la tension ligamentaire en flexion et extension,<br />
en s’efforçant de restaurer le niveau de l’interligne articulaire et<br />
l’offset condylien. Les condy<strong>les</strong> fémoraux et <strong>les</strong> plateaux tibiaux<br />
sont cimentées, mais <strong>les</strong> tiges d’extension ont été <strong>des</strong>sinées pour<br />
être pressfit. Cependant, el<strong>les</strong> ont été cimentées dans 12 <strong>des</strong><br />
34 cas. La restauration de la morphologie, en général satisfaisante,<br />
est rapportée dans une autre étude.<br />
RÉSULTATS. Six réinterventions ont été nécessaires, dont<br />
4 liées à la prothèse : 1 <strong>des</strong>cellement aseptique; 1 plateau tibial<br />
mal encliqueté; 2 laxités résiduel<strong>les</strong> reprises par prothèse charnière<br />
rotatoire. Un arrachement tardif de tubérosité tibiale a<br />
amené une luxation prothétique et a guéri avec la consolidation<br />
de la TTA (à signaler que 11 autres ostéotomies de la TTA n’ont<br />
entraîné aucune complication). Un sepsis hématogène à 3 ans a<br />
abouti à une arthrodèse. Sur <strong>les</strong> 6 réinterventions, il y a eu 3 bons<br />
résultats, 2 moyens (PTG contrainte) et 1 mauvais (arthrodèse).<br />
Six résultats étaient moyens : 2 par douleurs fémoro-patellaires<br />
(ostéolyse rotulienne, centrage médiocre) et 2 pour <strong>des</strong> ostéolyses<br />
métaphysaires peu évolutives : aucun patient n’a été réopéré.<br />
Vingt-deux résultats (66 %) étaient très bons ou bons d’emblée.<br />
Après reprise, il y avait 25 résultats très bons et bons, 8 moyens<br />
et 1 mauvais. Aucune évolution péjorative de la fixation <strong>des</strong> tiges<br />
diaphysaires n’était notée (ostéolyse, migration), que la tige soit<br />
cimentée ou non, en dehors <strong>des</strong> 3 anomalies (1 <strong>des</strong>cellement, 2<br />
ostéolyses) déjà notées.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. Ce type de prothèse<br />
semi-contrainte ne paraît pas adapté pour <strong>les</strong> reprises de gran<strong>des</strong><br />
laxités prothétiques. Dans <strong>les</strong> <strong>des</strong>cellements aseptiques, <strong>les</strong><br />
résultats sont satisfaisants, avec 1 seul <strong>des</strong>cellement itératif sur<br />
30 cas à plus de 5 ans de recul, et 2 ostéolyses modérées non<br />
réopérées. Il n’a pas été mis en évidence, à ce recul, d’inconvénient<br />
objectif à l’utilisation de tiges diaphysaires pressfit ou<br />
cimentées.<br />
* Anthony Patin, Service de Chirurgie Orthopédique,<br />
CHU Hôpital Sud, 16, boulevard de Bulgarie,<br />
35203 Rennes Cedex 2.<br />
98 Résultats d’une série consécutive<br />
de 100 prothèses uni-compartimenta<strong>les</strong><br />
du genou avec un recul<br />
moyen de 5 ans<br />
Jean-Luc PAILLOT *, Elvire SERVIEN, Tarik AIT<br />
SI SELMI, Philippe NEYRET<br />
INTRODUCTION. Les objectifs de cette étude étaient de<br />
rapporter <strong>les</strong> résultats d’une série consécutive prospective de<br />
100 prothèses uni-compartimenta<strong>les</strong> (P.uni) du genou et préciser<br />
<strong>les</strong> facteurs de réussite et d’échec.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Cent P.uni de resurfaçage<br />
cimentées de type HLS* ont été posées entre 1988 et 2003 dans<br />
un même centre selon <strong>des</strong> indications établies dès 1988, en suivant<br />
une même technique. La série inclut 53 P.uni internes et<br />
47 P.uni externes. El<strong>les</strong> ont été réalisées dans le cadre d’une arthrose<br />
uni-compartimentale (80 %) ou d’une nécrose uni condylienne<br />
(20 %). 92 prothèses ont été suivies (5 patients décédés et<br />
3 prothèses totalisées). Les données cliniques ont été analysées<br />
selon <strong>les</strong> critères IKS et <strong>les</strong> patients ont bénéficié d’un bilan<br />
radiologique complet en préopératoire et au dernier suivi. Le<br />
recul moyen est de 63 mois (24-155).<br />
RÉSULTATS. Le taux de patients très satisfaits ou satisfaits<br />
est de 95 %. Aucune douleur ou une douleur légère sont retrouvées<br />
dans 80 % <strong>des</strong> cas. La flexion moyenne est de 132°<br />
(90-150). Le score genou moyen passe de 65 (préopératoire) à<br />
89 (86 pour <strong>les</strong> P.uni interne, 92 pour <strong>les</strong> P.uni externes) et le<br />
score fonction de 64 à 83 (82 pour <strong>les</strong> internes et 83 pour <strong>les</strong><br />
externes). La déformation résiduelle moyenne est de 4° de varus<br />
pour <strong>les</strong> P.uni internes et de 2° de valgus pour <strong>les</strong> P.uni externes.<br />
Un liseré est retrouvé dans 23 % <strong>des</strong> cas (20 % tibial et 3 %<br />
fémoral), non évolutif dans tous <strong>les</strong> cas. Dans 3 cas, il a été réalisé<br />
une totalisation de la prothèse (1 <strong>des</strong>cellement du composant<br />
tibial, 1 métallose et 1 atteinte du compartiment opposé). Dans<br />
6 cas, il est retrouvé <strong>des</strong> douleurs résiduel<strong>les</strong> (P.uni interne dans<br />
60 % cas). Il n’est déploré aucune infection. Le taux de survie de<br />
Kaplan Meier est de 95 % à un recul maximum de 120 mois.<br />
DISCUSSION. Les résultats globaux de la série sont très<br />
satisfaisants même si ils sont un peu moins bons dans <strong>les</strong> P.uni<br />
internes. Nous avançons <strong>des</strong> hypothèses (surcoupe interne<br />
tibiale, risque d’hypercorrection dans <strong>les</strong> P.uni externes) qui permettent<br />
de rendre compte <strong>des</strong> douleurs résiduel<strong>les</strong> autrefois inexpliquées<br />
et de prévenir leur survenue.<br />
CONCLUSION. Des critères d’indications stricts permettent<br />
d’obtenir régulièrement d’excellents résultats dans <strong>les</strong> P.uni. La<br />
coupe tibiale interne excessive (et pas seulement l’hypocorrection)<br />
après une P.uni interne et l’hypercorrection après P.uni<br />
externe sont <strong>les</strong> 2 erreurs techniques, source d’échec dans notre<br />
expérience. Aucune P.uni n’a du être réopérée pour usure du<br />
composant tibial en polyéthylène.<br />
* Jean-Luc Paillot, Centre Livet, 8, rue de Margnol<strong>les</strong>,<br />
69300 Caluire-Lyon.
99 Prothèses fémoro-patellaires<br />
Richards : résultats à plus de 7 ans<br />
de recul<br />
Simon MARMOR *, Thierry JUDET,<br />
Christian GARREAU DE LOUBRESSE,<br />
Philippe PIRIOU<br />
INTRODUCTION. Le traitement chirurgical de l’arthrose<br />
fémoro-patellaire oppose classiquement <strong>les</strong> traitements conservateurs<br />
aux résultats incertains aux arthroplasties dont <strong>les</strong> modè<strong>les</strong><br />
et <strong>les</strong> indications ont considérablement évolué depuis<br />
l’analyse <strong>des</strong> échecs initiaux. Les auteurs présentent <strong>les</strong> résultats<br />
de la prothèse fémoro-patellaire Richards à plus de 7 ans de<br />
recul médian.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Entre 1988 et 2002, 22 prothèses<br />
fémoro-patellaires ont été implantées chez 20 patients d’âge<br />
moyen 70 ans et 3 mois. L’analyse clinique a été réalisée à l’aide<br />
du score de l’International Knee Society et du score fémoropatellaire<br />
lillois. Le bilan radiographique évaluait l’axe du membre<br />
inférieur, le stade d’arthrose fémoro-patellaire, la dysplasie<br />
trochléenne, la dysplasie rotulienne, la hauteur de rotule, son<br />
centrage et sa bascule.<br />
RÉSULTATS. Tous <strong>les</strong> patients présentaient une arthrose<br />
fémoro-patellaire isolée avec un HKA compris entre 3° de valgus<br />
et 4° de varus. L’arthrose était essentielle dans 21 cas et<br />
secondaire dans 1 cas à une fracture de rotule. Le score fémoro-<br />
100 Étude radiographique et densitométrique<br />
de la minéralisation périprothétique<br />
autour <strong>des</strong> cupu<strong>les</strong> de<br />
prothèse totale de hanche en tantale<br />
ou recouvertes d’hydroxyapatite<br />
Jean-Char<strong>les</strong> GRILLO *, Xavier FLECHER,<br />
Jean-Noël ARGENSON<br />
INTRODUCTION. L’intégration osseuse de la pièce acétabulaire<br />
sans ciment lors d’une arthroplastie totale de hanche reste<br />
une préoccupation. De nombreuses étu<strong>des</strong> révèlent une diminution<br />
nette du stock osseux périacétabulaire dans l’année suivant<br />
l’implantation. Le but de ce travail était d’étudier le remodelage<br />
osseux en radiographie standard et absorptiométrie biphotonique<br />
(DEXA) après implantation d’une cupule en tantale ou en titane<br />
recouverte d’hydroxyapatite.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. L’étude rétrospective concernait<br />
83 patients divisés en 2 groupes avec mise en place d’une<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S79<br />
Séance du 7 novembre matin<br />
HANCHE<br />
patellaire préopératoire était de 61. L’implantation de la prothèse<br />
a été effectuée sans aucun geste osseux associé de réalignement<br />
de l’appareil extenseur. Il y a eu 9 sections de l’aileron rotulien<br />
externe. À 7 ans et 5 mois de recul médian (2-16), 2 prothèses<br />
ont été reprises par <strong>des</strong> PTG avec de bons résultats cliniques :<br />
l’une pour <strong>des</strong>cellement rotulien précoce et l’autre pour arthrose<br />
fémoro-tibiale interne à 9 ans et 3 mois. Aucune anomalie de la<br />
course rotulienne, fracture, <strong>des</strong>cellement trochléen ou raideur<br />
n’a été observé. Le score fémoro-patellaire postopératoire montre<br />
82 % de bons ou très bons résultats.<br />
DISCUSSION. Malgré l’absence d’ostéotomie de réalignement<br />
de l’appareil extenseur, aucun accrochage ou instabilité<br />
rotulienne n’a été déploré : l’obtention d’une bonne course rotulienne<br />
est assurée en peropératoire par l’encastrement de la prothèse<br />
dans la corticale antérieure du fémur et l’orientation en<br />
haut et en dehors de la trochlée prothétique. La dégradation arthrosique<br />
<strong>des</strong> compartiments fémoro-tibiaux est prévenue par la<br />
sélection rigoureuse de nos patients dont la déviation frontale du<br />
genou n’excède pas 4° et l’absence de signe d’arthrose fémorotibiale.<br />
Enfin, l’arthroplastie totale du genou pour arthrose<br />
fémoro-patellaire isolée après 70 ans nous semble une solution<br />
excessive au vue <strong>des</strong> résultats fonctionnels, de la survie et <strong>des</strong><br />
possibilités de reprise par PTG <strong>des</strong> prothèses fémoro-patellaires.<br />
CONCLUSION. La prothèse fémoro-patellaire est une option<br />
thérapeutique intéressante avec d’excellents résultats cliniques à<br />
long terme pour <strong>des</strong> patients rigoureusement sélectionnés.<br />
* Simon Marmor, Service d’Orthopédie,<br />
Hôpital Raymond-Poincaré,<br />
104, boulevard Raymond-Poincaré, 92380 Garches.<br />
cupule en tantale (groupe 1) ou en titane recouvert d’hydroxyapatite<br />
(groupe 2). Les deux groupes étaient comparab<strong>les</strong><br />
concernant l’IMC, l’indication (arthroplastie de première<br />
intention), la technique opératoire ou la rééducation. L’âge<br />
moyen était de 76 ans (26-92 ans) (groupe 1) et 68 ans<br />
(49-85 ans) (groupe 2). Le recul moyen était de 21 et 24 mois,<br />
avec un recul minimum de 1 an. L’étude radiographique (liserés<br />
et positionnement de la cupule) et densitométrique (analyse<br />
de 3,5 mm d’os périacétabulaire dans <strong>les</strong> 3 zones de De Lee et<br />
Charnley) a été réalisée en postopératoire immédiat, à 3 mois<br />
et au dernier recul.<br />
RÉSULTATS. Les scores de Harris étaient comparab<strong>les</strong> dans<br />
<strong>les</strong> 2 groupes (respectivement 81 points et 86 points, p = 0,084).<br />
Aucune différence significative dans le positionnement <strong>des</strong><br />
implants n’a été notée. Des radioclartés étaient présentes chez<br />
14 % <strong>des</strong> patients du groupe 1, 5 % <strong>des</strong> patients du groupe 2,<br />
toutes résolutives à 1 an postopératoire. Aucune reprise pour<br />
<strong>des</strong>cellement a été réalisée. Les densités minéra<strong>les</strong> osseuses<br />
(DMO) du groupe 1 étaient significativement supérieures à cel<strong>les</strong><br />
du groupe 2 en zone 1 (1,323 +/- 0,327 g.cm -2 contre 1,110 +/<br />
- 0,242 g.cm -2 ) et en zone 2 (1,160 +/- 0,263 g.cm -2 contre<br />
1,049 +/- 0.261 g.cm -2 ), (p < 0,05).
3S80 81 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. L’augmentation <strong>des</strong> radioclartés<br />
dans le groupe 1, avec comblement durant la première<br />
année, est décrit dans la littérature et semblerait liée au <strong>des</strong>sin<br />
elliptique de l’implant. Les DMO plus importantes en zones 1 et<br />
2 du groupe 1 peuvent témoigner d’un meilleur transfert <strong>des</strong> contraintes<br />
en zone portante. Le module d’élasticité du tantale proche<br />
de celui de l’os diminuerait le « stress-shielding » périacétabulaire<br />
responsable de la décroissance <strong>des</strong> DMO périacétabulaires<br />
retrouvé dans le groupe 2. Matériau biocompatible d’utilisation<br />
récente en arthroplastie, le tantale semble donc permettre un<br />
meilleur transfert de force à la partie centrale de l’ilion et donc<br />
une possible préservation du stock osseux pelvien, qu’il sera<br />
nécessaire d’évaluer à long terme.<br />
* Jean-Char<strong>les</strong> Grillo, Service de Chirurgie Orthopédique,<br />
Hôpital Sainte-Marguerite,<br />
270, boulevard de Sainte-Marguerite, 13009 Marseille.<br />
101 Étude par logiciel informatique<br />
Imagika <strong>des</strong> prothèses fémora<strong>les</strong><br />
Esop : à propos de 172 cas<br />
Stéphane NAUDI *, Nazim MEHDI,<br />
Grégoire DAUPLAT, Carlos MAYNOU<br />
INTRODUCTION. Le principe de stabilité primaire et secondaire<br />
de la prothèse Esop repose sur un ancrage métaphysaire<br />
exclusif, non cimenté. Cet implant modulaire est composé d’une<br />
métaphyse revêtue d’hydroxyapatite, sur laquelle est adaptée en<br />
peropératoire une pièce diaphysaire jouant un rôle de simple<br />
centreur. L’objectif de cette étude rétrospective continue était<br />
d’évaluer <strong>les</strong> stabilités primaire et secondaire de l’implant ESOP<br />
en mesurant la migration axiale au cours du temps.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Entre 1995 et 2001, 172 prothèses<br />
primaires tota<strong>les</strong> de hanche (PTH) utilisant l’implant fémoral<br />
Esop et un implant acétabulaire toujours identique (ATLAS III),<br />
ont été implantées dans notre service. Après exclusion de<br />
6 patients perdus de vue et 11 décédés, nous avons revu 155 PTH<br />
chez 128 patients (66 femmes et 32 hommes) d’âge moyen<br />
57 ans (28-77), dont 53 % exerçaient une activité professionnelle<br />
au moment de l’intervention. La coxarthrose et l’ostéonécrose<br />
aseptique représentaient 87% <strong>des</strong> étiologies. Nous avons mesuré<br />
à l’aide du logiciel Imagika, dédié à cet usage, la migration<br />
axiale et l’offset global <strong>des</strong> PTH à 4 pério<strong>des</strong> distinctes. D’abord<br />
sur <strong>les</strong> clichés préopératoires et postopératoires immédiats,<br />
ensuite après la remise en charge et enfin lors de l’évaluation,<br />
effectuée à 61 mois en moyenne (35-114). Nous avons également<br />
analysé la survie et <strong>les</strong> résultats cliniques et radiographiques<br />
de cette série grâce aux scores PMA.<br />
RÉSULTATS. Le taux de survie <strong>des</strong> PTH de notre série était<br />
de 98 %, toutes causes confondues. Le score PMA retrouvait<br />
97 % de résultats excellents, très bons ou bons. Une migration de<br />
plus de 5 mm a été mise en évidence pour 10 pivots (6,4 %). Sur<br />
ces 10 cas, 7 avaient migré dans le premier mois, puis n’avaient<br />
pas évolué lors de la révision. La comparaison <strong>des</strong> clichés préopératoire<br />
et postopératoire a montré une diminution de l’offset<br />
global de plus de 10 mm dans 38 % <strong>des</strong> cas, témoignant de la<br />
médialisation du centre de rotation de la hanche.<br />
DISCUSSION. La migration observée sur 10 pivots correspondait<br />
dans 7 cas à un recalage lors de la remise en charge. Elle<br />
n’était pas corrélée à un résultat clinique péjoratif ni à un défaut<br />
d’ostéointégration radiologique.<br />
CONCLUSION. Les stabilités primaire et secondaire de<br />
l’implant Esop sont satisfaisantes. Dans cette série, le centre de<br />
rotation de la hanche subissait une médialisation pour laquelle il<br />
serait intéressant de disposer d’implants latéralisés.<br />
* Stéphane Naudi, Service d’Orthopédie A,<br />
Hôpital Salengro, avenue Oscar-Lambret, 59000 Lille.<br />
102 Morbidité et devenir <strong>des</strong> changements<br />
d’inserts de cupu<strong>les</strong> métalback<br />
laissées en place au cours de<br />
62 reprises de prothèses tota<strong>les</strong> de<br />
hanche<br />
Romain BIDAR *, Julien GIRARD,<br />
Yannick PINOIT, Marc SOENEN,<br />
Falah BACHOUR, Philippe LAFFARGUE,<br />
Henri MIGAUD<br />
INTRODUCTION. La modularité <strong>des</strong> cupu<strong>les</strong> métal-back est<br />
souvent présentée comme un avantage permettant de simplifier<br />
<strong>les</strong> reprises de prothèses tota<strong>les</strong> de hanche (PTH) en autorisant la<br />
préservation du stock osseux acétabulaire et une réduction du<br />
temps opératoire. Le but de ce travail était d’évaluer ces différentes<br />
hypothèses.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Une série continue de 62 révisions<br />
de PTH comportant un changement d’insert en polyéthylène<br />
a été analysée rétrospectivement (31 révisions comportaient<br />
le changement isolé du couple de frottement, et 31 fois le changement<br />
d’insert a été associé à une révision fémorale). Toutes <strong>les</strong><br />
reprises ont été effectuées par voie postéro-latérale. Un groupe<br />
contrôle de rescellements bipolaires a été constitué par appariement<br />
selon l’âge, le sexe, l’IMC et comparé aux changements<br />
d’insert isolés ou combinés à une révision fémorale.<br />
RÉSULTATS. Pour <strong>les</strong> changements d’insert isolés, <strong>les</strong> durées<br />
d’intervention, le saignement opératoire et postopératoire étaient<br />
significativement plus faib<strong>les</strong> que pour <strong>les</strong> changements fémoraux<br />
et bipolaires. Avant le changement d’insert, 19 cupu<strong>les</strong><br />
étaient entourées d’une ostéolyse limitée. Au recul, 2 ostéolyses<br />
étaient apparues et 5 s’étaient aggravées dont une s’est compliquée<br />
d’un <strong>des</strong>cellement qui a été réopéré. Neuf hanches ont été<br />
victimes d’un épisode de luxation (2 antérieures et 7 postérieures)<br />
dont 3 ont été réopérées pour récidive. Les luxations sont<br />
survenues après 4 changements d’inserts isolés et 5 révisions<br />
fémora<strong>les</strong> combinées. Les luxations ont été plus fréquentes sur<br />
<strong>les</strong> hanches multi-opérées et cel<strong>les</strong> dont l’inclinaison de la<br />
cupule était inférieure à 40°. Dix réinterventions ont été pratiquées<br />
en raison de : 2 déclipsages d’insert, 3 luxations récidivan-
tes, 3 <strong>des</strong>cellements fémoraux, 1 <strong>des</strong>cellement de cupule,<br />
1 infection précoce guérie après lavage. Les taux de survie à<br />
7 ans étaient comparab<strong>les</strong> pour <strong>les</strong> changements isolés d’insert<br />
(82 % ± 10 %) <strong>les</strong> changements fémoraux combinés à un changement<br />
d’insert (84 % ± 11 %) et <strong>les</strong> changements bipolaires<br />
(83 % ± 10 %).<br />
CONCLUSION. Le changement d’insert au cours d’une révision<br />
de PTH permet de réduire la morbidité par rapport à un<br />
changement plus complexe. Un changement isolé d’insert est<br />
insuffisant en cas d’ostéolyse acétabulaire, on doit préférer un<br />
débridement <strong>des</strong> ostéolyses plus ou moins combiné à une greffe<br />
ou un changement complet. Si le taux de survie après changement<br />
d’insert est comparable à celui de révisions plus complexes,<br />
le risque de luxation et de déclipsage du nouvel insert dans<br />
le métal-back doivent être redoutés, n’autorisant ce geste que si<br />
l’orientation de la cupule apparaît correcte et si le mécanisme de<br />
fixation du polyéthylène est en bon état, chez <strong>des</strong> patients non<br />
multi-opérés.<br />
* Romain Bidar, Service d’Orthopédie C, Hôpital Salengro,<br />
CHRU de Lille, place de Verdun, 59037 Lille Cedex.<br />
103 Évaluation au recul de plus de<br />
10 ans de 156 anneaux acétabulaires<br />
vissants<br />
Mohamed EL JAMRI *, Jean NORTH,<br />
Gil<strong>les</strong> FABET, Dan BORCOS<br />
INTRODUCTION. Les échecs précoces de certains anneaux<br />
acétabulaires vissants ont freiné prématurément leur développement.<br />
Les étu<strong>des</strong> biomécaniques ont démontré leur faillite du fait<br />
de la forme de l’anneau, du revêtement de surface ou de l’architecture<br />
<strong>des</strong> ailettes. Nous rapportons notre expérience avec<br />
l’anneau de Weill, de forme tronconique, en titane avec <strong>des</strong><br />
lamel<strong>les</strong> à bord tranchant et à surface sablée aux gros grains.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Il s’agit d’une série continue,<br />
rétrospective, concernant 147 patients (156 hanches), 73 femmes<br />
pour 74 hommes, dont l’âge moyen était de 68,3 ans (56-83),<br />
opérés entre 1992 et 1995. L’abord exclusif est la voie de Watson<br />
Jones. L’anneau était associé à une tige fémorale autobloquante<br />
cimentée avec un couple de friction polyéthylène-alumine. Lors<br />
de la revue, 55 patients (58 hanches) étaient vus et radiographiés<br />
et 25 (27 hanches) étaient contactés par téléphone. Quarantedeux<br />
étaient décédés et 10 perdus de vue. Le recul moyen était<br />
de 11,6 ans (10,1-14 ans). L’évaluation clinique reposait sur <strong>les</strong><br />
scores de Postel et Merle d’Aubigné et de Harris (HHS). Un<br />
questionnaire psychométrique téléphonique, utilisant le score<br />
d’Oxford, évaluait le résultat fonctionnel et le retentissement<br />
social de l’intervention. Le bilan radiologique étudiait la qualité<br />
de fixation de l’anneau, son orientation, son positionnement, <strong>les</strong><br />
liserés et <strong>les</strong> ossifications périprothétiques.<br />
RÉSULTATS. Le PMA global passait de 12,1 à 15,8 et le<br />
HHS de 64,1 à 82,2. Le score d’Oxford était de 21,92/60. Sur <strong>les</strong><br />
radiographies, on notait peu d’ossifications (13,8 % de stade II,<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S81<br />
3,5 % de stade III et 0 % de stade IV). Il n’y a eu aucune migration<br />
de l’implant et seulement 1,7 % de liseré en zone 1, sans<br />
retentissement clinique. Nous déplorons 4 <strong>des</strong>cellements avec<br />
reprise chirurgicale, 10 luxations précoces et 2 infections sans<br />
reprise. Le taux de survie selon Kaplan Meier était de 94,23 %.<br />
DISCUSSION. Les résultats à plus de 10 ans de recul de<br />
l’anneau vissant de Weill sont équivalents ou voisins <strong>des</strong> cupu<strong>les</strong><br />
impactées ou cimentées. Aucune migration n’est constatée et le<br />
taux d’échecs était plus faible que celui d’autres implants vissés.<br />
CONCLUSION. La bonne tolérance et <strong>les</strong> excellents résultats<br />
de l’anneau de Weill sont l’aboutissement d’un <strong>des</strong>sin original,<br />
un revêtement adapté et une bonne maîtrise chirurgicale. Ceci<br />
valide la confiance accordée dans l’implant et répond à nos<br />
attentes durant la période de son utilisation.<br />
* Mohamed El Jamri, Chirurgie B, Centre Hospitalier,<br />
avenue Pasteur, 67604 Se<strong>les</strong>tat.<br />
104 Arthroplastie totale de hanche<br />
chez le sujet de moins de 40 ans<br />
avec tige sans ciment et sur<br />
mesure<br />
Xavier FLECHER *, Sébastien PARRATTE,<br />
Jean-Manuel AUBANIAC, Jean-Noël ARGENSON<br />
INTRODUCTION. L’arthroplastie totale de hanche chez le<br />
sujet jeune et actif reste une préoccupation importante en termes<br />
de restauration de fonction et de longévité <strong>des</strong> éléments prothétiques.<br />
Le but de cette étude était d’analyser <strong>les</strong> résultats radio-cliniques<br />
d’une arthroplastie totale de hanche sans ciment<br />
comportant une tige sur mesure et une cupule en titane recouverte<br />
d’hydroxyapatite chez le sujet actif de moins de 40 ans.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. L’étude portait sur 149 hanches<br />
(126 patients) d’âge moyen 33 ans (17 à 40 ans). Il y avait<br />
78 hommes (62 %) et 48 femmes (38 %). L’indication comprenait<br />
57 ostéonécroses, 17 coxarthroses primitives, 63 coxarthroses<br />
secondaires (15 post-traumatiques et 48 sur luxation<br />
congénitale de hanche) et 12 diverses. Tous <strong>les</strong> patients ont eu le<br />
même bilan radio-tomodensitométrique permettant la restauration<br />
du bras de levier et la correction de l’antéversion dans le col<br />
prothétique. Selon la classification de Charnley, 110 patients<br />
étaient classés stade A et 16 stade B. Selon la classification du<br />
niveau d’activité selon Devane, 66 étaient stade 3, 51 stade 4 et<br />
9 stade 5. Le recul moyen était de 54 mois (24 à 168 mois).<br />
RÉSULTATS. Le score PMA postopératoire était au recul en<br />
moyenne de 17,3 points (12 à 18 points), avec 86,6 % de résultats<br />
classés excellents, très bons ou bons. Un cas de migration de<br />
tige (0,7 %) a été noté. Huit hanches (5,3 %) ont été réopérées<br />
sans changement d’implants incluant 2 infections, 3 ossifications,<br />
1 hématome, 1 fracture sous la tige et 1 déclipsage du<br />
polyéthylène. Quatre hanches (2,7 %) ont nécessité une reprise<br />
avec changement de la tige (1 fracture de tige) ou de la cupule<br />
(1 luxation récidivante, 1 ostéolyse et 1 infection). En prenant
3S82 81 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
comme événement la reprise quelle que soit la cause, la survie<br />
était de 96 % ± 3 % à 13 ans.<br />
DISCUSSION. Cette étude démontre <strong>les</strong> résultats satisfaisants<br />
en termes de restauration fonctionnelle et de survie de<br />
l’arthroplastie totale de hanche chez le sujet jeune et actif à<br />
l’aide d’une tige sans ciment sur mesure et d’une cupule sans<br />
ciment impactée vissée. La mise en place de scores fonctionnels<br />
plus adaptés au sujet jeune et actif et le suivi de ces patients dans<br />
le long terme est néanmoins nécessaire afin d’affirmer le succès<br />
de cette intervention.<br />
* Xavier Flecher, Service de Chirurgie Orthopédique,<br />
Hôpital Sainte-Marguerite,<br />
270, boulevard de Sainte-Marguerite, 13009 Marseille.<br />
105 Révision acétabulaire pour <strong>des</strong>cellement<br />
de stade III par croix de<br />
Kerboull et implant double mobilité :<br />
à propos de 34 cas<br />
Sophie GROSCLAUDE *, Philippe ADAM,<br />
Rémi PHILIPPOT, Frédéric FARIZON<br />
INTRODUCTION. Les <strong>des</strong>cellements acétabulaires de<br />
stade III de la SOFCOT posent plusieurs problèmes parmi <strong>les</strong>quel<strong>les</strong><br />
la perte de substance osseuse rendant difficile le recentrage<br />
de la hanche qui favorise l’instabilité postopératoire. Nous<br />
avons opté pour une armature de soutien type croix de Kerboull<br />
associée à une cupule à double mobilité.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Il s’agit d’une série de 34<br />
patients âgés de 66,8 ans (46-88), revus avec un recul moyen de<br />
16 mois (12-35). Pour 18 patients, il s’agissait de la première<br />
reprise, pour 7 patients de la deuxième, enfin 9 patients avaient<br />
déjà eu plus de 2 changements de prothèse. Un <strong>des</strong> patients avait<br />
déjà eu 6 reprises. Les causes de reprise étaient 18 <strong>des</strong>cellements<br />
bipolaires, 10 <strong>des</strong>cellements acétabulaires. Six <strong>des</strong>cellements<br />
étaient septiques. Tous <strong>les</strong> patients ont été opérés par voie postérolatérale.<br />
Après explantation de la cupule prothétique, la cavité<br />
acétabulaire était préparée avec repérage du U radiographique.<br />
Une croix de Kerboull était mise en place, puis une allogreffe<br />
cryoconservée comblait <strong>les</strong> défects. Enfin, une cupule à double<br />
mobilité était scellée dans l’armature. Dans <strong>les</strong> suites, l’appui<br />
était interdit pendant 45 jours. Les patients étaient revus régulièrement<br />
<strong>les</strong> premiers mois puis tous <strong>les</strong> ans avec une radiographie.<br />
Le score de Postel Merle d’Aubigné (PMA) était calculé en<br />
préopératoire et au dernier recul.<br />
RÉSULTATS. Au dernier recul, nous n’avons pas eu de luxation.<br />
Nous rapportons une complication peropératoire grave :<br />
plaie de la veine iliaque pontée en urgence. En postopératoire,<br />
nous notons une thrombose veineuse profonde et une fracture du<br />
grand trochanter. Un patient insuffisant cardiaque est décédé à<br />
24 mois. Le score PMA moyen au dernier recul était de 16.<br />
Vingt-deux bilans radiographiques ont été examinés. L’inclinaison<br />
moyenne de la croix était de 43° (30-60) ; Un liseré en<br />
zone III stable à 18 mois a été noté ainsi que deux recalages de la<br />
croix avec fracture de vis à 1 et 2 ans sans aucune traduction clinique.<br />
Il n’y a eu aucun <strong>des</strong>cellement itératif. Deux patients présentaient<br />
<strong>des</strong> ossifications Brooker II et III.<br />
DISCUSSION. Le remplacement d’une arthroplastie totale de<br />
hanche multiplie le risque de luxation par 12 en moyenne. Même<br />
si le recul de notre série est encore court on peut noter l’absence<br />
d’épisode de luxation, dans une population où 4 patients sur<br />
10 avaient déjà eu un changement de prothèse.<br />
* Sophie Grosclaude, 36, chemin de la Grande-Catonnière,<br />
42800 Saint-Martin-la-Plaine.<br />
106 Étude comparative de l’usure du<br />
polyéthylène <strong>des</strong> arthroplasties<br />
tota<strong>les</strong> de hanche : tête céramique<br />
versus tête métallique avec un<br />
recul de quinze ans<br />
Jean-Paul LEVAI *, Arnaud KELECHIAN,<br />
Stéphane DESCAMPS, Philippe MOREEL,<br />
Stéphane BOISGARD<br />
INTRODUCTION. Le but de ce travail prospectif randomisé,<br />
monocentrique en simple aveugle était de comparer l’usure du<br />
polyéthylène d’arthroplasties tota<strong>les</strong> de hanches avec une tête de<br />
28 céramique versus tête métallique.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Sur 226 arthroplasties tota<strong>les</strong> de<br />
hanches réalisées de 1988 à 1990 évaluées en 2005, 111 patients<br />
étaient décédés, 28 perdus de vue et dans 17 cas, le bilan radiologique<br />
n’était pas exploitable. Soixante quatorze arthroplasties ont<br />
pu être analysées. Dans tous <strong>les</strong> cas, il s’agissait d’un implant<br />
fémoral à tige droite en protasul 10 (Zimmer), de type Müller et<br />
au niveau acétabulaire, une prothèse tout polyéthylène à bord plat<br />
stérilisée au rayon Gamma à cinq millions de rad sous atmosphère<br />
inerte d’azote. Les 74 arthroplasties se répartissent en<br />
37 cas avec une tête métallique et trente-sept avec une tête céramique.<br />
Radiologiquement, sur le bassin de face en charge, ont été<br />
analysés <strong>les</strong> liserés: épaisseur, évolutivité, localisation. Les <strong>des</strong>cellements<br />
ont été définis selon <strong>les</strong> critères d’Hodgkinson et Harris.<br />
La pénétration de la tête fémorale a été mesurée à partir<br />
d’une technique uni-radiographique avec <strong>des</strong> radios digitalisées<br />
et le logiciel M.P.H. Wear dont la précision est de 0,09 mm et la<br />
reproductibilité de 0,03 mm.<br />
RÉSULTATS. Les deux groupes étaient statistiquement comparab<strong>les</strong><br />
(p = 0,0857). Pour <strong>les</strong> têtes métalliques l’usure linéaire<br />
était de 0,102 mm/an (usure volumétrique 62,8 mm 3 /an). Pour<br />
la céramique l’usure linéaire était de 0,058 mm/an (usure volumétrique<br />
35,7 mm 3 /an. Correspondant à une diminution significative<br />
(p = 0,0004) de 44 % de pénétration. Il existait une<br />
pénétration supérieure à 0,1 mm par an dans treize cas pour <strong>les</strong><br />
têtes métalliques et dans seulement un cas pour la tête céramique.<br />
Il a été noté quatre <strong>des</strong>cellements. Dans <strong>les</strong> quatre cas,<br />
la pénétration était supérieure à 0,2 mm par an. Dans trois cas,<br />
il s’agissait d’une tête métallique et dans un cas, une tête céramique.
DISCUSSION. Nos résultats sont comparab<strong>les</strong> à ceux de la<br />
littérature lorsque le recul est supérieur à dix ans comme l’ont<br />
rapporté Schuller, Oonichi et Hernigou. Pour <strong>les</strong> auteurs dont le<br />
recul est inférieur à dix ans, il est à noter <strong>des</strong> performances identiques<br />
entre tête céramique et tête métallique comme l’ont rapporté<br />
Jenni, Devane et Sychterz.<br />
CONCLUSION. Il s’agit de la première étude prospective<br />
randomisée avec deux populations identiques, montrant une<br />
diminution statistiquement significative de la pénétration de la<br />
tête céramique par rapport à une tête métallique.<br />
* Jean-Paul Levai, Service de Chirurgie Orthopédique<br />
et Traumatologique I, Hôpital Gabriel-Montpied,<br />
CHU de Clermont-Ferrand, BP 69,<br />
63003 Clermont-Ferrand Cedex 0.<br />
107 Reprises acétabulaires par implant<br />
sans ciment impacté à double revêtement<br />
hémisphérique non vissé<br />
Jean-Baptiste LEYMARIE *, Philippe PIRIOU,<br />
Isham GAD, Jean-Luc MARMORAT,<br />
Thierry JUDET<br />
INTRODUCTION. Les techniques de reprise acétabulaire<br />
sont multip<strong>les</strong>, fonction principalement de l’altération du stock<br />
osseux : greffe, matériel de synthèse, renfort métallique... À partir<br />
d’une série de 73 reprises par cupule sans ciment impactée<br />
sans vis à double revêtement titane HAP sont précisés <strong>les</strong> détails<br />
techniques de cette procédure simplifiée, ses résultats et ses limites<br />
d’indication.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Soixante-treize reprises ont été<br />
effectuées entre 1997 et 2002 (28 unipolaires, 45 bipolaires)<br />
chez <strong>des</strong> patients âgés de 65,8 ans et porteurs de défect Paprovsky<br />
I (14), II (47), III A (12), revus cliniquement et radiologiquement<br />
entre 24 et 88 mois (moyenne 47 mois). Utilisation<br />
préférentielle de la voie antérieure, dépose prudente de la prothèse<br />
et bilan <strong>des</strong> lésions. Impaction et évaluation de la stabilité<br />
de la cupule d’essai après fraisage mesuré. En cas de stabilité<br />
insuffisante, dans certains cas, essai de surdimensionnement de<br />
la cupule définitive ou acétabuloplastie d’approfondissement.<br />
L’échec de stabilisation primaire imposait l’adoption d’une autre<br />
technique. Revue <strong>des</strong> patients clinique et radiologique avec<br />
mesure numérisée du positionnement et d’éventuel<strong>les</strong> migrations,<br />
évaluation de l’interface et de la trame osseuse en postopératoire<br />
et au recul.<br />
RÉSULTATS. Deux patients décédés avant 2 ans, 2 démontages<br />
précoces ont imposé un changement de technique, 2 déposes<br />
pour infection. Le score PMA <strong>des</strong> 67 autres patients passait de<br />
13 à 16,32. Neuf luxations précoces ont imposé 3 reprises (causes<br />
non acétabulaires). Radiologiquement, le positionnement de<br />
la cupule est satisfaisant, avec une tendance à la médialisation. À<br />
distance, aucune cupule n’a migré et toutes présentaient <strong>des</strong><br />
signes de réhabitation osseuse. Toutes <strong>les</strong> acétabuloplasties ont<br />
consolidé.<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S83<br />
DISCUSSION. La voie d’abord antérieure ne protége pas <strong>des</strong><br />
luxations dans <strong>les</strong> reprises. La stabilité initiale de la cupule<br />
d’essai est d’évaluation difficile. Pour <strong>des</strong> acétabulums peu<br />
détruits, cette technique est préférable au scellement. Un vissage<br />
complémentaire peut entraîner une fausse impression de<br />
stabilité et <strong>des</strong> complications (vasculaires, granulome, rupture).<br />
La macroporosité aide à la stabilité primaire et avec l’HAP<br />
favorise la tenue secondaire. Le surdimensionnement (cupu<strong>les</strong><br />
Jumbo) altère le capital osseux. Les reconstructions par greffe<br />
osseuse sont réservées aux <strong>des</strong>tructions majeures.<br />
CONCLUSION. Cette technique délicate, mais simple permet<br />
une désescalade thérapeutique et respecte le capital osseux,<br />
elle est d’indication large, nous l’envisageons systématiquement<br />
pour toutes <strong>les</strong> reprises réservant la greffe compactée aux cas où<br />
la tenue primaire de l’implant est estimée insuffisante en peropératoire.<br />
* Jean-Baptiste Leymarie, Service d’Orthopédie,<br />
Hôpital Raymond-Poincaré,<br />
104, boulevard Raymond-Poincaré, 92380 Garches.<br />
108 Cupu<strong>les</strong> à double mobilité cimentées<br />
pour PTH : résultats et indications<br />
de 55 cas à plus de 2 ans de<br />
recul<br />
Frantz LANGLAIS *, Martin LISSARRAGUE,<br />
Olivier CHAIX, François GAUCHER,<br />
Thierry MUSSET, Jean-Christophe LAMBOTTE<br />
Cinquante-cinq cupu<strong>les</strong> à double mobilité cimentées ont été<br />
implantées chez <strong>des</strong> patients en état général médiocre<br />
(44 % d’ASA 3 ou 4, âge moyen 67 ans), chez <strong>les</strong>quels la nécessité<br />
de stabilité de la prothèse l’emportait sur sa longévité.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. La cupule métallique utilisée<br />
« Medial Cup » avait la morphologie extérieure d’une cupule de<br />
Charnley. Son centre de rotation était médialisé. Elle comportait<br />
un insert mobile en polyéthylène épais (Ø interne 22 mm). Les<br />
indications étaient : <strong>les</strong> instabilités potentiel<strong>les</strong> de hanche<br />
(28 % : neurologiques, tumora<strong>les</strong>, musculaires) ; <strong>les</strong> reprises de<br />
PTH (30 % : luxations itératives, infections, <strong>des</strong>cellements) ; <strong>les</strong><br />
prothèses primaires au-delà de 75 ans (32 %) ; 10 % d’état général<br />
très précaire (dialyse, ...). Le devenir de tous <strong>les</strong> patients était<br />
connu : 8 étaient décédés sans complication orthopédique ni<br />
anomalie radiologique.<br />
RÉSULTATS. Une luxation traumatique est survenue à 2 ans.<br />
Il y a eu 7 autres réinterventions : 1 infection, 4 fractures diaphysaires<br />
traumatiques, 1 hématome. Le résultat fonctionnel était en<br />
accord avec le terrain (67 % très bons et bons, 27 % passab<strong>les</strong>,<br />
8 % mauvais). Les 46 cupu<strong>les</strong> suivies au-delà de 2 ans ont été<br />
radiographiées : 22 ne montraient pas la moindre démarcation<br />
entre ciment et os; 20 montraient une démarcation en zone I à la<br />
limite de la visibilité, notée en postopératoire et non évolutive.<br />
Sont apparus 2 liserés d’1 mm en zone I, et 2 liserés plus étendus<br />
de 2 mm, survenant sur <strong>des</strong> reprises.
3S84 81 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
DISCUSSION. Sur ces patients à haut risque d’instabilité, il y<br />
a eu une luxation traumatique. Il n’y a eu que 4 % (2 cas) de liserés<br />
évolutifs, peu symptomatiques. Ce taux, avec <strong>les</strong> cupu<strong>les</strong><br />
cimentées à double mobilité, est très inférieur à celui observé<br />
avec <strong>les</strong> cupu<strong>les</strong> cimentées métalback à polyéthylène fixe<br />
(5 % de reprises et 20 % de <strong>des</strong>cellements évolutifs avant 2 ans).<br />
CONCLUSION. Le principe de la cupule à double mobilité<br />
se confirme efficace sur la prévention <strong>des</strong> luxations. À côté <strong>des</strong><br />
cupu<strong>les</strong> à double mobilité impactées, il existe sans doute une<br />
place pour <strong>les</strong> cupu<strong>les</strong> cimentées : dans <strong>les</strong> ostéolyses du sujet<br />
âgé; lorsqu’on souhaite une antibiothérapie in situ par le<br />
ciment; lorsque l’acetabulum n’est pas adapté à l’impaction, du<br />
fait de sa morphologie ou de sa texture. Ces résultats à moyen<br />
terme autorisent la poursuite de l’utilisation de ces cupu<strong>les</strong><br />
cimentées, mais avec vigilance et en <strong>les</strong> réservant à <strong>des</strong> indications<br />
spécifiques.<br />
* Frantz Langlais, Service de Chirurgie Orthopédique,<br />
CHU Hôpital Sud, 16, boulevard de Bulgarie,<br />
35203 Rennes Cedex 2.<br />
109 Étude d’une série de 70 cupu<strong>les</strong> à<br />
double mobilité à 10 ans de recul<br />
chez <strong>des</strong> patients de moins de<br />
50 ans<br />
Rémi PHILIPPOT *, Philippe ADAM,<br />
Sophie GROSCLAUDE, Frédéric FARIZON,<br />
Michel FESSY<br />
INTRODUCTION. Nous rapportons une série rétrospective à<br />
10 ans de 70 prothèses tota<strong>les</strong> de hanche implantées chez <strong>des</strong><br />
patients de moins de 50 ans. Le but de l’étude était d’évaluer la<br />
survie à dix ans de cette cupule.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. La série étudiée comporte<br />
70 prothèses tota<strong>les</strong> de hanche, implantées en première intention,<br />
chez 70 sujets. La série était homogène et continue sur 6 mois. La<br />
coxarthrose représentait la principale indication d’arthroplastie et<br />
l’âge moyen lors de l’implantation était de 41,16 ± 7,83 ans. Les<br />
implants utilisés étaient : 1) une cupule à double mobilité de type<br />
Novae-1 (Serf), de géométrie cylindro-sphérique, en inox et revêtue<br />
d’alumine poreuse AL2O3. 2) L’insert mobile permettant la<br />
double articulation entre le métal back et la tête était en polyéthylène,<br />
celui-ci est rétentif. 3) Les têtes en chrome cobalt étaient<br />
toutes de diamètre 22,2 mm. 4) Les tiges étaient toutes <strong>des</strong> tiges<br />
vissées de type Profil (Serf) en titane, revêtues d’alumine<br />
AL2O3. L’ensemble <strong>des</strong> patients a été revu cliniquement et radiologiquement<br />
dans le service en moyenne tous <strong>les</strong> deux ou trois<br />
ans. Nous avons étudié la survie de cette cupule à dix ans par une<br />
méthode actuarielle en prenant comme définition de l’échec, la<br />
reprise chirurgicale de la cupule pour cause aseptique.<br />
RÉSULTATS. Nous n’avons eu au cours de ces dix années<br />
aucun décès et aucun perdu de vue. Le score de Postel-Merle<br />
d’Aubigné passait de 7,1 en préopératoire à 15,9 à dix ans. Nous<br />
avons observé 2 <strong>des</strong>cellements acétabulaires isolés, 2 luxations<br />
intraprothétiques par usure de la rétention et une usure avancée.<br />
Un infection a nécessité un lavage précoce puis une explantation.<br />
Ainsi, le taux de survie actuariel global à dix ans de cette cupule<br />
était de 0,89 avec un intervalle de confiance supérieur à 95 %.<br />
Nous n’avons eu aucun épisode d’instabilité prothétique dans<br />
cette série.<br />
DISCUSSION. L’absence d’épisode d’instabilité prothétique<br />
confirme la grande stabilité à court et long terme de la double<br />
mobilité. La luxation intraprothétique due à la perte de rétentivité<br />
du polyéthylène est la principale limite de cette technique,<br />
mais son incidence est faible et son traitement simple. La comparaison<br />
avec la littérature montre que cette cupule à double<br />
mobilité ne possède pas une excellente survie à dix ans. Nous<br />
préconisons donc la pose de ce type de cupule en première intention<br />
chez <strong>des</strong> sujets jeunes uniquement en présence de gros facteurs<br />
de risques de luxation post opératoires.<br />
* Rémi Philippot, Service d’Orthopédie, Hôpital Bellevue,<br />
CHU de Saint-Etienne, 42055 Saint-Etienne Cedex 2.<br />
110 Étude comparée de la survie à long<br />
terme (18 et 20 ans) de deux cupu<strong>les</strong><br />
vissantes avec et sans traitement<br />
de surface<br />
Rémi PHILIPPOT *, Florent DELANGLE,<br />
Michel FESSY, Jean-Marc SEMAY<br />
INTRODUCTION. Nous rapportons deux séries homogènes<br />
et continues de prothèses tota<strong>les</strong> de hanche comportant une<br />
cupule vissante revêtue ou non d’hydroxyapatite. Le but de<br />
l’étude était de comparer la survie de ces deux cupu<strong>les</strong> et de mettre<br />
en évidence l’intérêt du traitement de surface.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. La première série étudiée comporte<br />
122 prothèses tota<strong>les</strong> de hanche, implantées durant l’année<br />
1986. La cupule de première génération était vissante, hémisphérique<br />
et sans traitement de surface. La deuxième série étudiée<br />
comportait 264 prothèses tota<strong>les</strong> de hanche, implantées de 1988<br />
à 1990. Le cupule Tropic (Depuy) était vissante, hémisphérique<br />
et revêtu d’hydroxyapatite. La tige était toujours une tige droite<br />
revêtue d’hydroxyapatite de type Corail (Depuy), <strong>les</strong> têtes<br />
étaient toutes de diamètre 28 mm en alumine, l’insert était toujours<br />
en polyéthylène. L’âge moyen lors de l’implantation était<br />
respectivement de 64,5 et 66,4 ans. La coxarthrose représentait<br />
la principale indication. Tous <strong>les</strong> patients ont été opérés par le<br />
même chirurgien qui a réalisé un suivi radio-clinique tous <strong>les</strong><br />
deux ans. La réalisation de l’étude a été confiée à deux observateurs<br />
indépendants. L’étude de la survie de ces cupu<strong>les</strong> au plus<br />
long recul était faite par une méthode de Kaplan-Meier en prenant<br />
comme échec toute reprise chirurgicale de la cupule.<br />
RÉSULTATS. Pour la première série : 62 décès, 6 perdus de<br />
vue. Le score de Postel-Merle d’Aubigné passait de 9,3 en préopératoire<br />
à 16,4 à 20 ans de recul. Nous avons retrouvé 16 <strong>des</strong>cellements<br />
acétabulaires et un changement de cupule pour<br />
luxation récidivante, ainsi le taux de survie à 20 ans de cette
cupule était de 0,82. Pour la deuxième série : 104 décès, 15 perdus<br />
de vue. Le score de Postel-Merle d’Aubigné passait de 9,1<br />
en préopératoire à 16,6 à 18 ans de recul. Nous avons retrouvé<br />
11 <strong>des</strong>cellements acétabulaires et 4 changements de cupule pour<br />
luxation récidivante, ainsi le taux de survie à 18 ans de cette<br />
cupule était de 0,92. Un test de Log Rank montrait une supériorité<br />
significative de cette cupule vissante revêtue d’hydroxyapatite<br />
en matière de survie.<br />
DISCUSSION. Cette étude, originale de part son grand recul<br />
nous confirme que ces deux séries de cupu<strong>les</strong> vissantes en tout<br />
point identiques sauf en ce qui concerne l’état de surface se comportent<br />
de manière différente. Au vu <strong>des</strong> résultats, il nous apparaît<br />
que l’hydroxyapatite par ses qualités bioactivesostéoconductrices<br />
peut assurer une ostéointégration de l’implant<br />
qui reste pérenne à très long terme.<br />
* Rémi Philippot, Service d’Orthopédie, Hôpital Bellevue,<br />
CHU de Saint-Etienne, 42055 Saint-Etienne Cedex 2.<br />
111 Contrôle de l’implantation de la<br />
prothèse acétabulaire d’une prothèse<br />
totale de hanche par un système<br />
de navigation sans image<br />
Cyril BOÉRI *, Jean-Yves JENNY,<br />
Jean-Claude DOSCH, Marius USCATU<br />
INTRODUCTION. Le positionnement de l’implant acétabulaire<br />
est un élément primordial lors de l’implantation d’une prothèse<br />
totale de hanche. Le contrôle manuel est imprécis, et <strong>les</strong><br />
systèmes de navigation pourraient améliorer la précision. Cette<br />
étude avait pour but de valider par un contrôle tomodensitométrique<br />
postopératoire <strong>les</strong> mesures d’orientation peropératoire de la<br />
prothèse acétabulaire faites par un système de navigation sans<br />
image.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Soixante implantations d’une<br />
prothèse totale de hanche cimentée posée par voie antérolatérale<br />
en décubitus dorsal ont été étudiées. La navigation a été effectuée<br />
à l’aide du système sans image OrthoPilot ® (Aesculap, Tuttlingen,<br />
Allemagne). Après implantation d’un localiseur de<br />
référence dans la crête iliaque du côté opéré, le plan pelvien<br />
antérieur était palpé, définissant l’orientation tridimensionnelle<br />
du bassin. La préparation acétabulaire et l’implantation étaient<br />
effectuées sous contrôle du système de navigation. La zone de<br />
sécurité était définie préalablement (de 40 à 50° d’inclinaison, de<br />
10 à 20° d’antéversion). L’orientation finale de l’implant était<br />
enregistrée, puis comparée au positionnement défini sur une<br />
tomodensitométrie (TDM) postopératoire, en utilisant le plan<br />
pelvien antérieur comme référence.<br />
RÉSULTATS. Il n’y avait pas de différence significative entre<br />
l’orientation en inclinaison de la prothèse acétabulaire mesurée<br />
en cours d’intervention et sur la TDM postopératoire. Il existait<br />
une différence significative entre l’orientation en antéversion de<br />
la prothèse acétabulaire mesurée en cours d’intervention et sur la<br />
TDM postopératoire, généralement comprise entre ± 5°. Trente-<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S85<br />
trois implants étaient positionnés dans la zone de sécurité choisie<br />
préalablement (83 %).<br />
DISCUSSION. Le système de navigation utilisé autorise un<br />
contrôle satisfaisant du positionnement de l’implant acétabulaire<br />
en inclinaison. Le contrôle du positionnement en antéversion est<br />
plus aléatoire, mais reste dans la majorité <strong>des</strong> cas dans une fourchette<br />
d’imprécision acceptable. En tout état de cause, la précision<br />
d’implantation est améliorée par rapport aux techniques<br />
manuel<strong>les</strong> conventionnel<strong>les</strong>.<br />
CONCLUSION. Le système de navigation sans image permet<br />
une amélioration de la qualité de positionnement de l’implant<br />
acétabulaire d’une PTH par rapport aux techniques manuel<strong>les</strong><br />
conventionnel<strong>les</strong>.<br />
* Cyril Boéri, CTO, 10, avenue Baumann, 67400 Illkirch.<br />
112 Révisions acétabulaires par cupule<br />
vissante sans ciment recouverte<br />
d’hydroxyapatite<br />
Jean-Christophe CHATELET *<br />
et le groupe Artro<br />
INTRODUCTION. La révision <strong>des</strong> <strong>des</strong>cellements acétabulaires<br />
pose <strong>des</strong> problèmes de fixation <strong>des</strong> implants et de reconstruction<br />
du stock osseux. Si <strong>les</strong> anneaux de reconstruction cimentés<br />
donnent de bons résultats sur <strong>les</strong> grands <strong>des</strong>cellements, la recherche<br />
de la <strong>des</strong>escalade oriente vers <strong>des</strong> implants sans ciment au<br />
contact de l’os vivant sans apport de greffes. Le but de cette<br />
étude était d’évaluer la fiabilité d’une cupule vissante dans <strong>les</strong><br />
reconstructions acétabulaires grâce à sa stabilité mécanique primaire<br />
et son ostéointégration secondaire.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Sur <strong>les</strong> 115 révisions de prothèses<br />
tota<strong>les</strong> de hanche pratiquées entre 1993 et 2000, 72 ont utilisé<br />
une cupule vissante sans ciment recouverte d’hydroxyapatite. Il<br />
s’agissait de 71 patients d’âge moyen 71,6 ans ( 40-91), 36 hommes<br />
pour 35 femmes, le délai de réintervention était de 11,5 ans<br />
(1-29). La reprise était bipolaire 45 fois et acétabulaire 27 fois.<br />
Le diamètre de la nouvelle cupule a augmenté de 3 tail<strong>les</strong> (3,17)<br />
et le diamètre moyen après révision était de 58 mm (57,7). Les<br />
vis ont completé la fixation de la cupule 44 fois (2 vis en<br />
moyenne) et il a été remis en place 63 têtes alumine pour 9 têtes<br />
inox. Les greffes osseuses ont été utilisées 30 fois mais uniquement<br />
en comblement <strong>des</strong> defects osseux (plots de ciment, greffe<br />
du fond), la cupule devant retrouver sa stabilité primaire sur de<br />
l’os vivant. L’étude clinique a utilisé la cotation PMA et l’étude<br />
radiologique a mesuré l’usure du couple de frottement ainsi que<br />
la modification du centre de rotation. Les lésions osseuses acétabulaires<br />
ont été evaluées par la classification de Paprosky :<br />
47 types 2 (21 2a, 18 2b et 8 2c), 17 types 3 (12 3a et 5 3b),<br />
8 types 1.<br />
RÉSULTATS. Cinquante-neuf patients ont été revus (11 décédés<br />
et 1 perdu de vue) avec un recul de 9,24 ans (6-13). La cotation<br />
PMA moyenne est passée de 9 en préoperatoire à 17 au
3S86 81 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
recul. Trois cupu<strong>les</strong> ont du être changés : 2 fois pour luxation<br />
recidivante et 1 fois pour mobilisation précoce (7 mois) par mauvaise<br />
fixation primaire. Des images de reconstruction osseuse<br />
ont été retrouvées au contact de l’implant avec comblement <strong>des</strong><br />
défects et de l’espace périprothétique. Il n’a pas été noté de liseré<br />
ou de mobilisation de la cupule en dehors du cas de reprise.<br />
L’usure du polyéthylène a été mesurée 13 fois à 1 mm. La modification<br />
du centre de rotation a été en moyenne de 3,2 mm<br />
(ascension) en raison de l’augmentation du diamètre <strong>des</strong><br />
implants acétabulaires (megacupule).<br />
DISCUSSION. Les cupu<strong>les</strong> vissantes doivent être considérées<br />
aujourd’hui comme <strong>des</strong> implants pressfit au même titre que <strong>les</strong><br />
cupu<strong>les</strong> impactées. Ce sont <strong>les</strong> spires qui prennent le rôle de<br />
macrostructure sur un acétabulum hémisphérique. Ces spires<br />
trouvent tout leur intérêt en chirurgie de révision par l’accroche<br />
supérieure et leur mordant sur un os fragilisé. La remise en contrainte<br />
de cet os va lui permettre une cicatrisation et une repousse<br />
osseuse au contact du revêtement bioactif et obtenir ainsi,<br />
l’ostéointegretion secondaire. La modularité <strong>des</strong> cupu<strong>les</strong> vissantes<br />
permet aujourd’hui, l’utilisation <strong>des</strong> nouveaux coup<strong>les</strong> de<br />
frottements (alu-alu ou métal-métal) et l’utlisation de têtes de<br />
gros diamètre ce qui permettra de diminuer <strong>les</strong> instabilités récidivantes<br />
(2 cas dans la série).<br />
CONCLUSION. Dans cette serie rétrospective de 72 reprises<br />
acétabulaires à 9 ans de recul, l’utilisation <strong>des</strong> cupu<strong>les</strong> vissantes<br />
recouvertes d’hydroxyapatite permet une reconstruction acétabulaire<br />
sans ciment avec désescalade. Les spires permettent une<br />
accroche peroperatoire dans tous <strong>les</strong> cas de <strong>des</strong>cellement (sauf<br />
s’il existe une pseudarthrose du bassin ou fracture de l’acétabulum<br />
car le vissage va augmenter l’écart inter-fragmentaire). La<br />
cupule doit reposer sur un os vivant hôte et <strong>les</strong> greffes ne doivent<br />
servir qu’au comblement <strong>des</strong> défects sans rôle de maintient de<br />
l’implant. La repousse osseuse au contact de l’hydroxyapatite se<br />
fera à partir de l’os vivant, atrophique ou sclereux, à condition<br />
d’avoir obtenue, grâce aux spires, une parfaite stabilité primaire.<br />
* Jean-Christophe Chatelet, Polyclinique du Beaujolais,<br />
69400 Arnas.<br />
113 Couple de frottement alumine-alumine<br />
sandwich : bilan à 6 ans de<br />
155 prothèses de hanche non<br />
cimentées<br />
Jean NORTH *, Dan BORCOS,<br />
Mohamed EL JAMRI<br />
INTRODUCTION. L’intérêt du couple alumine-alumine a été<br />
démontré depuis <strong>les</strong> travaux de P. Boutin. Le but de ce travail<br />
prospectif était d’évaluer le concept alumine-alumine sandwich<br />
en étudiant le devenir de ce couple de frottement avec une cupule<br />
vissante en titane et une tige droite rectangulaire en titane.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Il s’agit d’une série continue<br />
prospective de 155 arthroplasties de hanches implantées de 2000<br />
à 2005. La série comportait : 71 femmes pour 84 hommes. L’âge<br />
moyen était de 56 ans (28-74). Le recul moyen était de 29 mois<br />
(4,3-67,6). Les étiologie étaient : 62 % d’arthrose primitive,<br />
17,3 % séquel<strong>les</strong> de luxation congénitale, 11,3 % de nécroses.<br />
Les dossiers ont été analysés selon <strong>les</strong> cotations PMA et de Harris.<br />
Sur <strong>les</strong> radiographies de hanche, il a été recherché : l’inclinaison<br />
de la cupule, <strong>les</strong> signes de <strong>des</strong>cellement et <strong>les</strong> signes de<br />
dégradation de la cupule. Les tests statistiques utilisés ont été : le<br />
test de Student, l’analyse de la variance et la survie selon<br />
Kaplan-Meier.<br />
RÉSULTATS. Aucun patient n’a été perdu de vue. Il n’y a pas<br />
eu d’infection, mais 3 cas de luxation (1,9 %). Le score PMA<br />
passait de 11,5 à 17,7 et celui de Harris de 49,5 à 96,9. L’inclinaison<br />
de la cupule était en moyenne de 41° sans signe de mobilisation<br />
retrouvée. Il est noté un « remodelage » du Merckel dans<br />
17,7 %, et un liseré non évolutif dans 29,2 % en zone trochantérienne.<br />
Aucune usure du polyéthylène n’a été constatée.<br />
DISCUSSION. Dans cette série, <strong>les</strong> résultats cliniques et<br />
radiologiques sont très bons et bons à 89,3 % (PMA). Un patient<br />
a été repris pour l’exérèse d’un « kyste synovial » d’étiologie<br />
indéterminée et l’insert non usé a été changé par précaution. On<br />
ne déplore aucune rupture de tête alumine ni de l’insert alumine<br />
et aucune usure ni <strong>des</strong>sertissage de l’interface en polyéthylène.<br />
Les liserés non évolutifs en zone trochantérienne, sans traduction<br />
clinique, sont habituellement retrouvés dans <strong>les</strong> différentes séries<br />
et sont indépendants du couple de frottement.<br />
CONCLUSION. À 6 ans de recul, le couple de frottement<br />
alumine-alumine sandwich, donne de bons résultats cliniques et<br />
radiologiques sans <strong>des</strong>sertissage du polyéthylène et sans fracture<br />
de tête. L’analyse à moyen terme de ce concept permet d’obtenir<br />
<strong>des</strong> résultats très encourageants, mais ils doivent être confirmés<br />
par un plus grand recul clinique.<br />
* Jean North, Centre Hospitalier de Sé<strong>les</strong>tat, 24,<br />
avenue Pasteur, 67600 Sé<strong>les</strong>tat.<br />
114 L’arthroplastie totale de hanche à<br />
l’aide d’un système de navigation<br />
pour le contrôle de la longueur et<br />
de l’offset<br />
Grégory MOINEAU *, Eric STINDEL,<br />
Marc-Pierre HENRY, Romain GÉRARD,<br />
Christian LEFÈVRE<br />
INTRODUCTION. Le but de notre étude était d’évaluer <strong>les</strong><br />
écarts existant entre la planification préopératoire et le geste<br />
effectivement réalisé lors de la pose de PTH assistées d’un système<br />
de navigation.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Notre série comporte 20 PTH,<br />
mono-implant et mono-opérateur, posées à l’aide du système de<br />
navigation Hiplogics (Praxim medivision). Une planification<br />
préopératoire était réalisée déterminant : le centre de la cupule,<br />
la hauteur de la tige fémorale, l’offset, le type de tige, et la longueur<br />
du membre. L’arthroplastie totale de hanche était réalisée
en suivant <strong>les</strong> données de la station de navigation avec pour but<br />
de restaurer au mieux longueur et offset. Les mesures radiographiques<br />
préopératoires étaient réévaluées sur la radiographie<br />
postopératoire. La concordance était analysée par la méthode de<br />
Bland et Altman au seuil de 5 mm. Une taille de différence<br />
d’implant était également acceptée.<br />
RÉSULTATS. La planification opératoire a été respectée en<br />
termes de position et de type d’implant 13 fois. La position <strong>des</strong><br />
implants ne correspondait pas à celle planifiée 5 fois. Les<br />
implants alors posés ne correspondaient pas non plus. Cependant,<br />
la restauration de la longueur et de l’offset était obtenue.<br />
Une coupe fémorale haute a été compensée par la pose d’un<br />
implant latéralisé au prix d’une latéralisation excessive de 9 mm.<br />
Dans un cas, seul le type d’implant a changé. Une médialisation<br />
fémorale de 16 mm était retrouvée.<br />
DISCUSSION. Comme dans la littérature, la planification<br />
effectuée en préopératoire à pu être réalisée dans 65 % <strong>des</strong> cas<br />
restituant longueur et offset. Dans 25 % <strong>des</strong> cas, cette planification<br />
n’était pas respectée. Mais l’utilisation <strong>des</strong> informations<br />
117 Dysplasie focale fibropériostée<br />
(inclusion périostée) : une série de<br />
11 nouveaux cas et revue de la littérature<br />
Rémi KOHLER *, Jean-Luc JOUVE,<br />
Bruno DOHIN, Gérard BOLLINI,<br />
Scott MUBARAK<br />
INTRODUCTION. Depuis le premier cas de « dysplasie<br />
focale fibrocartilagineuse » décrit par Bell en 1985 chez un<br />
patient présentant une déformation du tibia, 71 cas ont été rapportés<br />
dans la littérature. La plupart <strong>des</strong> localisations sont : tibia<br />
proximal (60 %), 1 fémur distal (16 %) partie distale de l’ulna<br />
(14 %). L’histoire naturelle étant imprévisible, de nombreux traitements<br />
ont été proposés (simple surveillance, attelle nocturne,<br />
ostéotomie, curetage).<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. De 1992 à 2005, 11 cas (9 garçons<br />
et 2 fil<strong>les</strong>) ont été suivis dans trois services d’orthopédie<br />
pédiatrique. Les lésions ont entraîné <strong>des</strong> déformations en varus<br />
du tibia proximal (9 cas), en valgus de l’extrémité distale du<br />
fémur (1 cas) et de l’ulna distal (1 cas). L’âge au moment du diagnostic<br />
se situe entre 12 et 70 mois (moyenne 23 mois). La<br />
déformation en varus du tibia a été mesurée par l’angle métaphyso<br />
diaphysaire de Levine-Drennan et a bénéficié d’un suivi<br />
radiologique.<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S87<br />
Séance du 7 novembre matin<br />
PÉDIATRIE<br />
fournies par le système de navigation concernant <strong>les</strong> écarts à<br />
cette planification, permettait de modifier cette dernière en<br />
temps réels, permettant d’obtenir 90 % <strong>des</strong> hanches ayant longueur<br />
et offset restaurés. Deux cas sont <strong>des</strong> échecs. L’un est<br />
secondaire à la mobilisation inopinée et méconnue d’un corps<br />
rigide. Pour l’autre, une mauvaise décision peropératoire à fait<br />
poser un implant latéralisé, là ou la reprise de la coupe fémorale<br />
eut été préférable pour résoudre le problème d’une longueur<br />
excessive.<br />
CONCLUSION. La planification d’une arthroplastie totale de<br />
hanche est essentielle, mais garde ses limites. Des considérations<br />
anatomiques loca<strong>les</strong> rendent parfois sa réalisation difficile. Dans<br />
ces situations, disposer d’information 3D intra-opératoire est un<br />
atout permettant : a) d’objectiver et de mesurer l’écart entre geste<br />
planifié et geste réalisé ; b) d’adapter le geste opératoire pour restituer<br />
une hanche équilibrée en termes d’offset et de longueur.<br />
* Grégory Moineau, Service d’Orthopédie Traumatologie,<br />
CHU La Cavale Blanche, boulevard Tanguy-Prigent, 29200 Brest.<br />
RÉSULTATS. Les 9 cas tibiaux ont été traités par : simple surveillance<br />
ou attelle nocturne avec guérison (4 cas) ; ostéotomie<br />
tibiale (1 cas) avec une excellente correction ; curetage précoce<br />
(4 cas), suivi d’une correction très rapide. Le cas fémoral a été<br />
simplement cureté, permettant une correction complète. Le cas<br />
concernant l’ulna a bénéficié d’un curetage et d’un allongement.<br />
DISCUSSION. Dans la littérature, la surveillance est recommandée<br />
dans la moitié <strong>des</strong> cas pour <strong>les</strong> atteintes tibia<strong>les</strong> et fémora<strong>les</strong>.<br />
Cependant, une ostéotomie est proposée lorsque la<br />
déformation est sévère ou s’aggrave. Le curetage a été rarement<br />
proposé (5 cas). Dans notre série, cette méthode a été utilisée<br />
5 fois ; c’est un geste simple suivi d’une guérison rapide qui évite<br />
une ostéotomie. Les auteurs pensent que la dysplasie fibrocartilagineuse<br />
est un ancrage anormal du périoste (que nous appelons<br />
« inclusion périostée ») dont l’effet est identique à celui <strong>des</strong><br />
épiphysiodèses : si l’inclusion n’est pas trop importante, sa rupture<br />
peut être spontanée avec correction ; si l’inclusion est importante,<br />
la déformation va s’aggraver et nécessiter un traitement<br />
chirurgical. Pour le tibia, elle représente le « pes anserinus » et a<br />
été confirmée par IRM. Un curetage précoce doit être proposé<br />
dans <strong>les</strong> cas qui s’aggravent pour éviter une ostéotomie.<br />
CONCLUSION. La dysplasie fibrocartilagineuse n’est pas si<br />
rare si on sait la reconnaître : une courte période d’observation<br />
est proposée et un curetage précoce doit être envisagé si la déformation<br />
persiste ou s’aggrave.<br />
* Rémi Kohler, Service de Chirurgie Orthopédique,<br />
Pavillon T, Hôpital Edouard-Herriot, place d’Arsonval,<br />
69437 Lyon Cedex 03.
3S88 81 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
118 Arthrogrypose congénitale multiple<br />
: analyse du suivi de 13 enfants<br />
depuis la naissance jusqu’en fin de<br />
croissance<br />
Alice MARCDARGENT-FASSIER *,<br />
Philippe WICART, Jean DUBOUSSET,<br />
Raphaël SERINGE<br />
INTRODUCTION. La prise en charge de l’arthrogrypose<br />
congénitale multiple est un défi pour <strong>les</strong> orthopédistes. Les indications<br />
thérapeutiques et l’avenir <strong>des</strong> enfants atteints, en fonction<br />
de la sévérité de l’atteinte initiale, ne sont pas claires. Le but<br />
de cette étude était de revoir <strong>des</strong> patients suivis depuis la naissance<br />
jusqu’à la maturité osseuse afin de mieux déterminer l’utilité<br />
<strong>des</strong> traitements et le pronostic d’autonomie de ces patients.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Les dossiers cliniques et radiologiques<br />
de 13 enfants présentant une atteinte sévère ont été<br />
revus. Tous <strong>les</strong> enfants ont été traités par kinésithérapie intensive,<br />
orthèses prolongées et chirurgies répétées. Ils ont été suivis<br />
depuis la naissance (en moyenne à 18 jours de vie) jusqu’en fin<br />
de croissance (en moyenne 19,4 ans).<br />
RÉSULTATS. Au total, 95 interventions chirurgica<strong>les</strong> ont été<br />
réalisées (de 3 à 12 par enfant), en moyenne par patient : 6,1 sur<br />
<strong>les</strong> membres inférieurs, 1,2 sur <strong>les</strong> membres supérieurs et 0,2 sur<br />
le rachis. Après échec de traitement orthopédique, 7 luxations<br />
unilatéra<strong>les</strong> de hanche sur 8 ont été réduites chirurgicalement. De<br />
multip<strong>les</strong> ostéotomies de hanches et de genoux ont été pratiquées.<br />
Les pieds bots ont souvent nécessité <strong>des</strong> reprises chirurgica<strong>les</strong><br />
itératives. À maturité osseuse, 11 enfants étaient marchants dont<br />
8 sans aide, 12 avaient une fonction satisfaisante aux membres<br />
supérieurs. Des déficits d’extension inférieurs à 20° aux hanches<br />
et 15° aux genoux ont été notés chez <strong>les</strong> marchants. Contre toute<br />
attente, une amélioration de l’activité musculaire a été notée chez<br />
la moitié <strong>des</strong> marchants. À la fin de croissance, <strong>les</strong> patients présentaient<br />
le plus souvent <strong>des</strong> pieds rigi<strong>des</strong> mais plantigra<strong>des</strong>. Les<br />
2 non marchants étaient <strong>les</strong> seuls dont la sévérité de l’atteinte<br />
rachidienne a nécessité une arthrodèse vertébrale. Le niveau scolaire<br />
était normal, en étu<strong>des</strong> supérieures pour <strong>les</strong> plus âgés.<br />
DISCUSSION. L’objectif <strong>des</strong> traitements est dans un premier<br />
temps la levée <strong>des</strong> raideurs, puis la correction <strong>des</strong> luxations de<br />
hanche et <strong>des</strong> pieds bots. La thérapeutique est assurée en grande<br />
partie par <strong>les</strong> kinésithérapeutes. Néanmoins, le recours à la chirurgie<br />
est souvent nécessaire pour obtenir un secteur utile de<br />
mobilité.<br />
CONCLUSION. Le pronostic à long terme <strong>des</strong> arthrogryposes<br />
sévères est relativement favorable quant à la déambulation et<br />
la scolarisation. Il n’est pas corrélé avec la sévérité de la présentation<br />
à la naissance. Ainsi, il nous semble qu’une prise en<br />
charge multidisciplinaire kinésithérapique et orthopédique précoce,<br />
intensive et prolongée soit justifiée et recommandée.<br />
* Alice Marcdargent-Fassier,<br />
Service de Chirurgie Orthopédique Pédiatrique,<br />
Hôpital Saint-Vincent-de-Paul,<br />
74-84, avenue Denfert-Rochereau, 75014 Paris.<br />
119 Reconstruction diaphysaire <strong>des</strong> os<br />
longs par la technique de la membrane<br />
induite après résection<br />
tumorale chez l’enfant<br />
Benoit DE BILLY *, Christian BONNARD,<br />
Jean LANGLAIS, Benoit DE COURTIVRON,<br />
Marc PLANCHENAULT, Mohamed L’KAISSI<br />
INTRODUCTION. La technique de membrane induite développée<br />
par Masquelet est un concept original de reconstruction<br />
diaphysaire. Nous l’avons appliquée à la reconstruction diaphysaire<br />
après résection carcinologique pour tumeur maligne chez<br />
l’enfant.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Cinq enfants (1 fille et 4 garçons)<br />
sont inclus dans cette série. L’âge moyen était de 7,9 ans<br />
(3-11,5). Le diagnostic était un ostéosarcome dans un cas et un<br />
sarcome d’Ewing dans 4 cas. La localisation était une diaphyse<br />
humérale, 3 diaphyses fémora<strong>les</strong> et une reconstruction du col et<br />
de la diaphyse du fémur dans le dernier cas. Dans tous <strong>les</strong> cas,<br />
une entretoise a été mise en place après la résection tumorale. Du<br />
ciment stabilisé par <strong>des</strong> broches de Metaizeau a été utilisé 4 fois.<br />
Une entretoise métallique vissée sur mesure a été utilisée dans<br />
une reconstruction fémorale. La remise en charge dans ce premier<br />
temps a été autorisée après 6 semaines. Le deuxième temps<br />
a été effectué 9 mois après la résection tumorale (5-15 mois)<br />
pour <strong>les</strong> reconstructions du membre inférieur et 21 mois après la<br />
résection dans le cas de la reconstruction humérale. Après ablation<br />
<strong>des</strong> entretoises, la greffe autologue a été prélevée sur <strong>les</strong><br />
tibias et <strong>les</strong> crêtes iliaques. La stabilisation secondaire a été<br />
effectuée dans 2 cas par <strong>des</strong> broches centromédullaires, dans<br />
2 cas par un clou verrouillé et dans 1 cas par une vis-plaque type<br />
LCP pour la résection du col et de la diaphyse fémorale.<br />
RÉSULTATS. La remise en charge après cette greffe a été<br />
autorisée après 2 mois, à l’exception de la reconstruction du col<br />
pour laquelle il a fallu attendre 6 mois. La consolidation a été<br />
obtenue en moyenne en deux ans. Les complications ont été :<br />
2 changements de broches, 2 pseudarthroses sur la partie proximale<br />
de la greffe fémorale, traitées par décortication-greffe,<br />
1 fracture du fémur après ablation du matériel. Différence de<br />
longueur <strong>des</strong> membres inférieurs dans 2 cas.<br />
DISCUSSION. La consolidation a été obtenue dans tous <strong>les</strong><br />
cas. Seule, la localisation du col du fémur a nécessité deux gestes<br />
de reprise. La qualité de l’os obtenue dans ses reconstructions est<br />
radiologiquement très satisfaisante. Le taux de complications est<br />
comparable aux autres techniques de reconstruction diaphysaire,<br />
utilisant en particulier le greffon vascularisé. La simplicité technique<br />
est notable. Les propriétés de la membrane induite semblent<br />
encore importantes même avec un délai d’attente pour la<br />
reconstruction supérieur à 6 mois, délai nécessaire pour pratiquer<br />
la greffe après la période de chimiothérapie<br />
* Benoit de Billy, Service de Chirurgie Pédiatrique<br />
et Orthopédique, Hôpital Saint-Jacques,<br />
2, place Saint-Jacques, 25030 Besançon Cedex.
120 La reconstruction du pelvis après<br />
résection tumorale périacétabulaire<br />
chez l’enfant et l’ado<strong>les</strong>cent<br />
Habib NOURI *, Eric MASCARD,<br />
Philippe WICART, Gil<strong>les</strong> MISSENARD,<br />
Jean DUBOUSSET, Raphaël SERINGE<br />
INTRODUCTION. Le pelvis est une localisation fréquent <strong>des</strong><br />
tumeurs malignes. Il présente <strong>des</strong> problèmes diagnostiques et<br />
thérapeutiques surtout pour la reconstruction de la hanche et particulièrement<br />
chez l’enfant. Le but de notre travail était de discuter<br />
<strong>les</strong> différentes techniques de reconstruction du bassin.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Nous rapportons une série<br />
rétrospective de vingt patients d’âge moyen 13,2 ans opérés<br />
d’une tumeur maligne du bassin. La tumeur envahissait <strong>les</strong> zones<br />
I+II dans 7 cas, II+III dans 10 cas, I+II+IV dans 2 cas et<br />
I+II+III+IV dans 1 cas. Il s’agissait d’un sarcome d’Ewing dans<br />
11 cas, d’un ostéosarcome dans 6 cas, et d’un chondrosarcome<br />
dans 3. Les résections emportant l’aile iliaque ont été reconstruites<br />
par une greffe sacrocotyloïdienne avec pseudarthrodèse de<br />
hanche dans 4 cas par une allogreffe selon la technique de Pujet<br />
dans 3 cas, par un spacer en ciment et PTH dans 1 cas et par<br />
matériel CD et une PTH dans 1 cas. Les résections emportant le<br />
cadre obturateur ont été reconstruites par une arthrodèse iliofémorale<br />
dans 6 cas, par une prothèse Saddle dans 2 cas et par la<br />
technique de Pujet dans 2 cas. Les résultats ont été analysés avec<br />
un recul moyen de 57 mois.<br />
RÉSULTATS. Nous avons noté 5 infections et 4 paralysies<br />
radiculaires, une luxation permanente d’une PTH et une arthrodèse<br />
ilio-fémorale a évolué vers la pseudarthrodèse. Deux<br />
patients ont eu une récidive locale et 4 patients <strong>des</strong> métastases.<br />
Le taux de survie est de 76 % à 1 an et 69 % à 5 ans. Le résultat<br />
fonctionnel a été évalué chez 15 patients avec un recul moyen de<br />
72 mois selon la cotation fonctionnelle de Enneking. Le score<br />
moyen était de 65 %. L’inégalité de longueur <strong>des</strong> membres inférieurs<br />
était de 4,3 cm en moyenne. Deux patients avaient une<br />
scoliose.<br />
DISCUSSION. Les métho<strong>des</strong> de reconstruction après résection<br />
périacétabulaire du bassin sont nombreuses. La conservation<br />
de l’aile iliaque permet souvent une reconstruction plus facile et<br />
<strong>les</strong> résultats fonctionnels sont meilleurs quelle que soit la technique.<br />
Sa résection est plus difficile à reconstruire et <strong>les</strong> suites sont<br />
plus compliquées. La pseudarthrodèse de hanche entraîne une<br />
ascension progressive de la tête fémorale et un raccourcissement<br />
majeur. L’utilisation d’allogreffe et de prothèse est grevée de<br />
complications mécaniques et septiques très importantes.<br />
CONCLUSION. La reconstruction pelvienne après résection<br />
tumorale est un vrai défi chez l’enfant. Elle associe <strong>les</strong> problèmes<br />
techniques propres à cette chirurgie aux problèmes inhérents<br />
à la croissance. Les résections de l’aile iliaque sont <strong>les</strong> plus<br />
diffici<strong>les</strong> à reconstruire.<br />
* Habib Nouri, Service d’Orthopédie Pédiatrique,<br />
Hôpital Saint-Vincent-de-Paul,<br />
74-82, avenue Denfert-Rochereau,<br />
75674 Paris Cedex 14.<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S89<br />
121 Synovialosarcome de l’enfant : un<br />
diagnostic difficile. À propos de<br />
7cas<br />
Fabien WALLACH *, Thierry ODENT,<br />
Christian MORIN, Daniel ORBACH,<br />
Christophe GLORION<br />
INTRODUCTION. Le synovialosarcome est la deuxième<br />
tumeur maligne <strong>des</strong> parties mol<strong>les</strong> de l’enfant. Elle reste une<br />
tumeur rare, dont la croissance lente rend le diagnostic difficile.<br />
Les diagnostics différentiels sont nombreux et sont classiquement<br />
<strong>des</strong> diagnostics de tumeur maligne. Nous avons cherché à<br />
voir quels sont <strong>les</strong> pièges diagnostiques de cette tumeur chez<br />
l’enfant à partir de la série de notre service.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Sept dossiers : 4 fil<strong>les</strong> et 3 garçons,<br />
âgés de 4 à 16 ans au diagnostic, présentant un synovialosarcome<br />
<strong>des</strong> membres ont été revus. Les données du diagnostic<br />
initial (examen clinique, imagerie, examen anatomo-pathologique)<br />
ont été étudiées pour rechercher <strong>les</strong> causes de bon ou de<br />
mauvais diagnostic.<br />
RÉSULTATS. Quatre patients ont été pris en charge initialement<br />
dans un centre non habitué à la chirurgie tumorale, menant<br />
3 fois à un diagnostic erroné de tumeur bénigne : abcès enkysté,<br />
arthrite juvénile ou schwannome. Trois patients ont été pris en<br />
charge initialement dans un centre de référence, avec 1 diagnostic<br />
erroné de tumeur fibreuse bénigne sur un examen extemporané,<br />
corrigé à l’examen anatomo-pathologique final.<br />
DISCUSSION. Les tumeurs <strong>des</strong> parties mol<strong>les</strong> sont <strong>des</strong><br />
tumeurs de diagnostic difficile et <strong>les</strong> taux de diagnostics érronés<br />
sont élevés dans la littérature. Le diagnostic différentiel se fait<br />
essentiellement avec <strong>les</strong> autres sarcomes pour la littérature alors<br />
que notre expérience rapporte aussi <strong>des</strong> cas de difficultés diagnostiques<br />
avec <strong>des</strong> tumeurs bénignes.<br />
CONCLUSION. Le synovialosarcome de l’enfant reste une<br />
tumeur rare de diagnostic difficile, qui nécessite une confrontation<br />
entre <strong>les</strong> données cliniques, l’imagerie et l’examen anatomo-pathologique<br />
pour avoir un diagnostic plus précis. Il faut<br />
savoir y penser devant une tumeur péri-articulaire, d’évolution<br />
lente chez un grand enfant ou un adulte jeune.<br />
* Fabien Wallach, Service d’Orthopédie, HEGP,<br />
20, rue Leblanc, 75015 Paris.
3S90 81 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
122 Les atteintes épiphysaires de la<br />
hanche dans <strong>les</strong> dysplasies polyépiphysaires<br />
et <strong>les</strong> dysplasies spondyloépiphysaires<br />
de l’enfant<br />
Grégory COURTADE *, David BIAU,<br />
Georges FINIDORI, Vicken TOPOUCHIAN,<br />
Stéphanie PANNIER, Martine LE MERRER,<br />
Christophe GLORION<br />
INTRODUCTION. L’objectif de ce travail était de connaître<br />
l’évolution <strong>des</strong> atteintes épiphysaires de la hanche dans <strong>les</strong> dysplasies<br />
polyépiphysaires (DPE) et <strong>les</strong> dysplasies spondyloépiphysaires<br />
(DSE) à partir d’une étude rétrospective de 34 dossiers<br />
cliniques et radiologiques d’enfants. Nous avons essayé de<br />
savoir si une chirurgie conservatrice permettait de ralentir la<br />
dégradation épiphysaire et apportait une amélioration fonctionnelle<br />
par rapport à l’évolution naturelle.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. La série est constituée de<br />
34 patients ayant une atteinte bilatérale (68 hanches) : 23 patients<br />
étaient atteints de dysplasie poly-épiphysaire, 9 de dysplasie<br />
spondylo-épiphysaire congénitale, 1 de dysplasie acromicrique,<br />
1 de dysplasie pseudoachondroplasique. Un résultat global de la<br />
hanche comportant 3 sta<strong>des</strong> (bon, moyen et mauvais) a été noté<br />
au dernier recul. Ce score prenait en compte <strong>des</strong> critères cliniques<br />
(douleur, mobilité (flexion > 90°)) et radiologiques (congruence<br />
articulaire, état de l’interligne articulaire, taille <strong>des</strong> noyaux épiphysaires<br />
et de leur ossification). Les nécroses épiphysaires ajoutées<br />
à l’atteinte constitutionnelle ont été documentées par la date<br />
d’apparition de signes cliniques, <strong>des</strong> données scintigraphiques et<br />
d’imagerie par résonance magnétique.<br />
RÉSULTATS. La médiane de suivi était de 7,6 ans (de 1 à<br />
25 ans) pour l’ensemble de la série. Au dernier recul, 44 interventions<br />
ont été réalisées chez 24 patients ; 15 patients ont été opérés<br />
dans le groupe DPE et 9 dans le groupe DES : 18 ostéotomies<br />
pelviennes, 18 ostéotomies fémora<strong>les</strong> proxima<strong>les</strong>, 1 ostéotomie<br />
de fémur associée à une butée sur le bassin, 7 arthroplasties tota<strong>les</strong><br />
de hanche. Au dernier recul, l’âge moyen était de 17,3 ans<br />
(de 3,5 ans à 38,7 ans). Pour le groupe DPE, le score PMA<br />
moyen au dernier recul était de 17. Le résultat était jugé comme<br />
bon pour 36 hanches, moyen pour 7 hanches, mauvais pour<br />
7 hanches. Une ostéochondrite ajoutée est survenue pour 17 hanches.<br />
Pour le groupe DSE, le score PMA moyen au dernier recul<br />
était de 16. Au dernier recul, le résultat était jugé comme bon<br />
pour 4 hanches, moyen pour 10 hanches et mauvais pour 4 hanches.<br />
Une ostéochondrite ajoutée est survenue pour 2 hanches.<br />
DISCUSSION. La prise en charge thérapeutique de ces affections,<br />
dont l’évolution naturelle à court terme est assez défavorable<br />
est actuellement peu ou pas codifiée. Des tentatives de<br />
sauvetage articulaire par une intervention chirurgicale ont permis<br />
d’obtenir une protection épiphysaire qui paraît satisfaisante dans<br />
<strong>les</strong> DPE et qui semble être moins efficace dans <strong>les</strong> DSE.<br />
* Grégory Courtade, Service d’Orthopédie<br />
et Traumatologie Pédiatriques, Hôpital <strong>des</strong> Enfants Mala<strong>des</strong>,<br />
149, rue de Sèvres, 75015 Paris.<br />
123 Maladie de Legg-Perthes-Calvé :<br />
analyse en fin de croissance de<br />
patients âgés de 8 ans et plus au<br />
début de la maladie<br />
Grégory BIETTE *, Zaga PÉJIN,<br />
Thomas GREGORY, Georges FINIDORI,<br />
Jean-Paul PADOVANI, Christophe GLORION<br />
INTRODUCTION. La gravité potentielle de la maladie de<br />
Legg-Perthes-Calvé ou ostéochondrite primitive de hanche vient<br />
<strong>des</strong> déformations séquellaires qui évolueront, plus ou moins<br />
rapidement selon leur importance, vers une coxarthrose. Le principal<br />
facteur pronostique est l’âge de l’enfant au début de la<br />
maladie. Au-delà de 8 ou 9 ans selon <strong>les</strong> auteurs, le pronostic est<br />
moins bon. Le but de ce travail était d’analyser <strong>les</strong> résultats à<br />
l’âge adulte de cette population à risques.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Les enfants âgés d’au moins<br />
8 ans lors de la survenue de la maladie et pris en charge de façon<br />
consécutive entre 1977 et 1989 ont été revus cliniquement et<br />
radiologiquement (signes d’arthrose, coxométrie, classifications<br />
de Stulberg et Mose) de façon rétrospective. Au total, 36 hanches<br />
chez 33 enfants ayant terminé leur croissance ont été étudiées<br />
(29 garçons, 4 fil<strong>les</strong>). L’âge moyen au début de la maladie était<br />
de 10 ans (8 ans à 14,2 ans). Vingt-huit hanches ont été opérées<br />
(8 trip<strong>les</strong> ostéotomies pelviennes, 5 Chiari, 7 ostéotomies fémora<strong>les</strong><br />
de varisation, 7 de varisation-dérotation, 1 évidemmentbourrage)<br />
et 8 traitées orthopédiquement.<br />
RÉSULTATS. Le recul moyen de l’étude était de 14,2 ans<br />
(5,7 ans à 28,8 ans). Au dernier recul, 22 hanches (61 %) étaient<br />
classées parmi <strong>les</strong> bons résultats, 4 hanches (11 %) parmi <strong>les</strong><br />
résultats moyens et 10 hanches (28 %) parmi <strong>les</strong> mauvais résultats.<br />
Parmi <strong>les</strong> techniques chirurgica<strong>les</strong>, la triple ostéotomie pelvienne<br />
est celle qui a entraîné le moins d’inégalité de longueur et<br />
qui a restauré le mieux l’anatomie de l’articulation (critères<br />
coxométriques). Malgré la sélection sur l’âge, l’étude statistique<br />
a fait ressortir l’âge au début de la maladie comme facteur pronostique<br />
principal distinguant deux groupes (> 8 ans et < 9 ans :<br />
15 hanches, ≥ 9 ans : 21 hanches). Des tendances très nettes se<br />
sont dégagées en faveur du groupe le plus jeune sans preuve statistique<br />
du fait de la faib<strong>les</strong>se <strong>des</strong> échantillons.<br />
DISCUSSION. Les comparaisons avec la littérature sont rendues<br />
diffici<strong>les</strong> par l’hétérogénéité <strong>des</strong> populations étudiées, la<br />
variété <strong>des</strong> moyens d’évaluation et par l’importance de l’éventail<br />
thérapeutique. Nos résultats correspondent à ceux <strong>des</strong> autres étu<strong>des</strong>,<br />
qui el<strong>les</strong>, rapportent <strong>des</strong> séries tous âges confondus donc à<br />
priori de meilleur pronostic. Le traitement chirurgical doit être<br />
considéré comme une sanction quasi-inévitable chez cette population<br />
à risque. Les ostéotomies du bassin ont notre préférence.<br />
* Grégory Biette, Service d’Orthopédie<br />
et Traumatologie Pédiatriques, Hôpital <strong>des</strong> Enfants Mala<strong>des</strong>,<br />
149, rue de Sèvres, 75015 Paris.
124 Acétabuloplastie d’augmentation<br />
dans le traitement de l’ostéochondrite<br />
primitive de hanche<br />
Elias HADDAD *, Ismat GHANEM,<br />
‘Suha HADDAD-ZBOUNI, Noël AOUN,<br />
Fernand DAGHER, Kharrat KHALIL<br />
INTRODUCTION. L’ostéochondrite primitive de hanche est<br />
une maladie à évolution souvent bénigne, spontanément résolutive.<br />
Certains cas cependant nécessitent le recours à la chirurgie<br />
afin d’assurer le « containment », principe de base du traitement.<br />
L’objectif de cette étude était de démontrer l’efficacité de la<br />
butée dans le traitement chirurgical <strong>des</strong> ostéochondrites primitives<br />
de hanche agressives.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Une étude rétrospective a été<br />
conduite sur 20 patients consécutifs (15 garçons et 5 fil<strong>les</strong>) d’âge<br />
moyen au diagnostic 6,65 ans, présentant une forme grave et<br />
évolutive d’ostéochondrite primitive de hanche (Catterall 3 ou 4,<br />
Herring B ou C) avec <strong>des</strong> signes de tête à risque et traités par<br />
acétabuloplastie selon la technique de Staheli, avec ou sans<br />
ostéotomie fémorale de varisation entre novembre 1997 et juin<br />
2004. La butée a été réalisée sur <strong>des</strong> hanches présentant une<br />
incongruence ou une congruence asphérique avec aplatissement,<br />
excentration et déformation de la tête fémorale, tel que démontré<br />
par <strong>les</strong> radiographies préopératoires et/ou <strong>les</strong> données de<br />
l’arthrographie pratiquée sous anesthésie immédiatement avant<br />
l’incision. Tous <strong>les</strong> patients (100 %) présentaient une boiterie<br />
avec 18 (90 %) une douleur, et 15 (75 %) une limitation sérieuse<br />
de l’abduction et de la rotation interne. Une évaluation clinique<br />
(douleur, boiterie, mobilité, inégalité <strong>des</strong> membres inférieurs) et<br />
radiologique (taux de subluxation fémorale, taille de la tête<br />
fémorale, angle de Sharp, pourcentage de couverture acétabulaire,<br />
angle de Wiberg, migration de la butée) a été entreprise en<br />
préopératoire, postopératoire et au dernier recul. Une étude<br />
tomodensitométrique avec reconstruction 2D et 3D (congruence<br />
3D, « offset » de la butée, étendue de la butée) a été réalisée au<br />
dernier recul. Les classifications de Stulberg et de Mose ont été<br />
appliquées comme indicateurs de pronostic. L’analyse statistique<br />
a fait appel au test de corrélation de Pearson et à l’analyse de<br />
variance pour mesures répétées ; une valeur p < 0,05 était considérée<br />
significative. Les calculs ont été effectués au SPSSV13.<br />
RÉSULTATS. Tous <strong>les</strong> patients sont indolores au dernier recul<br />
avec 11 (55 %) sans boiterie, 7 (35 %) avec boiterie légère et 2<br />
(10 %) avec une boiterie franche. La mobilité comparative <strong>des</strong><br />
hanches est normale chez tous. Le recul moyen est de 50,70 mois<br />
(18-26). Trois hanches (15 %) sont classées en grade 1 de Stulberg,<br />
9 (45 %) en grade 2, 4 (20 %) en grade 3 et 4 (20 %) en<br />
grade 4. L’angle CC’D moyen est de 127,15° (107-145). Nous<br />
avons trouvé une différence significative dans le sens de l’amélioration<br />
du taux de subluxation fémorale (p = 0,05), de l’angle de<br />
Sharp (p = 0,000), du pourcentage de couverture acétabulaire<br />
(p = 0,000) et de l’angle de Wiberg (p = 0,000). L’étude tomodensitométrique<br />
au dernier recul a montré l’absence d’offset ou<br />
de migration de la butée. La tête fémorale est régulière chez 17<br />
(85 %) patients et aplatie chez 4 (20 %). La congruence 3D est<br />
bonne dans 100 % <strong>des</strong> cas. L’étendue coronale moyenne de la<br />
butée est de 7,91 mm. L’angle de Wiberg a été significativement<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S91<br />
influencé par le côté droit (p = 0,011), l’âge au diagnostic<br />
(p = 0,064), l’âge au traitement (p = 0,050). De même, pour<br />
l’angle de Sharp et le pourcentage de couverture acétabulaire.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. Cette étude a montré<br />
l’efficacité de la butée à moyen terme dans le traitement chirurgical<br />
de l’ostéochondrite primitive de hanche avec incongruence<br />
et déformation de la tête fémorale. L’absence de survenue de<br />
complication, l’amélioration <strong>des</strong> mesures radiologiques, l’obtention<br />
de bons scores pronostiques et l’aspect encourageant et tranquillisant<br />
<strong>des</strong> images scannographiques avec reconstruction<br />
permettent à la butée d’être un <strong>des</strong> traitements chirurgicaux <strong>les</strong><br />
plus pertinents dans la prise en charge <strong>des</strong> ostéochondrites sévères<br />
à évolution grave.<br />
* Elias Haddad, Hôpital Hôtel-Dieu de France,<br />
Université Saint-Joseph, boulevard Alfred-Naccache,<br />
961 Beyrouth, Liban.<br />
125 Analyse tridimensionnelle et étude<br />
de la rétroversion dans la triple<br />
ostéotomie juxta-cotyloïdienne<br />
chez l’enfant<br />
Rami KHALIFÉ *, Roger JAWISH<br />
INTRODUCTION. Cette étude comporte une évaluation<br />
scannographique avec reconstruction tridimensionnelle après<br />
ostéotomie juxtacotyloïdienne du bassin. Après l’analyse <strong>des</strong><br />
différents paramètres acétabulaires, nous présentons nos résultats<br />
et nous démontrons la cause <strong>des</strong> différents défauts morphologiques<br />
postopératoires, de découverture postérieure et de<br />
rétroversion.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Vingt-deux patients (25 hanches)<br />
dont 12 Legg-Perthés et Calvé et 10 dysplasies sont opérés<br />
à un âge moyen de 6,8 ans. Un CT-Scann de contrôle est fait<br />
entre 1 et 4 ans après la chirurgie. 1) La couverture latérale de la<br />
hanche est étudiée sur une vue de face. 2) La coupe axiale étudie<br />
la version acétabulaire, la couverture antérieure et postérieure.<br />
3) Les perspectives tridimensionnel<strong>les</strong> antérieures et postérieures<br />
étudient l’inclinaison <strong>des</strong> parois antérieure et postérieure. La<br />
vue inférieure 3D renseigne sur la rotation externe de l’acétabulum<br />
responsable de rétroversion. La vue 3D en latérale étudie<br />
l’inclinaison antérieure acétabulaire.<br />
RÉSULTATS. 1) La couverture latérale <strong>des</strong> hanches opérées<br />
est en moyenne 41°. 2) La version acétabulaire moyenne aux<br />
25 hanches opérées est une antéversion de 2° versus 6° au côté<br />
opposé sain. La couverture antérieure est en moyenne 27° versus<br />
31° du côté sain ; elle est 12° en postérieure, versus 10° du côté<br />
sain. 3) L’inclinaison <strong>des</strong> parois antérieure et postérieure est respectivement<br />
de 37° et 56°. La vue inférieure 3D confirme la rotation<br />
interne (antéversion) de la plupart <strong>des</strong> coty<strong>les</strong> réorientés.<br />
L’inclinaison acétabulaire antérieure par vue latérale est 6° en<br />
moyenne.<br />
DISCUSSION. Les réorientations importantes du cotyle permettent<br />
d’obtenir une inclinaison normale <strong>des</strong> parois, sans dépla-
3S92 81 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
cemement du centre de la hanche. L’amélioration de la<br />
couverture antérieure dans notre série n’implique aucune découverture<br />
postérieure <strong>des</strong> hanches opérées. Egalement, la réorientation<br />
antérieure n’implique pas nécessairement une rétroversion<br />
du cotyle, puisque 17 parmi 25 sont restés antéversés. La vue tridimensionnelle<br />
inférieure, avec repérage de l’EIAI, démontre<br />
que la rotation externe, effectuée lors de la réorientation, est responsable<br />
de l’apparition d’une rétroversion du cotyle et de la<br />
position vicieuse en rotation <strong>des</strong> hanches. Nous proposons par<br />
ailleurs une nouvelle méthode de mesure pour la version acétabulaire<br />
qui soit indépendante du degré de couverture <strong>des</strong> parois.<br />
CONCLUSION. Malgré <strong>les</strong> grands déplacements <strong>des</strong> coty<strong>les</strong><br />
réorientés, nous n’avons pas observé de découverture postérieure<br />
<strong>des</strong> hanches, ni d’importante rétroversion. La bascule du fragment<br />
cotyloïdien doit se faire dans le plan antérolatéral, en évitant<br />
toute rotation externe.<br />
* Rami Khalifé, Hôpital Sacré-Coeur, BP 116, Hazmieh, Liban.<br />
126 Résultats de la réduction chirurgicale<br />
de la luxation congénitale de<br />
hanche après échec du traitement<br />
orthopédique<br />
Jean-Michel MARTIN *, Patrick BOYER,<br />
Céline CADILHAC, Jean-Paul PADOVANI,<br />
Georges FINIDORI, Christophe GLORION<br />
INTRODUCTION. La prise en charge de la luxation congénitale<br />
de hanche repose en première intention sur le traitement<br />
orthopédique. En cas d’échec il faut proposer une réduction chirurgicale.<br />
Le but de ce travail est de présenter à long terme <strong>les</strong><br />
résultats radio-cliniques de la réduction chirugicale de la luxation<br />
congénitale de hanche après échec d’un traitement orthopédique.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Il s’agissait de 8 garçons et<br />
19 fil<strong>les</strong>. Trente-deux hanches (5 bilatéra<strong>les</strong>) ont été revues.<br />
L’âge moyen lors de l’intervention était de 10,8mois (5-23) avec<br />
un âge moyen de découverte de 4,2 mois (0-17). Deux voies<br />
d’abord (voies antéro-latérale et externe) ont été indifféremment<br />
utilisées. Après échec du traitement conservateur toutes <strong>les</strong> hanches<br />
étaient classées radiologiquement 5 ou 6 selon la classification<br />
de Séverin.<br />
RÉSULTATS. Le recul moyen de la série était de 16 ans<br />
(9-28 ans). La réduction chirurgicale a été associée dans le<br />
même temps à une ostéotomie pelvienne et ou fémorale dans<br />
31 % <strong>des</strong> cas. Les complications immédiates comportaient<br />
1 infection et 6 échecs de réduction. Dix-sept hanches sur 32 ont<br />
nécessité au moins une réintervention pour correction d’une dysplasie<br />
fémorale et/ou pelvienne. Au dernier recul, 86 % <strong>des</strong> hanches<br />
de la série présentaient un bon résultat fonctionnel (Séverin<br />
I ou II). La mobilité moyenne était de 125° en flexion, 37° en<br />
abduction, 42° en adduction, 30° en rotation externe et 45° en<br />
rotation interne. L’architecture de la hanche était normale ou peu<br />
altérée (Severin I ou II) dans 75 % <strong>des</strong> cas. On a observé une<br />
dysplasie acétabulaire (Severin III) dans 16 % <strong>des</strong> hanches. Une<br />
perturbation sévère de la morphologie de la hanche existaient<br />
dans 9 % <strong>des</strong> cas (Severin VI et VI). Des signes de souffrance<br />
épiphysaire ont été vues pour 15 hanches. À la dernière revue, un<br />
pincement coxo-fémorale était noté sur 3 hanches.<br />
CONCLUSION. La réduction chirurgicale est peu utilisée et<br />
techniquement exigeante. Les résultats de cette série sont acceptab<strong>les</strong><br />
malgré l’échec premier du traitement orthopédique. Le<br />
très long recul de cette série permet d’apprécier <strong>les</strong> séquel<strong>les</strong><br />
architectura<strong>les</strong> ainsi que <strong>les</strong> conséquences sur l’interligne.<br />
* Jean-Michel Martin, Service d’Orthopédie<br />
et Traumatologie Pédiatriques, Hôpital <strong>des</strong> Enfants Mala<strong>des</strong>,<br />
149, rue de Sèvres, 75015 Paris.<br />
127 Trochléoplastie de relèvement de la<br />
berge externe dans le traitement<br />
de l’instabilité rotulienne objective<br />
chez l’enfant avec trochlée fémorale<br />
plate<br />
Sébastien PARRATTE *, Jean-Luc JOUVE,<br />
Franck LAUNAY, Elke VIEHWEGER,<br />
Gérard BOLLINI<br />
INTRODUCTION. L’instabilité rotulienne objective a pour<br />
étiologie principale la dysplasie de trochlée. Cette instabilité<br />
peut se traduire dès l’enfance par <strong>des</strong> épiso<strong>des</strong> de luxation. Afin<br />
d’éviter l’évolution arthrosique, <strong>des</strong> interventions visant à restaurer<br />
l’anatomie de l’articulation fémoro-patellaire ont été proposées<br />
tel<strong>les</strong> que le relèvement de la berge trochléenne externe<br />
selon Albee. Le but de notre étude était d’évaluer <strong>les</strong> résultats de<br />
cette trochléoplastie chez l’enfant dans le cadre de syndromes<br />
rotuliens objectifs sur trochlée fémorale plate.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Il s’agit d’une étude rétrospective<br />
continue monoopérateur portant sur une série de 12 genoux<br />
chez 11 enfants (5 fil<strong>les</strong>-6 garçons) âgés en moyenne de 14 ans<br />
(12-17) opérés entre novembre 2000 et juin 2004. Ces enfants<br />
présentaient tous une dysplasie trochléenne de grade B selon<br />
Dejour avec en moyenne 11 épiso<strong>des</strong> de luxations (3-50). Une<br />
trochléoplastie de relèvement de la berge externe avec autogreffe<br />
prélevée au niveau de la corticale externe du fémur a été réalisée<br />
dans tous <strong>les</strong> cas, associé à une médialisation de l’appareil extenseur<br />
11 fois (avec abaissement 3 fois et avec avancement 1 fois)<br />
et une plastie du vaste interne 3 fois. Tous <strong>les</strong> patients ont été<br />
revus en consultation par un observateur indépendant. Une analyse<br />
radiologique et scannographique préopératoire et au recul a<br />
été réalisée.<br />
RÉSULTATS. Le recul moyen est de 22 mois (6-46). Aucun<br />
<strong>des</strong> patients n’a présenté de récidive de luxation. Tous <strong>les</strong><br />
patients sont satisfaits ou très satisfaits. La reprise du sport a été<br />
possible à un niveau identique ou supérieur. Deux patients présentent<br />
<strong>des</strong> douleurs antérieures après <strong>des</strong> activités sportives prolongées.<br />
Les amplitu<strong>des</strong> articulaires actives sont complètes. Le<br />
signe de Smilie est positif dans un cas. Un patient a présenté un
genu valgum dans <strong>les</strong> deux ans qui ont suivi l’intervention, faisant<br />
évoquer une epiphysiodèse partielle, non démontrée<br />
d’autant que l’axe s’est corrigé avec une épiphysiodèse partielle<br />
médiale par agrafes. Aux scanners, l’incorporation de la greffe a<br />
été acquise systématiquement. L’angle trochléen est passé en<br />
moyenne de 159 à 129°, la pente externe de 13 à 32°, le rapport<br />
de saillie de la berge externe de 1,08 à 1,26 et celui de hauteur du<br />
condyle externe de 1,06 à 1,24.<br />
DISCUSSION La trochléoplastie selon Albee permet de stabiliser<br />
efficacement la rotule et satisfait <strong>les</strong> patients. Cette intervention<br />
chez l’enfant est pour nous justifiée dans <strong>les</strong> dysplasies<br />
de gra<strong>des</strong> B, d’autant plus qu’il s’agit d’un geste accessible.<br />
Cette trochléoplastie ne semble pas dissociable d’un geste complémentaire<br />
sur la tubérosité tibiale antérieure, et a pour but de<br />
restaurer l’anatomie de la trochlée fémorale afin de préserver de<br />
l’évolution arthrosique.<br />
* Sébastien Parratte, Service de Chirurgie Orthopédique,<br />
Hôpital Timone-Enfants, 264, rue Saint-Pierre,<br />
13385 Marseille Cedex 5.<br />
128 Résultats du traitement chirurgical<br />
<strong>des</strong> raideurs du genou après<br />
reconstruction par prothèse massive<br />
pour tumeurs musculo-squelettiques<br />
chez l’enfant<br />
Mathieu THAUNAT *, Eric MASCARD,<br />
Philippe WICART, Gil<strong>les</strong> MISSENARD,<br />
Raphaël SERINGE, Jean DUBOUSSET<br />
INTRODUCTION. La raideur est une <strong>des</strong> causes <strong>les</strong> plus fréquentes<br />
de difficultés à la marche après prothèses massives de<br />
genou. Le but de cette étude était de rapporter <strong>les</strong> résultats de la<br />
chirurgie mobilisatrice du genou dans le cadre <strong>des</strong> reconstructions<br />
par prothèse pour tumeurs musculo-squelettiques chez<br />
l’enfant et l’ado<strong>les</strong>cent.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Entre 1984 et 2004, 19 patients<br />
opérés d’une résection tumorale pour sarcome d’Ewing ou<br />
ostéosarcome avec reconstruction par prothèse massive du genou<br />
ont subi une intervention mobilisatrice pour raideur. Les patients<br />
ont été revus cliniquement à un recul moyen de 5 ans (6 mois-<br />
21 ans). L’âge moyen au moment de la résection tumorale était<br />
de 12 ans (7-19 ans). La chirurgie mobilisatrice était réalisée<br />
en moyenne 3 ans après la mise en place de la prothèse<br />
(12-108 mois).<br />
RÉSULTATS. Le score fonctionnel de Ennecking moyen est<br />
passé de 16 à 23 en postopératoire, puis à 21 au dernier recul.<br />
L’amplitude articulaire moyenne est passée de 13° en préopératoire<br />
à 90° en postopératoire immédiat puis à 68° au dernier<br />
recul. Dix patients présentaient un résultat satisfaisant en termes<br />
de mobilité et de fonction au dernier recul (> 70° de mobilité).<br />
Deux patients présentaient un résultat moyen (mobilité entre<br />
40 et 70°). Quatre patients présentaient un mauvais résultat avec<br />
récidive de la raideur (< 40° de mobilité). Trois patients ont été<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S93<br />
exclus (2 patients sont décédés, et un patient a présenté une récidive<br />
locale ayant nécessité une amputation).<br />
DISCUSSION. Les résultats dépendent de la cause de la raideur<br />
qui peut être la conséquence d’une erreur technique, de facteurs<br />
liés au patient (défaut de rééducation) ou d’une<br />
complication (échec de l’implant, infection). La libération chirurgicale<br />
est principalement indiquée en cas de raideur chronique<br />
avec importante réaction fibreuse, à fortiori en cas d’échec<br />
de l’implant (<strong>des</strong>cellement, taille inadaptée, fracture du matériel),<br />
à distance du traitement de la tumeur. Les résultats de cette<br />
chirurgie associée à une rééducation bien conduite sont alors<br />
satisfaisants, permettant d’obtenir une amélioration du score<br />
fonctionnel durable. Les patients opérés pour libération du<br />
genou ont un risque élevé de récidive de l’enraidissement lors<br />
d’une reprise chirurgicale ultérieure, ce qui impose une vigilance<br />
particulière.<br />
* Mathieu Thaunat, Hôpital Saint-Vincent-de-Paul,<br />
82, avenue Denfert-Rochereau, 75014 Paris.<br />
129 Embrochage centromédullaire<br />
élastique stable dans <strong>les</strong> allongements<br />
progressifs de l’avant-bras<br />
Dimitri POPKOV *, Vladimir SHEVTSOV,<br />
Arnold POPKOV, Evgéni GRÉBÉNUK<br />
INTRODUCTION. L’avant-bras présente certains troub<strong>les</strong><br />
pour la chirurgie d’allongement. L’anatomie de l’avant-bras malformé<br />
rend l’ostéosynthèse externe difficile. Dans cette situation,<br />
une perte de la stabilité <strong>des</strong> fragments osseux risque d’entraîner<br />
<strong>des</strong> troub<strong>les</strong> de consolidation. Nous exposons, dans ce travail, <strong>les</strong><br />
résultats de notre série d’allongements de l’avant-bras par fixateur<br />
d’Ilizarov associé à l’ECMES.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Les résultats du traitement chirurgical<br />
de 33 enfants avec inégalité de longueur de l’avant-bras<br />
(F/H=18/15) ont été analysés. Le raccourcissement était d’origine<br />
congénitale dans 29 cas et traumatique chez 4 patients.<br />
Dans la première série (23 sujets, âgés de 14,1 ans en moyenne),<br />
l’ostéosynthèse était réalisée par le seul fixateur d’Ilizarov. Dans<br />
la deuxième série (10 sujets), l’ostéosynthèse externe était associée<br />
à l’ECMES. Dans cette série, l’âge moyen était de 13,6 ans.<br />
Dans la deuxième série le premier temps opératoire consistait<br />
en la pose du fixateur externe, suivie de l’ostéotomie. Le<br />
deuxième temps était la réalisation de l’ECMES. Nous avions<br />
utilisé le montage contraint par une broche.<br />
RÉSULTATS ET CONCLUSION. Le gain d’allongement<br />
obtenu était de 4,0 cm chez <strong>les</strong> patients de la première série. Pour<br />
la deuxième série, le gain était 5,5 cm. Dans <strong>les</strong> allongements<br />
ordinaires, l’index de consolidation était de 31,3 j/cm en moyenne.<br />
Dans la deuxième série, cet index a été abaissé à 23,8 j/cm. La<br />
mobilité <strong>des</strong> articulations adjacentes a été aussi récupérée dans<br />
<strong>des</strong> délais courts (de 1,5 à 3 mois). En effet, l’index de consolidation<br />
habituellement obtenu selon la méthode traditionnelle d’Ilizarov<br />
est de 30 à 40 j/cm pour l’avant-bras (Ilizarov, 1990).
3S94 81 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
L’allongement avec un système axial unilatéral donne l’index de<br />
consolidation de 51 à 61,9 j/cm en moyenne, même avec une broche<br />
guide intramédullaire et grevé de retard de consolidation<br />
nécessitant une greffe osseuse secondaire (Pajardi, 1995; Launay,<br />
2001). Notre expérience montre l’intérêt indiscutable de l’association<br />
de la méthode d’Ilizarov et de l’ECMES. La réduction<br />
moyenne de la durée d’ostéosynthèse externe est de l’ordre de<br />
7,5 jours par chaque centimétre d’allongement. L’ECMES ne<br />
semble pas compliquer ou perturber la période de réabilitation<br />
après l’ablation du matériel externe.<br />
N’oublions pas que la mise en place de l’ECMES n’empêche<br />
pas de corriger <strong>des</strong> déformations associées à une inégalité de longueur<br />
de l’avant-bras. L’ECMES associé au fixateur d’Ilizarov<br />
permet de réaliser tous <strong>les</strong> avantages de la méthode d’Ilizarov<br />
dans le traitement <strong>des</strong> anomalies congénita<strong>les</strong> de l’avant-bras.<br />
* Dimitri Popkov, Centre Acad. Ilizarov,<br />
6, Ouljanova 640014, Kourgan, Russie.<br />
130 Traumatismes de la cheville sans<br />
fracture chez l’enfant : étude prospective<br />
par résonance magnétique<br />
de 116 patients<br />
Franck LAUNAY *, Karine BARRAU,<br />
Jean-Luc JOUVE, Philippe PETIT,<br />
Pascal AUQUIER, Gérard BOLLINI<br />
INTRODUCTION. Les traumatismes de la cheville chez<br />
l’enfant font partie <strong>des</strong> motifs majeurs de recours aux services<br />
d’urgences. Un grand nombre d’examens d’imagerie a pu être<br />
proposé pour faire le bilan de ces traumatismes. Cependant, il<br />
n’existe pas de consensus sur la réalité et le type <strong>des</strong> lésions anatomiques<br />
présentes sur ces chevil<strong>les</strong>, rendant ainsi délicate la<br />
prise de décision thérapeutique. Nous avons ainsi voulu faire le<br />
bilan lésionnel de ces chevil<strong>les</strong> en période aiguë en utilisant<br />
l’imagerie par résonance magnétique chez un grand nombre<br />
d’enfants.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Il s’agit d’une étude prospective<br />
menée au sein d’un service d’accueil <strong>des</strong> urgences pédiatriques.<br />
La population d’étude était représentée par <strong>des</strong> enfants<br />
entre 8 et 15 ans avec un traumatisme isolé de la cheville sans<br />
fracture sur <strong>les</strong> radiographies. Un interrogatoire et un examen<br />
clinique standardisé ont été conduits, puis un examen par résonance<br />
magnétique a été réalisé dans <strong>les</strong> trois jours.<br />
RÉSULTATS. Durant la période d’étude, 116 patients ont été<br />
inclus. Soixante-trois examens par résonance magnétique sur<br />
cent seize présentaient au moins une lésion osseuse ou ligamentaire.<br />
Nous avons dénombré <strong>des</strong> lésions ligamentaires mineures<br />
chez 30 patients et une rupture ligamentaire chez 4 patients.<br />
Nous avons dénombré <strong>des</strong> lésions osseuses mineures chez<br />
36 patients et une fracture chez 9 patients. Aucune de ces fractures<br />
n’était visible sur <strong>les</strong> radiographies, et ce même en ayant connaissance<br />
<strong>des</strong> données de l’imagerie par résonance magnétique.<br />
Les garçons ont présenté plus de lésions que <strong>les</strong> fil<strong>les</strong>. Nous<br />
avons retrouvé un plus grand nombre de lésions lorsque la douleur<br />
était surtout localisée sur la face externe de la cheville et<br />
lorsqu’il existait un œdème de la cheville.<br />
DISCUSSION. Malgré l’abondance de la littérature sur<br />
l’entorse de la cheville, il n’existe que peu d’étu<strong>des</strong> prospectives à<br />
visée exclusivement pédiatrique. L’imagerie par résonance<br />
magnétique nous a paru être l’examen le mieux adapté à l’enfant<br />
car il permet de faire un bilan complet <strong>des</strong> éventuel<strong>les</strong> lésions<br />
anatomiques osseuses et/ou ligamentaires de la cheville sans douleur<br />
ni injection de produit de contraste. L’analyse <strong>des</strong> données<br />
montre que l’entorse de la cheville existe bien chez l’enfant car<br />
nous avons mis en évidence de véritab<strong>les</strong> ruptures ligamentaires,<br />
mais nous n’avons pas pu mettre en évidence de facteurs cliniques<br />
prédictifs de lésions ligamentaires et/ou osseuses. D’autres étu<strong>des</strong><br />
devront être menées afin de mieux comprendre le cadre nosologique<br />
de l’entorse de la cheville chez l’enfant et l’ado<strong>les</strong>cent.<br />
* Franck Launay, Service de Chirurgie Orthopédique,<br />
Hôpital Timone-Enfants, 264, rue Saint-Pierre,<br />
13385 Marseille Cedex 5.<br />
131 Infection ostéoarticulaire chez<br />
l’enfant : Kingella Kingae première<br />
bactérie en cause<br />
Mourad CHAKER *, Sylvia CHOMETON,<br />
Yvonne BENITO, Franck CHOTEL,<br />
Anne-Marie FREYDIERE, Christine PLOTTON,<br />
Vincent CUNIN, François VANDENESH,<br />
Jérôme BÉRARD<br />
INTRODUCTION. Les métho<strong>des</strong> bactériologiques conventionnel<strong>les</strong><br />
permettent le diagnostic de 40 % <strong>des</strong> infections ostéoarticulaires<br />
(IOA) primitives chez l’enfant avec une détection<br />
majoritaire de S. auréus (38 %). La technique de PCR universelle<br />
effectuée sur <strong>les</strong> prélèvements négatifs en culture permet<br />
une augmentation significative du taux de diagnostic due essentiellement<br />
à une meilleure détection de Kingella Kingae<br />
(30,4 %) plaçant cette bactérie en seconde position après<br />
S. auréus. Le but de ce travail était d’évaluer une PCR spécifique<br />
kingella kingae en temps réel, méthode non décrite jusqu’à présent<br />
plus sensible que la PCR universelle.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. De janvier 2004 à janvier 2006,<br />
<strong>les</strong> prélèvements de 136 enfants âgés de 4 mois à 16,5 ans<br />
(moyenne 4 ans 3 mois) ont été mis en culture. Tous <strong>les</strong> prélèvements<br />
négatifs en culture ont été soumis à une recherche d’ADN<br />
par PCR universelle, suivie, en cas de positivité, d’un séquençage<br />
d’ADN permettant l’identification du germe. Pour 42 prélèvements<br />
ayant une recherche par PCR universelle négative, une<br />
PCR spécifique Kingella Kingae a été effectuée.<br />
RÉSULTATS ET DISCUSSION. Soixante <strong>des</strong> 136 prélèvements<br />
ont donné une culture positive (44,1 %) incluant 24<br />
S. auréus (40 %) et 17 Kingella Kingae (28,3 %). Sur 24 <strong>des</strong><br />
77 prélèvements où la culture était négative, la PCR universelle<br />
était positive (18 Kingella Kingae et 6 autres micro-organismes),
permettant de faire passer le taux de détection <strong>des</strong> Kingella<br />
Kingae à 41,6 %. Quarante-deux <strong>des</strong> 53 prélèvements ayant une<br />
PCR universelle négative ont été soumis à une PCR spécifique<br />
Kingella Kingae et S. auréus : 6 ont montré la présence de<br />
Kingella Kingae, 0 de S. auréus portant ainsi le taux total de<br />
détection de ce germe à 45,5 % contre 26,6 pour S. auréus, cette<br />
bactérie devenant ainsi le pathogène majoritaire pour nos<br />
patients. Les 41 patients qui avaient <strong>des</strong> prélèvements positifs à<br />
K. Kingae (41 % par culture, 44 % par PCR 16 S et 15 % par<br />
PCR spécifique) présentaient pour 29 une arthrite, pour 7 une<br />
133 Courbe d’apprentissage de la mise<br />
en place de vis thoraciques : étude<br />
comparative de la mise en place de<br />
vis thoraciques pédiculaires et<br />
extrapédiculaires sur cadavres<br />
Pedro DOMENECH *, Eduardo HEVIA,<br />
Jesus BURGOS, Pedro GUTIERREZ, Biel PIZA,<br />
Ignaci SAMPERA, Juan RODRIGUEZ-OLAVERRI,<br />
Oscar RIQUELME, Joaquin FENOLLOSA<br />
INTRODUCTION. L’objectif était de comparer la sûreté de<br />
l’apprentissage de la mise en place de vis pédiculaires et extrapédiculaires<br />
en colonne dorsale par la technique <strong>des</strong> « mains<br />
libres ».<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Sur 15 colonnes de cadavres,<br />
différents chirurgiens du rachis placèrent <strong>des</strong> vis thoraciques<br />
(pédiculaires droits et extrapédiculaires gauches) par la technique<br />
« mains libres », avec <strong>des</strong> vis de 4,5 mm de D1 à D6 et de<br />
5,5 mm de D7 à D9. Une fois <strong>les</strong> vis insérées, la colonne vertébrale<br />
fut extraite du cadavre et furent réalisées radiographies,<br />
tomodensitométrie (TDM) et dissection anatomique pour<br />
évaluer la position <strong>des</strong> vis de D1à D10, analysant un total de<br />
280 vis.<br />
RÉSULTATS. Un cadavre fut écarté pour défaut général de la<br />
technique. Sur 14 cadavres, parmi <strong>les</strong> 140 vis pédiculaires analysées,<br />
nous avons trouvé 27 (19,3 %) qui rompaient de manière<br />
minime (< 2 mm) une <strong>des</strong> cortica<strong>les</strong> (10 l’interne (7,4 %) et<br />
17 (12,1 %) l’externe. Sept (5 %) vis pédiculaires se situaient en<br />
dehors du corps vertébral sans entrer en contact avec <strong>des</strong> structures<br />
anatomiques à risque, et trois (2,1 %). Neuf pénétraient de<br />
4 mm le canal sans lésion macroscopique de la dure-mère.<br />
Treize <strong>des</strong> 17 vis qui rompaient la corticale externe et six <strong>des</strong><br />
sept qui se situaient hors du corps vertébral se trouvaient au <strong>des</strong>sus<br />
de D5. Il ne fut pas mis en évidence d’association entre la<br />
rupture de la corticale médiale et le niveau vertébral. Il ne fut pas<br />
trouvé d’association statistiquement significative entre <strong>les</strong> différents<br />
chirurgiens et la malposition <strong>des</strong> vis pédiculaires. Sept vis<br />
extrapédiculaires (85 %) pénétraient le canal, cinq d’entre el<strong>les</strong><br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S95<br />
Séance du 7 novembre matin<br />
RACHIS<br />
ostéite, pour 5 une spondylodiscite ; il s’agissait de 18 garçons et<br />
de 23 fil<strong>les</strong> âgés de 15 jours à 7 ans (moyenne 18,6 mois).<br />
CONCLUSION. Kingella Kingae, bactérie longtemps considérée<br />
comme rare dans <strong>les</strong> IOA, apparaît actuellement dans notre<br />
série comme la principale étiologie chez l’enfant de moins de<br />
5 ans.<br />
* Mourad Chaker, Service de Chirurgie Orthopédique,<br />
Hôpital Debrousse, 29, rue <strong>des</strong> Sœur-Bouvier,<br />
69322 Lyon Cedex 05.<br />
de manière minime (< 2 mm) et <strong>les</strong> deux autres de moins de quatre<br />
mm. Huit vis (5,7 %) se trouvaient situées en dehors du corps<br />
vertébral. Trois vis qui envahissaient le canal furent mises en<br />
place par le même chirurgien. L’étude anatomique macroscopique<br />
démontra que 16 vis entraient en contact avec le nerf intercostal<br />
sans le léser. Aucune vis pédiculaire ni extrapédiculaire ne<br />
faisait protrusion par la partie antérieure du corps vertébral. Statistiquement,<br />
il ne fut pas mis en évidence d’association significative<br />
entre la malposition <strong>des</strong> vis pédiculaires par rapport aux<br />
extrapédiculaires.<br />
CONCLUSION. Dans cette étude, la technique « mains<br />
libres » de mise en place <strong>des</strong> vis pédiculaires utilisée par différents<br />
chirurgiens se révéla neurologiquement sûre, utilisée de<br />
façon isolée sans ajout de contrôle radiographique et neurophysiologique<br />
d’usage habituel dans la pratique clinique. Bien que<br />
19,3 % <strong>des</strong> vis pédiculaires rompaient la corticale externe ou<br />
interne ou se situaient en dehors du corps vertébral, el<strong>les</strong><br />
n’entraient pas en contact avec <strong>des</strong> éléments anatomiques à risque.<br />
Seulement 5 % <strong>des</strong> vis extrapédiculaires rompaient la corticale<br />
médiale et de façon peu significative ; quasiment la moitié<br />
d’entre el<strong>les</strong> furent incorrectement mises en place par le même<br />
chirurgien. Cette étude met en évidence la plus grande sûreté<br />
<strong>des</strong> vis extrapédiculaires par rapport aux pédiculaires utilisées<br />
par différents chirurgiens sur <strong>des</strong> colonnes sans déformation<br />
vertébrale.<br />
* Pedro Domenech, Maestro Alonso 109,<br />
03010 Alicante, Espagne.<br />
134 Les fractures transversa<strong>les</strong> thoraciques<br />
supérieures<br />
Jean-Louis LABBÉ *, Olivier PERES,<br />
Olivier LECLAIR, Renaud GOULON,<br />
Patrice SCEMAMA<br />
INTRODUCTION. Le thorax supérieur, composé de la<br />
colonne vertébrale dorsale (T1-T7), rattachée au sternum par <strong>les</strong><br />
« vraies » côtes, forme une véritable entité anatomique. Il ne fau-
3S96 81 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
drait donc plus parler de fractures « associées », mais de fractures<br />
transversa<strong>les</strong> thoraciques supérieures.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Dix cas de fracture du rachis<br />
thoracique supérieur associés à un traumatisme indirect du sternum<br />
ont été revus. Cette fracture rare avait touché 6 femmes.<br />
La moyenne d’âge était de 37 ans. Les étiologies regroupaient<br />
9 accidentés de la route et une chute. Huit fractures se situaient<br />
en T4-T5. Trois patients présentaient <strong>des</strong> fracture-dislocations,<br />
6 <strong>des</strong> « burst » de une à plusieurs vertèbres et 1 <strong>des</strong> « wedge<br />
compressions ». Le sternum était fracturé 8 fois dans la région<br />
articulaire manubrio-sternale. Six patients avaient une fracture du<br />
rachis cervical par hyperextention. Quatre patients étaient paraplégiques,<br />
<strong>les</strong> autres neurologiquement indemnes. Nous avons<br />
retrouvé 3 élargissements médiastinaux sans lésion aortique. Huit<br />
patients présentaient <strong>des</strong> lésions associées sévères avec contusion<br />
pulmonaire et pneumo-hémothorax nécessitant une admission<br />
immédiate en soins intensifs. Huit patients ont été ostéosynthésés<br />
par voie postérieure avec un bon résultat secondaire. Une patiente<br />
a été traitée orthopédiquement d’une façon satisfaisante, et une<br />
fracture passée inaperçue, a eu un mauvais résultat avec cyphose<br />
secondaire de 90° en T3.<br />
CONCLUSION. Toute fracture de la colonne thoracique doit<br />
toujours faire rechercher cliniquement et radiologiquement, un<br />
traumatisme indirect du sternum et vice-versa. Les radiographies<br />
standard sont pourvoyeuses de trop nombreux diagnostics négatifs,<br />
un scanner en urgence est essentiel, avec injection et reconstructions.<br />
La région articulaire manubriosternale et <strong>les</strong> vertèbres<br />
T4-T5 sont majoritairement fracturées, certainement en raison<br />
de leurs situations sur le même niveau de projection anatomique.<br />
À l’encontre <strong>des</strong> théories reposant sur un mécanisme initial en<br />
hyperflexion, dans notre série, ces fractures semblaient résulter<br />
d’une compression axiale. Cette compression était isolée pour<br />
<strong>les</strong> fractures type « burst » ou couplée avec une rotation dans <strong>les</strong><br />
fractures-dislocations, <strong>les</strong> 2 blocs thoraciques supérieur et inférieur<br />
s’imbriquant l’un dans l’autre, attirant le manubrium en<br />
arrière. Ces fractures particulièrement instab<strong>les</strong> et dévastatrices<br />
nécessitent une ostéosynthèse postérieure en urgence, après<br />
réanimation. Dans <strong>les</strong> formes à grand chevauchement avec section<br />
de moelle, la vertebrectomie totale par voie postérieure<br />
semblerait le meilleur compromis chirurgical. Toute fracture<br />
transversale thoracique supérieure non diagnostiquée peut être<br />
responsable d’une cyphose évolutive majeure.<br />
* Jean-Louis Labbé, CHT de Nouméa,<br />
BP J5, Nouméa, Nouvelle-Calédonie.<br />
135 Stabilisation endoscopique <strong>des</strong><br />
fractures thoraco-lombaires avec<br />
cage en titane<br />
Stefan ROSE *, Bernd MAIER, Ingo MARZI,<br />
Louis PILOT<br />
INTRODUCTION. La stabilisation <strong>des</strong> fractures thoracolombaires<br />
se base sur la reconstruction de la colonne porteuse<br />
antérieure, la protection de la moelle épinière et la conservation<br />
<strong>des</strong> segments moteurs. Les problèmes d’indications sont liés à la<br />
nécessité <strong>des</strong> stabilisations monosegmentaires ou bisegmentaires<br />
en fonction du type de fracture.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Utilisation d’une cage particulièrement<br />
appropriée à une application endoscopique. Nous<br />
avons implanté <strong>des</strong> cages monosegmentaires lors de lésions d’un<br />
disque intervertébral (par IRM) (la plupart du temps céphalique)<br />
et de fractures de compression céphaliques. Des cages bisegmentaires<br />
ont été placées en cas de lésion de deux disques intervertébraux,<br />
de fractures éclatement complètes de la colonne<br />
antérieure et en présence de déficits neurologiques. Analyse<br />
rétrospective entre 2003 et 2004. Suivi minimum : 12 mois.<br />
Statistiques : tests non-paramétriques.<br />
RÉSULTATS. Trente-deux patients (24 hommes et 8 femmes).<br />
L’âge moyen était de 43,4 +/- 15 ans. Paraplégie totale (2),<br />
paraplégie partielle (4). Suivi de 30 patients. Opérations bisegmentaires<br />
(22), dont fractures AO type A (10), type B (8), type C<br />
(4). Opérations monosegmentaires (6) et trisegmentaires (2).<br />
Stabilisations en deux temps (27), simultanées (1) et purement<br />
ventra<strong>les</strong> (2). Durées opératoires : bisegmentaire 308 min,<br />
monosegmentaire 273 min, trisegmentaire 316 min. Durée de la<br />
radioscopie : mono : 172 sec, bi : 191 sec, tri: 326 sec. Perte<br />
sanguine : mono : 1120 ml, bi : 1210 ml, tri : 1360 ml. Angle de<br />
Cobb bisegmentaire : perte de correction d’env. 2,5° au bout<br />
d’un an. Résultats similaires pour opérations mono- et trisegmentaires.<br />
Ablation de l’instrumentation dorsale chez 6 patients.<br />
Trois à 6 mois après l’ablation : bisegmentaire (5) perte de correction<br />
d’environ 1,5°, chiffre cependant peu significatif sur le<br />
plan statistique. Tant pour implantation monosegmentaire que<br />
bisegmentaire, enfoncement de la cage de seulement 3 à 5°.<br />
DISCUSSION. La reconstruction monosegmentaire de la<br />
colonne ventrale après une fracture exige une fixation dorsale<br />
supplémentaire. On devrait toujours utiliser <strong>les</strong> plaques termina<strong>les</strong><br />
<strong>les</strong> plus gran<strong>des</strong> possib<strong>les</strong>. Pour l’implantation bisegmentaire<br />
en particulier, <strong>les</strong> plaques termina<strong>les</strong> <strong>des</strong> corps vertébraux doivent<br />
être respectées pour empêcher une protrusion de la cage.<br />
Pour la reconstruction monosegmentaire, on devrait toujours utiliser<br />
de l’os spongieux pour une fusion osseuse solide. La fusion<br />
osseuse semble indispensable pour la stabilisation secondaire de<br />
la cage monosegmentaire.<br />
CONCLUSION. Compte tenu <strong>des</strong> principes d’implantation<br />
énoncés dans la discussion, la reconstruction endoscopique <strong>des</strong><br />
fractures thoraco-lombaires à l’aide de cages distractab<strong>les</strong> en<br />
titane n’est pas accompagnée de pertes de correction secondaires<br />
significatives.<br />
* Stefan Rose, Universitätsklinikum, Unfall-,<br />
Hand- und Wiederherstellungschirurgie, Theodor-Stern-Kai 7,<br />
60590 Frankfurt/Main, Allemagne.
136 Les nerfs intercostaux inférieurs<br />
peuvent-ils être utilisés pour neurotiser<br />
<strong>les</strong> racines lombaires et<br />
sacrées après un traumatisme<br />
médullaire ? Étude anatomique de<br />
faisabilité sur 50 sujets<br />
Raphaël VIALLE *, Char<strong>les</strong> COURT,<br />
Catherine LACROIX,<br />
Marc TADIÉ<br />
INTRODUCTION. L’anatomie topographique <strong>des</strong> 9 e , 10 e et<br />
11 e nerfs intercostaux (nerfs intercostaux inférieurs) est peu<br />
connue à la différence de celle <strong>des</strong> six premiers nerfs intercostaux<br />
et du 12 e nerf intercostal qui ont fait l’objet de <strong>des</strong>criptions<br />
spécifiques. Les nerfs intercostaux inférieurs pourraient être utilisés<br />
pour réaliser <strong>des</strong> neurotisations multip<strong>les</strong> <strong>des</strong> racines du<br />
plexus lombaire et sacré. Le but ce notre travail était de donner<br />
<strong>les</strong> précisions anatomiques suffisantes pour permettre l’utilisation<br />
<strong>des</strong> 9 e , 10 e et 11 e nerfs intercostaux dans de bonnes conditions.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Cinquante cadavres ont été utilisés<br />
dans l’étude anatomique visant à décrire la technique de<br />
prélèvement <strong>des</strong> nerfs intercostaux. Une étude histologique<br />
complémentaire visant à étudier la qualité <strong>des</strong> nerfs prélevés a<br />
été réalisée sur dix porcs. Sur chaque cadavre, <strong>les</strong> six nerfs ont<br />
été prélevés au moyen d’un système de « stripper » passé depuis<br />
l’espace intercostal latéral au niveau du grill costal jusqu’à<br />
l’espace intercostal postérieur qui était abordé par voie postérieure<br />
médiane. La longueur de chaque nerf prélevé était comparée<br />
à la longueur théorique nécessaire pour réaliser une<br />
neurotisation <strong>des</strong> racines lombaires ou sacrées au niveau du<br />
cône médullaire. Une étude histologique complémentaire réalisée<br />
sur le porc étudiait l’importance <strong>des</strong> lésions histologiques<br />
<strong>des</strong> nerfs intercostaux prélevés par la technique de stripping<br />
comparées à une technique conventionnelle à ciel ouvert.<br />
RÉSULTATS. La longueur moyenne totale de nerf prélevé<br />
par la technique de stripping variait de 15,94 cm pour le<br />
11 e nerf intercostal à 17,96 cm pour le 9 e nerf intercostal. La<br />
longueur de nerf prélevé était suffisante dans 297 cas sur 300<br />
pour réaliser la neurotisation <strong>des</strong> racines lombaires ou sacrées<br />
au niveau du cône médullaire. Le niveau de la division du nerf<br />
intercostal en une branche superficielle et une branche profonde<br />
semblait un repère de longueur satisfaisant. L’étude histologique<br />
réalisée sur le porc montrait que la technique de<br />
stripping n’entraînait pas plus de lésions histologiques <strong>des</strong><br />
nerfs prélevés qu’une technique conventionnelle de prélèvement<br />
du nerf à ciel ouvert.<br />
CONCLUSION. La technique de neurotisation du plexus<br />
lombaire par <strong>les</strong> nerfs intercostaux inférieurs semble être techniquement<br />
fiable et reproductible sur un plan purement anatomique.<br />
Bien que certains auteurs aient déjà publiés <strong>des</strong> résultats<br />
préliminaires sur quelques patients paraplégiques après une<br />
lésion traumatique du cône médullaire, une étude complémentaire<br />
sur le gros mammifère nous semble nécessaire afin d’étu-<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S97<br />
dier la qualité histologique et fonctionnelle de la repousse<br />
axonale après ces neurotisations multip<strong>les</strong>.<br />
* Raphaël Vialle, Université Pierre et Marie Curie-Paris 6,<br />
Service d’Orthopédie Pédiatrique,<br />
Hôpital d’Enfants Armand-Trousseau, 26,<br />
avenue du Docteur-Arnold-Netter, 75571 Paris Cedex 12.<br />
137 Étude à long terme du risque de<br />
réintervention après traitement chirurgical<br />
d’une sténose lombaire<br />
Thibault LENOIR *, Brice ILHARREBORDE,<br />
Ludovic RILLARDON, Pierre GUIGUI<br />
INTRODUCTION. Si l’efficacité sur la symptomatologie<br />
fonctionnelle à court et moyen terme du traitement chirurgical<br />
d’une sténose lombaire est généralement admise, la probabilité<br />
de réintervention à long terme de ces patients n’a jamais été étudiée.<br />
Les objectifs de ce travail étaient d’évaluer le risque à plus<br />
de 10 ans de réintervention après traitement chirurgical d’une<br />
sténose canalaire lombaire et de déterminer quels étaient <strong>les</strong> facteurs<br />
pouvant influencer celui-ci.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Tous <strong>les</strong> patients opérés de sténose<br />
lombaire de 1989 à 1992 ont été inclus dans ce travail. Au<br />
dernier recul, ont été étudiés : le résultat fonctionnel par l’intermédiaire<br />
d’un autoquestionnaire spécifique, d’un indice de<br />
satisfaction, d’une évaluation visuelle analogique de la lombalgie<br />
et <strong>des</strong> radiculalgies et d’un indice de qualité de vie, le<br />
SF36 ; la survenue ou non d’une réintervention en précisant la<br />
date de celle-ci par rapport à la date opératoire, son motif et <strong>les</strong><br />
modalités de la réintervention. La probabilité de réintervention<br />
a été étudiée selon la méthode de Kaplan-Meier. L’influence <strong>des</strong><br />
facteurs suivants sur la probabilité de survenue d’un tel événement<br />
a été étudiée par l’intermédiaire d’un modèle de Cox :<br />
âge, sexe, étendue de la zone de libération, réalisation ou non<br />
d’une arthrodèse postérolatérale, utilisation ou non d’une ostéosynthèse.<br />
RÉSULTATS. Cent quatre-vingt patients ont été inclus dans<br />
cette étude. Au dernier examen, 29 patients étaient décédés (en<br />
moyenne 8 ± 3 ans après l’intervention initiale) 30 ont été perdus<br />
de vue (en moyenne 7 ± 3,5 ans après l’intervention initiale) et<br />
121 ont été revus avec un recul moyen de 14 ± 0,8 ans. Vingtdeux<br />
patients ont nécessité une réintervention. Quatre motifs de<br />
réintervention ont été identifiés : la déstabilisation au sein ou au<strong>des</strong>sus<br />
de la zone de libération, une libération insuffisante, l’apparition<br />
ou la réapparition d’une zone de sténose, l’apparition ou la<br />
réapparition d’une hernie discale. À 5 ans, la probabilité de ne<br />
pas avoir de réintervention était estimée à 0,95 (IC 95 % :<br />
0,9-0,97), à 10 ans à 0,86 (IC 95 % : 0,8-0,9) et à 15 ans à 0,83<br />
(IC 95 % : 0,7-0,88). Aucun <strong>des</strong> facteurs étudiés n’avait<br />
d’influence sur le risque de survenue d’une réintervention.<br />
* Thibault Lenoir, Service de Chirurgie Orthopédique,<br />
Hôpital Beaujon, 100, boulevard du Général-Leclerc,<br />
92110 Clichy.
3S98 81 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
138 Les tiges d’allongement sans greffe<br />
dans la chirurgie de la scoliose de<br />
l’enfant : à propos de 15 cas<br />
Nicolas MOH ELLO, Pierre LASCOMBES,<br />
Jean-Damien MÉTAIZEAU, Thierry HAUMONT,<br />
Pierre JOURNEAU<br />
INTRODUCTION. Les scolioses infanti<strong>les</strong> ou juvéni<strong>les</strong> 1 ou<br />
2, sévères et évolutives sont le plus souvent inaccessib<strong>les</strong> au traitement<br />
orthopédique. L’objectif de ce travail était de présenter<br />
<strong>les</strong> résultats du traitement de ces scolioses par <strong>les</strong> tiges d’allongement<br />
sous-fascial sans greffe.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Il s’agit d’une étude rétrospective<br />
de 15 cas (7 garçons et 8 fil<strong>les</strong>). L’âge moyen au traitement<br />
était de 7,8 ans (3,9-11,5 ans). Les étiologies étaient neuromusculaires<br />
dans 10 cas, 1 scoliose malformative, 3 IMOC et 1 idiopathique.<br />
L’angle de Cobb initial moyen était de 69,57°<br />
(41°-105°). Les courbures étaient thoraco-lombaires dans 7 cas,<br />
thoraciques dans 3 cas et 5 doub<strong>les</strong> courbures. Le montage était<br />
constitué d’une pince supérieure et inférieure associée à une<br />
greffe osseuse pour éviter tout risque de démontage. Le nombre<br />
moyen d’allongements était de 3,1 (1-6) effectués avec un intervalle<br />
moyen de 9 mois (6-19 mois). L’âge au recul maximum<br />
était de 12,6 ans (4,6-16,5 ans), l’arthrodèse définitive ayant été<br />
pratiquée chez 5 patients.<br />
RÉSULTATS. Les résultats ont été appréciés par la mesure<br />
<strong>des</strong> gains angulaires et l’angle de Cobb final et la mesure <strong>des</strong><br />
gains en longueur <strong>des</strong> tiges. Le gain angulaire moyen par allongement<br />
était de 14,2° (0-23,1°). Le gain moyen en longueur par<br />
allongement était de 11,8 mm (0-16,75 mm) avec un gain moyen<br />
total en longueur de 38,2 mm (0-72 mm). L’angle de Cobb final<br />
était en moyenne de 44,7° (30-75°). Le gain angulaire moyen<br />
entre le début et la fin <strong>des</strong> allongements était de 23,5° (0-58°).<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. L’analyse <strong>des</strong> résultats<br />
montre que <strong>les</strong> meilleures corrections fina<strong>les</strong> sont obtenues par<br />
un allongement de plus de 12 mm par séance, et avec un intervalle<br />
entre chaque allongement compris entre 8 et 11 mois. Nos<br />
résultats sont comparab<strong>les</strong> aux données de la littérature, avec un<br />
taux faible de complication. Cette technique permet de réduire<br />
notablement <strong>les</strong> angulations rachidiennes ou d’éviter leur aggravation<br />
dans l’attente de l’arthrodèse définitive.<br />
* Nicolas Moh Ello, Service de Chirurgie Infantile A,<br />
CHU de Nancy, Hôpital d’Enfant,<br />
allée du Morvan, 54511 Vandoeuvre-<strong>les</strong>-Nancy.<br />
139 Semi-automatisation de la reconstruction<br />
tridimensionnelle du rachis<br />
à partir de deux radiographies :<br />
étude préliminaire de la précision<br />
Raphaël DUMAS *, Bertrand BLANCHARD,<br />
Jean-Char<strong>les</strong> LE HUEC, Jean-Marc VITAL<br />
INTRODUCTION. La reconstruction 3D du rachis à partir de<br />
deux vues radiographiques est un outil de recherche reconnus<br />
depuis <strong>les</strong> années 80. Elle nécessite cependant l’identification de<br />
nombreux points anatomiques dans chaque radiographie : de 6 à<br />
20 points par vertèbre selon <strong>les</strong> métho<strong>des</strong>. Une nouvelle méthode<br />
semi-automatique basée (i) sur l’identification de la ligne vertébrale,<br />
(ii) sur la superposition de deux vertèbres génériques<br />
(T1 et L5) et (iii) sur la mesure (dans la radiographie frontale) de<br />
la rotation axiale uniquement au niveau de l’apex permet une<br />
reconstruction 3D beaucoup plus rapide. L’objectif de ce travail<br />
était d’évaluer la précision de cette méthode.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Deux radiographies calibrées<br />
de face et de profil ont été prises sur 7 patients lombalgiques et<br />
3 patients scoliotiques (ang<strong>les</strong> de Cobb de 12° à 60°). À l’aide<br />
d’un logiciel spécifique, le rachis <strong>des</strong> patients a été reconstruit en<br />
3D d’abord en utilisant la méthode semi-automatique proposée<br />
ensuite en utilisant <strong>des</strong> métho<strong>des</strong> classiques (i.e. identification de<br />
6 points par vertèbres et mesure de la rotation axiale selon Perdriolle),<br />
considérées comme <strong>des</strong> métho<strong>des</strong> de référence. L’orientation<br />
3D (latérale, sagittale et axiale) <strong>des</strong> vertèbres a pu alors<br />
être comparée (méthode semi-automatique versus métho<strong>des</strong> de<br />
référence).<br />
RÉSULTATS. Les temps moyens de traitement par la<br />
méthode semi-automatique et <strong>les</strong> métho<strong>des</strong> de références étaient<br />
respectivement de 5 et 60 min. Les erreurs en termes de RMS<br />
étaient de 1,0° (n = 150 vertèbres) sur la rotation latérale, de 0,8°<br />
(n = 150 vertèbres) sur la rotation sagittale et de 3,1° (n = 13 vertèbres<br />
significativement tournées) sur la rotation axiale.<br />
DISCUSSION. Les métho<strong>des</strong> classiques de reconstruction 3D<br />
requièrent un traitement fastidieux afin d’obtenir une précision<br />
de l’ordre de 2° à 6°. La méthode semi-automatique proposée<br />
permet d’obtenir une reconstruction 3D avec un niveau de précision<br />
élévé tout en nécessitant un temps de traitement réduit de<br />
3 à 12 fois (respectivement par rapport à une autre méthode<br />
semi-automatique récente et par rapport à l’identification de 6<br />
points par vertèbres). Cette étude préliminaire devra toutefois<br />
être étendue à un plus grand nombre de patients, scoliotiques ou<br />
non, et à l’étude de la répétabilité intra- et inter-observateurs.<br />
CONCLUSION. La reconstruction 3D du rachis à partir de<br />
deux vues radiographiques peut être obtenue de manière simple<br />
et fiable par une méthode semi-automatique demandant un<br />
temps de traitement de l’ordre de 5 minutes.<br />
* Raphaël Dumas, Laboratoire de Biomécanique<br />
et Modélisation Humaine, Université Claude Bernard-Lyon 1 /<br />
INRETS, Bâtiment Omega, 43, boulevard du 11-Novembre-1918,<br />
69622 Villeurbanne Cedex.
140 Étude comparative <strong>des</strong> paramètres<br />
radiologiques de l’équilibre sagittal<br />
lombo-pelvien entre <strong>les</strong> positions<br />
assise et debout<br />
Elhadi SARI-ALI *, Michel GORIN,<br />
Jean-Yves LAZENNEC, Yves CATONNÉ<br />
INTRODUCTION. L’équilibre sagittal lombo-pelvien a été<br />
toujours été étudié debout dans toutes <strong>les</strong> étu<strong>des</strong> de la littérature.<br />
Cependant, l’homme moderne n’est pas en permanence en position<br />
verticale et en particulier il est souvent en position assise.<br />
Ceci doit donc être pris en compte pour le réglage <strong>des</strong> arthrodèses<br />
lombaires. Pour cela il est nécessaire de disposer de valeurs<br />
paramétriques. Le but de l’étude était d’établir <strong>des</strong> abaques de<br />
ces paramètres lombo-pelviens en position assise.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Cent rachis thoraco-lombaires<br />
de sujets sains asymptomatiques ont été analysés à l’aide de<br />
2 radiographies de rachis entier de profil incluant <strong>les</strong> têtes fémora<strong>les</strong><br />
en position debout et assise. Deux observateurs indépendants<br />
ont réalisé 2 séries de mesures radiologiques. Pour chaque<br />
vertèbre de L1 à S1, nous avons calculé la pente et l’incidence,<br />
ce qui permettait de déduire <strong>les</strong> lordoses pour chaque segment<br />
rachidien. Pour chaque vertèbre, nous avons analysé <strong>les</strong> corrélations<br />
entre la pente et l’incidence. Par ailleurs, nous avons étudié<br />
la corrélation entre la lordose lombaire et la pente ainsi que<br />
l’incidence de chaque vertèbre. Nous avons analysé l’évolution<br />
de la répartition de la lordose sur <strong>les</strong> étages lombaires entre <strong>les</strong> 2<br />
positions, ainsi que l’existence de morphotypes rachidiens.<br />
L’analyse statistique de corrélation a été faite sur le logiciel JMP<br />
avec utilisation de tests de corrélation polynomiale, pour la<br />
recherche de morphotype nous avons utilisé <strong>des</strong> tests d’analyse<br />
discriminative de type cluster. Le test de Student a servi pour<br />
comparer <strong>des</strong> moyennes avec un seuil de significativité de 0,05.<br />
RÉSULTATS. Nous avons établi <strong>des</strong> abaques de valeurs de<br />
pente et d’incidence pour chaque vertèbre. La pente diminue en<br />
valeur absolue en position assise alors que l’incidence augmente<br />
sauf pour S1 où elle reste identique. Pour la pente, L3 est une<br />
zone de faible variabilité constituant ainsi une zone de transition<br />
alors que <strong>les</strong> charnières sont <strong>des</strong> zones de forte variabilité. Les<br />
corrélations entre la pente et l’incidence sont mauvaises en position<br />
assise sauf pour L1 où elle est très forte (0,9). La lordose<br />
diminue en position assise (22 versus 55 p < 0,0001). L4S1<br />
constitue seulement 62 % de la lordose en position debout et<br />
89 % en position assise. Dans <strong>les</strong> 2 positions, la lordose est bien<br />
corrélée avec la pente sacrée (0,84) et l’incidence de L1 (0,8)<br />
mais pas avec l’incidence sacrée (0,6). Nous avons pu définir en<br />
fonction de la pente sacrée et de l’incidence de L1 cinq morphotypes<br />
de lordose.<br />
CONCLUSION. Les valeurs de l’équilibre pelvien diffèrent<br />
en position assise par rapport à la position debout. Dans le<br />
réglage <strong>des</strong> arthrodèses, il semble important de rétablir la lordose<br />
la pente sacrée et l’incidence de L1 permettant de garder le<br />
même morphotype. Ce réglage pourrait se faire dans une position<br />
intermédiaire en utilisant <strong>les</strong> abaques définies.<br />
* Elhadi Sari-Ali, 154, rue de Picpus, 75012 Paris.<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S99<br />
141 Intérêt de l’IRM dynamique dans<br />
l’exploration <strong>des</strong> myélopathies par<br />
canal cervical étroit<br />
Hugues PASCAL-MOUSSELLARD *,<br />
Delphine ZEITOUN, Jean-Yves LAZENNEC,<br />
Yves CATONNÉ<br />
INTRODUCTION. Les myélopathies cervicarthrosiques sont<br />
explorées par <strong>des</strong> IRM réalisées en position neutre. Or, il est<br />
reconnu que le diamètre du canal cervical diminue en extension.<br />
L’agression médullaire est donc susceptible de s’aggraver en<br />
extension et se minorer en flexion. Il parait alors licite d’explorer<br />
<strong>les</strong> myélopathies cervica<strong>les</strong> par <strong>des</strong> IRM en flexion-extension.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Les auteurs ont mis en place<br />
une étude prospective dont ils présentent <strong>les</strong> résultats préliminaires<br />
à propos de 10 patients explorés entre octobre 2005 et février<br />
2006. Pour chaque patient,3 acquisitions ont été réalisées en<br />
décubitus dorsal : 1) Position neutre : coupes sagitta<strong>les</strong> T2, T1 ;<br />
2) Hyperextension : coupes sagitta<strong>les</strong> T2 et axia<strong>les</strong> T2 sur <strong>les</strong><br />
discopathies ; 3) Hyperflexion : coupes sagitta<strong>les</strong> T2 et axia<strong>les</strong><br />
T2 sur <strong>les</strong> hypersignaux intra-médullaire. Dans chaque position,<br />
<strong>les</strong> items suivants étaient analysés : nombre de discopathies,<br />
rétrécissement canalaire de C2 à C7 dans <strong>les</strong> 3 positions et différences<br />
(en pourcentage) en flexion et extension par rapport à la<br />
position neutre, instabilité vertébrale, présence et dimension<br />
d’éventuel(s) hypersignal (signaux).<br />
RÉSULTATS. Les séquences sagitta<strong>les</strong> en pondération T2<br />
montraient une majoration <strong>des</strong> protrusions disca<strong>les</strong> en extension<br />
et leur réduction en flexion chez 8 patients. Deux patients majoraient<br />
le nombre de discopathies en extension. Cinq patients présentaient<br />
un hypersignal en séquence T2. Aucun patient ne<br />
majorait la dimension de l’hypersignal T2 intra-médullaire lors<br />
<strong>des</strong> manœuvres dynamiques, mais la flexion permettait une<br />
meilleure visibilité de ces hypersignaux chez 3 patients. Deux<br />
patients présentaient une mobilité vertébrale lors <strong>des</strong> manœuvres<br />
dynamiques, témoignant d’une instabilité.<br />
CONCLUSION. La modification de l’importance <strong>des</strong> protrusions<br />
disca<strong>les</strong> lors <strong>des</strong> manœuvres dynamiques peut être à l’origine<br />
de symptômes non expliqués par une IRM réalisée en<br />
position neutre. La meilleure visualisation <strong>des</strong> hypersignaux en<br />
flexion est susceptible de révèler <strong>des</strong> souffrances médullaires<br />
non ou mal visualisées sur <strong>des</strong> IRM réalisées en position neutre.<br />
* Hugues Pascal-Moussellard, Service d’Orthopédie,<br />
Hôpital Pitié-Salpêtrière, Pavillon Gaston-Cordier,<br />
47, boulevard de l’Hôpital, 75651 Paris.
3S100 81 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
142 Traitement chirurgical du syndrome<br />
du pyramidal : à propos de 16 cas<br />
avec un recul moyen de 3 ans<br />
10 mois<br />
Véronique DARCEL *, Thierry FABRE,<br />
Yacine CARLIER, Jérôme LECLERC,<br />
Benoit BOUTAUD, Alain DURANDEAU<br />
INTRODUCTION. Longtemps controversé, le syndrome du<br />
pyramidal est aujourd’hui une entité reconnue. Au moyen de<br />
cette étude, nous cherchons à partager notre expérience du traitement<br />
chirurgical de ce syndrome lorsque <strong>les</strong> traitements conservateurs<br />
se sont avérés inefficaces.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Il s’agissait d’une étude rétrospective<br />
portant sur une série 16 patients de 2000 à 2006, 6 hommes<br />
et 10 femmes, dont l’âge moyen était de 59,25 ans (31-76)<br />
au moment de l’opération. Tous souffraient d’une douleur fessière.<br />
Chez 11 patients, la douleur s’accompagnait d’une irradiation<br />
sciatique. Des paresthésies ou <strong>des</strong> hypoesthésies ont été<br />
trouvées chez 4 patients. Pour 5 d’entre eux, un facteur étiopathogénique<br />
a pu être identifié (deux traumatismes de la fesse,<br />
2 prothèses tota<strong>les</strong> de hanche et un exercice sportif). Le diagnostic<br />
a été porté sur <strong>des</strong> critères cliniques (douleur à la palpation,<br />
test de mise en tension du pyramidal...) et paracliniques (EMG,<br />
scanner et IRM lombaire). Le traitement conservateur (repos,<br />
étirements, physiothérapie...) ne <strong>les</strong> avait pas améliorés. La technique<br />
chirurgicale consistait en une neurolyse du nerf sciatique à<br />
la fesse et en une ténotomie du muscle pyriforme. Les patients<br />
ont été revus à 1 mois et à 6 mois.<br />
RÉSULTATS. Le recul moyen était de 3 ans et 10 mois. Au<br />
terme de l’étude, 7 patients avaient un très bon résultat (sédation<br />
complète <strong>des</strong> douleurs), 7 un bon résultat (amélioration nette<br />
mais sédation incomplète <strong>des</strong> douleurs ou persistance <strong>des</strong> paresthésies)<br />
et 2 n’ont pas été améliorés. L’un de ces 2 patients a<br />
bénéficié d’une autre neurolyse du sciatique au niveau de l’insertion<br />
<strong>des</strong> ischiojambiers avec succès.<br />
DISCUSSION. La série se distingue par le nombre de<br />
patients traités et par la moyenne d’âge <strong>des</strong> sujets, un peu plus<br />
élevée que dans la plupart <strong>des</strong> séries (Kouvalchouk, Hugues,<br />
Juhani, Benson...). Les résultats que nous avons obtenus sont<br />
comparab<strong>les</strong> à ceux décrits dans la littérature (87,5 % de bons et<br />
très bons résultats).<br />
CONCLUSION. Le diagnostic de syndrome du pyramidal est<br />
souvent porté très tardivement. Il faut savoir l’évoquer car <strong>les</strong><br />
traitements dont nous disposons permettent d’obtenir <strong>des</strong> résultats<br />
très satisfaisants.<br />
* Véronique Darcel, Service du Pr Durandeau (8 e étage),<br />
Groupe Hospitalier Pellegrin, place Amélie-Raba-Leon,<br />
33076 Bordeaux Cedex.<br />
Séance du 7 novembre matin<br />
TRAUMATOLOGIE<br />
143 Analyse <strong>des</strong> lésions du labrum sur<br />
le devenir <strong>des</strong> procédures d’agrandissement<br />
acétabulaire : étude<br />
prospective avec un recul minimum<br />
de 12 ans<br />
Julien GIRARD *, Kristina SPRINGER,<br />
Donatien BOCQUET, Falah BACHOUR,<br />
Philippe LAFFARGUE, Henri MIGAUD<br />
INTRODUCTION. En se basant sur <strong>les</strong> étu<strong>des</strong> rétrospectives<br />
déjà publiées, il semble que <strong>les</strong> lésions du labrum soient susceptib<strong>les</strong><br />
de générer <strong>des</strong> échecs <strong>des</strong> procédures d’agrandissement<br />
acétabulaire. Afin d’évaluer ce fait, une étude prospective a été<br />
conduite afin d’analyser la fréquence <strong>des</strong> lésions labra<strong>les</strong> dans<br />
<strong>les</strong> dysplasies acétabulaires et <strong>les</strong> facteurs radiologiques augmentant<br />
le risque de ces lésions et d’évaluer, avec un recul minimum<br />
de 12 ans (12-14 ans), l’impact <strong>des</strong> lésions labra<strong>les</strong> sur <strong>les</strong><br />
procédures d’agrandissement acétabulaire.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Vingt-six adultes (âge moyen<br />
de 34,5 ans) porteurs de 26 hanches dysplasiques (VCE < 20°<br />
dont 17 dysplasies fémora<strong>les</strong> associées) ont été consécutivement<br />
enrôlés entre 1991 et 1993 de façon prospective. Les critères<br />
d’inclusion étaient 1) un âge adulte, 2) une dysplasie acétabulaire<br />
avec ou sans arthrose, 3) une indication chirurgicale d’intervention<br />
d’agrandissement (7 Chiari et 19 butées), 4) une<br />
exploration complète de la hanche (radiographies, arthro-TDM<br />
et arthroscopie de hanche réalisée durant la chirurgie acétabulaire).<br />
RÉSULTATS. En préopératoire, toutes <strong>les</strong> hanches avaient<br />
<strong>des</strong> signes de coxarthrose (condensation osseuse et kystes dans<br />
10 cas et diminution de l’espace articulaire dans 16 cas). Tous<br />
<strong>les</strong> patients ont été revus. En peropératoire, seize hanches présentaient<br />
<strong>des</strong> lésions labra<strong>les</strong> (62 %), localisées le plus souvent<br />
dans la partie supérieure du labrum (69 %). Une augmentation<br />
de la latéralisation de la hanche et <strong>des</strong> ang<strong>les</strong> HTE et CCD ainsi<br />
qu’une diminution de l’angle VCA étaient observés sur <strong>les</strong> hanches<br />
porteuses de lésions labra<strong>les</strong>. Il y a eu huit conversions en<br />
PTH : 2 portant sur <strong>les</strong> 10 hanches (20 %) sans lésions labra<strong>les</strong> et<br />
6 sur <strong>les</strong> 16 hanches (37,5 %) avec lésions labra<strong>les</strong> (p = 0,42).<br />
Au recul de 150 mois, le taux de survie (conversion en PTH<br />
comme événement de survie) était de 80 % (intervalle de confiance<br />
à 95 % ± 13 %) pour <strong>les</strong> hanches sans lésions labra<strong>les</strong> et<br />
de 62,5 % (intervalle de confiance à 95 % ± 12 %) pour <strong>les</strong> hanches<br />
avec lésions labra<strong>les</strong>. La différence n’était pas statistiquement<br />
significative (p = 0,4).<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. Deux tiers <strong>des</strong> adultes<br />
atteints d’une dysplasie de hanche sont exposés à <strong>des</strong> lésions<br />
labra<strong>les</strong>. Une hanche présentant une coxa valga, un faible<br />
angle VCA et un angle HTE élevé est à risque de lésion<br />
labrale. Cette étude suggère que la présence de lésions labra<strong>les</strong>
ne compromet pas le devenir <strong>des</strong> procédures d’agrandissement<br />
acétabulaire.<br />
* Julien Girard, Service de Chirurgie Orthopédique,<br />
CHRU de Lille, Hôpital Roger-Salengro,<br />
2, avenue Oscar-Lambret, 59037 Lille Cedex.<br />
144 Prise en charge <strong>des</strong> mala<strong>des</strong> opérés<br />
d’une fracture de l’extrémité<br />
supérieure du fémur : amélioration<br />
<strong>des</strong> pratiques médica<strong>les</strong> grâce à<br />
une comparaison multicentrique<br />
Franck DUJARDIN *, Francis GOUIN,<br />
Laurent PIDHORZ, L. MORET, V. MERLE<br />
INTRODUCTION. Une étude multicentrique (INPECH) a été<br />
menée en vue d’évaluer, comparer et améliorer <strong>les</strong> pratiques<br />
dans le cadre du traitement <strong>des</strong> fractures de l’extrémité supérieure<br />
du fémur (FESF). Des indicateurs de qualité ont été retenus<br />
a priori par <strong>les</strong> représentants <strong>des</strong> différentes catégories<br />
professionnel<strong>les</strong> impliquées dans la prise en charge <strong>des</strong> FESF.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Au cours d’une première étape<br />
de 4 mois, <strong>les</strong> données correspondant à ces indicateurs ont été<br />
recueillies pour la totalité <strong>des</strong> patients dans <strong>les</strong> 3 centres hospitaliers.<br />
La confrontation <strong>des</strong> résultats a permis l’identification<br />
d’axes d’amélioration. L’effet de cette démarche a été mesuré<br />
par l’observation de ces mêmes indicateurs au cours d’une<br />
seconde période de 4 mois, un an après la première.<br />
RÉSULTATS. 856 FESF ont été analysées. Une différence<br />
significative dans <strong>les</strong> pratiques entre <strong>les</strong> 3 centres a été notée sur<br />
<strong>les</strong> délais opératoires (1 à 4,3 j), le nombre de jour de prise en<br />
charge par <strong>les</strong> kinésithérapeutes, <strong>les</strong> prescriptions de compléments<br />
nutritionnels et l’apparition d’escarres, <strong>les</strong> délais de<br />
demande de conva<strong>les</strong>cence, <strong>les</strong> délais de rédactions de compterendus,<br />
<strong>les</strong> durées d’hospitalisation en cours séjour. L’analyse<br />
par centre, sur la base <strong>des</strong> axes d’amélioration identifiés, a permis<br />
une amélioration significative : <strong>des</strong> délais préopératoires<br />
(4,3 à 32 j.), <strong>des</strong> délais de mise au fauteuil, de la prise en charge<br />
de la dénutrition par la prescription de compléments nutritionnels,<br />
de la prévention <strong>des</strong> escarres, <strong>des</strong> délais de demande de<br />
conva<strong>les</strong>cence, et du taux de réadmissions.On ne notait pas<br />
d’amélioration sur <strong>les</strong> délais de rédaction <strong>des</strong> comptes rendus<br />
opératoires et de sortie. Aucune différence significative sur la<br />
mortalité à 3 mois n’a été constatée lors de la mesure de la<br />
2 e période entre <strong>les</strong> 3 centres.<br />
CONCLUSION. Cette démarche a suscité <strong>des</strong> améliorations<br />
qualitatives de prise en charge <strong>des</strong> FESF dans <strong>les</strong> trois centres<br />
hospitaliers. Les retentissements sur la morbidité et la mortalité<br />
sont cependant diffici<strong>les</strong> à établir. D’autres améliorations paraissent<br />
encore possib<strong>les</strong> mais nécessitent une analyse et <strong>des</strong> mesures<br />
plus approfondies.<br />
* Franck Dujardin, Département d’Orthopédie,<br />
CHU de Rouen, 1, rue de Germont, 76031 Rouen Cedex.<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S101<br />
145 Traitement d’une fracture du fémur<br />
sur matériel par plaque à vis bloquées<br />
par voie mini-invasive et<br />
remise en charge immédiate : à<br />
propos de 21 cas<br />
Matthieu EHLINGER *, Jean-Michel COGNET,<br />
Antonio DI MARCO, Patrick SIMON<br />
INTRODUCTION. Les auteurs rapportent une série continue<br />
prospective de fractures fémora<strong>les</strong> sur matériel. Le but était<br />
d’évaluer leur traitement par plaque à vis bloquées mono-axia<strong>les</strong><br />
avec remise en charge immédiate.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. De juin 2002 à décembre 2005,<br />
nous avons traité 21 patients (16 femmes, 5 hommes) ayant présenté<br />
une fracture sur : PTH (11), PTG (1), PUC (1), entre clou<br />
Gamma et PTG (3), clou Gamma (4), THS (1), avec un âge<br />
moyen de 75,8 ans (39 à 90 ans). L’ostéosynthèse a été effectuée<br />
par voie mini-invasive à l’aide de plaques à vis bloquées<br />
(Synthes ® ) pontant le matériel en place afin d’éviter une zone de<br />
faib<strong>les</strong>se. Le protocole de rééducation autorisait une remise en<br />
charge immédiate.<br />
RÉSULTATS. À la révision, nous avons rapporté 3 décès et un<br />
échec soit 17 patients revus au recul moyen de 15,9 mois (6 à<br />
45 mois). La chirurgie mini-invasive a été réalisée 18 fois, un<br />
abord du foyer nécessaire 3 fois. La remise en charge sans restriction<br />
a été possible immédiatement 12 fois, avec appui partiel à<br />
20 kg 2 fois. Nous avons déploré 2 complications septiques dont<br />
1 arthrite du genou, 2 complications généra<strong>les</strong> et 1 déplacement<br />
précoce. La consolidation a été obtenue entre 6 et 10 semaines.<br />
Un défaut d’axe supérieur à 10° a été observé 3 fois.<br />
DISCUSSION. L’intérêt de ce travail réside en 1) l’utilisation<br />
de plaques à vis bloquées mono-axia<strong>les</strong>, 2) une technique chirurgicale<br />
mini-invasive 3) et une remise en charge postopératoire.<br />
Cette technique allie le principe de l’ostéosynthèse à foyer fermé<br />
avec conservation de l’hématome fracturaire à la stabilité du<br />
matériel. La plaque comme traitement <strong>des</strong> fractures fémora<strong>les</strong><br />
sur matériel est classique et la technique chirurgicale mini-invasive<br />
a été développée par le système LISS en distal. Nous avons<br />
élargi le concept à l’abord proximal. Les vis bloquées dans la<br />
plaque permettent la réalisation d’un « fixateur externe-interne »<br />
avec trois prises par vis (2 cortica<strong>les</strong> plus la plaque) ce qui permet<br />
une stabilité accrue. Cette tenue <strong>des</strong> vis parait suffisante<br />
pour permettre une remise en charge précoce.<br />
CONCLUSION. L’utilisation <strong>des</strong> plaques à vis bloquées dans<br />
<strong>les</strong> fractures fémora<strong>les</strong> sur matériel est efficace et la stabilité du<br />
montage permet dans la majorité <strong>des</strong> cas une reprise précoce de<br />
la déambulation sans restriction.<br />
* Matthieu Ehlinger, Service de Chirurgie Orthopédique,<br />
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg,<br />
1, avenue Molière, 67098 Strasbourg.
3S102 81 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
146 Vis plaque mini-invasive pour fractures<br />
du fémur proximal : étude<br />
mécanique et résultats préliminaires<br />
de 52 cas<br />
Frantz LANGLAIS *, Philippe BURDIN,<br />
Mickaël ROPARS, Julien ALEXANDRE,<br />
Nicolas BELOT, François MARTY<br />
INTRODUCTION. Cette étude expérimentale et clinique de<br />
la vis plaque MISS recherche si cet implant est mécaniquement<br />
fiable, techniquement simple, et s’il répond du fait de son caractère<br />
mini-invasif aux attentes an matière de consolidation, de<br />
réduction du traumatisme opératoire (incision, douleur, saignement),<br />
de raccourcissement du séjour hospitalier et de diminution<br />
de son coût.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Une vis plaque en 3 parties<br />
(vis, plaque, canon), reprenant le <strong>des</strong>sin (et donc la résistance) de<br />
la THS a été conçue pour implantation par une incision de moins<br />
de 50 mm. Elle a une seule vis céphalique (Ø 14 mm), guidée<br />
par broche. Elle s’utilise sans aucun davier, et convient aux fractures<br />
trochantériennes et cervica<strong>les</strong>. Elle a été étudiée au laboratoire<br />
comparativement avec une vis plaque mini-invasive à<br />
double vis cervicale (PCCP). Après une série inaugurale (12 cas<br />
en 2004), l’ancillaire a été optimisé, permettant une série prospective<br />
(40 cas).<br />
RÉSULTATS. Au laboratoire, la résistance <strong>des</strong> deux implants<br />
était satisfaisante, et équivalente. Leur fixation osseuse était<br />
équivalente en flexion et rotation. La série clinique inaugurale a<br />
montré un très bon centrage de la vis dans 9 <strong>des</strong> 12 cas, un non<br />
verrouillage du canon sur la plaque (repris par prothèse), et<br />
11 consolidations. La série multicentrique de 2005-2006 a montré<br />
une incision moyenne de 42 mm (30 à 70), une durée opératoire<br />
moyenne de 38 mn, une perte sanguine réduite (moins de<br />
20 cm 3 , chute de l’hématocrite moyenne de 0,4 g/dl, même chez<br />
<strong>les</strong> patients opérés sous antiagrégants), <strong>des</strong> douleurs modérées.<br />
À J4, il n’y avait pas d’utilisation d’antalgiques de classe 3, et<br />
72 % <strong>des</strong> opérés étaient sortants (s’ils avaient un lit d’aval...). Il y<br />
a eu 38 consolidations, 0 sepsis, 2 balayages sur malposition,<br />
nécessitant réopération.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. La vis plaque mini-invasive<br />
MISS est mécaniquement aussi fiable que <strong>les</strong> vis plaques<br />
classiques, et plus simple à implanter que <strong>les</strong> autres vis plaques<br />
mini-invasives. Les pertes sanguines sont minimes. L’appui précoce<br />
semble facilité par la douleur limitée. Les complications<br />
mécaniques sont rares (5 %), identiques à cel<strong>les</strong> <strong>des</strong> vis plaques<br />
« à foyer ouvert ». L’étude inter-centres qui se poursuit permettra<br />
de mieux quantifier la réduction effective du séjour en chirurgie,<br />
et <strong>les</strong> bénéfices objectifs de la chirurgie mini-invasive.<br />
* Frantz Langlais, Service de Chirurgie Orthopédique,<br />
CHU Hôpital Sud, 16, boulevard de Bulgarie,<br />
35203 Rennes Cedex 2.<br />
147 Arthrodèse sacro-iliaque et séquel<strong>les</strong><br />
de fracture du bassin<br />
Cédric PELEGRI *, Matthias WINTER,<br />
Stéphane JUND, Bernard SCHLATTERER,<br />
Fernand DE PERETTI<br />
INTRODUCTION. Le but de ce travail était d’étudier <strong>les</strong><br />
résultats du traitement chirurgical par arthrodèse sacro-iliaque<br />
dans <strong>les</strong> complications tardives <strong>des</strong> fractures du bassin.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Six patients polytraumatisés ont<br />
bénéficié d’une arthrodèse sacro-iliaque tardive après rupture par<br />
cisaillement de type C de l’anneau pelvien. La série était constituée<br />
de 4 hommes et 2 femmes d’âge moyen 43 ans (23-54). Il<br />
s’agissait dans quatre cas d’un accident de la voie publique à<br />
haute énergie et dans trois cas d’un accident de travail. Le délai<br />
moyen entre le traumatisme et l’intervention était de 29 mois<br />
(12-22). L’indication a été portée dans tous <strong>les</strong> cas sur l’existence<br />
d’une douleur rebelle à la station érigée et à la marche. Deux<br />
pseudarthroses sacrées et une déformation sacro-iliaque posttraumatique<br />
figée ont été traitées par arthrodèse postérieure in<br />
situ sans réduction du cisaillement et sans réduction pubienne. Un<br />
<strong>des</strong> patients avec une pseudarthrose sacrée présentait en préopératoire<br />
un syndrome de la queue de cheval partiel et l’autre une<br />
incontinence urinaire. Une laxité sacro-iliaque bilatérale et<br />
pubienne a été traitée par ostéosynthèse pubienne première par<br />
plaque et arthrodèse sacro-iliaque secondaire par vis. Deux déformations<br />
sacro-iliaques post-traumatiques figées associées à une<br />
ouverture pubienne résiduelle ont été traitées par un triple temps<br />
opératoire (ostéotomie postérieure première, ostéosynthèse<br />
pubienne secondaire puis arthrodèse sacro-iliaque postérieure tertiaire).<br />
Un de ces patients avait eu une tentative de traitement initial<br />
par vissage sacro-iliaque sous contrôle scanner avec un<br />
mauvais résultat sur la douleur. Cinq patients ont bénéficié d’une<br />
greffe spongieuse prélevée dans la tubérosité iliaque. Celle-ci<br />
entraine une difficulté technique pour réaliser un vissage sacroiliaque<br />
et a obligé à réaliser un boulonnage bi-iliaque.<br />
RÉSULTATS. Le recul moyen à la dernière consultation était<br />
de 60 mois (12-120). Aucune infection ni paralysie sciatique ne<br />
sont survenues dans <strong>les</strong> suites. Un patient traité par arthrodèse<br />
postérieure d’une déformation sacro-iliaque post-traumatique<br />
isolée a présenté une sciatalgie L4 en postopératoire. Les pertes<br />
sanguines compensées étaient inférieures à 1 litre. La durée<br />
moyenne d’intervention était de 250 minutes (180-330). L’inégalité<br />
de longueur préopératoire lorsqu’elle existait n’a pas été<br />
réduite de façon significative. Il n’y a pas eu d’amélioration <strong>des</strong><br />
déficits neurologiques préopératoires. Le seul résultat objectif<br />
était une diminution de la douleur. Au dernier recul, tous <strong>les</strong><br />
patients ont repris la marche dont un avec <strong>des</strong> cannes. Aucun<br />
patient n’était déçu de l’intervention.<br />
CONCLUSION. L’arthrodèse sacro-iliaque peut être proposée<br />
dans <strong>les</strong> séquel<strong>les</strong> <strong>des</strong> traumatismes du bassin, parfois associée<br />
à une ostéosynthèse pubienne si nécessaire. Les résultats de<br />
cette courte série sont globalement satisfaisants, en particulier<br />
sur la douleur, qui était la plainte principale <strong>des</strong> patients. Ces<br />
patients devront être revus avec un plus grand recul.<br />
* Cédric Pelegri, Service d’Orthopédie Traumatologie,<br />
Hôpital Saint-Roch, 5, rue Pierre-Dévoluy, 06000 Nice.
148 Écueils et indications de la voie ilioinguinale<br />
: à propos d’une cohorte<br />
continue de 34 patients opérés<br />
Jérôme TONETTI *, Marc BLAYSAT,<br />
Ahmad EID, Hervé VOUAILLAT, Johan ROSSI,<br />
Philippe MERLOZ<br />
INTRODUCTION. Cette étude rapporte la morbidité associée<br />
à l’apprentissage de la voie ilio-inguinale d’exposition endopelviennne<br />
de l’os coxal.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Trente-quatre patients, traités<br />
par un seul opérateur entre 1996 et 2006, ont été revus par un<br />
examinateur différent. L’âge moyen était de 34 ans (14 à 65 ans).<br />
Il y avait 21 hommes. L’abord était droit 24 fois et bilatéral<br />
6 fois. Nous avons noté <strong>les</strong> indications, la durée opératoire, la<br />
morbidité périopératoire. Dans la période postopératoire, nous<br />
avons noté l’existence de thromboses, l’apparition de troub<strong>les</strong><br />
sensitifs ou moteurs latéral et antérieur de cuisse, de l’aine ou<br />
ischiatique, de corps étrangers intra-articulaires, de problème de<br />
cicatrice. Au dernier recul, nous avons recherché <strong>des</strong> troub<strong>les</strong><br />
neurologiques séquellaires, une raideur de hanche, <strong>les</strong> reprises<br />
chirurgica<strong>les</strong>.<br />
RÉSULTATS. Le recul moyen était 14 mois (1 à 91 mois). Les<br />
indications étaient 2 fois une résection tumorale, 3 fois une réduction<br />
antérieure d’une disjonction sacro-iliaque, 4 fois une neurolyse<br />
du tronc lombosacré, 16 fois une fracture de l’anneau<br />
pelvien, 22 fois une fracture du cotyle. En périopératoire, nous<br />
avons noté 1 lésion du nerf fémoral, 1 lésion de la veine fémorale<br />
et 1 thrombose aigue de l’artère fémorale. L’existence d’une anastomose<br />
iliaque externe-obturatrice (corona mortis) a été notée<br />
8 fois. En postopératoire, nous avons noté 9 paresthésies cutanées<br />
latéra<strong>les</strong> de cuisse, 5 thromboses veineuses profon<strong>des</strong>, 5 paresthésies<br />
fémora<strong>les</strong> et 1 paresthésie ischiatique. Au dernier recul, <strong>des</strong><br />
paresthésies persistaient 5 fois à la face latérale de cuisse, et 1 fois<br />
à la face antérieure de cuisse. Une limitation de la rotation interne,<br />
de la flexion ou de l’adduction de hanche était constatée 12 fois.<br />
Une reprise chirurgicale était effectuée 4 fois pour corps étranger<br />
intra-articulaire (vis), 1 fois pour hernie inguinale, 1 fois pour<br />
thrombose artérielle et 1 fois pour hématome.<br />
DISCUSSION. D’après cette étude et la revue de littérature,<br />
cette technique est réalisable par un opérateur sénior jouissant<br />
d’un environnement multidisciplinaire. Les déficits moteurs sont<br />
exceptionnels, fémoraux. Les écueils vasculaires sont graves<br />
mais sans séquel<strong>les</strong>. Les lésions sensitives sont <strong>les</strong> plus fréquentes<br />
mais bénignes. Les corps étrangers intra-articulaires<br />
témoignent de la mauvaise perception endopelviennne de l’articulation.<br />
La fluoroscopie opératoire peut être utilisée. Une plaque<br />
en pont qui laisse libre <strong>les</strong> trous en regard de l’articulation<br />
maintient parfaitement la réduction sans prise de risque. Enfin, la<br />
rééducation postopératoire précoce en mobilisation de la hanche<br />
est primordiale pour éviter l’enraidissement par rétraction cicatricielle<br />
du muscle psoas-iliaque.<br />
* Jérôme Tonetti, Service Orthopédie-Traumatologie,<br />
Hôpital Michallon, BP 217X, 38043 Grenoble Cedex 09.<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S103<br />
149 Fractures péri-prothétiques B2 B3<br />
de Vancouver : traitement par<br />
implant fémoral recouvert d’HA<br />
avec verrouillage distal<br />
Gérard ASENCIO *, Christian NOURISSAT,<br />
Grégory COURTADE, Raoul BERTIN,<br />
Fabricio ANNOCARO<br />
INTRODUCTION. Le but de ce travail était d’analyser <strong>les</strong><br />
résultats du traitement <strong>des</strong> fractures péri-prothétiques B2 et B3<br />
de Vancouver par tige de reprise à verrouillage distal et revêtue<br />
partiellement d’hydroxyapatite.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. La série comptait 35 fractures<br />
B2-B3 de Vancouver sur PTH ou intermédiaires traitées entre<br />
2001 et 2005, soit 16 hommes et 19 femmes d’âge moyen<br />
80,6 ans (46-94). Le traitement a comporté l’ablation de la tige<br />
par voie postéro-latérale, la mise en place d’une tige fémorale de<br />
reprise, DLS (Stryker) à double verrouillage distal revêtue<br />
d’hydroxyapatite sur <strong>les</strong> 2/3 proximaux, et synthèse du fémur<br />
proximal par cerclages. Nous avons dénombré 15 reprises bipolaires<br />
et 13 unipolaires. L’évaluation clinque était basée sur le<br />
HHS et le PMA au dernier recul. L’évaluation radiologique était<br />
basée sur la consolidation osseuse, la stabilité et la réhabitation<br />
autour de la tige selon Engh et Massin, <strong>les</strong> ossifications péri-articulaires<br />
selon Brooker.<br />
RÉSULTATS. Sept patients, âgés, sont décédés dans <strong>les</strong> 3 premiers<br />
mois. Vingt-huit patients (11 hommes et 17 femmes) d’âge<br />
moyen 80,8 ans ont été revus avec un recul moyen de 9,3 mois<br />
(6-24). La durée moyenne de l’intervention était de 2h47<br />
(1h17-4h30). Aucune complication peropératoire n’est survenue.<br />
En postopératoire ont été observées : aucune luxation, aucune<br />
infection profonde mais une non-consolidation. Le délai moyen<br />
de consolidation a été de 3,8 mois (3-12). Le HHS moyen était<br />
de 82,2 (55-100) et de 14,4 (7-18) pour le PMA moyen. Les calcifications<br />
péri-articulaires ont été de 7,7 % stade 1, 3,8 %<br />
stade 2 et 3,8 % stade 3. Seuls 9 cas ont présenté un liseré proximal<br />
limité en zone 1A ou 7A. Aucune rupture de vis n’a été<br />
observée.<br />
CONCLUSION. Le double verrouillage distal et la synthèse<br />
autour de la tige ont permis d’obtenir une bonne stabilité primaire<br />
et autoriser une mise en charge précoce. La stabilité mécanique<br />
et le revêtement d’hydroxyapatite ont permis d’obtenir la<br />
consolidation rapide du foyer fracturaire et un bon remodelage<br />
osseux autour de l’implant. L’utilisation d’une tige non cimentée<br />
à double verrouillage distal recouverte d’hydroxyapatite permet<br />
ainsi d’éviter l’escalade thérapeutique et le recours aux tiges longues<br />
cimentées ou à ancrage diaphysaire.<br />
* Gérard Asencio, Service de Chirurgie Orthopédique,<br />
CHU Caremeau, avenue du Professeur-Robert-Debré,<br />
30029 Nîmes Cedex 9.
3S104 81 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
150 Fractures thoraco-lombaires<br />
comminutives : résultats de la<br />
réduction chirurgicale instrumentée<br />
plus comblement par ciment chez<br />
28 patients<br />
Hervé VOUAILLAT *, Jérôme TONETTI,<br />
Ahmad EID, Christian VASILE, Victor COSTACHE,<br />
Philippe MERLOZ<br />
INTRODUCTION. Les fractures thoraco-lombaires comminutives<br />
présentent une perte de substance du tissu spongieux vertébral<br />
après réduction en distraction-lordose. La réduction est<br />
maintenue par un montage court. Nous pratiquons un relèvement<br />
du plateau vertébral crânial et un comblement par injection de<br />
ciment phosphocalcique dans le vide post réductionnel. Cette<br />
étude analyse <strong>les</strong> résultats cliniques et radiologiques <strong>des</strong> premiers<br />
patients opérés.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Une cohorte continue de<br />
28 patients a été opérée dans le service en 2004 et 2005. L’âge<br />
moyen était de 38 ans. Il y avait 18 hommes. La lésion concernait<br />
3 fois T12, 17 fois L1, 5 fois L2 et 3 fois L3. Dans la classification<br />
de Magerl, nous avions 21 fractures A3, 4 fractures B1<br />
et 3 fractures A2. Aucun patients ne présentaient de lésions neurologiques.<br />
La cyphose vertébrale initiale (CVi) moyennne était<br />
de 18 degrés (extrêmes 11 à 30°). L’angulation régionale traumatique<br />
initiale (ARi) moyenne était de 11 degrés. Tous nos<br />
patients ont bénéficié d’une instrumentation pédiculaire <strong>des</strong><br />
niveaux sus et sous-jacent et de la vertèbre cassée. Le comblement<br />
vertébral était réalisé avec un ciment phosphocalcique. Les<br />
patients étaient rééduqués sans corset en autorisant la position<br />
assise à la 72 e heure postopératoire. Le résultat clinique a été<br />
suivi par le score d’incapacité d’Owestry, l’échelle EVA, le score<br />
OMS et le test de Schoeber. Nous avons évalué la réduction postopératoire<br />
(CV0 et AR0), au recul sans ablation de matériel<br />
(CVr et ARr). Pour 11 patients, CV et AR ont été contrôlés à<br />
3 mois de l’ablation de matériel. La perte de hauteur somatique<br />
antérieure et médiane a été recherchée au dernier recul.<br />
RÉSULTATS. Le recul moyen était de 4 mois. Le score<br />
d’incapacité d’Oswestry au dernier recul était de 6 %. Le test de<br />
Schoeber était de 13,6. L’évolution de la CV moyenne était :<br />
CV0 2°, CVr 6°. L’évolution de l’AR moyenne était : AR0 -5°,<br />
ARr -1°. La perte de hauteur antérieure était de 4,3 %. La perte<br />
de hauteur médiane sous le disque était en moyenne de 0,2 %.<br />
DISCUSSION. La technique de réduction plus comblement<br />
chirurgical du plateau vertébral permet de pérenniser, au delà de<br />
3 mois la réduction osseuse postopératoire. Le relèvement du<br />
plateau vertébral tente de replacer le disque dans <strong>des</strong> conditions<br />
de travail et de nutrition favorab<strong>les</strong>. Cependant le pincement discal<br />
reste la séquelle principale à long terme qui induit une perte<br />
angulaire cyphosante.<br />
* Hervé Vouaillat, Service Orthopédie-Traumatologie,<br />
Hôpital Michallon, BP 217X, 38043 Grenoble Cedex 09.<br />
151 Étude prospective randomisée de<br />
la rééducation fonctionnelle précoce<br />
de l’épaule dans le traitement<br />
conservateur <strong>des</strong> fractures de<br />
l’humérus proximal<br />
Antoine BABINET *,<br />
Marie-Martine LEFEVRE-COLAU, Fouad FAYAD,<br />
Jean FERMANIAN, Francois RANNOU,<br />
Yann MACE, Philippe ANRACT, Laurent VASTEL,<br />
Valérie DUMAINE, David BIAU,<br />
Serge POIRAUDEAU, Bernard TOMENO,<br />
Michel REVEL<br />
INTRODUCTION. Les fractures de l’humérus proximal sont<br />
fréquentes en particulier chez le sujet âgé. La récupération fonctionnelle<br />
dépend de la qualité et du délai de mise en œuvre de la<br />
rééducation. Certains auteurs ont proposé de commencer la rééducation<br />
précocement. Cependant, aucun travail prospectif comparant<br />
la rééducation précoce et la rééducation habituelle à<br />
3 semaines du traumatisme n’a été réalisé à ce jour. Le but de ce<br />
travail était de valider prospectivement l’intérêt de la rééducation<br />
précoce dans ce type de fracture.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Soixante-cinq patients ayant<br />
une fracture de l’humérus proximal nécessitant un traitement<br />
fonctionnel ont été randomisés en 2 groupes. Le groupe 1<br />
(G1 n = 32) a suivi une rééducation précoce (avant le 3 e jour suivant<br />
la fracture), le groupe 2 (G2 n = 33) une rééducation standard<br />
(débutée 3 semaines après la fracture). La rééducation s’est<br />
déroulée selon le même schéma et dans le même centre de rééducation<br />
fonctionnelle pour <strong>les</strong> 2 groupes. Le critère d’évaluation<br />
primaire était le score de Constant à 3 mois. Les critères secondaires<br />
étaient le score de Constant à 6 semaines et 6 mois, la<br />
douleur et <strong>les</strong> amplitu<strong>des</strong> articulaires.<br />
RÉSULTATS. Les résultats étaient significativement supérieurs<br />
dans G1, à 6 semaines et à 3 mois (score de constant à<br />
3 mois 69,8 G1 contre 61,1 G2). L’intensité de la douleur était<br />
significativement moins importante à 3 mois dans G1 et <strong>les</strong><br />
amplitu<strong>des</strong> articulaires étaient meilleures à 6 semaines et 3 mois<br />
dans G1. En revanche, aucune différence significative n’a été<br />
notée à 6 mois. Aucun déplacement secondaire de la fracture n’a<br />
été observé dans <strong>les</strong> 2 groupes.<br />
CONCLUSION. La place de la rééducation précoce <strong>des</strong> fractures<br />
de l’humérus proximal est intéressante : elle permet une<br />
récupération fonctionnelle plus rapide sans risque de déplacement<br />
secondaire.<br />
* Antoine Babinet, Service de Chirurgie Orthopédique B,<br />
Hôpital Cochin, 27, rue du Faubourg-Saint-Jacques,<br />
75014 Paris.
152 La satisfaction <strong>des</strong> patients vis-àvis<br />
<strong>des</strong> soins reçus : un indicateur<br />
prédictif de la qualité de vie un an<br />
après une arthroplastie totale de<br />
hanche ou de genou<br />
Cédric BAUMANN *, Anne-Christine RAT,<br />
Georges OSNOWYCZ, Didier MAINARD,<br />
Jean-Pierre DELAGOUTTE, Christian CUNY,<br />
Francis GUILLEMIN<br />
INTRODUCTION. La satisfaction <strong>des</strong> patients vis-à-vis <strong>des</strong><br />
soins qui leur ont été prodigués constitue un indicateur de<br />
mesure de la qualité <strong>des</strong> soins dont l’évaluation est l’une <strong>des</strong><br />
priorités <strong>des</strong> établissements de santé (Ordonnance du 24 avril<br />
1996, Loi du 4 mars 2002). Par ailleurs, <strong>les</strong> mesures de qualité<br />
de vie sont de plus en plus utilisées pour apprécier l’impact<br />
d’une affection ou d’une stratégie thérapeutique sur la vie au<br />
quotidien <strong>des</strong> patients.<br />
L’objectif de cette étude était d’étudier le rôle prédictif de la<br />
satisfaction <strong>des</strong> patients au décours de l’hospitalisation sur l’évolution<br />
de leur qualité de vie (QV) postopératoire à 1, 6 et<br />
12 mois après une prothèse totale de hanche (PTH) ou de genou<br />
(PTG).<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Une étude de cohorte multicentrique<br />
a été menée auprès de patients arthrosiques devant recevoir<br />
une PTH ou une PTG et suivis pendant une année après<br />
l’hospitalisation. La qualité de vie a été mesurée avant l’intervention,<br />
puis 1, 6 et 12 mois après la sortie avec le questionnaire<br />
SF36 (8 dimensions) et la satisfaction <strong>des</strong> soins a été mesurée<br />
1 mois après la sortie avec le questionnaire PJHQ (5 dimensions).<br />
Des modè<strong>les</strong> de régression linéaire à mesures répétées<br />
ont été utilisés pour étudier <strong>les</strong> relations entre la satisfaction <strong>des</strong><br />
soins et la QV postopératoire <strong>des</strong> patients, ajustées sur la QV<br />
préopératoire et <strong>les</strong> caractéristiques sociodémographiques et cliniques<br />
initia<strong>les</strong>.<br />
RÉSULTATS. Sur 231 patients inclus et opérés, 204 patients<br />
ont été revus à 1 mois après la sortie, 196 à 6 mois et 189 (âge<br />
moyen 69 (± 8) ans, 41,9 % d’hommes, 126 PTH et 63 PTG) à<br />
12 mois. Après la chirurgie, la qualité de vie <strong>des</strong> patients s’est<br />
améliorée dans toutes <strong>les</strong> dimensions. Les patients <strong>les</strong> plus satisfaits<br />
avaient une meilleure qualité de vie postopératoire ajustée.<br />
Les dimensions du PJHQ soins médicaux, admission et soins<br />
infirmiers prédisaient principalement <strong>les</strong> dimensions douleur<br />
physique (p = 7,10-4 à 0,05), santé mentale (p < 10-3), fonctionnement<br />
social (p = 7,10-3 à 0,03), vitalité (p < 10-3) et santé<br />
générale (p < 10-3) du SF36. Avoir une QV préopératoire élevée<br />
et être un homme prédisaient également une meilleure QV postopératoire.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. En plus d’être un indicateur<br />
de la qualité <strong>des</strong> soins, la satisfaction postopératoire immé-<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S105<br />
Séance du 7 novembre matin<br />
GENOU<br />
diate vis-à-vis <strong>des</strong> soins est un indicateur prédictif de l’état de<br />
santé perçu 1 an après PTH et PTG. Ces résultats constituent un<br />
argument supplémentaire en faveur de l’utilisation <strong>des</strong> mesures<br />
de satisfaction dans cette nouvelle perspective clinique.<br />
* Cédric Baumann, Service d’Epidémiologie<br />
et Evaluation Cliniques, Hôpital Marin, CHU de Nancy,<br />
92, avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny,<br />
CO 34, 54035 Nancy.<br />
153 L’état clinique et la qualité de vie<br />
préopératoires <strong>des</strong> patients prédisent-ils<br />
le niveau de satisfaction<br />
<strong>des</strong> soins après une arthroplastie<br />
totale de hanche ou de genou ?<br />
Didier MAINARD *, Cédric BAUMANN,<br />
Anne-Christine RAT, Georges OSNOWYCZ,<br />
Jean-Pierre DELAGOUTTE, Christian CUNY,<br />
Laurent GALOIS, Francis GUILLEMIN<br />
INTRODUCTION. L’évaluation de la qualité <strong>des</strong> soins à travers<br />
la mesure de la satisfaction <strong>des</strong> patients soulève <strong>des</strong> questions<br />
sur l’existence de facteurs indépendants <strong>des</strong> soins<br />
hospitaliers susceptib<strong>les</strong> d’influencer le niveau de satisfaction<br />
<strong>des</strong> patients. L’objectif de l’étude était d’identifier <strong>les</strong> facteurs<br />
influençant le niveau de satisfaction <strong>des</strong> patients vis-à-vis <strong>des</strong><br />
soins prodigués après une arthroplastie totale de hanche ou de<br />
genou.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Une étude de cohorte multicentrique<br />
a été menée auprès de 228 adultes arthrosiques devant<br />
recevoir une prothèse totale de hanche (PTH) ou de genou (PTG)<br />
suivis après la sortie d’hôpital. La satisfaction <strong>des</strong> soins a été<br />
mesurée 1 mois après la sortie par le questionnaire PJHQ<br />
(5 dimensions). La qualité de vie (QV) avant l’hospitalisation et<br />
1 mois après la sortie a été mesurée par un questionnaire générique<br />
(SF-36) et un spécifique de l’arthrose de membres inférieurs<br />
(AMIQUAL). Des modè<strong>les</strong> statistiques de régression linéaire ont<br />
été utilisés pour expliquer <strong>les</strong> scores de satisfaction (0-pire à<br />
100-meilleure). Les facteurs explicatifs étudiés incluaient <strong>les</strong><br />
caractéristiques sociodémographiques <strong>des</strong> patients, <strong>des</strong> mesures<br />
cliniques pré et post-chirurgica<strong>les</strong> et deux mesures de QV pré et<br />
postopératoires (questionnaire SF-36).<br />
RÉSULTATS. Au total, 210 patients opérés (140 PTH et<br />
70 PTG) ont complété le questionnaire de satisfaction. L’âge<br />
moyen était de 69 (± 8) ans et 43,8 % étaient <strong>des</strong> hommes. Le<br />
score de satisfaction le plus élevé concernait la dimension soins<br />
médicaux (74 points ± 18), le plus faible la dimension environnement<br />
hospitalier (68 points ±16). La satisfaction <strong>des</strong> patients<br />
était indépendante <strong>des</strong> paramètres cliniques pré et postopératoi-
3S106 81 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
res. Seuls <strong>les</strong> scores de QV préopératoires douleur (p < 0,01) et<br />
fonctionnement social (p < 0,05) du SF36 étaient corrélés à la<br />
satisfaction <strong>des</strong> soins : <strong>les</strong> patients ayant une meilleure QV préopératoire<br />
étaient <strong>les</strong> plus satisfaits vis-à-vis <strong>des</strong> soins reçus.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. En montrant que <strong>les</strong><br />
caractéristiques préopératoires <strong>des</strong> patients n’influencent pas<br />
leur niveau de satisfaction après une PTH ou une PTG, nos résultats<br />
suggèrent que <strong>des</strong> modifications du processus de soins pourraient<br />
avoir un impact direct sur la satisfaction <strong>des</strong> patients<br />
indépendamment de leurs caractéristiques cliniques et sociodémographiques<br />
initia<strong>les</strong>.<br />
* Didier Mainard, Service de Chirurgie Orthopédique<br />
et Traumatologique, CHU de Nancy, Hôpital Central,<br />
29, avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, 54000 Nancy.<br />
154 Correspondance entre <strong>les</strong> épaisseurs<br />
cartilagineuses <strong>des</strong> sites<br />
donneurs et receveurs dans <strong>les</strong><br />
mosaïc-plasties du condyle médial<br />
Mathieu THAUNAT *, Sophie COUCHON,<br />
Olivier CHARROIS, Philippe BEAUFILS<br />
INTRODUCTION. Une différence importante entre l’épaisseur<br />
cartilagineuse du site donneur et receveur lors de la réalisation<br />
<strong>des</strong> mosaïc-plasties peut conduire à <strong>des</strong> contraintes<br />
anorma<strong>les</strong> péjorant le résultat fonctionnel à long terme. L’objectif<br />
de l’étude était de déterminer <strong>les</strong> différences d’épaisseur cartilagineuse<br />
entre <strong>les</strong> sites donneurs et receveurs habituellement<br />
concernés lors de la réalisation <strong>des</strong> autogreffes ostéocartilagineuses<br />
au niveau du genou.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Dix-neuf arthroscanners réalisés<br />
chez <strong>des</strong> patients jeunes (âge moyen : 29 ans) sans lésions<br />
cartilagineuses ont été rétrospectivement analysés. Les sites<br />
donneurs étudiés étaient : la trochlée médiale et latérale, la partie<br />
centrale, médiale et latérale de l’échancrure intercondylienne,<br />
et la partie postérieure <strong>des</strong> condy<strong>les</strong> fémoraux. Les sites<br />
receveurs étudiés étaient quatre points situés sur la face latérale<br />
du condyle médial. Pour chaque site, une coupe de référence<br />
perpendiculaire à la zone cartilagineuse concernée était préalablement<br />
définie de façon à ce que la mesure soit réalisée de<br />
façon précise et reproductible sur chaque arthroscanner. Les<br />
mesures étaient réalisées à l’aide d’une table de numérisation<br />
équipée d’un logiciel spécifique (SigmaCom,version 6.00). La<br />
technique de mesure a été validée par l’étude <strong>des</strong> variations intra<br />
et inter-observateurs.<br />
RÉSULTATS. La mesure <strong>des</strong> épaisseurs cartilagineuses est<br />
fiable et reproductible puisqu’il existe une bonne corrélation et<br />
une bonne concordance inter et intra-observateur. Le cartilage<br />
est plus épais en moyenne au niveau <strong>des</strong> sites receveurs<br />
(moyenne : 2,49 mm, DS : 0,646) qu’au niveau <strong>des</strong> sites donneurs<br />
(moyenne: 1,79 mm, DS :0,432) (p < 0,0001). Il n’y a pas<br />
de différence d’épaisseur cartilagineuse entre <strong>les</strong> différents sites<br />
donneurs lorsqu’on <strong>les</strong> compare sauf pour la partie antérolatérale<br />
de l’échancrure qui est plus fine (moyenne : 1,3 mm, DS : 0,291)<br />
(p < 0,05).<br />
DISCUSSION. L’épaisseur cartilagineuse moyenne mesurée<br />
au niveau de chaque site donneur est constamment inférieure à<br />
l’épaisseur cartilagineuse moyenne mesurée en différents points<br />
d’une zone receveuse caractéristique (face latérale du condyle<br />
médial en zone portante). L’épaisseur cartilagineuse au niveau<br />
<strong>des</strong> différents sites donneurs diffère peu lorsqu’on <strong>les</strong> compare<br />
entre eux, sauf pour la partie latérale de l’échancrure ou le cartilage<br />
est significativement plus fin. Cette zone ne devrait être<br />
pas être prélevée en première intention lors de la réalisation<br />
d’une autogreffe ostéocartilagineuse afin de limiter <strong>les</strong> risques<br />
d’incongruence au niveau de la greffe.<br />
* Mathieu Thaunat, 17, avenue Beaucour, 75008 Paris.<br />
155 La greffe autologue de chondrocytes<br />
dans le traitement de l’ostéochondrite<br />
disséquante du genou : à<br />
propos de 14 cas<br />
Sylvain DEMAILLY *, Jacques BAHUAUD,<br />
Michel ALLIZARD<br />
INTRODUCTION. La réparation <strong>des</strong> lésions chondra<strong>les</strong> et<br />
ostéochondra<strong>les</strong> reste un challenge thérapeutique. Les lésions<br />
d’ostéochondrite disséquante évoluées (sta<strong>des</strong> III et IV de la<br />
classification de Bedouelle) du genou entrent dans ce cadre, et<br />
<strong>les</strong> traitements classiquement proposés n’aboutissent pas à une<br />
cicatrisation chondrale de bonne qualité avec un taux de morbidité<br />
non négligeable. En 1987, la première greffe autologue de<br />
chondrocytes était réalisée, consistant en l’injection au niveau de<br />
la lésion, sous un lambeau périosté, de chondrocytes autologues<br />
préalablement cultivés in vitro. L’objectif de ce travail était<br />
d’évaluer <strong>les</strong> résultats cliniques et radiologiques de la greffe<br />
autologue de chondrocytes dans le traitement de l’ostéochondrite<br />
disséquante du genou.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Il s’agit d’une étude rétrospective<br />
portant sur 14 greffes autologues de chondrocytes chez<br />
12 patients (11 hommes et une femme) de 23 ans d’âge moyen,<br />
atteints d’ostéochondrite disséquante du genou. Les lésions<br />
avaient une surface moyenne de 5,57 cm 2 et étaient toutes situées<br />
sur le condyle interne, en zone portante. La technique utilisée<br />
comportait un temps arthroscopique permettant le bilan lésionnel<br />
et la réalisation de la biopsie chondrale, un temps de culture cellulaire<br />
ex vivo, et un temps de greffe chondrocytaire associée à<br />
un lambeau périosté. Le recul moyen a été de 6,5 ans. L’évaluation<br />
a été réalisée à l’aide <strong>des</strong> scores clinique et radiologique de<br />
Hughston et de la fiche d’évaluation subjective du genou IKDC<br />
2000.<br />
RÉSULTATS. Tous <strong>les</strong> patients ont été cliniquement améliorés.<br />
Au dernier recul, le score IKDC moyen était de 91,7. Le<br />
score clinique de Hughston moyen était de 3,36, et le score<br />
radiologique de Hughston moyen était de 3,07. Il y a eu trois
complications : une hémarthrose et deux hypertrophies de la<br />
greffe (14,3 %) sans conséquances fina<strong>les</strong>. Un suivi IRM a été<br />
réalisé et a retrouvé une bonne intégration de la greffe.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. Nos résultats cliniques<br />
sont identiques à ceux de la littérature et se maintiennent au plus<br />
long recul. Le taux de complication spécifique correspond lui<br />
aussi à ceux retrouvés dans la littérature. Cette technique a permis<br />
à <strong>des</strong> patients jeunes et handicapés dans leur vie quotidienne<br />
d’améliorer leur qualité de vie, et le plus souvent de reprendre<br />
une activité sportive. Cependant, l’absence de contrôle arthroscopique<br />
systématique n’a pas permis de juger de la qualité et du<br />
type histologique du tissu de cicatrisation obtenu. L’avènement<br />
<strong>des</strong> matrices bioactives laisse espérer une simplification de la<br />
technique opératoire et une amélioration <strong>des</strong> résultats cliniques<br />
et histologiques.<br />
* Sylvain Demailly, Service d’Orthopédie et Traumatologie,<br />
HIA Robert-Picqué, 351, route de Toulouse,<br />
33140 Villenave d’Ornon.<br />
156 Mesure de la cinématique articulaire<br />
tridimensionnelle à l’aide de<br />
capteurs inertiels : application au<br />
genou<br />
François LUTHI *, Julien FAVRE,<br />
Kamiar AMINIAN, Olivier SIEGRIST,<br />
Rachid AISSAOUI, Jacques DE GUISE,<br />
Michel DUTOIT, Brigitte JOLLES<br />
INTRODUCTION. L’étude de la cinématique articulaire tridimensionnelle<br />
(3D) est un domaine d’évaluation fondamental<br />
en orthopédie. Cependant, <strong>les</strong> systèmes de mesures classiques<br />
nécessitent <strong>des</strong> laboratoires de marche coûteux. Leur utilisation<br />
en pratique clinique est de ce fait limitée. Les progrès récents <strong>des</strong><br />
capteurs inertiels permettent le développement de capteurs<br />
miniaturisés qui peuvent être fixés sur <strong>les</strong> segments corporels,<br />
sans entrave pour le mouvement. L’objectif de cette étude était<br />
de proposer une nouvelle méthode de calibration utilisant une<br />
référence anatomique solidaire de l’os pour la mesure de la cinématique<br />
3D du genou, à l’aide de capteurs inertiels et d’évaluer<br />
l’effet <strong>des</strong> artefacts dus aux mouvements de la peau, grâce à<br />
l’utilisation d’un système de référence, constitué d’un exosquelette<br />
muni d’un système magnétique de capture de mouvement.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Quatre sujets sains (26 ± 2 ans)<br />
ont participé à cette étude. Un parcours de marche de 7 mètres a<br />
été réalisé à deux reprises par chacun <strong>des</strong> sujets. Au premier<br />
essai, <strong>les</strong> capteurs inertiels (1 gyroscope tri-axial et 1 accéléromètre<br />
tri-axial, associés à un boîtier d’acquisition de données<br />
Physilog ® ) étaient fixés sur le système de référence. Au second<br />
essai, ils étaient fixés directement sur la peau de la cuisse et de la<br />
jambe.<br />
RÉSULTATS. Aucune différence significative n’a été mise en<br />
évidence entre <strong>les</strong> deux métho<strong>des</strong> de fixation <strong>des</strong> capteurs iner-<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S107<br />
tiels (peau versus exosquelette). Les amplitu<strong>des</strong> de mouvement<br />
moyennes obtenues avec <strong>les</strong> capteurs inertiels étaient de 51,5°,<br />
10° et 14° pour la flexion/extension, l’abduction/adduction et la<br />
rotation interne/externe. Pour le système de référence, ces<br />
valeurs étaient de 52,5°, 10,5° et 13°, soit moins de 1° de différence.<br />
L’erreur moyenne (avec déviation standard) sur le signal<br />
temporel pour <strong>les</strong> variations 3D <strong>des</strong> ang<strong>les</strong> étaient de 6,3° (1,7°),<br />
4,2° (2°) et 1,8° (1,7°).<br />
DISCUSSION. Les amplitu<strong>des</strong> articulaires mesurées avec le<br />
système inertiel sont très proches de cel<strong>les</strong> mesurées par le système<br />
de référence. La faible erreur observée entre <strong>les</strong> 2 métho<strong>des</strong><br />
en déviation standard reflète la validité de la méthode de calibration.<br />
L’erreur systématique est secondaire aux différentes façons<br />
de définir la valeur zéro (i.e. la position neutre). Les métho<strong>des</strong> de<br />
fixation n’influencent pas <strong>les</strong> résultats.<br />
CONCLUSION. Cette méthode de mesure de la cinématique<br />
3D est très prometteuse car le positionnement <strong>des</strong> capteurs sur la<br />
peau influence de façon non significative <strong>les</strong> résultats et autorise<br />
une évaluation clinique ambulatoire.<br />
* François Luthi, Hôpital Orthopédique de la Suisse Romande,<br />
4, avenue Pierre-Decker, 1005 Lausanne, Suisse.<br />
157 Analyse objective de la coordination<br />
à la marche avant et après prothèse<br />
totale de genou<br />
Brigitte JOLLES-HAEBERLI *, Kamiar AMINIAN,<br />
Hooman DEJNABADI, Caroline VORACEK,<br />
Claude PICHONNAZ, Michel DUTOIT,<br />
Pierre-François LEYVRAZ<br />
INTRODUCTION. La coordination est une stratégie choisie<br />
par le système nerveux central pour contrôler <strong>les</strong> mouvements et<br />
maintenir l’équilibre à la marche. Sa modélisation demeure<br />
encore un challenge et particulièrement difficile. Cependant,<br />
c’est un paramètre important pour le chirurgien lorsqu’il doit<br />
apprécier <strong>les</strong> troub<strong>les</strong> de la marche de son patient.<br />
Le but de cette étude était de mettre au point une méthode<br />
pour apprécier, de façon dynamique et quantitative, la coordination<br />
à la marche et de l’appliquer à <strong>des</strong> patients avant et après<br />
prothèse totale de genou.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Dix patients ont été inclus dans<br />
cette étude utilisant le système d’analyse de marche portatif Physilog<br />
® . Après obtention d’un consentement écrit, chaque participant<br />
a effectué deux essais de marche de 30 m de long, à<br />
3 vitesses différentes, et complété <strong>les</strong> questionnaires EQ-5D,<br />
WOMAC et le Knee Society Score. Huit patients bénéficiant<br />
d’une arthroplastie totale de genou ont été comparés à 2 participants<br />
sains appariés par âge. Les résultats ont été enregistrés<br />
préopératoirement, et postopératoirement à 6 semaines, 3 mois,<br />
6 mois et 1 année. Une nouvelle méthode d’analyse quantitative<br />
de la coordination à la marche a été développée, permettant de<br />
décrire la dynamique globale de la marche et de montrer <strong>les</strong><br />
synergies cinématiques à différentes vitesses de marche. L’inté-
3S108 81 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
gration de différents outils a été nécessaire à cet effet, notamment<br />
la décomposition harmonique, l’analyse par composants<br />
principaux et <strong>les</strong> réseaux de neurones artificiels.<br />
RÉSULTATS. La nouvelle méthode proposée a permis de<br />
développer <strong>des</strong> scores de coordination à différentes vitesses de<br />
marche. Elle a permis de donner un score global de coordination<br />
tout autant qu’une appréciation de la contribution de chaque articulation<br />
(hanches/genoux). Les différences obtenues entre <strong>les</strong><br />
valeurs de coordination préopératoires et postopératoires étaient<br />
corrélées avec <strong>les</strong> améliorations <strong>des</strong> scores subjectifs administrés<br />
aux patients.<br />
DISCUSSION. Cette méthode objective d’appréciation de la<br />
coordination à la marche, intégrant différentes articulations et<br />
différentes vitesses, n’a pas d’équivalent actuellement dans la littérature.<br />
Même si le nombre de patients est encore actuellement<br />
restreint, <strong>les</strong> résultats ont montré une faisabilité et <strong>des</strong> résultats<br />
probants dans le cadre de son application aux prothèses tota<strong>les</strong><br />
de genou. L’utilisation d’un système d’analyse de la marche portatif<br />
en améliore l’applicabilité en cabinet médical.<br />
CONCLUSION. Une nouvelle méthode objective d’analyse<br />
de la coordination à la marche a été développée et a montré <strong>des</strong><br />
résultats très encourageants pour l’appréciation <strong>des</strong> résultats de<br />
la chirurgie <strong>des</strong> membres inférieurs.<br />
* Brigitte Jol<strong>les</strong>-Haeberli,<br />
Hôpital Orthopédique de la Suisse Romande,<br />
4, avenue Pierre-Decker, 1005 Lausanne, Suisse.<br />
158 Quelle est la laxité frontale d’un<br />
genou normal ?<br />
Jean-Yves JENNY *, Cyril BOÉRI,<br />
Eugène CIOBANU<br />
INTRODUCTION. La restauration de la balance ligamentaire<br />
est recommandée lors de la pose <strong>des</strong> prothèses tota<strong>les</strong> de genou.<br />
Mais la définition de cette balance reste floue, notamment parce<br />
que la laxité physiologique d’un genou normal n’est pas connue<br />
avec précision. Les systèmes de navigation permettent de mesurer<br />
cette laxité de façon précise in vivo en cours d’intervention.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Vingt patients opérés pour<br />
laxité isolée du ligament croisé antérieur, notamment sans<br />
lésions <strong>des</strong> plans capsuloligamentaires médial ou latéral ou <strong>des</strong><br />
ménisques, ont été évalués. Avant la plastie ligamentaire réalisée<br />
sous contrôle d’un système de navigation, la laxité médiolatérale<br />
en extension et en flexion a été mesurée par le même système.<br />
Les auteurs utilisent le système de navigation sans image Ortho-<br />
Pilot ® (Aesculap, Tuttlingen, Allemagne). Des localiseurs infrarouges<br />
étaient fixés sur la partie basse du fémur, la partie<br />
proximale du tibia et sur le dos du pied. Après acquisition cinématique<br />
et anatomique <strong>des</strong> données de la navigation conventionnelle,<br />
une mesure de l’angle fémorotibial mécanique de face en<br />
extension et à 90° de flexion sans stress. Puis la variation de cet<br />
angle lors d’un mouvement de stress manuel en varus et valgus<br />
maximal, en extension et à 90° de flexion, a été mesurée. La<br />
variation d’angle entre la position de repos et la position de<br />
stress maximal en varus et valgus était assimilée à la laxité latérale<br />
ou médiale, respectivement.<br />
RÉSULTATS. La laxité médiale moyenne en extension était<br />
de 3° (écart-type de 2°, maximum = 6°, minimum = 1°). La<br />
laxité latérale moyenne en extension était de 3° (écart-type de 2°,<br />
maximum = 8°, minimum = 2°). La laxité médiale moyenne à<br />
90° de flexion était de 2° (écart-type de 2°, maximum = 4°, minimum<br />
= 0°). La laxité latérale moyenne à 90° de flexion était de<br />
4° (écart-type de 2°, maximum = 8°, minimum = 2°).<br />
DISCUSSION. Le logiciel utilisé offre la possibilité de mesurer<br />
de façon précise <strong>les</strong> laxités ligamentaires notamment dans le<br />
plan frontal. Les résultats apparaissent cohérents avec ceux de<br />
précédentes étu<strong>des</strong> réalisées in vitro.<br />
CONCLUSION. La connaissance de la laxité physiologique<br />
est une base de réflexion indispensable dans la définition du<br />
cahier <strong>des</strong> charges de l’implantation d’une PTG.<br />
* Jean-Yves Jenny, CTO, 10, avenue Baumann, 67400 Illkirch.<br />
159 Taux de sepsis dans <strong>les</strong> prothèses<br />
tota<strong>les</strong> de genou de première<br />
intention : série continue de 923<br />
prothèses sur 10 ans<br />
Romain DEBARGE *, Marie-Christine NICOLLE,<br />
Alban PINAROLI, Tarik AIT SI SELMI,<br />
Philippe NEYRET<br />
INTRODUCTION. Les objectifs de cette étude étaient de rapporter<br />
le taux de sepsis <strong>des</strong> prothèses tota<strong>les</strong> de genou de première<br />
intention sur une période de 10 ans dans un CHU, d’identifier <strong>les</strong><br />
facteurs susceptib<strong>les</strong> d’entraîner une infection du site opératoire,<br />
d’exposer nos métho<strong>des</strong> de surveillance, de préciser le pourcentage<br />
d’infections qualifiées de nosocomia<strong>les</strong>, et de réfléchir sur<br />
<strong>les</strong> perspectives de prévention<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Entre janvier 1995 et janvier<br />
2004, 999 patients ont eu une PTG cimentée HLS (Tornier ® ) postéro-stabilisée<br />
de première intention dans notre service. 923 dossiers<br />
ont été analysés. Nous disposons de deux sources<br />
d’informations : le registre du service rempli par <strong>les</strong> chirurgiens<br />
avant l’opération, à 2 mois, 6 mois, 1 an puis tous <strong>les</strong> 2 ans ; <strong>les</strong><br />
données du CLIN qui surveille <strong>les</strong> sepsis survenant l’année suivant<br />
l’implantation. Nous avons pu comparer ces deux bases de données,<br />
ce qui nous donne une évaluation précise du taux de sepsis.<br />
Nous avons relevé <strong>les</strong> caractéristiques démographiques (sexe et<br />
âge), cliniques (diabète, score ASA, indice de masse corporelle,<br />
antécédents de chirurgie du genou, traitement anticoagulant au<br />
long cours) et bactériologiques (germe en cause, sensibilité aux<br />
antibiotiques). Les infections étaient qualifiées de nosocomia<strong>les</strong> si<br />
el<strong>les</strong> survenaient au décours de l’année suivant l’implantation.<br />
RÉSULTATS. Le taux de sepsis est de 2 % (20 patients réopérés)<br />
avec un recul moyen de 41 mois et minimal de 16 mois. Soixantequinze<br />
pour cent sont apparus durant la première année suivant la
mise en place de la prothèse ce qui représente un taux d’infection<br />
nosocomiale de 1,5 %. On retrouve : 70 % de femmes, une majorité<br />
de patients obèses, un score ASA élevé, le Staphylocoque aureus est<br />
majoritairement retrouvé dans près de la moitié <strong>des</strong> cas, dix-huit<br />
mala<strong>des</strong> ont bénéficié d’une réimplantation en 2 temps, 1 d’une<br />
arthrodèse et 1 d’un traitement conservateur par lavage. Tous <strong>les</strong><br />
patients sont considérés en rémission (biologiques, cliniques,<br />
18 implants de reprise en place, une arthrodèse fusionnée).<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. L’intérêt de cette large<br />
série est de déterminer le taux de sepsis <strong>des</strong> PTG de première<br />
intention qui est de 2 % dont 75 % qualifiée de nosocomia<strong>les</strong>. Il<br />
faut rappeler la difficulté de surveiller <strong>les</strong> infections sur prothèses<br />
et insister sur une meilleure prévention à la fois péri-opératoire<br />
mais aussi secondaire.<br />
* Romain Debarge, Centre Livet, 8, rue de Margnol<strong>les</strong>,<br />
69300 Caluire.<br />
160 Le syndrome poplité douloureux<br />
par hypertrophie du semi-membraneux<br />
: à propos de 4 cas opérés<br />
Pablo TURELL *, Olivier TOUCHARD,<br />
Grégory NAVEZ, Olivier ROCHE,<br />
François SIRVEAUX, Daniel MOLÉ<br />
INTRODUCTION. Les tuméfactions douloureuses du creux<br />
poplité sont en général en rapport avec l’existence d’un kyste<br />
poplité, plus rarement d’un lipome, d’un ganglion lymphatique,<br />
d’une anomalie anévrismale de l’artère poplitée, d’un névrome,<br />
ou d’une tumeur. Nous rapportons 4 cas de tuméfactions douloureuses<br />
du creux poplité en rapport avec une hypertrophie du<br />
muscle semi-membraneux.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Il s’agissait de 3 patients de 15,<br />
16 et 18 ans pratiquant le football. Ils présentaient une tuméfac-<br />
166 De l’intérêt <strong>des</strong> biopsies percutanées<br />
<strong>des</strong> lésions osseuses d’allure<br />
tumorale<br />
Philippe ADAM *, Olivier PRETESEILLE,<br />
Rémi PHILIPPOT, Sophie GROSCLAUDE,<br />
Fabrice-Guy BARRAL, Jean-François MOSNIER,<br />
Michel FESSY<br />
INTRODUCTION. Dans la pathologie tumorale osseuse, la<br />
biopsie chirurgicale est la technique de référence. Nous évaluons<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S109<br />
Séance du 7 novembre après-midi<br />
TUMEURS<br />
tion bilatérale à la partie supéro-médiale <strong>des</strong> creux poplités, pour<br />
2 patients un seul coté était symptomatique, pour 1 patient <strong>les</strong><br />
douleurs étaient bilatéra<strong>les</strong>. Les douleurs initialement modérées,<br />
seulement exacerbées lors <strong>des</strong> efforts sportifs, avaient augmenté<br />
en intensité pour gêner la marche avec sensation de tension au<br />
niveau du creux poplité. L’examen retrouvait une tuméfaction<br />
douloureuse à la palpation, augmentant de volume et devenant<br />
plus dure aux mouvements contrariés de flexion du genou. Le<br />
bilan biologique et radiographique était sans particularité.<br />
L’échographie, l’examen tomodensitométrique et l’IRM retrouvaient<br />
une hypertrophie du semi-membraneux, à structure musculaire<br />
normale sans anomalie <strong>des</strong> rapports anatomiques avec <strong>les</strong><br />
éléments environnants. Après échec du traitement fonctionnel, un<br />
traitement chirurgical a été décidé. Les patients étaient en décubitus<br />
ventral, sous garrot pneumatique. L’abord était vertical centré<br />
sur la tuméfaction. Le tendon du semi-tendineux était récliné en<br />
dedans. Aucune insuffisance aponévrotique n’a été retrouvée<br />
pouvant expliquer la tuméfaction par une hernie musculaire.<br />
Nous avons toujours retrouvé une hypertrophie d’un chef musculaire<br />
du semi-membraneux, qu’il a fallu individualiser du reste du<br />
corps musculaire. Le chef musculaire était réséqué, puis la jonction<br />
myotendineuse était reconstituée par tubulisation.<br />
RÉSULTATS. Nous n’avons noté aucune complication. Nous<br />
avons préconisé un appui partiel avec deux cannes pendant<br />
15 jours, la marche avec appui complet a été possible dans tous<br />
<strong>les</strong> cas à 3 semaines. L’indolence complète était retrouvée la<br />
6 e semaine postopératoire. La reprise du sport à été possible à<br />
3 mois. L’examen anatomopathologique a toujours retrouvé du<br />
muscle strié normal, sans aucune anomalie de structure.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. Il s’agit d’une étiologie<br />
rare <strong>des</strong> tuméfactions du creux poplité. Seulement 4 cas sont<br />
décrits dans la littérature. Cette hypertrophie localisée d’un <strong>des</strong><br />
chefs musculaires du semi-membraneux survient à la maturation<br />
squelettique et est favorisée vraisemblablement par la pratique<br />
du sport. Il existe <strong>des</strong> hypertrophies douloureuses, d’autres<br />
asymptomatiques. Dans <strong>les</strong> cas résistants au traitement médical,<br />
l’exérèse chirurgicale permet la guérison.<br />
* Pablo Turell, Clinique de Traumatologie et d’Orthopédie,<br />
49, rue Hermite, 54052 Nancy Cedex.<br />
l’intérêt <strong>des</strong> biopsies effectuées en percutané dans la prise en<br />
charge <strong>des</strong> lésions osseuses d’allure tumorale et en particulier<br />
son efficacité dans la différentiation <strong>des</strong> tumeurs bénignes <strong>des</strong><br />
tumeurs malignes.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Les biopsies percutanées effectuées<br />
entre mai 1998 et octobre 2003 ont été étudiées rétrospectivement.<br />
Après exclusion <strong>des</strong> patients aux antécédents<br />
néoplasiques connus ou dont l’aspect clinique, radiologique ou<br />
biologique étaient en faveur d’une origine infectieuse, 91 biopsies<br />
ont été incluses. Le rachis et le bassin représentaient 2/3 <strong>des</strong><br />
sites de biopsie. La zone considérée avait fait l’objet au préalable<br />
d’une tomodensitométrie dans 100 % <strong>des</strong> cas, d’une IRM dans<br />
62 % <strong>des</strong> cas et d’une scintigraphie osseuse dans 91 % <strong>des</strong> cas.
3S110 81 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
Nous avons évalué <strong>les</strong> complications liées au geste lui-même, la<br />
validité de la technique quant au diagnostic <strong>des</strong> lésions malignes<br />
avec détermination de sa sensibilité et de sa spécificité et <strong>les</strong> conséquences<br />
sur la prise en charge thérapeutique. Le diagnostic de<br />
bénignité n’était retenu qu’en cas de contrôle chirurgical ou de<br />
suivi supérieur à 12 mois.<br />
RÉSULTATS. Les diagnostics suivants ont été retenus :<br />
29 métastases, 36 tumeurs osseuses primitives et 25 pseudotumeurs.<br />
Quatre complications ont été observées : une infection<br />
sévère et 3 complications spontanément résolutives : 2 hématomes<br />
et un pneumothorax. La validité de la biopsie percutanée<br />
quant au diagnostic de malignité retrouvait une sensibilité de<br />
92,3 % et une spécificité de 97,4 %. Pour <strong>les</strong> tumeurs osseuses<br />
primitives, la sensibilité était de 87 % et la spécificité de 92,9%.<br />
Pour <strong>les</strong> tumeurs osseuses primitives malignes opérées, 5 biopsies<br />
percutanées soit 20,8 % avaient un résultat imprécis ou<br />
insuffisant. Dans un cas, la prise en charge thérapeutique a été<br />
altérée du fait d’une approximation diagnostique.<br />
DISCUSSION. La biopsie percutanée est particulièrement<br />
efficace pour le diagnostic <strong>des</strong> localisations osseuses secondaires,<br />
que la tumeur primitive soit connue ou non, avec une sensibilité<br />
de 96,6 %. La malignité et le grade étaient bien<br />
diagnostiqués dans 83,3 % <strong>des</strong> tumeurs osseuses primitives alors<br />
que Yao et al retrouvaient eux 75 % de bons diagnostics. Dans<br />
<strong>les</strong> tumeurs osseuses primitives, le caractère hétérogène est un<br />
facteur limitant pour le diagnostic par biopsie percutanée. Le<br />
bilan radiologique initial peut permettre alors d’améliorer la qualité<br />
<strong>des</strong> prélèvements en ciblant une zone d’intérêt, mais lorsque<br />
une tumeur osseuse primitive est suspectée la biopsie chirurgicale<br />
a notre préférence.<br />
* Philippe Adam, Centre d’Orthpédie Traumatologie,<br />
Hôpital Bellevue, 29, boulevard Pasteur, 42055 Saint-Etienne.<br />
167 Valeur pronostique de la biopsie<br />
préopératoire du kyste osseux anévrysmal<br />
Pierre-Louis DOCQUIER *, Christine GALANT,<br />
Henri NOEL, Christian DELLOYE<br />
INTRODUCTION. L’histoire naturelle du kyste osseux anévrysmal<br />
(KOA) est composée de 4 phases : lytique, expansion,<br />
stabilisation, guérison. La guérison peut parfois survenir spontanément<br />
ou après biopsie, ce qui montre le potentiel intrinsèque<br />
du KOA à guérir. De multip<strong>les</strong> traitements ont été proposés pour<br />
le KOA avec <strong>des</strong> taux variab<strong>les</strong> de récidive. Les facteurs pronostiques<br />
(influençant le taux de récidive) rapportés dans la littérature<br />
sont le genre et l’âge du patient au moment de l’opération.<br />
Aucun autre facteur n’a été décrit précédemment. Un nouveau<br />
facteur pronostique fiable se basant sur la biopsie préopératoire<br />
est proposé.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Vingt patients consécutifs avec<br />
un KOA ont été opérés dans notre institution par une nouvelle<br />
méthode : l’implantation par voie mini-invasive de poudre d’os<br />
déminéralisée (ostéoinducteur) associée à de la moelle osseuse<br />
(cellu<strong>les</strong> souches ostéoprogénitrices). Il y avait 10 patients de<br />
sexe masculin et 10 de sexe féminin avec un âge moyen à l’opération<br />
de 17 ans (8 à 28 ans). La localisation du KOA était au<br />
niveau <strong>des</strong> os longs dans 10 cas, dans le bassin dans 8 cas, le calcanéum<br />
dans 1 cas et la glène de l’omoplate dans 1 cas. Une<br />
biopsie a été réalisée dans tous <strong>les</strong> cas. Sept patients étaient en<br />
récidive suite à un traitement chirurgical préalable (4 curettage et<br />
greffe2 curettage, greffe et embolisation, 1 injection répétée de<br />
stéroide). Pour 6 de ces 7 récidives la biopsie était disponible.<br />
Au total 26 biopsies étaient disponib<strong>les</strong>. Le suivi moyen était de<br />
33,7 mois (6 à 100 mois). L’évaluation postopératoire a été réalisée<br />
par <strong>des</strong> radiographies successives (tous <strong>les</strong> mois puis tous <strong>les</strong><br />
6 mois). Chaque biopsie fut examinée par 2 observateurs. Les<br />
3 composants du KOA furent évalués : composante cellulaire<br />
(cellu<strong>les</strong> stroma<strong>les</strong> et cellu<strong>les</strong> géantes), composante fibrillaire et<br />
composante ostéoïde.<br />
RÉSULTATS. Les 26 biopsies correspondaient à 16 guérisons<br />
et 10 récidives. Une relation très significative fut trouvée entre le<br />
rapport stroma ostéoïde/stroma cellulaire (rapport O/C) et l’évolution<br />
finale (p = 0,001). La composante fibrillaire n’était pas<br />
déterminante. Les KOA qui avaient un stroma ostéoïde prédominant<br />
ou équivalent au stroma cellulaire évoluèrent plus souvent<br />
vers la guérison tandis que <strong>les</strong> KOA qui récidivèrent avaient un<br />
stroma cellulaire prédominant.<br />
DISCUSSION. Le KOA a un potentiel d’auto-guérison qui<br />
est initiée au niveau <strong>des</strong> septa avec formation d’ostéoïde. Un<br />
KOA déjà entré dans la phase de stabilisation est plus enclin à<br />
guérir quel que soit le traitement. Au contraire un kyste en phase<br />
lytique ou en pleine expansion est plus à risque de récidiver.<br />
CONCLUSION. La biopsie est donc un facteur pronostique<br />
important. Choisissant un rapport O/C 3 2 comme valeur de cutoff,<br />
la valeur prédictive positive pour la guérison est de 90 %. Au<br />
contraire, si le rapport O/C est < 1, la valeur prédictive négative<br />
(pour la récidive) est de 70%.<br />
* Pierre-Louis Docquier, 10, avenue Hippocrate,<br />
1200 Bruxel<strong>les</strong>, Belgique.<br />
168 Utilité du repérage préopératoire<br />
par harpon en pathologie ostéoarticulaire<br />
Henri GUERINI *, Philippe ANRACT, Eric PESSIS,<br />
Jean-Luc DRAPÉ, Michael OUAKNINE,<br />
Xavier POITTEVIN, Antoine BABINET,<br />
Fabrice THEVENIN, Raphaël CAMPAGNA,<br />
Antoine FEYDY, Bernard TOMENO,<br />
Alain CHEVROT<br />
INTRODUCTION. Démontrer l’utilité de la pose de harpons<br />
semblab<strong>les</strong> à ceux utilisés en sénologie dans le cadre de pathologies<br />
musculo-squelettiques.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Quinze patients souffrant d’une<br />
pathologie tumorale ou de corps étrangers ont bénéficié de la
pose d’un harpon en préopératoire. Le geste était réalisé après<br />
anesthésie locale, sous scanner ou sous échographie, la veille ou<br />
le jour de l’intervention.<br />
RÉSULTATS. Cette technique nous a permis de repérer de<br />
petites lésions musculaires non palpab<strong>les</strong> (schwanome, angiomes).<br />
La pose d’un harpon permet également de repérer <strong>des</strong><br />
lésions osseuses diffici<strong>les</strong> d’accès (ostéome ostéoïde, chondrosarcome,<br />
métastases) et de réaliser <strong>des</strong> exérèses plus limitées et<br />
moins délabrantes. L’extraction de corps étrangers radio-transparents<br />
(morceaux de verres, échar<strong>des</strong> de bois), souvent sources<br />
d’échecs ou de cicatrices excessives, est également facilitée par<br />
la pose de ces harpons sous échographie.<br />
DISCUSSION. La technique de la pose d’un harpon en préopératoire<br />
est bien connue en sénologie. Le harpon permet de<br />
repérer <strong>des</strong> lésions de petite taille, non palpab<strong>les</strong> et donc chirurgicalement<br />
diffici<strong>les</strong> d’accès. Le principe est identique en<br />
ostéoarticulaire.<br />
CONCLUSION. La pose de harpons en pathologie musculosquelettique<br />
(tumeurs ou corps étrangers) permet simplement de<br />
guider et de réduire le temps et l’étendue d’exérèse. Elle peut<br />
s’effectuer sous scanner ou sous échographie après accord chirurgical<br />
sur la voie d’abord à utiliser.<br />
* Henri Guerini, Service de Radiologie B, Hôpital Cochin,<br />
27, rue du Faubourg-Saint-Jacques, 75014 Paris.<br />
169 Évaluation à moyen terme du comblement<br />
<strong>des</strong> tumeurs bénignes de<br />
l’os de l’adulte par <strong>des</strong> granu<strong>les</strong> en<br />
phosphate de calcium<br />
François GOUIN *, Romain LECONTE,<br />
Denis WAAST, Norbert PASSUTI,<br />
Joël DELÉCRIN<br />
INTRODUCTION. Les céramiques phosphocalciques sont<br />
une alternative aux greffes osseuses dans le comblement <strong>des</strong> pertes<br />
de substances osseuses. Le but de ce travail était l’évaluation<br />
de la tolérance locale et du résultat fonctionnel à moyen et long<br />
terme <strong>des</strong> tumeurs bénignes de l’os traitées par curetage et comblement<br />
par une céramique phosphocalcique.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Étude unicentrique, rétrospective<br />
de patients opérés entre 1990 et 2003 d’une tumeur bénigne<br />
de l’os, par curetage et comblement par <strong>des</strong> granu<strong>les</strong> de céramique<br />
macroporeuse phosphocalcique biphasée (60 % d’hydroxyapatite,<br />
40 % de phosphate tricalcique) et ayant plus de 24 mois<br />
de recul (TriositeR 29 cas, EurocerR 7 cas, BCPR 6 cas). Les<br />
patients ont été revus à 1 an puis au recul maximum. La perte de<br />
substance a été évaluée selon la classification TOD (Gouin et le<br />
Gesto) et son volume. L’évaluation radiographique selon une<br />
grille de relecture indépendante de l’opérateur.<br />
RÉSULTATS. Quarante-deux tumeurs ont pu être analysées<br />
(taux de révision 76 %), chez <strong>des</strong> patients de 33 ans (15 à<br />
67 ans). Le recul moyen est de 75 mois (24 à 204 mois). La moi-<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S111<br />
tié <strong>des</strong> tumeurs siégeaient au membre inférieur. Quarante et une<br />
tumeurs étaient <strong>des</strong> type I (TOD), et 22 fois D+ (centre de la<br />
tumeur à plus de 1 cm de l’os receveur), le volume moyen de 20<br />
cc (0,5 à 160 cc.). Aucune complication précoce ou tardive spécifique<br />
n’a été notée (2 algodystrophies, 3 récidives), pas de<br />
complication mécanique. Radiographiquement, tous <strong>les</strong> comblements<br />
sont au plus grand recul en continuité avec l’os receveur,<br />
et il existe un liseré de moins de 25 % de l’interface dans 4 cas<br />
(10 %). Le matériau a montré une homogénéïsation dans <strong>les</strong><br />
24 premiers mois, avec seulement 8 cas de résorption partielle<br />
(< 25 %). Aucune limitation fonctionnelle n’a été notée à 1 an,<br />
ni secondairement.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. Cette étude confirme la<br />
bonne tolérance clinique et radiographique a moyen terme de<br />
ces céramiques dans ces indications. Ce type de comblement a,<br />
dans tous <strong>les</strong> cas, rempli l’objectif fixé. Cependant, si <strong>les</strong> récidives<br />
ont été peu nombreuses, el<strong>les</strong> surviennent également sur <strong>des</strong><br />
comblements synthétiques. Enfin, une telle étude clinique et<br />
radiographique, si elle suggère la probable intégration (continuité<br />
osseuse entre l’os receveur et le matériau), ne préjuge pas<br />
de la réhabitation en profondeur, et nécessite donc un suivi à<br />
plus long terme.<br />
* François Gouin, Service d’Orthopédie, CHU Hôtel-Dieu,<br />
place Alexis-Ricordeau, 44093 Nantes Cedex.<br />
170 Curetage et comblement par<br />
ciment dans <strong>les</strong> tumeurs à cellu<strong>les</strong><br />
géantes : étude clinique et radiographique<br />
de 28 cas<br />
François GOUIN *, Gil<strong>les</strong> FAIZON,<br />
Nicolas FRAQUET, Philippe ROSSET<br />
INTRODUCTION. Le recours au ciment polymethylmétacrylate<br />
est une <strong>des</strong> alternatives au comblement <strong>des</strong> tumeurs à<br />
cellu<strong>les</strong> géantes (TCG), après curetage. Son objectif est double,<br />
combler la perte de substance osseuse de façon durable chez ces<br />
sujets jeunes et limiter l’incidence <strong>des</strong> récidives loca<strong>les</strong>.<br />
L’objectif de ce travail était d’évaluer l’incidence <strong>des</strong> récidives<br />
par cette technique dans notre expérience, et d’évaluer la tolérance<br />
fonctionnelle et radiographique de ces comblements<br />
juxta-articulaires.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Vingt-huit patients opérés dans<br />
2 centres ont été revus cliniquement et radiographiquement pour<br />
cette étude. Ils présentaient tous une TCG, traitée par curetage<br />
mécanique soigneux, comblement par ciment associé à une<br />
ostéosynthèse de principe pour un <strong>des</strong> centres (16 cas). L’analyse<br />
radiographique a porté sur le cartilage articulaire, le volume<br />
tumoral et sa taille par rapport à l’os environnant, ses rapports<br />
avec le cartilage articulaire.<br />
RÉSULTATS. Le recul moyen est de 5 ans (7 mois à 13 ans).<br />
Le volume tumoral était de 78 cm 3 (36 à 203), le rapport tumeur<br />
sur os de 70 % (50 à 97 %) et 22 comblements étaient en contact<br />
direct avec le cartilage articulaire et 4 à moins de 1 cm. Deux
3S112 81 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
patients ont été repris de principe à 2 ans pour ablation du ciment<br />
et autogreffe. Six patients ont présenté une récidive locale<br />
(21 %) traitée par « recimentation » et 2 fois par une PTG.<br />
Vingt-cinq fois la fonction est sub-normale, sans dégradation<br />
avec le temps. Quatre patients présentent un liseré os-ciment non<br />
évolutif et 3 une arthrose débutante.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. La cimentation est une<br />
solution chirurgicale simple, sans morbidité précoce pour le<br />
comblement de gros volumes péri-articulaires <strong>des</strong> TCG. Dans<br />
notre expérience, il permet un contrôle mo<strong>des</strong>te <strong>des</strong> récidives<br />
(21 %) par rapport aux séries de la littérature. Les récidives sont<br />
faci<strong>les</strong> à détecter précocément. La fonction et l’évolution radiographique<br />
à court terme sont satisfaisants même dans le comblement<br />
de gros volumes au contact de l’articulation. Cependant,<br />
<strong>les</strong> incertitu<strong>des</strong> sur le devenir à long terme du cartilage sousjacent<br />
et <strong>les</strong> difficultés pour une reprise chirurgicale doivent faire<br />
peser avec prudence <strong>les</strong> indications chez le sujet jeune.<br />
* François Gouin, Service d’Orthopédie, CHU Hôtel-Dieu,<br />
place Alexis-Ricordeau, 44093 Nantes Cedex.<br />
171 Chondrosarcome mésenchymateux<br />
: 8 observations à long recul<br />
Gérard DELÉPINE *, Fabrice DELÉPINE,<br />
Salwa ALKALLAF, Barbara MARKOWSKA,<br />
Nicole DELÉPINE<br />
INTRODUCTION. Le chondrosarcome mésenchymateux<br />
constitue une forme rare et hautement maligne de chondrosarcome<br />
dont le traitement n’est pas codifié. Cette étude critique de<br />
nos observations vise à en définir quelques principes.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Huit patients âgés de 4 à 45 ans<br />
(moyenne 30,7) lors de la biopsie ont été traités et suivis pour<br />
chondrosarcomes mésenchymateux. Le point de départ était une<br />
vertèbre mobile (2), le sacrum (2), l’os iliaque (1) ou un os long<br />
(humérus distal, fémur distal, diaphyse tibiale). Seuls trois ont<br />
été vus avant biopsie. Les autres ont été adressés après biopsie<br />
inadaptée (1), deux pour récidive locale après traitement et deux<br />
pour récidive et métastase. Les traitements ont recouru de<br />
manière personnalisée à la chirurgie de résection, à la chimiothérapie<br />
et à la radiothérapie.<br />
RÉSULTATS. Cinq mala<strong>des</strong> ont souffert de récidive locorégionale<br />
et 4 de métastases à distance. Trois mala<strong>des</strong> sont morts<br />
de maladie. Les 5 autres sont vivants en rémission avec un recul<br />
médian de 15,3 ans. La topographie centrale représente le principal<br />
facteur pronostique péjoratif. Ainsi, sur <strong>les</strong> 4 mala<strong>des</strong> atteints<br />
de tumeurs rachidiennes, un seul a survécu. Les récidives loca<strong>les</strong><br />
sont liées aux traitements locaux sub optimaux (résection contaminée<br />
ou réduction du volume tumoral suivie de radiothérapie).<br />
L’analyse <strong>des</strong> évolutions montre que la radiothérapie est peu efficace<br />
sur <strong>les</strong> lésions macroscopiques (3 échecs sur trois tentatives).<br />
Elle paraît susceptible de prévenir la croissance de dépôts<br />
tumoraux microscopiques: en cas de résection contaminée suivie<br />
de radiothérapie, <strong>les</strong> récidives loca<strong>les</strong> ont été observées à la<br />
limite <strong>des</strong> champs d’irradiation. En cas de métastases, la résec-<br />
tion <strong>des</strong> lésions visib<strong>les</strong> suivie de chimiothérapie agressive a été<br />
réalisée 3 fois et a permis dans <strong>les</strong> 3 cas de contrôler la maladie<br />
et d obtenir une rémission complète prolongée.<br />
DISCUSSION. Nos observations confirment que le chondrosarcome<br />
mésenchymateux est une tumeur de haut degré de malignité<br />
et que la chimiothérapie est susceptible de prévenir <strong>les</strong><br />
métastases.Que même dans <strong>les</strong> formes métastatiques un traitement<br />
multidisciplinaire peut obtenir une rémission prolongée.<br />
Que la radiothérapie peut aider au contrôle local après résection<br />
totale contaminée mais ne parvient pas à éradiquer une lésion<br />
macroscopique et qu’en conséquence la réduction tumorale ne<br />
représente qu’un traitement palliatif.<br />
CONCLUSION. Le chondrosarcome mésenchymateux hautement<br />
est sensible aux traitements complémentaires mais non<br />
radio curable. Les récidives très tardives sont possib<strong>les</strong>. Le traitement<br />
optimal associe résection monobloc et chimiothérapie.<br />
* Gérard Delépine, 8, rue Eugène-Varlin, 93700 Drancy.<br />
172 Localisations pelviennes <strong>des</strong> chondrosarcomes<br />
: à propos de 55 cas<br />
Xavier DELOIN *, Antoine BABINET,<br />
Philippe ANRACT, Valérie DUMAINE,<br />
Bernard TOMENO<br />
INTRODUCTION. Le chondrosarcome du bassin est la<br />
tumeur primitive osseuse la plus fréquente chez l’adulte de plus<br />
de 40 ans. Chimio et radio-résistant, son traitement est chirurgical.<br />
Son exérèse est difficile de part sa localisation et la reconstruction<br />
qu’elle nécessite parfois. Des taux faib<strong>les</strong> de survie et<br />
élevés de récidive locale après traitement chirurgical ont été rapportés<br />
dans la littérature. Le but de cette étude était d’évaluer <strong>les</strong><br />
résultats oncologiques et fonctionnels à long terme du traitement<br />
chirurgical d’une grande série de patients atteints de chondrosarcome<br />
du bassin traités dans notre établissement.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Les dossiers de 55 patients<br />
atteints de chondrosarcome pelvien opérés entre 1982 et 2003<br />
ont été passés en revue rétrospectivement. Il y avait 29 hommes<br />
et 26 femmes avec un âge moyen 48,6 ans (23 à 78 ans). Les critères<br />
étudiés comprenaient le grade, la qualité et le type de l’exérèse,<br />
la reconstruction, la survenue de récidive et la durée de<br />
survie. La durée moyenne du suivi <strong>des</strong> patients était de 88,8 mois<br />
(3 à 272 mois). Une analyse de survie actuarielle avec comparaison<br />
<strong>des</strong> courbes par le test de Logrank a été réalisée afin de<br />
déterminer <strong>les</strong> facteurs pronostiques.<br />
RÉSULTATS. Neuf patients étaient atteints d’un chondrosarcome<br />
grade 1 ; 35 d’un grade 2; 5 d’un grade 3; et 6 d’un chondrosarcome<br />
dédifférencié.14 tumeurs intéressaient la zone I du<br />
bassin, 11 la zone II, 5 la zone III, 3 <strong>les</strong> zones I+II, 18 <strong>les</strong><br />
zones II+III et 4 <strong>les</strong> zones I+II+III. 8 patients ont eu une désarticulation<br />
inter illio-abdominale, 47 ont bénéficié d’un traitement<br />
conservateur. Vingt et un patients (38 %) ont eu une récidive<br />
locale, et 12 (22 %) ont eu <strong>des</strong> métastases. Au dernier recul,<br />
17 patient (31 %) étaient vivants sans récidive, 21 (38 %) étaient
morts de la maladie, 17 (31 %) étaient morts de causes indépendantes<br />
ou perdus de vus.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. La résection chirurgicale<br />
large est le seul traitement efficace. La récidive tumorale locale<br />
ou à distance est très fréquente. Les facteurs de mauvais pronostic<br />
pour la survie sont le grade élevé de la tumeur, la résection<br />
incomplète et la survenue de métastase.<br />
* Xavier Deloin, 14, rue du Château-<strong>des</strong>-Rentiers, 75013 Paris.<br />
173 Tumeurs du bassin : résectionreconstruction<br />
selon la technique<br />
de Puget-Uthéza. À propos de huit<br />
cas<br />
Sébastien MARTRES *, Gualter VAZ,<br />
Olivier GUYEN, Jacques BÉJUI-HUGUES,<br />
Jean-Paul CARRET<br />
INTRODUCTION. Le pronostic vital <strong>des</strong> tumeurs du bassin<br />
atteignant l’acetabulum est directement lié à la qualité de la<br />
résection chirurgicale. Le pronostic fonctionnel est lié aux possibilités<br />
de reconstruction articulaire. Nous avons utilisé la technique<br />
de Puget-Uthéza chez 8 patients : la reconstruction du bassin<br />
et de l’acetabulum se fait avec l’extrémité proximale du fémur<br />
homolatéral comme autogreffe associée à une prothèse totale de<br />
la hanche de résection. L’objet de cette étude était de préciser la<br />
morbidité et <strong>les</strong> résultats fonctionnels de cette technique.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Notre série comportait 8 patients<br />
âgés de 45 ans en moyenne (15 à 73 ans) opérés dans le service<br />
entre 1997 et 2003. Les diagnostics étiologiques étaient : chondrosarcome<br />
(n = 3), fibrome <strong>des</strong>moïde (n = 1), sarcome d’Ewing<br />
(n = 1), angiosarcome (n = 1), rhabdomyosarcome (n = 1), ostéosarcome<br />
(n = 1). La topographie tumorale était précisée selon la<br />
classification de Enneking : 4 tumeurs dans la zone 1-2, 2 dans la<br />
zone 2 et 2 dans la zone 2-3. L’acétabulum était intéressé par la<br />
tumeur dans tous <strong>les</strong> cas. Le fémur proximal était indemne de<br />
tumeur dans tous <strong>les</strong> cas. L’indication thérapeutique était posée<br />
par une équipe multidisciplinaire. Quatre patients avaient eu une<br />
thérapie adjuvante (chimiothérapie, radiothérapie). Nous avons<br />
étudié la durée opératoire, <strong>les</strong> pertes sanguines et <strong>les</strong> complications<br />
postopératoires précoces et tardives. Nous avons évalué le<br />
résultat fonctionnel au dernier recul.<br />
RÉSULTATS. Le recul minimum pour <strong>les</strong> patients vivants<br />
était de 2 ans. Deux patients étaient décédés de métastases pulmonaires<br />
(chondrosarcome à 14 mois et sarcome d’Ewing à<br />
12 mois). Les complications postopératoires étaient détaillées.<br />
Au plus long recul, cinq patients marchaient de façon autonome<br />
avec au moins une canne. Une patiente était non marchante pour<br />
faillite mécanique de sa reconstruction articulaire.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. Dans la prise en charge<br />
thérapeutique <strong>des</strong> tumeurs du bassin intéressant l’acétabulum, la<br />
reconstruction peut se discuter avec la résection isolée. En cas<br />
de reconstruction, la reconstruction peut utiliser plusieurs<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S113<br />
techniques : <strong>les</strong> prothèses en selle, <strong>les</strong> allogreffes massives ou <strong>les</strong><br />
arthrodèses. La technique de Puget-Uthéza a notre préférence car<br />
elle utilise une autogreffe et permet de préserver une hanche<br />
mobile et fonctionnelle. On peut espérer obtenir un résultat fonctionnel<br />
satisfaisant avec restauration d’une marche autonome avec<br />
une canne. Cette étude confirme également qu’il s’agit d’une chirurgie<br />
à morbidité élevée propre à la situation oncologique.<br />
* Sébastien Martres, Service de Chirurgie Orthopédique,<br />
Pavillon T, Hôpital Edouard-Herriot, place d’Arsonval,<br />
69437 Lyon Cedex 03.<br />
174 Reconstruction diaphysaire segmentaire<br />
par l’association allogreffe-fibula<br />
vascularisée<br />
Jérôme DILIGENT *, Pierre JOURNEAU,<br />
Gil<strong>les</strong> DAUTEL, Stéphane BARBARY,<br />
Pierre LASCOMBES<br />
INTRODUCTION. La reconstruction diaphysaire <strong>des</strong> gran<strong>des</strong><br />
pertes de substance pose souvent un problème du fait du volume<br />
à combler, et de la stabilité mécanique nécessaire. Nous utilisons<br />
depuis 3 ans l’association d’une allogreffe cryo-conservée et<br />
d’une fibula vascularisée pour pallier à ces deux difficultés dans<br />
<strong>les</strong> reconstructions segmentaires <strong>des</strong> membres inférieurs.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Depuis 2003, nous réalisé<br />
6 reconstructions de ce type (4 reconstructions segmentaires et<br />
2 arthrodèses de genou). Il s’agit de 5 garçons et 1 fille, âgés de<br />
8 ans à 16 ans au moment de l’intervention. Le recul va de 6 mois<br />
à 3 ans. Nous utilisons une allogreffe taillée sur mesure, dans<br />
laquelle est crée une tranchée sur toute sa longueur, permettant<br />
d’accueillir la fibula vascularisée. La fibula est encastrée en proximal<br />
et en distal dans le canal médullaire <strong>des</strong> deux segments osseux<br />
sains, et a comporté pour 5 cas sur 6 une palette cutanée de surveillance.<br />
La synthèse osseuse a été assurée dans 4 cas par <strong>des</strong> plaques<br />
sur mesures, et dans deux cas par <strong>des</strong> plaques verrouillées.<br />
RÉSULTATS. L’appui a été repris en pleine charge à un délai<br />
moyen de 3 mois. La consolidation distale a été acquise dans<br />
6 cas sur 6 dans un délai moyen de 6 mois, et dans 5 cas sur<br />
6 pour la jonction proximale. Cette absence de consolidation a<br />
nécessité une reprise pour greffe osseuse et changement de matériel<br />
de synthèse. Nous avons déploré 1 cas de paralysie du nerf<br />
fibulaire commun, complètement régressive. Aucun problème<br />
infectieux n’a été infectieux.<br />
DISCUSSION. La reconstruction diaphysaire en particulier<br />
tumorale nécessite une grande quantité d’os, de bonne qualité<br />
afin d’obtenir une consolidation correcte à laquelle s’ajoute le<br />
problème de la stabilité primaire au membre inférieur, pour une<br />
reprise d’appui précoce. L’utilisation de la fibula vascularisée<br />
répond au critère de qualité osseuse, mais n’assure pas de stabilité<br />
mécanique suffisante initiale. L’allogreffe isolée, même si la<br />
cryoconservation a permis d’améliorer la qualité tissulaire, se<br />
résorbe au fil du temps, et <strong>les</strong> consolidations restent aléatoires.<br />
L’association de ces deux os semble répondre aux différents pro-
3S114 81 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
blèmes posés, en apportant la stabilité mécanique primaire initiale,<br />
et de l’os vascularisé, qui va progressivement s’épaissir.<br />
Cela raccourcit le délai de mise en charge, et la consolidation ne<br />
semble pas influencée par la chimiothérapie post-opératoire. Ces<br />
premiers résultats nous confortent dans l’utilisation de cette<br />
technique, en première intention dans <strong>les</strong> reconstructions segmentaires<br />
du membre inférieur.<br />
* Jérôme Diligent, Service de Chirurgie A, CHU de Nancy,<br />
Hôpital d’Enfants, 54511 Vandœuvre-<strong>les</strong>-Nancy.<br />
175 Reconstruction par prothèse inversée<br />
après résection de l’humérus<br />
proximal pour tumeur : à propos de<br />
11 cas<br />
François SIRVEAUX *, Grégory NAVEZ,<br />
Luc FAVARD, Pascal BOILEAU, Gil<strong>les</strong> WALCH,<br />
Daniel MOLÉ<br />
INTRODUCTION. La reconstruction de l’humérus proximal<br />
après résection pour tumeur peut faire appel à une prothèse<br />
inversée pour rétablir la mobilité quand le deltoïde reste fonctionnel.<br />
La prothèse peut alors être utilisée isolément, avec un<br />
manchon de ciment, ou manchonnée sur une entretoise ou une<br />
allogreffe. Le but de cette étude était d’analyser <strong>les</strong> résultats<br />
obtenus en fonction du procédé de reconstruction utilisé.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Il s’agit d’une étude rétrospective<br />
multicentrique incluant 11 patients, d’un âge moyen de<br />
45 ans (18-79) opérés avant décembre 2003. La tumeur était primitive<br />
dans dix cas (2 ostéosarcomes juxta-corticaux, un ostéosarcome<br />
télangiectasique, six chondrosarcomes, une tumeur<br />
<strong>des</strong>moïde) et secondaire dans un cas. Selon la classification<br />
MSTS, 2 cas étaient S3, 7 cas S34, 1 cas S345 et un cas S2345.<br />
La hauteur moyenne de résection était de 11 cm (6-15). La prothèse<br />
a été utilisée seule dans un cas, avec un manchon de ciment<br />
dans 3 cas, une entretoise dans 4 cas et une allogreffe dans 3 cas.<br />
Une suture de la coiffe restante a été réalisée dans 4 cas et un<br />
transfert du grand dorsal et du grand rond dans deux cas.<br />
RÉSULTATS. Deux cas de luxations postopératoires ont été<br />
relevés, deux reprises pour changement partiel de la prothèse et<br />
une reprise pour dépose simple de la prothèse. À la révision, <strong>les</strong><br />
trois patients qui avaient eu une résection intra-lésionnelle<br />
étaient décédés. Les autres étaient vivants sans signe de récidive<br />
locale ou d’évolution métastatique. Au recul moyen de 29 mois,<br />
le score de Constant était de 54 points (27-79) avec une élévation<br />
antérieure moyenne à 126°. Le score de Constant était en<br />
moyenne de 64 points avec une allogreffe et de 74 points avec<br />
une entretoise. Seuls <strong>les</strong> patients ayant eu une suture de la coiffe<br />
restante ou un transfert musculaire de grand dorsal-grand rond<br />
ont récupéré de la rotation externe active. Toutes <strong>les</strong> allogreffes<br />
ont consolidé avec une lyse partielle proximale.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. La prothèse inversée a<br />
donné <strong>des</strong> résultats fonctionnels à cours terme supérieurs à ceux<br />
rapportés par <strong>les</strong> hémiarthroplasties ou l’arthrodèse dans cette<br />
indication, malgré un taux élevé de complications. Quand elle<br />
est possible, la fixation <strong>des</strong> tendons restants ou <strong>des</strong> transferts<br />
musculaires sur une allogreffe ou une entretoise proximale semble<br />
préférable. La prothèse peut être utilisée seule pour <strong>les</strong> résections<br />
courtes ou avec un manchon de ciment quand il s’agit<br />
d’une solution de sauvetage à court terme.<br />
* François Sirveaux, Clinique de Traumatologie<br />
et d’Orthopédie, 49, rue Hermite, 54052 Nancy Cedex.<br />
176 Synovialosarcome au poignet et à<br />
la main : intérêt de la chirurgie conservatrice<br />
avec reconstruction composite<br />
très précoce. À propos de<br />
3cas<br />
Cyril LAZERGES *, Christian HERLIN,<br />
Manuel VALVERDE, Bertrand COULET,<br />
Didier CUPISSOL, Michel CHAMMAS<br />
INTRODUCTION. Le synovialosarcome est une tumeur rare<br />
développée le plus souvent aux dépens de structures périarticulaires.<br />
Il représente 8 à 10 % <strong>des</strong> tumeurs malignes <strong>des</strong> parties<br />
mol<strong>les</strong> et environ 10 % <strong>des</strong> tumeurs malignes <strong>des</strong> parties mol<strong>les</strong><br />
au niveau de la main. Son pronostic est sévère avec environ 60 %<br />
de récidives dans <strong>les</strong> deux ans et une survie estimée à 55 % à<br />
5 ans. La chirurgie conservatrice à la main et au poignet est<br />
d’indication limitée compte tenu de l’extension tumorale et <strong>des</strong><br />
spécificités anatomiques.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Les auteurs rapportent, ici, une<br />
série de trois cas de synovialosarcome de la main. L’âge moyen<br />
est de 38 ans (29-44). Le diagnostic a été une découverte fortuite<br />
dans <strong>les</strong> trois cas, avec un retard diagnostique de 12 mois (9-18)<br />
par rapport au début <strong>des</strong> symptômes : un cas au décours d’une<br />
libération du nerf médian au canal carpien, un cas lors d’une<br />
ténosynovectomie du bord ulnaire du poignet dans un contexte<br />
de polyarthrite rhumatoïde, et un cas sur une reprise d’exérèse<br />
d’un kyste synovial dorsal du poignet. Après bilan d’extension<br />
négatif, le traitement a associé dans <strong>les</strong> trois cas une exérèse<br />
tumorale élargie à une chimiothérapie adjuvante. Dans deux cas,<br />
une chimiothérapie néoadjuvante avait été réalisée. Les exérèses<br />
chirurgica<strong>les</strong> comprenaient une exérèse monobloc du contenu du<br />
canal carpien, une résection du bord ulnaire du poignet y compris<br />
de la tête ulnaire et une résection extra-articulaire de la partie<br />
dorso-radiale du poignet. Une reconstruction fonctionnelle<br />
précoce a été nécessaire dans deux cas. Pour un, une greffe du<br />
nerf médian avec un premier temps de Hunter de reconstruction<br />
<strong>des</strong> tendons fléchisseurs ont été effectués à J0 (jour de l’exérèse),<br />
le deuxième temps à 8 mois. Pour l’autre, <strong>des</strong> greffes tendineuses<br />
sur <strong>les</strong> extrinsèques du pouce et un lambeau pédiculé interosseux<br />
postérieur de couverture cutanée ont été réalisés à J8.<br />
RÉSULTATS. Au recul actuel de 48 mois (24-72), il n’a été<br />
retrouvé, dans <strong>les</strong> trois cas, ni récidive locale ni extension à distance.<br />
Le résultat fonctionnel est jugé très satisfaisant dans deux<br />
cas et satisfaisant dans le dernier.
CONCLUSION. Le traitement <strong>des</strong> synovialosarcomes reste<br />
avant tout chirurgical avec exérèse élargie de la lésion. Le caractère<br />
délabrant à la main de ce type d’exérèse ne doit cependant<br />
pas limiter le geste opératoire. Le traitement adjuvant et <strong>les</strong> possibilités<br />
de reconstruction semblent permettre une chirurgie conservatrice.<br />
* Cyril Lazerges, Service Orthopédie 2<br />
et Chirurgie de la Main, Hôpital Lapeyronie,<br />
avenue du Doyen-Gaston-Giraud, 34295 Montpellier Cedex 5.<br />
177 Sélection d’allogreffes massives<br />
par registration du scanner de<br />
l’hôte et de celui de l’allogreffe :<br />
résultats préliminaires<br />
Pierre-Louis DOCQUIER *, Laurent PAUL,<br />
Olivier CARTIAUX, Xavier BANSE, Olivier CORNU,<br />
Christian DELLOYE<br />
INTRODUCTION. Les allogreffes massives sont uti<strong>les</strong> pour<br />
restaurer le stock osseux en cas de large défect secondaire à un<br />
processus néoplasique, une révision d’arthroplastie ou un traumatisme.<br />
Les allogreffes osseuses offrent un meilleur support<br />
pour <strong>les</strong> réinsertions musculaires si on <strong>les</strong> compare aux implants<br />
métalliques. L’incorporation de l’allogreffe dépend fortement de<br />
facteurs mécaniques, à savoir la stabilité de l’ostéosynthèse et le<br />
contact hôte-allogreffe. Habituellement, la sélection de l’allogreffe<br />
se fait par simple comparaison <strong>des</strong> radiographies de l’allogreffe<br />
avec cel<strong>les</strong> du patient. Des erreurs de concordance<br />
peuvent subsister, susceptib<strong>les</strong> d’entraîner un mauvais contact<br />
allogreffe-hôte avec possibilité de pseudarthrose ou de fracture.<br />
193 La pente tibiale et l’échancrure<br />
intercondylienne dans <strong>les</strong> ruptures<br />
du ligament croisé antérieur : étude<br />
radiologique comparative<br />
Thomas CUCURULO *, Jean-Marie FAYARD,<br />
Mathieu THAUNAT, Pierre CHAMBAT<br />
INTRODUCTION. L’étude anatomique et biomécanique du<br />
genou révèle deux facteurs intrinsèques principaux nuisib<strong>les</strong> au<br />
ligament croisé antérieur (LCA) : l’échancrure intercondylienne<br />
et la pente tibiale osseuse qui favorise la subluxation tibiale antérieure<br />
et s’oppose ainsi à la résistance du ligament croisé antérieur.<br />
Le but de ce travail était d’étudier sur <strong>des</strong> radiographies et<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S115<br />
Séance du 9 novembre matin<br />
GENOU<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Cinq patients en attente d’une<br />
reconstruction par allogreffe massive purent bénéficier de la<br />
méthode : une ado<strong>les</strong>cente de 16 ans avec un volumineux ostéosarcome<br />
de l’hémibassin (touchant <strong>les</strong> zones 1, 2, 3, 4 d’Enneking),<br />
un homme de 23 ans avec un sarcome d’Ewing de l’aile<br />
iliaque, un homme de 31 ans avec un chondrosarcome du condyle<br />
fémoral droit, une femme de 31 ans avec une métastase unique de<br />
phéochromocytome malin dans la région supracotyloïdienne et<br />
enfin un homme de 71 ans avec une échinococcose kystique de<br />
l’aile iliaque gauche. La registration a été utilisée dans ces 5 cas<br />
pour augmenter la concordance entre l’allogreffe et l’hôte. La<br />
registration fut réalisée en créant un programme informatique<br />
adéquat. Toutes <strong>les</strong> allogreffes disponib<strong>les</strong> à la banque d’os furent<br />
scannées. La registration <strong>des</strong> images 3D de l’hôte avec <strong>les</strong> images<br />
3D <strong>des</strong> différentes allogreffes permit de choisir avec beaucoup<br />
plus de précision la meilleure allogreffe.<br />
RÉSULTATS. Dans 4 cas, un excellent matching fut obtenu.<br />
Dans le cinquième cas, aucune allogreffe disponible ne correspondait<br />
parfaitement. La meilleure (la moins discordante) allogreffe<br />
fut donc retenue pour ce cas et la discordance put être<br />
étudiée en préopératoire permettant de prévoir <strong>les</strong> problèmes<br />
rencontrés durant l’intervention. Une bonne ostéosynthèse fut<br />
ainsi aussi obtenue pour ce cas.<br />
DISCUSSION. Le respect d’une concordance la plus parfaite<br />
possible entre l’allogreffe et l’hôte a <strong>des</strong> conséquences directes<br />
sur la stabilité et la consolidation. La stabilité du montage permit<br />
un appui immédiat ou précoce dans tous <strong>les</strong> cas. Dans un cas, la<br />
tête fémorale du patient fut conservée, s’articulant avec une allogreffe<br />
ostéochondrale d’hémipelvis.<br />
CONCLUSION. La registration entre le scanner de l’hôte et<br />
celui de l’allogreffe permet d’augmenter la concordance et par<br />
conséquence la qualité de l’ostéosynthèse et la contact hôteallogreffe.<br />
* Pierre-Louis Docquier, 10, avenue Hippocrate,<br />
1200 Bruxel<strong>les</strong>, Belgique.<br />
IRM de genoux la mesure de la pente tibiale et la largeur de<br />
l’échancrure intercondylienne en fonction de la présence ou non<br />
d’une lésion du ligament croisé antérieur.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Cinquante patients avec une<br />
rupture du LCA (groupe 1) et 50 patients sans lésion du LCA<br />
(groupe 2) ont eu un cliché de profil entier de la jambe permettant<br />
de déterminer l’inclinaison postérieure du plateau tibial<br />
interne (pente tibiale) selon quatre manières différentes en fonction<br />
de l’axe tibial choisi, et une IRM du genou avec coupes<br />
corona<strong>les</strong> permettant de calculer l’indice (taille de l’échancrure/<br />
taille de l’épiphyse fémorale) décrit par Souryal (Notch Width<br />
Index, NWI). Les axes tibiaux sur la radiographie de jambe de<br />
profil strict, tracés pour <strong>les</strong> mesures de la pente tibiale ont été<br />
respectivement l’axe décrit par Bonnin, la corticale antérieure, la<br />
corticale postérieure, et l’axe anatomique du tibia passant entre<br />
le milieu du plateau tibial interne et le milieu de la cheville.
3S116 81 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
RÉSULTATS. Les moyennes de la pente tibiale mesurées<br />
dans le groupe 1 sont de 11,49° selon l’axe de Bonnin, 10,11°<br />
selon l’axe anatomique, 13,36° selon la corticale antérieure et<br />
9,06° selon la corticale postérieure. Les moyennes de la pente<br />
tibiale mesurées dans le groupe 2 sont de 8,73° selon l’axe de<br />
Bonnin, 7,52° selon l’axe anatomique, 11,51° selon la corticale<br />
antérieure et 6,18° selon la corticale postérieure. Ces différences<br />
de valeurs entre <strong>les</strong> deux groupes sont toutes très significatives<br />
(p < 0,01). La moyenne du NWI a été retrouvée à 0,22 dans le<br />
groupe 1 ; elle est de 0,27 dans le groupe 2. La différence <strong>des</strong><br />
moyennes du NWI entre <strong>les</strong> deux groupes est également très<br />
significative (p < 0,01).<br />
DISCUSSION. Ces deux facteurs anatomiques sont étroitement<br />
corrélés à la rupture du ligament croisé antérieur. Ces facteurs<br />
devront donc être pris en compte lors de la réfection du<br />
LCA (échancruroplastie en fonction du NWI) et dans <strong>les</strong> suites<br />
postopératoires (délai d’appui en fonction de la pente tibiale)<br />
afin de limiter <strong>les</strong> risques de rupture itérative du transplant.<br />
* Thomas Cucurulo, Service d’Orthopédie,<br />
Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière, 47-83,<br />
boulevard de l’Hôpital, 75013 Paris.<br />
194 Évaluation objective de la laxité<br />
postérieure : quelle technique ?<br />
Quelle mesure ?<br />
Roger BADET *, Simoné CERCIELLO,<br />
Rodrigo PRADO, Philippe NEYRET<br />
INTRODUCTION. L’évaluation objective de la laxité est<br />
importante dans la prise en charge <strong>des</strong> ruptures du LCP. La plupart<br />
<strong>des</strong> étu<strong>des</strong> publiées soulignent que le degré de laxité postérieure<br />
doit constituer un élément décisionnel prépondérant de<br />
l’indication opératoire et de l’appréciation du résultat postopératoire.<br />
L’expérience que nous avons de ces clichés radiologiques<br />
standardisés montre que la quantification précise de la laxité<br />
postérieure est peu reproductible entre observateurs différents et<br />
pour un même observateur (influence du degré de flexion, de la<br />
rotation ; difficulté <strong>des</strong> repères ...). Nous proposons à travers ce<br />
travail de mieux standardiser la réalisation de ces radiographies<br />
et de leurs mesures.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Huit volontaires sans lésion<br />
ligamentaire ont eu <strong>des</strong> radiographies comparatives <strong>des</strong> 2 genoux<br />
en position de Barlett’s (à genou sur la tubérosité tibiale antérieure).<br />
Cinq métho<strong>des</strong> de mesure différentes du tiroir postérieur<br />
(utilisant <strong>des</strong> points de repères différents sur le tibia et sur le<br />
fémur) ont été testées par 3 observateurs différents (mesure de la<br />
reproductibilité inter observateur) qui ont répété la mesure 3 fois<br />
(reproductibilité intra observateur). Les radiographies ont été faites<br />
à 70°, 90° et 110° afin d’évaluer l’influence de la flexion sur<br />
la mesure radiologique du tiroir postérieur. Les mesures ont<br />
ensuite été faites pour 25 patients présentant une rupture du LCP.<br />
RÉSULTATS. Cette étude montre : que la position de Barlett’s<br />
permet une bonne reproductibilité <strong>des</strong> conditions d’examen<br />
(bon contrôle de la flexion du genou et de la rotation, poussée<br />
par le poids du corps adaptée au morphotype du patient) ; que la<br />
mesure du tiroir postérieur en arrière du genou est celle qui est le<br />
moins sensible aux variations de flexion (moyenne de l’erreur<br />
entre 70 et 110° de flexion : 3,9 mm et écart type de 2,1 mm)<br />
qu’elle permet une bonne reproductibilité intra et inter observateur<br />
en dehors de trouble rotatoire (moyenne entre observateur<br />
de 2,1 mm avec un écart type de 1,4 mm) ; qu’une mesure plus<br />
près du centre du genou est possible en cas de trouble rotatoire<br />
avec une reproductibilité moins bonne (moyenne entre observateur<br />
de 3 mm avec un écart type de 2,5 mm).<br />
DISCUSSION. L’hétérogénéité <strong>des</strong> moyens de quantification<br />
de la laxité postérieure rend compte de la nécessaire harmonisation<br />
<strong>des</strong> étu<strong>des</strong> qui concernent la chirurgie du LCP et du caractère<br />
critique qu’il faut donc apporter aux résultats publiés.<br />
CONCLUSION. La position à genou en appui sur la TTA<br />
semble pouvoir être conseillée comme méthode d’examen. La<br />
mesure en arrière du genou peut être conseillée en l’absence de<br />
trouble rotatoire important (ou une mesure au centre du genou<br />
est préférable). Les progrès futurs de la chirurgie du LCP reposeront<br />
aussi dans l’avenir sur une mesure objective et reproductible<br />
de la laxité postérieure.<br />
* Roger Badet, Clinique Saint-Vincent-de-Paul,<br />
98, rue de la Libération, 38300 Bourgoin-Jallieu.<br />
195 Contusions osseuses et raideur du<br />
genou après chirurgie du ligament<br />
croisé antérieur : étude rétrospective<br />
<strong>des</strong> facteurs prédictifs<br />
Bénédicte QUELARD *, Roger BADET,<br />
Thierry PROST, Pierre CHAMBAT<br />
INTRODUCTION. La chirurgie du ligament croisé antérieur<br />
peut être source de complications postopératoires parmi <strong>les</strong>quel<strong>les</strong><br />
la raideur du genou occupe une place fréquente. Souvent<br />
modérés, <strong>les</strong> déficits de mobilité retentissent sur la récupération<br />
fonctionnelle et peuvent parfois nécessiter un geste secondaire<br />
de mobilisation ou d’arthrolyse. De nombreuses publications<br />
suggèrent qu’une chirurgie précoce favoriserait <strong>des</strong> suites diffici<strong>les</strong><br />
mais, nous avions montré qu’un délai opératoire inférieur ou<br />
égal à 90 jours ne semblait être un facteur de risque que si la rupture<br />
ligamentaire s’était produite en réception de saut. À partir<br />
de ces résultats nous avons pensé que <strong>les</strong> contusions osseuses<br />
(bone bruises) fréquemment associées aux ruptures du LCA<br />
pouvaient rendre plus difficile la rééducation en cas de chirurgie<br />
précoce. L’objectif de ce travail était de chercher une corrélation<br />
entre <strong>les</strong> retards de récupération fonctionnelle et l’existence de<br />
contusions osseuses. Nous avons analysé l’influence que pouvaient<br />
avoir leur(s) localisation(s), leur ancienneté par rapport à<br />
la chirurgie ainsi que le délai opératoire sur la survenue de ces<br />
difficultés de rééducation.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Cette étude rétrospective a colligé<br />
tous <strong>les</strong> patients ayant passé une IRM préopératoire et ayant
énéficié d’une greffe isolée du LCA avec le tiers moyen du tendon<br />
rotulien admis en rééducation dans notre service entre le<br />
1 er janvier 2003 et le 15 mars 2004.<br />
RÉSULTATS. Sur <strong>les</strong> 134 patients inclus dans l’étude, 44 ont<br />
présenté un retard de récupération qui était secondaire à une<br />
algodystrophie dans 86,4 % <strong>des</strong> cas. Les difficultés de récupération<br />
sont corrélées de façon significative à l’existence de contusions<br />
osseuses et plus particulièrement d’une contusion<br />
« récente » (datant de moins de 90 jours) du condyle externe.<br />
Une chirurgie précoce (réalisée moins de 3 mois après la rupture<br />
du LCA) et une contusion du condyle externe sont <strong>des</strong> facteurs<br />
de risque interdépendants.<br />
DISCUSSION. Au terme de ce travail, <strong>les</strong> auteurs suggèrent :<br />
que la contusion « récente » du condyle externe pourrait constituer<br />
un facteur potentiel majeur de raideur postopératoire si la<br />
greffe du croisé antérieur est réalisée dans <strong>les</strong> 3 mois qui suivent<br />
la rupture ; que la contusion osseuse pourrait être le facteur initiateur<br />
de l’algodystrophie post-traumatique en s’appuyant sur<br />
<strong>les</strong> données physiopathologiques actuel<strong>les</strong> de cette affection.<br />
CONCLUSION. Les auteurs souhaitent qu’une étude prospective<br />
soit menée afin de valider ces hypothèses.<br />
* Bénédicte Quelard, Unité Inter,<br />
Centre Interdépartemental d’Hauteville, 01110 Hauteville.<br />
196 Les reprises de ligamentoplastie<br />
du ligament croisé antérieur : analyse<br />
et résultats d’une série rétrospective<br />
de 74 cas<br />
Jean-Char<strong>les</strong> ROLLIER *, Bernard MOYEN,<br />
Jean-Luc LERAT<br />
INTRODUCTION. Nous avons réalisé une étude rétrospective<br />
sur 74 patients opérés d’une reprise de ligamentoplastie du<br />
ligament croisé antérieur afin d’apprécier le résultat fonctionnel<br />
de ce type de chirurgie et de déterminer d’éventuels facteurs pronostiques.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. L’étude a porté sur 74 patients<br />
d’âge moyen 34 ans (21-59). Les transplants utilisés lors de la<br />
première intervention ont été : une allogreffe dans 1 cas, un ligament<br />
synthétique dans 16 cas, une autogreffe dans 57 cas. La<br />
laxité différentielle moyenne mesurée au KT-1000 maxi-manuel<br />
était de 7 ± 2,5 mm. Sur <strong>les</strong> radiographies dynamiques, il existait<br />
au niveau du compartiment médial une laxité différentielle<br />
moyenne de 8 ± 4,7 mm et au niveau du compartiment latéral de<br />
8,3 ± 4,9 mm. Le délai moyen de la reprise chirurgicale a été de<br />
78 mois. L’intervention a été réalisée sous arthroscopie dans<br />
69 cas ; une nouvelle lésion méniscale a été notée dans 24 cas et<br />
35 cas de chondrite ont été rapportés. Le transplant utilisé pour<br />
la reconstruction itérative a toujours été une autogreffe : 42 tendons<br />
rotuliens, 15 tendon quadricipitaux, 13 ischio-jambiers, 1<br />
fascia-lata, 3 tendons rotuliens associés à un tendon quadricipital<br />
(Mac In Jones).<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S117<br />
RÉSULTATS. Les patients ont été revus avec un recul moyen<br />
de 21,2 mois. Ils avaient un score IKDC fonctionnel moyen de<br />
71,7 (21,8 – 100) ; 77 % considéraient leur genou comme normal<br />
ou presque normal et 88 % avaient un Lachman arrêt dur. La<br />
laxité différentielle moyenne du KT-1000 était de 2 ± 1,7 mm au<br />
maxi-manuel. Les radiographies ont montré une laxité différentielle<br />
moyenne de 3,7 ± 2,3 mm en interne et de 6,3 ± 4,3 mm en<br />
externe. L’existence d’une lésion méniscale n’altère pas le résultat<br />
fonctionnel de manière significative mais favorise la survenue<br />
d’une dégradation arthrosique. La présence de lésions chondra<strong>les</strong><br />
altère le résultat fonctionnel de manière significative et semble<br />
également limiter la reprise <strong>des</strong> activités. Enfin, une<br />
intervention initiale réalisée par un ligament synthétique limite<br />
le résultat fonctionnel tout en favorisant ou en aggravant <strong>des</strong><br />
lésions chondra<strong>les</strong>.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. Nos résultats cliniques<br />
sont semblab<strong>les</strong> à ceux publiés dans la littérature. Les reprises de<br />
ligamentoplastie du ligament croisé antérieur ne donnent pas un<br />
résultat fonctionnel aussi bon que lors d’une plastie de première<br />
intention, ce d’autant que la plastie initiale a été réalisée à l’aide<br />
d’un ligament synthétique ou qu’il existe <strong>des</strong> lésions ménisca<strong>les</strong><br />
ou chondra<strong>les</strong>.<br />
* Jean-Char<strong>les</strong> Rollier, Service d’Orthopédie,<br />
Centre Hospitalier Lyon Sud, chemin du Grand-Revoyet,<br />
batiment 3A, 69495 Pierre-Bénite.<br />
197 Les ruptures itératives du ligament<br />
croisé antérieur : analyse <strong>des</strong> suites<br />
de la première intervention<br />
Jean-Marie FAYARD *, Nicolas GRAVELEAU,<br />
Pierre CHAMBAT<br />
INTRODUCTION. Si le traitement chirurgical <strong>des</strong> ruptures<br />
du ligament croisé antérieur permet une reprise sportive au<br />
meilleur niveau, le praticien se trouve confronté à un nombre<br />
important de ruptures itératives. Le but de cette étude était de<br />
préciser <strong>les</strong> causes cliniques et radiologiques de ces échecs.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. La série portait sur 71 patients<br />
(72 genoux), opérés initialement sur une période de 21 ans et<br />
ayant présenté une rupture de la plastie. Différents critères cliniques<br />
(difficulté <strong>des</strong> suites, laxité postopératoire, existence d’une<br />
chirurgie intermédiaire) et radiographiques (pente tibiale et positionnement<br />
<strong>des</strong> tunnels) dans <strong>les</strong> suites de la première intervention<br />
ont été étudiés. Il s’agissait d’une population masculine,<br />
jeune (21,5 ans) et sportive. 88,9 % <strong>des</strong> patients ont bénéficié de<br />
plasties au tendon rotulien lors de la première intervention.<br />
RÉSULTATS. Les échecs sont survenus dans un délai moyen<br />
de 47 mois (3-230 mois). 16,7 % <strong>des</strong> plasties ont rompu avant la<br />
fin de la première année et 72,2 % avant la fin de la troisième<br />
année. Sur le plan clinique : quinze genoux ont présenté <strong>des</strong> suites<br />
diffici<strong>les</strong> avec un déficit d’extension, huit d’entre eux ont été<br />
réopérés pour un conflit antérieur (cyclope) ; quinze genoux<br />
présentaient, à 6 mois postopératoires, une laxité différentielle
3S118 81 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
supérieure ou égale à 3 millimètres, 4 genoux ont été réopérés<br />
pour <strong>des</strong> lésions ménisca<strong>les</strong> secondaires. Sur le plan<br />
radiographique : vingt et un patients avaient une pente tibiale<br />
supérieure ou égale à 12°. Plus de la moitié <strong>des</strong> patients ayant<br />
présenté une troisième rupture faisaient partie de ce groupe.<br />
Quinze genoux présentaient une malposition du tunnel tibial et<br />
sept une malposition du tunnel fémoral. Ainsi, seuls 17 genoux<br />
présentaient un parcours clinique parfait, une pente tibiale inférieure<br />
à 11° et un positionnement idéal <strong>des</strong> tunnels. Six patients<br />
n’évoquaient pas de traumatisme à l’origine de la rupture de la<br />
plastie.<br />
DISCUSSION. Pour 20,9 % <strong>des</strong> genoux, aucune cause à<br />
l’échec n’a été retrouvée. Les suites diffici<strong>les</strong> sont plutôt évocatrices<br />
d’un défaut de « ligamentisation ». La nécessité d’une chirurgie<br />
secondaire pour problème cartilagineux ou méniscal est<br />
évocatrice d’un mauvais contrôle de la laxité. Le mauvais positionnement<br />
<strong>des</strong> tunnels est responsable d’une détente ou de contraintes<br />
excessives sur la greffe. Une pente tibiale importante<br />
semble être un facteur prédisposant à la rupture itérative.<br />
CONCLUSION. L’existence d’une pente tibiale élevée pourrait<br />
faire envisager un geste de correction en cas de rupture itérative.<br />
Un positionnement parfait <strong>des</strong> tunnels est nécessaire au<br />
contrôle de la laxité.<br />
* Jean-Marie Fayard, Clinique Sainte-Anne-Lumière,<br />
85, cours Albert-Thomas, 69003 Lille.<br />
198 Incidence <strong>des</strong> fractures de rotule<br />
après prélèvement pour reconstruction<br />
du ligament croisé antérieur<br />
: comparaison de deux séries<br />
et influence sur le résultat clinique<br />
Julien CHOUTEAU *, Dan LAPTOIU,<br />
Jean-Char<strong>les</strong> ROLLIER, Jean-Luc LERAT,<br />
Bernard MOYEN<br />
INTRODUCTION. La technique de Kenneth-Jones (KJ) est<br />
largement utilisée pour la reconstruction du ligament croisé antérieur.<br />
Nous avons étudié l’incidence <strong>des</strong> fractures de rotule après<br />
prélèvement d’un transplant os-tendon-os avec bloc osseux<br />
patellaire et tibial. Nous avons aussi évalué le retentissement<br />
fonctionnel de cette complication.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Il s’agissait d’une étude rétrospective<br />
comparant deux techniques différentes de prélèvement<br />
du bloc patellaire. La série A comportait 1234 cas successifs sur<br />
14 ans. Dans cette série, la partie distale et centrale de la rotule<br />
était prélevée en utilisant une scie oscillante et un ciseau gouge.<br />
La série B comportait sur la même période 676 cas : 242 KJ et<br />
434 Mac In Jones. Le prélèvement était réalisé de la partie proximale<br />
à distale de la rotule et son détachement se faisait à l’aide<br />
d’une scie à fil. Pour <strong>les</strong> deux séries, le site osseux de prélèvement<br />
était greffé par du tissu spongieux et <strong>les</strong> protoco<strong>les</strong> de rééducation<br />
étaient semblab<strong>les</strong>.<br />
RÉSULTATS. Trois fractures de rotule (0,24 %) ont été observées<br />
dans la série A, aucune dans la série B. Ces trois fractures<br />
étaient toutes transversa<strong>les</strong>. Deux ont fait suite à un traumatisme<br />
indirect (hyperflexion et contraction du quadriceps), la troisième<br />
à un choc direct. Ces fractures sont survenues respectivement à<br />
45, 60 et 330 jours postopératoires. Le traitement a été chirurgical<br />
par haubanage et cerclage au fil métallique. L’évolution a<br />
été favorable mais au prix d’une consolidation lente. Tous <strong>les</strong><br />
patients ont eu une raideur postopératoire avec nécessité<br />
d’arthrolyse à l’ablation du matériel. Un patient a présenté une<br />
arthrite septique et une algodystrophie secondaire. Le recul<br />
moyen post-fracturaire à la révision était de 60 mois. Les scores<br />
fonctionnels étaient décevants : deux B et un C pour l’IKDC et<br />
respectivement de 66, 88 et 90 selon le score de Lysholm. Il<br />
n’existait aucune conséquence sur la stabilité du genou.<br />
CONCLUSION. Le prélèvement d’un bloc patellaire comporte<br />
un risque fracturaire faible et dépendant de la technique de<br />
prélèvement. La technique Mac In Jones prévient le risque de<br />
fracture secondaire par absence de trait transversal. La greffe du<br />
site de prélèvement est recommandée. La fracture de la rotule<br />
après reconstruction du LCA reste une complication importante<br />
en raison <strong>des</strong> conséquences fonctionnel<strong>les</strong> négatives qu’elle<br />
entraîne.<br />
* Julien Chouteau, Service de Chirurgie Orthopédique<br />
et de Traumatologie du Sport, Centre Hospitalier Lyon Sud,<br />
chemin du Grand-Revoyer, 69495 Pierre-Bénite Cedex.<br />
199 Étude rétrospective <strong>des</strong> facteurs de<br />
risque de retard de récupération<br />
après greffe du ligament croisé<br />
antérieur<br />
Bénédicte QUELARD *, Roger BADET,<br />
Thierry PROST, Pierre CHAMBAT<br />
INTRODUCTION. La raideur du genou reste une <strong>des</strong> principa<strong>les</strong><br />
complications de la chirurgie du croisé antérieur. Si <strong>les</strong> formes<br />
sévères (“arthrofibrosis” <strong>des</strong> anglo-saxons) sont devenues<br />
rares, <strong>les</strong> cas de raideur relative, c’est-à-dire de patients présentant<br />
<strong>des</strong> difficultés à récupérer leurs amplitu<strong>des</strong> articulaires malgré<br />
un geste techniquement correct et une rééducation immédiate<br />
bien conduite sont plus fréquents. Dans la littérature, différents<br />
auteurs ont cherché à corréler cette complication à <strong>des</strong> facteurs<br />
de risque avec <strong>des</strong> résultats contradictoires en fonction <strong>des</strong><br />
séries. Les auteurs ont recherché parmi 7 facteurs de risque<br />
potentiels (âge, sexe, niveau de pratique sportive, technique chirurgicale,<br />
existence d’un geste méniscal associé, délai opératoire<br />
et type de sport responsable de la rupture) ceux qui étaient responsab<strong>les</strong><br />
d’un retard de récupération. Ils ont ensuite étudié la<br />
contribution réelle de chacun de ces facteurs dans la survenue<br />
d’une rééducation difficile.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Cette étude rétrospective a colligé<br />
tous <strong>les</strong> patients ayant bénéficié d’une greffe du LCA avec le<br />
tiers moyen du tendon rotulien (associée ou non à un geste
méniscal) et admis en rééducation dans notre service entre le<br />
1 er janvier 1998 et le 31 décembre 2002.<br />
RÉSULTATS. Sur 744 patients inclus dans l’étude, 109 ont<br />
présenté un retard de récupération, lié de façon significative à un<br />
délai opératoire inférieur ou égal à 90 jours et à <strong>des</strong> sports au<br />
cours <strong>des</strong>quels la réception de saut est une composante habituelle<br />
du mécanisme lésionnel du LCA. Ces facteurs sont<br />
interdépendants : la chirurgie précoce n’augmente pas de façon<br />
significative le risque de retard de récupération si la rupture du<br />
croisé antérieur a été occasionnée par un sport au cours duquel<br />
<strong>les</strong> accidents en réception de saut sont rares.<br />
DISCUSSION. Le pronostic lors de la rééducation <strong>des</strong> greffes<br />
du LCA semble être influencé par le mécanisme à l’origine de la<br />
rupture ligamentaire. Le délai opératoire inférieur ou égal à<br />
90 jours n’apparaît être un facteur de risque de raideur que si la<br />
lésion ligamentaire s’est produite au cours d’un sport ayant pour<br />
mécanisme lésionnel habituel une réception de saut. Pour expliquer<br />
cela, <strong>les</strong> auteurs pensent que <strong>les</strong> accidents en réception<br />
engendrent, en plus de la rupture ligamentaire, <strong>des</strong> lésions de<br />
contusions osseuses qui pourraient rendre plus difficile la rééducation<br />
si la chirurgie est trop précoce.<br />
CONCLUSION. La réalisation d’une étude dans laquelle une<br />
IRM préopératoire serait systématique pourrait aider à vérifier<br />
cette hypothèse.<br />
* Bénédicte Quelard, Unité Inter,<br />
Centre Interdépartemental d’Hauteville, 01110 Hauteville.<br />
200 Résultats à court et moyen terme<br />
de la reconstruction du ligament<br />
croisé antérieur par le tendon rotulien<br />
sous arthroscopie : à propos<br />
de 113 cas<br />
Mohamed BÉCHIR KARRAY *, Haykel BEN<br />
AMOR, Soufiène KALLEL, Mounir ZOUARI,<br />
Slaheddine KARRAY, Mongi DOUIK<br />
INTRODUCTION. La reconstruction du ligament croisé<br />
antérieur par autogreffe libre du tendon rotulien sous arthroscopie<br />
est une technique de référence, fiable et reproductible. Notre<br />
travail a pour but d’évaluer <strong>les</strong> résultats à court et moyen terme<br />
de cette technique et d’apprécier <strong>les</strong> différents facteurs pouvant<br />
l’influencer.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Cette série comprend 113 genoux<br />
opérés entre 1996 et 2001. Elle comporte 90 hommes et 23 femmes<br />
âgés en moyenne de 27,3 ans. Avant le traumatisme, 62 % <strong>des</strong><br />
patients étaient <strong>des</strong> sportifs de loisirs et 32 % <strong>des</strong> compétiteurs. Il<br />
y avait 81 % d’accidents sportifs. Le délai accident-chirurgie était<br />
de 27,5 mois. Ces patients ont été revus à un recul moyen de<br />
32 mois afin d’apprécier <strong>les</strong> résultats fonctionnels (critères de<br />
l’IKDC et la classification d’ARPEGE), radiologique, anatomiques<br />
(positionnements <strong>des</strong> tunnels fémoraux et tibiaux) et arthrométrique<br />
(TELOS).<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S119<br />
RÉSULTATS. Seuls 60 % <strong>des</strong> patients ont repris une activité<br />
sportive dans un délai moyen de 11,3 mois. Le score d’ARPEGE<br />
et d’IKDC étaient bons ou excellents dans 84,1 % <strong>des</strong> cas. Le<br />
score IKDC ligamentaire retrouve 88,5 % de bons résultats anatomiques<br />
cliniques.<br />
DISCUSSION. Le résultat fonctionnel global était d’autant<br />
meilleur que la laxité résiduelle est minime, la mobilité est complète,<br />
qu’il n’y avait pas de lésions dégénératives et que le tunnel<br />
fémoral soit bien positionné. Plusieurs facteurs avaient une valeur<br />
prédictive sur la survenue de douleurs antérieures en postopératoire<br />
: le sexe féminin, le genu valgum, une laxité antérieure préopératoire<br />
importante, un faible score de DRF en préopératoire et<br />
<strong>les</strong> lésions dégénératives radiologiques. Les facteurs péjoratifs<br />
sur la reprise <strong>des</strong> activités sportives étaient : un déficit de mobilité,<br />
une laxité résiduelle importante, un tunnel fémoral antérieur,<br />
la présence de lésions dégénératives radiologiques et le sport de<br />
loisir. Les facteurs péjoratifs dans l’apparition d’arthrose étaient<br />
la méniscectomie interne, l’âge tardif à l’intervention et le mauvais<br />
positionnement du tunnel tibial dans le plan frontal.<br />
CONCLUSION. Le forage <strong>des</strong> tunnels fémoraux et tibiaux<br />
doit être extrêmement rigoureux. L’analyse de nos échecs fonctionnels<br />
et anatomiques prouve que le non respect <strong>des</strong> points<br />
d’ancrage physiologiques s’accompagne d’une inefficacité du<br />
transplant par perte de l’isométrie.<br />
* Mohamed Béchir Karray, Service d’Orthopédie B,<br />
Hôpital Cochin, 27, rue du Faubourg-Saint-Jacques,<br />
75679 Paris Cedex 14.<br />
201 Intérêt du Télos dans le suivi <strong>des</strong><br />
reconstructions du ligament croisé<br />
antérieur par le tendon rotulien<br />
sous arthroscopie : à propos de<br />
53 cas<br />
Mohamed BÉCHIR KARRAY *,<br />
Michael OUAKNINE, Haykel BEN AMOR,<br />
Fathi LADAB, Mounir ZOUARI,<br />
Slaheddine KARRAY, Mongi DOUIK<br />
INTRODUCTION. L’évaluation de l’efficacité <strong>des</strong> reconstructions<br />
du ligament croisé antérieur est incontournable. Peu<br />
d’artic<strong>les</strong> dans la littérature montrent la place du Télos dans le<br />
suivi postopératoire. Le but de cette étude était de rechercher<br />
l’intérêt du Télos en postopératoire en analysant <strong>les</strong> facteurs<br />
influençant la laxité résiduelle.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Il s’agit d’une étude rétrospective<br />
de 53 patients sportifs compétiteurs, sportifs de loisir et<br />
actifs suivi entre 1997 et 2001 ayant eu une reconstruction sous<br />
arthroscopie du ligament croisé antérieur par le tendon rotulien<br />
selon la technique de Kenneth-Jones (KJ) Rosenberg modifiée.<br />
Ces patients ont étés convoqués en 2003-2004 en vue d’une évaluation<br />
clinique (scores IKDC et ARPEGE), radiologique (positionnement<br />
<strong>des</strong> tunnels fémoraux et tibiaux selon l’indice<br />
d’Aglietti, Locker-Vielpeau, laxité au Télos) et isocinétique du<br />
quadriceps et <strong>des</strong> ischiojambiers (Biodex).
3S120 81 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
RÉSULTATS. Les Télos absolu ou différentiel n’étaient pas<br />
corrélés au positionnement <strong>des</strong> tunnels fémoraux. En revanche, la<br />
laxité résiduelle évaluée par le test de Lachman était corrélée<br />
aussi bien à l’indice de Locker-Vielpeau (p = 0,005) qu’à l’indice<br />
d’Aglietti (p = 0,02). La laxité résiduelle au Télos n’était pas corrélée<br />
aux échecs anatomiques, à la différence du test de Lachman<br />
(p = 0,0007), du ressaut (p = 0,001) et du rapport <strong>des</strong> performances<br />
isocinétiques. Pour le Télos absolu, avec une valeur seuil de<br />
10 mm en postopératoire (comparativement à 8 mm en préopératoire)<br />
sa sensibilité passe de 97 % en préopératoire à 80 % en postopératoire<br />
et sa spécificité décroît nettement de 81 % à 68 %. De<br />
même pour le Télos différentiel, avec une valeur seuil de 5 mm en<br />
postopératoire (comparativement à 4 mm en préopératoire) sa<br />
sensibilité passe de 100 % à 75 % et sa spécificité serait de 78 %.<br />
DISCUSSION. Compte tenu de ces données, l’évaluation de<br />
la laxité résiduelle par le Télos en postopératoire n’a pas un grand<br />
intérêt dans le suivi et le pronostic. Elle permet néanmoins de<br />
comparer <strong>les</strong> différentes séries et/ou de la laxité en pré et en postopératoire.<br />
Son rôle diagnostique dans <strong>les</strong> lésions du LCA n’est<br />
plus intéressant pour l’évaluation <strong>des</strong> transplants en postopératoire.<br />
Le Télos n’est pas corrélé au résultat anatomique.<br />
CONCLUSION. Le Télos postopératoire a perdu sa valeur<br />
diagnostique requise en préopératoire, sa sensibilité et surtout sa<br />
spécificité dans <strong>les</strong> laxités résiduel<strong>les</strong> en postopératoire.<br />
* Mohamed Béchir Karray, Service d’Orthopédie B,<br />
Hôpital Cochin, 27, rue du Faubourg-Saint-Jacques,<br />
75679 Paris Cedex 14.<br />
202 Résultats d’une technique de ligamentoplastie<br />
de ligament croisé<br />
antéro externe par DIDT pédiculé<br />
au tibia<br />
Minh KHANH NGUYEN *, Christophe GAILLARD,<br />
Jean DELATTE, Ronan JUGLARD,<br />
Christophe MICHAUT, Isabelle AUSSET,<br />
Pierre LE GUILLOUX<br />
INTRODUCTION. Nous rapportons ici <strong>les</strong> résultats d’une<br />
série de ligamentoplasties. La technique utilise un transplant<br />
DIDT de quatre faisceaux laissés sur leur insertion tibiale. La<br />
fixation fémorale est assurée par une vis d’interférence.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Soixante patients ont été opérés<br />
entre mai 2003 et mai 2005. La population comporte 8 femmes<br />
et 52 hommes, d’âge moyen de 28 ans. Ils ont été opérés par<br />
quatre opérateurs différents. L’évaluation clinique et le suivi ont<br />
été réalisés selon la fiche IKDC. Un contrôle par Télos<br />
(150 Newton) a été réalisé à distance. Pour l’évaluation du positionnement<br />
du transplant et du devenir <strong>des</strong> tunnels, <strong>les</strong> patients<br />
ont bénéficié d’un scanner post-opératoire réalisé la première<br />
semaine et à huit mois. Le transplant est prélevé aux dépens du<br />
gracile et du semi tendineux, ils sont laissés pédiculés sur leur<br />
insertion de la patte d’oie. La ligamentoplastie est effectuée sous<br />
arthroscopie. La fixation est uniquement fémorale, elle est assurée<br />
par une vis d’interférence de dedans en dehors.<br />
RÉSULTATS. À un recul moyen de 21 mois, le score final<br />
IKDC est de 93. Le Lachman est inférieur à 5 mm dans 96 %. Le<br />
ressaut rotatoire est absent dans 78 %. Le niveau ligamentaire est<br />
coté A ou B dans 92 %. Le sport a été repris dans 79 % au même<br />
niveau et dans 17 % pour un niveau inférieur. Le Télos postopératoire<br />
à 13 mois montre un différentiel de 2,6 mm. L’étude<br />
scannographique montre un remplissage fémoral et tibial à 95 %,<br />
une absence de ballonisation tibiale, une ballonisation fémorale<br />
inférieure à 2 mm au niveau de l’orifice d’entrée de la vis.<br />
DISCUSSION. La fixation tibiale du transplant semble être le<br />
point faible <strong>des</strong> diverses techniques. Notre plastie est laissée<br />
pédiculée sur son insertion anatomique sans vis d’interférence.<br />
Un test dynamométrique montre une résistance à l’arrachement<br />
de 700 N permettant une bonne tension.<br />
CONCLUSION. Cette étude a permis de montrer <strong>les</strong> bons<br />
résultats cliniques, fonctionnels à la fois subjectifs et objectifs.<br />
L’approche scannographique objective l’absence de ballonisation<br />
tibiale. Cette technique présente donc plusieurs avantages :<br />
la simplicité, la reproductibilité et le faible coût.<br />
* Minh Khanh Nguyen, 305, boulevard Cuneo, 83000 Toulon.<br />
203 Résultats à 21 ans de recul minimum<br />
d’une série de 67 greffes du<br />
LCA<br />
Jérôme PERNIN *, Peter VERDONK, Tarik AIT SI<br />
SELMI, Philippe MASSIN, Philippe NEYRET<br />
INTRODUCTION. Le but de cette étude était de préciser le<br />
résultat à très long terme d’une greffe de LCA de type Kenneth-<br />
Jones associée à une plastie extra-articulaire de Lemaire. Cent<br />
quarante-huit patients ayant été opérés entre 1978 et 1983 avaient<br />
été revus en 1993 et quatre vingt neuf d’entre eux en 1999.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. En 2005, soixante-sept patients<br />
ont pu être revus avec un bilan clinique et radiologique complet.<br />
L’âge moyen à la révision est de 48,2 ans. Le recul moyen de<br />
notre série est de 23,6 ans et le recul minimum de 21 ans. Trente<br />
huit patients avaient subi une méniscectomie pré ou peropératoire<br />
et vingt neuf patients présentaient <strong>des</strong> ménisques sains ou<br />
suturés. Les résultats fonctionnels ont été évalués à l’aide du<br />
score IKDC subjectif et du score KOOS. Des clichés radiologiques<br />
en Lachman passif (Télos) ont été réalisés pour <strong>les</strong> deux<br />
genoux. Le bilan radiologique de l’arthrose comprenait un cliché<br />
en appui monopodal de face et de profil <strong>des</strong> deux genoux et un<br />
cliché en schuss bilatéral. L’analyse statistique sera présentée.<br />
RÉSULTATS. Le score IKDC subjectif moyen de la série est<br />
de 74,5/100. Selon la cotation objective de l’IKDC, nous rapportons<br />
11 % de classe A, 46 % de B, 25 % de C et 18 % de D.<br />
L’analyse <strong>des</strong> radiographies objective 28 % de préarthrose et<br />
32 % d’arthrose. Parmi <strong>les</strong> patients dont <strong>les</strong> ménisques étaient<br />
initialement sains ou suturés (n = 29), nous retrouvons 27 % de<br />
pré-arthrose et 4 % d’arthrose. Parmi <strong>les</strong> patients ayant subi une<br />
méniscectomie (n = 38), nous rapportons 28 % de préarthrose et<br />
53 % d’arthrose.
DISCUSSION. Entre 1999 et 2005, l’évolution arthrosique<br />
est restée stationnaire si <strong>les</strong> ménisques étaient sains ou suturés<br />
(1999 : 3,5 % ; 2005 : 4 %). En revanche, si une méniscectomie<br />
avait été réalisée, <strong>les</strong> cas d’arthrose ont sensiblement augmenté<br />
au fil <strong>des</strong> révisions (1992 : 15 % ; 1999 : 27 % ; 2005 : 32 %).<br />
CONCLUSION. Cette étude confirme l’effet défavorable<br />
d’une méniscectomie quant à la survenue de modifications<br />
radiologiques après reconstruction du ligament croisé antérieur.<br />
* Jérôme Pernin, 200, rue Nungesser-et-Coli,<br />
01000 Saint-Denis-<strong>les</strong>-Bourg.<br />
204 Bilan clinique, radiographique et<br />
histologique d’une vis d’interférence<br />
en matériau ostéoconducteur<br />
(PLLA/ß-TCP) : revue de 30<br />
plasties du LCA à 1 an de recul<br />
minimum<br />
Henri ROBERT *, Jean-François BOCQUET,<br />
Denis CLEMENT, Patrick FRAYSSINET,<br />
Didier MAINARD<br />
INTRODUCTION. L’ancrage intra-tunnellaire <strong>des</strong> plasties du<br />
LCA avec <strong>les</strong> tendons de la patte d’oie est plus lent qu’avec le<br />
tendon rotulien. L’utilisation d’une vis ostéoconductrice peutelle<br />
accélérer l’ostéointégration sans risque de laxité résiduelle ?<br />
Nous avons évalué une vis composite contenant 60 % de ß-TCP<br />
et 40 % de PLLA.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Trente plasties du LCA avec le<br />
droit interne et le demi tendineux en 4 faisceaux ont été réalisées.<br />
Il s’agissait de 25 hommes et 5 femmes d’âge moyen<br />
205 Évolution du taux de titane sérique<br />
à 7 ans de recul moyen après<br />
arthroplastie totale de hanche<br />
Patrick BOYER *, Jean-Yves LAZENNEC,<br />
Joël POUPON, Marc-Antoine ROUSSEAU,<br />
Frédéric LAUDE, Yves CATONNÉ<br />
INTRODUCTION. La libération systémique de titane par <strong>les</strong><br />
tiges fémorale est peu étudiée dans la littérature malgré la grande<br />
utilisation de ces implants. Le but de notre travail prospectif était<br />
d’observer l’évolution du taux sérique de titane après implanta-<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S121<br />
Séance du 9 novembre matin<br />
HANCHE<br />
32 ans (de 15 à 54 ans). La plastie était fixée dans le fémur par<br />
un Rigidfix ® (Mitek) et dans le tibia par une vis Ligafix ® et une<br />
agrafe. Tous <strong>les</strong> patients ont été revus à 3, 6, 9, 12 et 18 mois<br />
postopératoires pour un bilan de laxité au KT-1000 en traction<br />
manuelle maximale et une radiographie de profil comparant la<br />
vis implantée et une vis témoin collée sur la jambe. Pour chaque<br />
radiographie, nous avons mesuré avec Adobe Photoshop 7.0 la<br />
densité de chaque vis en 2 zones centra<strong>les</strong> et celle de son environnement<br />
spongieux en 4 zones, puis calculé la résorption<br />
radiologique en pourcentage. Sur le cliché de profil, l’élargissement<br />
<strong>des</strong> tunnels tibiaux à l’entrée a également été mesuré.<br />
Enfin, 7 biopsies de l’interface vis-tendon-os ont été soumises à<br />
une étude histologique.<br />
RÉSULTATS. Tous <strong>les</strong> patients ont été revus à 1 an de recul<br />
minimum (18 mois en moyenne). Il y a eu une rupture de vis<br />
sans conséquence et aucune fistule aseptique. La laxité moyenne<br />
est passée de 6,5 ± 1,4 mm en préopératoire à 2 ± 2,2 mm en<br />
postopératoire. L’élargissement à l’entrée <strong>des</strong> tunnels tibiaux à<br />
12 mois était de 31 ± 16 % en moyenne. Dès le premier mois, <strong>les</strong><br />
vis commencent à se résorber. À 6, 12 et 12 mois, 63 %, 78 % et<br />
89 % <strong>des</strong> vis sont respectivement résorbées. L’examen histologique<br />
<strong>des</strong> biopsies révèle l’existence d’un ancrage conjonctif<br />
dense entre la vis et le transplant. L’implant est érodé et partiellement<br />
remplacé par un tissu osseux dans lequel sont incluses <strong>des</strong><br />
particu<strong>les</strong> de β-TCP. Il n’y a pas de réaction inflammatoire ni de<br />
membrane d’encapsulation.<br />
DISCUSSION. La présence de fortes teneurs de β-TCP au<br />
sein de la vis composite favorise sa résorption, son remplacement<br />
par de l’os néo formé, en l’absence de réaction inflammatoire.<br />
Aucune vis en PLLA seul ne présente cette évolution<br />
histologique.<br />
CONCLUSION. Les vis PLLA à forte charge en β-TCP accélèrent<br />
l’ancrage <strong>des</strong> plasties sans défaillance à la pose et sans<br />
entraîner de laxité résiduelle anormale.<br />
* Henri Robert, Centre Hospitalier Nord-Mayenne,<br />
boulevard Paul-Lintier, 53100 Mayenne.<br />
tion et de rechercher une corrélation éventuelle avec l’activité<br />
physique <strong>des</strong> patients, <strong>les</strong> enfoncements ou <strong>des</strong>cellements éventuels,<br />
et <strong>les</strong> conflits col-cupule constatés avec <strong>les</strong> inserts acétabulaires.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Quatre-vingt-dix-sept prothèses<br />
tota<strong>les</strong> de hanche cimentées (21 bilatéra<strong>les</strong>) ont été suivies sur<br />
une durée moyenne de 7 ans (5 à 12). Il s’agissait d’un couple<br />
Métasul en tête de 28 mm avec cône morse 12-14. L’âge<br />
moyen lors de l’implantation était 54 ans (30 à 65). La titanémie<br />
était régulièrement dosée (3, 6 mois puis tous <strong>les</strong> ans) par spectrométrie<br />
optique en plasma induit avec une limite de détection<br />
de 30 nmol/L. Chaque prélèvement était systématiquement réalisé<br />
deux fois selon un protocole strict et la valeur moyenne était<br />
retenue. Parallèlement, la fonction rénale était toujours contrôlée<br />
ainsi que <strong>les</strong> taux sériques de cobalt et de chrome liés au couple
3S122 81 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
de friction. L’activité physique était évaluée sur l’heure et la<br />
semaine précédant le prélèvement.<br />
RÉSULTATS. La titanémie <strong>des</strong> arthroplasties unilatéra<strong>les</strong><br />
était en moyenne sous la limite de détection jusqu’au recul<br />
moyen de 7 ans. Dans <strong>les</strong> cas d’arthroplastie bilatérale, le taux<br />
était également stable mais significativement plus élevé. La titanémie<br />
n’était pas corrélée à l’activité précédant le prélèvement.<br />
Aucune différence n’est apparue entre <strong>les</strong> tail<strong>les</strong> <strong>des</strong> tiges. Des<br />
déviations significatives <strong>des</strong> taux ont été observés pour quelques<br />
cas de conflit et de migration fémorale. Aucune relation n’a pu<br />
être établie avec une lésion du cône fémoral dans <strong>les</strong> cas explantés<br />
pour un dysfonctionnement du couple Métasul. Dans <strong>les</strong><br />
reprises pour conflit la réduction du taux de titane sérique était<br />
plus lente que la normalisation <strong>des</strong> taux de cobalt et de chrome.<br />
DISCUSSION. Ces dosages sériques montrent le faible<br />
niveau de relargage du titane après arthroplastie de hanche, confirmant<br />
sur le plan biologique la bonne tolérance <strong>des</strong> tiges fémora<strong>les</strong><br />
titane lisse cimentées. Nous soulignons le rôle de la couche<br />
protectrice de passivation qui limite la corrosion et la faillite<br />
mécanique de l’implant. L’interprétation <strong>des</strong> taux en cas de prothèses<br />
bilatéra<strong>les</strong> reste difficile.<br />
CONCLUSION. Le taux de titane sérique peut être un marqueur<br />
de l’évolution du scellement et de certains dysfonctionnements<br />
articulaires. Un plus grand recul est nécessaire pour<br />
confirmer ces résultats.<br />
* Patrick Boyer, Hôpital Bichat, 46, rue Henri-Huchard,<br />
75877 Paris Cedex 18.<br />
206 Résultats <strong>des</strong> taux d’ions chrome<br />
et cobalt sanguins consécutifs à<br />
l`implantation d`un remplacement<br />
total de hanche (couple métalmétal<br />
de 28 mm de diamètre) et<br />
d’un resurfaçage métal-métal : une<br />
étude randomisée<br />
Julien GIRARD *, Pascal-André VENDITTOLI,<br />
Martin LAVIGNE, Sophie MOTTARD, Alain ROY<br />
INTRODUCTION. Les étu<strong>des</strong> tribologiques suggèrent que<br />
<strong>les</strong> articulations de type métal-métal de grand diamètre favoriseraient<br />
la lubrification par film liquide, engendrant ainsi une très<br />
faible usure. L’objectif de cette étude était de comparer <strong>les</strong> taux<br />
sanguins <strong>des</strong> ions chrome et cobalt consécutifs à l’implantation<br />
d’une prothèse totale (PTH) avec surface articulaire métal-métal<br />
de 28 mm de diamètre ou d’un resurfaçage avec surface métalmétal.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Deux cent sujets ont été randomisés<br />
pour recevoir soit une PTH en titane non cimentée avec<br />
articulation métal-métal de 28 mm de diamètre, soit une prothèse<br />
hybride de resurfaçage métal-métal. Les surfaces articulaires utilisées<br />
dans <strong>les</strong> deux groupes étaient composées d’un alliage de<br />
chrome-cobalt-molbydène forgé à haute teneur en carbone (0,2).<br />
Des échantillons de sang et de sérum ont été prélevés en préopératoire<br />
ainsi qu`en postopératoire immédiat et au recul de 3, 6,<br />
12 et 24 mois postopératoires. Les taux de chrome et cobalt ont<br />
été mesurés par deux laboratoires indépendants qui utilisaient un<br />
spectrophotomètre de masse.<br />
RÉSULTATS. Au recul de 2 ans, dans le groupe resurfaçage,<br />
le taux <strong>des</strong> ions chrome et cobalt était respectivement de<br />
1,37 µmol/L (SD 0,54, min 0,7, max 2,4) et de 0,62 µmol/L<br />
(SD 0,23, min 0,31, max 0,92). Dans le groupe PTH, le taux de<br />
chrome était de 1,33 µmol/L (SD 0,36, min 0,8, max 1,6) et le<br />
taux de cobalt de 0,93 µmol/L (SD 0,71, min 0,27, max 1,77). Il<br />
n’y avait pas de différence significative entre <strong>les</strong> 2 groupes (pour<br />
le chrome p = 0,882 et pour le cobalt p = 0,213). En comparaison<br />
aux taux préopératoire, une augmentation significative était<br />
notée tant pour le chrome que le cobalt et ceci dans <strong>les</strong> deux<br />
groupes (chrome 1,3x et cobalt 5,0x dans le groupe resurfaçage ;<br />
chrome 1,3x, cobalt 5,9x dans le groupe PTH).<br />
DISCUSSION. Les taux de chrome et de cobalt de cette étude<br />
sont comparab<strong>les</strong> aux meilleurs résultats publiés avec <strong>des</strong> articulations<br />
métal-métal de 28 mm de diamètre. Toutefois, la cobaltémie<br />
était plus basse dans le groupe resurfaçage que dans le<br />
groupe PTH. Les résultats de cette étude confirment <strong>les</strong> concepts<br />
théoriques tribologiques ainsi que <strong>les</strong> excellentes propriétés <strong>des</strong><br />
articulations métal-métal de grand diamètre.<br />
* Julien Girard, Service d`Orthopédie C, CHRU Lille,<br />
Hôpital Roger-Salengro, 59037 Lille Cedex.<br />
207 Avantages et inconvénients de<br />
l’arthroplastie de resurfaçage<br />
métal-métal : analyse à court<br />
terme d’une série continue de<br />
117 cas<br />
Andrei FIRICA *, Mihai MAGUREAN,<br />
Dan LAPTOIU<br />
INTRODUCTION. Les échecs à court terme de l’arthroplastie<br />
totale de resurfaçage métal-métal dans la littérature ont été<br />
liés aux caractéristiques spécifiques du fémur proximal et de la<br />
technique chirurgicale.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Cent dix-sept hanches consécutives<br />
ont été traitées avec resurfaçage métal sur métal (11 cas<br />
bilatéraux) par le même chirurgien. Toutes <strong>les</strong> arthroplasties ont<br />
été réalisées par voie postérieure large avec <strong>des</strong> implants hybri<strong>des</strong><br />
type Birmingham Hip Resurfacing. Cinquante et un cas<br />
(43,5 %) ont été <strong>des</strong> nécroses avasculaires, 4 hanches dysplasiques,<br />
5 séquel<strong>les</strong> post-traumatiques (un cas fracture acétabulaire<br />
récente). L’âge au moment de l’intervention était entre 17 et<br />
72 ans (moyenne 41 ans). Le recul moyen était de 3 ans (début<br />
étude 2001).<br />
RÉSULTATS. Nous avons employé le système d’évaluation<br />
radiographique proposé par Schmalzried pour évaluer quatre
caractéristiques du fémur proximal : la densité osseuse, la forme,<br />
la biomécanique, et <strong>les</strong> défauts osseux. Des 117 hanches suivies<br />
à un minimum de 1 an, 75 % étaient <strong>les</strong> catégories A ou B, 25 %<br />
étaient la catégorie C, et aucune n’était de type D ou F. Les complications<br />
spécifiques notées ont été : deux paralysies nerf sciatique<br />
poplité, un cas de subluxation récidivante (ayant abouti à la<br />
seule reprise de la série) et deux cas de subluxations passagères<br />
(transitoires, dans la période postopératoire immediate). Au plus<br />
long recul, 95 hanches avaient un résultat fonctionnel excellent<br />
ou très bon selon le score de Oswestry.<br />
DISCUSSION. Des critères de sélection relativement stricts<br />
pour resurfaçage ont été associés à une faible fréquence <strong>des</strong><br />
échecs à court terme même avec la courbe d’apprentissage ou<br />
dans <strong>les</strong> cas de necrose avasculaire. Nous avons rencontré <strong>des</strong><br />
difficultés liées au geste chirurgical : planning difficile du aux<br />
contraintes de <strong>des</strong>ign (seulement deux dimensions acétabulaires<br />
pour chaque fémur), positionnement moins parfait (insertion<br />
incomplète de la cupule, anté- ou rétroversion fémorale), raccourcissement<br />
et offset modifié qui ont conduit aux subluxations<br />
notées. La réalisation d’une arthroplastie de resurfaçage a été<br />
techniquement plus difficile mais, finalement, responsable d’un<br />
résultat fonctionnel supérieur à celui d’arthroplasties habituel<strong>les</strong>.<br />
CONCLUSION. Concernant <strong>les</strong> complications et <strong>les</strong> résultats<br />
cliniques à court terme, nous n’avons mis en évidence aucune<br />
particularité, le resurfaçage peut être considéré comme un<br />
implant fiable pour <strong>les</strong> patients actifs et jeunes.<br />
* Andrei Firica, 57, rue Dionisie-Lupu, code 010458,<br />
Bucarest, Roumanie.<br />
208 Arthroplastie partielle de resurfaçage<br />
dans <strong>les</strong> nécroses avasculaires<br />
de la tête fémorale : métho<strong>des</strong>,<br />
indications et résultats<br />
Thierry SIGUIER *, Marc SIGUIER,<br />
Jean-Luc MARMORAT, Bertrand BRUMPT,<br />
Thierry JUDET<br />
INTRODUCTION. Cette étude rapporte <strong>les</strong> résultats, avec un<br />
recul minimum de 5 ans, du remplacement partiel par arthroplastie<br />
de resurfaçage dans <strong>les</strong> nécroses avasculaires de la tête fémorale.<br />
Deux étu<strong>des</strong> préliminaires publiées en 1999 (J Arthrop) et<br />
2001 (Clin Orthop) avaient montré <strong>des</strong> résultats satisfaisants et<br />
encouragants et concluaient à la nécessité d’un recul plus important<br />
pour juger de la tolérance du cartilage coxal à plus long<br />
terme face à l’implant de resurfaçage céphalique.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Soixante et une prothèses de<br />
resurfacage partiel ont été implantées chez 54 patients (45 hommes<br />
et 9 femmes) pendant 10 ans de 1991 à 2000. L’âge moyen<br />
<strong>des</strong> patients était de 42 ans (24-59 ans). Selon la classification de<br />
Ficat, on retrouvait 42 sta<strong>des</strong> III, 18 sta<strong>des</strong> IV et 1 stade II. Nous<br />
déplorons 2 décès (3 hanches) et 3 perdus de vue (4 hanches).<br />
L’ensemble de la série a été suivi cliniquement selon la cotation<br />
de Merle d’Aubigné et radiologiquement jusqu’en 2005. Le cri-<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S123<br />
tère d’échec était défini par la dépose de l’implant et son remplacement<br />
par une arthroplastie totale de hanche.<br />
RÉSULTATS. Le recul moyen de la série est de 7 ans<br />
(5-14 ans). Les échecs éytaient au nombre de 31. Ils sont à rapporter<br />
à <strong>des</strong> indication dépassées, à d’éventuel<strong>les</strong> malpositions<br />
diffici<strong>les</strong> à apprécier, mais surtout à l’évolution vers l’arthrose.<br />
Parmi <strong>les</strong> 25 implants toujours en place, 21 ont une bonne fonction<br />
et ces patients, selon la cotation de Merle d’Aubigné, ont un<br />
score bon ou excellent. Les douleurs, selon cette cotation, sont<br />
passées de 2,1 en préopératoire à 5,1 en postopératoire et la cotation<br />
globale <strong>des</strong> patients de 12 à 16,6. La survie de cet implant à<br />
10 ans est de 50 % (IC ± 7,5) et à 14 ans de 46,5 % (IC ± 9,8).<br />
DISCUSSION. La technique chirurgicale, le type de l’implant<br />
et l’instrumentation entraînent <strong>des</strong> dégâts mineurs sur <strong>les</strong> parties<br />
mol<strong>les</strong> et sans consommation de tissu osseux. Si <strong>les</strong> survivants<br />
ont <strong>des</strong> résultats satisfaisants, le taux de survie inférieur à 50 % à<br />
10 ans n’est pas suffisant même si la reprise par prothèse totale<br />
de hanche reste simple. En conséquence, s’appuyant sur cette<br />
étude, nous ne recommandons pas l’utilisation de cet implant ou<br />
de tout autre dispositif analogue.<br />
* Thierry Siguier, Clinique Jouvenet,<br />
6, square Jouvenet, 75016 Paris.<br />
209 Survie de la pièce fémorale<br />
Kerboull ® MKIII à 15 ans de recul<br />
Moussa HAMADOUCHE *, Firas EL MASRI,<br />
Nicolas LEFEVRE, Luc KERBOULL,<br />
Marcel KERBOULL, Jean-Pierre COURPIED<br />
INTRODUCTION. Le but de cette étude prospective était<br />
d’évaluer <strong>les</strong> résultats d’une série continue d’arthroplasties tota<strong>les</strong><br />
de hanche utilisant une pièce fémorale cimentée polie<br />
brillante de 10 à 18 ans de recul.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. La série comportait 164 arthroplasties<br />
tota<strong>les</strong> réalisées chez 155 patients (92 femmes, 63 hommes),<br />
âgés en moyenne de 63,7 ans. La coxopathie initiale était<br />
une coxarthrose primitive dans 65 % <strong>des</strong> cas. Une pièce fémorale<br />
Kerboull ® MKIII a été utilisée dans tous <strong>les</strong> cas. Il s’agit<br />
d’une pièce en acier inoxydable 316L, à section quadrangulaire<br />
régulièrement décroissante, et avec une surface hautement polie<br />
(Ra 0,04 microns). Le mode de préparation du fémur comportait<br />
un alésage du canal médullaire de façon à se débarrasser du<br />
spongieux diaphysaire afin d’obtenir une tenue primaire de la<br />
pièce fémorale avant la fixation cimentée. L’évaluation <strong>des</strong> résultats<br />
cliniques a été réalisée selon la cotation de Merle d’Aubigné.<br />
L’évaluation radiologique de la migration <strong>des</strong> implants a été réalisée<br />
à l’aide <strong>des</strong> repères classiques sur <strong>des</strong> radiographies du bassin<br />
de face. Enfin une analyse de survie a été effectuée selon la<br />
méthode actuarielle.<br />
RÉSULTATS. Lors de l’évaluation, 101 patients (106 hanches)<br />
étaient toujours vivants et n’avaient pas subi de reprise à<br />
13,5 ± 2,4 ans de recul (10 à 18 ans), 6 patients (6 hanches) avaient<br />
été repris (5 reprises bipolaires, 1 reprise acétabulaire), 33 patients
3S124 81 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
(35 hanches) étaient décédés, et 15 patients (17 hanches) étaient<br />
perdus de vue. Ces 52 dernières hanches n’étaient pas <strong>des</strong>cellées<br />
au dernier recul. Parmi <strong>les</strong> 5 reprises bipolaires, la pièce fémorale<br />
était <strong>des</strong>cellée 3 fois. Les 3 cas de <strong>des</strong>cellement fémoral étaient tardifs<br />
(13,3 ± 2,4 ans) et s’accompagnaient d’une usure importante<br />
du polyéthylène. Le score fonctionnel moyen était de 17,1 au dernier<br />
recul. Le taux de survie cumulée de la pièce fémorale, en définissant<br />
l’échec comme la reprise, était de 97,3 ± 1,9 % à 15 ans<br />
(intervalle de confiance à 95 % compris entre 93,7 et 100 %). Le<br />
taux de survie cumulée de la pièce fémorale, en définissant l’échec<br />
comme le <strong>des</strong>cellement, était de 98,6 ± 1,4 % à 15 ans (intervalle<br />
de confiance à 95 % compris entre 96,0 et 100 %).<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. Les résultats de cette série<br />
indiquent clairement que la fixation cimentée d’une pièce fémorale<br />
polie brillante à section quadrangulaire remplissant le canal<br />
médullaire est extrêmement fiable à long terme, contrairement aux<br />
données de la littérature anglo-saxonne.<br />
* Moussa Hamadouche,<br />
Service A de Chirurgie Orthopédique, Hôpital Cochin,<br />
27, rue du Faubourg-Saint-Jacques,<br />
75014 Paris.<br />
210 Reprise <strong>des</strong> tiges fémora<strong>les</strong> scellées<br />
par <strong>des</strong> tiges courtes et sans<br />
ciment dans l’arthroplastie totale<br />
de hanche : étude rétrospective de<br />
53 cas<br />
Julien CHOUTEAU *, Bruno BALAŸ,<br />
Bernard MOYEN, Jean-Luc LERAT<br />
INTRODUCTION. L’ablation de tiges cimentées, puis<br />
l’ancrage de nouveaux implants fémoraux, sont souvent diffici<strong>les</strong>.<br />
L’os est fragilisé par l’ostéolyse corticale, <strong>les</strong> granulomes et<br />
par l’extraction du ciment. L’utilisation d’implants non cimentés<br />
constitue une solution pour la régénération du capital osseux.<br />
Depuis plus de 15 ans, tous nos remplacements ont été faits avec<br />
<strong>des</strong> tiges non cimentées, soit par <strong>des</strong> tiges longues, rarement, ou<br />
parfois de taille intermédiaire, soit par <strong>des</strong> tiges courtes chaque<br />
fois que cela était possible. Nous rapportons <strong>les</strong> résultats de ces<br />
tiges courtes dans une option qui constitue ce que l’on qualifie<br />
de plus en plus du terme de « désescalade », justifié par un<br />
implant peu invasif et la suppression du ciment.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. La série comportait 53 hanches<br />
<strong>des</strong>cellées après 12,2 ans (2,4-31,5) chez 51 patients âgés de<br />
65,1 ans (40-83). Le <strong>des</strong>cellement du pivot était complet dans<br />
80,9 % <strong>des</strong> cas et le changement avait été bipolaire dans 88,5 %<br />
<strong>des</strong> cas. Les altérations du fémur étaient <strong>des</strong> sta<strong>des</strong> 2 et 3<br />
(SOFCOT). Le ciment a été extrait par en haut, sauf pour 11 cas<br />
ayant eu un volet fémoral (20,8 %). L’implant utilisé était une<br />
tige plate recouverte d’hydroxy-apatite <strong>des</strong>tinée aux arthroplasties<br />
primaires. 70,5 % <strong>des</strong> cas ont eu une greffe osseuse, majoritairement<br />
métaphysaire. L’évaluation a utilisé <strong>les</strong> scores de<br />
Harris et de Postel-Merle d’Aubigné. Avec <strong>des</strong> radiographies<br />
analysées avec un protocole informatisé, nous avons mesuré<br />
l’enfoncement et l’index cortical.<br />
RÉSULTATS. La durée opératoire a été de 187 minutes<br />
(75-320), la perte sanguine moyenne de 906 ml (80-4000). Deux<br />
fractures sur volet, une précoce et l’autre traumatique après<br />
6 mois, ont guéri après une ostéosynthèse. Nous avons noté une<br />
fissure du calcar et 2 fractures du trochanter (3,8 %). L’appui a<br />
été repris en moyenne à 45 jours. Nous avons déploré 2 infections<br />
: l’une survenue à moins d’un an, non réimplantée (lymphome<br />
terminal) et l’autre après 6 ans avec changement en<br />
2 temps sans récidive. Au recul moyen de 59 mois (12-180),<br />
aucun patient n’a été perdu de vue mais 3 étaient décédés. Le<br />
score moyen de Merle d’Aubigné était de 15,7, celui de Harris<br />
de 87,6. L’enfoncement de la tige a été en moyenne de 1,5 mm<br />
(0-31,7) (> 10 mm 2 fois). La reconstruction osseuse a été constante,<br />
<strong>les</strong> index corticaux ont surtout progressé en métaphyse.<br />
CONCLUSION. La reprise d’une tige scellée par une tige<br />
courte sans ciment recouverte d’hydroxy-apatite est une chirurgie<br />
fiable et reproductible. Elle permet la reconstitution du capital<br />
osseux.<br />
* Julien Chouteau, Centre Hospitalier Lyon-Sud,<br />
69495 Pierre-Bénite.<br />
211 Désescalade après fémorotomie<br />
dans <strong>les</strong> reprises de prothèse<br />
totale de hanche : à propos de<br />
8cas<br />
Louis-Etienne GAYET *, Benjamin GUENOUN,<br />
Laurent LATARGEZ, Nicolas LECLERCQ,<br />
Morgan FRESLON, Rémi PREBET<br />
INTRODUCTION. La voie trans-fémorale, initiée par<br />
Wagner et bien codifiée par Pierre Vives et Char<strong>les</strong> Picault, est<br />
une manière efficace de résoudre le difficile problème <strong>des</strong> reprises<br />
de prothèses tota<strong>les</strong> de hanche (PTH). Initialement, la technique<br />
prévoyait, après la reconstruction osseuse obtenue autour de<br />
la tige de reprise, une désescalade vers une tige standard avec ou<br />
sans ciment mais, de l’aveu même <strong>des</strong> auteurs, cette nouvelle<br />
intervention semble inutile dans la très grande majorité <strong>des</strong> cas.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Depuis 7 ans dans le service,<br />
nous pratiquons cette technique dans <strong>les</strong> reprises de PTH dans<br />
<strong>les</strong> sta<strong>des</strong> II, III et IV (symposium de la SOFCOT de 1989) de<br />
<strong>des</strong>cellement. Deux cent cinquante-neuf cas de reprise de PTH<br />
ont été traités suivant la technique de la voie trans-fémorale.<br />
Devant <strong>les</strong> bons résultats de cette technique de reprise, la désescalade<br />
est devenue l’exception. Parmi nos 259 reprises par fémorotomie,<br />
nous avons l’expérience de 8 désescala<strong>des</strong> soit 3 % <strong>des</strong><br />
cas. La moyenne d’âge de ces patients au moment de la désescalade<br />
était de 54,3 ans. Il s’agissait en moyenne, de la 4 e intervention<br />
(3-7) sur la même hanche. La désescalade survenait en<br />
moyenne 2 ans après la mise en place de la prothèse de reprise.<br />
Dans 2 cas, devant <strong>des</strong> douleurs et un épaississement cortical au<br />
niveau <strong>des</strong> vis, un déverrouillage distal préalable a été fait sans
succès. En plus <strong>des</strong> douleurs, nous avons retrouvé 5 <strong>des</strong>cellements<br />
aseptiques et 3 fractures de tige. Dans tous <strong>les</strong> cas, la<br />
fémorotomie était parfaitement consolidée.<br />
RÉSULTATS. L’extraction de la prothèse de reprise n’a pas<br />
posé de problème particulier. Dans 5 cas, nous avons mis un<br />
implant sans ciment et dans 3 cas, nous l’avons cimenté. Le recul<br />
moyen de la mise en place de l’implant définitif est de 2 ans<br />
(1-5 ans). Aucune complication notable (sepsis, luxation) n’est<br />
retrouvée à ce jour.<br />
CONCLUSION. Dans ces 8 cas, une désescalade est incontestablement<br />
obtenue, avec une reconstruction efficace du stock<br />
osseux. Même si la désescalade, reste l’exception dans <strong>les</strong> prothèses<br />
verrouillées après fémorotomie, elle montre bien qu’un<br />
retour en arrière avec une tige standard est à nouveau réalisable<br />
et peut être efficace quelle que soit la perte de capital osseux<br />
initial.<br />
* Louis-Etienne Gayet, CHU de Poitiers,<br />
2, rue de la Milétrie, 86021 Poitiers.<br />
212 Pose <strong>des</strong> tiges fémora<strong>les</strong> sans<br />
ciment à l’aide du pivert lors <strong>des</strong><br />
PTH<br />
Grégory MOINEAU *, Frédéric DUBRANA,<br />
Romain GÉRARD, Julien RICHOU,<br />
Christian LEFÈVRE<br />
INTRODUCTION. Pour diminuer l’incidence <strong>des</strong> complications<br />
fracturaires lors de la réalisation de PTH, nous utilisons le<br />
woodpecker ou pivert du laboratoire IMT ® . Notre étude avait<br />
pour but d’évaluer l’incidence de ces complications et le positionnement<br />
de l’implant fémoral avec l’utilisation d’un tel matériel.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Le pivert est un moteur pneumatique<br />
à percussion exerçant <strong>des</strong> mouvements axiaux de<br />
10 mm d’amplitude à une fréquence de 70 Hz. Il est utilisé lors<br />
<strong>des</strong> PTH de première intention, uniquement pour la préparation<br />
fémorale à l’aide <strong>des</strong> râpes. Notre étude prospective comporte<br />
une série continue de 154 arthroplasties tota<strong>les</strong> de hanche non<br />
cimentées. La répartition <strong>des</strong> interventions réalisées avec ou sans<br />
pivert n’est pas randomisée mais faite en fonction de la disponibilité<br />
du matériel. En peropératoire, toute fracture fémorale ou<br />
refend au niveau du Merckel étaient signalés. Sur la radiographie<br />
de bassin réalisée à 3 mois postopératoires était calculée la varisation<br />
de l’implant fémoral. Ces mesures étaient effectuées par<br />
un observateur indépendant sans avoir connaissance de l’utilisation<br />
du pivert. Une tige fémorale était considérée comme varisée<br />
à partir de 5°. Le service de biostatistiques réalisait l’étude statistique.<br />
RÉSULTATS. Sur ces 154 PTH, 148 dossiers ont été étudiés.<br />
Six dossiers radiologiques de mauvaise qualité étaient exclus.<br />
Soixante-seize PTH étaient réalisées sans pivert et 72 avec. Pour<br />
la série sans pivert, nous retrouvons 11 implants fémoraux varisés<br />
et 3 refends fémoraux. Pour la série pivert, nous retrouvons<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S125<br />
3 implants varisés et aucun refend. Aucune différence statistiquement<br />
significative n’est retrouvée : p = 0,089 pour l’étude du<br />
varus fémoral et p = 0,245 pour celle <strong>des</strong> fractures.<br />
DISCUSSION. Pour éviter le biais de la courbe d’apprentissage,<br />
sont uniquement inclus <strong>les</strong> PTH réalisées par <strong>les</strong> 2 opérateurs<br />
<strong>les</strong> plus expérimentés. Les fractures peropératoires sont<br />
dans notre série rare (1,5 %) comme dans la littérature. Cependant,<br />
nous ne pouvons affirmer que l’utilisation du pivert permet<br />
d’en diminuer l’incidence. Malgré tout, aucune complication<br />
fracturaire n’est signalée avec le pivert. L’implantation en varus<br />
d’une tige fémorale sans ciment ne semble pas source de complications<br />
contrairement aux implants cimentés. La règle de précaution<br />
nous fait cependant préférer une pose la plus<br />
reproductible sans varus. Le pivert semble nous le permettre.<br />
CONCLUSION. Le pivert semble, diminuer l’incidence <strong>des</strong><br />
complications fracturaires per-opératoires et permettre un<br />
meilleur positionnement de l’implant fémoral lors de l’implantation<br />
de la PTH. L’étude est actuellement poursuivie afin de mettre<br />
en évidence un bénéfice significatif.<br />
* Grégory Moineau, Service d’Orthopédie-Traumatologie,<br />
CHU la Cavale-Blanche, boulevard Tanguy-Prigent,<br />
29200 Brest.<br />
213 Extraction d’une tige à revêtement<br />
HA total, non <strong>des</strong>cellée : technique<br />
opératoire, complications et résultats.<br />
À propos de 17 cas<br />
Jean-Pierre VIDALAIN *, Alain MACHENAUD<br />
INTRODUCTION. Bien qu’il s’agisse d’une éventualité rare,<br />
l’extraction d’une tige fémorale à revêtement HA total, parfaitement<br />
ostéointégrée, demeure la hantise du chirurgien orthopédiste.<br />
Le développement d’un ancillaire adapté et d’une stratégie<br />
chirurgicale codifiée ont permis de réduire très sensiblement <strong>les</strong><br />
aléas chirurgicaux et le risque de complications iatrogènes.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Au cours <strong>des</strong> 2 dernières<br />
années nous avons été amenés à changer 17 tiges à revêtement<br />
HA total, non <strong>des</strong>cellées, pour une défaillance mécanique du<br />
segment extra-médullaire. La durée d’implantation était comprise<br />
entre 11 et 24 mois. Tous <strong>les</strong> patients avaient un score PMA<br />
à 18 avant la défaillance accidentelle de la prothèse, le capital<br />
osseux était normal, <strong>les</strong> tiges prothétiques stab<strong>les</strong> parfaitement<br />
ostéointégrées. Deux groupes peuvent être identifiés : un premier<br />
(7 patients), où l’intervention a été réalisée sans instrumentation<br />
spécifique, et où un abord extensif transfémoral a été<br />
privilégié. Un deuxième (10 patients) où un matériel ancillaire<br />
adapté a permis d’extraire la tige « par le haut » dans tous <strong>les</strong> cas<br />
(réalisation d’une courte fenêtre dans 4 cas). Dans tous <strong>les</strong> cas,<br />
un nouvel implant à revêtement HA total a été mis en place. Le<br />
taux de complication, la durée de conva<strong>les</strong>cence, la récupération<br />
fonctionnelle (score PMA) et l’intégration radiologique ont été<br />
comparés dans chaque groupe.<br />
RÉSULTATS. À terme (conva<strong>les</strong>cence variant de 3 à<br />
10 mois), tous <strong>les</strong> patients ont récupéré un score fonction identi-
3S126 81 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
que à celui obtenu avant l’accident (18) et, sur le plan radiologique,<br />
le nouvel implant s’est parfaitement intégré dans un site<br />
osseux qui a retrouvé une trophicité normale. Cependant, la<br />
durée opératoire, le temps de mise en décharge, la longueur de la<br />
conva<strong>les</strong>cence, le taux de complications (3 luxations, 2 fractures,<br />
1 enfoncement, 2 réinterventions), sont très significativement<br />
supérieurs dans le premier groupe, soulignant ainsi <strong>les</strong> risques de<br />
l’abord transfémoral étendu. Dans la deuxième série, <strong>les</strong> suites<br />
chirurgica<strong>les</strong> n’ont pas été différentes de cel<strong>les</strong> de la chirurgie<br />
primaire.<br />
DISCUSSION. Les publications concernant <strong>les</strong> difficultés<br />
d’extraction d’implants à revêtement HA extensif sont rares,<br />
même si le problème est bien connu. Mis à part <strong>les</strong> notes de technique<br />
concernant l’ostéotomie fémorale étendue, encore plus<br />
rares sont <strong>les</strong> artic<strong>les</strong> proposant une stratégie basée sur un ancillaire<br />
spécifique.<br />
CONCLUSION. Cette technique simple permet de réduire la<br />
complexité <strong>des</strong> reprises de tiges totalement ostéointégrées et non<br />
<strong>des</strong>cellées et d’envisager régulièrement <strong>des</strong> suites opératoires et<br />
<strong>des</strong> résultats similaires à ceux d’une primo implantation.<br />
* Jean-Pierre Vidalain, Clinique du Lac,<br />
22, rue André-Theuriet, 74000 Annecy.<br />
214 Reconstruction fémorale après<br />
fémorotomie : à propos d’une série<br />
rétrospective de 80 reprises fémora<strong>les</strong><br />
de prothèses tota<strong>les</strong> de hanche<br />
avec une tige clou modulaire<br />
Alexandre RICHARD *, Julien HENRY,<br />
Gualter VAZ, Olivier GUYEN,<br />
Jean-Marc DURAND, Jacques BÉJUI-HUGUES,<br />
Jean-Paul CARRET<br />
INTRODUCTION. Les reprises fémora<strong>les</strong> de prothèses tota<strong>les</strong><br />
de hanche (PTH) s’effectuent souvent sur un support osseux<br />
métaphysaire fragilisé avec <strong>des</strong> parois fémora<strong>les</strong> amincies, voire<br />
perforées ou fracturées, en particulier lorsqu’il s’agit d’une<br />
reprise sur tige cimentée. L’utilisation d’un volet fémoral ou<br />
d’une fenêtre diaphysaire plus limitée fragilise d’autant plus le<br />
stock osseux. Dans ces circonstances est utilisée une tige clou<br />
modulaire, composée de trois parties distinctes (diaphysaire,<br />
métaphysaire et épiphysaire), recouverte d’hydroxyapatite<br />
(HAP) et verrouillable.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Il s’agit d’une série rétrospective<br />
de 80 reprises de PTH avec fémorotomie, dont 70 sur tiges<br />
cimentées. L’âge moyen était de 65 ans (34 hommes et 46 femmes).<br />
Le diagnostic initial comprenait 10 <strong>des</strong>cellements septiques,<br />
62 aseptiques dont 51 bipolaires, 6 fractures sur PTH et<br />
une fracture de tête alumine. Les scores SOFCOT du fémur<br />
étaient <strong>les</strong> suivants : I (19), II (39), III (17) et IV (5). Le PMA<br />
préopératoire était de 3 3 3 et l’inégalité de longueur moyenne<br />
était de -10mm. La technique chirurgicale comprenait 72 volets<br />
fémoraux (22 cm de long en moyenne) et 8 fenêtres en bout de<br />
tige fémorale. Sept cas nécessitait une autogreffe iliaque homolatérale.<br />
Toutes <strong>les</strong> fémorotomies étaient ostéosynthésées par<br />
cerclages métalliques.<br />
RÉSULTATS. Le recul moyen était de 28,08 mois (de<br />
10,25 mois à 64,35 mois). L’appui complet était autorisé à 3 mois<br />
et la consolidation radiologique constatée sur la radiographie<br />
standard à 4,5 mois. Le PMA postopératoire était 5 5 5 et l’inégalité<br />
de longueur postopératoire -22,5 cm. Dans 4 cas, il était noté<br />
une pseudarthrose métaphysaire ou diaphysaire (3 sta<strong>des</strong> 4 et<br />
1 stade 3 SOFCOT). Treize tiges clou étaient considérées comme<br />
sous-dimensionnées sur <strong>les</strong> radiographies postopératoires. On<br />
retrouvait 18 complications peropératoires (14 fractures et 4 fausses-routes),<br />
10 complications précoces (3 infections, 7 luxations)<br />
et 9 complications tardives (3 luxations dont 1 reprise pour erreur<br />
d’antéversion épiphysaire, 1 infection avec dépose puis réimplantation<br />
secondaire, 4 fracture de tige modulaire dans le cadre d’une<br />
faute technique et une reprise en raison d’un sous-dimensionnement<br />
initial de l’implant).<br />
CONCLUSION. Ce type d’implant modulaire donne de bons<br />
résultats dans <strong>les</strong> <strong>des</strong>cellements fémoraux avec perte de substance<br />
osseuse. La reconstruction fémorale secondaire nécessite<br />
rarement l’utilisation de greffes osseuses supplémentaires. Les<br />
sta<strong>des</strong> SOFCOT III et IV sont malgré tout à risque de pseudarthrose.<br />
Le devenir à long terme de cet implant n’est pas analysable<br />
en raison du faible recul de la série.<br />
* Alexandre Richard, 6, rue Danton, 69003 Lyon.<br />
215 Prothèses tota<strong>les</strong> de hanche primaires<br />
pour ostéonécrose chez <strong>les</strong><br />
patients actifs de moins de 50 ans<br />
Christian DELAUNAY *, Jean-Noël ARGENSON,<br />
Pascal BIZOT, Jean-Alain EPINETTE,<br />
Xavier FLECHER, Luc KERBOULL, Henri MIGAUD,<br />
Christian NOURISSAT, Jean-Pierre VIDALAIN<br />
INTRODUCTION. Il existe un préjugé défavorable concernant<br />
le devenir <strong>des</strong> prothèses tota<strong>les</strong> de hanche (PTH) dans<br />
l’ostéonécrose aseptique (ONA). À partir d’une série de PTH<br />
primaires réalisées dans une population homogène de patients<br />
< 50 ans bien actifs, le but de ce travail rétrospectif multicentrique<br />
était de comparer <strong>les</strong> résultats <strong>des</strong> PTH réalisées pour ONA<br />
à ceux d’un groupe témoin T (coxarthrose 1ive et dysplasies<br />
simp<strong>les</strong>).<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Huit équipes ont réalisé<br />
1364 PTH primaires selon <strong>les</strong> critères suivants : âge < 50 ans,<br />
hanches vierges de tout matériel, dysplasie > stade 1 de Crowe et<br />
arthrites rhumatoïde ou juvénile exclues. 36 % (493 PTH) ont<br />
concerné <strong>des</strong> hanches nécrotiques avec 8 modè<strong>les</strong> de PTH dont 6<br />
(84,6 %) sans ciment. Les coup<strong>les</strong> de frottement ont été conventionnels<br />
dans 73 %. Les 388 patients du groupe ONA étaient<br />
âgés en moyenne de 40,4 ans ; Charnley B dans 31,4 % ; prothésés<br />
<strong>des</strong> 2 hanches pour 27 % ; avec un sexe ratio de 5,9H/1F
(versus 0,94H/1F pour le groupe T, p = 0,0001) et un niveau<br />
d’activité élevé Devane 4 et 5 dans 65,5 % (versus 52 %,<br />
p = 0,0001).<br />
RÉSULTATS. À 7,7 ans de recul moyen (versus 8 ans dans le<br />
groupe T), le score PMA était identique (17,47 versus 17,25), <strong>les</strong><br />
radiographies comparab<strong>les</strong> (imparfaites dans 8,5 % versus<br />
10,2 %) ainsi que la fréquence <strong>des</strong> échecs radio-cliniques (Sedel<br />
D dans 3 % versus 4,6 %, p = 0,21), le taux de luxations (3,45 %<br />
versus 2,18 %, p = 0,21) et le taux de révision (6,5 % versus<br />
8,3 %, p = 0,28). Les probabilités de survie à 10 ans entre la<br />
série ONA et la série globale <strong>des</strong> patients actifs de < 50 ans ont<br />
été identiques, voire supérieures dans le groupe ONA pour tous<br />
<strong>les</strong> événements étudiés.<br />
DISCUSSION. Les patients < 50 ans prothésés pour ONA<br />
sont essentiellement <strong>des</strong> hommes (86 %) et pour 65,5 % à forte<br />
activité (> Devane 3). Malgré cela, <strong>les</strong> résultats radio-cliniques<br />
sont identiques, voire supérieurs à ceux de la population de<br />
patients < 50 ans opérés pour coxarthrose 1ive ou dysplasies<br />
simp<strong>les</strong>. Si <strong>les</strong> luxations étaient plus fréquentes dans le groupe<br />
ONA lorsque l’intervention était réalisée par voie postéro-latérale<br />
(5,6 % versus 0,48 %, p = 0,004), ce fait était essentiellement<br />
lié à une seule série.<br />
CONCLUSION. Cette étude multicentrique et multi-implants<br />
ne confirme pas la notion de résultats plus mauvais dans l’ONA.<br />
On retiendra l’absence de bénéfice procuré par <strong>les</strong> bil<strong>les</strong> en zircone<br />
et la nécessité d’améliorer la régularité de l’obtention d’une<br />
fixation acétabulaire de qualité pour <strong>les</strong> inserts en alumine massive.<br />
* Christian Delaunay, Clinique de l’Yvette,<br />
43, route de Corbeil, 91160 Longjumeau.<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S127<br />
216 Ostéonécrose de la tête fémorale<br />
chez <strong>les</strong> patients greffés de moelle:<br />
revue d’une série de 93 arthroplasties<br />
tota<strong>les</strong> de hanches<br />
Frédéric ZADEGAN *, Agnès RAOULD,<br />
Pascal BIZOT, Didier HANNOUCHE,<br />
Rémi NIZARD, Gérard SOCIÉ, Laurent SEDEL<br />
INTRODUCTION. La greffe de moelle allogénique est devenue<br />
un traitement efficace et incontournable <strong>des</strong> pathologies<br />
hématologiques malignes et bénignes. Le taux de survie à 5 ans<br />
toute catégorie confondue atteint 60 %. Ces mala<strong>des</strong> sont alors<br />
confrontés aux complications tardives et non fata<strong>les</strong> compromettant<br />
leur qualité de vie. L’ostéonécrose de la tête fémorale représente<br />
un handicap important chez ces patients jeunes et souvent<br />
actifs. L’objectif de cette étude rétrospective et continue était de<br />
rendre compte du résultat clinique et radiologique <strong>des</strong> prothèses<br />
tota<strong>les</strong> de hanche dans cette indication.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Cinquante-quatre patients<br />
(93 hanches dont 87 de première intention) opérés de janvier<br />
1980 à juin 2003 ont été revus. L’âge moyen était de 33 ans. Le<br />
délai moyen de survenue de l’ostéonécrose dans <strong>les</strong> suites de la<br />
greffe de moelle était de 24,7 mois. Le score PMA préopératoire<br />
et au dernier recul ont été relevés. Le score de Ficat préopératoire<br />
a été enregistré. Les radiographies au dernier recul ont été revues<br />
par deux observateurs indépendants à la recherche d’anomalies.<br />
La classification de Sedel a été utilisée pour le résultat global<br />
radio-clinique. Le taux de survie a été calculé en prenant comme<br />
événement la reprise chirurgicale pour <strong>des</strong>cellement aseptique.<br />
RÉSULTATS. Le recul moyen était de 6,2 ans. Deux patients<br />
sont décédés, et deux ont été perdus de vue. L’atteinte était bilatérale<br />
d’emblée dans 72 cas. Le score PMA préopératoire moyen<br />
était de 10,75. Le score Ficat préopératoire était de II dans 3 cas,<br />
de III dans 32 cas et de IV dans 58 cas. Au dernier recul, le score<br />
PMA moyen était de 17. Cinq mala<strong>des</strong> ont nécessité une reprise<br />
chirurgicale (2 infections) et nous rapportons une seule luxation<br />
traumatique. L’analyse radiologique montrait : 7 liserés acétabulaires<br />
non évolutifs, une pseudarthrose du grand trochanter, une<br />
ascension de cupule et une fracture du fémur consolidée. Quatrevingt-cinq<br />
mala<strong>des</strong> étaient classés A dans la classification de<br />
Sedel, 5 B, 1 C et 2 D. Le taux de survie à 10 ans était de<br />
97,8 %.<br />
DISCUSSION. Notre choix de poser d’emblée une prothèse<br />
totale de hanche se justifie par le caractère souvent évolué <strong>des</strong><br />
nécroses, la douleur importante <strong>des</strong> patients et le bon résultat<br />
déjà obtenu dans l’indication plus générale d’ostéonécrose.<br />
L’arthroplastie totale de hanche est pour nous une option thérapeutique<br />
satisfaisante pour la prise en charge de ces mala<strong>des</strong> fragi<strong>les</strong><br />
et immunodéprimés leur permettant une reprise rapide de<br />
leur activité.<br />
* Frédéric Zadegan, Service de Chirurgie Orthopédique,<br />
Hôpital Lariboisière, 2, rue Ambroise-Paré, 75010 Paris.
3S128 81 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
217 Fixation interne percutanée au tibia<br />
distal et au pilon tibial : intérêt et<br />
complications précoces<br />
Colin DUJARDIN *, Sébastien GUILBERT,<br />
Fredson RAZANABOLA, Michel TRICOIT<br />
INTRODUCTION. Les fractures du quart distal du tibia et du<br />
pilon tibial, rendues difficile à traiter du fait de la situation souscutanée<br />
<strong>des</strong> deux os de la jambe, sont réputées pour leur mauvais<br />
pronostic mais aussi pour la fréquence et la gravité <strong>des</strong> complications<br />
liées aux traitements. Pour traiter ces lésions, nous utilisons<br />
depuis décembre 2003 <strong>des</strong> fixateurs internes en titane (plaques de<br />
types LCP) posés en percutané sur le versant médial du tibia distal.<br />
Le suivi <strong>des</strong> patients a été prospectif.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Nous avons traité ainsi en<br />
27 mois 35 fractures chez 32 patients ; métaphysaires complètes<br />
de type A de l’AO dans 23 cas et de type C articulaires de l’AO<br />
dans 12 cas. Vingt et un fixateurs ont été posés en primaire, 14 en<br />
secondaire en remplacement d’un autre type de traitement dont 4<br />
avec un délai supérieur à 5 semaines par rapport à l’accident. Ces<br />
patients ont été soignés par la mise en place d’un fixateur interne<br />
médial posé en percutané, sans abord médial du foyer de fracture,<br />
mais avec possibilité ; 1°) d’une synthèse fibulaire ; 2°) d’une synthèse<br />
par vissage percutanée <strong>des</strong> lésions articulaires du pilon<br />
tibial ; et 3°) d’un abord latéral du foyer tibial. Sans immobilisation<br />
complémentaire, la mobilisation active du membre a été<br />
immédiate. La remise en charge a été effectuée entre J2 et J45. Les<br />
patients ont été suivis régulièrement sur le plan clinique et radiologique,<br />
<strong>les</strong> complications ont été systématiquement recensées avec<br />
au délai maximal une mesure du score clinique de Kitaoka.<br />
RÉSULTATS. Toutes <strong>les</strong> fractures ont consolidé sans changement<br />
de mode d’ostéosynthèse. Les complications majeures ont<br />
été <strong>les</strong> suivantes : une infection profonde et deux retards cicatriciels,<br />
trois retards de consolidation, un défaut de réduction articulaire<br />
repris précocement, deux cals vicieux en valgus et deux en<br />
rotation externe, une algodystrophie.<br />
DISCUSSION. La fixation interne percutanée s’est avérée<br />
particulièrement fiable au tibia distal et au pilon tibial malgré <strong>les</strong><br />
difficultés liées à la réduction à foyer fermé. Une grande partie<br />
<strong>des</strong> complications est expliquée par <strong>des</strong> fautes techniques liées à<br />
la courbe d’apprentissage mais indépendantes de la méthode qui<br />
est désormais totalement intégrée à notre arsenal thérapeutique.<br />
CONCLUSION. L’utilisation dans <strong>des</strong> conditions complexes<br />
d’une technologie nouvelle de fixation nous a prouvé sa fiabilité<br />
et nous permet d’espérer l’amélioration <strong>des</strong> résultats thérapeutiques<br />
à long terme de lésions de mauvaises réputations.<br />
* Colin Dujardin, Service d’Orthopédie et Traumatologie,<br />
CHR d’Orléans, Hôpital de la Source,<br />
14, avenue de l’Hôpital,<br />
BP 6709, 45067 Orléans Cedex 2.<br />
Séance du 9 novembre matin<br />
TRAUMATOLOGIE<br />
218 Les fractures du col du talus : à<br />
propos de 44 cas<br />
Arnaud PATOUT *, Antoine GABRION,<br />
Joël VERNOIS, Karim BASHTI, Olivier JARDÉ<br />
INTRODUCTION. Le but de cette étude était d’évaluer à<br />
long terme <strong>les</strong> résultats cliniques et radiologiques de la prise en<br />
charge <strong>des</strong> fractures tota<strong>les</strong> du col du talus.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Il s’agissait d’une série rétrospective<br />
continue de 44 fractures du col du talus. Elle comprenait<br />
33 hommes et 11 femmes. L’âge moyen au moment du traumatisme<br />
était de 34 ans (18-77 ans). Les fractures ont été réparties<br />
selon la classification de Hawkins modifiée par Canale et Kelly<br />
permettant de retrouver 13 types I, 16 types II, 10 types III et<br />
5 types IV. Huit fractures ont été traitées orthopédiquement.<br />
Trente-six fractures ont bénéficié d’une réduction et ostéosynthèse<br />
avec prédominance du vissage (2 vis spongieuses AO 4.0<br />
ou 1 vis spongieuse AO 6.5) dans 24 cas (20 par voie antérieure<br />
et 4 par voie postérieure) et 12 brochages. Toutes ces fractures<br />
ont été immobilisées par une contention de type botte avec mise<br />
en décharge du membre inférieur. L’évaluation clinique était<br />
basée sur le score de Kitaoka et un indice subjectif de satisfaction.<br />
L’évaluation radiologique a consisté à réaliser <strong>des</strong> clichés<br />
standards face et profil centrés sur le talus ainsi que <strong>des</strong> clichés<br />
cerclés de Méary. Par ailleurs, une étude scanographique ou IRM<br />
a été effectuée dans un tiers <strong>des</strong> cas.<br />
RÉSULTATS. Le recul moyen était de 7 ans (1-15 ans). Le<br />
score de Kitaoka était en moyenne de 65,4 (30-98) pour l’ensemble<br />
de la série (71,5 pour le traitement orthopédique et 63,7 pour<br />
le traitement chirurgical) avec 11 % de résultats excellents, 28 %<br />
bons, 36 % moyens et 25 % mauvais. Subjectivement, 21 % <strong>des</strong><br />
patients étaient très satisfaits, 39 % satisfaits, 25 % moyennement<br />
et 14 % non satisfaits. L’analyse radiologique a permis de<br />
noter 23 % d’ostéonécrose du corps du talus. Tous <strong>les</strong> patients<br />
présentaient une arthrose d’au moins une articulation péritalienne<br />
avec atteinte sous-talienne plus fréquente. Onze cals<br />
vicieux (25 %) retrouvés se répartissaient pour 4 cas en dorsiflexion,<br />
5 en varus et 2 associant <strong>les</strong> deux précédents.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. Bien que rares, <strong>les</strong> fractures<br />
du col du talus sont grêvées de résultats fonctionnels souvent<br />
peu favorab<strong>les</strong>. Ceux-ci sont en partie dus aux taux de complications<br />
élevés tel<strong>les</strong> que l’ostéonécrose dont l’incidence augmente<br />
avec le déplacement du foyer de fracture, l’arthrose essentiellement<br />
sous-talienne conséquence fréquente <strong>des</strong> cals vicieux en<br />
varus. Paradoxalement, l’évaluation subjective <strong>des</strong> résultats<br />
apparaît majoritairement satisfaisante.<br />
* Arnaud Patout, CHU Nord,<br />
place Victor-Pauchet 80054, Amiens Cedex 1.
219 Notre expérience de l’enclouage<br />
rétrograde de cheville : suivi prospectif<br />
de 38 cas<br />
Olivier LAFFENÊTRE *, Loïc VILLET,<br />
Dominique CHAUVEAUX<br />
INTRODUCTION. Ce travail rapporte le suivi prospectif de<br />
38 patients opérés entre mai 1998 et mai 2005. Si la technique en<br />
elle-même ne pose guère de difficulté, notre expérience de<br />
l’arthroscopie talo-crurale et sous-talienne, s’est révélée un atout<br />
majeur.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Il s’agissait de 38 patients<br />
(23 hommes, 16 femmes) d’âge moyen 55 ans, qui ont bénéficié<br />
d’une double, ou triple arthrodèse de l’arrière-pied instrumentée<br />
par enclouage rétrograde. Quatre patients avaient un antécédent<br />
septique, 7 une arthrodèse sous-talienne antérieure. Dans 19 cas,<br />
l’avivement sous-talien a été réalisé selon nos principes endoscopiques.<br />
Chaque fois que possible il en a été de même à l’étage<br />
talo-crural malgré un abord antérieur ou antéro-latéral (avivement<br />
cartilagineux respectant la géométrie <strong>des</strong> surfaces, avivement<br />
soigneux <strong>des</strong> gouttières, perforations trans-osseuses). Dans<br />
un cas, la technique a été endoscopique pure bifocale. Vingt-six<br />
patients ont été greffés (25 auto, 1 allo). Les indications en<br />
étaient 7 échecs d’arthroplastie de cheville, 6 pseudarthrodèses<br />
de cheville avec sous-talienne bloquée ou non fonctionnelle,<br />
6 séquel<strong>les</strong> post-traumatiques graves, 5 arthroses bifoca<strong>les</strong> primitives,<br />
5 traumatismes complexes de l’arrière-pied, 4 pieds<br />
varus équin neurologiques, 3 séquel<strong>les</strong> de laxité chronique de<br />
cheville, une ostéo-arthropathie diabétique, une pseudarthrose de<br />
jambe avec arthrose sous-jacente talo-crurale. Le recul moyen<br />
était de 38 mois (12-90).<br />
RÉSULTATS. La reprise complète de l’appui a toujours été<br />
possible, sauf pour le patient paraplégique. On a noté 2 non<br />
fusions (une à chaque étage) chez deux patients ayant obligé à<br />
un changement de méthode avec succès. Tous <strong>les</strong> autres ont<br />
consolidé dans un délai moyen de 2,6 mois. On a noté un écoulement<br />
aseptique résolutif au niveau d’une vis de verrouillage,<br />
une algodystrophie, un septis sur le site iliaque, un sur une<br />
vis de verrouillage. Les patients ont été évalués par le score cheville<br />
AFCP/ SFMCP, dont la valeur moyenne est passée de 20,7<br />
à 66/100. On notait 19 patients très satisfaits, 15 satisfaits,<br />
2 déçus et 2 mécontents.<br />
DISCUSSION. Cette ostéosynthèse, très fiable biomécaniquement,<br />
a permis de rattraper nombre de situations délicates,<br />
sans dispenser toutefois d’une greffe dans 68 % <strong>des</strong> cas. L’application<br />
du principe d’avivement endoscopique a permis un taux<br />
de fusion de 97,5 %. Dans notre expérience un antécédent septique<br />
ne contre-indique pas l’enclouage.<br />
CONCLUSION. Cette technique réservée à <strong>des</strong> cas souvent<br />
diffici<strong>les</strong>, s’est avérée extrêmement fiable avec un taux de fusion<br />
excellent.<br />
* Olivier Laffenêtre, CHU Pellegrin,<br />
place Amélie-Raba-Léon, 33076 Bordeaux Cedex.<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S129<br />
220 Reconstructions <strong>des</strong> ruptures<br />
anciennes du tendon d’Achille avec<br />
un transfert du fléchisseur propre<br />
du gros orteil : à propos de 10 cas<br />
Sébastien LUSTIG *, Jean-Luc BESSE,<br />
Jean-Luc LERAT<br />
INTRODUCTION. Dans la littérature anglo-saxone, la<br />
reconstruction <strong>des</strong> ruptures négligées comporte essentiellement<br />
2 techniques en fonction de la perte de substance : l’allongement<br />
en V-Y myotendineux (pour <strong>les</strong> défects de 2 à 4 cm), <strong>les</strong> transferts<br />
tendineux avec le fléchisseur propre du gros orteil (FHL) ou<br />
avec le fléchisseur commun <strong>des</strong> orteils (FDL) (pour <strong>les</strong> défects<br />
de plus de 5 cm). En France, <strong>les</strong> techniques de transfert avec <strong>les</strong><br />
fléchisseurs <strong>des</strong> orteils ne sont pas utilisées ou du moins n’ont<br />
jamais été publiées. Nous rapportons <strong>les</strong> résultats d’une série<br />
prospective de 10 cas de transfert du FHL.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. De 2002 à 2003, 10 patients<br />
d’âge moyen 44,8 ans (27-71 ans) ont été opérés par cette technique.<br />
Il s’agissait de 6 hommes et 4 femmes, et de 7 sportifs<br />
(course à pied, alpinisme, foot, handball, tennis). Les étiologies<br />
étaient : 3 tendinopathies d’insertion (2 ruptures secondaires à<br />
une résection de l’enthésopathie, 1 opéré en semi-urgence après<br />
rupture sur une tendinopathie d’insertion avec lésions de rupture<br />
partielle connues), 5 ruptures « négligées », 2 ruptures itératives<br />
(1 suture simple - 1 Ténolig). Le délai moyen entre la rupture et<br />
le transfert tendineux était de 2 ans (15 jours -7 ans). La perte de<br />
substance après résection de la fibrose était en moyenne de<br />
7,0cm (5-10cm).<br />
RÉSULTATS. Les suites opératoires ont été compliquées<br />
d’une algodystrophie. Les patients ont repris leur travail en<br />
moyenne à 4,9 mois (3-8 mois) et le sport à 10,4 mois. Avec un<br />
recul moyen de 25,2 mois, <strong>les</strong> résultats étaient tous excellents ou<br />
bons. 90 % <strong>des</strong> patients pouvaient se tenir sur la pointe <strong>des</strong><br />
pieds, et avaient <strong>des</strong> amplitu<strong>des</strong> articulaires de cheville symétriques.<br />
L’amyotrophie moyenne du triceps était de 1,4 cm<br />
(0-3 cm). Le score fonctionnel moyen de Kitaoka était de 98/100<br />
(90-100).<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. Notre expérience récente<br />
avec cette technique de transfert tendineux est très satisfaisante.<br />
La perte de force du gros orteil ainsi que la perte de flexion<br />
active de l’inter-phalangienne du gros orteil ne s’est pas révélée<br />
comme handicapante, y compris chez <strong>les</strong> patients sportifs. La<br />
force de flexion du pied contre résistance est très bonne, même si<br />
à priori un transfert du FHL pouvait sembler faible en comparaison<br />
du triceps. Cela est peut être liée au fait que nous avons systématiquement<br />
associée un renfort avec le tissu « fibreux »<br />
restant ou avec une plastie de Bosworth.<br />
* Sébastien Lustig, Service de Chirurgie Orthopédique,<br />
Centre Hospitalier Lyon-Sud, 69495 Pierre-Bénite Cedex.
3S130 81 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
221 Résultats fonctionnels du traitement<br />
<strong>des</strong> fractures luxations tarsométatarsiennes<br />
: à propos d’une<br />
série de 50 cas<br />
Hacene DJOUIDENE *, Rabah ATIA,<br />
M’Hamed NOUAR, Mabrouk TEBANI,<br />
Ab<strong>des</strong>salem YAHIA, Adlene BEYLAGOUN<br />
INTRODUCTION. Les luxations tarso-métatarsiennes sont<br />
rares et passent souvent inaperçues quand el<strong>les</strong> surviennent dans<br />
le cadre d’un polytraumatisme. El<strong>les</strong> sont découvertes à la<br />
reprise de la marche avec <strong>des</strong> troub<strong>les</strong> de la statique du pied.<br />
L’objectif du travail était d’évaluer <strong>les</strong> résultats du traitement <strong>des</strong><br />
luxations tarso-métatarsiennes prises en charge le plus souvent<br />
en urgence, ainsi que la tolérance <strong>des</strong> séquel<strong>les</strong>.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Il s’agit d’une étude rétrospective<br />
fondée sur 50 fractures-luxations du pied, prises en charge<br />
entre 1998-2005, tous adultes avec 45 hommes et 5 femmes.<br />
L’âge moyen était de 28 ans avec <strong>des</strong> extrêmes allant de 20 à<br />
54 ans. Les accidents de la voie publique étaient représentés dans<br />
48 cas et domestiques dans 2 cas. La radiographie standard (face,<br />
profil - 3/4) a permis de retrouver : 18 FLTM homolatéra<strong>les</strong> dont<br />
14 FLTM spatulaires et 4 FLTM columno-spatulaires homolatéra<strong>les</strong>,<br />
32 FLTM divergentes dont 20 FLTM columnaires et<br />
12 FLTM columno spatulaires divergentes selon la classification<br />
de Trillat. Dix-neuf patients ont été opérés pour raison d’œdème<br />
et d’irréductibilité de la lésion osseuse par une ou deux incisions<br />
dorsa<strong>les</strong> longitudina<strong>les</strong>. Trente et un patients ont subi une réduction<br />
orthopédique avec synthèse par broche percutanée.<br />
RÉSULTATS. Dans la série traitée par un abord direct, nous<br />
avons retrouvé 14 patients avec un résultat satisfaisant pour<br />
5 mauvais résultats. Dans la série <strong>des</strong> patients traités par réduction<br />
orthopédique et synthèse par broches, le résultat a été satisfaisant<br />
chez 8 patients et mauvais chez 23.<br />
DISCUSSION. Dans la série traitée par une réduction orthopédique<br />
maintenue par broche percutanée, <strong>les</strong> mauvais résultats<br />
s’expliquent par le fait que la luxation n’était pas isolée mais<br />
accompagnée de fractures <strong>des</strong> métatarsiens et <strong>des</strong> cunéiformes.<br />
Cette méthode comme l’avait signalé Trillat ne peut s’appliquer<br />
qu’aux cas simp<strong>les</strong> c’est-à-dire aux luxations pures. Dans la<br />
série traitée chirurgicalement, <strong>les</strong> mauvais résultats sont dus à<br />
une communition importante qui aurait due faire pratiquée une<br />
reposition arthrodèse d’emblée. Cette technique n’a jamais été<br />
pratiquée dans notre série.<br />
CONCLUSION. Devant tout polytraumatisé, il faut toujours<br />
penser à un traumatisme du pied et faire un bilan radiographique<br />
complet et d’excellente qualité, condition essentielle au diagnostic<br />
précis de la lésion. Si la réduction orthopédique s’avère insuffisante<br />
il faut avoir recours à la reposition sanglante fixée par<br />
brochage. À la lumière de notre statistique, <strong>les</strong> résultats de cette<br />
série souffrent du manque de doctrine, mais c’est le sort habituel<br />
<strong>des</strong> lésions peu fréquentes.<br />
* Hacene Djouidene, 5, rue de Strasbourg,<br />
23000 Annaba, Algérie.<br />
222 Évaluation <strong>des</strong> séquel<strong>les</strong> <strong>des</strong> fractures<br />
<strong>des</strong> métatarsiens dans un<br />
contexte de polytraumatisme<br />
François BONNEL *<br />
INTRODUCTION. Les fractures <strong>des</strong> métatarsiens dans le<br />
cadre d’un polytraumatisme sont souvent ignorées et ne sont diagnostiquées<br />
qu’au stade <strong>des</strong> séquel<strong>les</strong>. Dans d’autres circonstances,<br />
le diagnostic initial est porté mais la prise en charge<br />
chirurgicale éventuelle est souvent retardée ou non réalisée.<br />
Notre objectif était d’évaluer <strong>les</strong> conséquences de cette abstention<br />
thérapeutique initiale.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Nous avons observé 35 cas de<br />
séquel<strong>les</strong> post-traumatiques (31 hommes et 4 femmes âgés de<br />
42 ans en moyenne). Le traumatisme initial consistait dans<br />
16 cas de polyfracturés du membre inférieur et dans 12 cas de<br />
polytraumatisme avec une surveillance en réanimation pour <strong>des</strong><br />
atteintes polyviscéra<strong>les</strong> et <strong>des</strong> fractures étagées du membre supérieur<br />
et inférieur et 3 cas de traumatisme crânien avec coma. Les<br />
séquel<strong>les</strong> <strong>des</strong> patients revus au stade pour traitement chirurgical<br />
ont été évaluées selon la fiche AOS.<br />
RÉSULTATS. Les cals vicieux intéressaient : 19 fois la tête<br />
<strong>des</strong> métatarsiens associant <strong>les</strong> 2,3 et 4 e dans 15 cas, la tête du<br />
5 e métatarsien dans 2 cas et <strong>les</strong> têtes <strong>des</strong> 4 et 5 e métatarsiens dans<br />
2 cas. Dans 9 cas, il s’agissait de cal vicieux diaphysaires sur <strong>les</strong><br />
2, 3 et 4 e métatarsiens dans 7 cas et 3 cas sur le 5 e métatarsien.<br />
Dans 7 cas, il s’agissait de fracture <strong>des</strong> bases métatarsiennes<br />
associées à une atteinte de l’articulation de Lisfranc. Tous <strong>les</strong> cas<br />
ont été opérés avec réalisation d’ostéotomie de réaxation en cas<br />
de cal vicieux ou d’arthrodèse de l’interligne de Lisfranc associée<br />
à une ostéotomie du cal vicieux.<br />
DISCUSSION. Les difficultés opératoires rencontrées pour<br />
corriger ces cals vicieux avec <strong>des</strong> séquel<strong>les</strong> invalidantes à type<br />
de métatarsalgie nous amène à considérer que malgré l’importance<br />
du polytraumatisme, ces fractures doivent être opérées au<br />
même titre que <strong>les</strong> autres localisations traumatiques <strong>des</strong> os longs.<br />
Le résultat final <strong>des</strong> patients victimes de polyfractures du membre<br />
inférieur ne présentaient que peu de séquel<strong>les</strong> sur <strong>les</strong> fractures<br />
<strong>des</strong> os longs mais étaient très handicapés par <strong>les</strong> troub<strong>les</strong><br />
statiques observés au niveau <strong>des</strong> avant-pieds. La notion du traumatisme,<br />
en particulier <strong>des</strong> accidents de circulation (de motocyclettes<br />
et de véhicu<strong>les</strong> automobi<strong>les</strong>) avec <strong>des</strong> lésions étagées du<br />
membre inférieur, doit attirer l’attention sur le pied nécessitant<br />
un bilan radiographique systématique, la prise en charge chirurgicale<br />
étant préconisée dans la première semaine du traumatisme.<br />
CONCLUSION. La notion d’abstention thérapeutique devant<br />
ces fractures <strong>des</strong> métatarsiens doit être révisée et ces fractures<br />
traitées avec la même attention que <strong>les</strong> autres localisations traumatiques<br />
fracturaires.<br />
* François Bonnel, Hôpital Lapeyronie, 371,<br />
avenue du Doyen-Gaston-Giraud, 34295 Montpellier Cedex 5.
223 Évaluation du traitement <strong>des</strong> pseudarthroses<br />
par la technologie <strong>des</strong><br />
ultrasons : à propos de 14 cas<br />
Xavier ROUSSIGNOL *, Franck DUJARDIN,<br />
Fabrice DUPARC, Char<strong>les</strong> CURREY,<br />
Norman BIGA, GÉRARD POLLE<br />
INTRODUCTION. La technologie <strong>des</strong> ultrasons de basse<br />
intensité est régulièrement utilisée en Europe du nord et outreatlantique<br />
pour le traitement <strong>des</strong> pseudarthroses. La diffusion de<br />
cette technologie en France (système Exogen Smith et<br />
Nephew) et son utilisation en routine date de 2004. Le but de<br />
cette étude était d’évaluer cette technique et d’en préciser <strong>les</strong><br />
limites.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Dans notre département hôpitalo-universitaire,<br />
14 pseudarthroses étaient traitées par cette<br />
technique entre juillet 2004 et juillet 2005 (recul de 6 mois minimum<br />
pour la révision <strong>des</strong> dossiers). Les critères d’inclusion<br />
étaient une pseudarthrose confirmée par la radiographie avec un<br />
délai minimum de 6 mois post-traumatique. Étaient exclus <strong>les</strong><br />
traitements orthopédiques initiaux et <strong>les</strong> fractures du rachis. Le<br />
gap fracturaire devait être inférieur à 5 mm. Il s’agissait de<br />
8 hommes et 6 femmes. L’âge moyen <strong>des</strong> patients était de 42 ans<br />
(extrêmes 16 à 80 ans). Les segments osseux étaient diaphysaires<br />
ou métaphysaires, comprenant 2 humérus, 1 radius, 1 olécrane,<br />
1 scaphoïde, 4 fémurs, 3 tibias, 1 fibula distale et<br />
1 métatarsien. Le délai moyen de prise en charge par rapport au<br />
traumatisme initial était de 10 mois (extrêmes entre 6 mois et<br />
22 mois). Le système Exogen était appliqué 20 minutes par jour<br />
pendant 3 à 6 mois en regard de la pseudarthrose et le patient<br />
revu à 6, 12, 36 semaines.<br />
RÉSULTATS. Une patiente était exclue de l’étude en raison<br />
de rupture de l’implant fémoral (clou de fémur pris en charge à<br />
15 mois post-traumatique) ayant conduit à une reprise chirurgicale.<br />
Le taux de consolidation était de 76 % à 6 mois avec<br />
3 échecs (1 olécrane, 1 humérus, 1 fémur). Les facteurs d’échec<br />
étaient une ostéosynthèse instable (macromobilité clinique sur<br />
broches de d’olécrane et clou d’humérus) et une surcharge pondérale<br />
majeure (150 kg pour 1M60 avec clou de fémur).<br />
DISCUSSION. Ce taux de consolidation de 76 % par le système<br />
Exogen est légèrement inférieur aux taux de consolidation<br />
par auto greffe observé dans la littérature (80 à 85 %).<br />
Cependant, notre délai moyen de prise en charge de la pseudarthrose<br />
était élevé (10 mois) et incluait 3 patient multi opérés.<br />
CONCLUSION. L’utilisation <strong>des</strong> ultrasons apparaît comme<br />
une alternative à la greffe osseuse, sous réserve d’une ostéosynthèse<br />
rigide. Cette technique doit être proposée en première<br />
intention dans <strong>les</strong> pseudarthroses <strong>des</strong> os longs encloués en<br />
l’absence de macro mobilité.<br />
* Xavier Roussignol, Département de Chirurgie Orthopédique,<br />
Hôpital Char<strong>les</strong>-Nicolle, 76031 Rouen.<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S131<br />
224 Pronostic <strong>des</strong> paralysies du nerf<br />
fibulaire commun après luxation<br />
traumatique du genou<br />
Nicolas BONNEVIALLE *, Yannick DELANNIS,<br />
Jean-Yves BEAULIEU, Vincent MARTINEL,<br />
Pierre MANSAT, Paul BONNEVIALLE<br />
INTRODUCTION. Lors <strong>des</strong> luxations du genou, le nerf fibulaire<br />
commun (NFC) est paralysé dans 10 à 30 % <strong>des</strong> cas (Rosset<br />
et al. A.A.Ouest 2003). Le taux de récupération et l’état anatomique<br />
du tronc nerveux sont rarement évoqués : c’était le but de<br />
l’étude rétrospective de cette série continue monocentrique.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Parmi <strong>les</strong> 37 luxations du<br />
genou suivies de 1988 à 2005, 23 s’accompagnaient d’une paralysie<br />
du NFC. Il s’agissait de 17 hommes (1 cas bilatéral) et<br />
5 femmes, de 41,5 ans de moyenne d’âge, victimes le plus souvent<br />
d’accidents de la voie publique (11) ou agrico<strong>les</strong> (6). La<br />
luxation était ouverte 7 fois et en ischémie 14 fois, nécessitant<br />
un pontage. La paralysie siégeait dans <strong>les</strong> deux territoires sciatiques<br />
8 fois et uniquement sur le NFC 15 fois. La luxation était<br />
postérieure 9 fois, antérieure 4, latérale 4 ; 6 déplacements<br />
n’étaient pas déterminés. Elle a été traitée par 15 fixateurs et<br />
8 plâtres. Le NFC a été abordé en urgence ou précocement<br />
11 fois : il était contus 6 fois, étiré 4 fois et sectionné une fois.<br />
RÉSULTATS. Le recul minimum a été de 18 mois pour<br />
22 patients (1 décès en postopératoire). Aucun geste n’a été réalisé<br />
sur le NFC 16 fois ; un nerf a été greffé, un suturé et 5 neurolysés.<br />
Les 7 paralysies sciatiques complètes ont récupéré<br />
totalement dans le territoire tibial 3 fois, 4 fois partiellement,<br />
mais jamais dans le territoire NFC. Les 15 paralysies isolées du<br />
NFC ont évolué vers 5 récupérations motrices cotées à 5, 2 récupérations<br />
importantes (coté 4), 4 récupérations partiel<strong>les</strong> (coté<br />
3) ; 6 paralysies sont restées complètes et définitives. Cinq <strong>des</strong><br />
11 nerfs contus ou étirés n’ont connu aucune récupération. Les<br />
5 neurolysés ont abouti à une récupération partielle et/ou bonne.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. La présence d’une paralysie<br />
sciatique complète dans <strong>les</strong> luxations du genou est en partie<br />
liée à l’ischémie musculaire. Lorsque l’état anatomique du nerf<br />
est connu, <strong>les</strong> lésions macroscopiques intéressent plus d’un tronc<br />
sur deux. Le taux de récupération du NFC est faible aboutissant<br />
à un steppage définitif chez plus d’un patient sur deux : cette<br />
séquelle motrice se surajoute aux lésions ligamentaires du<br />
genou. L’attitude interventionniste proposée par Bleton (RCO<br />
1993) et Piton (RCO 1997) est confirmée, basée sur l’absence de<br />
récupération électrique précoce, l’efficacité de la neurolyse ou<br />
<strong>des</strong> greffes courtes. L’échographie, moyen fiable d’évaluation de<br />
l’état macroscopique du NFCest à intégrer dans <strong>les</strong> critères décisionnels.<br />
* Nicolas Bonnevialle, Service d’Orthopédie-Traumatologie,<br />
CHU de Toulouse-Purpan, place du Docteur-Baylac,<br />
31059 Toulouse-cedex.
3S132 81 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
225 L’enclouage cimenté transitoire<br />
dans la prise en charge <strong>des</strong> fractures<br />
diaphysaires de jambe<br />
Cédric COSTE *, Antoine OKSMAN,<br />
Jérôme PROUST, Bertrand GALISSIER,<br />
Christian MABIT, Jean-Louis CHARISSOUX,<br />
Jean-Paul ARNAUD<br />
INTRODUCTION. Les auteurs rapportent leur expérience<br />
d’une prise en charge en urgence ou à distance <strong>des</strong> fractures de<br />
jambe par « enclouage cimenté » : cette technique chirurgicale<br />
s’apparente aux spacer en ciment connus dans la prise en charge<br />
<strong>des</strong> infections prothétiques.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Développé après la publication<br />
de cette technique par Sudhakar (Louisville), leur expérience a<br />
porté sur 6 enclouages réalisés chez 5 patients opérés entre juillet<br />
2004 et janvier 2006 : 1 fracture ouverte type III B selon la classification<br />
de Gustilo et Anderson, fractures bilatéra<strong>les</strong> par écrasement<br />
avec pronostic cutané défavorable, 1 pandiaphysite<br />
postopératoire précoce sur enclouage centromédullaire, 2 pseudarthroses<br />
septiques. Un traitement classique aurait conduit à la<br />
réalisation d’une fixation externe. L’utilisation d’un enclouage<br />
cimenté transitoire avec adjonction d’antibiotiques adaptés a été<br />
une alternative séduisante. Le clou en ciment a été de confection<br />
« artisanale » nécessitant un tube silastic de diamètre 9 mm et de<br />
longueur adaptée armé par 2 clous de Béhac ® . Sa mise en place<br />
respecte <strong>les</strong> mêmes temps qu’un enclouage classique et s’est<br />
effectué après la réalisation <strong>des</strong> prélèvements à visée bactériologiques<br />
et le parage chirurgical. Dans cette série, 5 patients ont<br />
bénéficié d’un enclouage secondaire conventionnel programmé<br />
avec nouvel alésage : 4 réalisés à la 6 e semaine et 1 au 5 e mois<br />
(en réanimation dans <strong>les</strong> suites de son accident de la voie public)<br />
lorsque <strong>les</strong> conditions loca<strong>les</strong> (cutanée) et généra<strong>les</strong> (leucocytes<br />
et CRP normalisées) étaient réunies. L’extraction du clou<br />
cimenté s’est effectuée sans difficulté (aucune détérioration du<br />
matériel).<br />
RÉSULTATS. Le recul moyen était de 18 mois (7 à 26 mois).<br />
La consolidation a été acquise au 5 e mois chez 4 patients avec<br />
une reprise du travail effectuée au 7 e mois chez 3 patients. Un est<br />
en cours de traitement. Pour <strong>les</strong> complications infectieuses initia<strong>les</strong>,<br />
l’évolution à court et à moyen terme a été favorable chez<br />
tous.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. Cette technique représente<br />
une solution dans la prise en charge initiale ou à distance<br />
de certaines fractures de jambe. Elle correspond à la philosophie<br />
du spacer prenant en compte <strong>les</strong> risques septiques et permet une<br />
stabilité réductionnelle fracturaire, un apport d’antibiotiques in<br />
situ et un suivi <strong>des</strong> pansements facilités par un fenêtrage de<br />
l’immobilisation.<br />
* Cédric Coste, Hôpital Universitaire Dupuytren,<br />
2, avenue Martin-Luther-King, 87042 Limoges Cedex.<br />
226 Reconstruction <strong>des</strong> pertes de<br />
substance du 1/3 distal de la<br />
jambe, de la cheville et du pied par<br />
lambeau neuro-cutané sural à<br />
pédicule distal : étude rétrospective<br />
à propos de 28 cas<br />
Mazen ALI *, Alexis FALINE,<br />
Yannick ROUSSANNE, Patrick FAURÉ,<br />
François CANOVAS, François BONNEL<br />
INTRODUCTION. Cette étude rétrospective de 28 cas avait<br />
pour but d’évaluer la fiabilité du lambeau neuro-cutané sural à<br />
pédicule distal dans la couverture de perte de substance du 1/3<br />
distal de la jambe, de la cheville et du pied, avec un recul moyen<br />
de 3,5 ans.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Il s’agissait d’une série rétrospective<br />
de 28 lambeaux chez 27 patients (7 femmes et 20 hommes)<br />
avec une moyenne d’âge de 34 ans. Dans 20 cas, il<br />
s’agissait d’un traumatisme osseux récent (17 cas), ou ancien<br />
(3 pseudarthroses septiques) ; le siège <strong>des</strong> lésions osseuses était<br />
8 fois le cadre jambier, 4 fois le pilon tibial, 5 fois le calcanéus,<br />
3 fois l’arrière-pied. La perte de substance cutanée était isolée<br />
dans 7 cas. La localisation de la perte de substance était : la face<br />
antéro-interne de la jambe et de la cheville (17 cas), la face<br />
interne de la cheville (3 cas), la face dorsale du pied (3 cas), la<br />
face postérieure du talon (5 cas). Les dimensions moyennes de la<br />
perte de substance étaient de 8,5 x 4,5 cm (40 cm 2 ). Vingt-cinq<br />
lambeaux étaient homo-latéraux et 3 lambeaux controlatéraux<br />
(cross-leg avec fixateur externe).<br />
RÉSULTATS. À 35 mois de recul, la couverture cutanée avait<br />
été obtenue dans tous <strong>les</strong> cas : 26 lambeaux avaient cicatrisé en<br />
3 semaines ; dans deux cas, un hématome et une nécrose partielle<br />
ont retardé la cicatrisation acquise en 2 mois ; 2 reprises<br />
ont été nécessaires pour réveil septique osseux mais sans nécrose<br />
du lambeau.<br />
DISCUSSION. Le lambeau sural neuro-cutané à pédicule distal<br />
est un procédé très utile pour assurer la couverture de la perte<br />
de substances du 1/3 distal de la jambe, de la cheville et de la<br />
face dorsale du pied dans le contexte traumatique ou d’ostéite<br />
chronique. Nous retrouvons <strong>les</strong> avantages décrits dans la littérature<br />
en terme de fiabilité (aucune perte de lambeau) et de morbidité<br />
(rançon cicatricielle modérée, anesthésie du territoire sural<br />
distal ne gênant pas la marche ni le chaussage). Dans notre série,<br />
3 lambeaux cross-leg ont été réalisés avec succès.<br />
CONCLUSION. C’est un lambeau fiable, facile d’exécution,<br />
qui n’exige pas de qualification micro-vasculaire. Il préserve le<br />
capital vasculaire et musculaire, et laisse peu de séquel<strong>les</strong> fonctionnel<strong>les</strong>.<br />
Il peut être utilisé en version croisée comme alternative<br />
d’un lambeau libre musculaire.<br />
* Mazen Ali, Service d’Orthopédie III, CHU Lapeyronie,<br />
371, avenue du Doyen-Gaston-Giraud, 34295 Montpellier.
227 Traitement chirurgical <strong>des</strong> pseudarthroses<br />
invétérées <strong>des</strong> os longs<br />
par apport de protéine osseuse<br />
morphogénétique humaine recombinante<br />
(rh-bmp7) : expérience<br />
préliminaire à propos de 7 cas<br />
Falah BACHOUR *, Philippe LAFFARGUE,<br />
Julien GIRARD, Stéphane HERENT,<br />
Marc SOENEN, Henri MIGAUD<br />
INTRODUCTION. La protéine osseuse morphogénique ou<br />
BMP a démontré son efficacité dans <strong>les</strong> cures de pseudarthrose<br />
grâce à son action ostéo-inductrice. Afin de mieux préciser <strong>les</strong><br />
indications de la rh-BMP 7 (OP-1), une étude a été menée pour<br />
le sauvetage de pseudarthroses rebel<strong>les</strong> du membre inférieur<br />
évoluant depuis plus d’un an.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Il s’agissait de 7 pseudarthroses<br />
(4 fémurs et 3 tibias) chez 7 patients. Le nombre total d’interventions<br />
antérieures variait de 4 à 10, supérieur à 5 dans 5 cas. Tous<br />
<strong>les</strong> cas avaient déjà fait l’objet d’une autogreffe avec prélèvement<br />
d’une crête iliaque dans 2 cas, de 2 crêtes dans trois cas et<br />
de 3 crêtes (antérieures et postérieure) dans 2 cas. Le délai traumatisme<br />
initial – implantation d’OP-1 était en moyenne de<br />
38,6 mois (16-72 mois). Une indication d’amputation avait été<br />
retenue initialement pour trois patients. Une infection était présente<br />
dans 5 cas.<br />
RÉSULTATS. L’ostéosynthèse a été changée dans 5 cas sur<br />
7 lors de la prise en charge. Elle était confiée à un fixateur<br />
externe dans 4 cas et à une synthèse interne dans 3 cas. L’intervention<br />
comprenait la résection du foyer de pseudarthrose et<br />
l’implantation de BMP associée à une autogreffe spongieuse<br />
dans 4 cas sur 7. La consolidation a été obtenue dans 6 cas sur 7,<br />
à un délai moyen de 5 mois. Un patient n’a pas consolidé : il<br />
s’agissait d’une pseudarthrose d’une fracture de tibia survenue<br />
72 mois auparavant, pour laquelle la rh-BMP avait été implantée<br />
sans modifier l’ostéosynthèse (clou centromédullaire en place<br />
depuis 4 ans). Aucun effet secondaire n’a été observé, en particulier<br />
pas d’ostéolyse, pas d’ossifications hétérotopiques, pas de<br />
fractures itératives.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. Le coût d’utilisation de<br />
ce produit doit être considéré, cependant le coût de l’échec <strong>des</strong><br />
traitements précédents permet de relativiser <strong>les</strong> dépenses engendrées<br />
par la BMP. Nous présentons ainsi 7 cas où le recours à<br />
l’implantation de rh-BMP constituait la dernière chance d’obtenir<br />
la consolidation, l’éventualité d’une amputation ayant été<br />
envisagée. Six fois sur 7 la consolidation a été obtenue dans ces<br />
cas désespérés pour <strong>les</strong>quel<strong>les</strong> différentes techniques de greffe et<br />
d’ostéosynthèse avait déjà été tentées, sans succès. La rh-BMP<br />
apparaît donc comme un traitement d’appoint intéressant dans la<br />
prise en charge <strong>des</strong> pseudarthroses <strong>des</strong> os longs, permettant la<br />
consolidation de formes rebel<strong>les</strong>, sous réserve de respecter <strong>les</strong><br />
lois de la biomécanique <strong>des</strong> fractures et de réaliser une ostéosynthèse<br />
stable et irréprochable. La BMP 7 semble démontrer son<br />
efficacité comme agent ostéo-conducteur et ostéo-inducteur. Elle<br />
demeure l’unique alternative thérapeutique <strong>des</strong> pseudarthroses<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S133<br />
invétérées <strong>des</strong> os longs quel<strong>les</strong> soient aseptiques ou septiques. Le<br />
recours à cette hormone de croissance pourrait être utile dans la<br />
reconstruction de gros défects osseux (rescellements <strong>des</strong> arthroplasties<br />
tota<strong>les</strong> de hanche).<br />
* Falah Bachour, Service d’Orthopédie-Traumatologie,<br />
CHRU de Lille, Hôpital Roger-Salengro,<br />
rue Emile-Laine, 59037 Lille Cedex.<br />
228 Aide à la consolidation <strong>des</strong> fractures<br />
ouvertes de jambes par injection<br />
percutanée de moelle osseuse<br />
concentrée autologue : étude pilote<br />
sur 21 cas<br />
Marc WALLON *, Isabelle DESBOIS,<br />
Jorge DOMENECH, Patrick COIPEAU,<br />
Philippe ROSSET<br />
INTRODUCTION. On estime à 24 pour 100 000 l’incidence<br />
<strong>des</strong> fractures de jambe, dont 25 % sont ouvertes. Les fractures<br />
ouvertes se compliquent de retard de consolidation ou de pseudarthrose<br />
dans 12 à 100 % <strong>des</strong> cas selon <strong>les</strong> séries. Les répercussions<br />
socio-économiques sont majeures. L’injection percutanée<br />
de moelle osseuse est utilisée pour traiter <strong>les</strong> pseudarthroses avec<br />
<strong>des</strong> taux de consolidation comparab<strong>les</strong> à la technique de référence,<br />
l’autogreffe spongieuse, qui nécessite un abord chirurgical<br />
et s’accompagne de douleurs résiduel<strong>les</strong> sur le site de prise de<br />
greffe. L’injection de moelle osseuse concentrée autologue<br />
(IMOCA) a été proposée par Hernigou dans le traitement <strong>des</strong><br />
pseudarthroses. Plutôt que d’attendre la survenue d’une pseudarthrose<br />
pour l’utiliser, il nous a semblé intéressant de l’utiliser<br />
dans <strong>les</strong> fractures ouvertes à fort risque de pseudarthrose, à partir<br />
du 30 e jour.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. De juin 2002 à décembre 2004,<br />
48 fractures ouvertes de jambes de l’adulte ont été suivies en<br />
prospectif. Vingt-sept fractures ont consolidé sans geste supplémentaire.<br />
Pour 21 fractures avec facteurs de risque faisant suspecter<br />
un retard de consolidation (défaut de réduction, fracture<br />
complexe, ouverture justifiant l’utilisation d’un fixateur externe,<br />
évolution radio non favorable), avant d’envisager un geste d’aide<br />
à la consolidation osseuse, une IMOCA a été réalisée en première<br />
intention.<br />
RÉSULTATS. Sur ces 21 cas d’IMOCA (dans un délai de précoce<br />
de 54 jours (31-74) pour 13 cas et dans un délai plus long de<br />
149 jours (83-96) pour 8 cas) : 15 ont consolidé sans autre geste,<br />
en moyenne 139 jours après l’IMOCA. Le taux de consolidation<br />
avec l’IMOCA était de 71 % et seuls 14 % de l’ensemble <strong>des</strong><br />
48 fractures ouvertes ont eu besoin d’une greffe osseuse conventionnelle.<br />
La richesse de la moelle en cellu<strong>les</strong> souches était exprimée<br />
en nombre de CFU-F (Colony Forming Unit-Fibroblaste). Il<br />
n’y avait pas de différence entre le nombre de CFU <strong>des</strong> IMOCA<br />
précoces ou tardives. Il existait une corrélation entre le nombre de<br />
CFU injecté et la consolidation : 425 x 103 dans <strong>les</strong> échecs et<br />
922 x 103 dans <strong>les</strong> succès. L’existence d’un écart interfragmen-
3S134 81 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
taire supérieur à 4 mm après réduction était un facteur de non<br />
consolidation. Le fait de fumer n’avait pas d’incidence.<br />
CONCLUSION. Grâce à son caractère peu invasif, l’IMOCA<br />
peut être proposée rapidement (à partir de J 30) après le traumatisme<br />
chez <strong>les</strong> mala<strong>des</strong> à risque de retard de consolidation. On<br />
229 Résultats et facteurs pronostiques<br />
de la chirurgie de reprise du canal<br />
carpien : à propos de 38 cas<br />
Mathieu CESAR *, Tanguy MRAOVIC,<br />
Cyril LAZERGES, Fabien LACOMBE,<br />
Marie-Noelle THAURY, Bertrand COULET,<br />
Michel CHAMMAS<br />
INTRODUCTION. Dans la littérature, <strong>les</strong> résultats de la chirurgie<br />
de reprise du syndrome du canal carpien opéré sont variab<strong>les</strong><br />
et incertains. Le but de notre étude était d’évaluer <strong>les</strong><br />
résultats de 38 reprises et de mieux définir <strong>les</strong> facteurs pronostiques<br />
de cette chirurgie.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Il s’agit d’une étude rétrospective<br />
de 38 patients, 28 femmes et 10 hommes, d’âge moyen<br />
49 ans (22-77), répondant aux critères d’inclusion suivants : contexte<br />
de chirurgie primaire idiopathique, « récidive vraie » <strong>des</strong><br />
symptômes et/ou apparition de nouveaux symptômes. La chirurgie<br />
primaire comportait : 5 libérations sous endoscopie, 5 en<br />
« mini-open » et 28 à ciel ouvert. Douze patients ont eu plus<br />
d’une intervention. Les gestes opératoires lors de la reprise se<br />
répartissaient en 38 exoneurolyses, 1 neurolyse interfasciculaire,<br />
26 sections du rétinaculum <strong>des</strong> fléchisseurs reformé, 15 enfouissements<br />
de la branche cutanée palmaire du médian et 16 procédés<br />
de couverture (11 lambeaux graisseux hypothénariens,<br />
1 greffon veineux, 1 carré pronateur, 2 lambeaux synoviaux et<br />
1 manchon de silicone). En pré et postopératoire ont été colligés<br />
<strong>des</strong> signes subjectifs (paresthésies, score EVA, indice de satisfaction)<br />
et d’examen (déficit sensitivo-moteur, tests de provocation,<br />
test d’étirement de Hunter, multiple crush syndrome). Une<br />
classification décroissante <strong>des</strong> résultats en 4 classes a été utilisée<br />
pour l’analyse pronostique.<br />
RÉSULTATS. Le recul moyen de la série était de 49 mois<br />
(6-84). Nous avons noté 11 guérisons, 15 améliorations,<br />
9 tableaux cliniques inchangés et 3 aggravations <strong>des</strong> symptômes.<br />
L’analyse statistique a pu mettre en évidence <strong>les</strong> facteurs pronostiques<br />
péjoratifs suivants : fibrose interfasciculaire (le franchissement<br />
de la barrière épineurale semble être un facteur<br />
déterminant), atteinte sévère de la sensibilité préopératoire, nombre<br />
d’interventions antérieures supérieur ou égal à 2, atteinte<br />
directe iatrogène du nerf médian, névrome de la branche cutanée<br />
palmaire du nerf médian, maladie professionnelle.<br />
CONCLUSION. La prise en charge thérapeutique, au vu de<br />
ces facteurs pronostiques, doit évoluer vers la nécessité de<br />
Séance du 9 novembre matin<br />
POIGNET/MAIN<br />
peut espérer éviter à 70 % d’entre eux le recours à un geste<br />
d’aide à la consolidation plus agressif.<br />
* Marc Wallon, Services d’Orthopédie 1 et 2, CHU de Tours,<br />
Hôpital Trousseau, 37044 Tours Cedex 1.<br />
reconstruction épineurale en cas de fibrose interfasciculaire et<br />
vers une prise en charge pluridisciplinaire <strong>des</strong> douleurs rebel<strong>les</strong><br />
post-lésions fasciculaires.<br />
* Mathieu Cesar, Service d’Orthopédie II,<br />
Hôpital Lapeyronie, 371, avenue du Doyen-Gaston-Giraud,<br />
34295 Montpellier Cedex.<br />
230 Intérêt du traitement chirurgical du<br />
syndrôme du canal carpien chez<br />
<strong>les</strong> patients de plus de 70 ans : à<br />
propos de 30 canaux carpiens<br />
Christophe CHANTELOT *,<br />
Jean-Batiste CASSION,<br />
Jean-François HURTEVENT,<br />
Guillaume WAVREILLE,<br />
Sandra CHANTELOT-LAHOUDE,<br />
Christian FONTAINE<br />
INTRODUCTION. L’indication du traitement chirurgical du<br />
syndrome du canal carpien au-delà de 70 ans est discutée. Le but<br />
de cette étude rétrospective était d’apprécier l’efficacité du traitement<br />
chirurgical et la capacité de récupération clinique et électrique<br />
sur ce terrain particulier.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Nous avons donc revu<br />
24 patients (30 poignets) disposant d’un électromyogramme<br />
(EMG) pré et postopératoire opérés entre 1994 et 2002, la<br />
moyenne d’âge était de 76 ans. Le recul moyen était de 45 mois<br />
(19 à 120 mois). La technique opératoire était à ciel ouvert par<br />
mini abord. Les patients ont été revus cliniquement par un opérateur<br />
indépendant et l’examen comprenait: la mesure du pinch, du<br />
grasp au dynamomètre, la mesure du Weber, recherche d’un<br />
signe de Tinel ou Phalen. L’interrogatoire recherchait la persistance<br />
de douleurs, de paresthésies, d’une gêne dans <strong>les</strong> activités<br />
quotidiennes. Enfin, la satisfaction du patient a été appréciée.<br />
L’EMG était réalisé par un même opérateur, sur la même<br />
machine et comportait 2 tests sensitifs et 2 tests moteurs. Les<br />
EMG pré et postopératoires ont été comparés.<br />
RÉSULTATS. Vingt-deux patients étaient très satisfaits,<br />
1 satisfait, 1 mécontent. Le Weber moyen était à 5,8 mm, le<br />
pinch moyen à 10,6 Kg force et le Grasp à 19,6 Kg force. Au<br />
niveau électrique, on retrouvait une amélioration significative
<strong>des</strong> vitesses de conduction sensitive étagées (14,9 m/s au canal<br />
en préopératoire contre 37,74 m/s en postopératoire) et de<br />
l’amplitude (7,3 µv en préopératoire contre 13,74 µv en postopératoire).<br />
Au niveau moteur, l’amplitude moyenne était très améliorée<br />
(3,19 mv initialement contre 4,97 mv en postopératoire)<br />
ainsi que la comparaison <strong>des</strong> latences motrices interosseux/lombricaux<br />
(2,42 ms initialement contre 0,85 ms à la révision). Neuf<br />
patients qui avaient en préopératoire une abolition totale <strong>des</strong><br />
réponses sensitives ont récupéré une réponse. On distinguait<br />
3 catégories de patients sur le plan électrique : 11 poignets normalisés,<br />
16 présentent <strong>des</strong> séquel<strong>les</strong> liées à la sévérité initiale, et<br />
3 ralentissements au canal sans atteinte clinique.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. Le traitement chirurgical<br />
du canal carpien même sévère, est justifié et efficace chez la personne<br />
âgée compte tenu de la récupération électrique, clinique et<br />
de la satisfaction <strong>des</strong> mala<strong>des</strong>. De plus, il s’agit d’un geste simple<br />
peut invasif qui se fait sous anesthésie tronculaire basse avec<br />
peu de contre-indications.<br />
231 Ouverture du canal carpien par<br />
mini-abord distal : quel geste réalisons-nous<br />
?<br />
Fabien WALLACH *, Michel VERCOUTÈRE,<br />
Romain CHASSAT, Marc-David BENJOAR,<br />
David BOCCARA, Yves AIGRAIN,<br />
Bernard AUGEREAU, Emmanuel MASMEJEAN<br />
INTRODUCTION. Les techniques d’ouverture du canal carpien<br />
par mini-abord se sont développées, avec l’avantage de ne<br />
pas inciser le talon de la main, source de dysesthésies et/ou de<br />
douleurs postopératoires fréquentes. Mais quel geste réalisonsnous<br />
? Quelle est la qualité de la section du rétinaculum <strong>des</strong><br />
fléchisseurs ? Quel est le risque pour <strong>les</strong> éléments nob<strong>les</strong> de la<br />
région ? Notre étude cadavérique tente de répondre à ces questions.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Cette étude porte sur 8 sujets<br />
embaumés, avec étude <strong>des</strong> 2 poignets. Seize sections du rétinaculum<br />
<strong>des</strong> fléchisseurs ont été réalisées, par un mini-abord distal<br />
dans l’axe de la 3 e commissure, à l’aide du couteau lumineux<br />
Knifelight ® . Ensuite <strong>les</strong> plans cutanés et sous-cutanés ont été<br />
ouverts pour réaliser <strong>les</strong> mesures qualitatives et quantitatives.<br />
RÉSULTATS. L’ouverture du rétinaculum a été complète<br />
dans tous <strong>les</strong> cas avec respect <strong>des</strong> structures vasculaires et nerveuses.<br />
Le nerf médian était complètement couvert par la partie<br />
radiale du rétinaculum dans 13 cas sur 16 (dans 3 cas le nerf était<br />
partiellement dans la cicatrice). La partie radiale du rétinaculum<br />
après section mesurait en moyenne 10 mm contre 5 pour la partie<br />
ulnaire. Le départ du rameau thénarien se situait en moyenne<br />
à 3 mm avant la terminaison du rétinaculum, toujours sur le bord<br />
radial du nerf médian et a toujours été retrouvé en dehors de la<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S135<br />
section du rétinaculum. Le rétinaculum mesurait en moyenne<br />
24 mm de long.<br />
DISCUSSION. L’abord de distal à proximal est préféré par de<br />
nombreux auteurs pour le contrôle de l’arcade palmaire superficielle<br />
et le contrôle de la section de la partie distale du rétinaculum<br />
<strong>des</strong> fléchisseurs qui est plus étroite à cet endroit. Cette étude<br />
confirme en règle l’absence de risque pour <strong>les</strong> éléments nob<strong>les</strong><br />
par cette technique. L’existence d’un nerf parfaitement couvert<br />
par la partie radiale du rétinaculum est probablement un élément<br />
favorable, par rapport à l’incarcération du nerf dans le site de<br />
section, qui est une <strong>des</strong> causes rapportées d’adhérence et de récidive<br />
du syndrome du canal carpien.<br />
CONCLUSION. Avec une technique par mini-abord distal,<br />
on peut bien contrôler la section du rétinaculum <strong>des</strong> fléchisseurs<br />
avec une section nettement sur le versant ulnaire du canal carpien<br />
avec un nerf médian qui reste le plus souvent complètement<br />
couvert par la partie radiale du rétinaculum, ce qui permet au<br />
nerf de garder son espace de glissement et d’éviter la zone de<br />
fibrose cicatricielle.<br />
* Christophe Chantelot, Service Orthopédie B,<br />
Hôpital Roger-Salengro, CHU de Lille, rue Emile-Laine,<br />
59000 Lille. * Fabien Wallach, Service d’Orthopédie, HEGP,<br />
20, rue Leblanc, 75015 Paris.<br />
232 Compressions du nerf ulnaire à la<br />
loge de Guyon à forme déficitaire :<br />
critères pronostiques après libération<br />
chirurgicale par comparaison<br />
aux formes déficitaires au coude<br />
Manuel VALVERDE *, Sophie DOMERGUE,<br />
Cyril LAZERGES, Marie-Noelle THAURY,<br />
Bertrand COULET, Michel CHAMMAS<br />
INTRODUCTION. Comme au coude, <strong>les</strong> compressions au<br />
Guyon sont caractérisées par la fréquence <strong>des</strong> formes déficitaires.<br />
Nous avons étudié l’influence <strong>des</strong> facteurs âge, sévérité <strong>des</strong><br />
signes déficitaires et délai opératoire dans cette localisation plus<br />
proche <strong>des</strong> effecteurs par comparaison à la décompression du<br />
nerf ulnaire au coude.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Les auteurs rapportent une série<br />
de 20 patients, d’âge moyen 51 ans (19-71), avec un recul moyen<br />
de 46 mois (12-98). Le site de compression selon Gross et Gelberman<br />
était 11 fois en zone 1 (sensitivo-motrice), 6 fois en zone<br />
2 (branche motrice pure), 2 fois en zone 3 (sensitive) et 1 fois en<br />
zone 2 à 3. Douze <strong>des</strong> zones 1 et 3 avaient un test de Weber<br />
> 5 mm. Toutes <strong>les</strong> zones 1 et 2 avaient un déficit moteur. L’électromyogramme<br />
était dans tous <strong>les</strong> cas perturbé et confirmait le<br />
diagnostic. Le délai moyen entre l’apparition <strong>des</strong> signes et la chirurgie<br />
était de 7 mois (1-25). Les étiologies étaient variées :<br />
7 causes post-traumatiques (3 cals vicieux du radius, 1 pseudarthrose<br />
de l’apophyse unciforme de l’hamatum, 2 luxations intracarpiennes,<br />
1 cause microtraumatique), 2 hypertrophies musculaires,<br />
2 kystes synoviaux carpo-métacarpien, 1 myosite ossifiante,<br />
1 synovite rhumatoïde, 7 ban<strong>des</strong> fibreuses (5 arca<strong>des</strong> uncipisifor-
3S136 81 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
miennes, 1 expansion du fléchisseur ulnaire du carpe, 1 fibrose<br />
après chirurgie du canal carpien). Nous avons comparé cette série<br />
à une autre série de 28 patients (âge moyen 52 ans) opérés pour<br />
compression du nerf ulnaire au coude à forme déficitaire traités<br />
par transposition sous-musculaire.<br />
RÉSULTATS. Dans la série « Guyon », la récupération sensitive<br />
était bonne (11/12 améliorés dont 8 cas normalisés avec un<br />
test de Weber moyen de 7,9mm en préopératoire et de 5,5 mm en<br />
postopératoire). La récupération motrice était complète pour<br />
9 patients, partielle pour 7, nulle pour 2. L’électromyogramme à<br />
la révision confirmait la libération nerveuse. La récupération<br />
sensitive paraît meilleure au niveau du Guyon avec 2/3 de normalisations<br />
contre 1/2 au niveau du coude. La récupération<br />
motrice par contre semble similaire avec 1 normalisation sur 2.<br />
Les critères péjoratifs âge, sévérité <strong>des</strong> signes déficitaires et délai<br />
opératoire se retrouvent dans <strong>les</strong> deux localisations avec une<br />
influence semblant moindre pour le déficit sensitif et identique<br />
pour le déficit moteur.<br />
CONCLUSION. La compression du nerf ulnaire au poignet à<br />
forme déficitaire a une fausse réputation de meilleur pronostic<br />
après libération par rapport à la forme déficitaire au coude.<br />
* Manuel Valverde, Service de Chirurgie Orthopédique 2<br />
et Chirurgie de la Main, Hôpital Lapeyronie, 371,<br />
avenue du Doyen-Gaston-Giraud, 34295 Montpellier Cedex.<br />
233 Traitement de la rhizarthrose par<br />
trapézectomie partielle avec tendinoplastie<br />
de suspension : résultats<br />
à 5 ans<br />
Vincent MARTINEL *, Pierre MANSAT,<br />
Michel MANSAT, Paul BONNEVIALLE<br />
INTRODUCTION. De nombreuses techniques chirurgica<strong>les</strong><br />
ont été proposées pour le traitement de la rhizarthrose. Depuis<br />
1999, nous réalisons une trapézectomie partielle avec tendinoplastie<br />
de recentrage, lorsque l’interligne scapho-trapézien est<br />
préservé, pour supprimer le conflit douloureux tout en évitant le<br />
collapsus de la colonne du pouce. Nous avons évalué dans cette<br />
étude <strong>les</strong> résultats à moyen terme de cette technique.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. De 1999 à 2001, 33 patients<br />
(41 cas) présentant une rhizarthrose ont été opérés selon cette<br />
technique. Il s’agissait de 30 femmes et 3 hommes de 57 ans<br />
d’âge moyen. La douleur représentait le symptôme prédominant.<br />
Selon la classification de Dell, il existait 23 sta<strong>des</strong> II, 15 sta<strong>des</strong><br />
III et 3 sta<strong>des</strong> IV. L’articulation scapho-trapézienne ne montrait<br />
aucun signe dégénératif. La trapézectomie partielle était effectuée<br />
selon la voie d’abord de Gedda-Moberg. Une résection du<br />
tiers distal du trapèze était effectuée à la scie oscillante, et une<br />
résection de l’ostéophyte médial complétait la libération de<br />
l’espace. Un fragment tendineux prélevé aux dépens du long<br />
abducteur du pouce, passé autour du tendon fléchisseur radial du<br />
carpe, permettait de stabiliser et recentrer le 1 er métacarpien. Les<br />
patients étaient immobilisés par un pansement commissural pen-<br />
dant 15 jours, puis par une orthèse radio-commissurale pendant<br />
1 mois, puis par une orthèse commissurale pendant 1,5 mois.<br />
RÉSULTATS. Avec un recul moyen de 57 mois, 90,4 % <strong>des</strong><br />
patients étaient satisfaits de leur intervention. Selon la classification<br />
d’Alnot et Muller, l’indolence était obtenue dans 71 % <strong>des</strong><br />
cas et une douleur apparaissait lors d’efforts important dans<br />
17 % <strong>des</strong> cas. L’opposition, selon Kapandji, était de 9,56 sur 10,<br />
avec une rétropulsion de 2,56 sur 4. Les résultats globaux montraient<br />
une force en Tip Pinch de 5,30 kg et en Key Pinch de<br />
6,51 kg. L’angle M1-M2 était de 34° en moyenne. Le recul<br />
moyen du premier métacarpien était de 2,52 mm. Une évolution<br />
arthrosique au niveau de la scapho-trapézienne était notée 2 fois.<br />
Trois patients ont développé une algoneurodystrophie, un patient<br />
a présenté une ténosynovite du long fléchisseur du pouce et dans<br />
un cas, <strong>des</strong> dysesthésies péri-cicatriciel<strong>les</strong> ont été notées. Dans<br />
un cas, une arthrodèse spontanée trapézo-métacarpienne a été<br />
constatée.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. La trapézectomie partielle<br />
avec tendinoplastie est efficace dans le traitement de la<br />
rhizarthrose, avec <strong>des</strong> résultats globaux satisfaisants à cinq ans<br />
de recul. Elle permet la restitution d’une mobilité proche de la<br />
normale sans douleur avec une force satisfaisante. Elle doit être<br />
réservée au rhizarthrose avec un interligne scapho-trapézien<br />
intact.<br />
* Vincent Martinel, Service d’Orthopédie-Traumatologie,<br />
CHU de Toulouse-Purpan, place du Docteur-Baylac,<br />
31059 Toulouse Cedex.<br />
234 Traitement chirurgical de la<br />
rhizarthrose par trapézectomie partielle<br />
et interposition d’une autogreffe<br />
chondrocostale : à propos de<br />
100 cas<br />
David GALLINET *, Daniel LEPAGE,<br />
Laurent OBERT, Patrick GARBUIO,<br />
Yves TROPET<br />
INTRODUCTION. La trapézectomie reste l’intervention de<br />
référence dans la rhizartrose. Le collapsus de la loge trapézienne<br />
est rendu responsable par certains (ligamentoplastie associée ou<br />
non) d’une perte de forceet de déformations intracarpiennes. Les<br />
auteurs rapportent leur expérience de la trapézectomie partielle<br />
avec interposition d’une autogreffe chondrocostale alliant <strong>les</strong><br />
avantages de la trapézectomie et d’un spacer biologique sans <strong>les</strong><br />
inconvénients d’une arthroplastie.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Entre 1992 et 2005, 97 patients<br />
(84 % de femmes), 116 pouces ont été opérés et revus par un<br />
évaluateur indépendant (mobilité du pouce, force de la pince,<br />
qualité de vie, évolution radiologique et viabilité du greffon).<br />
Tous <strong>les</strong> patients étaient classés au minimum Dell 2 et Eaton 2.<br />
21 % <strong>des</strong> patients présentaient une arthrose STT. La trapézectomie<br />
partielle était réalisée par une voie d’abord dorsale sous<br />
ALR. La prise de greffe s’effectuait par abord direct de la 9 e côte
sous AG brève. Le greffon cartilagineux était remodelé afin de<br />
s’adapter à la cavité de trapézectomie. Une immobilisation plâtrée<br />
en position de fonction du pouce était maintenue 3 semaines.<br />
RÉSULTATS. Cent pouces, 82 patients d’âge moyen 64,6 ans<br />
(47-82) ont été revus avec un recul moyen de 68 mois (4-159).<br />
Une effraction pleurale non drainée, 5 ablations de greffon et<br />
4 algodystrophies ont été observées. 96 % <strong>des</strong> patients étaient<br />
très satisfaits ou satisfaits avec 84 % de sta<strong>des</strong> Alnot 0. L’opposition<br />
selon Kapandji était de 9,29 (6-10), le Grasp de 24 Kg/Force<br />
(5-54), la force latéropulpaire de 5,39 Kg/Force (1-14,5). Radiologiquement,<br />
un tassement moyen de 3 mm de la loge a été<br />
observé ainsi qu’une décompensation faible de l’hyperextension<br />
métacarpophalangienne (de 16,4° à 22,4°). 45 % <strong>des</strong> patients<br />
présentaient une arthrose STT sans retentissement clinique. Le<br />
Dash était en moyenne de 18,8. Les biopsies et <strong>les</strong> IRM réalisées<br />
ont montré un minime degré de métaplasie osseuse dans et au<br />
pourtour du greffon.<br />
DISCUSSION. Nos résultats sont similaires aux autres techniques<br />
de la littérature sauf pour la force où le gain est plus<br />
important. À plus de 5 ans de recul le greffon n’est pas usé, la<br />
hauteur de la colonne du pouce est respectée et <strong>les</strong> zones de<br />
métaplasies osseuses sont ponctuel<strong>les</strong>. Le résultat est stable dans<br />
le temps, et la morbidité du site de prélèvement costal est anecdotique.<br />
L’interposition d’un matériel biologique peu sensible à<br />
l’usure et son association à la trapézectomie partielle permet de<br />
retrouver un pouce stable et fort.<br />
* David Gallinet, Service d’Orthopédie, CHU Jean-Minjoz,<br />
boulevard Fleming, 25000 Besançon.<br />
235 La prothèse trapézo-métacarpienne<br />
GUEPAR dans la rhizarthrose<br />
: à propos de 84 prothèses<br />
revues au recul moyen de 50 mois<br />
Christophe CHANTELOT *, Stéphane LEMOINE,<br />
Guillaume WAVREILLE, Marc LIMOUSIN,<br />
Christian FONTAINE, Jean-Yves ALNOT<br />
INTRODUCTION. La prise en charge chirurgicale de l’arthrose<br />
trapézo-métacarpienne est discutable. La trapézectomie est<br />
caractérisée par sa simplicité face à l’arthroplastie. La prothèse<br />
GUEPAR est de type rotule, rétentiveavec un centre de rotation<br />
trapézien. La tige métacarpienne et la cupule trapézienne sont<br />
cimentées. Le but de cette étude était d’évaluer à moyen terme<br />
<strong>les</strong> résultats cliniques et radiographiques de l’arthroplastie totale<br />
trapézo-métacarpienne.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Il s’agit d’une étude rétrospective<br />
bicentrique, incluant 84 prothèses, mises en place chez 68<br />
patients. Le recul moyen était de 50 mois. La série était composée<br />
de 82 % de femmes, dont l’âge moyen était de 61 ans.<br />
Soixante-seize pour cent <strong>des</strong> patients étaient retraités au moment<br />
de l’intervention. Avant l’intervention, le score de Kapandji<br />
moyen était de 8,6. Nous avons utilisé la classification radiogra-<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S137<br />
phique de Dell pour apprécier l’arthose (pincement,<br />
luxation,...) : il existait 94 % de sta<strong>des</strong> II et III et 35 % <strong>des</strong><br />
rhizarthroses étaient excentrées.<br />
RÉSULTATS. Au recul, quatre-vingt-douze pour cent <strong>des</strong><br />
patients déclaraient être satisfaits ou très satisfaits. Le score de<br />
Kapandji moyen après l’opération était de 9,2. Soixante-dixhuit<br />
pour cent <strong>des</strong> prothèses étaient indolores. La force moyenne<br />
était comparable à celle du côté opposé avec un Jamar moyen à<br />
20,8 kg, un pinch moyen à 6 kg. Nous n’avons recensé aucune<br />
luxation, aucune infection et aucune fracture peropératoire du<br />
trapèze ou du premier métacarpien. Le taux de <strong>des</strong>cellement<br />
global était de 12 %, il existait 33 % de liserés non évolutifs.<br />
Le taux de survie de la prothèse, avec <strong>des</strong>cellement comme événement<br />
terminal, était de 87 % à 50 mois. Une seule reprise chirurgicale<br />
a été nécessaire pour un <strong>des</strong>cellement de cupule<br />
trapézienne.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. Cliniquement, <strong>les</strong> résultats<br />
obtenus par <strong>les</strong> patients semblent être de qualité et leur donner,<br />
dans l’ensemble, satisfaction. Le résultat bon fonctionnel<br />
était précoce et durable. Nous avons remarqué un nombre non<br />
négligeable de <strong>des</strong>cellements précoces, certainement dus à une<br />
erreur technique (cimentation insuffisante), ce qui nous fait espérer<br />
un taux de <strong>des</strong>cellements et de lisérés moindre. La plupart de<br />
<strong>des</strong>cellement étaient asymptomatiques. Un recul plus important<br />
est nécessaire pour évaluer la pérennité du résultat clinique et le<br />
devenir radiographique <strong>des</strong> liserés observés.<br />
* Christophe Chantelot, Service d’Orthopédie,<br />
Hôpital Bichat, 46, rue Henri-Huchard, 75018 Paris.<br />
236 Rhizarthrose primitive : traitement<br />
par arthroplastie totale non cimentée<br />
revêtue d’hydroxyapatite<br />
(ARPE)<br />
Adil TRABELSI *, Omar NAJI, Sohria HACINI,<br />
Pascal KOUYOUMDJAN, Gérard ASENCIO<br />
INTRODUCTION. Les auteurs rapportent <strong>les</strong> résultats de<br />
40 arthroplasties trapézo-métacarpiennes pour rhizarthrose primitive.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Il s’agissait de 40 patients, dont<br />
4 hommes et 36 femmes, d’âge moyen 67 ans (52 à 83 ans). Le<br />
côté dominant était concerné dans 70 % <strong>des</strong> cas. L’arthrose était<br />
cotée selon la classification radiologique de Dell : stade 2 dans<br />
21 % <strong>des</strong> cas, stade 3 dans 75 %, et stade 4 dans 4 %. L’intervention<br />
a été réalisée par voie d’abord postéro-latérale dans la majorité<br />
<strong>des</strong> cas (30 cas), dans <strong>les</strong> autres cas par voie de Gedda<br />
Moberg. L’arthroplastie a comporté une résection <strong>des</strong> surfaces<br />
articulaires et la mise en place d’implants ARPE (Biomet) associant<br />
une cupule trapézienne vissée, une tige métacarpienne en<br />
press-fit, tous deux revêtus d’hydroxyapatite.Une immobilisation<br />
postopératoire du poignet prenent la colonne du pouce a été<br />
maintenue 4 semaines. Aucun geste complémentaire n’a été réalisé<br />
sur la MP ou sur la première commissure.
3S138 81 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
RÉSULTATS. Tous <strong>les</strong> patients ont été suivis avec un recul de<br />
12 à 114 mois. Nous avons déploré une fracture peropératoire du<br />
trapèze, sans conséquence sur la stabilité de la cup et sur l’évolution<br />
ultérieure, une luxation à J 45, réduite chirurgicalement, et<br />
1 <strong>des</strong>cellement repris à 1 an par trapézectomie. Les 39 patients<br />
restants ont été revus cliniquement et radiologiquement : 81 %<br />
d’entre eux étaient indolores, 15 % présentaient <strong>des</strong> douleurs<br />
occasionnel<strong>les</strong>, 1 seul (3 %) une douleur inchangée. 85 % présentaient<br />
un score de Kapandji supérieur à 8, et 15 % un score<br />
entre 4 et 7. La force testée au Jamar et au Pinch test était supérieure<br />
au préopératoire dans 71 % <strong>des</strong> cas, identique dans 18 %,<br />
diminuée dans 11 %. Les patients étaient subjectivement satisfaits<br />
pour 85 % d’entre eux. Il existait une bonne intégration<br />
osseuse sans liseré ou réction corticale sur <strong>les</strong> radiographies.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. À court et moyen terme,<br />
l’arthroplastie totale sans ciment pour rhizarthrose primitive permet<br />
une restitution gestuelle et fonctionnelle satisfaisante pour<br />
une population à large prédominance féminine. Elle permet de<br />
conserver la longueur de la colonne du pouce et la force de préhension<br />
pollici digitale. L’intégration osseuse obtenue dans la<br />
quasi totalité <strong>des</strong> cas doit cependant être suivie à plus long terme.<br />
* Adil Trabelsi, Clinique Fontvert, Val du Soleil, 84700 Sorgues.<br />
237 Résection arthroscopique <strong>des</strong> kystes<br />
synoviaux dorsaux du poignet :<br />
à propos de 52 cas<br />
Romain CHASSAT *, Geoffroy NOURISSAT,<br />
Geraud CHAUMEIL, Christian DUMONTIER,<br />
Levon DOURSOUNIAN<br />
INTRODUCTION. Le traitement chirurgical <strong>des</strong> kystes dorsaux<br />
du poignet n’est pas toujours suivi de succès. La récidive<br />
est particulièrement mal vécue par <strong>les</strong> patients et ce quelle que<br />
soit la technique employée. L’arthroscopie semble être une alternative<br />
intéressante à la chirurgie à ciel ouvert. Les objectifs ont<br />
été d’évaluer <strong>les</strong> résultats de cette technique.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Nous avons revu 54 kystes chez<br />
52 patients. Les critères d’évaluation étaient <strong>les</strong> mobilités actives<br />
pré et postopératoires et la force comparée au côté sain. Les récidives,<br />
<strong>les</strong> complications postopératoires et tardives, la durée<br />
d’arrêt de travail ont été notées. La technique chirurgicale utilise<br />
<strong>les</strong> voies ¾, 6R, 6U, UMC et RMC. Nous réalisions d’abord un<br />
débridement scapho-lunaire permettant l’exposition du collet<br />
kystique. Une résection capsulaire était ensuite réalisée exposant<br />
<strong>les</strong> tendons extenseurs.<br />
RÉSULTATS. Le recul moyen est de 28 mois (6 à 78 mois).<br />
L’arrêt de travail moyen est de 8,8 jours, le temps opératoire de<br />
41 minutes (25 à 90). Dans 67 % <strong>des</strong> cas, l’intervention a été<br />
jugée aisée. Trois conversions en chirurgie à ciel ouvert ont été<br />
réalisées. Comme complication, nous retrouvons un hématome<br />
enkysté avec dysesthésies et une algodystrophie secondaire. La<br />
douleur préopératoire moyenne était de 3,37 pour 1,76 en postopératoire.<br />
Au recul, la flexion dorsale moyenne était de 89 % en<br />
comparaison avec le côté controlatéral, la flexion palmaire<br />
moyenne était de 88 %. Les douleurs et la gêne postopératoire<br />
disparaissent en 3 mois, même en cas de récidive, la rançon<br />
esthétique quasi négligeable. Nous avons observé 16 récidives<br />
soit 29,7 %, où 9 patients avaient une EVA supérieure à 3.<br />
DISCUSSION. Soixante pour cent <strong>des</strong> récidives et <strong>les</strong> 3 cas<br />
de conversion sont apparues dans la première année de notre<br />
expérience. Malgré une expérience croissante cette intervention<br />
nous est apparue très difficile dans 1 cas sur 3. Aucun critère per<br />
opératoire ne permet actuellement de prévoir un risque de récidive.<br />
Les récidives sont apparues à un recul moyen de 37 mois<br />
(extrême 6 à 78 mois). Au-delà de deux ans, on peut s’interroger<br />
s’agit il d’une récidive ou de l’apparition d’un nouveau kyste ?<br />
CONCLUSION. Malgré de nombreuses récidive, seuls<br />
5 patients ont consulté. Ce taux est peut-être corrélé au long recul<br />
de notre étude. Même si nous continuons le traitement arthroscopique<br />
<strong>des</strong> kystes synoviaux (pour <strong>les</strong> bons résultats fonctionnels<br />
obtenus), peu d’éléments bibliographiques permettent de préconiser<br />
de façon systématique une prise en charge arthroscopique.<br />
* Romain Chassat, Hôpital Saint-Antoine, 184,<br />
rue Faubourg-Saint-Antoine, 75012 Paris.<br />
238 Résultats à cinq ans de l’arthrodèse<br />
capitato-lunaire dans l’arthrose<br />
du poignet<br />
Alexandre DURAND *, Bruno NURBEL,<br />
Alain HARISBOURE, Jamal KASSOUMA,<br />
Jean-Paul ESCHARD, Gil<strong>les</strong> DAUTEL,<br />
Emile DEHOUX<br />
INTRODUCTION. L’arthrose du poignet, d’origine médicale<br />
ou post-traumatique, aboutit à une adaptation biomécanique du<br />
poignet avec pour corollaire une douleur, une perte de force et de<br />
mobilité. Cette étude avait pour objectif d’évaluer <strong>les</strong> résultats de<br />
l’arthrodèse capitato-lunaire dans une série de 31 patients présentant<br />
une arthrose de poignet.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Trente et un patients (32 poignets)<br />
de 50,8 ans d’âge moyen, présentant une arthrose d’origine<br />
médicale ou post-traumatique, ont été revus avec un recul moyen<br />
de 5 ans. La cause de l’arthrose était : une disjonction scapholunaire<br />
évoluée dans 12 cas, une pseudarthrose du scaphoïde carpien<br />
évoluée dans 12 cas, une chondrocalcinose dans 3 cas, et une<br />
autre cause dans 5 cas. Tous <strong>les</strong> patients ont bénéficié de la même<br />
intervention : scaphoïdectomie totale et arthrodèse capitatolunaire<br />
ostéosynthésée par hauban en compression. Chaque poignet<br />
a été évalué en préopératoire et au recul maximal, cliniquement<br />
et radiologiquement. Le score de Green et O’Brien modifié<br />
par Cooney a été utilisé, ainsi que le score du DASH. La hauteur<br />
du carpe, l’angle radio-lunaire et capitato-lunaire, la dérive<br />
ulnaire du carpe et l’index de dérive ulnaire du lunatum (angle de<br />
Sokolow) ont été mesuré en préopératoire et au recul maximal.<br />
RÉSULTATS. Au recul maximal, la douleur était significativement<br />
diminuée, la force était significativement améliorée, et la
mobilité restait stable en flexion-extension à 62° (65° en préopératoire).<br />
Le score de Cooney était significativement amélioré. Le<br />
score du DASH était en moyenne de 27,74 sur 100. Le taux de<br />
consolidation de l’arthrodèse était de 97 % (31 fusions radiologiques<br />
pour 32 interventions). Les ang<strong>les</strong> radio-lunaire et capitatolunaire<br />
étaient normalisés, la hauteur du carpe était conservée. Il<br />
n’existait pas de détérioration radiologique de l’interligne radiolunaire<br />
au recul maximal. Le taux global de complication était de<br />
18,75 %. Vingt-sept patients sur 31 étaient satisfaits de l’intervention.<br />
DISCUSSION. L’arthrose du poignet, qu’elle qu’en soit<br />
l’origine, aboutit à un tableau douloureux et raide, avec une<br />
perte de force. Les options chirurgica<strong>les</strong> sont l’arthrodèse globale,<br />
<strong>les</strong> arthrodèses partiel<strong>les</strong> intra-carpiennes et l’arthroplastie.<br />
L’arthrodèse capitato-lunaire est une solution chirurgicale<br />
qui permet d’obtenir <strong>des</strong> résultats comparab<strong>les</strong> à d’autres techniques,<br />
satisfaisants à 5 ans de recul. Le taux de pseudarthrodèse<br />
est faible.<br />
CONCLUSION. L’arthrodèse capitato-lunaire a notre préférence<br />
dans le traitement de l’arthrose du poignet, tant que l’interligne<br />
radio-lunaire est conservé. L’ostéosynthèse par hauban,<br />
technique originale, participe à diminuer le taux de pseudarthrodèse.<br />
* Alexandre Durand, Service d’Orthopédie-Traumatologie,<br />
Hôpital Maison-Blanche, CHU de Reims,<br />
45, rue Cognacq-Jay, 51092 Reims Cedex.<br />
239 Étude de la mobilité en extension<br />
du poignet en cas d’ulna minus :<br />
nouvelle approche physiopathologique<br />
de la maladie de Kienböck<br />
Jorge BORETTO *, Agustin DONNDORFF,<br />
Veronica ALFIE, Gerardo GALLUCCI,<br />
MICHEL CHAMMAS, Pablo DE CARLI,<br />
D. Luis MUSCOLO<br />
INTRODUCTION. Le rôle de l’ulna minus est controversé<br />
dans la physiopathologie de la maladie de Kienböck. La pression<br />
veineuse intra-osseuse du lunatum augmente lors de l’extension<br />
du poignet pouvant représenter un facteur de risque d’ostéonécrose.<br />
Le but de cette étude était de déterminer si l’ulna minus,<br />
plus fréquent dans la maladie de Kienböck, est associée à une<br />
mobilité plus importante du poignet notamment en extension.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Cette étude a été réalisée dans<br />
une population de cent personnes saines soit 50 hommes et<br />
50 femmes, d’âge entre 20 et 70 ans. Une radiographie de face<br />
en pronosupination neutre du poignet dominant a été faite pour<br />
mesure de la variance ulnaire. Les poignets ont été classés en<br />
trois groupes : variance ulnaire minus, neutre et plus. La mobilité<br />
du poignet et de l’avant-bras a été mesurée grâce à un goniomètre.<br />
La laxité articulaire a été évaluée en mesurant la distance<br />
pouce avant-bras, l’extension métacarpo phalangienne, interphalangienne<br />
proximale et distale, ainsi que l’extension du<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S139<br />
coude. La différence de chaque variable mesuré a été évaluée par<br />
rapport à la variance ulnaire. Le test d’Anova a été utilisé pour<br />
analyser <strong>les</strong> différences parmi <strong>les</strong> groupes selon la variance<br />
ulnaire, le sexe et l’âge <strong>des</strong> patients.<br />
RÉSULTATS. Cinquante pour cent <strong>des</strong> patients avaient un<br />
ulna minus, 29 % neutre et 21 % plus. Une différence significative<br />
dans l’extension du poignet est trouvée chez <strong>les</strong> patients porteurs<br />
d’une variante ulnaire minus (ulna minus : 82,6°±0,9°;<br />
ulna neutre : 78,4°±1,6° et ulna plus : 79,6°±1,3°. p 0,027). Il<br />
n’y avait pas de différence dans <strong>les</strong> autres variab<strong>les</strong> de la mobilité<br />
ou dans la laxité articulaire.<br />
DISCUSSION. Les résultats de cet étude soutiennent l’hypothèse<br />
que <strong>les</strong> poignets porteurs d’une variante ulnaire minus ont<br />
une mobilité en extension plus importante. Ceci est susceptible<br />
d’augmenter la pression veineuse intra osseuse du lunatum et<br />
peut représenter un facteur de risque d’ostéonécrose.<br />
* Jorge Boretto, Service de Chirurgie Orthopédique 2<br />
et Chirurgie de la Main, Hôpital Lapeyronie,<br />
34295 Montpellier Cedex 5.<br />
240 Les mycétomes de la main : à propos<br />
de 14 observations<br />
Mouhamadou HABIB SY *, Amadou GUEYE<br />
DIOUF, Jean-Claude SANÉ, Mame THIERNO<br />
DIENG, André Daniel SANÉ,<br />
Char<strong>les</strong> BERTIN-DIÉMÉ, Seydina SEYE<br />
INTRODUCTION. Le mycétome est une affection infectieuse<br />
d’origine mycosique (maduro-mycétome) ou bactérienne<br />
(actino-mycétome) de la peau, <strong>des</strong> parties mol<strong>les</strong> et/ou de l’os. Il<br />
est caractérisé par une pseudo-tumeur d’évolution lente et chronique<br />
inflammatoire polyfistulisée marquée par l’émission de<br />
grains. Il est localisé dans plus de 50 % au pied et dans près de<br />
75 % au membre inférieur. L’atteinte de la main reste la plus fréquente<br />
du membre supérieur presqu’aucune série ne dépasse<br />
15 cas. Les objectifs de cette étude étaient d’évaluer la fréquence<br />
<strong>des</strong> atteintes de la main, d’étudier <strong>les</strong> différentes formes anatomo-cliniques<br />
et topographiques et de recenser <strong>les</strong> différents<br />
facteurs pronostiques de cette localisation.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Dix hommes et 4 femmes âgés<br />
en moyenne de 31,5 ans (extrêmes 18 et 50 ans) ont présenté<br />
8 mycétomes localisés au doigt et 6 atteintes extra-digita<strong>les</strong>. La<br />
durée moyenne d’évolution de la symptomatologie était de<br />
7,5 ans avec <strong>des</strong> extrêmes de 1 an et 30 ans. L’étude était rétrospective<br />
et continue. Elle a porté sur 15 dossiers (1 exclu) tirés<br />
d’un effectif global de 214 réunis entre juillet 1988 et avril 2003.<br />
La couleur du grain et/ou l’examen myco-bactériologique a permis<br />
de déterminer l’étiologie microbienne.<br />
RÉSULTATS. L’atteinte de la main reste la plus fréquente du<br />
membre supérieur 6,1 % et la 3 e localisation extra-podale derrière<br />
la cheville et le genou. La répartition topographique notait<br />
8 mycétomes digitaux dont 5 au pouce, 1 palmaire moyenne,<br />
1 thénarienne et 4 digito-palmaires dont 2 atteintes globa<strong>les</strong> de la
3S140 81 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
main. La pseudo-tumeur était diffuse polyfistilusée 11 fois,<br />
scléro-hyperthrophique 1 fois et encapsulée fistulisée 2 fois.<br />
L’étiologie fungique était notée dans 92,8 % cas avec une exclusivité<br />
du grain noir. Une ostéite sous-jacente a été chez 9 patients<br />
(62,4 %). Cette complication osseuse et/ou articulaire a fortement<br />
déterminé l’indication d’amputation (3/14) ou de désarticulation<br />
(2/14).<br />
245 Repérage premier <strong>des</strong> branches<br />
sensitives du nerf radial dans<br />
l’abord latéral de la diaphyse<br />
humérale<br />
Didier HANNOUCHE *, Christian DE LA PORTE,<br />
Alain-Char<strong>les</strong> MASQUELET<br />
INTRODUCTION. Plusieurs voies d’abord ont été proposées<br />
pour le traitement <strong>des</strong> fractures ou <strong>des</strong> pseudarthroses de l’humérus.<br />
La voie d’abord antéro-latérale classique, bien que couramment<br />
pratiquée, comporte un certain nombre d’inconvénients :<br />
abord distal extensif en cas de fracture du tiers proximal ou<br />
moyen de la diaphyse humérale, difficultés d’exposition du nerf<br />
radial dans sa gouttière, en particulier en cas de mobilité franche<br />
du foyer fracturaire ou de pseudarthrose. Nous proposons une<br />
voie d’abord latérale alternative fondée sur le repérage premier<br />
du nerf cutané latéral inférieur du bras (NCLI), et du nerf cutané<br />
postérieur de l’avant-bras (NCPAB, ou n. cutaneus antibrachii<br />
dorsalis, ou rameau cutané externe du nerf radial), branches<br />
superficiel<strong>les</strong> de division du nerf radial. Les objectifs de cette<br />
étude anatomique étaient d’étudier <strong>les</strong> rapports du nerf radial et<br />
de ses branches de division superficiel<strong>les</strong> à la face latérale du<br />
bras, et d’évaluer la faisabilité et l’intérêt d’un repérage premier<br />
de ces branches dans l’accès à la face latérale de l’humérus.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. L’étude porte sur 12 membres<br />
supérieurs provenant de 6 cadavres frais, dont 3 étaient préalablement<br />
injectés, et sur 3 dissections chirurgica<strong>les</strong>. Dans tous <strong>les</strong><br />
cas, la voie d’abord empruntée était une voie latérale stricte. Les<br />
branches nerveuses superficiel<strong>les</strong> du nerf radial étaient repérées<br />
dans le tissu sous-cutané immédiatement en avant du septum<br />
inter-musculaire externe. El<strong>les</strong> étaient ensuite disséquées de distal<br />
en proximal jusqu’à leur origine sur le nerf radial, puis refoulées<br />
avec ce dernier pour exposer la diaphyse humérale. L’étude<br />
comportait une analyse <strong>des</strong>criptive du nombre de rameaux nerveux,<br />
de leur ramification, de leur rapport avec le septum intermusculaire<br />
externe et le chef latéral du triceps.<br />
RÉSULTATS. Le NCLI naissait dans tous <strong>les</strong> cas du nerf<br />
radial à la partie basse de la gouttière de torsion, à environ 14 cm<br />
de l’épicondyle latéral. Le NCPAB naissait dans tous <strong>les</strong> cas du<br />
NCLI à 6 cm de l’épicondyle latéral, et cheminait superficiellement<br />
en avant du plan du septum inter-musculaire externe. Son<br />
Séance du 9 novembre matin<br />
TRAUMATOLOGIE<br />
CONCLUSION. Le mycétome de la main reste une localisation<br />
rare. Il présente plusieurs formes cliniques en rapport avec<br />
l’extension longitudinale et transversale du processus myco-bactérien<br />
mais aussi avec la profondeur et l’agent en cause. Une chirurgie<br />
radicale mutilante est souvent difficilement évitable.<br />
* Mouhamadou Habib Sy, BP 15, 551 Dakar, Sénégal.<br />
trajet était vertical <strong>des</strong>cendant, en direction de la partie postérolatérale<br />
de l’avant-bras.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. Compte tenu de leur diamètre<br />
et de leur émergence constante entre musc<strong>les</strong> brachioradial<br />
et triceps brachial, <strong>les</strong> nerfs NCPAB et NCLI constituent <strong>des</strong><br />
repères facilement identifiab<strong>les</strong> dans l’espace sous-cutané situé<br />
en regard du septum inter-musculaire externe du bras. Leur dissection<br />
proximale permet alors d’identifier aisément le nerf<br />
radial et d’exposer la diaphyse humérale aussi bien en avant<br />
qu’en arrière du septum inter-musculaire externe.<br />
* Didier Hannouche, Hôpital Lariboisière,<br />
2, rue Ambrosie-Paré, 75475 Paris Cedex.<br />
246 Désassemblage postopératoire<br />
<strong>des</strong> prothèses de tête radiale à<br />
cupule mobile GUEPAR : une complication<br />
inattendue<br />
Matthias WINTER *, Cédric PELEGRI,<br />
Vincent PAOLI, Fabrice DELÉPINE,<br />
Alexandru NEBUNESCU, Fernand DE PERETTI<br />
INTRODUCTION. La mise en place d’une prothèse représente<br />
actuellement une solution adaptée face aux fractures non<br />
reconstructib<strong>les</strong> de la tête radiale. L’utilisation d’un implant<br />
bipolaire permet une meilleure congruence de la prothèse avec le<br />
capitellum lors <strong>des</strong> mouvements du coude.<br />
Les auteurs rapportent une séquelle non encore décrite faisant<br />
suite à l’implantation de prothèse de tête radiale GUEPAR<br />
(Depuy) : le désassemblage de la cupule mobile chez 4 patients.<br />
OBSERVATION. Le phénomène a eu lieu dans tous <strong>les</strong> cas<br />
après un effort de poigne, entraînant une impotence douloureuse.<br />
L’expulsion extra-articulaire spontanée de la cupule prothétique<br />
a entraîné une sédation immédiate <strong>des</strong> douleurs. Les patients<br />
ayant subi cette complication ont bénéficié une fois d’un réassemblage<br />
avec modification de la taille de la cupule, deux fois<br />
d’une résection simple de la tête radiale. Dans un cas, le patient a<br />
refusé toute reprise chirurgicale.<br />
DISCUSSION. Une étude du système de rétention de la<br />
cupule mobile a permis de mettre en évidence une laxité exagé-
ée de la cupule sur la tige radiale. L’étude du seuil de désassemblage<br />
à 4°, 20° et 37°C montre une influence de la température.<br />
L’existence d’une platine prenant appui sur la cupule entraîne un<br />
effet de came favorisant le désassemblage de la prothèse. Ces<br />
phénomènes sont représentés sur un schéma explicatif. Tous ces<br />
éléments doivent être connus lors de l’établissement du cahier<br />
<strong>des</strong> charges d’une prothèse de tête radiale à cupule mobile.<br />
* Matthias Winter, Service d’Orthopédie Traumatologie,<br />
Hôpital Saint-Roch, 5, rue Pierre-Dévoluy, 06000 Nice.<br />
247 Bases anatomiques de la capsulotomie<br />
arthroscopique du coude<br />
Patricia THOREUX *, Camille BLONDEAU,<br />
Sébastien DURAND, Thierry BÉGUÉ,<br />
Alain-Char<strong>les</strong> MASQUELET<br />
INTRODUCTION. La raideur est un problème fréquent dans<br />
la pathologie du coude, post-traumatique ou non. Le traitement<br />
opératoire <strong>des</strong> raideurs du coude associe en règle plusieurs gestes<br />
et fréquemment une capsulotomie antérieure. L’arthroscopie du<br />
coude est une alternative certaine au traitement chirurgical mais<br />
la technique de capsulotomie arthroscopique reste controversée<br />
dans la littérature. Notre objectif était l’étude anatomique de la<br />
capsule antérieure du coude pour la réalisation d’une capsulotomie<br />
arthroscopique efficace et à moindre risque vasculo-nerveux.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Dix cou<strong>des</strong> cadavériques<br />
(6 embaumés et 4 frais) ont été disséqués. Les insertions de la<br />
capsule antérieure, leurs variations anatomiques et <strong>les</strong> rapports<br />
avec <strong>les</strong> structures neurovasculaires de voisinage (nerfs radial et<br />
médian, artère brachialis) ont été étudiés après dissection <strong>des</strong> éléments<br />
sous microscope. L’influence de la flexion du coude a été<br />
analysée sur <strong>les</strong> cou<strong>des</strong> frais sous contrôle scopique. Les distances<br />
entre la capsule antérieure et <strong>les</strong> structures neurovasculaires<br />
ont été évaluées sur <strong>les</strong> 10 cou<strong>des</strong> avec une règle millimétrique à<br />
4 niveaux de référence [(1) limite proximale de la fossette coronoide,<br />
(2) ligne passant par <strong>les</strong> 2 épicondy<strong>les</strong>, (3) interligne articulaire,<br />
(4) ligne horizontal passant par le col du radius]. Les<br />
insertions de la capsule antérieure ont été évaluées sur <strong>les</strong> 6 cou<strong>des</strong><br />
embaumés en mesurant la distance entre la capsule et la jonction<br />
os-cartilage au niveau de la fossette coronoide et de la<br />
fossette supracondylienne. Après individualisation radioopaque<br />
de chaque structure, <strong>les</strong> différents rapports ont été étudiés, sur <strong>les</strong><br />
cou<strong>des</strong> frais, avec <strong>des</strong> clichés radioscopiques de profil à 3 positions<br />
de flexion du coude.<br />
RÉSULTATS. Le nerf radial était la structure la plus proche de<br />
la capsule antérieure mais était dans cette série toujours protégé<br />
par le muscle brachialis. La distance entre la capsule et <strong>les</strong> structures<br />
neurovasculaires était toujours supérieure, quel que soit<br />
l’élément concerné, à la partie proximale de l’articulation. La<br />
position à 90° flexion permettait la meilleure distension capsulaire<br />
avec une sécurité optimale vis à vis <strong>des</strong> éléments nerveux.<br />
DISCUSSION. L’incidence <strong>des</strong> complications vasculo-nerveuses<br />
varie dans <strong>les</strong> séries d’arthroscopie du coude entre 0 % et<br />
14 % ; <strong>les</strong> travaux anatomiques publiés jusqu’alors concernent<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S141<br />
essentiellement <strong>les</strong> rapports entre <strong>les</strong> voies d’abord arthroscopiques<br />
et <strong>les</strong> structures de voisinage. Notre étude permet une analyse<br />
précise <strong>des</strong> relations entre la capsule et <strong>les</strong> éléments vasculonerveux<br />
dont découlent <strong>des</strong> propositions techniques précises pour<br />
la réalisation d’une capsulotomie arthroscopique. Cette étude<br />
devra être prolongée par l’analyse expérimentale de la faisabilité<br />
et <strong>des</strong> risques spécifiques de la capsulotomie arthroscopique.<br />
* Patricia Thoreux, Service de Chirurgie Orthopédique,<br />
Hôpital Avicenne, 125, route de Stalingrad,<br />
93009-Bobigny Cedex.<br />
248 Assistance arthroscopique et voie<br />
percutanée dans <strong>les</strong> ostéosynthèses<br />
du scaphoïde carpien<br />
Christophe MATHOULIN *<br />
INTRODUCTION. Le but du traitement était d’obtenir une<br />
réduction parfaitement anatomique <strong>des</strong> fragments osseux en évitant<br />
toute malrotation et en permettant l’utilisation de la main<br />
immédiatement. L’arthroscopie du poignet permet de vérifier et<br />
d’aider à la qualité de cette réduction en controlant l’ostéosynthèse<br />
par voie cutanée et de vérifier la bonne position proximale<br />
de la vis.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Nous avons opéré 35 patients<br />
par cette technique (27 hommes pour 8 femmes). L’âge moyen<br />
était de 31 ans (entre 18 et 51 ans). Le délai moyen entre la fracture<br />
et la chirurgie était de 12 jours (entre 1 et 21 jours). Il s’agissait<br />
toujours de fracture du corps du scaphoïde (stade 3 et 4 de<br />
Schernberg). Il s’agissait dans 15 cas d’accident de motocyclette<br />
et dans 13 cas d’accident de sport. Les patients ont toujours été<br />
opérés en chirurgie ambulatoire sous anesthésie loco-régionale et<br />
garrot pneumatique. L’ostéosynthèse se faisait par une très courte<br />
voie d’abord palmaire située à la base du tubercule distal du scaphoïde.<br />
L’arthroscope était mis en place par une entrée 3-4 radio<br />
carpienne et radiale médio-carpienne. La réduction pouvait faire<br />
appel à <strong>des</strong> manœuvres internes. L’ostéosynthèse définitive fait<br />
appel à une vis de Herbert dans 31 cas et d’une vis cannulée<br />
résorbable dans 4 cas. La mobilité était débutée immédiatement<br />
en laissant le patient choisir lui-même son secteur de mobilité.<br />
RÉSULTATS. Notre recul moyen était cours de 27 mois<br />
(entre 4 et 52 mois). Le temps de consolidation moyen était de<br />
7,1 semaines (entre 5 et 8). Les mobilités et la force musculaire<br />
ont été améliorées dans tous <strong>les</strong> cas. Les douleurs ont disparues<br />
complètement dans tous <strong>les</strong> cas. Nous avons dus cretirés 3 fois la<br />
vis pour <strong>des</strong> douleurs dista<strong>les</strong> et nous avons eu une lésion du nerf<br />
interosseux postérieur. L’utilisation du « Mayo Wrist Score » a<br />
montré 8 excellents résultats et 4 bons résultats.<br />
CONCLUSION. Cette technique nous apparaît simple et très<br />
confortable pour <strong>les</strong> patients. Elle permet de retrouver un poignet<br />
indolore et fonctionnel rapidement en évitant la pose d’un platre.<br />
* Christophe Mathoulin, Clinique Jouvenet,<br />
6, square Jouvenet, 75016 Paris.
3S142 81 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
249 Fracture du radius distal à déplacement<br />
dorsal traitées par plaque palmaire<br />
avec et sans vis<br />
autobloquées : étude prospective<br />
continue comparative de 38 cas<br />
Laurent OBERT *, Nicolas BLANCHET,<br />
Grégoire LECLERC, Séverin ROCHET,<br />
Lucas REHBY, Yves TROPET, Patrick GARBUIO<br />
INTRODUCTION. L’ostéosynthèse par plaque antérieure <strong>des</strong><br />
fractures du radius distal à déplacement dorsal se développe pour<br />
minimiser le déplacement secondaire et la raideur que le brochage<br />
ne parvient pas totalement à éviter. La possiblité d’utiliser<br />
<strong>des</strong> vis autobloquées semble séduisante. Est-ce nécessaire ?<br />
2 groupes de patients traités par plaque anatomiques avec et sans<br />
vis autobloquées sont comparés.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Trente-six patients d’âge<br />
moyen 58,2 ans (17-85) ont été ostéosynthésés par plaque antérieure.<br />
Vingt-deux patients par plaque anatomique à vis standards<br />
16 par plaque antérieure à vis autobloquées. Tous <strong>les</strong><br />
patients ont été évalués par un opérateur indépendant grâce au<br />
score de Herzberg, de Gartland et Werley et du DASH. La pente<br />
radiale de face, la bascule sagittale et la variance ulnaire étaient<br />
mesurées et comparées entre le préopératoire le plus grand recul.<br />
Aucune immobilisation postopératoire n’était prescrite.<br />
RÉSULTATS. Les 38 patients ont été revus avec un recul<br />
moyen de 18 mois (6-60). Un déplacement secondaire sont à<br />
déplorer dans chaque groupe. La durée d’hospitalisation<br />
(4,1 jours) et le DASH (24) et l’absence de perte de réduction<br />
étaient similaires dans <strong>les</strong> 2 groupes. Le score de herzberg était<br />
meilleur dans le groupe plaque à vis autobloquée (84,3/100<br />
versus 76,5/100).<br />
DISCUSSION. L’intérêt principal de la plaque antérieure<br />
réside dans la réduction anatomique de la corticale antérieure,<br />
élément essentiel de la stabilité <strong>des</strong> fractures du radius distal. Les<br />
plaques antérieures ne nécessitent pas d’ablation et permettent<br />
une récupération de l’autonomie plus rapide. L’intérêt <strong>des</strong> vis<br />
autobloquées n’est pas démontré dans ce travail et leur prix<br />
10 fois plus élevé qu’une vis standard doit pousser <strong>les</strong> équipes à<br />
<strong>les</strong> évaluer pour <strong>les</strong> valider réellement. Il semble plus judicieux<br />
d’imaginer <strong>des</strong> vis qui tiendraient mieux dans l’os porotique que<br />
de penser que <strong>les</strong> vis doivent d’abord tenir dans la plaque.<br />
* Laurent Obert, Service d’Orthopédie, CHU Jean-Minjoz,<br />
boulevard Fleming, 25000 Besançon.<br />
250 Perte de substance ostéo-articulaire<br />
du radius distal traitée par<br />
greffe de cartilage<br />
Laurent OBERT *, Daniel LEPAGE,<br />
Stéphanie GOUZOU, Jean-Michel COGNET,<br />
Yves TROPET, Patrick GARBUIO<br />
INTRODUCTION. Les auteurs rapportent 6 cas de perte de<br />
substance ostéo articulaire du radius du radius distal traités par<br />
greffe ostéo cartilagineuse costale et revus avec un recul minimum<br />
de 2 ans.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Cinq patients présentant un cals<br />
vicieux articulaire du radius distal, et une patiente pour arthrite<br />
septique du poignet ont été opérés avec résection de la zone<br />
détruite et remplacement par un greffon autologue chondro costal<br />
prélevé aux dépens de la 8 e ou de la 9 e côte. La voie d’abord<br />
dépendait de l’importance de la perte de substance (4 fois antérieures,<br />
2 fois postérieures). La fixation était assurée par une plaque.<br />
Une immobilisation de 3 mois chez le premier patient et de<br />
1,5 mois chez <strong>les</strong> autres patients ont été réalisées par plâtre antibrachio<br />
palmaire. L’évaluation fonctionnelle (score de Herzberg<br />
– DASH), a été réalisée à 6 mois et au plus grand recul. Le contrôle<br />
par imagerie (radiographie scanner et IRM était réalisé à<br />
6mois.<br />
RÉSULTATS. Les 5 cas de cals vicieux articulaires ont<br />
retrouvé une indolence au repos, un score de Herzberg égal à 72/<br />
100 (54-82) et un DASH égal à 38,3 (22,5-51,7). Dans tous ces<br />
cas, la consolidation a été obtenue et la vitalité du greffon confirmée<br />
par IRM. Au plus grand recul <strong>les</strong> résultats fonctionnels sont<br />
excellents pour le premier patient (amplitude et force de serrage<br />
équivalentes au côté controlatéral à 2 ans). Le cas du sepsis<br />
radio-carpien traité par greffe cartilagineuse à distance est considéré<br />
comme un échec du fait de la persistance <strong>des</strong> douleurs, malgré<br />
le maintien d’une fonction (volant flexion extension 64°,<br />
DASH = 52,5), l’absence de récidive du sepsis et le refus d’une<br />
arthrodèse.<br />
CONCLUSION. La reconstruction par greffon chondro costal<br />
est simple (adaptation au défect, fixation) et permet un resurfaçage<br />
en cas de cal vicieux articulaire vu tardivement avec <strong>des</strong>truction<br />
cartilagineuse ou sans possibilité de réduction de<br />
l’impaction articulaire. En cas de perte de substance sous-évaluée<br />
avec persistance d’un conflit postérieur <strong>les</strong> résultats sont<br />
décevants. L’absence d’autres solutions pour reconstruire une<br />
surface articulaire détruite est le principal argument justifiant<br />
cette technique opératoire simple et reproductible non rapportée<br />
jusqu’alors.<br />
* Laurent Obert, Service d’Orthopédie, CHU Jean-Minjoz,<br />
boulevard Fleming, 25000 Besançon.
251 Ostéosynthèse par plaque palmaire<br />
à stabilité angulaire <strong>des</strong> fractures<br />
articulaires du radius distal à<br />
déplacement postérieur<br />
Jorge BORETTO *, Veronica ALFIE,<br />
Agustin DONNDORFF, Gerardo GALLUCCI,<br />
Michel CHAMMAS, Pablo DE CARLI,<br />
D. Luis MUSCOLO<br />
INTRODUCTION. Difficulté de stabilisation et déplacements<br />
secondaires liés principalement à la comminution métaphysaire<br />
sont fréquemment observés en cas d’ostéosynthèse par broches<br />
<strong>des</strong> fractures articulaires du radius distal à déplacement postérieur.<br />
Le but de l’étude était d’évaluer l’intérêt et <strong>les</strong> complications<br />
de l’ostéosynthèse par plaque antérieure à stabilité<br />
angulaire dans une série continue de patients présentant une fracture<br />
articulaire du radius distal.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Vingt-deux patients soit 20 femmes<br />
et 2 hommes ayant un âge moyen de 68 ans (26-81 ans)<br />
ostéosynthésés par plaque antérieure sans libération du canal<br />
carpien pour une fracture articulaire du radius distal ont été revus<br />
rétrospectivement. Les fractures ont été classées selon la classification<br />
de la AO en C1 : 4 cas ; C2 : 8 cas et C3 : 10 cas. L’immobilisation<br />
postopératoire a été en moyenne de 2,5 semaines. Lors<br />
de la révision, un bilan clinique et fonctionnel a été fait incluant<br />
la mobilité, la force de serrage, la douleur et le délai au retour<br />
aux activités quotidiennes. Le bilan radiologique pré et postopératoire<br />
a évalué le degré de raccourcissement du radius, la<br />
variance radio-ulnaire, le déplacement de la pente radiale, de<br />
l’inclinaison palmaire et la congruence articulaire par rapport<br />
aux clichés controlatéraux. Le test de Student est la méthode statistique<br />
utilisée.<br />
RÉSULTATS. Trois patients seulement ont présenté une ténosynovite<br />
<strong>des</strong> extenseurs sur vis imposant l’ablation du matériel.<br />
Après un recul postopératoire moyen de dix mois (6-27 mois),<br />
<strong>les</strong> patients avaient une mobilité moyenne de 58º de flexion,<br />
66º d’extension, 90º de pronation et 88º de supination. La force<br />
de serrage du côté atteint représentait 84 % de la valeur du côté<br />
sain. Quinze patients ne présentaient aucune douleur, 5 avaient<br />
une douleur légère et 2 modérés. Le bilan radiographique a montré<br />
une hauteur radiale de 11,5 mm, une inclinaison radiale de<br />
21º, inclinaison palmaire de 4,6º et une variance radio ulnaire de<br />
+1 mm. Seule l’inclinaison palmaire a montré une différence<br />
significatif par rapport au côté sain. La marche d’escalier radiocarpienne<br />
moyen était de 0,1 mm.<br />
DISCUSSION. Les résultats obtenus dans cette étude montrent<br />
que la fixation par plaque palmaire à stabilité angulaire <strong>des</strong><br />
fractures articulaires du radius distal à déplacement postérieur<br />
confirme son efficacité même en cas de comminution métaphysaire<br />
et un faible taux de complication. Ceci est à mettre en<br />
balance avec son coût et la durée opératoire par rapport à l’ostéosynthèse<br />
par broches.<br />
* Jorge Boretto, Service de Chirurgie Orthopédique 2<br />
et Chirurgie de la Main, Hôpital Lapeyronie,<br />
34295 Montpellier Cedex 5.<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S143<br />
252 Plaies de la main par projectile :<br />
mécanismes lésionnels et conditionnement<br />
en urgence. À propos<br />
de 26 cas<br />
Alain FABRE *, Michel LEVADOUX,<br />
Bertrand BAUER, Eric TATON,<br />
Edouard VANGAVER, Jacques BATISSE<br />
INTRODUCTION. Les conflits civils, <strong>les</strong> attentats aveug<strong>les</strong><br />
ou <strong>les</strong> accidents industriels sont responsab<strong>les</strong> de lésions <strong>des</strong><br />
membres jusque là limitées au temps de guerre. Tout chirurgien<br />
traumatologue est donc susceptible de prendre en charge une<br />
plaie de la main par projectile. Après un rappel <strong>des</strong> mécanismes<br />
lésionnels, ce travail se propose de dégager quelques grands<br />
principes de stratégie chirurgicale.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Vingt-six b<strong>les</strong>sés de sexe masculin<br />
d’un âge moyen de 25 ans victimes de plaies de la main par<br />
projectile ont été traités en urgence (16 cas) ou en urgence différée<br />
avant la quarante huitième heure (10 cas). Les principes du<br />
conditionnement initial après bilan lésionnel reposaient sur le<br />
parage, l’hémostase et la stabilisation osseuse.<br />
RÉSULTATS. Les lésions observées étaient <strong>les</strong> suivantes :<br />
5 plaies par balle (dont 3 concernaient <strong>les</strong> doigts), 3 plaies par<br />
arme de chasse, 18 plaies par éclats dont 8 étaient associées à <strong>des</strong><br />
phénomènes de blast sévères (engins explosifs). 2 réparations<br />
d’un tronc artériel ont pu être réalisées en urgence, 6 segment<br />
digitaux ont été régularisés (dont une colonne du pouce) de<br />
même qu’une main dans la région métacarpienne. Dans 21 cas,<br />
la stabilisation a été assurée par <strong>des</strong> broches de kirschner ou un<br />
mini fixateur externe.<br />
DISCUSSION. Les projecti<strong>les</strong> pénétrants peuvent schématiquement<br />
être séparés en 2 groupes : <strong>les</strong> bal<strong>les</strong> (auxquel<strong>les</strong> on<br />
peut rattacher <strong>les</strong> cartouches de chasse) et <strong>les</strong> éclats. Lors <strong>des</strong><br />
conflits récents la majorité <strong>des</strong> plaies de guerre a été le fait de<br />
polycriblages, <strong>les</strong> b<strong>les</strong>sures de la main par éclats s’accompagnent<br />
la plupart du temps de lésions de blast qui en font toutes la<br />
gravité. La connaissance <strong>des</strong> mécanismes lésionnels de ces<br />
plaies est un préalable indispensable à leur prise en charge et<br />
nous proposons une conduite à tenir <strong>des</strong>tinée à conditionner au<br />
mieux ces mains avant de <strong>les</strong> transférer vers un centre spécialisé.<br />
CONCLUSION. Les lésions de la main par projectile se<br />
caractérisent par un taux de morbidité très élevé, leur prise en<br />
charge en urgence réalisée dans de bonnes conditions est la première<br />
étape d’une stratégie thérapeutique qui nécessitera de<br />
nombreuses réinterventions.<br />
* Alain Fabre, Hôpital Robert-Picqué, 351,<br />
route de Toulouse, BP 28, 33998 Bordeaux-Armées.
3S144 81 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
253 Prothèse partielle du scaphoïde<br />
par arthroscopie du poignet : recul<br />
minimum de 1 an<br />
Christophe MATHOULIN *,<br />
Massimo MASSARELLA<br />
INTRODUCTION. Les nécroses du pôle proximal du scaphoïde<br />
sont de traitement difficile et aléatoire en particulier<br />
chez <strong>les</strong> personnes âgées. Nous rapportons <strong>les</strong> résultats de la<br />
mise en place par arthroscopie d’un implant partiel en pyrocarbone.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Nous avons opéré 18 patients<br />
par cette technique. L’âge moyen était de 49 ans (entre 38 et<br />
81 ans). Il y avait deux populations distinctes : une première<br />
population de 6 patients âgés en moyenne de 76 ans (entre 72 et<br />
81 ans) avec une arthrose évoluée du poignet à la suite de<br />
nécrose du pôle proximal négligée ; une deuxième série de<br />
12 patients plus jeunes d’âge moyen 46 ans (entre 38 et 61 ans)<br />
dont la nécrose morcelée du pôle proximal rendait impossible la<br />
reconstruction par greffe et chez qui la conservation <strong>des</strong> cartilages<br />
nous a fait hésiter dans le choix d’une technique palliative<br />
plus invalidante. Tous <strong>les</strong> patients présentaient <strong>des</strong> baisses<br />
importantes de la mobilité et de la force musculaire ainsi que<br />
254 Résultats <strong>des</strong> prothèses tota<strong>les</strong><br />
d’épaule inversées après échec de<br />
chirurgie de la coiffe <strong>des</strong> rotateurs<br />
Jean-François GONZALEZ *, Luc FAVARD,<br />
François SIRVEAUX, GILLES WALCH,<br />
Daniel MOLÉ, Pascal BOILEAU<br />
INTRODUCTION. Le but de cette étude était de rapporter <strong>les</strong><br />
résultats à moyen et long terme de la prothèse totale d’épaule<br />
inversée (PTEI) après échec de chirurgie de la coiffe <strong>des</strong> rotateurs.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Étude rétrospective, multicentrique,<br />
continue de 46 PTEI réalisées entre janvier 1994 et avril<br />
2003 chez 44 patients présentant un échec de chirurgie de la<br />
coiffe <strong>des</strong> rotateurs. Deux patients sont décédés dans <strong>les</strong> deux<br />
premières années et 2 patients sont perdus de vue laissant<br />
42 prothèses chez 40 patients d’une moyenne d’âge de 71 ans.<br />
Treize patients avaient bénéficié d’une chirurgie réparatrice de<br />
la coiffe et 29 d’une chirurgie palliative (acromioplastie ou<br />
geste sur le long biceps). Trente patients présentaient une épaule<br />
pseudo-paralytique et 12 une épaule douloureuse avec élévation<br />
antérieure active (EAA) supérieure ou égale à 100°. Tous <strong>les</strong><br />
Séance du 9 novembre matin<br />
ÉPAULE<br />
<strong>des</strong> douleurs qui étaient invalidantes dans tous <strong>les</strong> cas. Les<br />
patients ont toujours été opérés en chirurgie ambulatoire sous<br />
anesthésie loco-régionale. L’arthroscope était mis en place par<br />
une entrée 6R et radiale médio carpienne. Une voie d’abord 3-4<br />
radio-carpienne de 0,7 cm environ permettait l’instrumentation.<br />
Après avoir retiré le pôle proximal, l’implant définitif était mis<br />
en place. La mobilité était débutée immédiatement en laissant le<br />
patient choisir lui-même son secteur de mobilité en fonction de<br />
ses douleurs post opératoires.<br />
RÉSULTATS. Notre recul moyen était cours de 36 mois<br />
(entre 12 et 63 mois). Les mobilités ont été améliorées dans tous<br />
<strong>les</strong> cas. Les douleurs ont disparu complètement dans 14 cas et<br />
ont été diminuées dans 2 cas. Nous avons eu une luxation antérieure<br />
de l’implant qui n’a pas posée de problème après replacement<br />
de l’implant. Nous avons eus 2 échecs qui ont nécéssité <strong>des</strong><br />
techniques palliatives.<br />
CONCLUSION. Cette technique de sauvetage nous apparaît<br />
simple et utile, très confortable pour <strong>les</strong> patients. Elle permet à<br />
<strong>des</strong> sujets âgés de retrouver un poignet mobile et indolore. Elle<br />
peut constituer chez <strong>les</strong> sujets plus jeunes, une solution thérapeutique<br />
d’attente intéressante car d’une grande simplicité, à condition<br />
de <strong>les</strong> prévenir que ce geste simple pour eux ne sera pas<br />
forcément définitif.<br />
* Christophe Mathoulin, Clinique Jouvenet,<br />
6, square Jouvenet, 75016 Paris.<br />
patients présentaient une rupture massive de la coiffe <strong>des</strong> rotateurs<br />
avec arthrose glèno-humérale (17) ou sans (25). Les<br />
patients ont été revus avec un recul moyen de 4 ans et 2 mois<br />
(2 à 10 ans).<br />
RÉSULTATS. On retrouve 6 complications (12 %) : 2 dévissages<br />
de glène, 1 fracture péri-prothétique postopératoire, 1 fistule<br />
axillaire aseptique, 1 <strong>des</strong>cellement huméral. Deux patients<br />
(5 %) ont été réopérés : 1 changement prothétique partiel et une<br />
excision de fistule. L’EAA a progressé significativement de 82°<br />
à 123° (p < 0,0001) et le score de Constant de 25 à 56 points<br />
(p < 0,0001). Les rotations actives n’ont pas été améliorées.<br />
Trente-sept patients (88 %) étaient très satisfaits ou satisfaits. Un<br />
teres minor intact est gage d’une meilleure rotation externe<br />
(7° versus 0°, p = 0,04). Radiologiquement, on retrouve 74 %<br />
d’encoches scapulaires, aucun <strong>des</strong>cellement de glène mais un<br />
<strong>des</strong>cellement huméral. Il n’y a pas de différence entre <strong>les</strong><br />
patients arthrosiques et <strong>les</strong> autres, ceux aux antécédents de chirurgie<br />
reconstructrice ou palliative. Les épau<strong>les</strong> douloureuses<br />
pures avaient globalement perdu de l’EAA après l’arthroplastie<br />
et leur taux de satisfaction était inférieur (27 % de déçus ou<br />
mécontents).<br />
CONCLUSION. Les résultats de la PTEI après échec de chirurgie<br />
de la coiffe sont bons mais inférieurs à une chirurgie primaire.<br />
Le type de chirurgie de la coiffe n’influence pas <strong>les</strong><br />
résultats. Les épau<strong>les</strong> pseudo-paralytiques persistantes consti-
tuent la meilleure indication. L’indication doit être prudente dans<br />
<strong>les</strong> épau<strong>les</strong> douloureuses pures du fait du risque de perte d’EAA<br />
et d’un indice de satisfaction moindre.<br />
* Jean-François Gonzalez, Service de Chirurgie Orthopédique<br />
et Traumatologie du Sport, CHU de Nice, L’Archet II,<br />
151, route de Saint-Antoine de-Ginestière,<br />
BP 3079, 06202 Nice Cedex 3.<br />
255 La prothèse totale d’épaule inversée<br />
Delta III : bilan de début<br />
d’expérience au CHU. Considérations<br />
à propos de 40 cas<br />
Guillaume GROSJEAN *, Fabrice DUPARC,<br />
Xavier ROUSSIGNOL, Gérard POLLE,<br />
Norman BIGA<br />
INTRODUCTION. Les échecs <strong>des</strong> prothèses tota<strong>les</strong> anatomiques<br />
dans le traitement <strong>des</strong> omarthroses avec rupture de<br />
coiffe ont conduit le Professeur Grammont à mettre au point<br />
une prothèse d’épaule « inversée », la prothèse Delta. En<br />
médialisant et en abaissant le centre de rotation de l’épaule, cet<br />
implant permet au deltoïde d’augmenter sa composante abductrice<br />
et coaptatrice et de retrouver une épaule fonctionnelle et<br />
indolore. Nous avons opéré 45 épau<strong>les</strong> entre 2001 et 2004 au<br />
CHU de Rouen. Le but de ce travail était d’évaluer cliniquement<br />
et radiologiquement <strong>les</strong> résultats obtenus après implantation<br />
de cette prothèse.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. L’étude monocentrique prospective<br />
a concerné 45 épau<strong>les</strong> chez 36 patients, d’âge moyen<br />
73,4 ans et qui présentaient une omarthrose sévère associée à<br />
une excentration de la tête humérale. La rupture irréparable <strong>des</strong><br />
tendons de la coiffe <strong>des</strong> rotateurs a été confirmée par examen<br />
tomodensitométrique. L’évaluation a été clinique en utilisant le<br />
score fonctionnel de Constant et radiographique. Les patients ont<br />
été revus à 6, 12, 24, et 36 mois par le même examinateur. Le<br />
recul moyen est de 14 mois (6 à 36).<br />
RÉSULTATS. Tous <strong>les</strong> patients sont satisfaits avec un gain sur<br />
le score de Constant de 35 points/100. La progression sur le<br />
score de la douleur est de 12,6 points/15. La progression est statistiquement<br />
significative pour l’élévation antérieure et latérale,<br />
de 62° en préopératoire à 113° en postopératoire (p < 0,001),<br />
mais l’amélioration <strong>des</strong> rotations est décevante. Au niveau radiologique,<br />
il apparaît précocement une encoche du pilier de la scapula<br />
dans un tiers <strong>des</strong> cas, traduisant une ostéolyse localisée,<br />
sans corrélation anatomique évidente. Cette encoche, lorsqu’elle<br />
est extensive, a une influence sur le score de Constant. Le potentiel<br />
de récupération du deltoïde, seul moteur restant, est bon dans<br />
la majorité <strong>des</strong> cas.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. La prothèse d’épaule<br />
Delta III permet d’obtenir une épaule fonctionnelle, stable et<br />
indolore. Elle améliore <strong>les</strong> mobilités surtout dans le secteur de<br />
l’élévation latérale et antérieure. Par son <strong>des</strong>sin et ses caractéris-<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S145<br />
tiques, elle entraîne une ostéolyse localisée du col de la scapula<br />
dont <strong>les</strong> conséquences sont inconnues à long terme.<br />
* Guillaume Grosjean, Service d’Orthopédie A,<br />
Hôpital Cochin, 27, rue du Faubourg-Saint-Jacques,<br />
75014 Paris.<br />
256 Analyse arthroscopique du conflit<br />
péri-prothétique de la prothèse<br />
totale inversée d’épaule : étude<br />
anatomique<br />
Jacques-Marie ADAM *, Fabrice DUPARC<br />
INTRODUCTION. Le développement au cours <strong>des</strong> dernières<br />
années de l’utilisation de la prothèse totale d’épaule inversée<br />
Delta III a conduit à observer certains phénomènes qui n’ont pas<br />
reçu d’explication formelle. Parmi ceux-ci, l’observation d’une<br />
encoche osseuse sous glénoïdienne est assez fréquemment rapportée,<br />
et semble en relation avec le frottement du bord de<br />
l’implant huméral contre la partie supérieure du pilier de la scapula<br />
et le tubercule infra-glénoïdal. L’objectif était d’effectuer<br />
un contrôle endo-articulaire <strong>des</strong> rapports réciproques entre <strong>les</strong><br />
implants prothétiques de la prothèse Delta III et <strong>les</strong> structures<br />
anatomiques articulaires et péri-articulaires, au cours d’unemobilisation<br />
en élévation antéro latérale et en rotation externe de<br />
l’épaule après implantation prothétique.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Colonne d’arthroscopie (SMITH<br />
and NEPHEW) : arthroscopie, source de lumière froide, monitor,<br />
système d’irrigation intra-articulaire de liquide et d’aspiration.<br />
Une prothèse Delta III associant métaglène, glénosphère, et<br />
implant huméral. Ancillaire de pose de la prothèse Delta III et<br />
visserie adaptée. Sujets cadavériques humains (n = 5 soit<br />
10 épau<strong>les</strong>). Cinq prothèses ont été mises par voie deltopectorale<br />
et 5 par voie trans-deltoïdienne. Les voies d’abord arthroscopiques<br />
étaient classiques antérieure et postérieure. Les arthroscopies<br />
ont été réalisées avec et sans irrigation.<br />
RÉSULTATS. Dans <strong>les</strong> 10 cas, le conflit entre le bord postéro-inférieur<br />
de la métaglène et le pilier de la scapula apparaissait<br />
en abduction à partir de 30° et était majoré en rotation<br />
externe. À partir de 60° d’abduction on observait une subluxation<br />
de la prothèse en rotation externe.<br />
DISCUSSION. Le conflit que l’on a observé sous arthroscopie<br />
pourrait expliquer cette image d’encoche au bord inférieur de<br />
glène qui peut aboutir à un <strong>des</strong>cellement de la pièce glénoïdienne.<br />
CONCLUSION. L’arthroscopie est réalisable après une prothèse<br />
totale inversée d’épaule. L’arthroscopie nous a apporté <strong>des</strong><br />
preuves du conflit péri-prothétique. Il faudra réévaluer sous arthroscopie<br />
le comportement intra-articulaire <strong>des</strong> nouvel<strong>les</strong> prothèses<br />
inversées.<br />
* Jacques-Marie Adam, Service d’Orthopédie,<br />
Hôpital Char<strong>les</strong>-Nicolle, 1, rue de Germont, 76000 Rouen.
3S146 81 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
257 Étude du comportement <strong>des</strong> vis de<br />
la prothèse inversée lors de différentes<br />
mises en charge<br />
Philippe CLAVERT *, Olivier DEVES, Joël KRIER,<br />
Pierre MILLE, Jean-Luc KAHN,<br />
Jean-François KEMPF<br />
INTRODUCTION. L’objectif de ce travail était de mettre au<br />
point un modèle aux éléments finis de la scapula et de l’extrémité<br />
proximale de l’humérus, afin d’évaluer la répartition et le<br />
flux <strong>des</strong> contraintes appliquées à la glène par la platine de la prothèse<br />
inversée Reversed (Tornier).<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. À partir de 153 coupes anatomiques<br />
et scanographiques, <strong>les</strong> contours de l’os cortical, de l’os<br />
spongieux de la scapula et de l’humérus ont été obtenus puis<br />
maillés avec le logiciel Patran. Le muscle deltoïde a été reconstruit<br />
puis maillé de la même façon, permettant de définir <strong>les</strong><br />
lignes d’effort de ces 3 faisceaux. La discrétisation a été faite<br />
avec <strong>des</strong> éléments de type tétrahédriques. Puis <strong>les</strong> pièces prothétiques<br />
maillées ont été implantées au niveau de l’humérus et de<br />
la scapula ; <strong>les</strong> vis de la platine ont été placées tel que : une vis<br />
bloquée dans le pied du processus coracoïde, une vis bloquée<br />
dans le pilier de la scapula et 2 vis antirotatoires (antérieure et<br />
postérieure) ; le plot central a été implanté en press-fit. Les propriétés<br />
mécaniques de chaque solide ont été incluses dans le<br />
modèle (module de Young et coefficient de poisson). Enfin, la<br />
scapula a été encastrée au niveau de son bord médial pour pouvoir<br />
étudier <strong>les</strong> contraintes appliquées au niveau de la glène. Les<br />
simulations ont fait varier : la position du bras (0, 30°, 60° et 90°<br />
d’abduction), ainsi que le positionnement <strong>des</strong> 2 vis bloquées<br />
(présence de l’une <strong>des</strong> vis ou <strong>des</strong> 2).<br />
RÉSULTATS. La position la plus défavorable en termes de<br />
contrainte et de déplacement est la position à 90° d’abduction.<br />
Dans tous <strong>les</strong> cas, la vis supérieure semble être soumise à <strong>des</strong><br />
contraintes supérieures à la vis inférieure (10 MPa vs 3 MPa).<br />
Cependant, la vis inférieure travaille en traction, quelque soit la<br />
position d’abduction, alors que la vis supérieure est soumise à<br />
<strong>des</strong> contraintes en compressions. De plus, <strong>les</strong> déplacements de la<br />
vis inférieure sont supérieurs (0,0533 mm) à ceux de la vis supérieure<br />
(0,0067 mm).<br />
DISCUSSION. Cette étude tend à montrer que lors de<br />
l’implantation d’une prothèse inversée, il faut privilégier le bon<br />
positionnement de la vis inférieure pour une tenue optimale. Par<br />
ailleurs, la présence de micromouvements au niveau de la vis<br />
inférieure pourrait fournir une explication concernant l’apparition<br />
de notch au niveau de la partie inférieure de la glène, sans<br />
contact entre <strong>les</strong> pièces osseuses et/ou l’os et la prothèse.<br />
* Philippe Clavert, Laboratoire de Biomécanique du GEBOAS,<br />
Institut d’Anatomie Normale, Faculté de Médecine,<br />
4, rue Kirschleger, 67085 Strasbourg Cedex.<br />
258 À quoi sert de moins médialiser<br />
une prothèse inversée ? Résultats<br />
comparés radiologiques et cliniques<br />
de la prothèse Delta et de la<br />
prothèse Arrow<br />
Philippe VALENTI *, Denis KATZ,<br />
Philippe SAUZIERES<br />
INTRODUCTION. L’objectif de cette étude était de comparer<br />
<strong>les</strong> résultats cliniques et radiologiques obtenus avec la prothèse<br />
Delta et la prothèse Arrow dont le <strong>des</strong>sin augmente la latéralisation<br />
de l’humérus.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Il s’agit d’une étude rétrospective<br />
regroupant 40 Delta et 40 Arrow implantées dans <strong>les</strong><br />
omarthroses excentrées et dans <strong>les</strong> épau<strong>les</strong> pseudo paralytiques<br />
sans arthrose gléno humérale. Nous avons mesuré sur une radiographie<br />
de face en position neutre la distance entre la glène et le<br />
bord externe du trochiter, l’abaissement de l’humérus et la latéralisation<br />
par rapport à l’acromion. Cliniquement ont été évalués<br />
<strong>les</strong> différents critères du score de Constant avec un recul d’au<br />
moins 12 mois.<br />
RÉSULTATS. La distance entre la glène et le trochiter était<br />
significativement plus grande pour l’Arrow (4,5 cm) que pour la<br />
Delta (4,1 cm). En revanche, l’abaissement n’était pas différent<br />
(moyenne 3,5). L’humérus très médialisé dans la Delta siégeait<br />
en dedans de la verticale de l’acromion (moyenne – 0,33 cm)<br />
alors qu’avec l’Arrow l’humérus était plus externe par rapport à<br />
l’acromion (moyenne + 1 cm). Les scores de Constant étaient<br />
non significativement différents : Delta 65, Arrow 63 ; l’élévation<br />
antérieure d’environ 10 degrés supérieures pour <strong>les</strong> Delta<br />
(140°/130°) ; en revanche, une meilleure rotation interne pour<br />
l’Arrow (main L3 / main sacrum) et un gain de 10 degrés de plus<br />
en rotation externe pour l’Arrow. Aucune encoche n’a été retrouvée<br />
dans la série d’Arrow alors que 30 encoches (75 %) avec la<br />
Delta dont 10 formes évolutives (7 type 3 et 2 type 4 selon<br />
Nérot) dans <strong>les</strong> 2 séries.<br />
DISCUSSION. Une latéralisation de l’humérus secondaire au<br />
<strong>des</strong>sin de la prothèse nous semble diminuer le risque de conflit<br />
avec le pilier de l’omoplate. Associée à la remise en tension du<br />
reste de la coiffe et au recrutement <strong>des</strong> fibres <strong>les</strong> plus internes du<br />
deltoïde, cette position améliore <strong>les</strong> rotations tout en conservant<br />
une bonne élévation antérieure. La moindre médialisation du<br />
centre de rotation augmente certes <strong>les</strong> forces de cisaillement sur<br />
la glène : c’est souligner l’importance d’une glène à fond convexe<br />
avec une excellente tenue. Aucun <strong>des</strong>cellement glénoïdien<br />
n’a été constaté.<br />
CONCLUSION. Un centre de rotation moins médialisé et un<br />
humérus plus latéralisé radiographiquement nous semble améliorer<br />
<strong>les</strong> rotations (surtout interne+++, externe+) tout en conservant<br />
une élévation antérieure utile. L’absence d’encoche semble<br />
confirmer l’absence de conflit mécanique grâce à cette moindre<br />
medialisation et au <strong>des</strong>sin de la prothèse.<br />
* Philippe Valenti, Institut de la Main, Clinique Jouvenet,<br />
6, square Jouvenet, 75016 Paris.
259 Étude radio-anatomique statique et<br />
dynamique du ligament acromiocoracoïdien<br />
Michel FERMAND *, ANTOINE FEYDY,<br />
Henri GUERINI, Antoine BABINET,<br />
Alain CHEVROT, Jean-Luc DRAPÉ<br />
INTRODUCTION. Réaliser l’étude statique et dynamique du<br />
ligament acromio-coracoïdien (LAC) et de ses rapports avec la<br />
coiffe <strong>des</strong> rotateurs.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Cent patients suivis pour épaule<br />
douloureuse et pour <strong>les</strong>quels un conflit sous acromial était cliniquement<br />
envisagé, ont été explorés par bursographie, réalisée en<br />
l’absence de rupture transfixiante à l’arthrographie, couplée à un<br />
scanner volumique en position indifférente puis en rotation<br />
interne avec 60° d’abduction et 60° d’antépulsion (cette position<br />
a été définie comme propice au conflit par Resnick et coll. dans<br />
un travail effectué sur cadavre : AJR : 167, Dec1996). Le LAC et<br />
ses rapports avec <strong>les</strong> tendons ont été étudiés dans <strong>les</strong> 2 positions.<br />
L’aspect de l’acromion sur <strong>les</strong> clichés standard ainsi que l’existence<br />
éventuelle d’une empreinte osseuse sur <strong>les</strong> tendons ont<br />
également été notés.<br />
RÉSULTATS. Le LAC était défini dans 27 % <strong>des</strong> étu<strong>des</strong> en<br />
position indifférente et dans 91 % <strong>des</strong> étu<strong>des</strong> dynamiques. Dans<br />
17 % <strong>des</strong> cas il marquait, en étude dynamique, une empreinte sur<br />
la face superficielle du supra-spinatus. Une seule de ces<br />
empreintes s’accompagnait d’un acromion de type III selon la<br />
classification de Bigliani et 14 d’entre elle ne s’accompagnaient<br />
pas d’une empreinte osseuse.<br />
DISCUSSION. Les indications d’acromioplastie dans <strong>des</strong><br />
tendinopathies de la coiffe <strong>des</strong> rotateurs non rompues ou avec<br />
rupture partielle sont controversées. La connaissance de la morphologie<br />
du ligament acromio-coracoïdien (LAC) et de ses rapports<br />
statique et dynamique avec <strong>les</strong> tendons de la coiffe peut<br />
être un argument dans la décision. Aucune <strong>des</strong> explorations classiques<br />
(radios standard, échographie, arthro-scanner, IRM)<br />
n’apporte cette information.<br />
CONCLUSION. Le LAC et ses rapports dynamiques avec la<br />
coiffe <strong>des</strong> rotateurs peuvent être étudiés de façon satisfaisante<br />
par burso-scanner positionnel alors que <strong>les</strong> clichés standard et le<br />
scanner statique ne permettent pas cette étude. Leur connaissance<br />
nous semble utile dans <strong>les</strong> choix thérapeutiques.<br />
* Michel Fermand, Service de Radiologie B, Hôpital Cochin,<br />
27, rue du Faubourg-Saint-Jacques, 75014 Paris.<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S147<br />
260 Neurolyse endoscopique du nerf<br />
suprascapulaire : voies d’abord origina<strong>les</strong><br />
Marc SOUBEYRAND *, Nicolas BILLOT,<br />
Alain LORTAT-JACOB, René GICQUELET,<br />
Philippe HARDY<br />
INTRODUCTION. Les compressions du nerf suprascapulaires<br />
sont source de douleur et de déficit moteur de l’épaule. Deux<br />
points de compressions sont connus : l’incisure suprascapulaire<br />
et l’incisure spinoglénoidienne. La neurolyse à ciel ouvert est la<br />
technique de référence. La décompression endoscopique a fait<br />
l’objet de peu de publications dans la littérature. Nous proposons<br />
3 voies d’abord inédites permettant une libération « tout<br />
endoscopique » du nerf à ses deux points de compression.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Vingt épau<strong>les</strong> de cadavres frais<br />
ont été utilisées. Les voies d’abord sont alignées le long de<br />
l’épine de l’omoplate. La chambre de travail est créée sous le<br />
muscle supraspinatus. Après réalisation du geste endoscopique,<br />
un contrôle à ciel ouvert de l’inocuité et de l’efficacité de la neurolyse<br />
était réalisé<br />
RÉSULTATS. Le nerf a été correctement libéré aux deux<br />
points de compression dans 20 cas sur 20. Aucune lésion du<br />
pédicule suprascapulaire n’a été retrouvée (artère et nerf).<br />
CONCLUSION. Cette étude cadavérique est très encourageante<br />
et offre un jour nouveau sur l’approche endoscopique de<br />
la ceinture scapulaire.<br />
* Marc Soubeyrand, 18, rue Estienne-d’Orves,<br />
93310 Le Pré-Saint-Gervais.<br />
261 Étude sur sujet anatomique d’une<br />
technique arthroscopique de fixation<br />
du transfert de tendon du<br />
grand dorsal pour rupture massive<br />
de la coiffe <strong>des</strong> rotateurs<br />
François YAOUANC *, Nicolas GRAVELEAU,<br />
Philippe HARDY<br />
INTRODUCTION. Le transfert du tendon du muscle grand<br />
dorsal pour rupture massive non réparable de la coiffe <strong>des</strong> rotateurs<br />
a été décrit par Gerber en 1988. Nous proposons une étude<br />
cadavérique décrivant et évaluant l’innocuité sur le plan anatomique,<br />
d’une technique de fixation arthroscopique de ce transfert<br />
sur le trochiter et le bord supérieur du sous scapulaire, permettant<br />
d’éviter un abord transdeltoïdien.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Sept sujets anatomiques frais<br />
ou formolés ont été disséqués. La levée du transfert a été effectuée<br />
à ciel ouvert par une incision minimisée. Une résection <strong>des</strong><br />
tendons <strong>des</strong> musc<strong>les</strong> sus et sous épineux a été effectuée juqu’à la
3S148 81 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
glène, simulant la rupture massive non réparable de la coiffe,<br />
chez <strong>les</strong> sujets à coiffe intacte. La fixation arthroscopique du<br />
transfert a été effectuée avec du matériel d’arthroscopie classique.<br />
Tous <strong>les</strong> sujets ont ensuite été disséqués afin de vérifier<br />
l’intégrité <strong>des</strong> nerfs axillaire, radial et thoracodorsal, <strong>des</strong> artères<br />
et veines axillaires, thoracodorsa<strong>les</strong> et circonflexes postérieures<br />
de l’humérus. La bonne tenue <strong>des</strong> sutures et ancrages osseux du<br />
transfert a également été vérifiée.<br />
RÉSULTATS. La fixation du tendon du grand dorsal par <strong>des</strong><br />
points side to side au subscapulaire en avant, au moignon <strong>des</strong><br />
tendons <strong>des</strong> musc<strong>les</strong> supra et infra spinatus médialement, et au<br />
tubercule majeur par <strong>des</strong> ancres a été possible en utilisant 4 voies<br />
d’abord arthroscopiques : antéro-latérale, une postérieure et<br />
2 voies latéra<strong>les</strong>. Les dissections complémentaires ont confirmé<br />
dans tous <strong>les</strong> cas l’innocuité de la technique.<br />
DISCUSSION. L’analyse <strong>des</strong> résultats de 5 séries de techniques<br />
à ciel ouvert publiées confirme l’intérêt théorique de préservation<br />
du muscle deltoïde pour la qualité <strong>des</strong> résultats et incite<br />
à relever le challenge de la fixation arthroscopique, pour améliorer<br />
<strong>les</strong> suites postopératoires de ce type d’intervention et ce malgré<br />
la difficulté technique du geste.<br />
CONCLUSION. La fixation arthroscopique du transfert du<br />
tendon du grand dorsal est techniquement possible, sans risque<br />
anatomique supplémentaire par rapport à la technique à ciel<br />
ouvert, et reste à effectuer et évaluer en pratique clinique.<br />
* François Yaouanc, 9, avenue Char<strong>les</strong>-de-Gaulle,<br />
92100 Boulogne.<br />
262 Évaluation <strong>des</strong> résultats après chirurgie<br />
de l’épaule à l’aide de capteurs<br />
cinématiques tri-dimensionnels<br />
Alain FARRON *, Kamiar AMINIAN,<br />
Aline BOURGEOIS, Brian COLEY,<br />
Claude PICHONNAZ, Michel DUTOIT,<br />
Brigitte JOLLES<br />
INTRODUCTION. L’objectif de cette étude était double :<br />
déterminer, à l’aide de capteurs cinématiques 3D, <strong>des</strong> paramè-<br />
tres objectifs permettant d’évaluer <strong>les</strong> résultats après chirurgie<br />
de l’épaule ; tester l’efficacité <strong>des</strong> capteurs cinématiques en<br />
quantifiant <strong>les</strong> différences entre épau<strong>les</strong> saines et pathologiques.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Dix sujets sains (groupe contrôle)<br />
et 10 patients opérés de l’épaule (réparations de coiffe <strong>des</strong><br />
rotateurs et arthroplasties prothétiques) ont été étudiés. Chaque<br />
individu a réalisé, pour chacune <strong>des</strong> 2 épau<strong>les</strong>, 9 tests correspondants<br />
à <strong>des</strong> activités de la vie quotidienne. Les patients ont<br />
été évalués en préopératoire, et à 3, 6 et 12 mois postopératoires.<br />
De plus, chaque patient a également rempli 2 questionnaires<br />
cliniques subjectifs : SST (simple shoulder test) et DASH<br />
(Disability of the arm, shoulder and hand). Un module fixé à<br />
l’humérus, comprenant accéléromètres et gyroscopes, relié à un<br />
enregistreur de données sur la ceinture (Physilogâ), permet de<br />
mesurer selon 3 axes <strong>les</strong> accélérations et vitesses angulaires.<br />
Trois scores ont été définis : 1) Score RAV : amplitude de<br />
vitesse angulaire calculée selon <strong>les</strong> trois axes pour <strong>les</strong> 9 tests. Le<br />
score est obtenu en normalisant l’épaule pathologique au côté<br />
sain controlatéral. 2) Score P : somme pour <strong>les</strong> 3 axes, <strong>des</strong> produits<br />
de la vitesse angulaire par l’accélération. Le score est<br />
obtenu à nouveau en normalisant le résultat au côté sain. Le<br />
score P est une estimation de la puissance du bras. 3) Score M :<br />
somme <strong>des</strong> moments maximaux selon <strong>les</strong> 3 axes et rapportés au<br />
côté sain.<br />
RÉSULTATS. Les sujets sains ont <strong>des</strong> scores RAV, P et M<br />
significativement plus élevés que <strong>les</strong> patients en préopératoire<br />
(p < 0,00018) et à 3 mois (p > 0,0099). En revanche, à 6 mois,<br />
<strong>les</strong> différences ne sont plus significatives. Parallèlement, <strong>les</strong><br />
scores cliniques (SST et DASH) <strong>des</strong> patients ne montrent pas<br />
d’évolution entre l’état préopératoire et 3 mois, mais progressent<br />
significativement dès 6 mois.<br />
CONCLUSION. L’utilisation de capteurs cinématiques tridimensionnels<br />
permet d’évaluer objectivement <strong>les</strong> conséquences<br />
fonctionnel<strong>les</strong> de pathologies de l’épaule, ainsi que d’analyser<br />
l’évolution après chirurgie. Ces résultats préliminaires<br />
montrent que <strong>les</strong> patients ont retrouvé à 6 mois postopératoire<br />
une épaule comparable au côté controlatéral sain, ce que confirment<br />
<strong>les</strong> questionnaires subjectifs cliniques. L’utilisation du<br />
système sur une longue période (8 heures) et sur un plus large<br />
collectif de patients est en cours et devra permettre de valider la<br />
méthode.<br />
* Alain Farron, 4, avenue Pierre-Decker,<br />
1005 Lausanne, Suisse.
263 Résultats à moyen terme de<br />
24 prothèses de cheville à patin<br />
intermédiaire mobile<br />
Karim BASHTI *, Joël VERNOIS, Eric HAVET,<br />
Arnaud PATOUT, Olivier JARDÉ<br />
INTRODUCTION. La réputation de l’arthroplastie de cheville<br />
reste médiocre comparée à l’arthrodèse. Notre étude rétrospective<br />
présente <strong>les</strong> résultats d’une série de prothèses de dernière<br />
génération munies d’un patin intermédiaire en polyéthylène, non<br />
cimentées et sans quille tibiale.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Vingt-quatre patients étaient<br />
concernés. L’âge moyen au moment de l’intervention était de<br />
56 ans, le recul moyen était de 54 mois. Deux patients ont été<br />
perdus de vue. L’arthrose post-traumatique constituait l’étiologie<br />
principale. L’implantation a toujours été réalisée par voie antérieure.<br />
Deux types d’implant ont été employés (STAR ® , Link et<br />
Hintegra ® , New Deal). L’évaluation clinique a été réalisée grâce<br />
au score de Kitaoka. Le bilan radiographique à la révision comportait<br />
<strong>des</strong> clichés standards de face et de profil, un cliché de<br />
Méary et <strong>des</strong> clichés dynamiques.<br />
RÉSULTATS. À la révision, le score clinique moyen était<br />
évalué à 67,7 points, le score était bon à excellent pour 6<br />
patients, moyen pour 11 et mauvais pour 2. La mobilité moyenne<br />
était de 30°. La mobilité radiologique isolée de l’articulation<br />
talo-crurale prothétique était de 15°. 69 % <strong>des</strong> patients se déclaraient<br />
très satisfaits à satisfaits. Une différence significative était<br />
retrouvée concernant le score de Kitaoka en faveur <strong>des</strong> sujets de<br />
plus de 50 ans. 52 % de nos patients présentaient un liséré périprothétique<br />
sans influence sur le résultat clinique. Quatre arthrodèses<br />
talo-crura<strong>les</strong> ont été réalisées secondairement après un<br />
délai moyen de 8,5 mois, deux en raison d’un sepsis et 2 par<br />
défaillance du matériel. La fusion articulaire était obtenue après<br />
un délai moyen de 3 mois.<br />
DISCUSSION. Les arthrites généralisées étaient initialement<br />
l’indication de choix de l’arthroplastie de cheville. Mais <strong>les</strong><br />
indications de remplacement prothétique dans l’arthrose posttraumatique<br />
du sujet de moins de 50 ans augmentent dans de<br />
nombreuses séries. Sa réalisation doit tout de même rester prudente.<br />
La voie d’abord antérieure présente pour nous l’avantage<br />
d’offrir une vision globale de l’axe du membre inférieur et un<br />
accès direct à l’articulation. L’utilisation de matériel non<br />
cimenté et la préservation du stock osseux doit permettre une<br />
amélioration de la longévité <strong>des</strong> implants. L’obtention d’une<br />
stabilité prothétique per-opératoire peut imposer la réalisation<br />
d’ostéotomies ou de ligamentoplasties. La possibilité d’arthrodèse<br />
secondaire doit toujours être envisagée. Sa réalisation est<br />
restée dans cette étude comparable à celle <strong>des</strong> arthrodèses de<br />
première intention.<br />
CONCLUSION. Les implants de dernière génération ont permis<br />
une amélioration significative <strong>des</strong> résultats de l’arthroplastie<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S149<br />
Séance du 9 novembre matin<br />
PIED<br />
de cheville. Ceci doit permettre l’obtention de résultats comparab<strong>les</strong><br />
aux autres arthroplasties.<br />
* Karim Bashti, CHU Nord, place Victor-Pauchet, 80000 Amiens.<br />
264 Prothèse de cheville et arthrodèse<br />
sous talienne en 1 temps : à propos<br />
de 11 cas<br />
Henri LELIÈVRE *, Jean-François LELIÈVRE<br />
INTRODUCTION. Le traitement <strong>des</strong> arthroses combinées<br />
tibio-taliennes et sous-taliennes est difficile. L’arthrodèse combinée<br />
<strong>des</strong> 2 articulations est mal tolérée fonctionnellement et particulièrement<br />
dans <strong>les</strong> polyarthrites. L’arthroplastie de cheville<br />
permet de préserver le médio et l’avant-pied, mais la plupart <strong>des</strong><br />
équipes réalisent l’arthrodèse sous-talienne dans un deuxième<br />
temps ce qui double la durée d’immobilisation du patient. Nous<br />
proposons de réaliser arthroplastie de cheville et arthrodèse<br />
sous-talienne dans le même temps opératoire.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Nous avons réalisés 11 arthroplasties<br />
de cheville associées à <strong>des</strong> arthrodèse sous talienne<br />
(7 arthrodèses extra-articulaires par évidement comblement du<br />
sinus du tarse en utilisant le produit de coupe tibial et 2 triplearthrodèses)<br />
ou talo-naviculaires (2) en un temps. Au début de<br />
notre expérience, nous utilisions <strong>des</strong> voies combinées (antérieure<br />
et externe centrée sur le sinus du tarse) <strong>les</strong> 5 derniers cas ont été<br />
réalisés par une voie antéro-externe de Méary. Les patients ont<br />
tous été revus pour un bilan clinique et radiologique avec un<br />
recul d’au moins 2 ans (2-14 ans).<br />
RÉSULTATS. Toutes <strong>les</strong> prothèses étaient intégrées et <strong>les</strong><br />
arthrodèses fusionnées à 3 mois. Le score fonctionnel de Kitaoka<br />
est passé de 26,36 en préopératoire à 86,45 au dernier recul.<br />
Trois patients ont eu <strong>des</strong> problèmes de cicatrisation. Un lambeau<br />
de couverture a été nécessaire une fois. Ils avaient été tous 3 opérés<br />
par une voie antérieure combinée à un petit abord externe.<br />
Deux patients ont du être repris (1 pseudarthrose malléolaire<br />
externe et un conflit interne).<br />
DISCUSSION. Les résultats fonctionnels sont flatteurs, il<br />
s’agit d’une série courte sans résultats catastrophiques. Le recul<br />
est trop court pour juger du résultat à long terme <strong>des</strong> prothèses,<br />
mais on peut constater que l’arthrodèse sous talienne est réalisable<br />
dans le même temps opératoire.<br />
CONCLUSION. Il est possible de réaliser une arthroplastie de<br />
cheville et une arthrodèse du couple de torsion dans le même temps<br />
opératoire. Il faut préférer une voie d’abord antéro-externe unique<br />
et éviter d’utiliser la voie antérieure combinée à une voie externe<br />
pour éviter d’être confronté à <strong>des</strong> difficultés de cicatrisation.<br />
* Henri Lelièvre, Service d’Orthopédie,<br />
Centre Hospitalier Sud Francilien, Site Louise Michel, Quartier<br />
du Canal-Courcouronnes, 91014 Evry Cedex.
3S150 81 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
265 Intérêt de la voie antéro-externe<br />
dans l’arthroplastie totale de cheville<br />
Henri LELIÈVRE *, Jean-François LELIÈVRE<br />
INTRODUCTION. La voie antérieure de cheville utilisée par<br />
la plupart <strong>des</strong> équipes pour l’arthroplastie de cheville est grande<br />
pourvoyeuse de difficultés de cicatrisation. Ceci fait courir un<br />
risque septique très péjoratif pour la prothèse. Bueggel et Pappas<br />
rapportent entre 15 et 22 % de difficultés de cicatrisation par<br />
cette voie d’abord, Graveleau et Judet 9 %. La berge médiale de<br />
la cicatrice est mal vascularisée et en cas de nécrose il n’y a que<br />
le tendon du tibial antérieur qui protège la prothèse. Nous utilisons<br />
depuis deux ans la voie antéro-externe qui offre l’avantage<br />
d’être vascularisée sur ses deux berges et d’être protégée par la<br />
présence <strong>des</strong> corps charnus <strong>des</strong> musc<strong>les</strong> extenseurs et pédieux.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Nous présentons une série prospective<br />
de 9 arthroplasties de cheville par une voie antéroexterne<br />
de Méary. Nous avons surveillé la cicatrisation et vérifié<br />
la position <strong>des</strong> implants en post-opératoire ainsi que l’absence de<br />
fractures malléolaires.<br />
RÉSULTATS. Nous n’avons pas été confronté à <strong>des</strong> difficultés<br />
de cicatrisation. Un patient a eu une névralgie transitoire du<br />
nerf fibulaire superficiel. Il n’y a pas eu de problème pour placer<br />
<strong>les</strong> ancillaires de 2 prothèses de cheville différentes. Les<br />
implants étaient tous positionnés de manière correcte. Nous<br />
n’avons été confronté qu’une fois à une fracture malléolaire<br />
médiale et la mise en place de bouton malléolaire latéral (3 fois)<br />
a été grandement facilitée et n’a pas nécessité de contre-abord.<br />
Nous avons pus mener 3 arthrodèses sous-taliennes dans le<br />
même temps opératoire que la prothèse par cette voie.<br />
DISCUSSION. Depuis longtemps, la voie antéro-externe de<br />
Meary est utilisée pour d’arthrodéser toutes <strong>les</strong> articulations de<br />
la cheville par un même abord. Nous constatons que cette voie<br />
permet de poser une prothèse dans de bonnes conditions avec un<br />
meilleur contrôle <strong>des</strong> malléo<strong>les</strong> et permet de réaliser <strong>des</strong> gestes<br />
diffici<strong>les</strong>, voire impossible par une voie antérieure (arthrodèses<br />
du couple de torsion, ligamentoplastie ou pose de bouton malléolaire).<br />
CONCLUSION. Pour <strong>des</strong> raisons anatomiques la voie<br />
d’abord antéro-externe ne pose pas <strong>les</strong> problèmes de cicatrisation<br />
de la voie antérieure de cheville. Il faut cependant se méfier<br />
<strong>des</strong> névromes cicatriciels. Cette voie permet un meilleur contrôle<br />
<strong>des</strong> malléo<strong>les</strong> (la fibula est très postérieure) et permet d’associer<br />
<strong>des</strong> gestes à l’arthroplastie totale de cheville.<br />
* Henri Lelièvre, Service d’Orthopédie,<br />
Centre Hospitalier Sud Francilien, Site Louise Michel,<br />
Quartier du Canal-Courcouronnes, 91014 Evry Cedex.<br />
266 L’arthrose métatarso-sésamoïdienne<br />
dans <strong>les</strong> résultats de<br />
l’ostéotomie SCARF : à propos<br />
d’une série prospective de 100 cas<br />
Arnaud LARGEY *, François CANOVAS,<br />
François BONNEL<br />
INTRODUCTION. Les sésamoï<strong>des</strong> ont un rôle fondamental<br />
dans la biomécanique de l’articulation métatarso-phalangienne<br />
de l’hallux. Nous avons voulu évaluer l’impact de l’atteinte<br />
dégénérative métatarso-sésamoïdienne sur <strong>les</strong> résultats de la chirurgie<br />
de l’hallux valgus.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Notre série continue était de<br />
89 patients (100 pieds). Tous ont bénéficié d’un traitement chirurgical<br />
d’hallux valgus par ostéotomie de type SCARF avec<br />
accourcissement phalangien. Un geste chirurgical d’ostéotomies<br />
métatarsiennes était associé 22 cas. Nous avons relevé <strong>les</strong> atteintes<br />
<strong>des</strong> surfaces articulaires métatarsiennes, phalangiennes et<br />
sésamoïdiennes. En préopératoire, chaque pied était évalué selon<br />
la cotation de Kitaoka et par la durée d’évolution du trouble statique.<br />
L’analyse radiographique préopératoire nous a permis de<br />
caractériser la déformation initiale. Sur l’incidence de face, nous<br />
avons mesuré l’angle métatarsophalangien du premier rayon<br />
(M1P1), l’angle articulaire distal du premier métatarsien<br />
(AADM), l’angle entre premier et deuxième métatarsiens<br />
(M1M2) et la position de la sangle sésamoïdienne en fonction de<br />
l’axe du premier métatarsien. Lors de l’intervention, nous avons<br />
relevé l’existence et la topographie <strong>des</strong> lésions arthrosiques sur<br />
la métatarso-sésamoïdienne et sur la métatarso-phalangienne. À<br />
la révision moyenne de 20 mois, une nouvelle cotation AOFAS<br />
et un nouveau bilan radiographique nous ont permis d’évaluer<br />
<strong>les</strong> résultats du traitement chirurgical.<br />
RÉSULTATS. Il s’agissait de 86 femmes et 3 hommes,<br />
52 pieds gauches et 48 pieds droits. L’âge moyen était de 55,3 ans<br />
(± 13,2). La durée d’évolution de la déformation avant chirurgie<br />
était en moyenne supérieure à 5 ans. Le score AOFAS moyen<br />
était de 32/100 (± 17) en préopératoire, et de 82/100 (± 12) à la<br />
révision. Les paramètres radiographiques préopératoire étaient :<br />
M1P1 27,1° (± 8,7), AADM 12,0° (± 7,3) et M1M2 11,0° (± 3,8).<br />
La luxation sésamoïdienne était de stade 1 pour 9 cas, stade 2<br />
pour 19 cas, et stade 3 pour 25 cas. En postopératoire, nous avons<br />
retrouvé : M1P1 13,9° (± 7,7), AADM 11,8° (± 4,6), M1M2 6,4°<br />
(± 3,5). Les lésions articulaires retrouvées étaient une atteinte<br />
sésamoïdienne dans 82 cas avec une atteinte préférentielle du<br />
sésamoïde médial. Une érosion complète de la crête intersésamoïdienne<br />
était notée dans 21 % <strong>des</strong> cas. Le compartiment métatarsophalangien<br />
n’était atteint que dans 19 cas.<br />
DISCUSSION. Les lésions métatarsosésamoïdiennes sont<br />
très fréquentes dans l’hallux valgus alors que l’articulation métatarsophalangienne<br />
n’est que rarement atteinte. Le compartiment<br />
médial est le plus souvent touché. La correction chirurgicale<br />
avec recentrage correct de la sangle sésamoïdienne doit permettre<br />
un bon résultat mais l’importance <strong>des</strong> lésions dégénératives<br />
sésamoïdiennes est un facteur péjoratif.<br />
* Arnaud Largey, Service d’Orthopédie 3,<br />
Hôpital Lapeyronie, 371, avenue du Doyen-Gaston-Giraud,<br />
34295 Montpellier Cedex 5.
267 Résultat de l’ostéosynthèse au fil<br />
<strong>des</strong> ostéotomies phalangiennes de<br />
varisation dans la cure de l’hallux<br />
valgus<br />
Joël VERNOIS *, Olivier JARDÉ, Eric HAVET,<br />
Zacharia LAYA, Arnaud PATOUT,<br />
Raphaël COURSIER<br />
INTRODUCTION. L’ostéotomie de varisation phalangienne<br />
est réalisé dans le traitement de l’hallux valgus afin d’obtenir un<br />
parallélisme entre l’interphalangienne et la métatarso-phalangienne.<br />
Les moyens d’ostéosynthèses sont divers : broche, vis,<br />
agrafes ou fils. Le but de cette étude était d’évaluer la qualité de<br />
l’ostéosynthèse au fils.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. L’étude a porté sur 120 patients<br />
opérés en 2005. L’âge moyen était de 56 ans. Un geste d’ostéotomie<br />
phalangienne, avec ou sans accourcissement, était réalisé<br />
pour le traitement d’un hallux valgus. L’ostéosynthèse était toujours<br />
réalisée au fil soit par un point en U, soit par un point simple<br />
ou soit par un point en X. Il s’agissait d’une série<br />
prospective. Tous <strong>les</strong> patients ont été revus cliniquement et<br />
radiologiquement à 1 mois et 3 mois post-opératoire. Nous<br />
avons évalué la douleur en regard du geste d’ostéotomie phalangienne,<br />
la qualité de la varisation, <strong>les</strong> éventuels déplacements<br />
secondaires et le délai de consolidation.<br />
RÉSULTATS. Au premier mois, une douleur était toujours<br />
retrouvée au niveau du site d’ostéotomie. Cette dernière avait systématique<br />
disparue au 3 e mois sans retarder la reprise de l’appui<br />
et du chaussage. Le taux de pseudarthrose a été de 1/120. Elle a<br />
nécessité une reprise chirurgicale. Aucun déplacement secondaire<br />
n’a été retrouvé.<br />
CONCLUSION. Nous estimons que l’ostéosynthèse au fil permet<br />
d’obtenir une consolidation satisfaisante sans avoir recours à<br />
un autre matériel. Il faut préféré la réalisation de point en U.<br />
Néanmoins lorsque le geste de varisation est isolé sans accourcissement,<br />
un point simple peut être utilisé. Il s’agit d’une technique<br />
intéressante peu invasive que nous continuerons d’employer.<br />
* Joël Vernois, Chirurgie Orthopédique,<br />
CHU Nord, place Victor-Pauchet, 80054 Amiens Cedex 1.<br />
268 L’arthrodèse talo-crurale : étude<br />
avec un recul minimum de 12 ans<br />
<strong>des</strong> résultats fonctionnels et radiologiques.<br />
Étude de la tolérance.<br />
À propos de 33 cas<br />
Olivier JARDÉ *, Joël VERNOIS, Arnaud PATOUT,<br />
RAPHAËL COURSIER, Guy ALOVOR<br />
INTRODUCTION. À une période où il y a une augmentation<br />
<strong>des</strong> indications de prothèse de cheville, le but de cette étude était<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S151<br />
d’évaluer <strong>les</strong> résultats cliniques et radiologiques <strong>des</strong> arthrodèses<br />
talo-crura<strong>les</strong>.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Notre étude a porté sur<br />
33 arthrodèses. Il s’agissait de 12 femmes et de 20 hommes. La<br />
moyenne d’âge était de 46,8 ans. Dans 85 % <strong>des</strong> cas, l’origine<br />
<strong>des</strong> lésions était traumatique, neurologique dans 6 % <strong>des</strong> cas et<br />
arthrosique primaire dans 9 % <strong>des</strong> cas. Les patients ont bénéficié<br />
d’une arthrodèse selon <strong>les</strong> techniques de Meary (19), plaque<br />
antérieure (8) Soulier (2), fixateur externe (2). L’évaluation clinique<br />
était basée sur le score de Kitaoka et un indice subjectif de<br />
satisfaction. L’évaluation radiologique a consisté à réaliser <strong>des</strong><br />
clichés standards face et profil centrés sur la talo-curale ainsi que<br />
<strong>des</strong> clichés cerclés de Meary.<br />
RÉSULTATS. L’étude fonctionnelle de la cheville a retrouvé à<br />
12 ans de recul 51,5 % de bons et très bons résultats. Nous avons<br />
également étudié la position du pied dans <strong>les</strong> différents plans de<br />
l’espace. Nous avons aussi étudié le retentissement de l’arthrodèse<br />
talo-crurale sur la sous-talienne et la médio-tarsienne à<br />
l’aide <strong>des</strong> clichés radiologiques. Ces deux articulations étaient<br />
ainsi sujettes à une dégénérescence arthrosique avec une aggravation<br />
dans 73 % <strong>des</strong> cas et de la sous-talienne par rapport à l’état<br />
préopératoire. Ceci entrainait un mauvais résultat fonctionnel<br />
pour <strong>les</strong> cas <strong>les</strong> plus graves. Nous avons eu trois pseudarthroses.<br />
DISCUSION ET CONCLUSION. Au terme de cette étude et<br />
à 12 ans de recul minimum, il apparait donc que la position<br />
idéale de la cheville arthrodésée était à 90° ou avec un léger talus<br />
dans le plan sagittal, quelques degrés de valgus dans le plan frontal<br />
et une rotation de 10° à 15° afin de faciliter le déroulement du<br />
pas. Nous n’avions qu’un malade sur deux à long terme avec un<br />
bon résultat.<br />
* Olivier Jardé, Service de Chirurgie Orthopédique<br />
et Traumatologique, CHU Nord, place Victor-Pauchet,<br />
80054 Amiens.<br />
269 Traitement <strong>des</strong> tendinopathies<br />
d’insertion d’Achille avec désinsertion<br />
partielle par une greffe os-tendon<br />
quadricipital : à propos de<br />
23 cas<br />
Sophie GROSCLAUDE *, Jean-Luc BESSE,<br />
Elisabeth BRUNET-GUEDJ, Bernard MOYEN,<br />
Jean-Luc LERAT<br />
INTRODUCTION. Avec l’essor du sport vétéran, l’incidence<br />
<strong>des</strong> tendinopathies d’insertion d’Achille sont en augmentation.<br />
Nous rapportons 23 cas de désinsertion partielle traitée par une<br />
greffe os-tendon quadricipital.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Il s’agissait de 22 patients<br />
(17 hommes, 1 cas bilatéral), d’âge moyen 46,9 ans (29-59 ans),<br />
18 étaient sportifs dont 8 en compétition (course à pied 8, marathon<br />
4). La désinsertion partielle du tendon d’Achille, évaluée<br />
par IRM (4,2cm de hauteur, 48 % en moyenne) étaient 7 fois
3S152 81 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
secondaire à un traitement chirurgical (peignage, exérèse de calcifications),<br />
4 fois après infiltration, 12 fois primitives.<br />
Tous <strong>les</strong> patients ont été opérés en décubitus latéral permettant<br />
<strong>les</strong> trois temps successifs : exploration et ténolyse de l’insertion<br />
d’Achille, prélévement au dépens de l’appareil extenseur du<br />
genou (baguette rotulienne de 20 mm de longueur – tendon quadricipital<br />
en moyenne de 6,5 cm de longueur), greffe encastrée<br />
dans un tunnel borgne calcanéen (vis d’interférence) et tendon<br />
quadricipital suturé au tendon d’Achille pied à 90°. Tous ont eu<br />
une gouttière plâtrée postérieure avec reprise de l’appui à 1 mois.<br />
RÉSULTATS. Tous <strong>les</strong> patients ont été revus avec un recul<br />
moyen recul de 4 ans 3 mois (4 mois-13 ans). Les complications<br />
étaient : 2 troub<strong>les</strong> de cicatrisation rapidement résolutifs,<br />
1 thrombose veineuse profonde, 2 algodystrophies. Ils ont repris<br />
le travail à 4,3 mois (2-8 mois), le sport à 6,9 mois (4-12 mois).<br />
Dix-sept patients étaient très satisfaits, 5 satisfaits. L’activité<br />
selon l’échelle de Tegner était de 5,1 /10 (3-7), le score de<br />
Kitaoka de 97,2/100 (87-100). Six patients présentaient une<br />
amyotrophie quadricipitale (< 1 cm), 11 une amyotrophie tricipitale<br />
(1-3 cm), 4 <strong>des</strong> douleurs rotuliennes. Aucun n’avait de limitation<br />
d’amplitude de la cheville. La radiographie du pied de<br />
profil en charge objectivait souvent un pied creux postérieur :<br />
angle de Djian 115° (21 fois < 120°), pente calcanéenne 25,8°<br />
(20 fois > 20°). Cinq patients avaient une calcification au niveau<br />
de la vis. L’IRM de contrôle (11 patients) objectivait toujours<br />
une bonne intégration de la greffe.<br />
CONCLUSION. Cette technique s’intègre dans l’arsenal <strong>des</strong><br />
traitements chirurgicaux <strong>des</strong> tendinopathies d’insertion : ténolyse<br />
et résection de l’entésopathie, résection du coin postérosupérieur,<br />
ostéotomie d’horizontalisation du calcanéum, allongement<br />
<strong>des</strong> jumeaux. Elle s’adresse aux lésions sévères de désinsertion<br />
partielle où elle constitue une alternative au transfert du<br />
fléchisseur propre de l’hallux ; cette plastie d’augmentation est<br />
simple, assure un ancrage calcanéen solide et sans décollement<br />
cutané. La récupération fonctionnelle et sportive est relativement<br />
rapide, <strong>les</strong> résultats sont excellents.<br />
* Sophie Grosclaude, Service de Chirurgie Orthopédique,<br />
CHU, Hôpital de Bellevue, 42055 Saint-Etienne Cedex.<br />
270 Pied varus équin spastique traité<br />
selon la technique de Watkins : à<br />
propos de 62 cas<br />
Hocine BENSAFI *, Jean-Michel LAFFOSSE,<br />
Aurélien POURCEL, Franck ACCADBLED,<br />
Jean-Louis TRICOIRE, Jean PUGET<br />
INTRODUCTION. Les séquel<strong>les</strong> motrices d’origine neurologique,<br />
le plus souvent spastique, compromettent l’autonomie <strong>des</strong><br />
patients. Le pied varus équin séquellaire constitue un handicap<br />
fonctionnel majeur. Le transfert du muscle tibial postérieur selon<br />
la technique de Watkins peut alors améliorer la marche et la statique<br />
du pied.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Il s’agit d’une étude rétrospective,<br />
continue, monocentrique intéressant 62 patients (25 hom-<br />
mes et 37 femmes), d’âge moyen 45 ans (16-72 ans), pris en<br />
charge pour pied varus équin tous d’origine spastique entre 1990<br />
et 2004. L’étiologie était majoritairement <strong>des</strong> accidents vasculaires<br />
cérébraux. Technique chirurgicale : Après son prélèvement,<br />
le muscle tibial postérieur était transféré à travers la membrane<br />
inter-osseuse puis fixé par une agrafe ou une vis d’interférence<br />
sur le 3 e cunéiforme. Nous avons associé presque toujours un<br />
allongement du tendon d’Achille et/ou une ténotomie <strong>des</strong> tendons<br />
fléchisseurs <strong>des</strong> orteils. L’ensemble <strong>des</strong> patients a été évalué<br />
par un seul examinateur distinct <strong>des</strong> opérateurs selon <strong>les</strong><br />
critères de Kling. Ont été analysés : l’autonomie à la marche, la<br />
correction du déficit, l’analyse de la marche et la satisfaction du<br />
patient. Les gestes associés, <strong>les</strong> complications postopératoires<br />
ainsi que l’utilisation ou non d’une orthèse ont été notés, ainsi<br />
que d’éventuel<strong>les</strong> récidives.<br />
RÉSULTATS. Au recul moyen de 45 mois (18-190) : <strong>les</strong><br />
résultats étaient excellents dans 52 cas, bons dans 7 cas et<br />
3 mauvais cas avec pieds plat valgus. L’autonomie à la marche<br />
était acquise chez 90 % <strong>des</strong> patients. Le résultat clinique était<br />
jugé très satisfaisant ou satisfaisant dans 85 % <strong>des</strong> cas. Subjectivement,<br />
95 % <strong>des</strong> patients étaient satisfaits de l’intervention. Les<br />
complications se sont résumées à 5 surinfections sur la cicatrice<br />
pour allongement du tendon d’Achille, deux phlébites et 3 cas de<br />
douleur sur matériel implanté.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. Le pied varus équin spastique<br />
est secondaire à un déséquilibre de la balance musculaire<br />
agoniste/antagoniste. Le transfert du muscle tibial postérieur, qui<br />
diminue sa spasticité, associé à l’allongement du tendon<br />
d’Achille favorisent un rééquilibrage et autorisent le « réveil »<br />
d’une activité <strong>des</strong> musc<strong>les</strong> antagonistes. Il permet, par effet ténodèse,<br />
une dorsiflexion parfois active, mais le plus souvent passive.<br />
Ceci améliore la marche et le schéma moteur chez <strong>des</strong><br />
patients pouvant présenter par ailleurs d’autres troub<strong>les</strong> d’origine<br />
centrale. Le traitement systématique <strong>des</strong> orteils en griffe<br />
améliore encore et pérennise le gain fonctionnel de cette chirurgie<br />
qui doit intégrer dans une prise en charge globale et multidisciplinaire<br />
pour en préciser <strong>les</strong> indications.<br />
* Hocine Bensafi, CHU Rangueil,<br />
1, avenue Jean-Poulhes, 31000 Toulouse Cedex 9.<br />
271 Intérêt prospectif <strong>des</strong> blocs anesthésiques<br />
dans l’élaboration du<br />
traitement chirurgical <strong>des</strong> déformations<br />
neuro-orthopédiques<br />
François GENET *, Alexis SCHNITZLER,<br />
Catherine KIEFER, Laurence MAILHAN,<br />
Camille THEVENIN-LEMOINE,<br />
Philippe DENORMANDIE<br />
INTRODUCTION. Les blocs anesthésiques consistent en<br />
l’anesthésie de troncs nerveux repérés par stimulation électrique.<br />
Largement utilisée en anesthésie, cette technique est également<br />
efficace dans l’évaluation de la spasticité focale. Cette étude a
pour objet de présenter l’intérêt <strong>des</strong> blocs anesthésiques dans le<br />
bilan <strong>des</strong> déformations neuro-orthopédiques.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Il s’agit d’une étude prospective<br />
incluant 38 patients vus en consultation pluridisciplinaire de<br />
neuro-orthopédie, soit 62 blocs anesthésiques. L’étiologie <strong>des</strong><br />
séquel<strong>les</strong> neuro-orthopédiques était vasculaire dans 15 cas, traumatique<br />
dans 8 cas, néonatale dans 12 cas et autre dans 3 cas.<br />
Pour chaque patient, une hypothèse diagnostique et le programme<br />
thérapeutique qui en découle ont été émis après examen<br />
clinique du patient. Cette hypothèse a ensuite été comparée aux<br />
résultats analytiques et fonctionnels après blocs anesthésiques et<br />
le choix thérapeutique précisé, confirmé ou modifié par le bloc<br />
neuro-moteur. Nous avons réalisé 17 blocs du sciatique poplité<br />
interne, 15 blocs sélectifs <strong>des</strong> branches du sciatique poplité<br />
interne, 17 blocs obturateurs, 5 blocs médians, 2 blocs cubitaux,<br />
6 blocs proximaux au membre inférieur.<br />
RÉSULTATS. Tous <strong>les</strong> blocs ont été bien tolérés, il n’y a eu<br />
aucune complication. Dix-neuf fois sur 62 nous avons modifié<br />
notre programme de prise en charge : 8 fois notre évaluation de<br />
la part respective de la spasticité et de la rétraction dans la déformation<br />
était erronée, 4 fois <strong>les</strong> blocs anesthésiques se sont<br />
accompagnés d’une aggravation fonctionnelle contre-indiquant<br />
formellement une intervention chirurgicale, 6 fois la fonction a<br />
272 Thromboses veineuses profon<strong>des</strong>,<br />
dépistées par écho-doppler, après<br />
chirurgie prothétique du genou et<br />
de la hanche : à propos de<br />
1590 cas<br />
Claude VIELPEAU *, Benoît LEBEL,<br />
Marie-Thérèse BARRELIER, Michel PÉGOIX<br />
INTRODUCTION. La chirurgie orthopédique majeure est<br />
réputée pour son risque élevé de thrombose veineuse profonde<br />
(TVP). Les événements thrombo-emboliques ont une incidence<br />
différente après prothèse de hanche (PTH) ou de genou (PTG).<br />
Le but de notre étude était de faire un état <strong>des</strong> lieux <strong>des</strong> TVP<br />
asymptomatiques au 7 e jour après PTG ou PTH.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Entre le 01/01/2001 et le 31/07/<br />
2005 une série continue de 586 genoux (390 femmes et 196<br />
hommes avec un âge moyen de 70,4 ans) et de 1004 hanches<br />
(540 femmes et 464 hommes avec un âge moyen de 66 ans) a été<br />
opérée d’une prothèse primaire. Tous <strong>les</strong> patients ont reçu un<br />
traitement prophylactique par héparines de bas poids moléculaire<br />
commencé après l’intervention. Un écho-doppler complet a<br />
été systématiquement effectué au 7 e jour + 2 postopératoires.<br />
RÉSULTATS. Après PTG, 299 TVP ont été mises en évidence<br />
(51 %). Vingt étaient proxima<strong>les</strong> (3,4 %) et 279 dista<strong>les</strong><br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S153<br />
Séance du 9 novembre matin<br />
RECHERCHE APPLIQUÉE/DIVERS<br />
été très améliorée par <strong>les</strong> blocs anesthésiques. Dans 43 cas sur<br />
62, nous n’avons pas modifié le programme médical ou chirurgical<br />
de prise en charge proposé au patient, mais <strong>les</strong> modalités<br />
techniques ont été précisées dans 23 cas.<br />
DISCUSSION. La technique <strong>des</strong> blocs anesthésiques est simple,<br />
<strong>les</strong> effets secondaires et <strong>les</strong> complications quasiment inexistants.<br />
Les blocs anesthésiques permettent de mieux comprendre<br />
<strong>les</strong> déformations neuro-orthopédiques en terme de spasticité,<br />
rétraction, commande (notamment <strong>des</strong> antagonistes), utilité de la<br />
spasticité et apportent un bénéfice d’ordre psychologique puisque<br />
<strong>les</strong> patients ont pu apprécier l’effet (ou l’absence d’effet) de<br />
la privation de spasticité. Les relations entre examen clinique,<br />
résultats <strong>des</strong> blocs anesthésiques et choix <strong>des</strong> techniques chirurgica<strong>les</strong><br />
doivent cependant encore être précisées et codifiées.<br />
CONCLUSION. Les blocs anesthésiques sont une aide précieuse<br />
dans la proposition du programme thérapeutique <strong>des</strong><br />
déformations neuro-orthopédiques et permettent un contrat<br />
d’objectifs clair et une bonne compliance du patient au traitement<br />
proposé.<br />
* François Genet, Service d’Orthopédie,<br />
Hôpital Raymond-Poincaré, 104, boulevard Raymond-Poincaré,<br />
92380 Garches.<br />
(47,6 %). Après PTH, <strong>les</strong> taux de TVP tota<strong>les</strong>, proxima<strong>les</strong> et dista<strong>les</strong><br />
étaient respectivement de 26,2 %, 2,6 %, 23,6 %. L’exploration<br />
complète <strong>des</strong> réseaux veineux profonds par écho-doppler<br />
montre donc que <strong>les</strong> TVP tota<strong>les</strong> sont 2 fois plus fréquentes<br />
après PTG. Les TVP proxima<strong>les</strong> ne sont pas statistiquement différentes.<br />
C’est à l’étage sous-poplité que se situe la différence.<br />
DISCUSSION. Nos résultats sont comparab<strong>les</strong> à ceux de la<br />
méta-analyse de Douketis (2002) (13 étu<strong>des</strong>, 7080 patients)<br />
après phlébographie au même délai. Il rapporte 2 fois plus de<br />
TVP tota<strong>les</strong> dans <strong>les</strong> PTG avec <strong>des</strong> taux de thromboses proxima<strong>les</strong><br />
comparab<strong>les</strong> aux nôtres. Le devenir <strong>des</strong> TVP sous-poplitées<br />
n’est pas bien défini. Leur plus grande inocuité et l’absence<br />
de thromboses retardées dans <strong>les</strong> PTG pourraient expliquer le<br />
nombre d’événements thrombo-emboliques cliniques plus faible<br />
après PTG qu’après PTH. La date médiane de survenue est plus<br />
précoce selon l’étude de WHITE (7 e jour après PTG, 17 e jour<br />
après PTH). Ces observations ont conduit <strong>les</strong> conférences de<br />
consensus récentes à ne recommander la poursuite de la prophylaxie<br />
entre le 10-14 e jour et le 35 e jour que dans <strong>les</strong> suites de<br />
PTH.<br />
CONCLUSION. Les TVP asymptomatiques, dépistées par<br />
écho-doppler, sont très fréquentes : 1 cas sur 2 après PTG, deux<br />
fois plus, au 7 e jour, qu’après PTH. La différence porte sur <strong>les</strong><br />
thromboses dista<strong>les</strong>, certainement <strong>les</strong> moins dangereuses. Nous<br />
menons actuellement une étude prospective et randomisée pour<br />
mieux comprendre l’évolution <strong>des</strong> TVP dista<strong>les</strong> après PTG.<br />
* Claude Vielpeau, Département d’Orthopédie,<br />
CHU de Caen, avenue de la Côte-de-Nacre, 14000 Caen.
3S154 81 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
273 Complications thrombotiques sévères<br />
après prothèse totale de<br />
hanche : étude prospective<br />
Camilla RYGE *, Michael RUD-LASSEN,<br />
Stig SONNE-HOLM, Søren SOLGAARD<br />
INTRODUCTION. Le but de cette étude était d’évaluer<br />
l’importance et la survenue dans le temps <strong>des</strong> complications<br />
thrombo-embolique (TE) sévères dans <strong>les</strong> 90 jours après PTH et<br />
de trouver <strong>les</strong> facteurs favorisants.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Cinq cents patients successifs<br />
(30 RPTH et 470 PTH) opérés de prothèse de hanche au Frederiksborg<br />
County au Danemark ont été inclus dans cette étude<br />
entre janvier et mai 2005 et suivis pendant 90 jours. Les antécédents<br />
ont été notés à l’entrée, puis <strong>les</strong> complications ont été<br />
recherchées au 5 e jour postopératoire pendant l’hospitalisation et<br />
recherchés par téléphone au 90 e jour. Les événements recherchés<br />
ont été : l’infarctus du myocarde (IDM), l’embolie pulmonaire<br />
(EP), la thrombose veineuse profonde (TVP), l’accident ischémique<br />
transitoire (AIT), l’accident vasculaire cérébral (AVC) et<br />
la thrombose veineuse rétinienne (TVR). Les événements étaient<br />
validés à l’hôpital selon <strong>les</strong> normes internationa<strong>les</strong>. Tous <strong>les</strong><br />
patients recevaient une prophylaxie médicamenteuse thromboembolique<br />
pendant la durée de l’hospitalisation. Seuls<br />
2 patients n’ont pas été suivis à 90 jours pour retrait du consentement.<br />
RÉSULTATS. Vingt-quatre patients (4,8 %) ont eu au moins 1<br />
complication TE pendant <strong>les</strong> premiers 90 jours. Deux patients<br />
(0,4 %) sont morts (pas autopsie faite). Cinq patients (1,0 %) ont<br />
eu une EP. Un patient (0,2 %) a eu un IDM, 10 (2,0 %) ont eu<br />
une TVP, deux (0,4 %) ont eu une TVR et quatre (0,8 %) ont eu<br />
un AIT. Deux patients ont eu 2 complications : un a eu un IDM<br />
et plus tard un AIT et un autre a eu une EP et un AIT le même<br />
jour. Neuf patients ont eu la première complication pendant <strong>les</strong><br />
cinq premiers jours postopératoires et 15 patients après le 5 e jour.<br />
La régression logistique a montré une relation significative avec<br />
une hémoglobinémie basse ainsi qu’une numération plaquettaire<br />
basse. Ces 2 facteurs sont prédictifs d’un risque TE élevé. La<br />
PTH de première intention est un facteur protecteur en comparaison<br />
avec la RPTH. Cependant, nous n’avons pu démontrer<br />
une corrélation significative avec l’âge, le sexe, <strong>les</strong> comorbités,<br />
le score ASA, l’utilisation de ciment et la durée de l’intervention.<br />
CONCLUSION. En conclusion cette étude montre nettement<br />
que le risque de complication thrombotique reste très élevé après<br />
la PTH. Il faudrait optimiser particulièrement <strong>les</strong> patients dont<br />
l’hémoglobine et la numération plaquettaire est basse. De plus,<br />
la prise en charge postopératoire de ces patients à risque de complication<br />
TE devrait être améliorée. Il reste à identifier ces<br />
patients à risque pour prolonger la prise en charge postopératoire<br />
et la prévention en prolongeant la prophylaxie après la sortie de<br />
l’hôpital.<br />
274 Étude comparative <strong>des</strong> supports<br />
d’information en chirurgie<br />
orthopédique : à propos d’une<br />
série prospective randomisée de<br />
60 cas<br />
Pascal GLEYZE *, Henry COUDANE, Jean-<br />
Christophe GUARDIOLLE, Blaise MICHEL,<br />
Thierry GEORGE<br />
INTRODUCTION. Le défaut d’information reste le moyen<br />
actuellement le plus utilisé par <strong>les</strong> patients et leurs conseils pour<br />
engager une action en responsabilité.Les supports d’information<br />
écrits sont uti<strong>les</strong>, mais il n’existe aucune étude concernant<br />
l’impact du type de document sur la qualité de l’information transmise.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Trois supports d’information<br />
élaborés par Persomed (fiche-type bénéfice/risque = BR, fichetype<br />
fascicule = F, fiche-type synthèse = S) ont été utilisés dans<br />
une étude prospective monocentrique randomisée chez <strong>des</strong><br />
patients devant bénéficier d’implants prothétiques (hanche,<br />
genou ou épaule). La compréhension <strong>des</strong> trois documents (BR,<br />
F, S) a été effectuée par un questionnaire, une étude visuelle analogique,<br />
ainsi qu’une série de QCM, permettant ainsi de définir<br />
un taux de compréhension pour chacun <strong>des</strong> supports utilisés.<br />
RÉSULTATS. Soixante patients ont été inclus (26 prothèses<br />
tota<strong>les</strong> de hanche, 26 prothèses tota<strong>les</strong> de genou, 8 prothèses<br />
tota<strong>les</strong> d’épaule). Le taux de compréhension, <strong>les</strong> principes de<br />
l’intervention, <strong>les</strong> suites, <strong>les</strong> bénéfices, <strong>les</strong> risques sont mieux<br />
compris dans le support F que dans <strong>les</strong> autres supports (BR, S)<br />
(p < 0,01). 73 % <strong>des</strong> patients ont déclaré avoir eu « une<br />
meilleure image de la chirurgie proposée » et 92 % d’entre eux<br />
ont compris que « <strong>des</strong> problèmes peuvent survenir, même si tout<br />
est fait pour le mieux ». Dans le groupe F, 95 % <strong>des</strong> patients sont<br />
prêts à signer un formulaire de consentement éclairé immédiatement<br />
après la consultation. Les réponses aux QCM du groupe F<br />
sont très supérieures à cel<strong>les</strong> <strong>des</strong> groupes BR et S (p < 0,001).<br />
DISCUSSION. L’information orale est peu retenue par le<br />
patient (Leccourreye 2005) même si elle est décrite comme satisfaisante.Une<br />
feuille d’information complémentaire ne permet<br />
pas d’obtenir <strong>des</strong> résultats supérieurs (Savornin 2000). Notre<br />
étude permet de démontrer <strong>des</strong> taux de compréhension de<br />
l’information par l’intermédiaire d’un support type fascicule par<br />
rapport aux autres supports. L’élément pédagogique reste incontournable<br />
dans le cadre <strong>des</strong> recommandations de la Haute Autorité<br />
de Santé (HAS).<br />
CONCLUSION. Les documents type « synthèse » ou une<br />
fiche type « bénéfice/risques » ne permettent pas de remplir<br />
l’obligation d’information pré opératoire prévue par la loi du<br />
4 mars 2002. Un document type fascicule, rédigé selon <strong>les</strong> critères<br />
de la HAS, validé par <strong>les</strong> associations de patients, <strong>les</strong> sociétés<br />
scientifiques (SO.F.C.O.T.), permet de remplir <strong>les</strong> conditions<br />
léga<strong>les</strong> relatives à l’information préopératoire.<br />
* Camilla Ryge, Département de Chirurgie Orthopédique,<br />
Hoersholm Hospital, Danemark. * Pascal Gleyze, Clinique du Diaconnat,<br />
18, rue Char<strong>les</strong>-Sandherr, 68000 Colmar.
275 L’évaluation de la qualité de vie et<br />
l’impact de la chirurgie orthopédique<br />
sur ses paramètres<br />
Marius M. SCARLAT *, Baudouin REDREAU<br />
INTRODUCTION. Il s’agissait d’une étude <strong>des</strong> modalités<br />
pratiques d’appréciation de l’effet de la chirurgie sur la santé <strong>des</strong><br />
patients permettant d’évaluer <strong>les</strong> risques avant le geste opératoire<br />
et de minimiser <strong>les</strong> facteurs générateurs de contentieux.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Une cohorte continue de 1119<br />
patients évalués en consultation par un opérateur a été analysé<br />
sur <strong>les</strong> paramètres fonctionnels et en regard <strong>des</strong> scores de santé<br />
générale. Un score de dépression était également calculé. Des<br />
tests spécifiques par pathologie étaient mis en oeuvre pour<br />
l’ensemble de la série. L’état de santé était apprécié avec le test<br />
SF-36, score basé sur un questionnaire, accepté dans la littérature<br />
comme fiable, reproductible et sensible au changement. Les<br />
paramètres qui peuvent interférer la motivation <strong>des</strong> patients<br />
étaient calculés en fonction de leur situation sociale (travailleur<br />
indépendant, employé, accident de travail, maladie professionnelle,<br />
traumatisme sportif), utilisant comme indicateur le pourcentage<br />
de revenus obtenus en cas d’arrêt maladie après<br />
chirurgie et qui était différent pour chaque catégorie décrite.<br />
303 patients ont été sélectionnés pour bénéficier d’une intervention<br />
chirurgicale à partir <strong>des</strong> 1119 patients examinés. Les<br />
patients sélectionnés étaient invités à estimer leur qualité de vie<br />
avant et après intervention, avec un recul de 3 mois minimum et<br />
12 mois maximum. Chaque patient accepte après réflexion et a<br />
signé un protocole d’accord pour l’intervention proposée.<br />
RÉSULTATS. Sur l’ensemble de cette série, nous n’avons<br />
rencontré aucun cas de contentieux ou de conflit avec l’assurance<br />
ou avec <strong>les</strong> patients. 82 % <strong>des</strong> sujets opérés s’estimaient<br />
mieux après l’intervention. 5 % se déclaraient inchangés après<br />
intervention. 7 % se déclaraient empirés ou nécessitant un<br />
deuxième geste opératoire de révision pour causes diverses. 6 %<br />
<strong>des</strong> patients étaient perdus de vue dans <strong>les</strong> 3 mois suivant l’intervention.<br />
Les résultats objectifs étaient corroborés avec <strong>les</strong> résultats<br />
de l’enquête épidémiologique.<br />
DISCUSSION. Le nombre croissant <strong>des</strong> interventions chirurgica<strong>les</strong><br />
effectuées pour pathologies de l’appareil locomoteur a<br />
déterminé une augmentation <strong>des</strong> complications et implicitement<br />
<strong>des</strong> risques prises par le chirurgien au moment de la décision<br />
opératoire. La jurisprudence fait état d’un nombre croissant <strong>des</strong><br />
procès pour faute professionnelle, ayant comme résultat une<br />
augmentation sans précèdent <strong>des</strong> primes d’assurance professionnelle.<br />
Le but de cette étude était de définir <strong>les</strong> paramètres qui<br />
pouvait interférer la décision opératoire et éventuellement déterminer<br />
un changement d’attitude allant jusqu’au refus d’intervenir.<br />
L’accoutumance du chirurgien avec ce nouveau langage<br />
permettra une meilleure prise en charge et une minimisation <strong>des</strong><br />
risques pour l’opérateur.<br />
* Marius M. Scarlat, Clinique Chirurgicale Saint-Michel,<br />
avenue d’Orient, 83100 Toulon.<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S155<br />
276 Proposition d’un protocole de suivi<br />
<strong>des</strong> infections de site opératoire<br />
avérées en chirurgie orthopédique<br />
et traumatologique<br />
Valérie DUMAINE *, Luc JEANNE, Gérard PAUL,<br />
Luc EYROLLE, Dominique SALMON-CERON,<br />
Jean-Pierre COURPIED, Bernard TOMENO<br />
INTRODUCTION. Le but de cette étude était de décrire une<br />
méthode de recensement <strong>des</strong> infections nosocomia<strong>les</strong> de site<br />
opératoire (ISO) et rapporter <strong>les</strong> résultats observés dans un service<br />
de chirurgie orthopédique et traumatologie.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Le recensement <strong>des</strong> ISO repose<br />
sur le signalement par un praticien du service de bactériologie de<br />
tous prélèvements de site opératoire ayant une culture positive.<br />
Un collège de 4 médecins spécialistes décide du caractère infectant<br />
du germe et de l’origine nosocomiale de l’infection. Un dossier<br />
informatique est alors créé pour chaque patient ayant une<br />
ISO regroupant <strong>des</strong> données cliniques, biologiques et microbiologiques.<br />
Le fichier informatique permet alors un suivi prospectif<br />
et une analyse <strong>des</strong> cas ainsi répertoriés.<br />
RÉSULTATS. Entre 2000 et 2002, 9397 interventions ont été<br />
réalisées et nous avons relevé 86 ISO considérées comme nosocomia<strong>les</strong>.<br />
Les patients avaient un âge moyen de 58 ans, un index<br />
de masse corporelle moyen à 25,8 et 72 % avaient un score ASA<br />
supérieur ou égal à II. L’ISO concernait une arthroplastie dans<br />
23 cas, un acte de traumatologie dans 21 cas, le traitement d’une<br />
tumeur dans 24 cas. L’ISO a été diagnostiquée dans <strong>les</strong> 30 jours<br />
suivant l’intervention dans 75 % <strong>des</strong> cas, et après la sortie de<br />
l’hôpital dans 65,4 % <strong>des</strong> cas. Les infections monomicrobiennes<br />
étaient <strong>les</strong> plus fréquentes (n = 59) et un staphylococcus aureus a<br />
été isolé dans 80,3 % <strong>des</strong> infections. En chirurgie tumorale, en<br />
revanche, <strong>les</strong> infections plurimicrobiennes étaient statistiquement<br />
plus fréquentes associant <strong>des</strong> staphylocoques à coagulase<br />
négatif et <strong>des</strong> bacil<strong>les</strong> Gram négatif. Nous avons déploré 6 décès<br />
directement imputab<strong>les</strong> à l’ISO.<br />
* Valérie Dumaine, Hôpital Cochin,<br />
27, rue du Faubourg-Saint-Jacques, 75014 Paris.<br />
277 Infections <strong>des</strong> prothèses massives<br />
de genou utilisées pour la reconstruction<br />
de l’extrémité proximale du<br />
tibia après résection pour tumeur<br />
Olivier PLOTKINE *, Valérie DUMAINE,<br />
Antoine BABINET, Philippe ANRACT,<br />
Bernard TOMENO<br />
INTRODUCTION. L’extrémité supérieure du tibia est la<br />
seconde localisation <strong>des</strong> tumeurs primitives <strong>des</strong> os. Le traitement<br />
de référence de ces tumeurs associe la chimiothérapie et la résec-
3S156 81 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
tion tumorale suivie d’une reconstruction articulaire par prothèse<br />
massive. Cette localisation semble entraîner plus de complications<br />
infectieuses que <strong>les</strong> autres.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Nous avons étudié rétrospectivement<br />
44 patients de 33,2 ans d’âge moyen (sex ratio:1), qui<br />
ont eu entre 1981 et 2004 une prothèse de reconstruction après<br />
résection de l’extrémité supérieure du tibia. L’étude a porté sur<br />
l’infection (taux, délai, tableau clinique, facteurs de risque), ses<br />
conséquences fonctionnel<strong>les</strong> et carcinologiques (traitement adjuvant,<br />
récidive, survie)<br />
RÉSULTATS. Le taux d’infection est de 36,4 %. 75 % <strong>des</strong><br />
infections sont apparues la première année. 62,5 % <strong>des</strong> infections<br />
sont en rapport avec <strong>des</strong> problèmes cicatriciels. Statistiquement,<br />
aucun facteur de risque n’a été retrouvé. Les germes retrouvés se<br />
répartissaient ainsi : bacil<strong>les</strong> gram négatif 36 %, staphylocoques<br />
32 %, streptocoques 24 %. 50 % <strong>des</strong> staphylocoques étaient résistants<br />
à la méticilline. Le traitement de l’infection a consisté initialement,<br />
dans 15 cas sur 16, par un traitement chirurgical<br />
conservateur qui a entraîné 4 guérisons, 10 échecs et 2 perdus de<br />
vue. Deux changements de prothèse en 1 temps ont entraîné la<br />
guérison. Sur 7 déposes de prothèse, remplacées par une arthrodèse<br />
de genou, 6 ont entraîné la guérison du patient. Les conséquences<br />
de l’infection ont été un taux de reprise chirurgicale<br />
augmenté : 50 % d’ arthrodèse du genou, et 42,8 % <strong>des</strong> chimiothérapies<br />
interrompues ou annulées. Sur <strong>les</strong> 16 patients infectés,<br />
14 sont vivants sans récidive et 2 sont vivants avec métastase.<br />
DISCUSSION. Le taux de survie <strong>des</strong> prothèses massives est<br />
inférieur pour l’extrémité proximale du tibia que pour l’extrémité<br />
distale du fémur. Ceci en raison d’un taux d’infection plus important<br />
en rapport avec <strong>des</strong> problèmes cicatriciels précoces. Le traitement<br />
conservateur a entraîné 64 % d’échec et 87 % en cas<br />
d’infection associée à un problème cicatriciel. La dépose de la prothèse<br />
a entraîné 71,4 % de bons résultats. Certaines séries montrent<br />
que <strong>les</strong> meilleurs résultats sont obtenus par <strong>les</strong> reprises en<br />
2 temps, mais nous n’avons pas l’expérience de repose secondaire<br />
de prothèse. Dans <strong>les</strong> cas d’infection, 42,8 % <strong>des</strong> chimiothérapies<br />
ont été interrompues ou non débutées, ceci n’ayant pas entraîné de<br />
conséquence en termes de récidive tumorale et de survie.<br />
* Olivier Plotkine, Hôpital Cochin,<br />
27, rue du Faubourg-Saint-Jacques, 75014 Paris.<br />
278 Allergie aux débris d’usure de<br />
prothèse : une affection méconnue<br />
de diagnostic et de traitement diffici<strong>les</strong><br />
Fabrice DELÉPINE *, Helène CORNILLE,<br />
Gérard DELÉPINE<br />
INTRODUCTION. Les métalloses par usure de prothèse sont<br />
connues depuis longtemps. El<strong>les</strong> s’accompagnent parfois de réactions<br />
inflammatoires intenses et prennent alors un aspect pseudo<br />
infectieux trompeur. C’est pour éviter <strong>des</strong> erreurs diagnostiques<br />
aux conséquences sévères que nous présentons ici notre série.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Depuis mars 2003, nous avons<br />
recherché parmi nos mala<strong>des</strong>, ceux qui étaient susceptib<strong>les</strong> de<br />
souffrir d’une intolérance aux débris métalliques. Les critères<br />
diagnostiques associent <strong>des</strong> signes inflammatoires locaux (douleurs,<br />
tuméfaction, augmentation de la chaleur locale, érythème,<br />
abcès, fistu<strong>les</strong>) et généraux (fièvre, polynucléose, élévation de la<br />
VS et de la CRP) à la découverte lors de l’opération de débris<br />
métalliques abondants et à l’absence de germes lors <strong>des</strong> cultures<br />
opératoires et postopératoires répétées (au moins 10 cultures).<br />
L’antibiothérapie éventuelle ne modifie pas l’évolution locale<br />
qui répond au contraire à la corticothérapie.<br />
RÉSULTATS. Neuf mala<strong>des</strong> remplissaient ces critères diagnostiques.<br />
Il s’agissait de fil<strong>les</strong> dans 3 cas et de garçons dans 6.<br />
La résection osseuse initiale mesurait en moyenne 17 centimètres.<br />
Elle avait été réalisée 6 fois pour ostéosarcome, 2 fois pour<br />
Ewing et une fois pour kyste anévrysmal. Huit mala<strong>des</strong> avaient<br />
subi une chimiothérapie et 4 avaient été irradiés. Tous ces mala<strong>des</strong><br />
étaient en rémission complète de leur cancer depuis plus de<br />
dix ans (moyenne 15). Dans un tiers <strong>des</strong> cas, l’intolérance est<br />
survenue spontanément après usure, <strong>des</strong>cellement ou rupture de<br />
la prothèse. Pour <strong>les</strong> 6 autres mala<strong>des</strong>, <strong>les</strong> signes ne sont survenus<br />
qu’après intervention pour changement de prothèse. Le traitement<br />
a reposé sur le nettoyage chirurgical minutieux du champ<br />
opératoire et la couverture par lambeau musculaire et sur la corticothérapie<br />
per os. Il a obtenu la disparition lente <strong>des</strong> troub<strong>les</strong><br />
dans 7 cas. Les deux derniers sont encore en traitement.<br />
DISCUSSION. Ces mala<strong>des</strong> se présentant avec un tableau<br />
classique d’infection (fièvre, polynucléose, tuméfaction locale)<br />
ont pour certains subi <strong>des</strong> traitements médicaux ou chirurgicaux<br />
qui ne leur étaient pas uti<strong>les</strong>. Le traitement antiallergique par <strong>des</strong><br />
corticoï<strong>des</strong> a obtenu la guérison ou l’amélioration <strong>des</strong> troub<strong>les</strong><br />
mais au prix d’un traitement aux corticoï<strong>des</strong> dont la tolérance est<br />
loin d’être constamment bonne.<br />
CONCLUSION. Lorsqu’un malade porteur d’une prothèse<br />
massive se présente avec un tableau infectieux et <strong>des</strong> signes cliniques<br />
ou radiologiques faisant évoquer une métallose, il faut<br />
s’assurer de la présence de germes avant d’effectuer un traitement<br />
lourd ou mutilant.<br />
* Fabrice Delépine, 36, rue Tonduti-de-l’Escarène, 06000 Nice.<br />
279 Effets de la stérilisation par irradiation<br />
gamma sur <strong>les</strong> propriétés<br />
mécaniques <strong>des</strong> allogreffes osseuses<br />
trabéculaires délipidées<br />
Laurent VASTEL *, Camille MASSE,<br />
Eric CROZIER, David MITTON,<br />
Raphaël BARDONNET, Jean-Pierre COURPIED<br />
INTRODUCTION. Les nouveaux procédés de stérilisation de<br />
l’os trabéculaire humain sont susceptib<strong>les</strong> d’en modifier la résistance<br />
mécanique. Ces procédés associent en règle une phase de<br />
délipidation, un traitement stérilisateur, puis une irradiation<br />
gamma sur os sec après conditionnement définitif. Le but de
cette étude a été d’étudier l’impact mécanique de cette irradiation<br />
sur <strong>les</strong> propriétés de l’os traité.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Soixante échantillons parallélépipédiques<br />
ont été obtenus à partir de la zone centrale de têtes<br />
fémora<strong>les</strong>, prélevées au cours de prélèvements multi-organes.<br />
Les donneurs, étaient indemnes de pathologies préalab<strong>les</strong> au<br />
niveau de la hanche. Ces échantillons ont été conservés à -40°C.<br />
Le temps de parcours d’on<strong>des</strong> ultrasonores à haute puis à basse<br />
fréquence a été mesuré pour chaque échantillon, avant et après<br />
traitement, parallèlement à l’axe mécanique physiologique, puis<br />
selon deux directions orthogona<strong>les</strong> à celui-ci. Les 3 lots de<br />
20 échantillons ont subis <strong>les</strong> traitements suivants : délipidation<br />
par CO 2 supercritique, puis peroxyde d’hydrogène, hydroxyde<br />
de sodium, dihydrogénophosphate monosodique puis ethanol.<br />
Le premier lot n’a pas subi d’irradiation complémentaire, le<br />
second a été irradié à la dose de 10 KGys, le troisième à la dose<br />
de 25 KGys (rayonnement gamma).<br />
RÉSULTATS. L’altération de la vitesse de propagation <strong>des</strong><br />
on<strong>des</strong> ultrasonores n’a pas excédé 3,5 %, comparée au groupe<br />
non irradié. La comparaison <strong>des</strong> modu<strong>les</strong> d’elasticité montrait<br />
une rigidification faible mais statistiquement significative dans<br />
trois <strong>des</strong> six sous groupes définis précédemment (HF et BF pour<br />
<strong>les</strong> trois traitements).<br />
CONCLUSION. L’irradiation de l’os traité délipidé altère faiblement<br />
ses propriétés mécaniques. Elle entraîne cependant une<br />
rigidification <strong>des</strong> échantillon faible mais mesurable à 25 Kgys,<br />
pouvant rendre <strong>les</strong> greffons plus cassant lors de l’implantation.<br />
La validation virobactériologique de doses plus restreintes serait<br />
de ce fait intéressante.<br />
* Laurent Vastel, Hôpital Cochin, Banque de Tissus Osseux,<br />
27, rue du Faubourg-Saint-Jacques, 75014 Paris.<br />
280 Un nouveau système chirurgical<br />
dans la réhabilitation de l’amputation<br />
: l’ostéo-intégration<br />
Marion BERTRAND-MARCHAND *,<br />
Rickard BRÂNEMARK, Jacques BAHUAUD<br />
INTRODUCTION. Les amputations traumatiques ou résultant<br />
de chirurgie carcinologique se situent souvent à <strong>des</strong><br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S157<br />
niveaux d’amputation proche de l’articulation sus jacente, avec<br />
<strong>des</strong> problèmes de cicatrisation et de moignon court. Il est souvent<br />
difficile d’obtenir une réhabilitation optimale chez ces<br />
patients par une prothèse. Une prothèse ancrée directement au<br />
niveau de l’os pourrait être une solution fonctionnellement<br />
bonne pour ces patients. L’ostéo-intégration est l’ancrage direct<br />
d’un implant dans l’os avec colonisation de celui-ci par le tissu<br />
osseux, sans formation de fibrine à l’interface os/implant. Les<br />
prothèses ancrées à l’os selon le concept de l’ostéo-intégration<br />
ont été développées par le professeur Per-Ingvar-Ingvar Brånemark<br />
à Goteborg (Suède). L’ostéo-intégration a d’abord été utilisée<br />
dans la chirurgie dentaire et maxillofaciale reconstructrice<br />
(29000 cas réalisés en maxillofacial dans le monde). Dans une<br />
approche multidisciplinaire, l’ostéo-intégration a été employée<br />
depuis 1990 d’abord en Suède, puis en Angleterre, pour<br />
l’ancrage direct <strong>des</strong> prothèses d’amputation, dans le squelette,<br />
dans <strong>des</strong> indications précises, se limitant aux patients ayant <strong>des</strong><br />
problèmes d’adaptation avec leur prothèse, <strong>les</strong> moignons<br />
courts.<br />
TECHNIQUE. L’équipe se compose de chirurgiens orthopédistes,<br />
de physiothérapeutes et de prothésistes. Le protocole chirurgical<br />
se fait en 2 étapes à 6 mois d’intervalle avec un<br />
protocole de remise en charge précis et progressif. Une fois en<br />
place, la prothèse est directement ancrée dans l’os, libérant ainsi<br />
l’articulation sus-jacente, améliorant <strong>les</strong> mobilités, la stabilité et<br />
le confort.<br />
RÉSULTATS. Les patients (150 cas suédois entre 1 an et<br />
15 ans de recul) ont montré une fonction accrue, une reprise de<br />
leurs activités, une facilité d’utilisation de la prothèse, une utilisation<br />
de tous <strong>les</strong> jours et toute la journée sans douleur. Des possibilités<br />
sensoriel<strong>les</strong> accrues ont été notées (ostéo-perception),<br />
améliorant la fonction et l’acceptation physiologique. Dans <strong>les</strong><br />
complications, <strong>des</strong> infections superficiel<strong>les</strong> résolutives, 1 cas<br />
d’infection profonde. Il n’y a pas eut de fracture d’implant.<br />
L’ostéo-intégration se fait aujourd’hui parfaitement dans 95 %<br />
<strong>des</strong> cas sans problème.<br />
CONCLUSION. Le concept <strong>des</strong> prothèses d’amputation<br />
directement ancrées dans l’os, selon le principe de l’ostéo-intégration,<br />
éprouvées depuis maintenant 15 ans, pourraient apporter<br />
une solution fonctionnelle à <strong>des</strong> patients souvent jeunes, ayant<br />
<strong>des</strong> difficultés de réhabilitation sociale et professionnelle, de part<br />
leur niveau d’amputation ou à cause de difficultés d’appareillage.<br />
* Marion Bertrand-Marchand, 61, avenue Saint-Char<strong>les</strong>,<br />
34090 Montpellier.
3S158 81 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
285 Effets d’ostéotomies fémora<strong>les</strong><br />
basses de rotations sur <strong>les</strong> contraintes<br />
fémoro-tibia<strong>les</strong> et la cinématique<br />
du genou<br />
Bruno BAILLON *, Stépane SOBCZAK,<br />
Patrick SALVIA, Jean-Marie BAILLON,<br />
Marcel ROOZE<br />
Certains auteurs se sont penchés sur le rôle <strong>des</strong> torsions <strong>des</strong><br />
membres inférieurs dans l’apparition <strong>des</strong> gonarthroses latéralisées.<br />
Des associations de troub<strong>les</strong> de torsions squelettiques du membre<br />
inférieur et gonarthroses ont été observées en l’absence de déformation<br />
dans le plan frontal. Afin de mieux comprendre le rôle de<br />
ces torsions, nous avons imaginé un dispositif expérimental permettant<br />
d’étudier le retentissement d’ostéotomies fémora<strong>les</strong> de<br />
rotations sur la cinématique du genou et <strong>les</strong> contraintes fémorotibia<strong>les</strong>.<br />
Six membres inférieurs de cadavres ont été requis. L’analyse<br />
de la cinématique a été réalisée grâce à un électrogoniomètre<br />
à six degrés de liberté. Les bras de levier <strong>des</strong> musc<strong>les</strong> de la cuisse<br />
ont été évalués par la méthode <strong>des</strong> excursions tendineuses. Six<br />
capteurs ont été introduits dans l’épiphyse proximale du tibia afin<br />
de mesurer <strong>les</strong> contraintes de compression. Ceux-ci sont constitués<br />
de jauges d’extensométrie coulées dans une résine. Des mouvements<br />
de flexion-extension sont effectués avant l’ostéotomie<br />
puis après <strong>des</strong> rotations allant de 6 à 18 degrés en interne et en<br />
externe. Nous avons observé que la correction en rotation interne<br />
augmente l’adduction tibiale alors que la rotation externe la diminue.<br />
La correction en rotation externe est responsable d’une translation<br />
latérale du tibia alors que la rotation interne provoque une<br />
translation médiale. La correction en rotation interne semble diminuer<br />
le bras de levier <strong>des</strong> musc<strong>les</strong> internes et diminuerait leur efficacité.<br />
La rotation interne augmente le bras de levier du tenseur du<br />
fascia lata et augmenterait son efficacité. Inversement, <strong>les</strong> rotations<br />
externes entraînent une augmentation <strong>des</strong> bras de levier <strong>des</strong><br />
musc<strong>les</strong> internes et une diminution du bras de levier du tenseur du<br />
fascia lata. La correction en rotation externe du fémur augmente<br />
<strong>les</strong> contraintes externes alors que la rotation interne <strong>les</strong> augmente<br />
au niveau du compartiment interne. Nos observations diffèrent de<br />
cel<strong>les</strong> de Goutallier et al. (97) qui avaient observé que la torsion<br />
fémorale interne élevée entraînait <strong>des</strong> contraintes externes. Selon<br />
Moussa (94), une torsion fémorale interne faible est associée à une<br />
gonarthrose évoluée. Takaï et al. (85) n’ont pas observé de différence<br />
de torsion fémorale entre un groupe d’arthrose externe et un<br />
groupe d’arthrose interne. Yagi a observé une tendance à la torsion<br />
fémorale interne élevée dans l’arthrose fémoro-tibiale interne.<br />
C’est la seule observation qui concorde avec <strong>les</strong> résultats de notre<br />
étude. Il apparaît donc que <strong>les</strong> modifications de torsions fémora<strong>les</strong><br />
ont <strong>des</strong> répercussions sur <strong>les</strong> contraintres intra-articulaires et également<br />
sur <strong>les</strong> paramètres cinématiques du genou.<br />
Séance du 9 novembre après-midi<br />
* Bruno Baillon, 332, avenue de Tervuren,<br />
1150 Bruxel<strong>les</strong>, Belgique.<br />
GENOU<br />
286 Ostéotomies étagées de dérotation<br />
<strong>des</strong> membres inférieurs dans la<br />
pathologie fémoro-patellaire : à<br />
propos de 49 cas<br />
Doan Co MINH *, Mohamed HASSAIRI,<br />
Olivier FONTES, Oussama ZGAIBI,<br />
Philippe MAURY<br />
INTRODUCTION. Beaucoup d’auteurs ont démontré<br />
l’influence <strong>des</strong> anomalies torsionnnel<strong>les</strong> sur la décompensation<br />
de l’articulation fémoro-patellaire mais peu d’entre eux ont proposé<br />
un traitement chirurgical de dérotation.<br />
Notre objectif est de démontrer l’efficacité de cette chirurgie<br />
en rapportant notre expérience sur une série de 49 cas d’ostéotomie<br />
de dérotation du membre inférieur pour syndrome ou instabilité<br />
rotulienne.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Il s’agit d’une étude rétrospective<br />
de 42 patients (49 genoux) opérés de 1986 à 2002, avec<br />
31 femmes, 11 hommes et d’âge moyen de 30 ans (14-55).Tous<br />
<strong>les</strong> patients avaient un syndrome douloureux rotulien, 20 %<br />
d’entre eux avaient une instabilité rotulienne. L’évaluation clinique<br />
comprenait <strong>les</strong> mesures <strong>des</strong> torsions tibia<strong>les</strong>, de la balance<br />
rotatoire <strong>des</strong> hanches et l’examen <strong>des</strong> genoux. La symptomatologie<br />
fonctionnelle rotulienne a été évaluée selon le score lillois<br />
sur 100 points. Un bilan radiologique comprenait <strong>des</strong> radiographies<br />
standards <strong>des</strong> genoux, <strong>des</strong> hanches, un pangonogramme en<br />
charge et un scanner mesurant <strong>les</strong> torsions fémora<strong>les</strong> et tibia<strong>les</strong>.<br />
L’indication chirurgicale était à la carte en fonction <strong>des</strong> anomalies.<br />
Dans 14 cas, une double ostéotomie de dérotation externe<br />
intertrochantérienne du fémur et de dérotation interne du tibia a<br />
été réalisée pour hyper-rotation interne de hanche associée à une<br />
torsion tibiale externe exagérée. Dans 31 cas, il y avait une dérotation<br />
interne du tibia pour <strong>des</strong> torsions tibia<strong>les</strong> externes exagérées<br />
isolées et dans 4 cas, une dérotation interne fémorale seule a<br />
été faite pour hyper-rotation externe de hanche.<br />
RÉSULTATS. Au recul moyen de 6 ans et 2 mois (2-18), le<br />
score fonctionnel postopératoire était de 89,9 points (gain relatif<br />
de 50 points) avec 85,7 % de bons et très bons résultats. La<br />
balance rotatoire moyenne <strong>des</strong> hanches opérées a été équilibrée<br />
avec une rotation interne de 39° et une rotation externe de 34° et<br />
la torsion tibiale externe moyenne postopératoire était de 12°.<br />
Aucun patient n’avait d’instabilité rotulienne. Cependant, il y<br />
avait 16 % de complications postopératoires transitoires (déficit<br />
du nerf fibulaire temporaire, sepsis précoce) qui n’ont pas eu<br />
d’influence sur le résultat fonctionnel après reprise.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. L’ensemble <strong>des</strong> résultats<br />
est satisfaisant pour cette chirurgie lourde qui s’avère efficace<br />
pour traiter ces troub<strong>les</strong> fémoro-patellaires sévères que le traitement<br />
médical ou la chirurgie à minima (section de l’aileron<br />
externe, transposition de la tubérosité tibiale antérieure) ne peut<br />
résoudre. Toute la difficulté est d’attribuer la part de responsabi-
lité <strong>des</strong> anomalies torsionnel<strong>les</strong> <strong>des</strong> membres inférieurs dans la<br />
pathologie rotulienne.<br />
* Doan Co Minh, Hôpital Lapeyronie, 371,<br />
avenue du Doyen-Gaston-Giraud, 34295 Montpellier Cedex.<br />
287 Essai de classification globale <strong>des</strong><br />
dysplasies de la trochlée fémorale<br />
Sébastien GUILBERT *, Colin DUJARDIN,<br />
Jean-François VIALA, François GOUGEON<br />
INTRODUCTION. Quel<strong>les</strong> sont, dans <strong>les</strong> dysplasies de la trochlée,<br />
<strong>les</strong> anomalies retrouvées en axial et en sagittal ? Une classification<br />
intégrant l’ensemble <strong>des</strong> anomalies peut-elle être<br />
proposée ?<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Cent vingt patients (72 IRO/<br />
IRP, 48 SDR) et 21 témoins inclus dans l’étude. Analyse arthroscannographique<br />
axiale basée sur 3 coupes étagées de la trochlée<br />
(coupe de l’arche « romane » et « trochlée proximale ») et de la<br />
sus-trochlée (coupe « sus-trochléenne ») avec mesure de l’obliquité<br />
du versant latéral de la trochlée par rapport à la ligne bicondylienne<br />
postérieure. Analyse arthroscannographique sagittale<br />
avec mesure de la saillie et analyse de la zone de jonction trochlée/sus-trochlée.<br />
RÉSULTATS. Axial : <strong>les</strong> dysplasies avec éperon sus-trochléen<br />
ont une obliquité du versant latéral de la trochlée négatif<br />
sur <strong>les</strong> coupes axia<strong>les</strong> proxima<strong>les</strong> (coupes « trochlée proximale »<br />
et « sus-trochléenne »). L’instabilité patellaire est hautement<br />
associée à cette anomalie (p < 0,0001). Les valeurs d’obliquité<br />
sont également diminuées en cas de dysplasie sans éperon sustrochléen<br />
par rapport aux témoins (p < 0,05) mais ne sont jamais<br />
négatives. L’instabilité patellaire dans ce cas est faible (15 % <strong>des</strong><br />
cas). Aucune différence SDR/témoins en axial. Sagittal : la<br />
saillie scannographique est mesurée à 3,7 mm ± 1 en moyenne<br />
en cas de dysplasie avec éperon pour 3,5 mm ± 1 en cas de dysplasie<br />
sans éperon(ns). Les SDR ont une saillie à 2,8 mm ± 1,<br />
supérieure à celle <strong>des</strong> témoins mesurée à 1,6 mm ± 1 (p < 0,05).<br />
Les lésions cartilagineuses patellaires sont plus fréquentees<br />
(p < 0,05) si la saillie est > 3 mm et si la zone de jonction entre la<br />
trochlée et la sus-trochlée est « agressive » (forme « carrée » ou<br />
« oblique » et largeur > 10 mm).<br />
DISCUSSION. Il existe <strong>des</strong> anomalies axia<strong>les</strong> et sagitta<strong>les</strong> de<br />
la trochlée, associées ou indépendantes. Nous proposons une<br />
nouvelle classification <strong>des</strong> dysplasies de la trochlée fémorale en<br />
3 sta<strong>des</strong>, basée sur une analyse anatomopathologique avec une<br />
gradation <strong>des</strong> lésions : <strong>les</strong> dysplasies axia<strong>les</strong> « luxantes » associées<br />
ou non à une dysplasie sagittale « agressive », <strong>les</strong> plus graves,<br />
pour <strong>les</strong>quel<strong>les</strong> le bilan radiographique retrouve un signe de<br />
l’éperon sus-trochléen ; <strong>les</strong> dysplasies axia<strong>les</strong> « non luxantes »<br />
associées ou non à une dysplasie sagittale « agressive », sans<br />
éperon sus-trochléen sur le bilan radiographique ; <strong>les</strong> dysplasies<br />
sagitta<strong>les</strong> isolées, sans signe du croisement et caractérisées par<br />
une saillie isolée de la trochlée.<br />
CONCLUSION. Cette classification permet pour chaque dysplasie<br />
de la trochlée fémorale de connaître son pronostic évolutif<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S159<br />
vis à vis du risque d’instabilité patellaire et de dégradation cartilagineuse<br />
à long terme.<br />
* Sébastien Guilbert, Service de Chirurgie Orthopédique<br />
et Traumatologique, CHR d’Orléans-Hôpital de la Source,<br />
14, avenue de l’Hôpital, 45000 Orléans.<br />
288 Comparaison de l’effet chondroprotecteur<br />
de 2 différents viscosuppléments<br />
sur un modèle d’arthrose<br />
expérimentale par section du ligament<br />
croisé antérieur<br />
Laurent GALOIS *, Astrid PINZANO,<br />
Stéphanie ETIENNE, Laurent GROSSIN,<br />
Patrick NETTER, Pierre GILLET,<br />
Didier MAINARD<br />
INTRODUCTION. La viscosupplémentation s’est imposée<br />
au cours <strong>des</strong> dernières années dans l’arsenal thérapeutique de la<br />
gonarthrose. Les aci<strong>des</strong> hyaluroniques (AH) disponib<strong>les</strong> sur le<br />
marché sont nombreux se distinguant par leur origine, leur poids<br />
moléculaire ou encore leur réticulation. Notre objectif a été de<br />
comparer l’efficacité de 2 AH lors d’un modèle d’arthrose expérimentale<br />
par section du ligament croisé antérieur.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Une section du ligament croisé<br />
antérieur (LCA) a été effectuée sur <strong>des</strong> rats Wistar de 250 grammes<br />
selon un protocole codifié. Les rats ont été répartis en<br />
4 groupes : (a) témoins absolus [G0], (b) groupe avec section du<br />
LCA et injection de sérum physiologique [G1], (c) groupe avec<br />
section de LCA et injection de Synvisc ® [G2], et (d) groupe avec<br />
section de LCA et injection de Hyalgan ® [G3]. Les injections<br />
intra-articulaires ont été effectuées à J7, J14 et J21. Les rats ont<br />
été sacrifiés à J28. Les genoux ont été prélevés pour examen histologique<br />
(colorations HES et bleu de Toluidine). Le score de<br />
Mankin a été utilisé pour apprécier la gravité <strong>des</strong> lésions cartilagineuses.<br />
Une étude immunohistochimique (Caspase 3 activée et<br />
Hsp 70) a été pratiquée pour apprécier l’apoptose et l’expression<br />
<strong>des</strong> protéines de choc thermique.<br />
RÉSULTATS. Après section du LCA (G1), le score histologique<br />
de Mankin augmentait progressivement (19/50 à J7, 30/50 à<br />
J14 et 35/50 à J28) traduisant l’apparition de lésions chondra<strong>les</strong><br />
dégénératives. Les lésions histologiques observées étaient statistiquement<br />
moins importantes dans <strong>les</strong> groupes de viscosupplémentation<br />
G2 (17/50) et G3 (19/50) par rapport au groupe<br />
témoin G1 (35/50) (p < 0,005). Il n’existait en revanche aucune<br />
différence statistiquement significative entre <strong>les</strong> 2 groupes G2 et<br />
G3. Les phénomènes apoptotiques étaient diminués significativement<br />
dans <strong>les</strong> groupes G2 et G3 par rapport au groupe témoin<br />
G1 (p < 0,05). Il existait une surexpression de la protéine Hsp 70<br />
dans <strong>les</strong> groupes G2 et G3 (p < 0,005). À noter cependant l’existence<br />
d’une synovite plus marquée dans <strong>les</strong> groupes G2 et G3.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. Ces résultats montrent<br />
l’effet bénéfique de la viscosupplémentation par AH dans la prévention<br />
<strong>des</strong> lésions dégénératives après section du LCA chez le
3S160 81 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
rat. Le type d’AH utilisé n’a pas influencé ces résultats. L’efficacité<br />
de l’AH, encore mal comprise, dépend de multip<strong>les</strong> facteurs,<br />
dont la diminution <strong>des</strong> phénomènes apoptotiques et la surexpression<br />
concomitante <strong>des</strong> protéines de choc thermique.<br />
* Laurent Galois, Service de Chirurgie Orthopédique<br />
et Traumatologique, Hôpital Central, CHU de Nancy, 29,<br />
avenue du Maréchal-Lattre-de-Tassigny, 54035 Nancy Cedex.<br />
289 Ostéotomies tibia<strong>les</strong> de valgisation<br />
du genou par addition interne :<br />
évaluation de l’utilisation d’une allogreffe<br />
traitée Osteopure ® et d’une<br />
plaque Surfix ®<br />
Stéphane BOISGARD *, Stéphane DESCAMPS,<br />
Désiré KACOU, Philippe MOREEL,<br />
Jean-Paul LEVAI<br />
INTRODUCTION. Dans la gonarthrose fémoro-tibiale<br />
interne sur genu varum,l’osteotomie tibiale de valgisation par<br />
addition interne, nécessite habituellement un comblement de<br />
l’ouverture par une greffe et une stabilisation avec du matériel<br />
d’ostéosynthèse. Le but de ce travail était d’évaluer l’utilisation<br />
d’une allogreffe traitée Osteopure ® et d’une plaque Surfix ® .<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Vingt-huit patients (19 hommes<br />
9 femmes) d’âge moyen 50 ans (32-62), soit 30 ostéotomies, ont<br />
été inclus. Le recul moyen était de 11 mois (minimum 6). Le<br />
greffon Osteopure ® est une allogreffe traitée par procédé physiso-chimique<br />
conservant la trame collagénique. La plaque Surfix<br />
® dispose d’une contre vis solidarisant vis et plaque.<br />
L’évaluation a été faite sur : cliniquement, douleur, mobilié, et<br />
périmètre de marche ; radiologiquement, correction angulaire,<br />
pente tibiale, hauteur de rotule, aspect de la greffe selon <strong>les</strong> critères<br />
du Gesto (aspect de la greffe, jonction os-greffe).<br />
RÉSULTATS. Vingt-six cas sur 28 ont un bon résultat clinique<br />
avec absence de douleur, flexion supérieure à 120° et périmètre<br />
de marche illimité. L’axe HKA passe en moyenne de<br />
6,8° en varusà 2,3° en valgus en postopératoire avec une seule<br />
hypocorrection en varus. La pente tibiale est augmentée et la<br />
hauteur rotulienne est diminuée, de façon significative dans <strong>les</strong><br />
deux cas (p < 0,01). La densité radiologique de la greffe est<br />
28 fois normale ou légèrement hyperdense, 2 fois hypodense. La<br />
jonction os-greffe est 26 fois normale sans liseré, 2 fois avec un<br />
liseré hyperdense, 2 fois avec un liseré clair. On ne note aucune<br />
complication liée à la greffe ou à la plaque.<br />
DISCUSSION. Sur le plan clinique la qualité <strong>des</strong> résultats est<br />
comparable à ceux de la littérature. La technique permet une correction<br />
fiable respectant la planification préopératoire. L’augmentation<br />
de la pente tibiale est liée à un défaut technique qui<br />
peut être corrigé par le positionnement plus postérieur de la<br />
greffe. Les complications <strong>des</strong> xenogreffes et du corail ne sont<br />
pas retrouvées, le comportement biologique étant comparable<br />
aux autogreffes et aux substituts osseux de synthèse. Sur le plan<br />
radiologique, l’image est proche de l’autogreffe dans la majorité<br />
<strong>des</strong> cas sans anomalie de la jonction greffe-os avec une densité<br />
proche de l’os receveur<br />
CONCLUSION. L’ostéotomie de valgisation par ouverture<br />
interne du tibia peut bénéficier de cette technique qui est fiable et<br />
n’entraîne aucune complication liée à la plaque ou à la greffe<br />
Osteopure ® , qui se comporte biologiquement et radiologiquement<br />
au plus près d’une autogreffe.<br />
* Stéphane Boisgard, Service de Chirurgie Orthopédique<br />
et Traumatologique I, Hôpital Gabriel-Montpied,<br />
CHU de Clermont Ferrand, BP 69,<br />
63003 Clermont-Ferrand Cedex 01.<br />
290 L’ostéotomie médiale de valgisation<br />
de tibia sans comblement fixée par<br />
la plaque tomofix (Synthes) :<br />
critères de faisabilité, technique<br />
chirurgicale et protocole postopératoire.<br />
Notre expérience à partir<br />
d’une série de 51 patients<br />
Thomas BROSSET *, Stéphane BOLZER,<br />
François GOUGEON<br />
INTRODUCTION. Le but du travail était de rapporter <strong>les</strong><br />
résultats d’une série prospective continue, de juin 2003 à février<br />
2006, de nos 51 premiers patients, d’exposer <strong>les</strong> évolutions<br />
apportées à la technique opératoire originelle (AE Staubli et<br />
coll.) et <strong>les</strong> critères per et postopératoires (cliniques et radiographiques)<br />
influençant le protocole de rééducation.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. L’ostéotomie est bi plane rétro<br />
tubérositaire et horizontale. L’ouverture du foyer d’ostéotomie<br />
s’effectue à l’aide d’un rapporteur-distracteur. L’ostéotomie est<br />
fixée par une plaque Tomofix. L’ouverture n’est pas comblée.<br />
51 patients, 36 hommes et 15 femmes, avec un âge moyen de<br />
53 ans (33 à 73 ans) ont été inclus. Ils présentaient une gonarthrose<br />
médiale sur genu varum avec un angle HKA pré opératoire<br />
moyen de 172° (165 à 178). L’objectif de correction d’axe était<br />
de 3 degrés de valgus. Le suivi a été clinique (score IKS) et<br />
radiologique (un index de consolidation dans le trait d’ostéotomie<br />
a été créé sur <strong>les</strong> radiographies de genou de face et un pangonogramme<br />
unipodal en charge a été systématiquement réalisé<br />
en post opératoire). La tolérance de la plaque a été évaluée.<br />
RÉSULTATS. L’axe a été sous corrigé de 1,89 degré en<br />
moyenne (7 degrés de varus à 3 degrés de valgus). La consolidation<br />
a été obtenue en 4,5 mois (1,5 à 9 mois) et l’appui complet<br />
était effectif à 3 mois (1,5 à 8 mois). La position superficielle de<br />
la plaque était douloureuse dans 7 cas, gênante dans 11 cas<br />
(35 % <strong>des</strong> patients). Le score genou est passé de 69 à 90 et le<br />
score fonction a été augmenté de 85 à 95. 92 % <strong>des</strong> patients<br />
étaient satisfaits ou très satisfaits. Les complications ont été<br />
mineures : 5 dysesthésies en regard de la cicatrice, 2 insuffisances<br />
de consolidation, 1 sepsis documenté.
DISCUSSION. Nos résultats sont comparab<strong>les</strong> à ceux de la<br />
littérature en terme de consolidation, d’appui complet ou de correction<br />
de l’axe du membre inférieur. Les deux insuffisances de<br />
consolidations ont été reprises par autogreffe iliaque sans changement<br />
de la fixation. Dans ces deux cas, la consolidation a été<br />
obtenue en 6 semaines. L’absence de comblement évite <strong>les</strong> problèmes<br />
liés à la prise d’os autologue (greffon iliaque) ou à<br />
l’ostéo-intégration de substitut osseux. On ne constate pas de<br />
perte de correction à moyen terme.<br />
CONCLUSION. L’ostéotomie de valgisation par ouverture<br />
médiale sans comblement fixée par la plaque Tomofix est une<br />
technique fiable qui n’expose pas dans notre série à <strong>des</strong> pertes de<br />
correction secondaires.<br />
* Thomas Brosset, Service d’Orthopédie D, Hôpital Salengro,<br />
CHRU de Lille, place de Verdun, 59037 Lille Cedex.<br />
291 Variation de hauteur de la rotule<br />
induite par une ostéotomie tibiale<br />
de valgisation par addition interne<br />
Moulay HICHAM EL AMRANI *,<br />
Stéphane SCHARYCKI, Bruno LÉVY,<br />
Frédéric DESMOULINS, Charaf AZMY,<br />
Alain ASSELINEAU<br />
INTRODUCTION. Le but de notre étude était de mesurer la<br />
variation de la position en hauteur de la rotule après une ostéotomie<br />
tibiale de valgisation par addition interne, ainsi que ses conséquences<br />
éventuel<strong>les</strong> sur <strong>les</strong> amplitu<strong>des</strong> articulaires et la<br />
fonction fémoro-patellaire.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Il s’agit d’une étude rétrospective<br />
incluant 40 ostéotomies tibia<strong>les</strong> de valgisation par addition<br />
interne réalisées entre 1994 et 2005 pour gonarthrose fémorotibiale<br />
interne sur genu varum. La correction moyenne a été de<br />
12 degrés. Toutes ces ostéotomies ont été synthésées par plaque<br />
vissée, associée soit à une greffe osseuse iliaque soit à un bloc de<br />
substitut osseux. La grande majorité <strong>des</strong> patients a été rééduquée<br />
dès le troisième jour postopératoire. Tous <strong>les</strong> patients ont fait<br />
l’objet d’une évaluation clinique et radiologique identique : la<br />
fonction a été évaluée avec le score IKS. Les index de Caton et<br />
Deschamps, de Insall et Salvati et de Blackburne et Peel ont été<br />
mesurés en pré et postopératoire ainsi qu’au dernier recul. Les<br />
axes fémoro-tibiaux (angle HKA) et la pente tibiale ont également<br />
été mesurés.<br />
RÉSULTATS. L’abaissement de la rotule a été quantifié de 12<br />
à 15 % de la hauteur initiale. Nous n’avons pas retrouvé de corrélation<br />
significative entre l’importance de l’abaissement de la<br />
rotule et le score clinique d’une part et l’importance de la correction<br />
angulaire frontale du tibia d’autre part.<br />
DISCUSSION. Notre étude confirme une donnée jusque là<br />
non quantifiée de la littérature : l’ostéotomie tibiale de valgisation<br />
par ouverture interne entraîne un abaissement de la rotule<br />
que nous évaluons à environ 15 %. Cependant, il est intéressant<br />
de noter que le degré d’abaissement n’est pas proportionnel au<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 3S161<br />
degré d’ouverture de l’ostéotomie, ce qui amène à penser que la<br />
hauteur de la rotule ne dépend pas uniquement de facteurs géométriques.<br />
Des rétractions tissulaires, évoquées par certains<br />
auteurs, peuvent intervenir. Il est d’ailleurs admis que <strong>les</strong> autres<br />
types d’ostéotomies tibia<strong>les</strong> de valgisation peuvent également<br />
entraîner un abaissement de la rotule. D’autre part, l’abaissement<br />
de la rotule n’a pas eu, dans cette série, de retentissement clinique<br />
significatif et aucun patient n’a dû être réopéré secondairement<br />
pour arthroplastie totale.<br />
CONCLUSION. L’ostéotomie tibiale de valgisation par addition<br />
interne entraîne un abaissement patellaire modéré sans<br />
retentissement clinique notable.<br />
* Moulay Hicham El Amrani, Centre Hospitalier<br />
de Villeneuve-Saint-Georges, 40, allée de la Source,<br />
94190 Villeneuve-Saint-Georges.<br />
292 Étude anatomique <strong>des</strong> rapports<br />
nerf infra-patellaire-ligament patellaire<br />
: application au prélèvement<br />
du greffon os-ligament patellaire-os<br />
Nicolas BONIN *, Daniel LEPAGE,<br />
Laurent OBERT, Patrick GARBUIO,<br />
David DEJOUR<br />
INTRODUCTION. Le but de ce travail était d’étudier <strong>les</strong> rapports<br />
entre <strong>les</strong> branches infra-patellaires du nerf saphène et le<br />
ligament patellaire pour évaluer l’intérêt <strong>des</strong> techniques de prélèvement<br />
du greffon os-ligament patellaire-os par mini-abord utilisant<br />
deux incisions.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Trente-huit genoux vierges,<br />
chez quarante cadavres frais, ont été disséqués au laboratoire<br />
d’anatomie. Les rameaux infra-patellaires ont été recherchés et<br />
leur nombre noté. Leur situation a été cartographiée par la distance<br />
entre la pointe de la patella et le rameau nerveux supérieur,<br />
et par la distance entre le rameau nerveux inférieur et le bord<br />
supérieur de la tubérosité tibiale.<br />
RÉSULTATS. La branche infra-patellaire du nerf saphène n’a<br />
pas été retrouvée en regard du ligament patellaire ou de ses<br />
insertions osseuses sur trois genoux. Un rameau a été retrouvé<br />
sur seize genoux, deux rameaux sur treize genoux, trois rameaux<br />
sur six genoux. Parmi ces rameaux, dix croisaient la pointe rotulienne,<br />
douze croisaient la tubérosité tibiale. Au niveau du ligament<br />
patellaire, cinq rameaux étaient à moins de dix millimètres<br />
de la pointe de la patella, quatre à moins de dix millimètres de la<br />
tubérosité tibiale. La situation du nerf infra-patellaire a été<br />
retrouvée différente d’un sujet à un autre, mais également sur <strong>les</strong><br />
deux genoux d’un même sujet.<br />
DISCUSSION. Cette étude confirme la variabilité de<br />
l’innervation sensitive infra-patellaire du genou. Sur trente-huit<br />
genoux, soixante rameaux nerveux sont en regard du ligament<br />
patellaire ou de ses insertions osseuses. De part cette localisation,<br />
la totalité de ces rameaux nerveux seraient sectionnés lors
3S162 81 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
du prélèvement du greffon os-ligament patellaire–os par un<br />
abord standard. Aussi certains auteurs proposent une technique<br />
de prélèvement du greffon os-ligament patellaire-os par miniabord<br />
en utilisant deux incisions. Dans notre étude, ce double<br />
abord aurait permis la sauvegarde <strong>des</strong> deux tiers <strong>des</strong> rameaux<br />
nerveux. Les incisions doivent être en regard <strong>des</strong> reliefs<br />
osseux, certaines branches infra-patellaires étant très proches<br />
<strong>des</strong> insertions ligamentaires. Certains proposent <strong>des</strong> incisions<br />
horizonta<strong>les</strong>.<br />
CONCLUSION. La localisation <strong>des</strong> branches nerveuses en<br />
regard du ligament patellaire reste imprévisible : il n’existe pas<br />
de zone de sécurité. Leur section a pour conséquence <strong>des</strong> dysesthésies<br />
antéro-latéra<strong>les</strong> du genou, qui peuvent compromettre le<br />
résultat fonctionnel final de la ligamentoplastie. Cette étude confirme<br />
le bien fondé du prélèvement du greffon os-ligament patellaire-os<br />
par mini abord utilisant deux incisions en regard <strong>des</strong><br />
reliefs osseux.<br />
* Nicolas Bonin, Clinique de la Sauvegarde,<br />
8, avenue Ben-Gourion, 69009 Lyon.<br />
293 Apport de la thérapie cellulaire<br />
dans la cicatrisation tendon-os<br />
Elias DAGHER *, Jean-François KEMPF,<br />
Scott RODEO<br />
INTRODUCTION. L’apport de la thérapie cellulaire a été<br />
étudié dans plusieurs applications, mais nous connaissons peu<br />
l’effet <strong>des</strong> cellu<strong>les</strong> souches mésenchymateuses sur la cicatrisation<br />
tendon-os. le but de ce travail était d’étudier l’influence <strong>des</strong><br />
cellu<strong>les</strong> souches mésenchymateuses humaines (CSMH) sur <strong>les</strong><br />
phénomènes de cicatrisation à l’interface tendon-os dans un<br />
modèle animal de reconstruction du ligament croisé antérieur<br />
(LCA) chez le rat.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Une reconstruction du ligament<br />
croisé antérieur par le tendon long fléchisseur <strong>des</strong> orteils a<br />
été réalisée de manière bilatérale chez 36 rats athymiques. Les<br />
72 genoux ont été placés dans trois groupes différents de 24<br />
genoux chacun. Dans le premier groupe, 1 million de CSMH<br />
suspendues dans 0,1 ml d’une solution de colle de fibrine ont<br />
été injectées au niveau <strong>des</strong> tunnels osseux après le passage du<br />
greffon. Le deuxième groupe a reçu la colle de fibrine seule à<br />
l’interface tendon-os. Le troisième groupe n’a rien reçu après la<br />
reconstruction du LCA et constituait le groupe contrôle.<br />
4 genoux dans chaque groupe étaient consacrés à l’étude histologique<br />
(étude morphologique en coloration H-E et S-O, mesure<br />
<strong>des</strong> fibres collagènes en lumière polarisée, étude immunohistochimique<br />
anti Collagène II) à la 2 e , 4 e et 6 e semaines postopératoires.<br />
Douze rats dans chaque groupe étaient consacrés à<br />
l’étude biomécanique qui a analysé la charge à la rupture et la<br />
rigidité <strong>des</strong> greffons à la 6 e semaine postopératoire.<br />
RÉSULTATS. Des cellu<strong>les</strong> ressemblant à <strong>des</strong> chondrocytes<br />
ont été observées à l’interface de cicatrisation dans le premier<br />
groupe. Ces cellu<strong>les</strong> étaient entourées d’une matrice riche en<br />
Protéoglycanes (coloration S-O) et en Collagène II (immunohistochimie).<br />
La mesure <strong>des</strong> fibres collagènes en lumière polarisée<br />
à l’interface était significativement plus importante dans le<br />
groupe <strong>des</strong> CSMH. Les tests biomécaniques ont retrouvé une<br />
charge à la rupture et une rigidité significativement plus importantes<br />
dans <strong>les</strong> genoux ayant reçu <strong>les</strong> cellu<strong>les</strong> souches ou la colle<br />
de fibrine par rapport au groupe contrôle.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. La colle de fibrine semble<br />
être un bon moyen pour délivrer <strong>des</strong> cellu<strong>les</strong> souches à<br />
l’interface tendon-os. Ces cellu<strong>les</strong> semblent avoir tendance à se<br />
différencier vers la lignée chondrogénique dans cet environnement,<br />
permettant ainsi une cicatrisation qui ressemble plus au<br />
site d’insertion natif formé d’un tissu fibrocartilagineux riche en<br />
Protéoglycanes et en Collagène II. L’importance de la formation<br />
collagénique à l’interface et l’amélioration <strong>des</strong> propriétés mécaniques<br />
suggèrent une amélioration de la cicatrisation tendon-os à<br />
la phase précoce.<br />
* Elias Dagher, CHU Hautepierre, avenue Molière, Strasbourg.
SO.F.C.O.T. Réunion Annuelle, novembre 2006 © 2006. Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés<br />
(Suppl. au n o 6, Rev. Chir. Orthop. 2006, 92)<br />
A<br />
ABADIE Pierre, 34<br />
ABID Aziz, 81<br />
ACCADBLED Franck, 46, 81,<br />
83, 270<br />
ADAM Jacques-Marie, 256<br />
ADAM Philippe, 50, 105, 109, 166<br />
AEBI Jürg, 45<br />
AIGRAIN Yves, 231<br />
AISSAOUI Rachid, 156<br />
AIT SI SELMI Tarik, 35, 98,<br />
159, 203<br />
AKHAVAN Hani, 14<br />
ALAEDDINE Tarek, 70<br />
ALEXANDRE Julien, 146<br />
ALFIE Veronica, 239, 251<br />
ALI Mazen, 226<br />
ALKALLAF Salwa, 171<br />
ALLAIN Jérôme, 8, 23, 24<br />
ALLIZARD Michel, 155<br />
ALNOT Jean-Yves, 235<br />
ALOVOR Guy, 268<br />
AMINIAN Kamiar, 156, 157, 262<br />
AMIOT Louis-Philippe, 93<br />
AMZALLAG Mickael, 87<br />
ANGIBAUD Laurent, 64<br />
ANNOCARO Fabricio, 149<br />
ANRACT Philippe, 151, 168,<br />
172, 277<br />
AOUN Noël, 124<br />
ARGENSON Jean-Noël, 9, 92,<br />
100, 104, 215<br />
ARNAUD Jean-Paul, 42, 225<br />
ARNDT Joseph, 20<br />
ASENCIO Gérard, 149, 236<br />
ASSELINEAU Alain, 291<br />
ATIA Rabah, 221<br />
AUBANIAC Jean-Manuel, 104<br />
AUBOURG Lucie, 24<br />
AUGEREAU Bernard, 96, 231<br />
AUNOBLE Stéphane, 25, 26<br />
AUQUIER Pascal, 130<br />
AUSSET Isabelle, 202<br />
AZMY Charaf, 291<br />
B<br />
BABINET Antoine, 151, 168,<br />
172, 259, 277<br />
INDEX DES AUTEURS<br />
Les chiffres correspondent aux numéros <strong>des</strong> <strong>résumés</strong> <strong>des</strong> <strong>communications</strong><br />
BACHOUR Falah, 102, 143, 227<br />
BACOU Francis, 66<br />
BADET Roger, 194, 195, 199<br />
BAHUAUD Jacques, 155, 280<br />
BAILLON Bruno, 285<br />
BAILLON Jean-Marie, 285<br />
BAKLANOV Andrei, 30<br />
BALAŸ Bruno, 210<br />
BALESTRO Jean-Christian, 10<br />
BANSE Xavier, 177<br />
BARBARY Stéphane, 174<br />
BARDONNET Raphaël, 279<br />
BARRAL Fabrice-Guy, 166<br />
BARRAU Karine, 130<br />
BARRELIER Marie-Thérèse, 272<br />
BASHTI Karim, 218, 263<br />
BASSO Yann, 25, 26<br />
BATISSE Jacques, 252<br />
BAUER Bertrand, 252<br />
BAUMANN Cédric, 152, 153<br />
BEAUFILS Philippe, 35, 36, 37,<br />
154<br />
BEAULIEU Jean-Yves, 224<br />
BEAURAIN Jacques, 24<br />
BÉCHIR KARRAY Mohamed,<br />
200, 201<br />
BÉGUÉ Thierry, 247<br />
BÉJUI-HUGUES Jacques, 49, 94,<br />
173, 214<br />
BÉRARD Jérôme, 131<br />
BELLAICHE Yatt, 21<br />
BELLUMORE Yves, 15, 61<br />
BELOT Nicolas, 146<br />
BEN AMOR Haykel, 200, 201<br />
BENDERSKY Noelle, 21<br />
BENITO Yvonne, 131<br />
BENJOAR Marc-David, 231<br />
BENSAFI Hocine, 46, 270<br />
BERCOVY Michel, 85<br />
BERLI Martin, 62<br />
BERTIN Raoul, 149<br />
BERTIN-DIÉMÉ Char<strong>les</strong>, 240<br />
BERTRAND-MARCHAND<br />
Marion, 280<br />
BESSE Jean-Luc, 220, 269<br />
BEYLAGOUN Adlene, 221<br />
BIAU David, 122, 151<br />
BIDAR Romain, 102<br />
BIETTE Grégory, 123<br />
BIGA Norman, 223, 255<br />
BILLOT Nicolas, 260<br />
BIZOT Pascal, 215, 216<br />
BLANCHARD Bertrand, 139<br />
BLANCHET Nicolas, 249<br />
BLAYSAT Marc, 148<br />
BLONDEAU Camille, 247<br />
BLUM Alain, 17<br />
BOÉRI Cyril, 39, 111, 158<br />
BOCCARA David, 231<br />
BOCQUET Donatien, 143<br />
BOCQUET Jean-François, 204<br />
BOGGIONE Christophe, 36<br />
BOGORIN Ioan, 20<br />
BOILEAU Pascal, 10, 12, 16,<br />
175, 254<br />
BOISGARD Stéphane, 106, 289<br />
BOLLINI Gérard, 75, 76, 78,<br />
117, 127, 130<br />
BOLZER Stéphane, 290<br />
BONIN Nicolas, 33, 292<br />
BONNARD Christian, 119<br />
BONNEL François, 222, 226, 266<br />
BONNET Xavier, 27<br />
BONNEVIALLE Nicolas, 81, 224<br />
BONNEVIALLE Paul, 15, 61,<br />
224, 233<br />
BORCOS Dan, 103, 113<br />
BORETTO Jorge, 239, 251<br />
BOSSON Jean-Luc, 72<br />
BOUBLIL Daniel, 88<br />
BOURGEOIS Aline, 262<br />
BOUSSOUGA Mostapha, 31<br />
BOUTAUD Benoit, 142<br />
BOUVAT Eric, 72<br />
BOVIER-LAPIERRE Philippe, 94<br />
BOYER Patrick, 88, 97, 126, 205<br />
BRÂNEMARK Rickard, 280<br />
BRASSEUR Pierre, 31<br />
BROSSET Thomas, 290<br />
BRUMPT Bertrand, 208<br />
BRUNET-GUEDJ Elisabeth, 269<br />
BURDIN Gil<strong>les</strong>, 38, 86<br />
BURDIN Philippe, 146<br />
BURGOS Jesus, 28, 80, 133<br />
C<br />
CADILHAC Céline, 126<br />
CAHUZAC Jean-Philippe, 78,<br />
81, 83<br />
CAMPAGNA Raphaël, 168<br />
CANOVAS François, 226, 266<br />
CARLIER Yacine, 142<br />
CARRET Jean-Paul, 49, 94, 173,<br />
214<br />
CARTIAUX Olivier, 177<br />
CASSION Jean-Batiste, 230<br />
CATONNÉ Yves, 140, 141, 205<br />
CERCIELLO Simoné, 194<br />
CESAR Mathieu, 229<br />
CHAIX Olivier, 108<br />
CHAKER Mourad, 131<br />
CHAMBAT Pierre, 193, 195,<br />
197, 199<br />
CHAMMAS Michel, 66, 176,<br />
229, 232, 239, 251<br />
CHANTELOT Christophe, 230,<br />
235<br />
CHANTELOT-LAHOUDE<br />
Sandra, 230<br />
CHARISSOUX Jean-Louis, 42, 225<br />
CHAROUSSET Christophe, 65<br />
CHARROIS Olivier, 35, 37, 154<br />
CHASSAT Romain, 231, 237<br />
CHATAIGNIER Hervé, 24<br />
CHATELET Jean-Christophe, 112<br />
CHATELLIER Patrick, 31<br />
CHAU Edouard, 82<br />
CHAUMEIL Geraud, 237<br />
CHAUVEAUX Dominique, 219<br />
CHAVANE Hervé, 94<br />
CHAVARY-BERNIER Estelle, 69<br />
CHEMAMA Bruno, 61<br />
CHEVILLOTTE Christophe, 49<br />
CHEVROT Alain, 168, 259<br />
CHEYROU Eric, 37<br />
CHIFFOLOT Xavier, 20<br />
CHIRON Philippe, 46<br />
CHOMETON Sylvia, 131<br />
CHOPIN Daniel, 30<br />
CHOTEL Franck, 131<br />
CHOUK Anis, 53, 91<br />
CHOUTEAU Julien, 198, 210<br />
CHRISTEL Pascal, 41<br />
CHUINARD Christopher, 16<br />
CIOBANU Eugène, 158<br />
CLÉMENT Jean-Luc, 82<br />
CLAVERT Philippe, 257<br />
CLEMENT Denis, 204<br />
COGNET Jean-Michel, 145, 250<br />
COIPEAU Patrick, 228<br />
COLEY Brian, 262
3S164 INDEX DES AUTEURS<br />
CORNILLE Helène, 278<br />
CORNU Olivier, 177<br />
COSTACHE Victor, 150<br />
COSTE Cédric, 225<br />
COUCHON Sophie, 154<br />
COUDANE Henry, 17, 274<br />
COULET Bertrand, 66, 176, 229,<br />
232<br />
COURNOT Maxime, 83<br />
COURPIED Jean-Pierre, 209,<br />
276, 279<br />
COURSIER Raphaël, 267, 268<br />
COURT Char<strong>les</strong>, 136<br />
COURTADE Grégory, 122, 149<br />
COUTIÉ Anne-Sophie, 78<br />
CROZIER Eric, 279<br />
CUCURULO Thomas, 193<br />
CUNIN Vincent, 131<br />
CUNY Christian, 152, 153<br />
CUPISSOL Didier, 176<br />
CURREY Char<strong>les</strong>, 223<br />
D<br />
DAGHER Elias, 293<br />
DAGHER Fernand, 124<br />
DARCEL Véronique, 142<br />
DAUGER Stéphane, 77<br />
DAUPLAT Grégoire, 101<br />
DAUSSIN Paul-André, 66<br />
DAUTEL Gil<strong>les</strong>, 174, 238<br />
DE BILLY Benoit, 119<br />
DE CARLI Pablo, 239, 251<br />
DE COURTIVRON Benoit, 119<br />
DE GUISE Jacques, 156<br />
DE LA PORTE Christian, 245<br />
DE PERETTI Fernand, 147, 246<br />
DEBARGE Romain, 159<br />
DEHOUX Emile, 32, 238<br />
DEJNABADI Hooman, 157<br />
DEJOUR David, 292<br />
DELÉCRIN Joël, 24, 29, 169<br />
DELÉPINE Fabrice, 171, 246, 278<br />
DELÉPINE Gérard, 171, 278<br />
DELÉPINE Nicole, 171<br />
DELAGOUTTE Jean-Pierre, 152,<br />
153<br />
DELANGLE Florent, 110<br />
DELANNIS Yannick, 224<br />
DELATTE Jean, 202<br />
DELAUNAY Christian, 215<br />
DELLOYE Christian, 167, 177<br />
DELOIN Xavier, 172<br />
DEMAILLY Sylvain, 155<br />
DEMOURA Ali, 53, 91<br />
DENORMANDIE Philippe, 271<br />
DESBOIS Isabelle, 228<br />
DESCAMPS Stéphane, 106, 289<br />
DESCHASEAUX Frédéric, 67<br />
DESMOULINS Frédéric, 291<br />
DEVES Olivier, 257<br />
DI MARCO Antonio, 145<br />
DILIGENT Jérôme, 174<br />
DIOP Amadou, 65<br />
DJIAN Patrick, 41<br />
DJOUIDENE Hacene, 221<br />
DMYTRUK Vitali, 42<br />
DOCQUIER Pierre-Louis, 167,<br />
177<br />
DOHIN Bruno, 117<br />
DOMENECH Jorge, 228<br />
DOMENECH Pedro, 28, 80, 133<br />
DOMERGUE Sophie, 232<br />
DONNDORFF Agustin, 239, 251<br />
DOSCH Jean-Claude, 111<br />
DOTZIS Anthony, 15<br />
DOUIK Mongi, 200, 201<br />
DOURSOUNIAN Levon, 60, 237<br />
DRAPÉ Jean-Luc, 168, 259<br />
DUBOUSSET Jean, 118, 120, 128<br />
DUBRANA Frédéric, 212<br />
DUCHARNE Gildas, 47<br />
DUFOUR Veronique, 22<br />
DUJARDIN Colin, 217, 287<br />
DUJARDIN Franck, 71, 144, 223<br />
DUMAINE Valérie, 36, 151, 172,<br />
276, 277<br />
DUMAS Raphaël, 139<br />
DUMONTIER Christian, 60, 237<br />
DUPARC Fabrice, 223, 255,<br />
256<br />
DUPUIS Michel, 39<br />
DURAND Alexandre, 32, 238<br />
DURAND Jean-Marc, 94, 214<br />
DURAND Sébastien, 247<br />
DURANDEAU Alain, 142<br />
DURANTE Ernesto, 47<br />
DURANTHON Louis-Denis, 65<br />
DUTOIT Michel, 156, 157, 262<br />
E<br />
EHLINGER Matthieu, 145<br />
EID Ahmad, 148, 150<br />
EL JAMRI Mohamed, 103, 113<br />
EL MASRI Firas, 209<br />
EPINETTE Jean-Alain, 215<br />
ERTAUD Jean-Yves, 71<br />
ESCHARD Jean-Paul, 238<br />
ESTOUR Gil<strong>les</strong>, 95<br />
ETIENNE Stéphanie, 288<br />
EYROLLE Luc, 276<br />
F<br />
FABET Gil<strong>les</strong>, 103<br />
FABRE Alain, 252<br />
FABRE Thierry, 142<br />
FACCA Sybille, 58<br />
FAIZON Gil<strong>les</strong>, 170<br />
FALINE Alexis, 226<br />
FANTIN Bruno, 21, 22<br />
FARCY Jean-Pierre, 68<br />
FARIZON Frédéric, 50, 105, 109<br />
FARMAN Thierry, 43<br />
FARRON Alain, 262<br />
FASSIER Alice, 74<br />
FAURÉ Patrick, 226<br />
FAVARD Luc, 175, 254<br />
FAVRE Julien, 156<br />
FAYAD Fouad, 151<br />
FAYARD Jean-Marie, 193, 197<br />
FENOLLOSA Joaquin, 28, 80,<br />
133<br />
FERMAND Michel, 259<br />
FERMANIAN Jean, 151<br />
FESSY Michel, 50, 109, 110,<br />
166<br />
FEYDY Antoine, 22, 168, 259<br />
FILIPPINI Paolo, 53, 91<br />
FINIDORI Georges, 122, 123,<br />
126<br />
FIRICA Andrei, 207<br />
FITOUSSI Franck, 73, 79, 84<br />
FLECHER Xavier, 9, 92, 100,<br />
104, 215<br />
FLURIN Pierre-Henri, 64<br />
FONTAINE Christian, 230, 235<br />
FONTES Olivier, 286<br />
FRAQUET Nicolas, 170<br />
FRAYSSINET Patrick, 204<br />
FRESLON Morgan, 211<br />
FREYDIERE Anne-Marie, 131<br />
FRITSCHY Daniel, 62<br />
FUNFSCHILLING Christine, 19<br />
G<br />
GABRION Antoine, 218<br />
GAD Isham, 107<br />
GAILLARD Christophe, 202<br />
GALANT Christine, 167<br />
GALAUD Bertrand, 86<br />
GALISSIER Bertrand, 225<br />
GALLINET David, 59, 234<br />
GALLUCCI Gerardo, 239, 251<br />
GALOIS Laurent, 153, 288<br />
GAMBIRASIO Riccardo, 62<br />
GARBUIO Patrick, 33, 59, 234,<br />
249, 250, 292<br />
GARREAU DE LOUBRESSE<br />
Christian, 99<br />
GAUCHER François, 108<br />
GAYET Louis-Etienne, 211<br />
GAZIELLY Dominique, 14, 18<br />
GENET François, 271<br />
GEORGE Thierry, 17, 274<br />
GÉRARD Romain, 114, 212<br />
GHANEM Ismat, 124<br />
GICQUELET René, 260<br />
GILLET Pierre, 288<br />
GIRARD Julien, 51, 52, 70, 87,<br />
102, 143, 206, 227<br />
GIRAUD Benoit, 32<br />
GLÉMAIN Pascal, 24<br />
GLARD Yan, 75<br />
GLEYZE Pascal, 17, 19, 274<br />
GLORION Christophe, 77, 121,<br />
122, 123, 126<br />
GODBOUT Véronique, 52<br />
GODEFROY Didier, 18<br />
GOMES Nuno, 19<br />
GONZALEZ Jean-François, 10,<br />
16, 254<br />
GORIN Michel, 140<br />
GOUGEON François, 87, 287,<br />
290<br />
GOUIN François, 169, 170<br />
GOUIN Francis, 144<br />
GOULON Renaud, 134<br />
GOUTALLIER Daniel, 13, 90<br />
GOUZOU Stéphanie, 58, 250<br />
GRÉBÉNUK Evgéni, 129<br />
GRAF Patrice, 93<br />
GRAVELEAU Nicolas, 197, 261<br />
GRAVIER Renaud, 9<br />
GREGORY Thomas, 123<br />
GRILLO Jean-Char<strong>les</strong>, 100<br />
GRIMBERG Jean, 65<br />
GROSCLAUDE Sophie, 105,<br />
109, 166, 269<br />
GROSJEAN Guillaume, 255<br />
GROSSIN Laurent, 288<br />
GUARDIOLLE Jean-Christophe,<br />
274<br />
GUENOUN Benjamin, 211<br />
GUERINI Henri, 168, 259<br />
GUEYE DIOUF Amadou, 240<br />
GUIGUI Pierre, 21, 22, 137<br />
GUILBERT Sébastien, 217, 287<br />
GUILLEMIN Francis, 152, 153<br />
GUTIERREZ Pedro, 28, 80, 133<br />
GUYEN Olivier, 49, 173, 214<br />
H<br />
HABIB SY Mouhamadou, 240<br />
HACINI Sohria, 236<br />
HADDAD Elias, 124<br />
HADDAD-ZBOUNI ‘Suha, 124<br />
HAMADOUCHE Moussa, 72,<br />
209<br />
HANNOUCHE Didier, 216, 245<br />
HARDY Philippe, 260, 261<br />
HARISBOURE Alain, 32, 238
HASSAIRI Mohamed, 286<br />
HAUMONT Thierry, 138<br />
HAVET Eric, 263, 267<br />
HAYEM Catherine, 82<br />
HÉLIX Marianne, 9<br />
HENRY Julien, 214<br />
HENRY Marc-Pierre, 114<br />
HENRY Patrice, 83<br />
HERENT Stéphane, 227<br />
HERLIN Christian, 176<br />
HERNIGOU Philippe, 53, 91<br />
HEVIA Eduardo, 28, 80, 133<br />
HICHAM EL AMRANI Moulay,<br />
291<br />
HOFFMEYER Pierre, 62<br />
HOVORKA Istvan, 12<br />
HULET Christophe, 34, 38, 86<br />
HURTEVENT Jean-François, 230<br />
HUSSON Jean-Louis, 31<br />
HUTEN Denis, 88, 89, 96, 97<br />
ILHARREBORDE Brice, 40, 73,<br />
77, 79, 84, 137<br />
I<br />
J<br />
JACQUOT Frédéric, 30<br />
JACQUOT Nicolas, 12, 16<br />
JARDÉ Olivier, 218, 263, 267,<br />
268<br />
JAWISH Roger, 125<br />
JEANNE Luc, 276<br />
JENNY Jean-Yves, 39, 111, 158<br />
JEUNET Laurent, 33<br />
JOLLES Brigitte, 156, 262<br />
JOLLES-HAEBERLI Brigitte, 157<br />
JOOMAH Nabil, 60<br />
JOUBERT Patrick, 54<br />
JOURNEAU Pierre, 138, 174<br />
JOUVE Jean-Luc, 75, 76, 78,<br />
117, 127, 130<br />
JUDET Thierry, 99, 107, 208<br />
JUGLARD Ronan, 202<br />
JUND Stéphane, 147<br />
K<br />
KACOU Désiré, 289<br />
KAHN Jean-Luc, 257<br />
KALLEL Soufiène, 200<br />
KARAMI Mohsen, 79<br />
KARRAY Slaheddine, 200, 201<br />
KASSOUMA Jamal, 238<br />
KATABI Mouss, 36<br />
KATZ Denis, 258<br />
KELECHIAN Arnaud, 106<br />
KEMPF Jean-François, 257, 293<br />
KERBOULL Luc, 209, 215<br />
KERBOULL Marcel, 209<br />
KHALIFÉ Rami, 125<br />
KHALIL Kharrat, 124<br />
KHANH NGUYEN Minh, 202<br />
KIEFER Catherine, 271<br />
KNORR Gorge, 81<br />
KOHLER Rémi, 117<br />
KÖRTING Oliver, 58<br />
KOUREAS Georgios, 74<br />
KOUYOUMDJAN Pascal, 236<br />
KRIER Joël, 257<br />
L<br />
L'KAISSI Mohamed, 119<br />
LABBÉ Jean-Louis, 134<br />
LACOMBE Fabien, 66, 229<br />
LACROIX Catherine, 136<br />
LADAB Fathi, 201<br />
LAFAGE Virginie, 68<br />
LAFFARGUE Philippe, 70, 87,<br />
102, 143, 227<br />
LAFFENÊTRE Olivier, 219<br />
LAFFOSSE Jean-Michel, 46, 270<br />
LAMARRE Hervé, 17, 19<br />
LAMBOTTE Jean-Christophe,<br />
108<br />
LANDREAU Philippe, 40<br />
LANGLAIS Frantz, 97, 108, 146<br />
LANGLAIS Jean, 119<br />
LAPORTE Jean-Dominique, 55,<br />
56<br />
LAPORTE Sébastien, 69<br />
LAPTOIU Dan, 198, 207<br />
LARGEY Arnaud, 266<br />
LASCOMBES Pierre, 138, 174<br />
LATARGEZ Laurent, 211<br />
LAUDE Frédéric, 205<br />
LAUNAY Franck, 75, 76, 127,<br />
130<br />
LAUTRIDOU Christine, 34<br />
LAVAU Laurent, 85<br />
LAVIGNE Martin, 51, 52, 206<br />
LAYA Zacharia, 267<br />
LAZENNEC Jean-Yves, 27, 69,<br />
140, 141, 205<br />
LAZERGES Cyril, 66, 176, 229,<br />
232<br />
LE GUILLOUX Pierre, 202<br />
LE HUEC Jean-Char<strong>les</strong>, 25, 26,<br />
139<br />
LE MERRER Martine, 122<br />
LE PAGE Laurence, 22<br />
LEBEL Benoît, 34, 38, 86, 272<br />
LECLAIR Olivier, 134<br />
LECLERC Grégoire, 33, 249<br />
INDEX DES AUTEURS 3S165<br />
LECLERC Jérôme, 142<br />
LECLERCQ Nicolas, 211<br />
LECONTE Romain, 169<br />
LECOULES Nathalie, 72<br />
LEFÈVRE Christian, 114, 212<br />
LEFEVRE Nicolas, 209<br />
LEFEVRE Yan, 75, 76<br />
LEFEVRE-COLAU<br />
Marie-Martine, 151<br />
LELIÈVRE Henri, 264, 265<br />
LELIÈVRE Jean-François, 264,<br />
265<br />
LEMOINE Stéphane, 235<br />
LENOIR Thibault, 21, 137<br />
LEPAGE Daniel, 59, 234, 250,<br />
292<br />
LERAT Jean-Luc, 196, 198,<br />
210, 220, 269<br />
LEVADOUX Michel, 252<br />
LEVAI Jean-Paul, 106, 289<br />
LÉVY Bruno, 291<br />
LEYMARIE Jean-Baptiste, 107<br />
LEYVRAZ Pierre-François, 157<br />
LHERMETTE Maxime, 71<br />
LIENHART Anne-Marie, 94<br />
LIMOUSIN Marc, 235<br />
LISAI Andréa, 10<br />
LISSARRAGUE Martin, 108<br />
LIVERNEAUX Philippe, 58<br />
LOCKER Bruno, 34, 38<br />
LORTAT-JACOB Alain, 43, 260<br />
LU Xiong-Wei, 14, 18<br />
LUSTIG Sébastien, 220<br />
LUTHI François, 156<br />
M<br />
MABIT Christian, 42, 225<br />
MACE Yann, 151<br />
MACHENAUD Alain, 213<br />
MAGUREAN Mihai, 207<br />
MAIER Bernd, 135<br />
MAILHAN Laurence, 271<br />
MAINARD Didier, 152, 153,<br />
204, 288<br />
MANICOM Olivier, 90<br />
MANSAT Michel, 15, 61, 233<br />
MANSAT Pierre, 15, 61, 224,<br />
233<br />
MARCDARGENT-FASSIER Alice,<br />
118<br />
MARKOWSKA Barbara, 171<br />
MARMOR Simon, 43, 99<br />
MARMORAT Jean-Luc, 107,<br />
208<br />
MARTIN Jean-Michel, 126<br />
MARTINEL Vincent, 224, 233<br />
MARTRES Sébastien, 173<br />
MARTY François, 146<br />
MARZI Ingo, 135<br />
MASCARD Eric, 120, 128<br />
MASMEJEAN Emmanuel, 231<br />
MASQUELET Alain-Char<strong>les</strong>,<br />
245, 247<br />
MASSARELLA Massimo, 253<br />
MASSE Camille, 279<br />
MASSE Yann, 96<br />
MASSIN Philippe, 203<br />
MATHIEU Gil<strong>les</strong>, 23, 53, 91<br />
MATHOULIN Christophe, 248,<br />
253<br />
MAUREL Nathalie, 65<br />
MAURY Philippe, 286<br />
MAY Olivier, 70<br />
MAYNOU Carlos, 101<br />
MAZDA Keyvan, 73, 79, 84<br />
MEHDI Nazim, 101<br />
MÉNARD Roméo, 38<br />
MENSA Christophe, 32<br />
MERLE V., 144<br />
MERLOZ Philippe, 148, 150<br />
MÉTAIZEAU Jean-Damien, 138<br />
MICHAUT Christophe, 202<br />
MICHAUT Mathieu, 34, 86<br />
MICHEL Blaise, 17, 274<br />
MIGAUD Henri, 70, 87, 102,<br />
143, 215, 227<br />
MILLE Pierre, 257<br />
MINH DOAN Co, 286<br />
MISSENARD Gil<strong>les</strong>, 120, 128<br />
MITTON David, 279<br />
MOH ELLO Nicolas, 138<br />
MOINEAU Grégory, 114, 212<br />
MOLÉ Daniel, 11, 160, 175, 254<br />
MOLINIER François, 46<br />
MOREEL Philippe, 106, 289<br />
MOREL Etienne, 73, 79, 84<br />
MORET L., 144<br />
MORIN Christian, 121<br />
MOSNIER Jean-François, 166<br />
MOTTARD Sophie, 206<br />
MOUILHADE Frédéric, 71<br />
MOUTTET Alexandre, 47<br />
MOYEN Bernard, 196, 198,<br />
210, 269<br />
MRAOVIC Tanguy, 229<br />
MSEDDI Mohamed, 8<br />
MUBARAK Scott, 117<br />
MUGNIER Gil<strong>les</strong>, 57<br />
MUSCOLO D. Luis, 239, 251<br />
MUSSET Thierry, 108<br />
N<br />
NAJI Omar, 236<br />
NAUDI Stéphane, 101<br />
NAVEZ Grégory, 11, 160, 175<br />
NEBUNESCU Alexandru, 246
3S166 INDEX DES AUTEURS<br />
NETTER Patrick, 288<br />
NEYRET Philippe, 35, 98, 159,<br />
194, 203<br />
NEYTON Lionel, 12, 16<br />
NICOLLE Marie-Christine, 159<br />
NIZARD Rémi, 216<br />
NOEL Henri, 167<br />
NOGER Marcus, 62<br />
NONNENMACHER Jean, 58<br />
NORTH Jean, 103, 113<br />
NOUAR M'Hamed, 221<br />
NOURI Habib, 120<br />
NOURISSAT Christian, 149, 215<br />
NOURISSAT Geoffroy, 60, 237<br />
NURBEL Bruno, 238<br />
O<br />
OBERT Laurent, 59, 67, 234,<br />
249, 250, 292<br />
ODENT Thierry, 121<br />
OKSMAN Antoine, 42, 225<br />
ORBACH Daniel, 121<br />
OSNOWYCZ Georges, 152, 153<br />
OUAKNINE Michael, 168, 201<br />
P<br />
PADOVANI Jean-Paul, 123, 126<br />
PAILLOT Jean-Luc, 98<br />
PANARELLA Ludovico, 35, 37<br />
PANNIER Stéphanie, 122<br />
PAOLI Vincent, 246<br />
PARRATTE Sébastien, 92, 104,<br />
127<br />
PASCAL-MOUSSELLARD<br />
Hugues, 141<br />
PASQUIER Gil<strong>les</strong>, 47<br />
PASSUTI Norbert, 29, 169<br />
PATIN Anthony, 97<br />
PATOUT Arnaud, 218, 263, 267,<br />
268<br />
PAUL Gérard, 276<br />
PAUL Laurent, 177<br />
PÉGOIX Michel, 272<br />
PÉJIN Zaga, 123<br />
PELEGRI Cédric, 12, 147, 246<br />
PENNEÇOT Georges-François,<br />
73, 79, 84<br />
PERES Olivier, 134<br />
PERNIN Jérôme, 203<br />
PESSIS Eric, 168<br />
PETERS Stéphane, 89<br />
PETIT Philippe, 130<br />
PHILIPPEAU Jean-Marie, 29<br />
PHILIPPOT Rémi, 50, 105, 109,<br />
110, 166<br />
PIÉTIN-VIALLE Claire, 77<br />
PIBAROT Vincent, 49<br />
PICHONNAZ Claude, 157, 262<br />
PIDHORZ Laurent, 144<br />
PIDHORZ Louis, 96<br />
PILOT Louis, 135<br />
PINAROLI Alban, 159<br />
PINOIT Yannick, 70, 87, 102<br />
PINZANO Astrid, 288<br />
PIRIOU Philippe, 99, 107<br />
PIZA Biel, 28, 80, 133<br />
PLÉ Jean, 47<br />
PLANCHENAULT Marc, 119<br />
PLOTKINE Olivier, 277<br />
PLOTTON Christine, 131<br />
POIGNARD Alexandre, 23, 53,<br />
91<br />
POIRAUDEAU Serge, 151<br />
POITTEVIN Xavier, 168<br />
POLLE Gérard, 223, 255<br />
POPKOV Arnold, 129<br />
POPKOV Dimitri, 129<br />
POSTEL Jean-Marie, 13<br />
POUPON Joël, 205<br />
POURCEL Aurélien, 270<br />
PRADEL Clément, 60<br />
PRADO Rodrigo, 194<br />
PREBET Rémi, 211<br />
PRETESEILLE Olivier, 14, 166<br />
PRIGENT François, 48<br />
PROST Thierry, 195, 199<br />
PROUST Jérôme, 42, 225<br />
PUGET Jean, 46, 270<br />
PUJOL Nicolas, 35<br />
Q<br />
QUELARD Bénédicte, 195, 199<br />
R<br />
RANNOU Francois, 151<br />
RAOULD Agnès, 216<br />
RAT Anne-Christine, 152, 153<br />
RAVAUD Philipe, 72<br />
RAZANABOLA Fredson, 217<br />
REDREAU Baudouin, 275<br />
REHBY Lucas, 33, 249<br />
REMI Julien, 37<br />
REVEL Michel, 151<br />
RICHARD Alexandre, 214<br />
RICHOU Julien, 10, 212<br />
RILLARDON Ludovic, 21, 22, 137<br />
RIOU Bruno, 72<br />
RIQUELME Oscar, 28, 133<br />
ROBERT Henri, 204<br />
ROCHE Chris, 64<br />
ROCHE Olivier, 11, 160<br />
ROCHET Séverin, 59, 249<br />
RODEO Scott, 293<br />
RODRIGUEZ-OLAVERRI Juan,<br />
28, 80, 133<br />
ROLLIER Jean-Char<strong>les</strong>, 196, 198<br />
RONAI Martin, 25, 26<br />
RONGIÈRES Michel, 61<br />
ROOZE Marcel, 285<br />
ROPARS Mickaël, 146<br />
ROSE Stefan, 135<br />
ROSSET Philippe, 170, 228<br />
ROSSI Johan, 148<br />
ROTHMANN Christophe, 72<br />
ROUSSANNE Yannick, 226<br />
ROUSSEAU Marc-Antoine, 27,<br />
69, 205<br />
ROUSSELIN Benoît, 18<br />
ROUSSIGNOL Xavier, 223, 255<br />
ROY Alain, 51, 206<br />
RUBIO Francisco, 68<br />
RUD-LASSEN Michael, 273<br />
RYGE Camilla, 273<br />
S<br />
SALES DE GAUZY Jérôme, 78,<br />
81, 83<br />
SALMON-CERON Dominique,<br />
276<br />
SALVIA Patrick, 285<br />
SAMAMA Char<strong>les</strong>-Marc, 72<br />
SAMPERA Ignaci, 28, 133<br />
SANÉ ANDRÉ Daniel, 240<br />
SANÉ Jean-Claude, 240<br />
SARAGAGLIA Dominique, 95<br />
SARAZIN Laurent, 18<br />
SARI-ALI Elhadi, 36, 140<br />
SAUZIERES Philippe, 258<br />
SAVATIER Xavier, 71<br />
SAYED Walid, 78<br />
SCARLAT Marius M., 275<br />
SCEMAMA Patrice, 134<br />
SCHARYCKI Stéphane, 291<br />
SCHENCK Benoit, 58<br />
SCHLATTERER Bernard, 147<br />
SCHNEIDER Ludovic, 39<br />
SCHNITZLER Alexis, 271<br />
SCHWAB Frank, 68<br />
SEDEL Laurent, 216<br />
SELMANI Zohair, 67<br />
SEMAY Jean-Marc, 110<br />
SEMPERA Ignaci, 80<br />
SERINGE Raphaël, 74, 118, 120,<br />
128<br />
SERVIEN Elvire, 98<br />
SEYE Seydina, 240<br />
SHEVTSOV Vladimir, 129<br />
SIEGRIST Olivier, 156<br />
SIGUIER Marc, 208<br />
SIGUIER Thierry, 208<br />
SIMON Patrick, 145<br />
SIRVEAUX François, 11, 160,<br />
175, 254<br />
SKALLI Wafa, 27, 69<br />
SOBCZAK Stépane, 285<br />
SOCIÉ Gérard, 216<br />
SOENEN Marc, 102, 227<br />
SOLGAARD Søren, 273<br />
SONNE-HOLM Stig, 273<br />
SOUBEYRAND Marc, 60, 260<br />
SOUCHET Philippe, 73<br />
SPRINGER Kristina, 143<br />
STEIB Jean-Paul, 20, 24<br />
STINDEL Eric, 114<br />
T<br />
TADIÉ Marc, 136<br />
TATON Eric, 252<br />
TEBANI Mabrouk, 221<br />
THAUNAT Mathieu, 128, 154,<br />
193<br />
THAURY Marie-Noelle, 229, 232<br />
THEVENIN Fabrice, 168<br />
THEVENIN-LEMOINE Camille,<br />
271<br />
THIERNO DIENG Mame, 240<br />
THOMAZEAU Hervé, 97<br />
THOREUX Patricia, 247<br />
TIBERGHIEN Pierre, 67<br />
TOMENO Bernard, 151, 168,<br />
172, 276, 277<br />
TONETTI Jérôme, 148, 150<br />
TOPOUCHIAN Vicken, 122<br />
TOUCHARD Olivier, 11, 160<br />
TOURNIER Clément, 25, 26<br />
TOURNY-CHOLLET Claire, 71<br />
TRABELSI Adil, 236<br />
TRICOIRE Jean-Louis, 270<br />
TRICOIT Michel, 217<br />
TROJANI Christophe, 12, 16<br />
TROPET Yves, 59, 234, 249,<br />
250<br />
TURELL Pablo, 11, 160<br />
U<br />
USCATU Marius, 111<br />
V<br />
VALENTI Philippe, 258<br />
VALLADE Marie-José, 82<br />
VALVERDE Manuel, 176, 232<br />
VAN AAKEN Jan, 62<br />
VAN DRIESSCHE Stéphane, 90<br />
VANDENESH François, 131
VANGAVER Edouard, 252<br />
VANJAK Dominique, 21<br />
VARÉ Bruno, 82<br />
VASILE Christian, 150<br />
VASTEL Laurent, 151, 279<br />
VAZ Gualter, 49, 94, 173, 214<br />
VENDITTOLI Pascal-André, 51,<br />
52, 206<br />
VERCOUTÈRE Michel, 231<br />
VERDONK Peter, 203<br />
VERNOIS Joël, 218, 263, 267,<br />
268<br />
VESIN Olivier, 9<br />
VIALA Jean-François, 287<br />
VIALLE Raphaël, 77, 136<br />
VIDALAIN Jean-Pierre, 213,<br />
215<br />
VIEHWEGER Elke, 75, 76, 127<br />
VIELPEAU Claude, 34, 38, 86,<br />
272<br />
VILLET Loïc, 219<br />
VINCHON Mathieu, 77<br />
VIOLAS Philippe, 78<br />
VITAL Jean-Marc, 139<br />
VORACEK Caroline, 157<br />
VOUAILLAT Hervé, 148, 150<br />
INDEX DES AUTEURS 3S167<br />
W<br />
WAAST Denis, 169<br />
WAJSFISZ Anthony, 41<br />
WALCH Gil<strong>les</strong>, 175, 254<br />
WALLACH Fabien, 121, 231<br />
WALLON Marc, 228<br />
WAVREILLE Guillaume, 230, 235<br />
WICART Philippe, 74, 118, 120,<br />
128<br />
WINTER Matthias, 147, 246<br />
WITVOET Jacques, 96<br />
WRIGHT Thomas W., 64<br />
Y<br />
YAHIA Ab<strong>des</strong>salem, 221<br />
YAOUANC François, 261<br />
Z<br />
ZADEGAN Frédéric, 216<br />
ZEITOUN Delphine, 141<br />
ZGAIBI Oussama, 286<br />
ZOUARI Mounir, 200, 201<br />
ZUCKERMAN Joseph D., 64