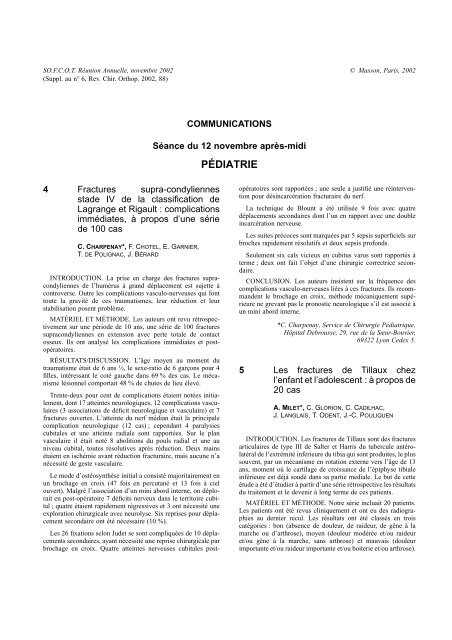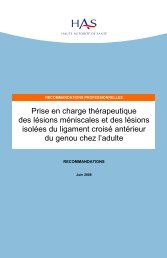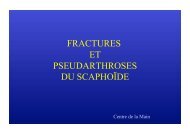les résumés des communications particulières - Sofcot
les résumés des communications particulières - Sofcot
les résumés des communications particulières - Sofcot
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
SO.F.C.O.T. Réunion Annuelle, novembre 2002 © Masson, Paris, 2002<br />
(Suppl. au n° 6, Rev. Chir. Orthop. 2002, 88)<br />
4 Fractures supra-condyliennes<br />
stade IV de la classification de<br />
Lagrange et Rigault : complications<br />
immédiates, à propos d’une série<br />
de 100 cas<br />
C. CHARPENAY*, F. CHOTEL, E.GARNIER,<br />
T. DE POLIGNAC, J.BÉRARD<br />
INTRODUCTION. La prise en charge <strong>des</strong> fractures supracondyliennes<br />
de l’humérus à grand déplacement est sujette à<br />
controverse. Outre <strong>les</strong> complications vasculo-nerveuses qui font<br />
toute la gravité de ces traumatismes, leur réduction et leur<br />
stabilisation posent problème.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Les auteurs ont revu rétrospectivement<br />
sur une période de 10 ans, une série de 100 fractures<br />
supracondyliennes en extension avec perte totale de contact<br />
osseux. Ils ont analysé <strong>les</strong> complications immédiates et postopératoires.<br />
RÉSULTATS/DISCUSSION. L’âge moyen au moment du<br />
traumatisme était de 6 ans ½, le sexe-ratio de 6 garçons pour 4<br />
fil<strong>les</strong>, intéressant le coté gauche dans 69 % <strong>des</strong> cas. Le mécanisme<br />
lésionnel comportait 48 % de chutes de lieu élevé.<br />
Trente-deux pour cent de complications étaient notées initialement,<br />
dont 17 atteintes neurologiques, 12 complications vasculaires<br />
(3 associations de déficit neurologique et vasculaire) et 7<br />
fractures ouvertes. L’atteinte du nerf médian était la principale<br />
complication neurologique (12 cas) ; cependant 4 paralysies<br />
cubita<strong>les</strong> et une atteinte radiale sont rapportées. Sur le plan<br />
vasculaire il était noté 8 abolitions du pouls radial et une au<br />
niveau cubital, toutes résolutives après réduction. Deux mains<br />
étaient en ischémie avant réduction fracturaire, mais aucune n’a<br />
nécessité de geste vasculaire.<br />
Le mode d’ostéosynthèse initial a consisté majoritairement en<br />
un brochage en croix (47 fois en percutané et 13 fois à ciel<br />
ouvert). Malgré l’association d’un mini abord interne, on déplorait<br />
en post-opératoire 7 déficits nerveux dans le territoire cubital<br />
; quatre étaient rapidement régressives et 3 ont nécessité une<br />
exploration chirurgicale avec neurolyse. Six reprises pour déplacement<br />
secondaire ont été nécessaire (10 %).<br />
Les 26 fixations selon Judet se sont compliquées de 10 déplacements<br />
secondaires, ayant nécessité une reprise chirurgicale par<br />
brochage en croix. Quatre atteintes nerveuses cubita<strong>les</strong> post-<br />
COMMUNICATIONS<br />
Séance du 12 novembre après-midi<br />
PÉDIATRIE<br />
opératoires sont rapportées ; une seule a justifié une réintervention<br />
pour désincarcération fracturaire du nerf.<br />
La technique de Blount a été utilisée 9 fois avec quatre<br />
déplacements secondaires dont l’un en rapport avec une double<br />
incarcération nerveuse.<br />
Les suites précoces sont marquées par 5 sepsis superficiels sur<br />
broches rapidement résolutifs et deux sepsis profonds.<br />
Seulement six cals vicieux en cubitus varus sont rapportés à<br />
terme ; deux ont fait l’objet d’une chirurgie correctrice secondaire.<br />
CONCLUSION. Les auteurs insistent sur la fréquence <strong>des</strong><br />
complications vasculo-nerveuses liées à ces fractures. Ils recommandent<br />
le brochage en croix, méthode mécaniquement supérieure<br />
ne grevant pas le pronostic neurologique s’il est associé à<br />
un mini abord interne.<br />
*C. Charpenay, Service de Chirurgie Pédiatrique,<br />
Hôpital Debrousse, 29, rue de la Sœur-Bouvier,<br />
69322 Lyon Cedex 5.<br />
5 Les fractures de Tillaux chez<br />
l’enfant et l’ado<strong>les</strong>cent : à propos de<br />
20 cas<br />
A. MILET*, C. GLORION, C.CADILHAC,<br />
J. LANGLAIS, T.ODENT, J.-C. POULIQUEN<br />
INTRODUCTION. Les fractures de Tillaux sont <strong>des</strong> fractures<br />
articulaires de type III de Salter et Harris du tubercule antérolatéral<br />
de l’extrémité inférieure du tibia qui sont produites, le plus<br />
souvent, par un mécanisme en rotation externe vers l’âge de 13<br />
ans, moment où le cartilage de croissance de l’épiphyse tibiale<br />
inférieure est déjà soudé dans sa partie mediale. Le but de cette<br />
étude a été d’étudier à partir d’une série rétrospective <strong>les</strong> résultats<br />
du traitement et le devenir à long terme de ces patients.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Notre série incluait 20 patients.<br />
Les patients ont été revus cliniquement et ont eu <strong>des</strong> radiographies<br />
au dernier recul. Les résultats ont été classés en trois<br />
catégories : bon (absence de douleur, de raideur, de gêne à la<br />
marche ou d’arthrose), moyen (douleur modérée et/ou raideur<br />
et/ou gène à la marche, sans arthrose) et mauvais (douleur<br />
importante et/ou raideur importante et/ou boiterie et/ou arthrose).
RÉSULTATS. Notre série comportait 8 garçons et 12 fil<strong>les</strong><br />
avec un âge moyen de 12,8 ans (3,4/14,9). Les patients ont été<br />
revus avec un recul moyen de 3 ans et 11 mois (12 mois à 8 ans<br />
et 9 mois). Onze patients ont été traités chirurgicalement et 9<br />
orthopédiquement. Nous avons toujours retrouvé un secteur<br />
externe du cartilage de croissance ouvert mais dans 2 cas un<br />
secteur medial ouvert et dans 6 cas incomplètement fermé. Dans<br />
un cas un scanner a éte nécessaire pour évaluer le déplacement.<br />
Le résultat a été jugé bon dans 18 cas et moyen dans 2 cas. Ces<br />
2 cas correspondaient à <strong>des</strong> douleurs persistantes sans gêne<br />
fonctionnelle avec un recul de l’ordre d’un an.<br />
DISCUSSION. Le résultat global à long terme de ces fractures<br />
est bon si el<strong>les</strong> sont correctement reconnues et évaluées au besoin<br />
par tomodensitomètrie afin de pouvoir réaliser le traitement<br />
approprié chirurgical ou orthopédique. Il s’agit d’une fracture<br />
articulaire qui en cas de mauvaise prise en charge peut induire<br />
une incongruence articulaire et une arthrose secondaire. Ces<br />
fractures atteignent dans la majorité <strong>des</strong> cas <strong>les</strong> ado<strong>les</strong>cents et <strong>les</strong><br />
troub<strong>les</strong> de croissance secondaire sont négligeab<strong>les</strong>. Cette fracture<br />
peut également survenir chez l’adulte. La fracture de Tillaux<br />
doit donc être connue et son pronostic est excellent quand le<br />
traitement est adapté.<br />
*A. Milet, Service d’Orthopédie,<br />
Hôpital Necker-Enfants-Mala<strong>des</strong>,<br />
149, rue de Sèvres, 75015 Paris.<br />
6 Validation <strong>des</strong> critères d’Ottawa<br />
pour <strong>les</strong> traumatismes en varus de<br />
la cheville chez l’enfant : à propos<br />
d’une étude prospective de 160 cas<br />
B. DOHIN*, D. LUBANZIADO<br />
Les auteurs rapportent <strong>les</strong> résultats d’une étude prospective sur<br />
160 cas de traumatismes en varus de la cheville chez l’enfant.<br />
L’objet du travail était de valider <strong>les</strong> critères cliniques d’Ottawa<br />
(« Ottawa ankle ru<strong>les</strong> ») chez l’enfant. Peu d’auteurs ont validé<br />
ces critères chez l’enfant (Chande 1995) qui permettrait de<br />
diminuer de 25 % le nombre de radiographies dans ces traumatismes.<br />
Entre février 2001 et décembre 2001 ont été inclus 160<br />
enfants, 71 garçons et 89 fil<strong>les</strong> d’âge moyen 11 ans 3 mois (de 3<br />
ans à 15 ans). Ils présentaient un traumatisme récent de cheville<br />
en varus (délai moyen 12 heures). On été exclus <strong>les</strong> tableaux<br />
cliniques de fracture de cheville ne posant aucun doute diagnostic<br />
(6 patients). Les éléments épidémiologiques, cliniques et <strong>les</strong><br />
critères d’Ottawa initiaux ont été consignés sur une fiche à<br />
critères fermés. Tous <strong>les</strong> patients ont bénéficié d’un bilan radiographique<br />
systématique : cheville et pied face, profil et¾, <strong>les</strong><br />
patients ont été revus en consultation à J+8 par un autre médecin<br />
pour confirmer le diagnostic. Les radiographies ont été examinées<br />
à trois reprises : par le médecin <strong>des</strong> urgences, au contrôle à<br />
une semaine par un second médecin et par un chirurgien orthopédiste<br />
pédiatre.<br />
Ont été confirmées 77 entorses bénignes (EB), 47 entorses de<br />
moyenne gravité (EM), 2 entorses graves (EG), 21 décollements<br />
épiphysaires de type I (DE), 13 fractures (8 fractures de la base<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 2S19<br />
du 5 e métatarsien, 1 fracture triplane, une fracture de malléole<br />
médiole, 2 fractures de malléole latérale et une fracture du<br />
scaphoïde tarsien).<br />
Pour <strong>les</strong> critères d’Ottawa, en plus de la douleur malléolaire,<br />
ont au moins un critère positif au niveau de la cheville : 64 <strong>des</strong> 77<br />
EB ; 43 <strong>des</strong> 47 EM ; 2 <strong>des</strong> 2 EG ; 21 <strong>des</strong> 21 DE et 13 <strong>des</strong> 13<br />
fractures. Toutes <strong>les</strong> fractures ont été diagnostiquées dès le<br />
premier examen ou au contrôle à une semaine.<br />
Pour <strong>les</strong> auteurs <strong>les</strong> critères cliniques d’Ottawa ne sont pas<br />
vali<strong>des</strong> chez l’enfant. Si l’on respecte ces critères, 143 patients<br />
auraient eu <strong>des</strong> radiographies pour seulement 13 patients avec<br />
fractures non évidentes cliniquement. Devant la trop faible spécificité<br />
<strong>des</strong> critères cliniques d’Ottawa chez l’enfant et comme<br />
Brooks (1981), <strong>les</strong> auteurs suggèrent l’utilisation de critères<br />
cliniques rigoureux pour le diagnostic de ces traumatismes chez<br />
l’enfant.<br />
Les critères diagnostics choisis dans l’étude permettent de<br />
faire le diagnostic de première intention de 129 <strong>des</strong> traumatismes.<br />
Les auteurs proposent de limiter <strong>les</strong> radiographies aux seuls<br />
traumatismes présentant <strong>des</strong> signes d’EM ou d’EG ou une douleur<br />
en zone C (base du 5 e métatarsien : 8/8) ou D (bord interne<br />
du pied : fracture du scaphoïde tarsien). Dans <strong>les</strong> autres cas<br />
(98/160) l’examen clinique est suffisant.<br />
Les auteurs ne retiennent pas <strong>les</strong> critères cliniques d’Ottawa<br />
comme vali<strong>des</strong> dans <strong>les</strong> traumatismes de cheville en varus chez<br />
l’enfant. Ils proposent <strong>des</strong> critères cliniques permettant de diminuer<br />
de 60 % le nombre de bilans radiographiques réalisés dans<br />
ce type de traumatisme chez l’enfant.<br />
*B. Dohin, Service de Chirurgie Pédiatrique,<br />
Centre Hospitalier du Mans, 194, avenue Rubillard,<br />
72037 Le Mans Cedex 09.<br />
7 Suivi à long terme de 69 enfants<br />
opérés d’hémivertèbres thoracolombaires,<br />
lombaires ou lombosacrées<br />
G. BOLLINI*, S. MINAUD, F.LAUNAY,<br />
E. VIEHWEGER, A.MARTY, J.-L. JOUVE<br />
INTRODUCTION. L’objet de ce travail était de présenter le<br />
suivi à long terme de 69 patients opérés pour excision d’hémivertèbres,<br />
thoraco-lombaires, lombaires ou lombo-sacrées.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Soixante-neuf patients (35<br />
fil<strong>les</strong> et 34 garçons) ont été opérés à l’âge moyen de 3 ans 6 mois<br />
(1 an à 10 ans 6 mois). Le suivi moyen était de 6 ans (6 mois à 18<br />
ans).<br />
La localisation de l’hemivertèbe était thoraco-lombaire dans<br />
20 cas, lombaire dans 34 cas et lombo-sacrée dans <strong>les</strong> 15 cas<br />
restant.<br />
Des malformations congénita<strong>les</strong> vertébra<strong>les</strong> ou viscéra<strong>les</strong><br />
étaient associées respectivement dans 32 % et 41 % <strong>des</strong> cas. Dix<br />
patients présentaient une malformation neurologique sous<br />
jacente.
2S20 77 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
Soixante patients ont été opérés en un seul temps opératoire<br />
comprenant une voie d’abord antérieure et postérieure combinées,<br />
résection de l’hémivertèbre, arthrodèse convexe antérieure<br />
et postérieure et instrumentation convexe postérieure par baby<br />
CD. Neuf patients ont été traités en deux temps opératoires à une<br />
semaine d’intervalle. Tous <strong>les</strong> patients ont porté un corset pendant<br />
6 mois.<br />
RÉSULTATS. Courbure structurale : L’angle de Cobb préopératoire<br />
était en moyenne de 35°, etl’angle de Cobb postopératoire<br />
était en moyenne de 16°. Au plus long recul l’angle de<br />
Cobb au plus long recul 15°.<br />
Courbure compensatrice : L’angle de Cobb pré-opératoire était<br />
au moyenne de 21°, etl’angle de Cobb au plus long revcul était<br />
en moyenne de 12°.<br />
Complications : 1 déficit partiel du tibialis antérieure, 3 pseudarthroses,<br />
1 sepsis, 3 démcutages, 1 tibia valgum sur le site de<br />
prélèvement du greffon péronier.<br />
DISCUSSION. La résection d’hémivertèbre nous semble dans<br />
ces localisations la technique la plus appropriée chez l’enfant de<br />
moins de 3 ans, dés lors qu’existent <strong>des</strong> signes patents de<br />
courbure évolutive.<br />
*G. Bollini, Service de Chirurgie Orthopédique Pédiatrique,<br />
Hôpital Timone-Enfants, boulevard Jean-Moulin,<br />
13385 Marseille Cedex 5.<br />
8 Résultats et complications du traitement<br />
conservateur de l’ostéosarcome<br />
du tibia distal chez l’enfant et<br />
l’ado<strong>les</strong>cent<br />
E. MASCARD*, G. MISSENARD, P.WICART,<br />
C. KALIFA, J.DUBOUSSET<br />
Les tumeurs malignes du tibia distal sont souvent traitées par<br />
amputation. Le but de notre étude était de rapporter <strong>les</strong> résultats<br />
et complications du traitement conservateur dans l’ostéosarcome<br />
du tibia distal.<br />
De 1983 à 1998, 8 patients ont été traités par chirurgie conservatrice.<br />
Il y avait 4 garçons et 4 fil<strong>les</strong> âgésde8à 16 ans (moyenne<br />
12 ans). Ils avaient tous reçu une chimiothérapie par Méthotrexate<br />
à hautes doses. Un patient avait <strong>des</strong> métastases pulmonaires<br />
au diagnostic. Tous <strong>les</strong> patients avaient eu une résection visant<br />
àêtre large. La longueur moyenne de résection était de 13 cm (9<br />
à 19). La reconstruction a consisté dans 7 cas en une arthrodèse<br />
tibio-talienne. Cette arthrodèse avait été effectuée 4 fois par<br />
greffons tibiaux et clou centro-médullaire, associée à une arthrodèse<br />
péronéo-talienne par vis. Dans deux cas, la fixation avait été<br />
assurée par plaque, et un patient avait eu un spacer en ciment en<br />
attendant une reconstruction biologique. Dans un cas, l’épiphyse<br />
tibiale avait été conservée. Après l’intervention, <strong>les</strong> patients<br />
étaient immobilisés par plâtre puis attelle pour 3 à 6 mois. La<br />
reprise d’appui était autorisée 2à 4 mois après l’intervention.<br />
La résection avait été large dans 4 cas, marginale 3 fois et<br />
contaminée dans 1 cas. La réponse à la chimiothérapie était<br />
bonne 4 fois et mauvaise 4 fois. Les résultats ont étéévalués avec<br />
un recul moyen de 5 ans et demi (2 à 17). Au dernier recul, six<br />
patients étaient en rémission, et deux étaient décédés, dont l’un<br />
aprèsrécidive locale et malgré une amputation. Trois patients ont<br />
eu une infection profonde, qui a toujours guéri après reprise<br />
chirurgicale. Une pseudarthrose a été reprise deux fois avant de<br />
consolider. Dans tous <strong>les</strong> cas d’arthrodèse tibio-talienne, l’apparition<br />
progressive d’une hyper mobilité de la sous-talienne a<br />
permis le développement d’une certaine mobilité de « cheville »,<br />
avec une fonction proche de la normale. Le score MSTS moyen<br />
était de 27,7/30 (22 à 30).<br />
En conclusion, le traitement conservateur de l’ostéosarcome<br />
du tibia distal paraît possible et donne d’excellents résultats<br />
fonctionnels, au prix de fréquentes complications infectieuses.<br />
L’obtention de marges chirurgica<strong>les</strong> larges nécessite une bonne<br />
réponse à la chimiothérapie. Au moindre doute, la reconstruction<br />
doit éviter la contamination de l’ensemble du tibia pour permettre<br />
une amputation secondaire.<br />
*E. Mascard, Service de Chirurgie Orthopédique,<br />
Hôpital Saint-Vincent-de-Paul, 82, avenue Denfert-Rochereau,<br />
75014 Paris.<br />
9 Infection après prothèse de genou<br />
pour tumeur maligne chez l’enfant :<br />
étiologie, traitement et pronostic<br />
P. LAUDRIN*, P. WICART, E.MASCARD,<br />
J. DUBOUSSET<br />
INTRODUCTION. L’infection aprèsrésection et arthroplastie<br />
totale de genou de l’enfant pour tumeur osseuse maligne est une<br />
complication grave remettant en cause le sauvetage du membre.<br />
Le sujet de ce travail était l’étude de l’étiologie, du traitement et<br />
du pronostic de cet événement.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Parmi <strong>les</strong> 169 arthroplasties de<br />
genou pour tumeur osseuse maligne réalisées de 1981 à 1999, ont<br />
été sélectionnés 17 dossiers satisfaisant aux critères suivants :<br />
infection prouvée par l’identification du germe sur <strong>des</strong> prélèvements<br />
profonds ou présence d’une fistule et recul supérieur à 2<br />
ans. Il s’agissait uniquement de sarcomes ostéogènes, en<br />
l’absence de sarcome d’Ewing qui représente cependant 30 %<br />
<strong>des</strong> tumeurs de cette topographie. La lésion était de siège fémoral<br />
(11) ou tibial (6), ayant fait l’objet d’une résection extraarticulaire<br />
(2) ou transarticulaire (14). L’infection était primitive<br />
(9), au décours de l’intervention initiale, ou secondaire (8) à une<br />
reprise chirurgicale dans 6 cas, à une plaie articulaire ou une<br />
contamination hématogène. Le germe a été identifié 13 fois<br />
(76%).Ils’agissait d’un staphylocoque. Outre l’antibiothérapie<br />
systématique, le traitement a consisté en un lavage (10), un<br />
changement de prothèse en un temps (3), une ablation de<br />
l’implant avec interposition d’un espaceur (2), une abstention<br />
chirurgicale (1), une amputation (1).<br />
RÉSULTATS. Le recul moyen était de 8 ans (2 à 16 ans). En<br />
moyenne, le traitement de l’infection a duré 51 mois et a nécessité<br />
3,9 interventions chirurgica<strong>les</strong>. Au dernier recul, l’infection<br />
était considérée comme guérie dans 70 % <strong>des</strong> cas, en l’absence de<br />
signe clinique ou biologique sans antibiothérapie depuis au<br />
moins un an. L’arthroplastie a pu être préservée dans un tiers <strong>des</strong>
cas (22 % en cas d’infection primitive et 50 % en cas d’infection<br />
secondaire), alors que dans deux tiers <strong>des</strong> cas a du être envisagé<br />
un autre traitement : une arthrodèse (6), une intervention de<br />
Borggreve (1) ou une amputation (4).<br />
DISCUSSION. Le taux de 10 % de la complication décrite<br />
correspond aux données de la littérature. La survenue d’une<br />
infection primitive est plus influencée par l’histologie de la<br />
tumeur et donc la chimiothérapie qui induit une immunosupression<br />
et surtout <strong>des</strong> lésions cutanées péri-cicatriciel<strong>les</strong> (Methotrexate),<br />
que par la topographie de la tumeur et le type de<br />
résection. Le diagnostic d’infection primitive est tardif, souvent à<br />
la fin de la chimiothérapie post-opératoire et son traitement idéal<br />
est le changement d’implant. L’infection secondaire est caractérisée<br />
par un diagnostic moins difficile, plus précoce, et un<br />
meilleur pronostic quant à la survie de l’arthroplastie.<br />
*P. Laudrin, Service de Chirurgie Orthopédique,<br />
Hôpital Saint-Vincent-de-Paul, 82, avenue Denfert-Rochereau,<br />
75014 Paris.<br />
10 Reconstruction par fibula vascularisée<br />
après résection d’une tumeur<br />
osseuse au niveau du membre<br />
supérieur chez l’enfant et l’ado<strong>les</strong>cent<br />
L. WATTINCOURT*, E. MASCARD, M.GERMAIN,<br />
P. WICART, J.DUBOUSSET<br />
INTRODUCTION. Les options possib<strong>les</strong> pour la reconstruction<br />
diaphysaire sont <strong>les</strong> allogreffes, <strong>les</strong> prothèses diaphysaires et<br />
<strong>les</strong> autogreffes vascularisées ou non. Le but de ce travail était<br />
d’évaluer <strong>les</strong> résultats à moyen terme et <strong>les</strong> complications <strong>des</strong><br />
reconstructions par fibula vascularisée au membre supérieur, en<br />
chirurgie tumorale de l’enfant et de l’ado<strong>les</strong>cent.<br />
PATIENTS ET MÉTHODES. De 1994 à 2000, 10 patients ont<br />
été opérés d’unetumeur osseuse du membre supérieur, la reconstruction<br />
étant effectuée par fibula vascularisée. Il s’agissait de 7<br />
garçons et 3 fil<strong>les</strong> âgésde7à 17 ans. La fibula vascularisée avait<br />
été utilisée dans le même temps que la résection tumorale dans 8<br />
cas et en sauvetage d’une prothèse d’humérus proximal dans<br />
deux cas. Les reconstructions en un temps, concernaient 4 résections<br />
de la diaphyse humérale et 4 résections du radius. L’histologie<br />
<strong>des</strong> tumeurs était, 7 ostéosarcomes conventionnels, un<br />
ostéosarcome de bas grade, une tumeur d’Ewing et un enchondrome<br />
agressif. Au moment du transfert de fibula, 6 patients<br />
recevaient de la chimiothérapie.<br />
La longueur du greffon était de 14 cm en moyenne (9 à 21). La<br />
fixation était assurée par plaque dans la plupart <strong>des</strong> cas. Tous <strong>les</strong><br />
patients avaient été plâtrés 6à 12 semaines en post-opératoire.<br />
RÉSULTATS. Les résultats ont été analysésrétrospectivement<br />
après 3,9 ans de recul moyen (de 1 à 7). Le délai de consolidation<br />
moyen de la greffe a été de trois mois (de 1,5 à 5). Cinq<br />
reconstructions huméra<strong>les</strong> sur six se sont fracturées, au cours de<br />
traumatismes avérés, nécessitant une reprise chirurgicale dans<br />
quatre cas. Tous <strong>les</strong> patients réopérés ont consolidé rapidement.<br />
Un radius a été repris pour apport osseux secondaire. Le score<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 2S21<br />
fonctionnel MSTS moyen était de 25,5 sur 30 (21 à 30). Un<br />
patient est décédé de métastases pulmonaires, <strong>les</strong> autres étant en<br />
rémission complète de leur tumeur.<br />
CONCLUSION. La reconstruction par fibula vascularisée au<br />
membre supérieur donne de bons résultats radiologiques, surtout<br />
lors <strong>des</strong> reconstructions du radius. Pour l’humérus, le résultat est<br />
d’autant meilleur que l’enfant est jeune au moment de la reconstruction,<br />
permettant une bonne croissance en épaisseur. Un certain<br />
nombre de complications mécaniques sont à craindre en cas<br />
de reprise trop précoce d’une activité sportive normale. Dans la<br />
plupart <strong>des</strong> cas, le résultat fonctionnel <strong>des</strong> reconstructions<br />
diaphysaires est proche de la normale.<br />
*L. Wattincourt, Service de Chirurgie Orthopédique,<br />
Hôpital Saint-Vincent-de-Paul, 82, avenue Denfert-Rochereau,<br />
75014 Paris.<br />
11 Reconstruction par fibula vascularisée<br />
après résection <strong>des</strong> tumeurs<br />
malignes <strong>des</strong> os longs chez<br />
l’enfant : à propos de 30 cas<br />
J.-L. JOUVE*, R. LEGRÉ, S.MALIKOV,<br />
F. LAUNAY, S.MINAUD, G.BOLLINI<br />
INTRODUCTION. La reconstruction après résection de<br />
tumeurs osseuses malignes reste un problème complexe. La<br />
fibula libre vascularisée (FLV) peut être une alternative intéressante<br />
dans cette indication.<br />
MATÉRIEL. Trente enfants (9 fil<strong>les</strong>, 21 garçons) ont été traités<br />
entre 1993 et 2000. L’âge moyen était de 11 ans. L’histologie de<br />
la tumeur était faite de 20 ostéosarcomes ostéogéniques, 5<br />
tumeurs d’Ewing, 3 ostéosarcomes juxtacorticaux, 1 synovialosarcome<br />
et 1 chondrosarcome. La localisation a été fémorale (17<br />
cas), tibiale (6 cas), humérale (5 cas), radiale (1 cas), fibulaire<br />
distale (1 cas). La longueur de la résection était entre 100 mm et<br />
260 mm (160 mm en moyenne). La fixation a été réalisée par<br />
ostéosynthèse interne dans 27 cas et fixateur externe dans 3 cas.<br />
L’épiphyse adjacente a été conservée dans 22 cas et une arthrodèse<br />
d’emblée aété réalisée dans 8 cas.<br />
MÉTHODE. Les patients ont été suivis cliniquement et radiologiquement.<br />
Une scintigraphie osseuse a été effectuée chez tous<br />
<strong>les</strong> patients au minimum une fois en post-opératoire. L’évaluation<br />
radiologique a été effectuée en calculant l’index d’hypertrophie<br />
du greffon selon la méthode de DeBoer et Wood. Le résultat<br />
fonctionnel a été évalué selon <strong>les</strong> critères Enneking.<br />
RÉSULTATS. Le recul moyen était de 2 à 9 ans (moyenne 51<br />
mois). Dans 2 cas une amputation précoce a été effectuée en<br />
raison de complications oncologiques loca<strong>les</strong>. Un patient est<br />
décédé à8 mois de recul du fait de métastases pulmonaires.<br />
Parmi <strong>les</strong> 27 patients restants, la consolidation primaire a été<br />
obtenue dans 22 cas. Les 5 autres patients présentaient <strong>des</strong> signes<br />
manifestes d’absence de vascularisation. Une greffe complémentaire<br />
autologue a permis la consolidation secondaire dans 4 cas.<br />
Tous <strong>les</strong> cas de fracture de fatigue ont consolidé avec une simple<br />
immobilisation.
2S22 77 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
Les 22 patients ayant consolidé en première intention présentaient<br />
une hypertrophie du greffon de 22 à 190 % (61 % en<br />
moyenne). Les 5 cas non vascularisés à la scintigraphie ayant<br />
nécessité une greffe complémentaire, ne présentaient aucune<br />
hypertrophie.<br />
L’hypertrophie de la FLV au niveau du membre inférieur a été<br />
plus marquée qu’au niveau de membre supérieur.<br />
Tous nos résultats fonctionnels ont été satisfaisants. Sur<br />
l’échelle de 30 points de la classification de Enneking modifiée,<br />
nos patients ont obtenu entre 19 et 30 points (26 en moyenne).<br />
DISCUSSION. Les résultats sont directement liés à la bonne<br />
perméabilité <strong>des</strong> anastomoses vasculaires. La scintigraphie<br />
osseuse, effectuée dans <strong>les</strong> mois qui suivent l’intervention, est un<br />
élément déterminant du pronostic. En cas d’échec vasculaire, une<br />
greffe cortico spongieuse autologue complémentaire est à indiquer<br />
systématiquement. La mise en contrainte précoce de la FLV<br />
est souhaitable sous couvert d’appareils protecteurs. Des systèmes<br />
d’ostéosynthèse dynamisab<strong>les</strong> devraient permettre d’améliorer<br />
l’hypertrophie du greffon.<br />
*J.-L. Jouve, Service de Chirurgie Orthopédique Pédiatrique,<br />
Hôpital Timone-Enfants, boulevard Jean-Moulin,<br />
13385 Marseille Cedex 5.<br />
12 Evaluation radiologique du risque<br />
fracturaire <strong>des</strong> kystes osseux<br />
essentiels de l’enfant<br />
P. MARY*, M. LARROUY, D.HANNOUCHE,<br />
G. FILIPE<br />
INTRODUCTION. Nous avons voulu définir un index fracturaire<br />
qui permettre de prévoir la survenue d’une fracture sur un<br />
kyste osseux essentiel.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Quatre-vingt-seize enfants<br />
ayant un kyste osseux essentiel ont été revus. Nous avons relevé<br />
<strong>les</strong> paramètres cliniques suivants : âge, localisation du kyste,<br />
circonstances du diagnostic.<br />
L’étude radiologique a porté sur 193 radiographies de face et<br />
de profil. Nous avons mesuré : 1) la distance séparant le pôle<br />
supérieur du kyste au cartilage de croissance sus-jacent. 2) la plus<br />
grande largeur du kyste. 3) la plus grande hauteur du kyste.<br />
4) l’épaisseur corticale minimale en regard du kyste. 5) la surface<br />
du kyste, calculéedemanière exacte grâce à un logiciel de calcul<br />
de surface, rapportée au diamètre diaphysaire élevé au carré<br />
(S/d 2 : index de Kaelin).<br />
Nous avons comparé ces différents paramètres pour <strong>les</strong> kystes<br />
qui se sont fracturés et ceux sans fracture.<br />
RÉSULTATS. L’âge moyen au diagnostic était de 10,4 ans<br />
(min : 2 – max : 12,8 ans). 72 % de kystes se localisaient à<br />
l’extrémité supérieure de l’humérus. La fracture a été révélatrice<br />
dans 68 % <strong>des</strong> cas.<br />
La comparaison <strong>des</strong> deux cohortes a montré <strong>les</strong> résultats<br />
suivants avec <strong>des</strong> différences statistiquement significatives (test<br />
de Student) concernant : 1) la largeur du kyste (p = 0,0038) : en<br />
<strong>des</strong>sous de moins de 16 mm, aucun kyste ne s’est fracturé. Pour<br />
<strong>des</strong> valeurs supérieures, il n’y a pas eu de différence entre <strong>les</strong><br />
kystes fracturés et <strong>les</strong> autres. 2) l’épaisseur <strong>des</strong> cortica<strong>les</strong> (p =<br />
0,0002) : une épaisseur corticale supérieure à 5 mm protège<br />
contre le risque fracturaire. Pour une épaisseur inférieure à moins<br />
de 3 mm, le risque fractiraire est de plus de 50 %. 3) le rapport<br />
S/d 2 (p < 0,0001) est directement corrélé au risque fracturaire,<br />
mais aucune valeur seuil ne peut être définie.<br />
Pour un risque fracturaire de 80 à 100 %, le kyste doit avoir <strong>les</strong><br />
caractéristiques suivants : largeur > 30 mm, hauteur > 75 mm,<br />
épaisseur corticale < 2,4 mm, S/d 2 > 5.<br />
Pour un risque fracturaire de 50 %, le kyste doit avoir <strong>les</strong><br />
caractéristiques suivantes : largeur > 24 mm, hauteur > 55 mm,<br />
épaisseur corticale < 3 mm, S/d 2 > 3.<br />
CONCLUSION. L’index de Kaelin est fiable, mais difficilement<br />
calculable en consultation. L’épaisseur corticale est un bon<br />
indicateur qui peut être amélioré en le corrélant à la hauteur du<br />
kyste et sa largeur. Ces mesures sont facilement réalisab<strong>les</strong> en<br />
consultation.<br />
*P. Mary, Service de Chirurgie Orthopédique,<br />
Hôpital Trousseau, 26, avenue du Docteur-Arnold-Netter,<br />
75012 Paris.<br />
13 Etude anatomique du creusement<br />
de la trochlée fémorale chez le<br />
fœtus<br />
E. GARRON*, J.-L. JOUVE, C.TARDIEU,<br />
M. PANUEL, S.AIRAUDI, G.BOLLINI<br />
INTRODUCTION. L’objectif de ce travail était de réaliser une<br />
évaluation biométrique de la trochlée fémorale fœtale, de comparer<br />
ces valeurs avec celle observées chez l’adulte, enfin de<br />
rechercher <strong>des</strong> corrélations avec <strong>les</strong> autres paramètres biométriques<br />
du fémur.<br />
MATÉRIEL. Vingt-deux fœtus conservés dans le formol indemes<br />
de pathologie orthopédique connue sont étudiés, soit 44<br />
genoux. L’âge <strong>des</strong> fœtus était de 26 à 40 semaines.<br />
MÉTHODE. Après dissection anatomique, <strong>les</strong> mesures sont<br />
effectuées à partir de documents photographiques numériques et<br />
d’un logiciel de mesures angulaires. En incidence épiphysaire<br />
distale sont mesurées <strong>les</strong> dimensions antéro postérieures <strong>des</strong><br />
condy<strong>les</strong>, <strong>les</strong> saillies <strong>des</strong> berges trochléennes latérale et médiale,<br />
la différence de hauteur <strong>des</strong> condy<strong>les</strong>, la longueur <strong>des</strong> berges<br />
trochléennes, l’angle alpha d’ouverture trochléenne, <strong>les</strong> ang<strong>les</strong> de<br />
pente trochléenne. En incidence fémorale de face sont mesurées<br />
l’antéversion fémorale, la longueur du col fémoral, l’angle cervico<br />
diaphysaire.<br />
Le test de Spearman était utilisé pour vérifier l’existence de<br />
corrélations. Les résultats sont comparés à ceux mesurés dans <strong>les</strong><br />
mêmes conditions dans une série de 32 genoux adultes publiée<br />
par Wanner.<br />
RÉSULTATS. L’angle alpha d’ouverture de la trochlée est<br />
retrouvéà148° pour un coefficient de variabilité de 4 %. Dix-huit<br />
trochlées ont un angle supérieur à 150°. La berge latérale de la
trochlée est retrouvée plus élevée que la berge médiale dans 37<br />
cas sur 44. Il n’y avait pas de corrélation entre l’âge et le sexe <strong>des</strong><br />
sujets étudiés.<br />
Concernant la biométrie fémorale, l’antéversion était de<br />
27,01° avec un coefficient de variabilité très important de 46 %,<br />
sans corrélation avec l’angle d’ouverture trochléenne.<br />
Il n’était pas retrouvé de différence significative avec la série<br />
comparable de trochlées adultes.<br />
DISCUSSION. Notre travail permet de réaliser la première<br />
étude biométrique concernant la trochléedufœtus. Il apparaît que<br />
la morphologie <strong>des</strong> extrémités inférieures <strong>des</strong> fémurs au cours du<br />
troisième trimestre de la grossesse est globalement superposable<br />
à celle <strong>des</strong> fémurs d’individus adultes. Les modifications morphologiques<br />
du fémur proximal au cours de la croissance ne<br />
semblent pas modifier la morphologie du fémur distal. L’engagement<br />
de la rotule sur une trochlée de plus en plus profonde et<br />
asymétrique, caractéristique de l’homme moderne est considéré<br />
comme conséquence de la bipédie. Notre étude semble confirmer<br />
que <strong>les</strong> caractères anatomiques de la trochlée ont pu être intégrés<br />
dans le génome au cours de l’évolution. Ceci plaide en faveur<br />
d’une origine génétique de la dysplasie trochléenne telle qu’elle<br />
a été évoquée par Dejour.<br />
*E. Garron, Service de Chirurgie Orthopédique Pédiatrique,<br />
Hôpital Timone-Enfants, boulevard Jean-Moulin,<br />
13385 Marseille Cedex 5.<br />
14 Monitorage de la pression interstitielle<br />
<strong>des</strong> loges musculaires : circonstances<br />
à risque<br />
M.-C. GIACOMELLI*, P. GICQUEL, P.CLAVERT,<br />
C. KARGER, J.-M. CLAVERT<br />
La prévention du syndrome de loges et de ses séquel<strong>les</strong> passe<br />
par le monitorage continu de la pression interstitielle <strong>des</strong> loges<br />
musculaires. C’est la pression de perfusion (différence entre la<br />
pression diastolique artérielle et la pression interstitielle) qui est<br />
le chiffre-clé qui doit toujours rester supérieur à 30 mm de Hg.<br />
Les résultats obtenus par ces mesures durant <strong>les</strong> premiers jours<br />
post-opératoires conduisent à quelques réflexions sur <strong>les</strong> circonstances<br />
où le risque augmente par chute de la pression artérielle<br />
diastolique.<br />
Vingt patients (13 garçons, 7 fil<strong>les</strong>) ont bénéficié d’un monitorage<br />
continu de la pression interstitielle de la loge antéroexterne<br />
de leur jambe. Le geste chirurgical était soit un<br />
allongement-réaxation de la jambe, soit une réaxation, soit une<br />
fracture de jambe L’âge moyen était de 11,5 ans. Quinze patients<br />
ont bénéficié d’une aponévrotomie préventive sous-cutanée. La<br />
durée moyenne du monitorage a été de 55 heures. Ont été notés<br />
toutes <strong>les</strong> heures la pression interstitielle, l’échelle visuelle de la<br />
douleur, le type la quantité et le mode d’administration <strong>des</strong><br />
antalgiques. La situation a été considérée comme «àrisque » si<br />
la pression de perfusion (Partérielle diastolique – Pression interstitielle)<br />
était inférieure à 30 mm Hg.<br />
Onze patients sur 20 ont eu un ou plusieurs épiso<strong>des</strong> de<br />
pression de perfusion inférieure à 30 mm Hg, 5 patients pendant<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 2S23<br />
<strong>les</strong> 5 premières heures post-opératoires, 8 patients pendant <strong>les</strong><br />
phases de sommeil et de réveil. La douleur ne s’était pas majorée<br />
pendant ces pério<strong>des</strong> car bien couverte par <strong>les</strong> antalgiques. Le<br />
dénominateur commun de ces situations à risque n’est pas une<br />
pression élevée dans la loge musculaire mais une pression artérielle<br />
diastolique basse. Aucun enfant n’a développé un syndrome<br />
de loge avec séquel<strong>les</strong>. L’aponévrotomie préventive ne<br />
protège pas contre la survenue de situations «àrisque ».<br />
Ces résultats doivent nous interroger sur <strong>les</strong> conditions dans<br />
<strong>les</strong>quel<strong>les</strong> nos enfants se comportent hémodynamiquement en<br />
salle de réveil et sur la nécessité de rétablir rapidement une<br />
pression artérielle diastolique élevée. Ceci devrait permettre de<br />
diminuer le risque d’initier un syndrome de loges et de diminuer<br />
également l’importance de l’oedème post-opératoire.<br />
En conclusion, le monitorage post-opératoire immédiat a mis<br />
en évidence que le risque de syndrome <strong>des</strong> loges apparaît dans <strong>les</strong><br />
situations où la pression artérielle diastolique était basse, c’està-dire<br />
le réveil post-opératoire et <strong>les</strong> pério<strong>des</strong> de sommeil sous<br />
Antalgiques.<br />
*M.-C. Giacomelli, Service de Chirurgie Infantile,<br />
Hôpital de Hautepierre, avenue Molière, 67098 Strasbourg.<br />
15 Analyse rétrospective de 33 pollicisations<br />
dans <strong>les</strong> anomalies congénita<strong>les</strong><br />
du pouce chez l’enfant<br />
P. JOURNEAU*, C. COUTURIER, A.SALON,<br />
S. GUERO<br />
INTRODUCTION. Nous avons revu une série pollicisations<br />
effectuées pour une anomalie congénitale du pouce. Le but de<br />
cette étude était d’apprécier l’influence de facteurs anatomiques<br />
ou techniques sur le résultat fonctionnel et cosmétique.<br />
MATÉRIEL. La série regroupait 33 interventions chez 26<br />
enfants. L’anomalie du pouce a été classée selon Blauth : 1 stade<br />
III A, 8 sta<strong>des</strong> III B, 8 sta<strong>des</strong> IV, 13 sta<strong>des</strong> V, et 3 mains en miroir.<br />
MÉTHODE. Les enfants ont été séparés en groupe A, anomalie<br />
isolée du pouce ou associée à une hypoplasie radiale mineure<br />
type I ou II de Bayne, (25 cas) et groupe B lorsqu’il existait une<br />
hypoplasie radiale majeure de type III ou IV, ou une main en<br />
miroir (8 cas). Nous avons noté le type d’incision cutanée, le<br />
mode de fixation de la tête du métacarpien sur le carpe, <strong>les</strong><br />
accourcissements tendineux. Les résultats ont étéévalués avec un<br />
recul de 4 ans en moyenne, sur l’aspect esthétique (indice de<br />
satisfaction parentale), et fonctionnellement par la mesure de<br />
l’indice de Kapandji, de la flexion-entension de l’articulation<br />
inter-phalangienne, de la pince pollici-digitale, et de la sensibilité.<br />
RÉSULTATS. L’âge moyen à l’intervention était de 32 mois.<br />
La fixation a été faite par 24 sutures et 9 brochages. Les accourcissements<br />
tendineux ont été pratiqués 16 fois pour l’appareil<br />
extenseur et 1 fois pour le fléchisseur profond. Le recul était de 4<br />
ans en moyenne. Il n’existait pas de différence significative sur<br />
l’aspect esthétique entre <strong>les</strong> groupes A et B. Le principal facteur<br />
qui modifiait le résultat fonctionnel objectif était l’association à<br />
une main bote radiale de stade III ou IV. Il existait dans ces cas
2S24 77 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
une déformation ou une raideur de l’articulation radio-carpienne,<br />
et surtout une raideur pré-opératoire de l’index pollicisé qui<br />
compromet le résultat final (Indice de Kapandji à 7 en moyenne<br />
pour le groupe A et à 4,75 en moyenne pour <strong>les</strong> patients du<br />
groupe B).<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. Les points techniques suivants<br />
n’ont pas eu d’influence significative sur le résultat fonctionnel<br />
final de notre série : type d’incision cutanée, mode de<br />
fixation sur le carpe, accourcissement de l’appareil extenseur ou<br />
fléchisseur. Cependant, la reconstruction de musc<strong>les</strong> thénariens<br />
par l’utilisation <strong>des</strong> musc<strong>les</strong> interosseux, le curetage du cartilage<br />
conjugal de la tête du deuxième métacarpien, l’hyper-extension<br />
de la tête du deuxième métacarpien lors de la fixation sur le carpe<br />
sont <strong>des</strong> points techniques à respecter pour éviter l’apparition de<br />
complications tel<strong>les</strong> une hypercroissance du néo-métacarpien, ou<br />
un pouce en Z.<br />
*P. Journeau, Service de Chirurgie Pédiatrique,<br />
Centre Hospitalier du Mans,<br />
194, avenue Rubillard, 72037 Le Mans Cedex 09.<br />
16 Remodelage après fracture distale<br />
du radius et/ou de l’ulna chez<br />
l’enfant<br />
C. HAUKE*, A. KAELIN<br />
INTRODUCTION. Le squelette immature démontre une capacité<br />
remarquable pour corriger une déformation résiduelle après<br />
une fracture. Traditionnellement il est accepté de tolérer un angle<br />
résiduel de moins de 25° pour <strong>les</strong> fractures dista<strong>les</strong> de l’avantbras<br />
chez l’enfant. Le degré de remodelage dépend de la distance<br />
entre la fracture et la ligne épiphysaire, le temps restant avant la<br />
fermeture du cartilage de croissance, l’angle résiduel aprèsréduction<br />
et de son orientation par rapport au plan de mobilité de<br />
l’articulation adjacente. Le but de cette étude était de pouvoir<br />
mieux définir <strong>les</strong> limites supérieures <strong>des</strong> déformations acceptab<strong>les</strong><br />
selon l’âge avant qu’une intervention chirurgicale soit indiquée.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Nous avons revu <strong>les</strong> dossiers<br />
radiologiques de 106 enfants atteints d’une fracture d’un ou <strong>des</strong><br />
deux os du tiers distal de l’avant-bras, qui ont nécessité une<br />
réduction fermée suivie d’une immobilisation par plâtre brachioantébrachial.<br />
Nous avons mesuré l’angle de déformation au<br />
niveau de la fracture ainsi que l’angle diaphyso-épiphysaire sur<br />
<strong>les</strong> radiographies de face et de profil après laréduction, à 6<br />
semaines, 3, 6 et à 12 mois du traumatisme. Il s’agissait de 79<br />
garçons et de 27 fil<strong>les</strong> avec un âge moyen de 8,5 ans (2,5 à 15<br />
ans). Vingt-cinq fractures étaient épiphysaire et 81 fractures<br />
métaphysaires.<br />
RÉSULTATS. Un an après la fracture, le remodelage était<br />
quasi complet pour la plupart <strong>des</strong> fractures, et ceci d’autant plus<br />
que l’enfant jeune et que la fracture était distale. Les fractures de<br />
type SALTER I ou II s’étaient remodelées très vite, entre 4 et 5<br />
mois post trauma. Ce remodelage se fait principalement par<br />
apposition – résorption dans la région métaphysaire et par réorientation<br />
de la ligne épiphysaire. Pour <strong>les</strong> fractures métaphysaires<br />
la vitesse de remodelage est inversement proportionnelle à la<br />
distance de celle-ci vis-à-vis du cartilage de croissance. Dans le<br />
cas <strong>des</strong> fractures ouvertes nécessitant une intervention chirurgicale<br />
et dans le cas d’infections secondaires le remodelage est<br />
fortement perturbé.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. L’analyse de ce collectif<br />
montre qu’une bascule postérieure peut être tolérée : jusqu’à 30°<br />
au-<strong>des</strong>sous de 8 ans, jusqu’à 25° entre 8 et 10 ans et jusqu’à 20°<br />
à l’âge pré-pubère. Ces aboques pour <strong>les</strong> fractures dista<strong>les</strong> de<br />
l’avant-bras chez l’enfant sont importantes pour la prise en<br />
charge initiale et peuvent aider à réduire le nombre <strong>des</strong> réductions<br />
primaires ou secondaires sous anesthésie générale ou locorégionale.<br />
*C. Hauke, Division d’Orthopédie Pédiatrique,<br />
Hôpital <strong>des</strong> Enfants, 6, rue Willy-Donzé, 1211 Genève, Suisse.<br />
17 L’algodystrophie de l’enfant et de<br />
l’ado<strong>les</strong>cent<br />
R. SARRAIL*, F. LAUNAY, M.-C. MAREZ,<br />
B. PUECH, P.CHRESTIAN<br />
INTRODUCTION. L’algodystrophie est une affection méconnue<br />
ou souvent niée chez l’enfant et qu’il faut savoir reconnaître<br />
car elle peut être invalidante.<br />
MATÉRIEL. Vingt-quatre enfants âgés de7à 15 ans ont été<br />
traités pour une algodystrophie depuis 1998. Il y avait 18 fil<strong>les</strong> et<br />
6 garçons. Dans 73 % <strong>des</strong> cas l’algodystrophie intéressait le pied<br />
ou la cheville, secondaire la plupart du temps à une entorse. Le<br />
diagnostic a été posé non seulement sur le tableau clinique mais<br />
également sur <strong>les</strong> données de la scintigraphie osseuse qui a été<br />
réalisée dans chaque cas. Le retard moyen du diagnostic était de<br />
17,9 semaines avec un cas ayant évolué pendant 2,5 ans.<br />
MÉTHODES. Un bloc intra-veineux sous garrot pneumatique<br />
gonflé à basse pression et sans anesthésie associant Xylocaine et<br />
Buflomédil a été réalisé chez 23 patients. L’analgésie procurée<br />
par l’anesthésique local a été mise à profit pour manipuler en<br />
douceur le membre concerné permettant de mobiliser une articulation<br />
enraidie et de faire visualiser à l’enfant la mobilité retrouvée.<br />
Le bloc a toujours été associé àune physiothérapie douce, à<br />
une balnéothérapie et à un suivi psychologique.<br />
RÉSULTATS. Le bloc intra-veineux a été immédiatement et<br />
totalement efficace dans 78 % <strong>des</strong> cas, l’enfant étant alors capable<br />
de remarcher avec appui sans douleur. Dans 17 % <strong>des</strong> cas, une<br />
récidive a été notée. Elle est survenue dans le premier mois après<br />
le bloc dans 80 % <strong>des</strong> cas.<br />
DISCUSSION. Même si le diagnostic d’algodystrophie est<br />
essentiellement clinique, la scintigraphie nous a permis de<br />
conforter notre diagnostic et de mieux localiser la région anatomique<br />
en cause. Nous avons complètement abandonné l’utilisation<br />
en première intention de la calcitonine dont <strong>les</strong> résultats dans<br />
la littérature sont moins bons que ceux <strong>des</strong> blocs intraveineux.<br />
L’association d’un anesthésique local et d’un garrot pneumatique<br />
gonflé à basse pression permet une bonne tolérance clinique par<br />
l’enfant sans avoir besoin d’une anesthésie plus complète.<br />
CONCLUSION. L’algodystrophie chez l’enfant et l’ado<strong>les</strong>cent<br />
est une affection qui faut savoir rechercher. La réalisation en
première intention d’un bloc intra-veineux permet d’en raccourcir<br />
significativement l’évolution, autorisant ainsi l’enfant, parfois<br />
déscolarisé, de reprendre ses activités physiques.<br />
*R. Sarrail, CHP La Résidence du Parc, rue Gaston-Berger,<br />
13362 Marseille Cedex 10.<br />
18 Evaluation posturographique<br />
d’enfants infirmes moteurs cérébraux<br />
après traitement d’un équin :<br />
étude préliminaire<br />
S. BOURELLE*, J. COTTALORDA, L.BESSENAY,<br />
V. GAUTHERON<br />
INTRODUCTION. L’évaluation <strong>des</strong> traitements orthopédiques<br />
ou chirurgicaux réalisés chez l’enfant infirme moteur cérébral<br />
(IMC) est devenue incontournable. Les traitements effectués<br />
au niveau <strong>des</strong> membres inférieurs visent dans la majorité <strong>des</strong> cas<br />
à améliorer la marche. La marche et le contrôle de la posture<br />
statique et dynamique étant étroitement liés, nous avons cherché<br />
à déterminer, dans une étude préliminaire, si le traitement d’un<br />
équin qui perturbait l’équilibre et la marche améliore le contrôle<br />
postural statique et dynamique.<br />
MATÉRIEL. Quatre enfants diplégiques spastiques, un garçon<br />
et 3 fil<strong>les</strong>, âgés de5à 14 ans ont fait partie de cette étude<br />
préliminaire. Ils présentaient un équin fixé ou dynamique uni ou<br />
bilatéral qui a nécessité une prise en charge médicale (injection<br />
19 Devenir <strong>des</strong> butées autologues<br />
posées sur <strong>des</strong> cupu<strong>les</strong> Métal-<br />
Back : 24 cas dont 19 à plus de 5<br />
ans<br />
J.-L. DORÉ*<br />
INTRODUCTION. L’os s’il n’est pas soumis à <strong>des</strong> forces se<br />
lyse. L’hydroxyapatite au contact d’un os mort n’a pas d’ostéoconduction.<br />
Les butées osseuses posées sur <strong>des</strong> cupu<strong>les</strong> métal back dans le<br />
cadre de PTH sur dysplasie acétabulaire vont-el<strong>les</strong> se lyser et<br />
vont-el<strong>les</strong> « adhérer »àl’hydroxyapatite ?<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. La série comportait : 22<br />
Butées, 21 Mala<strong>des</strong>. Il s’agissait de : Luxations basses appuyées :<br />
10/Hautes appuyées : 6/Hautes non appuyées : 6. Le recul moyen<br />
était de 6 ans (17 cas > 5 ans).<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 2S25<br />
Séance du 13 novembre matin<br />
HANCHE<br />
de toxine botulique et/ou plâtres d’allongement) ou chirurgicale<br />
(aponévrotomie <strong>des</strong> jumeaux).<br />
MÉTHODES. L’évaluation posturographique a été réalisée sur<br />
la Balance Mastert, qui comporte une plate-forme de force<br />
calculant la composante verticale du centre de pression <strong>des</strong> pieds,<br />
grace à 5 tests : test de répartition du poids du corps ; test de<br />
stabilité dans différentes conditions sensoriel<strong>les</strong> ; test de stabilité<br />
monopodale ; test <strong>des</strong> limites de stabilité ; test <strong>des</strong> mouvements<br />
de balancement rythmiques. Cette évaluation a été effectuée dans<br />
le mois qui a précédé le traitement puis 2 à 4 mois de la fin du<br />
traitement.<br />
RÉSULTATS. Après traitement, 2 enfants ont été nettement<br />
améliorés dans le test de répartition du poids du corps. Dans le<br />
test de stabilité dans différentes conditions sensoriel<strong>les</strong>, tous <strong>les</strong><br />
enfants ont été améliorés. Dans le test d’appui monopodal, aucun<br />
enfant n’est véritablement amélioré et on constate pour 2 enfants<br />
qui ont bénéficié d’un traitement unilatéral une dégradation du<br />
côté non traité. Dans le test <strong>des</strong> limites de stabilité, une seule<br />
enfant est améliorée. Dans le test <strong>des</strong> mouvements de balancements<br />
rythmiques, on constate surtout une amélioration du<br />
contrôle directionnel pour 3 <strong>des</strong> 4 enfants.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. Cette étude préliminaire<br />
nous a permis de constater qu’il est possible d’évaluer de façon<br />
simple et ludique le contrôle de la posture statique et dynamique<br />
chez <strong>des</strong> enfants IMC même très jeunes. La Balance Mastert<br />
paraît être une voie de recherche intéressante pour évaluer le<br />
contrôle de la posture avant et après traitement et pourrait devenir<br />
un outil de rééducation.<br />
*S. Bourelle, Service de Chirurgie Infantile, Hôpital Nord,<br />
CHU de Saint-Etienne, 42055 Saint-Etienne Cedex 2.<br />
Technique : 100 % <strong>des</strong> butées étaient autologues. Une fois<br />
choisi l’emplacement en hauteur, c’est le plus grand diamètre<br />
antéro-postérieur possible qui dicte la taille de la cupule et donc<br />
le volume de la butée. Le façonnage de la butée était fait cupule<br />
d’essai en place. Pose de la cupule définitive sans la butée puis<br />
vissage en compression de celle-ci.<br />
Implants : 22 Cups en titane (3 mm) revêtues d’hydroxyapatite.<br />
Largeur de la butée :28° environ par rapport au centre de la<br />
tête prothétique.<br />
Position de la cup : Paléocotyle : 11 fois/Néocotyle :<br />
0/Intermédiaire : 11 fois.<br />
RÉSULTATS. Complications : Parésie sciatique : 0/Luxation :<br />
0/Bascule de la cup : 1 à J 21. Lyses partiel<strong>les</strong> de la butée ont été<br />
observées mais aucune totale.<br />
Adhésivité butée-hydroxyapatite-titane : (17 cas. > 5 ans)<br />
aucun liseré visible. Aucune Pseudarthrose de la butée n’a été<br />
identifiée.<br />
DISCUSSION. Les greffes sont-el<strong>les</strong> nécessaires avec <strong>les</strong> cup<br />
métal back ? Souvent dans <strong>les</strong> coxarthroses primitives, la cupule
2S26 77 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
se trouve un peu découverte, on ne met pas de butée età 10 ans<br />
tout va très bien. A partir de quelle « découverture » <strong>des</strong> cupu<strong>les</strong><br />
<strong>les</strong> greffes sont-el<strong>les</strong> nécessaires ? Disposant d’autogreffe, il<br />
semble ridicule de se priver de cette possibilité car le fait que <strong>les</strong><br />
butées ne se lysent pas fait penser qu’el<strong>les</strong> sont uti<strong>les</strong> ! Toutes <strong>les</strong><br />
structures osseuses semblent intelligentes : Les butées se lysent si<br />
el<strong>les</strong> ont été posées trop volumineuses, mais leur partie en<br />
« charge » au-<strong>des</strong>sus de la cup se densifie.<br />
CONCLUSION. Les butées autologues sur <strong>des</strong> cupu<strong>les</strong> métalliques<br />
ne se lysent pas. L’adhésivité os-hydroxyapatite se fait de<br />
façon normale. Les butées autologues au-<strong>des</strong>sus de cupu<strong>les</strong> métal<br />
back sont « intelligentes » et se comportent comme <strong>les</strong> butées<br />
au-<strong>des</strong>sus <strong>des</strong> cupu<strong>les</strong> en polyéthylène cimentées.<br />
*J.-L. Doré, 2, rue Croix-Pasquier, 37100 Tours.<br />
20 Luxation tête fémorale polyéthylène<br />
sur <strong>les</strong> cupu<strong>les</strong> à double mobilité de<br />
Bousquet : à propos de 7 cas<br />
F. LECUIRE*, P. BENAREAU, J.RUBINI, M.BASSO<br />
INTRODUCTION. Le cotyle de G. Bousquet, avec sa double<br />
mobilité tête-polyéthylène et polyéthylène-cupule métallique<br />
diminue considérablement le risque de luxation sur P.T.H.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Nous avons observé 7 luxations<br />
« intra-prothétique » sur ce type de cupule, avec luxation de<br />
la tête fémorale à travers la jupe retentive du polyéthylène par<br />
usure progressive du système de rétention.<br />
Il s’agit de 6 patients (1 cas bilatéral) âgés de52ansen<br />
moyenne (43 à 58) lors de l’implantation prothétique. La luxation<br />
intra prothétique s’est produite en moyenne 10 ans après<br />
l’implantation prothétique (3,5 à 15 ans).<br />
Tous <strong>les</strong> patients ont été réopérés ; et nous avons toujours<br />
retrouvé une usure du polyéthylène au niveau du collet retentif<br />
autour du col, permettant l’issue de la tête métallique. L’interrvention<br />
réalisée très précocement pour 6 hanches a été très<br />
simple : changement de l’embase modulaire et changement du<br />
polyéthylène pour retrouver son caractère retentif. Le résultat fut<br />
satisfaisant dans tous <strong>les</strong> cas.<br />
Un patient dut subir 5 ans plus tard un changement prothétique<br />
en un temps pour une infection hématogène.<br />
Un patient opéré tardivement a subi un changement de<br />
l’embase modulaire associé à un changement complet de la<br />
cupule pour un implant press fit. Sa hanche est excellente mais il<br />
aprésenté quatre luxations qui vont nécessiter une reprise chirurgicale.<br />
DISCUSSION. La luxation intra-prothétique tête polyéthylène<br />
d’une cupule à double mobilité est rare et dans notre expérience,<br />
tardive. L’usure de la jupe retentive est favorisée par différents<br />
phénomènes : 1) directs : diamètre du col et de la tête responsab<strong>les</strong><br />
d’un contact plus précoce col-cupule. 2) indirects : facteurs<br />
limitant la mobilité du couple polyéthylène cupule métallique<br />
(fibrose, interventions itératives, ossifications).<br />
Dans notre expérience elle survient sur <strong>des</strong> terrains favorisants,<br />
avec risque de luxations aggravé (alcoolisme, problème<br />
musculaire, problème psychiatrique, obésité) retrouvés 6 fois sur<br />
7.<br />
CONCLUSION. La luxation intra prothétique d’une cupule à<br />
double mobilité, complication possible mais rare, nécessite une<br />
reprise chirurgicale, techniquement simple. Elle ne remet pas en<br />
cause pour nous le concept de la double mobilité. Ce type de<br />
cotyle utilisé systématiquement par certains, reste pour nous<br />
irremplaçable à titre préventif sur <strong>les</strong> terrains à risques ou curatif<br />
dans <strong>les</strong> reprises de luxations récidivantes.<br />
*F. Lecuire, Service de Chirurgie Orthopédique,<br />
Hôpital Renée-Sabran, boulevard Edouard-Herriot, Giens,<br />
83400 Hyères.<br />
21 Boiterie et défaut de latéralisation<br />
dans <strong>les</strong> arthroplasties de hanche<br />
L. BÉGUIN*, R. LIMOZIN, A.DEMANGEL,<br />
P. ADAM, M.-H. FESSY<br />
INTRODUCTION. Amstutz a introduit la notion de « level<br />
arm ratio », rapport du bras de levier <strong>des</strong> abducteurs sur celui du<br />
poids dans <strong>les</strong> arthroplasties. Il a démontré qu’une insuffisance de<br />
ce rapport par défaut de latéralisation était source de boiterie.<br />
Nous nous proposons d’analyser le pourcentage de restitution de<br />
la latéralisation au cours d’une arthroplastie par rapport à l’état<br />
pré-opératoire, sur une série continue de patients qui présentent<br />
un résultat excellent à un an. Nous nous proposons de faire la<br />
même étude sur une série de patients qui présentent une boiterie<br />
après arthroplastie, après avoir éliminé <strong>les</strong> causes classiques<br />
d’une faillite du résultat. Les résultats de ces deux séries ont été<br />
ensuite comparés.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Nous disposons d’une série de<br />
100 arthroplasties aux résultats excellents à un an. Il s’agit de<br />
patients qui présentent une arthroplastie uni-latérale associée à<br />
une hanche opposée saine. Nous disposons pour chaque patient<br />
d’une radiographie pré-opératoire du bassin de face debout et un<br />
contrôle à un an, en charge, au même agrandissemement. Pour<br />
chacun <strong>des</strong> dossiers, nous repérons le centre de tête de l’arthroplastie.<br />
Nous mesurons la latéralisation par rapport à l’axe fémoral.<br />
Nous mesurons la position de la cupule par rapport au U. Les<br />
résultats sont exprimés en pourcentage de restitution par rapport<br />
à l’état préopératoire. Nous mesurons par ailleurs, le « level arm<br />
ratio » de Amstutz. Nous mesurons enfin la distance entre la<br />
symphyse pubienne et le point le plus extrême du fémur sur le<br />
coté prothèse et le coté sain.<br />
Nous disposions d’une autre population de 12 patients, qui<br />
présentaient une boiterie persistante à un an, sans cause évidente.<br />
Les mêmes paramètres ont été évalués sur cette population.<br />
RÉSULTATS. Nous ne restituons que partiellement la latéralisation<br />
initiale et nous avons tendance à médialiser l’acétabulum.<br />
Il existe une différence statistiquement significative en<br />
matière de restitution de la latéralisation entre la série aux<br />
résultats excellents et la série avec boiterie.
DISCUSSION. Le défaut de latéralisation apparaît comme un<br />
facteur de boiterie. Il existe une valeur seuil de latéralisation à<br />
restituer, en <strong>des</strong>sous de laquelle, la boiterie est constante.<br />
Dans la littérature, il existe, semble-t-il, une grande variabilité<br />
de la latéralisation. Il semble donc important de restituer cette<br />
latéralisation pour éviter la boiterie ; ceci nous conduit, comme<br />
d’autres auteurs à recourir à <strong>des</strong> implants dits latéralisés dans<br />
certains cas.<br />
*L. Béguin, Centre d’Orthopédie Traumatologie,<br />
Hôpital Bellevue, CHU de Saint-Etienne,<br />
42055 Saint-Etienne Cedex 2.<br />
22 Cupule ajustée cimentée pour le<br />
traitement de la nécrose de la tête<br />
fémorale<br />
P. BEAULÉ*, T. SCHMALZRIED, F.DOREY,<br />
H. AMSTUTZ<br />
INTRODUCTION. Le traitement de la nécrose de la tête<br />
fémorale pour <strong>les</strong> sta<strong>des</strong> Ficat III et IV est toujours un problème<br />
majeur et sujet de controverse, en raison du jeune âge <strong>des</strong> patients<br />
et <strong>des</strong> résultats décevants <strong>des</strong> prothèses tota<strong>les</strong> de hanche (PTH).<br />
Nous avons revu notre expérience avec la cupule ajustée cimentée<br />
pour déterminer <strong>les</strong> raisons menant à la reprise chirurgicale<br />
ainsi que <strong>les</strong> résultats cliniques à long terme.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Soixante hanches atteintes<br />
d’ostéonécrose traitées par cupu<strong>les</strong> ajustées dans notre institution<br />
furent étudiées. Age moyen 33,6 ans (18 à 51) avec 23 % de<br />
femmeset77%d’hommes. Les hanches furent évaluées selon la<br />
méthode de Ficat (6 % stade II, 85 % stade III, et 9 % stade IV)<br />
et l’angle nécrotique Kerboull (angle moyen de 192°). De plus,<br />
au moment du geste chirurgical, l’état du cartilage acétabulaire<br />
fut évalué et enregistré : Grade I (17 %) : normal, Grade II<br />
(30 %) : fissure, Grade III : fibrillation sans (A = 28 %) ou avec<br />
(B = 13%) ostéophyte, Grade IV (10 %) : érosion partielle<br />
jusqu’à l’os sous-chondral.<br />
RÉSULTATS. Avec un recul moyen de 7,8 ans (1 à 21), aucun<br />
cas de luxation, fracture du col fémoral, ou ostéolyse. Les scores<br />
moyens de la grille d’évaluation UCLA montrent une amélioration<br />
significative de 4,5 à 8,1 pour la douleur, 6,1 à 8,8 pour la<br />
marche, 5,3 à 7,6 pour le fonctionnement, et 4,2 à 5,8 pour<br />
l’activité. La courbe de survie étant de 81 % à 5 ans, 57 % à 10<br />
ans, et 40 % à 15 ans. Quatorze hanches furent converties en<br />
PTH, 12 pour usure du cartilageacétabulaire, une pour déscellement<br />
fémoral, et une pour infection. Une corrélation positive (p =<br />
0,005) fut observée entre la durée pré-opératoire <strong>des</strong> symptômes<br />
et la dégradation du cartilage acétabulaire, suggèrant aussi une<br />
relation à la survie réduite de la prothèse. L’angle nécrotique de<br />
Kerboull et le stade Ficat ne montrèrent aucune corrélation avec<br />
la survie de la prothèse.<br />
DISCUSSION. La survie de la cupule ajustée est meilleure<br />
lorsque <strong>les</strong> symptômes ont été perceptible pour une durée inférieure<br />
à 1 an, probablement parce que le cartilage acétabulaire est<br />
moins endommagé. Ces résultats sont supérieurs à ceux <strong>des</strong><br />
autres solutions conservatrices tel<strong>les</strong> que l’ostéotomie ou le<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 2S27<br />
greffon vascularisé qui n’atteignent pas 80 % de survie à 5 ans et<br />
où le soulagement de la douleur est médiocre. Si nécessaire, la<br />
conversion à une PTH peut être réalisée sans effet néfaste sur ses<br />
résultats cliniques.<br />
*P. Beaulé, Joint Replacement Institute Orthopaedic Hospital,<br />
2400 S Flower Street, 90007 Los Ange<strong>les</strong>, Etats-Unis.<br />
23 Les fractures du grand trochanter<br />
au cours de l’arthroplastie totale de<br />
hanche<br />
J.-M. DURAND*, J. HENNER, G.VAZ,<br />
J. BÉJUI-HUGUES<br />
INTRODUCTION. L’étude spécifique <strong>des</strong> fractures du grand<br />
trochanter pendant l’arthroplastie totale de hanche n’a été rapportée<br />
qu’une seule fois (30 cas dont 26 de découverte postopératoire).<br />
Cette étude rétrospective évalue sa fréquence et ses<br />
conséquences post-opératoires.<br />
MATÉRIELS. Sur notre série de 1 171 prothèses tota<strong>les</strong> de<br />
hanche opérées de 1985 à 2000, 38 cas (3,2 %) ont été recensés<br />
(âge moyen : 63 ans). Toutes <strong>les</strong> fractures ont été ostéosynthésées.<br />
Trente-et-un cas ont été observés au cours d’une arthroplastie<br />
première et 7 cas au cours de reprise.<br />
RÉSULTATS. Dix-huit patients avaient un terrain favorisant :<br />
corticothérapie, éthylisme, ostéoporose, diabète, Paget, ablation<br />
de matériel trochantérien, ostéolyse périprothétique. La voie<br />
d’abord était antéro-latérale 22 fois et postéro-latérale 16 fois. La<br />
fracture a été observée 4 fois lors de la voie d’abord (ablation de<br />
matériel ou état préfracturaire), 2 fois lors de l’extraction de tige<br />
préalablement implantée et 32 fois lors de l’implantation. Douze<br />
pivots différents sont en cause mais une tige vissée représente à<br />
elle seule 18 cas soit 10 % <strong>des</strong> tiges vissées implantées, alors que<br />
pour <strong>les</strong> autres pivots, cette complication ne représente pas plus<br />
de 1,2 % <strong>des</strong> tiges implantées. La mise en appui a été immédiate<br />
27 fois et différée de trois semaines à trois mois 11 fois. Dans <strong>les</strong><br />
suites, on a observé sur 36 cas (deux décès), 22 consolidations<br />
anatomiques, 5 vicieuses et 9 pseudarthroses dont 2 septiques (3<br />
ont été réopérés). Les douleurs à deux mois ont été notées 11 fois<br />
et la boiterie persistante 10 fois (8 pseudarthroses).<br />
DISCUSSION. Les prothèses à encombrement métaphysaire<br />
majeur sont responsab<strong>les</strong> de la majorité <strong>des</strong> fractures. La voie<br />
d’abord ne peut être incriminée. Cette fracture, bien stabilisée,<br />
consolide bien. La pseudarthrose, souvent annoncée par une<br />
douleur persistante, est à craindre sur un terrain d’ostéopénie,<br />
avec une fracture mal stabilisée. Bien que toutes <strong>les</strong> pseudarthroses<br />
aient été constatées sur <strong>des</strong> patients mis en appui différé,ce<br />
critère ne reflète certainement que la crainte du chirurgien face à<br />
une ostéosynthèse peu satisfaisante.<br />
CONCLUSION. Cette fracture ne peut être assimilée à une<br />
ostéotomie réglée du grand trochanter car elle survient sur un<br />
stock osseux le plus souvent déficient, expliquant le taux de<br />
pseudarthrose supérieur. Elle doit être prévenue par le choix d’un<br />
pivot à faible encombrement métaphysaire en cas de terrain<br />
favorisant et doit faire l’objet d’une ostéosynthèse soigneuse
2S28 77 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
pour obtenir une consolidation rapide interférant peu avec l’intérêt<br />
fonctionnel de cette intervention.<br />
*J.-M. Durand, Pavillon T, CHU de Lyon,<br />
Hôpital Edouard-Herriot, 5, place d’Arsonval,<br />
69437 Lyon Cedex 03.<br />
24 Traitement <strong>des</strong> pseudarthroses du<br />
trochanter par plaques à griffes<br />
M. HAMADOUCHE*, B. ZNIBER, M.KERBOULL,<br />
L. KERBOULL, J.-P. COURPIED<br />
INTRODUCTION. La pseudarthrose du trochanter compliquant<br />
une arthroplastie totale de hanche réalisée par voie transtrochantérienne<br />
est une complication sérieuse dont la fréquence a<br />
été estimée à 3 %. Le traitement de la pseudarthrose trochantérienne<br />
par simp<strong>les</strong> fils métalliques est à l’origine d’un taux<br />
d’échec évalué à40 %. Pour ces raisons, une plaque spécifique<br />
pour fixation trochantérienne a été développée. Le but de cette<br />
étude rétrospective était d’évaluer <strong>les</strong> résultats d’une série continue<br />
de pseudarthroses trochantériennes traitées à l’aide de cette<br />
plaque.<br />
MATÉRIELS ET MÉTHODES. La série comportait 72 pseudarthroses<br />
chez 71 patients traités entre 1986 et 1999. L’âge<br />
moyen était de 66 ans. La majorité <strong>des</strong> arthroplasties avaient été<br />
réalisées pour coxarthrose primitive ou pour dysplasie de hanche.<br />
Le délai écoulé avant réintervention pour traitement de la pseudarthrose<br />
était en moyenne de 8 mois. La réinsertion du trochanter<br />
était assurée par plaque seule pour 47 hanches et par fils<br />
frontaux et plaque pour 25 hanches. Parmi <strong>les</strong> critères d’évaluation<br />
<strong>des</strong> résultats, le critère majeur était la consolidation du<br />
trochanter qui a été classée en trois sta<strong>des</strong> : consolidé (absence de<br />
douleur, pas d’instabilité et fusion radiologique), non consolidé<br />
(présence d’une instabilité et/ou absence de fusion radiologique),<br />
consolidation douteuse (douleur modérée, pas d’instabilité,<br />
fusion radiologique difficile à affirmer).<br />
RÉSULTATS. Le recul moyen de la série était de 47 mois (12<br />
mois à 14 ans). Le score fonctionnel moyen au dernier recul était<br />
de 15,9 versus 13,5 en pré-opératoire (test <strong>des</strong> signes appariés, p<br />
< 10 –4 ). Selon <strong>les</strong> critères décrits, le trochanter était jugé consolidé<br />
51 fois, non consolidé 12 fois, et consolidation douteuse 9<br />
fois. Parmi <strong>les</strong> facteurs étudiés, le seul facteur prédictif de<br />
l’obtention de la consolidation était la technique de fixation du<br />
trochanter. En effet, en cas de plaque seule, <strong>les</strong> résultats se<br />
distribuaient de la façon suivante : consolidation acquise 62 %,<br />
consolidation douteuse 13 %, et 26 % d’échecs. En cas de fixation<br />
par fils et plaques, <strong>les</strong> résultats se distribuaient de la façon<br />
suivante : consolidation acquise 87,5 %, consolidation douteuse<br />
12,5 %, et 0 % d’échec. La différence était hautement significative<br />
(Chi2, p = 0,006) en faveur de l’utilisation d’une synthèse<br />
trochantérienne par fils et plaque.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. Cette étude permet de<br />
conclure que le traitement de choix de la pseudarthrose trochantérienne<br />
est l’ostéosynthèse par fils métalliques et plaque, avec<br />
plus de 90 % de bons et très bons résultats.<br />
*M. Hamadouche, Service de Chirurgie Orthopédique A,<br />
Hôpital Cochin, 27, rue du Faubourg-Saint-Jacques, 75014 Paris.<br />
25 Etude comparative, à 12 ans de<br />
recul, de deux séries de prothèses<br />
tota<strong>les</strong> de hanche avec couple<br />
zircone/polyéthylène et alumine/<br />
polyéthylène<br />
P. HERNIGOU*, T. BAHRAMI<br />
INTRODUCTION. Cette étude compare deux séries de prothèses<br />
tota<strong>les</strong> de hanche à plus de 12 ans de recul, le seul<br />
changement entre <strong>les</strong> deux séries étant la nature de la tête<br />
fémorale : tête de 28 mm en zircone ou tête de 32 mm en alumine.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. La période d’implantation <strong>des</strong><br />
prothèses était la même (de 1988 à 1990) ; le polyéthylène, <strong>les</strong><br />
implants fémoraux, le ciment chirurgical et l’opérateur étaient<br />
identiques dans <strong>les</strong> deux séries. Pour <strong>les</strong> deux séries (40 prothèses<br />
Zir/PE et 62 Al/PE), l’âge et le poids moyen <strong>des</strong> patients étaient<br />
similaires (respectivement 68 et 63 ans ; 72 et 73 kilos). L’étude<br />
a comparé la survie <strong>des</strong> implants, l’usure du polyéthylène mesurée<br />
sur <strong>les</strong> radiographies de face et de profil, l’ostéolyse du<br />
merckel. Les pièces explantées ont été analysées.<br />
RÉSULTATS. Dans le groupe Zir/PE, 3 réinterventions ont été<br />
nécessaires à la 8 e ,10 e et 11 e année. Dans le groupe <strong>des</strong> prothèses<br />
ayant le couple Al/PE, aucune réintervention n’a été nécessaire et<br />
aucun <strong>des</strong>cellement évident n’est présent sur <strong>les</strong> radiographies.<br />
L’usure apparaît identique durant <strong>les</strong> 4 premières années pour<br />
<strong>les</strong> deux séries. Passé la 5 e année, la pénétration <strong>des</strong> têtes en<br />
alumine dans le polyéthylène reste identique avec vitesse<br />
moyenne de 0,07 mm par an. Passé la 5 e année, la vitesse de<br />
pénétration <strong>des</strong> têtes en zircone s’accélère pour atteindre en<br />
moyenne 0,4 mm dans la 12 e année. L’usure volumétrique <strong>des</strong><br />
cupu<strong>les</strong> en polyéthylène a été estimée en moyenne à 1360 mm 3<br />
pour la zircone et à 755 mm 3 pour l’alumine. L’ostéolyse appréciée<br />
comme la surface de la géode endostée du merckel est en<br />
moyenne de 2,5 cm 2 pour le couple Zir/PE et de 0,35 cm 2 pour le<br />
couple Al/PE. Les différences entre <strong>les</strong> deux séries sont significatives<br />
(p < 0,05) pour la pénétration linéaire, l’usure volumétrique<br />
et l’ostéolyse. Les trois têtes en zircone explantées ont<br />
montré une transformation partielle de la phase tétragonale en<br />
phase monoclinique (19 %, 25 % et 30 %) et une augmentation<br />
de la rugosité insuffisante néanmoins pour expliquer l’usure du<br />
polyéthylène. L’usure anormale s’explique plus par une perte de<br />
sphéricité et une augmentation de volume <strong>des</strong> têtes en zircone<br />
correspondant vraisemblablement à la modification de phase du<br />
cristal (le passage de la phase tétragonale à la phase monoclinique<br />
s’accompagne habituellement d’une augmentation de<br />
volume de 3 %). L’analyse <strong>des</strong> empreintes laissées par le cône<br />
morse sur <strong>les</strong> têtes en zircone laisse penser que la modification de<br />
volume <strong>des</strong> têtes en zircone s’est accompagnée demodifications<br />
de contact entre le cône morse et la tête en zircone au cours du<br />
temps. L’analyse <strong>des</strong> cupu<strong>les</strong> explantées a montré dans 2 cas <strong>des</strong><br />
usures avec délamination. Pour l’un <strong>des</strong> implants, le polyéthylène<br />
était déformé avec un aspect de fusion correspondant à une<br />
élévation anormale de température.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. Les implants en zircone<br />
fabriqués ilya12ansnecorrespondent sans doute plus aux<br />
normes actuel<strong>les</strong> de fabrication. Néanmoins, <strong>les</strong> modifications<br />
observées sur <strong>les</strong> pièces explantées, laissent penser qu’el<strong>les</strong> ne
sont pas liées au seul mode de fabrication mais à la nature même<br />
du matériau.<br />
*P. Hernigou, Hôpital Henri-Mondor,<br />
51, avenue de Lattre-de-Tassigny, 94010 Créteil.<br />
26 Arthrosplastie totale de hanche<br />
cimentée sur ostéonécrose aseptique<br />
de la tête fémorale : résultats à<br />
dix ans minimum de recul<br />
C. NICH*, M. HAMADOUCHE, M.KERBOULL,<br />
M. POSTEL, J.-P. COURPIED<br />
INTRODUCTION. Le but de cette étude rétrospective était<br />
d’évaluer <strong>les</strong> résultats cliniques et radiologiques à 10 ans minimum<br />
de recul d’une série continue d’arthroplasties tota<strong>les</strong> de<br />
hanche réalisées pour nécrose aseptique de la tête fémorale.<br />
MATÉRIELS ET MÉTHODES. La série comportait 122<br />
arthroplasties réalisées entre Janvier 1980 et Décembre 1990<br />
chez 96 patients (26 femmes et 70 hommes) âgés en moyenne de<br />
50,8 ± 13,3 ans (21-85 ans). Les étiologies étaient une cause<br />
essentielle pour 40,6 % <strong>des</strong> cas, une corticothérapie pour 19,8 %,<br />
un alcoolisme chronique pour 17 %, une origine posttraumatique<br />
pour 12 % et une autre origine médicale pour <strong>les</strong><br />
10 % restants. Selon la classification de Ficat et Arlet, 80 hanches<br />
étaient classées stade IV et 42 hanches stade III. Toutes <strong>les</strong><br />
arthroplasties ont été réalisées par voie transtrochantérienne. Les<br />
implants utilisés étaient dans tous <strong>les</strong> cas de type Charnley-<br />
Kerboull cimentés utilisant un couple de frottement métalpolyéthylène.<br />
L’évaluation fonctionnelle <strong>des</strong> résultats a été effectuée<br />
selon le score de Merle d’Aubigné.L’usure <strong>des</strong> cupu<strong>les</strong> a été<br />
mesurée selon la technique de Livermore. Enfin une analyse de<br />
survie a été effectuée selon la méthode actuarielle.<br />
RÉSULTATS. Lors de l’évaluation au recul minimum de 10<br />
ans, 59 patients (75 hanches) étaient toujours vivants et n’avaient<br />
pas subi de reprise au recul moyen de 13 ± 2,6 ans (10 à 21 ans),<br />
7 patients (7 hanches) avaient été repris sur le versant acétabulaire<br />
et/ou fémoral, 20 patients (24 hanches) étaient décédés, et<br />
10 patients (16 hanches) étaient perdus de vue. Les reprises ont<br />
été réalisées pour ostéolyse péri-acétabulaire dans 1 cas, pour<br />
sepsis dans 1 cas, et pour <strong>des</strong>cellement acétabulaire dans 5 cas.<br />
Trois patients avaient <strong>des</strong> épiso<strong>des</strong> de luxation ou de subluxation.<br />
Le score fonctionnel moyen pré-opératoire était de 11 (5-16)<br />
versus 17 (14-18) au dernier recul (p < 0,05). Quatre-vingtquinze<br />
pour cent <strong>des</strong> patients avaient un résultat clinique jugé bon<br />
ou excellent, 5 % avaient un résultat passable ou mauvais.<br />
L’usure moyenne globale de la cupule était de 0,965 mm (0-5)<br />
pour <strong>les</strong> hanches non reprises. Onze liserés acétabulaires et six<br />
liserés fémoraux sont apparus à terme. Le taux de survie cumulée,<br />
en définissant l’échec comme la reprise, était de 88,5 % à 15<br />
ans (intervalle de confiance à 95 % compris entre 80,2 et 96,9 %).<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. Les résultats de cette série<br />
permettent de conclure que l’arthroplastie totale de hanche basse<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 2S29<br />
friction reste le traitement de choix <strong>des</strong> sta<strong>des</strong> avancésdenécrose<br />
aseptique de la tête fémorale.<br />
*C. Nich, Service de Chirurgie Orthopédique A,<br />
Hôpital Cochin, 27, rue du Faubourg-Saint-Jacques,<br />
75014 Paris.<br />
27 « Cupule alumine métal backed »<br />
chez <strong>les</strong> patients âgés de moins de<br />
55 ans : résultats à 8 ans<br />
P. BIZOT*, R. NIZARD, J.WITVOET, L.SEDEL<br />
La résistance à l’usure de l’alumine est maintenant bien établie.<br />
Dans <strong>les</strong> années 80, l’amélioration <strong>des</strong> procédés de fabrication<br />
et du <strong>des</strong>sin <strong>des</strong> implants a conduit une diminution significative<br />
du risque fracturaire, mais l’échec de fixation <strong>des</strong> implants<br />
acétabulaires restait la cause la plus fréquente de reprise.<br />
Le but de l’étude était de présenter <strong>les</strong> résultats d’une série<br />
consécutive de PTH alumine-alumine utilisant une cupule sans<br />
ciment « pressfit métal hacked », implantées entre 1990 et 1992,<br />
chez <strong>des</strong> patients de moins de 55 ans.<br />
L’étude porte sur 71 PTH chez 62 patients. L’âge moyen à<br />
l’intervention était de 46 ans (21-54). Il y avait 56 hanches<br />
vierges et 15 reprises. La prothèse comprenait une tige en alliage<br />
de Ti cimentée, une tête alumine de 32 mm et une cupule « métal<br />
backed » grillagée impactée, munie d’un insert en alumine. Trois<br />
patients (4 hanches) sont décédés. Quatre hanches ont été reprises<br />
pour infection (1), douleur inexpliquée (1) fracture de tête alumine<br />
(1) et <strong>des</strong>cellement aseptique de la cupule (1). La survie à 9<br />
ans était de 93,7 % et 98,4 % en prenant comme échec respectivement<br />
la reprise quelque soit la cause, et la reprise pour <strong>des</strong>cellement<br />
aseptique.<br />
Cinquante patients (57 hanches) ont été revus avec un recul<br />
minimum de 5 ans et un recul moyen de 8 ans (6-11). 96 % <strong>des</strong><br />
hanches avaient un résultat excellent ou très bon selon la cotation<br />
PMA. 38 % <strong>des</strong> cupu<strong>les</strong> présentaient un liséré fin et partiel<br />
essentiellement en zone III et une cupule avait un liseré complet<br />
< 1 mm. Une hanche présentait une ostéolyse fémorale isolée.<br />
Aucun cas d’ostéolyse acétabulaire ni migration d’implant n’était<br />
rapportée.<br />
La combinaison d’une tige cimentée etd’une cupule « métal<br />
backed » impactée a donné <strong>des</strong> résultats très satisfaisants à<br />
moyen terme chez <strong>des</strong> patients actifs. L’utilisation d’une cupule<br />
hémisphérique impactée est apparue comme une méthode fiable<br />
de fixation <strong>des</strong> cupu<strong>les</strong> alumine et a amélioré de façon significative<br />
<strong>les</strong> résultats <strong>des</strong> PTH Al-Al. Eu égard à l’excellente résistance<br />
à l’usure de l’alumine, ces résultats peuvent se maintenir à<br />
très long terme.<br />
*P. Bizot, Service de Chirurgie Orthopédique,<br />
Hôpital Lariboisière, 2, rue Ambroise-Paré,<br />
75475 Paris Cedex 10.
2S30 77 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
28 Données récentes sur <strong>les</strong> fractures<br />
d’implants en alumine <strong>des</strong> prothèses<br />
tota<strong>les</strong> de hanche<br />
C. NICH*, D. HANNOUCHE, R.NIZARD, P.BIZOT,<br />
L. SEDEL<br />
INTRODUCTION. La fracture d’un implant en alumine<br />
demeure une cause rare d’échec de PTH. Au cours <strong>des</strong> 20<br />
dernières années, l’amélioration <strong>des</strong> propriétés <strong>des</strong> implants en<br />
céramique à permis de réduire ce risque.<br />
Durant cette dernière année, cinq fractures d’implants en<br />
alumine ont été constatées. Le but de ce travail était d’analyser<br />
ces événements récents et de tenter d’y apporter une explication<br />
au travers de notre expérience.<br />
MATÉRIELS ET MÉTHODES. De 1976 à 2002, 11 patients<br />
ont nécessité une reprise pour fracture d’un composant en alumine.<br />
Il s’agissait de 5 femmes et 6 hommes, d’âge moyen 57 ans<br />
(32-87 ans) à l’intervention initiale. Le poids moyen était de 72<br />
kg. Le délai moyen entre l’intervention et la reprise était de 36,5<br />
mois (7-106 mois). Le couple repris était un couple aluminealumine<br />
dans 9 cas, alumine-PE dans 2 cas. Les cupu<strong>les</strong> initia<strong>les</strong><br />
en alumine étaient impactées avec metal-back 5 fois, en alumine<br />
scellée 3 fois et en alumine massive impactée 1 fois. Le diamètre<br />
<strong>des</strong> têtes en alumine était de 32 mm dans 10 cas, de 22,2 mm dans<br />
1 cas. Les tiges étaient cimentées dans 7 cas, et recouvertes<br />
d’hydroxyapatite dans 4 cas. L’implant en cause était l’insert<br />
acétabulaire dans 4 cas, la tête dans 7 cas.<br />
RÉSULTATS. Les causes identifiées de rupture de l’implant en<br />
céramique étaient 1 traumatisme violent dans 1 cas (insert), un<br />
diamètre de tête insuffisant dans 1 cas et 1 défaut d’appairage<br />
(tête). Les 8 autres ruptures, concernant 3 inserts et 5 têtes, sont<br />
survenues sans facteur déclenchant. Les 3 fractures d’insert<br />
concernaient 2 cupu<strong>les</strong> de 50 mm et 1 cupule de 52 mm. Une<br />
modification du <strong>des</strong>sin de l’insert avait précédé la survenue de<br />
ces fractures. Le délai moyen de survenue <strong>des</strong> accidents était<br />
dans ces cas de 12 mois (8,5-15).<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. A notre connaissance,<br />
tous <strong>les</strong> cas rapportés dans la littérature de fracture d’implant en<br />
céramique ont concerné la tête prothétique. Ce travail met en<br />
évidence un phénomène récent concernant <strong>les</strong> inserts acétabulaires.<br />
L’hypothèse avancée pour expliquer ces accidents est le<br />
faible diamètre <strong>des</strong> cupu<strong>les</strong> associée à une modification récente<br />
du <strong>des</strong>sin avec une céramique affleurante au metal-back. Les<br />
modifications actuel<strong>les</strong> <strong>des</strong> inserts ont permis de retrouver une<br />
architecture « débordante » associée à <strong>des</strong> épaisseurs de céramique<br />
plus importantes pour <strong>les</strong> petits diamètres <strong>des</strong> cupu<strong>les</strong>. Ces<br />
accidents demeurent rares, mais une surveillance est justifiée,<br />
particulièrement dans l’année post-opératoire.<br />
*C. Nich, Service de Chirurgie Orthopédique A,<br />
Hôpital Cochin, 27, rue du Faubourg-Saint-Jacques,<br />
75014 Paris.<br />
29 Arthroplastie totale de hanche de<br />
type Charnley chez <strong>les</strong> patients<br />
âgés de moins de 60 ans : recul<br />
minimum de 26 ans<br />
J.-P. CLARAC*, H. HAMCHA, J.SOYER, P.PRIÈS,<br />
M. FRESLON, G.THIERRY<br />
INTRODUCTION. Les auteurs proposent, dans ce travail,<br />
d’étudier l’évolution clinique et radiologique <strong>des</strong> prothèses tota<strong>les</strong><br />
de hanche de Charnley chez <strong>les</strong> patients de moins de 60 ans,<br />
avec un recul minimum de 25 ans.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Il s’agit d’une étude rétrospective<br />
consécutive de 141 prothèses tota<strong>les</strong> de hanche de tvpe<br />
Charnley implantées entre 1972 et 1975.<br />
Ces prothèses ont toutes été mises en place par le même<br />
opérateur et selon la même technique chirurgicale.<br />
El<strong>les</strong> ont toutes fait l’objet d’une étude clinique et radiologique<br />
à intervalle régulier, jusqu’au plus grand recul d’un minimum de<br />
26 ans.<br />
Une mesure radiologique de l’usure <strong>des</strong> cupu<strong>les</strong> de polyéthylène<br />
ainsi que sa répercussion sur la longévité <strong>des</strong> prothèses a été<br />
étudiée.<br />
Nous avons testé l’influence de différents facteurs sur l’apparition<br />
d’un <strong>des</strong>cellement fémoral ou acétabulaire.<br />
Nous avons analysé le comportement <strong>des</strong> implants acétabulaires<br />
et fémoraux grâce à <strong>des</strong> courbes de survie.<br />
RÉSULTATS. Au plus grand recul, 28 prothèses sont encore<br />
en place, 44 prothèses ont été reprises, 42 patients ont été perdus<br />
de vue, et 27 patients décédés.<br />
Au dernier recul, en excluant <strong>les</strong> hanches réopérées, la fonction<br />
articulaire était jugée bonne, très bonne ou excellente dans<br />
86 % <strong>des</strong> cas (15 à 18 dans la cotation de Merle d’Aubigné).<br />
L’usure du polyéthylène était de 0,12 mm/an. Le Merkel était<br />
le siège d’une ostéolyse dans 50 % <strong>des</strong> cas.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. Ce travail conclut aux<br />
bons résultats fonctionnels <strong>des</strong> prothèses tota<strong>les</strong> de hanche de<br />
Charnley. Les taux d’usure et de <strong>des</strong>cellement sont plus importants<br />
que dans <strong>les</strong> séries de personnes âgées. Leur pronostic est<br />
menacé par l’usure du polyéthylène et ses conséquences biologiques.<br />
*J.-P. Clarac, Service Orthopédie, CHU de Poitiers, BP 577,<br />
86021 Poitiers Cedex.<br />
30 Etude rétrospective à 10 ans de<br />
recul de la cupule Alizé<br />
F. CHALENCON*, J.-P. FAYARD, R.LIMOZIN<br />
INTRODUCTION. Nous rapportons une série rétrospective<br />
continue et homogène de 107 prothèses tota<strong>les</strong> de hanche ayant<br />
utilisé une cupule revêtue d’hydroxyapatite avec un recul moyen
de 9,67 ans : étude de la stabilité de l’implant et de l’usure <strong>des</strong><br />
composants.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Cent sept dossiers de prothèses<br />
tota<strong>les</strong> de hanche implantées entre janvier 1991 et janvier 1992<br />
ont été revus : 67 femmes et 40 hommes opérés par le même<br />
chirurgien : cupule Alizé et tige Aura sans ciment. La moyenne<br />
d’âge <strong>des</strong> opérés était de 66,5 ans (30-85). Le recul moyen lors de<br />
l’analyse est de 9,6 ans. Nous avons évalué àterme 63 dossiers,<br />
nous dénombrons 17 décédés, 16 perdus de vue, 10 suivis<br />
impossib<strong>les</strong> et une seule ablation de l’implant (0,9 %). Il s’agissait<br />
d’une première intervention dans 90,7 % <strong>des</strong> cas, 6 patients<br />
ont été opérés d’un <strong>des</strong>cellement d’une première PTH avec cet<br />
implant.<br />
Cliniquement <strong>les</strong> patients ont étéévalués selon le score PMA et<br />
par questionnaire d’autoévaluation. Radiologiquement nous<br />
avons cherché àapprécier la stabilité (bascule, déplacement de<br />
l’implant) et l’usure <strong>des</strong> implants par <strong>des</strong> mesures précises<br />
informatisées sur <strong>des</strong> radiographies successives numérisées en<br />
utilisant le logiciel MetrOs. Nous avons, aussi recherché <strong>des</strong><br />
signes radiologiques qualitatifs de réaction osseuse au contact<br />
<strong>des</strong> implants.<br />
RÉSULTATS. Le score PMA global évoluait de 10,63 en<br />
moyenne en pré-opératoire à 16,98 au contrôle intermédiaire à 5<br />
ans pour diminuer à 15,77 à 10 ans. 93,9 % <strong>des</strong> patients étaient<br />
satisfaits à 5 ans et 98,5 % <strong>des</strong> patients revus à 10 ans (64<br />
31 Analyse tridimensionnelle de scolioses<br />
opérées par la technique du<br />
cintrage in situ<br />
J.-P. STEIB*, R. DUMAS, D.MITTON, F.LAVASTE,<br />
W. SKALLI<br />
INTRODUCTION. La scoliose est une déformation du rachis<br />
dans <strong>les</strong> trois plans de l’espace. La chirurgie moderne veut<br />
s’attaquer à ce problème tridimensionnel. Jusqu’à présent <strong>les</strong><br />
mesures pré et post opératoires étaient critiquab<strong>les</strong> en raison de<br />
leur approximation. Une reconstruction quantitative 3D du rachis<br />
peut être obtenue par stéréoradiographie. La précision de reconstruction<br />
est estimée à 1,1 mm pour la forme de la vertèbre et à<br />
1,4° pour la rotation axiale.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Dix patients (7 ado<strong>les</strong>cents, 3<br />
adultes) présentant une scoliose idiopathique de 56° en moyenne<br />
(36°-78°) ont été traités par la technique du cintrage in situ. Une<br />
téléradiographie calibrée de face et de profil aété prise avant et<br />
après la chirurgie. Le rachis <strong>des</strong> patients a été reconstitué par<br />
stéréoradiographie. Six ang<strong>les</strong> de rotation ont été mesurés dans<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 2S31<br />
Séance du 13 novembre matin<br />
RACHIS<br />
hanches). Nous déplorons deux fractures de tête céramique après<br />
chute directe sur le grand trochanter (qui ont donné lieu à un<br />
changement de l’implant fémoral, de la tête et du polyéthylène).<br />
Nous n’avons qu’un <strong>des</strong>cellement de cupule à 91,5 ans avec<br />
verticalisation de l’implant chez un patient sportif. L’analyse <strong>des</strong><br />
radiographies n’a pas montré de condensation anormale ou de<br />
liseré ; dans un seul cas, il yaeuapparition de géo<strong>des</strong>. Les<br />
mesures radiographiques avec MetrOs ont été réalisées sur 55<br />
dossiers complets : à 5 ans de recul, l’usure moyenne était de 0,53<br />
mm, elle augmentait à 0,76 mm à 10 ans (0,16 mm-2,24 mm).<br />
L’ascension de la cupule était de 0,15 mm à 5 ans évoluant à 0,76<br />
mm à 10 ans. L’inclinaison moyenne de la cupule était à 46,2° en<br />
post-opératoire immédiat, elle variait de 0,7° en moyenne à 5 ans<br />
et de 1° à10 ans.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. Cette étude radio-clinique<br />
au recul de 10 ans nous démontre que la cupule Alizé recouverte<br />
d’hydroxyapatite est un implant stable dans le temps. Les résultats<br />
cliniques de cette étude sont satisfaisants avec une petite<br />
régression du PMA du fait du vieillissement de la cohorte. Les<br />
mesures radiographiques ont été rigoureuses utilisant un outil<br />
précis et sont très rassurantes. Nous discutons le seul <strong>des</strong>cellement<br />
de la cupule de la série ainsi que l’évolution <strong>des</strong> deux<br />
patients repris pour fracture de tête céramique post traumatique.<br />
*F. Chalencon, Clinique Mutualiste, 3, rue Le Verrier,<br />
42013 Saint Etienne Cedex 02.<br />
<strong>les</strong> trois plans de l’espace (par vertèbre et par segment intervertébral).<br />
Il a été tenu compte <strong>des</strong> différentes courbures avec leurs<br />
zones apica<strong>les</strong> et jonctionnel<strong>les</strong>.<br />
RÉSULTATS. Pour <strong>les</strong> scolioses thoraciques la rotation axiale<br />
moyenne (VAR) à l’apex était de 20° en préopératoire ; la<br />
rotation vertébrale latérale moyenne (VLR) était de 30° pour<br />
leurs zones jonctionnel<strong>les</strong> avec une rotation intervertébrale axiale<br />
(IAR) de 10°. Selon <strong>les</strong> courbures le cintrage in situ a corrigé la<br />
VAR à l’apex de 52 à 60%etde78à79 % aux zones jonctionnel<strong>les</strong>.<br />
La VLR a été amélioréede58à74 % aux zones jonctionnel<strong>les</strong>.<br />
La rotation intervertébrale sagittale (ISR) au sommet<br />
(cyphose) a été améliorée de5,5° en moyenne.<br />
DISCUSSION. La reconstruction 3D du rachis permet une<br />
étude précise <strong>des</strong> déformations sur <strong>des</strong> rachis en charge contrairement<br />
aux étu<strong>des</strong> par scanners où <strong>les</strong> patients étaient couchés.<br />
L’amélioration est significative dans le plan frontal avec une<br />
correction de la VLR respectivement de 18,3° et 21,4° pour zones<br />
jonctionnel<strong>les</strong> thoracique et thoracolombaire, comparée à la rotation<br />
de la tige où le calcul peropératoire par stéréophotogrammétrie<br />
fait gagner respectivement 9,6° et 8,6°. L’amélioration de la<br />
VAR est réelle alors qu’elle semble moins importante par la<br />
rotation de la tige dans la littérature.
2S32 77 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
CONCLUSION. La reconstruction 3D du rachis permet une<br />
analyse segmentaire de la déformation <strong>des</strong> scolioses. En plus de<br />
la vision tous azimuts du rachis, <strong>les</strong> mesures d’angle peuvent être<br />
effectuées avec précision de façon répétitive et comparative.<br />
Cette technique prouve l’efficacité du cintrage in situ sur la<br />
rotation vertébrale.<br />
*J.-P. Steib, Service de Chirurgie Orthopédique B,<br />
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, BP 426,<br />
67091 Strasbourg Cedex.<br />
32 Etude in vitro du comportement biomécanique<br />
du rachis cervical par<br />
système opto-électronique<br />
P. BACON*, B. WATIER, F.LAVASTE, J.-M. VITAL<br />
INTRODUCTION. Afin de mieux comprendre la physiologie<br />
du rachis cervical, son comportement biomécanique in vitro a été<br />
étudié àl’aide d’un système opto-électronique.<br />
MATÉRIEL. Vingt rachis cervicaux frais (occiput-Th1), stérilisés<br />
par rayonnement (2,5 Mrad) et conservés à–24 °C, ont été<br />
étudiés après décongélation lente et excision <strong>des</strong> musc<strong>les</strong> pararachidiens.<br />
Ils provenaient de 14 hommes et 6 femmes, âgés en<br />
moyenne de 66,5 ans.<br />
MÉTHODES. Un tripode de marqueurs réfléchissants était<br />
rigidement liéàchaque vertèbre du segment rachidien testé (4 ou<br />
5 vertèbres). La vertèbre inférieure était fixée. Six coup<strong>les</strong> de<br />
moment purs (2 N.m maximum – 10 incréments) étaient appliqués<br />
dans <strong>les</strong> 3 plans anatomiques par un dispositif de chargement<br />
encastré sur la vertèbre supérieure. La mesure <strong>des</strong> déplacements<br />
était réalisée avec le dispositif optoélectronique VICON<br />
140 et un logiciel d’étude cinématique.<br />
RÉSULTATS. Les courbes de comportement tridimensionnel<br />
de chaque unité fonctionnelle (U.F.) permettent, pour chaque<br />
sollicitation, l’analyse du mouvement principal et <strong>des</strong> mouvements<br />
couplés (calculs <strong>des</strong> mobilités maxima<strong>les</strong>, zones neutres,<br />
zones rigi<strong>des</strong>, rigidités). Les mobilités maxima<strong>les</strong> moyennes en<br />
flexion-extension sont : C0/C1 = 28,7° ; C1/C2 = 22,3° ; C2/C3 =<br />
7,3° ; C3/C4 = 10,6° ; C4/C5 = 13,8° ; C5/C6 = 13,4° ; C6/C7 =<br />
10,8° et C7/Th1 = 6,4°. Les mobilités maxima<strong>les</strong> en inclinaison<br />
latérale globale sont : C0/C1 = 8,7° ; C1/C2 = 9,3° ; C2/C3 =<br />
8,7° ; C3/C4 = 6,7° ; C4/C5 = 10,5° ; C5/C6 = 11,2° ; C6/C7 =<br />
8,6° et C7/Th1 = 5,7°. Les mobilités maxima<strong>les</strong> en rotation axiale<br />
globale sont : C0/C1 = 11° ; C1/C2 = 71° ; C2/C3 = 9,5° ; C3/C4<br />
= 10,8° ; C4/C5 = 12,3° ; C5/C6 = 9° ; C6/C7 = 5,6° et C7/Th1<br />
= 5,7°. Toutes <strong>les</strong> U.F. ont un mouvement de flexion-extension<br />
plan. L’inclinaison latérale est marquée par un couplage en<br />
rotation controlatérale important en C1/C2 (42°), et par un faible<br />
couplage en rotation ipsilatérale dans <strong>les</strong> U.F. du rachis cervical<br />
inférieur (< 10°). La rotation axiale <strong>des</strong> U.F. de C1 à Th1 est<br />
associée à un couplage en inclinaison homolatérale (< 10°).<br />
DISCUSSION. Le protocole développé assure à nos essais la<br />
précision <strong>des</strong> mesures (< 1°) et une bonne répétabilité. Il permet<br />
une analyse tridimensionnelle simultanée de plusieurs unités<br />
fonctionnel<strong>les</strong> rachidiennes. Le dispositif de mesure sans contact<br />
est particulièrement adapté àl’étude du rachis cervical. Nos<br />
résultats se situent dans le corridor expérimental défini par <strong>les</strong><br />
travaux de Goel, Panjabi ou Wen.<br />
CONCLUSION. Ce travail, basé sur l’étude d’un nombre<br />
important d’unités fonctionnel<strong>les</strong>, conforte <strong>les</strong> données de la<br />
littérature concernant le comportement biomécanique du rachis<br />
cervical. Le recours à notre protocole est envisageable pour<br />
analyser le retentissement <strong>des</strong> techniques chirurgica<strong>les</strong> utilisées à<br />
cette étage rachidien, et notamment l’évaluation de nouveaux<br />
matériels d’ostéosynthèse ou prothétiques.<br />
*P. Bacon, Unité de Pathologie Rachidienne,<br />
Hôpital Pellegrin, place Amélie-Raba-Léon,<br />
33076 Bordeaux Cedex.<br />
33 Traitement <strong>des</strong> fractures du rachis<br />
cervical inférieur au cours de la<br />
spondylarthrite ankylosante<br />
O. GILLE*, C. SCHAELDERLE, V.POINTILLART,<br />
J.-M. VITAL<br />
INTRODUCTION. Il s’agit d’une étude rétrospective de 17<br />
fractures du rachis cervical chez <strong>des</strong> patients présentant une<br />
spondylarthrite ankylosante. Le but de cette étude est de rechercher<br />
un groupe de spondylarthrite ankylosante à risque fracturaire<br />
augmenté et d’évaluer le résultat du traitement.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Dix-sept patients traités entre<br />
1982 et 2001 ont été revus avec un recul moyen de 5 ans. Il y<br />
avait 3 femmes pour 14 hommes, avec un âge moyen de 60 ans<br />
au moment du traumatisme. 15 patients ont été opérés et 2 traités<br />
orthopédiquement.<br />
RÉSULTATS. La population <strong>des</strong> patients atteints de spondylarthropathie<br />
victimes de fracture du rachis cervical est homogène<br />
: <strong>les</strong> patients ont 60 ans, leur maladie évolue depuis 30 ans,<br />
la fracture survient au décours d’une chute banale. 47 % <strong>des</strong><br />
fractures surviennent au niveau C6-C7, au niveau du plus grand<br />
bras de levier, niveau difficilement exploré chez ces patients ce<br />
qui explique le retard diagnostic fréquent (35 %). 60 % <strong>des</strong><br />
patients étaient classés Frankel D ou E, 23 % A ou B. 14 patients<br />
ont bénéficié d’une ostéosynthèse antérieure, un patient a été<br />
ostéosynthésé par une voie postérieure. Dans tous <strong>les</strong> cas une<br />
ostéosynthèse longue sur plusieurs niveaux a été réalisée. Chez 3<br />
patients qui avaient une évolution très cyphosante de leur fracture,<br />
initialement passée inaperçue, une correction de cette<br />
cyphose cervicale a été réalisée lors du geste chirurgical en<br />
profitant du trait fracturaire pour relordosé la colonne à l’aide<br />
d’un greffon antérieur en forme de coin. La correction moyenne<br />
obtenue a été de 20° avec une bonne restauration de la lordose et<br />
une réhorizontalisation du regard. Tous <strong>les</strong> patients opérés ont<br />
consolidé de leur fracture, sans perte de réduction de la cyphose<br />
au recul. Il n’y a pas eu d’aggravation neurologique. Une<br />
fracture-luxation a été insuffisamment réduite par voie antérieure<br />
(lésion ancienne) et une décompression postérieure a été associée.<br />
2 patients n’ont pas été opérés : le premier, Frankel A, est<br />
décédéà2 mois et le second a consolidé avec une aggravation de<br />
10° de sa cyphose cervicale. Tous <strong>les</strong> patients Frankel A et B de<br />
la série sont décédés.
CONCLUSION. Tous <strong>les</strong> patients avec troub<strong>les</strong> neurologiques<br />
sévères sont décédés. La voie antérieure isolée permet une bonne<br />
stabilisation de la colonne cervicale. Chez <strong>les</strong> patients sans<br />
trouble neurologique une réduction de la cyphose cervicale doit<br />
être associée au geste de stabilisation dans <strong>les</strong> cas de fractures<br />
cyphosantes.<br />
*O. Gille, Unité de Pathologie Rachidienne, Hôpital Pellegrin,<br />
place Amélie-Raba-Léon, 33076 Bordeaux Cedex.<br />
34 Modification de la technique de Du<br />
Toit dans l’arthrodèse atloïdoaxoïdienne<br />
(vissage C1-C2) par<br />
voie latérale<br />
J.-L. MARMORAT*, C. MAZEL, P.ANTONIETTI,<br />
O. GUINGAND, E.DE THOMASSON,<br />
R. TERRACHER<br />
INTRODUCTION. Diverses techniques d’arthrodèse C1-C2<br />
ont été décrites, la voie antérieure trans-orale d’une technicité<br />
réelle reste l’abord le plus direct mais comporte <strong>des</strong> risques<br />
infectieux importants ; la voie postérieure permet de réaliser, soit<br />
un laçage C1-C2 (technique de Gallie), soit un vissage direct<br />
atloido-axoïdien (technique de Magerl). La voie latérale, rétrosterno-mastoïdienne<br />
(technique de Du Toit) est un vissage direct<br />
<strong>des</strong> masses latéra<strong>les</strong> C1-C2 par un abord bilatéral. Les données<br />
de la littérature retrouvent <strong>des</strong> taux de pseudarthrose élevés dans<br />
<strong>les</strong> techniques de laçage. Les étu<strong>des</strong> biomécaniques révèlent la<br />
supériorité mécanique <strong>des</strong> vissages trans-articulaires et <strong>les</strong> étu<strong>des</strong><br />
cliniques récentes le confirment.<br />
Le but de cette présentation est de décrire une modification de<br />
la technique de Du Toit et <strong>les</strong> résultats d’une court série.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. La modification technique de<br />
l’arthrodèse selon la méthode de Du Toit repose sur le fait<br />
d’abraser la transverse de C1 à son origine, permettant de faire<br />
pénétrer une curette de Cloward et de créer un point d’introduction<br />
stable pour la mèche évitant ainsi, comme dans la technique<br />
traditionnelle, de voir la mèche glisser en avant de la masse<br />
latérale de C1. La vis est dirigée vers C2, strictement dans un plan<br />
frontal, son obliquité dépend du débattement laissé par la mastoïde.<br />
La mèche doit traverser deux cortica<strong>les</strong> correspondant à la<br />
facette articulaire inférieure de C1 et à la supérieure de C2. Les<br />
vis doivent se croiser dans un plan coronal juste sous l’odontoïde.<br />
L’avivement et la mise en place de greffons complètent la fusion<br />
<strong>des</strong> masses latéra<strong>les</strong> C1-C2.<br />
Notre expérience repose sur 4 cas d’arthrodèse C1-C2 avec la<br />
technique de Du Toit modifiée : une polyarthrite rhumatoïde, une<br />
fracture de l’odontoïde, un os odontoïdome et une arthrose isolée.<br />
Dans le cas de l’arthrose, l’indication le fût de première intention<br />
mais pour <strong>les</strong> autres, il s’agit de reprises d’arthrodèses à chaque<br />
fois pour pseudarthrose après laçage.<br />
RÉSULTATS. La durée d’hospitalisation moyenne est de 6<br />
jours, la durée opératoire de 2 heures 10. Les pertes sanguines<br />
moyenne per opératoire sont de 200 ml et post-opératoire de 120<br />
ml. Le suivi opératoire de ces patients n’a pas révélé de pseudarthrose,<br />
ni de défaillance mécanique à un recul moyen de 2,7<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 2S33<br />
ans (1-5 ans). Les complications opératoires sont un saignement<br />
veineux ayant nécessité l’utilisation de clips vasculaires et la<br />
fragilisation d’une masse latérale de C1 consolidée par un cimentage.<br />
On déplore une complication post-opératoire immédiate<br />
neurologique à type d’hypoesthésie de l’hémi-langue régressive.<br />
Ces complications n’ont pas laissé de séquel<strong>les</strong>.<br />
CONCLUSION. L’avantage de cette modification technique<br />
pour le vissage latéral de C1-C2 est une amélioration du point<br />
d’entrée delavisée, permettant ainsi un positionnement optimal<br />
et surtout une stabilisation de la mèche pour réaliser ce vissage<br />
garant d’une bonne tenue mécanique et d’une fusion ultérieure<br />
certaine.<br />
*J.-L. Marmorat, Département d’Orthopédie,<br />
Institut Mutualiste Montsouris, 42, boulevard Jourdan,<br />
75674 Paris Cedex 14.<br />
35 Résultats clinico-radiologiques de<br />
la laminoplastie cervicale chez <strong>les</strong><br />
patients de la myélopathie cervicarthorosique<br />
: à propos de 31 cas<br />
avec un recul moyen de 3,5 ans<br />
I. YUGUE*, K. SHIBA, N.UEZAKI<br />
INTRODUCTION. La laminoplastie cervicale est bien utilisée<br />
comme un traitement <strong>des</strong> myélopathies cervicarthorosiques au<br />
Japon. Le but de ce travaill a été d’évaluer <strong>les</strong> résultats clinicoradiologiques<br />
avec un recul de plus de 2 ans.<br />
MATÉRIEL. Trente et un patients ayant eu une laminoplastie<br />
sur 3 étages ou plus pour myélopathie cervicarthorosique ont été<br />
revus avec un recul moyen de 3,5 ans.<br />
MÉTHODES. La symptomatologie fonctionnelle a étéévaluée<br />
en préopératoire et lors du dernier examen selon le score de<br />
Japanese Orthopaedic Association. Tous <strong>les</strong> patients ont eu <strong>des</strong><br />
radiograhies standards de profil strict, flexion et extension du<br />
rachis cervical, en préopératoire et au dernier recul. La courbure<br />
de profil aété déterminée sur <strong>des</strong> radiographies de profil en<br />
position neutre en mesurant l’angle de Cobb de C2 à C7. Sur <strong>les</strong><br />
radiographies dynamiques, la mobilité globale a été évaluée.<br />
RÉSULTATS. Le score préopératoire moyen était de 9,7, il<br />
était de 13,8 au dernier recul (paired-T, p < 0,0001). Le gain<br />
relatif moyen était de 52,9 %. L’angle préopératoire moyen de<br />
Cobb était de 17 degrés, il était de 8,9° au dernier recul*. Les<br />
mobilités globa<strong>les</strong> moyennes préopératoires étaient de 43,4°,<br />
el<strong>les</strong> étaient de 25,1° au dernier recul*. La courbure du rachis<br />
cervical, <strong>les</strong> mobilités globa<strong>les</strong> n’avaient aucune influence sur le<br />
score au dernier recul. L’angle postopératoire de Cobb n’avait été<br />
influencé que par l’angle préopératoire (p < 0,0001). Il n’y avait<br />
aucun cas de réintervention à cause de déstabilisation.<br />
DISCUSSION. Guigui a montré que la perte moyenne de la<br />
lordose cervicale, dans sa série de laminectomie étendue, était de<br />
14°. Dans notre étude, la perte moyenne de la lordose cervicale<br />
était de 8,1°. La laminoplastie est plus capable de maintenir la<br />
courbure du rachis cervical en lordose que la laminectomie. Il a<br />
aussi montré qu’il avait 3 cas de réintervention due à une
2S34 77 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
déstabilibation après laminectomie. A l’opposé, iln’avait aucun<br />
cas de réintervention dans notre série. Lors de la laminoplastie,<br />
une tranchée est creusée à un quart médial de massif articulaire<br />
pour ouvrir la lame, ce qui cause une arthrodèse imprévue <strong>des</strong><br />
massifs articulaires. Du fait de cette arthrodèse imprévue, la<br />
laminoplastie cause non seulement plus de diminution de la<br />
mobilité globale mais aussi moins de <strong>des</strong>tabilisation rachidienne<br />
que la laminectomie.<br />
CONCLUSION. La laminectomie étendue n’a pas d’avantage<br />
sur la laminoplastie.<br />
*I. Yugue, Service d’Orthopédie, Spinal Injuries Center,<br />
550-4 Igisu Iizuka Fukuoka, Japon.<br />
36 Devenir à long terme <strong>des</strong> étages<br />
adjacents à une arthrodèse cervicale<br />
antérieure<br />
V. POINTILLART*, Y. CARLIER, M.PEDRAM,<br />
P. BACON, O.GILLE, J.-M. VITAL<br />
INTRODUCTION. Les conséquences d’une arthrodèse cervicale<br />
antérieure sur <strong>les</strong> étages adjacents sont une préoccupation<br />
croissante de cette chirurgie. L’évaluation à long terme de ces<br />
patients est indispensable pour comprendre <strong>les</strong> mécanismes mis<br />
en jeu dans la dégradation observée et supporter <strong>les</strong> travaux<br />
entrepris sur <strong>les</strong> matériels conservant la mobilité de l’étage<br />
discal.<br />
MATÉRIEL. Trois cents patients opérés d’une arthrodèse cervicale,<br />
revus en 1996 à 40 mois de leur intervention ont été<br />
reconvoqués. Ils ont été examinés sur le plan clinique, radiologique<br />
(clichés dynamiques) et la douleur cervicale et radiculaire<br />
ont été mesurées sur une échelle visuelle analogique.<br />
MÉTHODES. La procédure complète a été réalisée chez 136<br />
patients et partiellement chez 34. 22 n’ont accepté que de répondre<br />
par téléphone. Les résultats cliniques dans ces 3 groupes ne<br />
sont pas différents et la moyenne <strong>des</strong> scores en 1996 dans ces 3<br />
groupes étaient dans la moyenne générale. 8 patients étaient<br />
décédés.<br />
RÉSULTATS. Les patients ont été séparés en 3 groupes en<br />
fonction de leur pathologie pré opératoire. Le recul moyen était<br />
de 102,5 mois (84 à 180).<br />
Traumatismes : Parmi <strong>les</strong> 42 patients revus, la détérioration de<br />
l’étage sous-jacent augmentait de 21 % en 1996 à 69 % en 2001.<br />
La détérioration de l’étage sous-jacent augmentait de 26 % à<br />
47.6 %. La douleur cervicale restait modérée (20/100 en 1996,<br />
27/100 en 2001).<br />
Rachis dégénératif (compression radiculaire nécessitant une<br />
dissectomie simple ou avec arthrodèse ou une corporectomie un<br />
étage) : Parmi <strong>les</strong> 42 patients revus, la détérioration de l’étage<br />
sous-jacent augmentait de 57 % en 1996 à 89 % en 2001. La<br />
détérioration de l’étage sous-jacent augmentait de 22 % à 41 %.<br />
La douleur cervicale passait de 14/100 en 1996 à 41/100 en 2001.<br />
Myélopathies : Parmi <strong>les</strong> 52 patients revus, la détérioration de<br />
l’étage sous-jacent augmentait de 54 % en 1996 à 81 % en 2001<br />
lorsqu’il y avait eu une ou deux corpectomies et de 40 % à 70 %<br />
au delà de deux corpectomies. La détérioration de l’étage sousjacent<br />
augmentait de 26 % à 50 %. La douleur cervicale restait<br />
modérée (18/100 en 1996, 23/100 en 2001).<br />
CONCLUSION. Bien qu’il ne soit pas possible d’avoir une<br />
étude statistique fiable du fait <strong>des</strong> petits nombres et <strong>des</strong> patients<br />
perdus de vue, ces résultats confirment que l’arthrodèse cervicale<br />
accélère la dégradation <strong>des</strong> étages adjacents. L’allongement du<br />
suivi permet d’observer un rattrapage <strong>des</strong> groupes dégénératifs<br />
par le groupe traumatologie.<br />
L’usage de matériels maintenant la mobilité devrait permettre<br />
de différencier ce qui revient au processus dégénératif et ce qui est<br />
induit par l’arthrodèse.<br />
*V. Pointillart, Unité de Pathologie Rachidienne,<br />
Hôpital Pellegrin, place Amélie-Raba-Léon,<br />
33076 Bordeaux Cedex.<br />
37 Embolie pulmonaire au décours de<br />
l’instrumentation dans la chirurgie<br />
du rachis : étude prospective par<br />
échocardiographie transœsophagienne<br />
S. TAKAHASHI*, H. KITAGAWA, T.ISHII,<br />
M. FUJIWARA, J.DELÉCRIN<br />
INTRODUCTION. L’embolie graisseuse ou de moelle peropératoire<br />
au décours de la chirurgie osseuse et articulaire représente<br />
une complication majeure. Nous avons voulu évaluer<br />
l’incidence et <strong>les</strong> circonstances de survenue <strong>des</strong> embolies peropératoires<br />
chez <strong>des</strong> patients opérés au niveau lombaire avec et<br />
sans instrumentation.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Soixante patients adultes souffrant<br />
d’une pathologie lombaire dégénérative ont été explorés par<br />
échocardiographie transoesophagienne peropératoire au décours<br />
d’une chirurgie lombaire postérieure. Dans 40 cas le geste opératoire<br />
comprenait la mise en place d’une instrumentation avec<br />
vis pédiculaires.<br />
RÉSULTATS. Des manifestations de type emboligue, modérées<br />
et sévères (grade 2 et 3 selon la classification de Pitto), ont<br />
été observées chez 80 % <strong>des</strong> patients instrumentés mais dans<br />
aucun cas chez <strong>les</strong> non instrumentés (p< 0,001).<br />
DISCUSSION. Parmis <strong>les</strong> différents gestes de la chirurgie<br />
lombaire postérieure, la mise en place <strong>des</strong> vis pédiculaires est<br />
apparue comme la grande pourvoyeuse d’embolies pulmonaires.<br />
En opposition l’abord, la laminectomie, la discectomie et l’avivement<br />
osseux ne semblent pas avoir produit d’embolie détectable.<br />
CONCLUSION. Nous considérons que, comme dans <strong>les</strong><br />
arthroplasties et <strong>les</strong> fixations intramedullaires, ces manifestations<br />
emboliques peuvent être potentiellement fata<strong>les</strong> au décours de la<br />
chirurgie du rachis.<br />
*S. Takahashi, Department Orthopaedic,<br />
Shiga University Medical Sciences, Seta-Tsuhinowa-Cho,<br />
Ohtau Shi Shiga 520-2192, Japon.
38 Ostéotomies lombaires de soustraction<br />
par voie postérieure dans<br />
<strong>les</strong> déformations majeures du<br />
rachis : conséquences sur l’équilibre<br />
sagittal<br />
J.-Y. LAZENNEC*, N. ARAFATI, N.CHARLOT,<br />
G. SAILLANT<br />
INTRODUCTION. La correction <strong>des</strong> cyphoses par spondylarthrite<br />
ankylosante est une indication classique <strong>des</strong> ostéotomies<br />
monosegmentaires de type « wedge ». L’intérêt de cette technique<br />
est analysé pour d’autres indications (reprises chirurgica<strong>les</strong><br />
pour dos plat et cals vicieux du rachis lombaire) en étudiant<br />
l’équilibre sagittal global du rachis et la position du bassin.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. De 1980 à 1999, nous avons<br />
retenus 68 patients pour leur évaluation clinique et radiologique<br />
complètes (37 cas de spondylarthrite ankylosante et 31 cas de dos<br />
plat « post opératoire » dont 9 post traumatiques et 22 rachis<br />
dégénératifs).<br />
Une ostéotomie d’ouverture a été réalisée chez <strong>les</strong> 19 premiers<br />
patients et une fermeture pour <strong>les</strong> 49 suivants. Le niveau de<br />
correction a été choisi 26 fois au <strong>des</strong>sus de L2L3 et 42 fois au<br />
<strong>des</strong>sous.<br />
De grands clichésdeprofil numérisés ont permis de mesurer au<br />
recul minimum de 3 ans :<br />
− le déport postérieur en T9 (entre la verticale et la droite<br />
joignant le centre géométrique de T9 et le centre <strong>des</strong> têtes<br />
fémora<strong>les</strong> : normale 11° ± 5°),<br />
− la bascule du sacrum (entre l’horizontale et la tangente au<br />
plateau sacré : normale 41° ± 5°).<br />
RÉSULTATS ET DISCUSSION. Globalement l’angle local<br />
de correction a été de 44° et la correction du déport en T9 de<br />
30,6°.<br />
Dans <strong>les</strong> ostéotomies basses, la correction locale a été de 49° et<br />
le changement de déport en T9 de +28° (-2° à+26°). La bascule<br />
sacrée a varié de 6° à 18°. Dans <strong>les</strong> ostéotomies hautes, la<br />
correction locale a été de 36,6°, et le changement de déport en T9<br />
de 35° (–12° à+23°). La bascule sacrée a varié de 4° à7°.<br />
Plus l’ostéotomie est basse, plus la correction influence la<br />
position du bassin. Quel que soit le niveau d’ostéotomie, le<br />
déport en T9 se stabilise entre 12° et +26° (moyenne 19°), bien<br />
que l’angle de correction locale par l’ostéotomie soit plus important<br />
(jusqu’à 60°). Cette discordance est expliquée par l’adaptation<br />
du bassin.<br />
Chez 7 patients, une cyphose fonctionnelle secondaire s’est<br />
développée (limitation <strong>des</strong> amplitu<strong>des</strong> articulaires <strong>des</strong> hanches<br />
empêchant l’adaptation nécessaire à la correction globale de<br />
l’équilibre sagittal).<br />
CONCLUSION. Les ostéotomies rachidiennes monosegmentaires<br />
restent techniquement diffici<strong>les</strong> mais offrent <strong>des</strong> possibilités<br />
de correction très importantes, affectant la position du tronc et<br />
l’adaptation du bassin.<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 2S35<br />
Le choix du niveau opéré est essentiel car il conditionne<br />
l’ajustement final et <strong>les</strong> conséquences fonctionnel<strong>les</strong> sur le secteur<br />
sous pelvien.<br />
*J.-Y. Lazennec, Service de Chirurgie Orthopédique,<br />
Hôpital Pitié-Salpêtrière, 47-83, boulevard de l’Hôpital,<br />
75651 Paris Cedex 13.<br />
39 Particularités diagnostiques <strong>des</strong><br />
fractures récentes de « l’os rachidien<br />
» <strong>des</strong> spondylarthrites ankylosantes<br />
et de l’hyperostose<br />
F. DE PERETTI*, J.-C. SANE, G.DRAN,<br />
C. RAZAFINDRATSIVA<br />
INTRODUCTION. La spondylarthrite ankylosante (S.P.A.) et<br />
l’hyperostose vertébrale de Forestier transforment la colonne<br />
vertébrale en segments osseux fusionnés. Les vertèbres fusionnées<br />
peuvent être comparées à un « os rachidien » dont la pathologie<br />
traumatique n’est pas comparable à celle du rachis mobile.<br />
Le but de notre travail est de préciser <strong>les</strong> particularités cliniques<br />
et iconographiques afin d’en diminuer le délai de diagnostic. Le<br />
but de ce travail rétrospectif est de préciser <strong>les</strong> modalités cliniques<br />
et iconographiques.<br />
PATIENTS – RÉSULTATS. Quarante-huit fractures ont été<br />
observées en 17 ans par un praticien. Vingt b<strong>les</strong>sés d’âge moyen<br />
62 ans avaient une S.P.A., 28 b<strong>les</strong>sésd’âge moyen 81 ans avaient<br />
une hyperostose. Il n’y avait que <strong>des</strong> hommes. Vingt-cinq chutes<br />
de « sa hauteur », 11 accidents de la voie publique, 6 accidents<br />
sportifs (tous S.P.A.) furent dénombrés. Six patients n’alléguaient<br />
aucun traumatisme certain. Seize fractures furent diagnostiquées<br />
aprèsundélai compris entre 1 et 28 jours. Quarantequatre<br />
b<strong>les</strong>sés présentèrent <strong>des</strong> lésions médullaires dont 16<br />
secondairement. Quatre types de fracture furent identifiés:<br />
− type I = par ouverture antérieure : 30 cas,<br />
− type II = fracture en « trait de scie » : 4 cas,<br />
− type III = fracture en « trait de lime » : 8 cas,<br />
− type IV = fractures comparab<strong>les</strong> aux autres fractures de la<br />
colonne vertébrale : 6 cas.<br />
Les fractures diagnostiquées tardivement furent 4 fractures par<br />
ouverture antérieure, 8 en « trait de lime » et4en« trait de scie ».<br />
Le scanner fut demandé chaque fois et l’IRM 30 fois. Trois<br />
hématomes extra duraux spinaux compressifs furent diagnostiqués.<br />
Trente deux patients décédèrent, 31 fois par complication<br />
de décubitus chez <strong>des</strong> b<strong>les</strong>sés médullaires et 1 fois par rupture<br />
d’un anévrysme de l’aorte.<br />
DISCUSSION. Nous désirons insister sur :<br />
La présence de fracture sans traumatisme important.<br />
Le retard diagnostic. Les fractures non diagnostiquées se compliquent<br />
secondairement de troub<strong>les</strong> neurologiques ou de pseudarthrose.<br />
L’impossibilité de faire le diagnostic <strong>des</strong> fractures en « trait de<br />
lime » grâce aux radiographies standards, ceci nous amène<br />
actuellement à demander systématiquement un scanner et/ou une<br />
IRM pour tout patient présentant un rachis ankylosé, douloureux,
2S36 77 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
même si la radiographie standard ne montre pas de fracture.<br />
La gravité neurologique et la présence d’hématomes extra<br />
duraux.<br />
L’importance de la mortalité chez ces sujets fragi<strong>les</strong>.<br />
La connaissance de ces lésions rares de la colonne vertébrale<br />
devrait permettre d’en améliorer le diagnostic et le pronostic.<br />
*F. de Peretti, Service de Chirurgie Orthopédique<br />
et Traumatologique, Hôpital Saint-Roch,<br />
5, rue Pierre-Dévoluy, 06000 Nice.<br />
40 Traitement orthopédique <strong>des</strong> fractures<br />
thoraco-lombaires par réduction<br />
et immobilisation selon Boëhler :<br />
revue d’une série continue unicentrique<br />
de 150 cas à un an de recul<br />
minimum<br />
J.-L. POLARD*, W. DAOUD, J.-M. HAMON,<br />
L. MONTRON, G.KERHOUSSE, J.-L. HUSSON<br />
INTRODUCTION. Ce travail rapporte l’évolution clinique et<br />
radiologique d’une série continue de 194 patients traités de<br />
fracture de la charnière thoraco-lombaire au sein d’une même<br />
équipe de 1996 à 2001. La thérapeutique appliquée était la<br />
méthode de réduction sur cadre de Cotrel et immobilisation par<br />
corset selon le principe de Boëhler.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Il s’agissait de 65 femmes et<br />
129 hommes de 16 à 77 ans. Le recul minimal imposéétait de un<br />
an pour autoriser une inclusion à l’étude. Ainsi plus de 85 % <strong>des</strong><br />
dossiers de départ ont été revus et l’étude concerne en définitive<br />
150 patients recontactés.<br />
Tous <strong>les</strong> patients étaient classés Frankel E. L’analyse <strong>des</strong><br />
radiographies pré-opératoires utilisait la méthode de recherche du<br />
mécanisme physiopathologique selon Rosset et Laulan, ainsi que<br />
la classification internationale de Magerl conformément aux<br />
données du Symposium de la SOFCOT 1995. L’étude radiographique<br />
portait sur <strong>les</strong> radiographies initia<strong>les</strong>, post-réductionnel<strong>les</strong><br />
immédiates, à un mois, trois mois et au dernier recul.<br />
Etait analysée l’évolution de la cyphose vertébrale, de l’angulation<br />
régionale traumatique et celle du disque sous-jacent à la<br />
fracture.<br />
Parallèlement à la série globale, <strong>les</strong> cas représentant <strong>les</strong> limites<br />
<strong>des</strong> indications thérapeutiques selon <strong>les</strong> valeurs de cyphose locale<br />
et d’angulation régionale traumatique initia<strong>les</strong>, ont été étudiées.<br />
RÉSULTATS. Pour l’indication initiale de choix que représentaient<br />
<strong>les</strong> fractures de type A1, on a obtenu un faible gain de<br />
réduction et le traitement a été jugé contraignant.<br />
Concernant <strong>les</strong> fractures de type A3, le recul du mur postérieur<br />
ne représentait pas une contre-indication à la méthode du fait <strong>des</strong><br />
possibilités de ligamentotaxis permettant la réduction du coin<br />
postéro-supérieur dans la majorité <strong>des</strong> cas. Le gain de correction<br />
sur la cyphose vertébrale était dans ces cas le plus important.<br />
Néanmoins, sur ce type de fracture, une cyphose vertébrale<br />
supérieure à 15° rendait compte implicitement d’une potentielle<br />
lésion de distraction postérieure pour laquelle l’ostéosynthèse<br />
pouvait se discuter, ce d’autant que <strong>les</strong> montages réalisés parallèlement<br />
utilisaient <strong>les</strong> systèmes de fixateur interne type USS et<br />
autorisaient <strong>des</strong> montages courts.<br />
CONCLUSION. La méthode de Boëhler par son innocuité et<br />
par le gain de réduction sur la cyphose vertébrale de 30 % au<br />
dernier recul constitue une méthode peu invasive et peu coûteuse,<br />
restant d’actualité dans le traitement <strong>des</strong> fractures de la charnière<br />
thoraco-lombaire de type A.<br />
*J.-L. Polard, Service d’Orthopédie-Traumatologie A,<br />
CHU Hôtel Dieu, 2, rue de l’Hôtel-Dieu,<br />
35064 Rennes Cedex.<br />
41 Etude anatomique de faisabilité<br />
d’une fixation lombo-sacrée antérieure<br />
par une plaque : résultats<br />
préliminaires de 15 patients<br />
J.-C. LE HUEC*, C. DICKMAN, M.LIU,<br />
J. MAGENDIE<br />
Les arthrodèses L5 S1 par cages seu<strong>les</strong> restent controversées<br />
du fait de la faib<strong>les</strong>se de stabilisation du rachis en extension et en<br />
rotation axiale. Une fixation complémentaire apparaît nécessaire<br />
pour améliorer la stabilité, mais la présence de la bifurcation <strong>des</strong><br />
gros vaisseaux est une limite anatomique. Nous avons effectué<br />
une étude anatomique pour évaluer la possibilité de mise en place<br />
d’une plaque d’ostéosynthèse antérieure.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Selon <strong>les</strong> références anatomiques<br />
reconnues (Rouvière, Bouchet et Cuilleret, Louis), une zone<br />
de sécurité de 33 mm au niveau de la bifurcation aorto-iliaque et<br />
ilio-cave a été définie. C’est un espace libre de contact avec <strong>les</strong><br />
gros vaisseaux en regard du disque L5 S1. Une évaluation angio<br />
IRM pré-opératoire a été utilisée pour apprécier la taille de cette<br />
zone de sécurité. Une plaque antérieure triangulaire a été <strong>des</strong>sinée<br />
pour effectuer une arthrodèse dans cette zone de bifurcation<br />
(Pyramid Sofamor Danek, USA). 15 patients consécutifs ont eu<br />
une arthrodèse L5 S1 en utilisant cette plaque avec un suivi de 1<br />
an. Tous <strong>les</strong> patients ont bénéficié d’une approche rétropéritonéale<br />
antérieure vidéo assistée. Le score de Prolo et le score<br />
Oswestry ont été utilisés pour le suivi préopératoire et jusqu’à la<br />
dernière visite.<br />
RÉSULTATS. Selon l’étude anatomique et <strong>les</strong> examens IRM,<br />
89 % <strong>des</strong> patients avaient une zone de sécurité suffisante pour<br />
placer la plaque d’ostéosynthèse. 2 patients ont été récusés pour<br />
bifurcation trop basse. L ’angio-IRM a été un examen simple et<br />
reproductible. Les résultats de l’analyse IRM ont été retrouvés<br />
lors <strong>des</strong> interventions (aucun faux négatifs). La plaque a été<br />
implanté chez <strong>les</strong> 15 patients sans contact avec <strong>les</strong> vaisseaux. Il<br />
n’y a pas eu de complication majeure : vasculaire, neurologique,<br />
urologique ou digestive. Le score de Prolo économique a été<br />
amélioré de 2,7 à 4,2 et le score fonctionnel de 2,6 à 4,3. Le score<br />
de Oswestry a été amélioré de 33 %. Le taux de succès clinique<br />
est de 93 % (14 patients sur 15).<br />
DISCUSSION – CONCLUSION. La mise en place d’une plaque<br />
d’ostéosynthèse antérieure L5 S1 est faisable. Les points<br />
clefs sont : 1) l’évaluation préopératoire rigoureuse de la bifurcation<br />
<strong>des</strong> gros vaisseaux 2) un implant de forme anatomique
3) une technique chirurgicale appropriée. Le risque d’éjaculation<br />
rétrograde lié à la rétraction du plexus hypogastrique est à<br />
déterminer par une étude prospective. Cette ostéosynthèse permet<br />
d’éviter un second geste postérieur de fixation par vissage<br />
pédiculaire ou trans-facettaire.<br />
*J.-C. Le Huec, Laboratoire Deterca, Université Bordeaux 2,<br />
126, rue Léo-Saignat, 33076 Bordeaux.<br />
42 Ejaculation rétrograde après arthrodèse<br />
lombaire antérieure L5 S1 :<br />
étude prospective comparant voies<br />
transpéritonéale et rétropéritonéale<br />
R. SASSO*, J.-C. LE HUEC, C.SHAFFREY,<br />
F. PAIN<br />
L’éjaculation rétrograde lors <strong>des</strong> abords antérieurs pour arthrodèse<br />
intersomatique L5 S1 est l’une <strong>des</strong> complications redoutées<br />
chez le sujet masculin jeune. Ce risque est lié àla <strong>des</strong>truction du<br />
plexus hypogastrique durant l’exposition de la charnière lombosacrée.<br />
Le taux de complications rapporté dans la littérature varie<br />
entre 0,42 et 5,9 %. Le sujet de cette étude est de comparer<br />
l’incidence de l’éjaculation rétrograde dans une étude prospective<br />
sur deux groupes de patients pour <strong>les</strong>quels l’abord est réalisé<br />
par voie trans ou rétropéritonéale.<br />
43 La prothèse d’épaule Aequalis dans<br />
<strong>les</strong> omarthroses avec rupture massive<br />
de la coiffe<br />
D. OUDET*, L. FAVARD, S.LAUTMANN,<br />
F. SIRVEAUX, J.-C. SCHAEFFER, D.HUGUET,<br />
G. WALCH<br />
INTRODUCTION. Le but de cette étude multicentrique était<br />
de rapporter <strong>les</strong> résultats de la prothèse Aequalis, humérale<br />
simple ou totale, à deux ans de recul minimum, dans le traitement<br />
de l’omarthrose avec rupture massive de coiffe non réparable.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Soixante-huit arthroplasties<br />
Aequalis posées entre 1992 et 1998 ont été analysées pour cette<br />
étude. El<strong>les</strong> ont été étudiées cliniquement par le score de Constant<br />
et radiologiquement. Il y avait 78 % de femmes, d’âge<br />
moyen 72 ans. Ont été implantées 62 hémi-arthroplasties et 6<br />
prothèses tota<strong>les</strong>, par voie delto-pectorale dans 63 cas et 5 fois<br />
par voie supérieure. Toutes <strong>les</strong> tiges et <strong>les</strong> glènes ont été scellées.<br />
Aucune complication neurologique ou infectieuse n’a été notée.<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 2S37<br />
Séance du 13 novembre matin<br />
ÉPAULE<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Cent quarante six sujets masculins<br />
ont été opérés de la charnière lombo-sacrée pour arthrodèse.<br />
116 patients (groupe A) ont été opérés par approche rétropéritonéale<br />
vidéo assistée et 30 patients (groupe B) ont bénéficié<br />
d’une approche transpéritonéale vidéo assistée. A chaque intervalle<br />
pré-opératoire puis post-opératoire à 3 mois, 6 mois, un an<br />
et deux ans, tous <strong>les</strong> patients ont été interrogés sur l’existence ou<br />
non d’une éjaculation rétrograde.<br />
RÉSULTATS. Sur <strong>les</strong> 146 patients, 6 avaient une éjaculation<br />
rétrograde lors du contrôle à 3 mois. 2 sont survenues dans le<br />
groupe A d’approche rétropéritonéale (1,72 %). Les 4 autres<br />
patients appartenaient au groupe B d’approche transpéritonéale<br />
(13,35 %). Cette différence est statistiquement significative en<br />
utilisant le test de Fisher (p = 0,0015). 2 <strong>des</strong> 6 patients ont eu une<br />
évolution régressive lors du suivi à 1an:l’un dans le groupe A et<br />
l’autre dans le groupe B. Au terme de l’étude, à deux ans de suivi<br />
post-opératoire, 4 patients avaient une éjaculation rétrograde<br />
permanente : un dans le groupe A (0,86 %) et 3 dans le groupe B<br />
(10%).Ladifférence est significative sur le plan statistique en<br />
utilisant le test de Fisher (p = 0,025).<br />
DISCUSSION. La présente étude est la seule à notre connaissance<br />
proposant une évaluation prospective du taux d’éjaculation<br />
rétrograde dans une cohorte de patients opérés par approche<br />
antérieure pour arthrodèse L5 S1. Les patients bénéficiant d’une<br />
approche transpéritonéale ont un risque statistiquement plus<br />
élevé d’avoir une éjaculation rétrograde en comparaison au<br />
groupe d’approche rétropéritonéale (10 %, versus 0,86 %).<br />
*R. Sasso, Unité Colonne Vertébrale,<br />
CHU Pellegrin, 33076 Bordeaux.<br />
RÉSULTATS. Deux hémi-arthroplasties ont été <strong>des</strong> échecs et<br />
ont été reprises par prothèse de Grammont. Une réintervention<br />
pour arthrolyse avec implant conservé a donné un résultat moyen.<br />
Sur le plan fonctionnel : 66 prothèses ont donc été revues avec<br />
un recul moyen de 45 mois. Dans tous <strong>les</strong> cas sauf un, l’intervention<br />
était faite dans un but antalgique. Le score de Constant<br />
absolu a progressé de 20 points (25-46) avec un gain sur la<br />
douleur de 7 points (3-10), l’élévation active a gagné 20°, la<br />
rotation externe coude au corps 18°, la force n’a gagné que 0,4<br />
points. Les prothèses tota<strong>les</strong> ont un gain sur la douleur significativement<br />
plus élevé. 5 patients seulement se disent déçus même si<br />
18 gardent <strong>des</strong> douleurs significatives. Les résultats sur le score<br />
de Constant et <strong>les</strong> mobilités ont été analysés notamment en<br />
fonction du recul, de la taille de la tête humérale et de la<br />
morphologie de la glène en pré-opératoire.<br />
Sur le plan radiologique : Une seule glène et une seule tige<br />
présentent un <strong>des</strong>cellement certain. Par contre, sur 52 dossiers<br />
radiologiques strictement comparab<strong>les</strong>, 33 épau<strong>les</strong> se sont détériorées<br />
soit au niveau de la voûte, soit de la glène, soit <strong>des</strong> deux,<br />
sans retentissement significatif sur le score de Constant.<br />
DISCUSSION. La prothèse non contrainte dans cette indication<br />
est une intervention à«objectifs limités », essentiellement
2S38 77 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
antalgique. Il est préférable de la réaliser par voie delto-pectorale<br />
pour conserver <strong>des</strong> freins à la migration supérieure de l’humérus<br />
dont l’absence explique <strong>les</strong> mauvais résultats constatés dans une<br />
étude parallèle (3 réinterventions sur 9 cas). Contrairement à<br />
d’autres séries, ici le diamètre de la tête n’a pas eu d’influence sur<br />
le Constant. Celui-ci est par contre significativement affecté par<br />
une glène de type E2 (biconcave). Les prothèses tota<strong>les</strong> ont un<br />
score douleur supérieur aux hémiarthroplasties et 4 glènes sur 6<br />
sont encore parfaitement scellées. Ceci ne permet pas toutefois de<br />
<strong>les</strong> conseiller de principe en raison de l’incertitude du scellement<br />
à plus long terme. Le recul ne dégrade pas <strong>les</strong> résultats cliniques<br />
malgré la détérioration de la voûte, de la glène ou <strong>des</strong> deux. Leur<br />
évolution à plus long terme impose néanmoins de poser avec<br />
prudence l’indication d’une prothèse non contrainte et particulièrement<br />
si cette épaule a déjà été opérée au niveau de la voûte ou<br />
si la glène est de type E2. Ces réserves faites, la prothèse<br />
Aequalis, au recul de presque 5 ans, atteint <strong>les</strong> objectifs fixés, à<br />
savoir l’amélioration sensible de la douleur et de la valeur<br />
fonctionnelle globale de l’épaule.<br />
*D. Oudet, Service d’Orthopédie, Clinique Saint-Grégoire,<br />
18, rue Groison, 37100 Tours.<br />
44 Résultats de la prothèse Bipolar<br />
dans le traitement <strong>des</strong> arthroplasties<br />
dégénératives à coiffe détruite :<br />
à propos de 44 cas<br />
S. AUDEBERT*, C. MAYNOU, E.PETROFF,<br />
H. MESTDAGH<br />
INTRODUCTION. Ce travail évaluait <strong>les</strong> résultats à moyen<br />
terme, <strong>des</strong> prothèses d’épaule à cupule mobile, dans le traitement<br />
<strong>des</strong> arthropathies dégénératives à coiffe détruite.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Quarante-quatre prothèses<br />
BIPOLAR étaient évaluées, au recul moyen de 32 mois (13 à 50<br />
mois).<br />
Les résultats étaient appréciés selon la fiche de la S.O.F.C.O.T.<br />
Les caractéristiques morphologiques <strong>des</strong> différentes formes<br />
d’omarthroses à coiffe détruite étaient analysées sur <strong>les</strong> radiographies<br />
standards pour définir <strong>les</strong> conditions anatomiques propices<br />
à ce type d’implant.<br />
RÉSULTATS. Au recul, 86 % <strong>des</strong> épau<strong>les</strong> étaient peu ou pas<br />
douloureuses, l’élévation antérieure active passait de 59,6 °à<br />
82,84 °, la rotation externe en position 1 de 8,86 °à30,68 ° et la<br />
rotation interne de 3,13 points à 5,68 points. Le score de Constant<br />
moyen atteignait 48,96 points (score pondéré = 69,13 %). 77 %<br />
<strong>des</strong> patients étaient satisfaits de l’intervention et avaient repris<br />
leurs activités antérieures. Nous avons déploré 1 luxation antérieure,<br />
sur une épaule à deltoïde paralytique. 3 complications<br />
nécessitaient une réintervention : 1 désassemblage du polyéthylène<br />
de la cupule mobile, 1 conflit entre le tendon du long biceps<br />
et la cupule et 1 conflit antéro-postérieur par utilisation d’une<br />
cupule trop volumineuse. 1 prothèse sans ciment était mobile à<br />
33 mois de recul.<br />
Une latéralisation excessive de l’humérus, une congruence<br />
articulaire médiocre, une atrophie du deltoïde obéraient le résultat<br />
clinique final.<br />
Les meilleurs résultats étaient observés avec <strong>les</strong> formes « centrées<br />
» d’omarthrose à coiffe détruite. La conservation d’un<br />
centrage satisfaisant de la cupule assurait l’indolence, une élévation<br />
antérieure moyenne de 112,3° et un score de Constant<br />
pondéré de 90,5 %.<br />
En cas d’omarthrose excentrée débutante, la conservation du<br />
stock osseux glénoïdien altérait la congruence articulaire et<br />
entraînait une latéralisation excessive de l’humérus : 20 % <strong>des</strong><br />
épau<strong>les</strong> restaient douloureuses, l’élévation antérieure atteignait<br />
68° et le score de Constant pondéré 56 %. Les résultats étaient<br />
paradoxalement meilleurs en cas d’omarthrose excentrée sévère.<br />
L’« acétabulisation » de l’épaule préservait la congruence articulaire<br />
et augmentait le bras de levier du deltoïde par médialisation<br />
et abaissement du centre de rotation. L’indolence était alors<br />
acquise dans tous <strong>les</strong> cas, l’élévation antérieure atteignait 86° et<br />
le score de Constant pondéré 78 %.<br />
DISCUSSION. L’arthroplastie bipolaire est efficace dans <strong>les</strong><br />
formes centrées d’omarthrose à coiffe détruite, et représente une<br />
solution de sauvetage dans <strong>les</strong> omarthroses excentrées évoluées,<br />
là où <strong>les</strong> autres types d’implants trouvent leurs limites. Nous<br />
proposons donc un arbre décisionnel basé sur une nouvelle<br />
classification anatomique <strong>des</strong> omarthroses à coiffe détruites.<br />
*S. Audebert, Service d’Orthopédie A, Hôpital Roger-Salengro,<br />
CHRU de Lille, rue du 8 mai 1945, 59037 Lille Cedex.<br />
45 Les prothèses d’épaule après<br />
radiothérapie<br />
A. GODENÈCHE*, L. NOVÉ-JOSSERAND,<br />
L. FAVARD, D.MOLÉ, P.BOILEAU, C.LÉVIGNE,<br />
J. DE BEER, J.-M. POSTEL, G.WALCH<br />
Le but de cette étude était d’analyser <strong>les</strong> résultats <strong>des</strong> prothèses<br />
d’épaule après radiothérapie, de définir une entité radio-clinique<br />
particulière et d’évaluer l’incidence <strong>des</strong> complications.<br />
Quatorze prothèses ont été implantées chez 13 femmes traitées<br />
pour néoplastie mammaire avec radiothérapie complémentaire et<br />
un homme traité poux lymphome Hodgkinien. Le délai entre la<br />
radiothérapie et la chirurgie prothétique était de 16 ans et 7 mois.<br />
2 formes radiologiques préopératoires ont été mises en évidence :<br />
dans 7 cas l’aspect était typique <strong>des</strong> ostéonécroses avasculaires<br />
selon la classification d’Arlet et Ficat alors que dans <strong>les</strong> autres cas<br />
l’aspect radiographique évoquait une arthrite, voire une arthrose.<br />
Il s’agissait de prothèses huméra<strong>les</strong> dans 5 cas et de prothèses<br />
tota<strong>les</strong> dans 9 cas.<br />
Ilyaeu4révisions prothétiques avec explantation de la<br />
prothèse, dont 3 sepsis et 5 patients ont été réopérés. Le score de<br />
Constant postopératoire moyen pour <strong>les</strong> 10 prothèses en place<br />
était de 53.1 points et l’élévation antérieure moyenne de 111°<br />
avec un recul de 3 ans et 7 mois. Le gain sur la douleur était de<br />
8,5 points pour un résultat moyen de 10,9 points. Les résultats<br />
étaient différents selon la forme radiologique initiale, étant moins<br />
bons dans <strong>les</strong> formes typiques d’ostéonécrose.<br />
Cette étude a mis en évidence une entité radioclinique particulière,<br />
indépendante <strong>des</strong> ostéonécroses classiques de la tête<br />
humérale. Le geste chirurgical était plus difficile et <strong>les</strong> résultats
étaient moins bons que dans <strong>les</strong> formes classiques avec un taux<br />
de complications très important.<br />
*A. Godenèche, Clinique Mutualiste, 107, rue Trarieux,<br />
69003 Lyon.<br />
46 Résultats <strong>des</strong> prothèses d’épaule<br />
dans <strong>les</strong> séquel<strong>les</strong> de fracture de<br />
l’humérus proximal avec pseudarthroses<br />
du col chirurgical<br />
O. LÉGER*, C. TROJANI, J.-S. COSTE,<br />
P. BOILEAU, J.-C. LE HUEC, G.WALCH<br />
INTRODUCTION. Les pseudarthroses du col chirurgical de<br />
l’humérus sont la conséquence d’un traitement orthopédique ou<br />
chirurgical inadapté après une fracture déplacée soustubérositaire<br />
ou céphalo-tubérositaire. Le but de cette étude est de<br />
rapporter <strong>les</strong> résultats fonctionnels et radiographiques de leur<br />
traitement par prothèse d’épaule.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Vingt-deux patients, traités par<br />
prothèse d’épaule non contrainte, ont été inclus dans cette étude<br />
rétrospective multicentrique. L’âge moyen était de 70 ans et le<br />
recul moyen était de 45 mois (2 à 9 ans). La fracture initiale était<br />
une fracture sous-tubérositaire à 2 fragments dans 6 cas, une<br />
fracture céphalo-tubérositaire à 3 fragments dans 13 cas et à 4<br />
fragments dans 3 cas. Le traitement initial était orthopédique<br />
dans 10 cas et chirurgical (ostéosynthèse) dans 12 cas. Le délai<br />
moyen fracture-prothèse était de 20 mois. La voie d’abord était<br />
delto-pectorale. 21 hémiarthroplasties étaient réalisées et une<br />
prothèse totale (arthrose gléno-humérale associée). Les tubérosités<br />
étaient ostéosynthésées autour de la tige humérale scellée et<br />
<strong>des</strong> greffons osseux étaient disposés en couronne au niveau de la<br />
pseudarthrose du col chirurgical. Tous <strong>les</strong> patients ont été revus<br />
avec un recul minimum de 2 ans et évalués selon le sore de<br />
Constant et un bilan radiographique.<br />
RÉSULTATS. Le score de Constant absolu passait de 23 en<br />
pré-opératoire à 39 en post-opératoire (élévation antérieure de<br />
53° à63°). Seu<strong>les</strong> la douleur (de 3 à 9 ; p = 0,001) et la rotation<br />
externe (de 13° à28° ; p = 0,01) étaient significativement améliorés.<br />
45 % <strong>des</strong> patients étaient satisfaits et 55 % déçus. Le type<br />
de traitement initial, le type de fracture initiale et le délai avant<br />
l’implantation de la prothèse n’avaient pas d’influence sur le<br />
résultat final. Le taux de complications était de 36 % (8 cas),<br />
engendrant 5 reprises opératoires. L’analyse radiographique<br />
retrouvait 6 pseudarthroses persistantes du trochiter, deux migrations<br />
proxima<strong>les</strong> de la prothèse et un <strong>des</strong>cellement humeral.<br />
CONCLUSION. Les résultats <strong>des</strong> prothèses d’épaule pour<br />
séquel<strong>les</strong> de fracture de l’humérus proximal avec pseudarthrose<br />
du col chirurgical sont mauvais. Il n’existe aucun bénéfice pour<br />
l’élévation antérieure, la force et l’activité. L’indication de prothèse<br />
d’épaule pour séquelle de fracture de l’humérus proximal<br />
avec pseudarthrose du col chirurgical doit être considérée comme<br />
une « prothèse à but limité»,n’apportant qu’un bénéfice sur la<br />
douleur.<br />
*O. Léger, Service de Chirurgie Orthopédique,<br />
Centre Hospitalier de la Côte Basque, avenue Jacques-Loëb,<br />
64100 Bayonne.<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 2S39<br />
47 Prothèse humérale pour fracture et<br />
complication tubérositaire<br />
J.-S. COSTE*, C. TROJANI, P.-M. AHRENS,<br />
P. BOILEAU<br />
INTRODUCTION. La consolidation <strong>des</strong> tubérosités est la clef<br />
de la réussite d’une prothèse d’épaule implantée pour fracture. Le<br />
but de cette étude est d’évaluer le nombre et <strong>les</strong> causes <strong>des</strong><br />
complications tubérositaires afin d’apporter <strong>des</strong> solutions à ce<br />
problème.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Dans le cadre d’une étude<br />
rétrospective, multicentrique, 334 prothèses d’épaule implantées<br />
pour fracture entre 1991 et 2000 ont pu être revu. 2 différentes<br />
prothèses furent utilisées : 300 prothèses Aequalis standard entre<br />
1991 et 1997 (4 ans de recul moyen) et 31 prothèses Aequalis<br />
Fracture entre 1999 et 2000 (9 mois de recul moyen). Les<br />
résultats radiologiques ont été évalués en post-opératoire immédiat<br />
et lors de la dernière révision. Les résultats cliniques ont été<br />
évalués selon le score de Constant.<br />
RÉSULTATS. Le score de Constant pour <strong>les</strong> 300 prothèses<br />
Standard et de 54 points avec une EAA à 104°. Pour <strong>les</strong> 31<br />
prothèses Fracture 58 points au Constant et 114° EAA. 49 % <strong>des</strong><br />
résultats radiologiques post-opératoire sont jugés moyen ou mauvais<br />
par l’opérateur et objectivement 35 % <strong>des</strong> tubérosités sont<br />
mal positionnées avec la prothèse Standard et 22 % avec la<br />
prothèse Fracture. 26 % <strong>des</strong> tubérosités bien ou mal positionnées<br />
migrent secondairement avec la prothèse Standard et 10 % avec<br />
la prothèse Fracture. Les facteurs pronostiques statistiquement<br />
significatifs limitant <strong>les</strong> complications tubérositaires sont : une<br />
ostéosynthèse initiale satisfaisante avec un respect de la hauteur<br />
et de la rétroversion prothétique facilité par l’utilisation de<br />
l’ancillaire fracture, une rééducation dans un centre spécialisé,<br />
une immobilisation relative durant le 1 er mois post-opératoire<br />
limitant la rééducation au travail pendulaire, ce qui diminue par 2<br />
le nombre de migrations secondaires par rapport aux patients<br />
mobilisés immédiatement (14 % contre 27 %).<br />
DISCUSSION. L’analyse précise <strong>des</strong> radiographies nous permet<br />
de retrouver un taux très important (50 %) de complications<br />
sur <strong>les</strong> tubérosités, complication peu étudiée ettrès sous-estimée<br />
dans la littérature. La prothèse Aequalis Fracture permet de<br />
diminuer par 2 <strong>les</strong> complications tubérositaires. L’immobilisation<br />
post-opératoire diminue par 2 <strong>les</strong> migrations tubérositaires et<br />
cette constatation va à l’encontre de la « early passive motion »<br />
prônée par Neer. Enfin la qualité de l’ostéosynthèse <strong>des</strong> tubérosités<br />
est primordiale et c’est principalement sur ce temps que le<br />
chirurgien doit se concentrer en s’appuyant sur une prothèse<br />
parfaitement positionnée et une radiographie de contrôle per<br />
opératoire.<br />
*J.-S. Coste, Service de Chirurgie Orthopédique,<br />
Hôpital de l’Archet II, 151,<br />
route de Saint-Antoine-de-Ginestière, 06200 Nice.
2S40 77 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
48 Omarthrose excentrée : analyse<br />
comparative <strong>des</strong> résultats à moyen<br />
terme <strong>des</strong> prothèses huméra<strong>les</strong><br />
simp<strong>les</strong> et de la prothèse de Grammont<br />
P. SAUZIÈRES*, P. VALENTI, R.COSTA,<br />
N. LEFEVRE<br />
Le traitement chirurgical prothétique de l’omarthrose excentrée(OE)s’est<br />
limité longtemps aux prothèses huméra<strong>les</strong> simp<strong>les</strong><br />
(PHS). La prothèse totale inversée (PTI) de Grammont semble<br />
apporter un bénéfice réel.<br />
Quels sont <strong>les</strong> résultats comparés ? La prothèse de Grammont<br />
est elle le traitement univoque ?<br />
Les prothèses huméra<strong>les</strong> simp<strong>les</strong> gardent el<strong>les</strong> <strong>des</strong> indications<br />
spécifiques ?<br />
Pour répondre à ces questions, nous avons revu 84 patients<br />
opérés entre 1986 et 2000 dont 52 PHS avec un recul moyen de<br />
7,1 ans, et 32 PTI avec un recul moyen de 4,3 ans.<br />
De 1986 à 1995 toute OE a été traitée defaçon univoque par<br />
prothèse humérale simple (36 cas). De 1995 à 2000 l’omarthrose<br />
excentréeaété traitée soit par PTI, soit par PHS (16 cas). Pour <strong>les</strong><br />
PTI, <strong>les</strong> indications se limitaient aux OE dont <strong>les</strong> patients étaient<br />
âgés de plus de 70 ans, avec un tableau d’épaule pseudoparalytique<br />
douloureuse, ou aux contre-indications <strong>des</strong> PHS<br />
(altération de la voûte acromio-coracoïdienne, du sousscapulaire...).<br />
Les PHS ont été réalisées soit du fait de l’impossibilité<br />
de mettre une PTI (âge trop jeune, glène trop détériorée,<br />
insuffisance deltoïdienne), soit par indication préférentielle<br />
(omarthrose excentrée du sujet jeune < 65 ans, conservation de la<br />
mobilité active, glène type 1 ou 2 de Favard...).<br />
1) Résultats de la série <strong>des</strong> PHS (1986 → 1995).<br />
Constant pré-opératoire = 16,4 Constant post-opératoire =<br />
48,6.<br />
Résultats radiologiques ; 1 <strong>des</strong>cellement humeral, 3 migrations<br />
supérieures, 3 détériorations glénoïdiennes.<br />
Reprises chirurgica<strong>les</strong> = 3.<br />
2) Résultats <strong>des</strong> PTI.<br />
Constant pré-opératoire = 14,2 Constant post-opératoire =<br />
61,6.<br />
Résultats radiologiques ; 1 <strong>des</strong>cellement humeral, 32 % d’altérations<br />
glénoïdiennes sta<strong>des</strong> 3 et 4 de Nérot.<br />
Reprise chirurgicale = 1.<br />
3) Résultats <strong>des</strong> PHS (1995 → 2000).<br />
Constant pré-opératoire = 18,2 Constant post-opératoire = 56,4<br />
(60,2 en éliminant <strong>les</strong> PHS liées aux contre indications <strong>des</strong> PTI).<br />
Résultats radiologiques ; 1 migration supérieure, 2 détériorations<br />
glénoïdiennes.<br />
A indication univoque, <strong>les</strong> résultats <strong>des</strong> PTI sont supérieurs<br />
aux PHS (p < 0,001). Toutefois, en dehors <strong>des</strong> indications de<br />
sauvetage ou <strong>les</strong> PTI ne peuvent être utilisées, <strong>les</strong> PHS utilisées<br />
de principe dans <strong>des</strong> indications précises donnent <strong>des</strong> résultats<br />
pratiquement équivalents aux PTI (p < 0,05), avec moins d’interrogation<br />
sur le futur. PTI et PHS se partagent donc pour nous <strong>les</strong><br />
indications du traitement chirurgical de l’omarthrose excentrée.<br />
*P. Sauzières, Clinique Jouvenet, 6, square Jouvenet,<br />
75016 Paris.<br />
49 Omarthroses excentrées : hémiarthroplasties<br />
versus prothèses<br />
inversées. Résultats à moyen<br />
terme<br />
L. FAVARD*, F. SIRVEAUX, D.OUDET,<br />
D. HUGUET, D.MOLÉ<br />
INTRODUCTION. Le but de ce travail a été de comparer le<br />
résultat <strong>des</strong> hemiarthroplasties et celui <strong>des</strong> prothèses inversées<br />
dans le traitement <strong>des</strong> omarthroses excentrées.<br />
MATÉRIELS ET MÉTHODES. Cette étude multicentrique a<br />
regroupé 136 patients, 110 femmes et 26 hommes d’âge moyen<br />
égal à 72,4 ans (55-86 ans), représentant 142 épau<strong>les</strong> prothèsées.<br />
Sur <strong>les</strong> 142 épau<strong>les</strong> opérées, 62 ont eu une hémiarthroplastie type<br />
« Aequalis », et 80 ont eu une prothèse inversée. Le handicap<br />
pré-opératoire était important avec un score moyen de Constant<br />
de 26 dans le groupe « hémiarthroplastie » et de 23 dans le<br />
groupe « inversée ».<br />
RÉSULTATS. Les patients ont été revus cliniquement et radiographiquement<br />
avec un recul moyen de 44 mois pour <strong>les</strong> Aequalis<br />
et de 45 mois pour <strong>les</strong> prothèses inversées. Il y a eu 7 échecs<br />
nécessitant 5 reprises : 3 dans le groupe « hémiarthroplastie » et<br />
4 dans le groupe « inversées ».<br />
Les différences entre <strong>les</strong> prothèses inversées et <strong>les</strong> hemiarthroplasties<br />
concernent le score de Constant, significativement<br />
meilleur avec <strong>les</strong> prothèses inversées (65,5) qu’avec <strong>les</strong><br />
hemiarthroplasties (46,1), et ceci pour tous <strong>les</strong> paramètres du<br />
score. L’élévation active était de 138° pour <strong>les</strong> prothèses inversées<br />
et 97° pour <strong>les</strong> hemiarthroplasties (p < 0,001). La RE1<br />
moyenne était de 22° pour <strong>les</strong> prothèses Aequalis et 11° pour <strong>les</strong><br />
prothèses inversées (p < 0,01) alors que <strong>les</strong> rotations en élévation<br />
ne différaient pas. Ces résultats restent significatifs et identiques<br />
dans le temps même au delà de 5 ans.<br />
Sur le plan radiographique, il n’yaqu’une anomalie au niveau<br />
<strong>des</strong> pièces huméra<strong>les</strong> à type d’enfoncement dans le groupe<br />
« inversée ». Pour <strong>les</strong> prothèses inversées, il existe 3 migrations<br />
non reprises à ce jour et 3 dévissages partiels. Le principal<br />
problème est celui <strong>des</strong> encoches du pilier de l’omoplate présentes<br />
dans plus de 50 % <strong>des</strong> cas dont 20 % atteignent la vis inférieure.<br />
Pour <strong>les</strong> hemiarthroplasties le principal problème est celui de la<br />
détérioration de la voûte acromiale présente dans la moitié <strong>des</strong><br />
cas et altérant le résultat fonctionnel.<br />
DISCUSSION. Les prothèses inversées donnent manifestement<br />
de meilleurs résultats à moyen terme, et même après 5 ans.<br />
L’évolution à long terme <strong>des</strong> hemiarthroplasties risquent de se<br />
faire vers une usure de la voûte. L’évolution <strong>des</strong> prothèses<br />
inversées est préoccupante en raison <strong>des</strong> encoches du pilier de<br />
l’omoplate et <strong>des</strong> contraintes sollicitant leur fixation. Leur utili-
sation est indiquée préférentiellement chez <strong>les</strong> personnes âgées à<br />
voûte abîmée.<br />
*L. Favard, Service de Chirurgie Orthopédique<br />
1, Hôpital Trousseau, CHU de Tours, 37044 Tours Cedex.<br />
50 Influence de la coiffe <strong>des</strong> rotateurs<br />
dans le résultat <strong>des</strong> prothèses<br />
d’épaule pour omarthrose centrée<br />
J.-F. KEMPF*, G. WALCH, B.EDWARDS,<br />
L. LAFOSSE, A.BOULAYA<br />
L’omarthrose centrée sedéfinit comme une arthrose de l’articulation<br />
gléno-humérale sans ascension de la tête notable, ce qui<br />
n’exclue pas une pathologie de la coiffe <strong>des</strong> rotateurs. Nous<br />
avons voulu savoir qu’elle pouvait être l’influence d’une rupture<br />
partielle ou totale du supra spinatus et/ou d’une dégénérescence<br />
graisseuse sur <strong>les</strong> résultats d’une prothèse totale d’épaule.<br />
Dans le cadre d’une révision multicentrique de 766 cas<br />
d’omarthroses centrées traitées par une prothèse Aequalis, nous<br />
avons isolé 555 épau<strong>les</strong> chez 478 patients comportant un arthroscanner<br />
pré-opératoire interprétable. Tous <strong>les</strong> patients ont été<br />
revus avec un recul minimum de 2 ans et un recul moyen de 3,6<br />
ans, avec un score de Constant et un bilan radiographique complet.<br />
Nous avons pu isoler 41 épau<strong>les</strong> comportant une rupture<br />
partielle du supra spinatus et 42 épau<strong>les</strong> présentant une rupture<br />
complète isolée du supra spinatus. 90 épau<strong>les</strong> avaient une dégénérescence<br />
graisseuse modérée (inférieur ou égale à 2) et 15<br />
épau<strong>les</strong> avaient une dégénérescence graisseuse sévère de l’infra<br />
spinatus ou du sous scapulaire (supérieur à 2). Nous avons<br />
analysé <strong>les</strong> différents critères de Constant, le résultat subjectif, le<br />
résultat radiographique et le taux de complication pour chacune<br />
de ces populations.<br />
Une rupture isolée du supra spinatus ne déstabilisant pas, la<br />
tête humérale n’a aucune influence sur le résultat post-opératoire<br />
qu’il s’agisse du score de Constant global, de la mobilité dans<br />
tous <strong>les</strong> plans, du résultat subjectif, du résultat radiologique ou du<br />
taux de complication. Nous n’avons retrouvé aucune différence<br />
significative quant au taux de complication. La réparation ou non<br />
de ces ruptures n’a pas influencé ces résultats. A l’opposé, une<br />
dégénérescence graisseuse supérieure ou égale à 2del’infra<br />
spinatus ou du subs scapularis a une influence significative en<br />
diminuant le score de Constant, la rotation externe active, l’élévation<br />
antérieure active et le résultat subjectif. Par contre, il n’y<br />
a pas d’influence sur le résultat radiographique ni sur le taux de<br />
complications.<br />
– Les résultats de cette étude multicentrique confirment qu’une<br />
omarthrose peut rester centrée avec une atteinte isolée du supra<br />
spinatus. Celle-ci ne modifiera en rien le résultat clinique et ne<br />
nécessite pas de réparation.<br />
– Al’opposé, la dégénérescence graisseuse est un facteur<br />
prédictif important pour la qualité du résultat final.<br />
*J.-F. Kempf, Service d’Orthopédie, Hôpital de Hautepierre,<br />
avenue Molière, 67098 Strasbourg.<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 2S41<br />
51 Que faut-il faire du chef long du<br />
biceps lors de la mise en place<br />
d’une prothèse d’épaule pour<br />
omarthrose primitive centrée :<br />
résultats d’une étude multicentrique<br />
de 625 cas<br />
J.-F. KEMPF*, G. WALCH, G.FAMA, L.LAFOSSE,<br />
B. EDWARDS, A.BOULAYA<br />
L’attitude à avoir vis-à-vis de la longue portion du biceps (chef<br />
long du biceps) lors de la mise en place d’une prothèse totale<br />
d’épaule pour omarthrose centrée reste controversée. Nous avons<br />
voulu dans ce travail analyser l’influence que pouvait avoir une<br />
ténodèse du LPB dans <strong>les</strong> résultats.<br />
Au sein d’une série multicentrique rétrospective de 766 prothèses<br />
d’épaule implantées pour une omarthrose primitive centrée,<br />
nous avons pu isoler 625 cas dont le dossier comportait <strong>des</strong><br />
renseignements suffisants concernant le LPB. Au sein de cette<br />
population, nous avons isolé 2 groupes : 131 patients ayant eu<br />
une ténodèse du LPB et 494 patients avec conservation du LPB.<br />
Dans chacun de ces deux groupes, nous avons analysé àplus de<br />
2 ans le résultat clinique selon le score de Constant et le résultat<br />
subjectif. Nous avons isolé 4 sous groupes : prothèse humérale<br />
sans ténodèse : 70 patients, prothèses huméra<strong>les</strong> avec ténodèse :<br />
10 patients, PTE sans ténodèse : 424 patients et PTE avec<br />
ténodèse : 121 patients.<br />
Le score de Constant (CS) a été significativement meilleur<br />
dans le groupe avec ténodèse (74,7) que dans le groupe sans<br />
ténodèse (70,8). Cette différence significative est retrouvée avec<br />
le score pondéré. Il en est de même pour l’élévation antérieure<br />
active et la rotation externe coude au corps active. Il n’y a pas eu<br />
pas de différence concernant la dégénérescence graisseuse postopératoire.<br />
L’analyse <strong>des</strong> sous-groupes : hémi-arthroplastie avec<br />
ou sans ténodèse et PTE avec ou sans ténodèse retrouve une<br />
amélioration significative du CS lorsqu’ilyaeuténodèse, quel<br />
que soit l’implant utilisé (hémi ou PTE). Si nous étudions <strong>les</strong> 364<br />
patients ayant un recul minimum de 36 mois, nous retrouvons la<br />
même différence significative : la ténodèseaamélioré le CS, le<br />
CS pondéré, l’élévation antérieure active, la rotation externe<br />
active.<br />
Le rôle du LPB dans la pathogénie <strong>des</strong> douleurs d’épaule est<br />
maintenant bien établi dans la littérature. De nombreux auteurs<br />
ont préconisé la ténotomie ou la ténodèse du LPB dans le cadre<br />
du traitement chirurgical <strong>des</strong> ruptures de la coiffe <strong>des</strong> rotateurs. Il<br />
n’en est pas de même lors de la mise en place d’une prothèse<br />
d’épaule pour traiter une omarthrose primitive. Dines et Hersch<br />
ont rapporté l’expérience de 10 patients présentant une PTE<br />
douloureuse qui ont bénéficié d’une arthroscopie avec une ténotomie<br />
ou une ténodèse et ils ont observé une amélioration <strong>des</strong><br />
douleurs.<br />
Notre série confirme sur un grand nombre de patients qu’il est<br />
préférable de réaliser une ténodèse du LPB lors de la mise en<br />
place d’une prothèse humérale ou totale d’épaule pour traiter une<br />
omarthrose primitive centrée etlebonrésultat ne se dégradera<br />
pas avec le temps.<br />
*J.-F. Kempf, Service d’Orthopédie, Hôpital de Hautepierre,<br />
avenue Molière, 67098 Strasbourg.
2S42 77 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
52 Ostéonécrose aseptique de la tête<br />
humérale (ONATH) : résultats cliniques<br />
et radiologiques <strong>des</strong> prothèses<br />
d’épaule<br />
J.-P. MARCHALAND*, G. VERSIER<br />
INTRODUCTION. Les auteurs rapportent <strong>les</strong> résultats satisfaisants<br />
d’une série multicentrique rétrospective de 80 prothèses<br />
d’épaule pour ostéonécrose aseptique de la tête humérale.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Soixante-quatorze patients (43<br />
hommes, 31 femmes, âge moyen 59 ans), porteurs d’une<br />
ONATH, opérés par prothèse ont été revus avec un recul minimum<br />
de 2 ans. En préopératoire, le score pondéré moyen était de<br />
37 %. 26 prothèses tota<strong>les</strong> et 54 prothèses huméra<strong>les</strong> simp<strong>les</strong> ont<br />
été posées par voie deltopectorale. Les complications avant<br />
révision étaient peu nombreuses : 7 raideurs, un lâchage de suture<br />
du subscapularis avec instabilité, 2glénoïdites, 1 migration. Les<br />
patients ont été revus cliniquement et ont eu <strong>des</strong> radiographies<br />
(recherche d’ossifications, de liserés).<br />
Le résultat a été évalué par le score de Constant brut et<br />
pondéré.<br />
RÉSULTATS. Le recul moyen est de 47 mois (24-104 mois).<br />
Le score de Constant était significativement amélioré (p < 0,05)<br />
surtout chez <strong>les</strong> sujets de moins de 50 ans (p < 0,0005). Le score<br />
total pondéré moyen de 88 % n’était influencé ni par le sexe, ni le<br />
côté, ni le caractère dominant du membre supérieur. 90 % <strong>des</strong><br />
patients étaient très satisfaits ou satisfaits. Le gain en mobilité<br />
était important dans tous <strong>les</strong> secteurs, en moyenne de 53° pour<br />
l’élévation antérieure active. Pour le stade 5 <strong>les</strong> résultats étaient<br />
significativement meilleurs avec une prothèse totale, alors que<br />
pour <strong>les</strong> sta<strong>des</strong> 2 et 3, l’hémiarthroplastie était préférable. La<br />
rupture transfixiante d’un tendon de la coiffe n’influençait pas le<br />
résultat global malgré une moins bonne récupération de mobilité<br />
(p < 0,05) et de force (p = 0,09). Les complications n’altéraient<br />
pas <strong>les</strong> résultats.<br />
DISCUSSION. Si la prothèse humérale simple doit rester le<br />
geste de base dans <strong>les</strong> sta<strong>des</strong> II-III, la prothèse totale est préférable<br />
en cas de glène usée (stade V). Au stade IV, le choix est plus<br />
ouvert ; il faut prendre en compte âge, activité et état de la coiffe.<br />
Le très jeune âge ou le grand âge, une activité physique importante<br />
peuvent dicter l’abstention de prothèser la glène en raison<br />
<strong>des</strong> risques de <strong>des</strong>cellement ou de rupture de la coiffe qui sont <strong>des</strong><br />
facteurs défavorab<strong>les</strong>.<br />
CONCLUSIONS. Les résultats de cette série multicentrique<br />
corroborent <strong>les</strong> données de la littérature, à savoir <strong>les</strong> bons résultats<br />
de l’arthroplastie dans le cadre du traitement <strong>des</strong> ONATH.<br />
D’une manière générale, l’arthroplastie permet de récupérer<br />
l’indolence, la mobilité, notamment en rotation externe et la force<br />
expliquant que <strong>les</strong> meilleurs résultats sont obtenus chez <strong>les</strong> sujets<br />
<strong>les</strong> plus jeunes encore en activité.<br />
*J.-P. Marchaland, Service de Chirurgie Orthopédique<br />
et Traumatologique, HIA Bégin, 69, avenue de Paris,<br />
94160 Saint-Mandé.<br />
53 Résultats <strong>des</strong> arthroplasties prothétiques<br />
d’épaule pour nécrose<br />
céphalique après fracture de<br />
l’extrémité supérieure de l’humérus<br />
F. DUPARC*, C. TROJANI, P.BOILEAU, J.-C. LE<br />
HUEC, G.WALCH<br />
INTRODUCTION. Le collapsus céphalique ou la nécrose<br />
après fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus, peut<br />
conduire à l’indication d’une arthroplastie prothétique. Les mauvais<br />
résultats classiquement rapportés ont incité àrechercher <strong>les</strong><br />
facteurs pronostiques du résultat anatomique et fonctionnel après<br />
arthroplastie pour séquel<strong>les</strong> post-traumatiques.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Parmi 221 prothèses Aequalis<br />
implantées dans le traitement <strong>des</strong> séquel<strong>les</strong> de fractures de<br />
l’extrémité proximale de l’humérus, 137 (62 %) l’avaient été<br />
pour ostéonécrose avasculaire post-traumatique de la tête humérale<br />
avec cal vicieux tubérositaire. La bascule céphalique était en<br />
valgus dans 83 cas et en varus dans 54. L’âge moyen était de<br />
61,49 ans. Les fractures initia<strong>les</strong> étaient sous-tubérositaires dans<br />
20 % <strong>des</strong> cas, à 3 fragments dans 32 % et céphalobitubérositaires<br />
à 4 fragments dans 48 % <strong>des</strong> cas. 25 % <strong>des</strong><br />
patients avaient fait l’objet d’une ostéosynthèse initiale. Une<br />
réparation de la coiffe <strong>des</strong> rotateurs était associée dans 4,5 % <strong>des</strong><br />
cas à la mise en place de la prothèse, 2 ostéotomies du tubercule<br />
mineur et 4 ostéotomies du tubercule majeur ont été réalisées.<br />
L’évaluation clinique et fonctionnelle pré et post-opératoire a<br />
utilisé le score de Constant et un indice fonctionnel comprenant<br />
11 gestes usuels.<br />
RÉSULTATS. Le recul moyen était de 44 mois (24 à 104), le<br />
gain moyen en élévation antérieure était de 42° et en rotation<br />
externe de 29°. Le gain total du score de Constant était de +32<br />
points (score moyen 61), et +43 % avec le score de Constant<br />
pondéré. Les 4 paramètres du score de Constant (douleur, mobilités,<br />
activités, force musculaire) montraient un doublement du<br />
score en post-opératoire. L’étude <strong>des</strong> 11 gestes usuels montrait<br />
une récupération dans 88 % <strong>des</strong> cas. L’indice subjectif de satisfaction<br />
<strong>des</strong> patients était de 86 %. Le score de Constant moyen<br />
était significativement supérieur après prothèse totale (67 points)<br />
qu’après hémiarthroplastie (55 points). La survenue d’une complication<br />
(mécanique per ou post-opératoire, infectieuse, neurologique)<br />
ou la nécessité d’une réintervention était <strong>des</strong> éléments<br />
défavorab<strong>les</strong>.<br />
DISCUSSION. La déformation et la déviation tubérositaire,<br />
surtout au niveau du tubercule majeur, a souvent incitéàassocier<br />
une ostéotomie tubérositaire avec la mise en place de la prothèse<br />
d’épaule. Dans cette série, ce geste n’était qu’exceptionnel, et <strong>les</strong><br />
résultats fonctionnels ont montré que la déviation tubérositaire<br />
pouvait être respectée etn’était pas un élément défavorable du<br />
pronostic fonctionnel. Bien au contraire, l’absence d’ostéotomie<br />
tubérositaire a simplifié le geste opératoire, et a conduit à <strong>des</strong><br />
résultats fonctionnels nettement supérieurs avec ceux qui étaient<br />
observés lors <strong>des</strong> précédentes étu<strong>des</strong>. Le taux de complications<br />
de cette chirurgie prothétique secondaire n’est pas négligeable<br />
(15 %), et la simplification du geste par l’absence d’ostéotomie<br />
tubérositaire est un critère utile. De plus, la possibilité de rééducation<br />
précoce après implantation de la prothèse, en l’absence
d’attente de consolidation tubérositaire, a constitué un facteur de<br />
pronostic favorable.<br />
CONCLUSION. L’implantation d’une prothèse d’épaule<br />
après collapsus ou nécrose céphalique sur fracture impactée en<br />
varus ou en valgus conduit à de bons résultats fonctionnels en<br />
l’absence d’ostéotomie tubérositaire associée, car la déformation<br />
tubérositaire est en règle tolérable.<br />
*F. Duparc, Service de Chirurgie Orthopédique<br />
et Traumatologique et Plastique, CHU de Rouen,<br />
boulevard Gambetta, 76031 Rouen Cedex.<br />
54 Ostéonécrose primitive humérale et<br />
chirurgie prothétique : facteurs<br />
influençant le résultat<br />
M. BASSO*, L. NOVÉ-JOSSERAND, G.VERSIER,<br />
W.-J. WILLEMS, A.GODENÈCHE<br />
Le but était d’identifier <strong>les</strong> facteurs influençant le résultat <strong>des</strong><br />
prothèses dans l’ostéonécrose humérale, pour préciser <strong>les</strong> indications<br />
de prothèse humérale ou totale dans cette étiologie.<br />
PATIENTS ET MÉTHODES. Quarante-sept femmes et 27<br />
hommes, d’âge moyen 57 ans, ont été opérés par 80 prothèses<br />
d’épaule pour ostéonécrose primitive. Il s’agissait de 5 sta<strong>des</strong> II,<br />
15 sta<strong>des</strong> III, 41 sta<strong>des</strong> IV et 14 sta<strong>des</strong> V, selon la classification<br />
d’Arlet et Ficat (modifiée par Cruess) (5 inclassés). On notait 14<br />
ruptures du supraspinatus et 5 de l’infraspinatus. 26 prothèses<br />
tota<strong>les</strong> et 54 prothèses huméra<strong>les</strong> ont été revues à un recul moyen<br />
de 47 mois. L’imagerie était exploitable pour 65 cas en préopératoire<br />
et 58 en postopératoire.<br />
56 Evaluation subjective <strong>des</strong> instabilités<br />
rotuliennes<br />
E. SERVIEN*, T. AÏT SI SELMI, P.NEYRET<br />
INTRODUCTION. Le but de ce travail est d’analyser sur le<br />
plan fonctionnel <strong>les</strong> résultats <strong>des</strong> Instabilités Rotuliennes Objectives<br />
opérés entre 1988 et 1999.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Cent quatre vingt dix genoux<br />
ont été inclus, soit 140 patients. Le recul minimum était de deux<br />
ans et le recul moyen lors de la révision était de 5 ans (24 mois –<br />
152 mois). La fiche d’évaluation subjective du genou de l’IKDC<br />
99 a été utilisée en post-opératoire.<br />
Cette fiche comprend 10 items permettant d’établir le niveau<br />
d’activité sportive et l’état fonctionnel du genou dans la vie<br />
quotidienne. 118 patients (83 %) ont répondu au questionnaire.<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 2S43<br />
Séance du 13 novembre après-midi<br />
GENOU<br />
RÉSULTATS. Le résultat subjectif est bon quel que soit le<br />
stade (très satisfaisant : 60 %, satisfaisant 30 %, décevant 4 %).<br />
Le score de Constant postopératoire moyen est de 70 ± 15. Si le<br />
score préopératoire est plus bas dans <strong>les</strong> sta<strong>des</strong> avancés, la<br />
différence n’est pas significative en postopératoire. La prothèse<br />
totale donne de meilleurs résultats au stade V, l’hémiarthroplastie<br />
aux sta<strong>des</strong> II et III.<br />
Le résultat <strong>des</strong> hémiarthroplasties est conditionné par le stade<br />
de nécrose. Aux sta<strong>des</strong> avancés, le score de Constant postopératoire<br />
diminue ; sur la mobilité, la force et aussi la douleur (ce<br />
dernier paramètre n’étant pas influencé par la différence d’âge). A<br />
la révision, 31 % <strong>des</strong> radiographies révèlent un pincement significatif<br />
gléno-huméral. Le résultat clinique est significativement<br />
moins bon, sur tous <strong>les</strong> paramètres du score de Constant. Une<br />
rupture de coiffe, la raideur préopératoire favorisent cette usure<br />
glénoïdienne.<br />
Une rupture de deux tendons de la coiffe <strong>des</strong> rotateurs est<br />
péjorative.<br />
Un collapsus osseux avec impaction de la tête sur la glène et<br />
médialisation humérale est significativement un facteur de moins<br />
bon résultat.<br />
DISCUSSION. Le stade de nécrose détermine habituellement<br />
<strong>les</strong> indications d’hémiarthroplastie ou de prothèse totale pour<br />
ostéonécrose.<br />
Des constatations objectives conduisent à recommander<br />
l’hémiarthroplastie aux sta<strong>des</strong> II et III et la prothèse totale au<br />
stade V.<br />
Au stade IV, le choix se basera sur l’âge, la raideur, l’état de la<br />
coiffe et surtout la présence d’un collapsus céphalique avec<br />
impaction-médialisation humérale.<br />
*M. Basso, Service de Chirurgie Orthopédique,<br />
Hôpital Renée-Sabran, boulevard Edouard-Herriot, Giens,<br />
83400 Hyères.<br />
RÉSULTATS. Quatre-vingt-dix-huit-patients (63 %) ont été<br />
revus cliniquement et 29 patients (20 %) interrogés par téléphone.<br />
94,87 % <strong>des</strong> patients (n = 111) étaient très satisfaits ou<br />
satisfaits. 4,27 % (n = 5) étaient mécontents et 1 déçu.<br />
Nous avons évalué nos résultats selon la douleur (37,6 % de<br />
gêne ou douleur climatique), un œdème résiduel ; la sensation de<br />
blocage (15,8 %) ; l’instabilité ; la pratique <strong>des</strong> activités quotidiennes<br />
(68 % de gêne lors de la position à genoux) ; la pratique<br />
et le niveau sportif.<br />
DISCUSSION. Certains auteurs (Insall) remettent en cause le<br />
traitement chirurgical <strong>des</strong> IRO en raison de la survenue secondaire<br />
d’arthrose fémoro-patellaire. Pour nous, le traitement chirurgical<br />
est indiqué lorsqu’ilyaeuaumoins un épisode de<br />
luxation associé à<strong>des</strong> anomalies morphologiques. Nous n’avons<br />
pas retrouvé d’arthrose fémoro-patellaire même chez <strong>les</strong> patients<br />
opérés il y a plus de 10 ans. L’appréciation <strong>des</strong> résultats par le<br />
patient lui-même montre que le traitement chirurgical par média-
2S44 77 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
lisation et/ou abaissement de la tubérosité tibiale antérieure est<br />
efficace avec un taux de satisfaction bon voire excellent. La<br />
qualité <strong>des</strong> résultats est directement liée au bon démembrement<br />
<strong>des</strong> lésions (il ne s’agit que de patients souffrant de luxation<br />
récidivante) et à une analyse systématique <strong>des</strong> différents facteurs<br />
d’instabilité rotulienne (dysplasie de trochlée, hauteur rotulienne,<br />
dysplasie du quadriceps, mesure de la TA-GT, longueur du<br />
tendon rotulien).<br />
Notre taux de révision peut sembler faible, mais il est directement<br />
lié àla jeune population et il est proche voire supérieur au<br />
taux de révision <strong>des</strong> séries avec un recul moyen supérieur à deux<br />
ans.<br />
CONCLUSION. La chirurgie de l’instabilité rotulienne objective<br />
donne de bons résultats à moyen et long terme. Le score<br />
d’évaluation subjective IKDC permet une appréciation précise<br />
par le patient. Nous n’avons pas trouvé de corrélation entre <strong>les</strong><br />
résultats subjectifs et <strong>les</strong> résultats objectifs.<br />
*E. Servien, Centre Livet, 8, rue de Margnol<strong>les</strong>, 69300 Caluire.<br />
57 Axes radiologiques du membre<br />
inférieur du sujet normal : étude<br />
d’une série de 100 cas considérée<br />
comme série témoin<br />
C. BOÉRI*, L. BALLONZOLI, J.-Y. JENNY<br />
INTRODUCTION. La connaissance <strong>des</strong> axes radiologiques<br />
normaux du membre inférieur est importante, notamment dans la<br />
chirurgie correctrice et reconstructrice. Il est classiquement<br />
admis que l’angle mécanique fémorotibial de face est nul, avec<br />
un valgus fémoral de 3° compensant un varus tibial de même<br />
valeur. Pourtant <strong>les</strong> travaux de référence sont méthodologiquement<br />
discutab<strong>les</strong>, car ils portent sur <strong>des</strong> populations sélectionnées<br />
et <strong>des</strong> effectifs faib<strong>les</strong>.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Les auteurs ont réalisé une<br />
téléradiographie de face d’un membre inférieur chez 100 volontaires<br />
sains, indemnes de toute pathologie <strong>des</strong> membres inférieurs,<br />
et sélectionnés au hasard parmi <strong>des</strong> patients opérés pour<br />
une pathologie traumatique ou dégénératives <strong>des</strong> membres supérieurs.<br />
Les ang<strong>les</strong> suivants ont été mesurés par un même chirurgien<br />
senior : angle fémorotibial mécanique, orientation du massif<br />
condylien fémoral selon l’axe fémoral mécanique, angle entre<br />
l’axe mécanique et l’axe anatomique du fémur, orientation <strong>des</strong><br />
plateaux tibiaux par rapport à l’axe mécanique du tibia.<br />
RÉSULTATS. Soixante-neuf hommes et 31 femmes, d’un âge<br />
moyen de 39 ans (extrêmes de 17 a 62 ans) ont participé àcette<br />
étude. L’angle fémorotibial mécanique moyen était de 179°<br />
(écart-type : 3°, médiane 179°, extrêmesde168a185°) ; 19 cas<br />
avaient la valeur classique de 180°. L’orientation moyenne du<br />
massif condylien fémoral selon l’axe fémoral mécanique était de<br />
91° (écart-type : 2°, médiane 91°, extrêmesde86à98°) ; 17 cas<br />
avaient la valeur classique de 93°. L’angle moyen entre l’axe<br />
mécanique et l’axe anatomique de fémur était de 6° (écart-type :<br />
1°, médiane 6°, extrêmesde3à 9°) ; 29 cas avaient la valeur<br />
classique de 7°. L’orientation moyenne <strong>des</strong> plateaux tibiaux par<br />
rapport à l’axe mécanique du tibia était de 88° (écart-type : 2°,<br />
médiane 88°, extrêmesde82à 84°) ; 14 cas avaient la valeur<br />
classique de 87°.<br />
DISCUSSION – CONCLUSION. Les valeurs reconnues<br />
comme norma<strong>les</strong> dans la littérature ne concernent en fait que 15<br />
à 20 % <strong>des</strong> sujets de cette étude. Bien qu’il puisse exister un biais<br />
théorique de sélection de la population étudiée, on peut supposer<br />
qu’il existe une large dispersion <strong>des</strong> valeurs dites norma<strong>les</strong> autour<br />
<strong>des</strong> valeurs moyennes. L’importance pratique de cette dispersion<br />
reste àévaluer. La question de l’individualisation <strong>des</strong> procédures<br />
reconstructrices ou prothétiques doit être posée.<br />
*C. Boéri, CTO, 10, avenue Baumann, 67400 Illkirch.<br />
58 Reconstruction du ménisque<br />
médial par le Collagen Meniscus<br />
Implant (CMI) : résultats préliminaires<br />
de l’étude européenne<br />
P. BEAUFILS*, B. MOYEN, O.CHARROIS, ET LE<br />
CMI GROUP<br />
Le CMI (Sulzer) est un substitut méniscal, matrice de collagène<br />
servant de tuteur pour la prolifération d’un tissu de régénération<br />
méniscale autologue. Le but est de prévenir à moyen terme<br />
l’apparition d’une dégradation cartilagineuse secondaire à une<br />
ménisectomie. Le CMI est implanté sous contrôle arthroscopique.<br />
Les objectifs de cette étude multicentrique européenne était<br />
de confirmer la sûreté, la faisabilité technique et l’efficacité<br />
clinique à court terme dans une population de méniscectomie<br />
médiale. Les résultats à long terme ne pourront être obtenus que<br />
dans un délai minimal de 5 ans.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. La série inclut <strong>des</strong> lésions<br />
ménisca<strong>les</strong> exclusivement média<strong>les</strong>, avec ou sans lésion du LCA<br />
(44 %) (réparé dans le même temps). Le consentement du patient<br />
était toujours obtenu (en France selon un protocole loi Huriet).<br />
Etaient exclues <strong>les</strong> lésions du ménisque latéral, <strong>les</strong> lésions associées<br />
cartilagineuses grade IV, <strong>les</strong> lésions du LCP.<br />
Ont été inclus 98 patients d’un âge moyen de 33 ans. 4 patients<br />
sont sortis pour complications. 66 sont actuellement évaluab<strong>les</strong> à<br />
1 an sur <strong>les</strong> critères subjectifs, le score de Lysholm, un bilan<br />
radiographique et IRM. Une évaluation jusqu’à 5 ans est prévue.<br />
RÉSULTATS. Complications : 4 complications précoces ont<br />
été observées : 1 arthrite infectieuse, 2 arthrites puriformes sans<br />
germe, 1 rutpure de l’implant. Il n’y a pas eu de complication post<br />
op liée à l’implant.<br />
Résultats Cliniques. Au recul d’1 an, le score de Lysholm était<br />
à 97. Une douleur, toujours modérée (1 sur l’EVA), n’était notée<br />
que dans 1 cas sur 6 ; 87 % <strong>des</strong> patients avaient un genou normal<br />
ou quasi normal.<br />
Résultats radiologiques. Iln’y avait pas de signes radiologiques<br />
de dégénérescence précoce. L’interprétation de l’IBM est<br />
difficile. Elle objective une structure de signal intermédiaire,<br />
ayant la forme du triangle méniscal. L’IRM n’a pas mis en<br />
évidence d’effet délétère sur le cartilage avoisinant.<br />
DISCUSSION. Cette technique de remplacement méniscal<br />
constitue une alternative à la greffe méniscale allogène. Les
ésultats préliminaires doivent évidemment pousser à une grande<br />
prudence. Ils permettent simplement de dire que l’implantation<br />
du CMI sous arthroscopie est possible mais difficile. Aucune<br />
réaction de type immunologique n’a été observée. Les complications<br />
sont plus à mettre sur le compte de la difficulté opératoire.<br />
Les résultats cliniques à 1 an sont satisfaisants en particulier en<br />
termes de douleur. En revanche, la valeur biomécanique de ce<br />
tissu ne pourra être évaluée qu’à long terme.<br />
CONCLUSION. Eu égard à la difficulté technique, aux suites<br />
longues dues au protocole de rééducation, le CMI s’adresse aux<br />
genoux méniscectomisés symptomatiques en particulier dans le<br />
cadre d’une laxité antérieure.<br />
*P. Beaufils, Centre Hospitalier de Versail<strong>les</strong>,<br />
Hôpital André-Mignot, 78150 Le Chesnay.<br />
59 Greffe ostéochondrale de type<br />
mosaïcplastie : résultats d’une<br />
série continue de 25 patients<br />
T. AÏT SI SELMI*, C. BUSSIÈRE, P.NEYRET<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Nous rapportons <strong>les</strong> résultas<br />
d’une série prospective, consécutive, de 25 patients présentant<br />
<strong>des</strong> lésions chondra<strong>les</strong> non dégénératives, traitées pas greffes<br />
ostéochondra<strong>les</strong> de type mosaïcplastie. Le groupe principal<br />
(genou) comporte 22 genoux, parmi <strong>les</strong>quels 16 ostéochondrites<br />
disséquantes, 5 lésions cartilagineuses contemporaines de laxité<br />
antérieure chronique, et une nécrose du condyle interne. Les<br />
autres lésions sont situées au talus. L’âge moyen est de 28 ans. Le<br />
recul moyen est de 13 mois (1 à 39 mois). Parmi le groupe genou,<br />
15 patients ont été opérés selon la technique standard de mosaïcplastie.<br />
La lésion mesurait 1,96 cm 2 en moyenne. Dans <strong>les</strong><br />
autres cas <strong>des</strong> gestes associés ont été nécessaires ; 4 ostéotomies<br />
tibia<strong>les</strong> de valgisation, et 3 ligamentoplasties antérieures. Nous<br />
déplorons peu de complications généra<strong>les</strong>, sauf un sepsis.<br />
L’évaluation clinique d’utilise la nouvelle fiche internationale<br />
de l’ICRS (avec mise à jour de la fiche subjective de l’IKDC). Le<br />
score subjectif IKDC était de 48,7 % en préopératoire.<br />
RÉSULTATS. La couverture de la lésion était en moyenne de<br />
68,5 %. Les résultats sont bons en ce qui concerne <strong>les</strong> mosaïcplasties<br />
isolées. Le score subjectif IKDC est de 67.5 %. 77 % <strong>des</strong><br />
patients n’avaient pas ou peu de douleurs et <strong>les</strong> deux tiers cotaient<br />
la performance de leur genou à au moins 8 sur une échelle<br />
visuelle de 10 graduations. La cotation objective IKDC retrouvait<br />
11/15 patients cotés A et 4/15 cotés B. Nous retrouvons un cas de<br />
complication spécifique liée au site donneur sous forme d’un<br />
pincement fémoro-patellaire, avec une prise de greffons importante.<br />
En cas de gestes associés, <strong>les</strong> suites étaient plus diffici<strong>les</strong><br />
avec <strong>des</strong> résultats moins bons. Tous <strong>les</strong> patients ont eu une IRM<br />
de contrôle à 6 mois, montrant le plus souvent un bon aspect<br />
morphologique.<br />
DISCUSSION. La réalisation technique est importante et un<br />
certains nombres de pièges et difficultés techniques doivent être<br />
maîtrisés. Si l’association de gestes systématiques tel qu’une<br />
greffe du LCA nous paraît justifiée, l’adjonction d’une ostéoto-<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 2S45<br />
mie nous paraîttrès discutable. Une lésion de plus de 3 cm 2 nous<br />
paraît être la limite de cette technique.<br />
CONCLUSION. La greffe mosaïcplastie est une méthode<br />
fiable dans la réparation cartilagineuse. Une évaluation à long<br />
terme permettra de mieux maîtriser <strong>les</strong> indications, et de dépister<br />
une éventuelle iatrogénicité et de préciser la place de cette<br />
technique parmi <strong>les</strong> autres métho<strong>des</strong> de réparations cartilagineuses.<br />
*T. Aït Si Selmi, Centre Livet, 8, rue de Margnol<strong>les</strong>,<br />
69300 Caluire.<br />
60 Absence congénitale du ligament<br />
croisé antérieur : à propos de 8 cas<br />
R. FRIKHA*, J. DAHMENE, K.BOUATTOUR,<br />
R. BEN HAMIDA, M.-L. BEN AYECHE<br />
L’absence congénitale du LCA est une affection rare. Les<br />
quelques séries rapportées par la littérature étaient limitées à <strong>des</strong><br />
cas sporadiques. Son étiologie et encore mal connue.<br />
L’objectif de ce travail est d’analyser à travers une étude<br />
<strong>des</strong>criptive, <strong>les</strong> résultats d’une série de 5 patients soit 8 genoux<br />
présentant une agénésie du LCA, de déterminer <strong>les</strong> caractéristiques<br />
de cette série et enfin de relever <strong>les</strong> particularités de<br />
l’évolution naturelle de l’agénésie comparée à la rupture post<br />
traumatique.<br />
La série comporte 4 hommes et une femme dont l’âge moyen<br />
était de 46 ans. Tous <strong>les</strong> patients sont issus d’un ancêtre commun,<br />
posant ainsi la question de l’origine génétique de cette affection.<br />
La douleur fémoro-tibiale interne et fémoro patellaire était le<br />
maître symptôme retrouvé chez tous <strong>les</strong> patients. L’examen<br />
physique a retrouvé <strong>les</strong> signes majeurs de la laxité antérieure du<br />
genou (Ressaut rotatoire, Trillat Lachman) et une saillie anormale<br />
de la tubérosité tibiale antérieure.<br />
Le bilan radiologique standard a mis en évidence quelques<br />
particularités sémiologiques évocatrices d’agénésie du LCA.<br />
L’IRM a confirmé le diagnostic dans 2 cas.<br />
La confrontation de nos résultats avec ceux de la littérature a<br />
permis de relever quelques particularités:<br />
− Le caractère familial de notre série avec un mode de transmission<br />
autosomique, dominante à expressivité variable.<br />
− La rareté <strong>des</strong> dérobements lors de l’agénésie du LCA est<br />
attribuée à une adaptation depuis le jeune âge.<br />
− L’hypoplasie <strong>des</strong> épines tibia<strong>les</strong> et du condyle fémoral<br />
externe est une conséquence d’une agénésie du LCA.<br />
L’étude de l’évolution naturelle de l’agénésie du LCA comparée<br />
à celle post traumatique a permis de faire quelques constatations<br />
:<br />
− La bonne tolérance fonctionnelle d’une laxité congénitale<br />
(clinique et radiologique).<br />
− L’apparition d’une arthrose sur laxité antérieure congénitale<br />
paraît inéluctable. Elle apparaît tardivement, évolue lentement,<br />
plus lentement encore que l’arthrose après rupture traumatique<br />
du LCA.
2S46 77 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
− Les compartiments fémoro-tibial externe et fémoropatellaire<br />
restent très longtemps préservés contrairement à l’arthrose<br />
sur rupture traumatique du LCA.<br />
L’absence d’étu<strong>des</strong> génétiques dans la littérature et le caractère<br />
familial de notre série nous amènent à insister sur l’intérêt d’une<br />
enquête génétique poussée pour mettre au point ce sujet.<br />
*R. Frikha, Service d’Orthopédie, Hôpital Sahloul,<br />
4054 Sousse, Tunisie.<br />
61 Reconstruction du ligament croisé<br />
antérieur par génie tissulaire<br />
R. CLOUTIER*, J. LAMONTAGNE, F.GOULET<br />
INTRODUCTION. Le but de nos travaux en génie tissulaire<br />
est de produire un substitut du ligament croisé antérieur (LCA)<br />
cultivé en laboratoire, à <strong>des</strong> fins d’implantation chez l’humain et<br />
d’effectuer <strong>des</strong> étu<strong>des</strong> fondamenta<strong>les</strong> sur ses mécanismes de<br />
guérison.<br />
MATÉRIEL. Nous avons utilisées <strong>des</strong> cellu<strong>les</strong> isolées de<br />
biopsies du LCA de l’hôte, une matrice bovine de collagène de<br />
type I et deux blocs osseux pour produire le LCA en culture.<br />
MÉTHODES. Le plusieurs couches de collagène contenant<br />
<strong>des</strong> cellu<strong>les</strong> autologues du LCA de l’hôte peuvent être superposées<br />
et liées aux 2 os qui sont placés à ses extrémités, par un<br />
procédé en voie d’être breveté. Les cellu<strong>les</strong> ou fibroblastes,<br />
contractent la matrice de collagène et débutent son remodelage<br />
avant implantation, en laboratoire. Ce LCA produit par génie<br />
tissulaire peut être prêt pour implantation 10-12 jours après avoir<br />
isolé <strong>les</strong> cellu<strong>les</strong> autologues du LCA rompu.<br />
RÉSULTATS. L’implantation de LCA autologues reconstruits<br />
s’est avéré un succès sur8chèvres. D’abord, <strong>les</strong> analyses histologiques<br />
<strong>des</strong> greffons implantés ont démontré l’intégration permanente<br />
<strong>des</strong> tissus après 1-13 mois. La membrane synoviale se<br />
reforme et devient vascularisée rapidement, soit 1 mois suivant la<br />
greffe. Par la suite, le remodelage de la matrice de collagène<br />
conduit à la formation d’un réseau très dense de fibres, organisées<br />
en faisceaux de façon fort comparable à l’histologie normale du<br />
LCA. Les blocs ossseux du greffon sont aussi très bien intégrés<br />
par une incorporation d’os au fémur et au tibia de l’hôte. Des<br />
fibres de Sharpey sont présentes à l’interface os-ligament, ainsi<br />
que du fibrocartilage bien structuré. De plus, la membrane synoviale<br />
qui entoure le greffon est innervée à 5 mois postimplantation,<br />
ce qui suggère que la proprioception pourrait être<br />
récupérée en fonction du temps. Finalement, il a été possible<br />
d’atteindre progressivement un gain de force correspondant à 20<br />
à 36 % de celle du LCA normal, après 9à 13 mois d’implantation.<br />
DISCUSSION. Ces données sont prometteuses car elle<br />
démontrent qu’il est possible de produire, du laboratoire vers la<br />
clinique, un substitut autologue du LCA qui présente un potentiel<br />
intéressant de regénération, évitant <strong>les</strong> risques de rejet, épargnant<br />
<strong>les</strong> structures saines du genou, favorisant une réadaptation fonctionnelle<br />
plus rapide.<br />
CONCLUSION. Le génie tissulaire est une voie d’avenir par<br />
ses applications potentiel<strong>les</strong> en chirurgie orthopédique de reconstruction,<br />
notamment pour le LCA.<br />
*R. Cloutier, LOEX, CHA, Hôpital du Saint-Sacrement,<br />
1050, chemin Sainte-Foy, Québec, Canada.<br />
62 Analyse par scanner du positionnement<br />
de l’axe trans-épicondylien au<br />
cours de la flexion du genou sur<br />
genoux sains<br />
M. BONNIN*, Y. CARILLON<br />
BUT DE L’ÉTUDE. L’axe trans-épicondylien (l’ATE) est un<br />
repère important pour le positionnement en rotation de la pièce<br />
fémorale dans <strong>les</strong> PTG. Des étu<strong>des</strong> in vitro ont montré qu’il<br />
correspond à l’axe de flexion-extension du genou. Deux ATE ont<br />
été définis dans la littérature selon le repère utilisé pour l’épicondyle<br />
médial : saillie principale pour l’ATE « clinique » et cratère<br />
pour l’ATE « chirurgical ». Le but de cette étude est de préciser in<br />
vivo sur sujets sains <strong>les</strong> rapports entre ATE et axes mécaniques du<br />
fémur (AF) et du tibia (AT) par scanner, au cours de la flexion du<br />
genou et en analysant séparément <strong>les</strong> deux ATE.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Dix genoux droits de volontaires<br />
sains ont été étudiés par scanner. Les donnés de la goniométrie<br />
étaient mesurées sur le scannogramme. Cinq témoins présentaient<br />
un morphotype en genu varum et cinq en genu valgum.<br />
L’acquisition était réalisée à 0°, 45° et 90° de flexion. Après<br />
repérage <strong>des</strong> épicondy<strong>les</strong> sur <strong>les</strong> coupes horizonta<strong>les</strong>, trois coupes<br />
fronta<strong>les</strong> parallè<strong>les</strong> à la corticale postérieure du tibia étaient<br />
reconstruites. Par superposition de ces trois coupes et pour<br />
chaque angle de flexion on disposait ainsi d’une coupe frontale<br />
avec ATEclin, ATEchir, AT et ligne bicondylienne postérieure<br />
(LBC). Les ang<strong>les</strong> entre ATE et AT, AF et LBC pouvaient être<br />
analysés au cours de la flexion. Pour chaque mesure, <strong>les</strong> ang<strong>les</strong><br />
étaient mesurés par le côté médial.<br />
RÉSULTATS. L’ATE chir. reste perpendiculaire à l’AT au<br />
cours de la flexion mais avec <strong>des</strong> variations interindividuel<strong>les</strong><br />
importantes. La variation moyenne au cours de la flexion est de<br />
3,4° ± 1,5. L’angle AF-ATE est de 88,5° ± 0,8 et ne varie pas<br />
selon le morphotype. Les ang<strong>les</strong> ATE/LBC et ATE/AT varient<br />
selon le morphotype mais d’autant moins que l’on se rapproche<br />
de la flexion.<br />
CONCLUSION. L’ATE chirurgical garde <strong>des</strong> rapports constants<br />
avec l’axe tibial au cours de la flexion du genou. Il peut<br />
donc être utilisé comme repère pour positionner la pièce fémorale<br />
dans <strong>les</strong> PTG dans l’espoir de retrouver une cinématique fémorotibiale<br />
optimale. Les rapports entre l’ATE clinique et l’AT sont<br />
variab<strong>les</strong> et le repérage peropératoire basé sur le relief maximal<br />
de l’épicondyle interne paraît plus aléatoire.<br />
*M. Bonnin, Clinique Sainte-Anne-Lumière,<br />
85, cours Albert-Thomas, 69003 Lyon.
63 Effet chondroprotecteur d’une activité<br />
physique modérée lors du<br />
modèle d’arthrose expérimentale<br />
induite par section du ligament<br />
croisé antérieur (LCA) chez le rat<br />
L. GALOIS*, S. ETIENNE, L.GROSSIN,<br />
C. COURNIL, P.NETTER, D.MAINARD, P.GILLET<br />
INTRODUCTION. Si la section du LCA induit classiquement<br />
une arthrose expérimentale dans différentes espèces (chien, lapin,<br />
rat...), la contribution de l’activité physique sur l’évolution <strong>des</strong><br />
lésions du cartilage lors de ce modèle reste méconnue. Nous<br />
avons étudié l’influence d’une activité physique modérée sur<br />
l’évolution de l’arthrose expérimentale induite par section du<br />
LCA chez le rat.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Une section du LCA par<br />
arthrotomie (genou droit) a été réalisée, sous anesthésie générale,<br />
chez 60 rats Wistar mâ<strong>les</strong> (180 g). La section du LCA, pratiquée<br />
au bistouri fin, était validée par la mise en évidence d’un tiroir<br />
antérieur. Le genou non opéré servait de témoin. Les rats ont été<br />
séparés aléatoirement en 2 groupes, avec ou sans exercice.<br />
L’effort calibré était réalisé sur tapis roulant, à une vitesse<br />
constante de 30 cm/s pendant 30 min/j (soit 15 km sur 28 jours).<br />
Les rats ont été sacrifiés à J7, J14 et J28. Une étude macroscopique,<br />
histologique et immuno-histochimique (Caspase 3) a été<br />
effectuée sur chaque compartiment du genou. Enfin, un dosage<br />
du NO sur le liquide synovial a été réalisé.<br />
RÉSULTATS. Aucune lésion cartilagineuse n’a été observée<br />
après une distance de 15 km sur <strong>les</strong> genoux non opérés. Après<br />
section du LCA, une synovite marquée était présente dès J7,<br />
associée à <strong>des</strong> fibrillations de surface. La sévérité <strong>des</strong> lésions<br />
cartilagineuses s’est majorée deJ14à J28, prédominant sur le<br />
plateau tibial médial et, dans une moindre mesure, sur le condyle<br />
fémoral adjacent, en zone portante. En revanche, <strong>les</strong> lésions<br />
étaient plus limitées sur la rotule. Par ailleurs, <strong>les</strong> phénomènes<br />
apoptotiques chondrocytaires, maximaux à J7, se stabilisaient<br />
ensuite. L’influence de l’activité physique sur ces paramètres a<br />
été significative : amélioration <strong>des</strong> lésions macroscopiques et<br />
histologiques à J14 et J28, tout comme <strong>des</strong> phénomènes apoptotiques<br />
chondrocytaires à J7, J14 et J28.<br />
DISCUSSION. Ce travail original confirme l’effet bénéfique<br />
d’une activité physique modérée dans un modèle d’arthrose<br />
expérimentale chez le rat, alors que, par ailleurs, il est bien établi<br />
expérimentalement qu’un surmenage articulaire intense a une<br />
influence délétère sur l’évolution <strong>des</strong> lésions chondra<strong>les</strong> après<br />
méniscectomie et/ou section du LCA. Cet effet préjudiciable<br />
d’un sur-entraînement a également été observé en clinique chez<br />
certains sportifs de haut niveau. Nos données expérimenta<strong>les</strong><br />
suggèrent qu’un effort physique modéré n’augmente pas le risque<br />
d’arthrose et pourrait même, dans certaines conditions, avoir un<br />
effet bénéfique sur l’évolution d’une gonarthrose, comme le<br />
suggèrent quelques travaux cliniques récents.<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 2S47<br />
CONCLUSION. Devant cet effet ambivalent de l’effort sur le<br />
cartilage, il reste à déterminer le seuil à partir duquel l’activité<br />
physique, de chondroprotectrice, devient chondrotoxique.<br />
*L. Galois, Service Orthopédie Traumatologie, Hôpital Central,<br />
29, avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny,<br />
CO n o 34, 54035 Nancy Cedex.<br />
64 Faut-il <strong>des</strong> radiographies standard<br />
pour tout traumatisme isolé du<br />
genou ?<br />
C. BOÉRI*, J.-Y. JENNY, J.-C. DOSCH,<br />
M. DUPUIS, A.MOUSSAOUI, F.MAIROT<br />
INTRODUCTION. Les critères d’Ottawa proposent de ne<br />
pratiquer <strong>des</strong> radiographies après un traumatisme du genou que si<br />
l’un au moins <strong>des</strong> critères cliniques suivants est présent : âge<br />
supérieur à 55 ans, douleur à la palpation de la tête de la fibula,<br />
douleur à la palpation de la face antérieure de la patella, impossibilité<br />
de fléchir le genou au-delà de 90°, incapacitéàfaire 4 pas<br />
immédiatement après le traumatisme et lors de la consultation en<br />
urgence. Les auteurs ont réalisé une étude prospective et continue<br />
afin de valider cette règle dans leur pratique quotidienne.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Ont été inclus, de décembre<br />
2001 à janvier 2002, tous <strong>les</strong> patients ayant consulté en urgence<br />
pour un traumatisme récent isolé d’un genou. Ont été exclus <strong>les</strong><br />
patients de moins de 10 ans, <strong>les</strong> plaies isolées, <strong>les</strong> traumatismes<br />
datant de plus de 2 jours, <strong>les</strong> patients ayant <strong>des</strong> antécédents<br />
traumatiques du même genou. Les patients ont été examinés en<br />
urgence, en répertoriant <strong>les</strong> critères d’étude, et <strong>des</strong> radiographies<br />
standard de face et de profil en position couchée ont été réalisées<br />
de façon systématique. Les patients et <strong>les</strong> radiographies ont été<br />
revus secondairement par un chirurgien orthopédiste et un radiologue<br />
confirmés, en notant l’existence d’une fracture nécessitant<br />
une prise en charge thérapeutique spécifique. La sensibilité, la<br />
spécificité et <strong>les</strong> valeurs prédictives positive et négative de la<br />
règle d’Ottawa pour la recherche d’une fracture ont été calculés.<br />
RÉSULTATS. Cent trente huit patients ont rempli <strong>les</strong> critères<br />
d’inclusion. La sensibilité et la valeur prédictive négative de la<br />
règle d’Ottawa étaient de 100 % ; la spécificité était de 36 %, et<br />
la valeur prédictive positive de 25 %. 19 fractures nécessitant une<br />
prise en charge thérapeutique spécifique (14 %) ont été détectées<br />
; tous <strong>les</strong> patients avaient au moins un signe positif. 76<br />
patients sans fracture (55 %) avaient au moins un signe positif. 43<br />
patients sans fracture (31 %) n’avaient aucun signe positif ; a<br />
posteriori, <strong>les</strong> radiographies auraient pu être évitées chez ces<br />
patients.<br />
DISCUSSION – CONCLUSION. Cette étude valide la règle<br />
d’Ottawa dans le contexte d’exercice <strong>des</strong> auteurs. La diffusion de<br />
cette règle pourrait permettre d’éviter environ un tiers <strong>des</strong> radiographies<br />
réalisées pour un traumatisme récent isolé du genou.<br />
*C. Boéri, CTO, 10, avenue Baumann, 67400 Illkirch.
2S48 77 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
65 Evaluation isocinétique prospective<br />
de la récupération musculaire après<br />
reconstruction du ligament croisé<br />
antérieur utilisant le DI-DT<br />
F. BUSCAYRET*, C. BUSCAYRET, P.MAURY<br />
INTRODUCTION. Nous nous sommes intéressés à la récupération<br />
musculaire précoce du genou, par un testing isocinétique<br />
sur Biodext, aprèsprélèvement <strong>des</strong> ischio-jambiers pour reconstruction<br />
arthroscopique du ligament croisé antérieur (LCA).<br />
MATÉRIEL. Il s’agit d’une série consécutive prospective de<br />
22 sportifs, 12 sportifs de loisir et 10 compétiteurs, présentant<br />
une rupture isoléeduLCA,opérés, par le même chirurgien, selon<br />
la même technique de ligamentoplastie intra et extra-articulaire<br />
par le gracilis et le semi-tendineux. Les mêmes consignes de<br />
rééducation sont appliquées à tous <strong>les</strong> sujets.<br />
MÉTHODE. Une évaluation <strong>des</strong> fléchisseurs et <strong>des</strong> extenseurs<br />
<strong>des</strong> 2 genoux a été réalisée pour chaque patient sur un appareillage<br />
Biodext en mode isocinétique concentrique. Ces tests<br />
ont été effectués à 2 vitesses, 90 et 180°/s, et aux 3 dates<br />
suivantes : en préopératoire, à 4 mois et à 7 mois postopératoires.<br />
Nous avons retenu lors de tous ces tests le pic de couple et la<br />
puissance moyenne au cours d’une série de 6 flexions-extensions.<br />
Les valeurs du genou sain ont été stab<strong>les</strong> aux 3 dates. Nous<br />
avons alors choisi la valeur préopératoire du genou sain de<br />
chaque patient comme référence appariée. Nous comparons donc<br />
par une analyse de variance en doub<strong>les</strong> mesures répétées, le<br />
genou opéré àcette valeur.<br />
RÉSULTATS. Au 4 e mois postopératoire, fléchisseurs et<br />
extenseurs sont significativement diminués (p < 0,05), et de<br />
manière équivalente. Mais, 25 % <strong>des</strong> patients ont déjà atteint le<br />
seuil de 80 % de récupération autorisant la reprise du sport.<br />
Au 7 e mois postopératoire, <strong>les</strong> extenseurs ont complètement<br />
récupéré, et<strong>les</strong>fléchisseurs restent significativement diminués<br />
(lié au prélèvement <strong>des</strong> ischio-jambiers) ; ainsi 65 % <strong>des</strong> patients<br />
ont atteint 80 % de récupération, <strong>les</strong> fléchisseurs étant le facteur<br />
limitant. Par contre, 90 % <strong>des</strong> compétiteurs ont récupéréàplus de<br />
80 %. D’autre part, l’analyse statistique a permis de corréler<br />
positivement la récupération musculaire au 7 e mois et le niveau<br />
musculaire préopératoire : <strong>les</strong> patients partis de plus haut arrivent<br />
plus haut.<br />
DISCUSSION – CONCLUSION. Ces résultats suggèrent :<br />
d’intégrer une rééducation préopératoire (pour partir de plus<br />
haut), d’accroître le travail sur <strong>les</strong> fléchisseurs (facteur limitant),<br />
et de fixer de nouveaux objectifs de récupération : 80 % à 4 mois,<br />
100 % à 7 mois.<br />
Nous décidons actuellement la reprise sportive d’un point de<br />
vue musculaire selon <strong>les</strong> résultats <strong>des</strong> tests isocinétiques qui<br />
seront effectués au4 e mois pour le compétiteur, et au 7 e mois<br />
pour le sportif de loisir.<br />
*F. Buscayret, Service d’Orthopédie 1, Hôpital Lapeyronie, 371,<br />
avenue du Doyen-Gaston-Giraud, 34295 Montpellier Cedex 5.<br />
66 La règle <strong>des</strong> 3-6° de valgus postopératoire<br />
pour obtenir un bon<br />
résultat à 10-13 ans après une<br />
ostéotomie tibiale de valgisation<br />
est-elle valable ? Influence <strong>des</strong><br />
index tibio-fémoraux<br />
P. PAILLARD*, D. GOUTALLIER, C.RADIER,<br />
S. VAN DRIESSCHE<br />
En 1986, il avait été montré qu’il fallait, pour obtenir un bon<br />
résultat radio-clinique 10 à 13 ans après une ostéotomie tibiale de<br />
valgisation effectuée pour traiter une gonarthrose fémoro-tibiale<br />
interne, que le valgus frontal à ce recul soit entre 3 et 6°. Nous<br />
avions donc pensé qu’il fallait en post opératoire obtenir un<br />
valgus entre 3 et 6°.<br />
En 1995, il avait été montré que le côté de la détérioration<br />
arthrosique dans <strong>les</strong> genoux primitivement axés (entre 2° de<br />
varus et 2° de valgus) ou en genu valgum (≥ 3° de valgus)<br />
dépendait de la valeur <strong>des</strong> index tibio-fémoraux. Un index positif<br />
(torsion tibiale supérieure à la torsion fémorale) favorisait la<br />
survenue d’une arthrose fémoro-tibiale interne et d’une varisation<br />
progressive. Un index négatif favorisait la survenue d’une<br />
arthrose fémoro-tibiale externe et d’une valgisation progressive.<br />
Le valgus post ostéotomie peut-il être modifié par la valeur <strong>des</strong><br />
index tibo-fémoraux et empêcher à 10-13 ans l’obtention de la<br />
correction idéale ?<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Quarante-cinq genoux avec une<br />
gonarthrose fémoro-tibiale interne ont été traités entre 1987 et<br />
1990 par une ostéotomie tibiale de valgisation d’ouverture<br />
interne. Les 45 genoux ont été fonctionnellement évalués à un<br />
recul moyen de 11 ans (de 10 à 13 ans). Tous <strong>les</strong> genoux avaient<br />
eu une évaluation par une goniométrie effectuée debout de la<br />
réaxation frontale post opératoire après consolidation et de la<br />
réaxation frontale au recul maximum. 38 d’entre eux avaient eu<br />
un scanner de torsion permettant de mesurer l’index tibiofémoral.<br />
RÉSULTATS. Au recul maximum, on notait 58 % de bons<br />
résultats, 24 % de résultats moyens et 18 % de mauvais résultats.<br />
Il n’y avait pas de différence statistique entre ces chiffres.<br />
La réaxation frontale évoluait dans le temps. Parmi <strong>les</strong> 36<br />
genoux bien réaxés (entre 3 et 6° de valgus) après la consolidation,<br />
4 avaient augmenté leur valgus au-delà de 6° et 5 avaient<br />
perdu du valgus passant sous la barre <strong>des</strong> 3°. Par contre, 3 <strong>des</strong> 5<br />
genoux hypocorrigés avaient atteints le valgus idéal au recul<br />
maximum.<br />
Parmi <strong>les</strong> 38 genoux ayant eu un scanner de torsion, 33 étaient<br />
bien corrigés en post opératoire et 22 l’étaient au recul maximum.<br />
Il n’y avait pas de différence statistique entre <strong>les</strong> résultats fonctionnels<br />
bons, moyens ou mauvais parmi <strong>les</strong> 33 genoux bien<br />
corrigés en post opératoire (entre 3 et 6° de valgus). Par contre,<br />
une différence statistique existait entre <strong>les</strong> bons (64 %), moyens<br />
(27 %) et mauvais (9 %) résultats fonctionnels parmi <strong>les</strong> genoux<br />
qui avaient au recul maximum le valgus idéal (p = 0,03).<br />
La variation <strong>des</strong> goniométries entre le post opératoire et le<br />
recul maximum dépendait statistiquement de l’index tibiofémoral<br />
(p = 0,0005). Avec un index inférieur à 13°, la majorité
<strong>des</strong> genoux avait augmenté leur valgus (13 fois sur 19) ; avec un<br />
valgus supérieur ou égal à 13°, 12 <strong>des</strong> 19 genoux avaient perdu<br />
du valgus.<br />
CONCLUSION. Pour avoir le maximum de chance d’obtenir<br />
un bon résultat fonctionnel 10 à 13 ans après une ostéotomie<br />
tibiale de valgisation, il faut que le valgus à ce recul soit entre 3<br />
et 6°. Mais, pour obtenir ce valgus, il faudrait moduler le valgus<br />
post opératoire en fonction de l’index tibio-fémoral. Un index<br />
supérieur ou égal à 13° doit pousser à obtenir un valgus post<br />
opératoire vers 6° ; un index inférieur à 13° doit faire préférer une<br />
valgisation vers <strong>les</strong> 3° de valgus voire moins.<br />
*P. Paillard, Service de Chirurgie Orthopédique,<br />
Hôpital Henri-Mondor, 51, avenue de Lattre-de-Tassigny,<br />
94010 Créteil.<br />
67 Etude prospective randomisée<br />
comparant l’articulation fémoropatellaire<br />
de 4 types de prothèses<br />
tota<strong>les</strong> de genou<br />
M. BERCOVY*, A. DURON, H.SINEY, E.WEBER,<br />
M. ZIMMERMAN<br />
Ce travail présente une étude comparative du fonctionnement<br />
<strong>des</strong> fémoro-patellaires (FP) de 4 types de PTG dans le but de<br />
mettre en évidence <strong>les</strong> relations entre la forme <strong>des</strong> FP et <strong>les</strong><br />
résultats fonctionnels <strong>des</strong> prothèses.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Quarante dossiers de patients<br />
opérés de PTG de 1 re intention pour gonarthrose isolée ont été<br />
sélectionnés par tirage au sort. Le recul minimum était de 1 an ;<br />
le score fonctionnel IKS supérieur à 85/100. Il s’agissait toujours<br />
de PTG sans conservation du LCP :<br />
− Postérostabilisée à plateau fixe, trochlée torique, rotule en<br />
dôme cimentée (n = 10).<br />
− PTG à plate-forme rotatoire, trochlée à 2 facettes, rotule<br />
congruente rotatoire (n = 10).<br />
− PTG à plate-forme rotatoire, trochlée à 2 facettes, sans<br />
resurfaçage (n = 10).<br />
− PTG à plate-forme rotatoire, trochlée anatomique creuse (n =<br />
10).<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 2S49<br />
Les paramètres étudiés ont été préparés defaçon prospective.<br />
Ils ont comporté :<br />
− Une évaluation analogique de la douleur sur échelle numérique.<br />
− Une évaluation clinique de la montée et <strong>des</strong>cente <strong>des</strong> escaliers<br />
(normale, marche par marche, avec rampe).<br />
− Une étude cinématique de la flexion extension active (0° à<br />
120°) au cours de laquelle nous avons mesuré la position de la<br />
rotule dans <strong>les</strong> 3 plans et sa trajectoire par rapport au coté sain<br />
ainsi que le moment du quadriceps.<br />
− L’efficacité du quadriceps mesurée au Cibex.<br />
RÉSULTATS. Au plan cinématique nous avons constaté une<br />
différence significative entre :<br />
− <strong>les</strong> PTG avec rotule en dôme et <strong>les</strong> PTG à rotule anatomique<br />
;<br />
− <strong>les</strong> PTG avec trochlée anatomique et <strong>les</strong> trochlées anatomiques<br />
creuses.<br />
Cette différence porte essentiellement la bascule rotulienne, la<br />
subluxation latérale de la rotule et surtout sur le rayon de la<br />
trajectoire rotulienne entre 20° et 90°, <strong>les</strong> trochlées toriques avec<br />
rotule en dôme ayant une trajectoire plus antérieure que celle du<br />
genou normal.<br />
Au plan clinique et fonctionnel il apparaît que :<br />
− Le pourcentage de fémoro-patellaires totalement indolore<br />
est supérieur pour <strong>les</strong> trochlées anatomiques creuses (96 %) par<br />
rapport aux 3 autres <strong>des</strong>sins (75 %) (p = 0,04).<br />
− La fonction escaliers est supérieure pour toutes <strong>les</strong> trochlées<br />
anatomiques par rapport aux trochlées en dôme (p = 0,05).<br />
− L’efficacité du quadriceps est identique dans <strong>les</strong> 4 types de<br />
PTG.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. Cette étude confirme <strong>les</strong><br />
travaux théoriques de Walker et cliniques de Andriacchi sur la<br />
courbure antérieure de la trochlée etcinématiques de Stiehl sur<br />
l’avantage <strong>des</strong> trochlées anatomiques.<br />
Elle fait ressortir l’avantage de la trochlée anatomique creuse<br />
dans laquelle la rotule prend appui sur une gorge trochléenne<br />
située à la même profondeur que celle de la trochlée naturelle, ce<br />
qui n’est pas le cas de la plupart <strong>des</strong> PTG. Cet avantage apparaît<br />
tant pour l’absence de douleur que pour la propulsion lors de la<br />
montée <strong>des</strong>cente <strong>des</strong> escaliers.<br />
*M. Bercovy, Clinique Les Fontaines,<br />
54, boulevard Aristide-Briand, 77000 Melun.
2S50 77 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
SÉANCES PROFESSIONNELLES<br />
68 Evaluation <strong>des</strong> pratiques professionnel<strong>les</strong><br />
J. CATON<br />
Secrétaire Général du SNCO<br />
INTRODUCTION. Quels sont <strong>les</strong> grands principes de la loi n o 98-1194 du 23 décembre 98 du décret n o 99-1130 du 28 décembre 99<br />
réglant le problème de l’évaluation <strong>des</strong> pratiques professionnel<strong>les</strong> ?<br />
Le décret rappelle que l’évaluation <strong>des</strong> pratiques professionnel<strong>les</strong> a pour finalité l’amélioration de la qualité <strong>des</strong> soins. Cette évaluation<br />
concerne tous <strong>les</strong> médecins exerçant la médecine dans le cadre libéral, qu’ils soient généralistes ou spécialistes.<br />
L’engagement dans la démarche doit être volontaire. Les médecins engagés dans l’évaluation sont <strong>les</strong> seuls <strong>des</strong>tinataires <strong>des</strong><br />
conclusions et ils reçoivent pour cela l’aide de confrères habilités qui <strong>les</strong> accompagnent dans la démarche d’évaluation.<br />
Deux types d’évaluation sont possib<strong>les</strong> : l’évaluation individuelle et l’évaluation collective.<br />
ORGANISATION. La responsabilité de l’organisation de l’évaluation <strong>des</strong> pratiques professionnel<strong>les</strong> repose sur <strong>les</strong> Unions Régiona<strong>les</strong><br />
<strong>des</strong> médecins Libéraux et sur leurs Collèges de médecins généralistes et de médecins spécialiste.<br />
L’ANAES apporte son concours en terme de méthode et d’outil d’évaluation. L’évaluation <strong>des</strong> pratiques professionnel<strong>les</strong> est menée<br />
à partir de gui<strong>des</strong> élaborés ou validés par l’ANAES qui sont <strong>les</strong> référentiels.<br />
Les Unions Professionnel<strong>les</strong> <strong>des</strong> Médecins Libéraux recrutent <strong>les</strong> médecins habilités à l’évaluation et <strong>les</strong> rémunèrent. L’ANAES<br />
habilite <strong>les</strong> médecins, assure leur formation initiale et continue, conduit leur propre auto-évaluation et élabore ou valide <strong>les</strong> gui<strong>des</strong><br />
d’évaluation et <strong>les</strong> référentiels permettant ainsi aux médecins habilités d’accompagner <strong>les</strong> professionnels.<br />
Ces médecins évaluateurs sont recrutés après appel de candidatures, formés etsélectionnés par l’ANAES.<br />
Quatre Unions régiona<strong>les</strong> sont entrées actuellement dans le processus : l’Ile de France, le Nord Pas de Calais, la Basse Normandie et<br />
la Lorraine. Après le bilan de ces quatre Unions, quatre nouvel<strong>les</strong> Unions rentreront à nouveau dans ce processus.<br />
En ce qui concerne <strong>les</strong> référentiels <strong>les</strong> Sociétés Savantes doivent s’impliquer dans leur confection, <strong>les</strong> médecins ainsi évalués devraient<br />
être théoriquement labellisés.<br />
CONCLUSION.L’évaluation <strong>des</strong> Pratiques Professionnel<strong>les</strong> permet de porter une appréciation sur la qualité <strong>des</strong> pratiques de soins, de<br />
faire <strong>des</strong> recommandations pour <strong>les</strong> améliorer, c’est une incitation. Elle est à distinguer de la formation médicale continue qui aboutit à<br />
une recertification par le Conseil de l’Ordre ou de l’accréditation <strong>des</strong> établissements réalisés par l’ANAES.<br />
69 Problèmes pratiques de l’installation en libéral<br />
Contrats, comptabilité, fiscalité, gestion sociale, assurances<br />
J-.M. ARTIGOU<br />
Melun<br />
Seront abordés <strong>les</strong> problèmes administratifs, fiscaux, <strong>les</strong> assurances, sujets le plus souvent inconnus de ceux qui s’installent en<br />
médecine libérale.<br />
I) Sujets administratifs :<br />
<strong>les</strong> contrats d’exercice professionnel et d’association qui sont une obligation légale et qui doivent être transmis au Conseil de l’Ordre dans<br />
<strong>les</strong> trois mois qui suivent la date d’installation,<br />
<strong>les</strong> contrats SCM,<br />
l’Ordre <strong>des</strong> Médecins<br />
l’inscription obligatoire,<br />
<strong>les</strong> missions du Conseil départemental,<br />
le rôle du Conseil régional et du national,<br />
la SAS,<br />
la convention,<br />
la NGAP,<br />
le bordereau 615,<br />
II) Le social, la fiscalité, la comptabilité :<br />
l’AGA, la gestion du personnel, <strong>les</strong> obligations fisca<strong>les</strong> avec <strong>les</strong> recettes, <strong>les</strong> dépenses, <strong>les</strong> amortissements chapitre lourd et très important.<br />
III) Les assurances<br />
Notre couverture sociale est très mauvaise, nous verrons :<br />
<strong>les</strong> caisses obligatoires : URSSAF et CARMF, la RCP devenue obligatoire depuis mars 2002, l’assurance accident du travail, <strong>les</strong><br />
assurances personnel<strong>les</strong>, indemnités journalières, assurance remplaçant, perte d’exploitation, protection juridique..., la loi Madelin, la<br />
tontine.<br />
Ces chapitres seront traités séparément, avec la possibilité pour l’auditoire de poser <strong>des</strong> questions à la fin de chaque chapitre.
71 La prothèse totale de cheville dans<br />
la polyarthrite rhumatoïde<br />
M. BONNIN*, M. BOUYSSET, J.TEBIB, E.NOËL,<br />
F. BUSCAYRET<br />
INTRODUCTION. Le but de l’étude était d’évaluer <strong>les</strong> résultats<br />
de la prothèse totale de cheville (PTC) dans la polyarthrite<br />
rhumatoïde (PR) et en préciser <strong>les</strong> difficultés techniques.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Entre 1993 et 1999, 32 PTC<br />
pour PR ont été mises en place (MPB) : 26 femmes et 16<br />
hommes, âge moyen à l’intervention 55 ans (32 à 81), durée<br />
d’évolution de la PR 17 ans (2 à 35). 18 étaient traités par<br />
corticoï<strong>des</strong> aux longs cours et 17 par Methotrexate. Il s’agissait<br />
de PTC non cimentées avec patin mobile : 7 Buechel-Pappas, 5<br />
S.T.A.R. et 20 Salto. En post opératoire, un plâtre de marche était<br />
mis en place pour 45 jours. Dans 21 cas, une arthrodèse sous<br />
talienne et médiotarsienne (ASTMT) a été associée à la PTC du<br />
fait d’une arthrite associée sous talienne (ST) ou d’une bascule en<br />
valgus par tendinopathie du tendon du tibial postérieur (TTP).<br />
Tous <strong>les</strong> patients ont été suivis avec consultation et bilan radiographique<br />
à 3 mois, 6 mois, 1 an puis tous <strong>les</strong> ans depuis<br />
l’intervention. Aucun n’a été perdu de vue. Le recul moyen est de<br />
57 mois (26 à 90). Les résultats cliniques ont été évalués à l’aide<br />
du score de l’AOFAS.<br />
RÉSULTATS. Deux échecs ont nécessité une reprise chirurgicale<br />
: un <strong>des</strong>cellement de pièce talienne avec migration après 4<br />
ansanécessité une arthrodèse ; une pièce talienne surdimensionnée<br />
source de douleurs et a été changée après 1 an avec un bon<br />
résultats (score AOFAS = 92). Parmi <strong>les</strong> 30 cas restant, le score<br />
moyen global et le score douleur sont respectivement de 82/100<br />
(73 à 92) et 35/40 (20 à 40). Plusieurs complications ont été<br />
observées:2nécroses cutanées sur cicatrice, 1 enfoncements de<br />
pièce taliennne et 2 de la pièce tibiale se sont produits à la reprise<br />
de l’appui et n’ont pas évolués. Une malposition de la pièce<br />
tibiale (translation antérieure) est asymptomatique et deux fractures<br />
de malléole médiale ont consolidés sans difficultés.<br />
DISCUSSION – CONCLUSION. La PTC est le traitement de<br />
choix dans l’arthrite tibio-tarsienne rhumatoïde. Les lésions associées<br />
de l’arriére pied influencent le pronostique et <strong>les</strong> résultats.<br />
Une analyse préopératoire de la déformation et <strong>des</strong> pertes de<br />
substances osseuses doit être réalisée par examen clinique, radiographique<br />
et par scanner. Une déformation en valgus par atteinte<br />
sous talienne ou du TTP nécessite l’association d’une ASTMT.<br />
Séance du 13 novembre après-midi<br />
*M. Bonnin, Clinique Sainte-Anne-Lumière,<br />
85, cours Albert-Thomas, 69003 Lyon.<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 2S51<br />
CHEVILLE/PIED<br />
72 Prothèse totale de cheville reprise<br />
par arthrodèse<br />
A. GABRION*, O. JARDE, E.HAVET, P.MERTL,<br />
M. DE LESTANG<br />
INTRODUCTION. L’arthroplastie totale de cheville reste une<br />
intervention difficile et dont <strong>les</strong> suites rendent parfois nécessaire<br />
une reprise par arthrodèse.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. L’étude porte sur neuf prothèses<br />
tota<strong>les</strong> de cheville posées dans la majorité <strong>des</strong> cas pour une<br />
arthrose post-traumatique et dont le résultat s’est détérioré nécessitant<br />
la réalisation d’une arthrodèse. Seule une patiente souffrait<br />
d’une polyarthrite rhumatoïde.<br />
Le délai de reprise était compris entre 6 mois et 7 ans.<br />
L’arthrodèse a été motivée essentiellement par <strong>les</strong> phénomènes<br />
douloureux liés ounonà l’existence d’un <strong>des</strong>cellement ou d’une<br />
nécrose du talus. Une patiente présentait une importante déviation<br />
de l’arrière pied secondaire à un <strong>des</strong>cellement progressif. Un<br />
patient présentait un sepsis précoce.<br />
Huit patients ont bénéficié d’une greffe iliaque pour combler le<br />
défect osseux.<br />
L’ostéosynthèse a été effectuée dans 6 cas par plaque vissée<br />
antérieure, dans un cas par vissage en croix, dans un cas par clou<br />
tibio-astragalien, dans un cas par fixateur externe (cas septique).<br />
RÉSULTATS. Huit patients ont consolidé avec un bon résultat<br />
sur la douleur. Le résultat fonctionnel dépendait du type d’arthrodèse<br />
: talo-crurale isolée ouétendue au couple de torsion.<br />
DISCUSSION. L’évolution <strong>des</strong> prothèses actuel<strong>les</strong> vers une<br />
économie du stock osseux permet dans notre expérience une<br />
reprise par arthrodèse dans de relatives bonnes conditions en<br />
utilisant une greffe iliaque. Le mode d’ostéosynthèse n’est pas<br />
univoque mais notre préférence va à la plaque vissée antérieure<br />
garante d’une excellente rigidité.<br />
*A. Gabrion, CHU Nord, place Victor-Pauchet,<br />
80054 Amiens Cedex 1.
2S52 77 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
73 Maux perforants diabétiques avec<br />
ostéite, cellulite ou nécrose, traités<br />
par chirurgie orthopédique : résultats,<br />
intérêt <strong>des</strong> examens bactériologiques<br />
préopératoires et <strong>des</strong><br />
examens radiologiques complémentaires<br />
J.-L. BESSE*, P. MICHON, M.KAWCHAGIE,<br />
X. DUCOTTET, B.MOYEN, J.ORGIAZZI<br />
INTRODUCTION. Depuis 1996, notre équipe pluridisciplinaire<br />
médico-chirurgicale, a pris l’option du traitement<br />
chirurgical orthopédique <strong>des</strong> maux perforants diabétique avec<br />
ostéite, cellulite ou nécrose (en « refroidissant » préalablement<br />
<strong>les</strong> lésions septiques aiguës afin de permettre une chirurgie<br />
programmée), plutôtqu’un traitement conservateur avec antibiothérapie<br />
prolongée.<br />
Nous rapportons une étude prospective de 44 maux perforants<br />
diabétiques.<br />
PATIENTS ET MÉTHODES. Trente-deux patients diabétiques<br />
ont été opérés :homme=77%;âge moyen = 65,2 ± 8,6 ans<br />
(43-86) ; diabète type 2 = 87 % ; antécédents de maux perforants<br />
=52%,d’amputations mineures = 45 %, et de chirurgie vasculaire<br />
= 14 %. Les lésions (maux perforants avec ostéite = 34,<br />
nécroses vasculaires d’orteils = 2, et « pieds aigus » avec cellulite<br />
= 8) avaient évolué en moyenne 13,2 ± 15,1 semaines.<br />
Le bilan pré-opératoire <strong>des</strong> patients comportait : <strong>des</strong> prélèvements<br />
bactériologiques, 89 % ; <strong>des</strong> radiographies simp<strong>les</strong> du<br />
pied, 100 % (ostéite 84 %) ; un écho-doppler artériel <strong>des</strong> membres<br />
inférieurs, 77 % (artériopathie jambière 87 %) ; une (double)<br />
scintigraphie osseuse, 34 % (ostéite 93 %) ; une mesure de la<br />
TcP02 (40 ± 14 mm Hg) ; une artériographie, 27 % ; et un avis du<br />
chirurgien vasculaire, 18 %.<br />
Avant l’intervention chirurgicale, 77 % <strong>des</strong> patients ont été<br />
hospitalisés en endocrinologie (13 ± 3 jours), et 88 % ont eu une<br />
antibiothérapie pendant une moyenne de 26 ± 18 jours (50 %<br />
I.V.).<br />
La chirurgie orthopédique (sans garrot – sous bloc anesthésique<br />
– durée moyenne = 53 ± 24 min) a comporté :23%de<br />
résection partielle d’orteil, 36 % d’amputation de rayon (1 premier<br />
rayon, 5 second, 1 troisième, 2 quatrième, 6 cinquième),<br />
32 % d’amputation trans-métatarsienne, 4 % de résection de têtes<br />
métatarsienne, 1 calcanéctomie, et 1 amputation de jambe ; ainsi<br />
que <strong>des</strong> prélèvements systématiques bactériologiques multip<strong>les</strong><br />
(tissus mous profonds et tissus osseux) et <strong>des</strong> prélèvements<br />
osseux <strong>des</strong>tinés à l’anatomo-pathologie.<br />
RÉSULTATS. La durée moyenne d’hospitalisation en chirurgie<br />
orthopédique a été de 4 ± 1 jours, suivie de 18 ± 10 jours en<br />
endocrinologie, avec une antibiothérapie (88 % orale) pendant 34<br />
± 22 jours. 91 % <strong>des</strong> lésions ont cicatrisé avec un délai moyen de<br />
33 ± 18 jours ; 4 ont nécessité une chirurgie itérative (2 amputations<br />
trans-métatarsiennes, 1 amputation du premier rayon, 1<br />
amputation de jambe) ; 3 ont récidivé.<br />
Les résultats <strong>des</strong> bactériologies per-opératoires <strong>des</strong> tissus mous<br />
profonds et du tissu osseux vs pré-opératoires ont objectivé une<br />
stérilisation avec <strong>les</strong> antibiotiques dans seulement 14 % <strong>des</strong> cas ;<br />
une comparaison discordante dans 40 %, partiellement concordante<br />
dans 24 % et totalement concordante dans 24 % <strong>des</strong> cas.<br />
Pour le diagnostic d’ostéite (confirmé par l’histologie <strong>des</strong> prélèvements<br />
osseux lors de l’intervention), <strong>les</strong> RX simp<strong>les</strong> ont été<br />
performantes (diagnostic exact 79 %, sensibilité 87 %, faux –<br />
12 %), ainsi que la scintigraphie osseuse aux polynucléaires<br />
marqués (diagnostic exact 93 %, sensibilité 93 %, faux – 7%).<br />
CONCLUSION. Cette étude prospective a démontré <strong>les</strong> avantages<br />
de la chirurgie programmée sur la chirurgie en urgence, y<br />
compris pour <strong>les</strong> « pieds aigus » :résection limitée, suture primaire,<br />
cicatrisation rapide et antibiothérapie brève. Elle soulève<br />
<strong>des</strong> questions sur la validité <strong>des</strong> examens bactériologiques (non<br />
chirurgicaux) sur <strong>les</strong> maux perforants, même effectuées dans <strong>des</strong><br />
conditions rigoureuses (76 % de prélèvements mono-bactériens)<br />
et sur la possibilité d’une sélection de la flore bactérienne par<br />
l’antibiothérapie.<br />
*J.-L. Besse, Service de Chirurgie Orthopédique,<br />
Centre Hospitalier Lyon Sud, 69495 Pierre-Bénite Cedex.<br />
74 Caractéristiques radiologiques de<br />
l’avant-pied : pieds « normaux »<br />
versus hallux rigidus versus hallux<br />
valgus<br />
J.-L. BESSE*, M. MAESTRO, E.BERTHONNAUD,<br />
F. LANGLOIS, A.MELONI, M.BOUHAROUA,<br />
J. DIMNET, J.-L. LERAT, B.MOYEN<br />
INTRODUCTION. Les facteurs constitutionnels responsable<br />
de la survenue <strong>des</strong> Hallux valgus et <strong>des</strong> Hallux Rigidus restent<br />
peu clairs. Le but de ce travail était de comparer <strong>les</strong> caractéristiques<br />
radiologiques de l’avant-pied de 3 populations : pieds dit<br />
« normaux », hallux rigidus, hallux valgus.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Les sujets étudiés ont eu <strong>des</strong><br />
radiographies de face dorso-plantaire en charge, dans le même<br />
service et selon le même protocole. Les 50 pieds « normaux »<br />
(sans déformation apparente, ni callosité, ni douleur) ont été<br />
sélectionnés parmi le personnel du service d’orthopédie ; l’âge<br />
moyen <strong>des</strong> 25 sujets était de 30,3 ans ± 9,6, 44 % étaient <strong>des</strong><br />
femmes. Les 30 patients porteurs d’Hallux Rigidus opérés<br />
avaient une moyenne d’âge de 57,4 ans ± 10,7 ; 48,4 % étaient<br />
<strong>des</strong> femmes. Les 50 patients porteurs d’Hallux Valgus opérés<br />
avaient une moyenne d’âge de 50,8 ans ± 12,8 ; 92 % étaient <strong>des</strong><br />
femmes.<br />
L’ensemble <strong>des</strong> radiographies ont été numérisées (scanner<br />
Vidar VXR-12 plus), puis analysées par 4 observateurs avec le<br />
logiciel FootLog de mesures semi-automatisées. Nous avons<br />
mesuré <strong>les</strong> paramètres suivants : distance entre le sésamoide<br />
latéral et le 2 e métatarsien (dist SL.M2d), angle M1P1 selon 2<br />
choix de l’axe de M1 (diaphysaire et mécanique), angle DMAA<br />
de M1 (distal metatarsal articular angle) diaphysaire et mécanique,<br />
angle M1M2 diaphysaire et mécanique, angle de Meschan<br />
(M1-M2-M5), distance SM4-M4 (distance entre la ligne passant<br />
par le centre du sésamoide latéral et perpendiculaire à l’axe du<br />
pied, et le centre de la tête de M4 ; un facteur correctif a été
introduit dans la mesure de la distance SM4-M4 pour tenir<br />
compte du recul du sésamoide latéral dans <strong>les</strong> hallux valgus),<br />
index de M1 = d1-d2 (longueur de la tête de M1/SM4 – longueur<br />
de la tête de M2/SM4), maestro 1 = d2-d3, maestro 2 = d3-d4<br />
maestro 3 = d4-d5. Les paramètres mesurés étaient automatiquement<br />
enregistrés sur un fichier Excel ; l’analyse statistique a été<br />
réalisée avec le logiciel SPSS 9.0.<br />
RÉSULTATS – DISCUSSION. La reproductibilité intra- et<br />
inter-observateur <strong>des</strong> mesures et de la classification en morphotypes<br />
a été excellente. La distance SL/M2 était comparable dans<br />
<strong>les</strong> 3 populations, ce qui prouve le caractère relativement fixe du<br />
sésamoide latéral par rapport à M2, et permet de l’utiliser comme<br />
référence de la ligne SM4. L’angle de Meschan n’était pas<br />
discriminant entre <strong>les</strong> 3 populations, de même que la moyenne de<br />
l’index de M1/M2, <strong>les</strong> ang<strong>les</strong> M1P1, M1M2, et le DMAA étaient<br />
différents dans <strong>les</strong> 3 populations ; il existait <strong>des</strong> variations de 2 à<br />
3° en fonction de l’axe mécanique ou diaphysaire. L’analyse <strong>des</strong><br />
morphotypes a permis pour la première fois d’objectiver <strong>des</strong><br />
différences morphologiques de l’avant-pied <strong>des</strong> 3 populations : le<br />
groupe <strong>des</strong> hallux rigidus avait une prédominance d’index plus et<br />
plus-minus, avec <strong>des</strong> formu<strong>les</strong> latéra<strong>les</strong> M23 longs ; alors que le<br />
groupe <strong>des</strong> hallux valgus avait une prédominance de pieds avec<br />
une hypoplasie M4M5.<br />
DISCUSSION – CONCLUSION. La définition de morphotypes<br />
métatarsiens est une approche chiffrée intéressante pour<br />
comprendre la pathologie de l’avant-pied et guider la correction<br />
chirurgicale éventuelle. Les résultats doivent être confirmés par<br />
<strong>des</strong> séries plus gran<strong>des</strong>, ce que permettra le Logiciel FootLog. De<br />
plus il serait souhaitable de combiner ces étu<strong>des</strong> radiologiques<br />
avec <strong>des</strong> étu<strong>des</strong> baropodométriques dynamiques <strong>des</strong> pieds étudiés.<br />
*J.-L. Besse, Service de Chirurgie Orthopédique,<br />
Centre Hospitalier Lyon Sud, 69495 Pierre-Bénite Cedex.<br />
75 Le métatarsus varus global du pied<br />
J.-P. DELAGOUTTE*, D. MAINARD, L.GALOIS,<br />
F. PFEFFER, R.TRAVERSARI<br />
INTRODUCTION. Le métatarsus global du pied est une<br />
déformation de l’avant-pied caractérisée par une déviation<br />
médiale de l’ensemble <strong>des</strong> métatarsiens ; il s’accompagne souvent<br />
d’un hallux valgus et d’un cavus, (dont c’est peut-être une<br />
forme clinique) ainsi que d’une verticalisation du clavier métatarsien<br />
touchant essentiellement le premier rayon.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Nous disposions de 20 patients<br />
dont 15 seulement avaient subi une intervention et servaient à<br />
l’étude, ces derniers comprenant 7 hommes et 8 femmes, d’âge<br />
moyen 43 ans. La lésion était souvent bilatérale (10 fois, mais<br />
seulement 9 de ces cas ont été opérés) mais prédominait d’un côte<br />
dans 5 cas. Les doléances consistaient toujours en <strong>des</strong> métatarsalgies,<br />
soit tota<strong>les</strong> touchant <strong>les</strong> rayons médians (12 cas) soit<br />
localisées sous la première tête métatarsienne (3 cas). Dans tous<br />
<strong>les</strong> cas existait une brièveté du tendon calcanéen, qui aggravait la<br />
surcharge antérieure sous capitale. De même un hallux valgus<br />
était présent dans 12 cas sur 15 ; il était en moyenne de 45 degrés.<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 2S53<br />
Dans un cas nous avons associé au geste sur l’avant-pied, une<br />
ostéotomie de valgisation du calcaneus.<br />
La correction de l’hallux valgus a toujours été effectué lorsqu’il<br />
était présent ; dans trois cas, une ostéotomie de relèvement<br />
du premier métatarsien a été pratiquée isolement, complétée par<br />
le port d’une orthèse plantaire. Dans 9 cas, nous avons effectué<br />
une ostéotomie basale <strong>des</strong> trois métatarsiens médians de relèvement,<br />
valgisation, raccourcissement ; dans trois cas, une ostéotomie<br />
de Weil a été pratiquée.<br />
RÉSULTATS. L’hallux valgus a récidivé dans tous <strong>les</strong> cas où<br />
il a été corrigé, en particulier, le métatarsus varus est réapparu.<br />
Les ostéotomies métatarsiennes basa<strong>les</strong> ont consolidé mais dans<br />
<strong>des</strong> délais très longs (environ 6 mois). Les métatarsalgies se sont<br />
modifiées et siégèrent sous <strong>les</strong> têtes qui n’avaient pas été parfaitement<br />
réaligné. Les ostéotomies de Weil n’ont pas amélioré<br />
l’évolution car, comme <strong>les</strong> ostéotomies basa<strong>les</strong>, el<strong>les</strong> n’ont pas<br />
empêché la récidive du varus global <strong>des</strong> métatarsiens.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. Le métatarsus global est<br />
une déformation redoutable qui répond mal aux traitements<br />
classiques <strong>des</strong> troub<strong>les</strong> de l’avant-pied. Les ostéotomies, quel que<br />
soit leur type, ne parviennent pas à éviter la récidive, non<br />
seulement au niveau <strong>des</strong> rayons externes mais également à<br />
l’hallux. Certains auteurs pensent qu’une arthrodèse métatarsienphalangienne<br />
de l’hallux pourrait permettre de stabiliser la correction<br />
; nous n’en avons pas l’expérience mais nous pensons<br />
qu’au vu de nos résultats par traitement conservateur de la<br />
mobilité articulaire, cette option paraît intéressante. Nous orientons<br />
nos indications dans ce sens, en y associant, non pas une<br />
ostéotomie de Weil au niveau <strong>des</strong> petits orteils mais une ostéotomie<br />
basi-métatarsienne. Un allongement <strong>des</strong> tendons extenseurs<br />
parait également nécessaire.<br />
*J.-P. Delagoutte, CHU de Nancy, Hôpital Central,<br />
29, avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny,<br />
CO n o 34, 54035 Nancy Cedex.<br />
76 Etude rétrospective sur <strong>les</strong> corrélations<br />
entre <strong>des</strong> paramètres<br />
d’empreinte et l’angle de Djian-<br />
Annonier dans l’étude de la voûte<br />
plantaire : résultats d’une série de<br />
158 cas<br />
R. MAES*, Y. ANDRIANNE, F.BURNY<br />
INTRODUCTION. En 1928, Schwartz définit pour la première<br />
fois une mesure quantitative de la voûte plantaire acquise<br />
au départ d’une empreinte plantaire. Depuis, toute une série de<br />
paramètres sont retrouvés dans la littérature.<br />
Le but de ce travail est d’étudier <strong>les</strong> corrélations entre différents<br />
paramètres mesurés sur l’empreinte plantaire et <strong>les</strong> radiographies<br />
du pied en charge.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. La série rétrospective étudiée<br />
comprend un échantillon de 158 patients (35 hommes et 123<br />
femmes) issus de la consultation spécialisée de podologie adulte.<br />
L’âge moyen est de 46 ans avec <strong>des</strong> extrêmes de 14 et 86 ans. Les
2S54 77 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
empreintes plantaires sont acquises, en appui bipodal sur deux<br />
feuil<strong>les</strong> A4, après badigeonnage de la sole plantaire à l’alcool<br />
iodé ou à l’éosine alcoolique en cas d’allergie à l’iode. Pour<br />
étudier l’empreinte plantaire, cinq index graphiques ont été retenus.<br />
Il s’agit de : l’angle d’arche, l’index de Chippaux-Smirak, et<br />
<strong>les</strong> index de contact II, III, IV de Qamra. Les index décrits dans<br />
la littérature qui font appel à un équipement sophistiqué (ordinateur,<br />
planimètre, capteurs de pression, ...) sont délibérément<br />
écartés. Le paramètre radiologique mesuré est l’angle de Djian-<br />
Annonier. Ces mesures ont été choisies car el<strong>les</strong> sont utilisées en<br />
pratique quotidienne dans notre institution.<br />
RÉSULTATS. Les résultats sont évalués pour l’ensemble de la<br />
série (316 pieds) et pour <strong>les</strong> sous-ensemb<strong>les</strong> de 158 pieds gauches<br />
et 158 pieds droits.<br />
La corrélation entre l’angle de Djian-Annonier et <strong>les</strong> cinq<br />
paramètres d’empreinte sélectionnés montre, mis à part pour<br />
l’angle d’arche (r compris entre -0,24 et -0,31), un coefficient r<br />
supérieur à 0,5. La meilleure corrélation est réalisée entre l’angle<br />
de Djian et l’index de Chippaux (ravoisinant 0,60). L’intercorrélation<br />
entre <strong>les</strong> cinq paramètres d’empreinte montre un coefficient<br />
r supérieur à 0,79 sauf pour l’angle d’arche où <strong>les</strong> valeurs<br />
sont négatives.<br />
DISCUSSION. La mesure simple et fiable de l’index de<br />
Chippaux-Smirak a une relation statistique avec l’angle de Djian-<br />
Annonier, meilleure qu’avec <strong>des</strong> index plus sophistiqués comme<br />
par exemp<strong>les</strong> ceux de Qamra dans une population symptomatique<br />
mais ces conclusions s’appliquent à <strong>des</strong> pieds issus d’une<br />
population à distribution gaussienne. En effet, <strong>les</strong> index podométriques<br />
ne sont pas mesurab<strong>les</strong> dans le cas de pieds extrêmes car<br />
l’estimation de la voûte plantaire est réalisée au niveau de la<br />
portion moyenne de l’empreinte. Or, dans le cas d’un pied creux<br />
extrême,iln’y a aucune impression à ce niveau ; et pour un pied<br />
plat extrême, le rapport de la portion imprimée sur la portion non<br />
imprimée est égal à un.<br />
*R. Maes, 321, chaussée de Bruxel<strong>les</strong>,<br />
6042 Ladelinnert, Belgique.<br />
77 L’ostéosynthèse transosseuse dans<br />
l’allongement <strong>des</strong> os tubulaires du<br />
pied<br />
V. SHEVTSOV*, G.-R. ISMAILOV<br />
Le travail présente le traitement de 114 mala<strong>des</strong> (125 pieds) à<br />
l’âge de 9 à 53 ans :<br />
− 82 raccourcissements congénitaux avec hypoplasie métatarsienne,<br />
− 3 moignons du 1er orteil du pied au niveau de la phalange<br />
principale (P1),<br />
− 32 cas post-traumatiques et post-opératoires, y compris 2 cas<br />
après résection <strong>des</strong> têtes métatarsiennes.<br />
Le défaut cosmétique était la plainte essentielle chez la plus<br />
part <strong>des</strong> mala<strong>des</strong> (95 femmes), aussi que <strong>les</strong> complications liées<br />
au chaussage. Les douleurs à l’avant-pied à cause <strong>des</strong> contraintes<br />
biomécaniques entre <strong>les</strong> orteils et <strong>les</strong> métatarsiens.<br />
Une ostéotomie d’allongement (oblique ou transversale) à la<br />
base <strong>des</strong> métatarsiens et <strong>des</strong> phalanges du pied. La fixation <strong>des</strong> os<br />
du pied et <strong>des</strong> fragments osseux a été assurée à l’aide du matériel<br />
externe et de ses modifications allégées. La prévention <strong>des</strong><br />
luxations et subluxations consistait en l’introduction de broches à<br />
travers <strong>les</strong> articulations au cours de l’ostéosynthèse.<br />
On débutait la distraction à 3 e –5 e jour post-opératoire avec le<br />
rythme 0,5-1 mm/24 heures. La charge partielle du membre opéré<br />
en marche était recommandée. Une <strong>des</strong> particularité de la période<br />
de fixation était le démontage progressif du matériel avec l’ablation<br />
<strong>des</strong> broches ce que permettait la rééducation complète <strong>des</strong><br />
orteils et la reprise de la marche. Les mesures prises favorisait la<br />
formation du régénérat osseux et son remaniement en tissu<br />
osseux mûr, et la diminution <strong>des</strong> délais du traitement qui était<br />
dans le groupe analysé de 45 ± 6 jours.<br />
Les résultats ont été suivi sur une période de 1 à 3,5 ans.<br />
L’allongement désiré de l’avant-pied (1,5 à 5cm)aété obtenu<br />
dans tous <strong>les</strong> cas. Le syndrome douleureux a été supprimé,<br />
l’aspect cosmétique du pied et l’appui ont été amélioré. Les<br />
patients sont satisfaits, n’ont pas de plaintes, marchent avec un<br />
appui complet, n’utilisent pas d’orthèses complémentaires, portent<br />
<strong>des</strong> chaussures habituel<strong>les</strong>.<br />
L’expérience du traitement <strong>des</strong> mala<strong>des</strong> avec raccourcissement<br />
<strong>des</strong> os courts tubulaires du pied confirme l’efficacité <strong>des</strong><br />
techniques et <strong>des</strong> moyens utilisées permettant obtenir un bon<br />
résultat cosmétique et anatomo-fonctionnel en une étape de<br />
traitement.<br />
*V. Shevtsov, Centre scientifique de Russie, Orthopédie<br />
et Traumatologie Réparatrice académicien G.A. Ilizarov,<br />
6, rue de M.Oulianova, 640005 Kourgan, Russie.<br />
78 Proposition d’une stratégie chirurgicale<br />
<strong>des</strong> pieds équins d’origine neurologique<br />
centrale de l’adulte<br />
P. DENORMANDIE*, L. MAILHAN, C.KIEFER,<br />
I. LAFFONT, T.JUDET<br />
INTRODUCTION. Les pieds équins sont une déformation<br />
fréquemment observée dans <strong>les</strong> atteintes neurologiques centra<strong>les</strong>.<br />
La stratégie chirurgicale s’appuie sur l’évaluation de la part de la<br />
spasticité et de la rétraction dans la déformation, et de la présence<br />
ou non <strong>des</strong> antagonistes. Nous proposons une stratégie de prise<br />
en charge codifiée etenprésentons <strong>les</strong> résultats sur <strong>les</strong> deux<br />
dernières années.<br />
MATÉRIEL. Tous <strong>les</strong> patients opérés d’un pied équin d’origine<br />
neurologique centrale en 1998 et 1999 ont été inclus dans<br />
cette étude.<br />
MÉTHODES. Les patients inclus ont tous été vus en consultation<br />
pré-opératoire par le chirurgien et un médecin de Médecine<br />
Physique et de Réadaptation. Des blocs neuro-moteurs sélectifs<br />
ont complété l’examen clinique. Ils ont permis l’évaluation de la<br />
spasticité et <strong>des</strong> rétractions (soleus, gastrocnemius, flexor digitalis).<br />
La présence fonctionnelle <strong>des</strong> antagonistes ou <strong>des</strong> musc<strong>les</strong><br />
transférab<strong>les</strong> a été recherchée. Un contrat fonctionnel a été passé<br />
avec le patient. Les patients ont tous été opérés par le même
chirurgien. Ils ont été revus à distance par un examinateur<br />
indépendant. Ont été analysés : <strong>les</strong> gains articulaires, <strong>les</strong> gains<br />
fonctionnels, <strong>les</strong> complications éventuel<strong>les</strong>.<br />
RÉSULTATS. Trente-cinq patients ont été opérés (42 pieds).<br />
Les résultats analytiques ont été bons : gain articulaire moyen de<br />
37,5°.<br />
Les objectifs fonctionnels (marche dans 31 cas, verticalisation<br />
dans 10 cas, confort dans 1 cas) ont été atteints chez tous <strong>les</strong><br />
patients, sauf 5. Il a été observé un talus-eversus, une subluxation<br />
antérieure de l’astragale, une persistance du steppage. Dans 2 cas,<br />
<strong>les</strong> troub<strong>les</strong> neurologiques sous-jacents n’ont pas permis la réalisation<br />
du contrat. De plus, il a été noté 3 griffes, avec un<br />
retentissement fonctionnel modéré.<br />
DISCUSSION. Les rétractions prédominantes rendent difficile<br />
l’évaluation <strong>des</strong> antagonistes et <strong>des</strong> intrinsèques, à l’origine <strong>des</strong><br />
complications observées. La réalisation d’EMG dynamique pourrait<br />
apporter une réponse. L’appréciation de l’état neurologique<br />
sous-jacent conditionne le résultat fonctionnel.<br />
CONCLUSION. Les bons résultats de notre série valident<br />
l’arbre décisionnel que nous proposons. La stratégie chirurgicale<br />
s’inscrit dans un contrat fonctionnel adapté àchaque patient.<br />
*P. Denormandie, Service de Chirurgie Orthopédique,<br />
Hôpital Raymond-Poincaré, 104, boulevard<br />
Raymond-Poincaré, 92380 Garches.<br />
79 Place du Baclofen intrathécal dans<br />
l’évaluation <strong>des</strong> complications<br />
neuro-orthopédiques par rétractions<br />
aux membres inférieurs<br />
P. DENORMANDIE*, E. LÔ, C.KIEFER, D.BEN<br />
SMAIL, I.LAFFONT, B.BUSSEL, J.-B. ELIS,<br />
T. JUDET<br />
INTRODUCTION. Les déformations multip<strong>les</strong> <strong>des</strong> membres<br />
inférieurs sont <strong>des</strong> complications neuro-orthopédiques <strong>des</strong><br />
lésions neurologiques centra<strong>les</strong>. El<strong>les</strong> posent la difficulté de leur<br />
évaluation. Des tests au Liorésalt intrathécal ont été proposés<br />
chez ces patients pour établir <strong>les</strong> parts respectives de la spasticité<br />
et de la rétraction musculo-tendineuse et ainsi définir la stratégie<br />
thérapeutique médico-chirurgicale.<br />
MATÉRIELS ET MÉTHODES. De janvier 1999 à décembre<br />
2000, 31 patients ont consulté pour une prise en charge d’un<br />
f<strong>les</strong>sum de genou. Pour 10 patients chez qui la part de spasticité<br />
et de rétraction était difficile à apprécier cliniquement, <strong>des</strong> tests<br />
au Blacofen intrathécal ont été réalisés.<br />
Une dose de 75 à 100 µg de Baclofen est injectée en intrathécal.<br />
L’effet sur la diminution de la spasticité apparaît dès la<br />
première heure, avec un effet maximal entre la deuxième et la<br />
quatrième heure. Un bilan moteur, articulaire et fonctionnel est<br />
réalisé durant cet intervalle. Le test est répété sur environ trois<br />
jours, avec parfois <strong>des</strong> doses supérieures en fonction de la<br />
réduction de la spasticité obtenue. Les limitations orthopédiques<br />
résiduel<strong>les</strong> s’expliquent par <strong>des</strong> rétractions musculo-tendineuses.<br />
RÉSULTATS. Sur 10 patients évalués, 3 présentaient <strong>des</strong><br />
rétractions musculo-tendineuses relevant d’un traitement chirurgical<br />
tendineux (allongement, désinsertion proximale) parfois<br />
associé àune arthrolyse. Pour <strong>les</strong> 7 patients qui présentaient une<br />
hypertonie spastique, un traitement médical a été instauré dont,<br />
dans 3 cas, une injection continue de Lioresal intrathécal par<br />
pompe. Chez tous ces patients, il yaeuunecorrélation entre<br />
l’importance <strong>des</strong> déformations évaluées après test et l’évaluation<br />
sous anesthésie générale lors de l’intervention.<br />
DISCUSSION. D’autres métho<strong>des</strong> d’évaluation <strong>des</strong> déformations<br />
orthopédiques <strong>des</strong> membres sont utilisées. Les blocs<br />
moteurs sélectifs par injection d’anesthésique local, cependant<br />
ceux-ci s’adressent qu’aux patients présentant <strong>des</strong> raideurs localisées<br />
et sont diffici<strong>les</strong> à réaliser pour évaluer certaines déformations<br />
(f<strong>les</strong>sum de hanche). Les mobilisations sous anesthésie<br />
générale peuvent être réalisées. Cel<strong>les</strong>-ci ne permettent pas<br />
d’apprécier l’éventualité d’un gain fonctionnel, en particulier<br />
dans un objectif de marche.<br />
Le test au Baclofen intrathécal permet non seulement de<br />
confirmer la rétraction orthopédique mais également d’évaluer le<br />
retentissement fonctionnel de la spasticité qui peut parfois être<br />
utile pour la verticalisation ou la marche.<br />
CONCLUSION. Le test par injection intrathécale de Baclofen<br />
est donc un test simple et qui a toute sa place dans l’évaluation<br />
préopératoire et fonctionnelle de la raideur neuro-orthopédique<br />
globale <strong>des</strong> membres inférieurs.<br />
*P. Denormandie, Service de Chirurgie Orthopédique,<br />
Hôpital Raymond-Poincaré, 104, boulevard<br />
Raymond-Poincaré, 92380 Garches.<br />
LE POINT SUR LA MATÉRIOVIGILANCE (CNM-GEDIM)<br />
80 Présentation du GEDIM<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 2S55<br />
S. TERVER<br />
Clermont-Ferrand<br />
Le GEDIM (Groupe d’Évaluation <strong>des</strong> Dispositifs Médicaux) de la SOFCOT fonctionne depuis un an.<br />
Le but de ce groupe de travail est de centraliser <strong>les</strong> informations concernant <strong>les</strong> dispositifs médicaux utilisés en orthopédie, qu’il<br />
s’agisse d’implants, d’ancillaires ou d’autres matériels...<br />
Ces informations proviennent en priorité de Commission Nationale de Matériovigilance, et plus particulièrement de la Commission<br />
Technique numéro 3 qui s’occupe <strong>des</strong> implants.
2S56 77 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
Mais <strong>les</strong> informations peuvent remonter directement de la pratique quotidienne <strong>des</strong> orthopédistes ou <strong>des</strong> contacts directs avec <strong>des</strong><br />
fabricants. En un an de fonctionnement, le GEDIM a ainsi pu aborder un certain nombre de points d’intérêt pratique pour notre activité<br />
quotidienne :<br />
− <strong>les</strong> phénomènes de <strong>des</strong>cellement précoce que certains d’entre nous ont pu observer,<br />
− <strong>les</strong> problèmes posés par <strong>les</strong> ruptures de matériel d’enclouage centro-médullaire,<br />
− <strong>les</strong> questions posées par <strong>les</strong> décès brutaux au ciment,<br />
− <strong>les</strong> problèmes liés à la diffusion métallique autour de frottement connus comme défavorab<strong>les</strong>, tels que le frottement Titane<br />
Polyéthylène,<br />
− <strong>les</strong> problèmes de corrosion ou d’usure anormale de nos instruments du fait du circuit de stérilisation et <strong>des</strong> nouvel<strong>les</strong> directives<br />
concernant le prétraitement.<br />
Dans tous ces cas, le GEDIM essaie de proposer <strong>des</strong> moyens d’analyse, <strong>des</strong> récupérations de données ou <strong>des</strong> mises en place d’étude.<br />
La transmission <strong>des</strong> informations ainsi réunies en milieu orthopédique a pu se faire à travers <strong>les</strong> formations, transmises dans <strong>les</strong><br />
publications habituel<strong>les</strong>, à travers <strong>des</strong> contacts directs avec la SOFCOT ou ses Sociétés Fil<strong>les</strong>, mais également à travers ce rapport d’étape<br />
proposé par la SOFCOT.<br />
Cette année, le milieu orthopédique a été confronté àun problème majeur qui est celui <strong>des</strong> ruptures <strong>des</strong> têtes Zircones.<br />
Une analyse tenant compte :<br />
− du nombre et de la gravité <strong>des</strong> déclarations faites à la Commission Nationale de Matériovigilance<br />
− <strong>des</strong> procédures mises en place par l’AFSSAPS pour analyser ce problème,<br />
− d’un avis d’un expert céramiste,<br />
− <strong>des</strong> conseils proposés par la Société Française de la Hanche et du Genou,<br />
− ainsi que <strong>des</strong> problèmes médicaux légaux,<br />
permettra au chirurgien de mieux comprendre la réalité <strong>des</strong> risques et la conduite proposée selon le niveau de celui-ci pour le chirurgien<br />
et son patient.<br />
83 Etude prospective de la qualité de<br />
vie <strong>des</strong> patients opérés par prothèse<br />
intermédiaire pour fracture<br />
cervicale vraie<br />
S. POULAIN*, P. HARDY<br />
ET LE GROUPE INTERMEDIA<br />
BUT. Les auteurs ont conduit une étude prospective, multicentrique,<br />
concentrique et continue sur 204 patients opérés d’une<br />
fracture de l’extrémité supérieure du fémur entre mai 1999 et<br />
août 2001. Le but était d’évaluer la qualité de vie <strong>des</strong> patients un<br />
an après leur intervention. Dans tous <strong>les</strong> cas, l’implant utilisé a<br />
été la prothèse Intermediat.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. L’âge moyen <strong>des</strong> patients était<br />
de 79,6 ans (± 8,6) composé de 18,8 % d’hommes. La majorité<br />
<strong>des</strong> fractures était de type Garden III et IV (87,4 %), et 90,9 %<br />
étaient récentes (< 21 j.). La prothèse intermédiaire Intermediat<br />
a été implantée par voie postéro-latérale dans 73,9 % <strong>des</strong> interventions,<br />
et un fraisage de l’acétabulum pratiqué pour 13,7 % <strong>des</strong><br />
patients, une tête à jupe a été choisie dans seulement 20,8 % <strong>des</strong><br />
cas. Le score de Robinson côtant la mobilité, le mode de vie, le<br />
degré d’ostéoporose (score de Singh), <strong>les</strong> antécédents (score<br />
ASA), l’indice psychomoteur (score Hodkinson) ont été utilisées<br />
en pré-opératoire 19/26 (± 6,89). Le score de Merle d’Aubigné à<br />
un an a lui aussi été calculé. Une analyse radiographique à un an<br />
a été effectuée pour apprécier l’adaptation de la tige fémorale (3<br />
Séance du 14 novembre matin<br />
TRAUMATOLOGIE<br />
tail<strong>les</strong>) au fût fémoral. Une étude mesurant l’adéquation entre la<br />
tige et le fût fémoral selon Kobayashi qui mesure le taux de<br />
remplissage de la tige dans le fûtfémoral permet de déterminer si<br />
le contrat d’autoblocage prévu avec seulement trois tail<strong>les</strong><br />
d’implant était bien respecté.<br />
RÉSULTATS. Onze (5,4 %) luxations postérieures ont été<br />
observées dont 4 ont été réduites orthopédiquement. Sur <strong>les</strong> 203<br />
patients, 40 (19,7 %) ont été perdus de vue, 34 patients sont<br />
décédés (16,7 %). Le score de Merle d’Aubignéàun an montrait<br />
84,7 % de résultats satisfaisants (excellents résultats, TB, B). En<br />
pré-opératoire, 59 % <strong>des</strong> patients étaient indépendants et 7 % en<br />
long séjour, alors qu’ils étaient respectivement 55,5 % et 5 % à<br />
un an post-opératoire. Radiologiquement, le taux de migration<br />
(enfoncement) à un an était de 3,9 p.cent. L’adéquation entre la<br />
tige et le fût fémoral selon Kobayashi dans <strong>les</strong> tiers proximaux,<br />
médian, et distal était respectivement de 73 %, 75 %, et 75 %.<br />
DISCUSSION. La mortalité de la fracture de l’extrémité supérieure<br />
du fémur reste élevée (16,7 % à un an). La morbidité était<br />
de deux infections (1 %) et 11 luxations (5,4 %). La différence de<br />
mobilité et de mode de vie entre le pré et le post-opératoire n’était<br />
pas significative. La simplification due à l’utilisation d’implant à<br />
3 tail<strong>les</strong> n’entraîne pas de différence pour <strong>les</strong> résultats radiographiques<br />
à un an.<br />
*S. Poulain, Hôpital Ambroise-Paré, CHU Paris Ouest,<br />
9, avenue Char<strong>les</strong>-de-Gaulle, 92100 Boulogne.
84 Prothèse totale de hanche après<br />
fracture du col : prévention du risque<br />
luxation par la double mobilité<br />
O. VANEL*, L. BÉGUIN, F.FARIZON, M.-H. FESSY<br />
INTRODUCTION. La fracture du col du fémur du sujet âgé<br />
relève en général d’un traitement par arthroplastie, totale ou<br />
intermédiaire mais toujours marquée par un risque de luxation<br />
élevé de l’ordre de 10 % dans la littérature.<br />
Nous nous proposons de démontrer l’intérêt d’une cupule à<br />
double mobilité pour diminuer ce risque.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Il s’agit d’un travail prospectif,<br />
multi-opérateurs, mené dans un service universitaire. De janvier<br />
1998 à avril 2001, 177 prothèses à mobilité ont été implantées<br />
chez <strong>des</strong> patients présentant une fracture cervicale vraie (145),<br />
une fracture cervico-trochantérienne (22), une fracture pathologique<br />
(4). Dans 6 cas il s’agissait d’une prothèse après échec<br />
d’une ostéosynthèse d’une fracture du massif trochantérien.<br />
Cent trente-six femmes et 41 hommes, âgés de61à92 ans,<br />
vivant à domicile (124) ou en institution avec un haut degré<br />
d’autonomie (53) ont été opérés par voie postéro-externe.<br />
La tige fémorale était cimentée (115) ou impactée (62). Dans<br />
tous <strong>les</strong> cas, la cupule avait un système à double mobilité.<br />
Le couple de frottement était chrome-cobalt/polyéthylène. La<br />
tête avait un diamètre de 28 mm (150) ou de 22,2 mm (27).<br />
Nous avons étudié le devenir et le risque luxant dans l’année<br />
suivant l’intervention.<br />
RÉSULTAT. Nous déplorons 6 décès pendant la période postopératoire.<br />
Sûr 171 patients, 134 ont été revus à 2 mois, 108 à 6<br />
mois et 89 à 1 an ; 39 ont été interrogés pour s’assurer de leur<br />
devenir.<br />
Nous déplorons 37 décès pendant la première année ; le dossier<br />
de ces patients a pu être suivi. Six patients sont perdus de<br />
vue.<br />
Nous avons noté 2 cas de luxation intra-prothétique en rapport<br />
avec un défaut de rétentivité entre la tête chrome-cobalt et le<br />
polyéthylène, nécessitant une reprise chirurgicale ; ces deux cas<br />
ont fait l’objet d’une déclaration de matériovigilance avec<br />
mesure corrective pour le laboratoire.<br />
Nous avons noté 3 luxations vraies (2 %) : 1) une luxation<br />
postérieure, survenue à J 24, chez une patiente présentant une<br />
fracture avec enfoncement de la tige fémorale, 2) une luxation<br />
postérieure aJ22chez une patiente à l’état général très altéré<br />
(défaillance cardio-respiratoire majeure et décès à 48 heures), 3)<br />
une luxation récidivante postérieure en rapport avec une rétroversion<br />
acétabulaire importante reprise chirurgicalement au 4 e<br />
mois.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. La cupule à double mobilité<br />
apparaît comme une méthode simple et reproductible pour<br />
prévenir le risque de luxation <strong>des</strong> arthroplasties pour fracture du<br />
col.<br />
*O. Vanel, Centre d’Orthopédie Traumatologie,<br />
Hôpital Bellevue, CHU de Saint-Etienne,<br />
42055 Saint-Etienne Cedex 2.<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 2S57<br />
85 Fracture associée de l’extrémité<br />
supérieure et de la diaphyse fémorale<br />
: traitement par enclouage verrouillé<br />
de reconstruction. A propos<br />
de 17 cas<br />
G. ASENCIO*, R. BERTIN, P.KOUYOUMDJIAN,<br />
B. MEGY, P.-P. MILL, A.BEN LASSOUED,<br />
Y. ROUSSANNE<br />
Les fractures associées de la diaphyse et du fémur proximal<br />
sont rares : Alho sur une métaanalyse de 1951 à 1985 ne rapporte<br />
que 659 cas de traitements très hétérogènes. Nous rapportons <strong>les</strong><br />
résultats d’une série homogène de 17 cas traités par enclouage<br />
verrouillé antérograde à verrouillage ascendant.<br />
MATÉRIEL D’ÉTUDE. Il s’agissait de 17 patients d’âge<br />
moyen 36 ans, 11 hommes et 6 femmes tous victimes d’un<br />
traumatisme à haute énergie, dont 12 polytraumatisés. La fracture<br />
diaphysaire siégeait au tiers moyen dans 15 cas, au tiers inférieur<br />
dans deux cas ; elle était ouverte dans 6 cas. La fracture proximale<br />
était transcervicale dans 9 cas (7 B21, 1 B22, 1 B23) et<br />
trochantérienne dans 6 cas (1 A32, 1 A31, 2 A12, et 2 A33).<br />
MÉTHODE. Le traitement a comporté une réduction à foyer<br />
fermé sous amplificateur de brillance sur table orthopédique en<br />
décubitus dorsal et une ostéosynthèse par enclouage antérograde<br />
à verrouillage proximal ascendant dans l’axe du col par clou de<br />
reconstruction de Russell et Taylor. L’ostéosynthèse a été réalisée<br />
à J0 dans 11 cas, dans la première semaine dans 3 cas, et au-delà<br />
dans 3 cas.<br />
RÉSULTATS. Ils portent sur <strong>les</strong> 17 cas. Nous déplorons une<br />
supuration superficielle précoce a évolué favorablement après<br />
simple parage. Deux fractures diaphysaires ont pseudarthrosé et<br />
ont été reprises par décortication greffe. Une fracture cervicale<br />
s’est déplacée précocement : reprise au 15 e jour, elle n’a pas<br />
consolidé etanécessité la mise en place d’une prothèse totale de<br />
hanche au 10 e mois. Tous <strong>les</strong> autres foyers ont consolidé de<br />
première intention dans un délai de 3 à 5 mois. A distance, une<br />
nécrose céphalique a été observée à 5 ans de recul, celle-ci a<br />
nécessité une arthroplastie totale.<br />
DISCUSSION. Les fractures associées proxima<strong>les</strong> et diaphysaires<br />
du fémur représentent entre 1 et 5 % <strong>des</strong> fractures du fémur<br />
dans la littérature. El<strong>les</strong> concernent <strong>des</strong> sujets jeunes, victimes de<br />
traumatismes à haute énergie et souvent <strong>des</strong> polytraumatisés. Le<br />
diagnostic n’est pas évident devant le faible ou le non déplacement<br />
du foyer proximal et peut être fait secondairement après<br />
enclouage standard (2 sur 17 cas).<br />
Les fractures trochantériennes ne posent généralement pas de<br />
problème de diagnostic, de réduction, ou de consolidation. Les<br />
fractures diaphysaires sont par contre, notablement déplacées,<br />
volontiers comminutives, parfois ouvertes absorbant la plus<br />
grande partie de l’énergie du traumatisme. Leur évolution est<br />
identique à celle <strong>des</strong> fractures unifoca<strong>les</strong> du fémur. Les fractures<br />
cervica<strong>les</strong> sont volontiers basi-cervica<strong>les</strong> à trait vertical El<strong>les</strong><br />
sont peu ou non déplacées.<br />
Le traitement par enclouage centro-médullaire <strong>des</strong> deux foyers<br />
fracturaires par le même matériel est séduisant. Il requiert toutefois<br />
une réduction préalable obligatoire et une stabilisation temporaire<br />
par broches per-cutanées du foyer cervical. L’évolution
2S58 77 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
post-opératoire est généralement simple. Dans le cas contraire,<br />
lorsque le foyer cervical ne peut être parfaitement réduit mieux<br />
vaut recourir à une ostéosynthèse dissociée <strong>des</strong> deux fractures par<br />
un matériel différent.<br />
*G. Asencio, Service d’Orthopédie, CHU de Nîmes,<br />
5, rue Hoche, 30029 Nîmes Cedex 4.<br />
86 Le désassemblage <strong>des</strong> matériels<br />
d’ostéosynthèse <strong>des</strong> fractures peret<br />
sous-trochantériennes : à propos<br />
d’une étude rétrospective de 16 cas<br />
R. TRAVERSARI*, F. PFEFFER, L.GALOIS,<br />
D. MAINARD, J.-P. DELAGOUTTE<br />
Le but de cette étude était d’analyser <strong>les</strong> échecs mécaniques<br />
appelés « désassemblages » <strong>des</strong> ostéosynthèses <strong>des</strong> fractures peret<br />
sous-trochantériennes ostéosynthésées soit par vis-plaque de<br />
type D.H.S, soit clou-vis de type clou Gamma, soit clou-plaque<br />
de type STACA.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Notre cohorte comporte 16 cas<br />
issus d’une série de 350 patients représentant 240 DHS, 80<br />
clous-plaques Staca, et 30 clous Gamma opérés entre 1996 et<br />
1999. Nous avons utilisé la classification de Ender pour l’analyse<br />
radiographique et <strong>les</strong> critères de Cuny correspondant aux causes<br />
<strong>les</strong> plus fréquentes <strong>des</strong> désassemblages.<br />
RÉSULTATS. Selon <strong>les</strong> critères définis, 70 ostéosynthèses/350<br />
(20 %) avaient un résultat jugé insuffisant au bilan radiographique<br />
post-opératoire immédiat évoluant vers un désassemblage<br />
pour 16 cas d’entre eux. Tous présentaient une ostéopénie<br />
majeure selon <strong>les</strong> critères de Singh et dix ont été réopérés en<br />
raison d’une mauvaise tolérance clinique. Il s’agissait de 6 DHS<br />
(3 « balayages » de la vis cervicale, 2 désassemblages de la<br />
plaque, et une protrusion intra-articulaire de la vis). Huit clousplaques<br />
Staca ont présenté une protrusion du clou, et 2 clous<br />
Gamma un « balayage » de la vis. Ces désassemblages concernaient<br />
en grande majorité <strong>les</strong> sta<strong>des</strong> 5, 7, 8 <strong>des</strong> fractures pertrochantériennes<br />
selon Ender.<br />
DISCUSSION. L’analyse de ces cas nous a permis de constater<br />
l’importance de plusieurs facteurs : 1) La qualité de la réduction<br />
du foyer de fracture avec restitution du pilier interne du<br />
massif per-trochantérien. 2) L’ancrage céphalique au centre de la<br />
tête fémorale déterminant dans la stabilité de l’ostéosynthèse. 3)<br />
La supériorité de la tenue de la vis cervicale de la DHS dans <strong>les</strong><br />
sta<strong>des</strong> 1 à 6, en raison d’une surface projetée supérieure augmentant<br />
sa tenue dans l’os spongieux. Nous pensons inversement que<br />
dans <strong>les</strong> fractures sous-trochantériennes (sta<strong>des</strong> 7 et 8), l’ancrage<br />
diaphysaire centromédullaire du clou Gamma diminue <strong>les</strong><br />
contraintes mécaniques en varus donc <strong>les</strong> risques de « balayage »<br />
de la vis. Enfin l’aspect monobloc du clou-plaque Staca, qui n’a<br />
pas la réserve d’impaction que proposent la DHS et le clou<br />
Gamma, l’expose au risque de protrusion surtout dans <strong>les</strong> fractures<br />
dites « en rotation interne » avec comminution métaphysaire<br />
importante (sta<strong>des</strong> 4 et 5). Ce dernier présente toutefois une<br />
très grande efficacité dans <strong>les</strong> fractures per-trochantériennes simp<strong>les</strong>,<br />
peu comminutives (stade 1 à 3).<br />
CONCLUSION. Les problèmesdedésassemblage sont dépendants<br />
de facteurs multip<strong>les</strong> liés aux caractéristiques du matériel et<br />
au respect <strong>des</strong> techniques opératoires. Nous réservons ainsi le<br />
clou plaque Staca aux sta<strong>des</strong> 1 à 3 de la classification de Ender,<br />
la vis-plaque DHS aux sta<strong>des</strong> 1 à 6 et le clou-vis aux fractures<br />
sous-trochantériennes, représentant <strong>les</strong> sta<strong>des</strong> 7 et 8.<br />
*R. Traversari, Service Orthopédie Traumatologie,<br />
Hôpital Central, 29, avenue du Maréchal-de-Lattrede-Tassigny,<br />
CO n o 34, 54035 Nancy Cedex.<br />
87 Ostéosynthèse renforcée au ciment<br />
acrylique pour <strong>les</strong> fractures du sujet<br />
âgé : une série de 44 cas<br />
O. TAÇKIN*, T. BÉGUÉ, A.-C. MASQUELET<br />
INTRODUCTION. La qualité de l’os <strong>des</strong> patients âgés touchés<br />
par l’ostéoporose ne permet pas de compter de façon fiable<br />
sur la tenue du matériel d’ostéosynthèse lors de leur implantation.<br />
L’amélioration de la fixation par ancrage dans du ciment acrylique<br />
peut être utilisée pour renforcer l’ostéosynthèse et assurer<br />
une rééducation précoce. Le but de ce travail était d’examiner la<br />
qualité de la synthèse renforcée au ciment acrylique. D’étudier<br />
pour cette méthode <strong>les</strong> conséquences fonctionnel<strong>les</strong> <strong>des</strong> fautes<br />
techniques, d’analyser <strong>les</strong> complications précoces ou secondaires<br />
et de déterminer avantages et inconvénients à moyen et long<br />
terme sur la qualité de vie et d’éventuel<strong>les</strong> interventions ultérieures<br />
sur le même site fracturaire.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Entre 1990 et 2000, 40 patientes<br />
toutes de sexe féminin, ont été étudiées rétrospectivement. Il<br />
s’agissait de 44 fractures, 38 fémurs (dont deux à double étage) et<br />
4 humérus, qui ont toutes été traitées par ostéosynthèse directe<br />
renforcée au ciment. L’âge moyen lors de la fracture était de 86,2<br />
ans. Le score de Robinson a été utilisé pour évaluer la situation<br />
physiologique <strong>des</strong> patients avant le traumatisme, comportant une<br />
étude du degré d’ostéoporose selon l’index de Sinon. La qualité<br />
du cimentage a été appréciée selon la technique de Cameron. Un<br />
recul minimal de 6 mois était nécessaire pour l’inclusion dans<br />
cette étude.<br />
RÉSULTATS. Le score de Robinson pré-opératoire était de<br />
18,8. L’index de Singh moyen était de quatre. Le cimentage était<br />
satisfaisant dans 29 fractures. L’appui immédiat ou l’utilisation<br />
complète du membre a été possible en post-opératoire précoce<br />
dans 42 <strong>des</strong> 44 fractures. Quarante-trois fractures ont « consolidé»<br />
dans un délai moyen de 2,8 mois. Le recul moyen <strong>des</strong><br />
observations était de 9,8 mois. Douze patientes sont décédées<br />
avant la fin de la première année. A distance, une pseudarthrose a<br />
été identifiée ainsi que cinq infections dont trois osseuses. Le<br />
score de Robinson au dernier recul était de 16 en moyenne.<br />
Aucune intervention ultérieure n’a été empêchée oumodifiée<br />
quant à ses modalités en raison de l’ostéosynthèse renforcée au<br />
ciment acrylique.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. Les résultats de cette série<br />
rétrospective sont comparées à cel<strong>les</strong> d’autres techniques<br />
d’enclouage centro-médullaire, ou d’ostéosynthèse avec greffe<br />
osseuse d’emblée ou secondaire de principe utilisée dans le
traitement de fractures du sujet touché par une ostéoporose<br />
sévère.<br />
*O. Taçkin, Service de Chirurgie Orthopédique<br />
et Traumatologique, Hôpital Avicenne, Université Paris XIII,<br />
93000 Bobigny.<br />
88 Les lésions neurologiques <strong>des</strong> fractures<br />
instab<strong>les</strong> de l’anneau pelvien :<br />
à propos de 44 patients opérés<br />
J. TONETTI*, J. CAZAL, A.EID, T.MARTINEZ,<br />
S. PLAWESKI, P.MERLOZ<br />
INTRODUCTION. Cette étude analyse <strong>les</strong> lésions tronculaires<br />
nerveuses associées aux fractures postérieures de l’anneau pelvien<br />
en distinguant la morbidité initiale post-traumatique et la<br />
morbidité corrélée au traitement par réduction et vissage iliosacré.<br />
MATÉRIEL. Cinquante lésions osseuses ou ligamentaires postérieures<br />
de l’anneau pelvien ont été incluses, représentant 44<br />
patients.<br />
La prise en charge comprenait une réduction initiale par<br />
manœuvres externes et une synthèse différée par vissage iliosacré<br />
sous-contrôle fluoroscopique.<br />
MÉTHODES. Un examen métamérique <strong>des</strong> troncs lombaires<br />
et sacrés L2, L3, L4, L5, S1, S2, S3 était réalisé àl’admission,<br />
lorsque le patient était conscient. Le contrôle post-opératoire<br />
comprenait un nouvel examen neurologique et un examen tomodensitométrique<br />
du trajet <strong>des</strong> vis. La qualité de la réduction était<br />
quantifiée sur une radiographie du bassin de face. Le contrôle au<br />
dernier recul recherchait l’évolutivité <strong>des</strong> symptômes ± EMG,<br />
une boiterie de trendelenburg, le score de Mageed, le score QMS<br />
et l’intensité douloureuse par l’échelle visuelle d’auto évaluation<br />
(EVA).<br />
RÉSULTATS. En pré-opératoire, 14 déficits neurologiques<br />
tronculaires ont été diagnostiqués. Le statut neurologique était<br />
inconnu pour 11 lésions ostéo-ligamentaires, <strong>les</strong> patients étant<br />
sédatés à l’arrivée.<br />
En post-opératoire, 28 déficits ont été diagnostiqués. Il s’agissait<br />
14 fois (50 %) de lésions du tronc lombo-sacral avec atteinte<br />
<strong>des</strong> myotomes L4 et L5, 5 fois de lésions isolées de la racine S1,<br />
6 fois de lésions <strong>des</strong> territoires L4, L5 et S1 et 3 fois de lésions de<br />
la queue de cheval de L5 à S4.<br />
L’examen tomodensitométrique a montré 15 vis extraosseuses<br />
en avant de l’aileron sacré ou dans le canal sacré. Ces<br />
trajets extra-osseux étaient associés 9 fois à <strong>des</strong> lésions neurologiques<br />
sans diagnostic pré-opératoire. Six fois le trajet extraosseux<br />
était isolé, sans déficit post-opératoire. Cinq fois aucun<br />
trajet extra-osseux n’était retrouvé pour <strong>des</strong> lésions diagnostiquées<br />
après l’opération.<br />
Vingt-six lésions neurologiques ont été revues avec un recul<br />
moyen de 25 mois : 19 se sont améliorés, 5 ne se sont pas<br />
modifiés, et 2 se sont aggravées.<br />
CONCLUSION. Le diagnostic initial, topographique, de<br />
lésion neurologique n’est fait que dans la moitié <strong>des</strong> fractures de<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 2S59<br />
l’anneau pelvien. Le mécanisme principal est l’étirement du<br />
tronc lombo-sacré par déplacement de l’aileron sacré. Une lésion<br />
du nerf glutéal supérieur est fréquemment associée. La réduction<br />
à foyer fermé ou la mise en compression du nerf incarcéré dans<br />
le foyer lors du vissage peut-être un deuxième mécanisme. Enfin<br />
une technique rigoureuse de vissage doit éviter <strong>les</strong> trajets extraosseux<br />
en avant de l’aileron sacré.<br />
*J. Tonetti, Service Orthopédie-Traumatologie,<br />
Hôpital Michallon, BP 217, 38043 Grenoble Cedex 09.<br />
89 Arthroplastie totale de hanche de<br />
première intention pour le traitement<br />
<strong>des</strong> fractures récentes de<br />
l’acétabulum du sujet âgé<br />
G. COCHU*, C. BAERTICH, F.FIORENZA,<br />
J.-L. CHARISSOUX, J.-P. ARNAUD, C.MABIT<br />
BUT DE L’ÉTUDE. Le but de cette étude était d’évaluer <strong>les</strong><br />
résultats <strong>des</strong> fractures récentes de l’acétabulum du sujet âgé<br />
traitées par prothèse ttotale de hanche de première intention.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Nous présentons une étude<br />
rétrospective de 18 fractures récentes de l’acétabulum chez 18<br />
patients, 9 femmes et 9 hommes, d’âge moyen 74,8 ans, traités<br />
par une prothèse totale de hanche de première intention. Les<br />
lésions fracturaires ont été assimilées à un défect osseux acétabulaire<br />
retrouvé lors <strong>des</strong> reprises de prothèses tota<strong>les</strong> de hanche<br />
(5 cas de stade III et 13 cas de stade IV selon la classification de<br />
la SOFCOT 1988).<br />
L’intervention a été réalisée 15,6 jours en moyenne après le<br />
traumatisme initial et comprenait une stabilisation par renfort<br />
acétabulaire métallique (sauf un cas), avec autogreffe osseuse<br />
(sauf trois cas). L’appui complet a été autorisé au 3 e jour dans 5<br />
cas, et à 6 semaines dans 10 cas, à 3 mois dans 3 cas.<br />
Le recul moyen est de 2,5 ans. Treize personnes vivantes ont<br />
été revues cliniquement et radiologiquement. Les 5 personnes<br />
décédées ont également été évaluées à partir d’informations<br />
rapportées par leur entourage avant leur décès.<br />
Les scores fonctionnels de Postel-Merle d’Aubigné/et de Harris,<br />
ainsi que le taux de survie ont été calculés. L’évaluation<br />
radiologique a étudié la consolidation, l’état du montage prothétique,<br />
et l’existence de liseré de <strong>des</strong>cellement selon <strong>les</strong> 3 zones<br />
acétabulaires de De Lee et Charnley.<br />
RÉSULTATS. Les scores fonctionnels moyens étaient de<br />
13,6/18 selon Postel-Merle d’Aubigné, et de 71,8/100 selon<br />
Harris. Il n’y a eu ni infection, ni luxation. La médiane de survie<br />
était de 6 ans sur la courbe de Kaplan-Meier. La survie à 1anétait<br />
de 94,4 %. Les cinq décès étainet tous indépendants de l’intervention<br />
chirurgicale réalisée.<br />
Radiologiquement, toutes <strong>les</strong> fractures ont consolidé. Aucune<br />
complication mécanique et en particulier aucun <strong>des</strong>cellement<br />
acétabulaire n’a été observé.<br />
DISCUSSION. Plusieurs auteurs ont démontré que l’ostéosynthèse<br />
chirurgicale, ou le traitement fonctionnel chez <strong>les</strong> sujets<br />
âgés comportaient tous <strong>les</strong> facteurs de mauvais pronostic (ostéo-
2S60 77 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
porose, comminution, chirurgie retardée par le mauvais état<br />
général), tandis que l’alitement prolongé expose ces patients au<br />
risque vital. D’autres travaux soulignent un taux de complications<br />
très élevé lors <strong>des</strong> reprises chirurgica<strong>les</strong> pour démontage,<br />
arthrose post-traumatique, ou ostéonécrose.<br />
L’absence de décès précoce chez ces sujets âgés et la faible<br />
morbidité liée à cette unique intervention sont confirmés par <strong>les</strong><br />
rares publications à ce sujet.<br />
CONCLUSION. Cette attitude thérapeutique autorise une verticalisation<br />
rapide sans complications de décubitus chez <strong>des</strong><br />
sujets âgés. Aussi <strong>les</strong> réinterventions nécessaires en cas d’ostéonécrose<br />
de la tète fémorale, ou d’arthrose post-traumatique sont<br />
évitées. Ces résultats nous encouragent à conserver cette option<br />
thérapeutique.<br />
*G. Cochu, Département d’Orthopédie, CHU Dupuytren,<br />
2, avenue Martin-Luther-King, 87042 Limoges.<br />
90 Ostéosynthèse et insertion d’une<br />
prothèse totale de hanche en un<br />
temps après fracture de l’acétabulum<br />
P. BEAULÉ*, J. MATTA<br />
INTRODUCTION. La voie d’abord chirurgicale est un élément<br />
essentiel pour une réduction précise et une fixation rigide<br />
<strong>des</strong> fractures de l’acétabulum. Dans <strong>les</strong> cas où la colonne antérieure<br />
est principalement impliquée et lorsqu’une prothèse totale<br />
de hanche (PTH) est indiquée, <strong>les</strong> voies d’abord classiques ne<br />
permettent pas le double accès à la colonne antérieure pour<br />
réduction et fixation ainsi qu’au canal fémoral pour l’insertion de<br />
la prothèse. En combinant l’approche antérieure de Heuter et la<br />
voie ilio-fémorale de Letournel, celle-ci donne accès à la colonne<br />
antérieure ainsi qu’à la fracture postérieure hemi-transverse qui<br />
lui est souvent associée, et permet l’insertion d’une PTH.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Dix PTH parmi 60 furent réalisées<br />
pour <strong>des</strong> fractures de l’acétabulum en utilisant cette voie<br />
antérieure, 7 en tant que traitement primaire et 3 comme reconstruction<br />
différée. L’âge moyen <strong>des</strong> patients 60,6 ans (50 à 85).<br />
Types de fractures : 8 fois <strong>les</strong> paroi et colonne antérieures seu<strong>les</strong>,<br />
et 2 fois la colonne antérieure avec postérieure hemi-transverse.<br />
Toutes <strong>les</strong> fractures aiguës présentaient d’importantes lésions du<br />
cartilage acétabulaire avec un patient ayant aussi une fracture du<br />
col fémoral. Une PTH hybride fut utilisée dans tous <strong>les</strong> cas après<br />
ostéosynthèse de la fracture. Les têtes fémora<strong>les</strong> furent utilisées<br />
comme greffon pour <strong>les</strong> colonnes antérieures déficientes dans<br />
deux cas, et comme « greffes morcelées » pour <strong>les</strong> autres.<br />
RÉSULTATS. Le recul moyen était de 36 mois (24 à 53). A<br />
terme, toutes <strong>les</strong> fractures étaient consolidées et tous <strong>les</strong> composants<br />
acétabulaires solidement fixés, ne montrant aucune migration.<br />
Diamètre extérieur moyen <strong>des</strong> composants acétabulaires<br />
utilisés était de 56 mm (52 à 64) avec un press-fit de 2 mm et une<br />
vis. La seule complication fut une dislocation antérieure postopératoire.<br />
Le soulagement de la douleur et la fonction étaient<br />
satisfaisants chez tous <strong>les</strong> patients au dernier suivi avec un score<br />
moyen d’Aubigné-Postel de 16- (13 à 18).<br />
DISCUSSION. Cette voie d’abord antérieure donne accès aux<br />
parois et colonnes antérieures, permettant une fixation rigide et<br />
l’insertion relativement aisée d’une PTH. La voie de Kocher-<br />
Langenbech reste la meilleure en cas de déficience de la paroi<br />
postérieure, et lorsque la fixation postérieure nécessite un retrait<br />
pour le placement d’un composant acétabulaire. Nous réservons<br />
l’usage d’une PTH pour le traitement <strong>des</strong> fractures aiguës de<br />
l’acétabulum dans <strong>les</strong> cas d’important dommage de l’acétabulum<br />
et/ou de la tête fémorale, avec ou sans fracture du col fémoral,<br />
chez <strong>des</strong> patients de 55 ans ou plus. Dans <strong>les</strong> cas de reconstruction<br />
différée, nous utilisons aussi cette voie d’abord si la lésion<br />
acétabulaire englobe la colonne antérieure.<br />
*P. Beaulé, Joint Replacement Institute Orthopaedic Hospital,<br />
2400 S Flower Street, 90007 Los Ange<strong>les</strong>, Etats-Unis.<br />
91 Arthroplastie totale de hanche<br />
après fracture de l’acétabulum<br />
A. VEIL-PICARD*, L. SEDEL, P.BIZOT<br />
INTRODUCTION. L’objectif de ce travail était d’analyser <strong>les</strong><br />
difficultés techniques et <strong>les</strong> résultats <strong>des</strong> arthroplasties de hanches<br />
mises en place pour coxarthrose secondaire à une fracture de<br />
l’acétabulum traitée chirurgicalement ou orthopédiquement.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Il s’agissait d’une étude rétrospective<br />
continue avec observateur indépendant. Soixante-quatre<br />
arthroplasties sur 63 patients ont été incluses de janvier 1979 à<br />
décembre 2000. Vingt-huit fractures ont été traitées chirurgicalement<br />
et 36 orthopédiquement. Cinq types de cupu<strong>les</strong> ont été<br />
posées (25 cerafit, 3 cerapress, 17 alumine scellée, 11 vissés,7en<br />
polyéthylène). Tous <strong>les</strong> patients ont été évalués cliniquement en<br />
pré-opératoire et au dernier recul selon la cotation de Merle<br />
d’Aubigné. L’évaluation radiologique en post-opératoire et au<br />
dernier recul a été faite selon <strong>les</strong> métho<strong>des</strong> de Charnley et De<br />
Lee. Les difficultés opératoires ont été évaluées par l’appréciation<br />
du temps opératoire, <strong>des</strong> pertes sanguines et par l’analyse <strong>des</strong><br />
compte-rendus opératoires. La survie était calculée selon une<br />
méthode actuarielle.<br />
RÉSULTATS. Le recul moyen de la série était de 5 ans et 2<br />
mois. Six patients ont été perdus de vue précocement. Les<br />
résultats cliniques étaient satisfaisants avec une amélioration<br />
significative du score de Merle d’Aubigné. Les résultats de la<br />
survie était de 81 % à 10 ans en prenant comme critère d’échec le<br />
<strong>des</strong>cellement aseptique et de 74 % avec comme critère d’échec la<br />
reprise chirurgicale. L’allongement du temps opératoire et<br />
l’importance du saignement opératoire étaient significativement<br />
liés à l’importance de la perte de substance osseuse acétabulaire<br />
et à l’expérience de l’opérateur (p < 0,05). La survie était<br />
significativement liée à l’importance de la perte osseuse acétabulaire<br />
(p < 0,05). On ne retrouvait pas de différence significative<br />
entre le mode de traitement initial de la fracture que ce soit en<br />
terme de difficultés per-opératoires ou de survie.<br />
DISCUSSION. L’arthroplastie de hanche après coxarthrose<br />
secondaire à une fracture de l’acétabulum donne de bons résultats<br />
fonctionnels. La survie à long terme est inférieure à cel<strong>les</strong> <strong>des</strong><br />
arthroplasties pour coxarthrose essentielle, le seul facteur péjoratif<br />
retrouvéétant la perte de substance osseuse acétabulaire. La
éalisation de ces arthroplasties est plus difficile et réclame une<br />
certaine expérience. Aucune différence n’a été retrouvée entre <strong>les</strong><br />
fractures traitées chirurgicalement et cel<strong>les</strong> traitées orthopédiquement.<br />
L’hétérogénéité <strong>des</strong> cupu<strong>les</strong> mises en place rend <strong>les</strong> différences<br />
diffici<strong>les</strong> à mettre en évidence.<br />
*A. Veil-Picard, Hôpital Ambroise-Paré,<br />
9, avenue Char<strong>les</strong>-de-Gaulle, 92100 Boulogne.<br />
92 Prothèse totale de hanche après<br />
fracture de l’acétabulum<br />
P.-Y. GLAS*, P. VALLESE, J.-P. CARRET,<br />
J. BÉJUI-HUGUES<br />
INTRODUCTION. Vingt-et-une prothèses tota<strong>les</strong> de hanche<br />
après fracture de l’acétabulum ont été revues avec un recul<br />
minimum de 2 ans. Le but de cette étude était d’analyser <strong>les</strong><br />
difficultés techniques et <strong>les</strong> complications de la mise en place<br />
d’une prothèse totale de hanche sur séquel<strong>les</strong> de fracture de<br />
l’acétabulum.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Sur <strong>les</strong> 21 fractures de l’acétabulum,<br />
10 avaient été traitées chirurgicalement et 11 orthopédiquement.<br />
La série comprend 6 femmes pour 15 hommes avec un<br />
âge moyen de 55 ans. Le délai moyen entre le traumatisme et la<br />
mise en place de la prothèse était de 14 ans (2 à 36 ans). La voie<br />
d’abord postero-latérale a été utilisée dans 13 cas et la voie<br />
antero-latérale dans 8 cas. Le matériel d’ostéosynthèse a été<br />
enlevé en totalité chez 2 patients et en partie chez 3 patients. Une<br />
arthrolyse a été effectué chez un patient présentant <strong>des</strong> ossifications<br />
hétérotopiques de stade IV. La majorité <strong>des</strong> cupu<strong>les</strong> posées<br />
étaient sans ciment recouvertes d’HAP à l’exception d’une<br />
cupule scellée et de 2 cupu<strong>les</strong> scellées dans un anneau de Postel<br />
Kerboul.<br />
RÉSULTATS. Pour <strong>les</strong> fractures traitées othopédiquement, une<br />
autogreffe de l’acétabulum a été nécessaire dans 9 cas sur 11<br />
contre 2 cas sur 10 pour <strong>les</strong> fractures traitées chirurgicalement (p<br />
< 0,05). La duréeopératoire moyenne était de 136 min et la perte<br />
sanguine peroperatoire moyenne représentait 1200cc. Parmi <strong>les</strong><br />
complications postopératoires, on dénombre une phlébite superficielle,<br />
une plaie vésicale sous péritonéale, un hématome superficiel,<br />
une paralysie incomplète du SPE, une luxation et 2 ossifications<br />
hétérotopiques (1 brooker I et 1 Brooker IV). A la<br />
révision, le score moyen MDAP était de 16,5 et radiologiquement<br />
il n’y avait aucun <strong>des</strong>cellement ni faillite de fixation.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. Les difficultés techniques<br />
sont essentiellement rencontrées dans le groupe <strong>des</strong> fractures<br />
traitées orthopédiquement du fait d’un cal vicieux du bassin<br />
(protusion de la tête fémorale dans un acétabulum ovalisé). Dans<br />
ces cas, l’autogreffe structurale et/ou de comblement se révèle<br />
indispensable (82 % <strong>des</strong> cas) afin d’éviter une médialisation<br />
excessive de la cupule. Pour le groupe <strong>des</strong> fractures traitées<br />
chirurgicalement, le matériel d’ostéosynthèse est enlevé unique-<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 2S61<br />
ment s’il gène le bon positionnement de la cupule, l’autogreffe<br />
pouvant être utilisée (18 %) pour combler <strong>des</strong> défects (nécrose<br />
d’une paroi ou du toit).<br />
La cupule sans ciment reste la règle en première intention chez<br />
<strong>les</strong> sujets jeunes, <strong>les</strong> anneaux de soutient devant être utilisés en<br />
cas de nécessité en deuxième intention.<br />
*P.-Y. Glas, Pavillon T, CHU de Lyon,<br />
Hôpital Edouard-Herriot, 5, place d’Arsonval,<br />
69437 Lyon Cedex 03.<br />
93 Fractures du fémur sous une synthèse<br />
proximale : une solution à<br />
moindre frais, le clou rétrograde<br />
G. PIÉTU*, D. WAAST, M.BARRERA, L.BIGOTTE,<br />
F. GOUIN, J.LETENNEUR<br />
INTRODUCTION. Les fractures diaphysaires survenant sous<br />
un matériel d’ostéosynthèse proximal du fémur se rencontrent de<br />
plus en plus souvent chez le vieillard. El<strong>les</strong> posent <strong>des</strong> problèmes<br />
de choix tant du moyen de fixation que de la technique chirurgicale<br />
afin de rester le moins agressif possible chez ces sujets<br />
fragi<strong>les</strong>.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. De janvier 1998 à janvier 2002,<br />
un enclouage rétrograde avec verrouillage proximal par <strong>les</strong> vis de<br />
fixation du matériel déjà en place a été réalisé chez 8 femmes de<br />
92 ans (79-99). La technique de l’enclouage ascendant n’avait<br />
rien de spécifique. L’implant utilisé était un clou de jambe de<br />
Russell-Taylor six fois et un clou supracondylien long de Stryker<br />
deux fois. La particularité concernait le verrouillage supérieur<br />
réalisé par <strong>les</strong> vis de la fixation apposée, imposant de faire<br />
coïncider <strong>les</strong> orifices de verrouillage du clou avec ceux <strong>des</strong> vis de<br />
la plaque. Ceci explique parfois qu’une seule vis assurait celui-ci<br />
du fait d’un écartement différent de ces derniers.<br />
RÉSULTATS. Aucune complication infectieuse n’est survenue.<br />
L’alignement fracturaire était toujours satisfaisant. La récupération<br />
<strong>des</strong> mobilitésetdel’autonomie était totale aux dires <strong>des</strong><br />
patients ou de leur entourage. Il en était de même pour la douleur<br />
bien que l’évaluation de celle-ci soit plus difficile. La consolidation<br />
était acquise en 4 mois. Un déplacement secondaire en varus<br />
est survenu du fait d’une prise insuffisante de la vis de verrouillage<br />
proximale dans la corticale médiale.<br />
CONCLUSION. Sans être la panacée, l’enclouage diaphysaire<br />
rétrograde verrouillé dans un implant proximal parait intéressant<br />
dans <strong>des</strong> cas particuliers, notamment chez la personne âgée,<br />
souvent fatiguéeetdébilitée. Cette solution permet au prix d’une<br />
intervention minimalement agressive la réalisation d’une ostéosynthèse<br />
composite protégeant dans un deuxième temps tout le<br />
segment fémoral du sujet âgé, sans pic de contraintes ponctuel.<br />
*G. Piétu, Services <strong>des</strong> Urgences, CHU de Nantes,<br />
44093 Nantes Cedex 1.
2S62 77 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
94 Renforcement de la fixation de vis à<br />
compression avec un nouveau biomatériau<br />
composite (CortossY)<br />
dans <strong>les</strong> fractures pertrochantériennes<br />
M. SZPALSKI*, R. GUNZBURG, J.-P. HAYEZ,<br />
N. PASSUTI<br />
INTRODUCTION. La consolidation <strong>des</strong> fractures pertrochantériennes<br />
traitées par <strong>des</strong> vis à compression chez le sujet ostéoporotique<br />
peut se révéler problématique dû fait du risque accru<br />
d’une défaillance de la fixation. Le ciment acrylique (PMMA) a<br />
été proposé pour renforcer la fixation <strong>des</strong> vis à compression chez<br />
ces sujets, surtout pour éviter <strong>les</strong> déplacements en valgus (cutout)<br />
du col. L’inconvénient du ciment acrylique est sa toxicité<br />
thermique, son absence de biocompatibilité et son maniement<br />
compliqué. Cortossy est un nouveau biomatériau composite à<br />
base de bisphenol-a-glycidyl (bis-GMA) qui peut représenter une<br />
bonne alternative aux ciments traditionels. Cortoss est un matériau<br />
injectable ayant <strong>des</strong> caractéristiques mécaniques comparab<strong>les</strong><br />
à cel<strong>les</strong> de l’os cortical humain. Cortoss est moins exothermique,<br />
nettement plus radio-opaque et plus facile à l’infection<br />
que le ciment acrylique. Le but de cette étude clinique était de<br />
décrire une nouvelle technique de mise en place du ciment ainsi<br />
que d’évaluer la force d’ancrage et l’innocuité de Cortoss chez<br />
<strong>des</strong> patients ostéoporotiques subissant une intervention chirurgicale<br />
pour fracture péritrochantérienne.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Il s’agit d’une étude prospective,<br />
approuvée par comité d’éthique, de 20 patients consécutifs<br />
âgés de 70 ans ou plus, se présentant avec une fracture péritro-<br />
96 Utilisation d’une prothèse de type<br />
Charnley-Kerboull comme espaceur<br />
dans l’échange en deux temps<br />
<strong>des</strong> prothèses tota<strong>les</strong> de hanche<br />
infectées : technique opératoire et<br />
résultats à moyen terme<br />
P. COLLIN*, P. BRASSEUR, J.-C. LAMBOTTE,<br />
H. THOMAZEAU, Q.NGUYEN, F.LANGLAIS<br />
L’échange en 2 temps d’une prothèse totale de hanche infectée<br />
peut être réalisé en utilisant un espaceur. Son but est de faciliter<br />
la reprise en évitant une rétraction <strong>des</strong> parties mol<strong>les</strong>. Sa nature<br />
peut être variable. Nous recherchions un implant : évitant <strong>les</strong><br />
débris d’usure par friction du méthacrylate sur l’os, capable de<br />
délivrer un antibiotique local, facilement extractible, pour ne pas<br />
aggraver <strong>les</strong> dégâts osseux.<br />
Séance du 14 novembre matin<br />
HANCHE<br />
chantérienne. Le placement de la vis à compression était fait sous<br />
fluoroscopie tout en mesurant le couple maximal d’insertion. La<br />
vis était dévissée de 7 tours complets, (longueur de la tête filetée),<br />
et 2,5 mL de Cortoss étaient injectés par un cathéter en polyimide<br />
de 2,5 mm de diamètre. La vis était revissée et, une fois le<br />
composite polymérisé, le couple était a nouveau mesuré jusqu’à<br />
atteindre une valeur 30 % supérieure à la valeur mesurée sans<br />
Cortoss.<br />
RÉSULTATS. Dix-huit femmes et deux hommes, âgésde70à<br />
96 ans, ont donné leur consentement et ont complété l’étude. La<br />
moyenne du couple de serrage maximal de départ était de 1,23<br />
Nm (min. 0 et max. 4,8 Nm), tous ont atteint une augmentation de<br />
30 % après application du composite. Les radiographies postopératoires<br />
montrent que la tête à vis est bien enveloppée par<br />
Cortoss et que Cortoss a diffusé dans l’os adjacent. Il n’y a pas eu<br />
d’effets indésirab<strong>les</strong>.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. Cortoss a effectivement<br />
renforcé l’ostéosynthèse confirmé par l’augmentation du couple<br />
de force d’insertion. Cortoss peut ainsi, en augmentant <strong>les</strong> propriétés<br />
mécaniques à l’interface vis-os spongieux, réduire la<br />
défaillance de la fixation, réduire le déplacement secondaire de la<br />
vis à compression, en particulier chez <strong>les</strong> patients ostéoporotiques.<br />
L’amélioration de la stabilité du montage peut ainsi réduire<br />
le temps d’immobilisation et faciliter la consolidation sans augmenter<br />
le risque de déplacement secondaire et de morbidité qui<br />
s’en suit. Sur la base de l’efficacité,del’innocuité et de sa facilité<br />
d’emploi, Cortoss peut présenter une meilleure alternative que le<br />
ciment acrylique pour le renforcement de vis à compression dans<br />
l’os porotique.<br />
*M. Szpalski, Centre Hospitalier Molière-Longchamp,<br />
142, rue Marconi, 1180 Bruxel<strong>les</strong>, Belgique.<br />
Depuis 1995, nous utilisons une prothèse type Charnley Kerboull<br />
(cf technique). Le but de cette étude était double : 1) vérifier<br />
l’absence de complications propres liées à l’utilisation d’un tel<br />
espaceur, 2) apprécier <strong>les</strong> résultats sur la guérison de l’infection<br />
et l’amélioration de la fonction.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Nous avons utilisé 14 espaceurs<br />
articulés pour <strong>des</strong> échanges en deux temps. Il s’agissait de<br />
9 hommes et 5 femmes d’un âge moyen de 64 ans. La VS<br />
moyenne était de 32 et la CRP de 17. Le PMA moyen était de<br />
3+5+2. Tous <strong>les</strong> patients ont été revus avec un recul moyen de 37<br />
mois.<br />
TECHNIQUE. Après avoir abordé la hanche le plus souvent<br />
par une trochantérotomie digastrique, plus ou moins associée à<br />
un geste fémoral en fonction de la longueur du bouchon àôter,<br />
l’ensemble <strong>des</strong> implants et du ciment est extrait. Une cupule en<br />
polyéthylène de petite taille était scellée avec un ciment contenant<br />
au moins un antibiotique sur un lit de Surgicel afin de<br />
faciliter son extraction lors du 2 e temps. Une longue tige fémo-
ale de petit diamètre (pontant la fenêtre fémorale) était mise en<br />
place et bloquée au niveau métaphysaire avec du ciment, également<br />
sur un lit de Surgicel. Entre <strong>les</strong> deux temps, un appui partiel<br />
puis progressivement total était autorisé.<br />
RÉSULTATS. Aucune luxation n’est survenue. La reprise d’un<br />
appui complet a toujours été possible entre <strong>les</strong> 2 temps. Dans<br />
deux cas il a été retrouvé lors du deuxième temps la présence du<br />
même germe que lors du premier temps, nécessitant une antibiothérapie<br />
prolongée. Un échec septique a été observé, différent de<br />
ces deux cas. Le PMA moyen était coté à5,7+5,8+5,2.<br />
CONCLUSION. Cette technique évite <strong>les</strong> frottements de<br />
méthacrylate induits par <strong>les</strong> espaceurs classiques, en ne modifiant<br />
pas le chimiotactisme <strong>des</strong> polynucléaires et facilitant l’efficacité<br />
du traitement médical. Elle permet également au patient de<br />
conserver une fonction entre <strong>les</strong> deux temps opératoires et évite<br />
ainsi une fonte musculaire pouvant grever <strong>les</strong> résultats fonctionnels<br />
à long terme.<br />
*P. Collin, Hôpital Sud, 16, boulevard de Bulgarie, BP 90347,<br />
35203 Rennes Cedex 2.<br />
97 Changement de prothèse totale de<br />
hanche septique en un temps<br />
V. GAUDIOT*, D. WAAST, S.TOUCHAIS,<br />
F. GOUIN, N.PASSUTI<br />
INTRODUCTION. Nous avons voulu étudier au travers d’une<br />
étude continue rétrospective monocentrique <strong>les</strong> résultats du changement<br />
de prothèse totale de hanche septique en un temps par <strong>des</strong><br />
implants non cimentés, lors d’infection chronique (> 30 j).<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Trente-quatre patients (12 femmes,<br />
22 hommes) ont ainsi été opérés entre 1992 et 1998. La<br />
moyenne d’âge était de 67,8 ans (45 à 89 ans). L’arthroplastie<br />
avait été réalisée 17 fois pour une coxarthrose primitive, 5 fois<br />
après fracture du col, 12 fois pour une coxarthrose secondaire.<br />
Vingt-deux patients avaient <strong>des</strong> facteurs de risque d’infection.<br />
Tous <strong>les</strong> patients ont été traités defaçon identique : changement<br />
en un temps de l’implant infecté avec mise en place d’un implant<br />
sans ciment recouvert d’hydroxy-apatite et antibiothérapie de 3<br />
mois adaptée aux prélèvements per-opératoires. Sept fémorotomies<br />
ont été réalisées. Ces résultats ont été évalués sur la<br />
clinique, <strong>les</strong> marqueurs biologiques et radiographiques. Les<br />
patients étaient considérés comme guéris devant une biologie<br />
normale et l’absence de signes radiographiques suspects.<br />
RÉSULTAT. Nous déplorons 3 échecs pour 31 succès thérapeutiques.<br />
Nous avons observé 6 complications per-opératoires à<br />
type de fracture du fémur qui ont nécessité une ostéosynthèse.<br />
Cinq patients ont présenté une complication au traitement médicamenteux.<br />
Du point de vue bactériologique, nous retrouvons 18<br />
staphylocoques sensib<strong>les</strong> à la Méticilline, 6 staphylocoques résistant<br />
à la Méticilline, 2 infections poly microbiennes, 6 infections<br />
à autres germes et 2 infections à germe indéterminés. Les 3<br />
échecs sont dus à <strong>des</strong> infections à staphylocoque aureus méticilline<br />
résistant.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. Le taux de succès de<br />
88 % est conforme à la littérature. Le changement en un temps est<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 2S63<br />
pour nous l’indication de choix en première intention ; <strong>les</strong> autres<br />
techniques étant retenues devant <strong>les</strong> états septique graves, <strong>les</strong><br />
échecs du un temps et en cas de <strong>des</strong>truction massive du stock<br />
osseux.<br />
Ces résultats nous encouragent à continuer dans cette option<br />
thérapeutique, mais une étude plus importante avec un plus grand<br />
recul devra confirmer ces résultats préliminaires.<br />
*V. Gaudiot, Service de Chirurgie Orthopédique,<br />
CHU de Nantes, 44093 Nantes Cedex 1.<br />
98 Résultats du lavage chirurgical<br />
avec conservation <strong>des</strong> éléments<br />
prothétiques dans <strong>les</strong> infections<br />
précoces sur arthroplastie de hanche<br />
D. WAAST*, V. GAUDIOT, E.CAREMIER,<br />
S. TOUCHAIS, N.PASSUTI, F.GOUIN<br />
INTRODUCTION. Nous avons voulu par une étude rétrospective<br />
monocentrique, évaluer <strong>les</strong> résultats du lavage chirurgical sur<br />
<strong>les</strong> infections précoces (< ou = 30 jours) après arthroplastie de<br />
hanche.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Trente-quatre patients âgés en<br />
moyenne de 67,8 ans (± 12,1), souffrant d’une infection précoce,<br />
stade II de la classification de Gustillo et Tsukayama, ont été<br />
traités, entre 1992 et 1995, par un débridement chirurgical et une<br />
antibiothérapie adaptéededurée limitée. L’arthroplastie avait été<br />
réalisée 17 fois pour une coxarthrose primitive, 11 fois pour<br />
coxarthrose secondaire, 6 fois après fracture du col. Nous retrouvons<br />
25 arthroplasties de première intention et 9 reprises. Nous<br />
retenons <strong>des</strong> facteurs de risques d’infection pour 17 patients.<br />
Chaque patient était suivi sur une période, d’au moins quatre<br />
ans. L’efficacité du traitement était retenue devant un examen<br />
clinique normal, <strong>des</strong> marqueurs biologiques normaux et<br />
l’absence de signes radiographiques suspects. Nous avons testé<br />
<strong>les</strong> données, cliniques biologiques et bactériologiques, à la<br />
recherche de facteurs prédictifs de bon résultat. Les comparaisons<br />
de répartition de population ont été effectuées par <strong>les</strong> test du<br />
chi-2 et de Fisher et <strong>les</strong> comparaisons de moyenne par <strong>les</strong> test de<br />
Student et Mann Withney.<br />
RÉSULTATS. Avec un recul moyen de 5 ans, 74 % <strong>des</strong><br />
patients ont présenté une récidive infectieuse. Seuls 56 % de ces<br />
patients bénéficieront d’un nouveau traitement, efficace sur la<br />
complication infectieuse et satisfaisant sur le plan fonctionnel<br />
(28 % ont été repris par résection arthroplastique et 16 % ont été<br />
traités par une antibiothérapie continue). Nous retrouvons une<br />
différence significative sur l’efficacité du lavage pour un délai<br />
inférieur ou égal à 21 jours (p = 0,002). L’analyse statistique<br />
suggère en outre une influence du type de germe (p = 0,006) et de<br />
la présence de facteurs de risques (p = 0,0052).<br />
DISCUSSION. Séduisant car simple et peu invasif, le lavage<br />
ne semble qu’atténuer une symptomatologie aiguë sans éradiquer<br />
l’infection. En outre, une reconnaissance tardive de l’échec, chez<br />
<strong>des</strong> patients affaiblis par l’infection devenue chronique, limite <strong>les</strong>
2S64 77 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
solutions de reprise et entraîne à moyen terme un résultat fonctionnel<br />
médiocre. Le délai est le seul paramètre influent que nous<br />
retenons comme <strong>les</strong> autres auteurs. Mais ces mauvais résultats<br />
nous poussent à restreindre <strong>les</strong> indications du lavage aux cas<br />
d’infections diagnostiquées très précocement, dans le cadre de<br />
l’urgence vitale en programmant une reprise secondairement et<br />
pour <strong>des</strong> patients très fragi<strong>les</strong>. Dans tous <strong>les</strong> cas un suivi attentif<br />
et prolongé <strong>des</strong> patients est indispensable.<br />
*D. Waast, Service de Chirurgie Orthopédique,<br />
CHU de Nantes, 44093 Nantes Cedex 1.<br />
99 Etude à long terme de l’ostéolyse<br />
autour <strong>des</strong> prothèses tota<strong>les</strong> de<br />
hanche sans ciment recouvertes<br />
d’hydroxyapatite<br />
J.-C. CHATELET*, L. SETIEY<br />
INTRODUCTION. Les prothèses tota<strong>les</strong> de hanche sans<br />
ciment comme <strong>les</strong> prothèses cimentées sont soumises à l’usure de<br />
leur couple de frottement et aux débris de polyéthylène. L’ostéolyse<br />
dépend du nombre de particu<strong>les</strong> et de leur taille. Cette série<br />
continue de 115 prothèses tota<strong>les</strong> de hanche Corail à 12 ans de<br />
recul à pour but d’étudier l’évolution de l’ostéolyse autour <strong>des</strong><br />
prothèses et la résistance <strong>des</strong> implants recouverts d’hydroxyapatite<br />
face à l’agression <strong>des</strong> débris d’usures.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Cent quinze patients ont bénéficié<br />
au cours de l’année 1989 d’une prothèse totale de hanche<br />
Corail par le même opérateur avec cupule comportant un métal<br />
back et un insert en polyéthylène. L’âge moyen à la date opératoire<br />
était de 65 ans. Quatre-vingt patients ont été revus et<br />
radiographiés (38 femmes et 42 hommes). Vingt-sept patients<br />
sont décédés, 5 ont été interrogés téléphoniquement et 3 ont été<br />
perdus de vue. Le recul était de 12 ans et l’étude a été faite sur la<br />
population revue et radiographiée.<br />
RÉSULTAT. Aucune tige ne s’est déstabilisée et aucune n’a<br />
été réopérée. Par contre 12 cupu<strong>les</strong> ont été reprises pour <strong>des</strong>cellement<br />
sur granulome. L’usure <strong>des</strong> inserts polyéthylène a été<br />
rétrouvé dans 62 % <strong>des</strong> cas. Il existe un rapport entre le volume<br />
<strong>des</strong> débris d’usure et l’importance <strong>des</strong> granulomes sur le fémur.<br />
Ces granulomes étaient localisés essentiellement en zone I et VII<br />
sur le fémur. Sur <strong>les</strong> 12 réinterventions, <strong>les</strong> géo<strong>des</strong> ont été<br />
curetées et greffées. Un changement de couple de frottement a été<br />
fait chez <strong>les</strong> patients jeunes. Les radios de contrôle ont toujours<br />
retrouvé une bonne cicatrisation osseuse.<br />
DISCUSSION. Les prothèses recouvertes d’hydroxyapatite<br />
résistent bien à long terme aux débris d’usure responsab<strong>les</strong><br />
d’ostéolyse puisqu’aucune prothèse fémorale Corail ne s’est<br />
déstabilisée. Les granulomes restent localisés en zone proximale<br />
et ne <strong>des</strong>cendent pas le long de la tige ou du ciment comme dans<br />
<strong>les</strong> prothèses cimentées. L’intime contact entre l’os receveur et<br />
l’implant semble faire barrage à la migration <strong>des</strong> particu<strong>les</strong><br />
d’usures. Il semble donc important que ce contact existe tout le<br />
long de la tige et que l’implant soit recouvert complètement<br />
d’hydroxyapatite.<br />
CONCLUSION. Les prothèses tota<strong>les</strong> de hanche sans ciment<br />
ne sont pas épargnées par <strong>les</strong> débris d’usure du polyéthylène. La<br />
prévention de l’ostéolyse passe par une limitation <strong>des</strong> débris<br />
d’usure. Cela justifie la remise en cause sur le long terme <strong>des</strong><br />
cupu<strong>les</strong> métal back à insert polyéthylène, et l’utilisation préférentielle<br />
de la low friction arthroplastie (LFA) ou le passage au<br />
couple dur : Cr-Co-Cr-Co ou alumine-alumine.<br />
*J.-C. Chatelet, Polyclinique du Beaujolais,<br />
69400 Arnas-Villefranche.<br />
100 La prothèse totale de hanche<br />
ABG1 : devenir de la tige à moyen<br />
terme (5-10 ans)<br />
L. PIDHORZ*, C. CADU, P.RIDEREAU<br />
INTRODUCTION. La tige ABG 1 donne un taux de survie à<br />
7 ans de 94 % (90-98) selon le registre finlandais de suivi <strong>des</strong><br />
prothèses. Il était de 99 % à 5 ans dans l’étude multicentrique de<br />
Tonino. Ces étu<strong>des</strong> montrent cependant <strong>des</strong> images radiologiques<br />
préoccupantes sous forme notamment d’une résorption du calcar<br />
dans 27 %. Nous nous proposons d’étudier le devenir clinique et<br />
radiologique de 102 ABG1 mises en place entre 9/90 et 12/96.<br />
MATÉRIEL. Etude prospective et continue concernant 91<br />
patients (102 hanches) ; 75 hommes et 27 femmes dont l’âge<br />
moyen à l’intervention était de 63,1 ans (34-81). L’intervention<br />
faite par voie postérieure a été réalisée soit pour coxarthrose<br />
(82 %), soit pour une ostéonécrose (11 %). La tige de taille 5 et 6<br />
a été employée dans 60 % <strong>des</strong> cas. Le couple métal polyéthylène<br />
a été utilisé dans 45 %, la zircone dans 55 % ; le diamètre de la<br />
tête était de 28 mms dans 91 % <strong>des</strong> cas de cette série. Lors de la<br />
revue, 5 patients étaient décédés, 10 étaient perdus de vue, 8<br />
joints par téléphone et 79 revus et radiographiés. Le recul moyen<br />
était de 90,6 mois (médiane : 86,4 mois).<br />
MÉTHODES. Tous <strong>les</strong> patients ont été examinésenseréférant<br />
aux cotations de Postel Merle d’Aubigné (PMA) et au score de<br />
Harris (HHS). Le positionnement, la qualité de la fixation<br />
osseuse ont été analysés. La migration de la tige a été calculée sur<br />
<strong>les</strong> divers clichés en tenant compte de la distance entre le centre<br />
de la tête et le sommet du grand trochanter. Les lisérés selon<br />
Gruen, l’ostéolyse et le score ARA ont été notés. La classification<br />
radio clinique (SOFCOT 1997) a été utilisée. Les courbes de<br />
survie ont été calculées selon la méthode actuarielle, l’événement<br />
étant défini par toute réintervention sur la tige quelqu’en fût le<br />
motif. Le test du chi 2 a permis de comparer <strong>les</strong> données<br />
quantitatives.<br />
RÉSULTATS. Sur le plan douloureux, le PMA est passé de 2,9<br />
à 5,7, le PMA global de 11,2 à 15,7. Le HHScore au recul était de<br />
83,6 points. La tige était parfaitement alignée 81 fois, elle était<br />
varus 26 fois et 4 fois en valgus. Une modification de l’alignement<br />
initial a été notée 3 fois et l’enfoncement de la tige 2 fois.<br />
Six révisions de tige ont été nécessaires soit pour malposition (1<br />
cas) soit pour fracture lors de l’intervention (3 cas), soit pour <strong>des</strong><br />
douleurs (2 cas). Finalement 53 hanches ne présentent aucune<br />
anomalie radioclinique (classe A), 17 présentent <strong>des</strong> anomalies<br />
radiologiques anorma<strong>les</strong> sans expression clinique (classe B), 6<br />
sont douloureuses sans anomalie radiologique décelable (classe
C), 4 mauvais résultats cliniques présentent <strong>des</strong> anomalies radiologiques<br />
(classe D).<br />
Le score ARA est à 5 et 6 dans 51 cas. La courbe actuarielle<br />
prenant en compte <strong>les</strong> révisions fémora<strong>les</strong> montre un taux de<br />
survie à 15 ans de 88,9 ± 4%.<br />
DISCUSSION. La forme de l’implant ABG1 ne permet un<br />
excellent alignement que dans 80 % <strong>des</strong> cas. L’ancrage métaphysaire<br />
se fait au prix d’un remodelage fréquent du calcar (23<br />
atrophies dont 10 sévèrement) –àdifférencier d’une ostéolyse (8<br />
cas) – et d’une transparence exagérée dufémur en zone proximale<br />
1A, B et 7 (12 cas). La transmission <strong>des</strong> contraintes en zone<br />
diaphysaire reste cependant anormale (30 épaississèment dont 4<br />
globaux) et 2 atrophies diaphysaires sévères.<br />
CONCLUSION. Les modifications apportées par l’ABG 2<br />
dans le sens d’un sous dimensionnement du diamètre de la tige<br />
devraient améliorer le remodelage diaphysaire. La forme de<br />
l’implant et la fixation favorisée par le revêtement d’hydroxyapatite<br />
qui sont responsab<strong>les</strong> de remaniements osseux en zone 1 et<br />
7 de Gruen doivent faire l’objet d’une attention toute particulière<br />
ces prochaines années.<br />
*L. Pidhorz, Service de Chirurgie Orthopédique<br />
et Traumatologique, CHU d’Angers, 4, rue Larrey,<br />
49033 Angers Cedex 01.<br />
101 La prothèse totale de hanche de<br />
Harris Galante 1 : comment se<br />
comporte la tige fémorale à 12,5<br />
ans de recul ?<br />
L. PIDHORZ*, P. RIDEREAU, C.CADU<br />
INTRODUCTION. Le devenir de la tige de Harris Galante 1<br />
(HGP1) reste l’objet de controverses, l’étude randomisée de<br />
Thanner (AOS 1999) mentionnait une survie de 72 % au recul de<br />
10 ans, essentiellement en raison d’une ostéolyse fémorale<br />
retrouvée dans 18 % <strong>des</strong> cas, une défaillance mécanique obligeant<br />
à une révision dans 20 % <strong>des</strong> cas.<br />
Nous nous proposons d’étudier le devenir clinique et radiologique<br />
de 191 tiges HGP 1 à 12,5 ans de recul moyen.<br />
MATÉRIEL. Il s’agit d’une étude prospective et continue<br />
concernant 181 patients (191 hanches), 101 hommes et 80 femmes<br />
dont l’âge moyen était de 62,1 ans (19-83). L’intervention a<br />
été réalisée soit pour coxarthrose (80 %), soit pour ostéonécrose<br />
(14,6 %). Le couple métal polyéthylène avec tête de 28 a été<br />
utilisé dans 86 % <strong>des</strong> cas.<br />
Lors de la revue, 41 patients étaient décédés (43 hanches), 2<br />
étaient perdus de vue, 37 joints par téléphone et 109 revus et<br />
radiographiés. Le recul moyen était de 150,2 ± 15,3 mois.<br />
MÉTHODES. Tous <strong>les</strong> patients ont été examinésenseréférant<br />
aux cotations de Postel Merle d’Aubigné (PMA) et de Harris<br />
(HHS). Le positionnement de la tige, la qualité de sa fixation<br />
osseuse ont été analysés. Sa migration a été calculée sur <strong>les</strong> divers<br />
clichés en tenant compte de la distance entre le centre de la tête<br />
et le sommet du grand trochanter. Les lisérés selon Gruen,<br />
l’ostéolyse et <strong>les</strong> réactions osseuses ont été notés.<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 2S65<br />
La classification radio clinique (SOFCOT 1997) a été utilisée.<br />
Les courbes de survie ont été calculées selon la méthode actuarielle,<br />
l’événement étant défini par toute réintervention sur la tige<br />
quelqu’en fût le motif. Le test du chi 2 a permis de comparer <strong>les</strong><br />
données quantitatives.<br />
RÉSULTATS. Un décès est à déplorer à J3 ainsi que 3 luxations.<br />
Sur le plan douloureux, le PMA est passé de 2,5 à 5,6, le<br />
PMA global moyen était de 10,5 à 16. Le HHScore était passé de<br />
52,5 à 85,6 points. La tige était parfaitement alignée 80 fois, le<br />
varus ≤ à 3° : 26 fois. Une modification de l’alignement initial a<br />
été notée 3 fois et un enfoncement de la tige 14 fois. Onze<br />
révisions ont été nécessaires soit pour fixation fibreuse (5 cas)<br />
soit pour douleurs (2 cas) soit pour malposition fémorale, fracture<br />
du fémur lors de l’intervention, luxation ou ostéolyse diaphysaire<br />
(1 cas respectivement). Finalement 69 hanches ne présentent<br />
aucune anomalie radioclinique (classe A), 34 présentent <strong>des</strong><br />
signes radiologiques anormaux sans expression clinique (classe<br />
B), essentiellement du fait d’une ostéolyse sévère du calcar (6<br />
cas) et d’un « stress shielding » en zone 1A-B (31 fois), 3<br />
hanches sont douloureuses sans anomalie radiologiquement<br />
décelable (classe C), 1 seule classée Ds’avère être un mauvais<br />
résultat clinique et radiologique.<br />
La courbe actuarielle prenant en compte toute révision de tige<br />
montre un taux de survie à 15 ans de 89,5 ± 3,7 %.<br />
DISCUSSION. La fixation fibreuse instable retrouvée dans<br />
5 % de cette série est sans commune mesure avec le taux de 16 %<br />
annoncé par Garcia Cimbrelo (2001). Une seule ostéolyse fémorale<br />
diaphysaire limitée à la zone 3 a été notée etréopérée en<br />
contraste avec <strong>les</strong> chiffres annoncés dans la littérature avec <strong>des</strong><br />
reculs moindres (16 % pour Thanner et 24 % pour Garcia Cimbrelo).<br />
CONCLUSION. A moyen terme avec une survie de 89,5 % la<br />
tige fémorale de Barris Galante 1 donne de bons résultats cliniques<br />
et une fixation solide à l’os permise par le revêtement<br />
poreux proximal de Titane. Bien que rare, la défaillance de la tige<br />
se manifeste dans <strong>les</strong> 6 premières années d’implantation.<br />
*L. Pidhorz, Service de Chirurgie Orthopédique<br />
et Traumatologique, CHU d’Angers, 4, rue Larrey,<br />
49033 Angers Cedex 01.<br />
102 Comportement d’une tige fémorale<br />
en arthroplastie primaire non<br />
cimentée de la hanche : étude<br />
radiologique de 89 cas avec un<br />
recul moyen de 9 ans<br />
G. GACON*, M. PHILIPPE, A.RAY<br />
INTRODUCTION. Le but de ce travail était d’étudier le<br />
devenir radiologique de 89 tiges fémora<strong>les</strong> anatomiques non<br />
cimentées pourvues d’un revêtement hydroxyapatite circonférentiel<br />
en métaphyse à plus de 7 ans par une analyse radiologique<br />
multicentrique systématique.<br />
MATÉRIEL. Il s’agissait de 89 patients opérés entre 1991 et<br />
1994 d’une arthroplastie primaire pour arthrose ou nécrose : 48<br />
hommes et 33 femmes, d’âge moyen de 59 ans (41 < 59 < 78).
2S66 77 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
Huit patients avaient été opérés <strong>des</strong> 2 cotés. Le critère d’inclusion<br />
dans la série était la possibilité d’obtenir dans le deuxième<br />
semestre 2001 un bilan clinique et un examen radiographique<br />
complet. Le recul moyen était de 9 ans (7 < 9 < 10).<br />
MÉTHODES. Toutes <strong>les</strong> radiographies ont été analysées par 4<br />
chirurgiens français indépendants et non concepteurs en utilisant<br />
<strong>les</strong> critères de Engh et Massin. Les évaluateurs disposaient <strong>des</strong><br />
résultats cliniques contemporains <strong>des</strong> dernières radiographies.<br />
L’étude radiographique portait essentiellement sur la tige fémorale<br />
à la recherche <strong>des</strong> signes d’intégration osseuse et d’éventuel<strong>les</strong><br />
images d’ostéolyse selon Gruen.<br />
RÉSULTATS. Au plus long recul seule une tige fémorale,<br />
douloureuse mais stable, avait été révisée à 7 ans. Six cupu<strong>les</strong><br />
avaient été changées pour usure du polyéthylène avec ostéolyse<br />
iliaque mais sans retentissement fémoral. Il n’y avait pas eu<br />
d’autre réintervention. L’usure du polyéthylène a été retrouvée<br />
près d’une fois sur 2 (44 cas) jugée importante (entre 1 et 2 mm)<br />
dans 9 cas.<br />
Il n’a pas été retrouvé de liserés ni de ligne réactive en zone<br />
métaphysaire (1 et 7) par contre on a identifié 16 % de lignes<br />
réactives dans la partie basse, lisse de la tige. Dans 72 % <strong>des</strong> cas<br />
il a été retrouvé <strong>des</strong> ossifications endostées en zones 2 et 6, moins<br />
souvent en 9 et 13 (3 %). Cinq fois (5,6 %) il existait une<br />
ossification osseuse en pointe de tige s’accompagnant d’un épaississement<br />
en zone 5 ; il s’agissait <strong>des</strong> seuls cas d’épaississement<br />
cortical, en dehors de la tige révisée(épaississement en 2 et 6). Il<br />
n’a pas été relevé d’amincissement cortical. Dans 42 cas (47 %)<br />
existait une atrophie du calcar avec 5 fois un aspect « en goutte ».<br />
Dans 4 cas il existait une ostéolyse fémorale proximale en zone<br />
1A, mais aucune image d’ostéolyse fémorale distale n’a été<br />
identifiée.<br />
DISCUSSION. L’analyse indépendante de 89 dossiers radiologiques<br />
a permis de mettre en évidence la fréquence <strong>des</strong> ossifications<br />
endostées en région isthmique, la bonne tolérance radiologique<br />
de cette tige (pas de modification corticale), mais aussi la<br />
difficulté d’interprétation <strong>des</strong> modifications du calcar dont on<br />
peut se demander si certaines ne correspondent pas plutôt à <strong>des</strong><br />
zones d’ostéolyse localisées au point le plus déclive de l’articulation,<br />
siège habituel <strong>des</strong> débris de polyéthylène. Le rôle de<br />
l’hydroxyapatite dans l’absence d’ostéolyse distale doit être souligné.<br />
CONCLUSION. A 9 ans de recul moyen dans cette série,<br />
l’absence d’ostéolyse fémorale distale malgré l’usure habituelle<br />
du polyéthylène permet de conclure que l’hydroxyapatite circonférentielle<br />
en métaphyse est une réelle barrière aux débris.<br />
*G. Gacon, Clinique du Parc, 86, boulevard <strong>des</strong> Belges,<br />
69006 Lyon.<br />
103 Tige fémorale sur mesure non<br />
cimentée pour séquelle de développement<br />
dysplasique de hanche :<br />
étude de 2 à 12 ans de recul<br />
X. FLECHER*, E. RYEMBAULT, J.-M. AUBANIAC<br />
INTRODUCTION. La prothèse pour séquelle de développement<br />
dysplasique de hanche (DDH) présente <strong>des</strong> difficultés liées<br />
à l’anatomie et à l’âge jeune <strong>des</strong> patients. Le but du travail était<br />
de rapporter <strong>les</strong> résultats d’une tige fémorale non cimentée dont<br />
le <strong>des</strong>sin intramédullaire et du col prothétique était basé sur<br />
l’anatomie radiotomodensitométrique de chaque patient.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. L’étude concerne 257 haches<br />
avec un recul moyen de 5,6 ans. L’âge moyen était de 55 ans (17<br />
à 78 ans). Le bilan radiotomodensitométrique a étudié : le stade<br />
de la luxation selon Crowe, l’inégalité de longueur, l’angle<br />
d’antéversion et le diamètre de l’acétabulum. La cupule était non<br />
cimentée avec crochet dans le trou obturateur pour implantation<br />
dans le paléoacétabulum. La cavité endomédullaire du fémur<br />
était préparée à l’aide d’une râpe mousse à la forme de la prothèse<br />
définitive et le col prothétique adapté àchaque cas de bras de<br />
levier et d’antéversion.<br />
RÉSULTATS. Il y avait 174 dysplasies et 83 luxations dont<br />
39 % de stade 1, 30 % de stade 2, 14 % de stade 3, et 17 % de<br />
stade 4. L’allongement moyen à réaliser était de 39 mm. L’angle<br />
d’antéversion moyen était de 28 ± 16° et le diamètre antéropostérieur<br />
moyen de acétabulum était de 51mm. Le score clinique de<br />
Harris était passé de 58 points en pré-opératoire à 93 points au<br />
recul. L’analyse radiographique post-opératoire a montré une<br />
ostéointégration dans 88 % <strong>des</strong> cas, une ostéolyse dans 5 % et 1<br />
cas d’enfoncement de la tige. Six hanches ont nécessité un<br />
changement : 2 pour raisons septiques, 1 pour luxation et 2 pour<br />
non-fixation. La courbe de survie était de 97 % à 11 ans.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. Cette étude confirme <strong>les</strong><br />
modifications anatomiques rencontrées dans <strong>les</strong> séquel<strong>les</strong> de<br />
DDH et apporte une solution pour résoudre certains problèmes<br />
chirurgicaux.<br />
Il n’existait pas de corrélation entre importance de la luxation<br />
et degré d’antéversion, il est donc difficile sans tomodensitométrie<br />
pré-opératoire d’évaluer <strong>les</strong> difficultés en cas de tige non<br />
cimentée. Le taux de survie à 11 ans est encourageant sur une<br />
population jeune et active.<br />
*X. Flecher, Service de Chirurgie Orthopédique,<br />
Hôpital Sainte-Marguerite, 270, boulevard de<br />
Sainte-Marguerite, BP 29, 13274 Marseille Cedex 09.<br />
104 Devenir d’implants acétabulaires<br />
non cimentés laissés en place lors<br />
de révisions fémora<strong>les</strong> isolées<br />
d’arthroplasties tota<strong>les</strong> de hanche<br />
P. BEAULÉ*, M. LEDUFF, F.DOREY, H.AMSTUTZ<br />
INTRODUCTION. L’ablation d’une cupule non cimentée<br />
peut avoir pour conséquence une morbidité opératoire augmentée,<br />
un surcoût et une perte du stock osseux. Des données sont<br />
donc nécessaires pour prédire la survie à long terme d’implants<br />
acétabulaires non cimentés laissés en place lors de révisions<br />
fémora<strong>les</strong> d’arthroplasties tota<strong>les</strong> de hanche.<br />
MÉTHODES. Les auteurs ont étudié <strong>les</strong> résultats cliniques et<br />
radiologiques de 5 à 15 ans de recul d’une série consécutive de 83<br />
patients (88 hanches) chez qui un implant acétabulaire non<br />
cimenté a été laissé en place lors d’une révision fémorale isolé
d’une arthroplastie totale de hanche. L’âge moyen <strong>des</strong> patients au<br />
moment de la reprise était de 54 ans. Deux types d’implants<br />
acétabulaires avaient été utilisés : 69 en titane grillagé et 19 avec<br />
un revêtement poro-coat. L’indication de la reprise était toujours<br />
un <strong>des</strong>cellement fémoral isolé. Au moment de la reprise, 33 %<br />
<strong>des</strong> patients présentaient une ostéolyse acétabulaire qui a été<br />
greffée chez 52 % <strong>des</strong> patients.<br />
RÉSULTATS. Au recul moyen de 7,5 ans après la reprise<br />
(implants cotyloïdiens in situ depuis 11,6 ans en moyenne), le<br />
score fonctionnel avant la reprise et au dernier recul selon la<br />
cotation de UCLA était respectivement de 3,8 versus 8,9 pour la<br />
douleur ; 6,3 versus 8,4 pour la marche ; 5,8 versus 7,9 pour la<br />
fonction ; et 4,8 versus 6,1 pour l’activité. Six implants acétabulaires<br />
ont été repris à 7,5 ans en moyenne (2 à 14 ans) après la<br />
reprise fémorale (implants acétabulaires in situ depuis 13,3 ans<br />
en moyenne) pour <strong>des</strong>cellement acétabulaire dans 1 cas, 3 pour<br />
conversion à un couple métal-métal, et un pour luxation itérative<br />
et sepsis. Dans aucun cas il n’a été noté une récurrence ni une<br />
aggravation du phénomène ostéolytique.<br />
DISCUSSION. Le changement d’un implant acétabulaire non<br />
cimenté basé sur sa durée deviein vivo ou sur le fait qu’une<br />
reprise précédente a été réalisée ne semble pas justifié. La<br />
présence d’une ostéolyse ne semble pas affecter la fixation à long<br />
terme d’un implant acétabulaire non cimenté après reprise fémorale.<br />
Les auteurs recommandent l’ablation <strong>des</strong> vis de fixation<br />
acétabulaire au moment de la reprise pour évaluer correctement<br />
la fixation du composant.<br />
*P. Beaulé, Joint Replacement Institute Orthopaedic Hospital,<br />
2400 S Flower Street, 90007 Los Ange<strong>les</strong>, Etats-Unis.<br />
105 La méralgie paresthésique, une<br />
cause rare de douleur inguinale : à<br />
propos de 119 cas opérés entre<br />
1987 et 1999<br />
T. FABRE*, I. BÉNÉZIS, J.BOUCHAIN, F.FARLIN,<br />
J. REZZOUK, A.DURANDEAU<br />
INTRODUCTION. L’origine de la méralgie paresthésique est<br />
le plus souvent une compression du nerf cutané latéral de la<br />
cuisse (NCLC) au niveau de son passage sous le ligament<br />
inguinal. Le sujet de cette étude était de présenter notre expérience<br />
sur le traitement chirurgical <strong>des</strong> méralgies paresthésiques,<br />
à partir de 119 cas opérés entre 1987 et 1999.<br />
MATÉRIEL. Nous avons revu 114 patients (5 bilatéraux, 48<br />
femmes et 66 hommes) opérés deméralgie paresthésique le plus<br />
souvent par neurolyse sous anesthésie locale entre 1987 et 1999.<br />
Nous avons retenus 5 étiologies de méralgie : 69 d’origine idiopathiqùe<br />
(3 bilatéraux), 19 après chirurgie abdominale, 12 après<br />
prise de greffon iliaque (1 bilatéral), 7 après chirurgie de hanche<br />
et 7 après un traumatisme (1 bilatéral).<br />
MÉTHODES. Nous avons analysé <strong>les</strong> résultats à plus de deux<br />
ans de recul sur l’ensemble de la série et en fonction de chaque<br />
étiologie grâce à l’élaboration d’un score d’évaluation. Ce score<br />
noté sur 12 tient compte de la douleur résiduelle, <strong>des</strong> troub<strong>les</strong><br />
sensitifs et de la satisfaction du patient.<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 2S67<br />
RÉSULTATS. Les résultats de l’ensemble de la série étaient<br />
bons car le score moyen était de 9 sur 12 (1 à 12). Dans 92 cas <strong>les</strong><br />
patients étaient satisfaits ou très satisfaits. Parmi <strong>les</strong> 27 cas<br />
insatisfaits, 5 ont présenté une récidive. Le délai moyen de<br />
régression <strong>des</strong> douleurs était de 70 jours (1 à 364 jours). La<br />
récupération de la sensibilité de la cuisse était d’environ 128<br />
jours (1 à 364 jours).<br />
DISCUSSION. Les critères essentiels de mauvais pronostic<br />
sont la longueur du délai pré-opératoire et l’étiologie de la<br />
méralgie. La neurolyse d’un NCLC lésé par un traumatisme ou la<br />
prise de greffon iliaque (scores respectifs de 7 et 6) donne de<br />
moins bons résultats que lors <strong>des</strong> lésions d’origine idiopathiqùe<br />
ou après chirurgie abdominale (scores respectifs de 9 et 10). La<br />
neurectomie effectuée à 8 reprises dans cette série ne donne pas<br />
de bons résultats (score de 5).<br />
CONCLUSION. La neurolyse nous semble la technique chirurgicale<br />
de choix de la méralgie paresthésique. Chez un opérateur<br />
entraîné elle peut être effectuée sous anesthésie locale mais<br />
<strong>les</strong> difficultés ne sont pas négligeab<strong>les</strong> : patients obèses, terrain<br />
remanié par <strong>des</strong> opérations ultérieures, variations anatomiques<br />
fréquentes du nerf. Ces dernières sont à bien connaître non<br />
seulement pour la réalisation de la neurolyse mais surtout pour<br />
éviter <strong>les</strong> lésions iatrogènes.<br />
*T. Fabre, Service de Chirurgie Orthopédique<br />
et Traumatologique, CHU Pellegrin, place Amélie-Raba-Léon,<br />
33076 Bordeaux Cedex.<br />
106 Résultats à plus de 5 ans d’une<br />
butée osseuse encastrée associée<br />
à une PTH dans le traitement <strong>des</strong><br />
coxarthroses secondaires<br />
J. CATON*, P. REYNAUD, Z.MERABET<br />
INTRODUCTION. De 1979 à 2000, nous avons réalisé 115<br />
prothèses tota<strong>les</strong> de hanche avec butée dont la plupart était sur<br />
séquel<strong>les</strong> de luxations congénita<strong>les</strong>. Jusqu’en 1992, nous utilisions<br />
la technique classique d’une butée osseuse vissée etd’une<br />
cupule tout polyéthylène type Charnley cimentée au niveau du<br />
paléoacétabulum. Cette technique avait pour inconvénient de<br />
reporter l’appui de 2 mois afin de limiter <strong>les</strong> contraintes sur la<br />
butée et de favoriser son intégration. Depuis 1992, nous avons<br />
modifié cette technique et utilisé une butée osseuse encastrée<br />
impactée dans l’angle dièdre entre la capsule et le néoacétabulum<br />
d’une part et une cupule non cimentée impactée avec vis dans le<br />
paléoacétabulum d’autre part ; l’appui postopératoire immédiat<br />
étant autorisé de façon identique à une prothèse normale de<br />
première intention.<br />
MATÉRIEL. De 1992 à 2002, nous avons opéré 56 patients<br />
(63 hanches) selon cette technique, 50 ont été revus (56 hanches)<br />
avec un recul moyen de 5 ans (1 à 9,5 ans). Trois patients étaient<br />
décédés à la révision (3 hanches) et 3 perdus de vue (4 hanches).<br />
Le but de ce travail était de vérifier la bonne intégration de la<br />
butéeetl’absence de complications au niveau au de l’acétabulum<br />
du fait d’un appui immédiat. L’âge moyen à l’intervention était
2S68 77 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
de 58,5 ans (17 à 88 ans).Dix-sept hanches avaient déjà été<br />
opérées primitivement, 13 deux fois et 4 trois fois.<br />
MÉTHODE. Les patients ont été reconvoqués avec un examen<br />
clinique et radiographique (de face de profil ainsi qu’un faux<br />
profil de Lequesne) afin de bien évaluer l’aspect radiologique de<br />
la butée. Les patients ont été évalués defaçon clinique objective<br />
selon le score de Postel Merle d’Aubigné et, de façon subjective,<br />
sur le plan de la satisfaction.<br />
RÉSULTATS. Le score moyen PMA en pré-opératoire était de<br />
11,7 et le score moyen à la révision était à 17,6. 94 % <strong>des</strong> patients<br />
se sont déclarés satisfaits ou très satisfaits, 6 % déçus (3 luxations<br />
post-opératoires). Sur le plan radiographique, la butée a été<br />
retrouvée lysée (1), présente mais non intégrée (8), parfaitement<br />
ostéo-intégrée (47). La cupule n’a pas subi de modification<br />
radiologique ni d’ascension. Nous avons observé <strong>des</strong> liserés en<br />
zone I et en zone 2 (14,8 %) ; en zone 3 (16,8 %). Aucune relation<br />
n’a été retrouvée entre l’intégration de la butée etlaprésence<br />
d’un liseré acétabulaire. Quatre complications ont été recensées :<br />
un <strong>des</strong>cellement à 8 mois, <strong>des</strong>cellement brutal traité par changement<br />
de cupule et 3 luxations dont 1 traitée à 4 ans par un<br />
croissant anti-luxation.<br />
Aucune relation n’a été retrouvée entre <strong>les</strong> complications et<br />
l’évolution de la butée.<br />
DISCUSSION. L’avantage de la technique de butée encastrée<br />
avec prothèse hybride utilisant un couple métal-polyéthylène<br />
22,225 est de permettre <strong>des</strong> suites opératoires immédiates identiques<br />
à cel<strong>les</strong> d’une prothèse classique standard en bonne position.<br />
L’autorisation d’un appui immédiat sur une cupule sans<br />
ciment impactée fixée par deux vis, n’a pas entraîné de complications<br />
néfastes <strong>particulières</strong> tant sur le plan clinique que sur<br />
l’évolution de la butée osseuse.<br />
CONCLUSION. Il s’agit d’une technique fiable permettant<br />
une reprise de la marche précoce avec raccourcissement <strong>des</strong><br />
délais de récupération et dont l’évolution sur la stabilité de la<br />
cupule est satisfaisante.<br />
*J. Caton, Clinique Emilie-de-Vialar,<br />
116, rue Antoine-Charial,<br />
69003 Lyon.<br />
107 Transmission d’une maladie de<br />
Paget à partir d’une autogreffe<br />
spongieuse : à propos d’un cas<br />
après arthroplastie totale de hanche<br />
M. HAMADOUCHE*, M. MATHIEU, G.DE PINIEUX,<br />
V. TOPOUCHIAN, J.-P. COURPIED<br />
INTRODUCTION. La maladie de Paget osseuse, définie par<br />
une augmentation de la résorption et de la néoformation oseeuse,<br />
demeure d’étiologie non complètement élucidée. L’hypothèse<br />
actuellement retenue est celle d’une infection lente à paramyxovirus<br />
chez <strong>des</strong> patients génétiquement prédisposés. Les auteurs<br />
rapportent dans cette observation un cas de maladie de Paget<br />
monostotique du bassin transmise au fémur distal homolatéral<br />
après arthroplastie totale de hanche.<br />
CAS CLINIQUE. Un patient âgé de 66 ans présentant une<br />
maladie de Paget d’un hémi-bassin compliquéed’une coxopathie<br />
pagétique a été opéré par prothèse totale hanche en 1993. Il<br />
s’agissait d’une prothèse de Charnley-Kerboull cimentée. Lors<br />
du scellement de l’implant fémoral, le canal médullaire avait été<br />
obturé par <strong>des</strong> fragments de spongieux provenant notamment du<br />
cotyle (plots réalisés pour augmenter la stabilité rotatoire de<br />
l’implant cotyloïdien). Un an après l’intervention, une lésion<br />
ostéolytique fémorale distale asymptomatique était observée au<br />
niveau du bouchon fémoral. La fonction de la hanche restait<br />
excellente malgré l’extension de l’ostéolyse fémorale en direction<br />
du fémur distal et proximal. Tous <strong>les</strong> paramètres inflammatoires<br />
étaient normaux, et la pièce fémorale n’était pas <strong>des</strong>cellée.<br />
Une scintigraphie au technecium 99m révélait une hyperfixation<br />
au niveau du bassin mais également au niveau fémoral distal sous<br />
la pièce fémorale. Une reprise fémorale isoléeaété réalisée pour<br />
éviter une fracture de fatigue du fémur en 1996. Les prélèvements<br />
réalisés ont mis en évidence un tissu osseux typique de<br />
maladie de Paget (hyperactivité <strong>des</strong> ostéoclastes et <strong>des</strong> ostéoblastes<br />
avec aspect en mosaïque). Après reprise fémorale par tige<br />
longue et traitement par biphosphonates, la lésion ostéolytique a<br />
disparu progressivement, prenant un aspect scléreux cicatriciel<br />
classique dans une maladie de Paget osseuse. Aucune reprise de<br />
la maladie n’a été notée 6 ans aprèslaréintervention. La fonction<br />
de la hanche est jugée excellente au dernier recul.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. Une telle complication<br />
n’a jamais été décrite dans la littérature. Cette observation de<br />
transfert d’une maladie de Paget via une autogreffe spongieuse<br />
supporte l’idéed’une étiologie au moins partiellement virale pour<br />
la maladie de Paget osseuse, via un processus d’infection ostéoclastique<br />
par contiguïté. Cette complication n’a jamais été observée<br />
après utilisation d’allogreffe congelée ou irradiée, bien que<br />
ces greffons soient parfois pathologiques, notamment atteints de<br />
lésions pagétiques.<br />
*M. Hamadouche, Service de Chirurgie Orthopédique A,<br />
Hôpital Cochin, 27, rue du Faubourg-Saint-Jacques,<br />
75014 Paris.
108 Biométrie <strong>des</strong> branches motrices<br />
<strong>des</strong> nerfs médian et ulnaire à<br />
l’avant-bras : à propos de 20 dissections<br />
(application à la chirurgie<br />
d’hyponeurotisation de la main<br />
spastique)<br />
G. POLLE*, P.-Y. MILLIEZ, F.DUPARC,<br />
I. AUQUIT-AUCKBUR, F.DUJARDIN<br />
INTRODUCTION. Le but de cette étude était de réaliser une<br />
cartographie <strong>des</strong> branches motrices <strong>des</strong> nerfs médian et ulnaire à<br />
l’avant bras et de dénombrer <strong>les</strong> anastomoses de Martin-Gruber.<br />
L’étude <strong>des</strong> variations anatomiques est susceptible d’apporter <strong>des</strong><br />
renseignements uti<strong>les</strong> à la chirurgie d’hyponeurotisation de la<br />
main spastique. Les variations de l’émergence ante-brachiale <strong>des</strong><br />
6 branches motrices du nerf médian et <strong>des</strong> 3 branches motrices du<br />
nerf ulnaire ont été étudiées.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Cette étude a été réalisée sur 20<br />
pièces anatomiques prélevées chez 5 femmes et 5 hommes. Nous<br />
avons mesuré la longueur de l’avant bras et le niveau d’origine de<br />
chaque branche motrice <strong>des</strong> nerfs médian et ulnaire à partir d’un<br />
repère horizontal joignant l’épicondyle médial et latéral. Le<br />
niveau d’origine de chaque branche a alors été calculé sous forme<br />
de % de la longueur globale de l’avant bras.<br />
RÉSULTATS. La longueur moyenne <strong>des</strong> avant bras était de<br />
26,93 ± 2,6 cm. Contrairement au niveaux d’origine <strong>des</strong> nerfs<br />
supérieur et inférieur du rond pronateur et <strong>des</strong> nerfs du long<br />
palmaire, du fléchisseur radial du carpe et du fléchisseur superficiel<br />
<strong>des</strong> doigts qui étaient très variab<strong>les</strong> (coefficient de variation<br />
entre 49 et 113 %), le niveau d’origine du nerf interosseux<br />
antérieur de l’avant bras (CV = 39 %) et de ses branches, nerf du<br />
long fléchisseur du pouce et du fléchisseur profond <strong>des</strong> doigts<br />
(CV = 23 et 29 %) était beaucoup plus régulier. Les niveaux<br />
d’origine <strong>des</strong> nerfs supérieur et inférieur du fléchisseur ulnaire du<br />
carpe (CV = 157 et 22 %) étaient variab<strong>les</strong> alors que le nerf du<br />
fléchisseur profond <strong>des</strong> IV et V doigt présentait le meilleur<br />
coefficient de variation (13 %).<br />
Nous avons observé 4 anastomoses de type Martin-Gruber soit<br />
20 %.<br />
CONCLUSION. Cette étude a permis de mettre en évidence la<br />
grande variabilité anatomique <strong>des</strong> nerfs médian et ulnaire tant au<br />
plan inter individuel qu’au plan intra individuel. L’émergence de<br />
certaines branches nerveuses semble plus régulière, en particulier<br />
le groupe nerveux inférieur du nerf médian issu du nerf interosseux<br />
antérieur de l’avant bras.<br />
Il est cependant possible de dégager de cette étude deux types<br />
anatomiques statistiquement plus fréquents pour le nerf médian.<br />
Les variations anatomiques du nerf ulnaire sont moindres.<br />
L’inconstance du nerf inférieur du fléchisseur ulnaire du carpe est<br />
à souligner.<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 2S69<br />
Séance du 14 novembre matin<br />
COUDE/POIGNET<br />
Ces variations anatomiques doivent être connues lors de la<br />
chirurgie d’hyponeurotisation du membre supérieur sous peine<br />
d’échec thérapeutique.<br />
*G. Polle, Service du Pr Biga, Hôpital Char<strong>les</strong>-Nicolle,<br />
1, rue de Germont, 76000 Rouen.<br />
109 Traitement <strong>des</strong> douleurs pisotriquétra<strong>les</strong><br />
par exérèse du pisiforme<br />
: à propos de 15 cas<br />
A. PIERRE*, D. LE NEN, A.SARAUX, F.CHAISE<br />
OBJECTIF. L’articulation piso-triquétrale peut être source de<br />
douleurs, souvent post-traumatiques. En cas d’échec du traitement<br />
conservateur, la pisiformectomie semble représenter la<br />
meilleure alternative. L’objectif de ce travail était d’évaluer <strong>les</strong><br />
résultats cliniques et fonctionnels <strong>des</strong> pisiformectomies.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. 13 patients ayant subi une pisiformectomie<br />
ont été revus avec un recul moyen de 31,5 mois.<br />
Deux d’entre eux ont fait l’objet d’une pisiformectomie bilatérale<br />
(n = 15). Les étiologies principalement traumatiques étaient<br />
rattachées en majorité àune maladie professionnelle. Quatre<br />
patients présentaient une neuropathie ulnaire associée. Tous <strong>les</strong><br />
patients ont été opérés selon une même technique opératoire et<br />
ont été revus régulièrement avec une évaluation clinique et<br />
subjective (échelle E.V.A.).<br />
RÉSULTATS. Aucune complication post-opératoire n’était à<br />
déplorer. Au plus grand recul, le résultat était jugé excellent 12<br />
fois, bon 2 fois et moyen dans 1 cas (n = 15). La douleur<br />
résiduelle évaluée analogiquement était en moyenne de 0,8<br />
points contre 6,4 points en préopératoire (p < 0,001). Les mobilités<br />
du poignet étaient améliorées en postopératoire.<br />
CONCLUSION. Les étiologies à l’origine de la pathologie de<br />
l’articulation pisotriquétrale sont nombreuses et dominées par <strong>les</strong><br />
étiologies traumatiques et micro traumatiques. La pisiformectomie<br />
s’avère être le meilleur traitement en cas d’échec ou d’épuisement<br />
du traitement conservateur. L’arthrodèse ne semble pas<br />
avoir sa place compte tenu <strong>des</strong> bons résultats de la pisiformectomie.<br />
Il est important toutefois de ne pas oublier que la pathologie<br />
piso-triquétrale peut s’inscrire dans le cadre d’une authentique<br />
pathologie régionale qu’il faudra savoir rechercher.<br />
*A. Pierre, Département d’Orthopédie (Pr Vielpeau),<br />
CHU de Caen, avenue de la Côte-de-Nacre,<br />
14033 Caen Cedex.
2S70 77 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
110 Traitement de l’arthrose scaphotrapézo-trapézoïdienne<br />
isolée : une<br />
série de 11 arthrodèses<br />
J.-N. GOUBIER*, B. BAUER, J.-Y. ALNOT<br />
INTRODUCTION. L’arthrose scapho-trapezo-trapézoidienne<br />
(STT) est fréquente et souvent peu symptomatique. Dans le cas<br />
contraire, après échec du traitement médical, plusieurs techniques<br />
chirurgica<strong>les</strong> peuvent être proposées. L’objectif de notre<br />
étude est d’évaluer <strong>les</strong> résultats d’une série de 11 arthroses STT<br />
isolées traitées par arthrodèse STT.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Dix patients, 3 hommes et 7<br />
femmes (11 mains), d’âge moyen 63 ans, présentant une arthrose<br />
STT ont été traité par arthrodèse STT. Tous <strong>les</strong> patients présentaient<br />
<strong>des</strong> douleurs lors <strong>des</strong> activités quotidiennes associées à une<br />
diminution <strong>des</strong> mobilités du poignet. Selon la classification<br />
radiographique de Crosby, il y avait un patient au stade I, 4 au<br />
stade II et 5 au stade II avec une désaxation adaptative du carpe.<br />
Un patient présentait une chondrocalcinose et 6 patients une<br />
tendinite du fléchisseur radial du carpe.<br />
Trois patients ont été opérés par voie antérieure et 7 par voie<br />
latérale. Une greffe iliaque était pratiquée chez 9 patients afin de<br />
combler la perte de substances osseuse due à l’usure antérieure.<br />
La synthèse utilisée était dans 6 cas <strong>des</strong> broches et dans 5 cas <strong>des</strong><br />
agrafes. Tous <strong>les</strong> patients étaient immobilisés dans un plâtre<br />
anti-brachio-palmaire pendant une durée minimale de 6 semaines.<br />
RÉSULTATS. Au recul moyen de 62 mois, la douleur était<br />
améliorée chez tous <strong>les</strong> patients (p = 0,05). Il n’existait aucune<br />
différence significative de mobilité en dehors d’une diminution<br />
de l’extension du poignet de 12° (p = 0,03). La force (grasp et<br />
pinch) n’était pas modifiée par l’arthrodèse STT. Tous <strong>les</strong> patients<br />
ont repris leurs activités antérieures de loisirs ou professionnel<strong>les</strong>.<br />
Aucune désaxation intracarpiennne ne s’est significativement<br />
aggravée et5ontété améliorés. Quatre patients présentaient une<br />
pseudarthrose (3 fixations par broches, une par agrafe), seuls<br />
deux symptomatiques furent réopérés avec la même technique<br />
conduisant à une fusion dans <strong>les</strong> deux cas. Aucune autre complication<br />
fut notée.<br />
DISCUSSION. Dans notre série comme dans la littérature,<br />
l’arthrodèse STT est efficace sur la douleur. Cependant, contrairement<br />
aux étu<strong>des</strong> précédentes, nous n’avons pas retrouvé de<br />
diminution significative de l’inclinaison radiale, de la force ou de<br />
conflit radio-carpien. De plus, l’adjonction systématique d’un<br />
greffon iliaque évite l’apparition ou l’aggravation d’une désaxation<br />
adaptative du carpe. L’autre orientation thérapeutique principale<br />
est la résection du pôle distal du scaphoïde donnant <strong>des</strong><br />
résultats cliniques plus rapi<strong>des</strong> mais aboutissant à une désaxation<br />
carpienne inéluctable.<br />
CONCLUSION. Nous restons donc fidèle à l’arthrodèse STT<br />
avec greffon iliaque dans le cadre de l’arthrose STT et ceci<br />
d’autant que le sujet est plus jeune.<br />
*J.-N. Goubier, Service de Chirurgie Orthopédique,<br />
Hôpital Bichat, 46, rue Henri-Huchard, 75877 Paris Cedex.<br />
111 Comparaison <strong>des</strong> résultats de<br />
l’intervention de Kapandji-Sauvé<br />
dans <strong>les</strong> séquel<strong>les</strong> de lésions du<br />
cadre antibrachial versus cel<strong>les</strong> du<br />
carrefour radio-ulnaire distal<br />
C. BEAUDON*, M. CHAMMAS, B.COULET,<br />
Y. ALLIEU<br />
OBJECTIFS. Les auteurs analysent <strong>les</strong> résultats d’une série<br />
rétrospective et continue de 30 interventions de Kapandji-Sauvé<br />
effectuées entre janvier 1993 et septembre 2000, pour correction<br />
de séquel<strong>les</strong> d’une part <strong>des</strong> lésions du cadre antibrachial (5 cas) et<br />
<strong>des</strong> lésions du carrefour radio-ulnaire distal (25 cas) d’autre part.<br />
RÉSULTATS. Tous <strong>les</strong> patients (âge moyen de 42 ans) ont été<br />
revus par un même examinateur avec un recul moyen de 44 mois.<br />
L’intervalle moyen entre le traumatisme initial et l’intervention<br />
était de 26 mois.<br />
Les objectifs dans <strong>les</strong> séquel<strong>les</strong> de lésions du carrefour radioulnaire<br />
distal ont été atteints avec un volant de prono-supination<br />
de 158°, tout en conservant une force de 73 % en moyenne par<br />
rapport au côté controlatéral. Le score fonctionnel de la Mayo-<br />
Clinic modifié au dernier recul était de 72/100 et 24/25 patients<br />
étaient très satisfaits ou satisfaits.<br />
Même si <strong>les</strong> résultats étaient inférieurs dans le groupe <strong>des</strong><br />
lésions du cadre antibrachial, avec un volant de prono-supination<br />
de 110°, une force de 48 % et un score de 56 en moyenne ; 3/5<br />
patients étaient très satisfaits ou satisfaits et 4/5 avaient repris une<br />
activité professionnelle.<br />
De plus aucun n’avait présenté d’instabilité du moignon<br />
ulnaire dans ce groupe.<br />
CONCLUSION. L’étude confirme l’efficacité de la technique<br />
dans <strong>les</strong> séquel<strong>les</strong> de lésions du carrefour radio-ulnaire distal<br />
notamment chez <strong>des</strong> patients jeunes.<br />
L’indication originale dans <strong>les</strong> séquel<strong>les</strong> de lésions du cadre<br />
antibrachial donne <strong>des</strong> résultats satisfaisants au prix d’une intervention<br />
simple comparée aux ostéotomies diaphysaires <strong>des</strong> 2 os<br />
de l’avant-bras.<br />
*C. Beaudon, Service d’Orthopédie 2, Hôpital Lapeyronie,<br />
371, avenue du Doyen-Gaston-Giraud,<br />
34295 Montpellier Cedex 5.<br />
112 L’instabilité du carpe avec dissociation<br />
scapho-lunaire : correction par<br />
reconstruction du ligament scaphotrapézoïdal<br />
volaire avec une bandelette<br />
du grand palmaire (FCR)<br />
G. BRUNELLI*<br />
INTRODUCTION. L’instabilité du carpe avec dissociation<br />
scapho-lunaire est encore considérée due à la rupture du soi-
disant ligament scapho-lunaire (S.L.). Mais ceci n’est pas un<br />
ligament, au contraire il est une capsule lâche laquelle permet <strong>des</strong><br />
flexions très différentes du scaphoïde et du lunaire (92° contre<br />
20°).<br />
Les reconstructions du « ligament » S.L. donnent <strong>des</strong> résultats<br />
souvent décevants.<br />
MATÉRIEL. Plusieurs sections cadavériques du « ligament »<br />
S.L. ne donnèrent jamais la dissociation S.L. Cette dissociation<br />
ne peut pas s’avérer parce que le scaphoïde est gardé àsa place<br />
par la facette articulaire du radius.<br />
Seulement en coupant le ligament scapho-trapezio trapézoïdal,<br />
le scaphoïde peut se fléchir (rotary subluxation) et se luxer<br />
dorsalement. Ce ligament est peu connu et il n’est pas décrit dans<br />
<strong>les</strong> textes d’anatomie parce que il est caché par la gaine du tendon<br />
du grand palmaire.<br />
Seulement en se luxant en arrière peut le pôle proximal se<br />
dissocier du semi-lunaire.<br />
MÉTHODE OPÉRATOIRE. Après lamiseàpoint sur cadavre,<br />
une technique de reconstruction du ligament scaphotrapézoïdal<br />
volaire par une bandelette du tendon du fléchisseur<br />
radial du poignet a été employée en 38 patients.<br />
La bandelette (7 cm) du grand palmaire, laissée attachée à la<br />
base du deuxième metà, est passée dans un tunnel perforé dans le<br />
pôle distal du scaphoïde. Ensuite la bandelette est tirée dorsalement<br />
(en remettant à sa place le scaphoïde) et est suturée au bord<br />
dorso-ulnaire du radius.<br />
RÉSULTATS. L’hauteur du carpe est restituée, la mobilité du<br />
scaphoïde par rapport au lunaire aussi (flexion en déviation<br />
radiale, extension en déviation cubitale) et la réduction est maintenue<br />
à moyen et long terme avec prévention du collapsus carpien<br />
et de l’arthrite). Parmi le 38 cas opérés 35 ne se plaignent pas de<br />
douleur, 3 ont douleur mo<strong>des</strong>te sous stress. Tous sont satisfaits.<br />
DISCUSSION. La recherche anatomique et <strong>les</strong> interventions<br />
humaines ont confirmé que le ligament scapho-trapézoïdal est la<br />
clé soit de la dissociation soit de la réparation.<br />
CONCLUSION. Cette opération est, au moment, la seule<br />
capable de corriger facilement et définitivement l’instabilité du<br />
carpe avec dissociation scapho-lunaire.<br />
*G. Brunelli, Fondazione Ricerca Midollo Spinale,<br />
Via Galvani<br />
26, 25123 Brescia, Italie.<br />
113 Intérêt del’arthroscopie du poignet<br />
dans le traitement <strong>des</strong> fractures articulaires<br />
du quart inférieur du radius<br />
C. MATHOULIN*<br />
INTRODUCTION. L’arthroscopie du poignet peut être une<br />
alternative au traitement à ciel ouvert <strong>des</strong> fractures articulaires du<br />
radius en contrôlant la réduction <strong>des</strong> fragments souvent impactés<br />
et en analysant <strong>les</strong> lésions intrinsèques associées.<br />
MATÉRIEL. 28 patients ont été traités par cette méthode (15<br />
hommes pour 13 femmes).<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 2S71<br />
L’âge moyen était de 51 ans (entre 19 et 82).<br />
Il y avait 4 fractures de la styloïde radiale, 6 fragments<br />
postéro-internes, 11 fractures en « T »à«3 fragments » et 7<br />
fractures à«4 fragments » ou plus.<br />
On a retrouvé 19 lésions associées (6 lésions du ligament<br />
triangulaire, 4 lésions du ligament luno-triquétral et 9 lésions du<br />
ligament scapho-lunaire dont 4 ont nécessité un brochage).<br />
MÉTHODES. Tous <strong>les</strong> patients ont été opérés sous anesthésie<br />
loco-régionale. Le coude était fléchi à 90° et le poignet en<br />
traction dans l’axe à l’aide de doigtiers « japonais ».<br />
Après un nettoyage soigneux de l’articulation, la réduction se<br />
faisait sous contrôle arthroscopique et fluoroscopique à l’aide de<br />
broches. Dans certains cas très instab<strong>les</strong>, tel<strong>les</strong> <strong>les</strong> fractures à«4<br />
fragments » ou plus, l’adjonction d’une plaque antérieure était<br />
rendue nécessaire.<br />
Une attelle était mise en place pour 45 jours.<br />
RÉSULTATS. Notre recul moyen était de 21 mois (entre 6<br />
mois et 36 mois).<br />
La mobilité du poignet était normale dans 24 cas et la douleur<br />
avait totalement disparu dans 27 cas.<br />
Nous n’avons eu aucun déplacement secondaire ayant nécessité<br />
une reprise chirurgicale.<br />
Dans 2 cas il y avait une horizontalisation du radius et dans 4<br />
cas un inversement de l’index radio-ulnaire inférieur de 0,5 cm<br />
environ.<br />
En fonction du score fonctionnel nous avons retrouvé 22<br />
excellent et bon résultats, 5 résultats moyens et 1 mauvais résultat<br />
dû àune algoneurodystrophie.<br />
DISCUSSION. La nécessité de traiter chirurgicalement <strong>les</strong><br />
fractures articulaires est maintenant bien connue. Nos résultats<br />
sont comparatifs aux autres séries utilisant l’arthroscopie du<br />
poignet dans ce type de fractures. La qualité <strong>des</strong> résultats fonctionnels<br />
semble directement liée à la qualité de la réduction<br />
obtenue et à la qualité du montage qui est réalisée sous traction.<br />
CONCLUSION. L’utilisation de l’arthroscopie du poignet<br />
dans le traitement <strong>des</strong> fractures articulaires du ¼ inférieur du<br />
radius permet une réduction anatomique garantit de bons résultats<br />
fonctionnels.<br />
*C. Mathoulin, Clinique Jouvenet, 6, square Jouvenet,<br />
75016 Paris.<br />
114 Reconstruction <strong>des</strong> pertes de substance<br />
osseuse post-traumatiques<br />
<strong>des</strong> deux os de l’avant-bras par<br />
transfert libre de fibula : à propos de<br />
6 cas<br />
C. CHANTELOT*, C. FEUGAS, M.SCHOOFS,<br />
P. LEPS, C.FONTAINE<br />
INTRODUCTION. La prise en charge <strong>des</strong> pertes de substance<br />
osseuse <strong>des</strong> os longs pose <strong>des</strong> problèmes de reconstruction,
2S72 77 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
notamment au-delà de 5 cm de longueur ou lorsqu’il existe une<br />
infection associée conduisant souvent à une résection osseuse<br />
complémentaire. Lorsque la perte de substance est peu importante,<br />
on peut se contenter d’une greffe spongieuse conventionnelle,<br />
mais pour <strong>des</strong> défects de plusieurs centimètres ou lorsque<br />
le site receveur est infecté, un apport osseux vascularisé par une<br />
greffe de fibula micro anastomosée peut être indiquée. Cet apport<br />
osseux est régulièrement pratiqué àla jambe, mais plus rarement<br />
utilisé pour <strong>les</strong> deux os de l’avant bras. Le but de cette étude était<br />
d’en préciser <strong>les</strong> modalités et <strong>les</strong> résultats dans cette localisation.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Il s’agit d’une étude rétrospective<br />
sur 6 greffes de fibula libre micro-vascularisées pratiquées<br />
pour <strong>des</strong> pertes de substance <strong>des</strong> deux os de l’avant-bras. Il<br />
s’agissait de 5 hommes et d’une femme, d’âge moyen 34 ans. La<br />
perte de substance osseuse était localisée 5 fois sur le radius et 1<br />
fois sur l’ulna. Le défect osseux était en moyenne de 10 cm (de<br />
6 à 18 cm). Les 6 patients avaient eu <strong>des</strong> traumatismes par<br />
écrasement, avec fracture ouverte et expulsion d’une partie du<br />
squelette de l’avant-bras. La prise en charge initiale avait consisté<br />
en un parage large, fermeture cutanée etfixation temporaire par<br />
fixateur externe. Dans 5 cas la greffe a été pratiquée en moyenne<br />
8 semaines après le traumatisme et pour le sixième le patient, qui<br />
avait eu de multip<strong>les</strong> greffes spongieuses autologues, laissant une<br />
pseudarthrose de l’ulna avec un défect osseux de 18 cm, la greffe<br />
a été pratiquée à 6 mois. L’anastomose vasculaire a été réalisée5<br />
fois par une boucle saphène selon Meyer. Dans un cas, nous<br />
avons réalisé un péroné vascularisé pontage. L’ostéosynthèse a<br />
été confiée soit à <strong>des</strong> vis ou <strong>des</strong> plaques.<br />
RÉSULTATS. Tous <strong>les</strong> patients ont consolidé dans un délai de<br />
4 à 6 mois. Le recul moyen de cette série était de 3 ans (1 à 5 ans).<br />
Aucune fracture secondaire n’a été observée. L’amplitude<br />
moyenne de flexion-extension du coude était au recul de 100°.La<br />
pronosupination était de 100° en moyenne.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. Le transfert libre de fibula<br />
a permis la reconstruction de larges pertes de substance traumatique<br />
<strong>des</strong> os de l’avant-bras. L’apport d’os vascularisé permet de<br />
raccourcir le délai de consolidation sur <strong>des</strong> pertes de substance<br />
étendues tout en donnant une qualité mécanique supérieure aux<br />
greffes conventionnel<strong>les</strong> non vascularisées. Ces greffes vascularisés<br />
peuvent être indiquées dans <strong>les</strong> pseudarthroses septiques car<br />
la vascularisation du greffon peut favoriser la diffusion de l’antibiotique.<br />
*C. Chantelot, Service d’Orthopédie B,<br />
Hôpital Roger-Salengro, CHRU de Lille, 59037 Lille Cedex.<br />
115 Fixation externe dynamique et distraction<br />
articulaire en traumatologie<br />
du coude<br />
S. LEVANTE*, L. MERLAUD, T.BÉGUÉ,<br />
A.-C. MASQUELET, J.-Y. NORDIN<br />
INTRODUCTION. L’instabilité d’un coude traumatisé se<br />
dévoile parfois précocement aprèsl’intervention, entraînant alors<br />
la récidive d’une luxation, ou la faillite d’une synthèse. La<br />
nécessité d’une immobilisation complémentaire fait prendre le<br />
risque d’une raideur. Le but de cette étude était d’apprécier<br />
l’apport d’une fixation externe dynamique permettant une mobilisation<br />
protégée del’articulation en légère distraction, sa faisabilité<br />
et d’en cerner <strong>les</strong> meilleures indications.<br />
MATÉRIELS ET MÉTHODES. Nous avons utilisé 15 fois le<br />
fixateur articulé de coude de Pennig en traumatologie.<br />
Il s’agissait majoritairement de traumatismes complexes<br />
récents :<br />
5 luxations associant lésions ligamentaires média<strong>les</strong> et fractures<br />
de la tête radiale, dont 2 avec récidive précoce de la luxation.<br />
5 fractures articulaires (associant à <strong>des</strong> degrés divers, condyle<br />
latéral, tête radiale, olécrane et palette humérale).<br />
Par ailleurs cette méthode a également été utilisée dans le<br />
traitement de lésions plus anciennes ou de séquel<strong>les</strong> : reconstructions<br />
de palettes huméra<strong>les</strong> (3 fois) ou arthrolyses extensives (2<br />
fois).<br />
La mobilisation a été débutée vers le 5 e jour.<br />
RÉSULTATS. Dans <strong>les</strong> lésions récentes, l’articulation humero<br />
ulnaire est toujours restée centrée. Dans ce groupe la flexion<br />
moyenne finale était de 0.35.130° et la prono supination de<br />
0.10.155°. Une tête radiale s’est subluxée.<br />
Dans <strong>les</strong> lésions anciennes la flexion était de 0.40.100° et la<br />
prono supination de 0.10.115°. Une luxation purement latérale<br />
s’est reproduite.<br />
Il y eu une synostose radio ulnaire après fracture de l’ulna et un<br />
ostéome.<br />
DISCUSSION. La mise en place de ce fixateur, à condition de<br />
respecter une technique rigoureuse, est simple et sûre. Le fixateur<br />
dynamique a permis de débuter précocement la rééducation, sans<br />
déplacement secondaire, assurant également une contention fiable<br />
particulièrement utile chez le polytraumatisé. Larééducation<br />
a été peu douloureuse probablement grâce à la distraction, qui ne<br />
semble pas ici donner d’algodystrophie. Dans <strong>les</strong> instabilités<br />
complexes du coude, la baisse <strong>des</strong> contraintes lors de la mobilisation<br />
nous a permis d’étendre <strong>les</strong> indications de conservation de<br />
fragments articulaires. Dans <strong>les</strong> lésions anciennes sur cou<strong>des</strong><br />
rai<strong>des</strong>, <strong>les</strong> résultats sont plus aléatoires.<br />
*S. Levante, Service d’Orthopédie, Hôpital de Bicêtre,<br />
78, rue du Général-Leclerc, 94275 Le Kremlin-Bicêtre.<br />
116 Instabilité chronique post-traumatique<br />
du coude : à propos de 22 cas<br />
D. HANNOUCHE*, T. BÉGUÉ, D.RING,<br />
A.-C. MASQUELET, J.-C. JUPITER<br />
INTRODUCTION. L’instabilité post-traumatique du coude<br />
est définie comme une subluxation de l’articulation huméroulnaire<br />
au moins 3 semaines après la survenue d’un traumatisme.<br />
Son traitement est fondé sur la restitution de 3 éléments stabilisateurs<br />
essentiels, l’apophyse coronoïde, la hauteur de la tête<br />
radiale, et la réparation du plan ligamentaire latéral. L’objectif de<br />
cette étude était d’analyser <strong>les</strong> modalités de traitement de ces<br />
instabilités etd’en évaluer le résultat à moyen terme.<br />
MÉTHODES. Une série continue de patients opérés entre<br />
1992 et 2000 a été analysée. Il s’agissait de 22 patients (12
hommes et 10 femmes), d’âge moyen 46 ans (26-74 ans). Le côté<br />
gauche était concerné 16 fois (2 dominants), le côté droit 6 fois (6<br />
dominants). Le traumatisme initial était une luxation isolée dans<br />
6 cas, une luxation associée à une fracture de l’apophyse coronoïde<br />
et de la tête radiale dans 9 cas, une fracture-luxation<br />
trans-olécranienne dans 7 cas. Le délai moyen entre le traumatisme<br />
initial et la reprise pour instabilité était de 4 mois. Dans<br />
tous <strong>les</strong> cas, l’intervention a consisté en une stabilisation par un<br />
fixateur externe dynamique de coude, associée ou non à la<br />
restauration de la hauteur du radius par prothèse de tête radiale<br />
(12 cas), et par la reconstitution d’une apophyse coronoïde (7<br />
cas). La réinsertion du plan ligamentaire latéral a été nécessaire<br />
17 fois.<br />
RÉSULTATS. Le recul moyen était de 33 mois. 6 patients ont<br />
été réopérés, 3 pour transposition du nerf ulnaire, 3 pour arthrolyse<br />
du coude. Un patient, considéré comme un échec, a eu une<br />
arthroplastie totale du coude dans l’année qui a suivi l’intervention.<br />
Au recul, <strong>les</strong> résultats étaient classés excellents dans 10 cas,<br />
bons dans 5, passable dans 1, et mauvais dans 5 (4 fracturesluxations<br />
trans-olécraniennes), selon la classification de la Mayo<br />
Clinic. Vingt patients avaient un coude stable. Le secteur de<br />
mobilité moyen en flexion extension était de 113°, avec un déficit<br />
d’extension moyen de 19°. Au recul, 6 patients présentaient <strong>des</strong><br />
signes radiographiques d’arthrose.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. L’analyse <strong>des</strong> résultats<br />
montre que celui-ci est directement corrélé àla nature du traumatisme<br />
initial et la qualité de la restauration <strong>des</strong> éléments<br />
stabilisateurs du coude. Les résultats <strong>les</strong> plus mauvais étaient<br />
observés avec <strong>les</strong> fractures-luxations trans-olécraniennes, génératrices<br />
d’arthrose dans 3 cas sur 5. Dans notre expérience, le<br />
traitement <strong>des</strong> séquel<strong>les</strong> de luxation du coude ou de triade terrible<br />
donne <strong>des</strong> résultats satisfaisants sous réserve d’une prise en<br />
charge thérapeutique appropriée.<br />
*D. Hannouche, Service d’Orthopédie, Hôpital Avicenne,<br />
125, route de Stalingrad, 93009 Bobigny.<br />
117 Réanimation de la flexion <strong>des</strong><br />
doigts et du poignet par transfert<br />
libre du grand dorsal neurotisé : à<br />
propos de 3 cas<br />
C. CHANTELOT*, C. FEUGAS, M.SCHOOFS,<br />
F. GIRAUD, C.FONTAINE<br />
INTRODUCTION. Les séquel<strong>les</strong> <strong>des</strong> traumatismes par écrasement<br />
du membre supérieur comportent habituellement <strong>des</strong><br />
lésions osseuses et <strong>des</strong> lésions <strong>des</strong> parties mol<strong>les</strong> notamment par<br />
l’effet de crush syndrome aboutissant pour ces dernières à une<br />
main paralytique de type syndrome de Volkmann. Nous rapportons<br />
ici notre expérience de la réanimation de la flexion <strong>des</strong><br />
doigts et du poignet par transfert libre neurotisé du grand dorsal<br />
pour <strong>des</strong> syndromes de Volkmann de l’avant-bras.<br />
PATIENTS ET MÉTHODE. L’âge moyen <strong>des</strong> patients était de<br />
25 ans, le recul moyen était de 3 ans. La technique chirurgicale a<br />
consisté en un transfert libre du grand dorsal avec suture artérielle<br />
sur l’artère ulnaire et une neurotisation sur le plus gros tronc du<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 2S73<br />
nerf médian <strong>des</strong>tiné aux fléchisseurs <strong>des</strong> doigts. Le muscle était<br />
fixé proximalement sur l’épicondyle médial et sa lame fibreuse<br />
distale était divisée pour permettre la suture avec <strong>les</strong> tendons<br />
fléchisseurs profonds. La mobilisation commençait à 21 jours<br />
post-opératoires.<br />
RÉSULTATS. Un électromyogramme était réalisé à4 mois<br />
montrant la réinnervation du grand dorsal. Les patients ont<br />
récupéré une pince pouce-index, avec flexion <strong>des</strong> doigts longs. Ils<br />
étaient capab<strong>les</strong> d’effectuer <strong>les</strong> gestes de la vie courante. Tous ont<br />
eu un reclassement professionnel mais s’estimaient satisfaits de<br />
l’intervention. La flexion <strong>des</strong> doigts et du poignet était active et<br />
n’était pas obtenue par effet ténodèse.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. Le syndrome de Volkmann<br />
laisse <strong>des</strong> séquel<strong>les</strong> importantes après écrasement de<br />
l’avant-bras. Les techniques chirurgica<strong>les</strong> habituel<strong>les</strong> permettent<br />
de réduire la griffe <strong>des</strong> doigts par effet de détente. Mais du fait de<br />
la nécrose musculaire, le geste chirurgical ne permet pas de<br />
donner de la fonctionnalité au patient. Le transfert libre de grand<br />
dorsal améliore la trophicité de l’avant bras et, par la neurotisation,<br />
permet de réanimer la flexion de la main. En raison de la<br />
brièveté du pédicule nerveux de ce transfert, la récupération est<br />
rapide, évitant toute dégénésence du muscle grand dorsal.<br />
*C. Chantelot, Service d’Orthopédie B,<br />
Hôpital Roger-Salengro, CHRU de Lille, 59037 Lille Cedex.<br />
118 Les voies média<strong>les</strong> pour l’ostéosynthèse<br />
<strong>des</strong> fractures <strong>des</strong> deux tiers<br />
distaux de l’humérus<br />
G. BIETTE*, C. LAPORTE, F.JOUVE<br />
INTRODUCTION. Les auteurs rapportent leur expérience de<br />
l’abord par voie médiale et postero-médiale humérale, pour<br />
l’ostéosynthèse par plaque <strong>des</strong> fractures siégeant aux deux tiers<br />
inférieurs de la diaphyse.<br />
MATÉRIEL. Quinze patients (11 hommes et 4 femmes) ont été<br />
traités pour une fracture (13 cas) ou une pseudarthrose (2 cas),<br />
situées au-<strong>des</strong>sous du tiers proximal de la diaphyse, sans atteinte<br />
du nerf radial.<br />
MÉTHODE. La voie médiale était réaliséeendécubitus dorsal<br />
chez 8 patients, entre le paquet huméral et le nerf médian en<br />
avant, et le nerf ulnaire en arrière. La voie postéro-médiale était<br />
réalisée endécubitus ventral chez 7 patients, en arrière du nerf<br />
ulnaire et en avant du muscle triceps brachial. L’ostéosynthèse<br />
était réalisée par une plaque prenant au minimum 6 cortica<strong>les</strong> de<br />
part et d’autre de la fracture, appliquée sur la face médiale. Dans<br />
<strong>les</strong> suites <strong>les</strong> patients étaient immobilisés dans un gilet durant 45<br />
jours. La rééducation concernait le coude et l’épaule en passif<br />
sans aucune rotation externe. Les patients ont tous été revus pour<br />
un contrôle radio-clinique.<br />
RÉSULTATS. Un patient était perdu de vue deux mois après<br />
l’intervention : à cette date, la radiographie montrait une consolidation<br />
presque acquise. La fonction ne pouvait être appréciée:<br />
la fracture siégeait du côté d’une hémiplégie survenue lors de<br />
l’accident. Pour <strong>les</strong> 14 autres patients, le dernier recul était de 12<br />
mois en moyenne (min. : 6 mois ; max. : 36 mois). Trois patients
2S74 77 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
opérés par voie médiale présentaient <strong>des</strong> paresthésies dans le<br />
territoire du nerf médian, régressives seulement pour 2. Aucune<br />
complication neurologique n’était survenue après voie postéromédiale.<br />
La fonction était bonne concernant <strong>les</strong> mobilités du<br />
coude et de l’épaule sauf pour 2 patients. Les douleurs étaient<br />
absentes. Le foyer de fracture était consolidé dans tous <strong>les</strong> cas.<br />
DISCUSSION. Ces voies permettent d’éviter la dissection du<br />
nerf radial, et ont un intérêt esthétique. Il existe <strong>des</strong> difficultés<br />
lors de la voie médiale : la réduction est difficile à contrôler. Il<br />
faut alors mieux s’exposer au risque d’étirer le nerf médian en<br />
avant. La voie postéro-médiale semble préférable du fait du<br />
confort opératoire et de l’absence de risque pour le nerf médian.<br />
Ces voies sont contre-indiquées en cas d’atteinte pré-opératoire<br />
du nerf radial.<br />
CONCLUSION. L’ostéosynthèse humérale à la face médiale<br />
permet d’éviter la dissection du nerf radial. La réduction par voie<br />
postéro-médiale semble plus facile et moins risquée que par voie<br />
médiale.<br />
*G. Biette, Service de Chirurgie Orthopédique, CH Meaux,<br />
6 bis, rue Saint-Fiacre, 77104 Meaux Cedex.<br />
119 Chondrolyse articulaire postopératoire<br />
au membre supérieur après<br />
irrigation articulaire à la chlorhexidine<br />
: à propos de 9 observations<br />
M. VALVERDE*, N. DEBLOCK, M.CHAMMAS,<br />
B. COULET, Y.ALLIEU<br />
INTRODUCTION. L’utilisation d’un antiseptique plus ou<br />
moins dilué pour le lavage du site opératoire est communément<br />
admis dans le cadre de la prévention du risque infectieux ou du<br />
traitement d’une infection avérée. La Chlorhexidine est pour cela<br />
l’un <strong>des</strong> antiseptiques utilisés. Nous rapportons chez 9 patients<br />
l’observation d’une <strong>des</strong>truction articulaire attribuée à l’irrigation<br />
per-opératoire par une solution de Chlorhexidine.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Nous avons pris en charge<br />
secondairement 9 patients (3 hommes, 6 femmes) opérés dans un<br />
autre centre porteurs d’une chondrolyse apparemment inexpliquée<br />
post-opératoire. La localisation articulaire était :<br />
− 7 fois le poignet après chirurgie d’un kyste arthrosynovial<br />
dorsal (âge moyen 37 ans),<br />
− 1 fois le coude après chirurgie d’une épicondylalgie (âge 49<br />
ans),<br />
− 1 fois l’épaule après arthroscopie pour conflit sous acromial<br />
(âge 51 ans).<br />
L’intervalle libre entre l’intervention initiale est la consultation<br />
dans notre centre était de 5 ans et 4 mois (minimum 3 ans –<br />
maximum 9 ans). Les suites opératoires avaient été marquées par<br />
une raideur persistante et <strong>des</strong> douleurs à la mobilisation articulaire<br />
d’aggravation progressive. Le bilan radiographique objectivait<br />
:<br />
− dans <strong>les</strong> cas d’atteinte au poignet une <strong>des</strong>truction articulaire<br />
radius-première rangée dans 1 cas, médiocarpienne dans 4 cas et<br />
globale dans 2 cas.<br />
− Dans <strong>les</strong> cas d’atteinte du coude et de l’épaule la <strong>des</strong>truction<br />
articulaire était globale.<br />
Le bilan étiologique <strong>des</strong> autres causes de <strong>des</strong>truction articulaire<br />
s’est révélé négatif notamment infectieuse ou dans le cadre<br />
d’un rhumatisme inflammatoire. L’irrigation articulaire par une<br />
solution de Chlorhexidine (Biseptinet) représentait le critère<br />
commun de ces patients.<br />
RÉSULTATS. Quatre patients sur 9 ont fait l’objet d’un traitement<br />
chirurgical.<br />
– Dans 3 cas d’atteinte médiocarpienne a été réalisée une<br />
arthrodèse 4 os avec scaphoidectomie.<br />
– Dans 1 cas a été effectuée une arthrodèse d’épaule.<br />
Du point de vue anatomo-pathologique existaient <strong>des</strong> lacunes<br />
cartilagineuses remplacées par un tissu dense fortement hyalinisé<br />
et acellulaire. Les prélèvements bactériologiques sont revenus<br />
négatifs.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. L’effet chondrolytique de<br />
la Chlorhexidine, substance de la famille <strong>des</strong> biguani<strong>des</strong>, a été<br />
rapporté depuis 1986 avec quelques cas décrits au niveau du<br />
genou. Du point de vue expérimental, une effet dose dépendant<br />
aurait été mis en évidence. Le mécanisme est une désorganisation<br />
de la membrane cellulaire avec nécrose cartilagineuse et résorption<br />
ostéocartilagineuse. Une prédisposition individuelle ne peut<br />
être exclue.<br />
CONCLUSION. L’utilisation d’une solution de Chlorhexidine<br />
pour le lavage peropératoire <strong>des</strong> articulations apparaît déconseillée<br />
au vue de cette série.<br />
*M. Valverde, Service d’Orthopédie 2, Hôpital Lapeyronie,<br />
371, avenue du Doyen-Gaston-Giraud,<br />
34295 Montpellier Cedex 5.
120 Indications et échecs du clou verrouillé<br />
àvis auto-stab<strong>les</strong> pour <strong>les</strong><br />
fractures proxima<strong>les</strong> de l’humérus :<br />
étude prospective de 50 clous Telegraph<br />
L. BÉGUIN*, P. ADAM, O.VANEL, M.-H. FESSY<br />
INTRODUCTION. Un nouveau clou verrouillé est proposé<br />
pour le traitement <strong>des</strong> fractures de l’extrémité supérieure de<br />
l’humérus. Sa simplicité d’utilisation et l’auto-stabilité de ses vis<br />
le conduise à le <strong>des</strong>tiner, pour son concepteur, à l’ensemble <strong>des</strong><br />
fractures proxima<strong>les</strong> de l’humérus.<br />
Le but de cette étude prospective est de préciser <strong>les</strong> indications<br />
et d’en fixer <strong>les</strong> limites.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Nous avons suivi la technique<br />
d’ostéosynthèse proposée en respectant la traversée delacoiffe<br />
en zone musculaire, et utiliser la technique du bilboquet pour <strong>les</strong><br />
fractures complexes à trois ou quatre fragments et à grand<br />
déplacement. Tous <strong>les</strong> clous ont comporté un verrouillage proximal<br />
avec au minimum 2 vis et un verrouillage distal. La mobilisation<br />
précoce de l’articulation prônée pour ce type de montage a<br />
été diversement suivi. La série comporte 50 fractures de l’extrémité<br />
supérieure de l’humérus toutes traitées par clou Telegraph<br />
de janvier 2000 à janvier 2002. Nous répertorions 18 fractures du<br />
col chirurgical, 32 fractures céphalo-tubérositaires, un âge moyen<br />
de 67 ans avec <strong>des</strong> extrêmes entre 23 et 94 ans.<br />
RÉSULTATS. L’appréciation <strong>des</strong> résultats clinique est rapporté<br />
grâce au score de Constant avec un recul maximum de 24<br />
mois. Nous ne retrouvons aucun défaut de consolidation mais<br />
déplorons plusieurs complications : déplacement secondaire (3<br />
cas), fracture <strong>des</strong> vis proxima<strong>les</strong> (5 cas), remontée du clou (3<br />
cas), rupture du tendon du long biceps (1 cas) et raideur en<br />
flexion (12), imposant l’ablation du matériel dans 5 cas et le<br />
remplacement prothétique dans 1 cas.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. L’autostabilité <strong>des</strong> vis<br />
dans le clou confère une grande rigidité. Malgré cette rigidité<br />
nous déplorons <strong>des</strong> délacements qui se traduisent par <strong>des</strong> ruptures<br />
de vis et <strong>des</strong> bascu<strong>les</strong> de la tête. La vis de verrouillage distale<br />
nous semble jouer un rôle néfaste dans l’impaction de la fracture.<br />
Le taux élevé de complications, 26 % dans notre série, nous<br />
oblige à reconsidérer l’ostéosynthèse par plaque pour <strong>les</strong> fractures<br />
complexes du sujet jeunes et l’embrochage ascendant type<br />
Apprill ou Hackethal non agressif pour la coiffe pour <strong>les</strong> fractures<br />
du col chirurgical.<br />
Ainsi, le clou Telegraph ne nous semble donc pas pouvoir être<br />
utilisé pour <strong>les</strong> fractures complexes du sujet ostéoporotique et<br />
l’arthroplastie doit garder une place dans cette indication.<br />
*L. Béguin, Centre d’Orthopédie Traumatologie,<br />
Hôpital Bellevue, CHU de Saint-Etienne,<br />
42055 Saint-Etienne Cedex 2.<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 2S75<br />
Séance du 14 novembre matin<br />
TRAUMATOLOGIE<br />
121 Fractures de l’humérus traitées par<br />
enclouage rétrograde verrouillé : à<br />
propos de 50 cas<br />
J.-F. LAHOGUE*, L. HUBERT, A.TALHA,<br />
P. CRONIER, J.-L. TOULEMONDE, P.MASSIN<br />
INTRODUCTION. Nous rapportons nos premiers cas<br />
d’enclouage verrouillé rétrograde par clou UHN.<br />
MATÉRIEL. Cinquante patients (26 hommes – 24 femmes),<br />
d’âge moyen 60,2 ans, ont été opérésd’une fracture de l’humérus<br />
par clou UHN : fractures le plus souvent diaphysaires, 40 traumatiques<br />
et 10 métastatiques.<br />
MÉTHODE. Un enclouage rétrograde a été effectué après<br />
trépanation au sommet de la fossette olécranienne. Un verrouillage<br />
proximal et distal était systématique par une à plusieurs<br />
vis. Les résultats ont été évalués en fonction <strong>des</strong> critères de la<br />
S.O.O (1996).<br />
RÉSULTATS. Deux patients ont été perdus de vue et 2 patients<br />
sont décédésprécocement. 46 patients ont été revus avec un recul<br />
moyen de 6 mois (3-18). Les résultats étaient : très bons et bons :<br />
43 cas (consolidation à 3 mois) ; moyen 1 cas ; mauvais 2 cas, (2<br />
démontages à J15). 3 fractures asymptomatiques n’étaient pas<br />
consolidées à 1 an, (toutes consolidées en 2 mois après mise en<br />
compression).<br />
Les complications per-opératoires sont : 4 fissures cortica<strong>les</strong><br />
postérieures sur la fenêtre d’entrée et 2 fractures supracondyliennes.<br />
Nous avons observé une paralysie radiale post-opératoire<br />
immédiate totalement régressive et 4 mobilisations précoces<br />
d’une <strong>des</strong> vis de verrouillage proximal.<br />
Enfin, une autre fracture supracondylienne s’est produite au<br />
point d’entrée suite à une chute 4 mois après une fracture<br />
enclouée et consolidée.<br />
DISCUSSION. Les deux démontages correspondent à <strong>des</strong><br />
fractures sous-tubérositaires de personnes âgées, de même que le<br />
résultat moyen correspondait à un léger déplacement secondaire<br />
non consolidéà5 mois. Les vis de verrouillage proximal ont une<br />
faible tenue dans <strong>les</strong> têtes ostéoporotiques expliquant ces 3 cas et<br />
<strong>les</strong> cas de mobilisation précoce.<br />
L’impaction <strong>des</strong> derniers centimètres du clou béquillé est<br />
souvent délicate et responsable au début de notre expérience <strong>des</strong><br />
petites fissures cortica<strong>les</strong> postérieures et <strong>des</strong> fractures supracondyliennes<br />
per-opératoires.<br />
Enfin, l’absence de viseur pour le verrouillage proximal rend<br />
celui-ci techniquement assez difficile. La possibilité d’un verrouillage<br />
proximal orthogonal présente cependant un avantage<br />
pour la stabilité rotatoire.<br />
Cet enclouage permet une rééducation précoce sans immobilisation.
2S76 77 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
CONCLUSION. L’enclouage rétrograde verrouillé donne de<br />
bons résultats à 3 mois pour <strong>les</strong> diaphyses huméra<strong>les</strong>. Les fractures<br />
sous-tubérositaires <strong>des</strong> personnes âgées ne sont pas de<br />
bonnes indications.<br />
Un clou droit nous paraîtrait cependant préférable et l’existence<br />
d’un viseur pour le verrouillage proximal souhaitable.<br />
*J.-F. Lahogue, Service de Chirurgie Traumatologie, CHU,<br />
4, rue Larrey, 49033 Angers Cedex 01.<br />
122 Le syndrome de loge <strong>des</strong> membres<br />
inférieurs : à propos de 6 cas<br />
M. GOTTIN*, M. LABRADA-BLANCO,<br />
H. DINTIMILLE<br />
Le syndrome de loge est une complication grave de toute la<br />
traumatologie pouvant exposer soit à l’amputation en cas de<br />
fracture de jambe ou au décès du malade en cas de fracture du<br />
fémur.<br />
A partir de 6 cas, nous essaierons de dégager <strong>les</strong> quelques<br />
signes cliniques qui devraient attirer notre attention sur cette<br />
complication grave.<br />
Notre série est composée de 4 fracture de jambe et de 2<br />
fractures du fémur.<br />
La principale caractéristique de ces fractures est leur hétérogénéité.<br />
Eneffetl’âge moyen est de 39.5 ans, allant de 54 ans à<br />
24 ; il s’agit de 4 femmes ; 2 <strong>des</strong> fractures de jambes sont<br />
ouvertes (stade 1 et 2). Il s’agit d’une transversale, d’un oblique<br />
courte, d’une fracture isolée du tibia et d’une fracture comminutive.<br />
Dans 3 cas il s’agissait d’une fracture à basse énergie, dans<br />
un cas d’une fracture à haute énergie. Le diagnostic a été évoqué<br />
dans 3 cas devant une douleur post-opératoire résistant au traitement<br />
médical, dans un cas devant la constatation de la tension<br />
d’une loge et c’est la prise de pression qui a mis en évidence<br />
l’augmentation de pression dépassant 45 mmHg dans tous <strong>les</strong> cas<br />
et montant à 60 mmHg dans 1 cas. L’atteinte touchait <strong>les</strong> 3 loges<br />
dans 1 cas et seulement la loge antérieure dans 3 cas. Le<br />
diagnostic a été porté dans un délai allant de 1 H à 12H. 2<br />
mala<strong>des</strong> opérés dans <strong>les</strong> 6 heures ont guéri sans séquel<strong>les</strong>. La<br />
malade présentant le pic de pression à 60mm Hg malgré une<br />
aponevrotomie avant la 6ème heure présente une parésie du<br />
jambier antérieur. Le dernier patient présente <strong>des</strong> séquel<strong>les</strong> graves<br />
avec anesthésie du pied, paralysie du JA et JP et pseudarthrose<br />
infectée de jambe. Les fractures du fémur constituent une<br />
série plus homogène. Il s’agit dans <strong>les</strong> 2 cas de sujets jeunes (âge<br />
moyen 19 ans : 20 et 18 ans), de fracture fermée, de fractures<br />
comminutives à haute énergie. Le diagnostic a étéévoqué devant<br />
une tension importante de la loge antérieure et confirmée par la<br />
prise de pression avec <strong>des</strong> chiffres maximum de 60 et 70 mm Hg.<br />
Dans un cas la diminution rapide <strong>des</strong> pressions a été suivie par<br />
l’apparition de signes de nécrose musculaire. Dans l’autre cas,<br />
l’aponévrotomie rapide n’a pas empêché l’apparition d’un déficit<br />
moteur portant sur le SPE et SPI.<br />
En conclusion le monitorage <strong>des</strong> pressions <strong>des</strong> loges doit être<br />
systématique en cas de fracture de jambe, quel que soit le type de<br />
fracture et le mécanisme. Le monitorage <strong>des</strong> pressions doit être<br />
systématique en cas de fracture à haute énergie du fémur. Deux<br />
facteurs sont importants dans le résultat fonctionnel : l’importance<br />
du pic de pression et sa durée pression.<br />
*M. Gottin, Service de Chirurgie Orthopédique,<br />
CHU de Fort-de-France La Meynard,<br />
97222 Fort-de-France, Martinique.<br />
123 Traitement chirurgical <strong>des</strong> syndromes<br />
de loges de la jambe compliqués<br />
denécrose musculaire après<br />
aponévrotomie<br />
A.-M. ABOU CHAAYA*, M. MOUKHALALATI,<br />
A. BAZELI, A.VINASSÉ, P.COTTIAS<br />
INTRODUCTION. Le syndrome aigu de loges à la jambe est<br />
rare (0,8 % <strong>des</strong> fractures de jambe) mais toujours redouté du fait<br />
du risque potentiel de nécrose musculaire.<br />
Le but de ce travail est de proposer une thérapeutique originale<br />
dans <strong>les</strong> syndromes de loges au stade de nécrose.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Entre novembre 1999 et janvier<br />
2001, nous avons traité au CHG de Saint-Denis 11 patients pour<br />
syndrome de loges aigu à la jambe.<br />
Il s’agissait de 11 patients, 10 hommes et 1 femme âgés en<br />
moyenne de 38 ans (19-70). L’étiologie était une fracture d’un ou<br />
<strong>des</strong> deux os de la jambe dans 9 cas (dans la même période 129<br />
fractures de jambe ont été prises en charge dans le service), et<br />
dans 2 cas il s’agissait d’une compression prolongée. Dans 7 cas,<br />
le syndrome <strong>des</strong> loges était présent à l’admission et dans <strong>les</strong><br />
autres, il est apparu après l’enclouage.<br />
RÉSULTATS. Le recul moyen est de 6 mois (avec <strong>des</strong> extrêmesde3à<br />
26 mois).<br />
Une aponévrotomie a été faite en urgence dans tous <strong>les</strong> cas :<br />
− Dans 6 cas, l’évolution a été favorable et l’aponévrotomie a<br />
été fermée entre le 5 e et le 10 e jour (moyenne 7 e jour) associée<br />
parfois à une greffe de peau.<br />
− Dans 4 cas, l’évolution s’est faite vers la nécrose musculaire.<br />
Le traitement a consisté en une excision musculaire large et une<br />
fermeture cutanée immédiate sur un drainage aspiratif suivies<br />
d’une antibiothérapie prolongée et adaptée. Une cicatrisation<br />
complète avec disparition du syndrome infectieux et une récupération<br />
sensitivo-motrice partielle ont été obtenues dans tous <strong>les</strong><br />
cas. Un patient a nécessité une couverture par un lambeau de<br />
cross-leg en raison d’une nécrose infectieuse.<br />
− Dans un cas, le patient âgé de 57 ans est décédé quelques<br />
heures après l’aponévrotomie par défaillance cardiaque sans<br />
origine déterminée.<br />
DISCUSSION. Il est admis que le syndrome de loges est une<br />
urgence chirurgicale, tous <strong>les</strong> auteurs s’accordent à faire une<br />
aponévrotomie en urgence. Par contre, le traitement au stade de<br />
nécrose musculaire n’est pas uniforme.<br />
CONCLUSION. Malgré l’aponévrotomie, la nécrose musculaire<br />
n’est pas rare (4 cas sur 11 dans notre série). Dans ces cas,<br />
nous proposons l’excision large de la nécrose et la fermeture
cutanée dans le même temps opératoire associées à un traitement<br />
antibiotique adapté aux prélèvements bactériologiques. En dépit<br />
de l’excision musculaire, une récupération partielle de la motricité<br />
et de la sensibilité du pied a été constatée plusieurs mois<br />
après le traitement initial.<br />
*A.-M. Abou Chaaya, Centre Hospitalier de Saint-Denis,<br />
2, rue du Docteur-Delafontaine, 93205 Saint-Denis Cedex.<br />
124 Reconstruction <strong>des</strong> pertes de substance<br />
traumatiques de l’extrémité<br />
inférieure de la jambe et du pied par<br />
lambeaux fascio-cutanés à pédicu<strong>les</strong><br />
inversés :à propos de 14 cas<br />
A. FABRE*, B. BAUER, F.LAMBERT, S.RIGAL<br />
INTRODUCTION. La couverture <strong>des</strong> pertes de substance du<br />
1/3 inférieur de la jambe, de la cheville et du pied par <strong>des</strong><br />
lambeaux fascio-cutanés à pédicu<strong>les</strong> inversés est une alternative<br />
intéressante aux lambeaux libres microanastomosés en traumatologie.<br />
Nous rapportons notre expérience à propos de 14 cas.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Quinze lambeaux fasciocutanés<br />
de jambe à pédicule inversés et disséqués enilôt, ont été<br />
réalisés chez 14 patients victimes d’un traumatisme de l’extrémité<br />
distale <strong>des</strong> membres inférieurs avec perte de substance<br />
cutanée. L’âge moyen de la série composée de 13 hommes pour<br />
1 femme était de 42 ans (24-70 ans). Les fractures concernaient<br />
le 1/3 inférieur de la jambe au niveau de la jonction diaphysométaphysaire<br />
dans 13 cas (dont 1 associéàune perte de substance<br />
de la coque talonnière), la malléole fibulaire dans 1 cas et le pilon<br />
tibial dans 1 cas. Selon Gustilo, la répartition <strong>des</strong> fractures était la<br />
suivante : 2 gra<strong>des</strong> 0, 3 gra<strong>des</strong> I, 8 gra<strong>des</strong> IIIb et 1 grade IIIc.<br />
Dans 4 cas il s’agissait de patients traités en première intention,<br />
parmi <strong>les</strong> patients admis secondairement, 3 présentaient une<br />
désunion de cicatrice avec une plaque d’ostéosynthèse exposée.<br />
La technique retenue a été 6 fois un lambeau supra-malléolaire<br />
latéral (40 % <strong>des</strong> cas), 7 fois un lambeau neurocutané sural à<br />
pédicule distal (47 % <strong>des</strong> cas) et 2 fois 1 lambeau neurocutané<br />
saphène médial à pédicule distal (13 % <strong>des</strong> cas). Ces lambeaux<br />
ont été réalisés 3 fois en urgence, 10 fois dans le cours du premier<br />
mois et respectivement 1 fois à 2,5 mois et 1 fois à 3 mois. Une<br />
greffe osseuse a du être pratiquée dans 7 cas (50 % <strong>des</strong> cas).<br />
RÉSULTATS. La cicatrisation a été obtenue dans 13 cas dont<br />
<strong>les</strong> 3 cas de complications septiques. Un échec est à déplorer, il<br />
s’agissait d’un lambeau neurocutané sural (fracture de jambe de<br />
grade IIIc). Dans 1 cas de désunion secondaire la plaque d’ostéosynthèseapuêtre<br />
conservée sous le lambeau. Les fractures ont<br />
toutes consolidées.<br />
DISCUSSION. Depuis l’introduction du concept de lambeaux<br />
fascio-cutanés à pédicule distal disséqués enîlot, leur intérêt n’a<br />
fait que croître pour la couverture <strong>des</strong> pertes de substance du 1/3<br />
inférieur de la jambe. Ils ont pour principaux avantages, outre la<br />
mise en oeuvre plus simple qu’un lambeau libre, de respecter le<br />
capital vasculaire et musculaire loco-régional. Notre série<br />
confirme ces bons résultats dans la mesure ou ces lambeaux sont<br />
planifiés avec discernement, leur réalisation en urgence n’étant<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 2S77<br />
pas souhaitable. La réalisation conjointe de 2 lambeaux fasciocutanés<br />
peut être une solution salvatrice dans certains cas. Dans<br />
ce contexte traumatique le préjudice esthétique et sensitif a été<br />
jugé mineur.<br />
CONCLUSION. Le recours aux lambeaux fascio-cutanés à<br />
pédicule distal apparaît comme une solution technique de premier<br />
choix dans la couverture <strong>des</strong> pertes de substance de l’extrémité<br />
inférieure de la jambe et du pied. Leur réalisation en urgence<br />
est àéviter.<br />
*A. Fabre, Service de Chirurgie Orthopédique<br />
et Traumatologique, Hôpital d’Instruction <strong>des</strong> Armées Percy,<br />
101, avenue Henri-Barbusse, 92140 Clamart.<br />
125 Traitement <strong>des</strong> pseudarthroses<br />
septiques de jambe avec perte de<br />
substance osseuse et cutanée :un<br />
nouveau transfert libre de fibulapontage<br />
C. CHANTELOT*, T. AIHONNOU, G.GUEGUEN,<br />
H. MIGAUD, C.FONTAINE<br />
INTRODUCTION. La prise en charge <strong>des</strong> pertes de substance<br />
osseuse étendues du tibia peut amener à discuter l’indication de<br />
greffes vascularisées. Cependant ces techniques dépendent du<br />
nombre d’axes vasculaires fonctionnels. Nous avons mis au point<br />
une modification technique qui permet d’utiliser cette greffe sans<br />
sacrifier de pédicule vasculaire jambier et qui est donc utilisable<br />
lorsqu’il ne persiste qu’un seul axe. A cette fin nous utilisons<br />
l’axe artériel de la fibula comme pontage sur l’axe restant de la<br />
jambe. Le but de ce travail était de préciser <strong>les</strong> modalités de cette<br />
technique et d’en fournir <strong>les</strong> premiers résultats.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Nous avons depuis 2000 réservé<br />
cette technique aux pseudarthroses infectées avec perte de substance<br />
du tibia exposées étendues sur plus de 5 cm et chez <strong>des</strong><br />
patients qui refusaient l’amputation.<br />
Quatre cas ont été ainsi pratiqués (4hommesd’âge moyen de<br />
30 ans). Les traumatismes initiaux consistaient en 3 accidents de<br />
moto et un traumatisme balistique. Les patients ont tous été pris<br />
en charge secondairement avec un délai moyen de 3 mois. Les<br />
traitements préalab<strong>les</strong>, pratiqués chez tous <strong>les</strong> patients (greffe<br />
spongieuse à ciel ouvert ou intra-focale), avaient tous échoué<br />
avec persistance de l’infection. Des antibiotiques ont été administrés<br />
jusqu’à consolidation dans tous <strong>les</strong> cas. La longueur <strong>des</strong><br />
pertes de substance était en moyenne de 10 cm (7 à 15 cm). Le<br />
greffon composite (peau et fibula avec le paquet vasculaire<br />
fibulaire) était prélevé sur le membre controlatéral et branché en<br />
termino-terminal aussi bien en proximal qu’en distal sur le<br />
paquet tibial antérieur receveur (4 cas).<br />
RÉSULTATS. Toutes <strong>les</strong> fractures ont consolidé entre 6 et 12<br />
mois après mise en œuvre de la technique. Les pertes de substance<br />
osseuse et cutanées ont guéri sans raccourcissement.<br />
Aucune fracture itérative n’a été constatée au recul moyen de 12<br />
mois (8 mois à 2 ans). Aucune greffe osseuse complémentaire n’a<br />
été pratiquée. L’infection avait guéri dans tous <strong>les</strong> cas.
2S78 77 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. Comme pour la greffe<br />
classique de fibula vascularisée, cette technique permet de régler<br />
<strong>les</strong> problèmes osseux et cutanés dans le même temps (greffe<br />
composite). Le greffon est vascularisé ce qui peut favoriser la<br />
diffusion <strong>des</strong> antibiotiques. La qualité mécanique est meilleure<br />
que la greffe spongieuse pure, mais une surveillance à plus long<br />
terme est nécessaire pour déterminer le taux de fracture itérative.<br />
Cette technique élargit le champ d’application <strong>des</strong> greffes de<br />
fibula vascularisées aux terrains vasculaires défavorab<strong>les</strong> lorsqu’il<br />
ne persiste qu’un ou deux axes jambiers.<br />
*C. Chantelot, Service d’Orthopédie B,<br />
Hôpital Roger-Salengro, CHRU de Lille, 59037 Lille Cedex.<br />
126 Evaluation à plus de 5 ans <strong>des</strong><br />
reconstructions <strong>des</strong> os longs supérieures<br />
à 5 cm, selon la technique<br />
de la pseudo-membrane associée à<br />
une greffe spongieuse massive<br />
F. WELBY*, C. NOURISSAT, B.BAJER, T.BÉGUÉ,<br />
A.-C. MASQUELET<br />
INTRODUCTION. La reconstruction <strong>des</strong> pertes de substance<br />
osseuse massive par de l’os spongieux déposé dans une pseudomembrane<br />
induite par une entretoise de ciment a été pratiquée40<br />
fois dans le service. Nous avons évalué le résultat de cette<br />
technique pour <strong>des</strong> pertes de substance de plus de 5cm, avec un<br />
recul de plus de 5 ans.<br />
MATÉRIEL. Nous avons revu 12 patients, tous porteurs d’une<br />
perte de substance du tibia. Les interventions ont comporté un<br />
premier temps d’excision, de mise en place d’une entretoise en<br />
ciment, et de couverture par lambeau local ou libre devant <strong>des</strong><br />
parties mol<strong>les</strong> défectueuses. Un deuxième temps de greffe spongieuse<br />
autologue morcelée respectant la membrane a été réalisé<br />
aprèsundélai minimum de 2 ans. Chaque fois qu’il était présent,<br />
le péroné était utilisé comme tuteur.<br />
Les pertes de substances allaient de 5 à 25 cm, chez <strong>des</strong><br />
hommes jeunes, présentant pour un cas une résection tumorale,<br />
pour <strong>les</strong> autres <strong>des</strong> séquel<strong>les</strong> septiques de traumatologie.<br />
MÉTHODE. Nous avons fait une étude clinique et radiologique.<br />
RÉSULTATS. Tous <strong>les</strong> patients ont été revus avec un recul de<br />
5 à 10 ans par rapport à la prise en charge dans le service. A la<br />
dernière consultation, tous <strong>les</strong> patients sont asséchés et soli<strong>des</strong>.<br />
Tous ont nécessité <strong>des</strong> interventions secondaires à type de greffes<br />
itératives, de chirurgie de correction d’axe (valgus et varus) ou<br />
<strong>des</strong> interventions imputab<strong>les</strong> à la lésion initiale (arthrodèse,<br />
orteils en griffe). Ils ont majoritairement repris le travail et le<br />
sport, ont un périmètre de marche illimité avec un appui monopodal<br />
indolore. L’étude radiologique a permis d’observer l’évolution<br />
de la greffe qui tend vers une tubulisation.<br />
DISCUSSION. La technique de l’entretoise de ciment induisant<br />
la formation d’une membrane pseudo-synoviale est utilisée<br />
depuis plus de 10 ans dans le service pour traiter <strong>les</strong> pertes de<br />
substance circonférentiel<strong>les</strong>. La consolidation a été obtenue dans<br />
tous <strong>les</strong> cas. La principale complication a été la déformation en<br />
valgus qui a imposé une réaxation chirurgicale quasi systématique.<br />
La rapidité de consolidation n’est pas fonction de la longueur<br />
de la perte de substance, mais du caractère radical de<br />
l’excision et de la qualité de la couverture. Cette technique doit<br />
être comparée aux autres techniques de comblement <strong>des</strong> gran<strong>des</strong><br />
pertes de substance osseuse (Illizarov, transfert osseux vascularisé).<br />
*F. Welby, Service d’Orthopédie, Hôpital Avicenne,<br />
125, route de Stalingrad, 93009 Bobigny.<br />
127 Résultats du traitement <strong>des</strong> fractures<br />
de la jambe de l’adulte par<br />
enclouage centro-médullaire d’alignement<br />
: à propos de 207 cas<br />
H. BEN AMOR*, H. MNIF, T.AISSAOUI, K.ZEHI,<br />
M. ZOUARI, S.KARRAY, T.LITAIEM, M.DOUIK<br />
Les fractures de la jambe représentent un problème quotidien<br />
en traumatologie. En effet, leur fréquence augmente du fait de la<br />
recru<strong>des</strong>cence <strong>des</strong> accidents de la circulation et le retentissement<br />
social est important puisqu’el<strong>les</strong> touchent particulièrement une<br />
population jeune et en pleine activité.<br />
Le but de ce travail, en analysant <strong>les</strong> résultats anatomiques et<br />
fonctionnels de la série et en <strong>les</strong> comparant à ceux de la littérature,<br />
est de dégager <strong>les</strong> indications et <strong>les</strong> limites de l’enclouage<br />
centro-médullaire d’alignement dans le traitement de ces fractures.<br />
Notre série comporte 207 fractures de la jambe traitées par<br />
cette méthode à l’Institut d’Orthopédie M.T.Kassab. Il s’agissait<br />
de 174 hommes et 33 femmes, âgés en moyenne de 35 ans (15-75<br />
ans) ; la prédominance masculine est nette (84 %). L’enclouage<br />
centro-médullaire a été complété par une immobilisation plâtrée<br />
avec autorisation de l’appui après 4à 5 semaines en moyenne,<br />
protégée par un plâre de Sarmiento de marche jusqu’à la consolidation.<br />
Les résultats ont été analysés avec un recul moyen de 12 mois<br />
(4 mois-18 ans). La consolidation a été obtenue dans 99 % <strong>des</strong><br />
cas dans un délai moyen de 15,3 semaines (6 à 66 semaines).<br />
Sur le plan anatomique, le retard de consolidation au delà de 4<br />
mois touche 6 % <strong>des</strong> cas. Par ailleurs, deux pseudarthroses soit<br />
1 % <strong>des</strong> cas ont nécessité un réenclouage avec un apport spongieux<br />
et ont évolué favorablement.<br />
Seize cals vicieux, soit 7,8 % <strong>des</strong> cas surtout en varus (10 cas),<br />
ainsi que 13 déplacements secondaires (6,3 % <strong>des</strong> cas). Ceci était<br />
significativement plus fréquent pour <strong>les</strong> fractures du tiers proximal<br />
par rapport au tiers moyen, pour <strong>les</strong> fractures comminutives,<br />
bifoca<strong>les</strong> et quand l’appui a été autorisé avant la 4ème semaine.<br />
Sur le plan fonctionnel, <strong>des</strong> douleurs à la marche étaient<br />
présentes dans 15 % <strong>des</strong> cas, le périmètre de marche était illimité<br />
dans ¾ <strong>des</strong> cas avec de bonnes amplitu<strong>des</strong> articulaires.<br />
L’enclouage d’alignement est une technique fiable, facile et<br />
satisfaisante pour le traitement <strong>des</strong> fractures simp<strong>les</strong> du tiers<br />
moyen de la jambe.
Les fractures du tiers supérieur et inférieur, ainsi que <strong>les</strong><br />
fractures bifoca<strong>les</strong> et comminutives nécessitent un verrouillage<br />
du clou pour neutraliser le risque de déplacement secondaire et<br />
éviter <strong>les</strong> cals vicieux.<br />
*H. Ben Amor, Institut d’Orthopédie M.T. Kassab,<br />
2010 La Manouba, Tunisie.<br />
128 Traitement <strong>des</strong> pseudarthroses<br />
de jambe par la technique de<br />
Kuntscher : indications et résultats<br />
P. BOISRENOULT*, S. GUILLO, A.VEIL-PICARD,<br />
A. LORTAT-JACOB<br />
INTRODUCTION. Le traitement d’une pseudarthrose aseptique<br />
de jambe est un problème difficile. De nombreuses solutions<br />
techniques ont été proposées. Le but de ce travail était d’évaluer<br />
<strong>les</strong> résultats <strong>des</strong> patients opères dans notre service par la technique<br />
de Kuntscher (TK) et d’en préciser <strong>les</strong> indications.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Vingt deux patients opérés<br />
entre 1987 et 1997, par la technique de Kuntscher (alésage,<br />
réenclouage) pour une pseudarthrose de tibia, ont été revus. Il<br />
s’agissait de 19 hommes et 3 femmes, d’âge moyen 36 ans<br />
(extrêmes 16 à 58 ans). Le recul minimal était de 2 ans. Le<br />
traitement initial comportait 21 cas d’enclouage centromédullaire<br />
non verrouille plus cruropédieux ; 1 cas de plaque vissée. Initialement,<br />
10 fractures étaient ouvertes (Gustilo I : 3 cas, Gustilo II :<br />
7 cas). Ont été étudiés : le délai avant réintervention, le délai de<br />
consolidation, <strong>les</strong> axes tibiaux préopératoire et à consolidation, la<br />
taille et le type de perte de substance osseuse (parcellaire ou<br />
segmentaire), <strong>les</strong> gestes complémentaires éventuels, l’existence<br />
de complications.<br />
RÉSULTATS. Nous déplorons un échec septigue (TK 9 mois<br />
après une plaque vissée, sepsis diagnostiqué à2 mois, consolidation<br />
après ablation du clou, alésage, fixateur externe et greffe<br />
spongieuse appuyée sur le péroné). Aucune autre complication<br />
n’est à déplorer. Un patient a été perdu de vue au 3 e mois, il<br />
s’agissait d’une perte de substance parcellaire interne de 1 cm,<br />
avec une fracture radiologiguement solide au dernier recul. Tous<br />
<strong>les</strong> autres patients ont consolidés dans un délai moyen de 3,44<br />
mois (2,5 à 10). Le délai moyen d’évolution préopératoire était de<br />
6 mois (2,5 à 12). Initialement, la perte de substance était<br />
parcellaire dans 16 cas (5 à 10 mm) et segmentaire dans 6 cas (3<br />
à 8mm).Iln’existait pas de défaut d’axe à la consolidation. Une<br />
ostéotomie du péroné a été pratiquée dans 5 cas. L’appui a été<br />
complet d’emblée dans 15 cas (soulagé dans 7).<br />
DISCUSSION. Dans notre expérience, la technique de Kuntscher<br />
est une méthode simple et efficace de traitement <strong>des</strong> pseudarthroses<br />
tibia<strong>les</strong> aseptiques. Elle est indiquée en cas de perte de<br />
substance parcellaires ou en cas de perte de substance segmentaires<br />
de petites tail<strong>les</strong>. La rapidité de la consolidation obtenue et<br />
<strong>les</strong> suites en général simp<strong>les</strong> peuvent la faire proposer de façon<br />
précoce en cas de retard de consolidation.<br />
*P. Boisrenoult, Service d’Orthopédie, Centre Hospitalier<br />
de Versail<strong>les</strong>, Hôpital André-Mignot, 78150 Le Chesnay.<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 2S79<br />
129 Traitement <strong>des</strong> pseudarthroses<br />
post-traumatiques de la jambe par<br />
la méthode d’Ilizarov : à propos de<br />
30 cas<br />
M. MSEDDI*, A. SIALA, M.MTAOUMI,<br />
K. BOUATTOUR, R.BEN HAMIDA, J.DAHMENE,<br />
M.-L. BEN AYECHE<br />
INTRODUCTION. Ce travail a pour but, de souligner l’importance<br />
de la technique d’Ilizarov dans le traitement <strong>des</strong> pseudarthroses<br />
de jambe.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Notre série comporte 30 cas de<br />
pseudarthrose post traumatique de jambe traités par cette<br />
méthode pendant une période allant de janvier 1990 à décembre<br />
1998.<br />
La lésion avait intéressé essentiellement <strong>les</strong> sujets de sexe<br />
masculin actifs.<br />
L’étiologie était dominée par <strong>les</strong> accidents de la voie publique.<br />
La pseudarthrose était septique dans 27 % <strong>des</strong> cas, non alignée<br />
dans 70 % <strong>des</strong> cas et associée à une perte de substance osseuse<br />
dans 17 % <strong>des</strong> cas.<br />
La technique adoptée dans cette série était une compression<br />
pure dans 24 cas, une compression distraction dans le foyer dans<br />
2 cas et une compression distraction bifocale dans 4 cas.<br />
RÉSULTATS. La consolidation a été obtenue dans 93 % <strong>des</strong><br />
cas dans un délai moyen de 6,5 mois. On a noté deux échecs dus<br />
à <strong>des</strong> défauts techniques.<br />
L’assèchement de l’infection et le comblement de la perte de<br />
substance osseuse ont été obtenus dans tous <strong>les</strong> cas.<br />
Nous avons déploré 4 cals vicieux avec une bonne tolérance<br />
clinique.<br />
Le résultat global était satisfaisant tant sur le plan anatomique<br />
que fonctionnel dans 87 % <strong>des</strong> cas.<br />
CONCLUSION. La méthode d’Ilizarov constitue une technique<br />
précieuse dans le traitement de cette pathologie complexe et<br />
variable. Elle permet d’assurer à la fois la consolidation, l’assèchement<br />
de l’infection, la correction <strong>des</strong> déviations axia<strong>les</strong>, le<br />
comblement <strong>des</strong> pertes de substance osseuse et la préservation de<br />
l’autonomie fonctionnelle du patient.<br />
*M. Mseddi, Service d’Orthopédie, CHU Sahloul,<br />
route de la Ceinture, 4054 Sousse, Tunisie.<br />
130 Application d’une thérapie cellulaire<br />
adjuvante au traitement <strong>des</strong> lésions<br />
nerveuses périphériques<br />
C. LAZERGES*, P.-A. DAUSSIN, F.BACOU,<br />
M. CHAMMAS<br />
INTRODUCTION. Un muscle qui subit une période de dénervation<br />
prolongée, soit du fait d’une réparation nerveuse différée,
2S80 77 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
soit du fait d’une distance importante séparant ce muscle de la<br />
lésion nerveuse réparée, est le siège d’importantes altérations<br />
dont <strong>les</strong> principa<strong>les</strong> concernent la dégénérescence <strong>des</strong> fibres<br />
musculaires et leur remplacement par un tissu fibreux voire<br />
adipeux. Ces modifications structura<strong>les</strong> du muscle constituent un<br />
frein à sa réinnervation et par voie de conséquence altèrent le<br />
résultat fonctionnel après réparation nerveuse périphérique avec<br />
comme corollaire une diminution de la force générée.<br />
L’objectif du présent travail est basé sur <strong>les</strong> potentialités de<br />
régénération de musc<strong>les</strong> dénervés-réinnervés et leur amélioration<br />
par thérapie cellulaire adjuvante grâce au transfert in situ de<br />
cellu<strong>les</strong> satellites (CS) autologues préalablement cultivées.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Les travaux ont été réalisés sur<br />
le muscle Tibialis anterior dans différents groupes de lapins New<br />
Zealand. Le modèle expérimental était une section du nerf fibulaire<br />
commun et une suture nerveuse microchirurgicale immédiate<br />
ou différée de 2 mois. Le transfert de CS a été effectué soit<br />
immédiatement soit 2 mois après laréinnervation. Les mesures<br />
fonctionnel<strong>les</strong> in vivo et l’évaluation histomorphologique ont été<br />
effectuées 4 mois après laréinnervation.<br />
RÉSULTATS. La réinnervation entraine une perte de poids et<br />
de force maximale (Fmax) d’autant plus importante qu’elle est<br />
différée. Le transfert de CS réalisé immédiatement après la<br />
réinnervation n’améliore pas <strong>les</strong> propriétés musculaires. Par<br />
contre, le transfert de CS réalisé 2 mois après la suture nerveuse<br />
permet une augmentation de la Fmax de 25 % (p < 0,01) et du<br />
poids du muscle traité de 28 % (p = 0,005) par rapport aux<br />
musc<strong>les</strong> témoins simplement réinnervés. De plus, la morphologie<br />
musculaire en est améliorée comme le montrent <strong>les</strong> marquages<br />
par différents anticorps anti-myosines.<br />
CONCLUSION. La thérapie cellulaire adjuvante permet, dans<br />
certaines conditions, d’améliorer la récupération fonctionnelle<br />
aprèslésion nerveuse périphérique. Son application clinique pose<br />
encore <strong>des</strong> problèmes éthiques. Cependant, l’ensemble de ces<br />
travaux devrait permettre, à terme, de proposer chez l’homme<br />
une voie thérapeutique pour réduire l’involution d’un muscle<br />
dénervé et améliorer sa réceptivité vis à vis <strong>des</strong> axones qui<br />
régénèrent après chirurgie nerveuse périphérique afin d’en améliorer<br />
<strong>les</strong> résultats post-opératoires.<br />
*C. Lazerges, Service d’Orthopédie 2, Hôpital Lapeyronie,<br />
393, avenue du Doyen-Gaston-Giraud,<br />
34295 Montpellier Cedex 5.<br />
131 Evaluation postopératoire de la<br />
qualité de vie dans <strong>les</strong> paralysies<br />
post-traumatiques partielle et totale<br />
du plexus brachial<br />
C. LAZERGES*, M.-N. THAURY, R.VERDIER,<br />
M. CHAMMAS<br />
INTRODUCTION. Jusqu’à présent, l’évaluation du traitement<br />
chirurgical <strong>des</strong> paralysies du plexus brachial était purement<br />
analytique, sans prise en compte <strong>des</strong> capacités fonctionnel<strong>les</strong><br />
globa<strong>les</strong> ni de la qualité de vie. Le caractère unilatéral de ces<br />
paralysies, et de fait l’existence d’un membre supérieur sain<br />
nécessite une évaluation globale <strong>des</strong> résultats. Nous proposons,<br />
dans ce travail, d’associer une étude analytique classique à une<br />
évaluation générale de la qualité de vie pour analyser le bénéfice<br />
<strong>des</strong> traitements chirurgicaux <strong>des</strong> paralysies partielle et totale du<br />
plexus brachial.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Quarante-quatre patients d’un<br />
âge moyen de 30 ans (17-60) ont été revus avec un recul moyen<br />
de 34 mois et séparés en deux groupes : <strong>les</strong> paralysies C5-C6 ±<br />
C7 (n = 18) et <strong>les</strong> paralysies C5-T1 (n = 26). Dans chaque groupe,<br />
une évaluation musculaire analytique complète, une évaluation<br />
visuelle analogique de la douleur et trois questionnaires de<br />
qualité de vie (DASH, Abilhand, MOS SF-36) ont été utilisés et<br />
comparés. Nous avons étudié pour chaque groupe l’influence sur<br />
la qualité de vie de la récupération de la flexion du coude (biceps<br />
≥ M3+), de la récupération d’une épaule fonctionnelle (abduction<br />
≥ M3+), ainsi que l’influence <strong>des</strong> douleurs résiduel<strong>les</strong>.<br />
RÉSULTATS. L’analyse globale <strong>des</strong> résultats ne met pas en<br />
évidence de différence de qualité de vie entre <strong>les</strong> paralysies<br />
partiel<strong>les</strong> et <strong>les</strong> paralysies complètes. Les trois questionnaires<br />
sont corrélés entre eux (p < 0,03). Les douleurs résiduel<strong>les</strong> (EVA<br />
≥ 4 dans 59 % <strong>des</strong> cas) sont corrélées avec la qualité de vie (p <<br />
0,05), alors que l’atteinte du coté dominant n’a, elle, pas<br />
d’influence.<br />
Dans le groupe <strong>des</strong> paralysies partiel<strong>les</strong>, la récupération d’une<br />
épaule fonctionnelle (61 %, n = 11) améliore de façon significative<br />
l’ensemble <strong>des</strong> scores de qualité de vie (p < 0,01). Par contre,<br />
la réanimation de la flexion du coude (72 %, n = 13) n’améliore<br />
la qualité de vie qu’en présence d’une épaule fonctionnelle (p <<br />
0,02).<br />
Dans le groupe <strong>des</strong> paralysies tota<strong>les</strong>, la récupération d’une<br />
épaule fonctionnelle (77 %, n = 20) semble au moins aussi<br />
importante que la flexion du coude sur la qualité de vie (p ≤ 0,05).<br />
CONCLUSION. Contrairement aux idées reçues, l’évaluation<br />
postopératoire de la qualité de vie de ces paralysies met en<br />
évidence l’importance de la fonction de l’épaule, qui apparaît au<br />
moins aussi importante que la réanimation de la flexion du coude.<br />
De plus, <strong>les</strong> douleurs persistantes apparaissent comme l’un <strong>des</strong><br />
facteurs négatifs principaux sur la qualité de vie et nécessite, el<strong>les</strong><br />
aussi, une prise en charge adaptée.<br />
*C. Lazerges, Service d’Orthopédie 2, Hôpital Lapeyronie,<br />
393, avenue du Doyen-Gaston-Giraud,<br />
34295 Montpellier Cedex 5.
132 Autogreffe du LCA sous arthroscopie<br />
: KJ versus DIDT. Résultats préliminaires<br />
d’une étude prospective<br />
randomisée de 100 cas<br />
Y. ACQUITTER*, B. GALAUD, C.HULET,<br />
G. BURDIN, B.LOCKER, C.VIELPEAU<br />
OBJECTIF. La plastie libre au tendon rotulien est le procédé<br />
classique du traitement <strong>des</strong> laxités antérieures chroniques du<br />
genou. Ses bons résultats fonctionnels sont cependant souvent<br />
nuancés par <strong>des</strong> douleurs antérieures invalidantes. L’objectif de<br />
cette étude randomisée est de comparer de façon prospective le<br />
devenir <strong>des</strong> plasties utilisant <strong>les</strong> tendons de la patte d’oie à celui<br />
<strong>des</strong> autogreffes de tendon rotulien.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. De mai 1998 à mai 2001, 100<br />
patients présentant une rupture isolée du LCA ont été inclus. Les<br />
critères d’exclusion de ce protocole comportaient <strong>les</strong> antécédents<br />
fracturaires, <strong>les</strong> laxités évoluées de grade II, et la rupture du LCA<br />
controlatéral. La randomisation faite au bloc opératoire selon la<br />
méthode <strong>des</strong> enveloppes, a réparti <strong>les</strong> sujets en 2 cohortes de 50<br />
cas : Groupe A : autogreffe libre os-tendon rotulien-os sous<br />
arthroscopie ; Groupe B : autogreffe libre à 4 faisceaux <strong>des</strong><br />
tendons gracilis et semitendinosus. La fixation était assurée dans<br />
tous <strong>les</strong> cas par 2 vis d’interférence métalliques. Le positionnement<br />
<strong>des</strong> tunnels calculé selon la méthode d’Aglietti était identique<br />
dans <strong>les</strong> 2 groupes. Le même protocole de rééducation en<br />
centre a été suivi par tous <strong>les</strong> sujets. Ces deux groupes étaient<br />
comparab<strong>les</strong> en ce qui concerne <strong>les</strong> données épidémiologiques et<br />
<strong>les</strong> caractéristiques cliniques, radiologiques et instrumenta<strong>les</strong><br />
(KT1000t) de la laxité. Tous <strong>les</strong> patients ont été revus et évalués<br />
selon <strong>les</strong> critères de l’I.K.D.C. et le niveau de reprise sportive,<br />
avec une mesure instrumentale à l’arthromètre Medmetric<br />
KT-1000t. Un degré de signification à 0,05 a été utilisé.<br />
RÉSULTATS. Au recul moyen de 24 mois (6 à 38), la comparaison<br />
<strong>des</strong> groupes A et B ne montrait pas de différence significative<br />
sur le niveau et le délai de reprise du sport initial, ni sur la<br />
mobilité, l’examen ligamentaire, le score global de l’IKDC, et<br />
l’évolution radiologique. Des douleurs antérieures étaient présentes<br />
chez 30 % <strong>des</strong> patients du groupe A à 6 mois, et encore chez<br />
20 % à un an, alors que <strong>des</strong> douleurs soit fémoropatellaires, soit<br />
sur le trajet <strong>des</strong> tendons prélevésn’étaient rapportées que par 8 %<br />
<strong>des</strong> sujets du groupe B à 6 mois et seulement par 4 % à un an (p<br />
= 0,0005). Ces différences disparaissaient à 2 ans. La laxité<br />
différentielle instrumentale était de 0,66 ± 1,1 mm pour le groupe<br />
Aetde1± 1,5 mm pour le groupe B (p = 0,20). 2 ruptures<br />
itératives traumatiques ont été observées dans le groupe B.<br />
CONCLUSION. Les résultats préliminaires de cette étude<br />
prospective randomisée confirment la faible morbidité sur le site<br />
donneur de la plastie aux ischio-jambiers, et sa fiabilité àrestaurer<br />
la stabilité du genou en cas de laxité isolée du LCA. Un recul<br />
plus important est cependant nécessaire pour valider ces données<br />
à long terme, notamment en ce qui concerne la distension secon-<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 2S81<br />
Séance du 14 novembre matin<br />
GENOU/RECHERCHE APPLIQUÉE<br />
daire de ce type de greffe qui est une donnée fréquemment<br />
retrouvée dans la littérature et que nous avions également<br />
observé sur <strong>des</strong> cas antérieurs à cette série.<br />
*Y. Acquitter, Département d’Orthopédie, CHU de Caen,<br />
avenue de la Côte-de-Nacre, 14033 Caen Cedex.<br />
133 Reconstruction du LCA par une<br />
plastie intra- et extra-articulaire au<br />
DI-DT : étude comparative de 2<br />
séries, avec et sans renfort synthétique,<br />
sur 100 cas<br />
F. BUSCAYRET*, C. BUSCAYRET, P.MAURY<br />
INTRODUCTION. Le but de notre travail est double :<br />
− apprécier <strong>les</strong> résultats de la reconstruction du LCA, par une<br />
plastie intra et extra-articulaire au DI-DT.<br />
− analyser l’intérêt d’un renfort synthétique à travers l’étude<br />
comparative de 2 séries.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Cette population de 100 patients<br />
est constituée de 2 groupes, le groupe 1 avec renfort synthétique<br />
(70 patients) et le groupe 2 sans renfort (30 patients).<br />
Le taux de révision a été de 89 %. L’âge moyen à l’opération<br />
est de 28 ans. La série comprend 56 % de sportifs type pivotcontact<br />
en compétition. On note en per opératoire 74 % de lésions<br />
ménisca<strong>les</strong> média<strong>les</strong>. Le recul moyen est de 40 mois. Les 2<br />
groupes sont comparab<strong>les</strong> en tous points, seuls le recul et l’âge<br />
sont discrètement inférieurs dans le groupe 2, sans renfort. Les<br />
résultats ont été évalués selon <strong>les</strong> cotations A.R.P.E.GE. et<br />
I.K.D.C. (avec le KT 1000 à 89 N).<br />
Nous avons mené une analyse précise de la laxité résiduelle au<br />
TELOS à 15 kg. Enfin nous avons étudié le positionnement et la<br />
largeur <strong>des</strong> tunnels.<br />
RÉSULTATS. Nous avons obtenu de bons résultats selon la<br />
cotation A.R.P.E.GE, avec 71 % d’excellents et bons résultats, et<br />
87 % de patients classés A et B selon la cotation I.K.D.C.<br />
70 % <strong>des</strong> patients pratiquant un sport pivot-contact en compétition,<br />
pratiquent à nouveau ce sport en compétition.<br />
La laxité résiduelle différentielle (mesurée par TELOS) est de<br />
5,7 mm en moyenne.<br />
L’élargissement <strong>des</strong> tunnels est en moyenne de 3,5 mm.<br />
Ce travail met en évidence la relative innocuité du prélèvement<br />
<strong>des</strong> ischio-jambiers.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. La laxité résiduelle est en<br />
corrélation étroite avec le résultat clinique : une laxité résiduelle<br />
différentielle inférieure à 6 mm (valeur seuil) est garante de<br />
l’absence de ressaut et de 94 % de bons résultats.
2S82 77 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
Nous n’avons pas retrouvé de corrélation entre l’élargissement<br />
<strong>des</strong> tunnels et la laxité résiduelle.<br />
Un positionnement fémoral trop antérieur et une méniscectomie<br />
médiale augmentent significativement cette laxité résiduelle.<br />
Le tunnel fémoral doit être suffisamment postérieur entre 60 et<br />
70 % de la largeur condylienne antéro-postérieure.<br />
Enfin, l’utilisation d’un renfort synthétique, dans le groupe<br />
avec renfort, n’a pas amélioré nos résultats, ni cliniques, ni<br />
laximétriques ; il semble donc préférable d’utiliser une plastie<br />
naturelle sans renfort.<br />
*F. Buscayret, Service d’Orthopédie 1, Hôpital Lapeyronie,<br />
371, avenue du Doyen-Gaston-Giraud,<br />
34295 Montpellier Cedex 5.<br />
134 Résultats de la greffe du LCA entre<br />
40 et 60 ans<br />
C. TROJANI*, N. JACQUOT, J.-S. COSTE,<br />
P. BOILEAU<br />
BUT. Evaluer <strong>les</strong> résultats de la greffe intra-articulaire isolée<br />
du LCA entre 40 et 60 ans par <strong>les</strong> techniques os-tendon rotulienos<br />
(KJ) et droit interne-demi tendineux (DIDT).<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Etude rétrospective, continue,<br />
comparative. 30 patients, opérés sous arthroscopie entre Septembre<br />
1996 et Septembre 1999 par le même opérateur : 14 KJ et 16<br />
DIDT. Indication opératoire : instabilité dans la vie courante ou<br />
lors de la pratique du sport. Critères d’exclusion : gestes ligamentaires<br />
périphériques ou gestes osseux associés.<br />
Les deux populations étaient strictement identiques sauf pour<br />
le sexe et recul. Série KJ : âge moyen 49 ans, 12 hommes, recul<br />
moyen 46 mois, 5 ménisectomies associées. Série DIDT : âge<br />
moyen 48 ans, 13 femmes, recul moyen 30 mois, 6 ménisectomies<br />
associées. Evaluation clinique : score IKDC ; laximétrique :<br />
KT 2000 ; radiologique : face, profil en appui monopodal, schuss.<br />
Evaluation par deux examinateurs différents de l’opérateur.<br />
RÉSULTATS. A la révision, il n’existait pas de différence<br />
significative entre <strong>les</strong> résultats fonctionnels et anatomiques <strong>des</strong><br />
DIDT et <strong>des</strong> KJ. 83 % <strong>des</strong> patients étaient classés IKDCAouB.<br />
Subjectivement, 90 % <strong>des</strong> patients étaient satisfaits ou très satisfaits.<br />
Le ressaut rotatoire était négatif dans 24 cas (80 %), bâtard<br />
dans 5 cas et positif dans 1 cas. 86 % <strong>des</strong> patients présentaient<br />
une laxité différentielle inférieure à 3 millimètres. Dans la série<br />
DIDT, 2 patients présentaient <strong>des</strong> douleurs chroniques <strong>des</strong> ischiojambiers.<br />
Dans la série KJ, deux patients présentaient <strong>des</strong> douleurs<br />
rotuliennes persistantes. Deux patients ont été réopérés<br />
(deux ménisectomies). Les radiographies au dernier recul montraient<br />
20 % de préarthrose et 10 % d’arthrose fémoro-tibiale<br />
interne.<br />
DISCUSSION. DIDT et KJ donnent <strong>des</strong> résultats strictement<br />
identiques : il n’existe pas plus de douleurs résiduel<strong>les</strong> dans la<br />
série KJ ; le contrôle de la laxité n’est pas moins bon dans la série<br />
DIDT. Dans notre série, la greffe du LCA après 40 ans donne <strong>des</strong><br />
résultats fonctionnels, laximétriques et radiographiques comparab<strong>les</strong><br />
à ceux <strong>des</strong> greffes du LCA avant 40 ans.<br />
CONCLUSION. 1) la greffe du LCA peut être indiquée après<br />
40 ans en cas d’instabilité dans la vie courante ou lors de la<br />
pratique du sport ; 2) <strong>les</strong> résultats fonctionnels et anatomiques<br />
sont identiques à ceux obtenus chez <strong>les</strong> sujets plus jeunes ; 3)<br />
quel que soit le greffon utilisé, KJ ou DIDT, le résultat est<br />
satisfaisant et la morbidité n’est pas différente.<br />
*C. Trojani, Service de Chirurgie Orthopédique,<br />
Hôpital de l’Archet II, 151, route de<br />
Saint-Antoine-de-Ginestière, 06200 Nice.<br />
135 Utilisation du tendon du droitantérieur<br />
dans <strong>les</strong> ruptures itératives<br />
du ligament croisé antérieur : à<br />
propos d’une série continue de 40<br />
cas<br />
J.-C. PANISSET*<br />
Les réparations du LCA étant de plus en plus nombreuses, et<br />
avec une qualité qui permet la reprise de tous <strong>les</strong> sports au même<br />
niveau ou à un niveau supérieur, nous sommes confrontés à <strong>des</strong><br />
ruptures itératives. Plusieurs greffons peuvent être utilisés: le<br />
tendon rotulien contro-latéral, <strong>les</strong> demi-tendineux et droit-interne<br />
et le tendon du droit antérieur. Nous avons choisi ce dernier pour<br />
le traitement <strong>des</strong> ruptures itératives. Le but de cette étude est<br />
d’analyser <strong>les</strong> résultats sur une série continue.<br />
Quarante patients ont été opérés entre 01/1998 et 06/2000 pour<br />
une rupture itérative. Tous avaient eu une greffe avec le tendon<br />
rotulien auparavant. Ils avaient tous repris le sport. 70 % faisaient<br />
un sport de compétition. Un nouvel accident est survenu dans un<br />
délai moyen de deux ans. Devant l’instabilité persistante une<br />
greffe itérative a été réalisée.<br />
La laxité pré-opératoire a été évaluée au telos à 20 kg : la<br />
différentielle avec le genou sain était de 12,2 mm en moyenne,<br />
(5-25).<br />
La technique opératoire a été réalisée sous contrôle arthroscopique<br />
avec la technique de dehors en dedans décrite par P<br />
Chambat. Le prélèvement a été réalisé sur le tendon du droit<br />
antérieur avec une baguette osseuse rotulienne. Le greffon a été<br />
introduit de dehors en dedans et la fixation a été réalisée au<br />
niveau du tunnel tibial par une vis d’interférence résorbable et au<br />
niveau du tunnel fémoral en press-fit avec la baguette rotulienne.<br />
Avec un recul moyen de 2 ans (1-3) <strong>les</strong> résultats ont été<br />
évalués. Tous <strong>les</strong> patients ont eu un bilan dynamique au telos à 20<br />
kg.<br />
Deux fractures vertica<strong>les</strong> de rotule sont survenues dans un<br />
délai de 3 mois post-op sur un traumatisme minime. Seulement<br />
50 % ont repris un sport de compétition.<br />
Deux patients/40 se sentent instab<strong>les</strong>. La laxité résiduelle<br />
différentielle est de 2,6 mm en moyenne (0-9).<br />
La greffe du LCA avec le tendon du droit antérieur est une<br />
technique qui semble satisfaisante pour réparer une rupture itérative.<br />
L’épaisseur, la largeur et la raideur du tendon permettent<br />
une correction satisfaisante de la laxité même dans le cas d’une<br />
laxité importante. La réalisation technique de l’intervention ne
présente pas de difficultés majeures si la chirurgie précédente n’a<br />
pas fait de dégâts osseux et si le placement <strong>des</strong> tunnels était<br />
satisfaisant. Les suites post-opératoires ont été peu différentes<br />
<strong>des</strong> suites d’une ligamentoplastie de première intention. Les<br />
complications ont été minimes.<br />
L’utilisation de ce type de greffon dans la chirurgie ligamentaire<br />
du pivot central ne pose pas de problème majeur. La<br />
complication majeure est la fracture de rotule. Elle peut être<br />
évitée si nous prenons le soin de greffer la zone de prélèvement<br />
dès la première intervention. Le contrôle de la laxité peut être<br />
amélioré en inversant le greffon et en fixant le fragment rotulien<br />
en tibial et le tendon proximal en fémoral.<br />
*J.-C. Panisset, 19, avenue Marcellin-Berthelot,<br />
38100 Grenoble.<br />
136 Résultats à deux ans du traitement<br />
chirurgical de 48 laxités postérieures<br />
chroniques du genou<br />
P. CHRISTEL*, P. DJIAN, M.BRANFAUX<br />
Il s’agit d’une étude prospective et continue de 48 laxités<br />
postérieures chroniques opérées entre 1995 et 2000.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. La série est composée de33<br />
hommes et 15 femmes âgées de 29 ans en moyenne lors de<br />
l’accident. La durée d’évolution moyenne de la laxité avant<br />
intervention était de 32 mois ; 26 patients avaient préalablement<br />
subis diverses interventions mais sans reconstruction du LCP.<br />
L’examen clinique pré-opératoire a démembré 17 laxités postérieures<br />
directes (LPD), 17 laxités postéro-postéro-externes<br />
(LPPE), 6 laxités postéro-postéro-internes (LPPI), 1 laxité postérieure<br />
globale et 7 laxités antéro-postérieures complexes. Le<br />
LCP a toujours été reconstruit par arthroscopie avec une autogreffe<br />
à deux faisceaux, soit de tendon rotulien pour <strong>les</strong> cas <strong>les</strong><br />
plus anciens (22 fois), soit de tendon quadricipital (26 fois). Les<br />
composantes périphériques ont toujours été traitées par remise en<br />
tension, renforcement ou reconstruction par autogreffe tendineuse.<br />
En cas de genu-varum associéàune LPPE une ostéotomie<br />
tibiale de normo-correction préalable à la ligamentoplastie a été<br />
effectuée. Les résultats ont été évalués avec le score IKDC 93 et<br />
la laxité postérieure mesurée par <strong>des</strong> clichés radiographiques<br />
sous contrainte.<br />
RÉSULTATS. Tous <strong>les</strong> patients ont été suivis au moins un an.<br />
Le recul moyen est de 24 mois. Aucune complication postopératoire<br />
n’a été àdéplorer. Nous analysons ici <strong>les</strong> résultats<br />
obtenus surtout pour <strong>les</strong> 3 premiers types de laxité : LPD, LPPE<br />
et LPPI.<br />
Etat pré-opératoire : Pour l’ensemble de la série, évaluation<br />
subjective : 12C, 36D. Symptômes : 6B, 10C, 32D. Score global<br />
: 9C, 39D. Laxité : 11,4 ± 4,3 mm.<br />
LPD, évaluation subjective : 4C, 13D. Symptômes : 2B, 2C,<br />
12D. Score global : 4C, 14D. Laxité : 9,9 ± 3,3 mm.<br />
LPPE, évaluation subjective : 7C, 10D. Symptômes : 2B, 6C,<br />
9D. Score global : 3C, 14D. Laxité : 11,7 ± 4,6 mm.<br />
LPPI, évaluation subjective : 6D. Symptômes : 1B, 5D. Score<br />
global : 6D. Laxité : 13,0 ± 3,7 mm.<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 2S83<br />
Au dernier recul : Pour l’ensemble de la série, évaluation<br />
subjective : 9A, 27B, 12C. Symptômes : 6A, 28B, 14C. Score<br />
global : 1A, 25B, 21C, 1D. Laxité : 5,0 ± 3,0 mm, soit un gain de<br />
62 %.<br />
LPD, évaluation subjective : 6A, 8B, 3C. Symptômes : 5A,<br />
10B, 2C. Score global : 1A, 10B, 6C. Laxité : 4,0 ± 2,0 mm, soit<br />
un gain de 62 %.<br />
LPPE, évaluation subjective : 2A, 11B, 14C. Symptômes : 3A,<br />
10B, 4C. Score global : 4B, 12C, 1D. Laxité : 5,7 ± 3,5 mm., Soit<br />
un gain de 54 %.<br />
LPPI, évaluation subjective : 6B. Symptômes : 6B. Score global<br />
: 5B, 1C. Laxité : 5,9 ± 3,0 mm soit un gain de 61 %.<br />
Quelque soit le paramètre considéré,lacatégorie D a pratiquement<br />
disparu au dernier recul. Cette amélioration, par rapport à<br />
l’état pré-opératoire est statistiquement significative (p = 0,001).<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. La reconstruction du LCP<br />
avec une greffe à deux faisceaux combinée à une compensation<br />
<strong>des</strong> laxités périphériques et <strong>des</strong> défauts d’axe permet d’obtenir<br />
<strong>des</strong> gains de correction de laxité similaires à ceux obtenus pour la<br />
chirurgie du LCA. Malgré cela, <strong>les</strong> laxités postéro-postéroexternes<br />
ont un moins bon pronostic que <strong>les</strong> autres types de<br />
laxité.<br />
*P. Christel, Clinique Nollet, 21, rue Brochant, 75017 Paris.<br />
137 Choix de la source cellulaire et du<br />
support pour la fabrication de cartilage<br />
in vitro par génie tissulaire<br />
D. HANNOUCHE*, H. PETITE, A.MEUNIER,<br />
L. SEDEL, J.-P. VACANTI<br />
INTRODUCTION. La fabrication de structures cartilagineuses<br />
par génie tissulaire offre aujourd’hui <strong>des</strong> perspectives thérapeutiques<br />
nouvel<strong>les</strong> pour un grand nombre de mala<strong>des</strong>. Ces<br />
structures sont composées d’un support synthétique résorbable<br />
couplé à<strong>des</strong> cellu<strong>les</strong> compétentes. Deux types cellulaires ont été<br />
proposés : <strong>les</strong> chondrocytes articulaires prélevésenpériphérie de<br />
l’articulation, ou <strong>les</strong> cellu<strong>les</strong> souches mésenchymateuses (CSM)<br />
présentes dans la moelle et possédant un potentiel chondrogénique.<br />
L’objectif de cette étude était de déterminer la source<br />
cellulaire optimale et le meilleur support pour la fabrication de<br />
fragments cartilagineux in vitro.<br />
MÉTHODES. Des CSM de lapin étaient isolées, puis amplifiées<br />
en culture cellulaire pendant 21 jours. Aprèscedélai, 20-40<br />
millions de cellu<strong>les</strong>/ml étaient combinées à <strong>des</strong> éponges d’acide<br />
polyglycolique (3 types d’épongés de 1 × 1 × 0,2 cm 2 ) et<br />
cultivées en milieu enrichi en TGF1, dans <strong>des</strong> conditions dynamiques<br />
spécifiques autorisant <strong>les</strong> échanges gazeux. Les tissus<br />
ainsi obtenus étaient comparés à <strong>des</strong> structures de taille identique<br />
obtenues avec <strong>des</strong> chondrocytes différenciés prélevés sur <strong>les</strong><br />
mêmes animaux. L’étude a comporté une analyse histologique,<br />
immuno-histochimique pour le collagène de type I, II, et X, et<br />
une analyse biochimique du contenu en ADN, glycosaminoglycanes<br />
(GAG), et collagène de type II.<br />
RÉSULTATS. Après 3 semaines en culture, <strong>les</strong> composites<br />
obtenus avec <strong>les</strong> CSM ont conservé leur taille et avaient un aspect
2S84 77 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
blanc nacré, comparable à du cartilage hyalin. L’analyse histologique<br />
et immuno-histochimique pour le collagène de type II a<br />
confirmé la présence d’une matrice cartilagineuse sur toute<br />
l’épaisseur <strong>des</strong> fragments. Le contenu en GAGs, et en collagène<br />
de type II était significativement supérieur avec <strong>les</strong> CSM par<br />
rapport aux chondrocytes, et cela quel que soit le support utilisé.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. Cette étude montre que<br />
<strong>des</strong> fragments tissulaires cartilagineux peuvent être obtenus avec<br />
<strong>des</strong> CSM cultivées sur <strong>des</strong> supports en PGA dans <strong>des</strong> conditions<br />
très <strong>particulières</strong>. L’utilisation de ces cellu<strong>les</strong> offre l’avantage de<br />
pouvoir être aisément prélevées, puis considérablement amplifiées<br />
in vitro, etderéduire la morbidité liée auprélèvement. Des<br />
étu<strong>des</strong> complémentaires sont nécessaires pour évaluer le comportement<br />
de ces matériaux vivants après leur implantation en site<br />
articulaire.<br />
*D. Hannouche, Laboratoire de Recherches Orthopédiques,<br />
10, avenue de Verdun, 75010 Paris.<br />
138 Critères d’infections secondaires de<br />
prothèses articulaires<br />
T. BAUER*, S. TEMPESTA<br />
ET LE GROUPE TIRESIAS<br />
INTRODUCTION. L’objectif de ce travail est de définir <strong>des</strong><br />
critères cliniques et microbiologiques permettant de distinguer<br />
<strong>les</strong> infections de prothèses articulaires post-opératoires <strong>des</strong> infections<br />
secondaires et de proposer un score de probabilité.<br />
MATÉRIEL. Il s’agit d’une étude rétrospective multicentrique<br />
portant sur 134 cas d’infections de prothèses de hanches et de<br />
genoux.<br />
MÉTHODES. Une première étape a permis de distinguer trois<br />
populations d’infections (post-opératoire, secondaire ou non précisable)<br />
en fonction du germe retrouvé lors du diagnostic d’infection<br />
de prothèse (respectivement Staphylocoque à coagulase<br />
négative, autres germes et Staphylocoque doré). Dans un<br />
deuxième temps, <strong>des</strong> paramètres cliniques ont été analysés dans<br />
le groupe <strong>des</strong> infections post-opératoires et dans le groupe <strong>des</strong><br />
infections secondaires pour évaluer la valeur prédictive de chacun<br />
de ces paramètres : intervalle libre, délai, foyer à distance.<br />
RÉSULTATS. Cinquante-sept cas d’infections secondaires ont<br />
été retrouvés, il existe 34 cas d’infections post-opératoires et dans<br />
43 cas l’infection n’a pas été classée (infection à Staphylocoque<br />
doré). Le diagnostic d’infection de prothèse a été obtenu par <strong>les</strong><br />
prélèvements per-opératoires dans 81 p.cent <strong>des</strong> cas. Un intervalle<br />
libre inférieur à 1 an (entre la pose de la prothèse et <strong>les</strong><br />
signes articulaires) est retrouvé dans 69 p.cent <strong>des</strong> cas d’infection<br />
post-opératoire et dans 36 p.cent <strong>des</strong> cas d’infection secondaire<br />
avec une différence significative (p = 0,003). Un épisode infectieux<br />
à distance a été retrouvé dans 44 p.cent <strong>des</strong> cas (et documenté<br />
par un prélèvement bactériologique dans 13 p.cent <strong>des</strong> cas<br />
(18/134)). Un acte thérapeutique invasif a été réalisé dans 17<br />
p.cent <strong>des</strong> cas. Une localisation septique à distance est retrouvée<br />
dans 12 p.cent (4/34) <strong>des</strong> cas d’infection post-opératoire et dans<br />
56 p.cent (32/57) <strong>des</strong> cas d’infection secondaire avec une différence<br />
significative (p < 0,001).<br />
DISCUSSION. La durée del’intervalle libre et la notion de<br />
foyer infectieux à distance (documenté ou non) représentent <strong>des</strong><br />
critères significatifs pour distinguer <strong>les</strong> infections postopératoires<br />
<strong>des</strong> infections secondaires de prothèses. La notion de<br />
délai (entre l’épisode infectieux et le diagnostic d’infection de<br />
prothèse) n’est pas un critère significatif d’infection secondaire<br />
(p > 0,005). Les infections à Staphylocoque doré demeurent<br />
diffici<strong>les</strong> à classer.<br />
CONCLUSION. L’analyse de paramètres cliniques en fonction<br />
de critères microbiologiques a permis d’isoler <strong>des</strong> critères<br />
significatifs d’infection secondaire de prothèse articulaire, ce qui<br />
permet de proposer un score de probabilité qui toutefois doit être<br />
évalué sur une plus grande échelle.<br />
*T. Bauer, Service de Chirurgie Orthopédique,<br />
Hôpital Ambroise-Paré, 9, avenue Char<strong>les</strong>-de-Gaulle,<br />
92100 Boulogne.<br />
139 Evaluation <strong>des</strong> lames et fraises<br />
autoclavab<strong>les</strong> réutilisab<strong>les</strong> en chirurgie<br />
arthroscopique<br />
O. GAGEY*, V. MOLINA, S.RASPAUD,<br />
S. SOREDA<br />
INTRODUCTION. Les dispositifs médicaux à usage unique<br />
présentent de nombreux avantages et sont de plus en plus utilisés.<br />
La valeur financière de l’usage unique à l’hôpital étant croissante,<br />
il était intéressant de repositionner l’usage multiple en démontrant<br />
son efficacité et sa sécurité. L’objectif de cette étude est de<br />
déterminer <strong>les</strong> aspects d’hygiène et d’évaluer l’usure d’une nouvelle<br />
version autoclavable de lames et fraises utilisées en chirurgie<br />
arthroscopique.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Après mise en condition standard<br />
et dix cyc<strong>les</strong> de stérilisation préalab<strong>les</strong>, quinze instruments<br />
(fraises et shaver) ont été utilisés 10 fois chacun, respectivement<br />
sur os spongieux ou cartilage et tissus ou tendons lors d’arthroscopies<br />
faites sur cadavres non embaumés. La durée d’utilisation<br />
était de 10 mn minimum par instrument. Les instruments ont fait<br />
l’objet du cycle standard de décontamination – nettoyage –<br />
immersion dans la soude 1N – stérilisation à 134 °C pendant 20<br />
minutes défini par la circulaire n o 138 du 14 mars 2001. Une fiche<br />
de traçabilité était remplie à chaque demande de stérilisation <strong>des</strong><br />
instruments. La 1 re phase consistait en l’évaluation de la résistance<br />
de l’équipement aux traitements en stérilisation et en<br />
particulier la non-altération de l’état de surface au moyen d’un<br />
instrument optique grossissant. L’objectif de la 2 e phase était de<br />
déterminer la faisabilité et la performance du lavage au moyen<br />
d’un dosage <strong>des</strong> résidus protéiques par la méthode de Bradford en<br />
spectrophotométrie UV.<br />
RÉSULTATS. Cent cinquante cyc<strong>les</strong> complets on été observés.<br />
Les résultats de la 1 re phase montrent une résistance satisfaisante<br />
<strong>des</strong> instruments sur 10 utilisations avec <strong>des</strong> traces d’érosion<br />
visib<strong>les</strong> sur 20 % <strong>des</strong> instruments à partir de la 5 e utilisation.<br />
Deux instruments ont été remplacés en cours d’étude pour usure<br />
mécanique. La 2 e phase a révélé 2 % de résultats positifs (protéines<br />
> 8µg/ml, seuil de positivité défini selon le projet de norme<br />
Pr EN ISO 15883-1 concernant <strong>les</strong> exigences généra<strong>les</strong> pour <strong>les</strong>
laveurs désinfecteurs). L’analyse de ces résultats a montré que<br />
12 % <strong>des</strong> instruments nettoyés aux ultrasons comportaient <strong>des</strong><br />
traces de protéines. Aucune trace de protéine n’était retrouvée sur<br />
<strong>les</strong> instruments ayant subi un nettoyage en machine à laver<br />
« cycle endoscopes » soit pour 143 cyc<strong>les</strong> successifs.<br />
CONCLUSION. Malgré <strong>les</strong> difficultés de leur nettoyage (double<br />
chemise), <strong>les</strong> lames et fraises utilisées en chirurgie arthroscopique<br />
sont réutilisab<strong>les</strong> sans risque puisque <strong>les</strong> traces de protéines<br />
mesurées sont négligeab<strong>les</strong> lorsque <strong>les</strong> instruments sont<br />
nettoyés en laveur désinfecteur qualifié cycle endoscope. En<br />
outre, compte tenu de l’usage intensif, l’usure est acceptable au<br />
long <strong>des</strong> dix cyc<strong>les</strong>. Le recours extensif aux instruments à usage<br />
unique mérite d’être discuté soigneusement en raison de ses<br />
conséquences financières.<br />
*O. Gagey, CHU de Bicêtre, 78, avenue du Général-Leclerc,<br />
94270 Le Kremlin-Bicêtre.<br />
140 L’avenir du secteur septique <strong>des</strong><br />
services de chirurgie orthopédique<br />
et traumatologique<br />
P. VICHARD*, D. TALON, L.JEUNET<br />
Au moment où <strong>les</strong> infections nosocomia<strong>les</strong> sont à l’ordre du<br />
jour et où le chirurgien est progressivement impliqué, on pourrait<br />
penser que l’isolement strict <strong>des</strong> patients septiques grâce à <strong>des</strong><br />
Unités de Soins Intégrés n’est pas contesté...Or,iln’en est rien.<br />
Plusieurs facteurs sont responsab<strong>les</strong> de ce flottement doctrinal, ce<br />
sont :<br />
− 1 er facteur : <strong>les</strong> Services d’Orthopédie Générale sont presque<br />
<strong>les</strong> seuls à recueillir dans une même formation une minorité<br />
importante de septiques à germes souvent résistants, constituant<br />
une menace vis-à-vis d’une majorité de mala<strong>des</strong> réputés aseptiques.<br />
L’orthopédiste dispose donc de peu d’alliés...<br />
− 2 e facteur : le nombre croissant <strong>des</strong> chambres <strong>particulières</strong><br />
procure une confiance (injustifiée ?).<br />
− 3 e facteur : <strong>les</strong> Hygiénistes craignent avant tout <strong>les</strong> porteurs<br />
occultes de bactéries résistantes, et appliquent à tous <strong>les</strong> patients<br />
<strong>les</strong> seu<strong>les</strong> mesures de protection rapprochée.<br />
− 4 e facteur : <strong>les</strong> économies à tout prix.<br />
Nous avons étudié :1)l’état actuel <strong>des</strong> Services d’Orthopédie<br />
Universitaires ; 2) <strong>les</strong> statistiques du Service d’Hygiène du CHU<br />
de Besançon et la littérature.<br />
RÉSULTATS. 1) 71 Services universitaires de France interrogés<br />
révèlent révèle que : * 11 Services pratiquent un isolement<br />
strict ; * 40 Services pratiquent un isolement incomplet ; * 20<br />
Services ne font aucune distinction entre septiques et aseptiques ;<br />
2) <strong>les</strong> chiffres du Service d’Hygiène Hospitalière : la charge<br />
épidémiologique <strong>des</strong> germes SAMR, souvent en cause en Orthopédie,<br />
est beaucoup plus forte dans <strong>les</strong> Unités Polyvalentes du<br />
CHU que dans l’Unité Septique. La contamination entre septiques<br />
est faible à son niveau. Par ailleurs, la contamination<br />
manuportée et l’aérobiocontamination ne sont pas endiguées<br />
dans <strong>les</strong> unités autres que l’unité septique.<br />
La littérature est partagée entre la nouvelle tendance et la<br />
prévention à distance.<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 2S85<br />
a) un argument en faveur du Secteurs Septiques est retenu par<br />
tous : l’efficacité de la concentration en moyens qu’il réalise.<br />
b) la charge de travail éventuellement croissante <strong>des</strong> Unités<br />
Mixtes entrave la prévention rapprochée.<br />
c) dans <strong>les</strong> Services Polyvalents sont présents de nombreux<br />
stagiaires, personnels éphémères, néophytes en matière de prévention.<br />
d) la standardisation de la prévention aboutit à une quantité<br />
moyenne de soins qui allonge leur déroulement chez l’aseptique<br />
et simplifie à l’excès la prise en charge du septique.<br />
e) l’argument financier est dérisoire comparativement aux<br />
conséquences de la contamination. De plus, la structure départementale<br />
assure un partage du secteur septique.<br />
CONCLUSION. – L’Unité Septique (ou le Département) est<br />
une structure à conserver.<br />
La responsabilité du Chirurgien vis-à-vis <strong>des</strong> infections nosocomia<strong>les</strong><br />
étant lourdement mise en cause, il doit, en s’appuyant<br />
sur son Consultant privilégié,l’Hygiéniste, refuser <strong>des</strong> arbitrages<br />
purement administratifs.<br />
*P. Vichard, Service de Chirurgie Orthopédique,<br />
CHU de Besançon.<br />
141 L’intérêt d’associer <strong>des</strong> plaquettes<br />
aux cellu<strong>les</strong> de moelle osseuse sur<br />
de la céramique en tant que substitut<br />
osseux<br />
M. ROMIH*, J. DELÉCRIN, D.HEYMANN,<br />
C. DESCHAMPS, N.PASSUTI<br />
INTRODUCTION. L’adjonction de cellu<strong>les</strong> de moelle osseuse<br />
sur de la céramique apporte <strong>des</strong> ostéoprogéniteurs et favorise la<br />
repousse osseuse. De même, l’addition supplémentaire de plaquettes<br />
qui contiennent <strong>des</strong> facteurs de croissance devrait potentiellement<br />
augmenter le taux de formation osseuse. Le but de ce<br />
travail était de quantifier in vitro le potentiel ostéogène de<br />
l’addition de plasma riche en plaquettes (PRP) dans une culture<br />
de moelle osseuse sur de la céramique.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Le PRP obtenu par centrifugation<br />
de sang a été rajouté à <strong>des</strong> cellu<strong>les</strong> de moelle osseuse<br />
obtenues à partir d’une ponction de crête iliaque et mises en<br />
culture sur <strong>des</strong> céramiques macroporeuses biphasées. L’adjonction<br />
de PRP avec comptage <strong>des</strong> plaquettes a été effectuée tous <strong>les</strong><br />
2 jours. La différenciation <strong>des</strong> cellu<strong>les</strong> de moelle osseuse en<br />
cellu<strong>les</strong> à potentiel ostéogène a été évaluée par la quantification<br />
de l’activité phosphatase alcaline après 15 jours de culture.<br />
RÉSULTATS. La prolifération <strong>des</strong> cellu<strong>les</strong> mesenchymateuse<br />
a été nettement plus importante dans <strong>les</strong> cultures avec PRP<br />
(+31 %). La prévalence moyenne du nombre de colonies<br />
phosphatase-alcaline positives a été aussi plus importante en<br />
présence de PRP (+ 38 %). De même, l’activité phosphatase<br />
alcaline a été augmentée par l’adjonction de PRP sur la céramique<br />
(+31 %).<br />
DISCUSSION. L’adjonction de PRP aux cultures de cellu<strong>les</strong><br />
de moelle sur céramique a stimulé la prolifération <strong>des</strong> cellu<strong>les</strong>
2S86 77 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
ostéoblast-like. L’augmentation de leur activité proliférative et<br />
différenciative apporte <strong>des</strong> éléments quantitatifs in vitro sur<br />
l’intérêt d’associer <strong>des</strong> plaquettes dans <strong>les</strong> greffes osseuses avec<br />
substitut osseux.<br />
*M. Romih, Pôle Ostéo-Articulaire, CHU, Hôtel Dieu,<br />
44093 Nantes Cedex 1.<br />
142 Résorption à long terme (plus de 10<br />
ans) <strong>des</strong> allogreffes massives manchonnant<br />
<strong>des</strong> prothèses<br />
P. HERNIGOU*, G. DELEPINE<br />
INTRODUCTION. Les allogreffes massives sont utilisées<br />
depuis longtemps en chirurgie orthopédique. Si <strong>les</strong> résultats<br />
immédiats sont habituellement encourageants, l’une <strong>des</strong> interrogations<br />
reste le risque de résorption à long terme. Cette série a<br />
analysé la résorption osseuse de 39 allogreffes avec un recul<br />
supérieur à 10 ans.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. 39 allogreffes massives manchonnant<br />
<strong>des</strong> prothèses de hanche, de genou ou d’épaule, ont été<br />
analysées radiographiquement avec un recul moyen de 13 ans (de<br />
10 à 17 ans). Ces allogreffes avaient été préparées de la même<br />
manière : conservation à–30° et stérilisation par 25 000 Grays<br />
avant implantation. La résorption corticale de l’allogreffe a été<br />
classée radiologiquement comme « mineure » (moins de 5 mm<br />
en profondeur et moins d’1 cm de longueur), « modérée », ou<br />
« majeure » lorsqu’elle concernait toute l’épaisseur de l’allogreffe<br />
sur <strong>les</strong> trois quarts de sa circonférence, quelle que soit sa<br />
longueur. Ces allogreffes de plus de 15 cm de longueur avaient<br />
été utilisées soit pour la reprise <strong>des</strong> fémurs de prothèses tota<strong>les</strong> de<br />
hanche <strong>des</strong>cellées, pour la reconstruction d’exérèse tumorale<br />
(tibia, fémur, humérus). Parmi ces 39 patients, 21 avaient reçuen<br />
postopératoire soit de la chimiothérapie isolément, soit de la<br />
radiothérapie associée à une chimiothérapie.<br />
RÉSULTATS. La consolidation de l’allogreffe a été obtenue<br />
dans la première ou deuxième année postopératoire. Seu<strong>les</strong> <strong>des</strong><br />
résorptions périphériques ont été observées au dernier recul.<br />
Parmi <strong>les</strong> 39 allogreffes massives à plus de 10 ans, 28 ont une<br />
résorption visible radiologiquement. Parmi ces 28 allogreffes, la<br />
résorption est « mineure » dans 15 cas, « modérée » dans 9 cas et<br />
« majeure » dans 4 cas. Le premier facteur responsable <strong>des</strong><br />
résorptions est l’adjonction de traitements complémentaires et en<br />
particulier une radiothérapie locale aprèsexérèse carcinologique.<br />
A un moindre degré, la chimiothérapie isolée donne aussi <strong>des</strong><br />
résorptions. Aucune <strong>des</strong> allogreffes implantées pour reprise du<br />
fémur d’une prothèse de hanche <strong>des</strong>cellée n’a derésorption à 10<br />
ans. Deux patients opérés pour résection d’un chondrosarcome,<br />
mais sans traitement complémentaire, ont une résorption mineure<br />
de leur allogreffe.<br />
Les résorptions mineures et <strong>les</strong> résorptions modérées ne compromettent<br />
pas le devenir de la prothèse. Les résorptions majeures<br />
observées préférentiellement sur <strong>les</strong> sites tibiaux et huméraux<br />
supérieurs compromettent le devenir de l’implant (trois <strong>des</strong>cellements<br />
à plus de 10 ans).<br />
Les résorptions périphériques sur l’allogreffe sont apparues en<br />
général entre la troisième et la septième année postopératoire.<br />
Passé ce délai, el<strong>les</strong> ne semblent plus survenir et ne semblent plus<br />
s’étendre. L’usure du polyéthylène évidente chez certains<br />
patients opérés depuis plus de 10 ans ne s’accompagne pas<br />
d’ostéolyse endostée del’allogreffe sous jacente.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. Les résorptions <strong>des</strong> allogreffes<br />
massives concernent préférentiellement l’extrémité supérieure<br />
de l’humérus et le tibia, et surviennent le plus souvent chez<br />
<strong>les</strong> patients ayant eu une exérèse carcinologique pour tumeur<br />
suivie d’un traitement complémentaire. El<strong>les</strong> sont exceptionnel<strong>les</strong><br />
chez <strong>les</strong> patients ayant reçu une allogreffe pour reprise de<br />
prothèse de hanche.<br />
*P. Hernigou, Hôpital Henri-Mondor,<br />
51, avenue de Lattre-de-Tassigny, 94010 Créteil.<br />
143 Caractérisation in vitro de l’expression<br />
phénotypique <strong>des</strong> cellu<strong>les</strong><br />
issues de paraostéoarthropathies<br />
neurogènes<br />
M. BANDELIER*, P. DENORMANDIE, P.DENYS,<br />
R. SAPENA, D.ENOUF, T.YOUSSEFIAN,<br />
Y. BLONDEAU, M.BONNET, D.BEN SMAIL,<br />
L. MAILHAN, T.JUDET<br />
INTRODUCTION. Les Para Ostéo Arthropathies neurogènes<br />
(POAn) n’ont pas fait à ce jour l’objet d’étu<strong>des</strong> systématiques.<br />
Nous en avons caractérisé l’expression <strong>des</strong> gènes spécifiques <strong>des</strong><br />
phénotypes ostéoblastique et chondrocytaire à partir de l’ostéome<br />
et <strong>des</strong> tissus non minéralisés environnant <strong>les</strong> ostéomes.<br />
MATÉRIELS ET MÉTHODES. Des fragments d’ostéome et<br />
du tissu non minéralisé l’entourant ont été obtenus lors de<br />
chirurgies d’exérèse chez plus de 25 patients. Des cultures ont été<br />
conduites jusqu’à 56 jours à partir de ces explants. Nous avons<br />
recherché <strong>les</strong> ARN messagers <strong>des</strong> principaux marqueurs <strong>des</strong><br />
phénotypes ostéoblastique, chondrocytaire et adipocytaire, ainsi<br />
que certaines <strong>des</strong> protéines spécifiques synthétisées.<br />
Des cryocoupes sériées suivies de colorations histochimiques<br />
et d’immunomarquages ont été réalisées.<br />
RÉSULTATS. Les cellu<strong>les</strong> issues de l’ostéome et <strong>les</strong> cellu<strong>les</strong><br />
issues <strong>des</strong> tissus avoisinants forment en culture <strong>des</strong> structures qui<br />
minéralisent. Les marqueurs <strong>des</strong> ostéoblastes retrouvés sont :<br />
phosphatase alcaline (isoforme osseuse), ostéocalcine, Cbfa1,<br />
collagène de type I ; pour <strong>les</strong> chondrocytes : collagène de type II,<br />
aggrécane ; le collagène de type X ainsi que le VEGF signent la<br />
présence de chondrocytes hypertrophiques. Le facteur de transcription<br />
PPARγ2 spécifique <strong>des</strong> adipocytes est aussi retrouvé<br />
dans <strong>les</strong> deux cultures. Les proportions et chronologies d’expression<br />
de ces marqueurs diffèrent légèrement entre <strong>les</strong> deux tissus.<br />
L’étude ex vivo démontre la séquence typique de la formation<br />
osseuse de type enchondral à partir de populations cellulaires<br />
d’origine non osseuse.<br />
DISCUSSION. Notre travail fournit la première caractérisation<br />
<strong>des</strong> tissus non minéralisés entourant l’ostéome. Il donne<br />
également <strong>des</strong> indications claires permettant de reconstituer l’histoire<br />
de la formation de l’os ectopique. Le potentiel ostéo-
chondrogénique <strong>des</strong> tissus conjonctifs entourant l’ostéome n’a<br />
jamais été rapporté. La persistance de ce potentiel pourrait expliquer<br />
l’apparition <strong>des</strong> récidives aprèsexérèse. La constatation que<br />
ce potentiel est réprimé in vivo tandis qu’in vitro son expression<br />
est complète, ouvre la voie à l’étude de certains <strong>des</strong> mécanismes<br />
contrôlant la formation osseuse.<br />
CONCLUSION. Le modèle de culture développé nous donne<br />
accès à l’étude <strong>des</strong> facteurs déterminant le <strong>des</strong>tin <strong>des</strong> populations<br />
cellulaires impliquées dans la formation <strong>des</strong> POAn en particulier,<br />
146 La fixation acétabulaire par cupule<br />
impactée sur <strong>des</strong> greffons osseux<br />
au cours <strong>des</strong> arthroplasties de révision<br />
: résultats à moyen terme<br />
C. PUIG ABBS*, P. SEMINARIO, D.VALVERDE,<br />
J. FENOLLOSA<br />
INTRODUCTION. Les buts de la révision d’une arthroplastie<br />
de hanche : un montage stable, récupérer le stock osseux et<br />
rétablir le centre mécanique de l’articulation.<br />
Nous avons réalisé une étude ayant comme objectif l’évaluation<br />
<strong>des</strong> résultats cliniques et radiographiques à moyen terme<br />
avec la technique.du press-fit sur <strong>des</strong> greffons osseux pour la<br />
révision de cupule de Prothèses tota<strong>les</strong> de hanche (PTH).<br />
MATÉRIEL. Pendant <strong>les</strong> années 1995 et 1996, 55 arthroplasties<br />
de hanche ont été révisées, dont 42 pour la révision de la<br />
cupule avec reconstruction. Pour seize patients (dix femmes et<br />
six hommes) nous avons employé la technique de la cupule<br />
impactée sur <strong>des</strong> greffons osseux. L’âge moyen <strong>des</strong> mala<strong>des</strong> fut<br />
de 64 ans (34-82) et la durée moyenne du suivi de 70 mois<br />
(62-86).Outre 4 arthroplasties partiel<strong>les</strong>, <strong>les</strong> composants révisés<br />
furent 6 cupu<strong>les</strong> vissées, 5 cupu<strong>les</strong> cimentées et 1 cupule impactée.<br />
L’étiologie de la première intervention était pour la majorité<br />
la coxarthrose.<br />
MÉTHODES. Dans tous <strong>les</strong> cas nous ayons employé la voie<br />
postérieure. L’os utilisé était de banque, broyé dans quinze cas,<br />
structuré en deux. Treize cupu<strong>les</strong> étaient recouvertes d’hydroxyapathite,<br />
trois avaient une couverture poreuse. Quatre composants<br />
ont du être renforcès avec <strong>des</strong> vis. Nous avons évalué <strong>les</strong> défauts<br />
osseux selon la classification de Paproski. Et l’aspect clinique<br />
avec l’échelle fonctionnelle de Merle d’Aubigné. Pour l’étude<br />
radiographique nous avons considéré la situation de l’implant<br />
aprèslarévision et son possible déplacement ultérieur. Quant aux<br />
greffons, nous avons étudié son intégration dans <strong>les</strong> zones de De<br />
Lee-Charnley.<br />
RÉSULTATS. Aucune cupule n’a nécessité de révision ultérieure.<br />
Dans 62,5 % <strong>des</strong> cas le composant s’est bien incorporé.<br />
L’évaluation fonctionnelle passa de 11,5/18 pré-opératoire à<br />
15/18 dans le postopératoire, puis à 15,9/18 au recul. L’évalua-<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 2S87<br />
Séance du 14 novembre après-midi<br />
HANCHE<br />
mais aussi dans <strong>les</strong> divers processus de formation osseuse physiologique<br />
ou pathologique. Les interactions entre l’ostéome et<br />
<strong>les</strong> tissus avoisinants doivent être étudiées. La capacité du tissu<br />
non minéralisé péri-ostéome à former <strong>des</strong> tissus minéralisés<br />
semble devoir être prise en compte lors <strong>des</strong> exérèses chirurgica<strong>les</strong>.<br />
*M. Bandelier, Service de Chirurgie Orthopédique,<br />
Hôpital Raymond-Poincaré, 104, boulevard<br />
Raymond-Poincaré, 92380 Garches.<br />
tion subjective <strong>des</strong> mala<strong>des</strong> fut bonne ou excellente dans 81 %<br />
<strong>des</strong> cas.<br />
DISCUSSION. Cette technique renforce le stock osseux puisqu’elle<br />
conserve l’os préexistant, en ajoute, et facilite son intégration<br />
dans l’hôte. De même elle n’implique pas un changement<br />
du centre fonctionnel de la hanche, et la bonne incorporation de<br />
l’implant assure le montage. Le résultat fonctionnel et l’évaluation<br />
subjective <strong>des</strong> patients ont été bonnes.<br />
CONCLUSION. Après un minimum de 6 ans de suivi la<br />
fixation press-fit avec greffons osseux dans la chirurgie de révision<br />
se présente comme une technique encourageante.<br />
*C. Puig Abbs, Servicio COT, Hospital Doctor Peset,<br />
90,<br />
avenue Gaspar Aguilar, 46017 Valence, Espagne.<br />
147 Reconstruction acétabulaire par<br />
tête fémorale de banque cryoconservée<br />
monobloc : étude prospective<br />
de 144 cas à 10 ans de recul<br />
P. PIRIOU*, J.-L. MARMORAT, C.GARREAU DE<br />
LOUBRESSE, T.JUDET<br />
INTRODUCTION. Les auteurs utilisent depuis 1985 une technique<br />
de reconstruction acétabulaire par greffon cryo-conservé<br />
massif sans armature de soutien associée à une arthroplastie<br />
totale de hanche cimentée pour défect acétabulaire important. De<br />
1985 à 1995, 140 reconstructions acétabulaire de ce type ont été<br />
réalisées. Le propos de cette étude prospective est d’en apprécier<br />
l’efficacité clinique ainsi que l’évolution radiologique.<br />
MATÉRIEL. L’âge moyen de la population était de 61 ans.<br />
En moyenne <strong>les</strong> patients avaient déjà bénéficié de deux interventions.<br />
Les 140 défects se répartissaient en 50 % de sta<strong>des</strong><br />
SOFCOT II, 35 % de sta<strong>des</strong> III et 15 % de sta<strong>des</strong> IV.<br />
MÉTHODOLOGIE. Le principe de la reconstruction était de<br />
combler le défect osseux acétabulaire par un greffon cryoconservé<br />
(tête fémorale de banque). Laquelle est adaptée par<br />
taille au défect de façon la plus congruente possible, cherchant à
2S88 77 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
obtenir une stabilité primaire du greffon. Nous n’avons jamais<br />
utilisé d’armature de soutien complétant la stabilité primaire<br />
obtenue par une synthèse par une ou deux vis. Puis au sein de<br />
cette greffe, était scellé une cupule en polyéthylène. Le scellement<br />
ayant lieu pour l’essentiel au sein de la greffe, laquelle aura<br />
été préalablement fraisée à la taille de l’acétabulum. Nous nous<br />
sommes imposés un recul minimum théorique de 6 ans à la<br />
révision <strong>des</strong> patients. Ils ont tous été revus radiologiquement et<br />
cliniquement avec cotation de leur score Postel Merle d’Aubigné.<br />
Les hanches ont été revues en utilisant la méthode d’Oakeshott<br />
pour l’analyse radiologique. L’analyse de survie a été réaliséeen<br />
utilisant la méthode de Kaplan-Meier en prenant comme critère<br />
de changement d’état, la reprise prothétique pour échec clinique.<br />
RÉSULTAT. Le recul moyen global de la série observéétait de<br />
8,5 ans, quant au recul de la population <strong>des</strong> implants encore en<br />
place, il était de 10 ans. Huit patients étaient perdus de vue<br />
(5,7 %). Ces perdus de vue ayant cependant compté dans la série<br />
pour une durée moyenne de 5 ans. Trente-cinq patients étaient<br />
décédés pendant le suivi (25 %). Ces patients ayant été suivis en<br />
moyenne avant leur décès pendant 4 ans. Au plan radiologique,<br />
l’inclinaison <strong>des</strong> cupu<strong>les</strong> ne s’est pas significativement modifiée<br />
au cours du temps. Par contre, la hauteur du centre de la cupule<br />
mesurée par rapport à la ligne <strong>des</strong> U ne s’est pas modifiée dans le<br />
groupe <strong>des</strong> patients décédés ou dans le groupe <strong>des</strong> patients<br />
vivants non repris au recul. Elle s’est modifiée dans le groupe <strong>des</strong><br />
échecs, puisqu’elle était en moyenne de 28 mm en postopératoire<br />
dans le groupe <strong>des</strong> échecs et passait à 39mm à la date<br />
de l’échec et ce, de façon significative (Anova < 10 –3 ). Nous<br />
déplorons avec cette technique 26 échecs (18 %) <strong>les</strong>quels ont eu<br />
lieu en moyenne à 6 ans de suivi avec une répartition bi-modale<br />
montrant un pic d’échecs précoces autours de 2 ans puis un<br />
nouveau pic autour de la 9 e année. L’analyse de survie selon la<br />
méthode de Kaplan-Meier donne une survie moyenne de 13,5 ans<br />
avec IC (5 %) = [12,5 ; 14] années. Au plan fonctionnel, le score<br />
pré-opératoire était en moyenne de 3\5\3 (11) pour un score PMA<br />
à la date de révision égal à 5,3\5,6\4,3 (15,2).<br />
DISCUSSION. Les résultats globaux de cette série à 10 ans de<br />
recul sont globalement satisfaisants avec un taux de succès<br />
dépassant <strong>les</strong> 70 %. Les échecs s’expliquent par <strong>des</strong> tassements<br />
radiologiques de la greffe stigmatisés par l’ascension du centre de<br />
la cupule par rapport à la ligne <strong>des</strong> U. La comparaison de ces<br />
résultats par rapport aux données de la littérature semble supérieurs<br />
à ceux de Harris (publiés à 7 ans de recul sur une faible<br />
série de 48 cas).<br />
CONCLUSION. Au total, cette méthode de reconstruction<br />
acétabulaire <strong>des</strong>tinée à <strong>des</strong> défects importants donne à 10 ans de<br />
recul un taux de succès de73%.<br />
*P. Piriou, Hôpital Raymond-Poincaré,<br />
104, boulevard Raymond-Poincaré, 92380 Garches.<br />
148 Analyse critique d’une série de<br />
reconstruction acétabulaire par biomatériaux<br />
et cupule sans ciment : à<br />
propos de 48 cas<br />
C. PERRIER*, V. GAUDIOT, D.WAAST,<br />
N. PASSUTI, J.DELÉCRIN, F.GOUIN<br />
L’utilisation de biomatériaux associés à une cupule non cimentée<br />
apparaît comme une nouvelle perspective de reconstruction<br />
<strong>des</strong> pertes de substance acétabulaire face aux échecs <strong>des</strong> techniques<br />
conventionnel<strong>les</strong>. Nous avons voulu évaluer <strong>les</strong> résultats à<br />
court terme de notre expérience et tenter d’en dégager <strong>les</strong> premières<br />
limites.<br />
MATÉRIEL. Entre le 01/01/96 et le 31/12/2000, nous avons<br />
changé 229 cupu<strong>les</strong>. Pour 48 d’entre eux (46 patients âgés en<br />
moyenne de 57 ans [29-84]), une reconstruction associant biomatériaux<br />
et cupule sans ciment a été réalisée. Le suivi rétrospectif<br />
moyen était de 37 mois [7-67] avec 2 patients perdus de<br />
vue précocement.<br />
MÉTHODE. Deux types de cupule recouvertes d’hydroxyapatite<br />
ont été utilisés selon <strong>les</strong> capacités rétentives primaires de<br />
l’acétabulum : 26 ATLAS 3 impactés (dont 4 vissés) et 22 Cerafit<br />
à vissage d’ancrage Surfix. Les pertes de substance ont été<br />
comblées par <strong>des</strong> granu<strong>les</strong> de céramique phosphocalcique macroporeuse,<br />
seuls ou additionnésd’autogreffe (5 cas) et/ou de moelle<br />
osseuse iliaque (24 cas). L’évaluation fonctionnelle a utilisé <strong>les</strong><br />
scores Harris et PMA modifié. En peropératoire la perte de<br />
substance selon d’Antonio a retrouvé 18 stade II, 27 stade III et<br />
3 stade IV et nous avons tenté de déterminer le pourcentage<br />
d’appui osseux sous la cupule avant reconstruction. Le centre de<br />
rotation prothétique et <strong>les</strong> interfaces avec <strong>les</strong> biomatériaux ont été<br />
régulièrement suivis.<br />
RÉSULTATS. Cette technique apporte à court terme une nette<br />
amélioration fonctionnelle (Harris augmenté de 53,7 à 81,3<br />
points). L’interface os-biomatériaux ne présente aucun liseré et<br />
tend à s’homogénéiser (31 cas). Sept patients (15,2 %) ont <strong>des</strong><br />
liserés millimétriques péri-prothétiques stab<strong>les</strong>. Nous déplorons<br />
9 échecs (19,6 %) avec 4 reprises chirurgica<strong>les</strong> (8,7 %) pour 3<br />
bascu<strong>les</strong> majeures de la cupule et 1 luxation récidivante, et 5<br />
migrations prothétiques asymptomatiques. Les bascu<strong>les</strong> sont toutes<br />
survenues, sauf un cas, lors de reconstructions présentant un<br />
appui osseux acétabulaire inférieur à 50 %, alors qu’une seule<br />
migration a été notée avec moins de 50 % d’appui (p = 0,02).<br />
CONCLUSION. A court terme cette méthode de reconstruction<br />
est techniquement plus facile, moins onéreuse et plus sûre<br />
que l’allogreffe avec <strong>des</strong> résultats fonctionnels similaires. Une<br />
continuité os receveur-biomatériaux existe dans tous <strong>les</strong> cas avec<br />
ces céramiques macroporeuses. Sur le plan mécanique, la cupule<br />
est stable lorsque <strong>les</strong> appuis avec l’os sain sont supérieurs à 50 %.<br />
Dans le cas contraire, d’autres stratégies de reconstruction doivent<br />
être envisagées.<br />
*C. Perrier, Service de Chirurgie Orthopédique,<br />
CHU, 44093 Nantes Cedex 1.
149 Reconstruction acétabulaire par<br />
allogreffe morcelée et anneau de<br />
soutien dans <strong>les</strong> <strong>des</strong>cellements<br />
évolués : à propos d’une série de<br />
135 hanches avec analyse actuarielle<br />
à 14 ans<br />
O. GOSSELIN*, O. ROCHE, F.SIRVEAUX,<br />
J.-L. AUBRION, M.DE GASPERI, D.MOLÉ<br />
INTRODUCTION. Les pertes de stock osseux dans <strong>les</strong> <strong>des</strong>cellements<br />
acétabulaires évolués nécessitent une reconstruction<br />
quelquefois difficile à obtenir. Le but de cette étude rétrospective<br />
était d’estimer <strong>les</strong> résultats, à long terme, <strong>des</strong> reprises par allogreffe<br />
morcelée et anneau de soutien dans cette indication.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. De 1987 à 1995, 135 patients<br />
(135 hanches) ont été pris en charge selon cette technique.<br />
Quatre-vingt quinze dossiers ont pu être exploités (15 patients<br />
perdus de vue et 25 patients décédés). Il s’agissait de 66 femmes<br />
et 29 hommes ; l’âge moyen était de 70 ans à l’intervention<br />
(42-86).<br />
Le score fonctionnel pré-opératoire (PMA) était de 8/18. Les<br />
implants acétabulaires en place étaient cimentés dans 62 % <strong>des</strong><br />
cas et non cimentés dans 38 % <strong>des</strong> cas. Selon <strong>les</strong> critères de la<br />
SOFCOT, 79 % <strong>des</strong> <strong>des</strong>cellements s’accompagnaient de lésions<br />
osseuses de stade 3, 15,8 % de stade 4 et 5,2 % de stade 2.<br />
Dans tous <strong>les</strong> cas, une reconstruction par allogreffe morceléea<br />
été effectuée. L’armature de soutien utilisée était un anneau<br />
d’Eichler dans 56 % <strong>des</strong> cas, de Ganz dans 25 % <strong>des</strong> cas, de<br />
Muller dans 19 % <strong>des</strong> cas.<br />
RÉSULTATS. Le recul moyen était de 8 ans (60-157). 39 %<br />
<strong>des</strong> patients ont présenté <strong>des</strong> complications post-opératoires précoces<br />
dont 1 luxation et 2 hématomes. Le score fonctionnel<br />
moyen à la révision est de 14,8/18 avec 64 % de résultats<br />
considérés comme TB et B. Seule la restauration du centre de<br />
rotation a influencé de façon significative le résultat. A l’analyse<br />
radiographique, 85 % <strong>des</strong> cupu<strong>les</strong> ne présentaient aucun signe de<br />
<strong>des</strong>cellement au recul. Les greffes étaient jugées assimilées ou<br />
inchangées dans 81 % <strong>des</strong> cas, lysées partiellement ou totalement<br />
dans 19 % <strong>des</strong> cas.<br />
L’analyse actuarielle du taux de survie cumulée, en prenant<br />
comme critère d’échec toute reprise chirurgicale et tout <strong>des</strong>cellement<br />
clinique et radiographique, montrait un taux de survie de<br />
87 % à 14 ans.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. L’utilisation d’allogreffes<br />
morcelées parfaitement stabilisées par un anneau de soutien<br />
permet de reconstituer le stock osseux acétabulaire avec <strong>des</strong><br />
résultats cliniques et radiographiques encourageants à long<br />
terme.<br />
*O. Gosselin, Clinique de Traumatologie et d’Orthopédie,<br />
49, rue Hermite, 54000 Nancy.<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 2S89<br />
150 La prothèse « en selle » dans <strong>les</strong><br />
<strong>des</strong>cellements acétabulaires graves<br />
D. HUTEN*, C. JEANROT<br />
Les auteurs rapportent <strong>les</strong> résultats de 7 reprises de <strong>des</strong>cellements<br />
acétabulaires graves par prothèse dite « en selle », pratiquées<br />
chez 6 patients âgés de 67 ans en moyenne (58 à 82 ans).<br />
Il s’agissait au départ de 3 coxites rhumatisma<strong>les</strong>, 3 coxarthroses<br />
dont 1 post-traumatique et 1 coxopathie radique. Une à 3 tentatives<br />
de reconstruction par greffe osseuse et renforcement métallique<br />
avaient échoué auparavant.<br />
Le recours a la prothèse en selle a été motivé dans tous <strong>les</strong> cas<br />
par une perte de substance osseuse massive de l’acétabulum,<br />
compliquée 5 fois de pseudarthrose transversale instable de<br />
l’hémi- bassin. Deux fois, une allogreffe vissée à la partie postérieure<br />
de l’aile iliaque a été nécessaire pour stabiliser la selle.<br />
L’appui a été autorisé immédiatement sauf dans ces 2 cas. La<br />
hanche a été immobilisée 4 fois entre 3 et 6 semaines dans un<br />
bermuda ou en traction dans 4 cas.<br />
Le recul était de 2 à 5 ans.<br />
Une seule complication est survenue à 2 ans : une fracture de<br />
fatigue de l’aile iliaque qui n’a pas consolidé et fait envisager une<br />
ostéosynthèse avec greffe osseuse.<br />
Tous <strong>les</strong> patients ont été soulagés de la majeure partie de leurs<br />
douleurs. Quatre patients se déplacent avec une canne et deux<br />
avec 2 cannes ou un déambulateur, en raison de pathologies<br />
associées ou de la survenue d’une fracture alaire. La flexion est<br />
comprise entre 60 et 95° et l’abduction entre 10 et 30°. Tous <strong>les</strong><br />
patients étaient satisfaits et 2 ont jugé leur résultat très supérieur<br />
à celui de la simple ablation de prothèse qu’ils avaient connu. Les<br />
radiographies ne montrent pas à ce recul d’ascension évidente de<br />
la selle mais il faut craindre la survenue de cette complication<br />
décrite dans la littérature. Une importante migration, ainsi que la<br />
fracture de fatigue de l’aile iliaque insuffisamment résistante<br />
pourraient nécessiter l’ablation de la prothèse.<br />
Cette technique, difficile, procure un meilleur résultat et paraît<br />
donc indiquée chez <strong>des</strong> patients encore assez jeunes pour supporter<br />
l’intervention. Il paraît logique d’y associer un renforcement<br />
par greffe osseuse de l’aile iliaque pour s’opposer aux<br />
fractures de fatigue et à la migration de la selle.<br />
La prothèse « en selle » apparaît comme un ultime recours,<br />
après échec ou en cas d’insuffisance <strong>des</strong> autres techniques de<br />
reprise. La pseudarthrose mobile de l’hémi-bassin est apparue<br />
chez ces patients la principale cause d’échec de ces techniques,<br />
ce qui incite à ne pas laisser évoluer jusqu’à ce stade <strong>des</strong><br />
<strong>des</strong>cellements acétabulaires bien tolérés.<br />
*D. Huten, Service de Chirurgie Orthopédique, Hôpital Bichat,<br />
46, rue Henri-Huchard, 75877 Paris Cedex.
2S90 77 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
151 Incidence de la pathologie rachidienne<br />
dans la survenue <strong>des</strong> luxations<br />
après changement de prothèse<br />
totale de hanche<br />
E. DE THOMASSON*, O. GUINGAND, C.MAZEL<br />
INTRODUCTION. Le taux de luxation après changement de<br />
prothèse totale de hanche (RPTH) varie de 8 à 28 p.100 selon <strong>les</strong><br />
séries. Les causes en sont nombreuses, mais peu de séries se sont<br />
intéressées à l’incidence <strong>des</strong> pathologies lombaires dans la survenue<br />
<strong>des</strong> luxations, post-opératoires.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Nous avons analysé prospectivement<br />
<strong>les</strong> dossiers de 267 patients opérés d’une RPTH à la<br />
recherche de facteurs de risque de luxation postopératoire. L’analyse<br />
statistique a été faite en utilisant le test du Chi 2 ou de<br />
Student. Une valeur de p < 0,05 a été considérée comme significative.<br />
RÉSULTATS. Les dossiers de 37 patienrts opérés d’emblée<br />
avec un cotyle rétentif et chez qui aucune luxation n’est à<br />
déplorer, ont été exclus. Sur <strong>les</strong> 230 patients restants opérés sans<br />
aucun artifice anti-luxation per ou post-opératoire, 31 (13,4<br />
p.100) ont présenté une luxation. Dans 10 cas, la cause était<br />
évidente (malposition, fracture du grand trochanter, paralysie<br />
sciatique...). Concernant <strong>les</strong> 21 patients restants, l’âge et le sexe,<br />
le type de chirurgie (uni ou bipolaire), la voie d’abord, la taille de<br />
la tête prothétique, ainsi que l’importance <strong>des</strong> défects fémoraux<br />
ou acétabulaires n’ont pas influencé le taux de luxation postopératoire.<br />
En revanche, il était significativement augmenté en<br />
cas d’antécédents de luxations itératives (p < 0,001), d’intervention<br />
préalable (p < 0,05) et d’association à une pathologie lombaire<br />
(p < 0,02). Celle-ci était caractérisée par une atteinte soit<br />
radiculaire, soit rachidienne, soit par une association <strong>des</strong> deux.<br />
L’analyse rétrospective <strong>des</strong> dossiers radiologiques de ces patients<br />
a montré que la valeur <strong>des</strong> mesures de l’incidence, de la pente<br />
sacrée ou de la lordose lombaire n’était pas un facteur prédictif de<br />
luxation. En revanche, la projection, par rapport au corps de L3,<br />
de la verticale passant par le centre de rotation <strong>des</strong> hanches était<br />
différente selon que <strong>les</strong> patients s’étaient luxés ou non (p =<br />
0,021).<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. Cette étude confirme le<br />
rôle <strong>des</strong> antécédents de luxation et du nombre d’interventions<br />
préalab<strong>les</strong> dans la survenue de luxation post-opératoire. Elle<br />
objective aussi le rôle <strong>des</strong> pathologies rachidiennes, qui pourrait<br />
intervenir, du fait <strong>des</strong> atteintes radiculaires qui <strong>les</strong> accompagnent,<br />
mais aussi du fait <strong>des</strong> modifications de la statique vertébrale. Une<br />
étude prospective est en cours pour tenter de faire la part entre <strong>les</strong><br />
deux.<br />
*E. de Thomasson, Département d’Orthopédie,<br />
Institut Mutualiste Montsouris, 42, boulevard Jourdan,<br />
75674 Paris Cedex 14.<br />
152 Intérêt d’une stabilisation primaire<br />
de l’implant fémoral dans la technique<br />
d’Exeter<br />
E. DE THOMASSON*, O. GUINGAND,<br />
J.-L. MARMORAT, C.MAZEL<br />
INTRODUCTION. La technique d’Exeter a ouvert de nouvel<strong>les</strong><br />
perspectives dans le traitement <strong>des</strong> pertes de substance fémora<strong>les</strong><br />
rencontrées lors <strong>des</strong> reprises de prothèse de hanche. Toutefois,<br />
la migration précoce de l’implant, considérée comme<br />
bénéfique par <strong>les</strong> promoteurs de la méthode quand elle est<br />
limitée, peut, en l’absence de stabilisation secondaire, aboutir à<br />
une fragilisation du manteau de ciment et à <strong>des</strong> révisions précoces.<br />
Plusieurs publications ont eu pour objet l’étude de l’amélioration<br />
de la stabilité primaire de l’implant en modifiant la technique<br />
d’impaction ou en cherchant la taille idéale <strong>des</strong> greffons à<br />
utiliser. Nous proposons d’assurer la stabilité primaire par un<br />
scellement direct de l’extrémité distale de l’implant à l’os receveur.<br />
Le but de cette étude était d’étudier la reproductibilité de la<br />
méthode et son incidence sur la transformation de l’allogreffe.<br />
MATÉRIEL. Nous avons étudié prospectivement le devenir de<br />
46 patients opérés depuis mars 1996. L’analyse clinique a suivi<br />
<strong>les</strong> critères de Merle d’Aubigné et Postel et celle radiologique,<br />
ceux de Ling et Gie pour l’évolution de l’allogreffe et de la<br />
SOFCOT pour l’appréciation <strong>des</strong> pertes de substance. Nous<br />
avons utilisé <strong>des</strong> allogreffes congelées, morcelées sans se soucier<br />
de la taille <strong>des</strong> greffons. Un implant fémoral de taille standard a<br />
toujours été utilisé.<br />
RÉSULTATS. Le recul moyen était de 3 ans (min : 12 mois,<br />
max : 66 mois). Quatre patients n’ont pu être suivis au delà de 9<br />
mois du fait de complications majeures ayant imposé une reprise<br />
chirurgicale (infection, fracture du fémur, fausse route) ou du<br />
décès du patient (AVC). Pour <strong>les</strong> 42 patients restant <strong>les</strong> pertes de<br />
substance fémorale étaient 6 fois de stade I, 23 fois de stade II, 13<br />
fois de stade III. Le score fonctionnel est passé de 9,13 ± 3,9 à<br />
16,07 ± 2,5 en post-opératoire. Radiologiquement, <strong>des</strong> travées<br />
osseuses sont apparues dans la greffe dans 36 cas, associées dans<br />
10, à une réparation de l’os du patient. Dans 6 cas l’aspect de<br />
l’allogreffe était hétérogène. Trois prothèses ont migré de moins<br />
de 4 mm. A chaque fois un défaut de scellement distal a été noté.<br />
Une prothèse implantée en varus, a aggravé celui-ci puis s’est<br />
stabilisée.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. La technique est fiable,<br />
puisqu’une stabilité primaire de l’implant a été obtenue dans plus<br />
de 90 p.100 <strong>des</strong> cas et s’est confirmé àdistance. Celle-ci n’a, par<br />
ailleurs, pas empêché la réhabitation de l’allogreffe.<br />
*E. de Thomasson, Département d’Orthopédie,<br />
Institut Mutualiste Montsouris, 42, boulevard Jourdan,<br />
75674 Paris Cedex 14.
153 Volet fémoral et <strong>des</strong>cellement<br />
fémoral<br />
F. DELANGLE*, F.-X. VERDOT, E.CHALENCON,<br />
L. BÉGUIN, M.-H. FESSY<br />
INTRODUCTION. Nous rapportons une série prospective de<br />
70 explantations de pivot fémoral par voie transfémorale liées à<br />
<strong>des</strong> <strong>des</strong>cellements septiques et aseptiques.<br />
MATÉRIEL, MÉTHODE. Dans 61 cas, le <strong>des</strong>cellement était<br />
aseptique et dans 9 cas septique. Tous <strong>les</strong> patients ont bénéficié<br />
pour l’explantation de leur matériel, d’une voie postero-latérale<br />
élargie et d’un volet fémoral de Wagner, la reconstruction fémorale<br />
était assurée par <strong>des</strong> tiges sans ciment verrouillées (65 cas)<br />
ou <strong>des</strong> tiges longues sans ciment (1 cas) ; 4 patients n’ont pas été<br />
réimplantés. Aucune greffe osseuse n’a été réalisée sur le fémur.<br />
Le recul moyen de la série est de 3 ans ½. L’évaluation<br />
clinique a été faite selon le score PMA. L’étude radiologique a<br />
apprécié la consolidation du volet ainsi que la repousse osseuse<br />
autour de l’implant, par mesure de l’index cortical.<br />
RÉSULTATS. Nous avons démontré un gain significatif du<br />
score PMA supérieur à 9. Nous avons déploré fractures du volet<br />
per-opératoire, 2 épiso<strong>des</strong> de luxation précoce. Tous <strong>les</strong> volets<br />
ont consolidé, nous avons 3 échecs d’ostéointégration avec rupture<br />
<strong>des</strong> vis de verrouillage et 2 fractures de grand trochanter à<br />
distance. La repousse osseuse est supérieure à 10 % en moyenne<br />
à 1 an, en terme d’index cortical.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. Nous avons discuté le<br />
contrat imposé par cette technique chirurgicale face aux autres<br />
solutions dans la chirurgie de reprise fémorale : duréeopératoire,<br />
pertes sanguines, choix <strong>des</strong> implants et reprise d’appui différée.<br />
Nous verrons aussi qu’elle permet une explantation plus facile<br />
du matériel, un nettoyage plus efficace du fût fémoral dans la<br />
chirurgie septique et la diminution <strong>des</strong> incidents per-opératoires<br />
(fausses-routes, fractures fémora<strong>les</strong>).<br />
Nous avons démontré qu’il est possible de reconstruire le<br />
fémur sans greffe grâce à la stimulation de l’ostéogenèse par le<br />
volet.<br />
Le verrouillage assurait la stabilité primaire dans 100 % <strong>des</strong><br />
cas et la stabilité secondaire était obtenu dans plus de 90 % <strong>des</strong><br />
cas grâce à la qualité de l’os néo-formé.<br />
*F. Delangle, Centre d’Orthopédie et Traumatologie,<br />
Pavillon 1-3 COT, Hôpital Bellevue, CHU de Saint-Etienne,<br />
42055 Saint-Etienne Cedex 2.<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 2S91<br />
154 Reprises <strong>des</strong> échecs fémoraux <strong>des</strong><br />
PTH par tige fémorale non cimentée<br />
revêtue d’hydroxyapatite et à<br />
verrouillage distal : à propos de 20<br />
cas<br />
A. BEN LASSOUED*, G. ASENCIO, R.BERTIN,<br />
B. MEGY, P.KOUYOUMDJIAN, S.HACINI<br />
Le but de ce travail était d’évaluer, à partir d’une série continue,<br />
<strong>les</strong> résultats et la qualité de la reconstruction osseuse au<br />
contact d’une tige fémorale de reprise longue, revêtue<br />
d’hydroxyapatite et munie d’un verrouillage distal.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Il comportait 20 cas de reprise<br />
de PTH pour <strong>des</strong>cellement aseptique (DA = 15 cas) et septique<br />
(DS = 5 cas) par prothèse AURA. L’âge moyen était de 70,5<br />
années. Le délai moyen entre la précédente tige et la reprise<br />
actuelle était de 11 ans pour <strong>les</strong> DA et le 2,6 années pour <strong>les</strong> DS.<br />
Les lésions osseuses fémora<strong>les</strong> selon la classification SOFCOT<br />
étaient stade I dans 5 cas, stade II dans 4 cas, stade III dans 4 cas<br />
et stade IV dans 1 cas. L’abord a comporté une voie transfémorale<br />
avec volet dans 14 cas et une voie endo-fémorale dans<br />
6 cas. Les DS ont été repris en deux temps dans 4 cas et en un<br />
temps dans 1 cas.<br />
La tige utilisée était une AURA de reconstruction dans 15 cas<br />
et de révision dans 5 cas. Une greffe osseuse spongieuse complémentaire<br />
a été utilisée uniquement dans <strong>les</strong> 6 cas comportant<br />
un abord endo-fémoral.<br />
RÉSULTATS. Deux patients sont décédés. Tous <strong>les</strong> autres ont<br />
été revus avec un délai moyen de 26 mois et <strong>des</strong> extrêmesde12<br />
à 46 mois pour un bilan clinique radiographique (et un scanner<br />
complémentaire pour <strong>les</strong> 5 patients à plus de 3 ans de recul).<br />
Nous avons déploré trois luxations au 15 e jour sans récidive et un<br />
sepsis au 3 e mois guérit après lavage et antibiothérapie adaptée.<br />
Tous <strong>les</strong> volets fémoraux ont consolidéàpartir de la 10 e semaine.<br />
Le score PMA est passé de 9,1 à 15,66 et le score Harris de 43,5<br />
à 85,5.<br />
Au plus long recul, toutes <strong>les</strong> lésions fémora<strong>les</strong> sont passées à<br />
<strong>des</strong> classes SOFCOT inférieures. Il existait sur <strong>les</strong> radiographies<br />
et le scanner au dernier recul un contact étroit entre la tige AURA<br />
et le fémur avec une augmentation <strong>des</strong> index corticaux mesurées<br />
à 1et8cmdel’éperon métaphysaire de la tige. Ces index étaient<br />
stabilisés à partir du 12 e mois post-opératoire. Aucun patient n’a<br />
eu de déverrouillage secondaire ou de changement par une tige<br />
courte.<br />
DISCUSSION. La reprise d’un échec fémoral avec <strong>des</strong>truction<br />
osseuse, par implant fémoral non cimenté revêtu d’hydroxyapatite,<br />
permet d’obtenir : d’une part une stabilité prothétique mécanique<br />
immédiate, d’autre part une reconstruction osseuse intime<br />
dans la région métaphyso-diaphysaire. Cette reconstruction est<br />
réelle même en l’absence de greffe et semble être favorisée par la<br />
fémorotomie. Les différences entre <strong>les</strong> index corticaux postopératoire<br />
et finaux confirment ce remodelage et reconstruction<br />
osseuse autour de l’hydroxyapatite stimulée essentiellement par<br />
une consolidation rapide <strong>des</strong> volets et une revascularisation<br />
globale du fémur. L’implantation de cette tige ne revêt pas de<br />
difficulté particulière et permet même d’alléger le geste opéra-
2S92 77 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
toire. L’intérêt delafémorotomie est certain, particulièrement<br />
dans <strong>les</strong> reprises septiques et <strong>les</strong> extractions diffici<strong>les</strong> de prothèses.<br />
*A. Ben Lassoued, Service d’Orthopédie, CHU de Nîmes,<br />
5, rue Hoche, 30029 Nîmes Cedex 4.<br />
155 Reconstruction fémorale par céramique<br />
de phosphate de calcium<br />
macroporeuse au cours <strong>des</strong> reprises<br />
de prothèse de hanche<br />
C. NICH*, P. BIZOT, P.DEKEUWER, L.SEDEL<br />
INTRODUCTION. Le comblement <strong>des</strong> pertes de substance<br />
osseuse au cours <strong>des</strong> reprises d’arthroplastie de hanche pose<br />
encore aujourd’hui de nombreux problèmes concernant autant la<br />
technique que le type de substitut osseux. Le but de cette étude<br />
était de rapporter <strong>les</strong> résultats cliniques et radiologiques d’une<br />
série de reconstructions fémora<strong>les</strong> par céramique phosphocalcique<br />
impactée.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. La technique utilisée est dérivée<br />
de celle <strong>des</strong> greffons impactés morcelés popularisée par Gie et<br />
Ling. Des granu<strong>les</strong> de phosphate de calcium biphasique macroporeux<br />
(PCBM) sont impactés dans le fûtfémoral jusqu’à obtenir<br />
un fourreau stable dans lequel est cimentée la tige (Ceraver<br />
Ostéal). De mars 1996 à octobre 2000, 18 patients (20 hanches)<br />
ont été opérés selon cette technique, pour <strong>des</strong>cellement fémoral<br />
dans 11 cas, dont 8 septiques, ostéolyse fémorale (1 cas), douleur<br />
(1 cas), et instabilité (1 cas). L’âge moyen à la reprise était de 66<br />
ans (30-79). La majorité <strong>des</strong> pertes de substance osseuse fémora<strong>les</strong><br />
étaient de type I ou II selon la classification SOFCOT, 2 cas<br />
était classés type IV. Les granu<strong>les</strong> de PCBM ont été utilisés seuls<br />
13 fois, mélangés à de l’allogreffe 5 fois et à de l’autogreffe 2<br />
fois.<br />
RÉSULTATS. Le recul moyen de la serie était de 31 mois<br />
(8-70). Aucun patient n’a été perdu de vue. Deux fractures<br />
diaphysaires fémora<strong>les</strong> per-opératoires ont consolidé sans<br />
séquelle. Deux patients ont nécessité une reprise itérative pour<br />
<strong>des</strong>cellement, dont un septique, à 20 et 16 mois de recul. A la<br />
révision, le score PMA moyen était significativement augmentéà<br />
16 (12-18) (p < 0,05) et 67 % avaient un bon ou excellent résultat<br />
clinique. Radiologiquement, on notait dans 14 cas une bonne<br />
ostéointégration <strong>des</strong> granu<strong>les</strong> de PCBM, sans migration <strong>des</strong><br />
implants. Un enfoncement moyen de 3 mm (2-5) était rapporté<br />
dans 3 cas, et dans 1 cas, un liseré incomplet non évolutif était<br />
apparu, sans conséquence clinique.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. Face au problème <strong>des</strong><br />
pertes de substance osseuse au cours <strong>des</strong> reprises de prothèse de<br />
hanche, l’utilisation <strong>des</strong> céramiques phosphocalciques peut constituer<br />
une alternative attractive, en limitant <strong>les</strong> inconvénients liés<br />
aux greffons et en améliorant en théorie la stabilité primaire <strong>des</strong><br />
implants. La technique originale présentée dans ce travail a<br />
permis d’obtenir <strong>des</strong> résultats encourageants à court terme, sous<br />
réserve de la proposer à <strong>des</strong> patients jeunes dont le fémur est<br />
continent.<br />
*C. Nich, Service de Chirurgie Orthopédique,<br />
Hôpital Lariboisière, 2, rue Ambroise-Paré,<br />
75475 Paris Cedex 10.<br />
156 Modalités de reprise <strong>des</strong> prothèses<br />
tota<strong>les</strong> de hanche à frottement<br />
alumine-alumine : résultats au recul<br />
moyen de 6 ans<br />
D. HANNOUCHE*, R. NIZARD, A.MEUNIER,<br />
P. BIZOT, L.SEDEL<br />
INTRODUCTION. Dans <strong>les</strong> reprises de prothèses aluminealumine,<br />
la réimplantation d’une tête en céramique suri une tige<br />
laissée en place exposerait à un risque accru de rupture de tête.<br />
De plus, <strong>des</strong> déformations graves de tête métal ont été rapportées<br />
après échec de prothèses à frottement céramique-céramique. Le<br />
but de cette étude rétrospective était donc d’évaluer l’incidence<br />
de ces complications et d’analyser <strong>les</strong> résultats cliniques et<br />
radiographiquies <strong>des</strong> reprises de prothèses tota<strong>les</strong> de hanche<br />
alumine/alumine.<br />
MÉTHODES. Une série continue de patients opérés entre<br />
1976 et 1997 a été analysée. Elle comportait 118 arthroplasties de<br />
reprise réalisées chez 107 patients (74 femmes et 33 hommes),<br />
d’âge moyen 65 ans (32-91 ans). La cause majoritaire était le<br />
<strong>des</strong>cellement aseptique isolé de la cupule dans 80 % <strong>des</strong> cas, une<br />
fracture d’implant céramique était notée dans 4 %. Les cupu<strong>les</strong><br />
étaient : 72 alumine scellés, 38 vissés, 6 impactés avec metalback,<br />
et 2 impactés en alumine massive. L’ostéolyse acétabulaire<br />
était de type cavitaire dans 67 % <strong>des</strong> cas. La cupule a été<br />
remplacée seule 94 fois (80 %). La cupule implantée était en<br />
polyéthylène dans 93 cas et en alumine dans 25 cas. Lorsque la<br />
tige fémorale était laissée en place une nouvelle tête en céramique<br />
a été implantée 49 fois (39 alumine, 10 zircone). La tête<br />
alumine a été remplacée par une tête métal 18 fois.<br />
RÉSULTATS. Quatre luxations précoces, 2 infections ont<br />
compliqué <strong>les</strong> suites immédiates. Le recul moyen après reprise<br />
était de 67 mois, 14 patients ont été perdus de vue. Seize patients<br />
ont du être réopérés, 10 d’entre eux pour un <strong>des</strong>cellement itératif<br />
de la cupule. Parmi <strong>les</strong> 49 têtes en céramique implantées sur une<br />
tige laissée en place, aucune fracture n’a été observée au recul<br />
moyen de 61 mois. Aucune reprise n’a été nécessaire pour usure<br />
de la cupule en polyéthylène, ou de la tête en métal. Au total, 72<br />
hanches ont pu être évaluées avec un recul minimum de 2 ans. Le<br />
score fonctionnel au dernier examen était de 15,2 ± 3,5. Le taux<br />
de survie actuarielle à 7 ans était de 95,5 %, l’échec étant défini<br />
comme la reprise pour <strong>des</strong>cellement aseptique.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. L’analyse <strong>des</strong> résultats<br />
montre que le <strong>des</strong>cellement acétabulaire est la cause principale de<br />
reprise <strong>des</strong> PTH alumine/alumine. La pièce fémorale n’était<br />
<strong>des</strong>cellée que dans 9 cas, et a pu être préservée dans 80 % <strong>des</strong> cas.<br />
Le remplacement du couple alumine/alumine par un couple
métal/polyéthylène n’apparaît pas dans cette étude comme une<br />
contre-indication.<br />
*D. Hannouche, Service de Chirurgie Orthopédique,<br />
Hôpital Lariboisière, 2, rue Ambroise-Paré,<br />
75475 Paris Cedex 10.<br />
157 Dosages sanguins de métaux chez<br />
48 patients porteurs d’une prothèse<br />
totale de hanche en chrome-cobalt<br />
à couple de frottement métalpolyéthylène<br />
F. DAMIE*, L. FAVARD<br />
Les complications à long terme <strong>des</strong> arthroplasties tota<strong>les</strong> de<br />
hanche sont dominées par l’usure <strong>des</strong> composants prothétiques et<br />
la dissémination de particu<strong>les</strong> dans l’organisme, notamment pour<br />
le couple de friction métal-métal. Dans le but de rechercher si une<br />
telle libération existait pour le couple métal-polyéthylène, notre<br />
travail a consistéàanalyser <strong>les</strong> taux sanguins de Chrome (Cr), de<br />
Cobalt (Co), de Nickel (Ni), et de Molybdène (Mo) chez <strong>des</strong><br />
patients porteurs d’une prothèse totale de hanche (PTH) en<br />
159 Définition de la courbe d’apprentissage<br />
de la chirurgie thoracoscopique<br />
vidéo-assistée : 70 cas consécutifs<br />
A. CRAWFORD*<br />
INTRODUCTION. L’objectif de cette étude était d’analyser la<br />
courbe d’apprentissage de la chirurgie thoracoscopique vidéoassistée<br />
au cours d’une série de soixante-dix interventions consécutives<br />
pour décompression et fusion intervertébrale consolidée<br />
par greffons costaux.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Il s’agit d’une série de<br />
soixante-dix patients ayant un suivi d’au moins deux ans. L’indication<br />
de la chirurgie thoracoscopique vidéo-assistée était une<br />
scoliose idiopathique (n = 32), une déformation rachidienne<br />
neuromusculaire (n = 13), une neurofibromatose (n = 1), une<br />
scoliose secondaire à une maladie de Marfan (n = 1), une scoliose<br />
post-radique (n = 1) et une intervention sur pseudarthrose (n = 1).<br />
La première côte était réséquée chez trois patients en raison d’un<br />
syndrome compressif. La résection d’un neurofibrome intrathoracique<br />
et d’une tumeur costale bénigne était réalisée chez deux<br />
patients. Une fusion antérieure après fracture-luxation du rachis<br />
dorsal était nécessaire chez un patient.<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 2S93<br />
Séance du 14 novembre après-midi<br />
RACHIS/TUMEURS<br />
Chrome-Cobalt à couple métal-polyéthylène. L’objectif était<br />
double : comparer ces taux à ceux d’une population témoin et<br />
étudier <strong>les</strong> variations de ces taux en fonction <strong>des</strong> signes cliniques<br />
et radiologiques classiquement recherchés dans le suivi <strong>des</strong> PTH.<br />
Pendant une période de 30 mois, 53 patients souffrant de<br />
coxarthrose ont eu la même PTH de type PVLt. Quarante-huit<br />
ont pu être évalués avec un recul minimum de 32 mois. Un<br />
examen clinique et radiologique de la hanche opérée était complété<br />
par un dosage <strong>des</strong> métaux par spectrométrie de masse sur<br />
sang total. Le groupe témoin était constitué de 56 patients en<br />
attente d’une PTH.<br />
Avec un recul moyen de 44 mois, 17 % <strong>des</strong> patients avaient un<br />
score fonctionnel de la hanche passable voire médiocre, et 37 %<br />
avaient un signe radiologique évocateur de <strong>des</strong>cellement prothétique<br />
fémoral. Il existait une augmentation significative de la<br />
Cobaltémie par rapport au groupe témoin, et cette augmentation<br />
se majorait en présence de signes radiologiques de <strong>des</strong>cellement.<br />
Le couple métal-métal ne semble donc pas le seul couple à<br />
augmenter le taux sérique <strong>des</strong> métaux, dont l’analyse pourrait<br />
devenir un examen diagnostique dans le suivi <strong>des</strong> prothèses de<br />
hanche.<br />
*F. Damie, Service de Chirurgie Orthopédique,<br />
Hôpital Trousseau, CHU de Tours, 37044 Tours Cedex 1.<br />
RÉSULTATS. Le temps opératoire moyen de la décompression<br />
antérieure par thoracoscopie avec discectomie et fusion était<br />
de 256 minutes (extrêmes 150-405 minutes). En moyenne, huit<br />
disques étaient réséqués (extrêmes 4-11). La comparaison du<br />
temps opératoire moyen par disque entre <strong>les</strong> premières (n = 31) et<br />
<strong>les</strong> dernières (n = 32) interventions ne montrait pas de différence<br />
significative. La perte sanguine moyenne au cours de la décompression<br />
antérieure par thoracoscopie avec discectomie et fusion<br />
était de 285 ml (extrêmes 50 -1300 ml).<br />
CONCLUSION. La correction postopératoire définitive était<br />
respectivement de 68 et de 90 % pour la scoliose et la cyphose.<br />
Une complication en rapport avec la thoracoscopie était constatée<br />
chez trois patients. La chirurgie thoracoscopique vidéo-assistée<br />
est une alternative intéressante à la thoracotomie conventionnelle,<br />
permettant le traitement efficace en toute sécurité <strong>des</strong><br />
déformations rachidiennes infanti<strong>les</strong>, malgré une longue courbe<br />
d’apprentissage.<br />
*A. Crawford, Pediatric Orthopaedics Children’s Hospital<br />
Medical Center, 3333 Burnet Avenue,<br />
C-3610 Cincinnati, Etats-Unis.
2S94 77 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
160 Evolution à long terme de la fusion<br />
intersomatique obtenue par mini<br />
abord antérieur du rachis lombaire<br />
J.-Y. LAZENNEC*, R. DEL VECCHIO,<br />
M. AMELTCHENTKO, N.ARAFATI, G.SAILLANT<br />
INTRODUCTION. Ce travail analyse l’évolution radiologique<br />
de greffes intersomatiques réalisées par mini-abord antérieur<br />
extrapéritonéal.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. De Janvier 1996 à Décembre<br />
2001, nous avons opéré 198 patients. 21 patients ont été exclus (2<br />
décès, 3 tumeurs, 16 suivis inférieurs à 12 mois). Pour <strong>les</strong> 177 cas<br />
étudiésd’âge moyen 53 ans (22 à 78 ans), le recul moyen était de<br />
2,7 ans.<br />
Les 55 atteintes post-traumatiques concernaient la charnière<br />
thoraco-lombaire essentiellement. Les 122 rachis lombaires<br />
dégénératifs regroupaient 14 scolioses, 26 spondylolisthésis, 72<br />
déstabilisations opérées par voie postérieure première et 10<br />
lésions disca<strong>les</strong> dégénératives isolées.<br />
Seuls 8 patients n’ont pas eu de fixation postérieure. La<br />
fusion (globalement 360 niveaux) a concerné un disque 89 fois,<br />
deux disques 71 fois, 3 disques et plus 17 fois. Les autogreffes<br />
spongieuses ont été associées à <strong>des</strong> cages. Des greffons tricorticaux<br />
ont été implantés dans <strong>les</strong> corporectomies (23 cas).<br />
La fusion radiologique a été affirmée sur l’absence de chambre<br />
de mobilité autour <strong>des</strong> vis pédiculaires, <strong>des</strong> cages ou <strong>des</strong><br />
greffons tricorticaux et sur la recherche <strong>des</strong> pertes angulaires<br />
sagitta<strong>les</strong>. (radiographies et coupes scanner numérisées – Auto-<br />
Cad L.T.2000).<br />
RÉSULTATS. 1) Etat post opératoire immédiat :<br />
− cas post-traumatiques (65 niveaux fusionnés – 55 patients) :<br />
28 fois il s’agissait d’un calage simple. Dans <strong>les</strong> autres cas, le<br />
gain moyen de correction a été de 4° par étage,<br />
− pathologie dégrénérative (295 niveaux fusionnés – 122<br />
patients) : 143 fois il s’agissait d’un calage simple. Dans <strong>les</strong><br />
autres cas le gain moyen de correction a été de 5° par étage.<br />
2) Pertes angulaires<br />
Pour <strong>les</strong> cas de traumatologie, la perte angulaire moyenne était<br />
de 3,9° dans 36 cas (29 greffes sur un seul niveau). 2 expulsions<br />
partiel<strong>les</strong> de greffons tricorticaux sur <strong>des</strong> patients ostéoporotiques<br />
n’ont pas été repris. La perte angulaire moyenne rapportée<br />
aux 65 niveaux greffés était de 2°.<br />
Pour <strong>les</strong> cas de pathologie dégénérative, la perte angulaire était<br />
de 3,7° en moyenne, sur 172 niveaux fusionnés (112 patients).<br />
L’expulsion d’une cage sur un spondylolisthésis de grade 3 n’a<br />
pas justifié de reprise. Deux impactions de cage n’ont pas provoqué<br />
de perte angulaire significative.<br />
3) Etat anatomique <strong>des</strong> greffes :<br />
Tous <strong>les</strong> niveaux ont fusionné sans rupture de cage ou de<br />
greffon tricortical. 5 fois, nous avons observé 1 liseré partiel et<br />
stable autour d’une cage.<br />
DISCUSSION. Les taux de fusion rapportés avec la technique<br />
de l’A.L.I.F (anterior lumbar interbody fusion) varient de 55à<br />
100 % dans la littérature. Cette technique pour <strong>les</strong> cas traumati-<br />
ques est originale ; elle permet d’éviter <strong>des</strong> montages postérieurs<br />
extensifs et/ou <strong>les</strong> abords antérieurs classiques délabrants. En<br />
pathologie dégénérative, la qualité osseuse médiocre et la fréquence<br />
<strong>des</strong> ALIF étages n’ont pas posé de problème.<br />
CONCLUSION. Cette technique d’A.L.I.F permet de renforcer<br />
<strong>les</strong> fixations postérieures avec une réelle efficacité sur la<br />
fusion.<br />
*J.-Y. Lazennec, Service de Chirurgie Orthopédique,<br />
Hôpital Pitié-Salpêtrière, 47-83, boulevard de l’Hôpital,<br />
75651 Paris Cedex 13.<br />
161 Intérêt <strong>des</strong> greffes intersomatiques<br />
par voie antérieure mini invasive<br />
dans <strong>les</strong> reprises pour infections itératives<br />
du rachis lombaire instrumenté<br />
par voie postérieure<br />
J.-Y. LAZENNEC*, E. FOURNIOLS, G.SAILLANT<br />
INTRODUCTION. L’infection sur un montage postérieur peut<br />
entraîner une impasse thérapeutique, en particulier dans <strong>les</strong> fixations<br />
étendues sur rachis déminéralisé.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. De 1998 à 2001, 7 patients de<br />
19 à 76 ans (moyenne 58 ans) ont été greffés par cage intersomatique<br />
PEEK et greffe autogène.<br />
Quatre cas de scoliose avaient été opérés en moyenne 5 fois<br />
par voie postérieure (3 à 9 fois) ; tous étaient pseudarthrosés avec<br />
<strong>des</strong> fistulisations itératives à chaque temps antérieur préalable, 4<br />
fois le germe était un staphylocoque méticilline résistant 1 fois<br />
associé initialement avec un streptocoque et 2 fois associé àun<br />
entérocoque. 3 patients présentaient <strong>des</strong> douleurs radiculaires<br />
sévères.<br />
Trois cas post traumatiques avaient été repris pour ablation<br />
simple du matériel postérieur. Tous étaient pseudarthrosés avec 2<br />
fois une perte totale de la correction initiale ; dans un cas la<br />
déstabilisation septique concernait l’étage supérieur au montage.<br />
Le germe était chaque fois un staphylocoque méticilline résistant<br />
avec 1 fois avec un entérocoque associé.<br />
Deux fistu<strong>les</strong> postérieures invétérées ont été préalablement<br />
réopérées. Les greffes ont porté sur 1 à 4 niveaux sans nouvelle<br />
fixation postérieure sauf dans un cas (2 abords de la charnière<br />
thoracolombaire, 5 fusions lombosacrées, immobilisation par<br />
corset 3 points pour 4 à 6 mois). La durée moyenne de l’antibiothérapie<br />
postopératoire a été de 4 mois (entre 3 et 12 mois).<br />
La fusion a été affirmée sur l’aspect <strong>des</strong> greffes au scanner avec<br />
un recul moyen de 22 mois (minimum 12 mois).<br />
RÉSULTATS. Aucune infection antérieure n’a été observée<br />
sauf dans un cas post traumatique où une vis postérieure était<br />
intradiscale (réactivation de l’infection sans abcès antérieur,<br />
reprise par voie postérieure pure et finalement fusion en<br />
cyphose). Aucun gain de correction appréciable n’a été obtenu,<br />
mais <strong>les</strong> 6 autre cas ont consolidé avec une nette amélioration<br />
clinique (sevrage du corset rigide, réduction <strong>des</strong> antalgiques,<br />
délai moyen 6 mois).
Les 3 cas de douleur radiculaire ont été améliorés.<br />
Une patiente déjà opérée 3 fois par voie antérieure et reprise<br />
par mini abord gauche sans problème per opératoire, a présenté<br />
secondairement une nécrose urétérale (néphrectomie secondaire).<br />
CONCLUSION. Cette stratégie de greffe intersomatique constitue<br />
une solution de sauvetage dans <strong>les</strong> échecs mécaniques <strong>des</strong><br />
infections sévères récidivantes et souvent polymicrobiennes.<br />
Sur ces déformations complexes et ces mala<strong>des</strong> souvent âgés,<br />
cette technique est plus difficile. Des prélèvements discaux positifs<br />
sont un facteur de moins bon pronostic. En cas de reprise<br />
d’une voie antérieure préalable, la pose d’une sonde urétérale est<br />
conseillée pour prévenir <strong>les</strong> conséquences d’une nécrose toujours<br />
possible. L’utilisation de cages intersomatiques n’a pas posé de<br />
problème et nous a assuré une stabilité primitive et secondaire<br />
précieuse chez ces patients au capital osseux médiocre sans<br />
générer de problème infectieux supplémentaire.<br />
*J.-Y. Lazennec, Service de Chirurgie Orthopédique,<br />
Hôpital Pitié-Salpêtrière, 47-83, boulevard de l’Hôpital,<br />
75651 Paris Cedex 13.<br />
162 Traitement de la hernie discale lombaire<br />
extra-foraminale par abord<br />
chirurgical extra-foraminal : à propos<br />
d’une série de 14 cas<br />
P. GARÇON*<br />
INTRODUCTION. L’objectif de cette étude est d’apprécier<br />
l’efficacité et l’inocuité d’une technique de traitement de la<br />
hernie discale lombaire en situation extra-foraminale, par abord<br />
extra-foraminal microchirurgical.<br />
MATÉRIEL. Quatorze patients ont bénéficié de cette technique.<br />
Cet abord, qui autorise une libération radiculaire en dehors<br />
du foramen avec conservation et respect de l’isthme vertébral, est<br />
décrit dans le détail, sans en omettre <strong>les</strong> astuces techniques. Les<br />
suites opératoires sont précisées.<br />
MÉTHODES. Tous <strong>les</strong> patients ont été revus cliniquement et<br />
radiologiquement, avec un recul minimum de 1 an. Le score de<br />
PROLO a permis d’évaluer <strong>les</strong> résultats.<br />
RÉSULTATS. Sur <strong>les</strong> 14 patients opérés, on dénombre 13 bons<br />
ou excellents résultats et 1 moyen. Aucun déficit neurologique<br />
post-opératoire n’a été constaté.<br />
Le faible nombre de cas traités n’autorise pas d’étude statistique<br />
mais s’explique par la rareté de cette forme clinique.<br />
CONCLUSION. L’abord extra-foraminal représente une alternative<br />
à la résection isthmique nécessairement suivie de fixation<br />
vertébrale, dans le traitement <strong>des</strong> conflits disco-radiculaire en<br />
position extraforaminale. Ce n’est pas une technique dangereuse,<br />
pour peu que l’on respecte <strong>des</strong> règ<strong>les</strong> précises dans la réalisation<br />
du geste opératoire.<br />
*P. Garçon, Clinique de l’Appareil Locomoteur et du Sport,<br />
36, boulevard Saint-Marcel, 75005 Paris.<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 2S95<br />
163 Excision extra-tumorale <strong>des</strong><br />
tumeurs thoraciques et cervicothoraciques<br />
envahissant le rachis :<br />
série de 36 cas<br />
C. MAZEL*, D. GRUNENWALD<br />
OBJECTIF. Les tumeurs originaires de l’apex pulmonaire ou<br />
du médiastin postérieur peuvent être retirées en monobloc associant<br />
une vertébrectomie totale ou partielle en cas d’envahissement<br />
de ces structures. La chirurgie extra-tumorale est une<br />
chirurgie parfaitement reconnue comme efficace sur le plan<br />
carcinologique. Raymond Roy-Camille et Bertill Steiner ont<br />
décrit <strong>les</strong> résections rachidiennes en bloc d’une vertèbre thoracique<br />
au travers d’un simple abord postérieur. Paulson, de son côté<br />
adécrit <strong>les</strong> résections <strong>des</strong> tumeurs de l’apex pulmonaire (pancoast<br />
Tobias) par un abord cervico-thoracique. Les auteurs ont<br />
associé <strong>les</strong> deux techniques chirurgica<strong>les</strong> pour permettre la résection<br />
monobloc <strong>des</strong> tumeurs médiastina<strong>les</strong> postérieures ou de<br />
l’apex pulmonaire avec envahissement vertébral.<br />
MÉTHODE. Les auteurs recommandent une technique chirurgicale<br />
qui est différente au niveau cervico-thoracique et à l’étage<br />
thoracique moyen. Au niveau cervico-thoracique, l’abord antérieur<br />
est fait avec une simple dislocation de l’articulation sternoclaviculaire<br />
sans résection de la clavicule. Les vaisseaux sousclaviers<br />
et le plexus brachial sont disséqués et exposés. La<br />
tumeur est ensuite disséquée de ses attaches périphériques et<br />
notamment œsophagiennes. La tumeur n’est pas détachée du<br />
rachis auquel elle adhère intimement. A l’étage thoracique, une<br />
simple thoracotomie est pratiquée. Le geste chirurgical de dissection<br />
de la tumeur par rapport aux parties mol<strong>les</strong> adjacentes est<br />
pratiquée delamême façon. En cas de tumeur médiastinale<br />
postérieure, le temps antérieur est relayé par un temps postérieur.<br />
En cas de tumeur pulmonaire primitive, la lobectomie ou segmentectomie<br />
voire pneumonectomie est réalisée au cours de ce<br />
temps antérieur. Lors du temps postérieur, en fonction du niveau<br />
de l’envahissement vertébral, il est pratiqué une vertébrectomie<br />
totale ou partielle.<br />
RÉSULTATS. Trente-six cas ont été opérés selon cette technique.<br />
La vertébrectomie a été complète dans 7 cas, partielle dans<br />
29. Le recul varie de 6 jours à 7,2 ans avec une moyenne de 23,3<br />
mois. Un patient est mort à un an post opératoire d’une cause sans<br />
rapport avec sa tumeur initiale. Seulement 35 patients sont<br />
disponib<strong>les</strong> pour évaluation quant au recul et à la survie. 21<br />
patients (60 %) sont morts avec une survie moyenne de 16,7 mois<br />
(8 à 44 mois). Les 14 autres (40 %) sont vivants avec une<br />
moyenne de 38,3 mois allant de 8 à 87 mois.<br />
CONCLUSION. Il existe une importante courbe d’apprentissage<br />
dans ce type de chirurgie, une évaluation extrêmement fine<br />
du niveau d’extension tumorale est toujours nécessaire avant<br />
décision. Les résultats aujourd’hui confirment la faisabilité et<br />
surtout l’intérêt de ces résections larges, avec <strong>des</strong> survies pour<br />
certains patients qui sont au-delà de 5 ans.<br />
*C. Mazel, Département d’Orthopédie, Institut Mutualiste<br />
Montsouris, 42, boulevard Jourdan, 75674 Paris Cedex 14.
2S96 77 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
164 Fixation cervico-thoracique postérieure<br />
dans <strong>les</strong> tumeurs du rachis<br />
C. MAZEL*, J.-L. MARMORAT, J.WILLIAM,<br />
P. ANTONIETTI, R.TERRACHER, O.GUINGAND,<br />
E. DE THOMASSON<br />
INTRODUCTION. Nous avons analysé rétrospectivement 32<br />
patients qui ont bénéficié d’une fixation postérieure cervicothoracique<br />
pour tumeur. Nous avons évalué la stabilité rachidienne,<br />
son alignement et <strong>les</strong> complications associées.<br />
OBJECTIF. Le but de cette étude est d’évaluer et d’analyser<br />
<strong>les</strong> complications liées aux fixations cervico-thoraciques avec vis<br />
articulaires cervica<strong>les</strong> et vis pédiculaires thoraciques dans le<br />
cadre de la fixation <strong>des</strong> tumeurs cervico-thoraciques. Peu de<br />
données, dans la littérature, sont disponib<strong>les</strong> quant à la fixation de<br />
la charnière cervico-thoracique ce qui fait l’intérêt de ce travail.<br />
Les caractéristiques anatomiques de cette région étant bien spécifiques<br />
de par l’hypermobilité cervicale opposée à la rigidité<br />
thoracique haute.<br />
MÉTHODE. Trente-deux patients ont été opérés : 27 hommes,<br />
5 femmes. L’âge varie de 17 à 72 ans avec une moyenne à 52 ans.<br />
96 vis articulaires ont été implantées de C4 à C6, 54 vis dans C7<br />
et 180 dans <strong>les</strong> pédicu<strong>les</strong> thoraciques de T1 à T8. 19 patients<br />
avaient un cancer primitif du poumon avec envahissement vertébral.<br />
11 avaient une métastase rachidienne, 1 un chondrosarcomeet1unmyélome.<br />
Dans un premier groupe de 19 patients,<br />
une résection en bloc de la tumeur a été pratiquée retirant la<br />
vertèbre et la lésion tumorale : 4 vertébrectomies tota<strong>les</strong> ont été<br />
réalisées, 15 vertébrectomies partiel<strong>les</strong>. Un deuxième groupe de<br />
13 patients a seulement bénéficié d’une fixation postérieure<br />
palliative avec décompression par laminectomie.<br />
RÉSULTATS. Le recul allit de 3 à 54 mois avec une moyenne<br />
à 15 mois. La survie moyenne pour la vertébrectomie partielle ou<br />
total était de 16 mois (3 à 54 mois). La survie pour la chirurgie<br />
palliative décompressive était de 11 mois avec un recul de 5 à 19<br />
mois. Aucune modification dans l’alignement sagittal n’est survenue<br />
en post opératoire pour 30 patients. 2 patients ont vu<br />
apparaître <strong>des</strong> complications mécaniques post opératoires, à distance,<br />
nécessitant une reprise chirurgicale. Nous n’avons pas<br />
observé de fracture de vis, de plaques ou de tiges. Aucune<br />
complication neurologique liée à l’insertion <strong>des</strong> vis, tant au<br />
niveau thoracique (180 vis) que cervicale (96 vis en C4 C5 C6, et<br />
54 vis en C7) n’a été observée. Un contrôle par scanner était<br />
disponible pour 21 patients. Une malposition sans conséquence<br />
était observée dans 2,5 % <strong>des</strong> vis implantées.<br />
CONCLUSION. La fixation postérieure par vis est une bonne<br />
méthode de traitement et de stabilisation de la charnière cervicothoracique<br />
en chirurgie tumorale. Les vis articulaires cervica<strong>les</strong><br />
et transpédiculaires thoraciques donnent une stabilisation efficaces<br />
avec un faible niveau d’instabilité post opératoire. De plus, ce<br />
type d’instrumentation ne va pas interférer avec une éventuelle<br />
laminectomie ou <strong>des</strong> techniques chirurgica<strong>les</strong> de résections plus<br />
extrêmes.<br />
*C. Mazel, Département d’Orthopédie, Institut Mutualiste<br />
Montsouris, 42, boulevard Jourdan, 75674 Paris Cedex 14.<br />
165 Traitement chirurgical <strong>des</strong> tumeurs<br />
osseuses primitives de l’articulation<br />
sacro-iliaque<br />
C. COURT*, L. BOSCA, V.MOLINA,<br />
G. MISSENARD, J.-Y. NORDIN<br />
INTRODUCTION. Le traitement <strong>des</strong> tumeurs primitives<br />
envahissants l’articulation sacro-iliaque (ASI) reste chirurgical.<br />
Le but de ce travail a été d’étudier <strong>les</strong> résultats du traitement<br />
chirurgical afin de mieux cerner ses indications.<br />
MATÉRIEL. Quarante patients (24 H, 16 F), d’âge moyen 24<br />
ans (12-56) ait été opérés. Il s’agissait de 30 sarcomes de haut<br />
grade (12 ostéosarcome, 13 Ewing, 5 chondrosarcom) ; 10<br />
lésions plus différenciées (5 Chondrosarcom S bas grade, 2<br />
Fibrosarcome, autres 3 cas).<br />
MÉTHODE. La résection a été réalisé 37 fois par double voies<br />
et 3 fois par voie externe. Elle a comporté une sacrectomie<br />
verticale, passant soit dans <strong>les</strong> trous sacrés homo-latéraux (27<br />
fois), soit sur la ligne médiane (10 fois), soit dans <strong>les</strong> trous sacrés<br />
contro-latéraux (3 cas). La reconstruction a consisté en une<br />
solidarisation sacro-iliaque associée le plus souvent à une ostéosynthèse<br />
vertébrale, avec auto-greffe dans 36 cas, ciment dans 1<br />
cas et allo-greffe dans 3 cas. Les résultats fonctionnels ont été<br />
évalué selon <strong>les</strong> critères du MSTS (Enneking).<br />
RÉSULTATS.Ilyaeu3infections (3 fois sur 3 voies externes<br />
élargies) et 5 paralysies du tronc lombo-sacré, postopératoires.<br />
Les complications tardives ont été 3 spondylolisthésis et 8 pseudarthroses.<br />
20 patients sont décédés (8 récidives loca<strong>les</strong>, 10<br />
métastases, 1 toxicitéàla chimiothérapie, 1 cause indéterminée).<br />
16 patients sont en rémission complète à 6 ans de recul (2-16) et<br />
4 patients ont été perdu de vue. Les résultats fonctionnels ont été :<br />
très bons 8 fois, bon 10 fois, moyen 12 fois et mauvais 10 fois. La<br />
survie a été pour <strong>les</strong> tumeurs malignes (38 cas) de 40 %, mais de<br />
20 % pour <strong>les</strong> ostéo-sarcomes.<br />
DISCUSSION. Les améliorations techniques (voie combinée<br />
plutôt que voie externe élargie et lambeau d’épiploon) ont permis<br />
de diminuer <strong>les</strong> complications cutanées et infectieuses. Les complications<br />
mécaniques sont prévenues par la réalisation systématique<br />
d’une arthrodèse lombo-sacrée du côté opposé à la<br />
résection-reconstruction de l’AST. Celle-ci donne un bon résultat<br />
fonctionnel, malgré le sacrifice d’un hémi-plexus sacré, sile<br />
tronc lombo-sacré est préservé. La reconstruction aprèsrésection<br />
étendue au cotyle reste un problème non résolu, donnant un<br />
résultat médiocre. La qualité de l’exérèse chirurgicale est primordiale<br />
puisque l’exérèse contaminée a donné une rechute locale<br />
dans 8 cas sur 10.<br />
CONCLUSION. La chirurgie d’exérèse de l’ASI est source de<br />
nombreuses complications malgré <strong>les</strong> améliorations techniques<br />
réalisées. Elle ne doit être proposée que si une exérèse carcinologique<br />
est certaine. Le contrôle local reste décevant dans <strong>les</strong><br />
sarcomes ostéo-ostéogènes de gros volume.<br />
*C. Court, Service de Chirurgie Orthopédique,<br />
Hôpital de Bicêtre, 78, rue du Général-Leclerc,<br />
94275 Le Kremlin-Bicêtre.
166 Chondrosarcome du pelvis : étude<br />
rétrospective sur 10 cas<br />
D. ANDRETTA*, V. PIBAROT, J.BÉJUI-HUGUES,<br />
J.-P. CARRET<br />
INTRODUCTION. Le traitement <strong>des</strong> chondrosarcomes reste<br />
prioritairement chirurgical : 35 à 40 % <strong>des</strong> localisations sont<br />
pelviennes. Leur traitement impose <strong>des</strong> sacrifices conséquents<br />
mais assure une durée de vie acceptable.<br />
MATÉRIEL. Cette étude rétrospective concerne 10 patients<br />
traités entre 1993 et 2001 pour chondrosarcome pelvien. Nous<br />
étudions la survie, <strong>les</strong> séquel<strong>les</strong> fonctionnel<strong>les</strong> en fonction du<br />
traitement réalisé et du grade histologique.<br />
Le chondrosarcome était primitif dans tous <strong>les</strong> cas. La population<br />
comportait 7 hommes et 3 femmes avec un âge compris<br />
entre 28 et 77 ans (âge moyen 50,9 ans). La durée moyenne de<br />
survie a été de 39,7 mois.<br />
MÉTHODE. Tous <strong>les</strong> patients ont eu une biopsie (7 sous<br />
scanner) et 6 ont nécessité une biopsie chirurgicale complémentaire.<br />
Selon la classification de O’Neel et Ackermann, il s’agissait<br />
de 5 gra<strong>des</strong> I, 2 gra<strong>des</strong> II, 3 gra<strong>des</strong> III. La classification tumorale<br />
selon la classification topographique de Enneking retrouvait : 1<br />
cas zone 1, 1 cas zone I + II, 1 cas zone I + II + III, 3 cas zone II,<br />
3 cas zone II + III, 1 cas zone III.<br />
Aucun patient ne présentait de métastase en préopératoire<br />
après laréalisation d’un bilan complet.<br />
Dans 6 cas, une résection tumorale sans reconstruction a été<br />
réalisée ; dans 3 cas la résection a été associée à une reconstruction<br />
par technique de Puget.<br />
Les patients ont tous été revus avec une radiographie du bassin<br />
de face et pulmonaire.<br />
RÉSULTAT. Dans 8 cas sur 9, la résection a été «in sano » ;<br />
pour le 9 e cas, a été marginale selon <strong>les</strong> compte rendus anatomopathologiques.<br />
Le suivi postopératoire a permis de constater<br />
l’apparition de métastase dans 3 cas et 1 cas de récidive locale.<br />
Au terme du suivi, 2 patients sont décédés et1aprésenté <strong>des</strong><br />
métastases multip<strong>les</strong>, et 7 sont à ce jour indemnes. Des complications<br />
postopératoires précoces ou tardives sont survenues dans<br />
80 % <strong>des</strong> cas.<br />
DISCUSSION. Actuellement, la chirurgie reste le traitement<br />
de choix du chondrosarcome pelvien, malgré une morbidité<br />
péri-opératoire importante. Le geste de reconstruction, s’il est<br />
entrepris, doit toujours respecter <strong>les</strong> principes de la chirurgie<br />
carcinologique. La reconstruction ne semble pas obligatoire,<br />
alors que <strong>les</strong> taux de complications secondaires et tardives restent<br />
particulièrement élevés dans la reconstruction dès qu’el<strong>les</strong> sont<br />
étendues. Le grade histologique, <strong>les</strong> dimensions tumora<strong>les</strong> et la<br />
qualité de la résection chirurgicale sont <strong>les</strong> paramètres pronostics<br />
majeurs.<br />
*D. Andretta, Pavillon T, CHU de Lyon,<br />
Hôpital Edouard-Herriot, 5, place d’Arsonval,<br />
69437 Lyon Cedex 03.<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 2S97<br />
167 Facteurs pronostiques <strong>des</strong> chondrosarcomes<br />
du bassin<br />
F. FIORENZA*, R.-G. GRIMER, A.ABUDU,<br />
K. AYOUB, R.-M. TILLMAN, J.-L. CHARISSOUX,<br />
S.-R. CARTER<br />
INTRODUCTION. L’objectif de ce travail est d’analyser la<br />
survie et <strong>les</strong> facteurs pronostiques d’une série de patients traités<br />
pour chondrosarcome du bassin.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Notre série se compose de 67<br />
patients (27 femmes et 40 hommes) traités entre 1971 et 1996.<br />
L’âge moyen lors du diagnostic était de 45 ans (de 18 à 78 ans).<br />
Les tumeurs étaient de grade 1 dans 40 % <strong>des</strong> cas ; la localisation<br />
la plus fréquente était l’os iliaque. Une chirurgie conservatrice a<br />
été effectuée 45 fois et pour 22 patients le seul traitement<br />
chirurgical envisageable a consisté en une désarticulation interilio-abdominale.<br />
Les marges de résection étaient adéquates pour<br />
seulement 19 patients (résection large), <strong>les</strong> limites d’exérèse<br />
étaient margina<strong>les</strong> 14 fois et intra-lésionnel<strong>les</strong> 17 fois.<br />
RÉSULTATS. La survie globale à 5et8ansétaient respectivement<br />
de 65 % et 58 %. La fréquence de survenue <strong>des</strong> récidives<br />
loca<strong>les</strong> étaient de 40 % survenant en moyenne 27 mois après la<br />
chirurgie initiale. L’analyse statistique n’a pas retrouvé de corrélations<br />
entre la taille de la tumeur, le grade, le type de chirurgie,<br />
<strong>les</strong> marges de résection et la survenue de récidive locale. Les<br />
résultats étaient cependant moins bons en cas de marges de<br />
résection inadéquates. Le grade, la taille de la tumeur, l’âge, le<br />
sexe et la qualité de l’exérèse n’influençaient pas de façon<br />
significative la survie globale. Seule la survenue d’une récidive<br />
locale apparaissait comme un facteur pronostique négatif de<br />
survie (p < 0,05).<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. La survenue de récidive<br />
locale apparaît au terme de cette série comme un facteur pronostique<br />
négatif pour <strong>les</strong> patients présentant un chondrosarcome du<br />
bassin. Dans cette localisation, <strong>des</strong> marges de résection satisfaisantes<br />
sont souvent diffici<strong>les</strong> à obtenir et la plupart <strong>des</strong> auteurs<br />
proposent en dernier recours une désarticulation inter-ilioabdominale.<br />
La question de savoir si il est licite de proposer une<br />
attitude chirurgicale initiale plus agressive visant à obtenir<br />
d’emblée <strong>des</strong> marges de résection plus radica<strong>les</strong> reste posée.<br />
*F. Fiorenza, Département d’Orthopédie, CHU Dupuytren,<br />
2, avenue Martin-Luther-King, 87042 Limoges.<br />
168 La dysplasie fibreuse : à propos de<br />
64 cas<br />
N. KARRAY*, A. BABINET, B.TOMENO,<br />
P. ANRACT<br />
INTRODUCTION. La dysplasie fibreuse est une affection<br />
rare, elle représente environ 1 % <strong>des</strong> tumeurs bénignes osseuses.<br />
Elle peut être mono ou polyostotique. Si le traitement <strong>des</strong> lésions<br />
localisées et de petite taille ne pose aucun problème, <strong>les</strong> formes<br />
étendues ou compliquées peuvent avoir une évolution toute autre.
2S98 77 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
Le but de ce travail est de présenter <strong>les</strong> résultats du traitement<br />
chirurgical d’une série consécutive de 64 cas en insistant sur la<br />
fréquence de complications.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Il s’agissait d’une étude rétrospective<br />
concernant 64 patients atteints de dysplasie fibreuse.<br />
L’âge moyen était de 32 ans. Il s’agissait de 37 femmes, et de 27<br />
hommes. La série comptait 58 formes monostotique. Les localisations<br />
<strong>les</strong> plus fréquentes concernaient le fémur (19 cas). Sept<br />
patients ont été pris en charge pour une fracture. Chez 61 patients<br />
le diagnostic à été confirmé par l’histologie. Dans 3 cas la<br />
dysplasie fibreuse a était associée à une autre tumeur (kyste<br />
anévrysmal ou adamantinome). Diverses attitu<strong>des</strong> thérapeutiques<br />
ont été choisies : l’abstention dans 3 cas, la biopsie isolée dans 13<br />
cas, l’exérèse dans 6 cas, le curetage dans 34 cas. Ce dernier àété<br />
associé àun comblement 23 fois, et à une synthèse 11 fois. Huit<br />
patients ont eu d’autres traitements chirurgicaux (prothèses,<br />
ostéosynthèses et amputation).<br />
RÉSULTATS. Nous avons déploré 5 complications post opératoires.<br />
Au recul moyen de 45 mois, 14 % <strong>des</strong> patients gardaient<br />
<strong>des</strong> douleurs le plus souvent discrètes ou modérées. Sur le plan<br />
radiologique, nous avons noté 4récidives, 12 stabilisations, 18<br />
régressions et 19 guérisons (le plus souvent après exérèse ou<br />
curetage comblement). A long terme 2 patients ont présenté une<br />
transformation maligne.<br />
DISCUSSION. Les lésions traitées par biopsie isolée n’ont<br />
guéri ou régressé que dans 30 % <strong>des</strong> cas, alors que le curetage<br />
comblement entraîne une guérison ou régression <strong>des</strong> lésions dans<br />
70 % <strong>des</strong> cas. Dans cette série nous n’avons pas inclus <strong>les</strong><br />
patients traités par bisphosphonates du fait du recul insuffisant.<br />
Cependant ce traitement paraît très prometteur sur la douleur.<br />
CONCLUSION. Les résultats du traitement de la dysplasie<br />
fibreuse ne sont pas aussi bons que ne laisse supposer la bénignité<br />
de la maladie. La place du traitement chirurgical semble être<br />
amenée à diminuer, remplacée par <strong>les</strong> bisphosphonates dont<br />
l’efficacité àlong terme doit être évaluée.<br />
*N. Karray, Service de Chirurgie Orthopédique B,<br />
Hôpital Cochin, 27, rue du Faubourg-Saint-Jacques,<br />
75014 Paris.<br />
169 Synovite villonodulaire pseudomaligne<br />
: à propos de 10 observations<br />
F. DELEPINE*, G. DELEPINE, F.-H. DUJARDIN<br />
INTRODUCTION. La synovite villonodulaire est une maladie<br />
très protéiforme. A côté <strong>des</strong> localisations <strong>des</strong> mains <strong>des</strong> synovites<br />
articulaires classiques, nous voudrions insister sur l’existence de<br />
formes pseudo-malignes qui doivent être reconnues pour éviter<br />
<strong>des</strong> traitements agressifs injustifiés.<br />
MATÉRIEL. Notre série comporte 10 dossiers de mala<strong>des</strong><br />
venus pour <strong>des</strong> tumeurs de parties mol<strong>les</strong> soit du genou (6 cas),<br />
soit de la hanche (4 cas). Le délai entre le premier signe clinique<br />
et la première consultation était, en moyenne, de 2 ans. Le tableau<br />
clinique était, dans tous <strong>les</strong> cas, dominé par une tuméfaction<br />
importante <strong>des</strong> parties mol<strong>les</strong>. Il n’y avait de signes articulaires<br />
que dans un peu moins de la moitié <strong>des</strong> observations et de signes<br />
radiologiques que dans 6 cas. Lorsqu’elle a été pratiquée, l’IRM<br />
a constamment montré, dans ses formes tumora<strong>les</strong>, l’existence de<br />
dépôts ferriques orientant considérablement le diagnostic.<br />
RÉSULTATS. Tous <strong>les</strong> mala<strong>des</strong> ont été opérés.5d’entre eux<br />
ont récidivé dont certains jusqu’à 4 reprises. L’une <strong>des</strong> récidives<br />
est survenue 17 ans après une intervention jugée satisfaisante<br />
(résection monobloc large). L’atteinte articulaire a toujours été<br />
relativement minime dans ces cas avec, parfois, une très forte<br />
discordance entre un tableau clinique peu gênant et <strong>des</strong> anomalies<br />
radiologiques importantes. Surtout, il faut insister sur <strong>les</strong><br />
erreurs diagnostiques possib<strong>les</strong>. Ces erreurs ont été marquées,<br />
dans notre série, par 2 propositions d’amputation dont l’une a été<br />
réellement réalisée car le diagnostic hésitait avec un synovialosarcome.<br />
Cela rappelle la reprise du registre Suédois <strong>des</strong> synovialosarcomes<br />
sur 82 dossiers inscrits, 12 se sont révélés, en fait,<br />
<strong>des</strong> synovites villonodulaires de forme agressive.<br />
CONCLUSION. Lors de grosses tuméfactions <strong>des</strong> parties<br />
mol<strong>les</strong>, l’existence de signes articulaires, ou la présence de<br />
dépôts ferriques à l’IRM, doivent rendre prudent lorsqu’on<br />
avance le diagnostic de synovialosarcome. Il faut s’assurer, de<br />
manière certaine, qu’il ne s’agit pas, en fait, d’une synovite<br />
villonodulaire qui requiert un traitement adapté àchaque cas et<br />
aussi peu agressif que possible.<br />
*F. Delepine, 5, passage du Bon-Pasteur, 76000 Rouen.
170 Intérêt de la navigation dans l’étude<br />
de la cinétique du genou<br />
P. MASSIN*, B. FAGUET, B.LEBEC<br />
INTRODUCTION. Les étu<strong>des</strong> en IRM dynamique ont<br />
confirmé le recul du condyle latéral au cours de la flexion du<br />
genou.<br />
MATÉRIEL. Nous avons utilisé <strong>les</strong> appareils de navigation<br />
basés sur le « bone morphing » pour étudier la cinétique du genou<br />
cadavérique et l’influence de lésions ligamentaires. La cinétique<br />
rotulienne a été contrôlée par broches.<br />
MÉTHODE. La rotation fémorale par rapport au tibia a été<br />
mesurée informatiquement lors de la flexion du genou.<br />
RÉSULTATS. Nous avons retrouvé la rotation externe fémorale<br />
au cours de la flexion lorsque le tibia est maintenu avec le<br />
pied dans l’angle du pas (15° par rapport au plan de<br />
flexion/extension), le fémur étant libre de tourner. Néanmoins,<br />
cette rotation a pu être supprimée en appliquant une contrainte en<br />
rotation externe sur le tibia. La rotation de déverrouillage entre -5<br />
et +5° a été mesurée entre 8 et 10°. Elle se prolonge par une<br />
rotation plus ample, augmentant régulièrement au cours de la<br />
flexion pour atteindre une trentaine de degrés à 130° de flexion.<br />
L’étude sur écran d’ordinateur de la cinétique <strong>des</strong> pièces osseuses,<br />
montre le recul du condyle latéral. A partir de 130° de<br />
flexion, on distingue le soulèvement du condyle médial, qui perd<br />
le contact du plateau tibial médial.<br />
Le recul du condyle latéral est confirmé par la rotation de la<br />
rotule sur son axe longitudinal. La rotule semble, de plus, effectuer<br />
une translation latérale pour venir se mettre en face du<br />
condyle latéral en forte flexion. Elle étire alors le vastus medialis,<br />
comme le suggère son mouvement de sonnette autour d’un axe<br />
antéro-postérieur.<br />
La section du ligament croisé antérieur apporte peu de modification<br />
à cette cinétique. Elle diminue la rotation de déverrouillage,<br />
dont la valeur ne dépasse pas 3°. Vers 110°, on observe<br />
un plafonnement de la rotation fémorale à une vingtaine de degré.<br />
L’étude sur écran du mouvement <strong>des</strong> condy<strong>les</strong> montre que <strong>les</strong> 2<br />
condy<strong>les</strong> semblent alors se déplacer vers l’avant, comme s’ils<br />
étaient repoussés par <strong>les</strong> parties mol<strong>les</strong> postérieures de cuisse.<br />
La section du muscle poplité diminue nettement la rotation<br />
externe fémorale du genou cadavérique.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. On voit ainsi se <strong>des</strong>siner<br />
deux types de mouvement :<br />
− la rotation externe tibiale obligatoire en fin d’extension sous<br />
la dépendance du LCA.<br />
− la rotation externe fémorale facultative en flexion, sous la<br />
dépendance du poplité. Elle s’exprime dans l’accroupissement<br />
unipodal, et pourrait protéger la patella de pressions excessives<br />
par l’effacement progressif du condyle latéral.<br />
*P. Massin, Service de Chirurgie Traumatologie,<br />
Centre Hospitalier Universitaire, 4, rue Larrey,<br />
49033 Angers Cedex 01.<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 2S99<br />
Séance du 14 novembre après-midi<br />
GENOU<br />
171 Reconstruction du LCA assistée par<br />
ordinateur : évaluation du positionnement<br />
<strong>des</strong> tunnels tibiaux et fémoraux<br />
S. PLAWESKI*, R. JULLIARD, G.CHAMPELOUX,<br />
S. IONESCU, C.SCHUSTER, P.MERLOZ<br />
Aucune technique chirurgicale de reconstruction ligamentaire<br />
dite conventionnelle ne peut assurer dans tous <strong>les</strong> cas une position<br />
idéale du transplant. Le principe de navigation sans imagerie<br />
du ligament croisé antérieur doit répondre à cet imperatif. Il<br />
s’agit d’une tactique opératoire faisant appel à un ou plusieurs<br />
procédés informatiques capab<strong>les</strong> de permettre une reconstruction<br />
ligamentaire sans avoir recours à une imagerie complémentaire<br />
pré, per ou post opératoire. Son principe repose actuellement sur<br />
l’utilisation d’une « station surgétique » comprenant un ordinateur,<br />
<strong>des</strong> localisateurs, un écran, une pédale de commande,<br />
capab<strong>les</strong> de traiter <strong>les</strong> données (essentiellement de mesure et de<br />
position dans l’espace) fournies par <strong>des</strong> marqueurs fixés sur <strong>des</strong><br />
corps rigi<strong>des</strong> et <strong>des</strong> outils (palpeurs, viseurs).<br />
L’étude concerne 10 genoux cadavériques. Chaque genou a été<br />
instrumenté avec la station surgétique. La cinématique articulaire<br />
a été enregistrée avec et sans LCA ainsi qu’aprèsprélèvement du<br />
transplant : tendon rotulien et ischio-jambiers. Le principe du<br />
bone morphing a été utilisé pour recaler <strong>les</strong> surfaces tibia<strong>les</strong> et<br />
fémora<strong>les</strong>. 2 types de viseurs ont été testés par enregistrement<br />
informatique <strong>des</strong> points de sortie tibiale et d’entrée fémorale. Le<br />
calcul de positionnement <strong>des</strong> tunnels fémoraux et tibiaux a pris<br />
en compte <strong>les</strong> principes de moindre anisométrie et d’absence de<br />
conflit avec l’échancrure. Ces zones dits isométriques ont été<br />
comparées aux zones anatomiques du LCA. Nous avons également<br />
comparé le positionnement du transplant effectué selon <strong>les</strong><br />
procédés utilisant <strong>les</strong> viseurs habituels arthroscopiques au positionnement<br />
donné par l’ordinateur. Chaque genou a été radiographié<br />
afin de comparer <strong>les</strong> données de la littérature concernant le<br />
positionnement conseillé <strong>des</strong> tunnels fémoraux et tibiaux avec la<br />
position donnée par l’ordinateur. Chaque genou a été testé au KT<br />
1000 avant et après chirurgie.<br />
La précision du bone morphing a été calculée à 0,1 mm près.<br />
Les courbes d’anisométrie ont autorisé dans 4 cas le perçage <strong>des</strong><br />
tunnels calibrés au diamètre du transplant. Dans 6 cas le point<br />
fémoral a été navigué de façon active par l’opérateur, l’ordinateur<br />
a alors automatiquement recalculé le point tibial afin d’éliminer<br />
tout conflit du transplant avec l’échancrure. Les valeurs d’anisométrie<br />
observées ont été toutes inférieures à 2 mm, la distance toit<br />
de l’échancrure/bord antérieur du transplant a été calculée en<br />
fonction du rayon du transplant (3,5-5 mm). Le positionnement<br />
du tunnel tibial donné par l’ordinateur a toujours été plus médial<br />
que celui donné par <strong>les</strong> viseurs tibiaux. Le positionnement du<br />
tunnel fémoral a toujours été plus antérieur que celui donné par<br />
<strong>les</strong> viseurs fémoraux. Les valeurs du KT 1000 post opératoire ont<br />
été identiques aux valeurs pré opératoires.
2S100 77 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
La navigation sans imagerie du LCA est ainsi capable de le<br />
positionner au plan isométrique ou au mieux au plan « anatomométrique<br />
», d’inscrire l’orifice articulaire du tunnel tibial dans la<br />
projection de l’arche antérieure de l’échancrure sur la surface<br />
tibiale, de <strong>des</strong>siner sur l’échancrure en temps réel pour le centre<br />
de cet orifice articulaire tibial la carte d’isométrie fémorale et la<br />
carte de laxité correspondante, d’indiquer sur l’échancrure fémorale<br />
le point qui sera le centre de l’orifice articulaire du tunnel<br />
fémoral, de tracer la courbe d’isométrie d’une fibre donnée etde<br />
tracer la courbe de laxité correspondante, de détecter et faire<br />
traiter tout conflit transplant échancrure.<br />
*S. Plaweski, Service Orthopédie-Traumatologie,<br />
Hôpital Michallon, BP 217, 38043 Grenoble Cedex 09.<br />
172 L’ostéotomie tibiale de valgisation<br />
assistée par ordinateur dans le traitement<br />
du genu varum : à propos<br />
de 19 cas<br />
H. PICHON*, D. SARAGAGLIA, C.CHAUSSARD,<br />
D. BERNE<br />
L’ostéotomie tibiale de valgisation est une intervention difficile<br />
qui expose soit à l’hypercorrection, soit à l’hypocorrection<br />
avec <strong>les</strong> conséquences esthétiques, fonctionnel<strong>les</strong> et médicoléga<strong>les</strong><br />
que cela peut entraîner. Afin d’améliorer la précision du<br />
geste opératoire nous avons adapté la navigation informatisée à<br />
l’ostéotomie tibiale de valgisation. L’objectif de ce travail était<br />
d’évaluer la faisabilité et <strong>les</strong> résultats de cette technique.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. De mars à novembre 2001<br />
nous avons opéré avec assistance par Orthopilot 19 genu varum<br />
chez 19 patients âgés en moyenne de 50,8 ± 11,7 ans (18 à 71<br />
ans). Une patiente n’avait pas d’arthrose mais un genu varum<br />
important particulièrement inesthétique et <strong>les</strong> 18 autres une<br />
arthrose fémorotibiale de grade 1, 2, ou 3 selon Ahlback modifié.<br />
L’axe mécanique préopératoire moyen (HKA) était de 173,73° ±<br />
3,24° (169 à 178°).<br />
La technique opératoire comportait l’acquisition de l’axe<br />
mécanique grâce à l’utilisation de l’Orthopilot ; puis on réalisait<br />
une ostéotomie de valgisation d’ouverture interne fixée temporairement<br />
par une cale métallique permettant de régler à la<br />
demande l’axe du membre inférieur ; l’orthopilot permettait de<br />
vérifier l’axe souhaité. Une fois que l’axe souhaité était obtenu,<br />
on enlevait la cale métallique et on la remplaçait par une cale de<br />
phosphate tricalcique (Biosorbt, B-Braun) de même taille et une<br />
plaque vissée pour stabiliser l’ostéotomie. L’objectif de l’intervention<br />
était d’obtenir un axe fémorotibial compris entre 182 et<br />
186° soit une hypercorrection de 2 à 6°.<br />
RÉSULTATS. En ce qui concerne la gonométrie peropératoire<br />
acquise avec l’Orthopilot l’angle HKA était de 174,05° ± 3,06°<br />
soit un angle tout à fait superposable à l’évaluation radiologique<br />
préopératoire. Aprèsl’ostéotomie l’angle HKA était de 183,47° ±<br />
1,07° (180°à184°) avec l’Orthopilot, et de 183,47° ± 1,46° (179°<br />
à 186°) avec l’évaluation radiologique. 18 genoux étaient compris<br />
entre 182 et 186° soit un objectif atteint dans 94,7 %.<br />
CONCLUSION. L’ostéotomie tibiale de valgisation assistée<br />
par Orthopilot est tout à fait possible avec une fiabilité remarquable.<br />
Pour valider complètement cette nouvelle technique il faudrait<br />
la comparer à la même technique sans assistance informatisée.<br />
*H. Pichon, Service de Chirurgie Orthopédique<br />
et Traumatologie du Sport, Hôpital Sud, BP 185,<br />
38042 Grenoble Cedex 09.<br />
173 Intérêt de la navigation informatisée<br />
pour évaluer la rotation fémorale<br />
lors de la mise en place <strong>des</strong> prothèses<br />
tota<strong>les</strong> du genou<br />
D. SARAGAGLIA*, C. CHAUSSARD, H.PICHON,<br />
D. BERNE, M.CHAKER<br />
Depuis quelques années un certain nombre d’auteurs estiment<br />
qu’il existe une torsion épiphysaire distale du fémur que l’on peut<br />
mesurer soit en per-opératoire, soit par un scanner préopératoire.<br />
Cependant cette mesure ne tient pas compte de l’axe mécanique<br />
dynamique et tout particulièrement de l’axe mécanique dans la<br />
position de la marche et à 90° de flexion. Grâce à la navigation<br />
informatisée (Orthopilott) nous avons essayé de mesurer la<br />
rotation fémorale en évaluant par la gonométrie dynamique <strong>les</strong><br />
axes en extension et en flexion à 90°, avant et après mise en place<br />
d’une prothèse totale du genou.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. A l’occasion de la mise en<br />
place de 50 prothèses tota<strong>les</strong> du genou assistée par Orthopilot,<br />
nous avons colligé <strong>les</strong> axes mécaniques fémoro-tibiaux (HKA)<br />
pré-opératoires (Rx), peropératoires (Orthopilot) en extension et<br />
en flexion à 90° avant et après implantation d’une prothèse<br />
search* (Aesculap AG, Tuttlingen) et post-opératoires (Rx). Il<br />
s’agissait de 19 genu valgum dont l’angle HKA était en moyenne<br />
de 187,36° ± 5,4° (181 à 203°), 30 genu varum dont l’angle HKA<br />
était de 169,2° ± 4,11° (160 à 176°), et un genou normo-axé.<br />
RÉSULTATS. Les ang<strong>les</strong> radiologiques préopératoires ont été<br />
confirmés par l’Orthopilot puisque nous avons retrouvé respectivement<br />
en per-opératoire <strong>les</strong> ang<strong>les</strong> suivants : 186.68° ± 5.25°<br />
et 169.76° ± 3.84° pour la gonométrie en extension. Pour ce qui<br />
concerne la gonométrie en flexion à 90° avant implantation de la<br />
prothèse <strong>les</strong> ang<strong>les</strong> étaient de 178.63° ± 5.7° pour le genu<br />
valgum, soit une bascule en varus tout à fait significative due à un<br />
bâillement externe en flexion, et de 171.6° ± 4.15° pour le genu<br />
varum, soit un maintien en varus de l’axe fémoro-tibial mécanique.<br />
Après implantation de la prothèse nous avons obtenu <strong>les</strong><br />
données suivantes :<br />
− Pour le genu varum : un angle HKA en extension de 180,57°<br />
± 0,82° et un angle HKA en flexion à 90° de 176,86° ± 2,55° soit<br />
un varus moyen résiduel de 3,16° ± 2,86° (de 4° de valgus à 8° de<br />
varus), alors que nous n’avons pas donné de rotation externe à<br />
l’implant fémoral.<br />
− Pour le genu valgum : un angle HKA en extension de<br />
179,60° ± 0,92° et un angle HKA en flexion à 90° de 176,1° ±<br />
3,23° soit un varus moyen résiduel de 3,26° ± 2,86° (0 à 10° de
varus) en sachant que dans le genu valgum nous mettons de<br />
manière quasi systématique de la rotation externe en raison de<br />
l’hypoplasie fréquente du condyle externe.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. La mise en place <strong>des</strong> prothèses<br />
tota<strong>les</strong> du genou assistée par Orthopilot apporte <strong>des</strong><br />
notions nouvel<strong>les</strong> sur la gonométrie dynamique et tout particulièrement<br />
sur la mesure du varus ou du valgus en flexion ce qui<br />
correspond à la mesure de la rotation externe ou interne naturelle<br />
du fémur. La mesure de la rotation épiphysaire fémorale distale<br />
par <strong>les</strong> métho<strong>des</strong> classiques ne prends pas en compte la rotation<br />
fémorale globale, celle-ci étant bien souvent en rotation externe<br />
(jusqu’à 8° pour le genu varum). Toute implantation en rotation<br />
externe systématique de la pièce fémorale risque d’augmenter de<br />
manière considérable <strong>les</strong> contraintes en varus de la prothèse du<br />
genou lors de la flexion.<br />
*D. Saragaglia, Service de Chirurgie Orthopédique<br />
et Traumatologie du Sport, Hôpital Sud, BP 185,<br />
38042 Grenoble Cedex 09.<br />
174 Pose d’une prothèse totale de<br />
genou assistée par un système<br />
numérisé sans image : étude multicentrique<br />
de 821 cas<br />
R. MIEHLKE*, J.-Y. JENNY<br />
INTRODUCTION. Le but de cette étude était la comparaison<br />
multicentrique de l’implantation d’une prothèse totale du genou<br />
par technique conventionnelle et par navigation informatisée.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Une étude prospective et comparative<br />
a été menée dans 5 centres sur 821 patients opérés avec<br />
le même implant (prothèse Searcht, Aesculap, Chaumont) : 555<br />
interventions avec le système de navigation OrthoPilott (Aesculap,<br />
Tuttligen – groupe 1) et 266 interventions conventionnel<strong>les</strong><br />
(groupe 2). Le résultat radiographique a été analysé par un<br />
observateur indépendant sur <strong>des</strong> télémétries réalisées au 3 e mois<br />
postopératoire.<br />
RÉSULTATS. L’axe fémorotibial mécanique était dans <strong>les</strong><br />
limites souhaitées (3° de déformation frontale) chez 88,6 % <strong>des</strong><br />
cas du groupe 1 et 72,2 % <strong>des</strong> cas du groupe 2 (p < 0,001). Le<br />
taux d’implantation inacceptable (> 5° de déformation) était de<br />
2,5 % dans le groupe 1 et de 9,8 % dans le groupe 2.<br />
L’orientation frontale de la pièce fémorale était satisfaisante<br />
dans 89,4 % <strong>des</strong> cas du groupe 1 et 77,1 % <strong>des</strong> cas du groupe 2.<br />
L’orientation sagittale de la pièce fémorale était satisfaisante<br />
dans 75,5 % <strong>des</strong> cas du groupe 1 et 70,7 % <strong>des</strong> cas du groupe 2.<br />
L’orientation frontale de la pièce tibiale était satisfaisante dans<br />
91,9 % <strong>des</strong> cas du groupe 1 et 83,5 % <strong>des</strong> cas du groupe 2.<br />
L’orientation sagittale de la pièce tibiale était satisfaisante dans<br />
81,3 % <strong>des</strong> cas du groupe 1 et 69,9 % <strong>des</strong> cas du groupe 2. 275<br />
patients du groupe 1 (49,5 %) et 82 patients du groupe 2 (30,8 %)<br />
avaient une implantation optimale pour tous <strong>les</strong> critères étudiés<br />
(p < 0,001). Aucune différence entre <strong>les</strong> résultats <strong>des</strong> différents<br />
centres n’a été retrouvée.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. La navigation a facilité<br />
l’implantation de la prothèse avec l’orientation désirée en com-<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 2S101<br />
paraison de l’instrumentation manuelle conventionnelle. Le nombre<br />
d’implantations inacceptab<strong>les</strong> est significativement diminué.<br />
Après une courte période d’apprentissage, la fiabilité du système<br />
utilisé est très satisfaisante, et sa facilité d’emploi a été améliorée<br />
depuis cette étude.<br />
*R. Miehlke, St-Joseph Stift, Postfach 1164/1165,<br />
48318 Sendenhorst, Allemagne.<br />
175 Prothèse tricompartementale du<br />
genou et tenseur ligamentaire :<br />
étude du positionnement <strong>des</strong><br />
implants, effets sur la laxité et sur<br />
l’axe du membre inférieur<br />
S. BOLZER*, F. GOUGEON<br />
INTRODUCTION. Si la majorité <strong>des</strong> prothèses tricompartimenta<strong>les</strong><br />
du genou ont <strong>des</strong> coupes indépendantes, quelques unes<br />
ont <strong>des</strong> coupes liées, ce qui peut entraîner <strong>des</strong> modifications de<br />
hauteur d’interligne ou induire <strong>des</strong> erreurs d’axe. Le but de cette<br />
étude était d’étudier le positionnement <strong>des</strong> implants, <strong>les</strong> laxitéset<br />
l’axe du membre inférieur après prothèse tricompartimentale du<br />
genou implantée avec un tenseur ligamentaire.<br />
PATIENTS ET MÉTHODE. Entre janvier 1998 et octobre<br />
2000, 109 prothèses tota<strong>les</strong> de genou de type Legacy Postérostabiliséet<br />
ont été implantées chez 94 patients.<br />
Trois patients étaient décédés, 3 patients géographiquement<br />
éloignés ont été interrogés par téléphone. 88 patients, soit 103<br />
prothèses, ont donc été revus au recul moyen de 22,5 mois.<br />
Aucun patient n’était perdu de vue.<br />
Toutes <strong>les</strong> prothèses de la série ont été posées avec le tenseur<br />
ligamentaire V-STATt qui permet de guider l’équilibrage <strong>des</strong><br />
plans capsulo-ligamentaires médial et latéral en flexion et en<br />
extension sous une tension constante.<br />
RÉSULTATS. A la révision, selon la cotation radiologique de<br />
l’IKS, l’angle alpha moyen était de 95,9° (90 à 108°) avec 76,7 %<br />
<strong>des</strong> implants entre 93 et 99°. L’angle gamma moyen était de 1°<br />
(-8 à 8°) avec 73,8 % <strong>des</strong> implants entre -3 et 3°. L’angle bêta<br />
moyen était de 89,8° (86 à 98°) avec 81,5 % <strong>des</strong> implants entre 87<br />
et 93°. La pente tibiale mesurée par rapport à l’axe tibial mécanique<br />
était en moyenne de 8,4° (2 à 15,5°) avec 67 % <strong>des</strong><br />
implants entre 4 et 10° (pente recherchée à 7°).<br />
L’angle HKA moyen au recul était de 178,8° (172,5 à 191°),<br />
avec 75,7 % <strong>des</strong> HKA compris entre 175 et 185°, pour une valeur<br />
préopératoire moyenne de 176° (161 à 203°) ; la correction était<br />
d’autant plus significative que la déformation préopératoire était<br />
importante.<br />
La hauteur d’interligne au recul était significativement augmentée<br />
par rapport à la hauteur d’interligne préopératoire.<br />
La laxité radiologique moyenne en varus au recul était de 3,1°,<br />
pour une valeur préopératoire de 2,8°, soit une augmentation non<br />
significative. La laxité radiologique moyenne en valgus au recul<br />
était de 3,2°, pour une valeur préopératoire de 4°, soit une<br />
diminution significative. La valeur moyenne de la somme <strong>des</strong>
2S102 77 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
laxités fronta<strong>les</strong> radiologiques au recul était de 6,4°, pour une<br />
valeur préopératoire de 6,8°, soit une diminution non significative.<br />
La laxité sagittale radiologique moyenne au recul était de<br />
4,2 mm. On ne notait pas de différence significative entre la laxité<br />
sagittale préopératoire et la laxité sagittale au recul.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. Les valeurs moyennes de<br />
positionnement <strong>des</strong> implants correspondent aux données de la<br />
littérature.<br />
Si l’élévation de la hauteur de l’interligne au recul était<br />
significative, celle-ci n’était pas corrélée à la diminution de la<br />
hauteur patellaire au recul. La diminution de hauteur patellaire au<br />
recul était corrélée à l’augmentation de la surface articulaire<br />
patellaire (distance AP de l’indice de Blackburne et Peel) et au<br />
raccourcissement du tendon patellaire.<br />
L’utilisation du tenseur ligamentaire V-STATt a permis<br />
d’obtenir une répartition médio-latérale homogène de la laxité<br />
frontale avec contrôle de la laxité sagittale, en conservant un axe<br />
du membre inférieur normal.<br />
*S. Bolzer, Service d’Orthopédie D, Hôpital Roger-Salengro,<br />
CHRU de Lille, rue du 8 Mai 1945, 59037 Lille Cedex.<br />
176 Prothèse totale de genou à <strong>des</strong>sin<br />
« plat sur plat » : étude de survie à<br />
8 ans<br />
J.-Y. JENNY*, C. BOÉRI<br />
INTRODUCTION. Le <strong>des</strong>sin <strong>des</strong> surfaces de contact <strong>des</strong><br />
prothèses tota<strong>les</strong> de genou est un facteur reconnu d’usure du<br />
polyéthylène, et donc de survie de la prothèse. Les prothèses au<br />
<strong>des</strong>sin dit « plat sur plat » ont une surface de contact limitée et<br />
sont réputées favoriser l’usure du polyéthylène ; leur usage est<br />
fortement déconseille à ce jour. Pourtant certaines séries présentent<br />
<strong>des</strong> survies similaires à d’autres prothèses plus congruentes.<br />
Les auteurs ont étudié la survie à 8 ans de tels implants.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Les auteurs ont implanté 223<br />
prothèses tota<strong>les</strong> de genou à <strong>des</strong>sin « plat sur plat » entre 1992 et<br />
1996 (prothèse Searcht, Aesculap, Chaumont). Tous <strong>les</strong> patients<br />
ont été suivis de façon prospective à interval<strong>les</strong> réguliers, sur le<br />
plan clinique et radiographiques. La survenue éventuelle d’une<br />
réintervention pour changement d’implant a été notée, en colligeant<br />
le délai postopératoire de cette réintervention et sa cause.<br />
Les courbes de survie de l’implant ont été établies selon la<br />
méthode de Kaplan-Meier, avec la réintervention pour toute<br />
cause ou pour cause non infectieuse comme critère de décès.<br />
RÉSULTATS. 94 % <strong>des</strong> patients ont été réexaminés ouréinterrogés<br />
par téléphone pour cette étude au cours de l’année 2001.<br />
6 % <strong>des</strong> patients ont été perdus de vue en cours d’étude, avec un<br />
recul moyen de 24 mois. 74 % <strong>des</strong> prothèses étaient encore en<br />
place lors de la revue, avec un recul moyen de 78 mois. 10 % <strong>des</strong><br />
patients étaient décédés en cours d’étude avec leur implant initial<br />
en place, avec un recul moyen de 50 mois. 10 % <strong>des</strong> patients ont<br />
été réopérés pour changement d’implant, avec un recul moyen de<br />
37 mois, dont la moitié pour infection et un quart pour cause<br />
mécanique. Le taux de reprise global à 8 ans est de 11 %. Le taux<br />
de reprise hors infection à 8 ans est de 6 %.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. La survie de cette prothèse,<br />
hors complication infectieuse, est similaire a celle d’autres<br />
implants plus congruents. Cette étude confirme ainsi d’autres<br />
travaux cliniques. La nocivité <strong>des</strong> surfaces de contact linéaires est<br />
prouvée en laboratoire, mais la transposition de cette nocivité en<br />
clinique humaine ne doit pas être automatique. L’usure du polyéthylène<br />
est donc multifactorielle, et on ne peut pas réduire cette<br />
question à la seule forme <strong>des</strong> surfaces de glissement.<br />
*J.-Y. Jenny, CTO, 10, avenue Baumann, 67400 Illkirch.<br />
177 Comparaison de la cinématique in<br />
vivo d’une prothèse totale de genou<br />
postéro-stabilisée équipéed’un plateau<br />
tibial fixe ou mobile<br />
T. TRICHARD*, H. MIGAUD, A.DIOP, W.SKALLI,<br />
F. LAVASTE, F.GOUGEON<br />
INTRODUCTION. L’utilisation d’un plateau mobile sur une<br />
prothèse totale de genou (PTG) est <strong>des</strong>tinée à réduire <strong>les</strong> phénomènes<br />
d’usure et à améliorer la cinématique prothétique. Les<br />
objectifs de notre étude étaient : 1) de comparer la cinématique<br />
d’une prothèse postéro-stabilisée avec plateau fixe (PF) ou<br />
mobile (PM), 2) de déterminer si le plateau mobile améliorait <strong>les</strong><br />
amplitu<strong>des</strong> de rotation axiale.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Dix patients porteurs d’une<br />
PTG unilatérale de type HLS à plateau fixe ou mobile ont été<br />
sélectionnés selon <strong>les</strong> critères suivants : arthroplastie pour<br />
gonarthrose, genou controlatéral indemne d’arthrose, âge < 80<br />
ans, arthroplastie indolore, score IKS genou > 80/100, flexion ><br />
90°, recul > 1 an. Il s’agissait de 5 patients porteurs d’une<br />
prothèse à plateau fixe et de 5 autres porteurs d’une même<br />
prothèse différent uniquement par l’adjonction d’un plateau<br />
mobile. Les amplitu<strong>des</strong> de mouvement (3 rotations : flexion<br />
extension, rotation axiale, valgus-varus) <strong>des</strong> genoux prothèses et<br />
sains ont étéévalués à l’aide d’un goniomètre électromagnétique.<br />
Quatre mouvements ont été enregistrés : marche, relevé-assis,<br />
flexion extension en décharge. Les amplitu<strong>des</strong> ont été comparées<br />
par <strong>des</strong> tests non paramétriques entre genou sain et prothèse et<br />
entre <strong>les</strong> deux types d’implants.<br />
RÉSULTATS. Les genoux PF étaient plus mobi<strong>les</strong> en valgusvarus<br />
traduisant une plus grande laxité frontale résiduelle que <strong>les</strong><br />
PM. Cet excès de laxité générait une rotation axiale excessive sur<br />
<strong>les</strong> PF lors <strong>des</strong> activités endécharge. En revanche, lors <strong>des</strong><br />
activités en charge, la rotation axiale <strong>des</strong> PM était supérieure (p <<br />
0,05) en moyenne de 10°àcelle <strong>des</strong> PF et ceci avec une meilleure<br />
stabilité dans le plan frontal. L’étude n’a pas mis en évidence de<br />
différence entre PF et PM pour l’amplitude de flexion. Chez <strong>les</strong><br />
patients porteurs d’une prothèse PM, il n’existait pas de différence<br />
significative d’amplitude <strong>des</strong> 3 rotations dans tous <strong>les</strong><br />
mouvements étudiés entre le genou prothèse et le genou sain<br />
controlatéral. Pour <strong>les</strong> patients porteurs d’une prothèse PF, <strong>les</strong><br />
amplitu<strong>des</strong> de rotation axiale et de mouvement dans le plan<br />
frontal étaient inférieures pour le genou prothèse par rapport au<br />
genou sain controlatéral (p < 0,05).
CONCLUSION. Notre étude, sur un <strong>des</strong>sin prothétique unique,<br />
a montré l’intérêt du plateau mobile pour <strong>les</strong> amplitu<strong>des</strong> de<br />
rotation axiale lors <strong>des</strong> activités en charge. La cinématique <strong>des</strong><br />
prothèses à PM se rapprochait plus de celle du genou sain. Les<br />
meilleures amplitu<strong>des</strong> de rotation axiale <strong>des</strong> PM lors <strong>des</strong> activités<br />
en charge évoque la persistance de la mobilité du plateau mobile<br />
au recul qui doit cependant être confirmée par une étude cinématographique.<br />
*T. Trichard, Service d’Orthopédie C, Hôpital Roger-Salengro,<br />
CHRU de Lille, rue du 8 Mai 1945, 59037 Lille Cedex.<br />
178 Influence du <strong>des</strong>sin et de la position<br />
<strong>des</strong> implants sur <strong>les</strong> amplitu<strong>des</strong><br />
maxima<strong>les</strong> de flexion après prothèse<br />
totale de genou<br />
J.-N. ARGENSON*, S. AIRAUDI, J.-M. AUBANIAC<br />
INTRODUCTION. L’intérêt actuel pour une flexion postopératoire<br />
supérieure à 120° chez certains patients pose <strong>des</strong> problèmes<br />
en terme de sollicitation du polyéthylène, de stabilité et de<br />
technique chirurgicale. Le but de cette étude clinique et radiographique<br />
comparative est l’analyse de certains de ces facteurs.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Nous avons étudié 2 groupes<br />
de prothèses tota<strong>les</strong> de genou postéro-stabilisées à plateaux<br />
mobi<strong>les</strong>. Dans le groupe A (23 cas) le plateau était mobile en<br />
rotation et en translation. Dans le groupe B (36 cas) le plateau<br />
n’était mobile qu’en rotation et le condyle postérieur était<br />
allongé. Nous avons étudié sur le plan clinique la flexion pré et<br />
postopératoire avec un recul d’un an. Sur le plan radiographique<br />
ont été étudiés : axe mécanique, hauteur de l’interligne articulaire,<br />
hauteur rotulienne et empatement prothétique antéropostérieur.<br />
Dans <strong>les</strong> deux groupes la technique chirurgicale comprenait<br />
une arthrotomie parapatellaire interne et le régimederééducation<br />
était identique.<br />
RÉSULTATS. Il n’existait aucune différence statistiquement<br />
significative entre <strong>les</strong> deux groupes concernant âge, sexe, poids,<br />
taille <strong>des</strong> patients, diagnostic préopératoire, et flexion, préopératoire<br />
avec en moyenne 120,8° (90° à130°) dans le groupe A et<br />
120,7° (90° à140°) dans le groupe B. La flexion postopératoire<br />
moyenne était de 114,8° (50° à140°) dans le groupe A et de<br />
130,4° (90° à 150°) dans le groupe B avec une différence<br />
statistiquement significative. Deux épiso<strong>des</strong> d’instabilité sont<br />
survenus dans le groupe A et aucun dans le groupe B. Il n’existait<br />
pas de différence concernant l’axe mécanique pré ou postopératoire<br />
et la hauteur rotulienne. Il existait une différence sur la<br />
hauteur de l’interligne et l’empatement prothétique.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. Le gain de flexion dans le<br />
groupe B doit intégrer un empatement prothétique moindre et<br />
l’utilisation plus systématique de distracteurs pour nettoyer la<br />
partie postérieure du genou. Si le <strong>des</strong>sin du condyle postérieur<br />
intervient également, il assure surtout une meilleure congruence<br />
au-delà de 120°.Ladifférence de stabilité entre <strong>les</strong> deux groupes<br />
peut être liée à la différence de hauteur entre le sommet du plot<br />
tibial et la came de postéro-stabilisation. Cette étude montre que<br />
l’obtention d’une flexion, importante est possible après prothèse<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 2S103<br />
totale de genou chez certains patients liée à <strong>des</strong> facteurs chirurgicaux<br />
mais avec <strong>des</strong> implications directes sur le <strong>des</strong>sin prothétique.<br />
*J.-N. Argenson, Service de Chirurgie Orthopédique,<br />
Hôpital Sainte-Marguerite, 270, boulevard<br />
de Sainte-Marguerite, BP 29, 13274 Marseille Cedex 9.<br />
179 Réglage de la rotation de la pièce<br />
fémorale dans <strong>les</strong> prothèses tota<strong>les</strong><br />
de genou : étude clinique et tomodensitométrique<br />
de 20 cas<br />
F. MENGUY*, C. HULET, Y.ACQUITTER,<br />
D. SOUQUET, B.LOCKER, C.VIELPEAU<br />
INTRODUCTION. Le positionnement en rotation externe de<br />
l’implant fémoral est un sujet encore controversé. Il peut être<br />
déterminé par rapport à <strong>des</strong> repères osseux fémoraux (ligne de<br />
Whiteside, parallèle à l’axe biépicondylien, 3° de rotation externe<br />
par rapport au plan condylien postérieur). Nous avons choisi<br />
depuis 7 ans de lier la rotation fémorale à l’orientation de la<br />
coupe tibiale afin d’assurer une bonne stabilité fémorotibiale en<br />
flexion en utilisant un ancillaire spécifique (Corest). Ce travail<br />
prospectif que nous rapportons avait pour but d’étudier la position<br />
de l’implant fémoral déterminé selon cette méthode et de la<br />
mesurer par rapport aux repères osseux fémoraux.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Vingts patients consécutifs ont<br />
été inclus. Des mesures scanographiques bilatéra<strong>les</strong> ont été effectuées<br />
avant et après l’intervention. Des coupes jointives de 8<br />
mm/8 ont été faites sur <strong>les</strong> cols fémoraux et de 5 mm/3 sur <strong>les</strong><br />
genoux. L’angle de torsion fémorale mesuré a été défini de deux<br />
manières : la première par l’angle formé entre l’axe du col<br />
fémoral (sur deux coupes superposées) et la tangente à la partie la<br />
plus postérieure <strong>des</strong> condy<strong>les</strong> fémoraux ; la deuxième par l’angle<br />
formé entre la ligne <strong>des</strong> épicondy<strong>les</strong> et la ligne condylienne<br />
postérieure.<br />
RÉSULTATS. L’étude scanographique préopératoire montrait<br />
que l’angle entre l’axe biépicondylien et la ligne condylienne<br />
postérieure était de 5,8° ± 1,5. L’utilisation du Corest a entraîné<br />
une mise en rotation externe de l’implant fémoral de 2,7° ± 0,6.<br />
Les mesures scanographiques postopératoires montraient que<br />
l’angle entre l’axe biépicondylien et le plan postérieur <strong>des</strong> condy<strong>les</strong><br />
prothétiques était en moyenne de 3,3°. Les mesures par<br />
rapport à l’axe du col fémoral apparaissaient moins précises, avec<br />
dans ce cas, une rotation externe de 5°. La rotule était équilibrée<br />
en post-opératoire (décalage rotulien de 0,75 mm sur le DFP<br />
contre 1,5 mm avant l’intervention) quelle que soit la position en<br />
rotation externe de l’implant fémoral.<br />
DISCUSSION. L’angle de près de6° entre la ligne biépicondylienne<br />
et le plan postérieur <strong>des</strong> condy<strong>les</strong> a également été trouvé<br />
par d’autres auteurs (Beaufils, Matsuda). Pour obtenir un espace<br />
rectangulaire en flexion, <strong>les</strong> coupes condyliennes postérieures<br />
sont plus importantes en interne qu’en externe. Nous avons<br />
retrouvé une corrélation entre la correction apportée par l’ancillaire<br />
et la différence de coupe <strong>des</strong> condy<strong>les</strong> postérieurs, ce qui<br />
montre la précision per-opératoire de l’ancillaire. Orienter la
2S104 77 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
pièce fémorale parallèlement à l’axe bi-épicondylien est difficile.<br />
Cette étude montre qu’il reste toujours 2 à 3° d’inclinaison de<br />
l’axe bi-épicondylien sur le plan condylien postérieur.<br />
CONCLUSION. Le positionnement de l’implant fémoral<br />
parallèlement à la ligne biépicondylienne conduirait à lui donner<br />
une rotation externe très importante. Une rotation systématique<br />
de 3° réduit <strong>les</strong> risques de malrotation interne mais il nous semble<br />
préférable de l’adapter aux variations anatomiques de chaque<br />
genou. L’ancillaire Corest permet de placer l’implant fémoral en<br />
rotation externe en fonction de l’équilibre ligamentaire obtenu en<br />
flexion après mise en tension <strong>des</strong> plans périphériques. On peut<br />
ainsi éviter une laxité fémorotibiale externe en flexion.<br />
*F. Menguy, Département d’Orthopédie, CHU de Caen,<br />
avenue de la Côte-de-Nacre, 14033 Caen Cedex.<br />
180 Résultats à plus de 5 ans d’une<br />
prothèse totale à conservation du<br />
ligament croisé postérieur (LCP) :<br />
étude du devenir du composant<br />
rotulien encastré<br />
D. HUTEN*, P. BOYER, M.BASSAINE<br />
ET LE GROUPE GUEPAR<br />
Les complications rotuliennes sont parmi <strong>les</strong> plus fréquentes<br />
<strong>des</strong> prothèses tota<strong>les</strong> du genou. L’encastrement de la pièce<br />
rotulienne permet de s’opposer aux forces de cisaillement qui<br />
tendent à la <strong>des</strong>celler. Les auteurs étudient <strong>les</strong> résultats à plus de<br />
5 ans d’une prothèse à conservation du LCP possédant un<br />
médaillon rotulien encastré, asymétrique, à plot central cimenté.<br />
L’instrumentation assure la maintien de l’épaisseur rotulienne.<br />
104 prothèses ayant plus de 5 ans de recul ont été revues. 6 ont été<br />
perdues de vue. 98 sont en place. Les complications rotuliennes<br />
ont été <strong>les</strong> suivantes :<br />
− 4 fractures à faible déplacement du rebord osseux supérieur<br />
sont survenues. Une seule était symptomatique. Elle a consolidé<br />
et la douleur régressait mais le médaillon a été changé ailleurs.<br />
− 3 fractures rotuliennes vertica<strong>les</strong> et peu déplacées ont consolidé.<br />
2 ont été symptomatiques temporairement. Une fracture<br />
transversale, polaire supérieure et déplacée a entraîné un défaut<br />
d’extension active.<br />
− 8 enfoncements modérés ont été notés, surtout visib<strong>les</strong> de<br />
profil (changement d’orientation du médaillon avec fracture du<br />
ciment). Aucun n’est symptomatique.<br />
Il n’y a pas de différence significative entre <strong>les</strong> résultats<br />
fonctionnels <strong>des</strong> patients (douleur : 40,9, mobilité : 21,9, score<br />
genou : 84,3) présentant une complication rotulienne et ceux de<br />
l’ensemble de la série.<br />
Une prothèse asymétrique expose à une erreur d’orientation (2<br />
cas au début de l’expérience). L’encastrement limite la médialisation<br />
; néanmoins, le centrage était satisfaisant (rotule centrée:<br />
95,2 %, bascule : 3,6 %, subluxation : 1,2 %). L’encastrement<br />
procure un mur osseux périphérique qui protège contre <strong>les</strong> forces<br />
de cisaillement transversa<strong>les</strong>. Le mur latéral ne s’est pas fracturé,<br />
ce qui témoigne de son efficacité. Le mur supérieur peut se<br />
fracturer au niveau sous l’effet <strong>des</strong> forces de flexion, sans consé-<br />
quence fonctionnelle. Les autres fractures, favorisées par la<br />
section de l’aileron rotulien latéral (P < 0,05), n’ont pas été<br />
reprises. Un enfoncement modéré mais certain a été noté 8 fois.<br />
Cet enfoncement a été constaté à3,5 ans en moyenne (de 1 à 6<br />
ans). Il est du à la défaillance du support osseux sous l’effet <strong>des</strong><br />
forces de compression appliquées sur une faible surface. En effet,<br />
le diamètre <strong>des</strong> pièces rotuliennes encastrées dépasse très rarement<br />
25 mm. Une fois la prothèse enfoncée, seule la périphérie<br />
de la rotule s’articule avec la trochlée et l’enfoncement ne<br />
s’aggrave pas. Ce contact n’a jamais entraîné de douleur.<br />
L’évolution et <strong>les</strong> complications <strong>des</strong> prothèses encastrées diffèrent<br />
donc de cel<strong>les</strong>, mieux connues, <strong>des</strong> prothèses apposées.<br />
*D. Huten, Service de Chirurgie Orthopédique, Hôpital Bichat,<br />
46, rue Henri-Huchard, 75877 Paris Cedex.<br />
181 Prothèse totale de genou (PTG)<br />
Interax (Howmedica) non cimentée<br />
avec conservation du ligament<br />
croisé postérieur (LCP) : à propos<br />
de 109 cas avec plus de 5 ans de<br />
recul<br />
P.-P. MILL*, G. ASENCIO, R.BERTIN,<br />
P. KOUYOUMDJIAN, S.HACINI, B.MEGY<br />
INTRODUCTION. Les auteurs rapportent <strong>les</strong> résultats à plus<br />
de 5 ans de recul moyen d’une série continue de PTG non<br />
cimentées avec préservation du LCP.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. La série comportait 109 primoimplantations<br />
réalisées chez 98 patients d’âge moyen 67,7 ans<br />
entre 1994 et 1998. La prothèse Interax possédait un revêtement<br />
Press-Fit macroporeux, recouvert d’hydroxyapatite dès 1996. La<br />
patella était resurfacée dans 92 % <strong>des</strong> cas avec un bouton en<br />
polyéthylène cimenté.<br />
La gestion de l’équilibre ligamentaire et de l’espace articulaire<br />
était réalisée par une libération ligamentaire progressive grâce à<br />
un tenseur derby.<br />
L’évaluation clinique a été faite selon le score KSS.<br />
L’évaluation radiologique a porté sur l’axe fémorotibial, le<br />
positionnement <strong>des</strong> implants et <strong>les</strong> interfaces os-implants.<br />
RÉSULTATS. Sept (6,4 %) patients ont été perdus de vue.<br />
Quinze (13,4 %) patients étaient décédésoudéments et 2 (1,8 %)<br />
infections tardives ont été traitées à part. 85 (77,9 %) patients<br />
constituaient le collectif révisé à5,2 ans de recul moyen. Cliniquement,<br />
le score KSS genou est passé de 33,4 en préopératoire<br />
à 79,4 au dernier recul. Le score KSS fonction est passé de 55,1<br />
à 82,4.<br />
La flexion du genou est passée de 124,5° à113,1°.<br />
Il existait à distance 4,8 % de laxités antéropostérieures supérieures<br />
à 5mm.<br />
Radiologiquement, l’angle fémorotibial mécanique est passé<br />
de 184,4° à180,6°. L’angle alpha était à 95,6°, l’angle bêta à<br />
89,1°, l’angle oméga à 4,77°, l’angle gamma à 3,8° et l’angle<br />
sigma à 89,4°.
La hauteur patellaire est passée de 0,84 à 0,65.<br />
Nous avons observé 3,5 fois moins de liserés à l’interface<br />
os-implant avec <strong>les</strong> implants recouverts d’hydroxyapatite.<br />
Un <strong>des</strong>cellement patellaire et un <strong>des</strong>cellement fémorotibial<br />
sont survenus.<br />
Trois prothèses ont été reprises ; pour <strong>des</strong>cellemnt bipolaire,<br />
pour raideur douloureuse et pour instabilité antéropostérieure.<br />
Le taux de survie hors causes septiques était 94,1 % à 5,2 ans.<br />
DISCUSSION. Les résultats cliniques à moyen terme sont<br />
comparab<strong>les</strong> à ceux récents de la littérature, concernant <strong>les</strong><br />
implants cimentés ou non, avec ou sans conservation du ligament<br />
croisé postérieur.<br />
182 La tarsectomie antérieure dans le<br />
traitement du pied creux antérieur<br />
de l’adulte : résultats à long terme<br />
de 39 interventions<br />
G. DAUPLAT*, O. LE RUE, C.MAYNOU,<br />
H. MESTDAGH<br />
INTRODUCTION. La tarsectomie antérieure de Méary est<br />
une intervention qui a fait ses preuves dans le traitement chirurgical<br />
du pied creux de l’adulte. Cependant aucune étude ne<br />
rapporte de résultats à long terme. Nous avons revu 39 pieds<br />
creux antérieurs ou mixtes traités par cette tarsectomie avec un<br />
recul moyen de 10 ans. Notre objectif était de confirmer <strong>les</strong><br />
résultats de cette intervention à long terme et d’évaluer ses<br />
conséquences sur <strong>les</strong> articulations adjacentes.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. L’âge moyen <strong>des</strong> patients était<br />
de 30 ans. L’étiologie neurologique était la plus fréquente<br />
(57,6 %). La plupart <strong>des</strong> déformations étaient complexes associant,<br />
un équin et un varus de l’arrière-pied, une pronation et une<br />
adduction de l’avant-pied. Ces anomalies étaient douloureuses<br />
dans 85 % <strong>des</strong> cas.<br />
Nous avons utilisé le barème de cotation fonctionnelle de<br />
l’AOFAS. Le bilan radiographique pré-opératoire retrouvait une<br />
angle de Djian à 100° et un angle de Tomeno à 23°.<br />
RÉSULTATS. Le score final moyen était de 69,2/100. Le<br />
résultat final était jugé excellent ou bon dans 66 % <strong>des</strong> cas. Les<br />
douleurs ont nettement régressé dans 75 % <strong>des</strong> cas même si<br />
seulement 28 % <strong>des</strong> patients étaient asymptomatiques. Les déformations<br />
de l’avant-pied étaient réduites dans 67 % <strong>des</strong> cas et<br />
l’arrière-pied était axé dans 68 % <strong>des</strong> cas. L’inclinaison calcanéenne<br />
s’est spontanément réduite de 6°.Undéfaut de correction<br />
persistait dans 80 % <strong>des</strong> cas mais l’angle de Tomeno restait<br />
inférieur à 10° dans 70 % <strong>des</strong> cas. 74 % <strong>des</strong> pieds présentaient<br />
<strong>des</strong> signes radiographiques d’arthroses touchant particulièrement<br />
<strong>les</strong> articulations sous-talienne et médio-tarsienne.<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 2S105<br />
Séance du 14 novembre après-midi<br />
CHEVILLE/PIED<br />
Un recul à long terme est néanmoins nécessaire pour juger de<br />
l’évolution de la stabilité antéropostérieure.<br />
L’évaluation <strong>des</strong> ang<strong>les</strong> et <strong>des</strong> axes radiologiques est à l’actif<br />
de la précision technique per opératoire et de l’équilibrage ligamentaire.<br />
Le revêtement avec hydroxyapatite améliore la fixation<br />
osseuse <strong>des</strong> implants, apportant une qualité de fixation comparable<br />
aux implants cimentés.<br />
CONCLUSION. Notre série confirme la fiabilité à moyen<br />
terme de la PTG Interax non cimentée avec conservation du LCP.<br />
*P.-P. Mill, Service d’Orthopédie, CHU de Nîmes,<br />
5, rue Hoche, 30029 Nîmes Cedex 4.<br />
DISCUSSION. Les 2 seuls critères pronostiques préopératoires<br />
étaient l’étiologie qui influence le résultat fonctionnel<br />
et la soup<strong>les</strong>se <strong>des</strong> articulations de l’arrière-pied qui conditionne<br />
<strong>les</strong> capacités de correction. Les alignements, surtout celui de<br />
l’arrière-pied, et l’arthrose, influençaient le résultat fonctionnel.<br />
Il existe une corrélation anatomo-fonctionnelle particulièrement<br />
évidente pour la ligne de Méary-Tomeno dont la continuité<br />
doit être rétablie. Si nous obtenons une correction spontanée <strong>des</strong><br />
déformations compensatrices fronta<strong>les</strong> et sagitta<strong>les</strong> de l’arrièrepied,<br />
il convient d’effectuer <strong>des</strong> gestes spécifiques sur <strong>les</strong> griffes<br />
<strong>des</strong> orteils et sur l’équinisme. Il faut aussi préserver l’interligne<br />
de Lisfranc au même titre que celui de Chopart. La tarsectomie a<br />
<strong>des</strong> capacités de correction limitées. Pour garantir <strong>des</strong> résultats<br />
anatomiques et fonctionnels satisfaisants elle doit donc se limiter<br />
à <strong>des</strong> pieds creux antérieurs soup<strong>les</strong> et modérés pour préserver <strong>les</strong><br />
articulations maîtresses du pied et avec un varus calcanéen<br />
modéré et réductible afin d’éviter un geste complémentaire.<br />
*G. Dauplat, Service d’Orthopédie A, Hôpital Roger-Salengro,<br />
CHRU de Lille, rue du 8 mai 1945, 59037 Lille Cedex.<br />
183 Récidive d’hallux valgus traitée par<br />
arthrodèse métatarso-phalangienne :<br />
à propos de 32 cas<br />
O. JARDE*, J. VERNOIS, S.MASSY, A.DAMOTTE,<br />
P. MERTL<br />
INTRODUCTION. Les auteurs rapportent une série de 32<br />
récidives d’hallux valgus traitées par arthrodèse métatarsophalangienne<br />
ayant 5 ans de recul minimum.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Le recul moyen entre la chirurgie<br />
initiale et la reprise était de 11 ans. Tous <strong>les</strong> patients se<br />
plaignaient de douleurs de l’avant pied. L’angle moyen du valgus<br />
phalangien était de 39° avec 16 métatarsalgies. L’interligne
2S106 77 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
articulaire métatarsophalangien du gros orteil était selon la classification<br />
de Regnauld : 2 fois stade 1, 8 fois stade 2a, 6 fois stade<br />
2b, 16 fois stade 3. L’arthrodèse était réalisée grâce à une vis<br />
axiale et une plastic de l’adductor hallux.<br />
Les résultats ont été appréciés avec un recul minimum de 5 ans<br />
selon <strong>les</strong> critères de Kitaoka. Il a été fait une étude statistique.<br />
RÉSULTATS. A la révision il existait une indolence dans 78 %<br />
<strong>des</strong> cas. La déviation en valgus a été corrigée avec un angle<br />
moyen de 19°. L’arthrodèse a fusionné dans 90,6 % <strong>des</strong> cas. Les<br />
tests statistiques ont montré l’influence du valgus du gros orteil<br />
en pré et post-opératoire sur le résultat final. Plus l’âge du patient<br />
à la reprise était élevé moins le résultat final était bon. Le résultat<br />
global était 84 % de très bons, 6 % de moyens et 10 % de<br />
mauvais résultats.<br />
CONCLUSION. Les résultats montrent que l’arthrodèse du<br />
gros orteil n’est pas une intervention invalidante. Une arthrose<br />
interphalangienne peut apparaître par hypersollicitation de l’articulation.<br />
*O. Jarde, CHU Nord, place Victor-Pauchet,<br />
80054 Amiens Cedex 1.<br />
184 Ostéonécrose aseptique de l’os<br />
naviculaire : à propos de 25 cas<br />
Y. CATONNÉ*, D. RIBEYRE,<br />
H. PASCAL-MOUSSELARD, J.-M. COGNET,<br />
O. DELATTRE, C.POEY, J.-L. ROUVILLAIN<br />
INTRODUCTION. La nécrose de l’os naviculaire, décrite par<br />
Müller puis par Weiss en 1927 est réputée rare, contrairement à<br />
l’arthrose talo-naviculaire, complication relativement fréquente<br />
du pied plat valgus. Entre 1985 et 2000 nous avons rencontré 25<br />
cas de cette affection. Le but de cette étude rétrospective est de<br />
préciser <strong>les</strong> signes cliniques et radiologiques de cette affection, de<br />
tenter de reconstituer son évolution naturelle et de préciser <strong>les</strong><br />
indications thérapeutiques.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Nous avons regroupé 25 observations<br />
dans <strong>les</strong>quel<strong>les</strong> le diagnostic de nécrose du naviculaire a<br />
été porté :ils’agissait de 14 femmes et 3 hommes (8 formes<br />
bilatéra<strong>les</strong>), tous de race noire. L’âge moyen était de 39 ans<br />
(extrêmes 16 et 59 ans). Le diagnostic de nécrose a été porté<br />
devant <strong>les</strong> altérations de structure (densification, parfois géo<strong>des</strong>)<br />
et dans <strong>les</strong> formes plus évoluées l’aplatissement et l’« expulsion<br />
» de l’os naviculaire.<br />
Nous avons recherché <strong>les</strong> signes cliniques et précisé l’aspect<br />
radiologique <strong>des</strong> nécroses. Un scanner a été fait dans <strong>les</strong> 14 cas<br />
<strong>les</strong> plus récents et une IRM dans 5 cas.<br />
RÉSULTATS. La douleur était dans tous <strong>les</strong> cas le signe<br />
motivant la consultation. Dans 1/3 <strong>des</strong> cas on retrouvait un pied<br />
plat valgus préexistant. L’interrogatoire retrouvait <strong>des</strong> éléments<br />
pouvant invoquer une étiologie dans 3 cas : antécédents probab<strong>les</strong><br />
de maladie de Köhler-Mouchet chez un ado<strong>les</strong>cent de 16 ans,<br />
drépanocytose SC chez un homme de 35 ans, marche prolongée<br />
avec signes évoquant une fracture de fatigue chez une femme de<br />
40 ans. Dans <strong>les</strong> 19 autres cas (11 femmes et un homme) dont <strong>les</strong><br />
7 cas bilatéraux, la nécrose pouvait être considérée comme<br />
idiopathique. Au plan radiologique, nous avons utilisé la classification<br />
de Ficat pour <strong>les</strong> hanches : stade 0 avec radio normale et<br />
hyper-fixation scintigraphique (1 cas), stade 1 avec forme normale<br />
de l’os naviculaire mais condensation ou géode intraosseuse,<br />
stade 2 avec modification de forme sans arthrose, stade<br />
3où <strong>les</strong> modifications de forme s’accompagnent d’une altération<br />
de l’interligne talo-naviculaire puis cunéo-naviculaire. Le scanner<br />
comportant <strong>des</strong> coupes fronta<strong>les</strong> et horizonta<strong>les</strong> ainsi qu’une<br />
reconstruction de profil semble indispensable pour apprécier<br />
l’état <strong>des</strong> interlignes de l’arrière.<br />
Le traitement a été chirurgical 12 fois et médical 13 fois. Les<br />
formes bien tolérées ont été traitées par orthèses plantaires et<br />
surveillées régulièrement. Parmi <strong>les</strong> interventions pratiquées on<br />
note une triple arthrodèse (au début de notre expérience), 2<br />
arthrodèses médio-tarsiennes, 7 arthrodèses talo-naviculaires et 2<br />
arthrodèses talo-cunéennes avec remplacement du scaphoide par<br />
un greffon iliaque.<br />
L’évolution naturelle de la nécrose a été précisée par l’étude<br />
<strong>des</strong> cas non opérés. Le début est marqué par une douleur médiotarsienne<br />
interne : à ce stade seuls la scintigraphie et l’IRM<br />
peuvent affirmer le diagnostic. Au stade 0 la condensation de l’os<br />
naviculaire, bien précisée par le scanner précède son aplatissement<br />
puis son expulsion en haut et en dedans, avec parfois<br />
fragmentation et l’apparition d’une arthrose talo-naviculaire.<br />
L’arthrose cunéo-naviculaire semble plus tardive (sauf dans un<br />
cas). Les résultats à long terme de la chirurgie sont bons au plan<br />
de la douleur et de la reprise de l’activité.<br />
DISCUSSION. Le tableau initialement décrit sous le nom de<br />
scaphoidite ou maladie de Müller-Weiss, semble assez différent<br />
de notre <strong>des</strong>cription : il s’agit d’une atteinte bilatérale, survenant<br />
en règle dans <strong>les</strong> suites d’un traumatisme avec parfois un facteur<br />
favorisant (alcoolisme, ostéoporose).<br />
Les facteurs mécaniques nous semblent prédominants et l’étiologie<br />
a de nombreuses similitu<strong>des</strong> avec la maladie de Kienböck.<br />
L’hyperpression exercée sur l’os naviculaire aboutissant à sa<br />
nécrose avasculaire, son aplatissement et son expulsion est sans<br />
doute la cause essentielle de cette affection.<br />
L’affection est parfois bien tolérée et peut aboutir à une fusion<br />
spontanée del’interligne. On peut alors se contenter d’une surveillance<br />
ou de moyens orthopédiques. En cas de gêne fonctionnelle<br />
plus importante un traitement chirurgical peut être proposé :<br />
une arthrodèse limitée talo-naviculaire suffit le plus souvent. Si<br />
l’os naviculaire est très scléreux et aplati, le fragment restant peut<br />
être remplacé par une greffe iliaque, réalisant une arthrodèse<br />
talo-cunéenne.<br />
CONCLUSION. La nécrose de l’os naviculaire nous semble<br />
moins rare qu’il est classique de le dire, du moins sur ce qui paraît<br />
être son terrain de prédilection : la femme de race noire âgée de<br />
25 à 50 ans. Une étude plus précise <strong>des</strong> facteurs anatomiques<br />
favorisants (longueur du rayon interne, taille du col du talus,<br />
effondrement de l’arche interne) pourra peut-être apporter <strong>des</strong><br />
informations sur son étiologie qui semble proche de celle de la<br />
maladie de Kienböck.<br />
*Y. Catonné, Service de Chirurgie Orthopédique<br />
et Traumatologique 2C, CHU de Fort-de-France,<br />
Hôpital Pierre-Zobda-Quitman, BP 632,<br />
97261 Fort-de-France Cedex.
185 Mobilité de l’articulation tibiofibulaire<br />
distale : caractérisation<br />
tomodensitométrique in vivo par la<br />
méthode du relèvement<br />
C. DUJARDIN*, X. CASSAGNAUD, H.MIGAUD,<br />
A. COTTEN, C.FONTAINE<br />
INTRODUCTION. Impliquée dans la stabilité et la mobilité<br />
de la cheville, l’articulation tibio-fibulaire distale a bénéficié de<br />
moins d’intérêt que l’articulation talo-tibiale.<br />
Sa mobilité au sein du complexe talo-crural n’est pas définie de<br />
manière aussi claire que son rôle statique dans la mortaise<br />
tibio-fibulaire.<br />
L’objectif de ce travail était de mettre au point une méthode<br />
simple non invasive et reproductible pour caractériser in vivo la<br />
mobilité de la fibula au niveau de la cheville, entre ses positions<br />
de flexion dorsale et plantaire.<br />
MATÉRIEL. Nous avons réalisé 32 scanners de chevil<strong>les</strong> chez<br />
16 volontaires sains <strong>des</strong> deux sexes dans chaque position de<br />
flexion de la cheville.<br />
MÉTHODE. Pour chaque cheville une coupe transversale au<br />
niveau de la syn<strong>des</strong>mose a été reconnue dans chacune <strong>des</strong> deux<br />
positions. Un référentiel médio-latéralyaété défini comme étant<br />
la tangente à la corticale postérieure de la métaphyse tibiale. La<br />
méthode du relèvement consiste à mesurer depuis un point<br />
remarquable du tibia ; la berge antérieure de l’incisure du tibial<br />
postérieur ; <strong>les</strong> coordonnées polaires <strong>des</strong> extrémités de l’axe<br />
antéro-postérieur de la fibula. Ces coordonnées permettent de<br />
calculer le déplacement de la fibula par rapport au tibia entre <strong>les</strong><br />
deux positions de flexion de la cheville. Répétabilité et reproductibilité<br />
de la méthode ont été testées.<br />
RÉSULTATS. La répétabilité était satisfaisante pour <strong>les</strong> mouvements<br />
de translation, la reproductibilité était moyenne sauf<br />
pour le référentiel où elle était bonne.<br />
Lorsque la cheville passait de la flexion dorsale à la flexion<br />
plantaire, la fibula se déplace médialement de 1,25 mm (0,03 à<br />
2,58 mm) (p < 0,0001) sans corrélation avec l’amplitude de<br />
flexion de la cheville.<br />
Le déplacement antéro-postérieur moyen est de 0,46 mm (NS)<br />
avec une amplitude large de -1,58 à 7,2 mm. Il était corrélé avec<br />
une moindre amplitude de flexion de la cheville.<br />
DISCUSSION. La méthode du relèvement a permis de confirmer<br />
<strong>les</strong> données connues concernant le rapprochement actif<br />
médio-latéral de la fibula et du tibia lors de la flexion plantaire.<br />
Elle pousse à s’interroger sur l’importante variabilité du mouvement<br />
antéro-postérieur de la fibula, l’influence de l’amplitude et<br />
de la position de flexion de la cheville et l’éventuel effet antépulseur<br />
<strong>des</strong> tendons fibulaires. Le caractère tri-compartimental de la<br />
cheville mérite un intérêt accru envers ses composantes tibiofibulaires<br />
et talo-fibulaires, en particulier dans l’optique de la<br />
mise au point <strong>des</strong> prothèses de cheville.<br />
CONCLUSION. La mobilité tibio-fibulaire distale, indéniable,<br />
nous incite à mieux connaître le versant latéral de la talo-crurale.<br />
*C. Dujardin, Service de Traumatologie,<br />
Hôpital de Hautepierre, 1, avenue Molière, 67098 Strasbourg.<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 2S107<br />
186 Essai de codification de la prise en<br />
charge <strong>des</strong> fractures de Maisonneuve<br />
: à propos d’une étude<br />
rétrospective de 20 cas<br />
P. TURELL*, O. ROCHE, F.SIRVEAUX,<br />
C. MARCHAL, A.BLUM, D.MOLÉ<br />
INTRODUCTION. La fracture de Maisonneuve est une<br />
variante rare <strong>des</strong> fractures malléolaires dont la prise en charge<br />
chirurgicale n’est pas codifiée. A partir d’une étude rétrospective<br />
de patients opérés, nous proposons une prise en charge adaptéede<br />
cette fracture en fonction <strong>des</strong> lésions.<br />
PATIENTS ET MÉTHODES. Il s’agit d’une étude rétrospective<br />
portant sur 20 patients opérés pour fracture de Maisonneuve<br />
entre 1989 et 2000. L’âge moyen était de 42 ans à la prise en<br />
charge, avec une majorité de sujets masculins (16 sur 20). 7<br />
patients (groupe 1) ont été traités sans vis de syn<strong>des</strong>modèse<br />
(ostéosynthèse de la malléole médiale dans 6 cas et suture du<br />
ligament collatéral médial dans 1 cas). 13 patients (groupe 2) ont<br />
été traités par abord externe premier et vis de syn<strong>des</strong>modèse,<br />
avec abord complémentaire interne dans 7 cas (2 ostéosynthèses<br />
de la malléole interne et 5 cas de suture du LCM).<br />
Alarévision, le résultat a été évalué fonctionnellement (score<br />
de Duquennoy). La qualité de la réduction et l’arthrose ont été<br />
évaluées par bilan radiographique standardisé et scanner.<br />
RÉSULTATS. Le recul moyen à la révision est de 4 ans 9 mois<br />
(1-10 ans).<br />
Les 7 patients du groupe 1 (patients non syn<strong>des</strong>modésés) ne<br />
présentaient aucun diastasis tibio-talien au recul minimum d’un<br />
an ; sur <strong>les</strong> 5 patients revus cliniquement, nous avons retrouvé 4<br />
excellents résultats et 1 résultat moyen.<br />
Dans le groupe 2 (patients syn<strong>des</strong>modésés), nous avons<br />
retrouvé 2 diastasis résiduels, 2 syn<strong>des</strong>moses serrées au recul<br />
minimum d’un an. Sur <strong>les</strong> 9 patients revus cliniquement, 3<br />
présentaient un excellent résultat et 6 un résultat moyen ou<br />
mauvais.<br />
DISCUSSION. Cette étude rétrospective vient corroborer <strong>les</strong><br />
données peu nombreuses de la littérature sur <strong>les</strong> fractures de<br />
Maisonneuve ; <strong>les</strong> lésions ligamentaires sont en effet très diverses<br />
(rupture ou non du LLI ; rupture plus ou moins complète de<br />
la membrane inter-osseuse). Dans notre expérience, l’abord premier<br />
externe pour réduire le diastasis s’est toujours révélé difficile.<br />
Par contre, l’abord médial premier, après testing, a permis<br />
dans 7 cas de se dispenser d’une vis de syn<strong>des</strong>modèse dont l’effet<br />
délétère est connu.<br />
CONCLUSION. Compte tenu de la diversité <strong>des</strong> lésions ligamentaires<br />
rencontrées dans <strong>les</strong> fractures de Maisonneuve, nous<br />
avons adopté l’attitude thérapeutique suivante, lorsqu’il existe un<br />
diastasis ; après confirmation éventuelle de l’atteinte du compartiment<br />
médial par testing, abord premier de celui-ci pour suturer<br />
le LCM ou ostéosynthéser la malléole médiale :<br />
− en cas de réduction du diastasis, nous ne préconisons pas la<br />
mise en place systématique d’une vis de syn<strong>des</strong>modèse ;
2S108 77 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
− si le diastasis persiste, abord secondaire externe, réduction<br />
du trouble de rotation malléolaire externe et mise en place d’une<br />
vis de syn<strong>des</strong>modèse.<br />
*P. Turell, Clinique de Traumatologie et d’Orthopédie,<br />
49, rue Hermite, 54000 Nancy.<br />
187 Traitement arthroscopique du<br />
conflit antéro-latéral de cheville : à<br />
propos d’une série consécutive de<br />
18 cas<br />
S. JAMBOU*, C. HULET, O.COURAGE,<br />
G. PIERRARD, B.LOCKER, C.VIELPEAU<br />
OBJECTIF. Le but de cette étude rétrospective était d’analyser<br />
<strong>les</strong> résultats du traitement arthroscopique <strong>des</strong> instabilités douloureuses<br />
de cheville sans laxité clinique ni radiologique.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Dix-huit patients d’âge moyen<br />
27 ans (7 hommes, 9 femmes) opérés entre 1999 et 2000 par un<br />
seul chirurgien ont été inclus. Seize patients (soit 90 %) ont été<br />
revus par deux examinateurs indépendants au recul moyen de 20<br />
± 4 mois.<br />
Concernant le statut fonctionnel initial, 15 patients étaient<br />
sportifs, 10 étant compétiteurs et 5 sportifs de loisirs. L’accident<br />
initial était 15 fois sur 16 un traumatisme en inversion forcée,<br />
d’origine sportive dans 85,5 % <strong>des</strong> cas, et survenant à l’âge<br />
moyen de 17 ± 6 mois. Le délai moyen entre l’accident initial et<br />
l’arthroscopie était de 8 ans. Une douleur antéro-latérale était<br />
toujours présente, associée à un épanchement dans 50 % <strong>des</strong> cas<br />
et à une appréhension ou une instabilité dans la vie quotidienne.<br />
Le bilan radiographique standard était normal pour 14 patients<br />
sur 16 (87,5 %), et <strong>les</strong> clichés en stress comparatifs ne montraient<br />
pas de laxité pathologique. Une iconographie complémentaire<br />
qu’elle soit par IRM, scanner, arthroscanner ou échographie a été<br />
réalisée 6 fois avec 50 % de faux négatifs. L’arthroscopie a<br />
retrouvé une interposition tissulaire antérieure [13 fois (81 %) en<br />
antéro-latéral et 3 fois en antéro-médial et antéro-latéral], excisée<br />
au shaver. Le cartilage articulaire était intact chez 15 patients soit<br />
81,25 % <strong>des</strong> cas.<br />
RÉSULTATS. Au dernier recul <strong>les</strong> résultats fonctionnels<br />
étaient bons, tous <strong>les</strong> patients pratiquant une activité sportive<br />
avaient repris cette dernière. Subjectivement, 6 patients estimaient<br />
avoir une fonction normale, 7 patients une fonction<br />
presque normale et 3 une fonction anormale (81 % <strong>des</strong> patients<br />
satisfaits ou très satisfaits). 6 patients étaient totalement asymptomatiques<br />
même lors <strong>des</strong> activités physiques intenses. 8 patients<br />
signalaient une gêne à l’effort, et 2 patients étaient gênés pour <strong>des</strong><br />
activitésmodérées. La mobilitéétait normale 10 fois et 6 patients<br />
avaient un déficit de flexion dorsale de 5°. Aucun nouvel épisode<br />
d’entorse n’était survenu. 87,5 % <strong>des</strong> patients présentaient une<br />
radiographie normale et identique à celle avant l’intervention.<br />
Globalement, 87,5 % <strong>des</strong> patients présentaient un bon ou excellent<br />
résultat alors que 2 patients présentaient un résultat moyen<br />
ou mauvais.<br />
CONCLUSION. Le diagnostic de conflit antéro-latéral de<br />
cheville repose sur une histoire traumatique compatible, un<br />
tableau clinique typique, et un bilan radiographique normal sans<br />
laxité. Le traitement arthroscopique par résection du conflit<br />
d’interposition tissulaire antéro-latérale permet d’obtenir de bons<br />
résultats fonctionnels et une reprise totale <strong>des</strong> activités sportives.<br />
Les examens complémentaires type IRM ou arthroscanner sont<br />
peu spécifiques et peu sensib<strong>les</strong>.<br />
*S. Jambou, Département d’Orthopédie, CHU de Caen,<br />
avenue de la Côte-de-Nacre, 14033 Caen Cedex.<br />
188 Les luxations sous-taliennes : une<br />
entité rare. Revue de douze cas<br />
avec un recul moyen de 10 ans<br />
P. BRUNET*, F. DUBRANA, A.BURGAUD, D.LE<br />
NEN, C.LEFÈVRE<br />
INTRODUCTION. Les luxations sous-taliennes sont rares.<br />
El<strong>les</strong> correspondent à une dislocation talo-calcanéenne et talonaviculaire,<br />
puisque le pied est luxé en bloc sous le talus. El<strong>les</strong><br />
intéressent le plus souvent <strong>les</strong> adultes jeunes et actifs. Leur<br />
pronostic est lié au risque de sepsis et de nécrose talienne.<br />
Le but de ce travail rétrospectif est d’individualiser <strong>les</strong> facteurs<br />
influençant le résultat clinique à long terme.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Entre 1984 et 1999, douze luxations<br />
sous-taliennes ont été traitées dans le service. Il s’agissait de<br />
neuf luxations latéra<strong>les</strong> et de trois luxations média<strong>les</strong>. Six luxations<br />
latéra<strong>les</strong> étaient ouvertes, la tête du talus étant alors exposée<br />
en médial. Le traitement a consisté en une réduction orthopédique<br />
en urgence associée à un parage et une fermeture cutanée lors<br />
d’ouverture. Un brochage temporaire (45 jours) entre le talus et le<br />
calcanéus a été réalisé dans six cas. Il existait deux lésions du<br />
pédicule tibial postérieur qui a été réparé en urgence. Un lambeau<br />
supra-malléolaire latéral de Masquelet a été nécessaire une fois<br />
dans le cas d’une nécrose cutanée exposant le jambier antérieur.<br />
L’immobilisation post-opératoire dans tous <strong>les</strong> cas a consisté<br />
en une botte plâtrée maintenue 45 jours.<br />
RÉSULTATS. Le recul moyen de la série était de dix ans. Les<br />
résultats cliniques étaient bons dans onze cas (seule la flexion<br />
dorsale est légèrement diminuée, 10° en moyenne) et médiocres<br />
dans un cas. Nous n’avons pas eu à déplorer de nécrose talienne<br />
ou d’arthrose sous-talienne.<br />
DISCUSSION. Notre série confirme <strong>les</strong> données de la littérature,<br />
<strong>les</strong> luxations pures ont en règle un pronostic favorable.<br />
Cependant plusieurs faits sont en contradiction avec la littérature<br />
:<br />
− Les luxations latéra<strong>les</strong> sont plus fréquentes que <strong>les</strong> luxations<br />
média<strong>les</strong> dans notre série ;<br />
− L’ouverture cutanée est fréquente et n’est pas un facteur de<br />
mauvais pronostic.<br />
L’absence de nécrose talienne est liée à la conservation de la<br />
branche deltoïdienne de l’artère tibiale postérieure et au respect<br />
<strong>des</strong> collatéra<strong>les</strong> de l’artère péronière qui vascularisent le tubercule<br />
postéro-latéral et le sinus du tarse.<br />
La réduction en urgence <strong>des</strong> luxations péri-taliennes lève la<br />
souffrance vasculaire et limite le risque infectieux. Le maintien
du talus sur le calcanéus par une broche temporaire est indispensable<br />
si l’articulation est instable après laréduction.<br />
*P. Brunet, Service Orthopédie Traumatologie,<br />
CHU de La Cavale-Blanche, boulevard Tanguy-Prigent,<br />
29609 Brest Cedex.<br />
189 Etude expérimentale comparative<br />
de deux techniques d’allongement<br />
du tendon d’Achille<br />
F. PFEFFER*, R. TRAVERSARI, L.GALOIS,<br />
J.-P. DELAGOUTTE<br />
INTRODUCTION. La ténotomie du tendon d’Achille peut<br />
être pratiquée selon diverses techniques chirurgica<strong>les</strong>. La première<br />
est effectuée à ciel ouvert et consiste en une ténotomie<br />
classique en marche d’escalier suivie d’une suture. La seconde,<br />
est percutanée et comprend deux incisions transversa<strong>les</strong> opposées<br />
sur la largeur tendineuse suivies d’une mise en contrainte du<br />
tendon permettant un glissement <strong>des</strong> fibres entre el<strong>les</strong>. Les propriétés<br />
biomécaniques et histologiques <strong>des</strong> tendons opères ont été<br />
analysées dans le cadre d’une étude expérimentale chez le lapin.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. 18 lapins de type New-Zealand<br />
ont été opérés. Les tendons opérés et <strong>les</strong> témoins étaient prélevés<br />
au 15 e ou au 30 e jour. Leurs propriétés biomécaniques (résistance,<br />
élasticité,déformation) étaient mesurées sur un appareil de<br />
type Instrom. Ils étaient ensuite analysés histologiquement, tout<br />
principalement au niveau de la charnière tendineuse, selon <strong>les</strong><br />
techniques de coloration standard.<br />
RÉSULTATS. Les deux techniques chirurgica<strong>les</strong> ont été d’une<br />
excellente reproductibilité technique. Nous n’avons eu aucun cas<br />
de souffrance cutanée oud’infection. 12 tendons prélevés aux<br />
différents temps ont pu être testés dans de bonnes conditions<br />
techniques et histologiques. La méthode de fixation <strong>des</strong> tendons<br />
sur le système d’Instrom restait seul facteur limitant de la<br />
méthode. Les résultats obtenus sur <strong>les</strong> premiers tendons testésne<br />
montraient pas de différence significative pour la force maximale<br />
(TC15 = 118 N, TP15 = 127 N) et la force subie avant rupture<br />
(TC15 = 104 N, TP15 = 114 N). En revanche, l’allongement<br />
maximal avant rupture (TC15 =27mm,TP15 =43mm),la<br />
section du tendon (TC15 =35mm 2 ,TP15 =27mm 2 ), la contrainte<br />
maximale (TC15 = 3,5 mPa, TP15 = 4,6 mPa), le pourcentage de<br />
déformation à la force maximale (TC15 =39%,TP15 = 28 %), la<br />
ténacité <strong>des</strong> fibres (TC15 = 6041 Gm/Denier, TP15 = 6451<br />
Gm/Denier) et l’élasticité (TC15 = 27,7 mPa, TP15 = 43,7 mPa)<br />
diffèraient.<br />
DISCUSSION. La section <strong>des</strong> tendons est différente selon <strong>les</strong><br />
deux modalités d’allongement. Macroscopiquement, <strong>les</strong> tendons<br />
TP prennent un aspect fusiforme régulier qu’on ne retrouve pas<br />
pour <strong>les</strong> tendons TC. Les forces maxima<strong>les</strong> supportées et <strong>les</strong><br />
forces avant rupture sont superposab<strong>les</strong> dans <strong>les</strong> deux cohortes.<br />
Nous pouvons considérer que si <strong>les</strong> deux tendons étaient de<br />
section identique, <strong>les</strong> tendons TP seraient significativement plus<br />
résistants. Le glissement <strong>des</strong> fibres tendineuses entre el<strong>les</strong> explique<br />
cela. Par ailleurs, le glissement s’effectuant par application<br />
de contraintes sur <strong>les</strong> libres, l’allongement se fait au dépens <strong>des</strong><br />
fibres <strong>les</strong> moins résistantes et <strong>les</strong> moins élastiques. Histologique-<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 2S109<br />
ment, le processus de cicatrisation est également différent entre<br />
<strong>les</strong> deux types de techniques, ce qui influence <strong>les</strong> propriétés<br />
définitives.<br />
CONCLUSION. Les propriétés derésistance et d’élasticité<br />
sont différentes entre ces deux techniques de ténotomie. Les<br />
propriétés biomécaniques sont excellentes, la cicatrisation et le<br />
recrutement <strong>des</strong> fibres tendineuses étant adaptée aux sollicitations<br />
physiologiques. Dans ces conditions, l’allongement percutané<br />
est une excellente technique par sa fiabilité, sa facilité<br />
d’exécution et la qualité du cal fibreux qu’elle forme.<br />
*F. Pfeffer, CHU de Nancy,<br />
29, avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny,<br />
CO n o 34, 54035 Nancy Cedex.<br />
190 Résultats à long terme du traitement<br />
chirurgical <strong>des</strong> tendinopathies<br />
d’Achille : à propos de 154 cas<br />
C. BOGGIONE*, P. THOREUX, G.SAILLANT<br />
INTRODUCTION. Les tendinopathies chroniques d’Achille<br />
sont fréquentes et leur traitement essentiellement conservateur<br />
est difficile et long. Le traitement chirurgical est indiqué dans <strong>les</strong><br />
formes rebel<strong>les</strong> au traitement médical.<br />
Le but de cette étude est d’évaluer, à différents reculs et selon<br />
le type de tendinopathie traitée, <strong>les</strong> résultats, de notre technique<br />
chirurgicale réalisée à ciel ouvert.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Nous avons étudié rétrospectivement<br />
une série de 154 cas de tendinopathies d’Achille chez 136<br />
patients (104 hommes et 32 femmes) opérés entre 03/85 et 10/97.<br />
L’âge moyen était de 35,5 ans (extrêmes de 16 et 70 ans). Un<br />
sport était régulièrement pratiqué dans 146 <strong>des</strong> 154 cas (compétition<br />
dans 120 cas).<br />
Il s’agisait de tendinopathies rebel<strong>les</strong> au traitement conservateur<br />
prolongé (durée moyenne d’évolution de 33,4 mois, extrêmes<br />
de 3 mois et 15 ans) et invalidantes (72 cas de stade III-A et<br />
82 cas de stade III-B selon Blazina). Les tendinopathies étaient<br />
réparties en 78 cas de tendinopathies d’insertion (59 cas sans<br />
désinsertion, 19 cas avec désinsertion partielle), 49 cas de tendinopathies<br />
du corps (32 nodulaires, 17 non nodulaires), 16 cas de<br />
ruptures partiel<strong>les</strong> et 11 cas de péritendinites isolées.<br />
La technique chirurgicale standard comprennait excision de la<br />
gaine péri-tendineuse et le peignage tendineux. Selon <strong>les</strong> lésions<br />
constatées, associés une excision <strong>des</strong> nodu<strong>les</strong>, un renfort tendineux,<br />
une résection calcanéenne ou une bursectojnie.<br />
RÉSULTATS. Les résultats globaux étaient clàssés en excellents<br />
(retour au niveau sportif antérieur sans douleur), bons<br />
(retour au niveau sportif antérieur avec légère gêne) ou mauvais<br />
(non amélioration).<br />
Les résultats de 110 cas ayant un recul supérieur à 43 mois ont<br />
été évalués à 1 an, 3 ans et au dernier recul de 7, 1 ans en<br />
moyenne (extrêmes de 43 mois et 147 mois.<br />
Les résultats globaux étaient superposab<strong>les</strong> aux différents<br />
reculs et étaient au dernier recul, répartis en 70 % excellents,
2S110 77 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
18,2 % bons et 11,8 % mauvais. On note <strong>des</strong> complications<br />
loca<strong>les</strong> précoces dans 40 <strong>des</strong> 154 cas (18 retards de cicatrisation,<br />
12 hématomes, 6 nécroses cutanées, 4 infections).<br />
Les résultats globaux étaient satisfaisants et se maintennaient<br />
avec le temps. Le pronostic final dépend principalement du type<br />
de tendinopathie avec de meilleurs résultats pour <strong>les</strong> péritendinites<br />
isolées et <strong>les</strong> tendinopathies du corps.<br />
191 Influence <strong>des</strong> rayons de courbure<br />
glénoïdien et céphalique dans <strong>les</strong><br />
prothèses tota<strong>les</strong> d’épaule<br />
G. WALCH*, P. ADELEINE, B.EDWARDS,<br />
P. BOILEAU, D.MOLÉ<br />
INTRODUCTION. Dans <strong>les</strong> prothèses tota<strong>les</strong> d’épaule non<br />
contraintes le mismatch est la différence de rayon de courbure<br />
entre la tête humérale et la glène. Le but de cette étude était<br />
d’évaluer <strong>les</strong> effets du mismatch sur <strong>les</strong> liserés glénoïdiens<br />
radiographiques et sur <strong>les</strong> résultats cliniques.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. La population d’étude comportait<br />
319 prothèses tota<strong>les</strong> d’épaule issues d’une série multicentrique<br />
européenne. Les patients ont été opérés avec un diagnostic<br />
unique d’omarthrose primitive, l’âge moyen à l’opération était de<br />
67 ans et <strong>les</strong> femmes étaient plus nombreuses (75 %) que <strong>les</strong><br />
hommes. Une rupture partielle du supra-épineux était présente<br />
dans 7 % <strong>des</strong> cas et une rupture complète dans 7 % <strong>des</strong> cas<br />
également. Un seul type de prothèse a été utilisé, composé d’un<br />
pivot huméral à tête modulaire (sept tail<strong>les</strong> de tête) et d’une glène<br />
en polyéthylène cimentée, fond plat à quille (trois tail<strong>les</strong> de<br />
glène). L’association variable <strong>des</strong> têtes huméra<strong>les</strong> et <strong>des</strong> glènes<br />
prothétiques définissait le mismatch dont la valeur était comprise<br />
entre 0 et 10mm (différence de rayon de courbure entre la tête et<br />
la glène). Les patients ont été revus cliniquement et radiographiquement<br />
avec un recul de 53,5 mois (24 à 110 mois). Les résultats<br />
cliniques ont été appréciés selon le score de Constant sur la<br />
douleur (15 points), l’activité quotidienne (20 points), la mobilité<br />
(40 points) et la force (25 points). Le liseré glénoïdien a été<br />
évalué sur la radiographie de face sur une échelle de 0 à 18 points<br />
(0 point pour absence, 18 points pour liseré de plus de 2 mm dans<br />
6 zones). Une analyse de variance et une régression linéaire ont<br />
été réalisées pour évaluer l’influence du mismatch sur le liseré<br />
glénoïdien et <strong>les</strong> résultats cliniques.<br />
RÉSULTATS. Il existait une relation linéaire statistiquement<br />
significative entre mismatch et liseré glénoïdien. Le score liseré<br />
était significativement plus faible lorsque le mismatch était compris<br />
entre 6 et 10 mm. Aucune influence du mismatch n’a été<br />
retrouvée ni sur le score de Constant ni sur chacun de ses items<br />
pris individuellement (douleur, mobilité, force, activitésdelavie<br />
quotidienne), ni sur <strong>les</strong> complications postopératoires immédiates<br />
et tardives.<br />
Séance du 14 novembre après-midi<br />
ÉPAULE/COUDE<br />
CONCLUSION. La chirurgie <strong>des</strong> tendinopathies chroniques<br />
d’Achille permet d’obtenir <strong>des</strong> résultats globaux satisfaisants et<br />
stab<strong>les</strong> mais dépendants du type de lésion traitée.<br />
*C. Boggione, Service de Chirurgie Orthopédique,<br />
Hôpital Pitié-Salpêtrière, 47-83, boulevard de l’Hôpital,<br />
75651 Paris Cedex 13.<br />
DISCUSSION – CONCLUSION. En fonction de cette étude,<br />
la première réalisée in vivo, le mismatch gléno-huméral « idéal »<br />
<strong>des</strong> prothèses tota<strong>les</strong> d’épaule se situe entre 6 et 10 mm, donc<br />
nettement plus élevé que ce qui était classiquement recommandé<br />
(de 0 à 5 mm).<br />
*G. Walch, Clinique Sainte-Anne-Lumière,<br />
85, cours Albert-Thomas, 69003 Lyon.<br />
192 Ostéononécrose avasculaire de<br />
l’épaule. Analyse <strong>des</strong> résultats de la<br />
chirurgie prothétique en fonction du<br />
stade radiographique : intérêtd’une<br />
nouvelle classification<br />
L. NOVÉ-JOSSERAND*, M. BASSO, G.VERSIER,<br />
G. WALCH<br />
INTRODUCTION. Devant une ostéonécrose avasculaire de<br />
l’épaule, l’indication de prothèse humérale ou totale dépend du<br />
stade radiographique de nécrose. Le but de cette étude est d’analyser<br />
<strong>les</strong> facteurs radiographiques pronostics permettant d’affiner<br />
<strong>les</strong> indications <strong>des</strong> prothèses huméra<strong>les</strong> et tota<strong>les</strong>.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Il s’agit d’une étude rétrospective<br />
multicentrique portant sur 53 épau<strong>les</strong> opérées d’une prothèse<br />
pour ostéonécrose avasculaire. Il y avait 20 hommes et 29<br />
femmes. L’âge moyen était de 57 ans. La prothèse était humérale<br />
dans 34 cas et totale dans 19 cas. L’analyse clinique a été réalisée<br />
selon le score de Constant et l’analyse radiographique selon la<br />
classification de Arlet et Ficat. Il y avait 4 sta<strong>des</strong> II, 16 sta<strong>des</strong> III,<br />
21 sta<strong>des</strong> IV et 12 sta<strong>des</strong> V.<br />
Indépendamment du stade radiographique de nécrose, 3 groupes<br />
caractéristiques ont été définis :<br />
Le groupe 1 (19 épau<strong>les</strong>) comporte <strong>les</strong> nécroses sans collapsus<br />
osseux de la tête humérale.<br />
Le groupe 2 (20 épau<strong>les</strong>) comporte <strong>les</strong> nécroses avec collapsus<br />
osseux de la tête humérale, avec conservation <strong>des</strong> rapports anatomiques<br />
avec la glène.<br />
Le groupe 3 (14 épau<strong>les</strong>) comporte <strong>les</strong> nécroses avec collapsus<br />
osseux et impaction de la tête humérale sur la glène avec médialisation<br />
de l’humérus.
RÉSULTATS. En préopératoire, l’existence d’un collapsus<br />
osseux s’accompagne d’une diminution du score douleur et<br />
mobilité. Le groupe 3 présente une raideur articulaire majeure<br />
(8).<br />
La prothèse humérale donne <strong>des</strong> résultats similaires pour <strong>les</strong><br />
groupes 1 et 2 (Constant 73 et 75,3). Le groupe 3 se caractérise<br />
par un résultat très inférieur (Constant 51,6). Il existe une érosion<br />
glénoïdienne postopératoire dans 83 % <strong>des</strong> cas pour le groupe 3<br />
contre 12,5 % dans le groupe 1 et 17 % dans le groupe 2.<br />
La prothèse totale optimise <strong>les</strong> résultats malgré la persistance<br />
d’une différence de 19 points entre <strong>les</strong> groupes 2 et 3 (Constant<br />
83 et 64).<br />
DISCUSSION. La déstabilisation de l’articulation glénohumérale<br />
par impaction de la tête humérale contre la glène<br />
retentit sur le plan clinique et sur le résultat de la chirurgie<br />
prothétique. Le respect <strong>des</strong> rapports anatomiques articulaires<br />
(groupes 1 et 2) semble le garant de bon résultat. L’impactionmédialisation<br />
humérale a une incidence péjorative sur le résultat<br />
<strong>des</strong> prothèses huméra<strong>les</strong> avec évolution vers l’érosion glénoïdienne.<br />
CONCLUSION. Indépendamment du stade radiographique de<br />
la nécrose, l’existence d’une impaction humérale avec médialisation<br />
mérite d’être individualisée car il s’agit d’un facteur<br />
péjoratif pour le résultat <strong>des</strong> prothèses en particulier huméra<strong>les</strong>.<br />
*L. Nové-Josserand, Clinique Sainte-Anne-Lumière,<br />
85, cours Albert-Thomas, 69003 Lyon.<br />
193 Reprise chirurgicale après faillite de<br />
l’implant glénoïdien <strong>des</strong> prothèses<br />
d’épaule : à propos de 16 cas<br />
L. NEYTON*, F. SIRVEAUX, O.ROCHE,<br />
P. BOILEAU, G.WALCH, D.MOLÉ<br />
INTRODUCTION. La faillite du composant glénoïdien représente<br />
la principale complication <strong>des</strong> prothèses tota<strong>les</strong> d’épaule.<br />
Lorsqu’une reprise chirurgicale est nécessaire, le chirurgien peut<br />
prendre l’option d’une nouvelle implantation prothétique ou<br />
réaliser une plastie non prothétique (glénoïdoplastie). Le but de<br />
ce travail est d’analyser <strong>les</strong> résultats obtenus avec ces deux<br />
techniques pour proposer une conduite à tenir adaptée.<br />
PATIENTS ET MÉTHODES. Cette étude rétrospective comporte<br />
16 patients d’un âge moyen de 62 ans au moment de la<br />
réintervention. Les échecs étaient constitués de 9 cas de <strong>des</strong>cellement<br />
d’implant glénoïdien cimenté et de 7 cas de faillite<br />
d’implant non cimenté (3 défauts d’ancrage et 4 déclipsage de<br />
l’insert en polyéthylène). Le délai moyen était de 39 mois (2-178)<br />
après la première intervention. 9 patients ont fait l’objet d’une<br />
repose d’implant glénoïdien cimenté (groupe 1) et 7 patients<br />
(groupe 2) ont été traités par glénoïdoplastie avec greffe iliaque<br />
dans 4 cas.<br />
RÉSULTATS. Au recul moyen de 37 mois (19-73), le score de<br />
Constant est passé, de 18 points au moment de la reprise, à 52<br />
points (+ 34 points). Deux patients ont présenté <strong>des</strong> complications<br />
nécessitant une reprise chirurgicale (une infection, une<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 2S111<br />
instabilité) et un patient a été réopéré pour ténodèse du biceps.<br />
Dans un cas de glénoïdoplastie avec greffe iliaque, la mise en<br />
place d’une prothèse inversée aété possible dans un second<br />
temps.<br />
Dans le groupe 1, le score moyen à la révision est de 63 points<br />
(+ 45 points) avec un score douleur de 11 points et un score<br />
mobilité de 29 points. Dans le groupe 2, le score de Constant<br />
moyen est de 37 points (+ 19 points) avec un score douleur de 6<br />
points et un score mobilité de 16 points. Dans ce groupe, le score<br />
moyen est de 48 points lorsqu’une greffe a été réalisée au niveau<br />
de la glène et de 21 points lorsqu’une dépose simple de l’implant<br />
a été réalisée.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. La reprise d’un implant<br />
glénoïdien reste une intervention difficile mais efficace sur <strong>les</strong><br />
douleurs, la mobilité et le score de Constant. Les faib<strong>les</strong> effectifs<br />
ne permettent pas une analyse statistique mais <strong>les</strong> résultats sont<br />
en faveur d’une réimplantation prothétique lorsque le stock<br />
osseux le permet. Dans le cas contraire, la réalisation d’une greffe<br />
est préférable à la simple dépose de l’implant, ce geste permettant<br />
éventuellement la repose d’un implant glénoïdien dans un second<br />
temps.<br />
*L. Neyton, Clinique de Traumatologie et d’Orthopédie,<br />
49, rue Hermite, 54000 Nancy.<br />
194 Instabilité antérieure <strong>des</strong> prothèses<br />
d’épaule : causes et traitements<br />
P. BOILEAU*, P. AHRENS, G.WALCH,<br />
C. TROJANI, E.HOVORKA, J.-S. COSTE<br />
BUT. Rapporter <strong>les</strong> causes et le résultat du traitement <strong>des</strong><br />
instabilités antérieures survenant après prothèse d’épaule.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Etude rétrospective, multicentrique<br />
de 51 patients présentant une instabilité antérieure prothétique<br />
: 42 cas après prothèse d’épaule de première intention et 9<br />
cas après une révision prothétique). Il s’agissait de 39 femmes<br />
(76 %) et 12 hommes d’âge moyen 67 ans, opérés par prothèse<br />
totale dans 29 cas (57 %) et par hémiarthroplastie dans 22 cas<br />
(43 %). 38 patients (75 %) présentaient <strong>des</strong> luxations prothétiques<br />
et 13 (25 %) <strong>des</strong> subluxations associés à <strong>des</strong> douleurs et une<br />
perte de l’élévation antérieure. La pathologie ayant motivé la<br />
prothèse initiale était une omarthrose (29 cas) une arthrite rhumatoïde<br />
(7 cas), et une fracture dans 15 cas. L’instabilité antérieure<br />
prothétique est survenue de manière précoce (dans <strong>les</strong> 6<br />
premières semaines) dans 23 cas ou de manière tardive dans 28<br />
cas (7 cas traumatiques ; 21 cas atraumatiques). Un traitement<br />
conservateur par réduction-immobilisation était réalisé dans 16<br />
cas et une révision prothétique dans 35 cas. Les patients ont été<br />
revus et radiographiés avec un recul de 41 mois (24-62 mois).<br />
RÉSULTATS. Une rupture ou une incompétence du sousscapulaire<br />
était la principale cause d’instabilité antérieure prothétique,<br />
retrouvée dans 87 % <strong>des</strong> cas. Des erreurs techniques<br />
concernant la prothèse étaient également retrouvées : tête prothétique<br />
trop grosse, malrotation prothétique. Les complications<br />
associées étaient fréquentes : <strong>des</strong>cellement glénoïdien (24 %),<br />
dissociation du polyethylène de l’implant glénoïdien métallique
2S112 77 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
(10 %), infection (10 %), fracture humérale (4 %). Le score final<br />
de Constant était de 54 points et 55 % <strong>des</strong> patients étaient déçus<br />
ou mécontents. Aucune épaule n’était stable après traitement<br />
conservateur. La révision prothétique donnait <strong>des</strong> résultats décevants<br />
avec 51 % d’instabilité antérieure récidivante.<br />
CONCLUSION. L’instabilité antérieure <strong>des</strong> prothèses<br />
d’épaule est une complication grave dont le traitement est décevant.<br />
Le lâchage de la suture du sous-scapulaire en est la principale<br />
cause.<br />
*P. Boileau, Service de Chirurgie Orthopédique,<br />
Hôpital de l’Archet II,<br />
151, route de Saint-Antoine-de-Ginestière, 06200 Nice.<br />
195 Les infections après prothèse<br />
d’épaule<br />
J.-S. COSTE*, S. REIG, C.TROJANI, P.BOILEAU<br />
INTRODUCTION. Le but de cette étude est d’analyser l’épidémiologie,<br />
la prise en charge et le taux de guérison de 49<br />
prothèses d’épaule infectées.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Etude rétrospective multicentrique<br />
portant sur 2396 prothèses d’épaule au recul minimum de<br />
2 ans (recul moyen 34 mois) : 2146 prothèses de première<br />
intention et 250 prothèses de reprise. Les résultats ont été analysés<br />
en fonction du :<br />
− délai d’apparition de l’infection : 14 cas aiguës (moins de 2<br />
mois aprèsl’opération), 6 cas sub-aiguë (entre 2 mois et 1 an), 29<br />
cas chronique (supérieur à un an),<br />
− de l’étiologie ayant conduit à l’implantation de la première<br />
prothèse,<br />
− du type de prise en charge thérapeutique de l’infection.<br />
RÉSULTATS. Deux patients étant décédés et 5 patients perdus<br />
de vu, <strong>les</strong> résultats ont été évalués sur 42 patients. Le taux<br />
d’infection de la série est de 1,8 % pour <strong>les</strong> prothèses de première<br />
intention et de 4 % pour <strong>les</strong> prothèses de reprise. Fracture,<br />
omarthrose avec rupture massive de la coiffe et nécrose radique<br />
sont à haut risque infectieux (25 % pour <strong>les</strong> nécroses radiques).<br />
30 patients sont guéris de leur infection (71 %), 3 patients<br />
douteux et 9 patients infectés (29 %). Le score de Constant passe<br />
de 20 points avant la reprise pour infection à 38. L’élévation<br />
active est inférieure à l’horizontale (74°). 80 % <strong>des</strong> infections<br />
aiguës sont guéries, mais 1/3 <strong>des</strong> cas ont nécessité une nouvelle<br />
reprise. Les changements en un temps donnent <strong>les</strong> meilleurs<br />
résultats fonctionnels et <strong>les</strong> meilleurs taux de guérison. Il existe<br />
une forte corrélation entre la précocité de la prise en charge<br />
chirurgicale, un traitement antibiotique adapté et le taux de<br />
guérison.<br />
DISCUSSION. Le taux global d’infection de cette série est<br />
comparable aux données de la littérature. Le taux de guérison<br />
certain de l’infection est décevant (71 %).<br />
Concernant <strong>les</strong> infections aiguës, <strong>les</strong> patients sont réopérés<br />
trop tard et le traitement est trop lourd. Le moindre doute sur une<br />
infection aiguë doit conduire à une reprise la plus précoce<br />
possible, qui seule permet la guérison et une fonction conservée.<br />
Pour <strong>les</strong> infections chroniques, le délai entre le diagnostic et la<br />
prise en charge est trop long. Ceci conduit à une résection<br />
arthroplastie dans 1/3 <strong>des</strong> cas. Le choix et la durée <strong>des</strong> antibiotiques<br />
associé àune technique chirurgicale rigoureuse doit permettre<br />
de remplacer la résection arthroplastique par <strong>les</strong> changements<br />
de prothèse en 2 temps courts ou 1 temps, qui, pour <strong>les</strong><br />
prothèses d’épau<strong>les</strong> infectées, semblent offrir le meilleur compromis<br />
guérison-fonction.<br />
*J.-S. Coste, Service de Chirurgie Orthopédique,<br />
Hôpital de l’Archet II,<br />
151, route de Saint-Antoine-de-Ginestière, 06200 Nice.<br />
196 Etude rétrospective d’une série de<br />
20 prothèses tota<strong>les</strong> de coude GSB<br />
III avec un recul moyen de 4,3 ans<br />
Y. KERJEAN*, J. LAULAN, Y.SAINT-CAST,<br />
G. RAIMBEAU<br />
INTRODUCTION. Les résultats <strong>des</strong> prothèses tota<strong>les</strong> de<br />
coude (PTC) donnent, entre <strong>les</strong> mains de leurs concepteurs, <strong>des</strong><br />
résultats favorab<strong>les</strong>. L’objectif de ce travail était d’évaluer nos<br />
propres résultats sur une série consécutive de PTC GSB III, pour<br />
confirmer ou non la fiabilité àmoyen terme de ces prothèses.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Pendant une période de 10 ans,<br />
20 PTC GSB III ont été posées par 2 opérateurs chez 17 patientes<br />
ayant une arthropathie inflammatoire. Toutes <strong>les</strong> PTC ont été<br />
posées selon la même technique et avec la même voie d’abord.<br />
Toutes <strong>les</strong> patientes ont été revues par un examinateur indépendant<br />
avec un recul moyen de 4,3 ans (12 à 128 mois). Ont été<br />
étudiées la douleur et <strong>les</strong> mobilités pré- et post-opératoires ainsi<br />
que la fonction selon la cotation de Morrey. A la révision, la<br />
satisfaction du patient a été précisée. L’analyse radiographique<br />
était basée sur la classification de Morrey en 4 sta<strong>des</strong>. Le<br />
positionnement de la PTC, le scellement et son évolution ont été<br />
étudiés.<br />
RÉSULTATS. L’âge moyen <strong>des</strong> patientes était de 51 ans (19 à<br />
66 ans) et la PR évoluait en moyenne depuis 14 ans. La principale<br />
indication était la douleur et l’EVA pré-opératoire était en<br />
moyenne de 7/10. Tous <strong>les</strong> cou<strong>des</strong> avaient une atteinte radiologique<br />
de stade 3 ou plus. A la révision, l’EVA moyenne était de<br />
0,3/10 et le score de fonction était passé de 11/25 à 24/25. Le gain<br />
de mobilité était de 49° en flexion-extension et de 42° en<br />
pronosupination. La satisfaction moyenne était de 8,85/10 et était<br />
liée à la mobilité.<br />
Sur <strong>les</strong> radiographies à la révision, il existait : 3 fois, une image<br />
de résorption osseuse métaphysaire localisée ; 5 liserés huméraux<br />
et 2 liserés cubitaux, inférieurs à 1 mm, tous partiels et non<br />
évolutifs.<br />
Il n’y a eu aucune complication (neurologique, cutanée ou<br />
infectieuse), et le taux de survie était de 100 %.<br />
DISCUSSION. Ainsi, à moyen terme, le résultat est très<br />
favorable tant sur la douleur que sur la fonction et la satisfaction<br />
du malade. Le gain sur la mobilité est moindre avec un déficit<br />
d’extension moyen de 20° et conditionne en grande partie la<br />
satisfaction du patient.
CONCLUSION. Notre étude confirme que ce modèle de PTC<br />
donne <strong>des</strong> résultats fiab<strong>les</strong> et stab<strong>les</strong> : aucune complication clinique<br />
n’a été observée ni, dans ce délai, de <strong>des</strong>cellement. La<br />
satisfaction du patient est moindre si le coude était raide mais peu<br />
douloureux.<br />
*Y. Kerjean, Service de Chirurgie Orthopédique<br />
1, Hôpital Trousseau, CHU de Tours, 37044 Tours Cedex.<br />
197 Descellements précoces de<br />
l’implant cubital observés avec la<br />
prothèse totale de coude de<br />
Coonrad-Morrey<br />
O. DELATTRE*, H. DINTIMILLE, M.GOTTIN,<br />
J.-L. ROUVILLAIN, Y.CATONNÉ<br />
INTRODUCTION. Le <strong>des</strong>cellement reste le problème <strong>des</strong><br />
prothèses tota<strong>les</strong> de coude semi-contraintes. L’évolution de ces<br />
dernières années s’est surtout faite vers <strong>des</strong> améliorations du<br />
<strong>des</strong>sin et de la stabilité <strong>des</strong> implants huméraux. Nous rapportons<br />
sur une courte série de 9 prothèses tota<strong>les</strong> de coude de Coonrad-<br />
Morrey, trois cas de <strong>des</strong>cellements précoces de l’implant cubital<br />
et tentons d’en analyser <strong>les</strong> causes avec une revue de la littérature<br />
récente.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Neuf patients d’un âge moyen<br />
de 60 ans (57 à 63) correspondant à 5 cou<strong>des</strong> rhumatoï<strong>des</strong>, 3<br />
arthroses post-traumatiques enraidis (secteur de<br />
flexion/extension : 20°), un coude ballant post-traumatique ont<br />
bénéficié d’une prothèse totale de Coonrad-Morrey. La voie<br />
d’abord postéro-latérale de Bryan et Morrey a été utilisée dans 8<br />
cas, la voie postérieure dans 1 cas. Les résultats cliniques et<br />
l’évaluation radiologique ont été appréciés respectivement selon<br />
l’index de performance et le score de la Mayo clinic.<br />
RÉSULTATS. Au recul moyen de 3,6 ans (1,5 à 4, 7) il y avait<br />
7très bons et bons résultats (score > 75 et > à 50), 1 moyen (score<br />
< 50) et un mauvais résultat (score < à 25). 3 cou<strong>des</strong> étaient<br />
indolores, 2 présentaient <strong>des</strong> douleurs aux mouvements de force.<br />
La flexion dépassait 120° dans 4 cas (4 PR).<br />
Sur le plan radiologique, il a été retrouvé 3 <strong>des</strong>cellements de<br />
l’implant cubital correspondant à 2 liserés de type IV, 1 de type<br />
III. Un seul implant huméral présentait un liseré non évolutif de<br />
type 1. Les deux cas de liseré type IV étaient associés à une<br />
migration en translation radiale et antérieure de la tige prothétique<br />
avec effraction ou lyse de la corticale ulnaire. Les 3 <strong>des</strong>cellements<br />
cubitaux sont apparus entre la deuxième et la troisième<br />
année post-opératoire, sur deux arthroses postraumatiques très<br />
enraidies (Secteur de flexion/extension < 20°), et un coude<br />
rhumatoïde. Au dernier recul il y avait un mauvais résultat ayant<br />
nécessité une reprise chirurgicale, un résultat moyen, et un très<br />
bon résultat (liseré type 4 totalement asymptomatique).<br />
DISCUSSION. Les causes de ces <strong>des</strong>cellements sont étudiées<br />
: Difficulté technique du cimentage dans un canal médullaire<br />
très étroit – Stabilité primaire médiocre de l’implant cubital<br />
qui s’oppose à l’excellente tenue de l’implant huméral avec le<br />
greffon encastré sous l’aileron antérieur – prothèse trop<br />
contrainte. Nos résultats, similaires à ceux de Hildebrand qui<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 2S113<br />
rapporte 30 % de liserés évolutifs cubitaux, nous encouragent à<br />
restreindre l’indication de cette prothèse aux cou<strong>des</strong> instab<strong>les</strong>.<br />
*O. Delattre, Service de Chirurgie Orthopédique<br />
et Traumatologique 2C, CHU de Fort-de-France,<br />
Hôpital Pierre-Zobda-Quitman,<br />
BP 632, 97261 Fort-de-France Cedex.<br />
198 L’arthroscopie du coude dans la raideur<br />
: étude rétrospective sur 32<br />
cas<br />
C. CONSO*, R. BLETON<br />
Cette étude rétrospective avait pour but de déterminer l’apport<br />
de l’arthroscopie dans la prise en charge <strong>des</strong> raideurs modérées<br />
du coude qu’el<strong>les</strong> soient post traumatiques ou dégénératives.<br />
Entre 1992 et 2001 nous avons réalisé 31 arthroscopies de<br />
coude chez <strong>des</strong> patients présentant <strong>des</strong> raideurs modérées dont<br />
l’arc de mobilité moyen préopératoire était de 94.8°. La moyenne<br />
d’âge au moment de la chirurgie était de 41.6 ans, il y avait 9<br />
femmes et 22 hommes, le coté dominant était impliqué dans 70 %<br />
<strong>des</strong> cas. 25 patients ont pu être revus cliniquement avec un recul<br />
moyen de 32 mois (de 9 ans à 5 mois). Dans 13 cas il s’agissait<br />
d’une raideur post traumatique, dans 13 cas il s’agissait d’une<br />
raideur dégénérative sans notion de traumatisme, dans 3 cas il<br />
s’agissait de microtraumatismes répétés. Dans une majorité de<br />
cas l’intervention a consisté en un temps antérieur par deux voies<br />
d’abord puis en un temps postérieur, dans 5 cas il a été réalisé une<br />
capsulotomie antérieure, dans <strong>les</strong> autres cas l’intervention à<br />
consisté en un « nettoyage » articulaire. Dans deux cas nous<br />
avons utilisé la technique de Kashiwagi Outerbridge. Dans 5 cas<br />
la neurolyse du nerf cubital au coude a été réalisée dans le même<br />
temps opératoire.<br />
La mobilité du coude opéré a été significativement augmentée<br />
en flexion avec P = 0,01 et le f<strong>les</strong>sum significativement réduit<br />
avec P < 0,0001. Aucun de nos patients ne s’est dit aggravé après<br />
l’arthroscopie au dernier recul. Le gain moyen de mobilité était<br />
de 25°.Ce gain est significativement plus élevé lorsque nous<br />
avons réalisé une capsulotomie antérieure en fin d’intervention p<br />
< 0,001. Dans trois cas il yaeuuneperte de mobilité post<br />
opératoire. Nous n’avons eu à déplorer aucune complication per<br />
ou post opératoire. 80 % <strong>des</strong> patients s’estimaient améliorés par<br />
l’arthroscopie.<br />
L’arthroscopie du coude dans <strong>les</strong> raideurs de causes variées<br />
reste un geste difficile qui dans notre série a apporté un gain de<br />
mobilité comparable avec <strong>les</strong> autres séries de la littérature. Ce<br />
peut être une alternative moins invasive à la chirurgie à ciel<br />
ouvert dans <strong>les</strong> cas de raideur peu importante.<br />
*C. Conso, Service de Chirurgie Orthopédique<br />
et Traumatologique, Hôpital Bichat,<br />
46, rue Henri-Huchard, 75018 Paris.
2S114 77 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
199 Traitement arthroscopique de<br />
l’ostéochondromatose du coude<br />
E. DAGHER*, F. BONNOMET, X.CHIFFOLOT,<br />
Y. LEFÈBVRE, P.CLAVERT, J.LANO, J.-F. KEMPF<br />
INTRODUCTION. L’ablation de corps étrangers (CE) intraarticulaires<br />
constitue au niveau du coude l’indication majeure de<br />
l’arthroscopie. Le but de notre étude était d’évaluer notre expérience<br />
du traitement arthroscopique de l’ostéochondromatose.<br />
PATIENTS ET MÉTHODE. Entre septembre 1988 et juin<br />
2001, nous sommes intervenus par arthroscopie chez 25 patients<br />
actifs (15 travailleurs manuels, 8 sportifs dont 2 de haut niveau)<br />
qui présentaient- <strong>des</strong> CE ostéochondromateux intra-articulaires<br />
du coude. Il s’agissait en majorité d’hommes (n = 22), âgés en<br />
moyenne au moment de l’intervention de 42 ans (17-68), opérés<br />
le plus souvent du côté droit (n = 21) et dominant (n = 24). La<br />
durée d’évolution clinique moyenne avant l’arthroscopie était de<br />
2 ans. Sept patients avaient subi un traumatisme du membre<br />
supérieur (dont 5 au niveau du coude), 60 mois en moyenne<br />
(6-144) avant l’arthroscopie. L’évaluation clinique pré opératoire<br />
et à la révision (recul moyen = 60 mois, 8-138) a porté sur la<br />
douleur (EVA), la notion de blocage(s) et d’épanchement articulaire,<br />
la mobilité articulaire ainsi que sur un index fonctionnel de<br />
gêne professionnelle et lors <strong>des</strong> loisirs et un index de satisfaction<br />
subjective établis pour ce travail. Une radiographie standard et un<br />
arthroscanner ont été réalisés avant l’intervention pour repérer et<br />
évaluer le nombre <strong>des</strong> corps étrangers intra-articulaires. Les<br />
lésions cartilagineuses et la présence d’anomalies de la synoviale<br />
200 Prothèses tota<strong>les</strong> de genou avec<br />
plateau tout polyéthylène : suivi de<br />
162 prothèses avec un recul moyen<br />
de 4,5 ans<br />
L. JACQUOT*, T. AÏT SI SELMI, E.SERVIEN,<br />
P. NEYRET<br />
INTRODUCTION. Le but de ce travail est de rapporter <strong>les</strong><br />
résultats à moyen terme d’une série de 162 prothèses tota<strong>les</strong> de<br />
genou avec un plateau tibial tout polyéthylène.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Entre 1989 et 1995, 162 prothèses<br />
tota<strong>les</strong> de genou postéro stabilisées cimentées HLS 2 avec<br />
plateau tibial tout polyéthylène de première intention ont été<br />
posées sous la responsabilité d’un seul chirurgien. 142 prothèses<br />
ont été revues à plus de 1 an, 3 patients sont décédés, et 17<br />
patients ont été perdus de vue (10 %). Les données cliniques ont<br />
été analysées selon <strong>les</strong> critères IKS, <strong>les</strong> données radiologiques<br />
grâce à <strong>des</strong> bilans complets incluant <strong>des</strong> pangonogrammes.<br />
Séance du 15 novembre matin<br />
GENOU<br />
ont étéévaluées sur le scanner préopératoire et durant l’intervention.<br />
L’arthroscopie fut réalisée selon la même procédure : décubitus<br />
latéral, garrot pneumatique au bras, exploration antérieure<br />
(voies antéro-médiale et antéro-latérale) et postérieure (voie postérieure<br />
et postéro-latérale). Après l’intervention et à la révision,<br />
<strong>des</strong> radiographies standards ont été réalisées pour chaque patient.<br />
RÉSULTATS. Des CE ont été retrouvés et extraits dans tous<br />
<strong>les</strong> cas. Dans 14 cas il existait <strong>des</strong> lésions cartilagineuses associées.<br />
La synovectomie a été systématique en présence d’une<br />
synovite, d’une anomalie macroscopique de la synoviale ou pour<br />
faciliter l’extraction de CE piégés dans la synoviale (18 cas). La<br />
régularisation d’ostéophytes a été associée dans 12 cas. Les suites<br />
furent simp<strong>les</strong> et sans complication (vasculaire, nerveuse, infectieuse).<br />
L’amélioration clinique post-opératoire fut significative<br />
et prolongée au dernier recul concernant la douleur, <strong>les</strong> blocages,<br />
la mobilité articulaire et <strong>les</strong> indices fonctionnels professionnel et<br />
de loisirs. L’indice de satisfaction subjective reste élevé 5 ans en<br />
moyenne aprèsl’arthroscopie. Nous n’avons pas noté de récidive<br />
cliniquement (blocage) ou radiographiquement décelable au dernier<br />
recul. Les moins bon résultats (persistance de douleurs) ont<br />
été retrouvés chez <strong>les</strong> patients qui présentaient <strong>des</strong> lésions cartilagineuses.<br />
CONCLUSION. L’arthroscopie semble un traitement sûr et<br />
d’efficacité prolongée dans le traitement de l’ostéochondromatose<br />
du coude. Le pronostic à long terme est dominé par <strong>les</strong><br />
lésions cartilagineuses.<br />
*E. Dagher, Service d’Orthopédie, Hôpital de Hautepierre,<br />
1, avenue Molière, 67098 Strasbourg.<br />
Le recul moyen est de 4 ans et demi.<br />
RÉSULTATS. 96 % <strong>des</strong> patients sont satisfaits ou très satisfaits,<br />
95 % ne présentent pas de douleurs ou <strong>des</strong> douleurs légères.<br />
La flexion moyenne est de 114°. Le score genou moyen post<br />
opératoire est de 81/100, le score fonction de 64/100.<br />
Les résultats radiographigues montrent un bon positionnement<br />
<strong>des</strong> implants avec un AFTm moyen de 178,6°, un AFm moyen de<br />
89,1° et un ATm moyen de 89°.<br />
Ilyaeu8échecs (4,9 %) avec changement de composant, 2<br />
pour laxité frontale, 3 pour fracture de rotule, 1 pour sepsis, 1<br />
pour <strong>des</strong>cellement aseptique, et 1 pour plateau tibial trop grand.<br />
Deux reprises sans changement ont été effectuées, 1 pour<br />
douleur (prélèvements), 1 pour arthrolyse.<br />
95 % <strong>des</strong> implants sont en place avec un recul moyen de 53<br />
mois.<br />
DISCUSSION. Ces 162 prothèses avec plateau tout polyéthylène<br />
sont extraites d’une série continue de 893 prothèses HLS.<br />
Nous comparons <strong>les</strong> résultats avec ceux <strong>des</strong> prothèses avec<br />
plateau métal back de la série ainsi qu’avec <strong>les</strong> données de la<br />
littérature. Nous avons retrouvé pour <strong>les</strong> 162 prothèses avec
plateau tout polyéthylène une corrélation significative entre la<br />
présence de liserés tibiaux et <strong>les</strong> défauts d’axes post opératoires<br />
expliqués par le type de composant tibial. Ces liserés sont non<br />
évolutifs, sans conséquence clinique.<br />
CONCLUSION. Les résultats cliniques et radiographiques <strong>des</strong><br />
prothèses avec composant tibial en polyéthylène sans soutien<br />
métallique de notre série sont très bons.<br />
Nous analysons d’après notre expérience en comparaison avec<br />
la littérature, <strong>les</strong> avantages et <strong>les</strong> inconvénients de ces deux types<br />
de composants.<br />
*L. Jacquot, Centre Livet, 8, rue de Margnol<strong>les</strong>,<br />
69300 Caluire.<br />
201 Résultats à 7 ans de recul (6-8 ans)<br />
d’une série continue de 105 prothèses<br />
tota<strong>les</strong> de genou postérostabilisées<br />
HLS II<br />
E. BECQUET*, H. MIGAUD, F.GIRAUD, T.ALA<br />
EDDINE, F.GOUGEON, A.DUQUENNOY<br />
INTRODUCTION. La postéro-stabilisation par un troisième<br />
condyle a été introduite par Henri Dejour avec la prothèse HLS I.<br />
Si le procédé de postéro-stabilisation a été validé, cet implant<br />
posait <strong>des</strong> problèmes de fixation tibiale en cas d’arthrose évoluée,<br />
qui ont justifié l’évolution vers le modèle HLS II. Le but de ce<br />
travail rétrospectif était d’évaluer <strong>les</strong> résultats fonctionnels et la<br />
pérennité de la fixation de la prothèse HLS II.<br />
PATIENTS ET MÉTHODES. Entre janvier 1992 et décembre<br />
1993, 105 prothèses tota<strong>les</strong> du genou (PTG) postéro-stabilisées<br />
HLS II (94 patients) ont été implantées consécutivement (78 %<br />
pour arthrose (dont 40 % de stade 4), 19 % pour polyarthrite).<br />
Aucun patient n’a été perdu de vue, mais 14 étaient décédés, 6<br />
étaient grabataires (séquel<strong>les</strong> d’accidents neurologiques) et 4 ont<br />
été évalués seulement par téléphone. Au total 70 patients (77<br />
PTG), âgés en moyenne de 66 ans [22-79], ont été évalués<br />
cliniquement et radiographiquement au recul moyen de 7 ans<br />
(6-8). Tous <strong>les</strong> implants étaient scellés et la patella toujours<br />
resurfacée. Huit opérateurs ont participé à cette série et <strong>les</strong><br />
« juniors » (5 chefs de clinique) ont posé 1/3 <strong>des</strong> cas.<br />
RÉSULTATS. Le score IKS genou passait de 27 ± 18 points<br />
[0-63] avant l’intervention à 81 ± 18 [21-100] au recul et le score<br />
fonction de 35 ± 20 points [0-75] à 64 ± 26 [0-100] (p < 0,0001).<br />
La mobilité passait de 114° [60°-140°] à 116° [80°-135°] (NS).<br />
86 % <strong>des</strong> patients pratiquaient <strong>les</strong> escaliers (13 % sans la rampe<br />
et 28 % en pas alterné) contre 52 % avant l’intervention (1 %<br />
sans rampe et 1 % en pas alterné) (p = 0,001). Les genoux étaient<br />
normoaxés à ± 5° dans 87 % contre 27 % avant l’intervention (p<br />
< 0,001). 79 % <strong>des</strong> genoux avaient une pente à ± 2° pour une<br />
pente recherchée à 0°. Des sections du rétinaculum patellaire<br />
latéral ont été pratiquées ¼, cel<strong>les</strong>-ci ont donné lieu à 4 <strong>des</strong> 5<br />
hématomes post-opératoires (non repris). Cinq fractures patellaires<br />
étaient constatées, dont deux avec <strong>des</strong>cellement patellaire<br />
(réopérés) et un clunck (guéri après libération arthroscopique).<br />
Des lisérés, observés sous le plateau tibial médial dans 30 % <strong>des</strong><br />
cas (tous < 1 mm), étaient d’autant plus fréquents que l’arthrose<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 2S115<br />
était sévère et le genou en varus en pré-opératoire (p = 0,01).<br />
Cependant, aucun <strong>des</strong>cellement aseptique fémoro-tibial n’a été<br />
observé. Une infection tardive (30 mois) a bénéficié d’un changement.<br />
Le taux de survie, si l’on considère <strong>les</strong> échecs mécaniques<br />
et/ou septiques, était de 97 % ± 1,3 % à 90 mois de recul.<br />
CONCLUSION. Le bon contrôle <strong>des</strong> axes souligne la fiabilité<br />
de l’ancillaire de pose de cette prothèse implantée 1/3 par <strong>des</strong><br />
opérateurs en formation. Les améliorations de la fixation tibiale<br />
de la prothèse HLS II semblent avoir été efficaces notamment sur<br />
<strong>les</strong> arthroses de stade 4, même si une surveillance prolongée <strong>des</strong><br />
liserés est nécessaire. La fémoro-patellaire à l’origine <strong>des</strong> complications<br />
aseptiques doit être améliorée. Le concept de postérostabilisation<br />
par un troisième condyle autorise une bonne amplitude<br />
de flexion et favorise la pratique <strong>des</strong> escaliers.<br />
*E. Becquet, Service d’Orthopédie C, Hôpital Roger-Salengro,<br />
CHRU de Lille, rue du 8 Mai 1945, 59037 Lille Cedex.<br />
202 Echecs de PTG par instabilité<br />
fémoro-tibiale : analyse <strong>des</strong> causes<br />
de l’instabilité et déductions thérapeutiques<br />
Y. CATONNÉ*, D. RIBEYRE, C.CALVET,<br />
C. VAUDOIS, O.DELATTRE,<br />
H. PASCAL-MOUSSELARD, J.-L. ROUVILLAIN<br />
INTRODUCTION. Dans la plupart <strong>des</strong> séries de reprises de<br />
prothèses tota<strong>les</strong> de genou (PTG), l’instabilité fémoro-tibiale est<br />
une cause fréquente de l’échec, après le <strong>des</strong>cellement et <strong>les</strong><br />
complications rotuliennes. Le but de cette étude est d’analyser <strong>les</strong><br />
échecs de PTG par instabilité fémoro-tibiale, de rechercher s’il<br />
existait un défaut initial de technique ou d’indication à l’origine<br />
de cette instabilité et d’en tirer <strong>les</strong> conséquences thérapeutiques<br />
lors de la reprise.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Entre 1989 et 2000, 43 PTG<br />
ont nécessité une reprise aseptique avec changement de la prothèse<br />
(implant tibial, fémoral ou <strong>les</strong> deux). Dans la même<br />
période, 1013 PTG de première intention ont été mises en place.<br />
Parmi ces échecs de la PTG initiale le <strong>des</strong>cellement <strong>des</strong> implants<br />
(fémoral, tibial ou <strong>les</strong> deux) était en cause 22 fois, l’instabilité<br />
fémoro-tibiale isolée 15 fois. Parmi <strong>les</strong> 22 <strong>des</strong>cellements, il<br />
existait dans 7 cas <strong>des</strong> instabilités fémoro-tibia<strong>les</strong> non liées à la<br />
migration ou à l’usure <strong>des</strong> implants. Nous avons analysé <strong>les</strong> 22<br />
cas d’instabilité fémoro-tibiale d’origine ligamentaire (15 isolées,<br />
7 associées à un <strong>des</strong>cellement) en étudiant : Cliniquement,<br />
le diagnostic initial, l’âge et le sexe du patient, <strong>les</strong> manifestations<br />
de l’instabilité et le délai de la reprise par rapport à la première<br />
intervention. Radiologiquement, le type de prothèse implantéeet<br />
son positionnement (angle alpha et bêta), et en pré et postopératoire<br />
l’axe fémoro-tibial mécanique, la pente tibiale, <strong>les</strong><br />
ang<strong>les</strong> tibial et fémoral mécaniques (recherchant une déformation<br />
extra articulaire).<br />
RÉSULTATS. Les 22 reprises ont concerné 17 femmes et 5<br />
hommes. Les signes d’appel étaient la douleur et la sensation<br />
d’instabilité.Ledélai moyen de la reprise était de 2 ans et 8 mois<br />
pour <strong>les</strong> instabilités isolées et de 6 ans et demi pour <strong>les</strong> instabi-
2S116 77 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
lités associées à un <strong>des</strong>cellement. Les implants posés lors de<br />
l’intervention initiale étaient variés car ils provenaient de différents<br />
services : il s’agissait de prothèses semi contraintes. Parmi<br />
<strong>les</strong> 22 instabilités retrouvées à l’origine de la reprise on dénombrait<br />
13 instabilités fronta<strong>les</strong>, 3 instabilités sagitta<strong>les</strong> et 6 globa<strong>les</strong>.<br />
L’analyse <strong>des</strong> dossiers a permis de trouver dans 19 cas <strong>des</strong><br />
explications pouvant expliquer l’échec, plusieurs défauts pouvant<br />
être associés : relâchement insuffisant lors de l’intervention initiale<br />
(externe ou interne), ou excessif (1 fois), coupe tibiale ou<br />
fémorale en varus ou valgus, pente tibiale excessive, implant<br />
fémoral ou tibial en rotation interne, déformation extraarticulaire<br />
corrigée en intra-articulaire (4 cas), insuffisance du<br />
LLI dans <strong>les</strong> importants genu valgum (3 cas).<br />
Certains échecs sont particuliers au type d’implants : laxité<br />
postérieure après implant postéro-conservé avec insuffisance du<br />
LCP, luxation d’un implant postéro stabilisé (un cas).<br />
DISCUSSION. L’analyse <strong>des</strong> facteurs ayant conduit à l’échec<br />
par instabilité fémoro tibiale montre que l’on trouve dans la<br />
majorité <strong>des</strong> cas une explication technique à l’origine de l’instabilité<br />
:<br />
1) Les défauts de coupe et d’équilibrage ligamentaire sont<br />
fréquents : une reprise du relâchement ou de la coupe doit être<br />
faite lors du changement de prothèse.<br />
2) Les insuffisances ligamentaires concernent le plus souvent<br />
le LLI dans <strong>les</strong> importants GVG. Il faut dans ces cas utiliser une<br />
prothèse plus contrainte ou pour certains réaliser une plastie du<br />
LLI.<br />
3) Les déformations extra-articulaires sont le plus souvent<br />
retrouvées dans <strong>les</strong> genu varum majeurs. Une ostéotomie associée<br />
peut être discutée siladéformation extra-articulaire excède<br />
10°.<br />
CONCLUSION. Les instabilités fémoro-tibia<strong>les</strong> sont à l’origine<br />
d’échecs précoces de PTG. Une précision plus grande dans<br />
l’implantation <strong>des</strong> PTG, un équilibrage ligamentaire correct et le<br />
choix adéquat du degré de contrainte <strong>des</strong> implants devrait permettre<br />
d’en diminuer la fréquence.<br />
*Y. Catonné, Service de Chirurgie Orthopédique<br />
et Traumatologique 2C, CHU de Fort-de-France,<br />
Hôpital Pierre-Zobda-Quitman,<br />
BP 632, 97261 Fort-de-France Cedex.<br />
203 Prothèses tota<strong>les</strong> du genou après<br />
ostéotomie tibiale<br />
T. DE POLIGNAC*, J.-L. LERAT, A.GODENÈCHE,<br />
K. MAATOUGUI, J.-L. BESSE, B.MOYEN<br />
INTRODUCTION. Des prothèses conservant le ligament<br />
croisé postérieur (ou <strong>les</strong> deux croisés) ont été analysées dans cette<br />
indication particulière après ostéotomie tibiale. Les résultats ont<br />
été précisés en fonction du degré de l’éventuel cal vicieux tibial<br />
créé par l’ostéotomie dans le plan frontal.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. L’étude a été rétrospective à<br />
partir d’une série continue de 56 prothèses conservant le LCP(43)<br />
ou <strong>les</strong> deux croisés (13). 47 cas avaient eu <strong>des</strong> ostéotomies<br />
tibia<strong>les</strong> de valgisation et 9 cas de varisation. En fonction de<br />
l’angle tibial préopératoire au moment de la prothèse, 7 groupes<br />
ont été définis. Les ang<strong>les</strong> ont été mesurés sur télégonométrie. Le<br />
suivi minimum était de 1 an et le suivi moyen de 4,1 ans ± 2,8.<br />
RÉSULTATS. La tubérosité tibiale a été relevée dans 15 cas.<br />
Devant une déformation osseuse importante en valgus ou en<br />
rotation, une ostéotomie tibiale a été associée à la prothèse dans<br />
9 cas.<br />
Au dernier recul, <strong>les</strong> scores moyens IKSg, IKSf et HSS étaient<br />
respectivement de 81,5, 77,6 et 82,3. L’angle fémoro-tibial<br />
moyen était de 177,4° ± 4,2, l’angle tibial moyen de 87,8° ± 3et<br />
l’angle fémoral moyen de 89,8° ± 2.<br />
La déformation tibiale préopératoire n’a pas influencé <strong>les</strong><br />
résultats cliniques. En cas de déformation tibiale préopératoire<br />
située entre 5° de valgus et 5° de varus, la durée opératoire, <strong>les</strong><br />
pertes sanguines et l’axe fémoro-tibial au dernier recul n’étaient<br />
pas significativement différents. Pour corriger <strong>les</strong> déformations<br />
tibia<strong>les</strong> en valgus supérieur à 7°, une ostéotomie tibiale a été<br />
associée à la prothèse au cours du même temps opératoire dans 6<br />
cas sur 13. En cas de varus tibial préopératoire supérieur à 5°,<br />
l’axe fémoro-tibial a été moins bien corrigé.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. Les résultats cliniques<br />
étaient comparab<strong>les</strong> à ceux <strong>des</strong> autres séries conservant ou non le<br />
LCP. La correction de l’angle fémoro-tibial était moins satisfaisante<br />
que dans certaines séries, mais <strong>les</strong> déformations et <strong>les</strong><br />
antécédents chirurgicaux étaient parmi <strong>les</strong> plus importants de la<br />
littérature. La conservation du LCP (ou <strong>des</strong> deux croisés) semble<br />
avoir majoré <strong>les</strong> difficultés techniques d’exposition de l’extrémité<br />
supérieure du tibia et de positionnement de l’implant tibial.<br />
Dans <strong>les</strong> cals vicieux tibiaux en valgus supérieur à 7°, une<br />
prothèse seule ne saurait corriger la déformation et une ostéotomie<br />
associée semble pouvoir apporter une solution. Dans <strong>les</strong> cals<br />
vicieux tibiaux en varus à partir de 5°, l’indication d’une ostéotomie<br />
tibiale associée pourrait se discuter.<br />
*T. de Polignac, Service de Chirurgie Orthopédique<br />
et Traumatologique, Centre Hospitalier Lyon Sud,<br />
69495 Pierre-Bénite.<br />
204 Etude clinique de la prothèse unicompartimentale<br />
interne Oxford à<br />
10 ans de recul minimum<br />
L. LINO*, J.-N. ARGENSON, J.-M. AUBANIAC<br />
INTRODUCTION. La prothèse unicompartimentale Oxford<br />
présente <strong>des</strong> surfaces articulaires congruentes grâce à l’utilisation<br />
d’un ménisque mobile dont la partie supérieure épouse la sphère<br />
que constitue le composant fémoral. Le but de ce travail est de<br />
rapporter <strong>les</strong> résultats d’une série de 75 prothèses étudiées avec<br />
un recul moyen de 12,4 ans (10 à 14 ans).<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. L’âge moyen <strong>des</strong> patients était<br />
de 65 ans (38 à 84 ans), il y avait 67 % de femmes et l’index<br />
moyen de masse corporelle était de 28,7 (21,2 à 40,6). Les<br />
patients ont été évalués par leur appréciation subjective de<br />
l’arthroplastie et sur le plan clinique à l’aide du score IKS. Sur le<br />
plan radiographique l’axe mécanique du membre inférieur a été<br />
évalué en pré et post-opératoire sur <strong>des</strong> clichés <strong>des</strong> membres
inférieurs en totalité en charge. Le passage de l’axe mécanique au<br />
niveau du genou a été évalué àl’aide <strong>des</strong> 4 sta<strong>des</strong> de Kennedy.<br />
RÉSULTATS. Au moment du recul trois patients ont été<br />
perdus de vue et 8 décè<strong>des</strong>. L’évaluation subjective retrouve<br />
84 % de patients enthousiastes ou satisfaits et le score global IKS<br />
retrouve 52 % <strong>des</strong> patients supérieurs à 180 et 25 % supérieurs à<br />
150. Le varus moyen en pré-opératoire était de 11° (2 à 24°) etil<br />
était en moyenne de 5,7° au recul (5° valgus à 14° varus). L’axe<br />
mécanique passait en zone de correction suffisante (c ou 2) dans<br />
77 % <strong>des</strong> genoux, insuffisante dans 17 % et dans 6 % dans la zone<br />
d’hypercorrection. Sept prothèses ont été révisées pour échec<br />
mécanique : 4 pour <strong>des</strong>cellement, 2 pour extension de l’arthrose<br />
et une pour douleur donnant une courbe de survie de 90 % à 12<br />
ans. Il faut ajouter à cela 2 luxations ménisca<strong>les</strong> une précoce par<br />
désunion de plaie et sepsis et une tardive <strong>les</strong> deux après une<br />
chute.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. La plupart <strong>des</strong> <strong>des</strong>cellements<br />
sont survenus précocement et au niveau tibial. Un défaut<br />
d’axe peut être incriminé dans un cas, <strong>les</strong> autres genoux montraient<br />
régulièrement une ligne réactive à la radiographie sous le<br />
plateau tibial. Le taux de luxation devrait pouvoir être diminué<br />
grâce à l’utilisation <strong>des</strong> fraises progressives, non disponib<strong>les</strong> à<br />
l’époque. Enfin aucune prothèse n’a été reprise pour usure,<br />
confirmant le but du <strong>des</strong>sin prothétique.<br />
*L. Lino, Service de Chirurgie Orthopédique, Hôpital<br />
Sainte-Marguerite, 270, boulevard de Sainte-Marguerite,<br />
BP 29, 13274 Marseille Cedex 09.<br />
205 Etude de l’usure du polyéthylène<br />
sur <strong>des</strong> arthroplasties unicompartimenta<strong>les</strong><br />
explantées<br />
P. HERNIGOU*, G. DESCHAMPS<br />
INTRODUCTION. Cette étude a été effectuée sur <strong>des</strong> prothèses<br />
unicompartimenta<strong>les</strong> explantées comportant un plateau polyéthylène<br />
plan sans métal back. Elle précise <strong>les</strong> facteurs cliniques<br />
qui peuvent avoir influencé l’usure du polyéthylène.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. La série comporte 30 plateaux<br />
en polyéthylène répartis en deux groupes. Dans le groupe A <strong>les</strong><br />
réinterventions ont été effectuées pour une autre raison que le<br />
<strong>des</strong>cellement de l’implant (usure du compartiment opposé, problèmes<br />
fémoro-patellaires). Dans le groupe B, <strong>les</strong> implants ont<br />
été enlevés après <strong>des</strong>cellement. La durée d’implantation <strong>des</strong> 13<br />
implants du groupe A était en moyenne de 126 mois (de 11 à<br />
218) ; elle était de 167 mois (de 137 à 224) dans le groupe B.<br />
L’épaisseur restante <strong>des</strong> implants ont été mesurées à l’aide d’une<br />
machine micrométrique Mitutoyo permettant de palper la surface<br />
usée avec une précision de 3 microns. Le volume de pénétration<br />
de la pièce fémorale dans le polyéthylène a été calculé de deux<br />
manières différentes pour pouvoir séparer la pénétration liée à la<br />
déformation du polyéthylène et celle en rapport avec l’usure. La<br />
machine micrométrique palpant la surface du polyéthylène a<br />
permis de calculer la somme <strong>des</strong> volumes correspondant à l’usure<br />
et à la déformation. Pour mesurer le volume correspondant à<br />
l’usure, <strong>les</strong> pièces explantées ont été pesées et le résultat comparé<br />
à <strong>des</strong> implants de la même taille et n’ayant jamais été implantés.<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 2S117<br />
En fonction de la perte de poids et de la densité du polyéthylène,<br />
l’usure a été calculée. La différence entre <strong>les</strong> résultats obtenus par<br />
la machine micrométrique et <strong>les</strong> résultats obtenus à partir de<br />
pesées ont été attribués à la déformation du polyéthylène.<br />
RÉSULTATS. L’épaisseur résiduelle du polyéthylène dans le<br />
groupe A sans <strong>des</strong>cellement était en moyenne de 7,16 mm, et<br />
dans le groupe B en moyenne de 4,5 mm. L’empreinte volumétrique<br />
effectuée par la pièce fémorale est en moyenne de 19 mm 3<br />
par an dans le groupe A et de 65 mm 3 dans le groupe B. Cette<br />
empreinte obtenue par la machine micrométrique était supérieure<br />
à l’usure appréciée par pesée etladifférence était d’environ<br />
25 %. La diminution en épaisseur de l’implant était donc sans<br />
doute pour <strong>les</strong> trois quarts liée à l’usure seule et pour quart liée à<br />
la déformation du polyéthylène.<br />
Dans le groupe A (sans <strong>des</strong>cellement), chaque annéed’implantation<br />
supplémentaire correspondait à une diminution de la<br />
vitesse d’usure d’environ 12 % par an, ce qui laisse penser que le<br />
mécanisme d’usure est une abrasion et qu’au cours du temps <strong>les</strong><br />
implants fémoraux et tibiaux deviennent plus congruents avec<br />
une diminution de la vitesse d’usure. A l’inverse dans le groupe<br />
B, chaque année d’implantation supplémentaire après la survenue<br />
du <strong>des</strong>cellement s’accompagnait d’une augmentation de la<br />
vitesse d’usure d’environ 9 %.<br />
L’analyse au microscope <strong>des</strong> implants du groupe A montre que<br />
<strong>les</strong> mécanismes d’usure sont essentiellement l’abrasion. Dans le<br />
groupe B <strong>des</strong> mécanismes de délamination ont été observés en<br />
particulier lorsque le <strong>des</strong>cellement s’accompagnait d’une rupture<br />
du croisé antérieur ou d’une déformation importante persistant<br />
sur la goniométrie.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. Les vitesses et <strong>les</strong> mécanismes<br />
d’usure dans <strong>les</strong> prothèses unicompartimenta<strong>les</strong> sont<br />
différents pour <strong>les</strong> prothèses non <strong>des</strong>cellées et pour <strong>les</strong> prothèses<br />
<strong>des</strong>cellées. Compte tenu du fait que la déformation du polyéthylène<br />
participe (pour environ un quart) à sa diminution d’épaisseur<br />
au cours du temps, l’adjonction d’un métal back pour <strong>des</strong> plateaux<br />
de faible épaisseur apparaît indispensable.<br />
*P. Hernigou, Hôpital Henri-Mondor,<br />
51, avenue de Lattre-de-Tassigny, 94010 Créteil.<br />
206 Reprise de prothèse unicompartimentale<br />
par prothèse totale du<br />
genou : à propos d’une série de 54<br />
cas<br />
F. CHÂTAIN*, A. RICHARD, G.DESCHAMPS,<br />
P. NEYRET<br />
INTRODUCTION. Le but de ce travail est d’analyser <strong>les</strong><br />
résultats <strong>des</strong> reprises de prothèse unicompartimentale (UNI) par<br />
prothèse totale du genou (PTG) en précisant <strong>les</strong> difficultés techniques<br />
rencontrées.<br />
MATÉRIELS. Notre série comportait 54 reprises de prothèse<br />
UNI par PTG. Il y avait 45 UNI internes et 9 UNI externes. Les<br />
causes d’échecs ont été déterminées à partir de l’histoire clinique<br />
<strong>des</strong> patients, du bilan radiographique postopératoire de l’Uni-
2S118 77 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
compartimentale et préopératoire de la reprise chirurgicale, et du<br />
compte rendu opératoire. Le délai moyen de l’échec de l’UNI est<br />
de 4 ans.<br />
MÉTHODE. L’analyse <strong>des</strong> résultats cliniques à la révision, a<br />
été faite selon la cotation IKS. Le bilan radiologique comprenait<br />
une radiographie de face et de profil en appui monopodal et pour<br />
44,5 % une goniométrie. 27 patients ont été revus avec un bilan<br />
radiographique, 8 patients ont donné <strong>des</strong> nouvel<strong>les</strong>, et 19 ont fait<br />
l’objet d’une étude de dossier. Il y avait 1 décédé.<br />
RÉSULTATS. Le recul moyen était de 4 ans (2 à 12 ans). Il y<br />
aeu7échecs (13 %). Il y a eu 6 phlébites, 2 embolies pulmonaires,<br />
1 sepsis secondaire et 3 mobilisations sous anesthésie<br />
générale. 55,5 % <strong>des</strong> patients étaient très satisfaits, 36 % satisfaits,<br />
et 8,5 % déçus. La reprise a été jugée facile ou assez facile<br />
dans 82 % <strong>des</strong> cas. 39 fois (72 %) une PTG standard à glissement<br />
a été mise en place. Le score genou moyen était de 85 points, la<br />
flexion moyenne était de 113°. Le score fonction moyen était de<br />
62 points. Dans 91 % <strong>des</strong> cas, il n’y avait aucune laxité. L’angle<br />
fémorotibial était à 180° dans 46 % <strong>des</strong> cas, l’angle fémoral<br />
mécanique était à 90° dans 54 % <strong>des</strong> cas et l’angle tibial mécanique<br />
à 90° dans 46 % <strong>des</strong> cas.<br />
DISCUSSION. Nos résultats sont similaires à ceux retrouvés<br />
dans la littérature. Ils sont meilleurs que <strong>les</strong> résultats <strong>des</strong> reprises<br />
de PTG par PTG.<br />
CONCLUSION. Les résultats <strong>des</strong> reprises d’UNI par PTG<br />
sont bons. Il n’y a pas de difficultés techniques majeures liées aux<br />
pertes de substances osseuses qui sont essentiellement tibia<strong>les</strong><br />
(45 %). La planification préopératoire permet de définir <strong>les</strong><br />
modalités de la reprise (quille longue, cale métallique, prothèse<br />
de reprise). Nous recommandons l’usage de la quille tibiale<br />
longue quand il y a une perte de substance osseuse tibiale.<br />
*F. Châtain, Centre Livet, 8, rue de Margnol<strong>les</strong>,<br />
69300 Caluire.<br />
207 Une cause méconnue de douleurs<br />
sur prothèse totale du genou : le<br />
névrome infra-patellaire<br />
P.-O. PINELLI*, A. SBIHI, A.ROCHWERGER,<br />
J.-P. FRANCESCHI, G.CURVALE<br />
INTRODUCTION. L’hypoesthésie latérale du genou consécutive<br />
à la section per-opératoire du rameau sensitif infrapatellaire<br />
dans la chirurgie du genou par voie antéro-interne est<br />
banale. La survenue d’un névrome douloureux à ce niveau est<br />
plus rare, mais est une cause de douleur persistante, souvent<br />
violente de la région antéro-interne du tibia proximal faisant trop<br />
souvent évoquer à tort un diagnostic de défaillance mécanique de<br />
la prothèse par conflit superficiel ou par <strong>des</strong>cellement. La littérature<br />
orthopédique française est relativement pauvre à ce sujet.<br />
Nous souhaitons attirer l’attention sur ce diagnostic trop souvent<br />
méconnu.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Nous rapportons <strong>les</strong> cas de trois<br />
patients opérés pour gonarthrose par prothèse totale postérostabilisée<br />
par une voie d’abord antéro-interne. Une douleur persistante<br />
depuis plus de six mois <strong>les</strong> avait conduits à consulter<br />
plusieurs chirurgiens qui avaient évoqué une cause « classique »<br />
de douleurs post-opératoires par défaut de scellement prothétique<br />
alors que <strong>les</strong> radiographies et la scintigraphie n’étaient pas<br />
concluantes. L’examen clinique mettait en évidence <strong>des</strong> dysesthésies<br />
infra-patellaires externes avec un signe de Tinel positif à<br />
la face antéro-interne du genou immédiatement au <strong>des</strong>sous de<br />
l’implant prothétique tibial, faisant évoquer un névrome du<br />
rameau infra-patellaire du nerf saphène.<br />
Une étude anatomique sur dix genoux nous a permis de fixer<br />
<strong>les</strong> bases anatomiques nécessaires pour réaliser <strong>des</strong> blocs anesthésiques<br />
locaux diagnostiques dans le cadre du bilan préthérapeutique.<br />
Un test diagnostique a été réalisé par injection de<br />
5 ml. de xylocaïne dans le tissu sous-cutané de la face interne du<br />
genou en amont de la zone suspecte de névrome. La disparition<br />
complète <strong>des</strong> douleurs évaluée 10 minutes après l’injection, a<br />
conduit à proposer au patient une neurotomie du nerf infrapatellaire,<br />
par une voie d’abord séparée à la face interne du<br />
genou.<br />
RÉSULTAT. Dans <strong>les</strong> trois cas <strong>les</strong> patients ont été immédiatement<br />
soulagés par la dénervation. Dans deux cas, la douleur et la<br />
gêne ont disparu complètement. Dans un cas, la patiente a<br />
ressenti une nette amélioration de l’hyper-esthésie.<br />
DISCUSSION. Les étu<strong>des</strong> anatomiques montrent qu’une ou<br />
plusieurs branches du nerf infra-patellaire croisent la ligne<br />
médiane allant de la pointe de la rotule à la tubérosité tibiale<br />
antérieure dans 98 % <strong>des</strong> cas. Dans un travail en cours de révision<br />
de prothèses tota<strong>les</strong> du genou, nous avons noté une hypo-esthésie<br />
ou une anesthésie dans le territoire du nerf infra-patellaire chez<br />
15 % <strong>des</strong> patients. Dellon sur une série de 70 patients souffrant de<br />
névromes post-opératoires du genou, obtient 86 % de très bons<br />
résultats après dénervation.<br />
CONCLUSION. Le névrome hyper-algique iatrogène du<br />
rameau infra-patellaire du nerf saphène est une cause certes rare<br />
mais trop souvent négligée de douleurs après chirurgie du genou<br />
et plus particulièrement sur prothèse, faisant parfois évoquer à<br />
tort une complication mécanique sous-jacente. Le diagnostic<br />
évoqué cliniquement est aisément confirmé par un test d’anesthésie<br />
locale sous-cutané.Après échec <strong>des</strong> traitements physiques<br />
et médicamenteux, une neurotomie du nerf infra-patellaire peut<br />
être proposée.<br />
*P.-O. Pinelli, Service de Chirurgie Orthopédique,<br />
Hôpital de la Conception, 147, boulevard Baille,<br />
13385 Marseille Cedex 5.<br />
208 Pertes de substances cutanées sur<br />
prothèse du genou : démarche stratégique<br />
et modalitésthérapeutiques<br />
T. BÉGUÉ*, A.-C. MASQUELET<br />
INTRODUCTION. La survenue d’une perte de substance<br />
cutanée lors de la réalisation ou au décours d’une prothèse de<br />
genou expose l’implant à une infection pouvant nécessiter son<br />
ablation, grevant le pronostic fonctionnel ultérieur. L’évolution<br />
de la perte de substance est souvent imprévisible, responsable de
etard au traitement curatif incluant la couverture de cette perte<br />
de substance cutanée.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. A partir d’une série rétrospective<br />
consécutive de 1990 à 2000 de 39 prothèses de genou traitées<br />
pour une perte de substance cutanée par un lambeau de couverture,<br />
évoluant de quelques jours à plusieurs mois, <strong>les</strong> auteurs ont<br />
étudié successivement le délai de survenue de la perte de substance,<br />
la vitalité <strong>des</strong> berges de la lésion, l’existence ou non d’une<br />
exposition de l’implant, la présence ou non d’une infection. Ont<br />
été étudiés <strong>les</strong> types de lambeau de couverture utilisés, en distinguant<br />
lambeaux fascio-cutanés et musculaires, le maintien ou<br />
non de la prothèse et <strong>les</strong> temps de reconstruction secondaires.<br />
RÉSULTATS. Dans 38 <strong>des</strong> 39 prothèses, l’utilisation d’un<br />
lambeau de couverture a permis de maintenir l’implant et d’obtenir<br />
une cicatrisation. La fonction articulaire est restée dans un<br />
secteur fonctionnel. Seu<strong>les</strong> 18 prothèses ont récupéré une flexion<br />
supérieure à 90 degrés. Dans un cas, l’implant n’a pu être<br />
conservé, en raison d’une infection à Serratia résistante. Des<br />
facteurs pronostiques ont pu être mis en évidence, incluant le<br />
délai séparant la survenue de la perte de substance de son<br />
traitement, l’intérêt du recours à <strong>des</strong> lambeaux de couverture<br />
dans la sauvegarde de l’implant prothétique, ou l’utilité d’une<br />
reconstruction en deux temps en cas d’infection de l’implant.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. Les auteurs comparent<br />
leur méthodologie thérapeutique aux propositions de la classification<br />
de Laing et préfèrent une distinction tactique simplifiéeen<br />
3 sta<strong>des</strong> évolutifs, basés sur le délai d’exposition, dans la prise en<br />
charge thérapeutique <strong>des</strong> pertes de substance cutanées sur prothèse<br />
de genou.<br />
*T. Bégué, Service de Chirurgie Orthopédique<br />
et Traumatologique, Hôpital Avicenne, Université Paris XIII,<br />
93000 Bobigny.<br />
209 Apport du milieu enrichi de Rosenow<br />
au diagnostic <strong>des</strong> infections<br />
sur arthroplastie de hanche et de<br />
genou<br />
E. SENNEVILLE*, I. NALLET, C.SAVAGE,<br />
L. DUBREUIL, Y.PINOIT, H.MIGAUD<br />
INTRODUCTION. Le milieu enrichi de Rosenow (RW) permet<br />
la culture <strong>des</strong> germes anaérobies ainsi que <strong>des</strong> bactéries en<br />
croissance lente parfois en cause dans <strong>les</strong> infections chroniques<br />
sur matériel. Le but de ce travail était de préciser l’intérêtduRW<br />
pour le diagnostic bactériologique <strong>des</strong> infections sur arthroplastie<br />
de hanche (PTH) et de genou (PTG).<br />
PATIENTS ET MÉTHODES. Cent cinquante quatre prélèvements<br />
pré ou intra-opératoires associant prélèvement systématiquement<br />
standard et RW ont été réalisés defaçon prospective et<br />
consécutive chez 80 patients (âge moyen 67,6 ans), traités pour<br />
une infection sur PTH (56) ou PTG (24) entre janvier 98 et juin<br />
2000. Une bactérie était « infectante » si obtenue par culture<br />
directe ou sur au moins 2 prélèvements après enrichissement. Un<br />
seul prélèvement positif après enrichissement était considéré<br />
comme une contamination sauf pour <strong>les</strong> anaérobies stricts pour<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 2S119<br />
<strong>les</strong>quels une culture directe ne peut être obtenue. Pour ces<br />
derniers, une culture après enrichissement était donc considérée<br />
comme significative.<br />
RÉSULTATS. Parmi <strong>les</strong> 154 prélèvements, 59 fois (38 %) la<br />
culture directe était positive et 95 fois (62 %) après enrichissement.<br />
Sur <strong>les</strong> 59 cultures directes positives, le RW était concordant<br />
dans 87 % <strong>des</strong> cas. Pour <strong>les</strong> 13 % discordants, il s’agissait de<br />
germes n’ayant cultivé que sur le milieu standard : staphylocoque<br />
(6), pyocyanique (1) et entérobactérie (1). Sur <strong>les</strong> 95 cultures<br />
après enrichissement, 41 fois (43,1 %) le RW était concordant<br />
avec le milieu standard, 13 fois (13,6 %) le standard était positif<br />
et le RW négatif (11 staphylocoques dont 5 dorés, 1 pyocyanique<br />
et 1 corynébactérie), mais 41 fois (43,1 %) le RW était positif<br />
alors que le standard était stérile [16 staphylocoques (dont 13 à<br />
coagulase négative), 5 streptocoques, 2 entérocoques, 1 corynébactérie,<br />
3 entérobactéries et 14 anaérobies]. Le caractère infectant<br />
de ces bactéries aérobies a été retenu du fait de la positivité<br />
de prélèvements préalab<strong>les</strong> ou ultérieurs. La sensibilité et la<br />
valeur prédictive positive du RW étaient de 0,86/0,86.<br />
CONCLUSION. L’association du milieu de RW au prélèvement<br />
standard est utile en cas de culture obtenue après enrichissement<br />
pour affirmer le caractère infectant du germe (double<br />
culture). Le milieu de RW a montré sa fiabilité, puisqu’en cas de<br />
culture directe positive (« gold standard ») ilétait concordant<br />
dans 87 % <strong>des</strong> cas. En cas de culture après enrichissement,<br />
lorsque le prélèvement standard était négatif, le RW a permis de<br />
redresser le diagnostic d’infection dans 43 % <strong>des</strong> cas. Son intérêt<br />
essentiel réside dans l’isolement <strong>des</strong> staphylocoques à coagulase<br />
négative et <strong>des</strong> anaérobies (notamment Propionibacterium sp. et<br />
Peptostreptococcus sp.).<br />
*E. Senneville, Service Universitaire Régional<br />
<strong>des</strong> Maladies Infectieuses, Hôpital Dron, 59200 Tourcoing.<br />
210 Traitement <strong>des</strong> lésions fraîches<br />
bi-croisées du genou<br />
S. PLAWESKI*, J. CAZAL, T.MARTINEZ, A.EID,<br />
P. MERLOZ<br />
Les lésions <strong>des</strong> 2 ligaments croisés du genou demeurent une<br />
pathologie préoccupante pour le traumatologue. Cette gravité est<br />
liée à la fois au contexte traumatique de polytraumatisme et<br />
également au contexte régional d’association lésionnelle vasculaire<br />
et nerveuse. La prise en charge thérapeutique peut être<br />
multidisciplinaire, dictant un ordre de priorité thérapeutique. Le<br />
traitement orthopédique doit prendre en compte <strong>des</strong> aspects<br />
diagnostiques et thérapeutiques. Le but de ce travail a été de<br />
préciser <strong>les</strong> lésions ligamentaires observées ainsi que d’évaluer<br />
<strong>les</strong> résultats du traitement engagé.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Il s’agit d’une étude rétrospective<br />
dont la série comporte 20 patients (14 hommes, 6 femmes)<br />
âgées en moyenne de 33 ans (18-54). 5 polytraumatismes associaient<br />
<strong>des</strong> lésions crânio encéphaliques et poly fracturaires. Le<br />
diagnostic initial était de 6 luxations traumatiques du genou et 14<br />
penta<strong>des</strong>. 7 patients ont bénéficié d’explorations vasculaires en<br />
urgence avec réalisation de 3 pontages fémoro poplités. Sur le<br />
plan neurologique nous avons retrouvé 3lésions complètes du
2S120 77 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
nerf sciatique poplité externe. Le traitement a été orthopédique 3<br />
fois. Dans 3 cas nous avons mis en place une fixation externe<br />
pour une durée de 2 mois en moyenne. 6 cas ont bénéficié d’une<br />
chirurgie réalisée en semi urgence (inférieure à 8 jours), après<br />
réalisation d’une IRM. La tactique et la technique chirurgicale<br />
reposaient sur plusieurs arguments : âge, terrain, niveau lésionnel<br />
ligamentaire. 3 cas ont bénéficié d’une chirurgie secondaire sur le<br />
LCA. Les résultats ont été évalués avec un recul moyen de 36<br />
mois (20-60). Le bilan clinique a apprécié le résultat objectif avec<br />
l’étude <strong>des</strong> laxités fronta<strong>les</strong> et sagitta<strong>les</strong>, le résultat subjectif ainsi<br />
que le niveau éventuel de reprise sportive. Sur le plan radiographique<br />
nous avons étudié <strong>les</strong> clichés standards, en appui monopodal<br />
ainsi que <strong>des</strong> clichés dynamiques avec un appareil telos en<br />
tiroir antérieur puis postérieur.<br />
RÉSULTATS. En dehors d’un cas d’amputation rendu nécessaire<br />
compte tenu <strong>des</strong> lésions vasculaires et nerveuses, le traitement<br />
orthopédique a permis d’obtenir un résultat fonctionnel<br />
acceptable chez <strong>des</strong> sujets sédentaires : bonne stabilité dans le<br />
plan frontal et laxité résiduelle antéro postérieure peu péjorative.<br />
14 sujets sportifs ont bénéficié d’une chirurgie de réparation du<br />
LCP en urgence : 8 abords postérieurs pour lésion au plancher<br />
avec absence de tiroir postérieur au dernier résultat clinique et<br />
radiologique. 6 genoux ont bénéficié d’un abord antérieur dont la<br />
technique associait une suture du LCP avec mise en place d’un<br />
tuteur ligamentaire synthétique avec une réparation du LCA dans<br />
le même temps : 2 réinsertions au plancher, 1 plastie au tendon<br />
rotulien, et 3 plasties de Cho. Si le résultat a été excellent sur la<br />
stabilité du pivot postérieur il n’en a pas été de même sur le LCA<br />
avec échec <strong>des</strong> réinsertions tibia<strong>les</strong>. 7 genoux ont nécessité une<br />
mobilisation sous anesthésie générale réalisée en moyenne à 2,5<br />
mois. 3 cas ont bénéficié d’une chirurgie ligamentaire secondaire<br />
du LCA de type Kenneth Jones avec absence de Lachman au<br />
meilleur recul clinique.<br />
DISCUSSION. En dehors <strong>des</strong> urgences vasculo nerveuses<br />
dictant l’attitude thérapeutique initiale notre choix thérapeutique<br />
orthopédique a été fonction de la précision du niveau lésionnel<br />
grâce à la réalisation d’une IRM en urgence : voie d’abord<br />
postérieure ou antérieure, technique de réparation du LCA en<br />
fonction <strong>des</strong> associations lésionnel<strong>les</strong> ligamentaires périphériques.<br />
Les bons résultats sur la laxité postérieure observés dans<br />
notre série confirment l’importance et la fiabilité de la réparation<br />
du LCP en urgence. En cas d’absence de lésion du plan ligamentaire<br />
interne la rupture du LCA peut bénéficier en urgence d’une<br />
plastie de type Cho, dans <strong>les</strong> autres cas il nous semble préférable<br />
de différer cette chirurgie ligamentaire du pivot antérieur.<br />
*S. Plaweski, Service Orthopédie-Traumatologie,<br />
Hôpital Michallon, BP 217, 38043 Grenoble Cedex 09.<br />
211 La fixation externe dans <strong>les</strong> fractures<br />
dista<strong>les</strong> du fémur : résultats et<br />
indications<br />
P. CARIVEN*, P. BONNEVIALLE, P.MANSAT,<br />
L. VERHAEGHE, M.MANSAT<br />
La fixation externe (FE) a <strong>des</strong> indications restrictives dans <strong>les</strong><br />
fractures du fémur en particulier en distal. De 1986 à décembre<br />
2001, 21 FE ont été posées en première intention pour une<br />
fracture métaphyso épiphysaire distale fémorale. L’étude rétrospective<br />
de ce collectif a pour but de préciser la place de ce type<br />
d’ostéosynthèse.<br />
Il s’agissait de 14 hommes et 6 femmes (1 cas bilatéral) âgé de<br />
33 ans en moyenne (extrêmes 17 et 83) victimes exclusivement<br />
de traumatisme à haute énergie. Douze étaient polytraumatisés<br />
(ISS moyen 20), et 16 polyfracturés dont 10 genoux flottants.<br />
Selon Gustilo, <strong>les</strong> 20 lésions ouvertes se répartissaient en 1 type<br />
I, 5 types II, 14 types III dont 2 IIIC avec rupture de l’artère<br />
fémorale. Trois patients avaient <strong>des</strong> lésions de brûlure ou de<br />
« degloving » au niveau de la cuisse. Le montage a été exclusivement<br />
femoro-fémoral, par fixateur axial dynamique associé à<br />
un vissage épiphysaire complémentaire dans 8 cas. Selon l’AO, 6<br />
lésions étaient métaphysaires (1 A31, 4 A32 et 1 A33), et 15<br />
métaphyso épiphysaires (4 C2, 7 C22 et 3 C23). Les gestes<br />
associés ont été :2réparations vasculaires, 2 lambeaux de grand<br />
dorsal et 4 modifications du fixateur ou nouvelle réduction.<br />
Un patient est décédé de son polytraumatisme ; deux ont été<br />
amputés pour échec de réparation vasculaire et d’un lambeau<br />
libre. Huit patients ont consolidé avec le seul fixateur dont 2 avec<br />
greffe autologue selon une durée moyenne de 10 mois (extrêmes<br />
5 et 14). Quatre ostéites sur fiches ont guéri après ablation du<br />
fixateur. Un patient a présenté au 8° mois une fracture itérative<br />
reprise avec succès par clou rétrograde. Une mobilisation du<br />
genou a été nécessaire 4 fois, et trois arthrolyses opératoires.<br />
Dans 10 cas, le FE a été volontairement remplacé par 2 ostéosynthèses<br />
centro-médullaires (1 supra condylien/1 Grosse<br />
Kempf) et 8 plaques dont 4 associées à une autogreffe (3 transferts<br />
de péroné et une autogreffe iliaque). Ces deux temps<br />
opératoires ont été immédiats 7 fois, après une période d’attente<br />
en traction 3 fois. Les deux enclouages et 5 <strong>des</strong> ostéosynthèses<br />
par plaque ont consolidé dans un délai moyen de 8 mois (extrêmes<br />
5 et 10). Trois plaques ont abouti à un échec : deux pseudarthroses<br />
aseptiques (reprises par prothèse et arthrodèse) et une<br />
suppurée toujours en traitement.<br />
Avec recul minimum de 18 mois, 15 patients ont un résultat<br />
clinique connu et une consolidation acquise : la flexion active<br />
moyenne est de 81° (extrêmes50et120°). Un seul patient a un<br />
déficit d’extension de 10°. Neuf patients ont <strong>des</strong> axes anatomiques<br />
rétablis sur <strong>les</strong> deux incidences ; 3 sont en recurvatum de 5<br />
à 10° ; 3 ont une déviation frontale inférieure à 10°.<br />
Cette expérience démontre <strong>les</strong> difficultés deréduire correctement<br />
<strong>les</strong> axes fémoraux et de maintenir la mobilité active du<br />
genou. Elle souligne <strong>les</strong> dangers septiques en cas d’ostéosynthèse<br />
secondaire. La FE conserve <strong>des</strong> indications d’exception : rupture<br />
de l’axe vasculaire, dégâts cutanés majeurs ou en attente chez le<br />
grand polytraumatisé relayé rapidement par une ostéosynthèse<br />
stable.<br />
*P. Cariven, Service d’Orthopédie Traumatologie, Hôpital<br />
Purpan, place du Docteur-Baylac, 31052 Toulouse Cedex.
212 Etude de l’influence du <strong>des</strong>sin de<br />
l’œillet <strong>des</strong> ancres de suture sur la<br />
résistance du fil<br />
F. BONNOMET*, P. CLAVERT, E.DAGHER,<br />
P. BOUTEMY, Y.LEFÈBVRE, J.LANO, J.-F. KEMPF<br />
INTRODUCTION. Les ancres de suture utilisées pour la<br />
réinsertion osseuse <strong>des</strong> tissus mous ont fait l’objet de plusieurs<br />
étu<strong>des</strong> <strong>des</strong>tinées àévaluer la qualité de leur tenue dans l’os.<br />
Cependant, aucune de ces étu<strong>des</strong> ne s’est intéressée à l’influence<br />
du <strong>des</strong>sin de leur oeillet sur la résistance <strong>des</strong> fils de suture. Le but<br />
de ce travail fut d’étudier cet aspect du problème.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Les ancres testées étaient : Statak<br />
4 (Zimmer, Warsaw, IN, USA), Corkscrew 3,5, Fastak 2,4<br />
(Arthrex, Nap<strong>les</strong>, FL, USA), PeBA C 6,5 (OBL, Scottsdale, AZ,<br />
USA), Mitek GII (Mitek, Norwood, MA, USA), Harpoon 2<br />
(Arthrotek, Warsaw, IN, USA), Ultrafix (Linvatec, Largo, FL,<br />
USA), Vitis 3,5 et 5 (Tornier, St Ismier, France). Les fils utilisés<br />
étaient : Vicryl déc 5,Fléxidène déc 5,PDSdéc 4. Trois types<br />
d’essais ont été réalisés sur machine Instron 8500+ : pour étudier<br />
la charge à la rupture du fil, une boucle de longueur constante a<br />
été réalisée et une traction exercée dans l’axe de l’ancre jusqu’à<br />
rupture du fil selon 2 modalités :l’une statique par augmentation<br />
linéaire de la charge à la vitesse de 1,25 mm/s et l’autre cyclique<br />
par traction imposée 5 fois à la fréquence de 1 Hz avec une<br />
charge croissante par palier de 10 N. Pour étudier la fatigue de<br />
chaque fil par rapport à chaque ancre, nous avons imposé au brin<br />
passé dans l’œillet de l’ancre un va-et-vient selon une sinusoïdale<br />
de 10 mm à la fréquence de 0,03 Hz, une extrémité du fil étant<br />
fixe et l’autre supportant une charge constante de 20 N. Chaque<br />
fil fut testé pour chaque ancre et chaque type d’essai à 3 reprises.<br />
RÉSULTATS. La charge à la rupture de chacun <strong>des</strong> fils ne<br />
semblait pas affectée de façon significative par le <strong>des</strong>sin de<br />
l’œillet <strong>des</strong> ancres. La rupture du montage se produisait la plupart<br />
du temps au niveau du nœud de suture, parfois au niveau de<br />
l’œillet (Harpoon, Fastak, Vitis) pour le Fléxidène déc 5.En<br />
revanche, d’importantes différences ont été constatées dans <strong>les</strong><br />
essais de fatigue du fil: unfil tressé sur âme tel le Vicryl est<br />
nettement plus performant que <strong>les</strong> 2 autres fils testés, quelle que<br />
soit l’ancre. Par ailleurs, la résistance au coulissage est très<br />
variable d’une ancre à l’autre : 100 ± 20 cyc<strong>les</strong> pour la Corkscrew<br />
3,5 à 3 ± 1 cyc<strong>les</strong> pour la Vitis 3,5 avec le Vicryl ou 6+/1<br />
cyc<strong>les</strong> pour la Harpoon 2 avec le Fléxidène.<br />
CONCLUSION. Le <strong>des</strong>sin et l’usinage de chaque œillet<br />
influent sur la résistance au coulissage du fil de suture. Pour <strong>les</strong><br />
ancres fragilisant le fil après quelques va-et-vient, on peut supposer<br />
que la simple rélisation du noeud endommage le fil au point<br />
d’aboutir à l’échec précoce de la réinsertion. Les meilleurs<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 2S121<br />
Séance du 15 novembre matin<br />
ÉPAULE<br />
résultats sont obtenus lorsqu’il existe un chanfrein et une gorge<br />
au niveau de l’oeillet de l’ancre.<br />
*F. Bonnomet, Service d’Orthopédie, Hôpital de Hautepierre,<br />
1, avenue Molière, 67098 Strasbourg.<br />
213 Effets <strong>des</strong> sections programmées<br />
<strong>des</strong> éléments capsulaires antérieurs<br />
d’épaule sur modèle expérimental<br />
de capsulite rétractile<br />
P. BOISRENOULT*, P. GAUDIN, F.DUPARC,<br />
P. BEAUFILS, S.F.A.<br />
INTRODUCTION. Le but de notre travail a été d’étudier <strong>les</strong><br />
effets de sections séquentiel<strong>les</strong>, sous contrôle arthroscopique, de<br />
la capsule antérieure de l’épaule en utilisant un modèle expérimental<br />
de capsulite rétractile créé par rétraction thermique.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Douze épau<strong>les</strong> de sujets anatomiques<br />
ont été étudiées. Leurs mobilités passives étaient initialement<br />
norma<strong>les</strong>. Une rétraction capsulaire antérieure était<br />
d’abord créée, sous contrôle arthroscopique (générateur Arthrocare<br />
t, puissance 2). Puis, 12 séquences de sections programmées<br />
(sonde thermique Arthrocare t (puissance 9)) ont porté successivement<br />
sur : l’intervalle <strong>des</strong> rotateurs (ligament coracohuméral<br />
(LCH) et gléno-huméral supérieur (LGHS)), le ligament glénohuméral<br />
moyen (LGHM), le ligament gléno-huméral inférieur<br />
(LGHI) et la portion intra-articulaire du tendon du muscle subscapulaire<br />
(TSS). La capsule postérieure n’a pas été étudiée. A<br />
chaque étape, <strong>les</strong> mobilités obtenues étaient mesurées de façon<br />
indépendante par deux opérateurs. En fin <strong>des</strong>équence, la réalité<br />
<strong>des</strong> sections et l’absence macroscopique de lésions d’éléments<br />
nob<strong>les</strong> de voisinage était vérifiée à ciel ouvert.<br />
RÉSULTATS. Les mesures étaient reproductib<strong>les</strong> (différence<br />
moyenne de 5° entre <strong>les</strong> deux séries de mesures). La réalité <strong>des</strong><br />
sections a toujours été confirmée. Macroscopiquement, aucun<br />
élément noble de voisinage n’a été lésé. Lerôle <strong>des</strong> différents<br />
éléments étudiés peut être résumé comme suit :<br />
− intervalle <strong>des</strong> rotateurs (LCH, LGHS) : gain en RE1 (en<br />
moyenne 40°) et en RE2 (en moyenne : 35°), (supérieurs à la<br />
perte lors de la rétraction) ;<br />
− LGHI : gain en élévation (en moyenne de 33°);<br />
− LGHI et intervalle <strong>des</strong> rotateurs : potentialisation <strong>des</strong> gains<br />
tant en RE2 (en moyenne de 41°)qu’en élévation (en moyenne de<br />
50°);<br />
− LGHM : augmentation modérée de la rotation externe à<br />
45°d’antépulsion et d’élévation (en moyenne de 20°);<br />
− TSS : discret gain en RE1 (10°), mais risque de luxation (1<br />
cas)<br />
DISCUSSION. Notre modèle était reproductible. La section<br />
de la capsule antérieure par procédé thermique n’entraîne pas de
2S122 77 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
lésions macroscopique <strong>des</strong> éléments nob<strong>les</strong>. Notre étude souligne<br />
le rôle prééminent de la section de l’intervalle <strong>des</strong> rotateurs dans<br />
la récupération de la rotation externe. Cette section combinée<br />
avec celle du LGHI en potentialise <strong>les</strong> effets. La limite de notre<br />
étude est l’absence d’étude de la capsule postérieure.<br />
*P. Boisrenoult, Service d’Orthopédie,<br />
Centre Hospitalier de Versail<strong>les</strong>,<br />
Hôpital André-Mignot, 78150 Le Chesnay.<br />
214 Instabilité expérimentale de<br />
l’épaule : classification et rôle du<br />
ligament glénohuméral supérieur<br />
O. GAGEY*, V. MOLINA, S.PACI, S.RASPAUD,<br />
S. SOREDA<br />
BUT DU TRAVAIL. Etudier l’instabilité expérimentale par<br />
section ligamentaire en respectant toutes <strong>les</strong> autres parties mol<strong>les</strong><br />
périarticulaires.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Seize épau<strong>les</strong> de cadavre frais<br />
ont été étudiées. La dissection était faite par voie axillaire avec<br />
isolement <strong>des</strong> ligaments sans section musculaire. Classification<br />
de l’instabilitéétait faite en 5 sta<strong>des</strong> : 0) stable, 1) tiroir et sulcus,<br />
2) subluxation : la tête franchit le rebord glenoïdien mais reste<br />
dans le plan de la glène, 3) luxation réversible : la tête se luxe<br />
mais revient spontanément en place lorsqu’on laisse la bras le<br />
long du corps, 4) luxation permanente. La séquence de section<br />
<strong>des</strong> ligaments était la suivante : 1) entre 7het5h,2)entre 5het<br />
2 h, 3) entre 1 h et 11 h. L’instabilité était testée par <strong>les</strong><br />
manoeuvres habituel<strong>les</strong> : tiroir, sulcus et test d’hyperabduction,<br />
la luxation était provoquéeenélévation et rotation externe maximum<br />
et pression vers le bas dans l’axe de l’humérus.<br />
RÉSULTATS. La dissection <strong>des</strong> ligaments donnait dans 50 %<br />
<strong>des</strong> cas une instabilité de classe 1. la section entre 7het5h<br />
(partie antérieur du ligament glenohumeral inférieur) donne une<br />
instabilité de classe 2 dans 12 cas et de classe 3 dans 6 cas, le test<br />
d’hyperabduction était positif dans tous <strong>les</strong> cas. La section entre<br />
5 h et 3 h (ligament glenohumeral moyen) donnait une instabilité<br />
de classe 3 dans tous <strong>les</strong> cas mais jamais de luxation permanente.<br />
Pour obtenir une instabilité de classe 4 il fallait sectionner entre<br />
1 h et 11 h (ligament glenohumeral supérieur). Aucune lésion de<br />
coiffe n’était nécessaire pour obtenir une luxation permanente.<br />
CONCLUSION. Le rôle du ligament glenohumeral supérieur<br />
dans la genèse de l’instabilité de l’épaule n’avait jamais été<br />
précisé. La fermeture de l’intervalle <strong>des</strong> rotateurs, proposée par<br />
Nobuhara et par Field, correspond à une retension de ce ligament.<br />
La fonction du ligament glenohumeral supérieure doit être prise<br />
en compte dans le traitement de l’instabilité.<br />
*O. Gagey, CHU de Bicêtre, 78, avenue du Général-Leclerc,<br />
94270 Le Kremlin-Bicêtre.<br />
215 Test radiologique dans l’instabilité<br />
antéro-inférieure de l’épaule<br />
F. JOUVE*, P. HARDY, B.ROUSSELIN,<br />
A. LORTAT-JACOB<br />
INTRODUCTION. Dans l’instabilité antéro-inférieure de<br />
l’épaule, il est démontré que la distension sévère du ligament<br />
gléno-huméral inférieur (LGHI) est un facteur de mauvais pronostic<br />
fonctionnel lors de la stabilisation arthroscopique.<br />
O. Gagey a proposé un test clinique permettant d’apprécier la<br />
laxité du LGHI. Le but de cette étude est d’évaluer la laxité du<br />
LGHI par un test radiologique dynamique (cliché de face en<br />
abduction passive de l’articulation gléno-humérale) et de le<br />
corréler à l’observation arthroscopique.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Nous avons réalisé une étude<br />
prospective chez 21 patients devant bénéficier d’une stabilisation<br />
arthroscopique pour instabilité antéro-inférieure de l’épaule.<br />
L’âge moyen était de 24,6 ans, 17 hommes et 4 femmes.<br />
Le test était réalisé en décubitus dorsal avec un cliché de<br />
l’épaule de face stricte de manière bilatérale et comparative.<br />
L’épaule était portée en abduction passive forcée en rotation<br />
neutre sans anesthésie générale ni locorégionale. On mesure<br />
l’angle entre l’axe de la diaphyse numérale et l’axe passant par le<br />
bord inférieur de la gléne et le bord externe du tubercule du pilier<br />
de la scapula. Vuillemin a montré que ce test était fiable et<br />
reproductible.<br />
Lors de l’arthroscopie à but diagnostique et thérapeutique, on<br />
appréciait l’importance de la distension quantifiée selon Detrisac<br />
en 4 sta<strong>des</strong>. Nous considérons une distension franchement pathologique<br />
pour stade 3 et 4 de Detrisac. Nous avons choisi une<br />
valeur seuil de 15° de différence entre le coté sain et le coté<br />
pathologique, pour le test radiologique ; et évaluer son aptitude à<br />
mettre en évidence une laxité sévère du LGHI.<br />
RÉSULTATS. Pour une différence d’abduction d’au moins 15°<br />
la sensibilité du test est de 77 %, la spécificité est de 91 %, la<br />
valeur prédictive positive est de 87 %, la valeur prédictive négative<br />
est de 84 %.<br />
DISCUSSION. Dans l’instabilité antéro-inférieure de l’épaule,<br />
un bilan clinique et paraclinique rigoureux est fondamental afin<br />
d’une part de préciser le diagnostic et d’autre part de dépister <strong>des</strong><br />
contre-indications au traitement par stabilisation arthroscopique.<br />
Les techniques de stabilisation arthroscopique sont encore grevées<br />
d’un taux de récidive supérieur aux techniques à ciel ouvert.<br />
Il a été démontré qu’une importante laxité du LGHI constitue une<br />
contre-indication relative à la stabilisation arthroscopique. Les<br />
mesures radiographiques s’avèrent précises pour évaluer la laxité<br />
du LGHI. En effet, en prenant comme seuil de positivité un<br />
différentiel de 15° sur <strong>les</strong> radiographies, on retrouve 87 % de<br />
distension ligamentaire stade 3 ou 4 de Detrisac.<br />
CONCLUSION. Nous proposons de réaliser lors du bilan<br />
paraclinique pré-opératoire, en complément <strong>des</strong> examens radiologiques<br />
classiques, notre test radiologique dynamique épaule de<br />
face en abduction passive. Si le différentiel est supérieur ou égal<br />
à 15°, la stratégie thérapeutique devra prévoir non seulement la<br />
réinsertion du bourrelet mais également une retension ou une
plicature du complexe ligamentaire,voire une stabilisation à ciel<br />
ouvert.<br />
*F. Jouve, Service de Chirurgie Orthopédique,<br />
Hôpital Ambroise-Paré, CHU Paris Ouest,<br />
9, avenue Char<strong>les</strong>-de-Gaulle, 92100 Boulogne.<br />
216 Influence de l’encoche humérale<br />
sur le résultat de la chirurgie arthroscopique<br />
de l’instabilité antérieure<br />
de l’épaule : étude radiologique<br />
et tomodensitométrique<br />
C. CONSO*, P. HARDY<br />
Cette étude analyse l’importance et la position de l’encoche de<br />
Malgaigne sur <strong>les</strong> clichés radiographiques standards en rotation<br />
interne et sur l’arthroscanner chez <strong>des</strong> patients traités par arthroscopie<br />
pour instabilité d’épaule, afindedéterminer <strong>des</strong> critères<br />
prédictifs du résultat d’une stabilisation arthroscopique de<br />
l’épaule selon Bankart.<br />
Cinquante-quatre patients ont été revus pour déterminer le<br />
score de Duplay post opératoire. Le recul moyen était de 68 mois<br />
(32 à 100 mois). L’âge moyen au moment de la chirurgie était de<br />
29 ans.<br />
Nous avons divisé ces différents patients en trois populations<br />
tenant compte <strong>des</strong> symptômes préopératoires : population A 2<br />
luxations antérieures ou plus, population B 1 luxation puis <strong>des</strong><br />
épiso<strong>des</strong> de subluxation, C pas de luxation mais <strong>des</strong> douleurs.<br />
Puis nous avons divisé cette population en fonction du score de<br />
Duplay. Groupe 1 <strong>les</strong> patients ayant un résultat moyen ou mauvais,<br />
Groupe 2 <strong>les</strong> patients ayant un bon ou excellent résultat.<br />
Nous avons visionné <strong>les</strong> 54 radiographies en utilisant <strong>des</strong> gabarits<br />
de rayon croissant tous <strong>les</strong> millimètres pour évaluer le rayon de la<br />
tête humérale ainsi que la profondeur de l’encoche. Nous avons<br />
évalué la reproductibilité de cette méthode auprès de 10 chirurgiens<br />
orthopédistes confirmés. Il n’existait pas de faux positif ni<br />
de faux négatif. La variance <strong>des</strong> différente mesures <strong>des</strong> 10<br />
chirurgiens était de 0,67 à 1,31mm ce qui est faible. Nous avons<br />
comparé le rapport entre le rayon de la tête humérale et la<br />
profondeur de l’encoche dans <strong>les</strong> différents groupes.<br />
L’encoche de Malgaigne est significativement plus importante<br />
dans le groupe A (19 %) que dans le groupe B (14 %) ou C<br />
(14,3 %) (p = 0,05). Ceci nous fais dire que la taille de l’encoche<br />
influence la symptomatologie dans l’instabilité d’épaule. L’encoche<br />
est aussi significativement plus importante dans <strong>les</strong> résultats<br />
moyen ou mauvais 21 % par rapport au groupe 2 (16 %) (p =<br />
0,05).<br />
Au delà d’une valeur seuil de 15 % il existe 54 % de résultats<br />
moyen ou mauvais. La position de l’encoche en hauteur est<br />
significativement différente dans la population A par rapport aux<br />
populations B etCp=0,01. Celle-ci apparaît plus haute dans <strong>les</strong><br />
luxations récidivantes vraies. Nous n’avons pas mis en évidence<br />
de lien statistique entre la position de l’encoche sur le scanner et<br />
le résultat chirurgical. Cette étude souligne l’importance <strong>des</strong><br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 2S123<br />
informations données par le cliché en rotation interne dans le<br />
choix du type de chirurgie pour l’instabilité d’épaule.<br />
*C. Conso, Centre Hospitalier de Versail<strong>les</strong>,<br />
Hôpital André-Mignot, 177, rue de Versail<strong>les</strong>,<br />
78150 Le Chesnay.<br />
217 Intérêts d’une capsuloplastie associée<br />
à la butée coracoïdienne en<br />
cas d’hyperlaxité dans le traitement<br />
<strong>des</strong> instabilités antérieures chroniques<br />
d’épaule : à propos de 88 cas<br />
P. COLLIN*, M. ROPARS, T.DRÉANO,<br />
J.-C. LAMBOTTE, H.THOMAZEAU, F.LANGLAIS<br />
En 1996, nous avions rapporté le résultat de 65 butées coracoïdiennes<br />
pour instabilité antérieure chronique. Nous retrouvions<br />
6 % de récidives vraies et 34 % d’appréhension persistante.<br />
Afin d’améliorer ce résultat, nous avons modifié notre technique<br />
opératoire, associant en cas d’hyperlaxité une capsuloplastie. Le<br />
but de ce travail est d’en apprécier <strong>les</strong> résultats à moyen terme.<br />
MATÉRIELS ET MÉTHODES. Quatre-vingt-huit butées<br />
coracoïdiennes ont été réalisées entre 1995 et 2000 par le même<br />
opérateur. Dans 41 cas, la technique classique a été réalisée. Dans<br />
47 cas nous avons associé une capsuloplastie.<br />
L’indication opératoire a toujours été portée sur une instabilité<br />
récidivante documentée, avec confirmation de la lésion capsuloligamentaire<br />
antéro-inférieure par radiographie, IRM ou endoscopie.<br />
Une capsuloplastie était associée en cas de signes faisant<br />
suspecter une hyperlaxité :<br />
− Luxation auto-réduite<br />
− Absence d’encoche<br />
− Rotation externe coude au corps (RE1) supérieure à 80°<br />
− Présence d’un sillon significatif<br />
− Laxité du lambeau inférieur d’une capsulotomie toujours<br />
réalisée enT.<br />
L’âge moyen <strong>des</strong> patients était de 24 ans (14-42) et le recul<br />
moyen de 40 mois (24-60). Les résultats cliniques ont étéévalués<br />
selon <strong>les</strong> critères de la fiche Duplay, et trois radiographies ont été<br />
réalisées lors de la revue (face standard, profil deLamyetprofil<br />
glénoïdien).<br />
RÉSULTATS. 85 % <strong>des</strong> patients présentaient un bon ou très<br />
bon résultat selon la fiche du groupe Duplay. 88 % <strong>des</strong> butées ont<br />
consolidé sans modification et 12 % présentaient une ostéolyse.<br />
Aucun cas d’arthrose n’a été retrouvé. Mais un patient s’est<br />
reluxé.<br />
Le taux d’appréhension persistante a diminué (12 %) par<br />
rapport à notre étude précédente (34 %). Cette amélioration s’est<br />
faite au prix d’une perte de RE1 supérieure dans le groupe avec<br />
capsuloplastie (-20° pour -8°), mais sans pénaliser la reprise<br />
d’une activité sportive (82 % <strong>des</strong> patients ont repris leur sport<br />
dont 72 % au même niveau sans différence significative entre <strong>les</strong><br />
2 groupes avec et sans capsuloplastie).<br />
DISCUSSION. Ces résultats justifient la capsuloplastie en<br />
présence de signes d’hyperlaxité. Cette technique a permis
2S124 77 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
d’améliorer nos résultats en matière de récidive et d’appréhension<br />
persistante, au prix d’une perte de mobilité peu importante et<br />
sans retentissement sportif.<br />
Les auteurs précisent <strong>les</strong> critères objectifs de reconnaissance<br />
d’un terrain hyperlaxe, en ajoutant aux signes cliniques habituels<br />
<strong>des</strong> critères radiographiques, arthroscopiques et opératoires.<br />
*P. Collin, Hôpital Sud, 16, boulevard de Bulgarie, BP 90347,<br />
35203 Rennes Cedex 2.<br />
218 Epaule douloureuse ou instable<br />
après butée coracoïdienne : résultat<br />
du traitement chirurgical<br />
P. MANSAT*, M. GUITY, B.ROQUES,<br />
Y. BELLUMORE, M.RONGIÈRES, P.BONNEVIALLE,<br />
M. MANSAT<br />
INTRODUCTION. Les résultats <strong>des</strong> butées coracoïdiennes<br />
pour le traitement <strong>des</strong> instabilités antérieures de l’épaule sont<br />
satisfaisants (SOFCOT-91 et 99). Peu d’artic<strong>les</strong> ont été consacrés<br />
aux complications de cette opération. Nous rapportons dans notre<br />
étude <strong>les</strong> résultats <strong>des</strong> reprises chirurgica<strong>les</strong> à travers une série<br />
continué de 17 patients.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Quatorze hommes et 3 femmes<br />
d’âge moyen 34 ans ont nécessité une nouvelle intervention<br />
chirurgicale après butée coracoïdienne antérieure : pour récidive<br />
d’instabilité dans 10 cas, et pour épaule douloureuse et enraidie<br />
dans 7 cas. L’évaluation radiographique retrouvait un conflit de<br />
la butée et/ou de la vis avec la tête numérale dans 13 cas, et <strong>des</strong><br />
signes d’omarthrose dans 3. La butée était mal positionnée dans<br />
8 cas. Un geste de stabilisation (Bankart ± capsuloplastie) a été<br />
effectué pour <strong>les</strong> épau<strong>les</strong> instab<strong>les</strong>, un débridement avec ablation<br />
de la vis et/ou de la butée pour <strong>les</strong> épau<strong>les</strong> douloureuses et<br />
enraidies. En peropératoire le tendon du subscapulaire était normal<br />
dans 2 cas, fibreux ou aminci dans 11 et rompu dans 1. Le<br />
délai entre l’intervention initiale et la révision était de 11 ans en<br />
moyenne.<br />
RÉSULTATS. Avec un recul moyen de 21 mois, <strong>les</strong> patients<br />
ont été évalués en utilisant le score de Duplay. Les résultats<br />
étaient bons ou excellents pour 11 patients (70 % pour <strong>les</strong> épau<strong>les</strong><br />
instab<strong>les</strong> stabilisées et 57 % pour <strong>les</strong> épau<strong>les</strong> douloureuses et<br />
enraidies débridées), moyens pour 4 et mauvais pour 2. L’évaluation<br />
clinique du subscapulaire retrouvait un déficit dans 10<br />
cas. La force en rotation interne était inférieure de 3.3 kg au<br />
niveau de l’épaule opérée par rapport à l’épaule contro-latérale.<br />
Un examen tomodensitométrique retrouvait une dégénérescence<br />
graisseuse significative au niveau du subscapulaire chez 4<br />
patients. Une arthrose gléno-humérale a été mise en évidence sur<br />
9 épau<strong>les</strong>. Le facteur pronostic le plus significatif pour le résultat<br />
final était le nombre d’interventions préalab<strong>les</strong> (p < 0,01).<br />
DISCUSSION. Le résultat <strong>des</strong> reprises chirurgica<strong>les</strong> après<br />
butée coracoïdienne dépend du tableau clinique présenté par le<br />
patient. Si <strong>les</strong> résultats pour <strong>les</strong> épau<strong>les</strong> douloureuses et limitées<br />
restent très mo<strong>des</strong>tes en raison de lésions intra-articulaires fréquentes,<br />
la réalisation d’une capsuloplastie ± associée à une<br />
réinsertion du bourrelet glénoïden permet d’obtenir un résultant<br />
satisfaisant dans plus de 2/3 <strong>des</strong> cas pour <strong>les</strong> épau<strong>les</strong> instab<strong>les</strong>.<br />
L’atteinte du muscle subscapulaire semble lié aux multip<strong>les</strong><br />
interventions réalisées sur ces épau<strong>les</strong>, ainsi qu’à l’effet néfaste<br />
de la butée (Picard-1998 ; Glasson-1999) et constitue un facteur<br />
pronostic essentiel pour le résultat final.<br />
*P. Mansat, Service d’Orthopédie Traumatologie,<br />
Hôpital Purpan, place du Docteur-Baylac,<br />
31052 Toulouse Cedex.<br />
219 L’épaule flottante : prise en charge<br />
orthopédique et chirurgicale. Revue<br />
rétrospective d’une série de 45<br />
patients<br />
G. GIORDANO*, F. ACCABLED, C.BESOMBES,<br />
J.-L. TRICOIRE, P.CHIRON<br />
INTRODUCTION. L’épaule flottante constitue une entité particulière<br />
dans la traumatologie du membre supérieur. Sur le plan<br />
biomécanique, elle représente comme le définit Goss une rupture<br />
du complexe suspenseur de l’épaule. La prise en charge de ces<br />
traumatismes est encore mal systématisée, partagée entre le<br />
besoin d’une restauration anatomique et la qualité <strong>des</strong> résultats<br />
fonctionnels de la majorité <strong>des</strong> cas traités orthopédiquement. Cet<br />
apparent paradoxe tient probablement à la précision <strong>des</strong> indications.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Quarante-cinq patients pris en<br />
charge entre 1980 et 2001 ont été revus rétrospectivement. 35<br />
présentaient un syndrome omo-cléido-thoracique, 10 un syndrome<br />
omo-cléidien. L’âge moyen au moment du traumatisme<br />
était de 39 ans et le recul moyen de la série de 2,4 ans (1 à 16 ans).<br />
Ces traumatismes concernaient 36 hommes pour 9 femmes et<br />
sont survenus dans 76 % <strong>des</strong> cas dans le cadre d’un accident de la<br />
voie publique avec 76.8 % de polytraumatisés (58 % en moto,<br />
33 % en voiture, 9 % comme piéton). Les lésions claviculaires<br />
étaient constituées de 18 fractures du tiers moyen, 12 luxations<br />
acromio-claviculaires, 3 luxations sterno-claviculaires, 7 fractures<br />
bifoca<strong>les</strong>, 3 fractures du tiers latéral et 2 du tiers médial. La<br />
lésion de l’omoplate se situait au niveau du corps dans 19 <strong>des</strong> cas,<br />
du col dans 14 cas, de la glène dans 2 cas, de la coracoïde dans un<br />
cas et étaient plurifoca<strong>les</strong> dans 9 cas.<br />
RÉSULTATS. Trente-trois patients ont été traités demanière<br />
orthopédique et 12 patients chirurgicalement 4 d’une ostéosynthèse<br />
claviculaire, 8 <strong>des</strong> deux. Les résultats ont été analysés sur le<br />
plan anatomique avec <strong>les</strong> radiographies post-opératoires et sur le<br />
plan fonctionnel en utilisant le score de Constant. Parmi <strong>les</strong><br />
complications ont été retrouvés six cals vicieux dont quatre<br />
responsab<strong>les</strong> de séquel<strong>les</strong> fonctionnel<strong>les</strong> invalidantes, un patient<br />
justifiant d’une correction chirurgicale. Tous sont le fait de<br />
traitement orthopédique.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. Si le traitement orthopédique<br />
représente la majorité <strong>des</strong> indications, l’analyse <strong>des</strong> déplacements<br />
conditionne l’acte chirurgical. Nous retenons comme<br />
critères chirurgicaux une lésion du col de l’omoplate entraînant<br />
une angulation de plus de 40°, une médiatisation-ventralisation<br />
de la glène de plus de 2 cm et une fracture articulaire déplacée.
L’ostéosynthèse de la clavicule dans <strong>les</strong> épau<strong>les</strong> flottantes à<br />
grand déplacement nous semble être le minimum requis en cas<br />
d’impossibilité de prise en charge optimale de patients souvent<br />
polytraumatisés.<br />
*G. Giordano, Service de Chirurgie Orthopédique<br />
et Traumatologique, Hôpital Rangueil, 1, avenue Poulhes,<br />
31403 Toulouse Cedex 3.<br />
220 Traumatisme de la clavicule et<br />
défilé cervico-thoracique : à propos<br />
de 8 cas<br />
P. VALENTI*, S. NASER CHOURIF, A.GILBERT<br />
INTRODUCTION. Les lésions claviculaires représentent une<br />
cause rare de syndrome de défilé cervico-thoracique. Nous en<br />
rapportons 8 cas afindedéterminer <strong>les</strong> éléments du diagnostic, le<br />
traitement et <strong>les</strong> résultats.<br />
MATÉRIELS ET MÉTHODES. Il s’agissait de 8 patients (5<br />
femmes et 3 hommes) de moyenne d’âge 48 ans (11/70), se<br />
plaignant de douleurs irradiantes du membre supérieur, avec <strong>des</strong><br />
paresthésies dans le territoire ulnaire de la main et une diminution<br />
de la force musculaire. Le diagnostic a été fait en moyenne 23,1<br />
mois (1/10 ans) après lalésion initiale. Il s’agissait au départ<br />
toujours d’une fracture claviculaire du tiers moyen comminutive,<br />
déplacée et traitée orthopédiquement (anneaux). Les radiographies<br />
standards de la clavicule ont révélé : 4 cals vicieux, 2<br />
pseudarthroses atrophiques, 1 fracture avec un fragment vertical<br />
(ostëosynthésée rapidement en raison d’une compression aiguë<br />
du plexus), et enfin une résection du tiers moyen de la clavicule<br />
(secondaire à une ostéite). Un électromyogramme a confirmé le<br />
diagnostic avec le plus souvent une compression du tronc secondaire<br />
antéro-interne. L’analyse osseuse a été réalisée par un<br />
scanner avec reconstruction tridimensionnelle (mesure de<br />
l’espace costo-claviculaire). Le traitement chirurgical a associé<br />
une réduction anatomique de la clavicule avec ostéosynthèse par<br />
plaque et neurolyse du plexus brachial.<br />
RÉSULTATS. Les douleurs ont disparu le lendemain de l’opération<br />
ainsi que <strong>les</strong> paresthésies dans 7 cas sur 8. La consolidation<br />
de la clavicule a été obtenue dans un délai compris entre 13 et 18<br />
mois.<br />
DISCUSSION. Différents mécanismes peuvent causer la compression<br />
du plexus brachial au décours d’une fracture comminutive<br />
déplacée de la clavicule. Différentes modalités thérapeutiques<br />
proposées dans la littérature seront discutées.<br />
CONCLUSION. Ce syndrome de défilé cervico-thoracique<br />
doit être évoqué dans <strong>les</strong> suites d’une fracture déplacée du tiers<br />
moyen de la clavicule comminutive, chez <strong>des</strong> patients présentant<br />
<strong>des</strong> douleurs irradiantes du membre supérieur. L’électromyogramme<br />
confirmera le diagnostic et le scanner tridimensionnel<br />
analysera au mieux la clavicule, pour adapter le traitement chirurgical.<br />
*P. Valenti, Institut de la Main, Clinique Jouvenet,<br />
6, square Jouvenet, 75016 Paris.<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 2S125<br />
221 Traitement <strong>des</strong> instabilités postérieures<br />
de l’épaule par butée<br />
osseuse : à propos de 18 cas<br />
F. SIRVEAUX*, J. LEROUX, O.ROCHE,<br />
M. DE GASPERI, C.MARCHAL, D.MOLÉ<br />
Les instabilités postérieures de l’épaule relèvent du traitement<br />
chirurgical dans <strong>les</strong> formes involontaires et après échec du traitement<br />
fonctionnel. Comme pour <strong>les</strong> instabilités antérieures, le<br />
principe d’une butée osseuse peut être appliqué soit par une butée<br />
iliaque, soit par une butée pédiculée prélevée aux dépends de<br />
l’acromion. Cette étude rétrospective analyse <strong>les</strong> résultats obtenus<br />
à partir d’une série continue de 18 cas.<br />
PATIENTS ET MÉTHODES. Cette série comporte 10 hommes<br />
et 8 femmes, d’un âge moyen de 26 ans (15-42) au moment<br />
de l’intervention. 14 (77 %) pratiquaient un sport dont 4 en<br />
compétition. La symptomatologie évoluait en moyenne depuis 4<br />
ans. Dans 3 cas (16 %), l’instabilité postérieure s’exprimait sous<br />
la forme de luxation ou subluxation récidivante, dans 9 cas<br />
(50%),ils’agissait de subluxation postérieure habituelle involontaire<br />
et dans 6 cas d’épau<strong>les</strong> douloureuses pures par accident<br />
d’instabilité postérieure passé inaperçu. Dans 7 cas (39 %), le<br />
diagnostic d’instabilité postérieure a été établi par arthroscopie.<br />
L’intervention a consisté dans 9 cas en une butée iliaque postérieure<br />
vissée associée à un geste de retension capsulaire (Groupe<br />
1) et dans 9 cas en une butéeprélevée sur l’acromion et pédiculée<br />
sur le deltoïde (Groupe 2).<br />
RÉSULTATS. Le recul moyen de l’ensemble de la série est de<br />
8 ans. A la révision le score de DUPLAY moyen est de 75 points.<br />
12 patients (85 % <strong>des</strong> sportifs) ont pu reprendre leur activité<br />
sportive dont la moitié au même niveau. 9 patients ne signalent<br />
aucune douleur. Six patients (33 %) gardent une appréhension à<br />
l’examen clinique mais aucun n’a présenté de récidive vraie. Le<br />
score de DUPLAY est de 69,4 points pour le groupe 1 (recul<br />
moyen de 12 ans) et de 82,2 points pour le groupe 2 (recul moyen<br />
de 3 ans). 13 patients (77 %) ne présentent aucun signe d’arthrose<br />
à la révision. Une patiente présente une arthrose évoluée de stade<br />
IV liée à la présence d’une vis intra-articulaire. Tous <strong>les</strong> patients<br />
se disent améliorés par l’intervention et un tiers se disent guéris.<br />
DISCUSSION ET CONCLUSION. L’utilisation d’une butée<br />
osseuse postérieure est une intervention efficace dans le traitement<br />
de l’instabilité postérieure avec <strong>des</strong> résultats comparab<strong>les</strong> à<br />
ceux obtenus avec <strong>les</strong> butées antérieures en terme de stabilité,de<br />
douleur, de récupération de la mobilité et de résultats subjectifs.<br />
Il s’agit d’une chirurgie peu arthrogène comparée à la chirurgie<br />
de stabilisation antérieure. Les résultats obtenus avec <strong>les</strong> butées<br />
acromia<strong>les</strong> pédiculées sont encourageants.<br />
*F. Sirveaux, Clinique de Traumatologie et d’Orthopédie,<br />
49, rue Hermite, 54000 Nancy.
2S126 77 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
222 Ténotomie arthroscopique du chef<br />
long du biceps brachial dans 40<br />
ruptures irréparab<strong>les</strong> de la coiffe<br />
<strong>des</strong> rotateurs sans omarthrose<br />
N. MEHDI*, C. MAYNOU, P.LESAGE,<br />
X. CASSAGNAUD, H.MESTDAGH<br />
INTRODUCTION. La ténotomie arthroscopique du chef long<br />
du biceps brachial, a pour objectif, dans le traitement <strong>des</strong> ruptures<br />
irréparab<strong>les</strong> de la coiffe <strong>des</strong> rotateurs, l’obtention de l’indolence.<br />
Notre étude avait pour but l’évaluation <strong>des</strong> résultats cliniques et<br />
radiographiques de cette intervention.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Cette étude rétrospective portait<br />
sur 38 patients (21 femmes, 17 hommes), âgés en moyenne de 65<br />
ans (44 à 78 ans), présentant une rupture de la coiffe <strong>des</strong> rotateurs<br />
non réparable par suture. Les patients bénéficiaient d’une ténotomie<br />
arthroscopique, associée à une acromioplastie dans 8 cas,<br />
après réalisation d’un bilan iconographique comprenant arthroscanner<br />
et radiographies standards. Cette imagerie préopératoire<br />
appréciait la rétraction du moignon du supra-spinatus et la dégénérescence<br />
graisseuse (IDG). L’évolution clinique était jugée sur<br />
la modification <strong>des</strong> scores de Constant et sur la recherche d’une<br />
perte de force du biceps (estimation faite par rapport à une<br />
cohorte d’individus de mêmes âge et sexe). Les clichés radiographiques<br />
de l’épaule opérée de face (debout et couché) appréciaient<br />
<strong>les</strong> modifications de la hauteur sous-acromiale, et le stade<br />
de l’arthrose.<br />
RÉSULTATS. Le délai moyen de révision était de 31 mois.<br />
Aucune complication liée à l’intervention n’était constatée. Le<br />
score global de Constant augmentait de 19 points, passant de 39<br />
à 58 points, la douleur (+7 points) et la.mobilité (+6.1 points)<br />
étaient <strong>les</strong> paramètres connaissant <strong>les</strong> gains <strong>les</strong> plus importants.<br />
L’activitéétait améliorée de 6 points. Les amplitu<strong>des</strong> articulaires<br />
actives en antépulsion, abduction et rotation latérale (coude au<br />
corps) augmentaient respectivement de 36,5°, de 13,1° et de<br />
20,8°. La hauteur sous acromiale diminuait très faiblement (de<br />
7,4 mm en préopératoire à 7,1 mm en postopératoire). Nous<br />
retrouvions une perte de force du bras de 37 % en<br />
flexion/supination par rapport au côté non opéré (6,05 kg vs 9,65<br />
kg). De façon subjective, 85 % <strong>des</strong> patients étaient très satisfaits<br />
ou satisfaits, 10 % déçus et 2,5 % mécontents. Pour 88 % d’entre<br />
eux le principe d’une réintervention était acquis.<br />
CONCLUSION. La ténotomie du chef long du biceps brachial<br />
est efficace sur la douleur et sur la mobilité par l’antalgie conférée.<br />
Elle est techniquement simple, n’accélère pas le développement<br />
d’une omarthrose excentrée, au recul considéré. En revanche<br />
elle diminue la force de flexion du bras.<br />
*N. Mehdi, Service d’Orthopédie A, Hôpital Roger-Salengro,<br />
CHRU de Lille, rue du 8 mai 1945, 59037 Lille Cedex.<br />
223 Histopathologie <strong>des</strong> lésions chroniques<br />
du chef long du biceps brachial<br />
associées aux ruptures de la<br />
coiffe <strong>des</strong> rotateurs<br />
F. DUPARC*, J.-L. GAHDOUN, C.MICHOT,<br />
X. ROUSSIGNOL, F.DUJARDIN, N.BIGA<br />
INTRODUCTION. Au cours de la chirurgie réparatrice <strong>des</strong><br />
ruptures <strong>des</strong> tendons de la coiffe <strong>des</strong> rotateurs de l’épaule, la<br />
ténotomie-ténodèse du chef long du biceps brachial (CLB) est<br />
associée de principe par certains auteurs ou peut être décidée en<br />
fonction de l’aspect macroscopique du tendon et de sa position<br />
par rapport à la gouttière bicipitale. Il est de plus classiquement<br />
admis que la conservation du CLB peut être à l’origine de<br />
douleurs persistantes dans <strong>les</strong> épau<strong>les</strong> opérées. Cette étude a<br />
recherché une validation histologique de cette décision de ténotomie.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. Cinquante tendons du CLB<br />
présentaient un aspect pathologique épaissi et inflammatoire<br />
associé ou non à une subluxation, au cours de 68 interventions<br />
réparatrices récentes pour ruptures de la coiffe (23 hommes, 27<br />
femmes, âge moyen 53,5 ans). Une ténodèse du CLB associée à<br />
une ténotomie proximale a été pratiquée, et un examen histologique<br />
a concerné le centimètre proximal du tendon. 4 paramètres<br />
histologiques ont étéétudiés : deux concernaient le tendon (organisation<br />
<strong>des</strong> faisceaux de collagène et aspect du tissu conjonctif<br />
interstitiel), deux concernaient la bordure synoviale (couche<br />
subsynoviocytique et mésothélium synovial). 16 tendons CLB<br />
d’aspect parfaitement sain avaient été prélevés sur <strong>des</strong> épau<strong>les</strong><br />
cadavériques pour préciser l’aspect normal <strong>des</strong> paramètres histologiques<br />
(faisceaux de collagène orientés parallè<strong>les</strong> et cohésifs,<br />
absence d’hypertrophie du tissu conjonctif interstitiel, couche<br />
subsynoviocytique fine et mésothélium synovial pluristratifié).<br />
RÉSULTATS. Le tendon : <strong>les</strong> faisceaux collagènes étaient<br />
orientés dans 32 cas, mais épaissis 40 fois, et dissociés 47 fois.<br />
Des signes microscopiques de fissures ou de ruptures intratendineuses<br />
étaient présents dans 17 cas. Le tissu conjonctif tendineux<br />
était œdémateux dans 49 cas, présentait une hypercellularité<br />
fibroblastique dans 37 cas et une hypervascularité dans 43 tendons.<br />
Des zones de fibrose de type cicatriciel étaient rencontrées<br />
dans 28 cas. La couche synoviale était régulière 11 fois, et<br />
nettement épaissie dans 26 cas avec <strong>des</strong> aspects mélangés irréguliers<br />
dans <strong>les</strong> cas restants. La couche subsynoviocytique était<br />
épaissie dans 33 tendons, avec <strong>des</strong> signes d’hypervascularité ou<br />
d’hypercellularité dans 12 cas. Le mésothélium synovial était<br />
paucistratifié dans 23 cas, épaissi 12 fois, régulier dans 15 cas.<br />
Les lésions étaient de type inflammatoire et intenses dans 26 cas,<br />
et de type dégénératif dans 21 cas.<br />
La confrontation de ces 4 paramètres histologiques témoignait<br />
de lésions évoluées associant une sclérose tendineuse dégénérative<br />
avec une synovite réactionnelle dans 30 cas, de lésions<br />
combinées modérées dans 13 cas, de lésions tendineuses et<br />
synovia<strong>les</strong> d’aspect uniquement inflammatoire dans 4 cas, et de<br />
lésions dégénératives du tendon et de la synoviale évoluées dans<br />
6 cas.<br />
DISCUSSION. Les lésions histologiques du tendon du CLB<br />
étaient le plus souvent de type dégénératif et irréversible, alors
que la majorité <strong>des</strong> lésions de la synoviale étaient de type<br />
inflammatoire réactionnel et réversible. Les zones de fibrose<br />
intratendineuse, de vascularité et de cellularité faib<strong>les</strong> ou absentes,<br />
constituaient <strong>les</strong> conditions anatomiques de la prérupture<br />
tendineuse dans l’évolution d’une tendinopathie chronique. Cette<br />
étude histologique a confirmé et validé la décision per-opératoire<br />
de ténodèse-ténotomie du CLB dans 46 cas (92 %). L’aspect<br />
224 Tumeurs à cellu<strong>les</strong> géantes de<br />
l’extrémité inférieure du radius traitées<br />
par résection-arthrodèse : à<br />
propos de 16 cas<br />
A. KAWADJII*, A. BABINET, B.TOMENO,<br />
P. ANRACT<br />
INTRODUCTION. Le but de cette étude rétrospective était<br />
d’évaluer <strong>les</strong> résultats carcinologiques et fonctionnels <strong>des</strong><br />
tumeurs à cellu<strong>les</strong> géantes de l’extrémité inférieure du radius<br />
traitées par réséction-arthrodèse.<br />
MATÉRIELS ET MÉTHODES. La série comportait 16<br />
patients, 9 hommes et 7 femmes, dont l’âge moyen était de 39 ans<br />
(19 et 63 ans). La symptomatologie initiale était toujours la<br />
douleur. Neuf <strong>des</strong> 16 patients ont été adressés pour récidive après<br />
un premier traitement par curetage-comblement ; <strong>les</strong> 7 autres<br />
présentaient <strong>des</strong> tumeurs volumineuses soufflant largement le<br />
massif épiphyso-métaphysaire et rendant impossible un curetagecomblement.<br />
Tous <strong>les</strong> patients ont eu une résection en bloc de la tumeur et<br />
une reconstruction utilisant 2 baguettes tibia<strong>les</strong> prenant appui<br />
proximalement sur le radius et distalement sur la première rangée<br />
(8 cas) ou la deuxième rangée du carpe (8 cas), le montage étant<br />
protégé par un plâtre ou un fixateur externe. Toutes <strong>les</strong> tumeurs<br />
étaient bénignes.<br />
Neuf patients ont été revus pour une évaluation fonctionnelle<br />
(douleur, mobilité et force) et radiologiques (radio du poignet de<br />
profilenflexion et en extension maxima<strong>les</strong>), pour <strong>les</strong> autres nous<br />
nous sommes basés sur <strong>les</strong> données de la dernière consultation.<br />
RÉSULTATS. Le recul moyen était de 70 mois (12 et 205<br />
mois). Le résultat fonctionnel était bon avec absence de douleur<br />
dans 15 cas ; pour <strong>les</strong> 8 patients dont la médio-carpienne a pu être<br />
préservée, la flexion dorsale était de 30° et la flexion palmaire de<br />
15° ; la prono-suppination allait de 10° à170°.<br />
La fusion osseuse aux extrémités du montage a été obtenue<br />
dans 15 cas. Une pseudarthrose, reprise un an plus tard pour<br />
greffe et ostéosynthèse par plaque, a fini par consolider. Deux<br />
fractures de greffon après traumatisme ont consolidé normalement<br />
après ostéosynthèse par plaque vissée associée à un nouvel<br />
apport osseux.<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 2S127<br />
Séance du 15 novembre matin<br />
TUMEURS/RECHERCHE APPLIQUÉE<br />
oedématié et fissuraire du tendon CLB apparaît comme un critère<br />
fiable, alors que la synovite inflammatoire qui entoure le tendon<br />
ne constitue pas à elle-seule un argument formel de décision de<br />
sacrifice tendineux.<br />
*F. Duparc, Département de Chirurgie Orthopédique<br />
et Traumatologique et Plastique, CHU de Rouen,<br />
boulevard Gambetta, 76031 Rouen Cedex.<br />
127<br />
Trois <strong>des</strong> opérés ont présenté <strong>des</strong> récidives loca<strong>les</strong> sous forme<br />
de nodu<strong>les</strong> sous-cutanées qui ont été réséqués. Un de ces 3<br />
patients a eu une récidive osseuse à la jonction greffon-radius qui<br />
a été traité par une nouvelle résection osseuse ce qui a permis la<br />
guérison.<br />
CONCLUSION. La réséction-arthrodèse est indiquée dans <strong>les</strong><br />
récidives de curetage-comblement et dans <strong>les</strong> volumineuses<br />
tumeurs à cellu<strong>les</strong> géantes avec extension extra-osseuse et <strong>des</strong><br />
échecs de curetage-comblement. Les curetages sont rarement<br />
réalisab<strong>les</strong> dans cette localisation <strong>des</strong> TCG du fait de l’envahissement<br />
<strong>des</strong> parties mol<strong>les</strong> et de la <strong>des</strong>truction de la surface<br />
articulaire qui surviennent précocement. Il parait préférable de<br />
réaliser une arthrodèse entre le radius et la première rangée <strong>des</strong> os<br />
du carpe qui préserve une mobilité partielle du poignet et une<br />
bonne fonction.<br />
*A. Kawadjii, Service de Chirurgie Orthopédique B,<br />
Hôpital Cochin, 27, rue du Faubourg-Saint-Jacques,<br />
75014 Paris.<br />
225 Ostéosarcome chez le sujet de plus<br />
de 40 ans : une entité de diagnostic<br />
difficile et de pronostic redoutable<br />
F. GOUIN*, M. TOURÉ, F.ROLAND, A.MOREAU,<br />
A. BERTRAND-VASSEUR<br />
INTRODUCTION. L’ostéosarcome est une pathologie rare<br />
après 40 ans, <strong>les</strong> tumeurs osseuses malignes étant alors dominées<br />
par <strong>les</strong> lésions secondaires, <strong>les</strong> tumeurs primitives étant surtout<br />
<strong>des</strong> chondrosarcomes sur ce terrain. Nous avons voulu au travers<br />
d’une courte série rétrospective, étudier <strong>les</strong> caractéristiques, <strong>les</strong><br />
difficultés diagnostics et le pronostic de cette pathologie.<br />
PATIENTS ET MÉTHODE. Ont été inclus dans ce travail <strong>les</strong><br />
ostéosarcomes confirmés histologiguement, chez <strong>les</strong> sujets de<br />
plus de 40 ans, traités au sein d’une même réunion interdisciplinaire<br />
de prise en charge <strong>des</strong> tumeurs de l’appareil locomoteur<br />
entre 1990 et Septembre 2002, en excluant ceux survenus sur<br />
terrain prédisposant (irradiation, Paget). Il s’agissait de 6 femmes<br />
et9hommesd’âge moyen 54 ans (41 à 79 ans). Seuls 3 patients<br />
avaient plus de 60 ans.
2S128 77 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
RÉSULTATS. Sur la même période, 59 ostéosarcomes ont été<br />
traités, le diagnostic après 40 ans représente donc 25 % <strong>des</strong> cas<br />
traités dans notre réunion interdisciplinaire.<br />
Trois patients ont été référés après traitement inadéquate, c’est<br />
à dire un curetage comblement sans diagnostic. Deux autres<br />
patients avaient eu un geste chirurgical pour <strong>des</strong> symptômes liés<br />
à l’ostéosarcome. Enfin pour 3 patients, le diagnostic anatomopathologique<br />
était difficile ou erroné. Iln’y avait pas de spécificité<br />
histologiques ou dans la localisation <strong>des</strong> tumeurs, dominée<br />
par le fémur inférieur. Dix patients ont eu un chimiothérapie<br />
néo-adjuvante avec seulement 2 bons répondeurs. La chirurgie<br />
était marginale dans 3 cas, intra lésionnelle avec reprise immédiate<br />
dans 1 cas et large dans 10 cas.<br />
Six patients sont décédés de leur maladie (dans <strong>les</strong> 2 ans qui<br />
ont suivi le diagnostic), et 1 d’une embolie pulmonaire postopératoire<br />
(46 %). Deux patients sont vivants avec une maladie<br />
évolutive. Seuls 6 patients sont vivants sans maladie (40 %)<br />
parmi <strong>les</strong>quels 1 patient a présenté une métastase pulmonaire<br />
réséquée et 1 patient a présenté 2 épiso<strong>des</strong> de récidives locorégiona<strong>les</strong><br />
opérés (recul respectivement 12 et 8 mois du dernier<br />
événement). Quatre patients (26 %) sont donc en rémission<br />
complète sans événement depuis le traitement (dont <strong>les</strong> 2 bas<br />
gra<strong>des</strong>).<br />
CONCLUSION. L’ostéosarcome après 40 ans est plus fréquent<br />
dans notre expérience que sur <strong>les</strong> données classiques de la<br />
littérature. Dans au moins 6 de nos cas (40 %), la méconnaissance<br />
de cette pathologie et ses difficultés diagnostics ont empêché<br />
un traitement optimal. Le pronostic est redoutable avec<br />
seulement 26 % <strong>des</strong> patients en rémission complète sans événement<br />
depuis le traitement.<br />
*F. Gouin, Service de Traumatologie et d’Orthopédie,<br />
Hôtel Dieu, CHU de Nantes, 1, place Alexis-Ricordeau,<br />
44093 Nantes Cedex 1.<br />
226 Les lésions nerveuses par compression<br />
kystique sont-el<strong>les</strong> d’origine<br />
articulaire ? A propos de 23<br />
cas<br />
J. REZZOUK*, A. DURANDEAU, F.FARLIN,<br />
J. BOUCHAIN, T.FABRE<br />
INTRODUCTION. Les pseudo kystes mucoï<strong>des</strong> sont <strong>des</strong><br />
tumeurs bénignes peu fréquentes qui touchent l’ensemble <strong>des</strong><br />
nerfs périphériques au voisinage <strong>des</strong> articulations. Rapportés<br />
pour la première fois dans la littérature en 1891, il se pose<br />
toujours la question de leur nature. Identifier l’origine de ces<br />
kystes peut influencer la prise en charge et le risque de récidive de<br />
ces lésions.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Vingt–trois patients (21 hommes<br />
et 2 femmes) de 38 ans en moyenne ont été suivis avec un<br />
recul moyen de 6 ans. Le kyste mucoïde siégeait 16 fois au<br />
niveau du fibulaire commun au col de la fibula, 1 fois au niveau<br />
du nerf tibial au genou, 1 fois au niveau du nerf médian, dans 3<br />
cas au niveau du nerf ulnaire et dans 2 cas au niveau du nerf<br />
suprascapulaire. La symptomatologie douloureuse a été locale<br />
dans 18 cas, irradiante dans le territoire concerné dans 20 cas.<br />
Dans 17 cas le mode de découverte a été un déficit moteur.<br />
L’EMG a été réalisé dans tous <strong>les</strong> cas, l’échographie dans 15 cas,<br />
le scanner dans 7 cas et l’IRM dans 10 cas. Tous <strong>les</strong> patients ont<br />
été opérés. La neurolyse a été faite sous microscope pour <strong>les</strong><br />
kystes intra neuraux. La recherche d’un pédicule communicant<br />
avec l’articulation voisine a été systématique.<br />
RÉSULTATS. Une communication articulaire a été retrouvée<br />
dans 17 cas. Le délai moyen de récupération d’une force musculaire<br />
à 5 et/ou d’une sensibilité normale a été de 7 mois dans 16<br />
cas, on note une absence totale de récupération dans 1 cas. Il y a<br />
eu une récidive nécessitant une arthrodèse tibio-fibulaire.<br />
DISCUSSION. Des trois théories avancées (dégénérescence<br />
kystique de certains schwannomes, dégénérescence du tissu<br />
conjonctif de la gaine nerveuse) c’est la théorie articulaire que<br />
nous a semblé la plus probable. L’existence d’un pédicule reliant<br />
une articulation dans plus de 60 % <strong>des</strong> cas, la situation anatomique<br />
péri-articulaire <strong>des</strong> nerfs touchés, parfois la migration le long<br />
d’un nerf articulaire et leur contenu mucoïde, sont en faveur<br />
d’une origine articulaire. La notion de récidive après <strong>des</strong> excisions<br />
complètes et minutieuses est également en faveur de la<br />
physiopathologie articulaire.<br />
CONCLUSION. Il faut évoquer un kyste mucoide devant<br />
toute lésion neurologique au voisinage d’une articulation. La<br />
recherche d’une communication articulaire en pré et en per<br />
opératoire est importante notamment pour limiter le risque de<br />
récidive.<br />
*J. Rezzouk, Service de Chirurgie Orthopédique,<br />
CHU Pellegrin, place Amélie-Raba-Léon,<br />
33076 Bordeaux Cedex.<br />
227 Résultats <strong>des</strong> prothèses massives<br />
de l’extrémité distale de l’humérus<br />
pour tumeur<br />
F. FIORENZA*, A. KULKARNI, R.-G. GRIMER,<br />
S.-R. CARTER, R.-M. TILLMAN,<br />
J.-L. CHARISSOUX, P.-B. PYNSENT<br />
INTRODUCTION. La localisation d’une tumeur osseuse primitive<br />
au niveau de l’extrémité distale de l’humérus est une<br />
situation rare survenant dans environ 1 % <strong>des</strong> cas. La reconstruction<br />
à ce niveau est souvent difficile du fait de la résection<br />
osseuse et le choix d’une prothèse tumorale massive constitue<br />
une méthode intéressante tant du point de vue carcinologique que<br />
fonctionnel. Nous rapportons une série de 10 patients qui ont<br />
bénéficié entre 1970 et 2001 d’une reconstruction de l’extrémité<br />
distale de l’humérus par prothèse massive après résection tumorale.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. La série se composait de 4<br />
hommes et 6 femmes. L’âge moyen était de 51 ans (15-76). 8<br />
patients ont présenté <strong>des</strong> tuneurs osseuses primitives et 2 <strong>des</strong><br />
lésions osseuses secondaires. Le recul moyen était de 79 mois<br />
(9-372). L’inplant utilisé était une prothèse faite sur mesure, en<br />
chrome cobalt et titane, contrainte, à charnière, cimentée. Un<br />
suivi clinique et radiologique a été régulièrement effectué. Les
ésultats fonctionnels ont étéévalués selon le score de Henneking<br />
et du TESS (Toronto Extremity Survival Score).<br />
RÉSULTATS. Trois patients ont eu une reprise de leur prothèse<br />
pour <strong>des</strong>cellement aseptique du composant humeral à 48,<br />
56 et 366 mois avec <strong>des</strong> problèmes d’usure <strong>des</strong> paliers en<br />
polyéthylène pour deux d’entre eux. Il n’y a eu ni infection, ni<br />
récidive locale, ni amputation secondaire. L’abord était postérieur<br />
ou antéro-latéral avec une résection numérale en moyenne<br />
de 153 mm (63-260). En post-opératoire 3 paralysies nerveuses<br />
transitaires (1 radiale et 2 ulnaires) ont été retrouvées. 4 patients<br />
sont décédés demétastases avec au moment du décès unrésultat<br />
prothétique tout à fait satisfaisant. Le score TESS était en<br />
moyenne à 73 % (29 % -93 %) à la révision.<br />
CONCLUSION. Bien que le nombre de patients de cette série<br />
soit limité, <strong>les</strong> résultats à long terme semblent indiquer que la<br />
reconstruction de l’extrémité inférieure de l’humérus par prothèse<br />
massive soit une option satisfaisante dans cette localisation<br />
tumorale rare.<br />
*F. Fiorenza, Département d’Orthopédie, CHU Dupuytren,<br />
2, avenue Martin-Luther-King, 87042 Limoges.<br />
228 Remplacement fémoral total par<br />
prothèse pour tumeur osseuse<br />
maligne primitive de l’adulte : à propos<br />
de 5 cas<br />
M. PERRIN*, J. FRAISSE, J.CUISENIER<br />
INTRODUCTION. Le remplacement de la totalité du fémur<br />
pour une tumeur osseuse maligne primitive est une éventualité<br />
rare.<br />
Les prothèses utilisées dans cette série ont été fabriquées sur<br />
mesure par Link selon le modèle de l’Endo Klinik de Hambourg.<br />
El<strong>les</strong> comportent une antéversion réglable et une prothèse de<br />
genou de type « charnière avec rotation ».<br />
PATIENTS-RÉSULTATS. Cas n o 1 : jeune homme de 15 ans,<br />
ostéosarcome grade 2A situé en zone diaphysaire basse du fémur.<br />
Chimiothérapie type Rosen. Résection « en bloc ». Remplacement<br />
par prothèse fémorale totale manchonnée par le massif<br />
trochantérien restant. Excellent répondeur : 100 %. Excellent<br />
résultat fonctionnel : il fait de la varape ! Etat actuel : ni récidive,<br />
ni métastase avec 16 ans de recul.<br />
Cas n o 2:Ostéosarcome de l’adulte (femme de 68 ans) avec<br />
métastase pulmonaire lors du diagnostic. Indication de nécessité<br />
en raison d’une fracture du 1/3 moyen du fémur. Excellent<br />
résultat immédiat. Survie 9 mois dans <strong>des</strong> conditions tout à fait<br />
acceptab<strong>les</strong>.<br />
Cas n o 3 : Malade de 72 ans ayant été traitée 1 an auparavant<br />
pour un cancer du sein T1N0M0. Image de métastase du massif<br />
trochantérien. Traitement par curetage et PTH. L’histologie montre<br />
qu’il s’agit d’un chondrosarcome. La scintigraphie décèle une<br />
hyperfixation du moyen fessier et de la partie basse du fémur.<br />
Résection « en bloc » du fémur entier et du moyen fessier.<br />
Remplacement fémoral total par prothèse manchonnée par une<br />
allogreffe. Exérèse complète. Etat actuel : ni récidive, ni métas-<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 2S129<br />
tase 5 ans après l’intervention. Marche non limitée, avec une<br />
canne en raison d’une boiterie qualifiée demodérée.<br />
Cas n o 4:Ostéosarcome de l’adulte (32 ans) de bas grade (1<br />
B) occupant tout le fémur. Chimiothérapie selon protocole Institut<br />
Rizzoli. Exérèse et remplacement fémoral total par prothèse<br />
manchonnée par une allogreffe. Exérèse complète. Mauvais<br />
répondeur. Excellent résultat fonctionnel, persistance d’une<br />
légère boiterie. Reprise évolutiye sous forme d’une métastase<br />
pulmonaire à 1anetdécès à 1,5 ans.<br />
Cas n o 5 : Leiomyosarcorne osseux grade 2Bdelarégion<br />
diaphysaire basse du fémur chez une femme de 37 ans. Chimiothérapie<br />
néo-adjuvante suivie de résection fémorale totale. Remplacement<br />
par prothèse manchonnée par une allogreffe. Excellent<br />
répondeur : 100 %. Résultat fonctionnel excellent mais recul<br />
faible : 1 an.<br />
DISCUSSION. La technique de remplacement du fémur total<br />
par prothèse avec manchonnage par une allogreffe, permettant la<br />
réinsertion du moyen fessier et du psoas, est fiable et permet<br />
d’éviter <strong>les</strong> instabilités majeures.<br />
Les complications, dans cette courte série, ont été rares et sans<br />
gravité. Les résultats fonctionnels constatés sont excellents et<br />
semblent dépendre, en premier lieu, de l’importance de la résection<br />
musculaire nécessitée par la lésion.<br />
*M. Perrin, Service de Chirurgie,<br />
Centre Georges-François Leclerc,<br />
1, rue du Professeur Marion, 21000 Dijon.<br />
229 Résultats <strong>des</strong> prothèses GUEPAR<br />
dans l’ostéosarcome du genou : à<br />
propos de 48 cas, à plus de 15 ans<br />
de recul<br />
E. MASCARD*, G. MISSENARD, P.WICART,<br />
J. DUBOUSSET<br />
INTRODUCTION. L’utilisation de prothèses massives du<br />
genou dans le traitement <strong>des</strong> tumeurs malignes permet d’excellents<br />
résultats oncologigues et fonctionnels à court terme. Le but<br />
de ce travail est de montrer que ces bons résultats précoces<br />
nécessitent ensuite de nombreuses réinterventions.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. De 1981 à 1986, 48 patients,<br />
d’un âge moyen de 13,8 ans (9 à 19), ont été traités pour<br />
ostéosarcome du genou, par chimiothérapie et resection. Six<br />
patients avaient <strong>des</strong> métastases au moment du diagnostic. La<br />
résection a intéressé le fémur distal 34 fois, le tibia proximal 13<br />
fois et <strong>les</strong> deux extrémités dans un cas. La résection moyenne a<br />
été de 20 cm (12 à 29). La reconstruction a fait appel à une<br />
prothèse sur mesure GUEPAR, cimentée. Vingt <strong>des</strong> prothèses<br />
initialement implantées avaient un mécanisme rotatoire. La<br />
reconstruction du segment diaphysaire a été effectuée le plus<br />
souvent par <strong>des</strong> prothèses massives en métal ou en polyéthylène<br />
et dans 3 cas avec une prothèse manchonnée d’allogreffe. Après<br />
résection du tibia proximal la reconstruction de l’appareil extenseur<br />
a été réalisée avec le jumeau interne.<br />
RÉSULTATS. Les résultats ont été évalués rétrospectivement<br />
avec un recul moyen de 11 ans (4 mois à 20 ans). Sept patients
2S130 77 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
ont été perdus de vue. Au dernier recul disponible, 34 patients<br />
étaient en rémission, 14 étaient décédés, soit une probabilité<br />
actuarielle de survie de 72 % à 15 ans. Sur <strong>les</strong> 48 prothèses<br />
initialement implantées, il y a eu 7 <strong>des</strong>cellements repris, 4<br />
infections (dont 2 secondaires), 4 fractures de queues fémora<strong>les</strong><br />
et 2 fractures du mécanisme rotatoire. Toutes <strong>les</strong> prothèses<br />
suivies plus de trois ans ont nécessité au moins une révision<br />
chirurgicale. Seu<strong>les</strong> huit <strong>des</strong> prothèses initialement implantées<br />
étaient encore en place à 15 ans de recul, soit une probabilité<br />
actuarielle de 39 ± 17 %. Certaines prothèses ont été changées 4<br />
fois. En incluant <strong>les</strong> reprises, <strong>les</strong> 32 patients survivants ont reçu<br />
84 prothèses. La plupart <strong>des</strong> reprises récentes étaient motivées<br />
par l’usure de la charnière, et pour éviter <strong>les</strong> changements<br />
rapprochés de paliers. Au dernier recul, un patient était amputé,<br />
un avait une rotationplasty, et un était arthrodésé, toujours pour<br />
infection.<br />
Les résultats fonctionnels au dernier recul étaient bons ou<br />
excellents 19 fois, moyens 5 fois, mauvais 3 fois, et n’ont pas pu<br />
être évalué 21 fois (14 décès et 7 perdus de vue).<br />
CONCLUSION. Les reconstructions par prothèses massives<br />
s’accompagnent d’un taux élevé de complications mécaniques,<br />
rendant inévitable <strong>les</strong> reprises chirurgica<strong>les</strong>. Ces complications<br />
sont dues avant tout à l’usure de la charnière elle-même. L’utilisation<br />
de prothèses mieux conçues mécaniquement devrait<br />
diminuer ces complications mécaniques. Il faut, quand l’extension<br />
tumorale respecte l’épiphyse, privilégier l’utilisation de<br />
moyens de reconstruction biologiques, non prothétiques.<br />
*E. Mascard, Service de Chirurgie Orthopédique,<br />
Hôpital Saint-Vincent-de-Paul, 82, avenue Denfert-Rochereau,<br />
75014 Paris.<br />
230 Fibula vascularisée pour résections<br />
oncologiques (14 cas) : quelle fixation<br />
utiliser ?<br />
F. LANGLAIS*, T. DRÉANO, F.-X. SEVESTRE,<br />
H. THOMAZEAU, P.COLLIN, S.AILLET<br />
INTRODUCTION. La reconstruction par fibula revascularisée<br />
a pour avantages le remodelage du transplant en fonction <strong>des</strong><br />
contraintes, et sa résistance aux infections. Une ostéosynthèse a<br />
<strong>des</strong> avantages mécaniques (stabilisation facilitant la consolidation<br />
primaire et cel<strong>les</strong> <strong>des</strong> fractures de fatigue) mais risque peut<br />
être d’empêcher l’hypertrophie de la fibula en détournant <strong>les</strong><br />
contraintes.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Notre série de 25 fibula vascularisées<br />
(recul maximum 15 ans) concerne <strong>des</strong> pertes de substances<br />
post traumatiques (11 cas) et <strong>des</strong> résections tumora<strong>les</strong> (14<br />
cas). Pour cette étude du remodelage, nous n’avons retenu que <strong>les</strong><br />
reconstructions oncologiques car beaucoup de facteurs peuvent<br />
interférer dans <strong>les</strong> séquel<strong>les</strong> de traumatisme (infection, conservation<br />
du péroné homolatéral intact dans une perte de substance<br />
tibiale). Aucun patient n’a été perdu de vue et le remodelage a été<br />
apprécié àdeux ans ou plus.<br />
RÉSULTAT.Ilyaeuunéchec nécessitant une amputation de<br />
jambe (pseudarthrose septique du tibia distal sur ostéosarcome<br />
irradié), toutes <strong>les</strong> autres fibula ont consolidé. Trois résections<br />
métaphysaires fémora<strong>les</strong> dista<strong>les</strong> ont été montées par lame plaque<br />
latérale avec fibula en étai médial en compression. Ce<br />
montage souple a aboutit à trois excellents remodelages.<br />
Cinq arthrodèses du genou ont été assurées par fibula avec clou<br />
fémoro-tibial. La consolidation a été lente et l’épaississement de<br />
la fibula peu marqué, surtout lorsque celle ci était simplement<br />
apposée en tuteur (3 cas) plutôt qu’encastrée en compression (2<br />
cas). Dans <strong>les</strong> 5 humérus proximaux, l’utilisation de plaque fine<br />
dans 3 cas (type plaque avant bras) a été suffisante pour permettre<br />
la consolidation sans empêcher le remodelage.<br />
DISCUSSION. Au membre inférieur, un bon remodelage est<br />
obtenu en utilisant un montage permettant la mise en compression<br />
de la fibula placée en dedans de l’axe diaphysaire. Pour <strong>les</strong><br />
pertes de substances métaphysaires, une plaque latérale avec étai<br />
fibulaire en dedans est conseillée. Dans <strong>les</strong> arthrodèses un clou<br />
est peut-être plus prudent. La position en tuteur latéral diminue<br />
<strong>les</strong> contraintes sur la fibula et est moins recommandée que la<br />
position médiale en étai. A l’humérus, la synthèse est nécessaire<br />
mais doit être légère pour obtenir un remodelage optimal.<br />
CONCLUSION. La fibula vascularisée est une technique fiable.<br />
Elle est recommandée pour <strong>des</strong> résections importantes<br />
(moyenne 160 mm), chez <strong>les</strong> sujets actifs. La mise en compression<br />
axiale du greffon, l’utilisation d’une ostéosynthèse légère,<br />
paraissent favoriser la consolidation et le remodelage.<br />
*F. Langlais, Hôpital Sud, 16, boulevard de Bulgarie,<br />
BP 90347, 35203 Rennes Cedex 2.<br />
231 Etude anatomique de la vascularisation<br />
artérielle de l’os coxal : application<br />
aux voies d’abord du cotyle<br />
F. DE PERETTI*, A. YIMING, P.BAQUE<br />
INTRODUCTION. Le but de ce travail a été d’étudier la<br />
vascularisation artérielle de l’os coxal afin de minimiser le risque<br />
de nécrose osseuse post-chirurgicale lors <strong>des</strong> ostéosynthèses de<br />
l’acétabulum. La nécrose de l’os coxal est une complication rare<br />
mais connue de la chirurgie <strong>des</strong> fractures de l’acétabulum.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODE. Dix cadavres frais ont été disséqués<br />
après injection intra-artérielle d’une résine colorée, toutes<br />
<strong>les</strong> collatéra<strong>les</strong> <strong>des</strong>tinées à l’os ont été décrites et comptées. Une<br />
cartographie artérielle a pu être élaborée.<br />
RÉSULTATS. L’acétabulum présente 4 sources artériel<strong>les</strong><br />
principa<strong>les</strong> :<br />
1) l’artère de l’ischion, collatérale de l’artère puddendale,<br />
vascularise la partie postérieure et latérale de l’acétabulum ;<br />
2) l’artère du toit de l’acétabulum, collatérale de l’artère glutéale<br />
supérieure, vascularise la partie supérieure et latérale de<br />
l’acétabulum ;<br />
3) <strong>les</strong> branches de division antérieure et postérieure de l’artère<br />
obturatrice vascularise la partie supérieure du pourtour du foramen<br />
obturé et <strong>les</strong> parties antéro-inférieures et postéro-inférieures<br />
de l’acétabulum ;
4) la vascularisation de la surface quadrilatère provient de<br />
rameaux issus de l’artère obturatrice.<br />
DISCUSSION. La voie de Kocher peut léser facilement<br />
l’artère de l’ischion. La grande voie latérale de Letournel et la<br />
voie triradiée de Mears peuvent léser l’artère de l’ischion et<br />
l’artère du toit de l’acétabulum. Le risque de nécrose osseuse<br />
semble théoriquement augmenté si on ajoute un abord endopelvien<br />
qui peut léser <strong>les</strong> artères endo-pelviennes issues de<br />
l’artère obturatrice. La voie antérieure de l’acétabulum semble<br />
théoriquement moins ischiémante que <strong>les</strong> autres voies d’abord.<br />
*F. de Peretti, Service de Chirurgie Orthopédique<br />
et Traumatologique, Hôpital Saint-Roch,<br />
5, rue Pierre-Dévoluy, 06000 Nice.<br />
232 Prévention <strong>des</strong> ossifications hétérotopiques<br />
à l’aide d’inhibiteurs sélectifs<br />
COX-2 après prothèse totale de<br />
hanche : étude randomisée prospective<br />
M. SAUDAN*, N. RIAND, P.SAUDAN, A.KELLER,<br />
P. HOFFMEYER<br />
INTRODUCTION. Les ossifications hétérotopiques sont une<br />
complication reconnue après mise en place d’une prothèse totale<br />
de hanche. Sa prévalance peut aller jusqu’à 53 % notamment en<br />
absence de prophylaxie entraînant <strong>des</strong> douleurs postopératoires et<br />
diminuant le pronostic fonctionnel. Les anti-inflammatoires nonstéroïdiens<br />
sont reconnus comme une prévention efficace, cependant<br />
ils présentent une toxicité gastro-duodenal rendant leur<br />
administration en postopératoire difficile. Récemment, <strong>les</strong> inhibiteurs<br />
sélectifs de type COX-2 ont montré une activité similaire<br />
du point de vue anti-inflammatoire, avec une nette réduction <strong>des</strong><br />
troub<strong>les</strong> gastro-intestinaux. Nous avons fait l’hypothèse que<br />
ceux-ci sont aussi efficace que <strong>les</strong> AINS classiques dans la<br />
prévention <strong>des</strong> ossifications hétérotopiques.<br />
MATÉRIEL. Il s’agit d’une étude clinique randomisée prospective<br />
comparant un groupe ayant une prophylaxie à base de<br />
Celecoxib (Celebrext) à un autre groupe recevant de l’Ibuprofen<br />
(Brufent).<br />
MÉTHODE. Tous <strong>les</strong> patients prévus pour une prothèse totale<br />
élective sont randomisés demanière prospective dans l’un <strong>des</strong><br />
deux groupes, soit Celecoxib 200 mg × 2/jour ou Ibuprofen 400<br />
mg × 3/jour pour 10 jours postopératoires immédiats. Une évaluation<br />
radiologique est faite à l’aveugle par 2 médecins indépendants<br />
de l’étude, un orthopédiste et un radiologue, pour<br />
évaluer <strong>les</strong> calcifications selon la classification de Brooker (type<br />
I à IV) à 3 mois postopératoires. La reproductibilité de la lecture<br />
de ces 2 médecins avait été testée et analysée statistiquement par<br />
un Kappa-test (K = 0,74).<br />
RÉSULTAT. Deux cent dix patients ont été déjà randomiséset<br />
73 déjà eu leur radiographie à 3 mois postopératoire.<br />
Le groupe Celebrex comprend 37 patients, avec 24 patients<br />
ayant un stade de Brooker à 0, 11 patients avec un stade de<br />
Brooker à 1, 2 patients avec un stade de Brooker à 2.<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 2S131<br />
Le groupe Brufen comprend 42 patients, 15 patients ayant un<br />
Brooker à 0, 16 ayant un Brooker à 11, 9 patients ayant un<br />
Brooker à 2, et 2 patients ayant un Brooker à 3.<br />
L’étude statistique sera fait à la fin del’étude, à savoir juin<br />
2002.<br />
CONCLUSION. Les résultats préliminaires montrent que le<br />
Celecoxib semble avoir une même efficacité que l’Ipubrofen dans<br />
la prévention d’ossification hétérotopique après prothèse totale<br />
de hanche. Il yamême une nette tendance en faveur du Celecoxib.<br />
*M. Saudan, Hôpital Cantonal Universitaire de Genève,<br />
24, rue Micheli-de-Crest, 1211 Genève 14, Suisse.<br />
233 L’Alendronate diminue la perte<br />
osseuse péri-prothétique après prothèse<br />
totale de hanche cimentée :<br />
étude prospective randomisée en<br />
double aveugle<br />
A. NEHME*, G. MAALOUF, J.-L. TRICOIRE,<br />
P. CHIRON, G.GIORDANO, J.PUGET<br />
INTRODUCTION. Le remodelage osseux et l’ostéolyse<br />
autour <strong>des</strong> prothèses tota<strong>les</strong> de hanche restent toujours d’actualité<br />
avec comme corollaire inéluctable le <strong>des</strong>cellement prothétique.<br />
L’Alendronate (biphosphonate) a déjà fait ses preuves dans le<br />
traitement de l’ostéoporose du rachis lombaire et du col fémoral.<br />
Quelques travaux ont souligné son intérêt dans l’inhibition de<br />
l’ostéolyse induite par <strong>les</strong> particu<strong>les</strong> in vitro. In vivo, une étude a<br />
montré son intérêt dans la prévention de l’ostéolyse autour de<br />
PTH non cimentées. Le but de notre travail est d’étudier l’efficacité<br />
de ce médicament dans la prévention de l’ostéolyse périprothétique<br />
autour <strong>des</strong> PTH cimentées en utilisant l’absorptiométrie<br />
biphotonique à rayons X (DPX).<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. La série étudiée comporte 38<br />
patientes opérées d’une PTH unilatérale pour coxarthrose. Après<br />
randomisation en double aveugle ; 20 patientes ont reçu 10mg<br />
d’Alendronate par jour associés à 600 mg de calcium, et 18<br />
patientes ont reçu du placebo associé à600 mg de Calcium,<br />
pendant deux ans. Toutes ont été suivies par <strong>des</strong> radiographies<br />
conventionnel<strong>les</strong> et <strong>des</strong> examens de type DPX de la hanche<br />
opérée. Ces examens ont été pratiqués au quatrième jour postopératoire<br />
ainsi qu’aux troisième, sixième, douzième et vingtquatrième<br />
mois post-op. L’analyse a été effectuée à partir <strong>des</strong><br />
zones périprothétiques définies par Gruen.<br />
RÉSULTATS. La DPX a objectivé une diminution significative<br />
de la DMO (densité minérale osseuse) chez toutes <strong>les</strong><br />
patientes incluses dans l’étude. Pour <strong>les</strong> deux groupes, cette perte<br />
reste identique au début et atteint son maximum à 3 mois avant de<br />
diverger par la suite. Pour le groupe placebo, la perte se stabilise<br />
jusqu’au sixième mois, à partir duquel, la DMO commence à<br />
remonter progressivement, pour rester à 12,7 % de diminution à<br />
2 ans de recul (p < 0,002). Dans le groupe ALN, aucune stabilisation<br />
n’est observée, et la DMO remonte directement pour<br />
atteindre 6,9 % de perte osseuse à deux ans (p < 0,003).
2S132 77 e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.<br />
DISCUSSION. Ainsi l’utilisation de l’Alendronate a permis<br />
de réduire de façon significative la perte osseuse périprothétique<br />
à deux ans de recul. Nos résultats sont <strong>les</strong> premiers à notre<br />
connaissance à rapporter l’effet bénéfique in vivo de l’utilisation<br />
de l’Alendronate sur le comportement osseux autour <strong>des</strong> PTH<br />
cimentées.<br />
CONCLUSION. Compte tenu du faible recul de la série, et de<br />
sa taille mo<strong>des</strong>te, d’autres étu<strong>des</strong> sont indispensab<strong>les</strong> afin de<br />
confirmer cet effet bénéfique in vivo que cette étude met en<br />
exergue. Ainsi l’action de l’Alendronate pourrait faciliter la<br />
chirurgie de reprise en préservant le capital osseux.<br />
*A. Nehme, Service de Chirurgie Orthopédique<br />
et Traumatologique, Hôpital Rangueil, 1, avenue Poulhes,<br />
31403 Toulouse Cedex 3.<br />
234 La densité minérale osseuse du<br />
rachis lombaire et de la hanche<br />
controlatérale ne varie pas après<br />
prothèse totale de hanche cimentée<br />
A. NEHME*, J.-L. TRICOIRE, P.CHIRON,<br />
G. GIORDANO, G.MAALOUF, J.PUGET<br />
INTRODUCTION. La mise en place de la tige fémorale d’une<br />
prothèse totale de hanche induit un pontage <strong>des</strong> contraintes dans<br />
le fémur proximal responsable d’une résorption osseuse bien<br />
documentée. La revue de la littérature concernant le comportement<br />
du fémur controlatéral et du rachis lombaire retrouve <strong>des</strong><br />
étu<strong>des</strong> contradictoires. La densité minérale osseuse du rachis<br />
lombaire varie selon <strong>les</strong> auteurs, par contre celle du col controlatéral,<br />
étudiée toujours après PTH non cimentées montre une<br />
baisse significative de la densité osseuse. Tous <strong>les</strong> patients dans<br />
ces étu<strong>des</strong> ont nécessité une période de décharge dans l’attente de<br />
la fixation définitive de la prothèse. Le but de ce travail est l’étude<br />
du comportement osseux du fémur controlatéral et du rachis<br />
lombaire après prothèse totale de hanche unilatérale cimentée<br />
avec un appui post-opératoire immédiat.<br />
MATÉRIEL ET MÉTHODES. La série étudiée comporte 52<br />
patients opérésd’une PTH unilatérale cimentée pour coxarthrose.<br />
Tous ont été suivis par <strong>des</strong> radiographies conventionnel<strong>les</strong> et <strong>des</strong><br />
contrô<strong>les</strong> de type DPX de la hanche contro-latérale et du rachis<br />
lombaire. Ces examens ont été réalisés un mois avant l’intervention<br />
puis à J8, M3, M6, à un an et à deux ans. L’analyse a été<br />
effectuée à partir <strong>des</strong> mesures de la DMO corticale du col fémoral<br />
et trabéculaire au niveau <strong>des</strong> vertèbres L2-L4. La verticalisation<br />
de ces patients avec reprise de la marche et appui immédiat a<br />
commencé en moyenne à J3-J4 post-opératoire.<br />
RÉSULTATS. La DPX n’a pas objectivé de diminution significative<br />
de la DMO chez aucun <strong>des</strong> patients inclus dans l’étude, ni<br />
au niveau du rachis lombaire ni au niveau du col fémoral<br />
controlatéral.<br />
DISCUSSION. Plusieurs travaux dans la littérature insistent<br />
sur la difficulté de récupérer la masse osseuse perdue après une<br />
période d’immobilisation ou de décharge. Cette perte osseuse<br />
pourrait atteindre jusqu’à 10 % de la masse osseuse même pour<br />
une mise en décharge courte. De plus, une perte osseuse minime<br />
de l’ordre de 2,5 % pourrait accélérer la transformation d’une<br />
ostéopénie en ostéoporose et augmenter ainsi <strong>les</strong> risques de<br />
survenue de fractures. L’intérêt de minimiser <strong>les</strong> pério<strong>des</strong> de<br />
décharges chez <strong>les</strong> patients <strong>les</strong> plus âgés parait donc évident.<br />
CONCLUSION. L’utilisation <strong>des</strong> tiges fémora<strong>les</strong> cimentées<br />
ou non cimentées mais avec un <strong>des</strong>sin et un traitement de surface<br />
permettant un appui post-opératoire immédiat est à favoriser chez<br />
<strong>les</strong> patients âgés afin de diminuer le risque de perte osseuse<br />
accrue chez ces patients souvent déjà ostéoporotiques.<br />
*A. Nehme, Service de Chirurgie Orthopédique<br />
et Traumatologique, Hôpital Rangueil, 1, avenue Poulhes,<br />
31403 Toulouse Cedex 3.<br />
235 Reconstruction individuelle du<br />
genou par prothèse unicompartimentale<br />
construite au moyen de<br />
données tomodensitométriques et<br />
prototypage rapide<br />
C. SCHUSTER*, A. GIEBL, R.WUTTGE,<br />
S. PLAWESKI, L.PITTET, X.COMBAZ, J.TONETTI,<br />
L. SCHUSTER<br />
INTRODUCTION. Un nouveau logiciel basé sur <strong>des</strong> données<br />
tomodensitométriques permettant une reconstruction individuelle<br />
unicompartimentale a été développé dans le but de réaliser<br />
une reconstruction anatomique sur mesure du compartiment<br />
interne du genou et de restaurer la cinématique physiologique<br />
propre à chaque genou. Ce système permet également de fournir<br />
<strong>des</strong> outils individuels pour l’implantation.<br />
MATÉRIEL. Des prothèses unicompartimenta<strong>les</strong> sur-mesure<br />
et leurs patrons d’implantation correspondants ont été conçues<br />
avec ce logiciel et l’ensemble <strong>des</strong> données saisies dans une<br />
machine de prototypage rapide ainsi que dans une machine de<br />
fraisage ; ceci pour produire une prothèse unicompartimentale en<br />
deux pièces (polyéthylène et cobalt chrome), ainsi que <strong>des</strong> gui<strong>des</strong><br />
de coupe anatomiques propres à chaque genou. Cette méthode à<br />
été testée sur 10 pièces cadavériques de genou afin de contrôler la<br />
précision de la reconstruction et l’alignement de cette prothèse.<br />
MÉTHODES. A l’aide d’un logiciel spécialement conçu, <strong>des</strong><br />
reconstructions 3D du genou spécimen sont produites en tenant<br />
compte précisément de la surface cartilagineuse. Dans un<br />
deuxième temps <strong>des</strong> coupes osseuses virtuel<strong>les</strong> sont réalisées<br />
pour obtenir le futur siège d’accueil de l’implant. Les données de<br />
la résection osseuse virtuelle sont récupérées afin d’obtenir la<br />
forme brute du futur implant. Les surfaces articulaires qui présentent<br />
encore <strong>des</strong> lésions arthrosiques sont réparées et affinées<br />
par interpolation ainsi que par utilisation en miroir <strong>des</strong> données<br />
obtenues à partir de la région correspondante du genou controlatéral.<br />
Puis un système de support individuel est mis en place pour<br />
permettre de réaliser <strong>les</strong> coupes osseuses obtenues virtuellement.<br />
L’ensemble <strong>des</strong> données affinées est alors saisi dans une machine<br />
de prototypage rapide ainsi que dans une machine de fraisage,<br />
ceci pour produire une prothèse unicompartimentale en deux<br />
pièces, ainsi que <strong>des</strong> gui<strong>des</strong> de coupe anatomiques propres à ce<br />
genou. L’opération est ensuite réalisée par une incision parapa-
tellaire médiale de 8 centimètres. Les implants sont placés sans<br />
autre fixation sur <strong>les</strong> geqoux et testésimmédiatement quant à leur<br />
fonctionnalité. La reconstruction anatomique du genou est vérifiée<br />
par <strong>des</strong> radiographies standards et <strong>des</strong> images TDM puis<br />
comparée aux données initia<strong>les</strong>.<br />
RÉSULTATS. Les implants ont pu être mis en place rapidement<br />
et facilement, ils ont montré une excellente qualité de<br />
pressfit et ont reproduit la morphologie initiale saine de l’articulation.<br />
DISCUSSION. Le mouvement du genou prothèse reproduisait<br />
toutes <strong>les</strong> caractéristiques du mouvement physiologique. De plus<br />
la prothèse de genou obtenue par cette méthode permettait une<br />
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 2S133<br />
résection osseuse individuelle et minimale, optimisait la<br />
congruence et <strong>les</strong> zones de contact de l’os avec l’implant et<br />
réduisait <strong>les</strong> difficultés chirurgica<strong>les</strong> d’alignement. Ce système<br />
semble performant pour restaurer la cinématique individuelle<br />
physiologique de l’articulation.<br />
CONCLUSION. Il semble également possible d’utiliser ce<br />
système à terme pour <strong>les</strong> arthroplasties tota<strong>les</strong> de genou. Afin<br />
d’éviter <strong>les</strong> radiations provoquées, <strong>des</strong> procédures identiques<br />
peuvent être adaptées à la technique d’imagerie par résonance<br />
magnétique.<br />
*C. Schuster, Service Orthopédie-Traumatologie,<br />
Hôpital Michallon, BP 217, 38043 Grenoble Cedex 09.