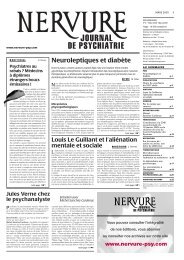Novembre - Nervure Journal de Psychiatrie
Novembre - Nervure Journal de Psychiatrie
Novembre - Nervure Journal de Psychiatrie
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
8<br />
LIVRES<br />
■ HISTOIRE<br />
Architecture et santé<br />
Le temps du sanatorium en<br />
France et en Europe<br />
Jean-Bernard Cremmitzer<br />
Préface <strong>de</strong> Jacques-Louis Binet<br />
Editions Picard, 30 €<br />
Le thème du sanatorium est récurrent<br />
dans l’histoire <strong>de</strong> l’architecture<br />
mo<strong>de</strong>rne. Présent dans les ouvrages<br />
<strong>de</strong> référence,on le rencontre dans les<br />
monographies consacrées aux architectes<br />
majeurs du XX e siècle : le<br />
sanatorium est un édifice emblématique<br />
dans l’œuvre <strong>de</strong> Jan Duiker aux<br />
Pays-Bas, d’Alvar Aalto en Finlan<strong>de</strong>,<br />
et pour la France <strong>de</strong> Tony Garnier,<br />
d’André Lurçat, <strong>de</strong> Pol Abraham et<br />
d’Henry-Jacques Le Même.<br />
La tuberculose, la Peste Blanche,<br />
comme on nomme alors ce fléau, fait<br />
au début du XX e siècle 100 000 victimes<br />
par an en France ; un programme<br />
<strong>de</strong> lutte contre la maladie, en partie<br />
inspiré par les Etats-Unis, et dont l’apogée<br />
se situe entre les <strong>de</strong>ux guerres,<br />
est à l’origine <strong>de</strong> la construction <strong>de</strong>s<br />
sanatoriums sur le territoire national.<br />
La valeur thérapeutique du sanatorium<br />
se fon<strong>de</strong> sur l’hypothèse <strong>de</strong> la<br />
cure d’air, <strong>de</strong> lumière, <strong>de</strong> soleil, et sur<br />
l’isolement <strong>de</strong>s mala<strong>de</strong>s contagieux,<br />
conduits à contempler un paysage<br />
naturel à l’écart <strong>de</strong>s méfaits <strong>de</strong> la ville<br />
industrielle. Ce défi, mené en l’absence<br />
<strong>de</strong> moyens thérapeutiques pleinement<br />
efficaces, s’est traduit en<br />
France par près <strong>de</strong> 250 réalisations,<br />
qui s’échelonnent du début du XX e<br />
siècle aux années 1950 ; l’avènement<br />
<strong>de</strong>s traitements par antibiotiques annonce<br />
alors la désuétu<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’institution<br />
et <strong>de</strong> ses instruments.<br />
L’ouvrage analyse le cas <strong>de</strong>s réalisations<br />
françaises dans leur rapport aux<br />
influences alleman<strong>de</strong>, suisse, hollandaise,<br />
et américaine. La plupart<br />
<strong>de</strong>s typologies produites relèvent <strong>de</strong><br />
transferts étrangers, et malgré les projets<br />
<strong>de</strong> Tony Garnier, il faut attendre<br />
les années 1920 pour que les tenants<br />
français du Mouvement mo<strong>de</strong>rne, architectes<br />
et aussi ingénieurs, s’engagent<br />
dans ce programme hygiéniste<br />
dicté par les mé<strong>de</strong>cins et apportent<br />
<strong>de</strong>s réponses, comme le témoignent<br />
les réalisations du Plateau d’Assy ou<br />
les étonnants solariums tournants.<br />
Ce nouveau concept d’isolement <strong>de</strong>s<br />
mala<strong>de</strong>s, soumis à une stricte discipline<br />
médicale, relève d’un nouvel<br />
ordre moral, d’une nouvelle culture<br />
<strong>de</strong> l’habiter ; le sanatorium <strong>de</strong>vient<br />
en quelque sorte le con<strong>de</strong>nsateur social<br />
<strong>de</strong>stiné à réinsérer les mala<strong>de</strong>s<br />
exclus, et fait figure <strong>de</strong> référence pour<br />
la réalisation <strong>de</strong>s nouveaux programmes<br />
d’hôpitaux, d’hôtels, et <strong>de</strong><br />
logements. Bien qu’aujourd’hui obsolète,<br />
il dépasse la simple traduction<br />
d’une politique <strong>de</strong> lutte contre la tuberculose,<br />
pour se poser en modèle<br />
<strong>de</strong> société, où les valeurs environnementales<br />
et les questions <strong>de</strong> santé<br />
dans la ville et l’habitat annoncent<br />
les problèmes auxquels nous sommes<br />
aujourd’hui confrontés.<br />
Malaise dans la famille<br />
Entretiens sur la psychanalyse<br />
<strong>de</strong> l’enfant<br />
Nazir Hamad<br />
Thierry Najman<br />
Préface <strong>de</strong> Charles Melman<br />
Erès, 18 €<br />
Il s’agit d’un dialogue entre un psychanalyste<br />
expérimenté et un psychiatre,<br />
psychanalyste plus jeune dans<br />
le métier, est en permanence vectorisé<br />
par la place <strong>de</strong> l’inconscient, et<br />
donc par l’équivoque dont est porteuse<br />
la parole <strong>de</strong>s enfants autant<br />
que celle <strong>de</strong>s adultes.<br />
<br />
l’hôpital général d’où il a sorti les aliénés<br />
n’est en rien la structure <strong>de</strong> soins<br />
que nous connaissons aujourd’hui.<br />
Penser la place <strong>de</strong> la<br />
psychiatrie dans la<br />
mé<strong>de</strong>cine : la<br />
professionnalisation<br />
De toute évi<strong>de</strong>nce, penser la place <strong>de</strong><br />
la psychiatrie dans la mé<strong>de</strong>cine est entachée<br />
d’un double contresens :<br />
- l’hôpital n’a pas toujours été un lieu<br />
médical,<br />
- la distance originelle que la psychiatrie<br />
prend avec lui est moins un signe d’ostracisme<br />
qu’une condition <strong>de</strong> son institutionnalisation.<br />
Un rapprochement, pour troublant qu’il<br />
soit, s’impose ici : Le premier Livre Blanc<br />
avait précédé l’autonomisation <strong>de</strong> la<br />
psychiatrie, le second se trouve en difficulté<br />
pour analyser son lien avec le<br />
reste <strong>de</strong> la mé<strong>de</strong>cine. La psychiatrie<br />
est dans un équilibre instable, voire<br />
oscille entre être ou ne pas être dans la<br />
mé<strong>de</strong>cine. Dans cette difficulté à penser<br />
la place la psychiatrie, un élément<br />
est particulièrement éloquent. De façon<br />
peu congruente avec l’optimisme <strong>de</strong><br />
ses conclusions – « les retrouvailles entre<br />
psychiatrie et mé<strong>de</strong>cine, sans dissolution<br />
<strong>de</strong> l’i<strong>de</strong>ntité <strong>de</strong> la discipline psychiatrique »<br />
– le Livre Blanc véhicule un message<br />
implicite différent : la place et la reconnaissance<br />
<strong>de</strong>s psychiatres parmi les<br />
autres mé<strong>de</strong>cins sont mises à mal. De<br />
nombreux passages abon<strong>de</strong>nt dans ce<br />
sens. La psychiatrie est « tributaire <strong>de</strong><br />
l’intérêt <strong>de</strong>s confrères somaticiens »<br />
(p. 67). Il peut être intéressant <strong>de</strong> souligner<br />
que le terme parfois un peu péjoratif<br />
<strong>de</strong> « somaticien » n’est utilisé que<br />
par les psychiatres pour dénommer les<br />
mé<strong>de</strong>cins qui traitent <strong>de</strong>s maladies du<br />
corps (soma). Cette référence sémantique<br />
laisse perplexe : elle peut être<br />
interprétée comme un mouvement <strong>de</strong><br />
mise à l’écart et <strong>de</strong> distinction d’avec les<br />
Société Psychanalytique <strong>de</strong> Paris<br />
Séminaire<br />
Jean Cornut<br />
d’introduction<br />
à la psychanalyse<br />
L’ iinco nnsc ii ee nnt d aa nns to uus s ees éé tt aats<br />
La découverte<br />
Programme 2006-2007 (1ère année)<br />
Théorie et clinique en<br />
psychanalyse et<br />
en psychothérapie<br />
Cycle <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux ans ouvert aux<br />
Mé<strong>de</strong>cins, Psychiatres,<br />
Psychologues, Etudiants en fin<br />
d’étu<strong>de</strong>s.<br />
Lundi 9 octobre 2006 La découverte <strong>de</strong> l’inconscient<br />
Lundi 23 octobre 2006 Breuer et Freud face à l’hystérie<br />
Lundi 13 novembre 2006 Actualité <strong>de</strong> Dora<br />
Lundi 27 novembre 2006 Le rêve, voie royale<br />
Lundi 11 décembre 2006 La sexualité infantile<br />
Lundi 22 janvier 2007 Les problèmes <strong>de</strong> transfert(s)<br />
Lundi 12 février 2007 La métapsychologie <strong>de</strong> la<br />
première topique<br />
Lundi 12 mars 2007 Résistances et Refoulement<br />
Lundi 26 mars 2007 I<strong>de</strong>ntification et Processus<br />
Lundi 23 avril 2007 L’inconscient et le travail d’analyste<br />
Lundi 14 mai 2007 Remémorer, répéter, éla,borer,<br />
le pivot ?<br />
Lundi 11 juin 2007 Narcissisme et pulsion<br />
Lundi 25 juin 2007 Névrose actuelle, névrose<br />
traumatique<br />
COMITÉ SCIENTIFIQUE : Le prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la SPP, et : Liliane Abensour, Marilia Aisenstein,<br />
Bernard Brusset, Monique Cornut, Paul Denis, Jean-Luc Donnet, Alain Fine, Jacques<br />
Fortineau, Roger Misès • COMITÉ D’ORGANISATION : Gérard Bayle, Danielle Kawin-<br />
Bonnefond, Cyrille Munier, Félicie Nayrou • AVEC LA PARTICIPATION DE : Jacques Angelrgues,<br />
Gérard Bayle, Michelle Bertrand, Christine Bouchard, Thierry Bokanowski, Jean-Luc<br />
Donnet, Alain Gibeault, Chantal Lechartier, Michel <strong>de</strong> M’Uzan, Hélène Parat, Roger<br />
Perron, Jacqueline Schaeffer, Bernard Touati.<br />
autres mé<strong>de</strong>cins, alors même que le<br />
propos du texte revendique un<br />
rapprochement.<br />
Plus loin, on retrouve cette même<br />
image négative <strong>de</strong> la psychiatrie supposée<br />
présente chez les autres mé<strong>de</strong>cins<br />
: la psychiatrie <strong>de</strong> liaison requiert<br />
« l’estime » réciproque entre psychiatres<br />
et « somaticiens » (p. 67), ces <strong>de</strong>rniers ne<br />
sont pas toujours « convaincus » (p. 70)<br />
<strong>de</strong> l’utilité <strong>de</strong> la psychiatrie, ils lui associent<br />
les notions « regrettables » <strong>de</strong> chronicité<br />
et <strong>de</strong> stigmatisation sociale<br />
(p. 70). Mais ces termes ne véhiculent<br />
pas le simple enjeu d’une image dégradée<br />
<strong>de</strong> la discipline, ils posent en fait<br />
une autre question. Les auteurs dénoncent,<br />
en effet, une « autonomisation<br />
abusive du mon<strong>de</strong> médical à l’égard du<br />
partenariat psychiatrique ». La psychiatrie<br />
ne serait donc pas indispensable<br />
au reste <strong>de</strong> la mé<strong>de</strong>cine, nous disent<br />
les psychiatres, discours qui serait<br />
improbable sous la plume d’un chirurgien<br />
par exemple. Comment comprendre<br />
<strong>de</strong> telles conceptions contradictoires<br />
?<br />
La question sous-jacente pourrait, en<br />
fait, être la suivante : comment la psychiatrie<br />
peut-elle négocier légitimement<br />
une place au sein <strong>de</strong> la mé<strong>de</strong>cine ?<br />
Question qui pourrait se formuler selon<br />
les termes suivants : est ce que les psychiatres<br />
« connaissent mieux que les<br />
autres la nature <strong>de</strong> certaines questions<br />
» (5) (p 108) ? Un contre-exemple<br />
éclaire facilement notre propos : personne<br />
ne remettrait en doute le recours<br />
indispensable à la chirurgie et son existence<br />
légitime, tant un savoir (et surtout<br />
un savoir-faire technique) la structure<br />
<strong>de</strong> façon homogène. Aucun risque n’est<br />
dénoncé concernant une « autonomisation<br />
abusive » <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins vis-à-vis<br />
<strong>de</strong>s chirurgiens.<br />
Les travaux <strong>de</strong> Hughes et <strong>de</strong>s sociologues<br />
<strong>de</strong> l’Ecole <strong>de</strong> Chicago au sujet<br />
<strong>de</strong>s professions sont à cet égard instructifs.<br />
En effet, selon ces auteurs, la<br />
profession est une organisation parti-<br />
Deux lundis par mois<br />
<strong>de</strong> 20h45 à 23h<br />
à la Schola Cantorum<br />
Salle César Franck<br />
269 rue Saint Jacques<br />
75005 PARIS<br />
Le nombre <strong>de</strong> places est limité<br />
à 100 participants.<br />
Cartes annuelles délivrées par le<br />
secrétariat après <strong>de</strong>man<strong>de</strong> écrite.<br />
Dans la mesure <strong>de</strong>s places disponibles,<br />
il est possible <strong>de</strong> s’inscrire à l’unité<br />
auprès du secrétariat <strong>de</strong> la SPP une<br />
semaine à l’avance.<br />
La porte sera fermée à partir <strong>de</strong> 21h.<br />
La Société psychanalytique <strong>de</strong><br />
Paris propose un séminaire <strong>de</strong><br />
sensibilisation à la psychanalyse,<br />
ouvert aux mé<strong>de</strong>cins, psychiatres,<br />
psychologues et aux étudiants<br />
en fin <strong>de</strong> cursus <strong>de</strong> Psychologie et <strong>de</strong><br />
<strong>Psychiatrie</strong>.<br />
A chaque séance sont présentés<br />
un exposé théorique et une<br />
illustration <strong>de</strong> cas ouvrant à la<br />
discussion. Nous envisagerons les<br />
divers aspects <strong>de</strong>s pulsions et <strong>de</strong><br />
leurs transformations à partir <strong>de</strong><br />
tableaux cliniques rencontrés en<br />
psychanalyse et en psychothérapie<br />
psychanalytique.<br />
DROITS D’INSCRIPTION<br />
POUR L’ANNÉE : 130 €<br />
A l’unité : 15 €<br />
Chèque libellé à l’ordre <strong>de</strong> la SPP,<br />
à retourner à :<br />
LA SOCIÉTÉ<br />
PSYCHANALYTIQUE DE PARIS<br />
Merci <strong>de</strong> joindre à votre règlement<br />
vos coordonnées précises<br />
(nom, prénom, adresse,<br />
téléphone et profession)<br />
•••<br />
UNE CARTE D’ENTRÉE VOUS<br />
SERA ADRESSÉE EN RETOUR<br />
•••<br />
Quelques inscriptions à l’unité<br />
pourront se faire une semaine à<br />
l’avance auprès du secrétariat<br />
<strong>de</strong> la SPP<br />
•••<br />
Pour tous renseignements,<br />
s’adresser à :<br />
SOCIÉTÉ PSYCHANALYTIQUE<br />
DE PARIS,<br />
187 rue Saint-Jacques, 75005 Paris<br />
Tél. : 01 43 29 66 70<br />
Fax : 01 44 07 07 44<br />
E-mail : spp@spp.asso.fr<br />
Site internet : www.spp.asso.fr<br />
Lundi-mercredi : <strong>de</strong> 9h - 13h<br />
Mardi-jeudi : <strong>de</strong> 13h - 17h<br />
culière du travail apparue au cours du<br />
19 ème siècle, dont la mé<strong>de</strong>cine est la<br />
forme archétypale, et qui se caractérise<br />
par la production spécifique et autonome<br />
(supérieure au non professionnel<br />
et distincte <strong>de</strong>s autres segments professionnels)<br />
<strong>de</strong> savoirs, <strong>de</strong> savoir-faire et<br />
<strong>de</strong> dispositifs éthiques. Toujours dans le<br />
Livre Blanc, nous pouvons percevoir<br />
combien la définition <strong>de</strong> ces items est<br />
problématique. On peut repérer <strong>de</strong>ux<br />
types <strong>de</strong> conceptions <strong>de</strong> la psychiatrie<br />
annoncées explicitement par les auteurs<br />
dans le troisième alinéa <strong>de</strong>s conclusions<br />
(p. 74) : la psychiatrie traite <strong>de</strong> la<br />
singularité, <strong>de</strong> la relation intersubjective<br />
; elle relève aussi <strong>de</strong> l’intention d’objectivation<br />
et d’expérimentation. Ce<br />
premier pôle, que nous pourrons qualifier<br />
<strong>de</strong> « science <strong>de</strong> la culture » (13) ou<br />
<strong>de</strong> « métaphysique » au sens popperien<br />
(7) étaye les expressions suivantes :<br />
la psychiatrie ne donne pas un simple<br />
avis expertal (comme le font les autres<br />
spécialités médicales) mais assure un<br />
suivi (p. 66) et une prise en charge globale<br />
(p. 72), elle offre écoute et soutien<br />
(p. 70-71), le psychiatre connaît la question<br />
<strong>de</strong>s valeurs (« gardien <strong>de</strong> la liberté<br />
<strong>de</strong> l’esprit (…) conscience morale »,<br />
p. 71) et les sciences humaines (p. 72),<br />
il est compétent en ce qui concerne<br />
les aspects <strong>de</strong> communication, les relations<br />
interpersonnelles (p. 72), les motivations<br />
individuelles <strong>de</strong>s patients (p.<br />
73), il traite du sens (p. 73). Le <strong>de</strong>uxième<br />
pôle, à l’opposé, relève <strong>de</strong>s<br />
« sciences <strong>de</strong> la nature » (13), et <strong>de</strong> la<br />
démarche expérimentale (7). On le<br />
retrouve dans le passage concernant<br />
la « psychologie <strong>de</strong> la santé » (les guillemets<br />
ici apposés par les auteurs ren<strong>de</strong>nt<br />
la distinction d’avec la psychiatrie<br />
<strong>de</strong>s plus floues) : « mesurer, objectiver,<br />
tester » (p. 68). De même, cette<br />
démarche scientifique caractérise la<br />
production <strong>de</strong> données épidémiologiques<br />
chiffrées (p. 69, 72) et la pratique<br />
« basée sur la preuve » (p. 72).<br />
Cela dit, paradoxalement, les auteurs<br />
citent <strong>de</strong>s sujets sur lesquels les psychiatres<br />
sont sollicités : les tableaux psychosomatiques<br />
(p. 66) et les innovations<br />
techniques, ou encore certaines<br />
situations tragiques (comme le développement<br />
du sida) sources <strong>de</strong> « désarroi<br />
» (p. 69). On peut relier cette sollicitation<br />
à la nature complexe <strong>de</strong> la<br />
psychiatrie : les psychiatres, ne relevant<br />
pas que <strong>de</strong>s sciences <strong>de</strong> la nature, pourraient<br />
avoir un discours sur la singularité<br />
du mala<strong>de</strong> que le modèle biologique<br />
<strong>de</strong> la mé<strong>de</strong>cine, permettant <strong>de</strong>s<br />
progrès techniques incessants, exclut<br />
par son essence épistémologique<br />
même. Les mé<strong>de</strong>cins « somaticiens »<br />
feraient donc appel aux psychiatres<br />
pour les éclairer sur <strong>de</strong>s situations où le<br />
raisonnement expérimental et objectivant<br />
ne donne pas <strong>de</strong> solutions. Ici<br />
donc, au contraire, cette nature complexe<br />
<strong>de</strong> la psychiatrie sert sa légitimité<br />
auprès <strong>de</strong>s autres mé<strong>de</strong>cines.<br />
Se pose tout <strong>de</strong> même une question :<br />
le psychiatre peut-il être le spécialiste<br />
d’une subjectivité malmenée par la<br />
mé<strong>de</strong>cine ? Il y a quelque chose d’inquiétant<br />
dans l’emphase <strong>de</strong>s auteurs<br />
qui font du psychiatre une figure<br />
éthique (« gardien(s) <strong>de</strong> la liberté <strong>de</strong> l’esprit<br />
et, en même temps conscience morale,<br />
dans une société ivre (…) <strong>de</strong> ses réussites<br />
médicales », p. 71).<br />
Conclusion<br />
De façon évi<strong>de</strong>nte, c’est <strong>de</strong> la complexité<br />
du statut <strong>de</strong> profession dont il<br />
est question dans les ambiguïtés <strong>de</strong><br />
relecture et les contresens que les psychiatres<br />
font <strong>de</strong> leur propre histoire.<br />
La marginalité historique à l’égard <strong>de</strong> la<br />
mé<strong>de</strong>cine reste conçue comme un élément<br />
péjoratif, ce dont ren<strong>de</strong>nt compte<br />
les <strong>de</strong>ux conceptions implicites que<br />
nous avons relevé (la psychiatrie s’est<br />
laissée éloigner <strong>de</strong> la mé<strong>de</strong>cine et <strong>de</strong><br />
ses hôpitaux, qui ont toujours été <strong>de</strong>s<br />
lieux <strong>de</strong> soins). Or ces conceptions<br />
occultent <strong>de</strong>ux aspects décisifs dans la<br />
construction <strong>de</strong> la psychiatrie :<br />
N°8 - TOME XIX - NOVEMBRE 2006<br />
Spirale a dix ans<br />
Les dix comman<strong>de</strong>ment <strong>de</strong> la<br />
périnatalité<br />
Coordonné par Patrick Ben<br />
Soussan<br />
Spirale n°39<br />
Erès, 12 €<br />
Ce numéro fête les dix ans <strong>de</strong><br />
Spirale. Cet anniversaire est celui<br />
dune approche pluridisciplinaire<br />
exigeante et dans le même temps<br />
d’un souci constant <strong>de</strong> proximité<br />
à l’égard <strong>de</strong>s professionnels <strong>de</strong> la<br />
petite enfance.<br />
- d’une part, l’éloignement <strong>de</strong>s hôpitaux<br />
au 19 ème siècle a été un facteur<br />
d’humanisation pour les mala<strong>de</strong>s,<br />
- d’autre part, la distance conceptuelle<br />
d’avec la mé<strong>de</strong>cine ultra-objectivante<br />
qu’il a autorisée participe à la définition<br />
et la consolidation d’un statut professionnel<br />
pour les psychiatres.<br />
Il faut aujourd’hui, pour relire <strong>de</strong> façon<br />
plus juste la place qu’occupe la psychiatrie<br />
au sein <strong>de</strong> la mé<strong>de</strong>cine, prendre<br />
en considération la marginalité qui l’a<br />
caractérisée dès son origine. Il faut également<br />
se poser la question <strong>de</strong> son<br />
existence comme profession, à l’instar<br />
<strong>de</strong> la mé<strong>de</strong>cine, c'est-à-dire <strong>de</strong>s définition<br />
et délimitation <strong>de</strong> ce que sont,<br />
spécifiquement, ses savoirs, savoir-faire<br />
et réflexions éthiques.<br />
Il faut enfin se rappeler que ces éléments<br />
se négocient au sein d’un lien<br />
contractuel tacite avec la mé<strong>de</strong>cine et<br />
la société. ■<br />
Yannis Gansel*,<br />
François Danet**<br />
* Psychiatre, chef <strong>de</strong> clinique, service <strong>de</strong> Mé<strong>de</strong>cine<br />
Légale Psychiatrique <strong>de</strong>s Urgences (Professeur<br />
Jean-Marc ELCHARDUS), Hôpital<br />
Edouard Herriot, Lyon. Chercheur associé du<br />
Groupe <strong>de</strong> Recherche en Epistémologie Politique<br />
et Historique (Professeur Jacques MI-<br />
CHEL), Institut d’Etu<strong>de</strong>s Politiques, Lyon.<br />
** Psychiatre, mé<strong>de</strong>cin légiste, praticien hospitalier,<br />
responsable <strong>de</strong> l’unité <strong>de</strong> psychiatrie d’urgence<br />
du service <strong>de</strong> Mé<strong>de</strong>cine Légale Psychiatrique<br />
<strong>de</strong>s Urgences (Professeur Jean-Marc<br />
ELCHARDUS), Hôpital Edouard Herriot, Lyon.<br />
Doctorant en psychologie et sociologie au Laboratoire<br />
<strong>de</strong> Changement Social (Professeure<br />
Dominique LHUILIER), Université Paris 7 –<br />
Denis Di<strong>de</strong>rot.<br />
Bibliographie<br />
(1) Fédération Française <strong>de</strong> <strong>Psychiatrie</strong>,<br />
Livre Blanc <strong>de</strong> la <strong>Psychiatrie</strong>, Paris, John Libbey<br />
Eurotext, 2003.<br />
(2) FOUCAULT M, Maladie mentale et psychologie,<br />
Paris: Presses Universitaires <strong>de</strong><br />
France, 1954.<br />
(3) FOUCAULT M, Naissance <strong>de</strong> la clinique,<br />
1993 ed. Paris, PUF, 1963.<br />
(4) GAUCHET M, La religion dans la démocratie,<br />
Paris, Folio, 1998.<br />
(5) HUGHES E, Le regard sociologique, Paris,<br />
éditions <strong>de</strong> l'EHESS, 1996.<br />
(6) KANTOROWICZ E, Les Deux Corps<br />
du Roi, 1989 ed. Paris, Gallimard, 1957.<br />
(7) POPPER K, La logique <strong>de</strong> la découverte<br />
scientifique, 1976 ed. Paris, Payot, 1958.<br />
(8) POSTEL J, Genèse <strong>de</strong> la psychiatrie, les<br />
premiers écrits <strong>de</strong> Pinel, Paris, Les empêcheurs<br />
<strong>de</strong> penser en rond, 1998.<br />
(9) SOURNIA J, Histoire <strong>de</strong> la mé<strong>de</strong>cine,<br />
Paris, La Découverte, 1997.<br />
(10) STRAUS P, L’hospitalisation <strong>de</strong>s enfants,<br />
une étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> pédiatrie sociale dans l’agglomération<br />
parisienne, Monographie <strong>de</strong> l’Institut<br />
national d’Hygiène 1961, 23.<br />
(11) SWAIN G, Le sujet <strong>de</strong> la folie, 1977 ed.<br />
Paris, Calman-Lévy, 1977.<br />
(12) VIGARELLO G, Histoire <strong>de</strong>s pratiques<br />
<strong>de</strong> santé : le sain et le malsain <strong>de</strong>puis le<br />
Moyen Age, Paris, Seuil, 1999.<br />
(13) WEBER M, Essai sur la théorie <strong>de</strong> la<br />
science, Paris, Plon, 1951.<br />
(14) WINNICOTT D, Le rôle <strong>de</strong> la monarchie,<br />
in WINNICOTT D, editor. conversations<br />
ordinaires, Paris, Gallimard, 1988, p.<br />
295-304.<br />
(15) WINTER J, Rhétorique psychanalytique<br />
et rhétorique talmudique, in TRIGANO S,<br />
editor, Psychanalyse et judaisme, Paris, In<br />
Press éditions, 1999, p. 87-98.