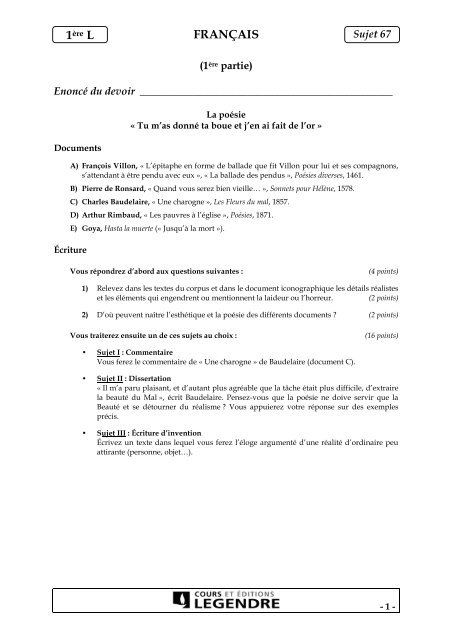Leg0009_1ère L_sujet_067 - Cours Legendre
Leg0009_1ère L_sujet_067 - Cours Legendre
Leg0009_1ère L_sujet_067 - Cours Legendre
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
1 ère L<br />
FRANÇAIS<br />
(1 ère partie)<br />
Sujet 67<br />
Enoncé du devoir _______________________________________________<br />
Documents<br />
La poésie<br />
« Tu m’as donné ta boue et j’en ai fait de l’or »<br />
A) François Villon, « L’épitaphe en forme de ballade que fit Villon pour lui et ses compagnons,<br />
s’attendant à être pendu avec eux », « La ballade des pendus », Poésies diverses, 1461.<br />
B) Pierre de Ronsard, « Quand vous serez bien vieille… », Sonnets pour Hélène, 1578.<br />
C) Charles Baudelaire, « Une charogne », Les Fleurs du mal, 1857.<br />
D) Arthur Rimbaud, « Les pauvres à l’église », Poésies, 1871.<br />
E) Goya, Hasta la muerte (« Jusqu’à la mort »).<br />
Écriture<br />
Vous répondrez d’abord aux questions suivantes : (4 points)<br />
1) Relevez dans les textes du corpus et dans le document iconographique les détails réalistes<br />
et les éléments qui engendrent ou mentionnent la laideur ou l’horreur. (2 points)<br />
2) D’où peuvent naître l’esthétique et la poésie des différents documents ? (2 points)<br />
Vous traiterez ensuite un de ces <strong>sujet</strong>s au choix : (16 points)<br />
• Sujet I : Commentaire<br />
Vous ferez le commentaire de « Une charogne » de Baudelaire (document C).<br />
• Sujet II : Dissertation<br />
« Il m’a paru plaisant, et d’autant plus agréable que la tâche était plus difficile, d’extraire<br />
la beauté du Mal », écrit Baudelaire. Pensez-vous que la poésie ne doive servir que la<br />
Beauté et se détourner du réalisme ? Vous appuierez votre réponse sur des exemples<br />
précis.<br />
• Sujet III : Écriture d’invention<br />
Écrivez un texte dans lequel vous ferez l’éloge argumenté d’une réalité d’ordinaire peu<br />
attirante (personne, objet…).<br />
- 1 -
1 ère L<br />
Document A<br />
1<br />
5<br />
10<br />
15<br />
20<br />
25<br />
30<br />
FRANÇAIS<br />
La ballade des pendus<br />
Sujet 67<br />
Le poète Villon est en prison. Dans cette « Épitaphe en forme de ballade que fit Villon pour lui et ses<br />
compagnons, s’attendant à être pendu avec eux », le poète fait parler les pendus qui demandent qu’on prie<br />
pour eux.<br />
Frères humains qui après nous vivez,<br />
N’ayez 1 les cœurs contre nous endurcis,<br />
Car, si pitié de nous pauvres avez,<br />
Dieu en aura plus tôt de vous mercis 2 .<br />
Vous nous voyez ci 3 attachés cinq, six ;<br />
Quant de 4 la chair, que trop avons nourrie,<br />
Elle est piéça 5 dévorée et pourrie,<br />
Et nous, les os, devenons cendre et poudre.<br />
De notre mal personne ne s’en rie 6 ;<br />
Mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre !<br />
Si frères vous clamons 7 , pas n’en devez<br />
Avoir dédain, quoique fûmes occis<br />
Par justice. Toutefois, vous savez<br />
Que tous hommes n’ont pas bon sens rassis 8 ;<br />
Excusez-nous, puisque sommes transsis 9 ,<br />
Envers le fils de la Vierge Marie,<br />
Que sa grâce ne soit pour nous tarie,<br />
Nous préservant de l’infernale 10 foudre.<br />
Nous sommes morts, âme ne nous harie 11 ;<br />
Mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre !<br />
La pluie nous a débués 12 et lavés,<br />
Et le soleil desséchés et noircis ;<br />
Pies, corbeaux, nous ont les yeux cavés 13 ,<br />
Et arraché la barbe et les sourcils.<br />
Jamais nul temps nous ne sommes assis ;<br />
Puis ça, puis là, comme le vent varie,<br />
À son plaisir sans cesser nous charrie,<br />
Plus becquetés d’ 14 oiseaux que dés à coudre,<br />
Ne soyez donc de notre confrérie ;<br />
Mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre !<br />
Prince Jésus, qui sur tous a maîtrie 15 ,<br />
Garde qu’Enfer n’ait de nous seigneurie 16 ;<br />
À lui n’avons que faire ni que soudre 17 .<br />
Hommes, ici n’a point de moquerie ;<br />
Mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre.<br />
1. N’ayez : n’ayez pas.<br />
2. « Si vous avez pitié de nous, Dieu aura pitié de vous ».<br />
3. Ci : ici.<br />
4. Quant de : en ce qui concerne.<br />
5. Piéça : déjà.<br />
6. Personne ne s’en rie : que personne ne se moque.<br />
7. Clamons : appelons.<br />
8. N’ont pas bon sens rassis : ne sont pas raisonnables.<br />
9. Transsis : trépassés, morts.<br />
Document B<br />
François Villon, Poésies diverses (orthographe modernisée),<br />
Poètes et romanciers du Moyen Âge, Gallimard,<br />
coll. « Bibliothèque de La Pléiade », 1984.<br />
10. Infernale : de l’Enfer.<br />
11. Âme ne nous harie : que personne ne nous tourmente.<br />
12. Débués : lessivés, trempés.<br />
13. Cavés : crevés.<br />
14. Becquetés d’ : par les oiseaux (nous recevons tant de coups de bec<br />
que nous sommes plus pleins de trous que des dés à coudre).<br />
15. Maîtrie : pouvoir.<br />
16. N’ait de nous seigneurie : ne devienne notre maître.<br />
17. Soudre : payer.<br />
- 2 -
1<br />
5<br />
10<br />
1 ère L<br />
Document C<br />
1<br />
5<br />
10<br />
15<br />
20<br />
FRANÇAIS<br />
Quand vous serez bien vieille…<br />
Quand vous serez bien vieille, au soir, à la chandelle,<br />
Assise auprès du feu, dévidant 1 et filant,<br />
Direz, chantant mes vers, en vous émerveillant :<br />
« Ronsard me célébrait du temps que j’étais belle ! »<br />
Lors, vous n’aurez servante oyant 2 telle nouvelle,<br />
Déjà sous le labeur à demi sommeillant,<br />
Qui au bruit de Ronsard ne s’aille réveillant,<br />
Bénissant votre nom de 3 louange immortelle.<br />
Je serai sous la terre, et, fantôme sans os,<br />
Par les ombres myrteux 4 je prendrai mon repos :<br />
Vous serez au foyer une vieille accroupie,<br />
Regrettant mon amour et votre fier 5 dédain.<br />
Vivez, si m’en croyez, n’attendez à demain :<br />
Cueillez dès aujourd’hui les roses de la vie.<br />
1. Dévidant : mettant le fil en écheveau, à l’aide du dévidoir.<br />
2. Oyant : entendant.<br />
3. Dont la louange est immortelle.<br />
4. Par les ombres myrteux : à l’ombre (masculin) des myrtes.<br />
5. Fier : farouche.<br />
Une charogne<br />
Rappelez-vous l’objet que nous vîmes, mon âme,<br />
Ce beau matin d’été si doux :<br />
Au détour d’un sentier une charogne infâme<br />
Sur un lit semé de cailloux,<br />
Les jambes en l’air, comme une femme lubrique,<br />
Brûlante et suant, les poisons,<br />
Ouvrait d’une façon nonchalante et cynique<br />
Son ventre plein d’exhalaisons 1 .<br />
Le soleil rayonnait sur cette pourriture,<br />
Comme afin de la cuire à point,<br />
Et de rendre au centuple à la grande Nature<br />
Tout ce qu’ensemble elle avait joint ;<br />
Et le ciel regardait la carcasse superbe<br />
Comme une fleur s’épanouir.<br />
La puanteur était si forte, que sur l’herbe<br />
Vous crûtes vous évanouir.<br />
Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride 2<br />
D’où sortaient de noirs bataillons<br />
De larves, qui coulaient comme un épais liquide<br />
Le long de ces vivants haillons.<br />
Sujet 67<br />
Ronsard, Sonnets pour Hélène, II, XLIII, 1578.<br />
- 3 -
25<br />
30<br />
35<br />
40<br />
45<br />
1 ère L<br />
FRANÇAIS<br />
Tout cela descendait, montait comme une vague,<br />
Ou s’élançait en pétillant ;<br />
On eût dit que le corps, enflé d’un souffle vague,<br />
Vivait en se multipliant.<br />
Et ce monde rendait une étrange musique,<br />
Comme l’eau courante et le vent,<br />
Ou le grain qu’un vanneur 3 d’un mouvement rythmique<br />
Agite et tourne dans son van.<br />
Les formes s’effaçaient et n’étaient plus qu’un rêve,<br />
Une ébauche lente à venir,<br />
Sur la toile oubliée, et que l’artiste achève<br />
Seulement par le souvenir.<br />
Derrière les rochers une chienne inquiète<br />
Nous regardait d’un œil fâché,<br />
Épiant le moment de reprendre au squelette<br />
Le morceau qu’elle avait lâché.<br />
— Et pourtant vous serez semblable à cette ordure,<br />
À cette horrible infection,<br />
Étoile de mes yeux, soleil de ma nature,<br />
Vous, mon ange et ma passion !<br />
Oui ! Telle vous serez, ô la reine des grâces,<br />
Après les derniers sacrements,<br />
Quand vous irez, sous l’herbe et les floraisons grasses,<br />
Moisir parmi les ossements.<br />
Alors, ô ma beauté ! dites à la vermine 4<br />
Qui vous mangera de baisers,<br />
Que j’ai gardé la forme et l’essence divine<br />
De mes amours décomposés !<br />
Sujet 67<br />
Charles Baudelaire, Les Fleurs du mal, XXIX, 1857.<br />
1. Exhalaisons : odeurs, vapeurs.<br />
2. Putride : pourri.<br />
3. Vanneur : ouvrier qui vanne le grain, c’est-à-dire qui le sépare la paille de l’épi.<br />
4. Vermine : insectes parasites.<br />
- 4 -
1 ère L<br />
Document D<br />
1<br />
5<br />
10<br />
15<br />
20<br />
25<br />
30<br />
35<br />
FRANÇAIS<br />
Les pauvres à l’église<br />
Parqués entre des bancs de chêne, aux coins d’église<br />
Qu’attiédit puamment leur souffle, tous leurs yeux<br />
Vers le chœur ruisselant d’orrie 1 et la maîtrise 2<br />
Aux vingt gueules gueulant les cantiques pieux ;<br />
Comme un parfum de pain humant l’odeur de cire,<br />
Heureux, humiliés comme des chiens battus,<br />
Les Pauvres au bon Dieu, le patron et le sire,<br />
Tendent leurs orémus 3 risibles et têtus.<br />
Aux femmes, c’est bien bon de faire des bancs lisses,<br />
Après les six jours noirs où Dieu les fait souffrir !<br />
Elles bercent, tordus dans d’étranges pelisses,<br />
Des espèces d’enfants qui pleurent à mourir.<br />
Leurs seins crasseux dehors, ces mangeuses de soupe,<br />
Une prière aux yeux et ne priant jamais,<br />
Regardent parader mauvaisement un groupe<br />
De gamines avec leurs chapeaux déformés.<br />
Dehors, le froid, la faim, l’homme en ribote :<br />
C’est bon. Encore une heure ; après, les maux sans noms !<br />
— Cependant, alentour, geint, nasille, chuchote<br />
Une collection de vieilles à fanons 4 :<br />
Ces effarés y sont et ces épileptiques<br />
Dont on se détournait hier aux carrefours ;<br />
Et, fringalant 5 du nez dans des missels antiques,<br />
Ces aveugles qu’un chien introduit dans les cours.<br />
Et tous, bavant la foi mendiante et stupide,<br />
Récitent la complainte infinie à Jésus<br />
Qui rêve en haut, jauni par le vitrail livide,<br />
Loin des maigres mauvais et des méchants pansus,<br />
Loin des senteurs de viande et d’étoffes moisies,<br />
Farce prostrée et sombre aux gestes repoussants ;<br />
— Et l’oraison fleurit d’expressions choisies,<br />
Et les mysticités prennent des tons pressants,<br />
Quand, des nefs où périt le soleil, plis de soie<br />
Banals, sourires verts, les Dames des quartiers<br />
Distingués, – Ô Jésus ! – les malades du foie<br />
Font baiser leurs longs doigts jaunes aux bénitiers.<br />
1. Orrie : ornements en or.<br />
2. Maîtrise : chœur, chanteurs.<br />
3. Orémus : prières.<br />
4. Fanons : replis de peau.<br />
5. Fringalant ; néologisme sur fringale et fringant ?<br />
Sujet 67<br />
Arthur Rimbaud, Poésies, 1871.<br />
- 5 -
1 ère L<br />
Document E<br />
FRANÇAIS<br />
Hasta la muerte (« Jusqu’à la mort »)<br />
Sujet 67<br />
Elle a raison de se faire belle.<br />
Elle a aujourd’hui 75 ans et ses petites amies<br />
vont venir lui rendre visite.<br />
Goya (1746-1828), Los Caprichos, (« Les caprices »),<br />
planche 55, 1799 (collection privée).<br />
- 6 -
1 ère L<br />
FRANÇAIS<br />
(2 ème partie)<br />
Sujet 67<br />
Aide méthodologique ___________________________________________<br />
A Questions<br />
1) Commencez par introduire la question en la recopiant : Comparez les textes et le document<br />
iconographique en montrant les détails réalistes. Précisez ce qu’est le réalisme.<br />
— Définir la laideur et l’horreur. N’hésitez pas à donner des exemples.<br />
2) Définir l’esthétique : « Science du beau dans la nature et dans l’art ; conception particulière du<br />
beau. », Le Petit Robert.<br />
— Parler de l’esthétique dans la métrique et la stylistique ; puis souligner le vocabulaire du<br />
Beau.<br />
Votre réponse doit faire environ 1 page.<br />
B Commentaire<br />
— Un commentaire est composé d’une introduction, d’un développement et d’une conclusion.<br />
Il ne faut pas utiliser le pronom personnel « je », mais le « nous » pour parler de votre<br />
analyse.<br />
— Introduction (10 à 15 lignes) : Elle se fait en trois parties :<br />
1) Présentation du texte, de l’auteur et du contexte.<br />
2) Formulation de la problématique : ici, l’angoisse.<br />
3) Annonce du plan : « Dans un premier temps, nous verrons que… Puis dans une seconde<br />
partie, nous analyserons… ».<br />
— Développement (30 lignes par partie) : Votre commentaire peut comporter 2 ou 3 parties, qui<br />
doivent être intégralement rédigées.<br />
Commencez par introduire votre idée, puis citez le texte afin d’argumenter votre analyse.<br />
Pour un poème, on parle de vers et non de lignes.<br />
Faites des citations comprenant un mot ou un vers. Ne pas recopier toute une strophe.<br />
En fin de chaque partie, vous devez conclure cette dernière en une phrase, puis introduire la<br />
partie suivante en une phrase.<br />
— Conclusion (5 à 10 lignes) : La conclusion est essentielle. Elle vous permet de revenir sur les<br />
éléments clefs de l’extrait et donc de votre analyse. Vous pouvez ensuite ouvrir sur un autre<br />
point. (Ici, par exemple le Spleen de Baudelaire)<br />
C Dissertation<br />
Une dissertation comporte toujours une introduction, un développement et une conclusion. Il ne<br />
faut pas utiliser le pronom personnel « je », mais « nous ».<br />
— Introduction (10 lignes) : Elle se fait en trois parties :<br />
1) Présentation du <strong>sujet</strong>.<br />
2) Formulation de la problématique : ici, la Beauté, la poésie et le réalisme.<br />
3) Annonce du plan : « Dans un premier temps, nous verrons que… Puis dans une seconde<br />
partie, nous analyserons… ».<br />
- 7 -
1 ère L<br />
FRANÇAIS<br />
Sujet 67<br />
— Développement (30 lignes par partie) : Votre dissertation peut comporter 2 ou 3 parties, qui<br />
doivent être intégralement rédigées.<br />
Commencez par introduire votre idée, puis donnez un exemple qui argumentera votre pensée.<br />
Vous pouvez reprendre les textes du corpus ; mais ne pas écrire « doc.A » ! Il faut recopier les<br />
titres des œuvres, des poèmes et bien donner le nom de l’auteur.<br />
Il faut donner environ 4 exemples par partie.<br />
En fin de chaque partie, vous devez conclure cette dernière en une phrase, puis introduire la<br />
partie suivante en une phrase.<br />
— Conclusion (5 à 10 lignes) : La conclusion est essentielle. Elle vous permet de revenir sur les<br />
éléments clefs de votre dissertation. Vous pouvez ensuite ouvrir sur un autre point. (Ici, par<br />
exemple en montrant la possibilité de combiner la Beauté et le réalisme).<br />
D Ecriture d’invention<br />
— Attention à l’intitulé : il faut rédiger un éloge.<br />
— Introduire le <strong>sujet</strong>.<br />
— Pensez à argumenter votre éloge : vous devez dire pourquoi vous avez choisi cet élément ou ce<br />
personnage d’ordinaire peut attirant.<br />
— Donnez des exemples<br />
— Conclure votre éloge.<br />
- 8 -
1 ère L<br />
FRANÇAIS<br />
(3 ème partie)<br />
Sujet 67<br />
Corrigé du Professeur____________________________________________<br />
A Questions<br />
1) Relevez dans les textes du corpus et dans le document iconographique les détails<br />
réalistes et les éléments qui engendrent ou mentionnent la laideur ou l’horreur.<br />
Dans un premier temps, nous pouvons relever dans « La ballade des pendus » de<br />
Villon les détails réalistes à travers le champ lexical de la déchéance physique :<br />
« attachés cinq, six […] dévorée et pourrie ».<br />
Dans le poème de Ronsard, c’est la description de la femme seule dans le futur faite<br />
par l’auteur.<br />
Baudelaire, dans « Une charogne », crée un effet de réalisme en plaçant dès le<br />
premier vers son lecteur comme spectateur de la description qui va suivre :<br />
« Rappelez-vous l’objet… ».<br />
La description est également un moyen employé par Rimbaud afin d’introduire des<br />
détails réalistes dans son poème, avec une présentation du topoï et celle des<br />
personnages.<br />
Enfin, dans « Hasta la muerte » de Goya, les détails réalistes se retrouvent dans<br />
l’apparence des personnages, leurs vêtements.<br />
L’horreur présente chez Villon est soulignée par la description de sa détention. En<br />
effet, de la prison, Villon demande la grâce, renforcée par l’anaphore en fin de chaque<br />
strophe : « Mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre ». La laideur dans le poème de<br />
Ronsard est d’une autre nature, puisqu’elle est contenue dans la projection dans le<br />
futur ; en effet, la solitude peinte par le poète instaure un sentiment d’oppression<br />
pour la femme destinataire du poème.<br />
Baudelaire, quant à lui, laisse entrevoir l’horreur dès le titre donné à son poème :<br />
« Une charogne ». Rappelons que la charogne désigne ici un cadavre humain<br />
abandonné. Ce sentiment de dégoût ressenti par le lecteur se poursuit avec<br />
l’utilisation du champ lexical de la laideur et de la mort : « infâme, lubrique, brûlante,<br />
poisons, carcasse, putride, oubliée, squelette ». Notons que le lecteur peut éprouver<br />
ces mêmes émotions à la lecture des « Pauvres à l’église » de Rimbaud, lorsque<br />
l’auteur joue du sens visuel – et de la capacité d’imagination du lecteur – en peignant<br />
des éléments « tordus […] déformés ».<br />
2) D’où peuvent naître l’esthétique et la poésie des différents documents ?<br />
L’esthétique et la poésie peuvent naître à travers la métrique (avec les rimes<br />
embrassées de Villon et Ronsard, les rimes croisées de Baudelaire). Mais nous<br />
pourrions supposer que la poésie est créée par sa capacité à dénoncer les atrocités du<br />
monde, et à se mettre ainsi au service des droits de l’homme.<br />
- 9 -
1 ère L<br />
B Sujet I : Commentaire<br />
FRANÇAIS<br />
Vous ferez le commentaire de « Une charogne » de Baudelaire (document C)<br />
Introduction<br />
Sujet 67<br />
Poète symboliste du XIX e siècle, Baudelaire exprime dans son recueil Les Fleurs du Mal<br />
son mal de vivre qu’il appelle : Spleen. Dans le présent poème, « Une charogne », rédigé<br />
en 1857, Baudelaire traduit une fois de plus son angoisse face à la vie en mettant en<br />
scène un corps en décomposition. Dans un premier temps, nous étudierons le champ<br />
lexical de la mort et la décomposition, afin d’analyser dans une deuxième partie la<br />
révélation d’une angoisse du poète.<br />
I) La mort<br />
A) La mort<br />
Nous relevons l’omniprésence de la mort à travers les substantifs : « âme,<br />
charogne, lit, poisons, carcasse, souvenir, squelette, ordure, ange, derniers<br />
sacrements, ossements, vermine, divine ».<br />
La mort est synonyme de fin, le corps chez Baudelaire s’adresse à « la reine des<br />
grâces », à « l’essence divine ». Cependant, si la mort peut apparaître, en fin de<br />
poème, comme une délivrance où la laideur semble céder la place à plus de<br />
douceur : « beauté, baisers, essence divine, amours » ; le poète prend soin<br />
d’achever son œuvre par l’adjectif « décomposés », laissant ainsi entendre qu’il<br />
n’y a pour lui aucun espoir.<br />
B) La décomposition<br />
Cette mort est l’occasion pour l’auteur de mettre en exergue la tristesse du poète.<br />
Une tristesse qui s’exprime avec toutefois une certaine ambiguïté à la quatrième<br />
strophe, puisque la carcasse est « superbe » et est comparée à une « fleur » qui<br />
peut « s’épanouir ».<br />
Nous observons donc qu’à travers la mort et la décomposition, Baudelaire traduit<br />
l’angoisse de la vie.<br />
II) L’angoisse<br />
A) La décomposition est la disparition<br />
Comme nous l’avons souligné précédemment, le corps décrit par le poète est un<br />
corps en décomposition, une « carcasse », que l’on voit « moisir parmi les<br />
ossements ». L’impression donnée au lecteur est celle d’une disparition totale de<br />
l’être.<br />
B) Le poète et l’incapacité à vivre<br />
Cependant cette disparition ne peut-elle trahir que l’incapacité à vivre ?<br />
Nous pouvons relever la musicalité du texte avec les rimes croisées et les rimes<br />
« vague… vague // musique… rythmique ». Nous avons alors le sentiment<br />
d’une résurrection où « l’horrible infection » semble pouvoir se taire face à<br />
« l’étoile » ou au « soleil ». Nous comprenons donc que l’angoisse du poète se<br />
situe dans cette volonté de saisir les « beautés » là où « les formes s’effaçaient ».<br />
Nous noterons en dernière analyse que dans ce poème, comme l’annonce le titre,<br />
- 10 -
1 ère L<br />
Conclusion<br />
FRANÇAIS<br />
Sujet 67<br />
c’est la disparition qui se fait plus forte que la vie : « vous irez […] moisir parmi<br />
les ossements ».<br />
Dans le poème intitulé « Une charogne », extrait du recueil Les Fleurs du mal, Charles<br />
Baudelaire témoigne de son mal de vivre, et de son rêve d’évasion en plongeant le<br />
lecteur dans un monde morbide. Comme nous avons pu l’analyser, la lumière s’éteint<br />
face à l’angoisse. La femme, tant aimée par Baudelaire devient objet de luxure et<br />
contribue à la déchéance. Toutes ces peurs exprimées par Baudelaire se retrouvent dans<br />
un autre de ses poèmes : « Spleen ».<br />
C Sujet II : Dissertation<br />
« Il m’a paru plaisant, et d’autant plus agréable que la tâche était plus difficile, d’extraire<br />
la beauté du Mal », écrit Baudelaire. Pensez-vous que la poésie ne doive servir que la<br />
Beauté et se détourner du réalisme ? Vous appuierez votre réponse sur des exemples<br />
précis.<br />
Introduction :<br />
La Beauté est définissable comme étant le caractère de ce qui est beau : une personne, un<br />
objet d’art ou de la vie de tous les jours. En parlant de son œuvre, Baudelaire écrit : « Il<br />
m’a paru plaisant, et d’autant plus agréable que la tâche était plus difficile, d’extraire la beauté du<br />
Mal ». Il apparaît donc comme une quasi gageure pour le poète de penser la beauté<br />
même dans le Mal. En effet, ces deux termes nous apparaissent presque incompatibles.<br />
Dès lors, nous pouvons nous demander si l’auteur ne trahit pas la réalité, ne la travestit<br />
pas afin de faire l’éloge de la Beauté. Mais « la poésie ne doit-elle servir que la Beauté et<br />
se détourner du réalisme ? ». Dans une première partie, nous nous intéresserons au<br />
genre poétique lorsqu’il est au seul service de la Beauté. Puis dans un second temps,<br />
nous poserons la question de la poésie réaliste afin de montrer la force esthétique du<br />
genre.<br />
I La poésie au seul service de la Beauté<br />
A) Qu’est-ce que la poésie et qu’est-ce que la Beauté ?<br />
Commencer par définir la poésie : genre, forme (donnez plusieurs exemples : le<br />
sonnet, l’alexandrin, le vers libre).<br />
Définir la Beauté. Bien penser que la Beauté est à la fois celle des règles de<br />
métrique, et celle du caractère de ce qui est beau. Penser au Sonnet, et à la beauté<br />
traduite par Baudelaire dans la Chevelure.<br />
Puis dire que cette beauté peut être subjective.<br />
B) Beauté et « Beauté du Mal » en poésie<br />
Il y a une beauté par exemple dans Le dormeur du val de Rimbaud, avec<br />
l’évocation de la Nature « C’est un trou de verdure », la quiétude du soldat « Il<br />
dort […] tranquille ». Mais cette Beauté est mise au service de la dénonciation de<br />
la guerre : le soldat est mort.<br />
La Beauté se retrouve comme mêlée au Mal.<br />
- 11 -
1 ère L<br />
II Poésie et réalisme<br />
FRANÇAIS<br />
Sujet 67<br />
A) Y a-t-il une poésie réaliste ?<br />
Définir le réalisme, puis poser la question de l’existence d’une poésie réaliste.<br />
Donner l’exemple de Villon, « La ballade des pendus ». Approfondir cette analyse,<br />
qui est l’argument en faveur de la poésie réaliste, et de la Beauté (beauté de la prière)<br />
dans une poésie réaliste.<br />
B) La force esthétique et l’exception poétique : Beauté et réalisme<br />
Reprendre les éléments développés dans les réponses aux questions afin de montrer<br />
l’existence de la laideur en poésie.<br />
Puis, développer la question de l’esthétique en poésie et donner des exemples de vers<br />
libres. En définir une possible combinaison : Beauté-Poésie-Réalisme.<br />
Conclusion :<br />
Selon Baudelaire, il existe donc une « Beauté du Mal ». Mais est-ce à dire que la<br />
poésie est un genre nécessairement au service d’une écriture « difficile » où les<br />
contingences du genre reviennent à nier tout réalisme ? La poésie n’est-elle qu’une<br />
écriture de la fiction ? Certes, comme nous l’avons vu les règles de métrique peuvent<br />
imposer des contraintes à l’auteur et lui faire négliger les éléments réalistes.<br />
Toutefois, l’absence de règles dans le vers libre donne à penser la poésie non plus<br />
comme soumise aux obligations stylistiques ; mais comme pouvant être au service du<br />
témoignage réel.<br />
D Sujet III : Ecriture d’invention<br />
Ecrivez un texte dans lequel vous ferez l’éloge argumenté d’une réalité d’ordinaire peu<br />
attirante (personne, objet…)<br />
Conformément à l’intitulé du <strong>sujet</strong> d’écriture, nous allons réaliser l’éloge de l’araignée.<br />
— Introduire le <strong>sujet</strong> en écrivant pourquoi vous réalisez un éloge<br />
— Dire quel sera votre objet d’étude : par exemple une araignée<br />
— Rédiger un paragraphe dans lequel vous décrivez vos peurs face à l’araignée<br />
— Puis trouvez un élément de transition – par exemple, la Nature – pour débuter votre<br />
éloge<br />
— Faire une description positive de l’araignée : couleur, ses pattes, son corps, ses<br />
mouvements<br />
— Conclure en vous adressant à l’araignée (La vouvoyer) et en vantant sa beauté.<br />
- 12 -