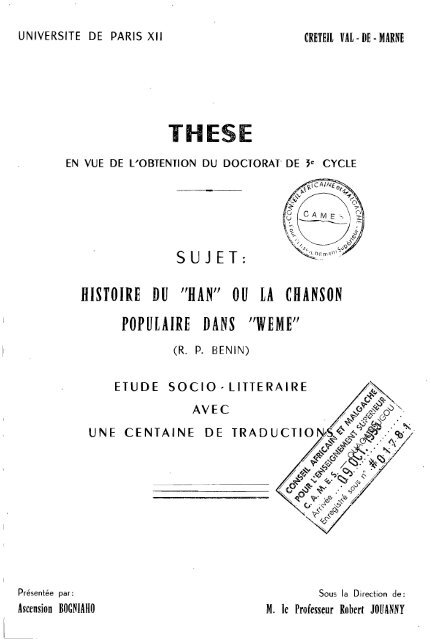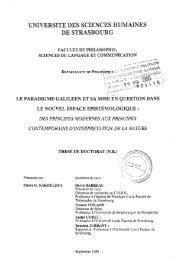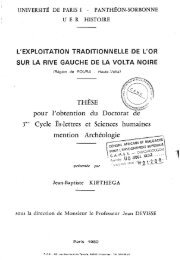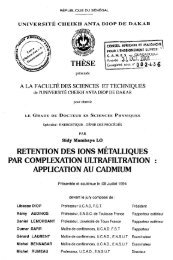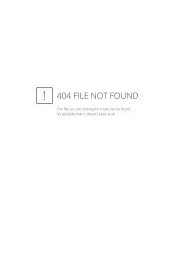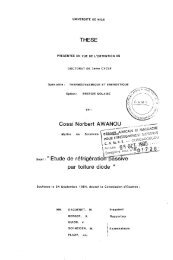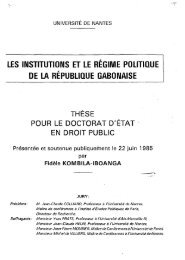HISTOIRE DU "HAN" OU LA CHANSON POPULAIREDANS "WEME"
HISTOIRE DU "HAN" OU LA CHANSON POPULAIREDANS "WEME"
HISTOIRE DU "HAN" OU LA CHANSON POPULAIREDANS "WEME"
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
UNIVERSITE DE PARIS XII<br />
Présentée par:<br />
Ascension BOGNIAHO<br />
THESE<br />
CRETEIL VAL - DE . MARNE<br />
EN VUE DE L'OBTENTION <strong>DU</strong> DOCTORAT' DE }e CYCLE<br />
SUJET:<br />
<strong>HISTOIRE</strong> <strong>DU</strong> "HAN" <strong>OU</strong> <strong>LA</strong> <strong>CHANSON</strong><br />
POP U<strong>LA</strong>IRED ANS "WEME"<br />
CR. P. BENIN)<br />
Sous la Direction de:<br />
M. le Professeur Robert J<strong>OU</strong>ANNY
évélé.<br />
- 5 -<br />
- Certaines paroles nous ont apparu tronquées comme la suite l'a<br />
b) Deuxième étape ou la vraie collecte<br />
Après ce premier contact indispensable, la deuxième phase n'a po<br />
sé aucun problème particulier. Nous nous sommes fait indiquer des personnes<br />
susceptibles de pouvoir nous exécuter les chansons portées sur notre réper<br />
toire, et nous les avons rencontrées. Elles ont chanté seules, pas accompa<br />
gnées d'instruments ni de tams-tams. Elles ont même accepté de répondre à<br />
des questions de compréhension à propos de certaines chansons. Nous nous<br />
sommes fait chanter les mêmes chansons par plusieurs personnes dans des<br />
villages différents afin d'en déceler les variantes. Elles sont presqu'<br />
inexistantes. On peut remarquer tout simplement que l'expression"les en<br />
fants de X" souvent rencontrée dans les chansons varie selon la famille,<br />
le clan.<br />
Il reste à r.ésoudre le problème complexe des chants sacrés féti<br />
chistes. Qui nous les chantera? Personne; tout le monde se dérobait.<br />
Alors, on nous conseilla d'aller trouver les informateurs, de nuit,<br />
et de les enregistrer. Cela fut fait. Et c'est ainsi que nous avons pu<br />
réunir une douzaine de cassettes chargées de chansons de toutes provenan<br />
ces.<br />
2. Le traitement du matériau, le codage<br />
Le tri s'est fait rapidement, du moins tout le temps qu'il nous<br />
a fallu pour transcrire à l'aide de l'alphabet fon des missionnaires<br />
tout le répertoire ainsi réuni. Cet ensemble peut se diviser en trois<br />
parties : les chansons profanes, les chansons sacrées fétichistes, les<br />
chansons funèbres. Un examen attentif révèle que, si les deux dernières
- 6 -<br />
parties semblent être nettement définies, la première apparaît comme un<br />
"fourre-tout" qu'il convient d'organiser. Cette organisation nous donne<br />
trois sous-parties : les chansons récréatives, les chansons ludiques,<br />
les chansons de fêtes. C'est donc, à partir de ces distinctions que<br />
J<br />
nous avons classé les chansons de notre repertoire en deux grandes ca-<br />
tégories : les chansons récréatives et les chansons occasionnelles.<br />
Nous avons évité de les classifier par thèmes; ces derniers étant nom-<br />
breux et parfois les chansons s'y rapportant en nombre infime.<br />
Une fois terminés ce tri et ce classement,nous avons entre-<br />
pris de soustraire du répertoire les pièces qui ne renferment aucun<br />
lien logique, ni apparent ni profond; pour vous donner un exemple,<br />
nous en avions gardé une: l'orphelin se plaint de son sort; il chan-<br />
te et regrette ses parents défunts; car à la mort de nos parents,nous<br />
sommes prompts à prendre nos oncles et tantes pour les remplacer,<br />
mais ceux-là nous désoivent :<br />
La perle déserre l'éléphant<br />
Quelle ceinture de perles qui déserre l'éléphant peut<br />
remplacer la mère ?<br />
et cela se poursuit. Cette chanson est en contradiction avec les au-<br />
tres chansons funèbres. Ici, deux images, deux métaphores la perle<br />
est le substitut de tante, l'éléphant est mis pour le géniteur<br />
défunt. La perle n'a que des qualités et la tante non solidaire<br />
est une figure négative. Et lorsque nous examinons toute la phrase,<br />
elle n'a aucun sens. Ces sortes de chansons, nous les avons laissées<br />
de côté; il n'yen a pas eue beaucoup.
- 8 -<br />
lire ceux de Wémè qui ont été quelque peu à l'école. La seu-<br />
le et unique raison qui nous ait imposé un tel compromis est<br />
que notre travail n'est pas celui d'un linguiste et qu'il vise a sau-<br />
vegarder les chansons en collant de très pres a leur vocation populaireJnous<br />
n'ignorons pas que ce travail sera jugé par un milieu averti sou-<br />
cieux de l'aspect scientifique de l'étude; mais peut-on nous repro-<br />
cher d'avoir rendu au peuple ce qui lui appartient? Ainsi donc, le<br />
Wémènu alphabétisé peut lire ces chansons aussi bien que l'intellec-<br />
tuel pour peu que l'un ou l'autre fasse attention aux règles élémen-<br />
taires et simples dont nous nous sommes servi.<br />
En effet, tous les sons du Wémègbé peuvent se rendre à<br />
l'aide d'un alphabet composé de huit voyelles simples, de cinq voyel-<br />
les nasales, de vingt-trois consonnes.<br />
Les voyelles simples<br />
Ce son t : l, "' e,e, , a, 0, " 0, 0, U,. En f"t al, l es accent s que<br />
nous avons mis sur certaines de ces voyelles représentent des tons<br />
simples indiquant qu'elles sont plus ou moins fermées ou ouvertes.<br />
Tout cela bien entendu vaut ce qu'il vaut, nous ne sommes pas un<br />
linguiste.<br />
i, se prononce i comme en français "ami, pire"<br />
e = E comme dans père, mere, fête, tête<br />
e = e comme dans "épée, purée"<br />
o 0 français, en combinaison avec une consomme"pont" ou<br />
léton 1 =le sien
- 11 -<br />
et d'exclamation seront signalés par les signes correspondants en fran<br />
çais et placés entre parenthèses (?), (!). Les mots de référence au<br />
texte en langue wémègbé seront encadrés par deux barres obliques<br />
exemple /Ajinaku/ = l'éléphant. Ces mots placés entre tlarres ne subis<br />
sent pas la règle de l'accord selon le nombre: les /vodun/.<br />
Ce travail de transcription s'est inspiré de l'ouvrage de Delafosse<br />
M., Manuel dahoméen, Paris:' E. Leroux 1894, de l'alphabet Fon en usa<br />
ge actuellement au Bénin.
- 12 -<br />
Tableau synoptique de l'alphabet, des signes de la thèse et leurs cor-<br />
respondants en français.<br />
a, an<br />
Alphabet<br />
é,è, en<br />
signes<br />
0, 0, on<br />
i, in<br />
u, un<br />
b<br />
c<br />
d, d<br />
f<br />
g, gb<br />
h<br />
j<br />
k, kp<br />
l<br />
m<br />
n, ny<br />
r ( = 1)<br />
s<br />
t<br />
Ü<br />
v<br />
w<br />
x<br />
y<br />
z<br />
/<br />
&<br />
/<br />
+<br />
+<br />
( ? ) ( ! )<br />
/<br />
Correspondants en français<br />
a, an<br />
e, è., in<br />
0, 0, on<br />
i, in, in (in latin)<br />
ou, oun<br />
b<br />
tch<br />
d, th<br />
f<br />
g, (dur) , gb<br />
h(dur)<br />
dj<br />
k, kp<br />
l<br />
ID<br />
n, gn<br />
r<br />
s<br />
t<br />
u<br />
v<br />
w<br />
h (aspiration légère)<br />
y<br />
z<br />
virgule<br />
point virgule<br />
point<br />
? !<br />
le mot cité
- 14 -<br />
HAPITRE l<br />
LE PAYS - LES HOMMES ET UN DE LEURS MODES D'EXPRESSION /HAN/<br />
1. Le pays - 2. Le peuplement - 3. L'organisation sociale<br />
A - L'habitat-les villages du plateau et les villages la-<br />
custres - B - Les groupes sociaux: les /glési /, les /akwè-<br />
non /, les /hunsi /, les /Bokonon /, le corps des métiers.<br />
4. /Han/, un des modes d'expression du Wémènu : brèves dé-<br />
finitions de la chanson et du terme populaire. Conclusion<br />
partielle.<br />
Qu'il nous soit permis de présenter très brièvement la région<br />
dont nous allons parler, au cours de cette étude, et ses habitants. Il<br />
convient d'entrée de distinguer deux régions :<br />
- une région administrative ou politique dont le chef-lieu<br />
fut Porto-Novo: l'ex-préfecture, aujourd'hui province de Wémè, couvre<br />
une bonne partie du Bénin méridional; elle s'étend du plateau de Zan-<br />
gnanado jusqu'à la lagune de Porto-Novo et la rive septentrionale<br />
du lac Nokoué, et de tout le plateau de Sakété jusqu'à la rivière<br />
Sô, aux confins d'Abomey-Calavi;<br />
- une région naturelle, celle que parcourt longtemps,<br />
avant de se jeter dans la lagune de Porto-Novo et le lac Nokoué,<br />
/wémè/, un des plus grands fleuves du Bénin.<br />
C'est a celle-ci que s'intéressent nos études.
- 16 -<br />
délimitent l'aire géographique wémènu, le village limitrophe s'appelle<br />
Damè-Wogon. Au sud, le pays wémènu s'arrête à la rive septentrionale<br />
(1) de la lagune de Porto-Nova et du lac Nokoué. Là, vivent des popu<br />
lations Toffinou et Aguégué qui en réalité ne forment pas un tout<br />
unifié avec les habitants de la vallée(surtout les Aguégué). Au Sud_<br />
Est, aux confins de la banlieu de Porto-Nova, un peu avant Djigbé,<br />
au marché Zèglè, les limites du pays Wémènu ne sont pas sensibles<br />
dans le paysage. Malgré quelques influences de la ville de Porto-Nova<br />
les habitants de Djigbé et de Hazin se sentent entièrement /Wémènu/.<br />
Cette délimitation de la zone naturelle fait apparatre<br />
trois éléments constitutifs du pays : le plateau de Sakété, la vallée<br />
ou la plaine d'inondation du fleuve, la lagune. Ils sont déterminants<br />
dans la vie économique des habitants. Le plateau porte des palmeraies<br />
aussi bien sauvages qu'aménagées par les programmes gouvernementaux<br />
de développement rural,des forêts qui fournissent du bois et des cul<br />
tures vivrières telles que le maïs, le manioc, le haricot. La val<br />
lée et la lagune offrent une pêcherie abondante qui fournit du pois<br />
son à la région et même a l'exportationn. Ce sont les domaines d'une<br />
végétation luxuriante.<br />
(1) A part certaines précisions apportées par nos recherches, les li<br />
mites de la zone étudiée sont tirées du remarquable travail de P.<br />
PELISSIER, Les pays du Bas-Ouémé, une région témoin du Dahomey méri<br />
dional, Faculté des Lettres et Sciences humaines, Dakar 1963,pages 8-9
- 18 -<br />
à d'autres, une économie autarcique n'étant plus de saison, tout cela<br />
Qet nous en avons sûrement oublié-a contribué à chasser les jeunes hors<br />
des campagnes. Il s'ensuit des hectares et des hectares de terre incul<br />
tes; et la terre, qui naguère montrait ses surfaces tressées de sillons<br />
où bourgeonnaient de jeunes pousses de cultures diverses, ,se terre sous<br />
les pieds fourchus d'une forêt envahissante.<br />
2. le peuplement<br />
Le second aspect de la personnalité du pays tient aux facteurs<br />
de son peuplement. C'est en réalité l'une des rares régions où l'on ne<br />
rencontre pas une multiplicité d'ethnies. Et P. PELISSIER disait à ce<br />
propos: "Sans doute les particularismes ethniques sont-ils beaucoup<br />
moins affinés dans tout le Bas-Dahomey que dans la plupart des autres<br />
régions de l'Afrique de l'Ouest..."(l). En effet, on ne rencontre pas<br />
dans la région des ethnies très différenciées les unes des autres, peut<br />
être que la vie dans une même aire géographique a-t-elle contribué a<br />
unifier ce qui, au départ, pouvait paraître diversifié. Cette popu<br />
lation compte entre autres deux grands groupes ethniques : les IWémènu/et<br />
les/Jigbénu{,faits d'une pléiade de clans et de familles. Les autres<br />
minorités ne se différencient pas tellement de ces groupes, du point<br />
de vue des coutumes. Ils se sont tous refugiés dans la vallée pour<br />
fuir la menace d'autres groupes sociaux numériquement et techniquement<br />
plus forts qu'eux.<br />
En fait, le peuplement a été le fait de migrations succes<br />
sives c'est d'après Edouard <strong>DU</strong>NG<strong>LA</strong>S qui a beaucoup travaillé sur<br />
l'histoire des IWémènul et cité par P. Pélissier, de l'Est que sont<br />
(1) P. PELISSIER, Op. cit. page 43.
- 24 -<br />
parfois, les jeunes hommes se séparent très tôt de leurs parents; ce qui<br />
donne des villages qui s'étirent sur deux ou trois kms le long du fleu<br />
ve. Cette situation pourrait entraîner la rupture d'une cohésion fami<br />
liale; mais en réalité, il n'en est rien.<br />
Ces villages lacustres vivent au rythme de la montée des eaux<br />
et de leur retrait. En période de crue, les riverains arrêtent toutes<br />
les activités de labour; seule la pêche bat son plein et nourrit les<br />
pratiquants. Dès le retrait des eaux, on cultive maïs, manioc,haricot.<br />
Ceux du plateau qui possèdent des terres dans cette plaine d'inonda<br />
tion ensemencent eux-aussi leurs champs. A ces activités agricoles<br />
des riverains, on doit ajouter l'élevage encouragé par de riches pâtu<br />
rages. AgonIin, Dannou, Hêtin se sont spécialisés en élevage des bovins<br />
et des caprins.<br />
Si ces éleveurs n'ont pas encore connu un problème d'épidémie<br />
qui décime le bétail, les agriculteurs se sont trouvés confrontés a<br />
des problèmes dangeureux pour leurs cultures. En 1952 est apparue pour<br />
la première fois dans la région "la rouille" du maïs (puccinia polysora),<br />
que les paysans ont appelée: IMè un Kpé/. Le fléau a fait tant et tant<br />
que le grain a manqué à la région et que la disette s'est installée en<br />
1953-1954. Inhérente par ailleurs a la crue du fleuve, l'invasion du<br />
Itingbol, herbe dure qui tue toutes les semences là où le paysan a réussi<br />
par sa tenacité a en déposer, car pour arriver à arracher cette herbe<br />
afin de trouver la terre argileuse qu'elle recouvre, il faut une trempe<br />
et la psychologie d'un homme résolu a se préserver malgré l'acharnement<br />
de certains éléments de la nature à l'en dissuader.
- 25 -<br />
B - Les groupes sociaux<br />
Les immigrés qui ont formé le peuplement du pays ont gardé entre<br />
autres coutumes et moeurs leur propre notion du chef et de la hiérarchie<br />
sociale. En effet, deux trônes gouvernaient le pays : le roi des IWémènul<br />
dont la capitale est Dangbo, et celui des IIfénu/, qui siégeait à Fanvi.<br />
Certes, ces petites cours ne menaient pas un train de vie aussi somptueux<br />
que celle d'Abomey. L'organisation sociale et politique dans Wémè était<br />
loin d'approcher celle qui avait cours à Abomey. Par ailleurs, que les<br />
rois de Wémè aient"dépendu" un court moment des princes de Porto-Novo,<br />
nous en convenons; mais nous ne sommes pas du meme avis que Hagen( et<br />
nos sources sont formelles là-dessus) lorsqu'il écrivait :f'A la suite<br />
d'actes arbitraires commis par Toffa, ces peuplades se séparèrent du<br />
reste du royaume. Un fugitif du Dahomè, nommé Haydé, parvint à s'y<br />
faire proclamer roi "(1) A aucun moment, Wémè n'a fait partie du royau<br />
me de Porto-Novo. Les Wémènus étaient venus dans la région avec tout ce<br />
qu'ils avaient pu sauver du sinistre qui les chassa de leur plateau de<br />
Zangnanado. Chaque lignage avait tout mis en oeuvre pour sauver ce qui<br />
lui appartenait; c'est ainsi qu'ont été transportés dans la vallée tous<br />
les fétiches qu'honoraient les Wémènus sur leur plateau.<br />
Des institutions politiques, celle qui est restée la plus viva.<br />
ce jusqu'à ces derniers temps est la royauté. Ce régime n'a pas donné<br />
naissance aux séries de ministres que l'on connaissait à Abomey(signe<br />
d'ailleurs évident dans le cas d'Abomey, d'un certain sens des affai<br />
res publiques et de l'organisation sociale) et à Porto-Novo; encore<br />
moins à une noblesse entièrement détachée du peuple et se consacrent<br />
(1) Dr HAGEN, Op.cit. page 2.
- 26 -<br />
à la chose publique. La royauté est cependant héréditaire, mais lors<br />
qu'on monte sur le trône à Dangbo, on n'atteint la plénitude du pou-<br />
voir que lorsqu'on a "mis les chaussures" : /yi afokpa/, cérémonie au<br />
cours de laquelle tous les Wémènus viennent reconnaître publiquement<br />
leur souverain. En fait, ce sont les /Axovi/ qui donnent la chassure.<br />
/Axovi/ = fils de roi, prince; mais ces présupposés/Axovi/ ne sont pas<br />
plus princes que n'importe qui dans Wémè. Les savates qu'on lui donne<br />
à chausser sont le symbole de sa mâturité politique et du plein pou<br />
voir, comme toute sa personne est un symbole. Car en fait, la direc<br />
tion des villages était confiée à des chefs de villages qui, ou choi<br />
sis par le roi parmi le peuple ou choisis par les habitants eux-mêmes<br />
ne forment pas une classe sociale : la chefferie, sauf cas rare, n'est<br />
pas héréditaire. C'est donc un pays où il n'y a pas de noblesse diri<br />
geante; cependant, il existe des groupes sociaux plus ou moins distincts.<br />
Les /glési /<br />
L'agriculture est la principale activité économique du pays;<br />
tous les Wémènus sont donc des /glési/. /glési/, c'est un homme ou une<br />
femme (comme on en rencontre dans le Nord du pays>, c'est le cultiva<br />
teur qui travaille la terre et qui en vit; c'est dans les villages<br />
lacustres/le paysan-pêcheur qui ne saurait vivre décemment sans culti<br />
ver la terre. Tout le monde étant propriétaire terrien ou presque,nous<br />
pouvons analyser le statut du /glési/. Il exerce les travaux des champs<br />
comme profession; il travaille pour lui-même et peut exploiter et gérer<br />
d'immenses palmeraies. Il peut aussi se louer de champ en champ pour<br />
s'amasser un pécule après que lui-même a fini de défricher son champ.
-29-<br />
ambulant, l'élu du fétiche se doit d'aller torse nu ou de porter un pagne<br />
en forme de toge attaché au-dessus de l'épaule gauche selon les convenan<br />
ces personnelles(surtout les Isol dont les épaules ne doivent pas être<br />
couvertes afin d'être toujours disponibles au fétiche). Enfin, parmi les<br />
signes distinctifs "ostentatoires", nous mettons le port d'un chapeau de<br />
forme conique, ou d'une calotte. Ce sont les Idahl qui seuls portent ces<br />
calottes dans leur vie quotidienne.<br />
Certains prêtres, dès qu'ils sont consacres ne doivent plus<br />
travailler; ils vivent au milieu d'une cour nombreuse ou seuls et les<br />
adeptes se chargent de les nourrir avec des produits rapportés par l'ex<br />
ploitation de la part du patrimoine de l'indivision, part qui leur est<br />
échueà leur élection. D'autres doivent travailler (la terre)pour se nour<br />
rir mais personne de cette catégorie sociale n'a le droit de porter une<br />
charge sur la tête. Au cours des mois ou des annees passées au couvent,<br />
ils apprennent une langue archaïque: IAja/, qu'eux seuls comprennent.<br />
Ainsi, ils peuvent parfois converser entre eux des choses du Ivodunl<br />
sans s'inquiéter d'une oreille indiscrète. Beaucoup de paroles et de<br />
chants rituels sont en cette langue; et nous nous demandons si ces chants<br />
accESsibles aux seuls "happy few" sont vraiment une production populaire.<br />
ILes IBokononl<br />
Nous n'avons aucunement l'intention d'écrire une étude exhaus<br />
tive sur cette catégorie sociale très importante dans la région. Nous<br />
estimons que ce travail revient de droit aux sociologues. Nous ne<br />
nous embarrasserons pas non plus de vaines spéculations d'Africanistes
- 30 -<br />
tentant de découvrir le sens précis de /bokonon/. R<strong>OU</strong>GET<br />
Gi l ber t a fa i t lep0 in t de ces s péculation s (1); on pen-<br />
se que /bo/ signifiant : amulette, le terme désignerait le fabricant<br />
d'amuléttes. Les !,l-imulettes désignent des objets que l'on porte<br />
sur soi dans l'idée"superstitieuse"(2) qu'ils préservent des mala-<br />
dies, des dangers etc.•. (talisman, porte-bonheur, gri-gri etc.. ).<br />
Limiter le personnage à ce rôle équivaut à restreindre son<br />
champ d'action dans la vie wéméenne, à minimiser son importance et<br />
a ignorer son essence. Par ailleurs,cette définition est très sub-<br />
jective et surtout se référant à l'esprit de la civilisation qui<br />
la propose; elle ne rend pas compte d'une façon "scientifique"de la<br />
conception universelle de "amulette". Ce qui parait superstitieux<br />
ici peut ne pas l'être là-bas. Dans son entreprise, Rouget ne pro<br />
\.<br />
pose pas une définition de /bokonon/ : "il n'a pas d'opinion person-<br />
nelle là-dessus "(]). Pourtant, il rejette catégoriquement le sens<br />
d'amulette qu'on attribue à /bo/ a cause d'une question de ton;<br />
dans /bokonon/, la voyelle 0 est de ton moyen-ascendant alors que<br />
/bo/ est bas. Il oublie peut-être que beaucoup de substantifs/Fon/<br />
ou /Wémègbé/ se composent d'autres substantifs et que leur combi-<br />
naison peut modifier les tons primitifs de chaque constitutants<br />
(ex: /ganu/ =/ga/ = le fer, /nu/= la chose; /ganu/= l'assiette).<br />
Nous pouvons décomposer d'une première façon le mot /bokonon/ :<br />
/bo/ = amulette,/ko/ = le cou, /non/ = la mère, le propriétaire.<br />
(1) R<strong>OU</strong>GET Gilbert,"Une chantefable d'un signe divinatoire au Daho-<br />
mey", in Journal of African languages,1-3, 1962, page 273-2930;<br />
(2) Nous avons pris cette définition dans le Petit Robert \<br />
(3) R<strong>OU</strong>GET Gilbert, Op. cit. page 276
- 31 -<br />
Dans cette première tentative le terme désignerait celui qui porte beau-<br />
coup d'amulettes au cou. Celui-là peut en être le fabricant comme aussi<br />
le simple utilisateur. Mais nous avons déplacé beaucoup de tons dans cet-<br />
te première démarche. Et si nous gardions les tons : Ibol= amulette,/kol=<br />
terre, sable; nous désignerons par le terme celui qui fabrique des statuts<br />
de sable et les anime par l'entremise des gris-gris: amulettes. Pratique<br />
magique ! Cela est plus près de la réalité et traduit bien la fonction du<br />
personnage. Nos deux démarches se complètent agréablement. Ce personnage<br />
est le plus souvent couvert d'amulettes. Le Ibokononl fabrique des amulet-<br />
tes, guérit des maladies, sauve le Wémènu des griffes de ses "ennemis".<br />
Deux rubriques se trouvent à l'actif du personnage: guérisseur, fabricant<br />
d'amulettes.<br />
Le bokonon au prime abord est un guérisseur traditionnel; ini-<br />
tié aux vertus des plantes et des herbes par son père, un de ses parents<br />
ou par un maître quelconque, il connaît le langage des plantes, leur<br />
génèse et leur nom secret que le profane n'utilise jamais, et enfin quels<br />
maux elles peuvent guérir. Personnage"scientifique", il donne des consul-<br />
tations et prescrit des médicaments qu'il compose lui-même. Il surveil-<br />
le personnellement ses malades jusqu'à leur rétablissement. Mais on ne peut<br />
pas soigner un mal sans un dépistage préalable; c'est ainsi qu'on ajoute<br />
au diagnostic la source naturelle ou supposée provoquée du mal. Aussi, le<br />
personnage s'est-il très tôt spécialisé en l'art divinatoire. Il interroge<br />
le Ifal (1) et peut alors dire d'où vient le mal , prescrire les sacrifices<br />
à accomplir, les gris-gris à utiliser (qu'il fabrique lui-même) pour éloi-<br />
gner le malheur conjointement avec l'utilisation des remèdes médicamen-<br />
teux. S'il peut entrer en contact avec les esprits, converser avec eux,<br />
(1) On se reportera à l'étude qu'a faite du Ifal et du Ibokononl DE S<strong>OU</strong>ZA<br />
{Germain),dans :Conception de vie chez les Ifonl,publié avec le concours<br />
du C.N.R.S. aux Editions du Bénin, Cotonou, chapitre III .
- 32 -<br />
il peut donc apprivoiser l'esprit d'un vivant. De ce volet découlent les<br />
forces du mal : les gris-gris de malfaisance. Un esprit "scientifique"<br />
comme les médecins, il n'ordonne pas une seule potion, mais plusieurs<br />
sachant que si l'une ne réussit pas, l'autre fera l'affaire(/yé da man/).<br />
De plus, il se tient au courant; il n'a pas de revue médicale mais<br />
chaque fois que les vertus médicinales d'une nouvelle plante viennent a<br />
être prouvées dans quelque contrée(même hors du Bénin) ,il se déplace, va<br />
se renseigner et se tient donc à la pointe du progrès. Cette culture tou<br />
jours en évolution ne s'arrête pas au seul domaine des remèdes, mais el<br />
le déborde largement dans celui des gris-gris; a-t-on découvert le<br />
gri-gri le plus malfaisant du monde ? Il court en chercher la composition<br />
et le remède: "il en a acheté la main "dit-il. Là où il n'y a plus dans<br />
ses démarches d'esprit scientifique, c'est qu'il se fait assister d'un<br />
/kinninsi/(1), un vodun de prédilection, il lui fait souvent référence.<br />
Bokonon vit entièrement de ses connaissances.Il fait vivre aus<br />
si une multitude de gens. D'abord, ses acolytes, des assistants ou des<br />
/bokonon/ de moindre importance, puis les apprentis-bokonons ou ceux qui<br />
viennent pour faire un stage chez lui enfin la troupe nombreuse des "igno<br />
ranti" qui accompagnent le grand dans ses déplacements,cultivent ses ter<br />
res, étouffent les victimes de sacrifices et les prépar'ent(les marmi<br />
tons) .<br />
Le corps des métiers<br />
Les immigrés wémènus n'avaient pas introduit beaucoup de métiers<br />
dans la vallée soit parce que dans l'ancien royaume, iln'y en avait pas<br />
beaucoup, soit parce que les représentants de tous les métiers n'avaient<br />
(1) de S<strong>OU</strong>ZA (Germain) Op. cit. Chapitre III
- 33 -<br />
pas pu immigrer. Deux métiers se pratiquent dans la région<br />
coordonnerie<br />
la forge, la<br />
Au terme de cette étude, il convient de signaler qu'aucun groupe<br />
social n',est tè rIDé à l'autre. On peut du jour au lendemain passer d'une ca<br />
tégorie sociale à une autre; ce qui est important, c'est que le "bourgeois",<br />
les prêtres et prêtresses, les bokonons, les forgerons et les cordonniers<br />
ajoutent à leur activité principale le travail de la terre. Tous les Wémè<br />
nus sont donc des paysans auxquels la terre est chère. Il n'y a pas de cas<br />
tes dans la région.<br />
Si tout le monde est paysan, tout le monde possède plus ou moins<br />
un lopin de terre à cultiver. Le régime foncier répond au vieil adage de<br />
"la terre aux premiers occupants". En effet, dans certains villages, une<br />
famille ou un lignage peut passer pour propriétaire de la majeure partie<br />
des terres du simple fait qu'ils ont été les premiers à occuper ces domaines.<br />
Ils acceptent cependant de céder une partie de leurs prérogatives à des voi<br />
sins venus après eux. Il subsiste de nos jours très peu de domaines d'indivi<br />
sions non morcelés. Les droits successoraux, le partage systématique entre<br />
les "mâles" d'une famille rendent visible l'acuité de la propriété privée;<br />
meme si certains membres d'une famille peuvent mettre en bail leur part<br />
d'héritage pour des raisons diverses, le patrimoine reste entier qu'aucune<br />
borne ne peut définitivement aliéner,car il est symbole de la cohésion fami<br />
liale. Le morcellement des parcelles est beaucoup plus remarquable dans<br />
les villages lacustres où la terre est hérissée d'arbres-bornes. Et com-<br />
me le remarque Si justement P. Pélissier:
"<br />
- 34 -<br />
dans ces vieux villages, la solidarité des familles<br />
et l'autorité de leurs chefs sont une tradition encore<br />
vivante.(1)<br />
Voilà la brève présentation que nous voulions faire des wé<br />
mènus; nous ne doutons pas un instant d'avoir fait des omissions que,<br />
nous esperons bien, la chanson populaire rétablira.Car, dans la ré<br />
gion, elle est comme un livre dont chacun en écrit une page. C'est<br />
ici le lieu de nous poser la question de savoir ce qu'est la chanson.<br />
4. IRan/, un des modes d'expression du Wémènu<br />
La chanson, c'est une alliance plus ou moins judicieuse d'un<br />
texte et d'une mélodie, c'est la symbiose de la parole et de la mélo<br />
die. Elle n'est le propre d'aucune époque ni d'aucun groupe social<br />
Art universel, elle se compose sous certains cieux de genres bien va<br />
riés, et sous d'autres, elle est apparemment moins riche : nous citons<br />
le genre folklorique, les genres littéraires, le genre politique ou<br />
idéologique. C'est à notre avis l'art le plus populaire. Nous attribons<br />
a ce terme son sens plein, non pas celui que proposent les dictionnai<br />
res. Un genre créé et utilisé par le peuple, il émane de lui, lui<br />
appartient; il s'adresse au peuple, lui plaît ou suscite en lui des<br />
réactions diverses. Et le peuple dans Wémè rassemble tout le monde :<br />
du/glésil au bokonon/,d'/akwènonl au forgeron, au savetier en passant<br />
par les prêtres. Et aujourd'hui, même les intellectuels produits par<br />
le contact avec d'autres cultures chantent et se sentent concernes;<br />
ils font partie du peuple. Et Claude TARDITS écrivait en 1958 :
- 40 -<br />
comme sa propre fille: elle lui fit les honneurs de la maison, l'initia<br />
aux secrets qui charment Bokossa, leur commun maitre. Elle lui fit la<br />
cuisine huit jours durant. Bokossa, lui, était plus heureux qu'aupara<br />
vant, mais Gozinmè, elle, avait pris sa décision. Au bout du huitième<br />
jour, la jeune épouse fut invitée à sortir, à se rendre à la source avec<br />
sa coepouse. Elle la suivit, docile. Gozinmè prit la première de l'eau,<br />
une eau limpide, fraiche,telle qu'aime Bokossa. Au tour de la petite<br />
femme, elle ne savait où puiser. Elle voulut puiser à côté, Gozinmè<br />
protesta; elle avança, la femme-mère l'envoya encore plus loin, tant et<br />
tant qu'elle se noya. Gozinmè revint discrètement au logis, ravie d'a<br />
voir supprimé sa rivale. Le mari vint s'enquérir des nouvelles de sa<br />
femme; on lui fit entendre qu'elle était allée faire un tour. Le mari<br />
se rendit très vite compte qu'il ne retrouverait plus sa femme; on<br />
entreprit des recherches, on battit forêts et marais. On fouilla par<br />
tout comme s'il s'était agi d'une épingle. Même le /Fa/ resta muet.<br />
Vaines recherches. Des lunes passèrent.On oublia la disparue.<br />
Un jour que Gantin, l'ami de Bokossa, coupait du bois pres<br />
de la source, il entendit chanter comme un oiseau. Il n'y prit garde<br />
qu'au moment ou il entendit clairement son nom. Et la chanson disait;<br />
Gantin, cher ami de mon mari,<br />
Toi qui coupes du bois près d'ici, je désire te confier un<br />
message,<br />
Que tu transmettras a Bokossa de ma part.<br />
Ma coépouse rongée de jalousie m'a accompagnée à la source.<br />
J'ai voulu puiser à côté, elle me suggéra d'aller plus avant.
- 42 -<br />
Il est certain que le récit comporte une beauté intérieure à<br />
laquelle s'ajoute l'art du conteur et qu'il véhicule structure sociale<br />
et mentalité. Mais cette expressivité serait tronquée en l'absence de<br />
la chanson. Et la chanson, elle énonce à mi-mo:t toute l 'histoire. Ex<br />
traite du texte, elle est parfaitement compréhensible : elle est auto<br />
nome. Une autre esthétique préside à son existence. Mais avant de pro<br />
céder à l'examen des questions générales d'esthétique et de créativité<br />
soulevées par notre propros, il convient d'abord de décrire/han/ dans<br />
le contexte socio-culturel.<br />
a) Origine de /han/<br />
2. /Han/ et le contexte socio-culturel<br />
Les récits cosmogoniques regorgent de mythes de créations et<br />
d'intitutions de toutes sortes. Cependant, on n'y rencontre même pas des<br />
allusions à la création de /han/. Toujours est-il que les Wémènus ont<br />
fait de la chanson et de l'Art lui-même un don d'un génie (1). En effet,<br />
et cette vision est unique dans la République Populaire du Bénin, la lé<br />
gende attribue l'origine de la chanson à "Aziza". A en croire les infor<br />
mateurs, Aziza serait une créature de petite taille, d'un aspect physi<br />
que très proche de celui de la race blanche et se révélant aux hommes<br />
toujours assis sur une ancienne termitière délabrée, sa demeure. Elle<br />
apparait avant tout comme la respecta'üe détentrice de toutes les scien<br />
ces, de toutes les perfections et de toutes les puissances du monde. Elle<br />
a choisi parmi toutes les professions humaines, les chasseurs, des aven-<br />
(1) Clément DA CRUZ,"Inventaire des instruments de musique dans le Bas<br />
Dahomey" ,in Etudes dahoméennes, N° XII, 1954 ..
- 45 -<br />
Il chante des chansons qu'il a composées. Et c'est pour nous une ambition<br />
que de chercher à suivre l'histoire de cet art autonome et multiforme,<br />
tant la matière est surabondante. Mais cette variété, signe évident d'une<br />
richesse culturelle de pensée et d'expression, de préoccupations (thèmes)<br />
à fixer dans un moule, est tantôt création personnelle du peuple, tantôt<br />
arrangement et affinage de productions adoptées. Aussi, rencontre-t-on<br />
dans la région plusieurs possibilités d'existence de /han/.<br />
c) / Han / dans Wémè - Existence<br />
Seules les caractéristiques du genre nous permettent de faire<br />
l'analyse suivante; en effet, la chanson populaire est quasi-spontanéité<br />
et avant tout fille de la réalité. Quasi-spontanéité à cause de la force<br />
de l'improvisation, de la force de créativité qui l'engendre en jets purs<br />
et limpides. Si elle était entièrement spontanée, on spéculerait inélucta<br />
blement sur son caractère primitif, c'est-à-dire sans aucune préoccupa<br />
tion esthétique. Mais elle est semi-spontanée. Sa sociologie apparaît<br />
complexe de ce point de vue. Un attentif examen révèle plusieurs possi<br />
bilités d'existence du chant populaire.<br />
On dénombre les chansons anciennes qu'ont transmises au Wémè<br />
nu les voix inconnues de ses ancêtres; ce sont d'abord les chansons de<br />
cérémonies, à savoir: les cérémonie.sinitiatiques, les cérémonies mor<br />
tuaires(enterrement, troisième jour, huitième jour, funérailles),puis<br />
les cérémonies fétichistes. Ces chansons ont un caractère opaque et sont<br />
entourées d'un certain sens religieux, sacré. Certaines d'entre elles
- 49 -<br />
- le deuxième sous-groupe de chansons nouvelles provient des<br />
tams-tams adoptés. En effet, la proximité d'autres régions, la ressem-<br />
blance entre les langues, permettent aux tams-tams de passer d'une ré-<br />
gion à l'autre. Dans ce cas, on adopte le tam-tam et un certain nombre<br />
de chants de son répertoire. Soit on garde ces chansons dans leur lan-<br />
gue d'origine,soit;ctlm ::hange les paroles. Par exemple,/Djèkè/(1) a été<br />
adopté; aussi le chant Ajasin vodun xwensé (ch 88) est-il populaire<br />
dans Wémè bien que le fétiche dont il est question n'appartienne à<br />
aucune famille de Wémè. Il a suffit que le contenu culturel de ce chant<br />
ait son pendant dans la région pourqu'il soit accepté. En effet, une<br />
multitude de fétiches recrutent des serviteurs chaque année dans Wémè<br />
comme le fait le fétiche /Xwensé/ d'Ajasin.<br />
- le troisième sous-groupe de chansons nouvelles constitue le<br />
répertoire de /Hanhun/. Tam-tam de société à l'origine, on y chante beau-<br />
coup plus qu'on ne danse. Son répertoire s'est spécialisé dans les chan-<br />
sons apologétiques ou laudatives, les chansons d'adversité ou des chan-<br />
sons historiques. Il se compose d'un certain nombre de mélodies modèles<br />
sur lesquelles on crée d'autres chansons. Ce qui change, c'est le thème,<br />
la gestuelle dans l'exécution. Le groupe de /hanhun/ le plus célèbre dans<br />
la région fut celui du nommé Chitou de Hozin. Aujourd'hui, ces chan-<br />
sons ont été récupérées par d'autres associations de tam-tam. C'est plus<br />
que jamais à ce niveau que nous avons la certitude de la quasi-sponta-<br />
néïté de la chanson populaire. Car, ici, le préchantre développe le thè-<br />
me dans la mélodie au fur et à mesure que le souffleur le lui souffle.<br />
(1 ) /Djèkè/ = tam-tam adopté des régions de Porto-Novo et surtout àes<br />
populations Aguégué.<br />
g-mT- . 'n....WP'2""!I
- 50 -<br />
Le souffleur dans le cadre de /hanhun/, c'est soit l'homme dont on chante<br />
l'histoire, soit un membre de l'association qui connait l'histoire en<br />
question. Le tout est si bien synchronisé que le spectateur n'entend<br />
que la chanson.<br />
La chanson populaire est aussi fille de la réalité à cause des<br />
thèmes socio-culturels qu'elle charrie, tel un vigoureux torrent empor-<br />
tant sur son passage cailloux et grès, débris et déchets de toute origi<br />
ne et de toute taille. Elle plonge ses racines dans la nature-même. Et la<br />
nature dans Wémè n'est-elle pas, elle, tout entière poésie, gravée en<br />
plume d'or sur des pages tantôt roses, tantôt grises, tantôt couleur jar<br />
re centenaire d'huile de palme. Echappant radicalement aux données de la<br />
poésie conventionnelle que nous connaissons dans les civilisations de<br />
l'écrit, elle surgit belle,esseulée, mais autonome et authentique. Car<br />
en fait, qu'est-ce que la poésie dans ces pays? Elle n'est pas autre cho<br />
se que la vie clairement et vigoureusement exprimée; c'est l'expression<br />
belle et harmonieuse des sentiments que nous éprouvons,vous et nous. Elle<br />
saisit l'origine des sentiments, des passions.Cependant, la réalité est<br />
fragmentaire, souvent obscure. La poésie "la vraie poésie débrouille,é<br />
claire, achève."(1) Mais si tout le monde éprouve des sensations, il<br />
n'est malheureusement pas donné à tout le monde de les exprimer. Seul le<br />
poète peut le faire. Le poète, pour nous, est celui dont l'étonnante sen<br />
sibilité s'allie fortement avec la culture afin de redonner jour au beau que<br />
recèle discrètement la nature. Les poètes forment dans la société une<br />
(1) Edouard SCHURE, Histoire du lied ou la chanson populaire en Allema<br />
gne, Paris:'Sandoz et Fischesacher, 1878, page 235.
- 5'2-<br />
"Il semblerait que le domaine où la fantaisie et la création<br />
personnelles peuvent davanatge se donner libre cours soit<br />
le chant "(1)<br />
Cette affirmation se vérifie bien aussi à propos des chansons<br />
nouvelles. En effet,l'existence des chansons nouvelles, leur création se<br />
lient étroitement à un caractère essentiel de la vie communautaire: "le'<br />
communalisme sentimental" (2). Car, en dépit des murs physiques, la vie du<br />
villageois n'a de secret pour personne dans le village.On a ainsi vu des<br />
joies, des scandales étalés sur la place du marché ou sous l'arbre à pa<br />
labre. Et comme pour fixer ces élémets de la vie quotidienne paysanne,<br />
comme pour les rendre éternels, la chanson populaire nouvelle s'en est<br />
emparee. Née sous cet arbre à palabre d'on ne sait qui, elle vole sur les<br />
ailes de la musique de bouche en bouche, de village en village, pour<br />
finir par atteindre toute la région.<br />
Une lavandière au travail près d'un marigot se croit seule; elle<br />
module d'une voix limpide une complainte que lui inspirent d'une part la<br />
rudesse de son labeur, d'autre part ce bosquet environnant, touffu et<br />
sombre, peuplé de mille bruits d'insectes et de gazouillis d'oiseaux in<br />
souciants, de cris rauques et effroyables de macaques apeurés. Un chas<br />
seur poursuivant discrètement un gibier l'a entendue; il repète cette<br />
complainte le soir en rentrant chez lui, le coeur gonflé par l'abondant<br />
(1)CA<strong>LA</strong>ME-GRIAULE (G.),Op. cit,page 76·<br />
(2) Le fait de partager avec d'autres les memes sentiments.<br />
Expression empruntée à K. NKRUMAH dans le consciencisme, Paris:Pré<br />
sence africaine,1976.
- 5§ -<br />
qui pouvaient le faire. On leur prend leur terre et on n'embauche pas leurs<br />
fils pour les bonnes places de l'exploitation.<br />
Pendant que notre glaneuse la fredonne,un vaillant laboureur,<br />
jouissant d'une pause tranquille à l'ombre d'un palmier et à cette heure de<br />
soleil meurtrier, l'entend. Il colporte cette mélopée au village; elle aussi<br />
entre dans le répertoire de Wémè. Combien de chansons sont nées ainsi ! Le<br />
peuple<br />
les chante tout en ignorant de qui elles sont; car, l'agent propaga<br />
geur n'en a pas indiqué la source, et le village qui l'exécute maintenant<br />
ne se soucie guère de cette source.<br />
Cependant, il n'est pas rare derencontrer de nos jours des chan-<br />
sons avec étiquette d'auteur. Dans ce cas, la langue désigne au travers du<br />
nom du préchantre l'association de tam-tam dont on tient le morceau; on di-<br />
ra que telle chanson appartient aux Chitou ou aux "Y" /Chitoulè han wè/.<br />
Nous nous permettons d'affirmer après toutes ces considérations que la chan-<br />
son populaire est, dans Wémè, une oeuvre à la fois anonyme et signée d'un<br />
nom d'auteur collectif: le peuple. Cette force de création provient fon-<br />
damentalement de la psychologie du Wémènu. En effet,il est fortement at-<br />
taché à sa terre)à sa case, à son clan, à sa famille et à son village. On<br />
observe chez lui à cet égard une vie affective secrète ou profane. Aussi,<br />
chante-t-il aisément son village, les esprits de son village, organisateurs<br />
providentiels. Fin observateur, il remarque et craint tout. Les animaux de<br />
la brousse, les plus familiers surtout, qu'il surprend régulièrement au dé-<br />
tour de la piste, ont leur histoire et partant leur chanson. Certains plus<br />
mystérieux, l'inspirent encore plus. Imaginatif, il a donné un nom parti-<br />
culier aux génies de la brousse et des eaux, aux héros des temps jadis;
- 59 -<br />
-enfin le cycle /Xwé/. On y distingue deux séries de fêtes:<br />
les fêtes des religions adoptées (le cas du christianisme), les fêtes tra<br />
ditionnelles qui comprennent les réjouissances marquant les cérémonies fé<br />
tichistes, celles qui caractérisent les grandes funérailles et les fêtes<br />
-dites civiles introduites par la colonisation :le Nouvel an, la fête de<br />
l'indépendance, les différentes fêtes célébrant les différentes"libérations<br />
nationales" .<br />
Les chansons occasionnelles<br />
Elles sont aussi importantes soit par leur nombre, soit par les<br />
occasions et leurs caractères. En effet, la plupart des occasions du groupe<br />
revêtent un caractère sacré; cousues de croyances populaires et souvent de<br />
superstitions, ces occasions confèrent aux chansons qu'elles nécessitent<br />
leurs propres caractères. Nous divisons donc les chants occasionnels en<br />
deux sous-groupes : les chansons sacrées ou considérées en tant que telles<br />
et les chants profanes.<br />
a) - Les chansons sacrées<br />
Elles groupent d'une part les chansons rituelles fétichistes :<br />
recrutement et sortie des serviteurs de fétiches, cérémonies initiatiques,<br />
cérémonies expiratoires/Savo/, et d'autre part les chansons funèbres:<br />
chansons d'enterrement, le piétinement de la tombe (/yozin han/ - 7 chants<br />
pour la femme, 9 pour l'homme), la huitaine ou /doyizan/, les petites fu<br />
nérailles /Yèsu/.<br />
b) - Les chansons profanes<br />
Elles -mêmes comportent deux groupes<br />
- les chansons profanes appartenant à tous; ce sont le cycle<br />
de chants de la naissance à la mort, les chansons phobiques ou d'adversité
- 60<br />
et les chansons apologétiques ou laudatives;<br />
- les chansons profanes de sous-groupes socio-profession-<br />
nels regroupant les chansons de laboureurs, de piroguiers, de voleurs<br />
et les chansons de jeux d'enfants. Cette classification m?ntre claire-<br />
ment que la chanson se trouve au commencement et à la fin d'une vie.<br />
e) - la chanson dans la nature<br />
La nature dans Wémè apporte une quantité de preuves qui vien-<br />
nent corroborer cette affirmation. Le jour ne commence-t-il pas par le<br />
chant du coq, audible par tous et servant de réveil-matin ?<br />
Koklo ho 0 ko = koklo ho 0 ko<br />
Dagbé ma xwégbé = le bien n'est, pas à la maison.<br />
le bonheur n'est pas au lit<br />
le coq prone et démontre que le bonheur n'est pas au lit. Le volatile<br />
. se lève en effet a quatre heures du matin tous les jours et part à la<br />
recherche du grain dès que les tout premiers rayons pâles du soleil<br />
levant dissipent les ombres de la nuit. Ce jour ne se poursuit-il<br />
pas dans le gazouillis allègre des oiseaux dont les plus proches de<br />
l'homme sont IAgonl avec son chant mélodieux et grave<br />
Un do sin mion + yé so èl<br />
Un do azincé + ye bè èl<br />
Dada kuku + huhu<br />
Un jè gboto + huhu 1<br />
Il dit<br />
J'ai chauffé de l'eau, on me l'a vidée<br />
J'ai pondu mes oeufs; ils les ont ramassés.
- 63-<br />
harmonie invitant à la réflexion et au reve, et non/comme on pourrait<br />
le penser/une cacophonie rugueuse mettant les sens à la torture. Une<br />
fois de plus, la nature toute entière est poésie; elle est chanson.<br />
Et la journée finit sur une note d'espérance, espoir de refaire par la<br />
nourriture l'énergie dépensée dans la journée et de pouvoir être dispos<br />
pour le lendemain.C'est le lieu de dire que la vie est un éternel recom<br />
mencement.Cet espoir sort du bec de la perdrix, un bel oiseau au pluma<br />
ge uni et alléchant, gris moucheté de rose pâle, à l'allure princière,<br />
aux gestes furtifs,un des symboles de la femme. Son caquètement: /kaka<br />
kraaa + kakaa kraaa/ est assimilé au raclament par la femme des fonds<br />
de la marmite afin de les débarrasser des restes de la veille et de<br />
préparer le repas du jour. Le laboureur au champ, entendant la perdrix,<br />
sent comme un appel de son épouse; il arrête son travail, va ramasser<br />
du bois pour la cuisine, et se dirige aussitôt vers sa chaumière. Tous<br />
ces oiseaux sont à l'image de l'espoir du Wémènu : pouvoir vivre tran<br />
quillement en harmonie avec la nature, fournisseur providentiel. L'im<br />
portant pour lui réside dans la vie tranquille de son village. Bien<br />
qu'il aspire aujourd'hui à faire de sa progéniture des hommes de leur<br />
temps (un quelconque échelon de la nouvelle élite), il s'efforce cepen<br />
dant de préserver son village de l'intellectualisme envahissant des<br />
villes et de lui faire garder ce qui est pur des sentiments premiers<br />
les sensations. Car, dans les villages de la région,on sent, on croit<br />
et on vit; on n'explique ni ne cherche à comprendre les choses qui<br />
ne fournissent pas par elles-mêmes des indications sur leur propre,·
- 7J -<br />
les airs d'un quelconque groupe fétichiste ! Que disons-nous? Cela ne<br />
viendrait même pas à l'idée de la femme qui fait la lessive dans sa cour<br />
et qui pourtant ponctue son travail de force chansons;on peut penser que<br />
l'envolée de son inspiration l'égarerait dans cette voie, mais non;une<br />
sorte de barrage subconscient se dresse en censeur et trie systématique<br />
ment tous les éléments de son répertoire. Cependant, il arrive que des<br />
gens passent outre ce qui est considéré comme un tabou :à ce niveau se<br />
pose le problème de la transgression du tabou . La seconde acception<br />
contenue dans le coeur concerne ses vertus physiologiques. Il est,dit-on<br />
couramment, le siège des sentiments. C'est le moteur du lyrisme. Lorsque<br />
le coeur est ému, il s'épanche dans un verbe éloquent et conséquent.<br />
Ce coeur-là, le Wémènu l'assimile au ventre. Aussi, dit-on que l'ivrogne<br />
ne raconte que ce qu'il avait dans le ventre, dans ses entrailles avant<br />
d'être soûl(in vino veritas). On peut en conclure que la parole chez le<br />
Wémènu est poésie, qu'elle confère une force expressive et une vierge<br />
beauté à la chanson qui elle-même exprime les moeurs.Le chant populaire<br />
est donc poésie.<br />
3. pe la dynamique sociale de /han/<br />
.. Les habitants des rives du grand fleuve chantent indifférem<br />
ment leur tristesse et leur joie, leurs craintes et leurs espérances,<br />
leurs conceptions de l'homme et de la vie, leurs divinités et leurs an<br />
cêtres, leurs morts, leurs génies, enfin leur Dieu. C'est en cela que<br />
l'analyse à propos de la dynamique de l'art, analyse faite par DIa BA<br />
LOGUN, se justifie. Il écrivait notamment :
- 72 -<br />
"A toutes les ét)'oques, dans toutes les sociétés, le contenu<br />
et la forme de l'oeuvre d'art sont à la fois la conséquence<br />
et le reflet parfois sous la forme d'une contradiction dia-<br />
lectique d'un certain nombre de croyances, d'espoirs, de préoc-<br />
cupations et d'aspirations d'une société et dune époque, puisque<br />
l'art est pour cette société, en même temps qu'un véhicule de<br />
communication, un facteur de cohésion."(1)<br />
Stephen CHAUVET avait déjà fait la même analyse à propos de la chanson.<br />
"La chanson joue, disait-il, a joué un rôle social considéra-<br />
ble. La symbiose (musique danse) sert a exprimer, à objec-<br />
tiver le sentiment collectif ou individuel à l'occasion de<br />
de quelque évènement et ou de quelque comportement." (2)<br />
Nous avons montré en quelles occasions le Wémènu chante.Et ces chansons<br />
Ces chansons renferment, comme la noix de coco couve jalousement son lait<br />
qui est aussi sa sève, des trésors cachés. On y trouve tout un monde vi-<br />
vant et connu, des traditions locales ayant toujours cours, de mâles ver-<br />
tus, des puissances secrètes. Une partie d'elles vient du fond des ages<br />
par l'intermédiaire de voix déjà oubliées, et l'autre est à mettre à l'ac-<br />
tif des générations du moment. Et, à notre avis, c'est une grande force<br />
pour la région comme pour son habitant, de ne rien oublier de son passe,<br />
de porter en eux-mêmes le meilleur et le pire de ce passé, la sève-même<br />
(1) Ola BALOGUN, Forme et expression dans les arts africains, in"Introduc<br />
tion à la Culture africaine" Union générale d'édition, 1977,Paris1 pageSO •<br />
(2) Stephen CHAUVET, Musique Nègre, Société d'éditions géographiques,mari<br />
times et coloniales, 1929,Paris, page 14.
-%-<br />
de meme pour la femme mariée. Et la mauvaise cuisine (Iwo munI = une<br />
pâte pas bien cuite) amène souvent la discorde dans le foyer. Une é<br />
pouse ne doit pas chanter à la cuisine; elle tuerait son. mari. Chacun<br />
dans Wémè respecte tout cela comme il le peut.<br />
Pour comprendre davantage le rôle que joue le chant populaire<br />
dans la vie,pour appréhender la splendeur que peut atteindre la chanson<br />
qui est aussi un roman de moeurs, il faut aller à wémè.Parcourez cette<br />
région, vous y rencontrerez partout Ihanldans sa force première et ses<br />
imbattables notes et parfums du terroir. Ce qui est curieux, c'est que<br />
dans un groupe où les différences d'âge sont sensibles, oùaujourd'hui<br />
les différences d'éthLque sont fort perceptibles, la chanson apparaît<br />
comme un facteur priviligié de communauté. Entendre une chanson, c'est<br />
entendre un appel; l'écouter, c'est aller franchement à la rencontre<br />
d'une communauté ou d'un homme; c'est aussi prêter attention pour mieux<br />
connaître. Et c'est cette attention que nous demandons à nos. lecteurs.<br />
Cependant, nous ne nions pas que le difficile est.de trouver dans la lan<br />
gue que nous allons utiliser pour traduire, dans le monde qui nous entou<br />
re, les images,les formes nécessaires pour donner réellement corps à ce<br />
monde vivant et riche de Wémè. Il y a lieu d'avoir peur que le lecteur<br />
ne l'entrevoie au lieu de le vivre et de le comprendre.Nous essaierons
-82-<br />
Parfois, toute une association s'annonce depuis des kilomètres du village.<br />
En effet, ils ont été invités à une fête, à des funérailles; ils viennent<br />
souvent de très loin. Dans ce cas, ils partent de chez eux par petits grou-<br />
pes unis par des affinités. En chemin, les femmes, leurs tabourets ou les<br />
tams-tams sur la tête, devisent gaîment, caquettent un peu ou se livrent<br />
volontiers aux cancans; ou alors, elles répètent une chanson récente. Les<br />
hommes, eux, parlent de "choses sérieuses", se chahutent. Mais voilà que<br />
les premiers s'arrêtent, les retardataires les rejoignent; tout le monde<br />
est là, au point de rassemblement convenu. De là, ils se dirigent vers le<br />
village en chantant, en clamant haut leur fierté de venir; car, une invi-<br />
tation expressè J:lotiveleur venue.<br />
(CH 07) Un message nous est parvenu.'<br />
C'est le message de (X) que nous avons reçu avant de nous<br />
présenter ici;<br />
Nous ne nous sommes pas faits récemment lali 0<br />
, ,<br />
Pour quemander a travers quartier ..<br />
Nous ne travaillons pas d'habitude<br />
o Lali : personne consacrée a un serpent déifié. Dès sa sortie du ou-<br />
vent, elle se promène de quartier en quartier pour quemander sa<br />
nourriture. Geste suprême d'humilité.
- 83-<br />
Nous vivons, Agbajumon 0&<br />
Nous ne nous sommes pas fait récemment lali pour mendier<br />
à travers quartier.<br />
o Agbajumon est un mot d'emprunt Yoruba. Il s'emploie dans plusieurs<br />
sens dans la région.<br />
1. Le terme désigne un homme, une femme riche, entouré d'amis, influent<br />
a tous les égards. Tous les facteurs<br />
nécessaires et obligatoires.<br />
richesses, amis, influences sont<br />
2. Il désigne, et c'est le plus courant, une femme, un homme moyennement<br />
nanti (ni très riche ni très pauvre), pourvu d'une pléiade d'amis et<br />
encore plus influent que le véritable riche.<br />
3. Le dernier sens que nous proposons ici connaît un emploi péjoratif.<br />
Le terme désigne quelqu'un ou qui a été riche, ruiné et qui garde les<br />
précieuses habitudes des riches: la course à la distinction, l'étala<br />
ge vaniteux d'une riche inexistante; ou qui n'a pas du tout. d'argent<br />
(parfois miséreux), comptant dans ses quelques amis deux ou trois ri<br />
ches qu'il s'évertue à copier surtout dans les relations publiques(il<br />
passe sa vie à échaffauder des projets grandioses aux oreilles de qui<br />
veut l'entendre: des châteaux en Espagne. Il s'endette le plus sou-<br />
vent pour s'habiller afin de paraître; il connait très souvent des<br />
nuits sans dîner); il n'est pas influent du tout ou du moins il pen<br />
se, a tort d'ailleurs, que les amis de ses amis riches sont ses amis.<br />
Une telle femme, un tel homme s'appelle /Agbajumon kuku/ : faux pre<br />
cieux.
- 91 -<br />
A en croire le chant récréatif, l'orphelin ne serait pas la<br />
seule victime de cet individualisme execerbant. Chacun de nous en est<br />
victime lorsqu'une difficulté le pousse vers la famille. (CH 50). La<br />
propriété serait à l'origine de cet individualisme. Les biens qui na<br />
guère faisaient partie du patrimoine collectif de l'indivision, du clan<br />
ou de la famille, ont été partagés sous la pression de certains cupides.<br />
Un lopin de terre échoit en partage à un individu qui veillera à ce que<br />
son droit de propriété soit strictement respecté. Dès cet instant, des<br />
heurts violents, des joutes verbales futiles aliènent l'esprit familial.<br />
La cohésion est rompue. Chacun doit demeurer dans ses frontières. Té<br />
moin de toutes ces tribulations, le chant populaire en rit; car il sait<br />
que rien n'est plus unificateur que la mort et la case.des morts où les<br />
mânes de toute la famille se rassembleront inévitablement. Divisée de<br />
son vivant. par la cupidité, la famille ne pourra jamais éviter de s'unir<br />
après la mort dans la commune demeure ancestrale. Là, il n'y aura plus<br />
de frontières, pas de biens privés; tout le monde sera au même régime.<br />
Le chant récréatif lance alors une exhortation à l'union, à la concorde<br />
et procède à un farouche dénigrement des vanités individuelles. C'est à<br />
cette seule condition que survivra l'unique voix familiale, et que les<br />
faibles seront pris en charge par l'ensemble.<br />
(CH 12) L'on dit que vous avez coutume de vous rassembler<br />
Et de fixer des limites aux.uns et aux autres;<br />
Vous vous divisez<br />
Mais pouvez-vous séparer la commune demeure mortuaiPe ?
- 93 -<br />
Le plus curieux s'observe au niveau des relations entre mem-<br />
bres directs d'une même famille. Cela est encore pire lorsque le père<br />
est polygame. Les enfants le plus souvent manquent de franchise entre<br />
eux. Pendant que le frère utérin vous dit qu'il fait nuit et vous dé-<br />
conseille de sortir, le frère consanguin minimise les dangers de la nuit.<br />
Si vous l'écoutez, vous vous livrez à des mésaventures dont vous serez le<br />
seul à en supporter les conséquences (CH 47). Cependant, il est une occa-<br />
sion où les frères ne se trompent point, où ils sont solidaires c'est<br />
quand l'un deux décède. Les congénères du clan, ceux de la grande famille<br />
vaquent sans inquiétude à leurs occupations habituelles. Pour camoufler<br />
leurs comportements,les uns prétextent qu'ils vont faire des commissions<br />
pour leur femme, d'autres affirment qu'ils vont chercher des médicaments<br />
aux champs. Les premiers vont à leur commerce, les seconds vont labourer<br />
leur champ, pendant qu'un corps est allongé sans vie. Seuls les frères,<br />
les soeurs s'affairent autour de lui, lui donnent les derniers soins et<br />
le mettent dans sa dernière demeure (CH 85). Mais le mort n'est pas dupe;<br />
il sait que certains sont allés à lui avec de vrais sentiments fraternels,<br />
et que la sollicitude des autres à son égard est dictée par la mortelle<br />
honte qu'ils éprouvaient pour n'avoir pas enterré leur mort. Il ne doute<br />
pas des négligences qu'on pourrait mettre à creuser son tombeau, des omis-<br />
sions qui pourraient se glisser dans l'accomplissement des cérémonies funè-<br />
bres. Mais la présence de son enfant, de ses enfants efface toutes ses<br />
appréhensions.<br />
H<br />
Dé é a ji è + wi nyi towé/ = n'est vraiment ton enfant que celui que tu<br />
•<br />
,u<br />
as engendre. Cette autre vision de la famille soulève en nous
- 94-<br />
des questions. L'homme est-il donc seul sur la terre? N'a-t-il personne<br />
à qui faire confiance? Le chant populaire nous rassure. L'enfant est le<br />
compagnon de l'homme. Comme la liane d'igname repose sur son tuteur, ainsi<br />
le fils et le père reposent l'un sur l'autre. L'importance de l'enfant pour<br />
les parents est remarquable lorsque ces derniers vivent leurs vieux ans.<br />
Elle est telle que celui qui n'a pas d'enfant doit tout mettre en oeuvre<br />
pour en avoir. La quête d'enfant chez certaines personnes, lorsqu'elle<br />
aboutit, se traduit dans le nom que l'on donne à l'enfant: /Babodji/ =<br />
" désiré. ' " Mais d'un désir ardent qui implique souvent des sacrifices aux<br />
dieux, aux ancêtres, parfois, une conversion a une société fétichiste.<br />
Que ne peut-on donc pas faire pour avoir un enfant ?<br />
La tentation serait de faire confiance aux enfants de son frère,<br />
de ses frères et soeurs si on n'en avait pas soi-même. Mais un enfant<br />
d'autrui ne peut jamais prendre soin de vous comme le vôtre propre. Le<br />
riche sans enfant mène une vie tronquée. Ses richesses, ses habits, ses<br />
parures ne valent pas le petit doigt d'un enfant. S'il y avait un marché<br />
aux enfants, le riche s'en achetèràit sûrement, mais il n'yen a pas. Aus-<br />
si,passe-t-il de tristes vieux jours. L'enfant apparaît doncCJmme la seule<br />
et unique richesse du pauvre. Il est, comme écrit Honorat AGUESSY : "la<br />
suprême récompense de la vie."(1)<br />
(1) Honorat AGUESSY,"Tradition orale et structures de pensee Essai<br />
méthodologique",in Cahiers d'histoire mondiale,Vol.XIV N° 2, 1972,<br />
Page 270.
_100 _<br />
Au meme moment, la touterelle son amie, triste elle aussi par<br />
ce temps morne, développe sa philosophie. Le paysan sourit et sa solitu-<br />
de s'estompe car, se dit-il, en voilà un qui comme moi attend un tout<br />
petit rayon de soleil.<br />
/sè / dans la région représente le destin responsable de la des-<br />
tinée. Chaque homme possèderait son /Sè/ ou /Joto/ que nous assimilons à<br />
l'ange gardien (c'est l'équivalent du "CHI" des Ibo dans le monde s'effon-<br />
dre de Chinua A.) ./sè/serait le quasi-double de l'homme qu'il protège;<br />
tout ce qui lui arrive échoit en contre-partie à son protégé; et chacun<br />
de nous assiste impuissant à son bonheur comme a son malheur. L'associa-<br />
tion/sè/ - /Gbè/ donnerait la Providence chrétienne ou plutôt le hasard<br />
en terme païen. Existe au-dessus de tout cet engrenage un programmateur<br />
universel : /Mawu / = le dieu suprême, créateur de toutes choses; par-<br />
fois, on l'appelle /Dada Sègbo/ = le plus grand parmi les /sè/.<br />
Au terme de cette étude, le Wémènu paraitrait bloqué par la<br />
destinée. La psychologie d'homme déterminé(CH 80) l'empêcherait d'envisa-<br />
sager l'avenir avec optimisme; de ce point de vue, on pourrait être tenté<br />
de le prendre pour un esprit improgressif entièrement rivé au présent. Le<br />
chant populaire nous donne l'assurance du contraire.<br />
Certes, il a conseillé à l'homme de s'armer de résignation dans<br />
les adversités, mais une résignation doublée de patience qui fait espérer<br />
des lendemains charmants. " Patience, patience, ayez tous de la patience;<br />
11<br />
tant que la terre tourne, la roue tournera toujours, et il n'y a pas de<br />
raison qu'elle ne s'arrête a chaque homme (CH 69 & CH.70). La perspecti-<br />
ve d'un bonheur inévitable apparait comme un facteur de galvanisation
- 101 -<br />
des esprits, faisant du Wémènu un homme résolument tourné vers l'avenir.<br />
Il prend en charge sa vie, lui inflige une direction. Pourquoi l'expérien<br />
ce ne partirait-elle pas de lui pour aboutir à ISè 1 ?Il s'insurge alors<br />
contre cette destinée dirigée de là-haut. Mais les arguments du hasard<br />
s'abattent sur lui comme des massues (la pluie qui ne tombe pas entraîne<br />
la sécheresse qui, a son tour, détruit les semences) et finissent par dé<br />
courager ses velleïtés d'une libération immédiate. Il ne se résigne pas,<br />
il espère plutôt que son tour arrivera.<br />
Dans une autre rubrique, le destin se sert le plus souvent d'a<br />
djuvant humain pour atteindre les hommes. La femme paraît l'adjuvant par<br />
excellence du destin. Dès qu'elle aime un homme, sa chance ou sa malchance<br />
se porte sur lui. La vision de la femme dans le chant populaire passe par<br />
deux images opposées l'une à l'autre.La première image, celle qui est con<br />
sidérée comme positive par le Wémènu, tracée tout en filigane, fait l'apo<br />
logie de la femme-épouse et mère. La femme tout court n'est pas encore la<br />
femme dont l'exemplarité serait parfaite; il faut qu'elle soit épouse et<br />
mère.De ce point de vue, elle a droit au respect de toute l'humanité dont<br />
elle est la génitrice. Prendre soin du ménage (/za xomèl = balayer la mai-<br />
son, Izé zin bo yi toi = prendre la jarre et se rendre à la source) est<br />
l'une de ses tâches essentielles. La société la dispense de travaux rudes;<br />
car, elle ne possède que sept paires de côtes alors que l'homme en compte<br />
neuf. La faiblesse, la fragilité et la finesse de la femme proviendrait de<br />
cette différence quelque peu sentie comme une imperfection. Cependant, la<br />
ruse, un des atouts .du sexe,vient effacer cette tare. Le chant populaire
- 1()2 -<br />
ne propose pas un portrait exhaustif de la femme; il s'est intéressé aux<br />
aspects saillants qui ont caractère de défaut et que la femme pourrait.<br />
corriger. Le mariage devrait être une entreprise bénéfique aux conjoints;<br />
il devrait être porteur d'épanouissement et de rayonnement. Mais ce n'est<br />
pas souvent le cas. Certains traits de caractère de la femme y font sou<br />
vent obstacle : un désir effrené de libération du joug du mari, le goût<br />
de l'aventure manquant ainsi aux règles traditionnelles de l'épouse do<br />
cile et fidèle, la coquetterie qui fait d'elle un réceptacle de toutes<br />
les influences. A ce niveau, le chant populaire distingue dans Wémè<br />
deux catégories de femmes: les mères comme à l'ancienne, dépendantes<br />
à tous points de vue du mari. Elles n'ont pas de sources de revenus. Les<br />
femmes en voie d'émancipation (une minorité dans la gent féminine), dé<br />
tiennent un commerce, se suffisent à elles-mêmes financièrement et, par<br />
conséquent, se passent de la présence écrasante du mari. Cependant, sub<br />
siste en elles un arrière petit goût de dominées; cette attitude expli<br />
que parfois des heurts violents motivés par la suspension par le mari<br />
de la pension alimentaire due aux enfants. La femme estime souvent dans<br />
ces cas-là que chacun porte le nom de son père, et doit être nourri en<br />
priorité par lui; la mère apporte des agréments supplémentaires. Alors<br />
de dispute en dispute, on en vient au divorce.<br />
La région a connu une vague de divorces dans les annees cinquan<br />
te. Ce fut l'une des fois où la femme fut perçue comme un objet. En effet,<br />
pour tous les divorces, on se rapportait au tribunal de concialiation qui<br />
siégeait tous les jeudis à Adjohon.Jeudi en wémègbé se dit/nyonnunzangbé/=
- 103 -<br />
le jour de la femme. Ce jour-là donc, la société a décidé de ne parler que<br />
de la femme. Lorsque les futurs divorcés se présentaient au tribunal - la<br />
femme accompagnée de son nouvel-époux, l'ex-époux entouré de ses amis et<br />
parents - le président du tribunal donnait la parole à l'ex-époux. Celui<br />
ci énumérait souvent avec parcimonie tout ce qu'il avait dépensé pour son<br />
ex-femme; le tribunal décidait du dédommagement que devait lui apporter le<br />
nouvel époux; c'était souvent des sommes lourdes pour l'époque. Pourtant,<br />
l'on faisait la queue pour divorcer ou pour prendre femme. Car, les hommes,<br />
au lieu d'être découragés de l'entreprise de suborner les femmes d'autrui,<br />
s'imposaient parfois d'immenses sacrifices pour parvenir à leur fin: mise<br />
en bail du patrimoine, ou même vente définitive des biens. Le chant popu<br />
laire relatant le divorce, chant célèbre dans Wémè, parut vers les années<br />
1955-1956. Il dénonce l'instabilité des femmes, la perversité des hommes.<br />
Il fustige ces défauts avec humour; on y sent une intention délibérée de<br />
corriger la nouvelle habitude en la ridiculisant.<br />
(CH 15) La vie doit-elle continuer sur ce train?<br />
Oh ! que l'on vienne nous en délivrer.<br />
Les choses doivent-elles toujours aller ainsi ?<br />
Moi, Ladé, je souhaiterais qu'on nous en délivre.<br />
Car, si la vie doit toujours continuer sur ce train,<br />
Il faudrait que quelqu'un nous en délivre.<br />
Réunissons- nous et parlons-en.<br />
Peut-on estimer une dot à Quarante mille francs ?<br />
On devrait s'asseoir et en discuter.
- 104 -<br />
Jusqu'à Adjohon, ma muse s'est efferte une promenade.<br />
Afin d'assister au verdict d'une conciliationmanquee.<br />
Un génie, Aziza,s'en est allé à Adjohon<br />
Afin d'assister à un verdict de divorce.<br />
Là, je vis un natif et originaire de Saoro;<br />
Cet homme était venu de Saoro, il avait pris<br />
Lorsqu'il parut à la barre,<br />
femme.<br />
Laminou, le chef de canton, supputa la somme de sa dot ,<br />
Lui et ses notables statuèrent une importante somme d'argent.<br />
Le marié paiera à peu près Quarante mille .francs.<br />
Dès qu'il fut hors du tribunal,<br />
Il se mit à courir_)<br />
Et pendant qu'il s'enfuyait, le pénis lui cria d'entre ses<br />
jambes :<br />
"Je m'en lave les mains<br />
Mon ami, tu est allé chercher noise, supportes-en les consé-<br />
quences.<br />
Moi, ce n'est pas pour la femme que le grand artiste m'a<br />
placé où je suis, sous les vêtements.<br />
Et ce n'est sûrement pas pour une epouse que j'ai daigné<br />
t'accompagner à Adjohon."<br />
En vérité, le pénis, ce jour-làJn'était pas plus gros qu'un<br />
index;<br />
Il s'était retracté par frayeur.<br />
L'épouse scruta autour d'elle et ne vit aucun des siens.<br />
La mariée tourna la tête et ne vit aucun des siens.
- 105 -<br />
Car toutes les tantes avaient déjà pris le large,abandon<br />
nant leur belle-soeur.<br />
Le presume beau-père lui-même voulut prendre la fuite;<br />
Il s'avisa dansSOn entreprise de passer entre deux cases.<br />
Son pagne de percale se prit malencontreusement dans une pou<br />
trelle;<br />
La besace elle-même s'erwola de ses côtés.<br />
"Ce mariage nous fera brader notre maison !<br />
Allons nous prendre femme en vendant nos terres ?<br />
Mon lopin de terre que j'ai vendu!<br />
Mon immense palmeraie sise à abidomè<br />
Allons-nous vendre une palmeraie afin de nous marier ?<br />
Et si la femme vient s'installer a la maison, il faut bien<br />
qu'elle mange.<br />
Allez donc vous faire voir ailleurs avec vos histoires de<br />
1)<br />
mariage.<br />
Les raisons primordiales qui motivent la recherche de femme<br />
chez l'homme,<br />
L'homme ira aux champs;<br />
De retour au logis, il fera la cuisine,<br />
Puis il prendra un balai _pour balayer sa case '",<br />
Enfin, jarre sur la tête, il ira à la source.<br />
Voilà les raisons primordiales qui motivent la quête de la<br />
femme chez l'homme.<br />
Vous les hommes, vous êtes turbulents et pervers.
- 101-<br />
Uma we nyanlo do tonlon hwèxwègbé +<br />
Nyanlo tonson hwèxomè bo jè koxo +<br />
Dé é na nyannè ka bè wézun +<br />
0<br />
Onè éton non samè bo do ce ma démè 1<br />
co<br />
Ovi a ba mèdé xo hun bo kpon é go +<br />
0<br />
Mi ma ton assigbé bo dé avomè 1<br />
0<br />
Omi ma ton yaogbé bo wa Ajohon +<br />
Ogbennègbé nékuin ma so alovi +<br />
Oxèsi wè nèkuin ka wa di do gbennègbé 1<br />
.. 0<br />
Yao lè ko + bo yao dié ma mon mèton dékpédkpé +<br />
0<br />
Yao lè ko bo + yao dié .. ma mon méton dékpékpéé<br />
CI<br />
E lè ko bo yao lè ma mon mèton +<br />
Otannyilè bi ko hon<br />
bo jo yao<br />
Omèé nyi asuto losu to na hon +<br />
1<br />
dol<br />
Dé .. e ka to na hon bo gbon xovlanmè +<br />
Bo dida ala éton jan do kpogènu 1<br />
.. '"<br />
Agolokan losu ma,so non akpa +<br />
Mi na da ahwannyonnu bo na sa xwe +<br />
Omi na da ahwannyonnu bo m sa ayi a (?)<br />
Ogélécé kpèvi é na nyen ze sa +<br />
Dékan daxo é do Abidomè +<br />
•<br />
Mi na sa dékan bo do da nyonnu (!)<br />
Onyonnu wa xwézin bé nu e na du +<br />
Q<br />
..<br />
Mi yi mon ridé mi 10 gbon kpo asuxo kpo 1<br />
..
- 114 -<br />
Tu as tué une jeune fille, dis-tu ?<br />
Occupe-toi de cela donc;<br />
Ne le susure même pas à mes oreilles.<br />
Ah ! elles sont allées manger nabobo",<br />
Je poursuivis ma course, essoufflé.<br />
J'accostai ma mère, je lui narrai mon forfait;<br />
Le coup de feu que je viens de tirer,<br />
A étendu raide mort un homme dans les hautes herbes.<br />
"Quoi donc !, s'écria ma mere;<br />
Qu'es-tu allé faire dans cette clairière?<br />
Si tu as vraiment assassiné quelqu'un,<br />
Va t'en occuper;<br />
Ton honorable père a vécu dans ce pays<br />
Il n'a tué personne que je sache.<br />
Tu as abattu un homme, fais-en ce que tu veux."<br />
Je repris ma course, je me ruai chez mon pere.<br />
"Papa, as-tu entendu un coup de feu, il y a un instant?<br />
C'était moi, et j'ai abattu un homme."<br />
"Comment donc? Quelle guêpe t'a piqué?<br />
Moi ton père, j'ai vécu dans ce pays<br />
Je ne me suis point souillé de sang humain;<br />
Qui t'a conseillé ce coup-là<br />
Assasin, va démêler tout seul ton forfait.<br />
Ne le raconte plus à mes oreilles, je suis sourd".<br />
Je me remis aux trots pour aller raconter ma mésaventure a mon<br />
ami
- 118 -<br />
Les faux amis eux aussi se recrutent parmi les Camarades. Ils<br />
gravitent autour de nous, font les empresses tant que la porte qui mène<br />
a nos richesses leur est ouverte. Que notre fortune vienne à se volati<br />
liser, les voilà partis, dispersés. Ils nous méconnaissent et nous aban<br />
donnent à notre nouveau sort. D'autres Camarades, au lieu de jouer aux<br />
empressés, d'en vouloir à notre fortune, en veulent à notre personne<br />
(CH 98). Ils cherchent notre "mort", et par conséquent, font des pieds et<br />
des mains (sacrifices aux voduns, gris-gris, sortilèges etc••• ) pour que<br />
nous conaissions toujours l'insuccès dans nos entreprises. C'est le thè<br />
me de "la persécution sociale" communément désigné dans la langue par<br />
les "ennemis" /kintolè/. Nous pensons tous avoir nos ennemis, des gens<br />
qui nous en veulent parce que nous avons réussi, ou que nous sommes en<br />
passe de réussir notre vie. Ce thème a été exploité par des auteurs afri<br />
cains dans leurs oeuvres: nous citons ici pour mémoire l'oeuvre d'ABD<strong>OU</strong><br />
<strong>LA</strong>YE Sadji, Maïmouna (1); le personnage thématique, Maïmouna, est partie<br />
de sa brousse de Louga rejoindre sa soeur-aînée, Rihana, mariée avec un<br />
haut fonctionnaire des cadres à Dakar. Mais la bonne de sa soeur, jalou<br />
se de sa nouvelle situation, concourra a sa perte. Et Mai retournera à<br />
Louga, non seulement victime de la ville, mais surtout victime de son<br />
"ennemie", la bonne de sa soeur.<br />
Le chant populaire préconise un remède efficace pour déjouer<br />
la rouerie, le jeu malfaisant des envieux, des ennemis la méfiance .<br />
Chacun, semble-t-il, devrait s'enfermer dans sa bulle, y démeurer avec.un<br />
(1) ABD<strong>OU</strong><strong>LA</strong>YE Sadji, Maïmouna , Paris :·Présence africaine, 1958.
- 119 -<br />
ou deux amis, ses enfants et sa femme, (CH 50). Cette éthique de vie<br />
s'oppose radicalement à la conception wemeenne de la famille, de la<br />
grande famille où les oncles, les tantes, les neveux, aussi nombreux<br />
que divers, aussi éloignés que proches, doivent équitablement bénéfi<br />
cier de notre attention. Pourtant, dit le chant récréatif, ce sont<br />
ceux-là qui nous jalousent et cherchent le plus souvent notre "mort",<br />
(CH 86). La psychose des "ennemis" ! Une attitude qui alimente toute<br />
la vénération que le Wémènu porte aux "Bokonons", un groupe social qui<br />
propose des remèdes contre les assauts des ennemis. Dans MaÏIDouna(1),<br />
le marabout Thierno, un homologue du bokonon dans une sociétéislami<br />
sée, annonce au personnage qu'elle est le jouet de la jalousie et lui<br />
envoie des talismans pour la protéger contre toute attaque.<br />
Montrant cette faiblesse du peuple, la peur des ennemis, le<br />
chant populaire tend à l'exorciser, l'exclure du sentiment collectif<br />
ou à l'y maintenir en l'épurant. C'est une action. Et c'est le lieu de<br />
dire que le chant populaire" est lui aussi un comportement, une action,<br />
c'est-à-dire qu'il vise à l'efficacité"(2). Cela se comprend aisément<br />
dans la mesure où le fondement du genre se trouve dans la parole,et<br />
la parole est parfois synonyme d'action, d'entreprise. En guise de con<br />
clusion à létude de l'esprit humain, le chant raconte une histoire;<br />
celle d'un jeune homme atteint comme tous ses congènères de cette psy<br />
chose de l'ennemi. Il s'en rapporte à un devin qui lui indique la<br />
vraie source de ses maux, de ses insuccès: le Destin = /Sègbo/.<br />
(1) Op. Cit.<br />
(2) J. JAHN, Muntu : L'homme africain et la Culture néo-africaine,<br />
traduit de l'allemand par Mr Brian, PariS' ':Seuil, 1971" page 262 ..
- 123 -<br />
correspondent un conte et sa chanson, un mythe et sa chanson. Ces élé-<br />
ments sont didactiques. Leur usage dénote d'un certain intellectualis-<br />
me, d'une certaine culture, d'une sagesse admirable. On se réfère à<br />
cette sagesse antique lorsqu'on est plongé dans des situations où<br />
l'on recherche une issue. Cependant, la part du récit est importan-<br />
te dans cette actualisation. A supposer un instant que l'interlocuteur<br />
ne connaisse pas le récit servant de support à la chanson qu'on lui li-<br />
vre, il faudrait bien qu'il comprenne, et souvent, il ne le peut qu'à<br />
la lueur du récit.<br />
(CH 18) Cauris, ma fille Cauris.<br />
Je serai bien fortunée.<br />
Oh ! Perle, ma fille Perle;<br />
Ma fortune sera grande.<br />
Oh ! ma bien-aimée Fer,<br />
Je serai bien heureuse.<br />
Cauris décide d'épouser un blanc,<br />
Je serai bien fortunée.<br />
Perle choisit un homme de Nago,<br />
Quel bonheur pour moi<br />
Fer choisit un Toso<br />
J'en serai ravie.(l)<br />
(1) Akwè é 10 + adimèvicé Akwè +<br />
()'<br />
E na nyon na mi jan /<br />
Ojè é 10 + adimèvicé Jè +<br />
#<br />
E na nyon na mi jan /
126<br />
Qui connait la génèse ?<br />
Quel homme connait la génèse de Jésus?<br />
Celui qui la connait vraiment,<br />
Qu'il approche et nous la raconte.<br />
Le Christ a créé Maria.<br />
Le Christ a créé Maria et l'a envoyée sur terre:<br />
Pure d'esprit et de corps.<br />
Elle portait déjà en elle le germe de son enfant.<br />
Nombreux sont les miracles de Jésus;<br />
Innocente vivait Maria,<br />
Aucune pensée mauvaise ne l'a hantée,<br />
Et elle est tombée enceinte.<br />
Lorsque vint le jour de la délivrance,<br />
Lorsqu'arriva le jour de la naissance du Christ,<br />
Le jour venu, dans une étable, on lui donna la vie.<br />
Quel vodun peut agir ainsi ?<br />
Quel vodun peut jamais se comporter ainsi?<br />
Fabricants et adorateurs d'esprits,<br />
Changez de voie.<br />
Vous qui avez entendu parler du christianisme,<br />
Et qui vous ententez à adorer les vodun,<br />
Tôt ou tard, vous tous, vous vous convertirez au christianisme(1)<br />
(1) Mèdé mon klétien dé ayi +<br />
o 0<br />
Bo wa fon bo
- 128, -<br />
Viennent enfin dans cette catégorie des fêtes adoptées les<br />
fêtes dites civiles: le nouvel an, la fête de l'indépendance, et<br />
toutes les autres fêtes de toutes les "libérations nationales". Seules<br />
les chansons de nouvel an sont dignes d'intérêt et particularisent la fête.<br />
En effet, le nouvel an est perçu comme un renouvellement de<br />
la personne; elle acquiert au cours de ce renouvellement des droits nou<br />
veaux, plus de liberté ; ces acquis font d'elle un être épanoui qui,<br />
tout au long de l'année nouvelle, ira de réalisation en réalisation.<br />
Oh à cette occasion où chacun formule des voeux immenses, le Wémènu<br />
ne demande pas grand chose : la santé et la prospérité. Le chant de nou-<br />
vel an le plus célèbre que l'on connaisse dans la région a paru en<br />
1972. Il traduit les libertés de l'homme et ses réalisations: l'un se<br />
propose d'aller voter en trois endroits différents pour trois personnes<br />
différentes; l'autre se propose d'acheter une bicyclette. Libération<br />
de la politique politicienne et du régionalisme, vie tranquille et<br />
heureuse, voilà des aspirations simplement exprimées et qui rendent vrai<br />
ment compte du tempérament des habitants de la région.<br />
(CH 97) L'année nouvelle<br />
Qui saura qui nous sommes ?<br />
Quel homme pourra découvrir notre vraie identité ?<br />
Nous sommes dans l'année nouvelle, nous vivons en 1972;<br />
Et, moi, je souhaite vivre pleinement ma vie avant de mourir.<br />
Comme tu sais te faire beau Tu as l'art de te faire belle?
- 133 -<br />
porter sur la tête jusqu'à la mort. Mais voilà que la vie a ses lois.<br />
Il faut travailler pour vivre. Paysan, le ISol ne peut plus rien ramener<br />
de ses champs; il lui faut payer des portefaix, alors que déjà les<br />
récoltes ne sont pas abondantes. Il est souvent menacé par la pauvre<br />
té. Ici le ISol manifeste ses velleïtés de se défaire de sa charge,<br />
de quitter son-fétiche et d'aller se faire portefaix lui-même afin de<br />
manger a sa faim. Vastes métaphore et allusion que ses confrères com<br />
prennent immédiatement; alors, ils lui donnent la réplique en chantant<br />
les conséquences de son projet insensé. Ils prétendent que IAkplogan/,<br />
le Ministre du culte/demande que l'on décapite tous ceux qui s'éloigne<br />
raient des voduns. Alors, le contestataire rapplique aussitôt (CH 98).<br />
Mais IWa nul : faire la chose, célébrer, ne s'applique pas seu<br />
lement aux cérémonies fétichistes: la périphrase désigne aussi les re-<br />
jouissances qui marquent les grandes funérailles. En effet, depuis des<br />
mois, l'âme du défunt erre attendant l'occasion de se présenter à ses<br />
ancêtres. Mais pour être reçue, il lui faut leur donner à manger. Et<br />
son rang parmi eux sera d'autant plus prestigieux que ses fils lui au<br />
ront organisé de pompeuses funérailles. Ce jour d'intégration du défunt<br />
au groupe de ses' ancêtres est perçu comme un jour de joie,un jour de ré<br />
jouissances par excellence. On y entend toutes sortes de chansons excep<br />
té les chants sacrés. Nous proposons ici un exemple afin de donner au<br />
lecteur une idée de la diversité des chansons qu'on peut entendre :<br />
(CH 21) Le piment ne fait pas bon menage avec'le vagin.<br />
L'eau du) rinçage des mains est incompatible avec ce vagin<br />
venu d'Aja.
- 138 -<br />
que se rencontre le totémisme. Les /hinnu vodun/ ou totems revêtent une<br />
importance particulière, influençant l'organisation sociale et politique<br />
des clans, du pays. Ils introduisent une hiérarchisation sociale rigou<br />
reuse et déterminent les calendriers des jours fastes et néfastes, par<br />
fois des jours de marchés de villages. C'est dans et par les fétiches<br />
que se justifie l'existence des prêtres et prêtresses :/vodunsi, hunyo<br />
et dah/ et celle d'une certaine catégorie de /bokonon/.<br />
Les prêtresses et les prêtres, comme nous l'avions rappelé<br />
au chapitre l, pour être sacrés aux divinités, forcent le respect pu<br />
blic, et ils y ont droit. Nous connaissons les méthodes d'exclusion<br />
dans nos sociétés africaines. La plus familière dans la société qui<br />
nous concerne est l'interdit. On n'a pas le droit de parler de tout<br />
dans n'importe quelle circonstance, ou d'appeler les noms de certains<br />
objets à certaines heures de la journée: : ce sont des tabous de la pa<br />
role ou des objets .. Déroger aux tabous déclenche une réaction sociale<br />
immédiate. Et, en ce qui concerne la personne sacrée des prêtres, leur<br />
manquer du respect met en "rage" toutes les congrégations : c'est pren<br />
dre la "rage" ou / so man/, /jè man/. On classe les interdits sous deux<br />
rubriques selon qu'ils sont rigoureusement observables par le peuple, le<br />
commun des mortels ou par les préposés au culte eux-memes. Le code du res<br />
pect dû aux prêtres s'ordonne comme suit :<br />
- ne pas appler l'ancien nom du prêtre.<br />
- Eviter de l'injurier, surtout de le traiter de fou;<br />
ne pas le frapper à la tête : la tête étant habitée par la<br />
divinité.
- 143-<br />
prêtre de ce moment-là décida qu'on lui ferait honte en divulgant<br />
son forfait. Cela fut fait. On cria partout que les deux sacrilèges<br />
ont fait l'amour selon la mode d'Aja, /Ajayo wèyé wa/ et un bâtard<br />
en sera le fruit. Aussi, tout profanateur, tout sacrilège est-il<br />
assimilé à un bâtard.<br />
(2) ADANDE (A.), "Un rite expiratoire<br />
N° 58 Avril 1953, page 43.<br />
orna ", in Notes Africaines,
A l'aide<br />
- 150 -<br />
de ces exemples, nous pouvons dégager les images wemeen-<br />
nes de la vie et de la mort. La vie est un "quelque chose" qui fait que<br />
l'homme est ce qu'il est, c'est-à-dire jouissant pleinement de ces capa-<br />
cités et accomplissant sans grand obstacle sa destinée. La mort, c'est<br />
aussi un "quelque chose" qui anéantit l'homme matériellement et le fait<br />
surgir dans le regne de l'esprit. Ce quelque chose dans le sens de la<br />
vie représente une force bénéfique, une vertu et dans celui de la mort,<br />
une force maléfique, destructrice/aveugle. On est vivant lorsqu'on jouit<br />
de toutes les capacités humaines ou lorsqu'on exerce toutes les fonc-<br />
tions humaines. Si l'une ou l'autre capacité vient à défaillir, on mene<br />
une vie tronquée a mi-chemin entre la vie et la mort. Aussi, entend-on<br />
souvent a propos d'un homme : lé dé gbé a 1= il n'est pas vivant, il<br />
Q<br />
est mort(entendez qu'il est impuissant). Incapable de participer, a<br />
cause de son infirmité, à l'oeuvre de la procréation, une fonction hu-<br />
maine, l'impuissant ne vivrait pas .pleinement sa vie. Et le chant po-<br />
pulaire exprime cette réalité cuisante avec humour :<br />
(CH 25) On conduit une femme chez un impuissant)<br />
Il s'enferme dans sa case et hurle.<br />
On amene une jeune épousée à un impuissant,<br />
Il s'enferme dans sa case et s'écrit:<br />
Mais que puis-je donc faire à ce vagin?<br />
y plonger la main et m'enduire la tête?<br />
Mais que puis-je faire à ce vagin d'aja ?<br />
y plonger la main et lécher. (1 )<br />
(1) Yé kpalan nyonnu yi na ahwankunon + é bio xomèbo dax I.;a e 1<br />
Ani un na yi wa na ajayo é 10 (?) Dalomè bo sa do tal<br />
Etè un na yi wa na ajayoélo (?) Dalomè bo didol<br />
• •
- 151 -<br />
Cette pièce 'traduit toutes les craintes et tous les états d'âme<br />
de l'impuissant devant le sexe opposé. Et lorsque des tracaseries vien-<br />
nent troubler la vie, on dit qu'on vit mal. L'impuissant vit mal, il<br />
est mort.<br />
La mort dans le chant populaire.<br />
Des sentiments divers composent le thème de la mort. Et la lan<br />
gue et le chant populaire s'accordent sur ce plan.<br />
a) La mort comme un voyage<br />
Le Wémènu perçoit la mort comme un voyage. Une première vie s'ar<br />
rête sur terre tandis qu'une autre commence dans le royaume des esprits.<br />
Ce voyage conduit à IKutomèl ou INugbo1otin/, séjour présumé des morts,<br />
des ancêtres. Le défunt n'y entre que lorsque toutes les cérémonies ont<br />
été convenablement accomplies par les vivants. Seul le type de mort dé<br />
termine les cérémonies. Une première mort, celle que souhaite tout le<br />
monde, est un aboutissement naturel de la vie: la mort par la vieil<br />
lesse ou par décrépitude. On dit de celui qui cannait une telle mort<br />
qu'il est allé à la maison/ e yi xwé/. Le second type de mort est acci<br />
dentelle parle fer, l'eau, le feu, les accidents du travail, de circu<br />
lation, une mort brutale, foudroyante et "chaude", qui vient faucher un<br />
homme, une femme, un enfant, un jeune homme. On dit alors que la vic<br />
time est morte de la mort du dieu/GU/, patron de la forge; lé ku gukul<br />
mais aussi lézin alo do afinmèl = il a plongé la main dans de la cendre<br />
(la braise ardente de la forge de Igul = Vulcain). Enfin, on peut mou<br />
rir par la méchanceté des sorciers. Aucune des chansons du répertoire<br />
ne parle du personnage tant il est craint.
- 155 -<br />
C'est bien fini a présent.(1)<br />
L'un des temps forts du voyage se situe au début, au moment du<br />
départ. 'Ceux qui restent disent leurs adieux au partant et vice-versa.<br />
Les vivants, eux, expriment divers sentiments au moment de cette sépa-<br />
ration 'douleureuse, mais le mort non. Aussi, les vivants prennent-ils<br />
le rôle du mort, l'animent et lui prêtent la parole. Le chant d'adieu,<br />
supposé chanté par le mort lui-même, est chargé de significations ,et<br />
met en relief les caractères de l'état. Se comparant.à un fluide, un<br />
fleuve en l'occurrence, il s'observe en train de couler dans un sens.<br />
A-t-on jamais vu un fleuve couler vers un point quelconque en amont?<br />
Ainsi partIe défunt et ne revient point le même. Une certitude sou-<br />
lage le mort, la mort n'est pas une honte, entendu que tout le monde<br />
y passera. Et la mort elle-même, qu'est-elle? Un caïman qui ne boit<br />
jamais l'eau de la rivière de refuge mais la rosée. La mé taphore est<br />
forte qui explique les rôles respectifs : la mort entre en comparai-<br />
son avec le caïman; ce dernier sort du fleuve pour boire la rosée.<br />
La mort ne tue plus ceux qui sont déjà morts et qui font partie de<br />
son milieu naturel, mais elle remonte des enfers chercher les vivants<br />
qui jouent pour elle exactement le même rôle que la rosée joue pour<br />
le caïman.<br />
(CHA 29) Adieu<br />
Le fleuve s'en va, coulant.<br />
(1) Hansaé +yokpo noncinu + éko vo nè /Ho 0 ka + dahun .. adogbanu +<br />
E ko vo nè/Anhan ahan+ ahan + e ko vo nè/<br />
Ya é na vinèlè ji do gbè é mè +<br />
•<br />
E ko vo nè /
- 160 -<br />
Hormis cet état de siège que le Wémènu observe à l'encontre de la mort,<br />
qu'aurait-il fait si la mort avait été une réalité palpable? Si elle<br />
àvait été une guerre périodique, le roi IHwézé/, le protecteur des Wémè<br />
nus, serait allé à sa rencontre et l'aurait vaincue définitivement, sup<br />
primant ainsi la source des maux de ses protégés; si elle avait été une<br />
fauve, le grand chasseur ILuvè/l'aurait traquée et tuée(CH 79). A sup<br />
poser un instant que l'assistance du roi et du chasseur défaille, le wé<br />
mènu étant courageux, il irait lui-même combattre cette guerre, cet hom<br />
me, affronter cette bête sauvage avec des esclaves qu'il achèterait pour<br />
la circonstance. Mais la mort n'est rien de tout cela. Mais alors, c'est<br />
un marché! dans ce cas-là, le cauris (l'argent) peut se faire le plus<br />
rare possible, l'homme irait tout de même le quérir et s'en servirait<br />
pour racheter les dépouilles de son défunt. Mais la mort n'est pas un<br />
marché.<br />
(CH 32) La mort aurait été une guerre, un homme,<br />
L'enfant de (X) achèterait des hommes,<br />
Les enverrait les combattre.<br />
Elle aurait été une guerre,<br />
Voyons, c'est le tour de ma maison,<br />
Mais veiller sur une tombe n'est pas deviser sous une cabane.<br />
L'enfant de (X) aurait acheté un homme<br />
Et l'y aurait envoyé.<br />
La mort aurait été un marché,<br />
Tenez! qu'un cauris se transforme en haricot et qu'il bourgeonne<br />
A ce moment-là, l'enfant de (X) achèterait les dépouilles d'un<br />
homme.
- 164 -<br />
a) Les chansons phobiques ou d'adversité.<br />
la psychose de l'ennemi, un trait psychologique du Wémènu<br />
et peut-être une très grande susceptibilité sont certainement à l'ori<br />
gine de ces chansons. Exarninée de près, la phobie n'est pas un thème<br />
étranger et développé par le chant populaire pour lui-même. Elle re<br />
présente une cause et engendre des effets. Elle-même a une cause. Les<br />
chants populaires sont ses effets. A cet égard, nous pouvons distin<br />
guer deux sortes de phobies profanes(nous disons bien profane dans<br />
la mesure ou IOmanl représente une phobie sacree ): IAtèl ou phobie<br />
suscitée par l'émulation entre deux ou plusieurs groupes sociaux; on<br />
la rencontre souvent entre les associations de tarn-tarn. Deux quar<br />
tiers ,d'un même village ou deux villages ont-ils inventé ou adopté<br />
chacun de son côté un même tarn-tarn, ils s,'cpposent aussitôt l'un à<br />
l'autre. C'est à qui exercera le mieux son art, c'est à qui rassem<br />
blera le plus de "fans" afin d'évincer 'l'autre. Ce genre de phobie<br />
a pris naissance au cours des luttes qui opposaient autrefois les<br />
villages, ces luttes qui étaient des "jeux olympiques " en miniature.<br />
"Les villages rivaux s'excitaient en se dénigrant d'abord par la<br />
parole puis par la chanson. Chacun s'échauffe de son côté et lorsque<br />
le choc se produit, c'est tout comme si la lutte faisait rage depuis<br />
des heures. IAtèl au niveau des tarns-tarns a récupéré la pratique, les<br />
luttes entre villages n'étant plus pratiquées. On se dénigre et cela<br />
dure "tant et tant que l'une des associations capitule.On dit alors que<br />
IAtè/l'a fait sombrer. Ces chansons foisonnent dans la région,/Atèl<br />
étant une coutume populaire.
- 165-<br />
(CH 34) Auriez-vous tous envie de pratiquer Kpoji ?<br />
Lorsque j'appris votre intention, j'en ai ri.<br />
Dès que sonneront douze heures, rendez-vous a Oussa.<br />
Auriez-vous tous envie de pratiquer kpoji ?<br />
Oreilles de chauve-souris, joues démesurément gonflées.<br />
Auriez-vous envie de pratiquer kpoji ?<br />
Soyez présents et nombreuxQ(1 )<br />
Le second cas de phobie s'observe dans les foyers. Le théâtre<br />
de prédilection de ce comportement est le foyer du polygame. Les femmes<br />
souvent opposées les unes aux autres, ne manquent pas d'extérioriser<br />
leurs sentiments. Ce sont des bagarres, des joutes verbales et même des<br />
rixes. C'est à qui couvrira l'autre de plus d'injures. C'est la jalou-<br />
sie, une grande inquiétude qu'inspire la crainte de partager l'époux<br />
(avantage) ou de le perdre définitivement au profit de la coépouse .<br />
• Tam-tam dont le danseur principal est le plus souvent un homme coif-<br />
fé de masque en général d'importation européenne. Le danseur monte<br />
sur des échasses dont la hauteur dépend de lui. /Kpoji/ = Kpo = bâton-<br />
échasse; /ji/ = sur.<br />
(1) Mimèbi wè do kpoji na xo ga ya (?)<br />
C><br />
Sé un sé bo ko ayé +<br />
E jè ganwémè yé ni kpé mi do Usa /<br />
"<br />
Omimèbi wè do kpoji na xo ga a (?)<br />
o<br />
To di awawaè + alaka gédéjé dékon<br />
•<br />
Mimèkpo wè ja kpojinè xo gbé a (?)<br />
Afo miton ni kpé 1
- 169 -<br />
Veux-tu préparer et vendre abodo ?<br />
La mijorée, assembleur de foule, dit<br />
Dois-je te monter un commerce ?<br />
"je refuse"<br />
La fainéante, assembleur de foule, me répond oui".<br />
Le commerce qu'autrefois ton père a monté à ta mère<br />
C'est sûrement ce commerce que ton père a monté àta mere<br />
Echassier au bec crochu,<br />
Si ton mari ne te donne pas de l'argent pour faire le marché,<br />
Point de fumée sur ton toit.<br />
Tu m'injuries, je te donne la réplique aussitôt.-<br />
Si tuvn'insultes, je te donne la réplique aussitôt,<br />
Ma chère épouse de salon, si' tu m' insultes,<br />
. .<br />
Je te donne la réplique aussitôt . .<br />
Echassier au bec crochu)<br />
Si ton mari ne pourvoit pas a l'argent du poisson,<br />
Point du feu dans ton foyer.<br />
Veux-tu préparer et vendre abodo ?<br />
La fainéante, assembleur de foule dit<br />
Veux-tu préparer et vendre l'akassa ?<br />
Elle dit : "je refuse"<br />
"je refuse."<br />
Alors , tu iras chercher et vendre du bois mort ?<br />
Elle répond: "jamais."<br />
Dois-je alors te monter un commerce?<br />
L'éhontée, assembleur de foule répond "oui voilà."<br />
Le commerce qu'autrefois ton pere a monté à ta mère!
Mimèkpo ni tonson yovotomè +<br />
- 113-<br />
Bo zon Kpo bo wa jala Adjohon do /<br />
o<br />
Awonlin : Lagos, la capitale de l'état du Nigéria, est connue<br />
sous ce nom dans la région. Le rayonnement de Lagos fut tel que<br />
toute ville du Dahomey qui connait l'électrification lui est<br />
comparee.<br />
Wadon le sobriquet d'Adjohon.
- 189 -<br />
nion ou du stéréotype. L'opinion et le stéréotype portent double aspect<br />
ils peuvent être soit à priori (on peut avoir une opinion de quelque<br />
chose sans l'avoir vu vraiment et en se fondant sur ce que les autres<br />
en ont dit.), soit à postériori (un contact avec l'objet motive l'opide<br />
nion ou le stéréotype.) Cependant, nous nous devons/dire que le stéréo-<br />
type a pour base les préjugés. C'est à ces niveaux que prend naissance<br />
la phobie ou l'apologie qui représentent des intentions d'auteurs. Le<br />
stéréotype reste figé(l) appartenant au domaine des idées reçues: l'i-<br />
mage et l'opinion évoluent sans cesse.<br />
Les étapes successives de la formation de l'image, de l'opi-<br />
nion et du stéréotype telles que nous les avons laissées entrevoir dans<br />
notre définition ci-dessus se trouvent télescopées dans l'image que<br />
nous avons de la région de Wémè. L'objet, c'est bien sûr la région,<br />
ses habitants et leurs coutumes; le créateur d'image, c'est le peuple<br />
de la région. Il y a auto-portrait, une connaissance immédiate, sans in-<br />
termédiaire. Nous assistons dans ce cas précis et particulier à la sup-<br />
pression du préjugé, de l'opinion pour atteindre à une image non appro-<br />
ximative, mais véridique et exacte : c'est une peinture sociale que ne<br />
motive aucune idéologie sinon une expression de soi-même à travers un<br />
genre: le chant. Ni la phobie ni l'apologie n'en sont la source. Peut-<br />
être que les idéaux exprimés à propos d'écarts de comportement consta-<br />
tés l'ont été sous le coup d'un certain ressentiment. A ce moment-là,<br />
(1) Marandon Sylvaine, L'image de la France dans la conscience anglaise,<br />
PARIS: Armand Colin, 1967-
- 196 -<br />
parfaitement ces visions de la femme : la femme-mère, aboutissement<br />
auquel toute famille prépare ses filles. Elle est digne de considé<br />
ration et de respect; la femme-objet, objet de mépris que décrivent<br />
les chansons 36 & 63.
- 2
- 215-<br />
ou qui est allée vivre en ville et en a acquis les usages; l'une ou"l'au-'<br />
tre, une fois' accrochée à un homme, se refuse: ' absolument' à se livrer<br />
à des travaux"avilissants" à moins que ce soit quelque commerce digne<br />
d'elle. La Ch 36 en rend très bien compte. La femme visée dans cette' piè<br />
ce reJette toutes les occupations susceptibles d'apporter quelques sous<br />
à son foyer, occupations auxquelles s'adonnent les épouses traditionnel'<br />
les. La femme en voie d'émancipation qu'elle est,' restera toujours dé<br />
pendante de son mari si elle ne se résoud' pas à prendre une occupation<br />
rentable. Comme quoi des questions économiques se posent dans presqtle<br />
tous les foyers de la région. Nous pouvons multiplier les'exemples in"'<br />
définiment, mais tout montre que'le mot indice apporte plus'de rensei<br />
gnements sur les grands sentiments que le discours lui-même.<br />
B) Les informants ou indices de civilisation ou indices<br />
d'intentions d'auteur.<br />
Ils permettent de décrire la culture et ses constituants. 'Ce<br />
sont des critères pertinents d'identification de la société wéméenne à<br />
l'intérieur de l'Afrique.<br />
Cette culture renferme des traits communs avec d'autres d'A<br />
frique; ces traits communs,' nous les' appelons des indices·.d' Africanité<br />
les fétiches forments des panthéons locaux et,se rencontrent dans toute<br />
l'Afrique - /yoxo/ = la case des morts. Les morts vivent parmi les'vi<br />
vants; aussi, chaque famille a-t-elle une case où les restes symbo}'iques<br />
des ancêtres sont déposés. /Tovi/ = le frère consanguin, /Nonvi/ =le<br />
frère utérin; ces deux substantifs portent les empreintes de la poly<br />
gamie, mais le fait peut se rencontrer dans le monde entier sans qu'il<br />
y ait polygamie. Des frères peuvent être consanguins ou utérins par suite
- 217 -<br />
en proie à la panique; sa besace d'habitude portée en bandoulière change<br />
de place. C'est un.spectacle délirant de comportement. C'est de plus un<br />
comique de situation. Parfois, les auteurs animent certains objets et<br />
cela d'une manière insolite. Dans CH 15, le "pénis" a pris la parole<br />
et s'est désolidarisé de l'épouseur, "je m'en lave les mains" dit-il.'<br />
Enfin, contribuent à créer ce comique' certains mots faits d''Onomatopées.<br />
visualisant la qualité ou le défaut qu'ilScritiquent chez le sujet. 'CH<br />
72 /kuncankuncanl; ridée, cela nous fait voir la coépouse comme une<br />
vieille femme ridée clopinant comme un cheval boiteux. L'adjectif /koca-<br />
koca/ = efflanquée, achève la coépouse : efflanquée et ridée, pourvue<br />
d'une démarche de vieille : c'est un phénomène. Il importe de relever<br />
un autre comique que nous' avons rencontré dans nos chansons : le comi-<br />
que humoristique.<br />
Il est fait d'un humour rose qui invite à ne pas prendre 'au<br />
sérieux certains'aspects tragiques de la condition humaine. CH 25: l'im-<br />
puissant prend femme; d'abord, il court' s'enfermer dans sa 'chambre 'et<br />
s'écriè. Se pose à lui le problème des relations sexuelles av§c son'<br />
de<br />
epouse. Il ne trouve pas autre solution que/faire du vagin de son 'epouse<br />
un vase à lotion dont il pense se parfumer. On en rit pourtant on devait<br />
en pleurer. Vient enfin le ,comique de fantaisie. Il nous plonge 'dans<br />
une atmosphère à la fois réelle et irréelle. La surprise est telle ,qu'on<br />
ne rit pas d'abord; on réfléchit puis on éclate de rire. CH 46 : une per-<br />
sonne sacrée, un prêtre/avosè/ se permet d'aller tout nu'déroberduma-<br />
nioc à Wémèdangbo. Situation cocasse : le voleur est maltraité; mais "<br />
voilà que /avosè/ est une personne sacrée; et il se permet d'aller tout
- 227-<br />
C'est une relation d'exclusion au niveau des prédicats, une incompatibilité.<br />
CH 38 IGèdè wolo mon non non kpo e<br />
Hizi wè non hizil<br />
a<br />
b<br />
C +<br />
'1 Des chaines jetées pêle-mêle s'entremêlent." (remarquer l 'utilisa-<br />
tion de l'adverbe de négation/mon nonl dans l'expression d'une norme).<br />
Un troisième type de raisonnement a une valeur explicative et procède par<br />
juxtaposition.<br />
CH 41 1 A ko mi + a ko mi + a ko déwél<br />
II/<br />
" 'i<br />
Si tu ris de moi, tu ris de toi.<br />
La cause et l'effet s'expriment de plusieurs façons<br />
CH 03 IYé yi zon misi bodo lilè<br />
•<br />
Bo finliengboma do géléta 1<br />
..<br />
" Ils nous les ont arrachés et les cultivent, et partant, point<br />
de champs de manioc dans les campagnes,:i 'ICi, l'effet est introduit par<br />
Ibol = et, partant, par conséquent. La formule Ihwénul peut aider à ex-<br />
primer la cause et l'effet; nous l'avons traduite par "du moment que",elle<br />
est suivie d'une construction négative, l'effet est a l'affirmatif.<br />
CH 60 IHwénu a ma yi ahangbémè<br />
... - ......<br />
Ogo dé awadamè ni cocodocol<br />
. 0 0<br />
+<br />
+
- 229 -<br />
avec le second membre du raisonnement, équivaut à une affirmation. Nous<br />
ne saurions terminer l'étude de l'énoncé sans parler d'un autre élément<br />
qui le détermine : le rythme<br />
5. Le rythme<br />
Nous ne saurions étudier le rythme en général dans notre tra-<br />
vail, chaque chanson montrant un rythme ou un complexe, voulu par lethè-<br />
me, l"occasion, et l'intention de l'auteur. Nous nous contenterons d'ap-<br />
porter des indications(résultats de nos observations) sur des procédés<br />
rythmiques qu'on pourra rencontrer d'une chanson à l'autre. Il convient<br />
dès l'abord de distinguer deux niveaux possibles d'étude rythmique:<br />
le niveau mélodique de l'air intéresse au premier chef le,musicologue;<br />
l'autre, fondé sur les paroles verbales peut intéresser le littéraire<br />
ou un quelconque chercheur en sciences humaines: 'c'est' le débit verbal.<br />
Ce débit peut imposer son rythme à l'air.<br />
Dans nos énoncés, il, y a lieu de distinguer plusieurs procédés<br />
rythmiques tous liés à la langue et ses schèmes tonaux. En effet, les<br />
tons déterminent les pauses brèves ou longues. Leur combinaison corres-<br />
pond à l'intention de l'auteur. On peut rencontrer:<br />
- le formulisme : nous dénommons ainsi les chansons que commencent les<br />
formules: IYé dol = on dit (deux tons), lun dol: je dis (deux tons),<br />
o 0<br />
lehansaél = et la chanson dit. Elles'influencent 'l'ensemble du texte<br />
oral qu'elles introduisent. Après les deux syllabes accentuées de la<br />
formule, on peut rencontrer deux autres types de constructions: NV.qui<br />
se décompose en N + GV.Le nom (N) comporte le plus souvent qUatre syl<br />
labes accentuées. CH 26 IYé10 + kugékuto/le GV compte deux syllabes,<br />
et la fin du vers se perd en une syllabe. Le (N) apparait le seul
.'<br />
- 235 -<br />
les êtres ou les situations qui sont à l'origine des représentations<br />
mentales sont prélevés dans le concret. Il n' y a pas de place pour l'i-<br />
maginaire ni pour la fiction. Comment en serait-il autrement étant donné<br />
que l'homme est le plus souvent dans ce contexte, à peu près incapable<br />
de fixer une image mentale' de l'imaginaire, à moins d'en faire une al-<br />
légorie. Dans ce cas extrême, l'allégorie a besoin d'un support concret.<br />
La démarche de compréhension de l' image n'est pas intellectuêlle • elle<br />
;)<br />
est mentale, c'est-à-dire que l'auditeur, par des associations venues<br />
de l'expérience, visualise mentalement le bambou que l'on rapporte du<br />
marigot; il saisit tout de suite sans avoir besoin de décortiquer la<br />
carapace de la pensée. Les qualités du bambou ne sont donc pas perçes<br />
comme des réalités intellectuelles; elles sont liées à l'image du bam-<br />
bou en situation.<br />
On peut rencontrer aussi un groupe adverbial introduisant la<br />
comparaison: 1 di..•.•.unkol = comme<br />
CH 38 IAdjohon konmun di Awonlinunkol = Et adjohoun est rayonnant com-<br />
me Awonlin.<br />
Ici, la similitude est partielle, mais elle existe. Le chan-<br />
teur connait Lagos, sa'beauté, son rayonnement, sa grandeur. La beauté<br />
le. fascine et, est symbolisée par l'électricité. Il faut être réaliste<br />
et se faire crédible: 1 unkol. Ainsi, nous pouvons conclure que le<br />
. concret et d'autre part la qualité mentale du dénoté forment les carac-<br />
téristiques d'une image. Cependant, il convient de remarquer que l'ima-<br />
ge que nous venons d'étudier est une image simple : il y en a beau-<br />
coup dans notre corpus. Mais l'image peut devenir complexe et même<br />
se spécifier : déjà métaphore, elle peut devenir dans nos textes mé-<br />
tonymie, symbole•
- 241 -<br />
Ch 38 /Gèdè wolo mon non kpo e<br />
Hizi wè non hizi/<br />
En apparence, un seul substantif est imagé ;il fait partie<br />
des images complexes et action : /gèdè/ est suivi d'un qualificatif<br />
•<br />
/wolo/ = en quantité - pêle-mêle = image complexe. La deuxième portion<br />
de l'énoncé porte toute l'intention de l'auteur et est imagée: /hizi<br />
we non hizi/ = elles se mélangent, s'entremêlent, inextricables; c'est<br />
une image désignative complexe. C'est en même temps le prédicat, alors<br />
que toute la première portion est sujet. Le prédicat est imagé, ce que<br />
nous n'avons pas rencontré lors de l'étude des images simples ou com-<br />
plexes. Les deux ensembles /gèdè wolof et /hizi wè non hizi/ s'oppo-<br />
sent comme il y a déjà dans la première portion une opposition expri-<br />
mée par la forme négative : '/mon non / (expression d'une exclusion):<br />
/gèdè/ = A. /mon non kpo é/ = négation = b, c = /hizi wè non hizi/<br />
( b )<br />
A(-------------------------------) c<br />
Les correspondances de l'énoncé dans la réalité sont les suivantes<br />
A<br />
b<br />
c<br />
Symbole<br />
gèdè wolo<br />
mon non non kpo<br />
hizi we non hizi<br />
R@alité<br />
A' les jeunes hommes<br />
b' influences néfastes des uns sur<br />
les autres du fait de la vie col-<br />
lective.<br />
c' identité. Les bons sont noyes<br />
parmi les mauvais; confusion.<br />
La femme amoureuse qui chante ainsi veut tout simplement dire<br />
que ce sont les camarades, les amis qui transforment le caractère
du mari, lui apprenant la méchanceté. En clair, la société corrompt<br />
les moeurs, fait des bons/des méchants. Mais l'amour apporte du dis-<br />
If<br />
cernement a ceux qu'il possède; la chanteuse peut alors dire : je suis<br />
bête mais j'ai su choisir? D'ailleurs , son mari est un cas particulier,<br />
il était déjà isolé : la source qui riait sous le cocotier et que per-<br />
sonne n'a daigné visiter. Le symbole 'confère à la pensée son caractè-<br />
re imagé. Mais chaque fois, l'auditeur doit faire référence à l'occa-<br />
sion ou plus exactement à la situation. Une telle façon de s'exprimer<br />
parait nonchalente, mais elle l'est volontairement afin que ceux qui<br />
possèdent layixA/, l'idée, la marque de l'intelligence, saisissent-<br />
C'est une tradition de la parole; et tous ceux qui ont de l'expérience<br />
doivent comprendre la tradition. Avec ces symboles littéraires, il est<br />
possible d'étudier la symbolique de tel ou tel élément social, car,la<br />
recension des termes imagés formant des symboles à propros d'un élé<br />
ment quelconque constitue déjà(gos yeux une étude de la symbolique tel-<br />
le que nous en avions parlé au paragraphe des informants.<br />
Un énoncé peut avoir une allure anodine et pourtant véhicu-<br />
1er le maximum d'informations: c'est le cas des énoncés elliptiques<br />
qui ont valeur de "litote". Nous mettons litote entre guillemets par-<br />
ce que nos énoncés ne répondent pas dans leurs schèmes grammqticaux<br />
aux constructions syntaxiques de la litote. Nos énoncés affirment un<br />
peu pour laisser imaginer le reste par l'auditeur:<br />
Il<br />
Ch 56 IBo na ci dèkpèlè . xomè + asa xwiyèl = et s'affale chez les jeunes<br />
"<br />
hommes, jambes maigrelettes; ou'alors<br />
tf<br />
Ch 54 IBo non do acagbé acagbél = et soupire,<br />
8/<br />
soupire.
- 244 -<br />
Nous voici à la fin de notre entreprise, celle de montrer que<br />
la chanson wéméenne est une littérature et rassemble le beau et l'utili<br />
té. Certes, nous n'avons pas tout dit dans ce chapitre V qui se veut gé-<br />
néral, très général. Il a eu l'avantage de montrer que le genre peut<br />
se classifier en trois grandes inspirations; l'inspiration poétique qui<br />
peut être lyrique, satrique et comique, enfin tragique; l'inspiration<br />
didactique enseigne, éduque, l'inspiration mixte unit,le réel à la fictirn et<br />
est romanesque, lyrique. Le chant populaire est fait d'énoncés; l'énon-<br />
cé est coUsu de mots dont tous ont un rôle important, les constructions<br />
ne sont nullement indifférentes. Et le tout concourt à exprimer des réa<br />
lités quotidiennes, des "réalités" inventées, des réalités supranatu<br />
relIes, dans un langage imagé, poétique et surtout doté de cette carac<br />
téristique : le "mi-dit". Il est donc clair que /han/ est une littéra-<br />
ture à part entière qui n'a rien à envier à aucune autre; il exprime<br />
une norme, un, idéal(le bonheur, les relations humaines); à cet égard"<br />
il fonctionne comme un miroir fidèle dans le cas de la dénonciation des<br />
moeurs sociales, un miroir déformant lorsqu'il sert de cheval de batail<br />
le. Il est aussi un élément visant à la conservation, la pérennité de<br />
la tradition et de ses différents codes, ou une effusion lyrique, en-<br />
fin une catharsis. Ce sont-là les attributs d'un roman: roman de Quête,<br />
roman de moeurs ou roman initiatique.
- 247-<br />
Mais le propre des constituants de l'ensemble des arts tradi<br />
tionnels, c'est de n'attirer l'attention qu'au moment où ils déclinent,<br />
se meurent pour être définitivement remplacés.C'est le cas de/Hante Sa<br />
forme originelle se meurt, du moins les chansons profanes; car, tant<br />
qu'il y.aura des décès, tant que le sentiment de dépendance à l'égard<br />
des fétiches sera toujours vivace, les chansons sacrées vivront et sous<br />
leur forme pure; les autres qui nous ont permis de décrire le peuple<br />
disparaitront à moins que la modernité n'aille à leur secours.<br />
Nous appelons modernité un ensemble de moyens modernes qui ai<br />
dent à sauvegarder une partie des arts traditionnels. Ici, elle est for<br />
mee par les orchestres modernes, les moyens d'impression de disques,<br />
les adaptations modernes du /Han/, la diffusion parla radio. Nous pré<br />
férons le travail des chanteurs traditionnels aidés des moyens d'impres<br />
sion à celui des orchestres dits modernes affublés de leurs arrangements.<br />
L'arrangement moderne c'est la fixation des paroles exactes d'un air<br />
dynamisé par l'apport des instruments de musique modernes. Il est inté<br />
ressant dans cette mesure ou il respecte les paroles de l'air. Pendant<br />
ce temps, d'autres airs' sont dépouillés de leurs paroles pour servir<br />
de supports à des paroles en relation avec un contexte quelconque. Ce<br />
procédé ne sert pas vraiment le chant traditionnel. Mais on peut être<br />
optimiste en pensant que nos différents'chercheurs mettront leur point<br />
d'honneur à essayer"de consigner par l'écriture les grandes productions<br />
menacées de disparition: Et c'est alors que nous pourrons fredonner une<br />
parodie de la CH 76 à l'adresse de l'oubli, véritable ennemi du chant
populaire<br />
- 248 -<br />
La chanson a jeté ses racines,<br />
Iyé, iyé, iyé, iyé.<br />
Han a sûrement jeté 'ses racines;<br />
Que peux-tu faire à présent? .f.
- 250-<br />
Ch 48 1 Kpovi ma nyi vodun(l)1<br />
Ton autre se demande ce qu'il peut y avoir<br />
dans la nuit.<br />
Utin é na mi non kplé do +<br />
yé 0 gbo é 1<br />
Utin é na mi non lè do<br />
Un do yé 0 gbo é 1<br />
•<br />
Zosè majanuè ko ko<br />
Do kpovilè ma nyi hundé 1<br />
o •<br />
Zosè majanuè' ko gbè<br />
Kpovilè ma nyi vodunl<br />
Azosè majanuè ko ko<br />
Do kpovilè manyi vodun él<br />
o<br />
Utin é na mi non kplé do<br />
yé 0 gbo él<br />
Tous ceux qui te souhaitent le bonjour<br />
Ne sont pas à mettre au compte de tes amis.<br />
Kpovi n'est pas un fétiche 1<br />
Utin autour duquel vous aviez coutume de vous rassembler,<br />
Ils l'ont coupe.<br />
Utin, qui d'habitude vous servait de forum,<br />
Ils l'ont saccage.<br />
Les habitants d'Azossè maja ont affirmé<br />
Kpovi n'est pas un fétiche véritable.<br />
Les habitants d'Azossè maja ont maintenu
- 252-<br />
Et les femmes mariées se font confectionner des caleçons.<br />
Que puis-je faire pour vous, jeunes filles ?<br />
Moi Jimini Gooungo, vous conseille de ne pas suivre.<br />
Il Y a un mieux-aller chez toi, et toi, tu en es blasé;<br />
Tu en récolteras de très précieux résultats.<br />
Un nouvel usage est arrivé<br />
Le sais-tu? Une nouvelle mode a débarqué dans votre pays,<br />
Et les femmes mariées se font coudre des cache-sexes.<br />
Fuyez l'homme<br />
Ch 50 /Mi hon na gbèto/<br />
Xo e do .. gbètolè xome +<br />
Mi nyon en aji (? )<br />
Do we ye na do xe we dagbé dagbé +<br />
0 0 0 ..<br />
Bo jè zo don bo do kiko we /<br />
•<br />
yé na ko we bo +<br />
Hi ma nyi médé .. /<br />
Gumulè na kowé bo do +<br />
o<br />
Ho ma nyi gbèto'/<br />
Toyi mèdé do fi a (?)<br />
..<br />
Agoo 10 0 + hinnumè dé do fi a (?)<br />
•<br />
Mi hpa'yi do gbéto /<br />
Ce que pensent intérieurement les gens,<br />
Le savez-vous ?<br />
Ils composent parfaitement en votre présence;<br />
Et lorsqu'ils s'éloignent, ils rient de vous.
- 254 -<br />
Do -non hu nonvicé so yi 1<br />
Mè e ci anonwé noun +<br />
Ala mon non gan domè<br />
Ku non wa nu badabada +<br />
0 ••<br />
Do non hu unnoncé lè yi +<br />
Anonwé ci anonwé nonun 1<br />
Ala mon non gan domèl<br />
Otolixo dié cédécédé e+<br />
o<br />
Ahlivo + Ahlivo +<br />
A wa so nu bo yi ahlivo kèdè +<br />
c><br />
A na yi mon nae towé'wè a (? )<br />
Mè e ci anonwe' noun +<br />
Ala mon non gan domè 1<br />
La mort est déplaisante.<br />
Mort fait habituellement des choses" déplaisantes,<br />
La tombe m'a arraché mon frère et l'a emporté.<br />
Cette personne ressemble à ta mère,<br />
Mélis la percale ne prend pas la place du fer.<br />
Mort fait habituellement des choses déplaisantes,<br />
Le trou m'a arraché ma mère et l'a emportée;<br />
Ma mere- ressemble à ta mere,<br />
Et pourtant, la percale ne remplace point le fer.<br />
Voici que le chemin du marigot est vide;<br />
Ahlivo, Ahlivo<br />
Et puis, si tu t'habillais et te rendais a Ahlivo,<br />
Penses-tu y trouver ta mère ?
- 255-<br />
Cette personne ressemble à ta mere<br />
Mais la percale ne remplace pas le fer.<br />
Oda sin huèhuè "+<br />
..<br />
Ch 53 IXo non dé mèxomèl<br />
fi<br />
A ze zan bo yi do dé loko ji aga 1<br />
0 0<br />
Nyonnu é hu assisiè +<br />
Bo zé zan bo yi do dé kpokpo dé ji 1<br />
o 0 •<br />
Xo non dé mèxomè cobo<br />
/1<br />
yé non dé vudé ., son égol<br />
9'<br />
Hun non dé mèxomè cobo +<br />
w<br />
yé non tun atan'wéwé dé 1<br />
•<br />
Xolo non dé mèxomè cobo +<br />
o<br />
Yé non dé vudé son ego +<br />
o 0<br />
Ohun non tomèxomè cobo<br />
Yé non tun atan wéwé dé 1 ..<br />
Modère-toi!<br />
Et pourtant,<br />
Toi qui es allée étendre ta natte au faïte de l'iroko;<br />
Toi la femme qui a tué ta coépouse,<br />
Et es allée étendre ta natte sur une monticule.<br />
Nous avons tous en nous, une profusion de choses à dire<br />
Et pourtant, nous n'en exprimons que quelques-unes.<br />
Nous avons tous du sang dans le corps<br />
Et pourtant, la salive que nous crachons est blanche.<br />
Nous portons tous dans nos entrailles une profusion de choses à dire,
- 256 -<br />
Et pourtant, nous n'en exprimons que quelques-unes.<br />
Nous avons du sang dans le corps,<br />
Et pourtant, la salive que nous crachons est candide.<br />
Hwédanmè ja +<br />
Ch 541 Hwédanmèl<br />
Hun é do tonune bo non gbon kenken<br />
'"<br />
Kpon hwédanmèja +<br />
Hun é do tonu ne bo nongbon akpa akpal<br />
d<br />
hwédanmè so to'nu +<br />
E na yi ci dèkpèlè , xomè +<br />
Bo non do acagbé acagbé 1<br />
Hwédanmè ci dékpèlè xomè +<br />
, Cl<br />
Bo non do acagbé acagbé 1<br />
Houédanmè vient<br />
Houédanmè vient<br />
Que la barque qui vogue sur le fleuve<br />
Gagne le large.<br />
Vois, houédanmè vient,<br />
La barque qui vogue sur le fleuve<br />
Devrait gagner le large.<br />
Houédanmè sort pour se' rendre à la source,<br />
Elle va s'affaler chez les jeunes hommes<br />
Et soupire, et soupire encore.<br />
Houédanmè est couchée chez les jeunes hommes<br />
Et soupire.
- 251 -<br />
Ch 55 IYé gbè wé 1<br />
\.<br />
Ahuili mon xoboye gbe we 10 +<br />
Gbé wè ye gbè we' bo gbè xo towé +<br />
Ekpo fi a na jiayovilo do 1<br />
o<br />
Olowé tomè awa yi jè +<br />
Dékpè e do lowé lè fo kpo<br />
• •<br />
Bo nyan wél<br />
E kpo fié a na ji ayovilodol<br />
•<br />
Ogangban tomè' ho so yi jè +<br />
Dèkpè é do Gangban fo kpo<br />
o<br />
Bo nyan we 1<br />
E kpo fi é na ji ayovilo dol<br />
•<br />
L'indésirable<br />
Une jeune fille est tombée enceinte et fut rejetée.<br />
Elle et sa grossesse'furent rejetées, reniées.<br />
Reste où elle ira accoucher de son bâtard.<br />
Elle alla s'établir à'Lowé,<br />
Mais les jeunes hommes de Lowé prirent le gourdin<br />
Et l'en éjectèrent.<br />
Reste où elle ira accoucher de son bâtard.<br />
A Gangban où elle tenta sa 'chance,<br />
Les jeunes hommes prirent les fouets,<br />
Et la chassèrent.<br />
Reste où tu iras accoucher de ton indésirable.
Ch 56 /Akélégbé/<br />
- 258 -<br />
Un ka non xo aja manlanAkélégbé +<br />
Akélégbé + Akélégbé + wa do to + Akélégbé +<br />
•<br />
Waxala towé jè jojo/<br />
Un non.xo nu manlanAkélégbé +<br />
Akélégbé + Akélégbé+ wa do to + Akélégbé +<br />
•<br />
Go yiyi towé,jè jojo/<br />
E na gbè nudé ba wa +<br />
o<br />
Bo ka na ci dékpèlèxomè +<br />
•<br />
Asa wüiyè + Akélégbé +<br />
Go yiyi towé jè. ganglan<br />
A fon a gbè nudé din wa +<br />
o ..<br />
Lobo na ci dékpèlè xomè<br />
o<br />
Asa kpaca + Akélégbé +<br />
Waxala towé jè jojo/<br />
Akélégbé<br />
Mon art fait vibrer'le monde et parle d'Akélégbé<br />
Akélégbé, Akélégbé, viens prêter oreille, Akélégbé<br />
Tes comportements importuns se font fréquents.<br />
Mon art fait vibrer le monde et en veut à Akélégbé;<br />
Akélégbé, Akélégbé, viens écouter, Akélégbé<br />
Tes vantardises se font fréquentes·<br />
Tu ne cherches rien à faire)<br />
Sinon te planter chez les hommes;<br />
Pieds de poulet, Akélégbé,<br />
Tes vantardises se font fréquentes.
Tu ne cherches rien à faire,<br />
- 259 -<br />
Sinon t'affaler chez les hommes<br />
Cuisses maigriottes, Akélégbé<br />
Tes comportements éhontés agacent.<br />
Sakabo<br />
Ch 57 /Sakabo/<br />
E du akwècé bi vo +<br />
G<br />
Sakabo wè du akwècé bivo + Sakabo/<br />
..<br />
Etè we a zé bo do don mi (?) Sakabo/<br />
Lii we ho zé bo do don mi + Sakabo/<br />
A ko ze alinkanjè do don mi + Sakabo /<br />
Kèlè.wè hosa bo do don mi + Sakabo /<br />
E du akwècé bi vo<br />
Cl<br />
Sakabo wè du akwècé bi vo + Sakabo/<br />
Elle a dissipé toute ma fortune,<br />
Sakabo a dissipé ma fortune toute entière, Sakabo.<br />
Quels appâts as-tu utilisés pour m'attirer dans tes nasses, Sakabo ?<br />
Ton lit moelleux m'a attiré, Sakabo.<br />
La ceinture de perle de tes fesses m'a fait pâmer d'admiration, Sakabo.<br />
Ton visage joliment maquillé de craie m'a ébloui,<br />
Elle a mangé tout mon argent<br />
C'est Sakaboqui m'a rongé jusqu'au dernier sou, Sakabo.<br />
Ch 58 /Awadamè /<br />
Yé do anonwé dié ku é é e +<br />
,. 0<br />
Anonwé dié ku e<br />
o<br />
Hwénu a ma yi ahangbèmè
Voici morte ta mère<br />
Voici morte ta mère<br />
- 260 -<br />
Kpon anonwédié ku é<br />
o<br />
Ogo d'awadamè'ni cocJcodo/<br />
o '<br />
Awadamè + awadamè ni cococodo +<br />
Ago d'awadamè ni codocodo/<br />
4<br />
Sous les aisselles<br />
Tu n'es membre d'aucune association de boisson,<br />
Et ta mère vient à mourir<br />
Le litron vide t'accompagne impunément raide sous les aisselles.<br />
Sous les aisselles, et encore sous les aisselles,<br />
Tu portes le litron vide honteusement raide sous les aisselles.<br />
CH 59 / Un do ago na xwéto/<br />
Un do ago'na xwéto<br />
Bo kan xwé sé /<br />
Didoto ma ja alo so mi gbé +<br />
• •<br />
Jonon ma fon +<br />
Zanxato non xa zan we ja (?)<br />
Mi doagoo na xwéto bokan xwe sè /<br />
Ahen en + agoo na xwétobo kan xwe se a e +<br />
Iyégé / Agoo na xwé to bo kanxwé sé +<br />
Nyen to yé mè bo ayi kpé mi +<br />
Jonon ma fon zanxato na xazan we ja (? )<br />
Mi do ago 0 na xwéto bo kan xwé se /
.',,,,.,.<br />
- 263 -<br />
Zanvodunnyan mon ahwé dé<br />
"<br />
Mon non mon ahwéxomèlala +<br />
..<br />
Dékpè nyinyi basi mèton mèton +<br />
..<br />
Dèkpè mon ahwé dé mon non mon ahwéxomè lala +<br />
Ahüili nyinyi basi mèton mètonl<br />
Ho ma gala bodo do xoce ma +<br />
•<br />
1<br />
Omèyolè y:e nyon gbigbocé 1<br />
Ils me craignent<br />
Tu n'es pas homme à médire de moi,<br />
Tu n'as pas le toupet de broncher.<br />
Et tu n'es pas homme à proférer des menaces;<br />
Nous, nous savions "déjà qui nous sommes;<br />
Avant d'arriver ici.<br />
Tant qu'on n'a pas "fréquenté quelqu'un,<br />
Comment peut-on juger de sa qualité ?<br />
Le chanteur Agoungnon a déjà énoncé cette vérité dans une chanson.<br />
Ceux-là savent qui je suis.<br />
J'en appelle à Zanvodun; qui voit la craie,<br />
N'en voit pas l'intérieur.<br />
La célébrité d'un homme dépend de ses moyens;<br />
La renommee d'une jeune fille repose sur elle-même<br />
Tu n'es pas tel que tu puisses parler de moi.<br />
Ils me craignent.
- 266 -<br />
Viens m'embrasser, diffiCUlté!<br />
Fais-moi mon lit, histoirel<br />
Donne-moi ,à boire" dispute!<br />
Fais-moi mon lit, ai-je dit, et les tracas n'en finissent point.<br />
Chère belle-mère, viens récupérer" ta fille,<br />
Ta mal polie de fille, la voici.<br />
Ai-je pris femme pour ne pas avoir la paix ?<br />
Ch 64 INè yi 1<br />
Onyonnu na '. gbè mi' kpon yi jan e na yi +<br />
Avomènu Zunlè ma jolo tagbaxo gè 1<br />
Nyonnu dé gbèmi'bé yi jan é na yi +<br />
Avomènu Zunlè ma jolo tagbaxo kpali 1<br />
Gbèto wè tonson lagosu bo wa tocémè<br />
Asié ka gbè gbédo 1<br />
Gbéto tonson Lagosu bowa tocémè<br />
Asié ma ba sin' na/<br />
Xonè tonyi hanlèloZunlè wa+<br />
Mibo kan bio (X)<br />
Xo énè do wè zunlè dé to xomè t<br />
•<br />
Asiéton so hun avi /<br />
Nyonnu na gbèmi kponyi jan é na yi<br />
Avomènu zunlè ma jolo hwègbé xo dé 1<br />
•<br />
Je n'insiste pas.<br />
Si ma femme veut me quitter, je n'insiste pas.<br />
Car', moi, fils d'Avomè, ne veux pas de casse-tête.
Le voilà perdu pour kponmènu.<br />
- 268 -<br />
Le seul grand arbre à l'ombre protectrice,<br />
Est perdu pour kponmènou.<br />
Que j'aille au marché, que je revienne, m'a dit yao;<br />
Je vais a Dangbo et je reviens, a dit ma maman.<br />
Je vais a Azossè, puis a Dangbo et je reviens,<br />
C'est cela que Yao a dit à Avomènou.<br />
Le dernier grand arbre à l'ombre<br />
Est perdu pour Avomènou.<br />
Ch 66 IXodo ayi towél<br />
Ma zon glagla gbon yé mèo +<br />
Ma di wézun gbon yémèo+<br />
Ma kpa 9abo yi ye me 0+<br />
Ma do afokpa do yi ye mec +<br />
Ma do avo dagbé yi ye mèo +<br />
"<br />
Ovié na (X) jilè +<br />
Ma zon glagla-gbon fami'mè 0+<br />
Bo xodo ayi towé + e e e e e ayi towé 1<br />
e e e e ayi towé +<br />
Ma hon wézun gbon ye mè 0 +<br />
Ovi e na (X) jilè +<br />
Ma zon glagla gbon ajobimè 0<br />
Bo xo do ayitowél<br />
Ecoute ta conscience<br />
Ne marche pas pressé devant eux,<br />
Ne cours pas parmi eux,<br />
bénéfique et mobile
Ch 68 / Suulu /<br />
- 270 -<br />
Suulu mi mèkpo ni do suulu e + .<br />
Ogbèmè ma jé yi fidé é é ayé e e /<br />
b<br />
Suulu mi mèbi ni dO'suulu +<br />
Ayihon gbèmèma jè yi fidé +<br />
E jolo Ajalonnon + é na so nyon /<br />
Patience<br />
Patience, vous tous, ayez de la patience)<br />
Le monde ne va nulle part, certainement.<br />
Patience, vous tous, armez-vous de patience,<br />
Le monde ne va nulle part;<br />
Et s'il plait à Dieu, la vie s'améliorera.<br />
Ch 69 / Jezudo 10 /<br />
Jézu wè do 10 ?é + agbawè mi zon a e +<br />
Klisu wè do 10 dé + agba wè mi zon<br />
Tata we gbèto zon wa gbè fié<br />
lyé iyé é + tata wè gbèto zon wa gbè fié +<br />
Tata mon jan ma wè a na so zon do yi +<br />
A ma œn nudé wa gbèmè +<br />
0<br />
Mon jan a ma hen nudé jéyi /<br />
Akwètowé kpo asitowélè kpo +<br />
Hennumè ajobi ton wè bi sésé +<br />
A ma hen nudé wa gbèmè +<br />
..<br />
Hwèkpo ama hen nudé jéyi /<br />
•<br />
vitowé kpo gan towé lè kpo<br />
Hennumè akotonon ,ton wè kpo sésé +<br />
..<br />
.
1<br />
Hi ma hen<br />
1<br />
1<br />
- 271 -<br />
nudé wa gbèmè +<br />
•<br />
Hwèkpo a ma hen nudé .. jé yi /<br />
La parabole de Jésus.<br />
Jésus a dit une parabole, nous sommes arrivés les mains vides.<br />
Le christ a dit une parabole, nus nous sommes venus.<br />
Eh oui! l'homme est venu au monde bras balants.<br />
C'est ainsi qu'il s'en retournera;<br />
Tu n'as rien apporté dans ce monde,<br />
Ainsi tu t'en retourneras.<br />
Ta fortune,. tes femmes, toutes iront aux membres de ta famille.<br />
Tu n'as rien apporté ici bas,<br />
Tu n'en emporteras rien au dernier jour.<br />
Tes enfants, tes biens divers tomberont aux mains de la famille ..<br />
Tu n'as rien apporté ici bas,<br />
Tu n'en emporteras rien.<br />
Ch 10 /Ogbè ace /<br />
Ogbè ace + osègbo munundé (?)<br />
•<br />
Osè é da toké + bo é lè aji ma du 10 +<br />
Ajoto moun dé .. na do .. mi a ma /<br />
Ogbè acé + sègbo monun dé /<br />
•<br />
Un tel destin<br />
La vie, n'est-ce pas? un dieu d'un tel comportement!<br />
..<br />
Ce dieu qui a fait la,chauve-souris, et elle travaille sans pouvoir<br />
récolter le fruit de son labeur.
- 272 -<br />
Un tel dieu ne peut être le mien •<br />
Eh!,cui la vie, je me refuse à être la créature d'un tel dieu.<br />
Ch 71 /Mi ma do gon na gon /<br />
•<br />
Omi ja + omi' ma do gon na gon +<br />
0<br />
" " " " " " " " " +<br />
Omi dogbanu vilè + omi 'wa e +<br />
" " " " " " "+<br />
Ayihon' bo gbélé agangan nadu'folo wè ja (?)<br />
o<br />
Gbè bo gbélé + toké ma na non vo ma dé /<br />
Nous venons<br />
Nous venons, nous n'y manquerons pas;<br />
Nous, fils d'adogba, nous' voici.<br />
Et si le monde tournait mal, pensez-vous que l'épervier mangerait des<br />
pelures ?<br />
Même si le monde tournait très mal, la chaure- -souris ne manquera pas<br />
de se suspendre à un arbre.<br />
Ch 72 / Ku wa zon /<br />
A mon nudé okuwa a (? )<br />
0<br />
Asoè yi so 'monkan do Ko +<br />
Gbèmè nu ma gbè mèdé ma wa /<br />
0<br />
..<br />
..<br />
Mi wa kpon nudé ogbè non wa /<br />
Mi wa kpon nudé ogbè non wa e /<br />
L'oeuvre<br />
Vois-tu l'oeuvre de la mort?<br />
Le perdrix s'est laissée prendre au piège.<br />
..
Me voici donc.<br />
Orphelin de père,<br />
Orphelin de père et de mère,<br />
Il Y en a toujours quelque part;<br />
Me voici.<br />
Ch 75 / Mèmonso /<br />
Egbé wè mi sa mon e<br />
Mè e mon égbé ma sa mon sa e ja +<br />
Ayi é mi dé din + e nyon gbau /<br />
0<br />
Egbé wè mi sa mon +<br />
Omè e mon égbé ma sa mon sa e ja +<br />
Ayi e mi dé din + e sa nyon /<br />
II'<br />
yé kpli bo ba donu mi kaka +<br />
Mèdé .. ma mon donu mi cenun /<br />
Hagbèlè ba donu mi kaka +<br />
yédé ma mon donu mi kpali /<br />
0<br />
Egbé we mi sa mon +<br />
Omè e mon égbé ma sa mon sa e sa ja<br />
Ayi e mi té din + e sa nyon /<br />
Qui sait l'avenir?<br />
Nous vivons ce jour.<br />
Qui vit cet instant ignore de quoi demain sera fait;<br />
L'existence que l'on mène de nos jours,<br />
Est certainement charmante.<br />
C'est l'instant présent que nous vivions;
1<br />
- 277-<br />
Nous ne mourrons pas tous.<br />
Que tonne le canon,<br />
Nous ne mourrons pas tous.<br />
Et que crépite le tam-tam de la guerre,<br />
Nous autres, nous ne finirons jamais tous.<br />
Voyez ! nous ne sommes que les mêmes,<br />
Assemblés dans la maison familiale,<br />
Faisons vibrer l'échos de nos chants.<br />
Que tonne le canon de la guerre,<br />
Nous autres, nous ne finirons jamais tous.<br />
Un na so monen dé a +<br />
..<br />
Omonvo dié 10 0 /<br />
Un na so monen dé (? )<br />
..<br />
Omonvo dié 10 0/<br />
Ch 79 /Mon vo dié 10 0 /<br />
..<br />
..<br />
..<br />
Un na so monen dé + monen dé + monen dé wè ya (?)<br />
Q D ..<br />
Un na so monen dé (?)<br />
0<br />
Omonvo dié 10 0/<br />
0<br />
E 10 nyi ahwan wè kuo 10 nyi +<br />
Axolu hwézé na baè na mi +<br />
Hwézé na baè mon dodo /<br />
Omonvo dié 10 0/<br />
..<br />
E 10 nyi ahwan wè kuo 10 nyi +<br />
Gbènyanto luvè na baè na mi +<br />
Luvè na baè mon dodo +<br />
Omonvo dié 10 0 /<br />
..
- 279 -<br />
Frapper les mains l'une contre l'autre,<br />
N'abîme point les traits<br />
Que Dieu y a tracés;<br />
Ces traits, nul ne peut les effacer.<br />
Ch 81 / Kahun /<br />
Ayonu anagonou dé + na yi ayotomè<br />
•<br />
Kahun é na do /<br />
.<br />
Ayonu dé na yi ayotomè +<br />
Kahun é na do /<br />
La barque fatale.<br />
Qu'un ressortissant d'Oyo veuille se rendre a Oyo)<br />
Il empruntera une barque en calebasse.<br />
Qu'il décide de rentrer chez lui à Oyo,<br />
Il empruntera une barque en calebasse.<br />
Ch 82 / Biligédé /<br />
Obiligédé xo do mi té +<br />
..<br />
Un ma yolo gbéto nyi +<br />
Obiligédé xo do .. mi dé ..<br />
Un ma yolo gbéto nyi /<br />
Obiligédé xo do mité +<br />
..<br />
Mè é non hen gan koko +<br />
Non gbon wolomè xo do mi dé +<br />
..<br />
Un ma yolo gbéto nyi/<br />
Biligédé<br />
C'est de biligédé que je parle,<br />
Je ne parle pas de Gbéto.<br />
C'est bien sûr de biligédé que je parle,<br />
Je n'ai pas nommé un gbéto;<br />
Je parle de biligédé,
o sodabi do 0 nu wé +<br />
..<br />
- 280 -<br />
Celui-là qui court le village muni d'un gon,<br />
Je ne parle point de gbéto '"<br />
Ch 83 / Ba nu /<br />
A ko so ja mi hwlen gbé a (?)<br />
Miu ahannuntolè hwlen gbé a (?)<br />
A bolo gbon mon bé é na nyon /<br />
Ahan da non fi bo xo we +<br />
Kaka bo yé ma mon we +<br />
S02abi ahan da non fi bo kpon ho +<br />
Kaka bo yé ma mon wé /<br />
Na do con hvè dO'wé<br />
Ba nu bo ba nu /<br />
+J (bis)<br />
Ennivrons-nous.<br />
Bienvenu , sodabi<br />
(bis)<br />
Tu es encore venu nous sauver ?<br />
Nous tes adeptes !<br />
Un tel geste venant de toi,<br />
Est un acte louable.<br />
Un demi litron est resté ici à t'attendre,<br />
Et personne ne t'a entrevu, .<br />
(bis)<br />
Oui ! un demi litron de sodabi a trainé en ces lieux,<br />
Mais tu n'es point venu.<br />
l<br />
Pour passer le temps ensemble,<br />
Ennivrons-nous.<br />
(bis)
- 284 -<br />
E nyi médè ma sen ajalonon +<br />
•<br />
océton ma dé mè 10 0 +<br />
•<br />
_Dagbé é na Jézu wa ma so nyi nu na bu dé 0 /<br />
Ils sont éternels.<br />
Les bienfaits de Jésus ne se perdront jamais•.<br />
Le christ est venu ici bas,<br />
Il n'a jamais accompli de méfaits;<br />
Il n'en a jamais accomplis que je sache.<br />
S'il en avait accomplis,<br />
Tu sais que je ne l'adorerais pas.<br />
Sache que l'oiseau qui traverse le ciel,<br />
Il ne fait rien de productif.<br />
La fournl;dans son trou, ne travaille point.<br />
Le seigneur seul pourvoit à tout pour eux.<br />
Si quelqu'un n'adore pas dieu,<br />
Je m'en lave les mains.<br />
Car, les bienfaits de Jésus sont éternels.
- 2a;) -<br />
CH 89 1 Nyinyanto han 1<br />
xè jè kpanué +<br />
Kowé jè kpanu ma so mon nyinyanto dé<br />
Onué do non wa dié do wa é 1<br />
•<br />
Personne pour l'en chasser.<br />
L'oiseau s'est posé sur l'enclos;<br />
L'oiseau de la mort, kowé, s'est posé sur l'enclos;<br />
Et, il n'y a personne pour l'en chasser.<br />
Voici que la mort a accompli son oeuvre habituelle.<br />
Ch 90 1 Adan ma hun do 1<br />
Un do adanto gala ma hun do nugbo +<br />
"<br />
Adan ma hun yo a e +<br />
Adan hun yo +<br />
(X) cé na ko hun yol<br />
Vaine, la bravoure.<br />
L'homme ne peut échapper à la tombe.<br />
Fut-il vaillant,<br />
Un homme brave ne peut pas ouvrir sa tombe.<br />
Le courage et la force n'ouvrent point la tombe.<br />
lJ<br />
bis<br />
C'aurait été possible que mon (X) aurait défoncé sa tombe.<br />
Ch 91 1 Maolè 1<br />
A do ta dagbé di agba nonun e +<br />
0 0 ..<br />
Adogbanu yokpocé a do tagbé +<br />
Amaolè jan wè milè na yi é 1<br />
1bis<br />
bis
- 291 -<br />
A·ka mon l zaki bé agban wè a na jo /<br />
Xo dé tin dé agban godo bo e do dicto bo zan ku +<br />
0 .. 0<br />
'" •<br />
Xo dé tin dé agban godo bo e do dido bo zan ku e +<br />
.. 0 •<br />
Xo dé tin dé agban godo bo e do dido bo zan ku +<br />
• CP .. ..<br />
Bo mèdè jan ma mon do éton /<br />
..<br />
, , )<br />
Xo ne mawe. Monpè se bo na xome eton gbélé +<br />
Bo Monpèlè ka wa kan wéman /<br />
Ojan bo zé weman sè do Izaki +<br />
Bo do .. na Izaki. do .. gigo éton ni ya /<br />
Gigo dié + Izaki gigo dié +<br />
D 0-<br />
Nyonnu mèsi mon non do ahanjo e +<br />
. ..<br />
Gigo mi sé bo dado /<br />
Ado wè'na.gbo + xovèsin ado wèna gbo +<br />
, ....<br />
Mi ma mon.xo dé bo na do do din gba +<br />
o • ..<br />
Ado wè nagbo bo mi na kpé /<br />
Xovè wè si ahwanmènyonnu bè hon dosé a e +<br />
Xovè we si ahwanmènyonnu bè hon dosé +<br />
. ...<br />
, v<br />
Mi ma mon nudé bona do do din gba +<br />
Gbo jan é nagbo bomi na kpé /<br />
La Famine<br />
La famine qui a sévi à cette époque-Ià-,<br />
Je l'ai immortalisée dans une chanson .'.<br />
Cette famine! moi Ladé, je l'ai chantée.<br />
Cette chanson !Tousles méfaits de la famine,<br />
Je vais les chanter.
- 292 -<br />
......................................................<br />
Il y 'avait un travail à Accra,<br />
On y était engagé à force de "couloir!'<br />
Et Isack servait d'intermédiaire.<br />
Si vous cherchez du, travail et que vous allez trouver Isack,<br />
Il vous faut lui payer des pourboires.<br />
Mais, parfois,après les "pots dl vin",<br />
encore;<br />
1<br />
les pourparlers traînent, traînent<br />
Au point où tout le monde se laisse gagner par le découragement.<br />
Monpè fut mis au courant d'une de ces interminables transactions.<br />
Il fut fâché et envoya une missive à Isack,<br />
Il lui intima de revenir illico.<br />
Voici ton retour, Isack, voici ton retour !<br />
La femme d'autrui ne, pratique point le commerce d'alcool,<br />
Ton retour mit fin à toutes les escroqueries.<br />
A la fin de la famine; c'est quand elle aura pris fin<br />
Nous ne trouvons rien à dire à présent,<br />
C'est à la fin de -la famine que nous ouvrirons la bouche.<br />
La faim a traqué une femme au point où elle a déterré et vendu son foyer.<br />
Nous n'avons rien à dire à présent.<br />
Rendez-vous à la fin de la famine.<br />
Monpè = mon père: ce terme désigne le curé d'Azossè qui semble-t-il<br />
aurait aidé beaucoup de gens durant cette famine; c'est le R.P. Adéyèmi.
- 293 -<br />
Ch 91 / Gbè badabada /<br />
• •<br />
Ogbè badabada + mon wè gbè non bolo do +<br />
..<br />
•<br />
Ogbè na nudé wè hun jUon en me /<br />
E na vi we hun jijonen mè +<br />
E so na kwè wé hun jijonenmè + bo non du /<br />
co<br />
Ogbè badabada + mon gbè non bolo do +<br />
• "<br />
Ogbè na nudé we hun jijonenmè /<br />
Vie changeante.<br />
Vie changeante,. vie traîtresse; c'est ainsi qufelle agit<br />
Si elle t'apporte quelque chose, prends-le.<br />
Si elle te donne des enfants, réjouis-toi,<br />
Si elle t'apporte la fortune, jouis-en et vis.<br />
Car, vie changeante,. vie traîtresse; c'est ainsi qu'elle agit ..<br />
Si elle t'apporte quelque chose<br />
CH 98 / Hagbè dindin /<br />
, prends-le.<br />
Hagbè dindin e· nè lè + dé kun non mon mè gbo 0 +<br />
"<br />
Ohabgbè dindin é nè lè + yé kun non mon dio gbo wé +<br />
0<br />
Ohagbé dindin + ho non jè ahan nèlè bo mi non nun +<br />
Ohagbè dindin + dio non xo gi nèlè bo mi non du +<br />
.. C><br />
Ohagbè dindin é nèlè + yé kun non mon mè gbo 0 /<br />
Les Camarades !<br />
Ces amis qui foisonnent ne vous acceptent pas •<br />
Ces camarades qui satellisent autour de moi ne me souffrent pas.<br />
Ces amis auxquels tu offres la boisson, et avec qui tu bois,<br />
Ces amis ne t'acceptent pas.<br />
..
né, Hé, Hé,<br />
- 296 -<br />
Ch 100 / Nyemba<br />
né + Hé + Hé fofo nyen ba /<br />
né + Hé + Hé jètè (? ) nyen ba /<br />
Dio ma ja nu da gbé + nyen ba +<br />
0 ..<br />
Dio ma dé afokpa na sunsun +·nyen ba +<br />
..<br />
Dio ma dé ayi na za gba /<br />
Q<br />
•<br />
Asu ma dé gbé· do mi 10 +<br />
•<br />
Xomèsu ma dé gbé do mi ·0+<br />
..<br />
Etè a wa na mi è (? )<br />
Avo a xo na mi an (? )<br />
Avo e na asunon xo na asi bè non gba +<br />
Ho mon non xo dé na mi bo non dé gbé do mi. an (?)<br />
• ..<br />
. Nyen ba /<br />
Moi, pas<br />
lIé, ilé, toi qui? moi, pas !<br />
Moi, je ne ferai pas la cuisine, pas moi;<br />
Je ne cire pas tes chaussures, moi pas;<br />
Moi,je ne vais pas balayer;<br />
Ou' un mari ne me donne point des ordres !<br />
Oue l'homme avec lequel je vis ne me nargue point.<br />
Oue m'as-tu fait?<br />
M'as-tu offert un pagne?<br />
Le simple pagne que l'époux offre d'ordinaire a sa campagne<br />
Afin qu'elle se. fasse belle
- 297 -<br />
Achète-m'en un avant de vouloir me commander;<br />
Moi, pas !<br />
Ch 101 / Tata /<br />
Na un na non tata bo jè kpen do (? )<br />
"'<br />
Na un na non' tata bo jè kpenwé do (? )<br />
•<br />
Hwénu un ma yi gbaunjadu mèdé si +<br />
o "'<br />
Na un na non tata bo jè kpen do (? )<br />
0<br />
Inopinément?<br />
Comment puis-je contracter inopinément la toux ?<br />
Comment le -puis-je ?<br />
Du moment que ,je n'ai pas'pris et mangé de-la noix chez quelqu'un,<br />
Comment puis-je contracter inopinément la tuberculose ?<br />
Ch 102 / Agbajumon to ku /<br />
Ohansaé +yokpo avomenu +<br />
Agbajumon to ku /<br />
Bo yé do dido +<br />
o •<br />
Mè é ma mon ,do na lè ja doton din gbé +<br />
01310 wè +<br />
Gbètomamon do na lè ja doton din gbé /<br />
Ohansaé + iyégégé + agbajumonto ku /<br />
Le décès du père d'agbajomon.<br />
Et la chanson dit, enfants d'avomè,<br />
Le pere d'agbajumon est décédé.<br />
Tout le monde le proclame,<br />
Pourtant, ceux qui n'y croient pas,
Sont venus s'en assurer.<br />
Mensonge<br />
Ceux qui n'y croient pas,<br />
Sont venus s'en assurer.<br />
- 298 -:-<br />
Et la chanson dit, oh ! là ! là<br />
Le père d'agbajumon est décédé.<br />
-:-:-:-:-:-0::000:-:-:-:-:-
ADANDE (Alexandre)<br />
- 302 -<br />
1. "Une association d'entr'aide<br />
23 JUILLET 1943..<br />
Ajonu", in Notes africaines nO<br />
2. "Un rite expiratoire"Oma", in Notes africaines, N° 58 AVRIL 1953 .<br />
BETENE (Abbé Pierre)<br />
BRAND (R.Bernard)<br />
Bastide (R)<br />
Barthes (Roland)<br />
BENEVENISTE (E.)<br />
" Le Béti vu à travers ses chants traditionnels" dans Abbia,<br />
nO 26 FEVRIER 1973.<br />
" Les hommes et les plantes " dans Genève -Afrique Vol XV<br />
N° 1 19760<br />
CA<strong>LA</strong>ME-GRIAULE (G.)<br />
"L'homme africain à travers sa religion traditionnelle "in<br />
Présence africaine nO 40, trimestre 1 1962.·<br />
"<br />
"Introduction à l'analyse structurale du récit dans<br />
Communication nO 8,1966.<br />
"Remarques sur la fonction du langage dans la découverte freu-<br />
dienne "in La psychanalyse t. 1 sur la Parole et le langage<br />
1. "L'art de la parole dans les Cultures africaines "in<br />
Présence africaine nO 47, 3° trimestre 1963.,<br />
2. "Introduction à la musique africaine "in La revue musicale,<br />
cahier spécial N° 238, Richard Masset,1957.
- 304 -<br />
1. "Uri chromatisme africain "in L'homme, 1,3 Sept"-Décembre 1961.<br />
2. " Une chantefable d'un signe divinatoire au Dahomey" in Journal<br />
of Africam languages, 1,31962.<br />
---------00000------------
- 306 -<br />
2. IHanl et lé contexte sotie-culturel . . · · · · · ·<br />
a) Origine . . . . . . . . · · · · · · · · · 42<br />
b) Signification de IHan/pour le Wémènu · · · · · ·<br />
c) IHanl dans Wémè : Existence · · · · · · · · · · · · · 45<br />
d) Classification . . . . . . . . . . . · · · · · · . . 51<br />
c) La chanson dans la nature . · · · · · · · · · · · · ·<br />
f) L'Esthétique de la chanson populaire dans Wémè · . . 65<br />
3. De la dynamique sociale du IHan/ · · · · · · · · · · · · 11<br />
CHAPITRE III. Les chansons récréatives • • . 11<br />
1. Le cycle IAyèsil<br />
dénigrement .•<br />
départ - arrivée - joie - remerciement<br />
2. Le cycle IAko ou hinnul - les géniteurs - l'enfant - la<br />
grande famille .<br />
3. Le cycle/Gbèl - la femme - le divorce - l'homme - le<br />
destin ISèl - l'homme philosophico-moral : l'amitié <br />
les refrains des, chantefables didactiques .....<br />
4.-Le cycle IXwé 1<br />
- le cas du christianisme<br />
- les fêtes civiles<br />
- IWa nul.'.<br />
Conclusion partielle<br />
CHAPITRE IV . Les chansons occasionnelles<br />
1. Les chansons sacrées - les fétiches IVodunl<br />
- La transgression d'un interdit' fétichiste : un rite<br />
expiratoire IOmanl •.<br />
42 - 11<br />
43<br />
60<br />
19<br />
88<br />
91<br />
123<br />
124<br />
128<br />
131<br />
134<br />
135 - 196<br />
135<br />
138
- <strong>LA</strong> MORT.<br />
- La mort comme un voyage •<br />
- 307 -<br />
- La mort comme une délivrance • • .<br />
- Les autres caractères de la mort . •<br />
2. Les chansons profanes . . • • • • .<br />
A. Les chansons profanes appartenant à tous • .<br />
- Les chansons phobiques /Atè/ - /Auhwan/.<br />
- les chansons apologétiques<br />
- les chansons d'amour •...<br />
B. Les chansons de sous-groupes socio-professionnels . • • .<br />
- les laboureurs • . . • • •<br />
- les voleurs • • • • . • • • . . . • • • • • •<br />
- l'ivrogne<br />
- les jeux •<br />
- le cache-cache .<br />
- /Kpaklèkpaklè/<br />
- / Ahan/ . . . • . . . . .<br />
- / Agwé / . . . . . • . • • . • • •<br />
Conclusion parteielle . . . • • • • . • • • •<br />
3. Image de Wémè à travers la chanson populaire . . .<br />
CHAPITRE V<br />
la littérarité de la chanson populaire de Wémè<br />
1. Les intentions des créateurs: les inspirations .••.••<br />
1. L'inspiration poétique.<br />
2. L'inspiration didactique<br />
3. L'inspiration mixte ••<br />
II. Les valeurs expressives . • • • • • • • • •<br />
1. Le mot comme la clef de voûte de l'ensemble.<br />
148<br />
151<br />
154<br />
156<br />
163<br />
163<br />
164<br />
111<br />
114<br />
115<br />
116<br />
111<br />
119<br />
180<br />
180<br />
182<br />
184<br />
186<br />
181<br />
188<br />
191<br />
199<br />
200<br />
204<br />
201<br />
209<br />
209
2. Le mot indice . . . . . . .<br />
- 398 -<br />
a) Les indices proprement dits . . . . . . .<br />
b) les informants ou indices de civilisation .<br />
3. Le mot poétisé ....<br />
- le mot dépouillé d'adjectif .....<br />
- le mot accompagné d'un déterminatif<br />
- l'adjectif ou l'adverbe .<br />
4. L'énoncé . . .<br />
5 . Le rythme . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229<br />
III. Le "mi-dit", ou la pensée imagée<br />
A. Les différents· types d'images .....•.•...<br />
a) Les caractéristiques de l'image.<br />
b) Complexification et spécification<br />
c) Les symboles ..<br />
B. La norme<br />
CONCLUSION GENERALE .<br />
Conclusion partielle . .<br />
REPERTOIRE DE REFERENCES<br />
BIBLIOGRAPHIE<br />
TABLE DES MATIERES . . . . . . . . . .<br />
Deux cartes sont incluses dans la<br />
et une carte ethnique.<br />
211<br />
du Bénin<br />
212<br />
215<br />
218<br />
219<br />
219<br />
221<br />
221<br />
233<br />
233<br />
234<br />
236<br />
239<br />
243<br />
244<br />
245 _ 248<br />
249 - 298<br />
299 _ 304<br />
305 _ 308