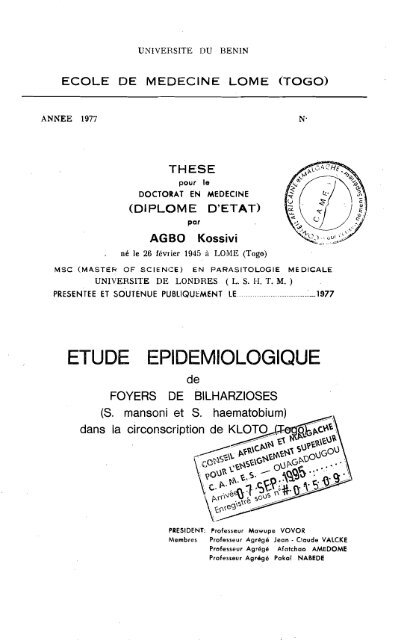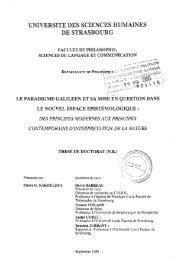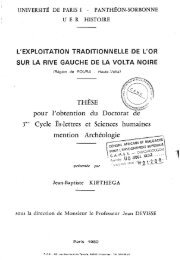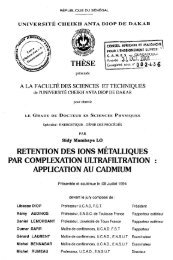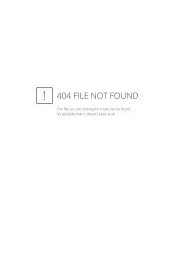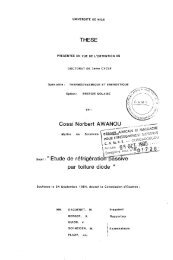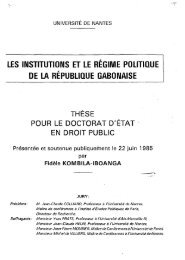ETUDE EPIDEMIOLOGIQUE
ETUDE EPIDEMIOLOGIQUE
ETUDE EPIDEMIOLOGIQUE
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
UNIVERSITE DU BENIN<br />
ECOLE DE MEDECINE LaME (TOGO)<br />
ANNEE 1977 N'<br />
THE5E<br />
pour le<br />
DOCTORAT EN MEDECINE<br />
(DIPLOME D'ETAT)<br />
par<br />
AG BO Kossivi<br />
né le 26 février 1945 à LaME (Togo)<br />
MSC (MASTER OF SCIENCE) EN PARASITOLOGIE ME DICALE<br />
UNIVERSITE DE LONDRES (L. S. H. T. M. )<br />
PRESENTEE ET SOUTENUE PUBLlQUtMENT LE---- .:_1977<br />
<strong>ETUDE</strong> <strong>EPIDEMIOLOGIQUE</strong><br />
PRESIDENT: Professeur Mawupe VOVOR<br />
Membres Professeur Agrégé Jean - Claude VAlCKE<br />
Professeur Agrégé Afotchao AMEDOME<br />
Professeur Agrégé Pokai NABEDE
PRO F E S S E URS<br />
l !vI EDE C l N E<br />
LISTE DU PERSONNEL ENSEIGNANT<br />
Professeur (O.V.S.)<br />
Professeur<br />
"<br />
"<br />
Pierre CARTERET<br />
Koffi KEKEH<br />
Kotso NATHANIELS<br />
Mawupé VOVOR<br />
Physiologie<br />
Chirurgie Générale<br />
Chirurgie Thoracique<br />
Gynécologie-Obstétrique<br />
Professeur Agrégé Afatchao AHEDONE Maladies Infectieuses<br />
" " Pierre BEGUE Pédiatrie<br />
" " Souroufai BITHO Urologie<br />
1<br />
,<br />
" " Komlatsé KPODZRO Anatomie-Pathologique<br />
" " Pakai NABEDE Hygiène et Santé Publique<br />
" " Nassame NAKPANE Traumatologie<br />
" " Jean-Louis PLESSIS Anatomie<br />
" " Didier RABINEAU Histo-Embryologie<br />
" " Jean-Claude VALCKE Médecine Interne
Professeur Pierre MAURER Traumatologie-Orthopédie<br />
"<br />
"<br />
"<br />
M. PHIl. BERT<br />
M. RENOUX<br />
Claude VEDRENNE<br />
( Doyen de Cochin - Paris<br />
Médecine du Travail<br />
Immunologie<br />
Anatomie Pathologie Spéciale<br />
Professeur Agrégé Claude AARON: Anatomie Radiologique<br />
"<br />
" "<br />
" Jean-Paul GIROUD Pharmacologie<br />
Jean-Claude KAPLAN Biochimie<br />
Chef de Travaux J. F. DESANGES Physiologie<br />
Chef des Travaux-Assistant des Hôpitaux<br />
A. PHILIPPON Bactériologie<br />
Chef de Clinique-Assistant J. RONDIER Rhumatologie<br />
Assistante<br />
Assistante<br />
Mme LAFITTE<br />
Tourte SCHAEFER<br />
Gastro-Entérologie<br />
Parasitologie
A S SIS TAN T S<br />
ftC,'R'F - "?'<br />
ASSISTANTS DES SERVICES UNIVERSITAIRES DES HOPITAUX<br />
CHARGES DE COURS<br />
Ayité D'ALMEIDA<br />
Kossi Kowu ASSIMADI<br />
Kossi HOMAWOO<br />
Mme Marie-Claude BÉGUÉ<br />
Max DUFRENOT<br />
Komlan EDEE<br />
ASSISTANT ATTACHE<br />
Hygiène<br />
Pédiatrie<br />
Komlavi J \MES Anatomie<br />
PROFESSEURS MISSIONNAIRES<br />
Professeur<br />
"<br />
Claude GALLIEN<br />
Jacques LAPIERRE<br />
Chirurgie-Orthopédie-Traumatologie<br />
Biochimie<br />
Biochimie<br />
Biophysique<br />
Biologie<br />
Parasitologie
A MON PERE ET A MA MERE<br />
A MA GRAND'MERE<br />
A MES ONCLES<br />
A TOUS MES PARENTS<br />
A MA CHERE EPOUSE<br />
A MES CHERS ENFANTS<br />
qui m'ont mis sur la bonne voie et<br />
qui ont accepté de grands sacrifices dûs<br />
à mes études.<br />
qui a contribué au bonheur de mon enfance<br />
et à qui je dédie une affection particulière.<br />
qui m'ont toujours prodigué de bons conseils.<br />
qui m'ont aidé et encouragé.<br />
à qui je dédie ce travail comme signe<br />
de ma profonde reconnaissance.
A MES FRERES ET SOEURS<br />
je crois nvoir joué mon rôle d'aîné en<br />
vous laissant cet exemple.<br />
A LA FAMILLE DOUGLAS DE SAINT-VINCENT<br />
A SYLVIE ET J.<br />
A MON3IEUR KPAKOTE<br />
NETTER<br />
dont le foyer était mon "home" lors de<br />
mon séjour à LONDRES.<br />
Je vous adresse ma profonde gratitude.<br />
Docteurs en Médecine.<br />
Je vous dédie ce travail comme sceau de<br />
l'amitié qui nous lie depuis votre premier<br />
passage au TOGO.<br />
A votre fille Sophie et à vous-mêmes<br />
meS solides amitiés.<br />
de l'Ecole Supérieure d'AGRONOMIE (U. B.)<br />
qui a accepté volontiers d'étudier les plantes<br />
aquatiques.<br />
Je te dédie ce travail pour te témoigner<br />
ma reconnaissance.
A ESTHER KIENTEGA<br />
qui a accepté volontiers de relire ce travailo<br />
A L'AIMABLE PERSONNEL DES MALADIES INFECTIEUSES<br />
AUX DOCTEURS<br />
avec qui je me suis senti en familleo<br />
P. SCHEIBER<br />
Â. D'ALMEIDA<br />
DOGBA<br />
A LAWSON LATEVI DE L'INSTITUT ERNST RODENWALDT.<br />
A MES MAITRES DE L'ECOLE DE MEDECINE TROPICALE DE LONDRES<br />
Professeur LUMSDEN<br />
"<br />
"<br />
pour leur sympathie et la formation<br />
qu'ils m'ont donnéeo<br />
G. NELSON<br />
BERTRM'1<br />
Chef de département de PROTO<br />
ZOOLOGIE<br />
Chef de département de HELMIN<br />
THOLOGIE<br />
Chef de département d'ENTOMOLOGIE
Aux Docteurs<br />
SOUTHGATE<br />
TARGETT<br />
DENAM<br />
A Mon Cher Ani Docteur ALEXANDRE ELLIOT du PEROU<br />
A Monsieur le Professeur Agrégé J.-C. VALCKE,<br />
Chef des Services Médicaux au Centre Hospitalier<br />
Universitaire de LOME<br />
Votre dévouement pour vos malades aux risques<br />
de compromettre votre santé est un exemple que<br />
nous ne manquerons pas de mettre en pratique<br />
dans notre carrière.<br />
Nous vous disons merci.
A Monsieur le Professeur K. KEKEH,<br />
Chef des Services Chirurgicaux au Centre<br />
Hospitalier Universitaire de LOME,<br />
Directeur de l'Ecole de Médecine de l'Université<br />
c<br />
du Bénin<br />
Nous avons saisi en vous l'homme de paroleo<br />
Votre dévouement pour la jeune Ecole de Médecine<br />
depuis sa création et votre lutte inlassable pour<br />
notre cause ont forcé notre respectueuse admiration.<br />
Veuillez trouver dans ce travail le témoignage<br />
de notre profonde reconnaissance.
A Monsieur le Professeur Mawupé VOVOR,<br />
Professeur de Gynécologie-Obstétrique au<br />
Centre Hospitalier Universitaire de LOME,<br />
Directeur de l'Enseignement du Quatrième Degré<br />
du TOGO,<br />
Directeur de l'Ecole Nationale des Sages-Femmes<br />
du' TOGO,<br />
Membre de l'Académie Française de CHIRURGIE<br />
Notre Président de Thèse<br />
Notre Maître de DAKAR et notre Maître de LOME<br />
Vous avez toujours prêté une oreille attentive<br />
à nos problèmeso Vous avez été et demeurez notre<br />
bon conseillero Votre rigueur pour un travail<br />
bien fait et votre souci de justice ont contribué<br />
à faire de nous ce que nous sommes aujourd'huio<br />
Par le stylet de votre humour, vous avez gravé<br />
en nous à la fois des notions scientifiques ardues<br />
et de solides qualités humaineso<br />
Vous nous faites l'honneur de présider cette thèseo<br />
Très humblement nous vous adressons notre recon-<br />
naissanceo
A Monsieur le Professeur ngrégé Afatchao AMEDOME,<br />
Chef du Service des Maladies Infectieuses<br />
au Centre Hospitalier Universitaire de LaME<br />
Mon Cher Maître,<br />
Grâce a vous ce travail a pu être réalisé.<br />
,Vous nous avez toujours entourés de votre chaude<br />
sollicitude. Votre dynamisme et votre infatiga<br />
bilité sont devenus légendaires. Votre sens<br />
pratique aigu nous a toujours mis en confiance<br />
sur le terrain. Votre aide matériel n'est que<br />
le reflet de vos exceptionnelles qualités morales.<br />
Nous vous dédions ce travail en signe de notre<br />
profonde reconnaissance.
T A BLE 55 E S MAT 1ER E S<br />
P A G E<br />
1 Introduction 1 0<br />
2 Généralités sur les bilharzioses 20<br />
a) Historique<br />
b) Rappel des notions acquises 40<br />
cc) Bilharziose dans le monde 120<br />
3, - Présentation géographique du TOGO 140<br />
4 Historique de l'étude de la bilharziose au TOGO 21.<br />
5 Etude épidémiologique de foyers de bilharzioses 27.<br />
dans la circonscription de KLOTO<br />
A<br />
B<br />
c<br />
Situation géographique des villages<br />
Modalités de l'enquête<br />
Résultats<br />
1 Evaluation du parasitisme<br />
humain cartes et tableaux<br />
2 Etude malacologique
l N T R 0 DUC T ION<br />
***********************<br />
Les bilharzioses ou schistosomoses sont des helminthiases connues<br />
au TOGO depuis longtemps. Une corte endémique en a été dressée en<br />
1959 par B. Mc MULLEN et Jo Z. BUZO. Déjà en 1925 certains auteurs<br />
dont M. PELTIER ont étudié la répartition des mollusques hôtes in<br />
termédiaires. Cependant la bilharziose urinaire à s. haematobium<br />
semble la mieux connue parce que la mieux étudiée jusqu'à ce jour.<br />
Au sein de la population togolaise, l'hématurie est un symptôme<br />
fréquent, surtout chez les enfants à l'âge scolaire. Et bien qu'elle<br />
ne soit pas souvent rattachée à sa cause, elle constitue un symptôme<br />
impressionnant et joue ainsi un rôle important dans le dépistage de<br />
l'infection.<br />
Par contre, .la schistosomose â So mGnsoni est quasi inconnue du<br />
grand public probablement parce que ses manifestations cliniques<br />
de début attirent peu l'attention et de surcroît n'ont rien de<br />
spécifique. Par conséquent aucun signe clinique ne fait d'emblée<br />
penser à la bilharziose intestinale. La mise en évidence dans les<br />
selles d'oeufs à éperon latéral est une découverte souvent fortuite<br />
et tous les cas rapportés par les laboratoires d'analyses de diffé<br />
rentes subdivisions sanitaires font partie des examens de selles<br />
de routine.<br />
1 •
HISTORIQUE DE LA BILHARZIOSE<br />
La schistosomose est une parasitose connue depuis la plus haute<br />
antiquité. En ,effet, vers 1500 ans avant l'ère chrétienne, mention<br />
en a été faite en Egypte sous forme de maladie caractérisée par<br />
l'émission d'urines rouges. Plusieurs textes anciens babyloniens<br />
donnaient la description de symptômes identiques en Mésopotamie.<br />
L'autopsie systématique des momies de la XXè dynastie égyptienne<br />
révélait la maladie chez les rois de l'époque.<br />
Au XIVè siècle, les médecins arabes mentionnaient l'émission d'u-<br />
rines rouges chez les habitants des comptoirs commerciaux d'Afrique<br />
Noire et chez les caravaniers qui remontent du Niger vers la Médi<br />
terranée en traversant le désert du SAHARA. Deux siècles plus tard,<br />
les Portugais observent les mêmes symptômes dans leurs comptoirs<br />
africains et puis l'expédition de BONAPARTE en Egypte permit aux<br />
médecins de l'armée française de s'intéresser les premiers à la<br />
schistosomose ..<br />
Jusqué là les hématuries n'étaient pas encore rattachées à laur<br />
cause.<br />
Deux dates sont à retenir. En effet, c'est en 1851 que BILHARZ<br />
travaillant au Caire découvre à l'autopsie d'un sujet mort d'une<br />
affection vésicale, des couples de vers plats munis de deux ven<br />
touses dans le plexus veineux périvésicaux.. Il les nomma Distoma<br />
2.
2 - Poursuite du cycle dans le milieu extérieur<br />
. . ;.<br />
L'oeuf embryonne, au contact de l'eau, éclot et libère des larves<br />
ciliées appelées miracidium. La température de l'eau (25 -30°)<br />
favorise cette éclosion. Le miracidium ne vit pas plus de 24 Ho<br />
à l'état libre. Il nage à la recherche du mollusque spécifique<br />
dont il pénètre alors activement les téguments.<br />
Chez le mollusque spécifique, différents stades larvaires vont<br />
se produire.<br />
Les sporocystes primaires logés dans la cavité respiratoire<br />
donnent par bourgeonnement des sporocystes secondaires qui émigrent<br />
dans l'hépatopancréas. Ceux-ci à leur tour se transforment en cer-<br />
caires. Ainsi en quatre à six semaines après son infestation,<br />
le mollusque libère des milliers de furcocercaires (cercaires a<br />
queue fourche) par un processus de polyembryonie. Elles mesurent<br />
environ 500 !J'.•<br />
L'émission cercarienne, discontinue, est abondante en période<br />
chaude et ensoleillée.<br />
3 - Mode de contamination de l'homme<br />
L'homme se contamine par immersion totale ou partielle du corps<br />
dans une eau contaminée, par pénétration transcutanée des furco-<br />
eercaires eL moins de dix minutes.<br />
9.
BILHARZIOSE DANS LE MONDE<br />
Il existe selon une estimation des experts de l'Organisation Mondiale<br />
de la Santé deux cents à trois cents millions de bilharzieos dans le<br />
12.<br />
monde. La répartition des espèces varient selon les continents.<br />
La bilharziose à S. h2ematobium sévit dans presque toute l'Afrique.<br />
Elle est endémique dans la Vallée du Nil, en Afrique de l'Ouest et<br />
en Afrique du Sud. Elle est moins fréquente en Afrique Equatoriale<br />
et en Afrique du Nord où de petits foyers existent en Tunisieet dans<br />
le Sud du Haroc et de l'Algérie. Elle atteint Madagascar (côté ouest),<br />
la Réunion, l'Ile Maurice, Nossibé .<br />
. Il existe quelques foyers sur le pourtour du Bassin Méditerranéen et<br />
dans le Proche.Orient (Arabie, Iran). En Inde un petit foyer existe<br />
près de Bombay où le mollusque vecteur est Ferrissia tenuis.<br />
En Europe le foyer portugais historique d'Algave, entretenu par<br />
Planorbis metidjensis est en voie d'extinction. L'Amérique est indemne.<br />
- La bilharziose à S. mansoni a une extension très importante en<br />
Afrique. Elle sévit notamment en Egypte, Afrique Occidentale, Orientale,<br />
Equatoriale et en Afrique du Sud. Elle sévit également SUr le côté Est<br />
de Madagascar. En Amérique intertropicale et aux Antilles, elle est<br />
la seule bilharziose connue.
La plaine du Sud de l'Atakora se subdivise en deux portions séparées<br />
par une ligne imaginaire Tsévié-Kouvé. Au Nord de cette ligne quelques<br />
petites collines s'élèvent CD et là : exemple: la colline d'Agbélouhoé.<br />
Au Sud de la ligne Tsévié-Kouvé, s'étend une zone sédimentaire basse<br />
parsemée de dépression marécageuse : basse vallée du Zio et la vallée<br />
du Raho.<br />
La basse plaine sédimentaire du Sud du TOGO se termine par une falaise<br />
qui domine de moins de vingt mètres la zone lagunaire et le cordon<br />
littoral sablonneux, planté de cocotiers.<br />
Lomé, la Capitale s'étend sur le cordon littoral et sur la plaine<br />
sédimentaire.<br />
15·
LE .TOGO EN AFRt:QUE Dt L'OUEST /1
c ) - avec splénomégalie seule<br />
1 (0,850<br />
2° - Sujets non parasités par Schistosoma mansoni<br />
a ) - avec hépatomégalie seule :<br />
36<br />
172 (59%)<br />
82 (4756) dont 53 (64%) sont par-as i t è s par des anky-<br />
lost0illes et des asccris et 29 (35%) sans aucun parasite.<br />
b ) - avec hépatcsplfnom&gôlic<br />
32 (18%) dont 22 (68%) ... ;t'<br />
s o n t parasr es par des as car i o<br />
et des ankylostomes ct 10 (31%) sans autres parasites intestinaux.<br />
c ) - avec spléDomégalie seule
11 - 15<br />
M<br />
F<br />
76<br />
63<br />
T A BLE A U 2<br />
31<br />
32<br />
N<br />
16 - 20<br />
F<br />
---+-.-,-i-----f------+------f------t-------t<br />
21 - 35<br />
M<br />
F<br />
11<br />
21<br />
1<br />
9<br />
23,8<br />
36 - 45<br />
46 - 55<br />
56 - 70<br />
71 - 80<br />
90<br />
M<br />
F<br />
M<br />
F<br />
M<br />
F<br />
M<br />
F<br />
M<br />
F<br />
11<br />
13<br />
8<br />
14<br />
8<br />
10<br />
1<br />
1<br />
1<br />
5<br />
1<br />
2<br />
1<br />
41<br />
51<br />
9<br />
10<br />
9<br />
38.<br />
7 3 21<br />
7,62<br />
14,28<br />
-4-----ii-----r----+--------+-------+ ,..-,-----i-----,,-<br />
92<br />
96<br />
F<br />
F<br />
1<br />
1 1<br />
1<br />
REPARTITION PAR GROUPE D' AGE DE PERSONNES EXAMINEES<br />
DANS LE VILLAGE DE KLONOU
Tranche d'âge 46 - 55 ans<br />
2 hommes sur 14 ont dss oeufs de S. h.<br />
Au-delà de 55 ans, aucun oeuf n'est retrouvé. Comme on peut le re-<br />
marquer aucune infection à s. m. n'a été dépistée à partir de 16 ans<br />
et au-delà dans ce village.<br />
Le graphique 2 montre la différence du taux d'infection des bilhar-<br />
zioses dans ce même village. On note une nette prédominance de la<br />
bilharziose vésicale sur la bilharziose intestinale. Les taux dfim-<br />
fection bilharzienne les plus élevés se situent entre 5 et 15 ans.
2° Sujets non parasités par s. m. 100<br />
a) avec hépatomégalie seule<br />
46 (46%) dont 35 (76%) ont des ankylostomes ou<br />
des ascaris, et 11 n'ayant pas d'autres parasites intestinaux.<br />
des ascaris.<br />
b) avec hépatosplénomégalie<br />
17 (17%) tous parasités par des ankylostomes ou<br />
c) - avec splénomégalie seule 3 (3%)
F<br />
27<br />
20<br />
14<br />
17<br />
T A BLE A u:7'<br />
REPARTITION PJ.R GROUPE D'AGE ET PAR SEXE<br />
35<br />
17<br />
DES FERSONNES EXAl'
24 -,<br />
5<br />
, G R A PHI QUE 3<br />
TOM E<br />
55." -<br />
r- I . ,<br />
i<br />
U il<br />
0 5 10 15 20 35 45 55 70<br />
Infection à S. m. '<br />
1<br />
,
E T U D E MAL A COL 0 G l QUE<br />
61.<br />
Nous avons fait l'expérience des difficultés inhérentes à une<br />
étude malacologique comme l'a souligné GAUD. En effet, en dehors<br />
des conditions climatiques qui influencent la collection des mol-<br />
lusques, il existe des difficultés de localisation des gîtes, même<br />
dans les meilleures conditions. C'est ainsi qu'on ne trouvera aucun<br />
mollusque là où on est presque sÜr d'en trouver. Inversement on<br />
tombe par hasard sur un gîte où abondent les mollusques alors qu'on<br />
ne s'y attendait pas.<br />
Des échantillons de mollusques recueillis dans les gîtes des quatre<br />
villages sont envoyés au Docteur CHEVALLIER du Muséum de l'Histoire<br />
Naturelle, Laboratoire de Malacologie à PARIS pour identificationo<br />
Signalons que la recherche des mollusques a eu lieu deux fois par<br />
mois pendant toute l'année et nous avons pu ainsi suivre la variation<br />
de la population en fonction des saisons.<br />
Dans les gîtes des quatre villages, "POTA-DOMA" Togoensis", nouvelle<br />
espèce non encore décrite se rencontre en toutes saisons et en nombre<br />
presque invariableo Cette invariabilité dans la population peut<br />
s'expliquer par le fait que ces mollusques ont une forte attache<br />
sur leur support (rochers, cailloux)o On les voit souvent remonter<br />
le courant sur leur support.
Quelque soit la force du courant, très peu sont emportés à la dérive.<br />
Mais ils ne jouent aucun rôle comme vecteur de bilharziose. Leur den<br />
sité varie de 150 à 200 mollusques collectés par heure et par personne.<br />
Gyraulus costulatus Krauss sont des planorbidés non décrits comme<br />
vecteur du Schistosoma mansoni. Et d'ailleurs leur exposition à la<br />
lumière pendant une matinée à plusieurs reprises n'a montré aucune<br />
infestation.<br />
Ils peuplent les gîtes de KLONOU et de YOKELE uniquement. Leur popu<br />
lation varie avec les saisons. En effet, en saison sèche on en récolte<br />
facilement 200 par heure et par personne. En saison pluvieuse le<br />
courant les emporte. Il faut attendre trois mois après les pluies<br />
pour retrouver une population jeune.<br />
Bullinus globosus Morelet : peuple surtout le gîte de AGBESSIA. On en<br />
trouve très peu à KLONOU et a TOME (5 mollusques / heure et par homme).<br />
Les saisons influent sur leur nombre.<br />
La saison sèche ayant duré trop longtemps cette année dans la circons<br />
cription, les rivières se sont asséchées ne laissant que des flaques<br />
stagnantes par endroits dans leur lit. Ceci nous a permis de récolter<br />
220 bullins par heure et par personne eq un seul gîte.<br />
Nous n'avons trouvé aucun planorbe dans le dit gîte.<br />
......t\<br />
62.
dans les conditions de laboratoire est plus importante.<br />
Nous avons pu séparer les oeufs de Schistosoma mansoni de l'excès de<br />
déchets fécaux, à l'aide d'un agitateur électrique. Les Biomphalaria<br />
ont été wis ensemble avec les miracidja . Quatorze planorbes ont été<br />
ainsi infectés. Six semaines plus tard 10 d'entre eux ont émis des<br />
cercaires mais malheureusement, la mortalité importante (70%) n'a pas<br />
permis la poursuite du cycle expérimental•<br />
. "<br />
64.
phénate de sodium. Le produit chimique idéal serait celui qui agirait<br />
à très faible concentration d'une part et qui ne seraît toxique ni pour<br />
la faune et la flore aquatique, ni pour l'homme d'autre part. Or les<br />
produits utilisés jusqu'à présent sont toxiques pour les poissons et<br />
l'homme, bien sûr à des degrés divers et leur efficacité est influencée<br />
76.<br />
par de nombreux facteurs: pH et turbidité de l'eau, fixation d'une<br />
partie du produit sur la boue ou le sable constituant le lit du cours<br />
d'eau, désintégration et inactivation par les rayons ultra violets<br />
du soleil.<br />
En outre, ils coûtent très chers.<br />
Les grands travaux d'assèchement et de désherbage des marais et des<br />
étangs, leur drainage par des canaux constituent une des phases de<br />
la lutte contre les mollusques.<br />
La troisième phase de la prophylaxie consiste à empêcher le contact de<br />
l'homme avec l'eau infectée. L'interdiction de déféquer et d'uriner<br />
n'importe où préviendrait la pollution des eaux. La distribution d'eau<br />
potable par fontaines dans tous les centres ruraux, la création de<br />
piscines protégées par adduction d'eau mettrait la population à l'abri<br />
de la contamination et des réinfestations. L'exemple de la piscine de<br />
Bembéréké au Dahomey cité par GAUD est instructif. Car comme l'a dit<br />
à juste titre le Directeur du Service de Santé de la Province de KASAI<br />
cité par le même auteur : "Nous ne pe nsons pas que nous puissions<br />
arriver à une stérilisation de la région avant que le problème de l'eau
En ce qui concerne la région intéressée par notre étude, le reseau<br />
hydrographique faciliterait une lutte contre les mollusques parce que<br />
la rivière Hédzo représente un des principaux cours d'eau vers lequel<br />
sont drainés les petits affluents. Cependant le débit irrégulier des<br />
cours d'eau constitue un sérieux handicap. Il faudrait choisir la<br />
bonne saison, par exemple la saison sèche, pour l'épandage de mollus-<br />
78.<br />
cocides, pour les raisons que nous avons citées plus haut.<br />
Par ailleurs, KLOTO étant l'une des régions les plus arrosées du TOGO<br />
. 1 :.'....<br />
(1.600mm de pluie par an) le problème de distribution de l'eau par<br />
fontaines serait beaucoup plus facile à résoudre.<br />
Il est évident que la lutte contre la bilharziose dans cette région<br />
doit s'intégrer dans un progrdmme global de contrôle sur toute l'étendue<br />
du territoire et si possible s'organiser de concert avec les pays limi-<br />
trophes. Et malgré les problèmes complexes que pose cette lutte, l'édu-<br />
cation sanitaire demeure le Beul moyen à la portée des pays pauvres.<br />
La bilharziose étant l'affection des populations à niveau socio-écono-<br />
mique bas, elle dieparaitra avec l'élevation du niveau de vie<br />
c'est-à-dire quand chaque village aura ses fontaines et ses latrines<br />
ou mieux quand chaque foyer aura son eau courante et son water closet,<br />
quand un système d'évacuation des égouts sera mis au point et que<br />
chaque individu, grâce à l'élevation du niveau intellectuel aura<br />
compris l'importance des mesures prophylactiques.
Les populat10ns de mollusques subissent une fluctuation au cours des<br />
différentes saisons.<br />
D'autres mollusques comme POTADOMA "Togoensis", Gyraulus costulatus<br />
Krauss peuplent ces gîtes mais ne jouent aucun rôle dans la transmission<br />
de la bilharziose.<br />
Nous avons soulevé la complexité des problèmes concernant la prophylaxie<br />
de la bilharziose par exemple le danger du traitement de masse, la toxi<br />
cité des molluscoscides pour l'homme et les poissons, le coüt élevé de<br />
ces produits.<br />
Malgré tout, nous avons retenu l'éducation sanitaire comme la clé de<br />
voûte de la prophylaxie antibilharzienne et le seul moyen disponible<br />
entre les mains des pays pauvres.
A N N Ji' X E S
1 Gîte de Biomphalaria pfeifferi<br />
2 Gîte de Bullinus globosus<br />
92.
\<br />
\<br />
1<br />
B l B LlO G R A PHI E
12 LE GALL (R.)<br />
88.<br />
Les bilharzioses en Afrique Occidentale<br />
Française, au TOGO et à Madagascar de 1939 à 1941.<br />
Off Int. Hyg. Publ. Bull. mens. 1944, 36, 122 - 124.<br />
13 LIBREZ (P.), COCHETON (J. J.) Les bilharzioses génito-urinaires.<br />
Le Concours Médical, '22 - 12 - 1973, - 96 - 51,<br />
7835 - 43.<br />
14 MANDAHL BARTH (G.), MALAISSE (F.), RIPERT (C.)<br />
Etude malacologique dans la région du lac de<br />
retenue de la Lufira (KATANGA).<br />
Distribution et écologie des mollusques<br />
aquatiques. Rôle épidémiologique des vecteurs<br />
des bilharzioses intestinale et urinaire •<br />
Bull. Soc. Path. Exo t , 1972, 65, (6), 146 - 164.<br />
15 MONSEUR (J.,), RIPERT (C.), RACCURT (C.), LAGOUTTE (J.),<br />
FOND (G.), HUMEAU (F.).<br />
Etude épidémiologique des bilharzioses intestinale<br />
et urinaire dans la région du lac de retenue de<br />
la Lufira (IV). Retentissement de l'helminthiase<br />
sur la santé d'après l'examen des lésions urolo<br />
giques de sujets émettant des oeufs de Schistosoma<br />
haematobium.<br />
Bull. Soc. Path. EXot. 1972 - 65, (6), 822 - 840
21 SOW (A. M.), DIOP MAR (1.), TOSSOU (H.)<br />
90.<br />
Les antibilharziens, indications cliniques.<br />
Médecine d'Afrique Noire 1973, 20 (10), 791 - 797.<br />
22 TOGO Ministère de la Santé Publique et des Affaires<br />
Sociales -<br />
Service National de la Statistique Sanitaire<br />
Situation sanitaire 1971 publié en 1974, 32 - 33·