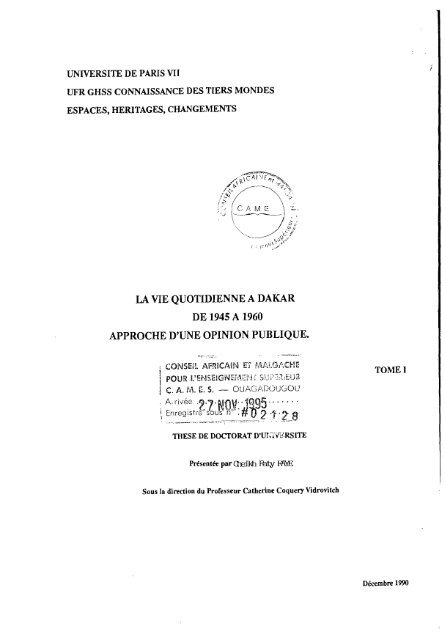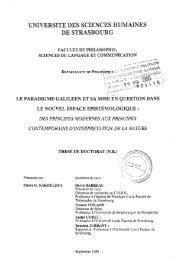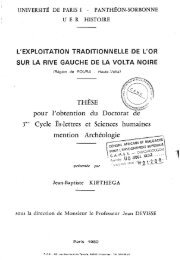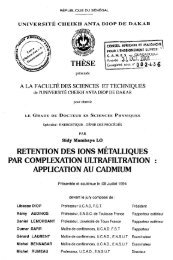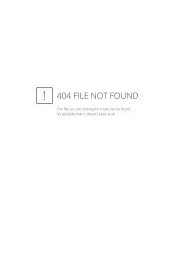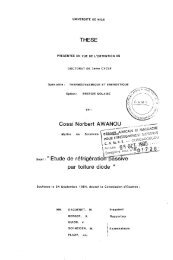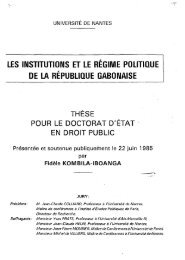CS_02128.pdf
CS_02128.pdf
CS_02128.pdf
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
DEDICACE<br />
Aux élèves des générations présentes et futures de l'école élémentaire Gomack<br />
Coumba Ndiaye du village de Dionewar - dans les îles du Saloum au Sénégal - je dédie<br />
ce travail espérant qu'ils soient nombreux à s'investir dans la recherche.<br />
Si ce modeste exemple pouvait servir à mes enfants...<br />
1
REMERCIEMENTS.<br />
Ce travail universItaIre nous a conduit dans diverses bibliothèques et<br />
plusieurs services d'archives tant au Sénégal qu'en France. Aussi à tous les personnels<br />
de ces structures je prie de bien vouloir trouver ici, un témoignage de gratitude<br />
profonde. Beaucoup de personnes ont accepté avec joie, de répondre à un questionnaire<br />
écrit tandis que d'autres ont préféré la discussion à bâtons rompus. Les uns et les autres<br />
m'ont éclairé sur divers points d'ombre. J'espère avoir traduit fidèlement leurs propos et<br />
les remercie très sincérement pour leur disponibilité.<br />
Je cite - avec le risque d'être partiel- Mbah Diatta, Khady Diouma, Madame<br />
Gnima, Mamadou Sama Senghor, Mamadou Thié Diouf, Pape Ansou, Djibril Khady<br />
Faye, El Hadj Amadou Ndour et Aminata Maï Sarr. A toutes ces personnes de<br />
Dionewar, je sais gré de leurs encouragements chaleureux et constants.<br />
Bintou Mariama Sarr s'est beaucoup souciée de l'avancement de ce travail et<br />
n'a ménagé aucun effort pour soutenir l'auteur, comme Moussa Ndoucou Ndong et<br />
Khady Sarr.<br />
A y ouba Sambou, Amadou Gando Souaré, Badara Ciss, Marakary<br />
Danfakha, je renouvelle un témoignage d'amitié profonde et sincère exactement comme<br />
je l'ai déjà fait, il y a de cela vingt ans, dans un travail universitaire plus modeste. Que<br />
Marie Thérèse Gauthier, Michelle Taurines, Yvette Le Lait, Malick Ndiaye et Papa<br />
Waly Danfakha qui ont bien accepté de relire et corriger ce travail me pardonnent les<br />
insuffisances.<br />
Mes maîtres de l'université de Paris VII, U.F.R G.H.S.S reçoivent ici mes<br />
remerciements sincères pour l'encadrement dont j'ai été l'objet à toutes les étapes de ce<br />
travail. Une mention toute particulière pour mon directeur de recherches, Mme<br />
Catherine Coquery Vidrovitch qui a bien compris qu'en plus de ma préoccupation<br />
académique, mon séjour en France avait aussi une autre raison fondamentale: de santé.<br />
A toutes les autorités sénégalaises de l'Education Nationale, à la direction de<br />
l'Ecole Normale Supérieure de Dakar et à l'ensemble de mes collègues de cette<br />
structure de formation pédagogique, je prie d'accepter mes remerciements sincères. A<br />
toutes les personnes qui ont soutenu moralement et/ou matériellement ce travail et qui<br />
ne trouveront pas leurs noms, j'adresse aussi un mot de haute signification: gratitude.<br />
II
F.O.M: France d'Outre-Mer<br />
ABREVIATION<br />
M.F.O.M: Ministère de la France d'Outre-Mer<br />
A.O.F: Afrique Occidentale française<br />
A.E.F: Afrique Equatoriale française<br />
T.O.M: Territoires d'Outre-Mer<br />
U.F. : Union Française<br />
G.G: Gouvernement Général<br />
G.C: Grand Conseil<br />
E.N.F.O.M : Ecole Nationale de la France d'Outre-Mer.<br />
F.LD.E.S :Fonds d'Investissement pour le Développement économique et social<br />
C.C.F.O.M :Caisse Centrale de la France d'Outre-Mer.<br />
F.C.F.A : France pour les Colonies Françaises d'Afrique.<br />
c.C.C : Comité Consultatif Constitutionnel.<br />
S.LC.A.P : Société Immobilière du Cap-Vert.<br />
B.O.M : Bureau Organisation et Méthode.<br />
LF.A.N : Institut Français d'Afrique Noire.<br />
R.A.N : Réseau d'Afrique Noire.<br />
Haussaire : abréviation télégraphique pour Haut Commissaire.<br />
Partis politiques<br />
S.F.LO : Section Française de l'Internationale Ouvrière.<br />
B.D.S : Bloc Démocratique Sénégalais.<br />
R.D.A: Rassemblement Démocratique Africain.<br />
M.P.S : Mouvement Populaire Sénégalais.<br />
B.P.S : Bloc Populaire Sénégalais<br />
U.P.S : Union Progressiste Sénégalaise.<br />
P.A.I : Parti Africain de l'Indépendance.<br />
P.LT: Parti de l'Indépendance et du Travail.<br />
M.L.N : Mouvement de Libération Nationale.<br />
R.P.F: Rassemblement du Peuple Français.<br />
P.R.A : Parti pour le Regroupement Africain.<br />
P.R.A/S : Parti pour le Regroupement Africain du Sénégal<br />
III
1<br />
P.S.S : Parti de la Solidarité Sénégalaise.<br />
LO.M : Indépendants d'Outre-Mer.<br />
P.F.A : Parti pour la Fédération Africaine.<br />
P.D.C.I: Parti Démocratique de Côte d'Ivoire.<br />
P.D.G : Parti Démocratique de Guinée.<br />
U.S : Union Soudanaise.<br />
P.C.F. : Parti Communiste Français.<br />
C.G.T: Confédération Générale du Travail.<br />
Organisations syndicales<br />
C.T.T/ A : Confédération Générale des Travailleurs d'Afrique.<br />
F.O : Force Ouvrière.<br />
C.F.T.C : Confédération Française des Travailleurs Croyants.<br />
C.AT.C : Confédération Africaine des Travailleurs Croyants.<br />
U.G.T.AN : Union Générale des Travailleurs d'Afrique Noire.<br />
F.S.M : Fédération Syndicale Mondiale.<br />
C.LS.L : Confédération Internationale des Syndicats Libres.<br />
F.S.C.A : Fédération des Syndicats de Cheminots africains.<br />
Synep : Syndicat de l'enseignement primaire.<br />
S.U.E.L: Syndicat Unique de l'Enseignement Laïc.<br />
Unisyndi : Union des syndicats industriels.<br />
U.T.S : Syndicat des commerçants, importateurs et exportateurs.<br />
U.T.S : Union des Travailleurs du Sénégal.<br />
C.N.S.M : Confédération nationale des Syndicats du Mali.<br />
Organisation de jeunesse. d'étudiants, de femmes<br />
C.J.S. : Conseil de la Jeunesse du Sénégal.<br />
C.J.A. : Conseil de la jeunesse d'Afrique.<br />
J.R.D.A. : Jeunesse du Rassemblement Démocratique Africain.<br />
R.J.D.A: Rassemblement de la Jeunesse Démocratique d'Afrique.<br />
M.J .S.F.I.O : Mouvement de la Jeunesse de la Section Française de l'Internationale.<br />
M.J.B.D.S: Mouvement de la Jeunesse du Bloc Démocratique Sénégalais.<br />
C.J.U.F: Conseil de la Jeunesse de L'Union Française.<br />
F.M J.D : Fédération Mondiale de la Jeunesse Démocratique.<br />
W.AY: World Assembly Young.<br />
AG.E.D : Association Générale des Etudiants de Dakar.<br />
AG.E.F.A.N : Association Générale des Etudiants Français d'Afrique Noire.<br />
IV
U.G.E.A.O: Union Générale des Etudiants d'Afrique Noire.<br />
F.E.A.N.F : Fédération des Etudiants d'Afrique Noire en France.<br />
U.N.E.F : Union Nationale des Etudiants de France.<br />
U.G.E.M.A: Union Générale des Etudiants Algériens.<br />
A.M.E.A.N: Association Musulmane des Etudiants d'Afrique Noire.<br />
Cosee: Comité de Coordination d'unions nationales d'étudiants.<br />
M.E.P.A.I : Mouvement des Etudiants du Parti Africain de l'Indépendance.<br />
A.E.R.D.A : Association des Etudiants du Rassemblement Démocratique Africain.<br />
U.C.M : Union Culturelle Musulmane<br />
U.F.S : Union des Femmes du Sénégal.<br />
U.F.O.A: Union des Femmes de l'Ouest Africain.<br />
Autres sigles<br />
C.E.F.A : Comité d'Etudes Franco-Africaines.<br />
G.E.C: Groupe d'Etudes Communistes.<br />
C.C.A.! : Chambre de Commerce, d'Agriculture et d'Industrie.<br />
G.I.A: Grande Imprimerie Africaine.<br />
A.D.P : Agence de distribution de presse.<br />
A.F.P : Agence France Presse.<br />
D.A.F.: Défense de l'Afrique Française.<br />
v
INTRODUCTION GENERALE<br />
PROBLEMATIQUE<br />
Le sujet de cette recherche : "La vie quotidienne à Dakar de 1945 à 1960 :<br />
approche d'une opinion publique" est neuf dans la mesure où jusqu'à présent un travail<br />
de cette nature n'a pas été mené sur le Sénégal et plus particulièrement sur cette ville.<br />
L'orientation fondamentalty\?e voir comment, quotidiennement, la<br />
population d'une grande métropole coloniale réagit face aux événements locaux,<br />
métropolitains ou internationaux qui l'intéressent directement ou indirectement. Les<br />
limites chronologiques sont:<br />
* 1945 : Par la capitulation sans condition de l'Allemagne nazie au début de<br />
mai et du Japon militariste cinq mois plus tard, la deuxième guerre mondiale s'achève.<br />
La ville de Dakar, hors du principal théâtre des opérations, a pourtant connu dans sa<br />
chair et dans sa sueur les affres du conflit. Aussi, elle a accueilli dans la joie et l'espoir la<br />
fin des hostilités.<br />
* 1960 marque l'accession du Sénégal comme de presque tous les territoires<br />
d'AOF et d'AEF à la souveraineté internationale. Ainsi des espoirs légitimes sont<br />
nourris dès lors que des nationaux prennent en mains tout l'appareil du nouvel Etat<br />
malgré les insuffisances et faiblesses nées des mécanismes voulus, définis et exécutés par<br />
la puissance coloniale dans cette passation du pouvoir.<br />
Dans cette période ainsi délimitée, d'importants événements se produisent<br />
tant au niveau local que métropolitain et international et influencent largement la<br />
situation dans cette grande capitale fédérale de l'ensemble colonial de l'AOF.<br />
Cette ville a connu un net accroissement de sa population tant dans sa<br />
composante d'origine métropolitaine que dans celle d'origine africaine, tout comme<br />
dans celle d'origine levantine. Schématiquement, en elle même, chacune de ces<br />
composantes constitue une force s'appuyant sur des leviers précis pour défendre des<br />
intérêts propres. Dans le détail, il y a divers sous- groupes de pression ou "faiseurs<br />
d'opinion". Ce sont: partis politiques, mouvements syndicaux, organisations de jeunesse,<br />
d'étudiants, groupements à intérêt économique ou religieux etc...Dans chacun de ces<br />
sous- groupes, on note une multitude d'orientations. Chaque groupe ou sous- groupe<br />
. s'organise de manière à être indépendant, opérationnel, solide et combatif dans la<br />
défense de ses intérêts. Celle-ci suppose également que les moyens de communication,<br />
d'information et d'expression disponibles soient entièrement mis à contribution pour<br />
atteindre les objectifs visés.<br />
1
@/b<br />
Y , l '<br />
//<br />
Or ces objectifs, non seulement ne concordent pas toujours mais, souvent,<br />
sont diamétralement opposés. Ainsi, lorsque l'administration coloniale refuse<br />
l'application d'un code du travail aux organisations syndicales, elle défend ses intérêts de<br />
dominateur mais aussi d'employeur de la fonction publique. Dans ces conditions, elle est<br />
appuyée ouvertement ou pas par les grands milieux d'affaires soucieux de ne pas donner<br />
satisfaction aux revendications des travailleurs salariés. On voit dès lors, les centrales<br />
syndicales chercher à remettre en cause la domination coloniale qui se met au service du<br />
patronat qui les exploite, et développer leurs relations avec les partis politiques mais<br />
aussi avec les organisations progressistes de jeunes, d'étudiants, de femmes etc... qui·<br />
s'assignent les mêmes objectifs.<br />
Cette lutte a pour principal théâtre le territoire de la Fédération mais elle<br />
peut se transposer en métropole où se trouve le pouvoir réel de décision politique,<br />
administratif et économique. D'autres théâtres secondaires peuvent exister ailleurs selon<br />
la nature et l'intensité du conflit. Ainsi, la bataille de l'AGED - plus tard UGEAO<br />
déborde le cadre de l'Union française pour se poser à diverses instances de l'U.I.E car<br />
les étudiants de Dakar comprennent bien l'intérêt qu'ils peuvent tirer dans une activité<br />
internationale indépendante. De même, le mouvement réformiste islamique qui se<br />
développe veille suffisamment à ne pas être coupé du monde musulman qui le nourrit<br />
intellectuellement mais peut-être aussi financièrement.<br />
La réforme politique introduite en 1956 par la Loi-Cadre responsabilise les<br />
élites autochtones car la métropole est tenaillée par le contexte national et international<br />
et tire la leçon des événements d'Indochine et d'Afrique du nord. Comment les élites<br />
autochtones héritières du pouvoir l'assument et dans l'intérêt de qui principalement?<br />
Les dernières Années de notre période se caractérisent par la naissance d'espoirs mais<br />
très vite déçus.<br />
La question essentielle de comment vivent les diverses composantes de la<br />
population dakaroise nous conduit à voir leurs réactions devant les questions comme<br />
l'accaparement de la terre par le colonisateur, la nature et l'équipement de l'habitat,<br />
l'alimentation, la santé et l'hygiène, l'école et la culture, l'impôt, le transport etc... La<br />
condition de la femme dakaroise reste un important élément pour connaître la vie<br />
quotidienne. Malgré ses responsabilités sociales importantes, elle a été marginalisée<br />
pour des raisons liées au passé mais aussi au fait que l'administration s'est peu souciée<br />
d'elle.<br />
L'objectif de cette étude est d'ajouter une pierre à la connaissance de la vie<br />
quotidienne de la population dakaroise sensible aux souffles de toutes parts. En ce sens,<br />
sa prétention est grande. Reste donc à la mener de façon scientifique car les matériaux<br />
sont certes nombreux maiS pas toujours faciles à utiliser.<br />
2
LA QUESTION DES SOURCES<br />
Les sources pour connaître cette opinion publique existent. Elles sont même<br />
nombreuses et variées.<br />
On peut citer:<br />
- la presse écrite, parlée ou filmée,<br />
- les documents de l'administration,<br />
- les documents des institutions à caractère politique, économique, social...<br />
- les travaux de congrès, colloques, séminaires, symposiums, journées<br />
d'études, enquêtes, discours ...<br />
etc ...<br />
-les ouvrages généraux ou spécifiques sur l' AOF, sur le Sénégal, sur Dakar...<br />
- les interviews que l'on peut réaliser<br />
- d'autres matériaux comme la chanson populaire à l'époque, l'habillement<br />
Bien entendu, l'utilisation de matériaux aussi divers impose une démarche<br />
prudente pour en tirer un résultat objectif, donc crédible. C'est dire donc que faire une<br />
analyse critique des sources utilisées est un élément important dans ce travail de<br />
recherche.<br />
I/PRESENTATION DES SOURCES<br />
1) la presse.<br />
Pendant la période 1945-1960, on peut dire que Dakar a connu un regain<br />
d'activité en matière de presse. En effet, contrairement à la période de la guerre (1939<br />
1945) et plus particulièrement à l'époque vichyste à Dakar (1940 à 1943) pendant<br />
laquelle cette presse fut bâillonnée, au sortir de la guerre, une véritable renaissance<br />
s'opère. Ce sont quelques 160 titres qui existent. De 1914 à 1939, seulement la moitié<br />
avait vu le jour au Sénégal 1 .<br />
Les quotidiens restent peu nombreux et ceux: qui couvrent toute la période<br />
sont trois au maximum. On peut citer le journal Paris Dakar qui est le seul important en<br />
réalité à être diffusé largement à Dakar, mais aussi le Bulletin quotidien de l'Agence<br />
France Presse qui a ouvert un bureau à Dakar ainsi que le Bulletin quotidien de la<br />
Chambre de Commerce. Les hebdomadaires et mensuels sont plus nombreux;<br />
cependant, pour l'essentiel, la parution de ces journaux est irrégulière parce qu'ils sont<br />
conditionnés par des événements occasionnels.<br />
1. Symbiose, Revue de coopération germano-sénégalaise nO 9, 2ème semestre 1986, Dakar.<br />
3
- Les documents de la Chambre de Commerce de Dakar<br />
On a signalé l'existence d'un bulletin quotidien édité par la Chambre de<br />
commerce de Dakar. Même si ce document n'est pas expressif des préoccupations du<br />
petit peuple de Dakar, il a une valeur très grande car exprimant les vues des grands<br />
milieux du négoce et de l'industrie. Outre ce bulletin quotidien, il y a également les P.V<br />
des délibérations, les notes techniques, les synthèses etc... La variété de ces éléments<br />
indique, le poids et le degré d'information de ces milieux dans la ville de Dakar. La<br />
permanence des relations entre cette Compagnie et les hautes sphères de<br />
l'administration coloniale et aussi des milieux politiques locaux est la donnée<br />
fondamentale du bon niveau d'information de cette institution.<br />
De plus, contrairement aux hautes sphères de l'administration, les milieux<br />
constituant la chambre de commerce de Dakar sont présents dans la ville depuis fort<br />
longtemps en général, ce qui représente un poids non négligeable dans le cadre des<br />
contacts et de l'information.<br />
4) les travaux de congrès, séminaires, colloques, symposiums, conférences,<br />
journées d'études etc ..,<br />
La richesse de l'activité politique, économique, intellectuelle, culturelle et<br />
sociale du Dakar des Années 1945 à 1960 donne une idée de l'importance à accorder<br />
aux travaux de ces rencontres.<br />
Ces documents se retrouvent pour une large part dans la presse politique,<br />
économique, syndicale, ou culturelle mais aussi dans les documents de l'administration<br />
surtout dans le cadre de la surveillance des organisations dont certaines sont<br />
officiellement reconnues, contrairement à d'autres. Dans tous les cas, les manifestations<br />
pour être organisées, avaient besoin, pour maintes d'entre elles, de l'autorisation ou de<br />
l'appui de l'administration quand ce n'est pas elle même qui les organise directement.<br />
Certains de ces travaux concernent des manifestations se tenant à Dakar même, ou au<br />
Sénégal ou ailleurs dans la Fédération, si ce n'est pas en Métropole même ou quelque<br />
part dans l'Union française ou dans le reste du monde. Les infrastructures relativement<br />
importantes dans la capitale de l'AOF expliquent que beaucoup d'activités s'y déroulent.<br />
5) Les ouvrages.<br />
Pratiquement, aucun n'est directement proche de notre sujet de recherche.<br />
Cependant, certains concernent les études d'opinion, d'autres portent sur la ville de<br />
Dakar elle même, et sur des aspects variés.<br />
Les ouvrages sur l'histoire politique, économique et sociale de la métropole<br />
de la ériode permettent également de mieux comprendre les problèmes qui se posent à<br />
6
Cette expérience est racontée simplement pour montrer que dans le cadre de<br />
ce genre de travail, au Sénégal, aucune précaution n'est de trop. Je ne veux pas dire<br />
pourtant que les personnalités sénégalaises ne tenaient pas en respect un chercheur. En<br />
effet, je compris plus tard que la carrière politique se jouait dans cette période de nos<br />
rendez-vous. Il ne pouvait peut être pas, répondre négativement à ma demande car<br />
j'étais recommandé par des relations à elle.<br />
7) Les émissions radiophoniques et télévisées.<br />
Des archives sonores sont disponibles à l'ORTS (Office de Radiodiffusion et<br />
Télévision du Sénégal). Il s'agit d'enregistrements radiophoniques effectués à propos de<br />
certains événements importants de la période tels que le passage du général de Gaulle à<br />
Dakar en fin Août 1958, sa venue dans la capitale de l'AOF en tant que président de la<br />
Communauté française en décembre 1959, la proclamation de l'indépendance de la<br />
fédération du Mali le 20 juin 1960 et la rupture de celle-ci deux mois plus tard etc...<br />
Beaucoup d'autres enregistrements sont disponibles même si certains sont dans un état<br />
déplorable en raison des conditions matérielles de conservation. Se pose parfois à<br />
l'ORTS le moyen adéquat d'audition sur place pour le chercheur qui a repéré un<br />
enregistrement susceptible de l'intéresser.<br />
Toujours à propos d'émissions radiophoniques, nous avons souvent écouté<br />
R.F.I (Radio France Internationale) dans le cadre d'émissions spéciales comme<br />
"Mémoire d'un continent" ou "Livre d'or", lesquelles permettent à des personnalités<br />
africaines ou françaises de donner un point de vue sur tel ou tel événement passé, ou de<br />
présenter un livre ou un article. Au niveau de l'ORTS, il y a dans la même ligne une<br />
émission intitulée "Confidences autour d'un micro". Nous avons aussi pu participer en<br />
tant que chercheur invité à un débat sur la préparation à Dakar de l'arrivée du général<br />
de Gaulle en fin août 1958. L'émission s'intitulait "Les porteurs de pancartes".<br />
Ces émissions de l'üRTS ou de RFI constituent, de par la qualité des<br />
animateurs et invités, une source intéressante pour l'histoire de l'Afrique de l'ouest. En<br />
ce sens, elles nous ont permis de compléter les diverses sources que nous avons passées<br />
en revue plus haut.<br />
Quant aux émissions télévisées, rappelons que ce moyen moderne de<br />
communication de masse n'existait pas encore en AOF à l'époque qui nous intéresse.<br />
Même pour la métropole, la télévision n'était qu'à ses débuts. La première chaîne de<br />
télévision française c'est à dire TF1 vient de fêter, le 3 Août 1989, ses quarante ans. A<br />
l'ORTS de Dakar, quelques enregistrements télévisés existent sur la période qui nous<br />
intéresse. Cependant, elles ne sont que le fruit d'une coopération récente entre le<br />
Sénégal et la France dans le domaine de la culture.<br />
8
La diversité de la vie politique, syndicale et culturelle à Dakar pendant cette<br />
époque, malgré les insuffisances décelées dans les sources, est d'un intérêt évident pour<br />
le chercheur qui sait utiliser judicieusement ces matériaux en question. La présentation<br />
et la critique des sources que nous venons de faire n'ont été que sommaires. Elles sont<br />
plus détaillées dans l'étude elle-même.<br />
11
PROPOS PRELIMINAIRES<br />
CONSIDERATIONS GENERALES SUR LA VILLE DE DAKAR<br />
12
de l'habitat, l'instruction, la santé etc... Les recensements, sondages et autres sources<br />
indiquent une réelle progression de la population dakaroise. C'est ce qui fait dire à Paul<br />
Mercier, chef de l'équipe sociologique de Dakar que la population a triplé entre 1938,<br />
veille de la deuxième guerre mondiale, et 1955, année du recensement général.<br />
L'accroissement accéléré de la population dakaroise n'est pas un fait isolé. En effet, les<br />
principales villes du Sénégal connaissent le même phénomène ainsi que l'atteste le<br />
tableau suivant7 :<br />
Villes 1945 1950 1956 1960 Taux<br />
Saint-Louis 51.000 60.000 37.100 48.800 -4,3%<br />
Thiès 24.000 38.700 42.100 69.100 287%<br />
Rufisque 43.000 34.000 39.800 49.700 115 %<br />
Ziguinchor 10.000 16.100 22.400 29.800 298 %<br />
Kaolack 30.000 38.500 42.100 69.600 232%<br />
Diourbel 13.000 14.300 20.600 28.600 220%<br />
Ces exemples montrent un réel accroissement de la population urbaine du<br />
Sénégal dans la période de 1945 à 1960. Mais, en fait c'est toute la population du<br />
Sénégal qui augmente.<br />
D'après Régine Bonnardel, le taux d'accroissement de la population de<br />
Dakar dans la période de 1921 à 1955 est de 4,9% et entraîne son doublement tous les<br />
15 ans. Ce taux passe en 1960 à 9,9 % par an, ce qui est remarquable car il est le double<br />
de celui de la période précédente 8 . Assane Seck explique cet important accroissement<br />
de la population par la politique des grands travaux créateurs d'emplois que la grande<br />
métropole a connue; mais aussi par l'évolution du statut de la ville pendant la période,<br />
puisqu'elle devient successivement capitale du Sénégal et de la fédération du Mali.<br />
Cette importance de l'immigration vers Dakar est attestée par le fait que 47 %<br />
seulement des habitants de la ville sont nés dans la presqu'île du Cap Vert; c'est dire<br />
que 53 % proviennent de cette immigration. Ces chiffres sont fournis par Assane Seck<br />
sur la base des éléments issus du recensement de 1955(9).<br />
Cette population dakaroise représente 2,6 % de la population totale du<br />
Sénégal en 1921; dès 1926, elle monte à 2,95 %, atteint 5,20 % en 1936, 10,55 % en 1955<br />
et 12,98 % en 1960-61.<br />
7. Zuccarelli, p. 32.<br />
8. Regine N'guyen Van Chi Bonnardcl : La vie de relations au Sénégal. P 89.<br />
9. Assane Seck, Dakar en devenir, 1968, p. 55<br />
14·
TABLEAU DE L'EVOLUTION DE LA POPULATION DE DAKAR<br />
DEPUIS 1878.DID<br />
ANNEES Nombre d'habitants<br />
1878 1.560<br />
1891 8.700<br />
1904 18.400<br />
1910 26.000 dont 23.600 Africains<br />
1914 26.800 dont 24.300 "<br />
1921 33.400 dont 31.000 "<br />
1931 54.000 dont 47.400 "<br />
1936 92.000 dont 85.000 "<br />
1948 185.400 dont 168.100 "<br />
1955(11) 230.579 dont 200.780 "<br />
1960 374.000<br />
NAISSANCES ET DECES ENREGISTRES DANS LA COMMUNE DE<br />
DAKAR 1 2<br />
ANNEES NAISSANCES DECES BALANCE<br />
1936 2477 1771 + 706<br />
1945 5441 3012 + 2429<br />
1955 12.867 4800 + 8067<br />
1961 19.933 5314 + 14.619<br />
10. Recensement démographique de 1955, fascicule n 0 1, p.6.<br />
11. Y compris une population Oottante totale de 16.409 personnes dont 15.766 Africains.<br />
12. Etude sur la situation de la jeunesse au Sénegal, Conseil Economique et Social, Avis n066-06, Mars 1966, p.36.<br />
15
11/ COMPOSITION RACIALE ET RELIGIEUSE.<br />
La population de Dakar se compose de cinq grands groupes ethniques que<br />
sont les Africains, les Européens, les Levantins, les Cap verdiens ou "Portugais" et les<br />
Eurafricains.<br />
- Le groupe "indigène"<br />
C'est celui des Africains.' Chronologiquement c'est le premier à s'installer<br />
mais ce groupe n'est pas homogène.<br />
L'état-major de l'AOF y distingue des sous-groupes:<br />
1/ le groupe atlantique de l'ouest: Ouolofs, Lébous, Sérères, Casamançais,<br />
Soussous et autres... pour un total de 119.700 habitants.<br />
2/ Le groupe nord : Toucouleurs, Peulhs, Maures, Foulahs et autres avec<br />
37.200 habitants au total.<br />
3/ Le groupe soudanais: Bambaras, Sarakollés, Socès, Malinkés et autres<br />
pour un total de 15.800. 13<br />
Dans le détail, nous remarquons que l'élément ouolof reste largement<br />
majoritaire avec 80.200 habitants devant le groupe léboues qui compte 22.700 habitants<br />
pour toute la presqu'île du Cap Vert. C'est le groupe toucouleur qui arrive en troisième<br />
position par ordre d'importance numérique avec 22.000 personnes, tandis que Sérères et<br />
Peulhs occupent les quatrième et cinquième rang.<br />
Dans cette population indigène, on note que l'élément léboues ne représente<br />
que moins de 6,20 % de la population de la ville elle même et de sa banlieue<br />
immédiate; mais son poids politique est déterminant surtout en ce qui concerne les<br />
, affaires de la municipalité. L'explication de cette situation apparemment paradoxale<br />
réside dans l'ancienneté du peuplement léboues dans la région et dans la solidité de ses<br />
structures organisationnelles. De plus, l'adaptation des anciennes structures léboues aux<br />
nouvelles réalités de la période coloniale permet à cet élément de garder la haute main<br />
mise sur toutes les affaires municipales. (Voir Chapitre 1 de la IVeme partie).<br />
Quant à la stabilité de cette population, une indication est fournie sur le<br />
pourcentage des gens nés hors de la ville et qui y habitent au moment du recensement<br />
de 1955. La chambre de commerce de Dakar, sur la base de 1958, indique comme<br />
résidents: 92.092 hommes et 87.103 femmes soit un total de 179.195 personnes. Les<br />
personnes de passage sont seulement au nombre de 4524 hommes et 4844 femmes soit<br />
au total 10.368 personnes. Les saisonniers représentent au même moment 3776 hommes<br />
et 2522 femmes soit au total 6298 habitants 14 . Donc, la population est stable dans la<br />
ville.<br />
13. Fiche 32 de la notice de l'état-major sur la presqu'île du Cap Vert, Août 1959, Base 1955, Recensement général<br />
14. Chambre de commerce de Dakar. Synthèse de la situation de l'ex AOF, 1948-1958.<br />
16
Sur le plan matrimonial, la situation se présente de la manière suivante:<br />
TABLEAU DE L'ETAT MATRIMONIAL DE LA POPULATION<br />
AFRICAINE DE DAKAR EN 1955 (Ceux ayant 14 ans et plus)15.<br />
STATUT HOMMES FEMMES % HOMMES % FEMMES<br />
Célibataires 24.473 8321 40,1 14,9<br />
Mariés<br />
- Etat civil 1989 1977 3,3 3,6<br />
- Coutume 32.847 37.164 53,8 66,9<br />
Total 34.830 39.141 57,1 70,5<br />
Veufs 530 4688 0,9 8,5<br />
Divorcés 1162 3385 1,9 6,1<br />
Totaux 60.995 55.535 100 100<br />
Au plan religieux, le recensement de 1955 donne 92,3 % de musulmans et<br />
seulement 7,2 % de chrétiens en majorité catholiques. L'animisme ne subsiste à Dakar<br />
que par des traces rares et perceptibles seulement en milieu léboues.<br />
TABLEAU DE LA REPARTITION PAR SEXE ET PAR AGE ET<br />
RELIGION DE LA POPULATION AFRICAINE DE DAKAR16<br />
Religion Total Nbre par sexe Nbre par âge<br />
Masculin, ' . Féminin -14ans ' J , 14 ans +<br />
Musulmans 165.147 84.744 80.403 57.909 107.238<br />
Chrétiens 31140 6848 6292 4329 8811<br />
Cette population musulmane est à 55 % de confrérie Tidjane, 20 % de<br />
mourides, et 20 % de Khadriya. Les 5 % restant sont constitués de divers dont les<br />
hamallistes (sous secte tidjane) sont au nombre de 500 à Dakar selon le rapport de<br />
l'état-major sur le Cap Vert.<br />
15. Recensement démographique de 1955, 1eme fascicule, p.25.<br />
16. Recensement démographique de 1955, Fascicule 1, p.25.<br />
17
En données plus détaillées, Ibrahima Marône indique pour l'année 1955 :<br />
144.500 tidjanes, 10.300 mourides et 1600 hamallistes 17.<br />
Cet islam dakarois est marqué par le fait que les grands chefs des confréries<br />
résident tous loin de la ville de Dakar; les villes de Tivaouane, Touba et Ndiassane en<br />
sont les directions religieuses principales. Par contre les villages de Yoff et Cambéréne<br />
sont les capitales de la confrérie layéne qui ne compte que quelques milliers d'adeptes,<br />
surtout lébous.<br />
De plus, dans ses principaux centres de direction, cet islam est conservateur.<br />
Par contre, un courant relativement réformateur se développe dans la ville<br />
particulièrement dans les milieux jeunes sortis des grands centres d'enseignement du<br />
monde arabe. C'est ainsi qu'une association réformiste dénommée "Union Culturelle<br />
Musulmane" voit le jour à Dakar dès 1953. Trois ans plus tard, de nombreuses<br />
associations réformistes se regroupent. en une "Union des associations culturelles<br />
musulmanes". Ces associations culturelles accordent une place de choix à<br />
l'enseignement coranique et à la langue arabe, ce qui a pour conséquence de leur attirer<br />
des difficultés de la part de l'administration coloniale.<br />
- Le groupe européen.<br />
Il a fait l'objet de trois recensements et de plusieurs sondages et estimations<br />
en l'espace de quinze ans. On peut donc dire que sa connaissance est plus crédible;<br />
d'autant plus que l'administration dispose de tous les moyens pour s'assurer un contrôle<br />
précis et rigoureux de cet élément, ce qui n'est pas toujours le cas pour l'élément<br />
indigène de la population.<br />
En 1946, ce groupe comprend 11.200 personnes non compris les militaires.<br />
Par contre, en 1953, il Ya déjà 26.955 Européens dans Dakar et la Médina d'après le<br />
rapport annuel de la Délégation18 sur une population totale de 269.430 habitants. Le<br />
recensement général de la population dakaroise en 1955 donnait le chiffre de 23.994<br />
Européens; ce qui représente moins que le chiffre annoncé par le rapport de 1953.<br />
17. Ibrahima Marône, Le tidjanisme au Sénégal. p. 174<br />
18. Affaires politiques AOF, ANS, DOS 2G 53-183, 1953.<br />
18·
TABLEAU DE LA POPULATION EUROPEENNE DE DAKAR DE 1946<br />
A 1958.®<br />
Années Population<br />
1946 11.200<br />
1953 26.955<br />
1955 23.994<br />
1958 27.266 dont 13.124 femmes et 14.142 hommes<br />
Accroissement total entre 1946 et 1958 : 212 %<br />
C'est une progression très nette surtout entre 1951 et 1956, où en l'espace de<br />
cinq ans, la population européenne de la ville s'accroit de 56 %. Par contre à Rufisque,<br />
c'est en sens inverse qu'évolue cette population qui passe de 1955 à 1958 de 1280<br />
personnes à 550. Ce constat est fait par Paul Mercier, chef de l'équipe sociologique de<br />
Dakar qui a consacré plusieurs travaux au groupement européen de la ville. Il écrit: «[...]<br />
La population européenne de Dakar s'est, depuis la guerre, accrue de façon très rapide; cet<br />
accroissement a même été, propol1ionnellement, plus grand que celui de la population<br />
africaine. »20 Paul Mercier traduit cette progression dans la période 1946-1951 par les<br />
chiffres suivant en comparant ceux fournis par les deux recensements: 226 recensés en<br />
1951 pour 100 eh 1946. En d'autres termes, c'est plus qu'un doublement qu'on observe<br />
d'après Mercier. Cette population européenne est à 98 % française d'après le<br />
recensement de 1955. D'autre part, elle est peu enracinée puisque l'immigration est<br />
surtout nette dans les Années 1950-1956. C'est la période de la politique des grands<br />
travaux financés par le FIDES et qui a assez nettement profité aux Européens. Elle se<br />
répartit de la manière suivante entre hommes et femmes: en 1946, il Y a 163 hommes<br />
pour 100 femmes, ce qui dénote une nette prédominance de l'élément masculin. En<br />
1958, il Y a au total 14.142 hommes et 13.124 femmes. Ces chiffres montrent la nette<br />
progression de l'élément féminin dans ce groupement européen.<br />
Cette population est dans l'ensemble très stable puisque c'est seulement 643<br />
personnes qui sont considérées comme "occasionnellement de passage", se répartissant<br />
ainsi: 331 hommes et 312 femmes. Aucun saisonnier n'est noté dans ce groupement<br />
européen.<br />
Quant à l'âge, il s'agit d'une population essentiellement adulte comme le dit<br />
Paul Mercier lorsqu'il écrit: «...Les individus de 20 à 59 ans sont 665 pour 1000 et les plus<br />
de 60 ans sont eux, 15 pOLIr 1000 alors que les moins de 20 ans sont 320 pour 1000. »21 Un<br />
autre aspect important que dégagent diverses sources est le fait que cette population<br />
19. AC. pol AOF, Délégation de Dakar, rapport de 1953, ANS, dos 2G 53-183 et Paul Mercier, op. cit, p.B1.<br />
20. Paul Mercier, Op. Cit, p. 131.<br />
21. Ibidem.<br />
19
européenne ne fait pas souche à Dakar. En effet, le recensement de 1946 montrait que<br />
72 % de cette population était née en métropole. Celui de 1951 indique une progression<br />
de cette situation puisque la proportion est de 78 %. Les Années 60 confirment cette<br />
tendance d'après les données de la Chambre de commerce. Les personnes interrogées<br />
par Paul Mercier en 1955, soit un échantillon de 250 personnes ayant 40 ans et plus,<br />
répondent que leur objectif est la préparation de leur retour et de leur installation en<br />
France. C'est la quasi totalité des réponses. Les 2/3 de ces personnes interrogées ne<br />
souhaitent pas que leurs enfants embrassent une carrière coloniale 22 comme si la<br />
colonisation constituait un fait détestable.<br />
Quant à l'habitat, le groupement européen vit en splendide isolement. Il<br />
habite la partie haute de la ville, celle qu'on appelle le Plateau. Depuis les Années 1919<br />
1920, l'administration coloniale s'est évertuée à pratiquer ce que l'historien et homme<br />
politique sénégalais Abdoulaye Ly a appelé la "politique du zoning" c'est à dire cette<br />
pratique consistant à séparer géographiquement l'habitat des différents groupes raciaux.<br />
Cet habitat européen c'est aussi les quartiers neufs et très sélects de Fann-Résidence sur<br />
la corniche ouest comme le Point E non loin de Fann, dans le Grand Dakar.<br />
Au plan religieux, ce groupement européen est chrétien, catholique dans sa<br />
presque totalité. Depuis 1956, Dakar a été érigée, par le Saint-Siège, en archidiocèse<br />
dont le titulaire est délégué pour toute l'Afrique noire française. Plusieurs Années après<br />
l'indépendance, c'est un Européen qui occupait la charge, en la personne de Mgr<br />
Lefebvre, chef de l'église dakaroise depuis novembre 1947 en qualité de Vicaire<br />
apostolique. Les autres chrétiens de Dakar, c'est à dire les protestants représentent<br />
moins de 500 croyants en 1955.<br />
Ajoutons pour terminer, que l'on a recensé aussi à Dakar 98 nationaux<br />
d'Amérique mais ils sont rangés dans le groupement européen, dans la notice de l'Etat<br />
Major sur la presqu'île du Cap Vert.<br />
- Le groupement levantin<br />
Son implantation à Dakar est relativement récente, elle remonte seulement<br />
au début du siècle, lorsque, par l'intermédiaire du consulat français à Beyrouth, le<br />
gouverneur général de l'AOF fit directement appel à eux « certainement pour servir debarrage<br />
à la montée d'une bourgeoisie locale»23.<br />
Au point de vue numérique combien sont ils ? D'après le journal Echos<br />
d'Afrique noire ces libano-syriens sont 3 à 4000 à Dakar en 1945. Ce journal estime, en<br />
janvier 1955, qu'ils sont plus nombreux que les Européens dans l'ensemble du Sénégal et<br />
qu'ils constituent le problème numéro un en AOF. Il accuse l'administration coloniale<br />
22. Item. p.135<br />
23. Mahjrnout Diop, Histoire des classes sociales dans l'Afrique de l'ouest, 1972, p.142<br />
20'
de s'être montrée trop complaisante à leur égard; le journal parle même de<br />
"l'empoisonnante question" ou de "l'invasion étrangère" pour traiter de la question<br />
libano-syrienne à Dakar. Ils sont au nombre de 15.000 dans le territoire du Sénégal en<br />
1960 d'après cet organe du petit colonat dakarois.<br />
Pour Mahjmout Diop, ils atteignent 4000 personnes en 1945 sur les 7000 qui<br />
habitent le Sénégal à cette période. Dès 1953, ils sont au nombre de 8000 à Dakar pour<br />
21.000 domiciliés au Sénégal au même moment.<br />
Par contre Régine Bonnardel avance les chiffres de 3591 libano-syriens à<br />
Dakar en 1955 et 10.000 en 1960.<br />
Cruise O'Brien 24 donne les chiffres suivants pour Dakar:<br />
1941 : 1600<br />
1945: 1900<br />
1948: 2000<br />
1955: 3591<br />
1960 : 10.000<br />
Paul Mercier se référant au recensement de 1955 à Dakar donne le chiffre de<br />
5000 Libano-syriens. Ces diverses sources montrent un accroissement net de ces Libano<br />
syriens à Dakar.<br />
Au plan de l'habitat, ce groupement dispose presque de son propre quartier<br />
situé entre le Plateau qui est le quartier des Européens et la Médina, habitat des<br />
Indigènes. En gros les limites de ce quartier sont le marché Sandaga du côté du Plateau<br />
et l'avenue Elhadj Malick Sy qui le sépare de la Médina. En somme le quartier libano<br />
syrien sert de tampon entre les habitats européen et africain de la ville.<br />
Au plan religieux, ce groupe libano-syrien ou levantin ( terme qu'utilisent les<br />
rapports politiques) est de religion catholique mais de rite maronite pour l'essentiel de<br />
ses membres. Le journal dakarois "Horizons Africains" mettait, dans son édition du mois<br />
d'avril 1947, un accent particulier sur la différence importante entre le catholicisme de<br />
rite byzantin et le catholicisme pratiqué à Dakar, cela à propos d'une messe célébrée à<br />
la cathédrale de Dakar le 22 mars 1947 par Monseigneur Malouf archevêque grec<br />
catholique de Balbeck, de passage à Dakar.<br />
Notons aussi que ces Libano-syriens vivent dans la plupart des cas en famille<br />
et s'installent durablement à Dakar. si les voyages vers la terre natale sont fréquents, les<br />
raisons économiques en constituent l'explication principale.<br />
24. R.C.O'Brien, Les relations raciales au Sénégal, 1975, p. 275<br />
21
consacrée aux relations entre le conseil et les étudiants africains poursuivant leurs<br />
études en métropole, note: « D'après nos renseignements, sur 200 étudiants sénégalais, 80<br />
ont épousé des Européennes... C'est là une européanisation abusive ». Ces inter-mariages<br />
dénoncés par le rapport du Conseil de la jeunesse du Sénégal comme du reste le congrès<br />
constitutif de l'Union des femmes du Sénégal (U.F.S) sont contractés en France même.<br />
Mais des enfants issus de ces mariages mixtes ne sont pas absents de Dakar dans la<br />
mesure où certains étudiants rentrent avec leurs familles, les études terminées.<br />
Les Eurafricains de Dakar sont aussi et, dans une large mesure, issus de ce<br />
qui n'est rien d'autre, dans la capitale fédérale, que l'enfance abandonnée. Il s'agit des<br />
enfants nés d'un père européen et d'une mère africaine. Ces enfants sont en régIe<br />
générale, abandonnés du père. Et les mères africaines sont obligées d'élever ces enfants<br />
dans des conditions matérielles et sociologiques très difficiles. C'est ce qui a fait écrire à<br />
Awa Thiam qu'« Aux yeux du colon, la négresse n'est valorisée qu'en tant qu'objet de<br />
satisfaction sexuelle... victime de sa double condition de femme et de colonisée »28. Nous<br />
notons même que dans la plupart des cas, la maman africaine, victime des relations<br />
sexuelles trop circonstanciées, aura cherché à se débarrasser de l'enfant dès sa<br />
naissance, dans les cas favorables, en l'abandonnant de nuit au coin d'une rue passante.<br />
Ramassés par la police, ces enfants sont confiés aux oeuvres sociales des missions<br />
chrétiennes qui les élèvent dans le cadre de l'assistance publique. L'administration<br />
coloniale veille à fournir les subsides. En somme, ces Eurafricains ou métis sont<br />
présents à Dakar. Ils se sont même constitués en une association reconnue par les<br />
pouvoirs publics et dénommée "L'Union des Eurafricains de l'AOF et du Togo" avec son<br />
siège social dans la capitale fédérale. Elle publie même à Dakar un organe de presse,<br />
bulletin d'information et de liaison sous le nom de l'Eurafricain.<br />
Au point de vue habitat, rien de très spécifique n'indique une zone<br />
particulière pour ces Eurafricains. Cependant, au regard de leur condition économique<br />
et sociale qui en fait des intermédiaires, surtout dans les activités économiques, on peut<br />
penser que ces Eurafricains habitent les quartiers nouvellement construits par la SICAP,<br />
et ceci avec l'aide plus ou moins directe des pouvoirs publics. Au plan religieux, à cause<br />
des lieux où ils ont été élevés c'est à dire les oeuvres sociales de l'église, ils sont<br />
principalement chrétiens.<br />
Si ces Eurafricains ont un rôle très faible dans la vie sociale à Dakar, il n'en<br />
est pas de même dans la ville de Saint Louis où l'ancienneté de l'implantation<br />
européenne a donné naissance à une société créole non négligeable. Leur poids<br />
numérique explique même le rôle politique de cette société créole qui a longuement<br />
dominé la scène locale.<br />
28. Awa Thiam, La parole aux négresses, 1978, p.17S.<br />
23·
111/ STATUT<br />
La question du statut de la ville, est un ensemble de grandes victoires, mais<br />
aussi de défaites aussi grandes.<br />
Dakar est la capitale de l'AOF pendant presque toute la période de notre<br />
étude de 1946 à 1958, puis elle est la capitale du Sénégal de 1958 à 1960 après en avoir<br />
été , de 1946 à 1958, une véritable deuxième capitale avec l'établissement d'une<br />
délégation spéciale du gouvernement du Sénégal. Cette délégation a été si importante<br />
qu'elle portait ombrage à la capitale en titre: Saint-Louis du Sénégal.<br />
La ville a aussi été la capitale de l'éphémère fédération du Mali de 1959 à<br />
1960. Ajoutons également que Dakar a été, de 1945 à 1946, une capitale pour la<br />
Circonscription de Dakar et dépendances que l'on peut, à juste titre, comparer à un<br />
territoire fédéral comme le district de Washington aux Etats Unis d'Amérique.<br />
Ce statut de la ville, c'est aussi sa situation de commune de plein exercice,<br />
l'une des quatre de l'Afrique noire française qui furent toutes sénégalaises. Ce statut de<br />
commune de plein exercice est bien antérieur à celui de capitale. Tout cela indique à<br />
quel point l'histoire de la ville est riche. C'est ce qui fait dire à Mamadou Dia ancien<br />
président du conseil du Sénégal que « Dakar avait pour lui trop d'atouts pour manquer sa<br />
vocation de reine des cités de la côte occidentale d'Afrique »29.<br />
1) La capitale fédérale.<br />
Depuis le décret du 18 octobre 1904, Dakar est érigée en capitale de<br />
l'ensemble fédéral colonial de l'AOF constitué de huit territoires. Cette fonction était<br />
assumée par la ville de Saint-Louis depuis la gestation du projet de la fédération en<br />
1895. Cette fonction, Dakar la doit évidemment à son développement notoire en<br />
l'espace de quarante ans d'existence comme ville coloniale. Cette fonction est<br />
matérialisée par la présence, à la tête de la fédération, d'un gouverneur général. Ce<br />
dernier porte, à partir de 1946, avec la mise en place de l'Union française qui remplace<br />
l'Empire colonial français, le titre de Haut commissaire gouverneur général, ce qui<br />
traduit l'évolution politique. En tout dix neuf, sous des titres divers, ont assuré la<br />
fonction depuis 1895.<br />
29. Mamadou Dia, Nouvelle revue internationale de la FOM, tIl330, Mai 1957, Célébration du centenaire de la vill<br />
24
pallier car il y a fractionnement de l'autorité en matière d'administration entre le maire<br />
\" de la ville, le gouverneur et le gouvernement général. En ce qui concerne les services<br />
techniques, un double emploi existe, ce qui entraîne la dispersion des efforts. D'après le<br />
rapport, tout cela reste préjudiciable à l'essor de la grande cité africaine. Cette<br />
circonscription dont la suppression est ainsi décidée, couvrait géographiquement<br />
environ 530 Km 2 soit Dakar et sa banlieue, l'île de Gorée, la commune de Rufisque et<br />
sa banlieue étant venues s'y ajouter par le décret du 8 juin 1937.<br />
A la tête de cette Circonscription, se trouve un gouverneur dont les attributs<br />
étaient importants. C'est ainsi par exemple, qu'en janvier 1946, lors de la grève générale<br />
déclenchée à Dakar par les syndicats pour réagir à la chute du pouvoir d'achat<br />
provoquée par le blocage des salaires des personnels indigènes, le gouverneur de la<br />
circonscription décide de réquisitionner tous les fonctionnaires de Dakar, qu'ils<br />
appartiennent aux services du gouvernement général ou à ceux de la circonscription 40 .<br />
La circonscription est, pour l'ensemble de la collectivité léboues de Dakar,<br />
une structure intéressante. Elle donne ainsi le sentiment d'une puissance, d'une<br />
importance dans la mesure où cette structure est pour eux, une forme de dépendance<br />
directe de la seule personne du gouverneur général de l'AOF, même si c'est par<br />
gouverneur interposé. Pour cette raison, lorsque la circonscription est supprimée, ces<br />
milieux lébous expriment ouvertement leur mécontentement. C'est ce que nous apprend<br />
le rapport de police et sûreté de la Délégation en octobre 1948, où nous lisons: «<br />
Prenant contact avec la collectivité léboue, par ses dirigeants, Lamine Guéye . absent du<br />
Sénégal depuis plusieurs mois - s'est fait exposer leurs revendications: premier point: le<br />
retour de la Circonscription de Dakar et dépendances et la nomination d'un<br />
gouvemeur...»41. Quelques dix ans plus tard, cette revendication des milieux lébous de<br />
Dakar est encore présente. Mamadou Dia, ancien président du Conseil du Sénégal<br />
explique, que, parmi les raisons qui l'ont déterminé à transférer la capitale du Sénégal<br />
de Saint Louis à Dakar, en 1958, celle-ci est la plus importante. Il écrit: « Au cours de<br />
cette période de semi-autonomie, il y eut un mouvement des notables de la collectivité<br />
léboue pour revendiquer le détachement de la presqu'île du Cap Verl »42. Exactement<br />
comme du temps de la Circonscription. C'est la nostalgie d'une époque.<br />
Cependant, la question de la Circonscription n'est pas seulement un<br />
problème spécifique à la collectivité léboue. En effet, le Grand Conseil de l'AOF, lui<br />
aussi, se saisit de la question à plusieurs reprises. A la séance du 30 octobre 1954, lors de<br />
la discussion du budget de la fédération, une vive polémique surgit relative au "poste<br />
Délégation" prévu dans la nomenclature du budget. Un Grand Conseiller, au titre du<br />
territoire du Soudan demande le rétablissement de la Circonscription, dans la mesure<br />
40. "Paris-Dakar" des 6 et 7 janvier 1946.<br />
41. Affaires politiques AOF, ANS, dos 2G 48-117, Délégation de Dakar, 1948.<br />
42. Mamadou Dia, Mémoires d'un militant... 1985, pp.82-83.<br />
28
où, pour lui, « Dakar est à la fédération ce que Washington est aux USA ». Le gouverneur<br />
secrétaire général de la fédération Xavier Torré apporte son appui au Grand Conseiller<br />
soudanais.<br />
Léopold Sédar Senghor intervient immédiatement pour dénoncer la<br />
proposition de son collègue mais surtout l'aide que lui apporte Xavier Torré, le<br />
deuxième personnage de la fédération, présent au débat en tant que représentant du<br />
gouverneur général. Il dénonce surtout cette collision qui lui semble être une menace<br />
pour son territoire qu'on voudrait ainsi amputer d'un maillon essentiel. Senghor propose<br />
même que la capitale fédérale soit transférée où que l'on voudra, l'important restant le<br />
maintien de l'intégrité territoriale du Sénégal. Cette réplique de l'homme politique<br />
sénégalais est très tactique dans la mesure où, à cette époque, il ne vient à l'idée de<br />
personne de prendre l'initiative de placer ailleurs la capitale fédérale. Trop<br />
d'investissements de taille y sont réalisés· ou en cours de l'être. Le réalisme s'impose<br />
donc. Le débat n'est pas clos pour autant mais il change d'aspect. A diverses reprises, les<br />
Années suivantes, chaque débat budgétaire voit la question resurgir au sein de la<br />
Grande Assemblée. Beaucoup de conseillers des autres territoires reprochant à<br />
l'administration d'avantager trop fortement le Sénégal dans la mesure où le budget<br />
fédéral consacre une bonne partie de ses ressources à la capitale alors que les recettes<br />
de celle-ci sont versées au budget du territoire du Sénégal depuis le décret de 1946<br />
supprimant la Circonscription. Aux Conseillers du Sénégal qui ont toujours justifié cette<br />
situation, en matière de poste budgétaire, ceux des autres territoires ont souvent<br />
reproché de ''vouloir garder le beurre et l'argent du beurre à la fois", pour employer une<br />
expression terre à terre.<br />
Dakar reste présent.<br />
Jusqu'à la dissolution de la fédération, le débat sur le statut administratif de<br />
Quant à la Délégation comme statut de Dakar, c'est incontestablement un<br />
renforcement du pouvoir du gouverneur du Sénégal et, dans une certaine mesure, un<br />
retour à la situation d'avant 1924. Jusqu'à cette date, Dakar était partie intégrante de ce<br />
territoire. Pour pouvoir coordonner plus efficacement la politique des grands travaux<br />
entreprise à Dakar dès les premières Années de la première guerre mondiale il était<br />
apparu, aux yeux du gouvernement général, qu'il fallait que ce territoire géographique<br />
devienne une entité à part. C'est dans ce sens que le gouverneur général Carde écrivait,<br />
le 1 eme octobre 1924, à son ministre de tutelle, mettant l'accent sur les obligations et<br />
charges spéciales que le budget du Sénégal, tout comme le budget communal, ne<br />
pouvaient assumer. Satisfaction était donnée à cette requête par le décret du 21 octobre<br />
1924 qui était remanié pour devenir celui du 21 novembre 1924. Le député Blaise<br />
Diagne avait appuyé la naissance de cette entité administrative. Il en résultait une totale<br />
satisfaction des milieux lébous dakarois, contrairement à la désapprobation des<br />
éléments saint-Iouisiens nombreux dans la ville- mais aussi des Saint-Iouisiens de la<br />
29
capitale du Sénégal. Le mécontentement de ces derniers s'expliquait par la victoire<br />
supplémentaire que Dakar affichait à son palmarès dans sa rivalité avec la vieille ville<br />
coloniale, fondée bien avant elle. Cette situation avait donc permis aux lébous de jubiler<br />
alors qu'à Saint-louis c'était le mécontentement.<br />
En 1937, la Circonscription qui jusque là ne comprenait que les communes<br />
de Dakar et de Gorée s'agrandit par absorption de la commune de Rufisque et banlieue.<br />
Il est sûr qu'il s'agissait d'un fait supplémentaire dans cette longue rivalité entre Saint<br />
louis et Dakar, et ceci au profit de cette dernière. Pour cette raison, la création de la<br />
Délégation remettant le territoire de Dakar sous l'administration directe du gouverneur<br />
du Sénégal siégeant à Saint-louis, a été savourée, à sa juste valeur, par les natifs de cette<br />
ville. Saint-louis obtient, au point de vue administratif un droit de regard presque total<br />
sur Dakar, capitale même de la fédération. C'est dans ce cadre qu'en janvier 1953, après<br />
les graves incidents politiques de Bignona ayant causé la mort de plusieurs personnes<br />
dans la suite de Me Lamine Guéye en déplacement politique en Casamance, la tension<br />
monte dangereusement à Dakar et dans presque toutes les villes du territoire, entre<br />
partisans de l'avocat dakarois et Léopold Sédar Senghor. Le gouverneur du Sénégal est<br />
obligé de venir faire le "pompier" dans la capitale où se trouvent les états-majors<br />
politiques.<br />
Ce fut également aussi le cas lors de la campagne électorale pour les<br />
municipales de novembre 1953 lorsque les cortèges politiques adverses en viennent aux<br />
mains dans la capitale chaque fois qu'ils se croisent. Du reste, si le gouverneur est obligé<br />
de descendre si régulièrement à Dakar, c'est que son pouvoir y est puissant.<br />
De l'étape de la Délégation, on aboutit administrativement, pour Dakar, au<br />
statut de Région sous le régime de l'autonomie interne. En effet, lorsque Mamadou Dia<br />
mettra en application ce qu'il appelle une nouvelle ligne de travail : la réforme des<br />
institutions «J'entrepris de détruire complètement le système de structuration administrative<br />
du Sénégal qui était alors divisé en cercles. Je décide de diviser le Sénégal en Régions, en<br />
grandes régions économiques ... Je visais aussi la création d'un pouvoir politique à partir de<br />
la base »43. Au total, cette réforme dote le Sénégal de sept grandes régions<br />
administratives et économiques. L'une de ces régions s'appelle "la Région du Cap Vert".<br />
Elle recouvre territorialement l'ancienne Délégation de Dakar née en 1946. En effet,<br />
c'est l'arrêté nO 7160 SGC en date du 4 août 1958 qui porte suppression de la<br />
Délégation de Dakar et crée une circonscription administrative dite "Région du Cap<br />
Vert,,44. Par cette réforme donc, le statut de Dakar la met exactement au même niveau<br />
que les autres villes comme Ziguinchor; Tambacounda, Kaolak, Thiès, Diourbel et<br />
Saint-louis. A la tête de cette région du Cap Vert, un gouverneur au même pouvoir que<br />
ceux qui règnent dans les six autres villes citées ci-dessus. Ce nouveau statut efface donc<br />
43. Mamadou Dia, Op. Cil, pp 115-116<br />
44. J.O du Sénégal, 18 Aoûl 1958.<br />
30·
Le décret du 9 avril 1929 stipulait: «Article 1 er : Les limites territoriales de la<br />
commune de Dakar sont:<br />
- au nord et sud et à l'ouest: la mer,<br />
- à l'est une ligne partant de la borne limite située à l'est du village de Grand<br />
Mbao passant par la borne kilométrique 22 de la route de Dakar à Rufisque et rejoignant<br />
entre les villages de Keur-Massar et Niakoulbonate la côte nord de la presqu'île de façon à<br />
englober la totalité de la zone de captage des eaux.<br />
Art.2 : La commune de Gorée est réunie à la commune de Dakar.<br />
Art.3 : Le conseil municipal de Dakar se compose de 34 conseillers municipaux<br />
dont un maire et six adjoints »46.<br />
Dans les dernières Années de la guerre, cette commune de Dakar a eu<br />
comme maire Alfred Goux, revenu à la tête des affaires municipales lorsque les<br />
assemblées locales dissoutes par le régime de Vichy ont été à nouveau reconnues. Mais<br />
dès octobre 1945, c'est Me Lamine Guéye que la ville élit comme maire. Il fut réélu à<br />
plusieurs reprises. Jusqu'en 1961, il reste le premier magistrat de la ville, exception faite<br />
du bref intermède pendant lequel, à la suite de la mise en place d'une commission<br />
spéciale, Bâ Amadou, l'un de ses anciens adjoints à la tête de la municipalité, dirige la<br />
mairie.<br />
Dakar commune de plein exercice n'était pas facile à administrer pour<br />
diverses raisons, en particulier à cause de son statut administratif teinté d'ambiguïté,<br />
avec la présence dans ses murs d'un gouverneur général chef de l'ensemble fédéral de<br />
l'AOF au moment même où elle dépend du gouverneur du Sénégal à Saint-louis. Ce à<br />
quoi s'ajoutent l'insuffisance notoire de ses moyens, et le contexte politique global. La<br />
gestion municipale de Lamine Guéye fit l'objet d'attaques les plus variées: gabegie,<br />
dilapidation, politisation, recrutement partisan d'un personnel municipal pléthorique qui<br />
ne travaille guère, détournement, incapacité etc... Bref des reproches nombreux et très<br />
souvent étayés. Cependant, devant de telles attaques de provenances diverses, les<br />
répliques ne manquent pas de poids non plus: absence de moyens conséquents eu égard<br />
aux responsabilités, désir politique d'acculer la municipalité à la faillite, objectif non<br />
avoué de vouloir prouver l'incapacité des nègres à gérer. C'est donc, une ligne de<br />
défense ferme devant des critiques multiples. Nous reviendrons sur ces questions dans<br />
le Chapitre 1 de la quatrième partie consacrée à la municipalité.<br />
Cette question de la gestion municipale à Dakar reste l'un des points<br />
centraux autour desquels on cerne le mieux l'opinion publique.<br />
46. Archives municipales de Dakar, série 2G, dos H/40.<br />
32
4) Dakar. siège du Grand Conseil de l'AOF.<br />
Le Grand Conseil de l'AOF est l'une des institutions nées de la réforme qui a<br />
mis en place l'Union française en 1946. Il s'agit plus précisément de la partie relative<br />
aux assemblées représentatives locales. Ce Grand Conseil est inauguré en décembre<br />
1947 après que les huit territoires aient désigné leurs représentants au nombre de cinq<br />
par territoire. La loi du 29 août 1947, en application de la nouvelle constitution, portait<br />
la naissance de cette institution.<br />
En 1947, le territoire du Sénégal y fut représenté par Lamine Guéye et<br />
Léopold Sédar Senghor tous deux députés, Robert Delmas, Edouard Monville et<br />
Amadou Camara4 7 . Une cérémonie hautement riche en couleurs, présidée par le<br />
ministre de la FOM en présence du Haut commissaire gouverneur général Barthes<br />
inaugure cette assemblée qui, dès sa première séance, porte à sa tête un sénégalais, en<br />
l'occurrence Lamine Guéye, et désigne ses commissions. La plus importante de toutes,<br />
la Commission permanente, est confiée à un autre représentant du Sénégal, Robert<br />
Delmas. Le député Senghor est élu à la tête de la commission des affaires sociales et de<br />
l'Education 48 . La municipalité de Dakar offre une grande réception à l'ensemble des<br />
membres du Grand Conseil 49 , peut être pour témoigner sa satisfaction devant une<br />
élection ayant consacré son premier magistrat. Mais cette première session du Grand<br />
Conseil se tient sur fond de grève, celle des cheminots du R.A.N (Réseau d'Mrique<br />
Noire) ce qui entraîne de profondes répercussions sur cette institution fédérale dans la<br />
mesure où, dans les faits, tous les grands conseillers prirent position face à ce puissant<br />
mouvement social s'étendant à l'ensemble du territoire fédéral.<br />
Le Grand Conseil est doté d'un splendide immeuble situé place Tascher, non<br />
loin du building administratif et du palais du gouverneur général. Il reçoit également un<br />
luxueux hôtel situé boulevard de la République ,servant de résidence pour les grands<br />
conseillers. Le tout est financé par le FIDES et le budget fédéral. La pose de la<br />
première pierre du palais du Grand Conseil a eu lieu le 27 octobre 1954 par le ministre<br />
de la FOM, Robert Buron. Les travaux sont terminés deux ans plus tard puisque, le 22<br />
novembre 1956, c'est le président de l'Assemblée Nationale française Albert Sarraut qui<br />
vient l'inaugurer. Le coût total des travaux est de 325 millions de francs CFA Leon<br />
Boissier Palun, un autre Grand Conseiller du Sénégal assure, à cette époque, la<br />
présidence de la Haute assemblée.<br />
Le Grand Conseil fut présidé par Lamine Guéye de décembre 1947 au 30<br />
avril 1952, puis par Leon Boissier Palun d'avril 1952 à mars 1957. Ce fut ensuite Felix<br />
Houphouët Boigny de Côte d'Ivoire qui prit la tête de l'institution de mars 1957 à mars<br />
47. "Paris-Dakar" du 4 novembre 1947.<br />
48. "Paris-Dakar" du 9 décembre 1947.<br />
49. "Paris-Dakar" du 12 décembre 1947.<br />
33
1958. Enfin Gabriel d'Arboussier dirigea l'assemblée de mars 1958 jusqu'à sa dissolution<br />
en 1959.<br />
La présidence du Grand Conseil a souvent donné lieu à d'ap(è?compétitions,<br />
à de laborieux marchandages et aussi à des rancoeurs notoires tant les rivalités entre les<br />
grands partis, entre les territoires et entre les hommes ont été aiguës. Si la première<br />
période a été marquée par une incontestable prépondérance du Sénégal, il n'en fut pas<br />
de même dans la phase ultérieure. Notons aussi qu'une autre question a souvent secoué<br />
la Haute Assemblée locale : la désignation de ses représentants dans les divers<br />
organismes de la Fédération. Léopold Sédar Senghor, dans un débat autour de cette<br />
question le 5 avril 1958, constate même une attitude "anti-sénégalaise" des grands<br />
conseillers dans la mesure où les représentants du Sénégal sont éliminés, alors que la<br />
plupart des sociétés en question ont leur siège au Sénégal comme les chemins de fer,<br />
l'IPRAO (Institut de Prévoyance et de Retraite de l'Afrique occidentale) etc... 50<br />
Les tumultes politiques résultant du processus précipité de la marche vers<br />
l'autonomie et l'indépendance ne laissent guère au Grand Conseil que le choix de se<br />
saborder. La loi Gaston Defferre, en balkanisant l'AOF et l'AEF porte le coup mortel à<br />
cette haute assemblée locale.<br />
Mais, avant même ce processus, en dehors des séances de renouvellements<br />
des bureaux et commissions, la fréquentation de cette assemblée par les grands<br />
conseillers pose problème 51 en ce sens que les multiples absences laissaient croire à un<br />
désintéressement à l'égard de l'institution. Pourtant il est évident que ce Grand Conseil,<br />
de par son rôle auprès du Haut Commissaire auquel il sert d'organe législatif doté de<br />
pouvoirs plus ou moins importants, est un maillon essentiel de la réforme de 1946. De<br />
plus, avec la mise en place de la Loi-cadre, il devient un moyen important de<br />
concertation et d'échange d'expériences des gouvernements issus de l'autonomie<br />
interne.<br />
Mais à cette étape les intérêts coloniaux ne sont pas favorables à son<br />
maintien; ce qui entraîne sa disparition.<br />
5) Dakar. centre important de communications.<br />
Au plan des communications, Dakar représente un noeud incontournable sur<br />
la côte occidentale de l'Afrique tant au plan terrestre, aérien, routier, ferroviaire que<br />
maritime.<br />
Déjà, dès la fin du XIXeme siècle, la ville avait pris le troisième rang dans<br />
l'Union française dans la hiérarchie portuaire après Marseille et le Havre. Au cours de<br />
cette première moitié du XXeme siècle, la ville a accru considérablement son trafic<br />
50. L.S. Senghor, intervention séance du 5 avril 1958, Bulletin du Grand Conseil de l'AOF.<br />
51. "Paris-Dakar" du 25 mai 1948.<br />
34
,surtout après la seconde guerre mondiale. Port en eau profonde, naturellement protégé<br />
!par une large rade, dans une zone aux vents réguliers, Dakar disposait ainsi d'atouts de<br />
taille qui permirent le rapide développement d'un trafic articulé sur un port de<br />
commerce et aussi sur un port militaire. Dakar, c'est également un réseau ferroviaire<br />
pénétrant profondément à l'intérieur du pays, permettant ainsi de drainer vers la<br />
capitale divers produits agricoles et matières premières de l'intérieur de la fédération et<br />
acheminant en sens inverse des produits importés ou manufacturés. Ce réseau<br />
ferroviaire était lui même articulé sur d'autres infrastructures comme les wharfs de la<br />
plupart des villes côtières importantes de la Fédération. De même, un réseau routier<br />
dense existe dans la zone immédiate de la presqu'île dakaroise; son développement<br />
connait un réel élan avec les investissements financiers de la période. A tout cela<br />
s'ajoutent un important aéroport civil à Dakar-Yoff drainant un trafic très dense<br />
essentiellement orienté vers la métropole et un aéroport militaire à Ouakam.<br />
Ces infrastructures de communication entraînent la présence sur place de<br />
nombreuses entreprises industrielles (industries extractives, de transformations etc) et<br />
commerciales (grandes maisons marseillaises, bordelaises, lyonnaises) plus ou moins<br />
liées aux grands trusts internationaux, et celles de multiples services. En rapport avec<br />
ces infrastructures, Dakar connaît une grande concentration de main d'oeuvre occupée<br />
ou non. Le dynamisme syndical de la période, tant dans le secteur privé que dans le<br />
secteur public reste étroitement lié aux conditions de travail et de salaires qui ne sont<br />
pas très bonnes dans l'ensemble, comme l'attestent diverses sources.<br />
6) Dakar; important centre intellectuel et culturel<br />
Le développement de l'enseignement primaire est très ancien dans la ville.<br />
C'est surtout au niveau de l'enseignement secondaire et supérieur que la ville<br />
de Dakar s'assure une réelle prééminence avec ses écoles fédérales comme les écoles<br />
normales (de garçons à Sébikotane et de filles à Rufisque), son lycée technique fédéral<br />
(Delafosse), son lycée d'enseignement général (lycée Van Vollenhoven) et autres<br />
collèges. Au niveau post-baccalauréat, Dakar possède son institut des Hautes Etudes. La<br />
création, dès 1947, d'une académie en AOF ayant son siège à Dakar annonce la création<br />
de cet Institut des Hautes Etudes en 1950. Certes, les débuts de cet institut n'ont pas été<br />
faciles comme le prouvent les polémiques au tour de la qualité du personnel, ou de la<br />
liberté d'organisation et de mouvement des étudiants.<br />
Dakar est aussi un centre important au point de vue culturel. La dure bataille<br />
qui opposa l'administration coloniale au Conseil de la jeunesse au sujet du contrôle des<br />
maisons de jeunesse ou centres culturels, est une preuve réelle de l'importance que<br />
chacune des parties en conflit accorde à la question. La capitale fédérale a souvent<br />
connu des temps forts, au plan culturel avec les multiples conférences organisées au<br />
35
8) Dakar: siège des formations politiques. syndicales de jeunesse etc...<br />
Cette prérogative de la ville ne figure nulle part dans ses statuts<br />
administratif ou communal. C'est de par la force des choses que Dakar conquiert cette<br />
responsabilité.<br />
Durant toute la période 1945-1960, les partis politiques sénégalais sont nés à<br />
Dakar ou sont dirigés de Dakar où les états-majors s'installent. Les partis à audience<br />
interterritoriale, même s'ils sont nés ailleurs comme par exemple le RDA à Bamako, le<br />
PAI à Thiès, le PRA à .Cotonou installent très rapidement leurs directions dans la ville.<br />
Dakar devient, toute la période durant, un lieu privilégié de rencontres entre hommes<br />
politiques ou entre partis politiques. Les sessions du Grand Conseil de l'AüF offrent<br />
des occasions à ce genre de manifestations. Il en est de même pour les organisations<br />
syndicales avec la CGT d'abord, puis dans une période ultérieure la CGT, la CGT-Fü<br />
et la CFTC. Au moment de l'autonomisation des centrales syndicales, Dakar devient un<br />
lieu privilégié de rencontres pour les organisations comme la CGTA, la CATC... Dans la<br />
dernière période de cette étude, c'est à dire dans les Années 1959-1960, Dakar tend à<br />
perdre ce rôle pour les organisations syndicales car l'UGTAN, c'est à dire la centrale<br />
africaine de regroupement syndical finit même par transférer son siège de Dakar à<br />
Conakry. Le contexte politique y est pour quelque chose avec l'indépendance de la<br />
Guinée. Quant aux organisations de jeunesse, la situation est pratiquement la même.<br />
L'essentiel des activités tout comme de direction, est axé sur Dakar. C'est ainsi que le<br />
Conseil de la Jeunesse du Sénégal, le Conseil de la Jeunesse d'Afrique eurent à Dakar<br />
leur siège durant toute cette période.<br />
Si les partis politiques, les syndicats, les mouvements de jeunesse etc... ont été<br />
dirigés de Dakar, c'est bien en raison des multiples possibilités qu'offre la capitale en<br />
matière de transport, d'hébergement, de nourriture, de contacts, d'infrastructures<br />
(comme : lieux de réunion, téléphone, impression, diffusion, information, couverture<br />
radiodiffusée, photographique ...) et aussi stades, cinémas, salles de débats etc...<br />
*<br />
Conclusion<br />
En somme, Dakar est une ville aux fonctions nombreuses et aux possibilités<br />
énormes. Cette importance de la ville laisse bien saisir que des forces diverses y sont en<br />
place, avec des intérêts divergents sinon contradictoires mêmes.<br />
Ces forces se manifestent de toute évidence, comme des groupes de pression<br />
ou "faiseurs d'opinion". D'où l'intérêt de leur étude.<br />
37
PREMIERE PARTIE<br />
LES GROUPES DE PRESSION ET "FAISEURS" D'OPINIONS.<br />
Ces groupes de pression ou "faiseurs" d'opinion, par leur nombre, par leur<br />
diversité, par leur évolution, par leur poids etc... jouent un rôle important dans la<br />
formation et le développement de l'opinion. En ce sens, ils sont des indicateurs<br />
importants de la vie sociale à Dakar.<br />
La place très importante des partis politiques dans cette étude s'explique en<br />
partie par le fait que quelques informations qui n'ont pas une grande influence sont<br />
aussi passées en revue. La raison est qu'à travers le P.S.S1 et le M.L.N 2 , l'Islam et<br />
l'Eglise sénégalais rentrent plus ou moins directement dans l'arène politique. L'analyse<br />
du R.p.p3 se justifie par les relations entre Européens et Africains au sein de ce parti.<br />
1. Parti de la Solidarité Sénégalaise.<br />
2. Mouvement de Libération Nationale.<br />
3. Rassemblement du Peuple Français.<br />
38
CHAPITRE 1: LES PARTIS POLITIQUES<br />
LE RENOUVEAU DES ANNEES 1943-1945<br />
La période du vichysme triomphant des années 1940-1942 eut entre autres<br />
conséquences l'interdiction des activités politiques et syndicales démocratiques. Tout ce<br />
qui ne cadre pas avec la politique de collaboration était l'objet d'une répression<br />
violente, particulièrement parmi les Mricains. Mais, dès novembre 1942, les alliés, dans<br />
le cadre de la lutte contre l'Allemagne nazie, ont débarqué en Mrique du nord. Les<br />
autorités françaises en place, durent se rallier. Au niveau de l'AOF, après une période<br />
d'hésitation, autorités militaires et civiles s'alignèrent sur celle d'Mrique du nord.<br />
Un retournement politique d'une telle ampleur constitue un atout important<br />
pour la France Combattante puisque des efforts humains et matériels de taille sont<br />
consacrés à la nouvelle cause. Au plan politique, un renouveau apparait avec la reprise<br />
de l'activité des partis et associations démocratiques. C'est dans ce cadre que le<br />
Groupement d'Action Républicaine, la Croix de Lorraine, le Combat de l'AOF etc...<br />
reprennent leurs activités ou voient le jour. Le nombre de ces associations crée des<br />
difficultés; au point que des tentatives pour fédérer ont lieu, conformément aux voeux<br />
exprimés par le congrès d'Alger qui a regroupé toutes les associations et organisations<br />
de la Résistance. Sous la direction du professeur Théodore Monod, grand résistant en<br />
AOF, directeur de l'IFAN de Dakar, la Fédération de l'Mrique Occidentale de la<br />
France Combattante, le 22 décembre 1942 voit le jour. Mais, à côté de cette grande<br />
fédération, d'autres regroupements se développent à Dakar; ils ont pour vocation de<br />
s'étendre à toute l'AOF. C'est le cas de la "Quatrième République", de "l'Association<br />
Régionale des Anciens Combattants et Victimes de guerre d'AOF et du Togo etc... A<br />
côté d'elles, les associations politiques se développent. Ces associations ou fédérations<br />
d'associations donnent naissance ou renaissance à des hebdomadaires à caractére<br />
politique comme le "Reveil" organe de presse porte-parole des Anciens Combattants,<br />
"Clarté" organe du parti socialiste sénégalais, "l'AOF" dans lequel apparaissent doctrine,<br />
orientations et mots d'ordre de la Fédération socialiste du Sénégal que dirige Me<br />
Lamine Guéye.<br />
Dakar vécut donc un renouveau des activités politiques mais le clivage<br />
fondamental entre les associations ne s'éteignit pas : d'un côté l'élément autochtone de<br />
la population dakaroise, de l'autre l'élément européen. Si ce dernier trouva<br />
généralement suffisamment de ressorts internes pour pouvoir unir ses anciens éléments<br />
vichystes à ceux de la Résistance, l'élément autochtone dans lequel les clivages sont<br />
39
Il REMARQUES GENERALES SUR LES PARTIS POLITIQUES.<br />
On peut, au début de cette étude des partis politiques, faire une série de<br />
remarques générales sur leur durée, leur mode de recrutement, leur orientation, leur<br />
représentativité, leurs relations avec l'administration coloniale.<br />
Cette étude s'intéresse seulement aux principaux partis politiques de la<br />
période. Les autres partis ne sont pas étudiés car ils furent éphémères et sans poids réel<br />
sur la scène politique: exemple le RDS fondé à la fin de 1955 par Abbas Guéye qui finit<br />
par rejoindre la SFIO un an plus tard, sans avoir eu une existence effective excepté dans<br />
quelques milieux lébous de la capitale. Deux autres partis n'eurent aucune audience<br />
réelle: d'une part le Parti travailliste indépendant du Sine Saloum fondé par Djim<br />
Momar Guéye après que le congrès de la SFIO ait prononcé son exclusion en 1946 et<br />
d'autre part le BDD (Bloc Démocratique du Diambour).<br />
l} Durée d'activités:<br />
- Dix ans et plus: trois partis:<br />
* la SFIO que nous retrouvons à Dakar dès la fin de la seconde guerre<br />
mondiale jusqu'en 1956. Elle devint par la suite le PSAS puis se retrouve dans l'UPS en<br />
1958.<br />
* Le BDS créé en 1948, se fond dans le BPS en 1956 et dans l'UPS en 1958.<br />
* L'UDS né en 1947, rejoint le BDS dans le cadre unitaire du BPS en 1956.<br />
- Entre cinq et dix ans d'activité: aucun parti.<br />
- Entre 1 et 4 ans, il y'en a eu trois :<br />
* Le P.A.I (3 ans), le M.P.S (2 ans), le PRA-Sénégal (2 ans), le P.S.S (1 à 2<br />
ans) et le M.L.N (1 an).<br />
Il s'en suit que de manière importante, trois formations seulement ont occupé<br />
longuement l'échiquier politique sénégalais: la SFIO, le B.D.S et l'U.D.S. L'UDS/RDA<br />
a connu une longue traversée du desert dans l'activité pratique en raison de ses<br />
querelles d'orientation qui aboutirent à l'existence de fait de deux formations politiques<br />
concurrentes à partir des années 1950; donc en fait, seuls la SFIO et le BDS ont vécu<br />
longtemps et ont marqué la scène politique. Pour l'essentiel, les partis politiques<br />
sénégalais, autres que la SFIO et le BDS, sont nés dans la période de l'application de la<br />
Loi-cadre, période pendant laquelle, face aux nouvelles orientations de la métropole,<br />
des répercussions locales importantes se perçoivent. Il s'agit donc dans la grande<br />
majorité de partis politiques jeunes.<br />
42
2) Les modes de recrutement et de fonctionnement;<br />
On distingue deux sous-groupes;<br />
a) - un sous groupe constitué par des partis de notables et de clientélisme<br />
politique; la SFIO, le BDS, le PSS.<br />
Dans ces partis, les hommes en tant que tels sont les raisons<br />
d'apparentement: "je suis laministe" ou "senghoriste" sont des expressions que diverses<br />
enquêtes menées à Dakar, dans la période, ont dégagées comme étant des moyens de<br />
{ proclamer son appartenance militante. L'orientation politique du parti n'est pas une<br />
l référence importante puisque l'activité militante effective se réduit à des rares<br />
manifestations qui ont lieu le plus souvent, lorsque le leader revient de la métropole ou<br />
lors des consultations électorales. Evidemment, ces formes d'attachement à un homme,<br />
plus qu'à tout autre chose, donnent aux leaders SFIO, BDS et PSS l'obligation de<br />
paraître plutôt que d'être. Cela implique de créer une distance suffisante entre le leader<br />
et la masse, pour que celle-ci ne découvre pas l"'homme commun" dans le leader. Les<br />
entourages des leaders et la rumeur publique jouent bien le jeu. Ainsi entend on dire"<br />
Senghor sait plus que les Français" car il est agrégé et "enseigne les Français" dans leur<br />
plus grande école (ENFOM). Cheikh Tidiane Sy "est le fils du premier Calife Malick Sy"<br />
chef religieux vénéré. Lamine Guéye, premier avocat d'AOF "connait le droit français<br />
plus que les Français". Dans ce mode de fonctionnement du parti, les notables, où qu'ils<br />
se situent, sont importants car ils sont les califes, c'est à dire les représentants de "dieu<br />
leader" au niveau local. Abbas Guéye désigna son propre grand frère comme son<br />
représentant attitré à Dakar et le journal du parti consacre un article à cette nomination<br />
pour la populariser davantage. Dans les conditions de fonctionnement de ces partis, le<br />
leader, homme hors du commun des mortels, est vénéré. Il en résulte que les luttes de<br />
personnes sont au centre de tout. Senghor souffre d'être sous l'ombrage de Lamine<br />
Guéye et rompt avec lui. Abbas Guéye se sent humilié du peu de considération que lui<br />
accorde son colistier, le député Senghor; il fonde alors son propre parti après la rupture.<br />
C'est ce mode de fonctionnement qui organise le régionalisme dans la<br />
mesure où chaque notable a tendance à ne donner d'importance qu'à son propre milieu.<br />
Le BDS a eu à souffrir de ce mode de fonctionnement qui pourtant lui a semblé, au<br />
départ, un moyen démocratiql,le et libéral puisque tous les groupes ethniques<br />
(Toucouleurs, Lébous, Ouolofs...) pouvaient être représentés. Mais un tel système finit<br />
par mettre en évidence de puissants intérêts régionaux qui sans qu'aucun d'entre eux ne<br />
puisse dominer, deviennent une menace pour l'unité même du parti obligeant Senghor à<br />
mener la bataille autour de la seule bannière du BDS. La SFIO a connu ces mêmes<br />
difficultés puisque les luttes, à Dakar, entre ressortissants de Saint-Louis et Lébous se<br />
sont répercutées jusqu'au fonctionnement même du conseil municipal dirigé par un<br />
Saint-louisien, Lamine Guéye. Les lébous revendiquaient le poste de premier adjoint<br />
43
qui devait leur permettre de contrôler la mairie de Dakar puisqu'à cause des absences<br />
fréquentes et prolongées du maire, souvent retenu en métropole notamment par les<br />
fonctions de député ou de ministre, le premier adjoint était le véritable patron de la<br />
mairie.<br />
b) - Le sous groupe à organisation démocratique:<br />
Dans cette catégorie, se rangent l'UDS, le PAl, le PRA-Sénégal, le MLN.<br />
Ces partis ne reposent pas sur la personnalité exclusive du leader politique.<br />
Le responsable moral du parti n'est pas une personnalité particulièrement importante<br />
qui émerge notoirement des autres responsables. Ainsi, l'UDS-RDA de 1946 à 1956 est<br />
dirigé par Doudou Guéye puis par Bassirou Guéye. Mais ces deux personnalités n'ont<br />
vraiment rien de particulierement notable par rapport aux autres avec lesquelles elles<br />
assument la direction du mouvement politique. Il en est de même au P.A.I qui est dirigé<br />
par Mahjmout Diop. Cette absence de personnalité spécifiquement particulière autour<br />
de laquelle se fonderait le parti politique, est certainement dans ce contexte dakarois,<br />
une donnée fondamentale de démocratie. Que le chef de parti soit présent ou absent, le<br />
parti fonctionne, organise ses réunions, développe son programme etc... Ce qui n'est pas<br />
le cas dans les partis de notable comme la SFIO qui ne peut ni fixer et ni tenir ses<br />
congrès tant que son leader Lamine Guéye est absent. Même lorsque les dates sont<br />
fixées, elles sont susceptibles d'être modifiées par le calendrier métropolitain de son<br />
chef. Ainsi, on vit ce parti annuler sine die au dernier moment ses assises de congrès<br />
parce que Lamine Guéye ne pouvait être présent au Sénégal. Dans l'incertitude d'une<br />
nouvelle date de tenue du congrès, les délégués sont appelés à rester sur le qui vive car<br />
celui-ci peut se tenir dès que le leader débarqué. Il en est de même du BDS car<br />
beaucoup de rapports politiques trimestriels ou annuels tout comme les rapports<br />
journaliers de police et de sûreté dégagent l'absence d'activités du parti à Dakar quand<br />
le leader Senghor est absent.<br />
Les partis UDS, P.A.I et PRA-Sénégal ne sont donc pas des partis où seul le<br />
Chef compte. Dans ce sens, leur fonctionnement est plus régulier. C'est ainsi par<br />
exemple qu'au moment où le secrétaire général de l'UDS fut emprisonné pour délit de<br />
presse en 1990, les activités du parti n'en souffrirent point. Il en est de même pour le<br />
P.A.I dont le premier secrétaire fut arrêté à diverses reprises, mais le parti, dans la<br />
période, ne fut nullement affaibli. Ces partis, parce qu'ils ne reposent pas sur la seule<br />
personnalité du chef, sont plus à même de pouvoir surmonter les épreuves lorsque, pour<br />
telle ou telle raison, le chef n'est pas là ou n'est plus dans la ligne. Ainsi, l'UDS n'est pas<br />
particulièrement affecté dans son fonctionnement, lorsque son secrétaire général<br />
Doudou Guéye, sorti de prison, se range aux thèses d'Houphouët Boigny. Les partisans<br />
de la ligne de refus de la collaboration prônée par le député ivoirien, malgré la<br />
44 .<br />
4. Voir rapport 13 eme congrès SFIO: télégramme à Lamine Guéye, télégramme de réponse de Lamine, télégramm<br />
envoyés aux sections in dossier H/34 série 2G, Mai 1951, Archives municipales de Dakar.
épression entreprise par l'administration, remontent la pente et quatre ans plus tard,<br />
apprécient favorablement la distance parcourue dans le sens du redressement. Ce<br />
redressement est confirmé par des rapports de l'administration elle-même, preuve que<br />
la deféction du chef ne plongea pas le parti dans le chaos. C'est le contraire qui se passe<br />
au P.S.S : il a suffi, en 1959, au gouvernement Mamadou Dia de mettre Cheikh Tidiane<br />
Sy en prison pour obtenir, pratiquement la disparition totale des activités de son parti, le<br />
PSS et lorsque le leader religieux retrouve la liberté, c'est en fait, au prix d'un abandon<br />
de son opposition au pouvoir. Il se rallie publiquement. Ce ne fut pas le cas au P.A.I<br />
dont l'organe de la section territoriale du Sénégal "Mom Sarew" titre, au sujet de<br />
l'emprisonnement de divers responsables du parti : «Même en prison, la lutte continue ».<br />
Ce qui prouve que cet emprisonnement n'a eu d'effet démobilisateur ni sur les<br />
responsables emprisonnés ni sur les militants de base.<br />
3) L'orientation<br />
Les partis politiques sénégalais sont certes nombreux dans la période mais,<br />
les orientations se schématisent de la manière suivante:<br />
- les partis de la continuité<br />
Ce sont ceux pour lesquels, un combat conséquent contre la domination<br />
coloniale ne rentre pas dans les préoccupations essentielles. Ce sont la SfIO, le BDS, le<br />
MPS, le PSS.<br />
Avant 1950, Lamine Guèye et Senghor prônent plus ou moins ouvertement<br />
l'assimilation que la métropole propose à ses "enfants aînés". L'un et l'autre cultivent les<br />
amitiés coloniales: Lamine Guéye fait placer le gouverneur Wiltord à la tête du Sénégal<br />
et Jacquemin Vergnet, un ami non moins connu, à la Délégation de Dakar. Il devient lui<br />
même membre du gouvernement français en qualité de sous-secrétaire d'état à la<br />
présidence. Leopold Sédar Senghor n'est pas en reste dans cette manière de cultiver<br />
l'assimilation : il est si influent sur Bernard Cornut Gentille, le Haut commissaire<br />
dakarois q'une partie de la presse locale met le fait en exergue; de même qu'il fut, à un<br />
niveau politiquement plus élevé que Lamine Guéye, membre du gouvernement français<br />
comme secrétaire d'état dans le gouvernement Edgar Faure. Il avait chanté, sur toutes<br />
les tribunes, les bienfaits de l'assimilation. Le colonialisme a vu d'un bon oeil le<br />
déploiement de toute cette activité et en retour a eu, à son égard, des marques<br />
d'attention privilégiée. Invité et envoyé partout, Senghor était chargé de prouver la<br />
réussite de l'oeuvre coloniale; il le fit au cours de ses nombreux voyages à l'ONU, au<br />
parlement de Strasbourg, aux congrès de la jeunesse mondiale, tendance WAY, aux<br />
congrès de la jeunesse de l'Vnion française etc... Partout le discours est aux antipodes de<br />
la lutte et de l'indépendance nationales. Parfois même, il prend des positions<br />
45
enflammées pour mieux y revenir, ensuite estimant qu'il a été abusé: ainsi, en 1950,<br />
lorsqu'il parle à Strasbourg des "Etats Unis d'Afrique" ce qui permet à l'hebdomadaire<br />
de la droite française "Climats" de railler "ces Etats Unis d'Afrique qui n'auront duré<br />
que 24 heures"; ceci nous indique que l'incartade de l'homme politique sénégalais peut<br />
être pardonnée, parce qu'elle n'est pas réellement consciente 5 . Cheikh Tidiane Sy, chef<br />
du PSS, assimilait le vote en faveur du oui au référendum à un acte religieux car tout<br />
musulman doit "saisir sa chance quand Dieu ouvre une porte (du Paradis) avant qu'elle<br />
ne se referme". Le PSS regroupait, essentiellement, parmi ses principaux fondateurs,<br />
ceux qui n'avaient pas pardonné à l'UPS d'avoir tardé à se proclamer en faveur du "oui".<br />
Le pro-gaullisme si ouvertement affiché par ces hommes en Août et septembre 1958<br />
n'était rien d'autre qu'un refus délibéré de tout processus de marche vers<br />
l'indépendance.<br />
- Les partis à orientation progressiste.<br />
Dans cette catégorie, nous rangeons l'UDS, le PAI et le PRA-Sénégal.<br />
Depuis le choix de Bamako en 1946, le RDA avec plus ou moins de<br />
conséquence dans l'action, affiche une orientation progressiste c'est à dire de remise en<br />
cause du système colonial, et d'édification d'une société nouvelle. Sa section locale de<br />
l'UDS plus peut être même que la direction du parti, essaie d'appliquer cette orientation<br />
sur le terrain. Ceci avec d'autant plus de conséquence que ses hommes proviennent de<br />
structures telles que le CEFA ou le GEC sur lesquelles l'administration ne se trompait<br />
pas; elle s'en méfiait et les surveillait étroitement car elle trouvait dans ces structures<br />
des ennemis du système colonial : les communistes. Du reste, lorsque la direction<br />
houphouëtiste du RDA passe avec armes et bagages à la collaboration, c'est l'UDS, tout<br />
comme l'UPC et l'Union nigérienne qui refusent ouvertement de suivre. C'est la raison<br />
pour laquelle la direction exclut ces organisations territoriales du mouvement. C'est<br />
aussi ce choix progressiste qui justifie la dure répression contre l'UDS dans les années<br />
1950-1954. Même lorsque en 1956, il s'allie au parti senghorien dans un processus de<br />
recomposition politique au Sénégal, Senghor qui accepte l'unité sait prendre<br />
suffisamment de précautions contre ces hommes venus de l'UDS puisqu'aucune<br />
responsabilité importante ne leur est confiée dans la nouvelle formation ainsi mise en<br />
place. D'autre part, à travers la ligne de rupture de l'UPS en septembre 1958 qui donne<br />
naissance au PRA-Sénégal, ce sont les anciens militants de l'UDS/RDA qui constituent<br />
pour l'essentiel, le gros des troupes de la rébellion. Ce sont ces hommes qui refusent,<br />
lors de la réunion du comité exécutif de l'UPS à Rufisque le 10 puis le 20 septembre, de<br />
laisser passer cette occasion d'être indépendant et de s'engager dans une perspective<br />
5. "Climats· du 31 août 1950.<br />
46
d'édification du socialisme. Jusqu'à la fin de 1960, le PRA-Sénégal, en ce qu'il peut être<br />
considéré comme une survivance de l'UDS, mène une activité politique progressiste.<br />
Le P.A.I, lui aussi, par son manifeste, posait clairement une orientation<br />
progressiste puisqu'il affichait son option pour l'édification d'une voie communiste en<br />
rupture totale, sur le plan politique et social, avec le système colonial.<br />
La direction de l'UPS comprenait donc bien l'incompatibilité qui existait<br />
entre son action politique et gouvernementale et le style et l'orientation de cette<br />
formation marxiste; d'où la répression gouvernementale contre le P.A.I.<br />
4) Le poids des partis politiques ou leur représentativité.<br />
Les paramètres de mesure sont nombreux mais s'avèrent inégalement fiables.<br />
Si nous prenons l'aspect électoral et le résultat des urnes, à coup sûr, dans le<br />
Dakar de la période étudiée, les partis réellement les plus importants sont dans l'ordre,<br />
la SFIO et le BDS. Toutes les autres formations qui se sont présentées dans des<br />
consultations électorales, n'ont jamais obtenu de résultats chiffrés significatifs par<br />
rapport aux suffrages exprimés. La SFIO sort nettement victorieuse de toutes les<br />
consultations, qu'elles soient municipales, cantonales ou législatives (française ou<br />
sénégalaise). On constate même qu'à toutes les consultations électorales, ses scores sont<br />
au moins le double de ceux de son adversaire principal: le BDS G •<br />
Dans la phase d'unification de la formation de Lamine Guéye et de celle de<br />
Senghor, le terrain dakarois devient une véritable chasse gardée pour ce parti politique<br />
nouveau qu'est l'UPS. Les urnes traduisent, par exemple aux élections législatives de<br />
mars 1959, une victoire UPS acquise à près de 99 % des voix. Ce résultat marque les<br />
débuts d'un score coutumier des partis au pouvoir en Afrique francophone, surtout<br />
après les indépendances. Le parti islamique PSS, malgré l'appartenance de la<br />
population de Dakar à plus de 80 % à la religion islamique, a presque été marginalisé<br />
aux élections de 1959. Le PRA-Sénégal fut moins heureux encore si nous considérons<br />
ses résultats en Mars 1959 et aux municipales de 1960. Le PAI obtient des résultats de<br />
l'ordre de "epsilon" à Dakar, aux élections municipales de juillet 1960. D'autres<br />
formations eurent des résultats électoraux plus faibles encore.<br />
En somme, sur la base des résultats des consultations électorales, nous<br />
pouvons dire que la SFIO et le BDS, avec leurs variantes des étapes du processus de<br />
reconstruction politique, ont eu une réelle influence à Dakar.<br />
crédible?<br />
Mais ce critère électoral peut-il être considéré comme suffisamment<br />
6. Voir Ive partie, Chap II, Validité des scrutins.<br />
47
apparentement du parti africain au parti européen7. Les signes distinctifs du parti<br />
étaient la couleur rouge et trois flèches parallèles.<br />
Le fondateur de la section AOF/Togo fut Me Lamine Guéye, de son nom<br />
complet: Amadou Lamine Ibrahima Guéye. Il fut le premier avocat africain inscrit au<br />
barreau dakarois. Sa carrière d'avocat fut intimement liée à sa carrière politique dans la<br />
mesure où la première permit, incontestablement, de faire connaître l'homme dans le<br />
grand public dakarois, sénégalais et aussi aofien. C'est dès 1921, alors qu'il n'est que<br />
simple avocat stagiaire, qu'il entre dans les grandes affaires où politique et droit sont<br />
profondément liés. A l'occasion du différend opposant les grandes maisons de<br />
commerce de la place aux municipalités nouvellement élues de Saint-louis et de Dakar,<br />
Lamine Guéye accepte de défendre les dites municipalités, attitude particulièrement<br />
courageuse de la part d'un Africain à cette période, de surcroît simple avocat stagiaire.<br />
La première étape de la défense eut lieu le 11 juin 1921. Les tribunaux de Saint-louis et<br />
de Dakar, par jugement donnèrent raison aux grandes maisons commerciales du groupe<br />
bordelais d'origine, plaignantes sur la question des taxes jugées illégales mais qui,<br />
pendant plus d'une quinzaine d'années avaient été acquittées par elles.<br />
Pourquoi attendre l'élection d'équipes municipales toutes favorables au<br />
député noir Blaise Diagne pour sortir la grande artillerie et d'ester en justice ? La<br />
question se posa. Le fait est perçu par la défense des municipalités comme une attitude<br />
délibérément politique; ceci explique le pourvoi en appel fait par Lamine Guéye après<br />
l'echec simultané à Dakar et Saint-Louis où les deux tribunaux crurent devoir juger<br />
l'affaire le même jour.<br />
Lorsque l'arrêt de la cour d'appel de Dakar, rendu le 3 novembre de la<br />
même année, déclara les établissements Maurel et Prom mal fondés en toutes leurs<br />
démarches, fins et conclusions, le jeune avocat d'origine saint-Iouisienne obtint une<br />
brillante victoire morale. Elle eut un grand impact sur l'opinion sénégalaise qui s'était<br />
profondément passionnée pour le procès. Après ce procès contre le grand commerce<br />
bordelais, l'avocat dakarois eut à assumer d'autres défenses importantes dans des<br />
affaires où les victimes étaient des Africains poursuivis par l'administration coloniale.<br />
Ce fut le cas dans l'affaire du marabout mouride Cheikh Anta Mbacké de Touba ou<br />
dans l'affaire d'un autre marabout de la confrérie tidiane Cheikh Hamallah fondateur<br />
de la branche hamalliste. Lamine Guéye plaida aussi pour El Hadji Maguette Bâ.<br />
Malgré les jugements de tribunaux favorables comme celui de El Hadji Maguette Bâ<br />
commerçant notoirement connu à Dakar, ces personnalités africaines furent toutes trois<br />
par décision administrative,condamnées à la déportation.<br />
Me Lamine Guéye y gagne beaucoup en popularité malgré l'echec de ses<br />
actions au plan du droit. Aussi, on peut ajouter à son actifla défense des rescapés parmi<br />
7. Dimitri Georges Lavroff, Les partis politiques en Afrique noire. Que sais je ? 1970.<br />
50
1<br />
les tirailleurs de l'aube du 1er décembre 1944 à Thiaroye. L'avocat dakarois avait<br />
spontanément offert sa défense aux victimes de la fusillade qui inspira à Sembène<br />
Ousmane, écrivain et cinéaste sénégalais, le film intitulé "Camp de Thiaroye"S.<br />
Malgré cette popularité, Lamine Guéye échoua en 1934 quand il brigua.<br />
contre Galandou Diouf, la députation du Sénégal. Lorsque le deuxième conflit mondial<br />
s'achève, cette popularité atteint à son sommet avec son activité personnelle sur les<br />
questions des salaires, des prisonniers de guerre rapatriés, des terres léboues, du droit<br />
de vote des femmes sénégalaises autochtones des quatre communes etc...<br />
La constitution du 27 octobre 1946 marquant l'entrée en vigueur des partis<br />
permit une reprise totale de toutes les activités politiques. Lamine Guéye qui avait dèjà<br />
constitué une liste du Bloc africain pour briguer les suffrages des Dakarois, s'était vu<br />
largement plébiscité. Le quotidien "Paris-Dakar" écrivait à ce sujet: « Dakar a voté hier<br />
comme Saint-Louis et Rufisque. Jamais élections ne furent aussi calmes...La liste Lamine<br />
Guéye massivement élue»9. Ce premier triomphe électoral de Lamine Guéye à Dakar,<br />
inaugurait une longue série dans laquelle la municipalité de la capitale fédérale fut<br />
dominée par la SFIO de 1945 à 1960.<br />
b) Composition de la SFIO.<br />
La SFIO, dans les premières années de l'après guerre, représente diverses<br />
couches de la population sénégalaise surtout dans cette première étape où le suffrage<br />
universel n'était pas encore établi et où le parti garde son unité.<br />
* Les travailleurs salariés autochtones qui se considèrent comme brimées par<br />
l'administration coloniale et le secteur privé. La principale revendication, pendant<br />
longtemps fut, pour ces travailleurs, " A travail égal, salaire égal" formule largement<br />
reprise à Dakar particulièrement, mais au Sénégal et en AOF en général. Le poids des<br />
travailleurs salariés, surtout dans les villes communes de plein exercice, ralliés au parti<br />
politique SFIO, fit prendre en charge cette revendication par les instances du parti.<br />
Lorsque Lamine Guéye fut élu à la première constituante, les travailleurs salariés<br />
sénégalais purent espérer avoir une tribune pour exprimer leurs revendications. Le 30<br />
juin 1950, Lamine Guéye obtint le vote de la seconde loi portant son nom. Elle se<br />
résume au fait que, dans les TOM, entre Européens et autochtones, les salaires,<br />
désormais furent les mêmes, à travail égal.<br />
* Les couches moyennes et supérieures de l'élément lébou de Dakar :<br />
parceque la SFIO leur apparaissait comme le parti défendant les intérêts de la<br />
collectivité léboue particulièrement à travers la question des terres. Le fait que cet<br />
élément lébou soit d'un poids déterminant dans l'électorat dakarois, fait comprendre,<br />
8. Film paru en décembre 1988 à Dakar.<br />
9. 1 er el 2 juillet 1945.<br />
51
Comment s'expliquerait une progression aussi rapide des effectifs des<br />
mandats et normalement des mandants? La question mérite d'être posée même si nous<br />
ne pouvons pas y répondre directement. De même, est un autre paramètre de la<br />
représentativité de Dakar dans les instances dirigeantes de la SFIO: la composition de<br />
commission administrative exécutive car elle est, après le congrès, la seconde instance<br />
par ordre d'importance. Sur les 36 membres après son renouvellement au XIéme<br />
congrès du parti en Avril 1950, Dakar compta 12 contre 5 à Saint-Louis, 3 à Kaolack et 1<br />
à Thiès. Le poids de Dakar est donc d'un tiers dans l'instance territoriale de la SFIO. On<br />
remarque évidemment que ce poids n'a rien à voir avec le nombre des mandats au<br />
congrès. En effet, on compte alors un tiers des postes à la commission administrative<br />
exécutive pour 12 mandats de délégués; tous les délégués de Dakar font partie de<br />
l'instance. D'autre part, en regardant de près la composition de la commission<br />
administrative exécutive issue de ce congrès dont la liste est donnée par ordre<br />
d'importance, on remarque que sur les 12 représentants de Dakar, 3 occupent les trois<br />
premiers rangs. Ils sont tous trois conseillers municipaux de la commune de Dakar avec<br />
à leur tête, le maire de la ville, Lamine Guéye 12 .<br />
La représentation à l'Assemblée Territoriale du Sénégal qui comptait 50<br />
membres, constituait un autre élément d'appréciation du poids politique de la SFIO. En<br />
1947, elle était représentée au sein de l'institution territoriale par 47 membres conduits<br />
par Lamine Guéye et Senghor, tous deux députés. En mars 1952, la SFIO n'obtient que<br />
19 sièges sur un total cette fois-ci de 60 au lieu des 50 précédents. En 1957, date du<br />
premier suffrage universel au Sénégal, le PSAS (Parti Sénégalais d'Action Socialiste,<br />
nouvelle dénomination de la SFIO) recueille 19 % des voix alors que le BPS ( fusion du<br />
BDS, force principale, avec d'autres formations) obtient 78 % des suffrages.<br />
d) La Question des moyens matériels et financiers du parti.<br />
C'est une question d'importance capitale. Dans la mentalité populaire, la<br />
SFIO est avant tout perçue comme le parti qui organise les grandes réceptions de "mille<br />
et un couverts" où le bon riz au poisson "Thiéboudiène" ou le riz à la viande "thiébou<br />
yapp", les boissons de toutes sortes et autres victuailles sont servis en abondance.<br />
Alcools et femmes aussi n'y font pas défaut si l'on en croit certaines sources. Tout ceci se<br />
déroule au milieu des chants et danses exécutés à la gloire des leaders politiques;<br />
Souvent, de gros billets de banque, tout neufs, viennent s'engloutir dans les poches des<br />
chanteurs et danseurs émérites. Ces réceptions de la SFIO ont souvent été considérées<br />
comme de véritables "khawarés" c'est à dire des manifestations traditionnelles<br />
auxquelles on se livrait dans les cours royales du Cayor, du Djolof, du Baol, du Sine<br />
12. Ibidem<br />
54
Saloum, manifestations dans lesquelles. la morale était mise de côté provisoirement, ce<br />
qui amena certains adversaires politiques à qualifier ces réceptions de séances d'orgies.<br />
Le journal de Senghor les définit de la manière suivante : « C'est tout ce qui se trouve<br />
dans l'opposé de l'Islam »13.<br />
La SFIO utilise facilement toute occasion pour organiser des réceptions et<br />
celles-ci deviennent aussi des formes de recherche d'argent pour le financement des<br />
activités du parti. Le journal d'opposition, "Condition Humaine" dénonce ces pratiques<br />
en écrivant : « Des quêtes auprès des commerçants étrangers ou des fonds provenant de<br />
sources inavouables »14. Il en est de même des "fanaIs" SFIO qui, annuellement à Noél<br />
ou le jour de l'an, circulaient dans les rues de la capitale ou d'autres grandes villes du<br />
territoire. C'étaient des occasions publiques pour les grands dignitaires du parti de faire<br />
preuve de véritables largesses, tout comme le faisaient les grandes notabilités qui<br />
pouvaient avoir l'honneur que le fanal porte leur nom. A ce sujet, d'aucuns n'ont pas<br />
hésité à parler de "véritables folies financières".<br />
Mais cet argent ainsi dépensé est-il propriété du parti SFIO? la réponse à<br />
cette question n'est pas facile à donner. La comptabilité de la formation politique, si on<br />
considère stricto sensus les rentrées classiques c'est à dire, achat des cartes de membres<br />
et autres matériels de propagande, cotisations régulières et occasionnelles, n'est pas<br />
rose, du moins dans les années pour lesquelles nous avons des chiffres. A ce sujet, le<br />
rapport financier soumis à la réflexion des délégués du XIème congrès du parti, envoyé<br />
préalablement à toutes les sections, indiquait ceci : « Le montant du matériel avancé à<br />
certains responsables de sections s'éléve à 196.000 Fr CFA... Espérons que cette situation<br />
sera régularisée dans les meilleurs délais et que ces prêts ne viendraient pas s'ajouter à nos<br />
vieux débiteurs ».<br />
Au total 15 , nous pouvons faire les observations suivantes: la source<br />
principale des finances du parti provient de la cotisation des parlementaires pour<br />
313.726,95 Fr car la somme de 765.570 Fr provenant de la vente du matériel concerne<br />
en réalité les sommes recueillies au cours de trois années (1947, 1948, 1949) et même<br />
d'une partie de l'année 1950. Par ailleurs, ce budget ne mentionne pas la part de<br />
13. "Condition Humaine" du 8 mars 1952.<br />
14. Le 14 juin 1949.<br />
15. Ce rapport présentait, dans ses grandes lignes, la situation de la manière suivante:<br />
Recettes (en Fr CFA)<br />
encaisse au 31 od 1948 : 102.172,80<br />
produit vente du matériel: 765.570<br />
souscriptions élections complémentaires: 40.000<br />
cotisations des parlementaires: 313.726,95<br />
TOTAL: 1.221.469,75<br />
Au chapitre des dépenses, nous retrouvons:<br />
- dépenses engagées: 869.346,95 Fr CFA<br />
- encaisse au 8/4/1950: 352.122,80 Fr CFA.<br />
55
cotisations des militants alors que la contribution des parlementaires y figure. Faut-il en<br />
déduire que les militants ne cotisent pas ? Certainement pas. Il faut rechercher les<br />
causes de la non indication de la participation financière des militants dans le fait que<br />
que, certainement, peu d'entre eux ont pu effectivement payer leur cotisation, donnant<br />
alors des sommes maigres. Le rapport financier indiquait d'ailleurs que des sections<br />
restent débitrices de sommes élevées et ceci malgré les appels réitérés de la direction.<br />
Ceci prouve que l'état de la trésorerie de la SFIO n'est pas brillante. Ceci est du reste<br />
confirmé par le rapport qui dit: « Devant une telle situation, des réductions sévères ont été<br />
opérées sur toutes nos dépenses ». On comprend, par la suite que parmi les éléments<br />
menacés par la réduction, il y'a le journal de la SFIO, "l'AOF" pour lequel le rapport<br />
présageait un danger sur la poursuite de la parution.<br />
La trésorerie de la SFIO, c'est aussi, dans une large mesure, un appel direct à<br />
certaines autres sources de financement, les souscriptions notamment. A partir du 1er<br />
novembre 1947, une vaste campagne pour une souscription de "solidarité volontaire et<br />
libre" est lancée en direction des militants et sympathisants. L'objectif assigné à cette<br />
opération par le congrès réuni à Kaolak est de ramasser 1.000.000 Fr CFA Le texte de<br />
l'appel massivement distribué, explique la raison de fond de cette souscription<br />
particulière qui est destinée à « implanter la démocratie socialiste jusque dans les<br />
moindres villages de brousse ». Cet appel se fixe une limite de temps « Il faut que nous<br />
l'ayons avant la fin de la traite », c'est à dire la vente des arachides qui se situe d'octobre<br />
à mars, soit une durée de cinq à six mois. L'objectif a t-il été atteint ? Le rapport<br />
financier au congrès de 1950, dit à ce sujet « La souscription ouverte en 1948, avait<br />
rapporté la somme de 386.846 F CFA, soit un peu plus du tiers des prévisions ».<br />
L'argent du parti provient aussi de personnalités à titre de grands électeurs<br />
de la SFIO auxquels le secrétaire général Amadou Babacar Sarr écrit individuellement<br />
pour annoncer la souscription et leur envoie des feuilles pour que les intéressés fassent<br />
un travail de collecte auprès d'eux. Ely Manel Fall, chef du canton de Diourbel, reçoit<br />
55 feuilles numérotées. Dans la lettre à Cheikh Mbacké grand chef religieux à Touba, il<br />
est écrit que le motif de l'envoi de sa sollicitation est « Pour vous demander d'aider (le<br />
parti) en vue de toucher la masse de vos talibés ». Sont sollicités d'autres notables comme<br />
Abdoul Soulèye Bâ, chef du canton de Djilor, Massamba Sall, chef de canton à<br />
Tivaouane mais aussi des hommes d'affaires comme Robert Delmas de la Chambre de<br />
commerce de Dakar. Sur cette question, le dossier SFIO aux archives de la municipalité,<br />
regorge de noms de chefs de cantons, présidents de coopératives, grands chefs religieux,<br />
commerçants...<br />
Les moyens financiers de la SFIO proviennent également, en partie, de la<br />
Municipalité de Dakar. Même s'il est difficile d'en apporter des preuves irréfutables,<br />
une chose demeure certaine comme une forte présomption basée sur la multitude des<br />
attaques contre la gestion municipale. Là, le principe des vases communicants jouait<br />
56
particulièrement entre la trésorerie du parti et le budget municipal car ceux qui gèrent<br />
ce budget sont les hauts responsables de la SFIO. Du reste, cette situation n'est pas<br />
propre à la seule Municipalité de Dakar. La Cour des Comptes à Paris, dans son rapport<br />
d'inspection à Dakar sur les budgets de 1945 à 1950 mais aussi à Saint-Louis et<br />
Rufisque, est formelle dans ce sens: toutes les municipalités de plein exercice agissent<br />
ainsi.<br />
La comptabilité de la trésorerie de la SFIO est-elle correctement tenue? Ce<br />
n'est pas toujours le cas. Ainsi, Youssou Mbargane Diop, secrétaire de la section SFIO<br />
de Louga nous apprend dans une lettre qu'il adresse au trésorier général de la<br />
fédération SFIO, que le rapport financier soumis au congrès de Kaolak en 1947 a été<br />
rejeté à l'unanimité des congressistes. Lui-même se plaint, dans sa lettre, qu'une sonune<br />
de 20.000 Fr envoyée par sa section pour la participation aux frais de réception du chef<br />
de l'Etat Vincent Auriol, ne laisse trace nulle part dans le rapport du trésorier général<br />
bien que l'engagement de faire la lumière sur cette question ait été pris 16 .<br />
Manifestement, ce trésorier de section met en cause la bonne foi du trésorier national<br />
du parti SFIO. Ceci peut bien être une explication au rejet du rapport financier par le<br />
congrès.<br />
e) Comment fonctionne la SFIO?<br />
La SFIO-Sénégal est un élément de la fédération d'AOF/Togo de la SFIO<br />
parti politique français. D'après Obéye Diop, ancien responsable territorial au Sénégal,<br />
cette section étal/'t,par l'importance de .ses militants 17 , la quatrième du parti<br />
lmétropolitain de . Elle est directement rattachée aux instances nationales<br />
métropolitaines et en épouse intégralement le programme politique. Elle a cependant<br />
une certaine autonomie locale dans la mesure où la section sénégalaise est la base de la<br />
SFIO AOF/Togo et parce qu'elle est la structure territoriale la plus importante par ses<br />
effectifs, son implantation et ses activités. Elle tient régulièrement ses assises annuelles<br />
et les congrès sont organisés, de manière rotative, à travers les grandes villes du Sénégal:<br />
Dakar, Saint-Louis, Kaolak, Diourbel... Ces assises permettent au mouvement de se<br />
rapprocher, chaque année, d'une de ses bases locales, ce qui stimule la section régionale<br />
qui reçoit le congrès. Le rapport moral soumis à la réflexion du XIIIéme congrès<br />
donnait l'explication en ces termes « Pour la cinquième fois, nous avons accepté de<br />
comparaître en accusés, devant la base, pour que la voix des militants se fasse entendre,<br />
pourproclamer clairement si oui ou non, nous avons été à la hauteur des grandes tâches qui<br />
nous ont été confiées ». Ces congrès sont dominés pendant presque toute la période de<br />
1945 à 1950, par les interventions des parlementaires du parti dans les compte-rendus<br />
16. Archives municipales de Dakar, série 2G, dos H/23.<br />
17. Quotidien sénégalais "Soleil" du 30 juillet 1986, pp 6-7.<br />
57
d'activités, surtout celles qui concernent les représentations en métropole : Palais<br />
Bourbon, Sénat, Assemblée de l'Union Française etc...<br />
Cette rubrique est si importante qu'on ne conçoit pas la tenue d'un congrès<br />
en l'absence des parlementaires et particulièrement du chef de la SFIO locale, Lamine<br />
Guéye. C'est pourquoi les dates exactes des congrès sont souvent fonction de la<br />
disponibilité des leaders, souvent retenus à Paris. Il arrive ainsi qu'un congrès soit<br />
renvoyé seulement deux à trois jours avant sa tenue, à cause de "l'impossibilité du chef<br />
d'être présent,,18. Ces compte-rendus d'activités justifient, qu'à chaque passage des<br />
parlementaires à Dakar, une réception soit organisée pour donner l'occasion à<br />
l'intéressé de s'adresser aux militants.<br />
Le parti se structure, en réalité, en une série de côteries autour du chef.<br />
Rarement une forme de relations démocratiques entre instances et structures est<br />
respectée. En fait, il s'agit ni plus ni moins de groupes de pression qui s'organisent à<br />
l'intérieur même du parti et qui ne rendent pas son fonctionnement facile. Ainsi, les<br />
griots du parti s'organisent à part, tout comme les Laobés ou les Lébous, ou les Saint<br />
louisiens. Chaque groupe tient à mettre en avant ses propres intérêts. Les lébous mènent<br />
campagne en faveur d'un des leurs pour sa désignation au poste de 2eme candidat pour<br />
l'élection des deux députés du Sénégal. Il s'agit de Ousmane Socé Diop. C'est le sens de<br />
cette lettre en date du 27 avril 1951 adressée au secrétaire général fédéral de la SFIO<br />
AOFjTogo et signée de Gningue Madiène. Cette lettre fait référence à une réunion<br />
tenue le 22 avril 1951 par la jeunesse léboue et les chefs de quartiers, au pinth ( place<br />
publique) de Santhiaba, lieu habituel des délibérations de la collectivité léboue, à la rue<br />
17 angle 22 dans la Médina. L'extrait du procès-verbal de cette réunion est annexé à<br />
cette lettre qui revêt réellement, un caractére de chantage puisqu'elle s'exprime ainsi<br />
«Toute la population léboue de Dakar à Cayar, Diender jusqu'à Yenne est favorable à la<br />
candidature de Ousmane Socé Diop. Toutefois, à défaut de cette investiture, nous vous<br />
faisons savoir dores et dèjà que nous employerons tous les moyens nécessaires pour qu'il soit<br />
élu »19. Au destinataire il est demandé de diffuser la teneur de cette missive au sein du<br />
congrès du parti. L'extrait de P.V accompagnant cette lettre fait état de l'adoption, par<br />
acclamation et à l'unanimité de ce premier voeu ainsi exprimé: « Tous les orateurs (...)<br />
émettent le voeu tendànt à ce que Ousmane Socé Diop soit désigné candidat aux élections<br />
législatives prochaines. L'Assemblée est favorable à cette candidature : "au cas où le<br />
congrès qui se tiendrait à Thiès n'apporterait pas l'investiture absolue à Diop Ousmane<br />
Socé, les lébous dans toutes les régions précitées maintiendront leur candidat et apporteront<br />
tout l'appui nécessaire afin qu'il soit élu" ».<br />
18. Télégrammes de Amadou Babacar à Lamine Guéye à Paris aux dates des 24 Avril 1951 et 2 mai 1951 ainsi que<br />
lettres du même aux sections, Archives municipales de Dakar, dossier H/33 (1), série 2G.<br />
19. Dossier SFIO, archives municipales de Dakar, série 2G, dos H/34.<br />
58
-----------------<br />
l<br />
Cette pression des lébous eut son impact sur le congrès réuni les 24 et 25 mai<br />
1951 puisque Ousmane Socé Diop et Lamine Guéye sont désignés, aux termes des<br />
travaux, comme candidats du parti aux législ'atives pour les deux sièges qui reviennent au<br />
Sénégal. Cela montre le poids de ces groupes de pression organisés dans le parti comme<br />
véritables structures de fonctionnement.<br />
f) Le programme de la SFIO<br />
Il est, dans ses grandes lignes, celui du parti métropolitain. Cependant, des<br />
données spécifiques locales pèsent aussi sur les responsables et les structures.<br />
Le rapport moral soumis au XIIIeme congrès indique au sujet du programme<br />
« La fédération du Sénégal-Mauritanie a été, ici comme ailleurs, à la base des lois qui ont<br />
libéré ce pays du joug colonialiste et de l'exploitation capitaliste... Notre parti a<br />
complètement changé la physionomie économique et mis à la disposition du producteur<br />
sénégalais les moyens de sa propre libération et de son juste enrichissement ». En parlant de<br />
l'action de ses élus, le rapport ajoutait « La santé et l'instruction pénétrent plus<br />
profondément la brousse et la savane... La maladie et l'ignorance reculent ».<br />
Mais ici une question doit être posée. Comment peut-on se libérer du joug<br />
colonialiste et rester un pays colonisé? comment peut-on être libéré de l'exploitation<br />
capitaliste dans un pays où les structures capitalistes fondent la domination coloniale.<br />
De même, la santé et l'instruction se développent à Dakar de façon certaine mais dans<br />
la réalité, à un degré très faible comparativement aux besoins optimums.<br />
Cependant, le rôle joué par les élus socialistes sénégalais au Palais Bourbon,<br />
au Sénat et à l'Assemblée de l'Union Française reste important dans la mesure où deux<br />
lois adoptées par le Parlement portent le nom de Lamine Guèye leader de la SFIO<br />
Sénégal. Il s'agit de la loi sur la citoyenneté et de celle qui est relative au travail dans les<br />
TOM. La loi sur la citoyenneté, votée en 1946 par l'Assemblée Constituante, donnait<br />
aux habitants des TOM, les mêmes droits et devoirs qu'aux métropolitains. Cependant,<br />
la loi n'entra effectivement en application que dix ans plus tard, en 1956, lors des<br />
élections qui virent les habitants des TOM voter au suffrage universel pour la première<br />
fois, dans un collège unique. La seconde loi qui porte le nom de Lamine Guéye<br />
proclame" A travail égal salaire égal" dans les TOM. Adoptée en 1950, cette loi aussi<br />
doit, elle aussi, attendre très longtemps son application effective. La bataille des<br />
travailleurs salariés à Dakar pour obtenir le vote et l'application d'un code du travail,<br />
témoigne bien de l'inexistence d'effets pratiques immédiats. Cette oeuvre législative<br />
engagée par la SFIO locale était largement combattue par ses adversaires locaux comme<br />
le BDS et les milieux lébous qui y voyaient pour Lamine Guéye le moyen de conserver<br />
le contrôle de la Municipalité de Dakar. Le grand capital local et même le petit colonat<br />
furent hostiles à cette loi. Le petit colonat y voyait une certaine forme d'humiliation à<br />
59
dirigeantes du parti. Souvent mis en minorité au bureau fédéral et même devant<br />
l'instance suprême locale qu'est le congrès, Senghor prépara longuement sa revanche.<br />
Au congrès du parti qui se tient à Kaolack chef lieu de la troisième circonscription<br />
électorale, en septembre 1947, il monte au créneau, et dénonce tous azimut la situation<br />
morale dans le parti, son mode de fonctionnement, l'absence de ligne, l'action<br />
incohérente etc... Dans cette circonscription électorale, il compte des amis solides et<br />
puissants comme Ibrahima Seydou Ndao. Mais le congrès auquel il s'adresse lui assène<br />
un rude coup car il est assez nettement mis en minorité et on lui concéde tout juste, la<br />
création d'un journal.<br />
Lorsque la direction du parti décide de présenter la candidature de Djim<br />
Momar Guéye, notable kaolakois et adversaire de Ibrahima Seydou Ndao, pour les<br />
élections à l'Assemblée de l'Union française, Senghor juge que la coupe déborde<br />
largement. Pour lui, Djirn Momar Guéye exclu du parti pour activités jugées<br />
fractionnistes en 1946, ne peut être le candidat de la SFIO malgré sa réintégration à<br />
laquelle, du reste, Senghor ne peut croire. Dès lors, c'est la rébellion ouverte. Il<br />
démissionne avec fracas en adressant une lettre ouverte à Guy Mollet, chef du parti en<br />
métropole, et en tenant une conférence de presse.<br />
Cependant ces raisons politiques ouvertement exprimées ne semblent pas, à<br />
elles seules, motiver l'acte de démission. En effet, Robert Bourgi dit « C'est l'entourage<br />
familial et politique qui a poussé Senghor à se séparer de Lamine Guéye »26. Il fait état de<br />
bruits ayant circulé à Dakar au début du mois de septembre 1948. Ces rumeurs<br />
laissaient entendre que Senghor allait rejoindre le RPF (Rassemblement du Peuple<br />
Français) fondé par de Gaulle. Bourgi note qu'un tel ralliement était même confirmé<br />
par Abdoul Aziz Wane, le propre représentant de Senghor au Sénégal. Pour la direction<br />
locale du R.P.F il s'agirait là d'une opération extraordinaire, étant donnée la<br />
personnalité de celui qui rejoindrait alors la formation gaulliste. Madame Senghor, née<br />
Geneviéve Eboué, fille du gaulliste de la première heure, Félix Eboué l'ancien<br />
gouverneur général de l'AEF, ne manquant pas d'être un atout déterminant dans cette<br />
perspective de ralliement de Senghor au RPF.<br />
Cependant, en démissionnant de la SFIO, Senghor n'adhère pas au RPF. Il<br />
fonde son propre parti, le BDS : Bloc Démocratique Sénégalais qui est un parti sans<br />
aucune attache avec un quelconque parti politique métropolitain; c'est une nouveauté<br />
dans la période de l'après guerre. En cela, Senghor dispose d'une arme psychologique<br />
importante. Lui qui a si vertement reproché à la SFIO de ne concevoir les problèmes<br />
des populations de l'outre-mer que sous l'angle des intérêts électoraux et politiques<br />
métropolitains a ainsi l'occasion de réaliser et mettre en pratique son indépendance de<br />
pensée et d'organisation en se basant sur les caractéristiques propres de son milieu.<br />
26. Robert Bourgi, Le Général de Gaulle et l'Afrique noire 1940-1969, 1980.<br />
63
RPF qui votent dans leur totalité - huit voix - la validation du mandat de Senghor.29. Ce<br />
soutien gaulliste fut déterminant car la validation ne fut obtenue qu'à deux voix de<br />
majorité car il obtient au total quinze voix contre treize qui demandaient l'annulation de<br />
son mandat. Les communistes s'étaient abstenus. Cette victoire de Senghor consacre<br />
l'importance de ses appuis dans la droite française regroupée dans le RPF. Si, au niveau<br />
du Sénégal et de Dakar particulièrement, il ménage à fond son alliance avec le RPF,<br />
c'est bien en reconnaissance de cet acte de grande portée politique de la part du RPF<br />
qui a bloqué ses voix en sa faveur.<br />
C'est dire que l'alliance passée avec le parti gaulliste comporte des intérêts<br />
politiques évidents. Dans cette perspective, il est certain que Senghor sait bien fixer ses<br />
objectifs et s'y consacrer entièrement. Tout appui utile dans ce sens est bon; il doit donc<br />
être recherché; mieux il doit être cultivé.<br />
Cette alliance porte un rude coup à la SFIO chaque fois que les masses<br />
rurales doivent intervenir dans le débat car, au total, RPF et BDS disposent, à ce niveau,<br />
de leviers importants.<br />
b) Organisation et fonctionnement.<br />
La rupture de la SFIO consommée par la démission de Senghor, la première<br />
tâche qui s'impose au dissident est de créer et d'organiser son parti.<br />
Dès le lendemain de sa démission, Senghor et tous ceux qui l'ont suivi dans la<br />
rupture s'y attèlent. Ibrahima Seydou Ndao dit à Mamadou Dia: « Maintenant, tu vas<br />
passer la commande des cartes et dans une semaine, tu reviendras les retirer et aller créer des<br />
sections »30. Ces deux hommes vont jouer un rôle important dans le parti, tout comme<br />
Boissier Palum et Ibrahima Sarr.<br />
* Ibrahima Seydou Ndao:<br />
Il est l'ancien maître incontesté de la SFIO dans l'importante région du Sine<br />
Saloum, poumon même de la production arachidière du Sénégal. Ses démêlées avec<br />
Djim Momar Guéye, riche commerçant kaolakois comme lui, avaient largement émaillé<br />
la politique locale de la SFIO et avaient eu de profondes répercussions sur la vie<br />
territoriale du parti. Directement, elles sont à l'origine de la démission de Senghor du<br />
parti SFIO. Au moment où la rupture devient effective, Ibrahima Seydou Ndao est<br />
handicapé physiquement, presque entièrement paralysé, à la suite d'un accident de<br />
circulation. Mais il n'en reste pas moins actif dans les activités d'organisation du parti,<br />
surtout dans la région très peuplée et très active du Sine Saloum. Dès le départ, il met à<br />
contribution sa richesse et sa notoriété, donnant ainsi à la nouvelle formation une de ses<br />
assises les plus solides au niveau local autant dans l'immédiat qu'à long terme. Cette<br />
29. Robert Bourgi, op.cit.<br />
30. Mamadou Dia, op.cit., P.51.<br />
65
emarque Mamadou Dia qui rend un hommage appuyé, anonymement « aux cheminots<br />
qui faisaient, eux-mêmes le travail »34.<br />
Quant à l'organisation même du parti, nous en avons une idée à la lecture du<br />
rapport moral présenté devant son premier congrès tenu à Thiès en avril 1949. Le<br />
rapporteur, en l'occurrence le directeur politique du parti, Senghor, écrit: «Le BDS est<br />
une fonnation de toutes les forces politiques et sociales, traditionnelles et modernes<br />
sénégalaises, groupements ethniques et régionaux, réligieux et culturels, économiques et<br />
sociaux »35.<br />
C'est dire que, dans cette phase première de son organisation, le BDS adopte<br />
le même schéma que la SFIO. On y retrouve pêle-mêle:<br />
- la Grande Collectivité Saint-Louisienne,<br />
-la Jeunesse Léboue,<br />
- le Comité Sérére,<br />
- le Comité des Bijoutiers,<br />
- le Comité des Femmes de Grand Dakar,<br />
-le Comité des Casamançais,<br />
- la Section des Laobés,<br />
- le Comité directeur des ressortissants de la presqu'île,<br />
- le Comité des griots BOS ...36.<br />
A travers cette liste relative à la vie interne du BDS au seul niveau de la ville<br />
de Dakar, on a une idée de la multitude et de l'importance des sous-groupes de pression<br />
qui s'activent dans la nouvelle formation politique avec des dominantes régionales<br />
(exemple des Ressortissants de la presqu'île du Cap Vert, des Saint-Iouisiens et des<br />
Casamançais), ethniques (le comité des Séréres, la Jeunesse léboue), professionnelles<br />
(cas des Laobés, des bijoutiers et des griots), de zone d'habitation (femmes de Grand<br />
Dakar) etc...<br />
C'est en somme, une organisation complexe pour un parti politique. Si dans<br />
l'immédiat, ce mode d'organisation est fièrement présenté par le rapport moral comme<br />
une donnée intrinsèque de démocratie, très vite, il apparaît comme un fardeau et<br />
!1surtout comme une véritable entrave au fonctionnement normal du BOS. Ceci est<br />
1<br />
\ d'autant plus vrai que, dans la ville de Dakar, les Lébous militants de la nouvelle<br />
formation s'entre-déchirent souvent férocement et à propos de chaque candidature<br />
territoriale ou locale. S'y ajoutent la rivalité entre Ubous et non natifs de Dakar ainsi<br />
que des rivalités de clans, d'ethnies ou de régions etc... ce qui complique l'organisation<br />
interne du parti. Dans les faits, à Dakar, ce mode d'organisation du parti ne fait pas<br />
progresser la formation politique dans l'électorat, même si son congrès le considère<br />
34. Idem, P.55.<br />
35. "Condition Humaine" du 26 avril 1949.<br />
36. "Condition Humaine" du 27 mars 1949.<br />
67
comme étant démocratique: aux élections municipales de 1953, les deux députés, élus<br />
du territoire deux ans plutÔt, sont largement battus avec la liste qu'ils conduisent. Le<br />
rapport politique du territoire n'écarte pas ses modes d'organisation et de<br />
fonctionnement. Dans sa synthèse du deuxième trimestre, juste après les municipales, il<br />
note: « Le BDS fut mis en echec à Dakar. Faut-il voir dans ce recul le résultat des<br />
difficultés que l'attitude du député Abass Guéye a suscitées lors de l'élaboration de la<br />
liste»37.<br />
Des difficultés résultent du mode même d'organisation et de fonctionnement<br />
du parti. Le directeur politique du BDS a bien conscience de cette situation<br />
préjudiciable à sa formation politique. Le rapport politique de la Délégation constate:<br />
«Senghor manifeste une activité parlementaire intense complétée à Dakar par d'incessantes<br />
interventions en vue d'apaiser les conflits de personnes...dans les fractions BDS léboues»38.<br />
Parmi les entraves du BDS à Dakar, le rapport signale également les conflits entre les<br />
Lébous et les Ressortissants, ce dont le directeur politique du BDS est inquiet. Profitant<br />
d'une réception offerte à Léon Boissier Palun, nouvellement élu président du Grand<br />
Conseil de l'AOF et l'une des têtes d'affiche du BDS à Dakar, il s'exprime en ces<br />
termes: « Plus de fonnations ethniques, réligieuses ou territoriales... maintenant, une seule<br />
bannière, celle du BDS »39.<br />
C'est une condamnation sans équivoque du mode d'organisation et de<br />
fonctionnement du BDS que prononce Senghor; il espère ainsi libèrer son parti de<br />
lourdes entraves. Réussit-il dans la voie ainsi tracée?<br />
A Dakar, en tout cas, ce fut un echec puisque la situation perdure et que le<br />
parti ne put remonter de manière significative, son handicap sur la SFIO.<br />
En tout cas dans l'immédiat, la formation politique de Senghor connaît<br />
d'énormes difficultés que nous percevons à travers ce constat fait par la direction des<br />
affaires politiques à propos du congrès du BDS de 1953 : « Congrès laborieusement<br />
préparé et qui eut toutes les peines du monde à se tenir... Il débute avec 300 délégués sur les<br />
600 attendus...D'ailleurs, vers la fin du congrès le nombre de délégués allait en<br />
diminuant»40.<br />
c) Représentativité à Dakar.<br />
Certes, le BDS compte à Dakar des personnalités très importantes parmi ses<br />
militants, tant dans les milieux européens de la ville que dans les milieux lébous et<br />
autres africains. Cependant, une appréciation significative est fournie par les résultats<br />
électoraux du parti à Dakar.<br />
37. Affaires politiques AOF, ANS de Dakar, 2G 53-183, Délégation de Dakar.<br />
38. Synthèse du 1 er trimestre, rapport 2G 53-183, Délégation de Dakar.<br />
39. Rapport délégation de Dakar 2G 53-183,1953, dèjà cité.<br />
40. Affaires politiques ANSOM, carton 2230, dos 4.<br />
68
- En juin 1951, il y'eut des élections législatives au cours desquelles le BDS<br />
sortit vainqueur sur l'ensemble du territoire du Sénégal mais fut mis en minorité à<br />
Dakar. Les résultats sont les suivants: au niveau territorial, le BDS obtient 213.407 voix<br />
contre 96.469 à la SFIO.<br />
Au niveau de Dakar:<br />
- mars 1952, lors des cantonales pour le renouvellement de l'assemblée<br />
territoriale, sur les 30.934 suffrages exprimés, le BDS comptabilise 11.112 voix. La SFIO<br />
remporte tous les sièges de la circonscription électorale de Dakar.<br />
- avril 1953, aux élections municipales, sur 31.714 suffrages exprimés, la liste<br />
conduite par Senghor et Abbas Guéye tous deux députés, ne recueille que 10.599 voix.<br />
La SFIO remporte alors ces élections.<br />
- novembre 1956, de nouvelles élections municipales sont organisées à la<br />
suite de l'annulation par le Conseil d'Etat des élections de 1953. Sur les 41.963 suffrages<br />
exprimés, le BPS ( nouveau nom du BDS) obtient 17.734 voix; ce qui lui donne 16 sièges<br />
au conseil municipal contre 21 à la liste de Lamine Guéye qui obtient 24.226 voix. Cette<br />
élection a eu la particularité d'être organisée avec un mode de scrutin proportionnel<br />
contrairement aux précédentes.<br />
Au regard des résultats obtenus dans ces diverses consultations, il apparaît<br />
clairement que, malgré une progression non négligeable, le BDS est toujours resté<br />
minoritaire à Dakar, pendant toute la période comprise entre sa création et la fin de<br />
notre étude.<br />
Quant au nombre de militants, pour Dakar, nos sources sont très peu<br />
expressives. C'est le sociologue Paul Mercier qui souligne, en parlant des principaux<br />
centres urbains du Sénégal, que l'ampleur du phénomène d'adhésion aux partis<br />
politiques est faible. A propos de Dakar, lors d'une enquête sur un échantillon de 1200<br />
personnes, plus de la moitié (56 %) d'entre elles ont déclaré être membre d'un parti<br />
politique. Mais P. Mercier met en garde contre toute déduction à valeur de certitude<br />
dans la mesure où les personnes interrogées sont stabilisées car elles sont installées à<br />
Dakar depuis de nombreuses années 41 . D'après cet observateur, d'autres enquêtes ont<br />
prouvé que la participation à la vie politique est faible lorsque la population concernée<br />
est temporaire ou saisonnière. Ainsi, à peine 10 % de la population des villes<br />
sénégalaises militent dans les partis politiques. Ibrahima Marône 42 donne les chiffres<br />
suivants: en juin 1949, le BDS compte, pour tout le Sénégal, 27.000 adhérents contre<br />
26.000 à la SFIO et 900 au RDA.<br />
41. Paul Mercier, La vie politique dans les centres urbains du Sénégal, décembre 1959, p.69.<br />
42. Bulletin de l'IFAN, janvier 1970.<br />
69
d) Les changements de nom.<br />
Dans l'histoire du BDS, par suite de diverses fusions avec d'autres<br />
formations, nous le retrouvons avec des noms différents :<br />
- le 26 août 1956 : dissolution du BDS par son congrès et fusion avec une<br />
fraction unitaire de la SFIO et une autre de l'UDS. Cette fusion a lieu à Dakar, dans la<br />
salle de cinéma Le Colisée. La nouvelle formation s'appelle le B.P.S (Bloc Populaire<br />
Sénégalais). Senghor est élu directeur politique de ce parti tandis que Mamadou Dia<br />
conserve le secrétariat général. Ainsi, les deux hommes occupent des postes<br />
primordiaux. L'organe central du B.P.S s'appelle "l'Unité" et remplace "Condition<br />
Humaine" qui disparait.<br />
- Les 26 et 27 mars 1958, une nouvelle fusion rapproche le B.P.S créé par<br />
Senghor deux ans auparavant, du P.S.A ( Parti de la Solidarité Africaine ), mutation de<br />
la SFIO. Une nouvelle formation naît sous le nom d'U.P.S (Union Progressiste<br />
Sénégalaise). Lamine Guéye devint directeur politique et Senghor secrétaire général.<br />
Un nouvel organe est créé sous le nom de "l'Unité africaine".<br />
e) Les relations entre le BDS et l'administration.<br />
De 1948 à 1952, la formation politique de Senghor se hisse à tous les niveaux<br />
de représentativité du territoire : Assemblée territoriale, Grand Conseil de l'AOF,<br />
Assemblée nationale etc... L'explication de cette rapide ascension n'est pas la même<br />
selon les sources. Selon certaines, elle serait due à une adhésion massive de l'électorat<br />
aux idéaux défendus par la nouvelle formation politique.<br />
A l'opposé, nombreuses sont celles qui y voient une action plus ou moins<br />
discrète de l'administration coloniale et des milieux du colonat, local et métropolitain.<br />
Les affirmations sont nombreuses et variées pour les défenseurs de cette<br />
dernière thèse. Ainsi, le journal dakarois "Echos d'Afrique noire", sous la plume de son<br />
rédacteur en chef Maurice Voisin, présente Bernard Cornut Gentille, le gouverneur<br />
général de l'AOF, comme un mannequin entre les mains de Boissier Palum, président<br />
du Grand Conseil de l'AOF et figure de proue du BDS. Le journaliste écrit que :<br />
«Chaque fois que le EDS fait un chantage, il gagne parceque l'administration lui est<br />
servilement attachée »43. Pour lui, le BDS est tabou depuis que Bernard Cornut Gentille<br />
est au pouvoir en AOF. L'hebdomadaire donne à titre de preuve, le massacre de<br />
militants SFIO lors de l'embuscade tendue par les partisans BDS des environs de<br />
Bignona, en Casamance, à la fin de janvier 1955. Le journal affirme que l'administration<br />
était bel et bien au courant de ce qui se préparait contre Lamine Guéye dans cette<br />
43. Numéro du 27 janvier 1955.<br />
70
tournée, mais n'a rien fait pour éviter le drame, se contentant d'en faire le constat. Cela<br />
fait dire au journal que « Senghor est le leader du parti des assassins »44. Pourtant, le<br />
même organe de presse avait d'abord largement exprimé dans des livraisons diverses de<br />
1953, l'appui qu'il apportait à Senghor et à sa formation contre Lamine Guéye et la<br />
SFIO. L'organe du petit colonat dakarois étalait au grand jour ses apports d'argent aux<br />
caisses de la formation BDS, tout comme ses appuis matériels par tracts, circulaires et<br />
numéros spéciaux et ses démarches pressantes dans les travées du Palais Bourbon, à<br />
Paris, pour faire valider l'élection de Senghor contre Lamine Guèye 45 .<br />
Un autre organe de presse dakarois "Reveil" affirme que l'administration<br />
coloniale, par d'importants prêts financiers consentis aux principaux responsables du<br />
BDS, s'en fait ainsi ses hommes-liges.<br />
Cette situation est également décrite et expliquée comme telle par d'autres<br />
journaux comme "Echos d'Afrique Noire". Un autre journal dakarois titrait largement<br />
que « L'administration ne refuse rien au BDS et pour cause ».<br />
Un autre élément noté comme preuve de la collusion entre le BDS et<br />
l'administration coloniale est le fait que celle-ci ait propulsé maints responsables<br />
régionaux et locaux du parti comme inspecteurs du conditionnement. A ces postes, ceux<br />
ci disposent de moyens de pression énormes leur permettant de s'enrichir aux dépends<br />
des paysans. Ces structures d'encadrement du monde rural perdurèrent malgré les<br />
détournements multiples de leurs moyens financiers et matériels par les cadres du BDS<br />
et les dénonciations par les journaux. L'organe de la section sénégalaise du P.AI traita<br />
le parti de Senghor de « collaborateur des colonialistes », de parti ayant « Jardiné les<br />
intérêts de l'impérialisme »46. Le journal "l'AOF" écrit: « Ces pressions et ces violences<br />
aujourd'hui éxercées en leur faveur (les dirigeants du BDS) se retourneront tôt ou tard contre<br />
eux »47.<br />
L'organe central de la SFIO apporte un exemple concret de cette "assistance"<br />
tout azimut au parti senghorien. Il se demande comment comprendre autrement,<br />
qu'après les élections municipales du 18 novembre 1956, dans les grands centres urbains<br />
du Sénégal, le BDS qui a totalisé 31.495 voix ait pu avoir 111 sièges dans ces conseils<br />
alors que la SFIO, avec ses 30.686 suffrages, soit presque autant de voix que le BDS, ne<br />
soit crédité que de 59 sièges. Le journal tire une conclusion qui lui semble la seule<br />
explication plausible: c'est que l'administration est toute entière au service du BPS de<br />
Senghor parceque le BPS est tout entier au service de l'administration. Il y'a donc là un<br />
échange courtois de bons services et de bons procédés.<br />
44. Numéro du 4 au 9 février 1955.<br />
45. Numéro du 4 mai 1953.<br />
46."Momsarew", nO 2 et 4.<br />
47. "L'AOF' du 15 décembre 1956, P.l.<br />
71
L'organe du M.P.S, "l'Action", n'est pas en reste dans le constat puisqu'il<br />
présente le parti de Senghor comme étant une formation d'obédience administrative, le<br />
genre même de ce que la rue Oudinot recherche fébrilement 48 .<br />
Un autre point souvent présenté par les organes dakarois du RDA comme<br />
manifestation évidente d'une collaboration notoire entre l'administration coloniale et<br />
Senghor, est le fait qu'en 1953, les I.O.M (Indépendants d'Outre-Mer), groupe politique<br />
monté par Senghor au palais Bourbon pour regrouper tous les élus d'AOF et d'AEF non<br />
RDA, ait eu l'autorisation et le soutien effectif de l'administration pour tenir leur<br />
congrès à Bobo Dioulasso en Haute Volta alors que cette même ville a été<br />
effectivement refusée au parti d'Houphouët Boigny quelques années plus tôt pour son<br />
congrès de 1948. Le refus s'était manifesté par l'imposition de conditions absurdes. En<br />
effet, l'administrateur maire de la ville ne donnait son accord à la tenue du congrès du<br />
RDA qu'à la condition expresse que le parti construise lui-même tous les locaux<br />
nécessaires à cette manifestation et que, dès la fin du congrès, ces mêmes locaux soient<br />
détruits.<br />
En somme, de nombreux faits sont présentés par des organes de la presse<br />
dakaroise comme la preuve d'une collaboration notoire entre le parti de Senghor et les<br />
autorités coloniales.<br />
Est-ce simplement parceque ces journaux représentent des lignes politiques<br />
opposées à celle défendue par le BDS ? En partie peut-être. Cependant, certaines<br />
preuves paraissent si probantes qu'on est bien tenté d'y croire entièrement. Il reste alors<br />
à comprendre les raisons profondes de cette situation. Le journal du P.AI,<br />
"Momsarew,,49 l'explique par la position dominante des Européens dans le BDS et cite<br />
les personnes de Robert Delmas, Georges Larché, Léon Boissier Palun etc... comme les<br />
milliardaires qui «nous gouvernent ».<br />
Senghor, lui-même, dans une de ces autocritiques qui lui sont familières, au<br />
sujet de son absence au congrès constitutif du RDA à Bamako en 1946 alors qu'il avait<br />
signé le manifeste du parti et même fait une partie du voyage, dit «Mon tort a été d'obéir<br />
à des ordres qui m'étaient imposés de l'extérieur ». Il faisait ce méa-culpa dans son rapport<br />
d'orientation au congrès constitutif du parti de la Convention Africaine, en janvier 1957<br />
à Dakar. Bien sûr qu'il est possible d'épiloguer sur la source des ordres que Senghor a<br />
reçus et exécutés. Il semble bien qu'ils émanent de l'administration. La SFIO à laquelle<br />
Senghor appartient à l'époque, s'était opposée à ce congrès africain et ses hommes<br />
occupaient la FOM et le palais de Dakar. Dès sa descente d'avion à Dakar, en route<br />
théoriquement pour Bamako, Senghor était reçu par le Haut commissaire de l'AOF.<br />
Que se sont-ils dit? Rien n'en a filtré. Mais Senghor transforme sa venue à Dakar en<br />
mission de compte rendu de ses activités parlementaires à Paris. Il ne foula pas le sol de<br />
48. "L'Action", nO de décembre 1957.<br />
49. NO 8 de 1958.<br />
72
Pour l'administration, il est utile de chercher, dans le cadre même des statuts<br />
de l'organisation, à en influencer l'orientation. C'est ainsi que comme condition de<br />
--:;:::>-=-reconnaissance,<br />
les autorités ont rajouté un certain nombre d'éléments dans les objectifs<br />
de l'organisation, par exemple: « Le développement de la langue française doit rester la<br />
première préoccupation »53. De même qu'au sigle proposé: Comité d'études africaines<br />
(CEA), il fallait ajouter le terme franco donnant ainsi le sigle définitif Comités d'études<br />
franco-africaines. Ces rajouts sont acceptés par les promoteurs du projet comme geste<br />
de compromis dans la mesure où l'essentiel est maintenu: la devise "Africa mater" tout<br />
comme le droit de cité en AOF pour toutes les élites sans distinction d'origine. Le texte<br />
dénonce l'accaparement des terres des collectivités et des individus, prend position en<br />
faveur de la libre constitution de syndicats et de coopératives.<br />
Le premier président du mouvement, à Dakar, est Armand Pierre Angrand,<br />
goréen d'origine et ancien rédacteur du journal le "Périscope africain". Le secrétaire<br />
général est Joseph Corréa, boutiquier à Dakar et originaire de la Casamance, d'une<br />
famille cap verdienne. Il avait eu longuement maille à partir avec l'administration<br />
coloniale. Il avait été révoqué de l'école normale William Ponty de Sébikotane et<br />
interdit de tout emploi dans la fonction publique, et subi des pressions de toute sorte<br />
pour qu'il ne trouve pas d'emploi dans le secteur privé.<br />
Le CEFA compte aussi parmi ses membres les plus actifs, Guillaume<br />
Couteau, ingénieur métis et père adoptif de Houphouët Boigny, Abdoulaye Sadji<br />
instituteur et grand romancier sénégalais, Bassirou Guéye et Latyr Camara, tous deux<br />
instituteurs de même que les frères Ousmane Bâ (futur ministre des affaires étrangères<br />
du Mali) et Alassane Bâ. Lamine Guéye en fut membre mais il démissionna<br />
publiquement du CEFA en fin 1946 54 . Le mouvement comprend également des<br />
Européens comme Camille Souris directeur adjoint de l'enseignement, Georgette et<br />
Jean Suret Canale professeur agrégé au lycée Van vollenhoven de Dakar, Vickie et<br />
Gérard Cauche ainsi que de nombreux instituteurs, médecins, commis... Il est nettement<br />
perçu par l'administration comme une force importante et dangereuse; ceci entraine<br />
diverses mutations qui frappent certains de ses membres, et même des emprisonnements<br />
comme c'est le cas pour certains militants de la section de Ségou au Soudan.<br />
L'administration ne se trompe pas car le rapport politique du Sénégal note: «L'origine<br />
du RDA remonte en fait à la création du CEFA qui s'est constitué à Dakar dès 1944 »55.<br />
Ce que confirme du reste Jean Suret Canale 56 , l'un des principaux animateurs du<br />
mouvement : « Le CEFA apparaît comme le précurseur du RDA auquel il fournira bon<br />
nombre de ses cadres ». Roger de Benoîst, en parlant du CEFA constate que: «A la tête<br />
53. Article 3 F des statuts du CEFA.<br />
54. J.S. Canale, op.cit.<br />
55. Affaires politiques AOF, ANSOM, carton 2263, dos 1 et 2.<br />
56. Op.cit., p. 21.<br />
74
de ses sections locales, on trouve des hommes qui auront presque tous un rôle dans l'action<br />
politique ou syndicale »57.<br />
Les fondateurs de la section sénégalaise du RDA proviennent aussi d'un<br />
autre mouvement appelé le Groupe d'études communistes (GEC). Ce dernier est né à<br />
Dakar à la même période que le CEFA Il est mis en place par des militants<br />
communistes d'origine européenne avec la collaboration de quelques Mricains comme<br />
Latyr Camara. Certains des membres du GEC sont aussi membres du CEFA C'est ainsi<br />
qu'avec la création du RDA, on retrouve largement les mêmes, aux postes responsables<br />
du parti.<br />
L'UDS se développe rapidement au Sénégal, particulièrement à Dakar. Une<br />
première assemblée générale se tient en août 1947 et une autre au début 1948. La<br />
principale manifestation a lieu les 30 et 31 juillet 1948. C'est le congrès territorial du<br />
mouvement que préside Gabriel d'Arboussier l'un des principaux fondateurs du parti.<br />
Ce congrès couronne toute une longue période d'intenses activités minutieusement<br />
notées par le rapport politique de la Délégation 58 . Le congrès constitutif adopte le nom<br />
de UDS-RDA comme étant celui de la section sénégalaise du RDA. Le rapport de<br />
l'administration note à son sujet qu'il est libellé ainsi en réponses aux accusations "anti<br />
sénégalaises" lancées contre le RDA par un certain nombre de détracteurs locaux. La<br />
section reçoit son récepissé de reconnaissance. Le congrès élit comme secrétaire<br />
général, le médecin africain Doudou Guèye, Sénégalais d'origine, mais revenant de Côte<br />
d'Ivoire où il a exercé longuement ses activités professionnelles. Il est très proche de<br />
Houphouët Boigny avec lequel il a travaillé étroitement à l'implantation des premières<br />
cellules du RDA dans ce territoire. Des raisons psychologiques ne sont pas étrangères à<br />
son élection à la tête de la section. En effet, un Sénégalais authentique à la tête de<br />
l'UDS est un élément de crédibilité pour la formation. Cela permet aussi de couper<br />
court à toutes les insinuations et accusations malveillantes à l'endroit du RDA. Depuis<br />
la création du RDA à Bamako, le nom utilisé au niveau sénégalais pour les activités du<br />
parti était RDA. L'adoption du nom de UDS pour cette formation politique est<br />
incontestablement une forme d'affirmation de l'existence d'une personnalité<br />
sénégalaise; c'est une façon de mieux faire saisir qu'il y a plus qu'un simple écho aux<br />
intérêts exclusifs du leader ivoirien. Cette démarche tenait également compte de<br />
l'hostilité des leaders de la SFIO du Sénégal qui considèraient le RDA comme une<br />
formation communiste à cause de son apparentement au PCP. Ceci s'explique<br />
davantage par un contexte sénégalais dans la mesure où à la suite de la rupture entre<br />
Lamine Guéye et son poulain Senghor, l'islam devient une arme importante dans la<br />
bataille politique, chacun des leaders voulant attirer la grâce des forces islamiques<br />
sénégalaises dans son électorat.<br />
57. R. de Benoist, Histoire de l'Afrique Occidentale, 1978, p.27.<br />
58. Affaires politiques AOF, ANSOM, carton 2143, dos 4.<br />
75
\<br />
Dès 1948-1949, le comité de coordination du RDA, c'est à dire son organe<br />
directionnel a pris la décision de fixer, à Dakar même, sa délégation permanente. Celle<br />
ci comprend, entre autres, Doudou Guéye secrétaire général de la section sénégalaise,<br />
Gérard Cauche ainsi que Gabriel d'Arboussier. Le rapport de l'administration note, dès<br />
1949, que l'UDS s'est solidement organisée et implantée au Sénégal. A Dakar, la section<br />
dispose de structures dynamiques. L'année 1950 est marquée par une nette<br />
consolidation de l'UDS au Sénégal comme le rapportent les sources administratives qui<br />
signalent que 16.000 cartes ont été distribuées sur le territoire.<br />
Ibrahima Marône, dans une étude parue en janvier 1970, dans le bulletin de<br />
l'IFAN, donne le chiffre de 900 militants pour la section sénégalaise du RDA en 1949.<br />
Par contre, ce développement rapide de l'implantation de la section est<br />
marquée par un net arrêt dès l'année 1951. L'administration note que « des sections de<br />
l'intérieur vont disparaître les unes après les autres» dans son rapport annuel. pourquoi cet<br />
arrêt brutal? L'explication se trouve dans la confrontation qui a lieu à propos de la ligne<br />
politique du RDA. En effet, la direction, autour de Houphouët Boigny, décide de<br />
désapparenter le RDA du PCF dont le RDA s'était organiquement rapproché pour des<br />
raisons "stratégiques" et parce que ce parti politique métropolitain avait énormément<br />
aidé à sa mise en place. La période qui suit immédiatement cette rupture voit une baisse<br />
réelle du militantisme pour l'ensemble du mouvement. Un rapport spécial de<br />
renseignements sur les partis politiques en AOF, fait le point de l'influence électorale du<br />
mouvement en ces termes : « 4 sièges de députés, 3 sénateurs, 5 sièges de conseillers de<br />
l'Union française et 34 sièges dans les conseils généraux, dont un seul au Sénégal »59. Ces<br />
chiffres indiquant un recul ne peuvent être appréciés qu'au regard de la situation<br />
antérieure sur laquelle en parlant de la situation organisationnelle du parti en 1948,<br />
Gérard Cauché O écrivait: «Le RDA compte un million d'adhérents auxquels s'ajoutent<br />
plusieurs millions de sympathisants ». Pourquoi donc un recul réel de l'influence du<br />
RDA?<br />
Rappelons que, dès 1947, pour des raisons de politique française en rapport<br />
direct avec l'application du Plan Marshall d'aide à la reconstruction de l'après-guerre, le<br />
PCF a été évincé du gouvernement de Paris. Et dès cette période, Paris et ses<br />
représentants dans la fédération de l'AOF, ont multiplié les attaques contre l'allié du<br />
PCF, c'est à dire le RDA. C'est la période de la grande répression contre ce parti<br />
nationaliste au moment même où à Madagascar aussi, la répression frappe durement.<br />
Les exemples de la répression contre l'UDS-RDA ne manquent pas. Gérard Cauche,<br />
élève administrateur ayant servi à Podor d'abord puis affecté ensuite à la Délégation de<br />
Dakar, est révoqué pour s'être présenté sur la liste UDS aux municipales de Dakar de<br />
1947. Le professeur Jean Suret Canale militant PCF dynamique et influent à Dakar dans<br />
59. Affaires politiques AOF, ANSOM, carton 2263, dos 9 : le RDA.<br />
60. Les pionniers de l'indépendance, 1975, p.29.
les milieux politiques et syndicaux est expulsé le dimanche 20 février 1949 de l'AOF sur<br />
décision du gouverneur général, et ceci par avion spécial. La police dakaroise qui vient<br />
le chercher, de nuit, pour le conduire de force à l'aéroport où un équipage militaire est<br />
dèjà aux commandes de l'avion, ne lui laisse ni le temps de prendre quelques affaires ni<br />
celui d'informer ses voisins immédiats 61 . Il est vrai que le secrétaire général de<br />
l'intersyndicale ouvrière de Dakar, vient de conduire une grève massivement suivie dans<br />
la capitale fédérale pour protester contre la baisse vertigineuse du pouvoir d'achat. Une<br />
institutrice européenne, Adrienne Quadreli, qui est le seul élément européen à observer<br />
le mot d'ordre de grève déclenché pour protester contre l'expulsion de J. S. Canale, est<br />
licenciée.<br />
La répression contre les militants de l'UDS-RDA ne vise pas seulement les<br />
Européens. Elle touche aussi de nombreux Africains comme Abdoulaye Guéye, Thierno<br />
Bâ, Septime Doddé, Sembané Sarr et Tchisoundzi condamnés à des peines de prison<br />
ferme de quatre à six mois, pour avoir manifesté, à Dakar devant le consulat d'Espagne,<br />
en faveur de l'Espagne Républicaine. Cette manifestation s'est pourtant déroulée<br />
calmement. Mais l'administration coloniale ne l'entend pas ainsi; d'où ces<br />
condamnations, après un procès expéditif contre les militants de la section sénégalaise<br />
du RDA. A cette même occasion, une Européenne, Gerard Cauche est arrêtée et<br />
condamnée elle aussi au même motif que les Africains. Cependant, à son sujet,<br />
l'administration coloniale fait encore preuve de discernement puisque l'Européenne et<br />
les Africains ne purgeront pas ensemble leur peine. En effet, Gérard Cauche est<br />
expédiée, à la prison de Fresnes, puis à celle de la Santé à Paris tandis que les Africains<br />
purgent leurs peines dans la prison de Dakar.<br />
Quant à Septime Doddé, éléve à l'Ecole de Médecine de Dakar au moment<br />
de sa condamnation, il est révoqué de son école où il fait sa dernière année de<br />
formation. Une grève générale a aussitôt lieu au sein de l'établissement pour protester<br />
contre l'exclusion de Septime Doddé d'autant que c'est le corps professoral de l'Ecole<br />
de Médecine même qui se prononce pour son renvoi. Cette décision des enseignants ne<br />
fut pas unanime car, le colonel Cler, professeur agrégé de médecine, comme il en est<br />
rare d'en trouver à Dakar à l'époque, ne se prononça point en faveur de l'expulsion. Il<br />
avait publiquement estimé que le corps professoral ne devait pas être soumis à prendre<br />
des mesures dictées par l'administration. Il fut alors rayé des cadres 62 .<br />
Bien sûr, les actions de l'administration coloniale ne se résument pas<br />
seulement à ces révocations et emprisonnements, radiations et licenciements. La gamme<br />
est beaucoup plus ouverte contre l'UDS. C'est ainsi que Mody Diagne, secrétaire<br />
général de l'Union des syndicats de Dakar et secrétaire du syndicat unique de<br />
l'enseignement est muté d'office de Dakar à Koungheul dans la région du Sine Saloum,<br />
61. Entretien avec J. S. Canale en décembre 1986 à Paris.<br />
62. J. S. Canale: les groupes d'études communistes en Afrique noire 1943-1950, document non publié, 34 pages.<br />
77
un véritable exil intérieur car de longues années durant, il est interdit de toute mutation.<br />
Quant à Joseph Mbaye que le congrès constitutif de l'UDS avait porté à son secrétariat<br />
à la propagande est muté d'office de Dakar à Cascas dans le Fouta Torro, en exil interne<br />
également pour de longues années. Thierno Bâ, rédacteur en chef de l'organe de la<br />
section territoriale du RDA, n'échappe pas à la répression. C'est son organe "Réveil"<br />
qui écrit: « L'administration frappe Réveil en déplaçant son rédacteur en chef Thiemo<br />
Bâ»63. Cette mutation arbitraire donne lieu, à Dakar, à une vive inquiétude dans l'un<br />
des villages de la banlieue : Yoff où Thierno Bâ tient une classe d'examen. La<br />
population envoie au chef de la délégation une motion de protestation après une<br />
assemblée générale tenue le 21 février 1954, mais aussi au maire de Dakar. Une<br />
imposante délégation est même constituée pour porter cette plainte des populations qui<br />
exigent l'annulation pure et simple de cette mesure publiée dans le J.O du Sénégal.<br />
Cette motion est signée par deux chefs de village, deux maires indigènes et sept chefs de<br />
quartier. Il est même décidé, à titre de disposition immédiate, de retirer tous les enfants<br />
de l'école en attendant de voir la suite des démarches engagées.<br />
Une autre réaction relative à cette mutation, est la grève déclenchée par le<br />
personnel enseignant africain de la Délégation. Mais la grève n'avait été déclenchée<br />
qu'après maintes démarches infructueuses pour rencontrer les autorités compétentes, en<br />
particulier le Haut Commissaire. Le syndicat lui même tire la conclusion de cette grève<br />
en en reconnaissant l'echec 64 .<br />
Autre mesure contre le RDA local, son secrétaire général Doudou Guéye est<br />
condamné le 8 mars 1950 à trois mois de prison ferme et 50.000 Fr d'amende. Dès sa<br />
sortie de prison, il est à nouveau condamné, le 23 août 1950, à deux ans de prison et<br />
300.000 Fr CFA d'amende pour avoir signé deux articles publiés par "Réveil", porte-voix<br />
du RDA. Il Ydénonçait les menées provocatrices de l'administration coloniale contre le<br />
RDA en Haute Volta ( pour la 1ère condamnation) et en Côte d'Ivoire ( pour la<br />
2éme)65.<br />
Ajoutons aussi que pour l'administration frapper d'autres organisations<br />
dakaroises comme les Partisans de la Paix, le Conseil de la Jeunesse du Sénégal, la<br />
RJ.DA etc, c'est aussi frapper l'UDS en raison du fait que les cadres de ces<br />
organisations sont aussi, dans une large mesure, militants du RDA. C'est pourquoi, le<br />
1er février 1950, la police dakaroise se mobilise fortement contre le projet des Partisans<br />
de la Paix dakarois lesquels entendent commémorer la fusillade de Thiaroye au cours de<br />
laquelle plusieurs tirailleurs africains ont été fauchés, nuitamment, par les balles des<br />
autorités militaires, alors qu'ils demandaient à rentrer dans leurs droits. Il en est de<br />
63." Réveil" du 27 février 1954.<br />
64. "SYNEP-liaison", Octobre 1954.<br />
65. R.de Benoîst : Afrique histoire, nO 9,1983.<br />
78
même lorsque le Conseil de la jeunesse du Sénégal décide, à Dakar, d'observer une<br />
journée de solidarité internationale de la lutte contre le colonialisme 66 .<br />
Bref, si l'UDS-RDA connait des difficultés dans son implantation à partir des<br />
années 1949-1950, c'est la conséquence de la répression sans cesse accrue de ses<br />
activités par l'administration coloniale. C'est aussi ce que note le rapport moral au<br />
congrès du mouvement, en 1954. Cependant, des facteurs internes interviennent aussi<br />
c'est l'absence d'unité de vue autour de la ligne du parti et les querelles entre les<br />
principaux leaders Gabriel d'Arboussier et Houphouët Boigny, le premier élément<br />
expliquant le second.<br />
Tout ceci est attesté par le rapport d'activités de Gabriel d'Arboussier le<br />
secrétaire à l'organisation du RDA, au comité de coordination du parti, en décembre<br />
1948. Parlant de cette situation, il disait: « Le point de la résistance essentielle se trouve<br />
au Sénégal dont l'influence traditionnelle sur la politique en Afrique noire, lui donnera<br />
encore une influence quasi-déterminante »67. Gabriel d'Arboussier fait ce constat à la<br />
suite d'une longue tournée de contact avec les diverses sections territoriales du<br />
mouvement, de mars à juillet 1948. Quand la crise intervient à la suite de la publication<br />
du manifeste du désapparentement du PCF, l'uns ne peut, logiquement, qu'en<br />
enregistrer les soubresauts. Dans ce manifeste, on peut lire : « Les élus du<br />
Rassemblement ont abandonné l'apparentement de propos délibéré... Cet apparentement<br />
n'avait été qu'une recherche d'un appui parlementaire et non un programme politique...<br />
Nous ne sommes pas des communistes. Nous ne l'avons jamais été... »68.<br />
Dèjà, le 9 août 1950, les dirigeants du RDA, Houphouët en tête, ont signé<br />
avec les I.O.M un protocole de désaffiliation des formations politiques métropolitaines.<br />
Houphouët s'est engagé, à cette occasion, à désaffilier le RDA du PCF dès la rentrée<br />
parlementaire. D'autre part, Houphouët et son groupe ont voté la confiance à Pleven<br />
ancien ministre de la FOM au temps fort de la répression contre le RDA en Mrique<br />
noire. En somme, lorsque le 17 octobre, Houphouët rend public son texte, il est en fait<br />
en pleine période de collaboration avec la droite africaine (l.O.M) et française.<br />
Dans ce contexte, la logique veut qu'il s'écarte du PCP. Ce manifeste lui fait<br />
franchir le pas. Dès que la décision est publiée, les auteurs se font le devoir d'aller, en<br />
Mrique même, en expliquer les raisons aux sections de base.<br />
Dans une lettre confidentielle adressée au ministre de la FOM, le Haut<br />
Commissaire de Dakar, à la date du 20 avril 1951, sous le numéro 385 int/AP, indique<br />
que:« Houphouët Boigny s'est rendu à Dakar et a tenu une réunion groupant une vingtaine<br />
de personnes, membres influents de l'UDS. ET que le député avait expliqué les raisons de<br />
66. "Réveil" nO du 27 février 1950.<br />
67. Roger de Benoîst, l'Afrique Occidentale, P.154.<br />
68. Texte remis à la presse le 17 octobre 1950 à Paris.<br />
79·
périr tant de militants presque partout dans les territoires de la fédération de l'AOF.<br />
Qu'en fait, en quittant l'alliance avec le PCF, le leader Houphouët menait, à Canossa, le<br />
RDA, et ceci pour des intérêts propres et de bas étage. Le groupe parlementaire qui a<br />
orchestré le désapparentement est furieux du comportement de Gabriel d'Arboussier et<br />
l'exclut du mouvement le 12 juillet 1952 pour "menées subversives". Et Houphouët<br />
Boigny répond, par une longue lettre, rendue publique par l'organe du RDA. Nous y<br />
reviendrons.<br />
En attendant, la section sénégalaise n'est pas la seule à prendre la décision<br />
de déjouer la manoeuvre de la direction politique du RDA car celles du Niger et du<br />
Cameroun ont la même attitude. Une large explication s'impose dès lors pour faire<br />
clarifier la ligne du mouvement et faire marcher ensemble les sections. Mais cette<br />
explication, dans l'immédiat, est refusée par la direction qui multiplie les atermoiements<br />
pour éviter la convocation d'un congrès demandé par certains, notamment la section<br />
UDS. Aux yeux de l'administration, si la section sénégalaise du RDA refuse de suivre la<br />
ligne de la direction, c'est parce que, sur cette section, l'emprise des militants<br />
communistes est totale. D'arboussier y compte donc des appuis solides. Mais ce rejet par<br />
la section territoriale de la nouvelle ligne politique est-il suffisant pour créer auprès de<br />
l'ensemble des militants, toutes les conditions d'un militantisme actif? Apparemment<br />
non puisque les effectifs connaissent une chute brutale. Un point tel, qu'à un moment<br />
donné, seules restent actives, à peine d'ailleurs, les sections des villes de Saint-louis et de<br />
Dakar pour l'ensemble de l'UDS. C'est exactement ce que constatait le rapport<br />
politique envoyé par le gouverneur général de Dakar au ministre de la FOM sur la<br />
question dès 1951. Même les dirigeants locaux s'en rendent bien compte. Une reprise en<br />
main de l'appareil de l'UDS s'impose. Il faut s'y atteler rapidement et vigoureusement<br />
avant qu'il ne soit trop tard. Un patient travail est entrepris par ceux-là même qui<br />
rejettent la ligne de collaboration. Le résultat porte ses fruits, à la longue. L'autorité<br />
administrative le reconnait à son corps défendant. Dans le rapport de 1954, nous lisons:<br />
« Leparti refait surface, plus vimlent et mieux organisé que jamais»71.<br />
Pour mieux consolider l'action de reprise en main et d'organisation, les<br />
responsables portent une attention particulière aux organisations de masse.<br />
L'administration, par un rapport annuel de territoire remarque : « L'UDS coiffe ou<br />
s'efforce de coiffer les trois organisations de masse suivantes: U.C.M : Union Culturelle<br />
Musulmane, la C. G. T dont tous les leaders valables sont de l'union, le RJ.DA : la jeunesse<br />
et les étudiants ». Parachevant sa réorganisation après une véritable traversée du désert<br />
de près de quatre ans, l'UDS peut enfin tenir un congrès les 9, 10 et 11 octobre 1954.<br />
Dix sections sont présentes; elles attestent l'importance du redressement opéré par la<br />
direction qui a rejeté la tactique de son leader H. Boigny. Il s'agit des sections de Dakar,<br />
71. Affaires politiques A.O.F, ANSOM, carton 2143, dos 4.<br />
81
Au plan de la participation électorale t le MPS est pratiquement absent dans<br />
les consultations municipales dakaroises de la période t tout comme au niveau territorial.<br />
Ainsi, aux municipales de novembre 1955, il prône l'abstention et l'organe central titre,<br />
à ce sujet: « Le RDA ne présente pas de liste aux élections municipales »75. C'est très<br />
probablement en raison du manque de représentativité que le MPS est absent de la<br />
scène électorale. Aussi en 1956 t est affirmé dans un rapport de l'administration où nous<br />
lisons: « Quant au MPS, son influence est pratiquement nulle »76. Par contre, son rival<br />
l'UDS se présente aux élections législatives du 2 janvier 1956.<br />
Le MPS est partie prenante lors des tractations politiques entre partis au<br />
Sénégal, au début de 1958. Engagées d'abord à Paris, puis à Dakar, ces tractations ont<br />
pour but de réduire les contradictions entre formations politiques opposées. L'organe du<br />
MPS écrit à ce sujet: « Afin de ne pas passer notre temps à nous entre-déchirer»77.<br />
En 1957, Doudou Guéye secrétaire général du MPS est élu président de la<br />
commission permanente du Grand Conseil de l'AOF lorsque le RDA interterritorial,<br />
après son action de collaboration, a obtenu des gains électoraux importants en AOF<br />
contrairement aux résultats de juin 1951. En effet, il obtient quinze députés élus en 1956<br />
contre seulement quatre en 1951, ce qui lui permet de s'installer solidement au Grand<br />
Conseil de l'AOF puisque le député de Côte d'Ivoire est élu président de la Haute<br />
Assemblée locale tandis que Doudou Guéye du MPS dirige sa Commission Permanente.<br />
Pourtant, à ces élections des assemblées territoriales qui avaient permis le<br />
renouvellement du Grand Conseil, l'assise du MPS fut très faible.<br />
En somme, le MPS n'est pas très significatif au plan représentation sur la<br />
scène politique sénégalaise. Cependant, puisqu'il se réclame de la ligne Houphouët, la<br />
domination de ce parti sur la scène de l'ensemble de l'AOF après 1956, assure une<br />
position importante au principal leader du MPS sénégalais. En effet, le Grand Conseil,<br />
installé à Dakar, a pratiquement toujours élu des représentants du territoire du Sénégal t<br />
à la présidence de sa Commission Permanente, depuis sa création en 1947. Cette<br />
situation paraît paradoxale au seul niveau sénégalais mais, elle se comprend dans le<br />
cadre de la rivalité entre les grandes formations politiques interterritoriales. Lorsque<br />
l'influence électorale du RDA lui permet de contrôler le Grand Conseil, il y met ses<br />
hommes et les représentants du Sénégal, proches de L.S. Senghor, en seront d'ailleurs<br />
particulièrement vexés.<br />
En 1958, le MPS se dissout dans le cadre du nouveau parti unitaire, résultant<br />
des tractations du début de cette même année: l'UPS.<br />
75. "L'Action" du 31 octobre 1955.<br />
76. Affaires politiques AOF, ANSOM, carton 2230, dos 2.<br />
77. "L'Action" du 13 janvier 1958.<br />
84
écrit : « Les partis extrémistes, véritable pool de subversion, ont montré, en août et<br />
septembre 1958, qu'ils pouvaient menacer sérieusement l'ordre public ... et peuvent se livrer<br />
au terrorisme urbain ». Rappelons que cette référence à août et septembre 1958, est<br />
relative à l'arrivée à Dakar le 26 août 1958 du général de Gaulle et à la campagne pour<br />
le référendum qu'il est venu proposer à l'Afrique noire et Madagascar.<br />
Au plan de la presse, le P.AI dispose d'un organe central intitulé "La lutte"<br />
tirant à 4.000 exemplaires et dont 1.800 sont vendus à Dakar d'après la source militaire.<br />
Le premier numéro de ce journal paraît dans la capitale fédérale dès le 12 octobre 1957<br />
soit un mois après la création du parti et la publication du Manifeste. La section<br />
territoriale du Sénégal du P.AI, intervient, elle aussi, dans le cadre de la presse<br />
dakaroise , par un autre organe intitulé "Mornsarew" né le 13 février 1958 et tirant à<br />
1.000 exemplaires d'après l'Etat-Major. Par contre le journal lui-même annonce qu'il<br />
tire à 2.000 exemplaires pendant ses six premiers mois d'existence 83 .<br />
La composition même du parti apparait dans le rapport de l'Etat-Major qui<br />
fournit un répertoire alphabétique des principaux militants dans la section de Dakar. Ce<br />
répertoire montre que les militants sont d'origines diverses par les secteurs d'activités<br />
auxquels ils appartiennent.<br />
- Des mouvements de jeunesse, il y'avait Ngagne Faly Diouf secrétaire à<br />
l'organisation du conseil de la jeunesse du Sénégal, Lô Cheikh Bara secrétaire général<br />
adjoint de la F.M.J.D dont le siège est à Budapest.<br />
- De l'enseignement avec : Seydou Cissokho, rédacteur en chef de "La lutte"<br />
et instituteur comme Gaye Amadou dit Gabin, trésorier adjoint du syndicat UGTAN de<br />
l'enseignement,<br />
- de l'Union Culturelle Musulmane avec des hommes comme Ly Bachir,<br />
Tamsir Diop, Touré lbrahima ...<br />
- du Mouvement de la Paix avec Abdoul Moumini vice président du Conseil<br />
Mondial de la Paix et président de la section sénégalaise de ce mouvement,<br />
- des organisations syndicales avec des militants comme Soumaré Mamadou<br />
secrétaire général adjoint du syndicat du port de Dakar, Camara Mamadou responsable<br />
syndical à l'USlMA, Kouyaté lbrahima responsable syndical de la COMACICO,<br />
- des milieux étudiants dakarois et métropolitains avec Dieng Amady de<br />
l'UGEAO, Khaly Basile de la FEANF, Papa Soulèye Ndiaye premier vice président de<br />
la FEANF,<br />
- de l'administration financière avec des hommes comme Babacar Niang<br />
inspecteur des impôts et domaines,<br />
- des milieux de la presse avec le publiciste Mahjmout Diop qui est le<br />
secrétaire général du parti 84 .<br />
83. "Momsarew", nO 2, Septembre 1958.<br />
84. Synthèse fiche nO 42, P.3, 4 et 5.
Aux adversaires politiques et à l'administration qui présentent le P.AI<br />
comme un parti de jeunes, voire de gamins, sans aucune expérience ni de l'action<br />
politique ni d'une autre, la rédaction de l'organe de la section territoriale du Sénégal<br />
répond par cette présentation professionnelle des militants : «Nous insistons sur le fait<br />
que notre parli compte parmi ses militants deux agrégés de mathématiques et de physique et<br />
chimie, des ingénieurs en grand nombre, des professeurs, des administrateurs etc...»85. Pour<br />
"Momsarew", il est évident que les diplômes comptent énormément mais il souligne que<br />
le plus important est l'engagement politique et la détermination du militant.<br />
L'hebdomadaire de la section territoriale du Sénégal indique que, dans ce domaine<br />
également, le parti dispose d'hommes dévoués et déterminés. Un article signé de Gaye<br />
Amadou en donne un échantillon dans la présentation des militants emprisonnés à<br />
Saint-louis le 8 août 1959. Dans cet article intitulé: « Même en prison, la lutte continue» .<br />
La rédaction de "Momsarew" présente la détermination et le dévouement de « deux<br />
instituteurs, un étudiant en sciences, un éléve en classe terminale philosophie, un comptable,<br />
un relieur, un menuisier, un professeur ».<br />
Ses relations avec l'administration?<br />
Pendant près de trois ans d'existence légale du parti, les relations entre le<br />
P.A.I et l'administration furent des plus mauvaises; ceci tant avec l'administration<br />
coloniale qu'avec celle de l'autonomie interne. L'explication de cette situation se trouve<br />
dans la ligne d'engagement de ce parti qui se réclame du marxisme léninisme. C'est<br />
essentiellement sur les questions sociales et les questions politiques que l'affrontement<br />
sans répit est le plus violent. Durant la période 1958-1960, la presse notamment, cite de<br />
nombreuses manifestations de la répression du pouvoir à l'égard de cette formation<br />
politique. Les organes la "lutte" et "Mornsarew" publient régulièrement des éléments de<br />
cette répression. Elle dévoile les mutations, les emprisonnements, les condamnations<br />
sans oublier les licenciements et révocations de militants parfois torturés par la police.<br />
Mamadou Dia lui même en apporte un témoignage. Celui qui fut le chef du<br />
gouvernement du Sénégal de la Loi-Cadre à l'indépendance, parlant de la répression<br />
constante qui a frappé le P.AI écrit: « Ce n'était pas le programme du PA.I qui était<br />
proscrit... Ce n'était pas non plus l'idéologie du PA.1.. Mais parce qu'il a provoqué des<br />
troubles graves »86.<br />
Bien sûr, Mamadou Dia parlait alors de la situation de 1960, notamment du<br />
30 juillet, au moment où le gouvernement prit une mesure administrative d'interdiction<br />
du P.A.I après les incidents des élections municipales de Saint-louis. Mais, cet acte<br />
administratif n'est que l'aboutissement d'une longue suite de tensions. Dans une<br />
85: Momsarew" nO 2, Sept. 1958.<br />
86. Mamadou Dia, op. cit, p. 222.<br />
87
certaine mesure, aux yeux de l'administration, le P.AI est un élément trop irritant avec<br />
ses positions notamment celles qui concernent l'indépendance nationale, "immédiate et<br />
totale", alors que la démarche du pouvoir en place est toute autre. La dissolution du<br />
P.A.I n'a atteint qu'un objectif fort limité puisque le parti continue à mener ses activités<br />
dans la clandestinité.<br />
L'explication de cette répression est que l'administration perçoit le P.AI<br />
comme l'un des éléments constitutifs du pôle de subversion à Dakar et au Sénégal<br />
d'abord et de manière plus ou moins importante au niveau de l'AOF ensuite. L'état<br />
major de l'AOF affirme bien cet aspect car dans son étude sur la presqu'île du Cap Vert,<br />
il consacre sept pages entières au P.A.I et au PRA contre une seule page à l'UPS qui<br />
pourtant, détient tous les postes de l'Assemblée Territoriale du Sénégal et du<br />
gouvernement. Cette étude concerne non seulement le mode de fonctionnement, les<br />
structures, l'évaluation numérique, les déplacements des principaux militants derrière ce<br />
que l'Etat-Major appelle le "Rideau de fer" mais aussi la stratégie de subversion dégagée<br />
par le parti... Tout cela amène l'état-major à une planification rigoureuse des réactions<br />
de défense dans l'hypothèse d'une action de subversion déclenchée par le P.AI. Ce plan<br />
prévoit même la manière de séparer la presqu'île du Cap Vert du reste du Sénégal pour<br />
être en même de faire face à une telle action. Tout ceci indique bien que ce parti<br />
politique était pris au sérieux par l'autorité militaire dakaroise. Cette analyse faite pour<br />
l'information des hauts milieux gouvernementaux parisiens, est elle totalement<br />
étrangère à la mesure de dissolution du P.A.I en début août 1960 ? Nous ne disposons<br />
d'aucun écrit comme élément de réponse. Mais, au regard de la nature des relations<br />
entre ce parti politique et l'administration, il est fort plausible qu'une complicité de la<br />
part de Paris existe.<br />
phases électorales:<br />
Au plan de la participation électorale, le P.A.I a vécu, légalement, trois<br />
- le référendum du 28 septembre 1958 au cours duquel le parti prône<br />
ouvertement et agit activement pour le "non" et milite en faveur de l'indépendance<br />
immédiate. En alliance avec l'UGTAN, le OS, les étudiants et le PRA-Sénégal, le P.AI<br />
influence largement le cours de la campagne électorale par une réelle agitation,<br />
particulièrement dans la capitale.<br />
Le résultat de ce référendum ne donne que 5.733 "non" dans le Cap Vert 87<br />
pour toute la coalition. l'état-major justifie ce résultat en affirmant que le P.AI et le<br />
PRA se dédoublent simplement par le OS, l'UGETAN et l'UGEAO; mais pour le<br />
P.A.I, les résultats du référendum ne sont pas crédibles car ce sont ceux de<br />
l'administration qui manipule les chiffres.<br />
87. Fiche 42. P. 2.<br />
88
- Quant aux élections législatives du 22 mars 1959, le P.AI refuse d'y<br />
participer tout en prônant l'abstention active. La conférence fédérale du parti, réunie à<br />
Dakar, le 25 février 1959, adopte la résolution finale qui proclame: « Nous nous sommes<br />
refusés à toute alliance électorale avec les réactionnaires de tous bords...Mais pour une<br />
abstention active...pour marquer notre attachement à l'indépendance »88. Samba Ndiaye<br />
qui signe l'éditorial de l'organe de la section territoriale sur cette position adoptée par la<br />
conférence territoriale écrit: «Je ne voterai pas pour ceux qui n'ont pas osé faire comme<br />
les dirigeants guinéens... Je m'abstiendrai le 22 Mars 1959...»89.<br />
- Pour les élections municipales du 30 juillet 1960, le P.A.I présente des<br />
candidats dans plusieurs grandes villes du Sénégal notamment à Saint-louis et à Dakar,<br />
et c'est à la suite de cette élection que le gouvernement Mamadou Dia prend la mesure<br />
de dissolution administrative du P.A.I. Les incidents de Saint-louis auraient lourdement<br />
pesé sur la balance si l'on en croît Mamadou Dia qui s'exprime, dans ses mémoires, à ce<br />
sujeëO.<br />
A Dakar, l'AF.P du 31 juillet 1960 donne les résultats suivants pour ces<br />
élections municipales:<br />
114.852 suffrages exprimés pour 135.330 inscrits.<br />
U.P.S : 110.627 voix<br />
PRA : 1.666 voix<br />
Listes diverses intérêts locaux: 2.444 voix<br />
P.A.I : 315 voix.<br />
Sans formuler, ici, un jugement hâtif sur la crédibilité de ces résultats<br />
électoraux, quelques questions s'imposent : comment expliquer que le P.A.I dont<br />
l'influence a été jugée assez grande à Dakar au référendum du 28 septembre, pour faire<br />
"officiellement" plus de 5.000 voix, n'obtient, à ces municipales dakaroises que 315 voix<br />
c'est à dire moins de 0,30 % des suffrages exprimés? Le parti aurait-il perdu si<br />
largement de sa crédibilité en l'espace de moins de deux ans? C'est possible mais c'est<br />
bien le contraire que constate le rapport de l'état-major. Or, ce rapport date d'août 1959<br />
c'est à dire exactement à mi-parcours entre les deux consultations électorales. Il nous est<br />
en tout cas difficile de retenir l'hypothèse d'une perte de crédibilité aussi grande pour<br />
cette formation.<br />
y aurait-il un rapport quelconque entre la dissolution du parti et ces résultats<br />
proclamés? c'est fort probable pour qui sait que le gouvernement de 1960 comprend<br />
entièrement les membres de l'U.P.S lesquels sont aussi les candidats aux élections<br />
municipales du 30 juillet. De plus, à Dakar, l'U.P.S c'est à dire la résultante des diverses<br />
88. "Momsarew", nO 4.<br />
89. Ibidem.<br />
90. Ces incidents ont fait plusieurs blessés graves dont Daniel Cabou gouverneur de la région du Fleuve à l'époque.<br />
89
adopte le principe de l'indépendance immédiate dans sa résolution générale, ce ne fut<br />
fait qu'au terme d'un débat d'orientation très flou. En effet, Senghor rapporteur moral<br />
du congrès est violemment et publiquement pris à partie par Abdoulaye Ly pourtant<br />
membre de la délégation territoriale du Sénégal à ce congrès. La raison de cet<br />
affrontement réside dans le fait que Abdoulaye Ly s'exprime ouvertement en faveur de<br />
l'indépendance immédiate de l'Afrique noire française alors que Senghor rejette cette<br />
motion. Cette passe d'armes devant le congrès, est révélatrice des difficultés que la<br />
section sénégalaise du P.R.A va vivre dès la fin du congrès. Dès le 14 septembre 1958, le<br />
comité directeur du P.R.A se réunit à Niamey pour définir la position du mouvement, à<br />
l'égard du référendum du 28 septembre. Cette position ne tranche pourtant pas le débat<br />
qui est à son ordre du jour. En effet, « Le comité directeur invite toutes les sections<br />
territoriales du P.RA à prendre position face au référendum en tenant compte de leur<br />
contexte politique propre »92.<br />
On comprend dès lors que la situation soit difficile dans la section du<br />
Sénégal. En effet, cette résolution renvoie le débat à la base, avec la liberté de choix<br />
accordée à chaque section. Il n'y a donc pas eu à Niamey de position commune. Or,<br />
deux fois de suite, c'est à dire les 11 et 20 septembre, à Rufisque, le comité exécutif,<br />
instance de l'U.P.S a planché sur la question. Entre ces deux réunions, une mission est<br />
même envoyée à Conakry, d'urgence, pour tenter de mettre Sékou Touré et son parti, le<br />
PDG, dans une logique de vote pour le "oui". Mamadou Dia qui a conduit la mission<br />
rapporte à l'instance qui l'a mandatë 3 , le refus opposé par Conakry. Le comité exécutif<br />
du 20 septembre, c'est à dire une semaine avant le référendum est saisi du débat sans<br />
pouvoir trouver une solution acceptable pour chacune des thèses en conflit. Le débat est<br />
si vif, en raison de l'irréductibilité des positions contradictoires, que la rupture se<br />
produit dans le parti. Le gouvernement en subit, logiquement les contre-coups puisque,<br />
deux jours plus tard, quatre de ses membres rendent leur démission. Il s'agit de<br />
Abdoulaye Ly, Amadou Mactar Mbow, Diaraf Diouf et Latyr Camara. Ces ministres<br />
démissionnaires avaient été mis en minorité dans l'instance du 20 septembre par 204<br />
voix contre 13 et 41 abstentions. La majorité du comité exécutif avait décidé de faire<br />
voter le " oui". En quittant le gouvernement, ils expriment ainsi, l'impossibilité, pour eux,<br />
d'accepter que l'indépendance, comme telle, ne soit pas saisie à partir de cette<br />
opportunité offerte par le général de Gaulle.<br />
Ainsi, le P.R.A en tant que section territoriale sénégalaise, éclate au grand<br />
jour. Les ministres démissionnaires ainsi que tous leurs partisans quittent l'U.P.S pour se<br />
constituer en P.R.A-Sénégal en tant que parti politique indépendant. Le secrétaire<br />
général du nouveau parti est Abdoulaye Ly qui était au sein du comité exécutif de<br />
92. Abdoulaye Ly, Emergence... pp.49-50, 1981.<br />
93. Op. cit., pp. 93-94.<br />
91
l'U.P.S, le chef de file de la contestation sur cette question. Le parti se dote d'un organe<br />
central appelé "Indépendance Africaine" tirant à 4.000 exemplaires.<br />
En ce qui concerne ses militants, le P.R.A recrute essentiellement dans les<br />
milieux de la jeunesse, de l'UGTAN et parmi les étudiants. En fait, d'après le rapport de<br />
l'état-major, le P.R.A-Sénégal et le P.A.I recrutent presque dans les mêmes milieux; ce<br />
rapport les considère tous deux: comme des pôles de la subversion. La ressemblance du<br />
vivier y est, peut-être, pour quelque chose.<br />
Au plan électoral, le P.R.A-Sénégal a vécu quelques participations. Le<br />
référendum du 28 septembre et les législatives sénégalaises de mars 1959. L'autorité<br />
militaire affirme que les 5.733 voix en faveur du "non" à Dakar sont l'addition des votes<br />
P.A.I et P.R.A-Sénégal. En tout cas, aux législatives sénégalaises de mars 1959, le<br />
P.R.A-Sénégal est crédité de 1.316 voix sur les 90.087 inscrits au Cap Vert et les 66.054<br />
suffrages exprimés. Aux élections municipales de Dakar, en juillet 1960, la liste P.R.A<br />
Sénégal obtient 1.666 voix sur les 114.852 exprimés.<br />
Au nombre des militants, la source militaire donne, pour le P.R.A-Sénégal un<br />
chiffre de 3.200 au début de 1959. Cette source met l'accent sur le développement que<br />
ce parti, tout comme le P.A.I, a connu dans la période récente.<br />
Le P.R.A-Sénégal continue jusqu'à la fin de notre étude, comme parti<br />
politique d'opposition au parti au pouvoir.<br />
7) Le M.L.N (Mouvement de Libération Nationale).<br />
C'est le 25 août 1958, en période de pleine agitation politique à Dakar,<br />
agitation due à l'arrivée du général de Gaulle à Dakar, dès le lendemain même, que le<br />
manifeste d'un nouveau parti politique est rendu public dans la ville : il annonce la<br />
création du M.L.N.<br />
Parmi les signataires du manifeste, vingt au total, nous trouvons : Albert<br />
Tévoedjré, Joseph Ki-Zerbo, Joseph Mathiam, Daniel Cabou, tous des chrétiens<br />
progressistes, étroitement liés à la hiérarchie catholique dakaroise. Ils sont d'anciens<br />
dirigeants de la jeunesse chrétienne, d'anciens animateurs du mouvement des étudiants<br />
catholiques de l'Institut des Hautes Etudes de Dakar. Ils ont milité également soit à la<br />
FEANF, soit à l'Association des Etudiants Catholiques africains en France. Mais aussi<br />
des musulmans comme Cheikh Amidou Kane, Abdoulaye Wade, Mamoudou Touré<br />
etc... Le parti nouvellement mis en place à Dakar et dont le manifeste s'intitule «<br />
Libérons l'Afrique» a une vocation interterritoriale exactement comme le P.A.I né un an<br />
auparavant, ou le R.D.A, le P.R.A etc...<br />
Des Sénégalais signataires du manifeste, retenons les noms suivants :<br />
- Daniel Cabou administrateur civil de la FOM, conseiller technique du<br />
gouvernement du Sénégal pour les questions économiques.<br />
92
- Cheikh Amidou Kane, lui aussi administrateur stagiaire et écrivain connu<br />
pour avoir publié un roman à thèse: "L'aventure ambiguë".<br />
- Mamoudou Touré, administrateur de la FOM.<br />
- Joseph Mathiam, étudiant.<br />
- Abdoulaye Wade, docteur en droit.<br />
- Trois instituteurs signent aussi le texte du manifeste 94 .<br />
Tous ces signataires ont en commun le fait de ne pas avoir de passé politique<br />
sur la scène dakaroise. Ils sont presque tous inconnus du grand public. Ce sont des<br />
intellectuels car ils ont fait, pour l'essentiel, des études universitaires 95 .<br />
Au regard du nombre et des responsabilités des dirigeants du M.L.N liés à<br />
l'église catholique dakaroise, on peut penser que celle-ci a été pour beaucoup dans cette<br />
création pour pouvoir peser plus ou moins directement sur la vie politique dakaroise.<br />
Ainsi donc, l'église dakaroise dispose, indirectement certes, d'un outil<br />
adéquat pour intervenir sur le terrain politique. Elle disposait dèjà à Dakar de leviers<br />
importants et nombreux tels que les organisations culturelles, de jeunesse, une presse<br />
diversifiée au tirage important, un pouvoir de "rassembleur" surtout avec ses conférences<br />
organisées au centre culturel Daniel Brottier où catholiques, protestants, musulmans,<br />
militants politiques de divers horizons, acteurs sociaux etc... s'affrontaient dans des<br />
débats contradictoires très suivis par un public nombreux. Ainsi, il ne manquait à l'église<br />
que "son" parti politique. Le M.L.N lui offrait en partie, l'occasion d'en avoir un.<br />
De même très probablement, la création de ce parti politique nouveau à<br />
Dakar serait, en rapport direct avec la volonté manifestée par certaines forces<br />
islamiques, de peser suffisamment dans la scène dakaroise. Le tout se déroule sur toile<br />
de fond de référendum du 28 septembre 1958.<br />
Le manifeste du parti présente un programme duquel trois mots d'ordre<br />
principaux se dégagent: Indépendance, Etats unis d'Afrique et Socialisme 96 .Ces mots<br />
d'ordre épousent largement les préoccupations politiques centrales de la période, même<br />
si, dans le détail, le contenu mis dans ces termes n'a pas tout à fait la même signification<br />
que dans l'U.P.S, le P.R.A-Sénégal ou le P.AJ.<br />
Quel est le poids du M.L.N sur le terrain politique dakarois de 1958 à 1960 ?<br />
Les sources ne permettent pas d'avancer le moindre chiffre sur le nombre de<br />
militants ou sympathisants du M.L.N. De plus, dans cette phase, il ne participe à la<br />
moindre consultation électorale, évidemment ceci en rapport avec le niveau<br />
d'organisation de ce parti. Cependant, on peut penser, eu égard au caractère trop<br />
94. Présence africaine, nO 61 Fev-mars 1959.<br />
95. Bakary Traoré, Forces politiques en Afrique noire, 1966, p. 74.<br />
%. Fiche 41, p. 6, Notice de l'état-major AOF, 1959.<br />
93
marqué de ce parti par une certaine coloration religieuse, que ses militants se recrutent<br />
avant tout dans les milieux catholiques locaux. Or, l'église dakaroise, reste, au plan du<br />
nombre de ses adeptes, très minoritaire à Dakar. En tout cas, l'état-major général, dans<br />
sa notice d'information sur la presqu'île du Cap Vert, fait la remarque suivante au sujet<br />
de son audience : «Audience faible en raison de la nature même du mouvement animépar<br />
des intellectuels catholiques ». Cette remarque se confirme par le fait que nous ne notons<br />
aucune activité importante de sa part. De plus, c'est à peine si les rapports politiques de<br />
la période signalent son existence.<br />
En somme, le M.L.N (Mouvement pour la Libération Nationale) n'a été, à<br />
Dakar, qu'un mouvement politique très marginal. Les caractéristiques même de ses<br />
membres, mais aussi la particularité du contexte dakarois ont certainement été, pour<br />
beaucoup, dans la faible implantation de cette formation politique.<br />
8) Le P.S.S (Parti de la Solidarité Sénégalaise).<br />
Sa création remonte à février 1959. Parmi ses principaux fondateurs, se<br />
trouvent Cheikh Tidiane Sy, Ibrahima Seydou Ndao.<br />
Cheikh Tidiane Sy est le fils de Elhadj Ababacar Sy, premier Calife d'Elhadj<br />
Malick Sy le fondateur de la confrérie tidjane au Sénégal. Il vit à Tivaouane, en plein<br />
coeur du pays du Cayor. Il a été très actif comme soutien du B.D.S de Senghor dès sa<br />
création, avant de rompre plus tard avec ce parti politique. Partisan acharné du "oui" au<br />
référendum de 1958, il mène une campagne active dans ce sens. Il déploie, ainsi que ses<br />
partisans, des moyens d'information et financiers importants à cette occasion. Le journal<br />
"Paris-Dakar" lui ouvre largement ses colonnes. La radiodiffusion fédérale, par sa chaîne<br />
régionale notamment, lui a accordé un important temps d'antenne pour populariser sa<br />
position. Ensuite, pour son parti, des appuis ont été nombreux dans d'autres branches<br />
importantes de la confrérie comme celle des "Kanène" de Kaolak 97 et celle de la famille<br />
Tall descendante du grand marabout résistant à la pénétration française au XIXème<br />
siècle.<br />
Cheikh Tidiane Sy dispose aussi, dans la grande confrérie mouride, de<br />
soutiens notoires. Il a joué un rôle important dans le déclenchement de l'émeute qui eut<br />
lieu, le 6 mars 1957, dans la ville de Tivaouane. Il fut condamné à la prison à la suite de<br />
ces incidents sanglants 98 . Ce qui n'entama pas son influence.<br />
Quant à Ibrahima Seydou Ndao, il a été président de l'assemblée territoriale<br />
du Sénégal de 1952 à 1957. Ancien homme fort de la SFIO dans le Sine Saloum, il est<br />
l'une des grandes figures de la fondation du B.D.S en septembre 1948. Mamadou Dia 99<br />
97. Famille de Elhadj Ousmane Kane de Kaolak qui est la famille d'origine de sa mère.<br />
98. Ibrahima Marône, le Tidjanisme au Sénégal, 1971, p.204.<br />
99. Op. cit., P.52.<br />
94
loue ses qualités de courage politique et sa détermination dans la défense de ses idées,<br />
tout en remarquant aussi son caractère peu discipliné. Le transfert de la capitale du<br />
Sénégal de Saint-louis à Dakar à la fin de 1957, fut l'un des principaux mobiles de sa<br />
rupture avec la formation qu'il avait largement implanté au Sine Saloum. Il prit<br />
ouvertement, contre la décision gouvernementale, fait et cause pour Saint-louis.<br />
Comme Cheikh Tidiane Sy, il mène activement campagne pour le "oui" au<br />
référendum et dispose d'énormes moyens matériels et financiers. Membre actif du<br />
"Comité de soutien à l'action du général de Gaulle" créé à Dakar en début septembre<br />
1958, et qui regroupe les nostalgiques de la période du colonialisme triomphant, il prend<br />
violemment à partie les manifestants de la place Prôtet à Dakar, lors de l'arrivée du<br />
général de Gaulle. L'A.F.P rapporte ses propos en la circonstance: « Mon devoir est de<br />
protester contre ces agissements qui déshonorent notre pays... Il ne faudrait pas que les<br />
populations de France et des pays étrangers aient, en aucun moment, le sentiment que le<br />
Sénégal est d'accord avec les manifestants de cette journée »100.<br />
extérieures du parti.<br />
Le P.S.S dès sa création se dote de la direction suivante:<br />
- Cheikh Tidiane Sy : président du parti,<br />
- Ibrahima Seydou Ndao : directeur politique,<br />
- Omar Diop: avocat saint-Iouisien, secrétaire général du parti,<br />
- Charles Grazziani : industriel européen dakarois, chargé des relations<br />
Cette direction est mise en place par le congrès constitutif du P.S.S à Kaolak,<br />
la ville de Ibrahima Seydou Ndao. Le manifeste du parti avait dèjà donné une idée de<br />
l'orientation politique: « Le Sénégal doit rester uni au peuple de France pour le meilleur et<br />
pour le pire ». Parmi les autres objectifs que s'assigne la nouvelle formation politique: «<br />
Refaire l'unité et la solidarité sénégalaise contre la politique de division de l'u.P.S ». Le<br />
parti se dote d'un organe de presse appelé "La Solidarité".<br />
L'activité politique du P.S.S se perçoit surtout à travers l'organisation de<br />
chants religieux à caractère très politique qui lui permettent de pourfendre le<br />
gouvernement Mamadou Dia et son parti politique, l'U.P.S; ce qui mécontente le<br />
pouvoir. Ainsi, le 23 juin 1959, Cheikh Tidiane Sy leader du P.S.S est arrêté à Tivaouane<br />
à la suite de chants religieux particulièrement violents contre le régime. Il est écroué à la<br />
prison de Dakar pendant six mois. Il dut sa libération à une rencontre de négociations<br />
entre Mamadou Dia chef de gouvernement et El hadj Ibrahima Niasse, chef religieux<br />
très puissant de la confrérie tidjane du Sine Saloum, lui aussi membre du P.S.S. La<br />
condition mise par le pouvoir à sa libération fut la dissolution du P.S.S par ses<br />
dirigeants, si l'on en croit diverses sources. En tout cas, le 14 janvier 1960, Cheikh<br />
Tidiane Sy et Ibrahima Niasse annoncent officiellement leur ralliement à l'U.P.S, parti<br />
100. A.F.P du 28/08/1958. (Agence France Presse)<br />
95·
au pouvoir, marquant ainsi la fin d'une activité "politico-religieuse" islamique sous la<br />
bannière du P.S.S. En juillet 1960, concrétisant le ralliement, Cheikh Tidiane Sy vient, à<br />
la tribune du congrès de l'U.P.S, faire amende honorable 101 .<br />
Le P.S.S a donc vécu, tout juste un an. Peut-on apprécier son poids politique<br />
pendant cette courte période ? Aux élections législatives sénégalaises du 22 mars 1959,<br />
le P.S.S présente sa propre liste. Dans l'ensemble de la région du Cap Vert, il est crédité<br />
de 5.448 voix sur 66.034 suffrages exprimés. Ses voix se répartissent géographiquement,<br />
sur le territoire régional, ainsi:<br />
- Dakar-commune: 3.871 voix,<br />
- Gorée : 10 voix,<br />
- Rufisque-commune: 446 voix<br />
- Rufisque subdivision: 1021 voix. 102<br />
Paradoxe remarquable, l'objectif de la création du P.S.S avait été la<br />
recherche de l'unité. Sa disparition était justifiée aussi par la recherche de l'unité<br />
politique. Cheikh Tidiane Sy, lui-même, disait, le 12 juin 1960, sur les ondes de Radio<br />
Dakar, repris le lendemain à la une de Paris-Dakar: « Tout ce que le pays compte<br />
comme forces vives, ouvrières et paysannes, travailleurs de toutes catégories, lettrés de toutes<br />
cultures, doit s'unir en cette heure de ferveur nationale ».<br />
Ainsi, ce parti politique islamique n'eut qu'une existence éphémère, une<br />
représentativité faible et surtout une implantation avant tout, tidjane. En ce sens, son<br />
objectif affirmé fut un échec dans la mesure où d'autres confréries hésitèrent à s'engager<br />
dans le parti, tout comme d'autres familles même tidjanes.<br />
9) Le P.F.A ( Parti de la Fédération africaine).<br />
Ce n'est pas un parti politique sénégalais, mais un parti fédéral dans lequel<br />
l'U.P.S se retrouve, avec le parti de l'Union soudanaise. Le P.F.A est né le 14 janvier<br />
1959 dans la grande salle du Grand Conseil de l'AOF. Quatre délégations territoriales<br />
sont à l'origine de sa gestation: Sénégal, Soudan, Niger, Dahomey auxquelles s'ajoutent<br />
des observateurs d'autres territoires. Roland Colin103, présent à la cérémonie notait<br />
que des larmes d'émotion avaient abondamment coulé ce jour-là parmi les délégués.<br />
Même dans l'assistance, l'émotion fut grande. Modibo Keita, secrétaire général de<br />
l'Union soudanaise, clôturant les travaux, au Grand Conseil, faisait jurer les délégations<br />
présentes: «Je jure sur l'honneur... et si pour la fédération du Mali, pour l'unité politique,<br />
101. Christian Coulon, le Marabout et le prince. 1981.<br />
102. Additif, notice sur le Cap Vert.<br />
103. Systèmes d'éducation... 19n, p.462<br />
96
c'est une forte personnalité politique confirmée. Mais, Lamine Guèye et Senghor sont<br />
de vieux rivaux politiques, même s'ils viennent de se retrouver dans l'U.P.S. La fraction<br />
ex RD.S de l'U.P.S ne l'entend nullement de cette oreille. Ce qui a pour effet de<br />
retarder toute solution acceptée de tous. Deux mois durant, des consultations, des<br />
tractations ont lieu pour débloquer la situation qui bute sur le choix du président de la<br />
Fédération alors même que la date de l'élection était arrêtée pour le 27 août 1960. Dans<br />
la nuit du 19 au 20 août 1960, la Fédération du Mali éclate avec, comme cause directe,<br />
la révocation de Mamadou Dia, numéro deux du gouvernement fédéral, par Modibo<br />
Keïta, le Président. Un conflit ouvert autour de la nomination du chef d'état-major de<br />
l'armée fédérale ( deux colonels: l'un sénégalais présenté par son léSénégal et l'autre,<br />
. /<br />
Soudanais présenté par son pays) avait été à l'origine de la querelle des deux chefs de<br />
gouvernement. Ce conflit sur toile de fond de rivalité autour de l'élection à la<br />
présidence de la Fédération mit le feu aux poudres. La rupture intervient en cette nuit<br />
du 19 au 20 août 1960, soit exactement deux mois, jour pour jour, après la proclamation<br />
de l'indépendance de la Fédération. L'idéogramme renversé à la levée des couleurs lors<br />
de la cérémonie de proclamation de l'indépendance, le 20 juin, augurait-il de cette brève<br />
existence de la fédération du Mali? Le fait, en tout cas, était présenté comme tel dans<br />
divers milieux dakarois les jours suivants. Ils insistaient sur le signe que la précipitation<br />
avait été l'élément principal dans le processus de la mise en place des institutions de la<br />
fédération du Mali. Dans la mentalité dominante de l'époque, cette interprétation est<br />
largement véhiculée même s'il ne s'agit pas là d'un élément scientifique.<br />
La rupture de la Fédération du Mali trouve son explication dans des<br />
éléments plus tangibles; en effet, Soudanais et Sénégalais, par leurs partis politiques<br />
respectifs initiateurs de la fédération, proviennent de deux écoles politiques fort<br />
différentes. L'U.P.S des Sénégalais est un parti politique qui, pendant les cinq dernières<br />
années, a subi une série de mutations. Du RD.S à l'U.P.S en passant par le RP.S, il a<br />
englouti diverses formations politiques sans avoir le temps de les digérer réellement. De<br />
plus, de 1948 à 1960, ses dirigeants sont des hommes étroitement liés aux cercles<br />
coloniaux; ils ont étroitement appuyé les solutions coloniales par l'école de la SFIO<br />
..§Fr6, des I.O.M ou du M.R.P. A l'opposé, l'Union soudanaise, par ses hommes, vient<br />
d'une école politique bien différente: celle du R.D.A qui a longtemps épousé, les<br />
formes d'organisation et de mobilisation du PCF. Depuis de nombreuses années, elle a<br />
engagé un combat conséquent contre la domination coloniale. Cette formation<br />
territoriale a souvent pris position contre la direction Houphouët du mouvement,<br />
particulièrement lors du désapparentement.<br />
Mais, si Soudanais et Sénégalais se sont néanmoins retrouvés, c'est que le<br />
contexte politique d'ensemble de l'AOF, en proie à des mutations politiques et<br />
syndicales très rapides surtout depuis l'année 1956, date de la Loi-Cadre, s'y prêtait. Les<br />
Soudanais du R.D.A ont eu maille à partir avec Houphouët leader du mouvement<br />
99
interterritorial. Les Sénégalais en veulent particulièrement à Houphouët qu'ils<br />
considérent comme la cause même de la balkanisation de l'AüF. La rupture de la<br />
Fédération du Mali s'explique aussi, c'est le moins qu'on puisse dire, par des querelles<br />
de personne et des rivalités d'ambitions politiques: Senghor ne voulait pas s'effacer<br />
devant Modibo Keita et vice versa. Créée par le P.F.A, la Fédération eut une existence<br />
brève. L'absence de solidité du parti initiateur du projet et les ambitions personnelles, à<br />
quoi s'ajoutent les difficultés d'une telle entreprise précipitée à deux seulement, sont les<br />
raisons évidentes de l'echec du projet. L'oeuvre initiée par le P.F.A fut donc un echec<br />
parce que ce parti manquait d'unité idéologique et d'action conséquentes. Des intérêts<br />
extérieurs puissants n'ont certainement pas manqué aussi d'avoir agi dans le sens de la<br />
rupture du P.F.A et donc de sa fédération.<br />
10) Le R.P.F ( Rassemblement du Peuple Français).<br />
Cette étude des partis politiques a jusque-là suivi l'ordre chronologique. Si le<br />
R.P.F se place juste ici, c'est que, de par sa nature même, il nous a donné quelques<br />
embarras quant à sa position. Notre choix de le placer ici, se fonde sur sa nature. En<br />
effet, contrairement aux autres partis politiques, le R.P.F à Dakar, se présente comme<br />
un parti européen, transplanté simplement en terre africaine. Il est entièrement dirigé<br />
par des Européens qui en sont d'ailleurs les fondateurs. Cependant les Africains<br />
constituent la majorité des membres du parti mais n'y ont que la portion congrue aux<br />
postes de responsabilités. Ce sont ces caractéristiques qui font qu'il est placé seulement<br />
ici dans notre étude des partis politiques.<br />
Le R.P.F est fondé par le général de Gaulle à partir de son discours<br />
prononcé à Strasbourg le 7 avril 1947 105 . Il s'est résolu à fonder un parti dans le but de<br />
peser sur la vie politique française. Cela, à peine, un peu plus d'un an après avoir<br />
condamné sans appel les partis politiques existants pour lesquels il n'a exprimé que<br />
haine et mépris. Le 20 janvier 1946, devant ses ministres convoqués, d'urgence, un<br />
dimanche, au grand complet, il a annoncé son départ de la tête du gouvernement et<br />
justifié la chose en ces termes que lui même rapporte : «Le régime exclusif des partis a<br />
reparu. Je le réprouve, il me faut me retirer »106.<br />
Le 5 octobre 1947 à Vincennes, il prononce un discours dans lequel il<br />
reprend publiquement ses attaques contre le système des partis politiques "incapable" de<br />
faire face au danger : « Les petits partis qui cuisent leur petite soupe, au petit coin de leur<br />
feu »107. En créant le R.P.F, de Gaulle devient de fait un homme de parti, même s'il<br />
105. "Paris-Dakar" du 8 avril 1947.<br />
106. De Gaulle, Mémoires de guerre. T III. Le Salut 1954à 1959, p.302.<br />
107. Jean Pierre Rioux, La France de la Quatrième République. T l, Paris 1980, ardeur et necessité, p.l80.<br />
100
entend inscrire sa démarche dans un sens opposé opposé à celui des autres partis qu'il<br />
dénonce.<br />
Dès le mois d'avril 1947, à Dakar, une section du RP.F est créée "autour du<br />
premier résistant" de France, ce qui prouve que son appel trouve ici, un écho. Un<br />
bureau provisoire que dirige Robert Lattes, est chargé de la mise en place des structures<br />
qui se développent rapidement dans plusieurs grandes villes du Sénégal comme Saint<br />
louis, Thiès, Kaolak, Mbour, Diourbel etc... Le rapide développement du parti, surtout à<br />
Dakar, se marque par l'implantation de comités de nombreux points de la capitale<br />
fédérale. Les quartiers de Dakar-ville, de Colobane, de Fith-Mith, Khayes-Findiou,<br />
Thiaroye, Grand Dakar etc... mettent sur pied des comités du RP.F 1 08. Le nombre des<br />
inscrits atteint, dans la ville de Dakar le chiffre de 800 dès la date du 30 mai 1947. A la<br />
fin de cette même année, 3057 Européens et 2041 Africains y militent. Les effectifs sont<br />
au nombre de 6.200 dès le mois de février 1949 109 . Le RP.F publie un bulletin intérieur<br />
intitulé "L'Eclair" ayant son siège 85, rue Blanchot à Dakar et distribue aussi<br />
"L'Etincelle", l'organe national du parti, imprimé à Dakar par la G.I.A (Grande<br />
Imprimerie Africaine) sur la base des plans envoyés de Paris.<br />
Le rapide développement du R.P.F dans lequel beaucoup de résistants se<br />
sont regroupés, se heurte très vite à des difficultés liées à son fonctionnement et à des<br />
rivalités de personnes. D'abord la question des relations raciales qui surgit dans la<br />
nouvelle formation. C'est que, pour l'essentiel, les directions territoriales et locales sont<br />
presque entièrement occupées par les Européens; or, ceux-ci sont minoritaires sur<br />
l'ensemble des inscrits. Cette situation donne aux Africains, l'impression qu'ils ne<br />
constituent qu'un simple élément d'appoint. La constitution de la liste électorale du<br />
RP.F pour l'Assemblée Territoriale du Sénégal qui réserve toutes les places<br />
importantes aux Européens vient conforter cette impression. Les Africains réclament,<br />
haut et fort, un fonctionnement démocratique du parti dans lequel ils militent de leur<br />
propre gré. A ce mécontentement là, s'ajoute le fait que la direction constituée avant<br />
tout d'Européens, passe, à la suite de longs et nombreux contacts, alliance avec le B.D.S<br />
de Senghor. L'accord entre les deux formations politiques porte sur la constitution d'une<br />
liste commune aux cantonales de 1952. Les Africains sont fort mécontents de n'avoir été<br />
ni consultés ni même informés.<br />
A ces conflits raciaux, se superposent des conflits de personnes entre<br />
Européens qui rendent difficile le fonctionnement interne du R.P.F au Sénégal. Ces<br />
conflits multiples ont pris une dimension telle que le mouvement politique perd de son<br />
influence. A titre d'exemple de conflits, notons celui qui oppose Robert Lattes à<br />
Lemoine pour la direction territoriale du mouvement, puis celui qui existe entre<br />
Lemoine et Rogier pour la même raison. Ces conflits s'étalent publiquement et la<br />
108. Robert Bourgi, Le Général de Gaulle et l'Afrique noire, op. cit., p.163.<br />
109. Idem, P.211 et suivantes.<br />
101
direction nationale du R.P.F de Paris doit intervenir à diverses reprises pour les arbitrer,<br />
faute de solutions locales. Ceci fait même écrire à Maurice Voisin, rédacteur en chef des<br />
Echos d'Afrique Noire: « Soyez sérieux messieurs du RP.F »110 car le rédacteur craint le<br />
mauvais effet sur les indigènes de ces rivalités entre Européens.<br />
Ces rivalités et conflits de personnes entre Européens hauts responsables du<br />
R.P.F aboutissent même à une véritable rupture dans le parti gaulliste. En effet,<br />
mécontent d'avoir été désavoué par la direction parisienne, Robert Lattes dépose, le 12<br />
juillet 1948, les statuts d'une autre association avec ses activités propres. Pour lui, les<br />
dirigeants parisiens ignorent tout du contexte local et leurs interventions, dans ces<br />
conditions, ne peuvent être qu'intempestives; ce qui l'amène à créer son "Union gaulliste<br />
africaine".<br />
Dès lors, dans le camp gaulliste, la situation se complique puisque le R.P.F<br />
continue à mener ses activités politiques à côté de l'Union gaulliste africaine qui, elle<br />
aussi, s'active. Et, chaque formation se réclame de l'Homme du 18 juin. L'Union<br />
gaulliste africaine affiche notoirement sa dépendance directe à l'égard du "Premier<br />
Résistant de France" sans intermédiaire de l'appareil parisien. Mais elle n'a été qu'une<br />
simple manifestation de mauvaise humeur dans la mesure où son influence reste<br />
presque nulle à Dakar. Quant au R.P.F, au niveau territorial, il s'était fait l'allié du parti<br />
de Senghor, après avoir dans une certaine mesure, activé sa démission de la SFIO mais<br />
sans réussir à en faire un militant.<br />
L'alliance R.P.F-B.D.S a été bénéfique à Senghor car la validation de son<br />
mandat de député du Sénégal en 1951,est dû, pour une bonne part, au comportement du<br />
parti gaulliste à son égard lorsque le lOème bureau de l'assemblée nationale doit<br />
trancher la question à la suite de la contestation du résultat électoral par la SFIO.<br />
L'alliance est aussi bénéfique au R.P.F car Senghor, en constituant la liste électorale de<br />
l'Union entre les deux formations, permet aux représentants locaux du gaullisme, de se<br />
faire élire. D'autre part, le R.P.F et le B.D.S ont ensemble et massivement fait<br />
campagne contre la réelection de la liste SFIO conduite par Lamine Guéye à la tête de<br />
la Municipalité de Dakar. Aux municipales d'avril 1953, dans la capitale fédérale une<br />
liste commune R.P.F-B.D.S se constitue mais elle est largement battue.<br />
Le R.P.F, par son mode de fonctionnement qui en fait un parti dirigé quasi<br />
exclusivement par des Européens, manque d'audience effective à Dakar, surtout lorsque<br />
les Africains, mécontents de la présence et la prééminence totale des Européens,<br />
quittent massivement le parti gaulliste dans les années 1952-1953.<br />
La notoriété du Général de Gaulle n'a pas suffi, à elle seule, à l'asseoir<br />
solidement à Dakar. C'est que la domination des Européens sur ce parti lui donne, plus<br />
ou moins distinctement l'impression, politiquement, d'être le véhicule du colonialisme.<br />
110. "Echos" du 22 juin 1948.<br />
102
Pourtant, malgré cette volonté délibérée de vouloir donner un caractère<br />
politique à ces grèves l'administration ne peut pas occulter leur cause réelle. Le rapport<br />
de 1947 écrit: « Tous les syndicalistes du secteur privé comme du secteur administratif ont<br />
fait preuve d'une grande activité résultant de difficultés matérielles inhérentes à<br />
l'accroissement continu du coût de la vie... Le second problème est le réajustement des<br />
soldes et salaires eu égard à la cherté de la vie »7. Les grèves de 1948 et 1949 restent<br />
nombreuses et sont légalement suivies par les travailleurs. L'administration leur trouve<br />
une autre raison: c'est la revendication d'un code du travail qui garantirait le principe<br />
de l'égalité des salaires, de la sécurité sociale et des allocations familiales. A ces diverses<br />
causes, il faut ajouter l'arbitraire patronal qui apparait nettement à travers la grève de<br />
l'huilerie Lesieur de Dakar. Dans cette importante unité industrielle de Dakar, une<br />
grève éclate le 11 février 1949 parce que l'ouvrier Dieng Mbaye est licencié par sa<br />
direction. Immédiatement, les ouvriers africains arrêtent le travail par solidarité avec<br />
l'ouvrier licencié. Cet arrêt immédiat de travail devient vite une véritable grève.<br />
Diverses tentatives de réconciliation entre la direction et les 280 ouvriers grévistes se<br />
soldent par un échec, chaque camp campant solidement.§Y.e.ses positions 8 .<br />
Une décision surarbitrale intervient donnant entièrement raison à la<br />
direction qui a licencié tous les grévistes dès le début de leur action. Elle n'est pas plus<br />
heureuse pour régler la situation. La justice dakaroise, elle aussi, saisie de la question<br />
donne raison à la direction de Lesieur, rejetant même la demande de réembauchage du<br />
personnel. L'agitation se développe très rapidement dans l'ensemble des industries<br />
dakaroises. Devant les mesures de la direction de l'entreprise Lesieur qu'elle juge<br />
arbitraires et délibérées, l'intersyndicale lance un appel à la grève générale auquel<br />
répondent 5 à 6.000 ouvriers de la capitale. A cause de la paralysie de l'ensemble des<br />
activités de ce secteur, et surtout par crainte de généralisation, la direction de Lesieur<br />
cherche une solution de compromis. Elle y est obligée par la détermination de ses<br />
employés soutenus par les autres travailleurs.<br />
Une autre grève déclenchée contre l'arbitraire patronal a lieu dans<br />
l'enseignement le 7 mars 1949. Elle est organisée par le syndicat du cadre unique de<br />
l'enseignement. Ce mouvement de grève est une protestation contre l'expulsion de la<br />
Fédération du professeur Jean Suret Canale. Quatre vingt des quatre vingt sept<br />
membres du personnel enseignant africain de la Délégation suivent le mot d'ordre de<br />
grève 9 .<br />
7. Affaires politiques AOF, ANS, Dakar, 2G 47-29.<br />
8. Aff polit AOF, Service police et sûreté, rapport 2G 49-123, 1949 1er trimestre.<br />
9. Rapport politique annuel 1949, Délégation, 2G 49-123, Service police et sûreté.<br />
106
Toutes ces raisons se retrouvent dans les causes de la longue grève des<br />
cheminots africains d'octobre 1947 à mars 1949 dont Dakar fut l'un des théâtres<br />
principaux.<br />
En somme, dans la période de l'immédiat après guerre, et jusqu'en 1949, les<br />
grèves furent nombreuses à Dakar. Elles traduisent un niveau d'organisation élevé et<br />
une prise de conscience aiguë des travailleurs devant l'exploitation et l'arbitraire<br />
patronal privé comme administratif. Les grèves sont multiples et manifestent la volonté<br />
des travailleurs salariés de défendre plus fortement leurs intérêts. Les grèves des années<br />
1950-1954 traduisent davantage encore cette détermination dans la lutte syndicale<br />
autour de l'enjeu que fut le code du travail. C'est elle qui explique, par la suite, la<br />
recherche d'unité dans le mouvement syndical pour une plus grande efficacité dans<br />
l'action.<br />
Il LE MONDE SYNDICAL ET SES MODES D'ORGANISATION.<br />
Pendant l'entre-guerre, les syndicats, à Dakar, sont constitués par les<br />
Européens même si quelques Africains peuvent y adhérer.<br />
La seconde guerre mondiale terminée, le mode d'organisation des syndicats<br />
épouse, dans l'immédiat, des contours d'unité mais ce n'est que pour une brève période.<br />
En réalité avant même la fin du conflit mondial, les travailleurs européens et les<br />
travailleurs indigènes agissent séparément, parfois même, sur des intérêts<br />
contradictoires. C'est ainsi qu'à la fin de l'année 1944, chez les dockers du port de Dakar<br />
tout comme chez les ouvriers du chantier de l'aéroport de Yoff, des grèves éclatent chez<br />
les ouvriers indigènes mécontents de leurs salaires dérisoires. Les intéressés insistent<br />
longuement sur la maigreur de leurs salaires par rapport à ceux de leurs homologues<br />
européens. Cette situation se développe dans plusieurs entreprises au point que le défilé<br />
du 1 er mai 1945 auquel les autorités coloniales veulent donner un cachet particulier en<br />
raison de la proximité de la victoire alliée, ne peut regrouper que deux cent travailleurs<br />
européens car les travailleurs indigènes de la ville refusent de participer à cette<br />
manifestation.<br />
Dans la période 1945-1960, il Ya pour l'essentiel un clivage. Les grèves sont<br />
surtout déclenchées par les travailleurs indigènes. Les Européens, par leurs grèves,<br />
défendent, eux aussi, des intérêts spécifiques. Tous ces intérêts sont non seulement<br />
spécifiques, mais très contradictoires. Les syndicats prennent donc une ligne de<br />
démarcation raciale : Africains d'un côté, Européens de l'autre. Dans cette période,<br />
cette forme d'organisation n'est pas caractéristique du seul domaine syndical. Elle existe<br />
aussi au plan politique et social même si l'on trouve des Européens dans la SFIO, dans<br />
le R.D.A et le B.D.S, exactement comme on trouve des Africains dans le R.P.F. Ainsi,<br />
lors de la grève des cheminots du RAN en 1947-1948, les travailleurs européens de la<br />
107
Régie s'organisent pour s'opposer à toute satisfaction des revendications des grévistes<br />
africains. Celles-ci leur apparaissaient comme une tentative de remise en cause des<br />
privilèges acquis, propres aux Européens. L'administration coloniale, en tant<br />
qu'employeur, trouve souvent intérêt, exactement comme le patronat privé, à ce que la<br />
division raciale se poursuive dans le domaine syndical car elle affaiblit les travailleurs,<br />
elle est donc une arme au service de l'employeur qui s'appuie sur les syndicats<br />
européens.<br />
Dans le rapport annuel de la Délégation de Dakar, plus précisément dans la<br />
synthèse du premier trimestre lO , c'est un véritable regret qu'exprime l'administration de<br />
la situation qu'elle appelle "lune de miel". Elle est inquiète des contacts suivis engagés<br />
entre syndicats européens et syndicats africains pour la recherche d'une certaine unité<br />
d'action. Aussi elle ne reste pas inactive; le rapport soumis à la réflexion des<br />
congressistes du SYNEP (Syndicat Unique de l'Enseignement Primaire) réunis du 21 au<br />
24 août 1950 à Saint-louis, évoque ses interventions: « Après le congrès de Dakar, les<br />
manoeuvres administratives furent tel/es que le personnel indigène et le personnel européen<br />
eurent des divergences de vue et se séparèrent. Ce n'est pas hasard que la méfiance s'est fait<br />
jour dans nos rangs et avec el/e, un mal que nous n'avons su combattre qu'en partie: le<br />
séparatisme ».<br />
Le syndicat des enseignants prend la situation très au sérieux. Le rapport dit:<br />
. «Malgré la répression qui sévit actuel/ement...l'intérêt de tous est de se côtoyer dans le même<br />
groupement. La décision ne sert que la cause de nos adversaires».<br />
Cette division raciale, le syndicat en perçoit largement les méfaits puisque<br />
dans sa partie "Analyse de la situation", le rapport continue : «L'opposition du<br />
gouvernement général aux revendications des fonctionnaires africains s'intégre dans la<br />
politique du gouvernement français» 11. Les enseignants du SYNEP ont donc une réelle<br />
conscience des difficultés d'organisation syndicale dans un contexte où l'administration<br />
coloniale et le patronat jouent la carte de la division raciale afin d'affaiblir le<br />
mouvement syndical. Dans ce sens, le rapport du SYNEP, tout en appelant à l'unité,<br />
dénonce également l'opportunisme et le favoritisme basés sur la coloration<br />
épidermique. Mieux, il réaffirme sa ferme volonté de combattre cette situation pour<br />
créer les meilleures conditions de défense de l'école par tous les intéressés, Européens<br />
comme Mricains.<br />
Pour mieux comprendre les manoeuvres de division dont il est question dans<br />
ce rapport, il faut faire un retour vers les années 1945-1950.<br />
En effet, en 1946, à Dakar, un cadre unique de l'enseignement est créé, il<br />
regroupe tous les enseignants: du moniteur auxiliaire au professeur agrégé, sans aucune<br />
distinction raciale. Ce groupement doit remédier à la faiblesse issue du fait que depuis<br />
10. Rapport annuel 1948, Délégation de Dakar, 2G 48-117, Aff polit AOF, ANS.<br />
11. "SYNEP-Lïaîson", Octobre-décembre 1950.<br />
108
1943, les syndicats se sont organisés racialement et par niveau. C'est ainsi qu'il existait<br />
un syndicat des commis expéditionnaires moniteurs, un syndicat des instituteurs des<br />
cadres secondaires, un autre des instituteurs etc... En 1948, tous ces syndicats africains se<br />
sont regroupés dans un ensemble unique, avec les syndicats européens: celui du<br />
personnel enseignant de la Délégation de Dakar. D'après les services de police et de<br />
sûreté de Dakar, l'unification résulte « de l'idée maintes fois émise par le professeur Jean<br />
Suret Canale pour la création de syndicats uniques basés sur le plan strictement corporatifet<br />
non sur des considérations d'ordre racial ou de cadre »12. De fait, le professeur J.S. Canale<br />
est l'un des principaux artisans de l'unité syndicale à Dakar pendant cette première<br />
période.<br />
En effet, les employés européens se sont organisés en syndicats séparés<br />
pendant la période immédiate d'après-guerre. Ainsi, dans les industries et bâtiments, un<br />
syndicat a été mis en place sous la direction de Pierre Chevalier. Les employés<br />
européens du commerce sont regroupés dans un autre syndicat avec Georges Boudin<br />
comme secrétaire général. Ceux de l'administration s'organisent en divers syndicats<br />
respectivement dirigés par Charles Brun et Pierre Bouvier. Quant à Jean Suret Canale,<br />
il dirige le syndicat des enseignants européens, dès son arrivée à Dakar en 1946. Cette<br />
organisation des travailleurs en une multitude de syndicats raciaux et par niveau<br />
n'empêche pas une certaine coopération. Jusqu'en 1947, ils se retrouvent tous dans un<br />
cadre plus vaste, sous une forme confédérée, dans la centrale CGT. C'est le cas de<br />
l'Union des syndicats de la circonscription de Dakar et dépendances qui regroupe les<br />
syndicats africains, dix au total.<br />
Cette union est dirigée par le vieux syndicaliste Maguette Codou Sarr qu'un<br />
rapport de l'inspection du travail en 1946 qualifie de "pondéré et conciliant". Dès la fin<br />
de 1945; il est remplacé à la tête de cette union par Amadou Lamine Diallo. Pour cette<br />
même source, ce dernier « est plus soucieux de faire de la politique que du syndicalisme<br />
»13. Il est secondé par Pape Jean Kâ dirigeant du syndicat des employés de commerce et<br />
de l'industrie que l'inspecteur du travail qualifie ainsi: «Actif, intelligent et intègre mais<br />
qui ne nous aime guère ». On note aussi parmi les responsables de cette union, Abbas<br />
Guèye14 qui passe, aux yeux de l'administration « comme une grande figure qui mène une<br />
politique de revendications qui contribue à maintenir tous les salariés en état d'alerte ». Cet<br />
homme remplace à la tête de son syndicat ouvrier, Théophile Mbaye que les ouvriers<br />
jugent trop modéré et presque inactif. Cette grande union des syndicats confédérés est<br />
un véritable état-major syndical propre à harmoniser les revendications pour mieux<br />
assurer la défense des intérêts des travailleurs de la capitale fédérale.<br />
12. Rapport 2G 48-117, Délégation de Dakar, 1948, Aff polit AOF, ANS Dakar.<br />
13. Délégation de Dakar, 1946, Rapport inspecteur du travail, 2G 45-46, Aff polit AOF, ANS, Dakar.<br />
14. Fut député du Sénégal de 1951 à 1956.<br />
109
Au niveau du Sénégal-Mauritanie, d'autres organisations syndicales et unions<br />
existent également. Tout comme au niveau de chacun des territoires. Les deux unions de<br />
syndicats (africain et européen) regroupées dans cette forme de confédération, sont<br />
dirigées par un collège de deux secrétaires généraux confédérés en l'occurrence les deux<br />
chefs de file des Africains et des Européens c'est à dire Amadou Lamine Diallo et<br />
Pierre Bouvier. Cette union se dénomme "CGT-AOF'.<br />
Face aux employés et ouvriers qui s'organisent ainsi dans la capitale fédérale<br />
et dans toute la fédération, apparaissent également, des organisations syndicales<br />
patronales. Monique Lakroum écrit à ce sujet: « Sur la pression des pouvoirs publics, les<br />
organisations professionnelles s'unifièrent et mirent en place:<br />
- le SCIMPEX: ( Syndicat des commerçants importateurs et exportateurs) au<br />
sein duquel les intérêts des groupes marseillais et bordelais étaient prédominants,<br />
- /,UNISYNDI : (Union des syndicats industriels) où les mêmes intérêts<br />
marseillais et bordelais cohabitaient avec ceux des groupes lyonnais»15.<br />
En somme, la situation d'ensemble à Dakar se présentait de la manière<br />
suivante, au plan organisationnel côté travailleurs et côté employeurs:<br />
- du côté patronal: deux unions: SCIMPEX et UNISYNDI, le tout groupant<br />
douze syndicats dans la fédération nationale du commerce ouest africain,<br />
- du côté des travailleurs: une seule union CGT comprenant cinq syndicats<br />
d'employés et ouvriers européens et dix syndicats d'employés et ouvriers africains.<br />
En somme, une situation simple mais complexe à la fois dans le domaine de<br />
l'organisation. La situation est simple dans la mesure où l'union présente pour chaque<br />
groupe, une force réelle qui rend possible une certaine coordination. La complexité de<br />
la situation réside dans ce que les bases d'un certain affrontement sont mises en place<br />
par le fait que chaque camp s'organise pour se renforcer et peser plus solidement.<br />
Pour marquer son influence sur le monde syndical dakarois, la CGT organise,<br />
en avril 1947, une grande conférence à Dakar. Celle-ci regroupe dans un premier temps,<br />
c'est à dire le 8 avril, les syndicats de Dakar et du Sénégal-Mauritanie et dans un second<br />
temps, tous les représentants des syndicats CGT d'AOF dès le 9 avril 16 . Cette initiative<br />
de la CGT est un moment fort dans la phase d'organisation des syndicats de travailleurs<br />
en AOF, et dans ce contexte global de la politique métropolitaine de reconstruction. Ses<br />
principaux objectifs consistent à permettre aux travailleurs, de dresser ensemble, et pour<br />
la première fois la liste de leurs revendications et d'étudier les moyens qui doivent<br />
permettre d'obtenir satisfaction. La F.S.M qui prête main forte à cette initiative et est<br />
fortement représentée à cette conférence syndicale panafricaine. Cette conférence ne<br />
. passe pas inaperçue aux yeux du quotidien dakarois qui dès le lendemain, affirme<br />
qu'elle fera date dans l'histoire du syndicalisme en Afrique noire. "Paris-Dakar" place<br />
15. Monique Lakroum, Chemin de fer et réseaux d'affaires, p.387, 1983.<br />
16. Falilou Diallo, Histoire du Sénégal 1944-1948, 1983, p 74.
III LA REPRESENTATMTE DES SYNDICATS.<br />
Cette donnée ne peut être appréciée à sa juste valeur qu'au regard du<br />
nombre de travailleurs salariés.<br />
Dans le cadre de cette recherche, les éléments de référence ne sont pas<br />
toujours en rapport direct avec Dakar mais ils n'en demeurent pas moins intéressants.<br />
En 1945, un rapport de l'administration donne les chiffres suivants sur la<br />
main d'oeuvre dans la capitale:<br />
- Européens: 1.080<br />
- Indigènes: 40.505<br />
Le rapport est rédigé par l'inspection du travail. Il donne pour les Européens<br />
943 ouvriers spécialisés ou employés sur les 1.080 recensés soit près de 90 % d'entre eux.<br />
Par contre, chez les indigènes, il y'a 7.463 ouvriers spécialisés et employés soit seulement<br />
17 % dans ces niveaux élevés. Tous les autres, c'est à dire 33.042, sont des manoeuvres<br />
sans qualification aucune dans leur emploi. Ils représentent près de 75 % des<br />
travailleurs indigènes à Dakar 25 .<br />
Tableau de la Fonction Publique d'AOF de 1955.<br />
Cadres % Européens % Africains<br />
Supérieurs 77,5 22,5<br />
Secondaires 70,9 29,1<br />
Subalternes 0,1 99,9<br />
Dans la fonction publique d'AOF, dans un rapport datant de 1955, on<br />
retrouve ces chiffres qui donnent une idée du niveau de qualification dans l'emploi selon<br />
que le travailleur est européen ou indigène. Les Africains représentent 22,5 % des<br />
cadres généraux à l'échelon supérieur de cette fonction publique locale. Ils sont 70,9 %<br />
des cadres secondaires à l'échelon intermédiaire. En chiffres absolus, on trouve 6.219<br />
Africains contre 8.773 Européens. Au niveau le plus bas de la hiérarchie, à l'échelon des<br />
cadres locaux, on trouve 99,9 % d'Africains; soit la quasi-totalité 26 .<br />
Dans l'armée d'AOF, également, les emplois occupés par les indigènes ne<br />
sont que des emplois subalternes. En effet, en 1955, il n'y a que 13 officiers autochtones<br />
contre 1.570 Européens 27 soit moins de 1/100.<br />
25. Rapport 2G 45-46 de la circonscription, Inspection du travail.<br />
26. R. de Benoist, Op. Cit., p. 275.<br />
27:"Afrique nouvelle" du 24 février 1954.<br />
115
TABLEAU DE LA REPARTITION DES EFFECTIFS SYNDICAUX ET<br />
SALARIES EN AOF EN 1956 (secteur public et privé)38.<br />
TERRITOIRES SALARIES SYNDIQUES %<br />
Mauritanie 4.800 1425 30<br />
Sénégal 100.300 62.600 62<br />
Soudan 41.700 17.500 42<br />
Guinée 109.400 46.000 42<br />
Côte d'Ivoire 171.000 20.000 12<br />
Haute Volta 25.500 6500 27<br />
Niger 13.735 3500 26<br />
Dahomey 22.025 18.575 83<br />
Togo 20.000 7.200 36<br />
TOTAUX 507.510 183.300 36<br />
38. Juliette Fausther, aspects du syndicalisme en Afrique noire, 1981, p.62 et Marchés tropicaux, n0645 du 22 mars 19<br />
119
TABLEAU DE LA REPRESENTATIVITE SYNDICALE EN AOF EN<br />
1956 (secteur public et privé)39<br />
Territoires Autonomes CGT CcrA CATC FO<br />
Mauritanie - 9% 39% 24 % 28%<br />
Sénégal 12 % 44% 26% 7% 11%<br />
Soudan - 83 % - 3% 14 %<br />
Guinée 6% 2% 84% 7% 1%<br />
Cte Ivoire 22% 47% 2% 25 % 4%<br />
Hte Volta 24 % 3% 32% 15 % 26%<br />
Niger 9% 40% 37% 4% 10%<br />
Dahomey 27% 33 % - 38 % 2%<br />
Togo 72% - - 28% -<br />
Ces tableaux nous indiquent que le Sénégal et le Dahomey arrivent<br />
largement en tête pour le pourcentage des syndiqués avec 62 % et 83 % par contre ce<br />
taux est le plus faible en Côte d'Ivoire avec seulement 12 % alors que par le nombre de<br />
travailleurs, la Côte d'Ivoire et la Guinée détiennent les plus gros effectifs avec 171.000<br />
et 109.400 salariés. Le Sénégal occupe le 3eme rang avec 100.300.<br />
La CGT arrive au 1er rang des effectifs syndiqués avec 33 % et la CGTA au<br />
2eme avec 32 %. Par contre, les autonomes, la CATC et F.O ont des effectifs trés<br />
réduits avec 14,5 %, 13 et 7,5 % respectivement. Pour les deux principales centrales,<br />
CGT et CGTA, on note la faiblesse particulière de la première en Guinée et en Haute<br />
Volta (2% et 3 %) alors qu'elle syndique les 83 % au Soudan, les 47 % en Côte d'Ivoire<br />
et 44 % au Sénégal. Par contre la CGT- A est très fortement représentée en Guinée, au<br />
Niger et en Haute Volta. Des considérations politico-syndicales expliquent, pour<br />
l'essentiel, cette situation.<br />
Au niveau du Sénégal, en 1956, on dénombre sur une population totale de<br />
2.269.000 habitants, l'effectif de travailleurs suivant: 101.110 dont 73.327 pour le secteur<br />
privé soit 66.951 Africains et 6.376 Européens dans ce secteur. Ces travailleurs se<br />
répartissent en 6449 entreprises publiques et privées de taille diverse.<br />
39. Ibidem.<br />
120-
que « la proportion relativement importante d'enseignants français n'est pas pour étonner si<br />
l'on tient compte du fait que le stage s'adressait à des Afn'cains de langue française »41.<br />
Cette formation met l'accent sur des éléments théoriques mais aussi pratiques. Ces<br />
derniers consistent, selon l'administration, à apprendre « comment rédiger une affiche<br />
appelant les travailleurs de l'entreprise à une assemblée générale afin de décider d'un<br />
mouvement revendicatif, comment rédiger un tract appelant les travailleurs à la grève,<br />
comment confectionner et rédiger un journal d'entreprise... ». Ce stage, dirigé par un<br />
collectif de sept membres sous la responsabilité du présidium du Conseil Central des<br />
syndicats hongrois et de la ES.M, est sous la responsabilité directe de Seydou Diallo<br />
vice président de la ES.M, chef du groupe d'études de ce stage. Sur les 38 stagiaires,<br />
l'administration dakaroise a identifié, par ses renseignements généraux, 27 des<br />
participants dont le Sénégalais Mawade Wade, instituteur 42 . Le stage comporte aussi<br />
d'autres volets comme des visites de réalisations économiques, des rencontres avec des<br />
responsables hongrois de la sécurité sociale, des milieux de jeunesse etc... Toujours en<br />
1959, un autre rapport de l'administration note qu'une école de formation a été créée à<br />
Brazzaville et qu'elle est ouverte aux délégués syndicaux d'AüF dont 18 ont pris part à<br />
la formation. Ce stage est également organisé par la F.S.M et la CGT métropolitaine.<br />
En dehors des stages à l'étranger, très souvent c'est sur place même, en AüF et<br />
principalement à Dakar, que des stages sont organisés. En avril 1947, par exemple, un<br />
stage y est fait pour les délégués CGT de toute l'Afrique noire française.<br />
Ces stages de formation sont, pour la plupart, organisés et financés, soit par<br />
la centrale métropolitaine, soit par la ES.M ou d'autres branches d'activités spécifiques.<br />
Même les billets de déplacements des participants sont pris en charge, car les syndicats<br />
d'AüFjTogo sont, en régIe générale, pauvres, au point de vue financier et matériel dans<br />
la mesure où les militants et sympathisants sont eux-mêmes assez pauvres en raison des<br />
salaires très bas qu'ils reçoivent.<br />
Bien entendu, les relations extérieures des syndicats ne sont pas vues d'un<br />
bon oeil par l'administration coloniale qui surveille tous les déplacements et ne manque<br />
aucune occasion de les rendre difficiles, si elle ne peut les interdire. C'est ainsi, que la<br />
délivrance des passeports reste, pour elle, un moyen privilégié d'intervention. Sur cette<br />
question, la bataille des organisations syndicales d'AüF, plus précisément de la CGT et<br />
des organisations syndicales autonomes, est permanente durant toute la période. C'est<br />
dans ce cadre que Amadou Ndao, instituteur, responsable syndical du S.U.E.L (Syndicat<br />
unique de l'enseignement laïc) envoie une lettre au chef de cabinet du ministre de la<br />
santé publique et de la population à Paris 43 , en décembre 1957. Dans cette missive,<br />
nous lisons: «Je vous signale par ailleurs que le comité de coordination des enseignants<br />
41. Affaires politiques AOF, ANSOM, carton 2230, dos 2.<br />
42. Il est actuellement haut dirigeant des milieux sportifs sénégalais et de la CAF (Confédération africaine de foot t<br />
43. F. H. Boigny à l'époque.<br />
122
d'ADF et le Conseil de la jeunesse m'avaient donné mandat, depuis août 1957, pour<br />
intelVenir auprès de toutes les personnalités et organisations susceptibles de faire lever le<br />
régime de restriction et de discrimination sur la délivrance des passeports »44. Une autre<br />
lettre de l'intéressé est adressée, toujours sur la même question, aux dirigeants des partis<br />
politiques et à diverses personnalités civiles et réligieuses. Dans cette lettre, le secrétaire<br />
général chargé de la propagande au Conseil de la jeunesse du Sénégal écrit: «Je vous<br />
prie de m'indiquer les démarches faites ..Avant le 26 décembre, période à laquelle le<br />
Conseil de la jeunesse du Sénégal et le syndicat de l'enseignement auront certainement à<br />
entendre des rapports sur la question des passeports, consécutive au problème des libertés<br />
démocratiques »45.<br />
Les multiples interdictions de publications syndicales en provenance de la<br />
FSM sont une autre manifestation concréte de la volonté de l'administration de rendre<br />
difficiles, sinon impossibles, les relations extérieures des organisations syndicales qu'elle<br />
ne contrôle pas. C'est ainsi que, par exemple, les services de police et de sûreté de<br />
Dakar signalent, avoir saisi dans le troisième trimestre de 1953, neuf envois de journaux<br />
et autres matériels de propagande en provenance de la F.S.M et qui sont destinés aux<br />
syndicats CGT de la capitale fédérale 46 . Durant toute la période de 1952 à 1953, les<br />
rapports de police et de sûreté signalent, avec force et détails, les multiples saisies<br />
opérées. Elles ne concernent pas seulement des journaux et matériels de propagande en<br />
provenance de la F.S.M. Divers journaux des pays du bloc de l'EST sont signalés dans<br />
ces rapports. Il y a même des saisies sur des journaux en provenance de pays arabes,<br />
comme l'Egypte ou le Liban, considérés comme proches du camp communiste. Ces<br />
saisies se fondent, pour les services de police et de sûreté, sur l'arrêté du gouverneur<br />
général de 1951. Mais, divers organes de presse saisis ne sont pas, de manière explicite,<br />
cités dans cet arrêté. Ce qui offre à la police dakaroise, une liberté d'interprétation de<br />
l'arrêté, selon les opportunités.<br />
Pourquoi donc l'administration dakaroise s'acharne t-elle à rendre difficiles,<br />
sinon impossibles les relations des organisations syndicales locales avec celles des pays<br />
et organisations du camp communiste ? Une réponse à cette question se trouve dans<br />
l'un des rapports de l'administration coloniale: « Les masses endoctrinées et nous pouvons<br />
faire, sur ce point, confiance aux Guéye Djibril et Latyr Camara, dûment dressés au delà du<br />
rideau de fer...Et il leur est facile, ces leaders marxistes, de dresser les travailleurs contre les<br />
pouvoirs publics et le patronat »47. Ces dirigeants syndicaux nommément cités ici sont de<br />
hauts responsables CGT de Dakar. Dans une autre synthèse, quelques mois plus tard,<br />
des dirigeants syndicaux CGT dakarois sont présentés, par le gouverneur, chef de la<br />
44. Archives personnelles de A. Ndéné Ndao, Dakar.<br />
45. "Jeunesse liaison", 4 eme trimestre 1957.<br />
46. Aff polit AOF, ANSOM, carton 2230, Dos 4, rapport de police et de sûreté, 2eme trimestre 1953..<br />
47. Aff polit ANS, Délégation de Dakar, Rapport du 1 er trimestre 1953.<br />
123
Délégation comme « Les fidèles exécutants des consignes marxistes, cultivant l'agitation<br />
sociale dans la fédération ». Pour l'administration, les actions hors de l'Union française,<br />
menées par les syndicats dakarois, sont un danger dès lors qu'elles sont tournées vers les<br />
pays du camp communiste. Ce danger vise le système colonial représenté par<br />
l'administration locale mais aussi le patronat tant du secteur privé que du secteur public<br />
représenté par l'administration à travers la fonction publique. Certains organes de la<br />
presse dakaroise se font fort d'appuyer cette action contre les relations des organisations<br />
syndicales locales et des pays de système communiste. C'est ainsi que "Paris-Dakar"48<br />
publie une lettre d'André Lafont, responsable des activités outre-mer de F.O à Paris.<br />
Selon la lettre, les Soviétiques, par l'intermédiaire du PCF et de la CGT ont fait<br />
parvenir 500 millions de Fr C.F.A aux responsables syndicaux d'Afrique noire pour<br />
développer l'activité syndicale dans la fédération. Cette affirmation vise à accréditer les<br />
thèses patronales et administratives dakaroises, selon lesquelles, la CGT en Afrique<br />
noire est téléguidée par le camp communiste mondial.<br />
Quant aux autres centrales syndicales comme la C.F.T.C et F.O, nos sources<br />
ne font état d'aucune entrave à leurs relations extérieures. Souvent même,<br />
l'administration dakaroise épaule largement ces organisations par les facilités accordées<br />
pour leurs déplacements à l'extérieur, ou même pour l'organisation d'écoles de<br />
formation, sur place. Il est vrai, que ces centrales syndicales en question sont affiliées à<br />
la C.I.S.L (Confédération internationale des syndicats libres), centrale internationale<br />
d'obédience américaine et mise en place pour faire contrepoids à la F.S.M detendance<br />
communiste, dans le contexte de la guerre froide. A cette époque, la politique extérieure<br />
de la métropole s'inscrit dans ce contexte global, selon les vues américaines, sur les<br />
questions tant politiques que syndicales, à cette époque.<br />
Les relations extérieures de la CGT-AüF/Togo, mal vues par<br />
l'administration et le patronat dakarois, ont parfois aussi des répercussions négatives sur<br />
le fonctionnement même de la centrale. La division syndicale intervenue après la tenue<br />
du comité de coordination de la CGT à Conakry en début 1956, s'explique, dans une<br />
certaine mesure, par la conception même de ces relations extérieures. En effet, pour la<br />
tendance CGT-A animée par Sékou Touré, il faut se désaffilier de la CGT<br />
métropolitaine et de la F.S.M. Est ce seulement par nationalisme ou par suite de<br />
pressions plus ou moins directes de ceux qui acceptent mal ces relations? Il est difficile<br />
de répondre d'un bloc.<br />
En somme, le mouvement syndical dakarois est un groupe de pression<br />
puissant dans la mesure où son organisation est solide et bien structurée. Cependant, il<br />
est en bute à l'opposition de groupes de pression contraires, eux aussi solidement<br />
48. Du 7 septembre 19<br />
124
L'objectif visé par cette initiative est d'offrir à toute la jeunesse organisée du territoire<br />
up. véritable creuset pour accroître la prise de conscience dans un cadre unitaire plus<br />
large et plus diversifiée. A cette initiative participe également le scoutisme laïc c'est à<br />
dire le mouvement des éclaireurs qui apporte aussi son poids et son expérience; ils sont<br />
d'ordre international par suite de sa participation aux jamborees qui rassemblent<br />
périodiquement des mouvements de jeunes de divers pays du monde et sont des<br />
occasions de larges échanges de vues, d'informations et de contacts.<br />
Cette initiative, venue de divers milieux particulièrement de l'église<br />
catholique aboutit, en 1950 et à Dakar, à la création du Conseil de la Jeunesse du<br />
Sénégal (C.J.S).<br />
La W.A.Y (World Assembly of Yo4h) a fortement conseillé la création de<br />
ce conseil. Les principales composantes du C.J.S sont:<br />
- le mouvement du "milieu" c'est à dire les associations et mouvements<br />
confessionnels catholiques comme:<br />
* la J.A.C : Jeunesse agricole catholique<br />
* la J.O.C : Jeunesse ouvrière catholique<br />
* la J.E.C : jeunesse étudiante catholique<br />
* la J.U.C : jeunesse universitaire catholique<br />
- le mouvement des éclaireurs<br />
- Les organisations de jeunesse des partis politiques:<br />
* la J.R.D.A: Jeunesse du R.D.A<br />
* le M.J.SFIO : Mouvement de la jeunesse de la SFIO<br />
* le M.J.B.D.S : Mouvement de la jeunesse du B.D.S<br />
- des associations culturelles comme les sociétés des spectacles, de danses et<br />
chants, de théâtre, la Jeunesse Léboue, le Cercle Artistique, le Cercle de la Jeunesse<br />
etc...<br />
- des organisations syndicales aussi.<br />
Ces associations qui se regroupent ainsi dans le c.J.S sont diverses dans la<br />
mesure où certaines ont une étendue territoriale comme celles des partis politiques, des<br />
syndicats, et celles de l'église catholique alors que d'autres n'existent qu'à Dakar ou dans<br />
quelques villes du Sénégal.<br />
Dès sa création, le C.J.S s'affilie à la W.A.Y en raison même de la nature des<br />
forces qui sont à l'origine de sa naissance: l'église et l'administration essentiellement.<br />
Mais dans les années 1951-1952, cette affiliation devient une question épineuse pour le<br />
Conseil et elle a des répercussions internationales. En effet, cette affiliation à la W.Ay<br />
est faite par l'intermédiaire d'une affiliation au Conseil de la Jeunesse de l'Union<br />
française (CJ.U.F). Cette dernière affiliation traduit une sorte d'echec d'un projet de<br />
création d'une fédération des jeunesses d'Afrique qui a été formé par certains milieux<br />
anticoloniaux locaux.<br />
127
Element affilié du C.J.U.F et de la W.AY, le Conseil de la Jeunesse du<br />
Sénégal, à l'exemple des autres conseils territoriaux de jeunesse d'AOF et d'AEF, est si<br />
actif que Dakar est désignée, deux ans après la création de ce Conseil, pour abriter les<br />
assises de la W.AY. C'est ainsi que l'assemblée générale de la W.AY se tient dans les<br />
locaux du lycée Van Vollenhoven du 3 au 13 août 1952. Le président du C.J.U.F,<br />
Antoine Lauvrence, est élu, au terme des travaux, vice-président de la W.A.Y. Cette<br />
assemblée générale de Dakar est préparée par une assemblée générale du C.J.U.F<br />
tenue à Saint-louis. Le quotidien dakarois couvre largement les travaux de Saint-louis<br />
mais aussi ceux de Dakar. Il exprime ainsi la satisfaction morale de tous ceux qui ont<br />
pris l'initiative de tenir des assises d'une telle importance sur le continent africain à<br />
Dakar, capitale de l'AOF. Cette ville prend ainsi le relais d'Ankara qui a abrité les<br />
assises précédentes.<br />
Mais depuis sa création en 1950 et son affiliation au C.J.U.F et à la W.A.Y, le<br />
C.J.S est marqué par le débat de fonds sur l'affiliation; ses répercussions sont<br />
importantes et la tenue de ces deux assemblées générales (du C.J.U.F et de la W.AY)<br />
en terre sénégalaise, en août 1952, lui donne une plus grande acuité.<br />
Abdoul Maham Bâ et Youssou Diop affirment que dès la fin de 1952, le<br />
congrès du c.J.S est marqué par une dissension intense car de nombreux délégués<br />
s'expriment ouvertement dans le sens de la désaffiliation.<br />
C'est l'existence, au niveau mondial, de deux organisations de regroupement<br />
de la jeunesse qui est au centre du débat.<br />
- la W.A.Y regroupant des organisations de jeunesse des pays du camp<br />
occidental dont le C.J.U.F. Cette organisation internationale de jeunesse est<br />
essentiellement d'obédience américaine dans ce contexte des années 50 marquées par la<br />
guerre froide.<br />
- La F.M.J.D : (fédération mondiale de la jeunesse démocratique). Elle<br />
regroupe les jeunesses des pays communistes et les organisations progressistes de<br />
certains pays capitalistes et de pays sous domination coloniale.<br />
1952 et 1953.<br />
W.A.Y ou F.M.J.D, est donc le débat qui agite sérieusement le C.J.S entre<br />
Lorsque du 18 au 28 août 1953, le C.J.U.F tient ses assises à Yaoundé au<br />
Cameroun, le Conseil de la Jeunesse du Sénégal est absent à ce congrès ainsi que celui<br />
du Soudan. La raison en est qu'entre les assises de Dakar en 1952 et celle de Yaoundé,<br />
le débat est pratiquement clos car le congrès du c.J.S a opté pour une désaffiliation<br />
totale tant à l'égard du C.J.U.F que de la W.AY.<br />
Le rapport moral présenté au congrès du C.J.S en novembre 1955, à Kaolack<br />
explique que cette désaffiliation va permettre au Conseil de s'ouvrir à tous les jeunes du<br />
Sénégal; il s'exprime en ces termes : « L'unique but et art de regrouper tous les jeunes car,<br />
en raison de cette situation de dépendance à l'égard du CJ. u.F, beaucoup d'associations
s'étaient tenues à l'égard du Conseil »2. Il montre, en données chiffrées, que la décision de<br />
désaffiliation est salutaire pour l'organisation. Alors que neuf associations seulement se<br />
retrouvent dans le Conseil en 1951, le 1 er congrès après la désaffiliation, celui de 1953,<br />
voit 40 organisations, devenir membres du CJ.S. Le congrès de Thiès, l'année suivante,<br />
compte 68 associations qui y envoyent des délégués. A celui de Kaolak, en 1955, 80<br />
associations sont présentes. Déjà, en 1954, le rapport présenté par le président Ali Bocar<br />
Kane se félicite de la progression remarquable. Prenant en considération cette<br />
progression devenue plus marquante aux assises de 1956, le rapporteur s'exprime ainsi:<br />
« Le congrès peut valablement parler au nom de toute la jeunesse du Sénégal ».<br />
y oussou Diop, secrétaire général du CJ.S pendant près d'une décennie,<br />
explique qu'à partir de 1955, la quasi totalité des associations de jeunesse du Sénégal se<br />
retrouvent dans le Conseil qui offre des avantages très importants en matière de<br />
contacts et d'échanges d'expériences.<br />
L'organisation du Conseil<br />
L'organisation du Conseil est simple dans l'ensemble. Ce sont les sections qui<br />
constituent l'organisation. Chaque section, organisation géographique correspondant au<br />
cercle (entité administrative), regroupe les diverses associations de son aire. Dans les<br />
sections, les associations gardent chacune leur autonomie propre. C'est ainsi que, le<br />
Progrès de Dakar tient le samedi 19 février 1955, son propre congrès, à son siège social,<br />
à la rue 6 dans la Médina. Le congrès du Conseil est annuel depuis sa création en 1950.<br />
C'est ainsi qu'en 1954, les assises se tiennent à Thiès, puis à Kaolak en 1955 et à<br />
Rufisque en 1956. Le congrès de 1957 se déroule à Rufisque et celui de 1958 à Dakar.<br />
Le souci de faire découvrir le pays aux jeunes s'explique par ces assises tournantes.<br />
Chaque congrès élit le Comité exécutif qui élit à son tour et en son sein un bureau<br />
éxécutif. Le comité éxécutif se compose de trente membres et le bureau de douze. Le<br />
congrès de Kaolak en 1955, porte à la présidence du Conseil, Abdoul Maham Bâ.<br />
y oussou Diop est confirmé au secrétariat général tandis que Alioune Badara Paye est<br />
élu aux relations extérieures et Adrien Senghor devient trésorier. Les membres cités<br />
sont tous de Dakar et ils occupent des postes-clef dans l'organe exécutif du C.J.S. On est<br />
tenté d'en déduire que c'est le poids de la section de Dakar au congrès qui explique<br />
cette situation. Mais, interrogé sur ce point, Youssou Diop est formel. Pour lui, ces choix<br />
n'ont rien à voir avec le poids spécifique de Dakar dans les mandats des délégués au<br />
congrès mais ce sont «Seulement les appréciations que se faisaient les différents délégués,<br />
sur tel ou tel individu, pour lui confier telle ou telle tâche. Aucunement à cause du poids de<br />
la capitale dans les votes ». On remarque également que les instances du Conseil de la<br />
2. "Jeunesse-liaison", NU spécial sur congrès de Kaolack, 1955.<br />
129
Jeunesse d'Afrique, en 1955, comptent surtout, elles aussi, des Dakarois : président,<br />
secrétaire général, secrétaire administratif, secrétaire aux relations extérieures et<br />
trésorier. Pour l'essentiel, ce sont les mêmes personnes qui déjà, sont responsables au<br />
bureau exécutif du Conseil de la Jeunesse du Sénégal.<br />
Peut être que la raison de ces choix n'est pas le poids électoral de Dakar dans<br />
les instances, mais incontestablement, cet aspect n'est pas négligeable en la<br />
circonstance.<br />
Bien sûr qu'il faut prendre en considération les immenses moyens dont<br />
dispose la ville de Dakar : ils facilitent le déploiement d'activités d'un Conseil, qu'il<br />
s'agisse de celui du Sénégal ou de celui d'Afrique: moyens de contacts, d'informations,<br />
de communications etc.,. sans oublier que Dakar est la capitale fédérale et que, pour<br />
cela, les autorités les plus importantes de la Fédération s'y trouvent.<br />
11/ LES RELATIONS DU CJ.s.<br />
1) avec l'administration coloniale.<br />
Pour l'essentiel, elles furent mauvaises durant toute la décennie.<br />
A travers la plate-forme revendicative soumise au Haussaire de Dakar lors<br />
de l'audience qu'il a accordée au C.J.S en juin 1955, nous retrouvons l'essentiel du<br />
contentieux.<br />
Cette plate forme s'articule en 7 points:<br />
* point 1 : le remplacement des centres culturels par des maisons de jeunes et<br />
de la culture.<br />
* point 2 : l'abrogation de l'arrêté de 1942 plaçant le service de la jeunesse<br />
sous la tutelle du bureau des affaires politiques et son rattachement au service de<br />
l'enseignement comme en France.<br />
* point 3 : création de deux centres fédéraux d'éducation populaire, l'un à<br />
Mbour au Sénégal, l'autre à Labé en Guinée.<br />
* point 4 : octroi de crédits suffisants pour la construction de la maison des<br />
jeunes et de la culture à Saint-louis.<br />
* point 5 : octroi de crédits suffisants au service de la jeunesse pour organiser<br />
des camps de colonies de vacances.<br />
* point 6 : délivrance de passeports pour nos délégués au festival de la<br />
jeunesse à Varsovie.<br />
* point 7 : autorisation de tenir le congrès fédéral de Bamako et envoi de<br />
jeunes en France pour un stage dans des maisons de jeunes et de la culture 3 ,<br />
3. Congrès du Cl.S, Rapport moral, Kaolack 1955.<br />
130
Dans toute cette plate-forme, deux points permettent d'expliquer tous les<br />
autres et partant, toutes les relations entre le Conseil et l'administration. Ce sont les<br />
points 1 et 6.<br />
a) : le point 1 : les centres culturels ou maisons de jeunes et de la culture?<br />
Il ne s'agit nullement d'une querelle de mots. C'est un débat de fond. De<br />
1953 à 1960, ce débat est l'une des principales pierres d'achoppement entre le C.J.S et<br />
l'administration. De quoi s'agit-il ?<br />
Le 14 mars 1953, Bernard Cornut Gentille, gouverneur général de l'AOF,<br />
signe la circulaire 159/ cab/AS qu'il adresse aux divers gouverneurs placés sous ses<br />
ordres. Le texte est important pour le Haussaire de Dakar car, en l'espace d'un an ,<br />
quatre fois de suite, il envoie à ses subordonnés des circulaires pour l'application de ce<br />
texte du 14 mars qui impose aux gouverneurs des territoires de construire, dans les<br />
principales villes, des lieux où élites africaines et européennes pouront se retrouver et<br />
échanger des vues et, par cette confrontation pacifique, mieux se connaître, s'apprécier<br />
et travailler davantage ensemble à la consolidation de l'oeuvre française en AOF. Ces<br />
lieux de rencontres sont appelés les centres culturels.<br />
Autant l'administration coloniale est favorable à ces centres culturels, autant<br />
le C.J.S leur était hostile. Le rapport du Conseil au congrès de Kaolack en 1955<br />
s'exprime en ces termes: « Le comité exécutif avait condamné le système...Malgré nos<br />
arlic1es, nos motions, nos pétitions, nos meetings et conférences, le service social avait fait la<br />
sourde oreille et développé partout au Sénégal et dans la fédération, les centres culturels ». A<br />
la place des centres culturels, le C.J.S demande des maisons de jeunes et de la culture.<br />
Quelle est donc la différence entre les deux ?<br />
Les centres culturels sont rapidement édifiés car en l'espace de deux ans, on<br />
en dénombre 117 à travers la fédération, ce qui prouve que d'importants moyens sont<br />
débloqués.<br />
L'une des quatre circulaires que le Haussaire consacre à la question, celle du<br />
23 février 1954, concerne leur fonctionnement même. Selon cette circulaire, ces centres<br />
dépendent directement du cabinet du gouverneur général au niveau fédéral et pour le<br />
territoire, la coordination est du ressort exclusif du gouverneur alors que les<br />
commandants de cercles sont responsables au niveau de leurs divisions administratives.<br />
Dans une autre circulaire, le Haussaire dakarois écrit: « Vous savez toute l'attention que<br />
je porte aux problèmes de la fonnation et du développement des élites autochtones.<br />
J'entends contribuer efficacement à leur épanouissement par l'appui solide que doivent
* Les maisons de jeunes et de la culture<br />
Cette forme d'organisation de la culture, au niveau des jeunes, est connue<br />
dans divers milieux, en AOF avant la deuxième guerre mondiale car elle existe en<br />
métropole et dans les premières années de l'après-guerre, l'église dakaroise prend<br />
diverses initiatives pour son développement au Sénégal.<br />
Youssou Diop dit : « Avant 1955, nous étions en relation avec une autre<br />
institution qui nous paraissait plus démocratique, et beaucoup plus adaptée aux besoins des<br />
jeunes: les maisons de jeunes dont le siège se trouvait à Neuilly à Paris, et avec lequel siège<br />
nous avions des relations suivies»8.<br />
D'après cet interlocuteur, une maison des jeunes et de la culture existe à<br />
Dakar dès 1948. Un formateur envoyé par le siège de l'institution de Paris, a permis de<br />
lancer des activités intéressantes. Un Sénégalais, Amadou Diop Sylla, son adjoint, part<br />
en formation en France pour être en mesure de prendre, par la suite, la direction de la<br />
maison des jeunes de Dakar. D'autres villes' du Sénégal comme Thiès et Kaolak se<br />
familiarisent, plus tard, avec l'expérience, après Saint-louis.<br />
Pourquoi ces maisons de jeunes et de la culture ont-elles donc les faveurs du<br />
Cl.S au détriment des centres culturels?<br />
Sur le plan organisationnel, ces maisons de jeunes ont des dirigeants élus par<br />
les jeunes eux mêmes à la différence de ceux des centres culturels qui sont désignés par<br />
les commandants de cercles auxquels ils sont tenus de rendre compte. Au contraire,<br />
dans les maisons de jeunes, les directions rendent des comptes aux assemblées qui les<br />
ont élues.<br />
La différence entre les deux formes de structure est donc énorme puisque<br />
c'est celui qui conçoit et contrôle en amont et en aval qui est le maître véritable; dans<br />
les centres culturels, c'est incontestablement l'administration et les jeunes n'y sont<br />
qu'objet. Par contre, dans les maisons de jeunes, les jeunes sont les exécutants de ce<br />
qu'ils ont décidé; ils sont donc les maîtres. C'est cette dernière situation que le Cl.S<br />
préfère et réclame.<br />
L'opposition entre les autorités administratives et le Cl.S sur cette question<br />
fondamentale explique que, pendant la période 1953-1958, les maisons de jeunes ne<br />
peuvent se développer au Sénégal, l'administration détentrice des moyens matériels et<br />
financiers donnant la priorité absolue à ses centres culturels. Ainsi pour Dakar, la<br />
maison des jeunes et de la culture attend longuement la fin de son édification, après le<br />
début des travaux. Les crédits nécessaires à son achèvement sont régulièrement reportés<br />
d'un budget à un autre 9 .<br />
8. Entretien du 24 janvier 1989 à Dakar.<br />
9. "Reveil" nO 9, Mars 1954.<br />
133
Cependant, après 1958, le gouvernement de la loi-cadre se prononce en<br />
faveur des maisons de jeunes et de la culture. Mais très vite, les nouvelles autorités se<br />
comportent comme l'administration coloniale et agissent par la caporalisation qui n'est<br />
pas davantage acceptée par le CJ.S.<br />
b) : Le point 6 de la plate-forme: la question des passeports.<br />
C'est un problème très important pour le CJ.S puisque, de 1950 à 1958, il est<br />
débattu à tous les congrès de l'organisation de jeunesse. Il en fut de même pour le<br />
Conseil de la Jeunesse d'Afrique. Hors d'AOF également, cette question fait l'objet de<br />
plusieurs démarches et interventions de la FEANF qui appuie la revendication du C.J.S<br />
et du CJ.A.<br />
Cette question des passeports pose un problème fondamental : celui de la<br />
liberté de déplacement des responsables de l'organisation hors des frontières de l'ADF.<br />
Elle est appréciée comme tel par la commission de réorganisation et du programme du<br />
4 ème congrès du c.J.S, tenu à Rufisque du 23 au 25 novembre 1956 : « Mais il est un<br />
problème qui revient chaque fois que nous voulons aller à l'étranger: c'est le problème des<br />
passeports. Il nous faut le résoudre une fois pour toutes. Il ne nous a causé que trop de mal<br />
»10. Pour faire face à cette situation, la commission propose au congrès qui l'adopte, une<br />
véritable stratégie par le lancement d'une vaste campagne d'opinion, en prenant acte: «<br />
de la carence de nos associations en matière de presse ». La résolution finale adoptée par<br />
le congrès à l'unanimité dit: «Le congrès, considérant la nécessité pour les jeunes de visiter<br />
des pays étrangers pour bénéficier de leur expérience et accélérer la fonnation des cadres<br />
aptes à diriger et à animer des mouvements de jeunesse.<br />
Considérant l'intérêt que les organisations internationales portent de plus en plus<br />
au C.IS à cause de sa représentativité<br />
Considérant l'impérieux devoir du Conseil de participer aux différentes instances<br />
de jeunes auxquelles il est invité<br />
Remarque avec indignation la discrimination qui joue dans l'octroi des<br />
passeports<br />
S'élève contre cette restriction des libertés démocratiques ».<br />
La campagne d'opinion que le Cl.S décide pendant ces assises, comprend<br />
une série d'actions concrètes, tels ce meeting et cette marche de protestation à la date<br />
du 7 janvier 1957. Le meeting est tenu au cinéma Empire de la Médina à Dakar. Divers<br />
orateurs y prennent la parole; ils dénoncent les multiples atteintes aux libertés<br />
fondamentales des jeunes et leurs auteurs, notamment le Haut Commissaire de l'ADF<br />
"stratège des anti-libertés" comme dit l'un des intervenants. Ce meeting, massivement<br />
10. "Jeunesse-liaison", janvier 1957.<br />
13-4
de la jeunesse fédérale d'AOF d'autre part était, en même temps, membre du comité<br />
exécutif du RP.S, le parti de Senghor né en 1956 de la réunification de diverses<br />
formations sénégalaises. Refuser cette démarche demandée par Ali Bocar Kane aurait<br />
été un risque politique pour le député du Sénégal. Pour nos interlocuteurs, ce n'est donc<br />
pas par sympathie particulière pour le C.J.S que Senghor a agi en sa faveur. Au<br />
contraire, à diverses reprises déjà, il avait exprimé son mécontentement consécutif à la<br />
désaffiliation du C.J.S du C.J.U.F. De ceci, le quotidien "Paris-Dakar" s'était déjà fait<br />
l'écho en rapportant des propos tenus par l'homme politique sénégalais. A la tribune du<br />
congrès du Cl.U.F, à Tananarive, le 11 août 1955, il dit: « Les problèmes de la jeunesse<br />
sont un des soucis majeurs du gouvernement. Le gouvernement ne croît ni aux états<br />
généraux, rassemblements et autres soviets avec uniformes et orphéons. Il ne croît ni aux<br />
festivals, ni aux voyages touristiques ». Plus loin dans ce discours, il lance à l'adresse des<br />
délégués: «Je n'aipu que me réjouir, en lisant vos statuts, et votre programme d'action, de<br />
constater que le Cl U.F travaille en communion avec le gouvernement »16. Déjà, à<br />
Yaoundé, en 1953, Senghor a fustigé ceux qui s'opposent au Cl.U.F. A Accra, au<br />
congrès panafricain de la jeunesse, il n'est pas tendre à l'égard de ceux qui prennent<br />
leurs distances à l'égard du C.J.U.F. Ces divers propos ne peuvent pas ne pas s'adresser<br />
au C.J.S et au Cl.A même si Senghor n'en cite pas les noms.<br />
En tout état de cause, la démarche du député du Sénégal pour la libération<br />
des jeunes arrêtés à l'occasion de la marche de protestation relative aux passeports n'eut<br />
aucune suite heureuse pour régler définitivement cette question. Si à cette période, c'est<br />
à dire sept à huit mois, après la mise en place du gouvernement Mamadou Dia, le<br />
problème de la délivrance des passeports se pose toujours, c'est qu'elle ne rentre pas<br />
dans le domaine de compétence des autorités nouvelles issues de la Loi-Cadre. Ceci est<br />
d'autant plus vrai que, dès le 18 juillet 1957, le gouvernement du Sénégal, par la voix de<br />
son ministre de l'éducation et de la culture, assure le CJ.S, de son appui total à cette<br />
revendication, exactement comme l'Assemblée Territoriale par la voix de son<br />
représentant; ceci se fait lors de la réunion de la commission territoriale de la jeunesse.<br />
La campagne d'opinion que le congrès de 1956 décide autour de la question<br />
des passeports, prévoit une sensibilisation des autorités diverses par des<br />
correspondances. Ceci explique les lettres adressées par le bureau exécutif du C.J.S à<br />
Houphouët Boigny ministre du gouvernement français, au ministre de l'intérieur du<br />
Sénégal, au chef de service de police du Sénégal, au gouverneur du Sénégal etc...<br />
Il est à remarquer que le refus de délivrance des passeports au C.J.S n'a pas<br />
été appliqué par l'administration avec la même rigueur au long de la période 1950-1958.<br />
En effet, dans le rapport moral soumis aux délégués au congrès annuel de 1955 du C.J.S,<br />
il est fait état d'un « acte vraiment sensationnel de l'administration car, après évidemment<br />
16. "Paris-Dakar" du 21 novembre 1955.<br />
136
ien des démarches, nous avons pu obtenir des passeports pour nos sept délégués ». Le<br />
rapport ajoute même que ces délégués ont pu effectivement sortir pour accomplir la<br />
mission qui leur est confiée par le C.l.S.<br />
Cette attitude est peut être simplement une tactique de la part de<br />
l'administration. En effet, un fait significatif, aux yeux du congrès de la jeunesse, est le<br />
comportement de la police dakaroise au retour des festivaliers pour lesquels des<br />
passeports ont été délivrés. Dans les premiers jours du mois d'août 1955, en pleine nuit,<br />
la police opére, simultanément, des perquisitions aux domiciliés des festivaliers. Le<br />
journal "Reveil" publie une photographie de la dame Fatou Mbengue, grand mère du<br />
festivalier Samba Taminou secrétaire administratif du C.l.S. L'article accompagnant la<br />
photographie a pour titre" Une victime de plus des colonialistes ". Il relate le meeting<br />
de protestation organisé à Dakar, le Il août, à la place de Mboth par le Conseil de la<br />
jeunesse et les centrales syndicales au sujet de la mort de cette dame de quatre vingt<br />
ans. La vieille Fatou Mbengue s'est brusquement réveillée, aux bruits faits par les<br />
policiers perquisitionnant dans sa chambre, sa surprise voir des hommes en uniforme<br />
chez elle en pleine nuit, est si grande qu'elle s'évanouit immédiatement et meurt. Les<br />
policiers ne se soucient nullement d'elle et continuent tranquillement leur perquisition.<br />
Cette mort soulève une vive indignation dans tous les quartiers indigènes de la ville. Dès<br />
le 4 août, un tract, distribué dans ces milieux, appelle à manifester contre cette action de<br />
la police dakaroise. Le congrès de Kaolack marque une « minute de silence à la mémoire<br />
de la vieille Fatou Mbengue...décès qui a profondément indigné toute la population<br />
dakaroise ». Le rapport retrace les diverses initiatives du bureau exécutif du Conseil<br />
pour stigmatiser, auprès des autorités dakaroises, cette perquisition inqualifiable.<br />
A travers ces deux points, centres culturels ou maisons de jeunes et de la<br />
culture d'un côté et délivrance des passeports de l'autre, un long et épineux conflit se<br />
manifeste entre l'administration coloniale et le Conseil de la jeunesse. La permanence<br />
du conflit impose la recherche des véritables raisons de l'affrontement.<br />
3) Les raisons du conflit.<br />
Elles sont principalement au nombre de deux: la désaffiliation du C.J.S du<br />
C.l.U.F et de la W.Ay et les attaques des jeunesses S.F.I.O et B.D.S, pourtant<br />
membres, contre le Conseil.<br />
a): la désaffiliation<br />
Dès sa naissance, le C.l.S est affilié au C.J.U.F et partant à la W.A.Y. Mais à<br />
cette époque, l'essentiel des troupes du Conseil dépendent de l'église dakaroise qui joue<br />
un rôle non négligeable dans sa gestation. Ensuite, cette situation pose des problèmes en<br />
137
par une sortie du C.J.S de sa dépendance à l'égard du C.J.U.F et de la W.A.Y mais<br />
aussi par une non affiliation à la F.M.J.D.<br />
Donc, la l.R.D.A et le mouvement des éclaireurs, tous deux membres du<br />
C.J.S, ont, avec d'autres associations moins importantes, des positions communes pour la<br />
défense de l'indépendance de l'organisation regroupant la jeunesse territoriale. Le débat<br />
est ainsi largement ouvert au sein du C.J.S entre 1951 et 1953, d'autant plus que<br />
l'assemblée mondiale de la W.A.y et l'assemblée du C.J.U.F ont lieu au Sénégal en<br />
début d'août 1952, comme pour signifier l'intérêt que portent ces organisations du camp<br />
occidental au Conseil de la Jeunesse du Sénégal qui vient de naître. Lorsque le c.J.S<br />
décide, fin 1952, de ne plus dépendre de ces organisations, c'est un coup dur qui est<br />
porté à la politique coloniale en matière de jeunesse, d'autant plus rude que le Sénégal<br />
est considèrè par la métropole comme son fils aîné en Afrique noire. L'administration<br />
coloniale ne pardonne pas cet abandon au C.J.S d'autant moins qu'il réussit à entraîner<br />
le Conseil de la Jeunesse du Soudan dans sa quête d'indépendance.<br />
L'absence des jeunesses des territoires du Soudan et du Sénégal aux assises<br />
du C.l.U F à Yaoundé en 1953 et à Tananarive en 1955 n'est pas acceptée par<br />
l'administration coloniale. En ce sens, on peut comprendre que lorsque L.S. Senghor,<br />
invité d'honneur à Yaoundé et ministre du gouvernement français à Tananarive, fustige<br />
ceux qui refusent la politique du gouvernement métropolitain en matière de jeunesse; il<br />
pense bien sûr, avant tout, aux jeunesses du Sénégal et du Soudan. Sa position de député<br />
du Sénégal, donne davantage de poids à la hargne qu'il manifeste dans les discours qu'il<br />
prononce lors de ces manifestations du C.J.U.F.<br />
b): les attaques des jeunesses SFIO et B.D.S contre le c.JS.<br />
Ces attaques qui se conjuguent avec celles de toutes les forces hostiles au<br />
Conseil apportent à l'administration coloniale des appuis solides à son attitude négative<br />
à l'égard de l'organisation de jeunesse, d'autant plus que ces deux mouvements de<br />
jeunesse de parti politique sont également membres du C.J.S.<br />
Après le congrès de Kaolack en 1955, le C.J.S s'est doté d'une nouvelle<br />
direction, élue conformément à ses statuts. Dès les lendemains du congrès, le quotidien<br />
"Paris-Dakar" ouvre largement ses colonnes, à des responsables des jeunesses SFIO et<br />
B.D.S qui attaquent le Conseil. C'est un certain Massar qui monte, le premier, au<br />
créneau contre le Conseil « Ce sont les dissidents moscoutaires du RDA, à tendance<br />
communiste, qui contrôlent désonnais les mouvements de jeunesse »18. L'auteur de<br />
l'article passe en revue un certain nombre de postes au sein du bureau du Conseil avec<br />
des remarques relatives à l'appartenance politique des titulaires. Il arrive à la conclusion<br />
18. "Paris-Dakar" du 19 novembre 1955.<br />
139
qu'un bureau dont le président, les premier et deuxième vice-présidents, le trésorier et<br />
le secrétaire chargé des relations extérieures, appartiennent tous à un parti politique par<br />
son organisation de jeunesse interposée, un tel bureau apporte la preuve que les<br />
hommes de Moscou contrôlent le Cl.S. "Paris-Dakar" ne précise pas si Massar,<br />
signataire de l'article en question, est d'une organisation politique donnée. Il est<br />
simplement présenté comme un "certain Massar".<br />
Dès le lendemain, le journal officieux dakarois consacre un autre article à la<br />
question. Cette fois, l'auteur de l'article est un délégué de la jeunesse SFIO. Le titre "A<br />
son tour le délégué des jeunesses socialistes nous parle du congrès de Kaolack". L'auteur<br />
écrit: « C'est un échec profond... Sur les centaines que comporte le pays... Que 56 petites<br />
associations qui ne totalisent pas plus de 3.000 adhérents... Y étaient représentées ». Il met<br />
l'accent sur le fait que les jeunesses SFIO et B.D.S, tout comme celle de l'église,<br />
totalisent, elles, plusieurs milliers d'adhérents chacune.<br />
Dès le sur lendemain, "Paris-Dakar", encore, s'ouvre à une plume attaquant<br />
le Cl.S, c'est celle de Mamadou Alcaly Diouf, pharmacien installé à Dakar en sa qualité<br />
de secrétaire général du mouvement des jeunes du RD.S. Cet article est encore plus<br />
virulent contre le C.J.S : «En vérité, comme l'explique la composition du bureau du CJ.S,<br />
il y'a une victoire U.D.S-RIDA... Minorité par rapport aux autres mouvements de jeunesse<br />
»19. Il explique plus loin comment la jeunesse de l'U.D.S a pu arriver à ce résultat de« 6<br />
RIDA et RDA sympathisants communistes sur un bureau exécutif de douze membres ».<br />
Pour lui, la R.l.D.A a fait preuve d'une tactique sans bavure et aussi d'une maturité au<br />
milieu d'une "racaille" de "grandes gueules" vides de bon sens. Mamadou Alcaly Diouf<br />
ajoute: « Un mouvement comme le nôtre, le plus puissant des mouvements de jeunesse du<br />
territoire n'a pas pu avoir de représentant à la direction du CJ.S ».<br />
Un autre organe dakarois, les "Echos d'Afrique Noire", vient ajouter sa voix à<br />
ces attaques contre le C.J.S en appelant l'église à sortir ses associations d'un Conseil<br />
dominé par les communistes.<br />
Attaques orchestrées ou simplement conjonction?<br />
Les liaisons entre l'administration coloniale et la direction du quotidien<br />
dakarois sont trop étroites et trop évidentes pour qu'on puisse penser à une simple<br />
conjonction. Surtout lorsque l'organe des "petits colons" dakarois, les "Echos d'Afrique<br />
noire", s'engage dans la même voie que "Paris-Dakar".<br />
Il est certain que ces attaques posent, par rapport aux normes démocratiques,<br />
des problèmes très sérieux sur le fonctionnement du C.J.S.<br />
Mieux, elles nient même toute représentativité au CJ.S, tout comme elles<br />
posent aussi des questions de même nature pour les organisations politiques de jeunesse<br />
: SFIO et B.D.S.<br />
19. "Paris-Dakar" du 20 novembre 1955.<br />
140
conseil fédéral, b/ entretenir, après avis du comité exécutif, des relations avec des<br />
organisations nationales ou internationales».<br />
Ajoutons aussi que, non seulement le CJ.S proclame son indépendance à<br />
l'égard des organisations comme le C.J.U.F et la W.A.Y, mais il entraîne dans cette<br />
attitude, le Conseil soudanais et plus tard tous les autres territoires dont les Conseils<br />
constituent le C.J.A (Conseil de la Jeunesse d'Afrique) à partir des assises de Bamako<br />
en 1955. Le Conseil fédéral inscrit son orientation dans la même ligne que celle du<br />
Conseil sénégalais : une ligne de refus de caporalisation dans le cadre des centres<br />
culturels, et la dénonciation de tous les maux déjà repertoriés par le CJ.S. Les<br />
résolutions adoptées par le congrès constitutif du CJ.A dénoncent la politique coloniale<br />
comme étant la grande responsable de la progression de l'alcoolisation en AOF, des<br />
films de qualité médiocres et néfastes sur les écrans, des enfants jetés dans la rue par<br />
manque de places dans les écoles, des centres culturels éléments de diversion, de la<br />
guerre colonialiste menée contre l'UPC au Cameroun et contre le F.L.N en Algérie<br />
etc... Le deuxième congrès du C.J.A et le premier festival qu'il organise à Abidjan, en<br />
1957, confirment cette ligne du Conseil fédéral dans son orientation. Sa résolution<br />
générale proclame: « Le seul moyen de libérer totalement les peuples opprimés d'Afrique<br />
est la lutte pour l'indépendance nationale».<br />
A toutes ces raisons internes de conflit entre l'administration et le C.J.S,<br />
s'ajoutent les répercussions des relations internationales. En effet, à diverses reprises,<br />
les hautes autorités dakaroises reçoivent de divers pays et de la FMJD, télégrammes,<br />
motions et lettres qui protestent contre le refus de sortie des délégués du C.J.S et du<br />
C.J.A, par la non délivrance de leurs passeports par l'autorité coloniale.<br />
En somme, dans la période 1950-1960, c'est une très rude et très longue<br />
empoignade qui caractèrise les relations entre le Conseil de la Jeunesse du Sénégal et<br />
les autorités de l'administration coloniale. L'origine de ces relations difficiles, est le<br />
refus que la jeunesse oppose à l'embrigadement que tentent de lui faire subir les<br />
autorités. Cette jeunesse proclame, haut et fort, son indépendance. Par là même, la<br />
jeunesse sénégalaise et la jeunesse d'Afrique œ,Mr-ique, réunies dans le C.J.S et le C.J.A,<br />
l<br />
expriment leur rejet du système colonial. Cette décennie apporte les preuves de la<br />
constance du C.J.S dans son orientation.<br />
142
La progression moyenne annuelle est de 30,7 %. Cependant, les effectifs<br />
n'ont pas été en accroissement constant car en une décennie, on note trois diminutions :<br />
21 % en 1952/1953, 6 % en 1954/1955 et 2,3 % en 1959/1960. La première est<br />
relativement importante: 21 % alors que les autres le sont moins.<br />
Les progressions de 1953/1954 (104 %), de 1955/1956 (35 %) et de<br />
1957/1958 (83 %) sont importantes. La transformation de l'Institut en Université en<br />
1957 explique celle de 1957/1958; nous ne pouvons pas avancer de raison pour les deux<br />
autres, ni pour les trois diminutions.<br />
On remarque que depuis sa création, c'est vers l'école de droit que l'autorité<br />
coloniale a surtout orienté les étudiants. L'école de lettres, jusqu'en 1957, possède les<br />
effectifs les plus faibles car elle arrive seulement en dernière position derrière le droit,<br />
les sciences et la médecine. Mais, dans les trois dernières années, cette école de lettres<br />
connait une réelle progression de ses effectifs pour passer à la deuxième position après<br />
le droit. Au sujet de la répartition raciale des étudiants, Mahjmout Diop indique pour<br />
l'année 1957-58, que sur un total de 1069 étudiants, 368 sont des Français et 628 des<br />
Africains pour 3 étrangers seulement. Sur le même sujet, Roland Colin écrit que les<br />
étudiants métropolitains constituent le tiers des effectifs d'ensemble. Le nombre des<br />
étudiantes africaines est insignifiant puisqu'elles ne sont que 12 sur un total de 310<br />
d'origine africaine pendant l'année universitaire 1955-1956. Il y a néanmoins une<br />
progression numérique car, en 1953, on compte seulement 3 étudiantes africaines pour<br />
80 garçons 8 . L'auteur de l'artic1è, intitulé "Jeunes filles africaines et l'enseignement",<br />
Papa Soulèye Ndiaye, constate que ce n'est pas là une caractéristique propre à l'Institut<br />
car le mal est général. Il conclue qu'il existe une véritable marginalisation de la jeune<br />
fille africaine.<br />
11/ LES ORGANISATIONS ESTUDIANTINES.<br />
Roland Colin écrit : « A l'origine, il n 'y avait qu'une seule association<br />
d'étudiants, l'AGED (Association Générale des Etudiants de Dakar) au sein de laquelle les<br />
étudiants africains étaient naturellement en majorité. La présidence en avait été confiée à<br />
un Européen dont la négligence et l'insuffiSance aboutirent à l'éjection virtuelle de tous les<br />
étudiants blancs».<br />
Citant toujours cette enquête menée à Dakar et dont il rapporte les résultats,<br />
Roland Colin ajoute : « Ceux-ci se regroupèrent à part et formèrent l'association<br />
générale des étudiants français en Afrique noire : AGEFAN »9. Cette division des<br />
étudiants de l'Institut, sur une base raciale est confirmée par "AGE-Presse", organe des<br />
étudiants français de Dakar lorsqu'il écrit : « D'autre part, lorsque nous nous sommes<br />
8. "Dakar Etudiant", NU 1, Janvier 1953.<br />
9. Roland Colin, Systèmes d'éducation... 1977, p. 421.
egroupés au sein de l'AGEFAN, la situation était claire. Nous venions d'être exclus<br />
publiquement, en assemblée générale, où le président de l'AGED, Diané Charles, déclara: "<br />
Quant au cas des camarades européens, il n'est pas à discuter: ils sont exclus d'office"jO.<br />
Ceci se passe en novembre 1955. Dès lors, deux associations corporatives existent sur le<br />
campus universitaire de Dakar-Fann, elles sont organisées sur des bases raciales. Leur<br />
développement se fait par la suite, dans le cadre d'une véritable rivalité dont les<br />
manifestations frisent parfois la violence.<br />
Les associations religieuses apparaissent après les associations corporatives.<br />
La première d'entre elles est celle des étudiants catholiques; puis, une association<br />
musulmane se crée en juillet 1956. Des associations politiques voient le jour à l'IHED; il<br />
s'agit de l'A.E.R.D.A (Association des étudiants du R.D.A) et du M.E.P.A.I<br />
(Mouvement des Etudiants du P.A.I).<br />
L'étude de ces associations montre l'intérêt particulier de la connaissance de<br />
l'AGED dans la mesure où, elle est la plus représentative au plan corporatif, mais aussi<br />
parce qu'elle est présente durant toute la période, de la création de l'Institut à la fin de<br />
notre étude. Les autres associations ont pour des raisons diverses, moins d'impact sur le<br />
campus de Fann.<br />
1) De l'AGED à l'UGEAO<br />
C'est toute l'évolution de l'AGED qui apparaît à travers ce titre.<br />
L'AGED (Association générale des étudiants de Dakar) est mise en place<br />
dès la création de l'Institut car cette nouvelle structure posait aux étudiants des<br />
problèmes tels qu'ils éprouvent la nécessité de s'organiser. Au départ, Africains et<br />
Européens s'y côtoyent. Dans l'organe "AGE-Presse", nous lisons à ce sujet: «Lors de la<br />
création de l'AGED, une juste répartition des postes était effectuée entre Africains et<br />
métropolitains au sein du bureau »11. En effet, le premier président de l'association est<br />
un métropolitain. Mais, cette situation unitaire ne dure pas en raison de l'absence<br />
d'activités effectives, le premier président ne manifestant ni initiative ni intérêt. A cette<br />
raison s'en ajoute une autre de taille; c'est le débat relatif à la question de l'affiliation de<br />
l'organisation. Pour les étudiants métropolitains, il faut affilier l'AGED à l'UNEF<br />
(Union nationale des étudiants de France). Ce point de vue n'est pas celui de la plupart<br />
des Africains qui veulent une organisation largement indépendante. Pour s'opposer aux<br />
arguments de leurs collègues métropolitains, ils mettent en avant la spécificité de leurs<br />
problèmes. Ils ajoutent également le fait que les étudiants africains, en France même, se<br />
sont constitués en une association propre dénommée FEANF, indépendante de<br />
l'UNEF.<br />
10. "AGE-Presse", NU 2, 26 juin 1957.<br />
11. Ibidem.<br />
14-6
de personnel enseignant : noms, prénoms, fonctions et titres universitaires; elle ajoute<br />
même des remarques sur l'organisation des cours des différents enseignants.<br />
Pour les étudiants, cette publication apporte la preuve, pour qui s'y intéresse,<br />
qu'ils ont parfaitement raison.<br />
Face à la querelle entre étudiants africains et autorités universitaires de<br />
métropole, les autorités politiques ont leur mot à dire. Moustapha Diallo que nous<br />
avons interrogé rapporte que le bureau de l'AGED est convoqué par le président du<br />
Grand Conseil, Léon Boissier Palun. Ce dernier fait longuement alterner devant la<br />
délégation, le bâton et la carotte, ceci pour un résultat contraire à son attente car la<br />
direction de l'AGED refuse catégoriquement de signer un texte qu'il lui propose par<br />
lequel elle se dédirait. Léopold Senghor est un autre adversaire de la ligne des<br />
étudiants. Dans un débat au Grand Conseil, en 1953, il affirme que les professeurs de<br />
lycée sont plus aptes que tout autre à enseigner l'art de la dissertation 13 . Il confirme<br />
ainsi indirectement des faits affirmés par les étudiants mais il en conteste la signification<br />
retenue par ceux-ci. Le député du Sénégal prenait fait et cause contre les étudiants.<br />
Ces derniers considérent que leur cause est juste. En tirant les leçons de leur<br />
campagne d'information sur la qualité du personnel enseignant de l'Institut, la rédaction<br />
de l'organe de presse de l'AGED constate « Depuis la parution de notre numéro spécial...<br />
des messages de félicitations et d'encouragements nous arrivent des quatre coins de la<br />
Fédération et de la Métropole. La première phase de l'action s'est donc réalisée: alerter<br />
l'opinion publique. La deuxième doit être réalisée »14. En tout cas, journaux politiques,<br />
organes de jeunesse, syndicats, personnalités diverses font écho à l'AGED sur cette<br />
question et popularisent sa lutte. Les étudiants africains en métropole ne sont pas en<br />
reste dans cette bataille d'opinion puisqu'ils apportent tout l'appui possible à ceux de<br />
l'Institut. Ainsi, au 43 ème congrès de l'UNEF, le 24 avril 1954, à Toulouse, c'est à<br />
l'observateur de l'AGED que la FEANF laisse délivrer le message commun AGED<br />
FEANF. Sur cette tribune du congrès des étudiants de France, le rapporteur donne<br />
maints exemples qui veulent prouver que c'est un enseignement au rabais qui est<br />
dispensé à l'Institut. Il cite le cas de l'enseignement de la parasitologie où une dame,<br />
élève en troisième année, donne des cours aux étudiants de la deuxième année. Ensuite,<br />
la physique médicale est enseignée par un docteur es sciences. La chaire de chimie étant<br />
vacante, les cours dans cette matière sont concentrés sur une période d'un mois par un<br />
professeur en mission etc... Presque au même moment, le délégué de la FEANF<br />
s'adresse à la tribune du Conseil des étudiants de l'U.I.E (Union Internationale des<br />
Etudiants) réuni à Moscou, et dénonce dans une longue intervention, l'enseignement au<br />
rabais dispensé à Dakar 15 .<br />
13. Numéro spécial de "Dakar-Etudiant", mars 1956.<br />
14. Ibidem.<br />
15. Comité exécutif de l'U.I.E, 20 Avril 1954.<br />
150
Sur cette même question, la FEANF manifeste son soutien à l'AGED,<br />
lorsqu'une délégation de l'organisation des étudiants africains en métropole s'entretient,<br />
à sa demande, avec le Haut Commissaire de l'AüF de passage à Paris, le 24 septembre<br />
1954, dans les locaux de la Délégation générale de l'AüF16<br />
L'AGED reçoit aussi le soutien d'un enseignant de l'Institut, le professeur J.<br />
Trusque, agrégé d'histologie et d'embryologie17. II dit: « Je crois pouvoir dire que je<br />
considère l'atmosphère de l'Institut de Dakar contraire à toute tradition universitaire<br />
authentique ». Répondant à une question plus précise, pendant cet interview accordé à<br />
"Dakar-Etudiant", le professeur Trusques dit: « Il ny a pas de système de recrutement. n<br />
y'a presque autant de cas particuliers que de professeurs dans cet institut ». Pour lui, cette<br />
situation en matière de personnel enseignant est la conséquence d'une politique qui a<br />
toujours consisté à éloigner les hommes de valeur. Ce professeur, apprécié des étudiants<br />
de Dakar, doit rejoindre la métropole à peine un an après son arrivée à Dakar, dans des<br />
conditions que l'AGED cherche vainement à élucider. Ses demandes d'explication se<br />
heurtent à une fin de non recevoir de la part des plus hautes autorités universitaires<br />
d'AüF. C'est du reste pour cela que les étudiants présentent le départ du professeur<br />
Trusque comme une preuve supplémentaire de ce qu'ils dénoncent.<br />
L'AGED a un autre argument relatif à l'incompétence du personnel<br />
enseignant de l'institut; il s'agit du taux d'échec élevé des étudiants dakarois. Par une<br />
analyse de tous les résultats des Africains aux examens et, dans toutes les disciplines,<br />
l'organe de l'AGED conclut que le sabotage est organisé en haut lieu. Les échecs<br />
massifs des étudiants africains font titrer à Babacar Diop : "Des cadres au compte<br />
goutte" dans un article de "Dakar-Etudiant", en janvier 1959.<br />
Le journal parisien des intellectuels africains, "Présence Africaine", trouve<br />
dans les propos du Recteur Capelle directeur général de l'enseignement en AüF, une<br />
preuve supplémentaire que les étudiants ont parfaitement raison. Ce haut responsable<br />
écrit dans la revue "Education Nationale" paraissant à Paris : « Elle (l'université de<br />
Dakar) doit ajuster ses programmes à ceux des universités métropolitaines... Avoir le même<br />
corps professoral que les universités métropolitaines »18<br />
Le directeur général de l'enseignement d'AüF, peut-être, malgré lui, fait<br />
douter également de la qualité du corps professoral du secondaire en AOF puisqu'il<br />
affirme dans le même article: « 50 % des 496 étudiants boursiers envoyés d'AOF en<br />
métropole n'étaient pas qualifiés pour des études supérieures. En moyenne les déchets se<br />
situent aux environs de 70 % dans les examens en métropole ».<br />
En somme, avec un corps professoral non qualifié au niveau du secondaire et<br />
un corps professoral non qualifié au niveau de l'enseignement supérieur d'AüF, qui<br />
16. L'Etudiant d'Afrique noire, NU 3, Oct-Nov 1954.<br />
17. L'un des deux universitaires que compte l'Institut.<br />
18. "Présence Africaine", Décembre 1959.<br />
151
1<br />
leur indépendance vis à vis du C.J.U.F et de la W.AY. y a t-il une simple coïncidence ou<br />
relation directe?<br />
Moustapha Diallo, ancien président de l'AGED, Y établit une relation<br />
directe. Pour lui, la présence de l'AGED dans le Cl.S est déterminante dans la défense<br />
des principes notamment son indépendance par ce dernier. Pour Youssou Diop, ancien<br />
secrétaire général du CJ.S, cette relation est également directe. Le Cl.S et l'AGED<br />
forment l'aile "marchante" du mouvement démocratique à Dakar, pendant la période.<br />
En définitive, l'AGED, par une longue lutte, préserve son indépendance à<br />
l'égard de l'UNEF, au plan métropolitain. Au plan international, les étudiants dakarois<br />
coopérent avec l'U.J.E, exactement comme ils le souhaitent.<br />
c) Les relations avec les partis et les syndicats<br />
Très vite, les étudiants de l'Institut s'intéressent aux questions politiques et<br />
syndicales locales. Les relations entre l'AGED, plus tard UGEAü, avec le monde<br />
politique dakarois sont un élément important du contexte général.<br />
Pour Moustapha Diallo, à la création de l'Institut, rares sont les étudiants qui<br />
affichent une appartenance politique. Mais ceux qui le font ont toujours eu le courage<br />
de leurs opinions et avec la création du P.A.I, nombreux sont, à Dakar, les étudiants qui<br />
militent ouvertement dans cette formation politique, affirme notre interlocuteur.<br />
Dans "Dakar-Etudiant", la rédaction considére que le rôle des étudiants est<br />
triple: « Rôle social, économique et politique qui doit demeurer la mission de l'étudiant<br />
»22. Dès le numéro suivant, un article signé de Thierno Diop, directeur de publication<br />
de l'organe étudiant, est consacré aux relations entre monde politique et monde<br />
étudiant. L'article s'intitule "Etudiants africains et politique". Il passe en revue les deux<br />
seules voies qui s'offrent aux étudiants: ou bien - «S'occuper de ses études, une fois les<br />
diplômes tenninés, une fois la situation assurée, alors, vous pourrez avoir et défendre vos<br />
OpiniOns ».<br />
Cette attitude est fortement conseillée aux étudiants par de nombreuses<br />
personnes, dit Thierno Diop. A l'opposé l'autre position est qu'- « Une fonnation<br />
culturelle, pour être solide, nécessite une fonnation politique qui n'est pas synonyme de<br />
vaine agitation ou de phraséologie révolutionnaire».<br />
Le directeur de publication exprime le point de vue selon lequel l'étudiant<br />
africain a l'obligation de choisir la deuxième voie. Evidemment, cette politique est bien<br />
définie comme étant très différente de la "poleutic,,23 c'est à dire de la « marche pieds<br />
d'escaliers qui mènent au bureau du commandant de cercle ou du gouverneur ». Cette<br />
politique là considérée comme ayant largement cours en AüF, est « condamnable car<br />
22. "Dakar-Etudiant", Juin 1953.<br />
23. Mot de la langue ouoloff par déformation du mot français "politique".<br />
155·
c'est le fait de troquer le mandat politique contre les faveurs qui sont autant de chaînes<br />
dorées pour l'élu»24. Cette position des étudiants explique, en partie, leur refus d'adhérer<br />
à l'UNEF en laquelle, ils ne voient que l'expression de la domination coloniale.<br />
Avec les partis politiques locaux, les relations des étudiants africains<br />
regroupés dans l'AGED ou l'UGEAO dépendent de la ligne et de la nature de ces<br />
partis.<br />
C'est ainsi, qu'en 1956, invitée au congrès du B.P.S, formation politique de<br />
Senghor, l'UGEAO proclame, à la tribune du congrès, l'engagement de l'organisation<br />
dans la lutte pour la liquidation totale du système colonial. Le président de l'UGEAO<br />
affirme : « Nous voulons vous dire que la liquidation du système colonial, sans<br />
transformation des structures sociales, c'est une mystification des masses ». A propos de la<br />
loi-cadre, le rapporteur des étudiants ajoute plus loin, dans son discours : « Nous<br />
craignons que partout en Afrique, dans quelques mois peut-être, quand les conseils de<br />
gouvernements seront mis en place, des maffia perpétuent leur habituelle et déshonorante<br />
besogne. Nous craignons de connaître de nouveaux Boo-Dai" à la merci des tenants du<br />
sYstème colonial ». Ces déclarations ont lieu à un moment où le B.P.S se prépare<br />
activement à diriger le gouvernement de l'autonomie interne issu de la Loi-Cadre. Pour<br />
bien être compris, les étudiants répétent par l'intermédiaire de leur délégué: « Nous<br />
voulons que les problèmes soient correctement posés... Nous posons sans équivoque le<br />
problème de l'indépendance totale à l'égard de la métropole ». Mais la formation politique<br />
de L. S. Senghor n'a pas la même conception des choses que les étudiants.<br />
A l'égard du R.D.A, l'UGEAO exprime aussi clairement ses vues, en 1957,<br />
lors du lIerne congrès du mouvement de H. Boigny à Bamako. La délégation des<br />
étudiants de Dakar saisit également cette occasion pour délivrer un message dont la<br />
teneur politique est la dominante. Après avoir rappelé les nobles espoirs que le congrès<br />
constitutif du R.D.A a fait naître, dix ans auparavant, dans cette même ville et après<br />
avoir évoqué les énormes responsabilités qui pèsent sur les congressistes pour le devenir<br />
de l'Afrique, les étudiants se situent clairement. « Nous ne sommes pas de jeunes excités,<br />
des illuminés, des exaltés, des rêveurs, des révolutionnaires que l'on veut bien croire... Nous<br />
tenons simplement à ce que les problèmes soient correctement posés, les étudiants, sans<br />
équivoque, posent le problème de l'indépendance, non par théorique, mais concréte »25.<br />
En somme, à ces importantes assises du B.P:S, parti territorial, et du R.D.A,<br />
parti interterritorial, les étudiants de Dakar ont nettement conscience de s'adresser à<br />
des auditeurs privilégiés car ce sont ces hommes politiques qui vont assurer la relève du<br />
colonisateur. Il s'agit, donc de leur exprimer clairement, les appréhensions des étudiants<br />
à l'égard de la question fondamentale de l'indépendance nationale, qui à leurs yeux, ne<br />
doit souffrir d'aucune équivoque. Les étudiants africains qui se sont constitués en<br />
24. "Dakar-Etudiant", NU 2, Juillet 1953.<br />
25. "Dakar-Etudiant", Janvier-Février 1958.<br />
156
Cette orientation correspond t-elle à ce que la hiérarchie catholique<br />
dakaroise attend de cette association qu'elle a porté sur les fonds baptismaux ?<br />
Certainement pas. Un an à peine après l'apparition de "Jeunesse d'Afrique", tout<br />
indique que les relations entre les étudiants catholiques et la hiérarchie sont loin d'être<br />
des plus cordiales. Ainsi, en avril 1956, ils publient une "mise au point" dans leur organe<br />
de presse: «A Dakar, quelques événements nous ont donné à refléchir. Des heurts nous<br />
ont indiqué clairement que notre action commençait à déplaire ». Plus loin, à propos de ce<br />
qu'il leur est reproché, ils écrivent: « Que les étudiants fassent du bruit à Dakar, on peut<br />
encore le souffrir, mais que les jecistes (jeunesse étudiante catholique) aussi se mêlent de<br />
critiquer, voilà qui dépasse les bornes ».<br />
Pour plus de précision, le journal indique qu'un article sur le clergé indigène,<br />
paru dans cet organe de presse a déclenché des réactions en chaîne. Les étudiants<br />
catholiques affirment leur point de vue « Le dialogue avec la hiérarchie ne signifie pas<br />
qu'il soit en sens unique: écouter des conseils»32. C'est à cette hiérarchie catholique<br />
dakaroise qui tente de la museler que l'association s'adresse en écrivant: «L'université<br />
brasse à Dakar les éléments hétéroclites de la Fédération. C'est une chance inouïe et unique<br />
qui est offerte aux futurs cadres de la nouvelle Afrique. Gâcher une occasion aussi belle<br />
serait une trahison pour l'Afrique »33.<br />
Ces propos se dégagent d'un éditorial qui s'intitule "Faire le point". Il indique<br />
que les étudiants tiennent à intégrer globalement leurs activités à celles plus générales<br />
du monde étudiant dakarois.<br />
Cependant, certaines positions de cette association s'inscrivent en faux contre<br />
celles de l'UGEAO. C'est ainsi que parlant de la guerre d'Algérie, les étudiants<br />
catholiques estiment que les Algériens veulent forcer la main à la France en se livrant «<br />
à un terrorisme excessif qui n'épargne pas le sang des innocents» tout en précisant,<br />
cependant, qu'à la haine, la France n'a pas opposé l'amour et la douceur et que sa<br />
répression est terrible 34 . Pour l'organe des étudiants catholiques de Dakar, la<br />
responsabilité de la guerre d'Algérie se situe du côté algérien. La France se trouve<br />
seulement en position de légitime défense. Cette position est totalement différente de<br />
celle défendue par l'AGED sur la question algérienne.<br />
L'association des étudiants catholiques s'intéresse aussi à la situation<br />
économique du continent, en dénonçant les méfaits du capitalisme qui laisse les grands<br />
trusts (Unilever, CFAO, SCOA) piller en toute quiétude avec la complicité de l'Etat.<br />
Ces étudiants catholiques se préoccupent aussi de la promotion de la femme africaine,<br />
de la création d'un clergé authentiquement africain, de la promotion des langues<br />
nationales comme solution à une préservation de la culture africaine.<br />
32. "Jeunesse d'Afrique", NU la, Juin-Juillet 1956.<br />
33. Ibidem, Editorial na la, juin-juillet 1956.<br />
34. "Jeunesse d'Afrique", Decembre 1956.<br />
160
Cette association est également inquiète de la situation du cmema en<br />
Afrique; elle dènonce les films pervers qui inondent les salles de cinéma en AOF et<br />
constituent un véritable danger pour la jeunesse africaine.<br />
Cependant, le rôle de cette association dont le siège se trouve dans la<br />
résidence universitaire de Fann reste secondaire à cause du petit nombre de militants.<br />
Les étudiants catholiques constituent une faible minorité dans la masse des étudiants de<br />
l'Institut. De plus, leur activité est dans l'ensemble trop proche des initiatives de la<br />
hiérarchie catholique pour être attirante à la grande masse.<br />
4) l' AMEAN (Association Musulmane des Etudiants d'Afrique noire).<br />
Du 11 au 15 juillet 1956, à Dakar, les étudiants musulmans d'Afrique noire<br />
tiennent leur premier congrès, au terme duquel ils publient un manifeste et créent<br />
l'AMEAN. Le thème du congrès ,s'intitule: « 'sIam et colonialisme» et les étudiants,<br />
réunis pour en débattre, viennent des milieux africains de métropole ainsi que de ceux<br />
de l'Institut de Dakar. L'analyse qui est faite montre que la place donnée à l'islam dans<br />
la situation coloniale «est particulièrement outrageante et humiliante». Ce constat s'appuie<br />
sur un ensemble de faits et de pratiques : le rôle du bureau des affaires musulmanes, la<br />
place faite aux dates marquantes de l'Islam, la politique d'alcoolisation des populations,<br />
le sort de la jeune fille et de la femme africaine, l'abandon de l'enseignement privé<br />
islamique alors que l'enseignement privé catholique est largement subventionné etc...<br />
C'est sous cet angle que le sort fait à la religion musulmane est jugé "indigne et<br />
humiliant". Pour réagir, les étudiants musulmans se proposent « de faire face résolument<br />
au colonialisme». Pour ce faire, l'obligation de se doter d'un outil de lutte les amène à la<br />
création de cette association.<br />
Le rôle qu'elle s'assigne est clairement défini dans le Manifeste puisque les<br />
étudiants musulmans excluent de leur champ d'action les problèmes syndicaux et<br />
purement corporatifs. L'AMEAN se démarque ainsi des autres organisations comme<br />
l'UGEAO et la FEANF dans lesquelles elle appelle ses membres, à Dakar comme en<br />
métropole, à militer activement. Mais tout en délimitant son domaine d'action par<br />
rapport à ces deux organisations, elle ne s'en réserve pas moins le droit d'avoir son<br />
opinion sur toute question à incidence islamique. L'association reconnait aussi, dans son<br />
Manifeste, toutes les organisations de jeunesse, en Afrique et dans le monde,<br />
notamment les associations musulmanes. Elle proclame également sa volonté<br />
d'entretenir des rapports culturels et amicaux avec toutes les organisations<br />
confessionnelles non musulmanes dans le cadre d'un respect mutuel. Le congrès affirme<br />
qu'il n'a aucune position anti-cléricale. Il exprime le souhait que ses travaux rencontrent<br />
« des échos de compréhension et fassent naître l'espoir et la foi en l'unité africaine ».<br />
L'activité pratique de l'AMEAN, au niveau de l'Institut des Hautes Etudes, se limite à<br />
161
Ce congrès qui installe les structures définitives de l'association s'ouvre, pour<br />
trois jours, à Paris, le 20 mars 1951 à Paris. Au terme des travaux, les membres<br />
fondateurs sont confirmés. Ainsi, Solange Faladé du Dahomey est élue président,<br />
Amadou Mactar Mbow du Sénégal secrétaire général avec Aki Traoré de Guinée<br />
comme adjoint.tandis que Abdoul Moumini du Niger est à la trésorerie. Ce premier<br />
collectif traduit l'interterritorialité du mouvement. Cette naissance marque aussi la fin<br />
de l'Association des Etudiants Africains en France créée au sortir de la deuxième guerre<br />
mondiale. La FEANF fait ainsi une sorte de synthèse de deux courants politiques<br />
divergents animés l'un par des éléments S.F.I.O dont Boubacar Guèye est le chef de file,<br />
et l'autre par le R.D.A avec des étudiants comme Cheikh Anta Diop. Entre ces deux<br />
courants, se situent des éléments non politiques comme Assane Seck et Doudou<br />
Thiam 37 , mais aussi un noyau plus actif animé par Amadou Mactar Mbow, Abdoulaye<br />
Ly, Louis Behanzin et François Amorin. La FEANF fédére, à travers ces courants<br />
politiques, les étudiants africains par un schéma fort simple; elle regroupe:<br />
- les associations territoriales au nombre de 14 (8 de l'AOF, 4 de l'AEF et<br />
celles du Cameroun et du Togo),<br />
- les sections académiques car les étudiants africains poursuivent des études<br />
dans diverses universités comme Paris, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Montpellier,<br />
Lyon...<br />
Combien sont-ils, ces étudiants?<br />
Leur nombre varie selon les périodes considérées et les sources.<br />
"AGE-Presse", organe de l'association des étudiants français en Afrique<br />
noire, les chiffre à 5.000 en 1956. En 1957, à la tribune du deuxième congrès du R.D.A,<br />
la FEANF, par la voix de son président, les chiffre à 5.000, originaires de tous les<br />
territoires d'Afrique noire française. Mais, à la fin de l'année 1959, le chiffre de 8.000 est<br />
avancé à la tribune du 11 eme congrès de la FEANF même, par le président sortant<br />
Hamat Bâ.<br />
Au plan de ses relations avec le mouvement étudiant métropolitain, il faut<br />
rappeler que l'UNEF a cherché, mais en vain, à intégrer la FEANF en son sein; ceci<br />
entraîne pendant de très longues années des rapports relativement tendus entre les deux<br />
organisations, et pour des raisons très diverses notamment, à partir de 1955, lorsque la<br />
direction de la FEANF, jugée la plus nationaliste 38 , décide l'affiliation à l'U.I.E dont le<br />
siège est à Prague.<br />
La FEANF, de 1950 à 1960, a tenu onze congrès ordinaires et<br />
extraordinaires. Ses assises ne passent pas toujours inaperçues dans l'opinion publique<br />
française, même si, en général, la FEANF dénonce « La conspiration du silence mais qui<br />
37. Tous deux deviennent ministres au Sénégal après l'indépendance.<br />
38. D'après Roger de Benoîst: par opposition aux années précédentes et plus particulièrement 1954, la FEANF<br />
invite L.S. Senghor.<br />
163
n'a"êteraguère la marche de nos peuples vers l'indépendance »39. Cette attitude tranchait<br />
très nettement d'avec le comportement de cette même presse française vis à vis du<br />
X eme congrès de la FEANF. Plusieurs organes avaient pris de violentes positions contre<br />
le mouvement. C'est ainsi que le "Figaro,40, parlant des motions du congrès, écrit: « Il<br />
faut revenir sur ces motions dont le ton anti-français frise la provocation... Ces jeunes élites<br />
africaines, -ou présumées telles- n'ont pas d'objectif plus positif que la démolition<br />
systématique des institutions auxquelles ils doivent ce qu'ils sont ». L'organe de presse<br />
parisien ne voit en ces étudiants que « des marxisants... aux bourses d'études trop<br />
confortables». "Climats", autre organe de la droite française, dit ceci en parlant d'eux: «<br />
Ces incapables, les exclus, les recalés, les condamnés de droit commun obtenant des<br />
assemblées politiques des bourses d'études en France ». La presse du PCF, elle, est<br />
considérée par la FEANF comme faisant un travail d'information de l'opinion publique<br />
française correct par une couverture objective des assises de la fédération. Evidemment,<br />
pour le "Figaro", c'est que le X eme congrès a «vilipendé comme ''colonialistes'' toute la<br />
presse française saufles journaux communistes ».<br />
a) Les relations entre la FEANF et les autorités administratives.<br />
Dans l'ensemble, elles ne sont pas bonnes. Deux questions permettent de s'en<br />
faire une idée: la presse du mouvement, notamment face à la censure, d'une part et la<br />
question des subventions d'autre part.<br />
- La presse de la FEANF<br />
L'association s'est vite dotée d'un organe de presse, à la fois bulletin intérieur<br />
et journal. Roger de Benoîst écrit que : « Le bulletin de la FEANF fut saisi à plusieurs<br />
reprises par ordre du préfet de Toulouse notamment en décembre 1956 pour critiques à<br />
l'action gouvernementale et en février 1958, pour le compte-rendu du congrès de décembre<br />
1957 ». Ce chercheur, journaliste et ancien rédacteur en chef d"'Afrique Nouvelle",<br />
ajoute: « Le président de la Fédération, fut inculpé le 11 avril 1958 pour atteinte à la sûreté<br />
extérieure de l'Etat» en tant que rédacteur en chef de l'organe étudiant. Même si cette<br />
inculpation fut suivie d'un non lieu, il n'en demeure pas moins qu'elle traduit l'état de<br />
tension qui existe dans les relations entre la FEANF et les autorités métropolitaines.<br />
A Dakar, il en est de même. C'est ainsi qu'un arrêté du gouverneur général,<br />
suivant les instructions du ministre de la FüM, interdit« sur toute l'étendue de l'ADF la<br />
circulation, la vente, la distribution, la production et l'exposition dans tous les lieux publics»<br />
du numéro 10 du journal "L'Etudiant d'Afrique noire" paru en janvier 1958. 11 sera<br />
procédé à la saisie des exemplaires existant 41 .<br />
39. "L'Etudiant d'Afrique noire", Mai 1960.<br />
40. Du 2 janvier 1959.<br />
41. "L'Etudiant d'Afrique noire", tJl de février 1958.<br />
164
En réaction à cette censure, un grand meeting est organisé, le 20 février 1958,<br />
à la place de Mboth, par l'UGEAO, le CJ.S, le P.AI et le P.S.AS. L'ensemble des<br />
organisations présentes adoptent une motion qui proteste contre cette saisie en «...<br />
Considérant l'indignation des masses africaines à l'annonce de la troisième saisie de<br />
l'organe de la Fédération... assure tous les étudiants afdcains de la totale solidan"té dans la<br />
lutte pour l'indépendance nationale»42. De plus, le journal peut également être interdit<br />
par les autorités locales des différents territoires. Ainsi, selon "L'Etudiant d'Afrique<br />
noire" de décembre 1959, il n'a plus droit de cité en Haute Volta.<br />
- La question des subventions.<br />
Elle constitue l'une des causes de tension dans les relations entre la FEANF<br />
et les autorités tant métropolitaines que locales.<br />
Dans un article intitulé "Surdité volontaire", la FEANF écrit : « Nous<br />
apprenons que la conférence des gouverneurs qui vient de se réunir à Dakar, a rejeté la<br />
demande de subvention fonnulée par la FEANF »43. La FEANF publie une lettre de<br />
protestation adressée au Délégué du gouvernement général de l'AOF à Paris relative à<br />
ce rejet en mars 1954. La question revient aussi dans un compte-rendu d'activités du<br />
bureau exécutif de la fédération qui, le 24 septembre 1954, rencontre, à Paris, le<br />
gouverneur général Bernard Cornut Gentille. On la retrouve également dans une autre<br />
lettre de la FEANF adressée au Grand Conseil de l'AOF et la question reste entière<br />
jusqu'en 1959.<br />
La FEANF attend beaucoup des subventions en raison de ses activités qui<br />
nécessitent des moyens financiers. C'est ce qui est avancé dans la discussion du Ill eme<br />
point de l'ordre du jour, lors de la rencontre avec le gouverneur général: «L'organisation<br />
de nos colonies de vacances et de nos congrès, le financement des activités culturelles et<br />
sportives des associations fédérées, nécessitent un budget que, de toute évidence, les seules<br />
cotisations de nos membres ne peuvent équilibrer ». La position de l'administration est<br />
souvent un refus de subventionner la Fédération en invoquant des arguments que les<br />
étudiants de la FEANF jugent infondés.<br />
Dans une lettre envoyée au Délégué du gouverneur général à Paris, ils<br />
donnent leur point de vue sur les raisons du refus: « Vous continuez, depuis quatre ans, à<br />
prétendre que la FEANF n'est pas représentative; à cette fin vous appelez à votre rescousse<br />
des associations territodales dont vous vous moquez éperdument »44. Pour la Fédération,<br />
l'argument de la représentativité déployé par l'administration n'est ni solide, ni<br />
raisonnable, mais il n'est qu'un simple et grossier prétexte. Ils mettent en relief le fait<br />
42. "Dakar-Etudiant", NU de Janv-Fev 1958.<br />
43. "L'Etudiant d'Afrique noire" de Juin-juillet 1954.<br />
44. Lettre du 17 mars 1954, in "L'Etudiant d'Afrique noire", Juin-juillet 1954.<br />
165·
comme celui de la guerre d'Algérie. C'est dire que l'arme de la subvention, utilisée par<br />
l'administration, n'obtient pas le résultat escompté.<br />
b : Les relations entre la FEANF et les partis politiques.<br />
De par ses statuts, la FEANF n'a rien à voir avec un parti politique mais ceci<br />
ne l'empêche pas de se prononcer sur tous les événements relatifs au devenir des<br />
populations d'Mrique noire. C'est ainsi qu'elle qualifie la Loi-Cadre de «nouvelle<br />
manoeuvre colonialiste », considére que « Le général de Gaulle est porté au pouvoir par les<br />
éléments les plus colonialistes qui prétendent restaurer par la force et la terreur 'T'Empire<br />
colonial français" »46. De même, la FEANF estime pouvoir entretenir des relations avec<br />
les partis politiques sans perdre sa liberté d'action. Le congrès extraordinaire de juin<br />
1958 proclame dans sa résolution générale « sa détennination à soutenir toute<br />
organisation ou parti politique africain ayant clairement opté pour l'indépendance<br />
nationale».<br />
En janvier de la même année, la FEANF participe à Paris à la rencontre des<br />
partis politiques africains: R.D.A, P.F.A, P.A.I, P.S.A.S. A la seconde rencontre de ces<br />
partis à Dakar, la FEANF n'a pas participé car elle constate que les partis politiques,<br />
excepté le P.A.I, n'ont pas inscrit la question de l'indépendance immédiate dans leur<br />
projet.<br />
La FEANF préconise le vote en faveur du "non" au référendum du 28<br />
septembre joignant sa voix à celles du P.A.I, du CI.S, de l'UGTAN etc...; elle appelle<br />
les organisations d'étudiants africains, à opter clairement et hardiment pour l'alliance<br />
avec ceux qui, concrètement et quotidiennement, combattent l'impérialisme. La FEANF<br />
répond à diverses invitations de partis politiques africains comme au congrès constitutif<br />
du B.P.S au Sénégal, au lIerne congrès du R.D.A à Bamako etc... Les messages, lors de<br />
ces rencontres ont marqué son désaccord à l'égard de la ligne suivie par ces partis; elle<br />
considére que Houphouët Boigny et le R.D.A ont, en se "repliant", abandonné la lutte<br />
anti-colonialiste engagée au départ. Le mouvement étudiant compare H. Boigny à cet<br />
oiseau de la légende « L'oiseau stupide qui vient de s'engluer a trouvé le bonheur et a<br />
oublié son "akama" (la case de ses mauvais jours) ». En clair, Houphouët devenu ministre<br />
à Paris, a oublié la répression contre le R.D.A. Il a abandonné la lutte de son peuple.<br />
Parlant des attaques multiples contre ce parti, Claude Gérard considére que « La<br />
fédération était systématiquement contre le RDA »47.<br />
La FEANF s'est intéressée à diverses questions comme l'alcoolisme des<br />
populations d'Mrique noire, la politique de non emploi des cadres africains dans la<br />
fonction publique locale d'AOF, les bénéfices scandaleux réalisés par les grandes<br />
46. "Présence Africaine", Congrès extraordinaire de la FEANF, Paris, Juin 1958.<br />
47. R.F.!, Mémoire d'un continent, 29 mai 1989.<br />
167
l'Eglise d'orienter, à sa guise, l'activité des étudiants catholiques, était, à coup sûr, bien<br />
aléatoire.<br />
Dans une certaine mesure, la hiérarchie catholique s'accommode de cette<br />
situation de fait.<br />
169
ECONOMIQUE.<br />
CHAPITRE V<br />
LES GROUPES DE PRESSION A CARACTERE<br />
Trois sortes de groupes se dégagent : la Chambre de Commerce,<br />
d'Agriculture et d'Industrie de Dakar (C.C.A.I), l'Assemblée des Propriétaires de la<br />
Circonscription, le Comité de Défense des Locataires. Ces groupes ont une grande<br />
activité à Dakar, à cause notamment du contexte général. Par ailleurs, il est intéressant<br />
de noter que les deux derniers groupes ont des objectifs souvent contradictoires.<br />
Il LA C.CAI<br />
La Chambre de Commerce, d'Agriculture et d'Industrie de Dakar est l'une<br />
des plus vieilles institutions de la ville puisqu'elle remonte aux premières années de la<br />
création de la ville. Dans la deuxième guerre, la C.C.A.I apporte tout son appui à l'effort<br />
de guerre de la métropole; puis elle apporte sa collaboration au vichysme dakarois. Au<br />
moment du retournement de 1942-1943, cette institution se mobilise pour la nouvelle<br />
cause et prouve ainsi sa capacité d'adaptation aux circonstances. C'est pourquoi, le<br />
contexte de l'après-guerre lui permet de consolider son assise dans le cadre de la<br />
nouvelle politique économique de la France à l'égard de ses colonies d'Mrique noire.<br />
Ainsi, la création de la nouvelle zone monétaire avec le franc CFA (colonies<br />
françaises d'Mrique) décidée par le décret du 26 décembre 1945, est avantageuse pour<br />
les hommes d'affaires. En effet, le franc CFA est« surévalué permettant aux exportateurs<br />
métropolitains des bénéfices de change importants pour les revenus acquis en AOF et AEE<br />
»1.<br />
Outre la réforme monétaire, une nouvelle approche économique entre en<br />
vigueur à partir de 1946. Le principe d'autonomie financière des colonies, jusque là en<br />
vigueur, est remplacé par celui des contributions non remboursables du budget<br />
métropolitain aux budgets locaux. Des institutions financières comme le FIDES (Fonds<br />
d'investissement pour le développement économique et social) et la CCFOM ( Caisse<br />
centrale de la France d'Outre-Mer) sont mises en place pour le financement de la mise<br />
en valeur des colonies.<br />
La mise sur pied de cette nouvelle politique économique constitue un soutien<br />
important au grand capital dans la recherche d'investissements et de débouchés en<br />
Afrique noire. Dans cette perspective, la C.C.A.! de Dakar se trouve très bien placée<br />
pour assumer une fonction de coordination.<br />
1. Papa Waly Danfakha, Les hommes d'affaires sénégalais 1930-1960, DEA Histoire, Université Paris VII, 1985, p. 15<br />
170
Cette institution est, depuis sa création, un domaine réservé des Européens.<br />
Déjà, en 1929, la physionomie des Chambres de commerce du Sénégal se présente de la<br />
manière suivante:<br />
- 100 % d'Européens en 1ere catégorie c'est à dire celle des chefs<br />
d'entreprises commerciales, agricoles et industrielles<br />
- Il Y a une très faible présence africaine en 2 eme catégorie réservée aux<br />
employés ou gérants des grandes maisons de commerce françaises<br />
- Au niveau de la 3 eme catégorie, c'est à dire celle qui regroupe ceux qui sont<br />
installés à leur propre compte, les Africains constituaient la masse.<br />
L'analyse de la composition de la C.C.AI faisait écrire à Papa Waly<br />
Danfakha, qu'il n'y a pas d'entreprises sénégalaises avant 1945.<br />
Marc Diallo est le seul Sénégalais inscrit en 1ere catégorie en 1946. Il est le<br />
fondateur du syndicat des petits commerçants, exportateur d'objets d'art africain et<br />
importateur de produits spécialisés ( Whisky, appareils radios etc...). En 1950, deux<br />
autres Sénégalais sont admis en 1ere catégorie.<br />
Les élections consulaires du 25 avril 1954 à Dakar doivent désigner 25<br />
membres pour la 1ere catégorie, 10 pour la seconde et seulement 4 pour la troisième. La<br />
quatrième catégorie, constituée de 14 membres, ne peut pas être représentée au bureau<br />
de la Chambre de commerce. Le nombre des électeurs inscrits est de 272 à la réunion de<br />
renouvellement du 26 janvier 1956. La composition de la Chambre de commerce de<br />
Dakar est de 34 Européens et seulement quatre Africains. Les chiffres étaient les<br />
mêmes en fin février 1954.<br />
Donc, de 1945 à 1955, l'assemblée de la C.C.A.! se compose d'une<br />
quarantaine de membres dont 90 % sont des Européens.<br />
Cette situation de quasi-monopole des Européens résulte de dispositions<br />
contenues dans le réglement intérieur qui stipule que le nombre total des membres élus<br />
dans les second et troisième collèges ne peut être supérieur à la moitié des membres de<br />
la première catégorie 2 .<br />
De plus, les statuts interdisent toute possibilité de représentation aux<br />
Levantins alors qu'ils sont très actifs dans le domaine économique.<br />
Cette situation de prééminence des Européens à la C.C.A.! de Dakar est<br />
encore remarquée par Régine Bonnardel, bien après l'indépendance puisqu'elle écrit: «<br />
Aucun chefd'industrie, plus de dix ans après l'indépendance, n'est Sénégalais »3.<br />
Diverses raisons expliquent l'importance de la C.C.A.! dans la vie<br />
économique dakaroise. Nous en avons retenu deux plus importantes: la maîtrise de<br />
l'information et la coordination des actions.<br />
2. Ibrahima Thioub, Entreprises-Entrepreneurs et Etat, 1989, p.149.<br />
3. Régine Bonnardel, La vie de relations..., 1976, p.91.<br />
171
gros intérêts coloniaux locaux, la Chambre de commerce manifeste une vive opposition<br />
à toute nouvelle réglementation en matière de travail en AOF. En conséquence, elle se<br />
mobilise fortement. Si de 1945 à 1952, le code du travail a longuement traîné, de projet<br />
à projet, durant toute la période, c'est incontestablement à cause de l'opposition de la<br />
C.C.AI, d'autant plus efficace qu'elle dispose d'appuis solides à Paris.<br />
Les travailleurs de l'AOF doivent l'adoption du code, en 1952,<br />
essentiellement à la détermination qu'ils ont manifestée par le déclenchement de<br />
multiples grèves. La puissance de la Chambre explique aussi que le texte voté en<br />
décembre 1952 ne soit pas mis immédiatement en application.<br />
En somme, la C.C.A.! reste, pendant toute la période de 1945 à 1960, un<br />
organisme très puissant sur le plan économique. Il est l'expression même des puissants<br />
intérêts marseillais, bordelais et lyonnais à Dakar. Son poids économique permet à<br />
l'institution d'imprimer sa ligne "politique" dans la marche des affaires, au niveau local.<br />
11/ L'ASSEMBLEE DES PROPRIETAIRES.<br />
Remarquons, d'abord, que le terme de Circonscription est encore utilisé en<br />
1955 dans la dénomination de cette association dakaroise, expression peut-être d'une<br />
nostalgie, puisque cette entité administrative est supprimée depuis 1946.<br />
Son domaine d'activités se limite à la question de la gestion des immeubles<br />
ou maisons de location. Elle regroupe des Européens, pour l'essentiel, mais elle compte<br />
aussi des Africains. Son conseil d'administration de 1953 se compose de sept membres<br />
dont cinq sont Européens et deux seulement sont des Africains. Cette prééminence des<br />
Européens s'explique, ici, par le fait que ces immeubles et maisons en location sont en<br />
dur. Or, le coût de la construction reste très élevé à Dakar et la condition première est<br />
la possession d'un terrain certifiée par un titre foncier, conformément à la législation<br />
coloniale. Peu d'Africains répondent à ces critères. Ce qui explique leur faible<br />
représentation au sein de l'association. Cette association est donc une expression des<br />
grands intérêts européens auxquels se joignent ceux de quelques Africains.<br />
Le 18 mai 1952, elle écrit au ministre de la FOM, sous le couvert du Haut<br />
Commissaire de l'AOF pour inciter l'autorité parisienne à agir car il y a «...Nécessité<br />
urgente d'édicter une nouvelle réglementation des loyers plus juste et plus efficace». Pour<br />
l'association des propriétaires, cette démarche se justifie par le fait que « la situation<br />
actuelle qui dure depuis 1940, est paradoxale, injuste et nuisible à l'intérêt général,<br />
incohérente et anarchique ». Elle juge que le prix illégal, pratiqué par certains<br />
propriétaires et locataires, fait courir des risques sérieux aux propriétaires qui sont à la<br />
merci d'un changement d'humeur et d'attitude des locataires 9 d'autant plus que le prix<br />
9. Affaires politiques AOF, ANSOM, carton 2163 dos 2, 1952.<br />
174
En septembre 1947, Detraves, secrétaire administrative du groupe socialiste,<br />
adresse à Marius Moutet, ministre de la FOM, une lettre lui demandant si satisfaction<br />
peut être apportée aux desiderata des petits et moyens commerçants de Dakar. Elle<br />
vient d'en être saisie par ce groupe. La réponse du ministre, datée du 30 septembre,<br />
indique à Detraves que sa demande est envoyée au Haut Commissaire de l'AOF pour<br />
qu'il en soit tenu compte dans l'étude en cours d'un projet d'une nouvelle<br />
réglementation sur les baux.<br />
Deux mois plus tôt, la fédération nationale des syndicats du commerce s'est<br />
adressée au ministre de la FOM, par une lettre qui met l'accent sur la précarité de la<br />
situation des locataires dans les grandes villes de l'AOF, particulièrement à Dakar.<br />
D'après elle, les locataires «étaient impitoyablement expulsés avant d'atteindre<br />
quatre ans d'occupation, ce qui représente une absence de garantie de sécurité »10.<br />
Pour cette association, la législation en vigueur est bonne, car elle offre<br />
théoriquement des garanties de sécurité. Donc, il faut que les autorités de la fédération<br />
d'AOF la mettent effectivement en application en en faisant respecter la pratique par<br />
les propriétaires, par intervention de la justice.<br />
Cette lettre dénonce les expulsions administratives dans un domaine où seule<br />
la justice doit être compétente. Cette question d'expulsions, se retrouvent en 1950 et en<br />
1952 dans les échanges de télégrammes entre le ministre de la FOM, le Grand Conseil<br />
de l'AOF et le Haussaire de Dakar. En effet, en janvier 1950, c'est le secrétaire général<br />
du comité de défense des locataires de Dakar, Jamil Haddah, qui écrit au gouverneur<br />
général avec ampliation au Grand Conseil, pour demander la parution urgente d'un<br />
décret devant régler les rapports entre locataires et propriétaires. Il demandee, en outre,<br />
la mise en place d'une commission compétente pour règler les cas épineux. Dans<br />
l'annexe de la lettre, il propose que soit reconsidérée la situation des secteurs<br />
résidentiels de Dakar, au nombre de sept, dont cinq sont réservés aux Européens, un aux<br />
Européens et Africains et un aux Africains.<br />
Le 29 juin 1952, c'est le président du Grand Conseil de l'AOF qui télégraphie<br />
au ministre, sur une démarche urgente de l'association des médecins d'AOF qui se<br />
plaignent des agissements abusifs des propriétaires soutenus en cela par le Haut<br />
commissaire de, Dakar qui ordonne les multiples expulsions administratives.<br />
L'association des médecins télégraphie, aussi, en ce sens, au ministre de la FOM. Ce<br />
dernier, en réponse, demande au Grand Conseil d'informer les médecins africains que le<br />
gouvernement vient d'adopter la réglementation sur les loyers en AOF.<br />
Les journaux dakarois s'intéressent aussi à cette question des loyers.<br />
"Echos d'Afrique noire" accuse le Crédit Foncier de l'Ouest Africain de<br />
saboter la bonne entente entre Blancs et Noirs, à Dakar, par les conditions de location<br />
10. Lettre du 19 juin 1947, carton 2163 dos 2, ANSOM.<br />
176
compris celle qui est tenue par des Africains, restent muets sur les loyers des cases et<br />
baraques.<br />
Ces groupes de pression à caractère économique sont donc très influents à<br />
Dakar. Le réel dynamisme s'explique par les contradictions d'intérêts entre les uns et les<br />
autres. Dans l'expression de ces contradictions à Dakar, l'administration est surtout<br />
sensible aux intérêts des propriétaires, tout en se souciant aussi des aspects de sécurité<br />
dans le cadre des relations entre ces groupes d'intérêts. Le contexte global de pénurie de<br />
logements impose, bien sûr, cette prudence à l'administration, juge entre les parties.<br />
178
11/ LA CONFRERIE TIDJANE<br />
Le recensement démographique de 1955 indique que plus de la moitié des<br />
musulmans à Dakar, exactement 55 % , se réclame de cette confrérie.<br />
La confrérie tidjane est fondée au Sénégal par le marabout toucouleur El<br />
Hadj Omar Tall qui a combattu la présence française sur le territoire. Jean Louis Triaud<br />
dit que: « Ses descendants spirituels passeront pacte avec le colonisateur. Les Français ont<br />
judicieusement utilisé la confrérie. »7 Mais c'est à un autre marabout toucouleur El Hadj<br />
Malick Sy que l'on doit d'avoir introduit le Tidjanisme en pays ouolof. Il est né en 1855 à<br />
Gaya, près de Dagana, dans un Waalo intellectuellement influencé par la Mauritanie. Il<br />
fait le pélerinage de la Mecque, puis s'installe, successivement à Saint-louis, dans le<br />
Gandiolais, à Pire, à Ndiarndé où il se fixe de 1895 à 1902 Y donnant le plein de son<br />
enseignement à des disciples qui viennent de tous les cvoins du territoire. Puis, le chef<br />
religieux se fixe définitivement à Tivaouane, en plein coeur du Cayor, au faîte de sa<br />
notoriété.<br />
Lorsqu'il meurt en 1922, il laisse derrière lui, beaucoup de disciples auxquels<br />
il a longuement enseigné la rhétorique et l'éxégése, mais aussi beaucoup d'écrits soit des<br />
commentaires du Coran, soit de la littérature, soit des chansons à la gloire du Prophète<br />
de l'Islam, Mohamet (Paix et Salut sur Lui). Sa succession ne fut pas facile et les<br />
rivalités internes de sa famille se répercutent, par la suite, sur l'unité même de la<br />
confrérie et ceci jusqu'à Dakar.<br />
Comment s'est-il développé à Dakar, le mouvement esquissé par<br />
l'enseignement religieux d'El Hadj Malick Sy ?<br />
D'après Ibrahima Marône, c'est tout juste un an après la disparition du<br />
Mawdo 8 qu'est créé à Dakar, le premier dahira 9 à l'initiative d'une dizaine de fidèles.<br />
Ce groupement est, à l'origine, un simple canal de relations. Il est dénommé "dahiratoul<br />
kirame tidjaniya". Son siège est au 60 de l'avenue William Ponty à Dakar, mais ses<br />
réunions se tiennent chez El Hadj Ibra Ndiaye Diop, au boulevard de la République.<br />
C'est dans le local où siège l'association que El Hadj Malick était auparavant<br />
hôte lors de ses rares venues à Dakar. Ce premier dahira est important dans l'historique<br />
du développement de la confrérie à Dakar car, très vite, il connait une extension<br />
remarquable dans un contexte politieo-religieux dominé par les divisions relatives à<br />
l'affrontement Galandou Diouf/Lamine Guèye lesquels briguent la succession du<br />
député Blaise Diagne mort en 1934. Les forces religieuses sénégalaises, plus ou moins<br />
directement, prennent parti dans ce conflit. L'après deuxième guerre mondiale et les<br />
7. Jean Louis Triaud, cours de DEA Connaissance Tiers-mondes, 1985-1986, Université Paris VII<br />
8. Terme ouolof désignant le sage.<br />
9. Mot ouolof d'origine arabe désignant groupement religieux.<br />
181
ivalités politiques SFIO de Lamine Guèye et BDS de Senghor se répercutent aussi sur<br />
la confrérie, et jusqu'à Dakar où la dahiratoul kirame tidjaniya se brise sur ce conflit.<br />
Ibrahima Marône passe en détails, dans son étude sur la confrérie tidjane, le<br />
processus qui conduit à cette dislocation. D'après lui, une tendance fidèle au Khalife<br />
Ababacar Sy, premier successeur d'El Hadj Malick Sy, tient à extirper du dahira "les<br />
mauvais éléments". Ceux-là s'opposent violemment aux manoeuvres des partisans du<br />
Khalife. Ils se constituent en une autre association dénommée "Ahmadiya" qui installe<br />
son siège social chez El Hadj Mansour Sy, frère du Khalife Ababacar Sy. Cette division<br />
se manifeste concrètement par le refus de ce clan de rendre visite, en 1950, au Khalife<br />
de Tivaouane Ababacar Sy, lors de la grande cérémonie religieuse du gamou annuel lO .<br />
Cette grande manifestation, à laquelle viennent participer les Tidjanes du pays entier,<br />
rend publique la division de la confrérie. Lorsque, au gamou de 1951, ce sont les frères<br />
même du Khalife qui refusent de lui rendre visite, or cette cérémonie revêt valeur<br />
d'allégeance au chef spirituel, ainsi la division est vraiment consommée d'autant que les<br />
dissidents organisent à part, un autre gamou.<br />
Cette division ouverte des Tidjanes donne lieu à des pamphlets, des<br />
moqueries, des insultes, des chansons rivales obscènes et même des affrontements<br />
physiques sanglants. Lorsque, le 5 mars 1952, à la mosquée d'EIHadj Malick Sy de<br />
Dakar 11 , en pleine prière, de violents incidents se produisent parmiles participants, on<br />
mesure à quel point, les clans dakarois sont devenus antagonistes. C'est ainsi que le 6<br />
mars 1956, dans la ville sainte de Tivaouane, capitale de la confrérie, «ily eut 2 morts, 6<br />
blessés graves, 34 blessés légers, 373 habitations détmites, 90 tonnes d'arachide brûlées, 17<br />
arrestations opérées. »12 Parmi les divers clans, il est fondé de se demander ce qu'est<br />
devenu la recommandation du fondateur à propos de l'unité de la confrérie. Le 23 ,<br />
décembre 1956, lorsque la cour d'assises de Dakar juge ces incidents du 6 mars, la ville<br />
sainte est véritablement en état de siège et Dakar sous haute surveillance policière.<br />
Lorsque le verdict tombe, condamnant à de lourdes peines de prisons et d'amende les<br />
partisans du Khalife Ababacar Sy, surtout, le mécontentement de ce dernier se<br />
manifeste par un communiqué traduisant son indignation. L'unité de la confrérie tidjane<br />
demeure largement compromise.<br />
Le 29 mars 1957, Ababacar Sy meurt à Tivaouane. Quatre jours plus tard, on<br />
annonce la mort de son frère et rival El Hadj Mansour Sy. Les querelles de la confrérie<br />
prennent, par suite, de la conjonction de faits, une dimension nouvelle car le problème<br />
de la succession au Khalifat arrive au premier plan, dans un contexte de profonde<br />
division. Toutes les tentatives de réconciliation entre les tendances échouent. Le<br />
gouvernement Mamadou Dia se croit même interpellé au point de devoir publier un<br />
10. Cérémonie annuelle à la mémoire de la naissance du Prophète Mohamet.<br />
11. Située à l'avenue Maginot.<br />
12. Ibrahima Marône, Le Tidjanisme au Sénégal, op. cit., p. 204.<br />
182
. Dès sa création, le mouvement mouride qui, par l'enseignement et par la<br />
pratique même du fondateur, accorde une grande place au travail de la terre, imprime à<br />
la culture de l'arachide une grande dynamique, à la joie du colonisateur. Mais dès la fin<br />
de la seconde guerre mondiale, le front pionnier de l'arachide se fixe comme le constate<br />
le géographe Paul Pélissier 17<br />
Cette stabilisation du front pionnier arachidier se traduit par un important<br />
changement de caractère du mouvement mouride qui devient essentiellement urbain.<br />
Beaucoup d'adeptes se glissent alors vers les villes et particulièrement à Dakar. Ils sont<br />
attirés par les activités de commerce de détail dans les marchés car Dakar, de ce point<br />
de vue, leur offre d'énormes possibilités.<br />
En somme, c'est un mouridisme urbain qui s'amorce ainsi.<br />
Le recensement démographique de Dakar, en 1955, chiffre les mourides à 20<br />
% de la population totale. Ils sont 25.781, constitués à 85 % par des Ouolofs.<br />
L'étude de Momar Coumba Diop sur la confrérie mouride 18 est<br />
particulièrement intéressante sur son aspect d'implantation urbaine, y compris les<br />
années d'après indépendance. Elle distingue trois formes de Dahiras : le dahira de<br />
quartier, le dahira scolaire et le dahira regroupement. Si les dahiras de quartier ont<br />
comme activités principales, l'organisation de chants religieux à l'occasion des dates<br />
marquantes de la confrérie, les dahiras regroupement revêtent une autre forme. Ils<br />
permettent aux talibés mourides qui travaillent dans la même entreprise ou dans le<br />
même service administratif, de s'organiser culturellement etlou économiquement.<br />
Sur les marchés dakarois, les dahiras mourides constituent des noyaux<br />
importants de ce qui peut être considéré comme un syndicalisme des marchés. En effet,<br />
ces commerçants mourides, par les dahiras qui ressemblent à bien des égards aux<br />
dahiras tidjanes, sont des canaux de revendications et d'organisation en tant que groupes<br />
de pression. Le syndicat des petits commerçants de Dakar doit beaucoup, dans son<br />
implantation et son dynamisme, à ces dahiras regroupements qui se fédèrent pour mieux<br />
organiser la solidarité entre ses membres, mais surtout pour assumer la solidarité à<br />
l'égard des chefs de la confrérie à Touba : la capitale du mouridisme. Ces organisations<br />
mourides à Dakar, tout comme dans les autres villes du Sénégal, jouent un rôle<br />
déterminant dans l'organisation annuelle du magal, la plus grande cérémonie de la<br />
confrérie, celle qui annuellement, marque le retour d'exil du fondateur. A cette<br />
occasion, les organisations urbaines mourides mobilisent des moyens humains,<br />
financiers et matériels considérables.<br />
Le mouridisme urbain se double aussi d'une autre dynamique dont l'ampleur<br />
est considérable: c'est celle d'un projet politique mouride. Ce projet se fonde sur un des<br />
17. P. Pélissier, Les paysans du Sénégal.<br />
18. Mornar Coumba Diop, La confrérie rnouride..., 1980.<br />
----._-- -<br />
184 .
Xassaïds 19 , selon lequel, Ahmadou Bamba Mbacké prédit que le Sénégal sera dirigé,<br />
après un certain Senghor, par des talibés mourides. Selon Mactar Ndiaye, l'un des chefs<br />
mourides de Dakar, qui le rapporte à Momar Coumba Diop20, la prédiction connait un<br />
début de réalisation puisque le premier président du Sénégal fut Senghor. Le Xasaïd a<br />
bien parlé de ce nom.<br />
Cependant, on constate que le mouvement mouride ne donne pas naissance,<br />
pendant la période, à un mouvement politique.<br />
Mais, il est certain que si ce projet politique donnait naissance à un parti, ce<br />
dernier disposerait d'atouts énormes: l'unité directionnelle du mouvement mouride qui<br />
n'est pas éclaté en plusieurs centres, mais aussi de la solidarité organisationnelle dont<br />
font preuve les mourides, en ville comme à la campagne. Il est évident qu'un tel parti<br />
poserait de sérieux problèmes pour l'unité même de la nation. Mais, même sans parti<br />
politique, le rôle des mourides dans la vie sociale du pays et à Dakar, particulièrement,<br />
est très important dans la période étudiée. C'est ainsi qu'en début septembre 1958,<br />
lorsque l'agitation bat son plein au Sénégal en vue du référendum du 28 septembre,<br />
Mamadou Dia, chef du gouvernement, de retour de l'étranger débarque à Yoff, il se fait<br />
immédiatement conduire à Touba. Au cours de l'entretien qu'il a aussitôt avec le chef<br />
de la confrérie mouride, il s'entend dire fermement, le choix fait par la Communauté<br />
mouride, qui à travers son chef, se prononce en faveur du "oui" lequel est déjà annoncé<br />
aux fidèles à titre de consigne de vote. La présence du chef du gouvernement lui offre<br />
seulement l'occasion de la porter sur les antennes de la radiodiffusion 21 . Le chef du<br />
gouvernement n'a d'autre choix que de s'y conformer eu égard au poids moral du chef<br />
religieux dans le pays, surtout quand cette position s'accorde avec celles de diverst)<br />
autres chefs religieux.<br />
Un autre fait marquant l'influence du chef de la confrérie mouride se produit<br />
à l'occasion de l'élaboration et de l'adoption de la constitution sénégalaise après le<br />
référendum de 1958. Des autorités religieuses sénégalaises demandent à être consultées<br />
sur le projet mais le gouvernement refuse car Mamadou Dia craint une orientation<br />
droitière de la constitution. Plusieurs chefs religieux, regroupés dans le cadre du Conseil<br />
Islamique, interviennent alors auprès du Général de Gaulle à Paris. Le Khalife des<br />
mourides dénonce cette démarche du Conseil Islamique. Il apporte ainsi un véritable<br />
soutien au gouvernement de Mamadou Dia et creuse en même temps le tombeau de ce<br />
Conseil Islamique. Ainsi donc, le chef religieux des mourides, Falilou Mbacké, apporte<br />
par delà sa personne, le poids effectif des mourides sur l'échiquier politique sénégalais.<br />
Le mouvement mouride est moins important à Dakar que celui des Tidjanes. Cela<br />
s'explique par le caractère d'urbanisation très récent du mouridisme jusque là orienté,<br />
19. Chants religieux composés ou supposés l'être par le fondateur de la confrérie mouride.<br />
20. Momar Coumba Diop, op. CiL,<br />
21. "Paris-Dakar", 4 septembre 1958.<br />
185
principalement, vers les campagnes. Mais, la crise de la culture arachidière accentue<br />
notablement l'implantation urbaine de cette confrérie.<br />
IV/LA CONFRERIE HAMALLITE<br />
Il s'agit en fait, d'un sous-ensemble de la confrérie tidjane. Le Hamallisme<br />
est né au Soudan, à Nioro du Sahel, en plein fief de la famille Omar Tall, vers 12_00.<br />
Son fondateur est Sidi Momamed Ben Abdallah Cheikh Akhdar. Il prône un<br />
tidjanisme pur. Mais, c'est surtout le disciple Cheikh Hamallah qui marque le plus,<br />
l'histoire du mouvement religieux puisqu'il porte même son nom. L'intéressé prêche la<br />
supériorité de la mystique sur l'érudition. Mais c'est surtout l'homme qui fait changer la<br />
direction de la Kibla en faisant prier vers Nioro et non plus vers vers la Mecque 22<br />
L'agitation spirituelle qui a suivi la naissance de ce mouvement religieux<br />
donne naissance, à Nioro, à des incidents graves. Se sentant menacés dans leur propre<br />
fief, les autorités omariennes présentent Cheikh Hamallah et ses adeptes comme des<br />
éléments dangereux pour l'ordre public, en raison du caractère agressif de leur nouveau<br />
prosélytisme. Les autorités coloniales arrivent vite à la rescousse en prononçant pour<br />
une période de dix ans, l'internement administratif de Cheikh Hamallah par l'arrêté<br />
2639 bis du 28 novembre 1925 du gouverneur général Carde. Interné d'abord en<br />
Mauritanie, Cheikh Hamallah est transféré par la suite en Côte d'Ivoire puisqu'il<br />
continue à influencer la région de Nioro du Sahel 23 , Cependant, dix ans d'internement<br />
n'ont pas eu raison de la vie du chef. Il revient à Nioro après sa libération.<br />
Mais son influence que les années de prison ont fortement grandie, continue<br />
à gêner les Omariens. De nouveaux incidents sanglants éclatent dans la période de<br />
l'administration vichyste. Le gouverneur général, Pierre Boisson, décide, le 19 juin 1941,<br />
d'un nouvel internement du chef religieux. Deux jours plus tard, le 21 juin, Cheikh<br />
Hamallah, enchaîné, lui est présenté au palais du gouvernement général à Dakar, en<br />
présence d'une assemblée de chefs religieux islamiques convoqués pour la circonstance.<br />
Au gouverneur général qui lui demande les raisons pour lesquelles il ne veut pas rester<br />
tranquille comme le font les chefs religieux présents devant lui, la réponse de Cheikh<br />
Hamallah ne se fait pas attendre: «J'attends toujours des preuves de ma culpabilité. Ces<br />
marabouts ne veulent pas être enchaînés publiquement comme mo4 et moi, je ne voudrais<br />
pas être comme eux. Leurs poitrines acceptent vos médailles. Je n'accepterai jamais vos<br />
médailles sur ma poitrine. »24 Après cette entrevue, le chef religieux est conduit à Alger<br />
puis à Montluçon en France où il meurt le 16 janvier 1943 dans l'isolement total. Sa<br />
22. J. C Froelich, Les musulmans d'Afrique, 1%2, p. 239.<br />
23. Alioune Traoré, Contribution à l'étude de l'Islam, 1975, p. 159.<br />
24. Ibidem, p. 205.<br />
186
famille n'est informée de son décès que quatre ans plus tard. Le quotidien dakarois<br />
l'annonce seulement le 7 août 1947.<br />
La dimension du mouvement hamaliste à Dakar est fournie par le<br />
recensement de 1955 qui chiffre à 500 personnes, le nombre de ses adeptes. J. C<br />
Froelich 25 dit qu'ils sont, à travers le Sénégal, seulement quelques milliers pendant la<br />
période.<br />
Quelle est l'influence de ces quelques adeptes hamallistes à Dakar?<br />
L'administration leur consacre beaucoup de notes. Le rapport annuel de la<br />
Délégation de Dakar de 1949, indique que le mouvement religieux est traversé à Dakar<br />
par deux tendances rivales. Elle recommande une surveillance, la 'plus étroite possible,<br />
des croyants dont l'activité peut constituer une sérieuse menace à l'ordre public2 6 . Ce<br />
même rapport note le mécontentement général né chez ces Hamallistes et « dû au fait<br />
que depuis quelques temps, ils ne peuvent rendre visite au Moghadem Fodé Abdoulaye<br />
Doucouré, interné à la prison civile de Dakar. » Cette grande figure du mouvement à<br />
Dakar est emprisonnée par décision administrative.<br />
Un an auparavant, un rapport de l'administration note les diverses tentatives<br />
de réconciliation, demeurées infructueuses, pour calmer le conflit entre deux chefs du<br />
mouvement à Dakar: l'Imam Mohamed Diaby de la mosquée hamalliste et Mohamed<br />
Ould Chérif, frère de Cheikh Hamallah. l'une de ces tentatives de réconciliation,<br />
présidée par le Moghadem Fodé Bakary Touré, a lieu en présence d'un autre frère du<br />
fondateur du mouvement, Chérif Baba Haïdara. La réunion à laquelle participent tous<br />
les Hamallistes de Dakar, n'a pas le résultat escompté à savoir la réconciliation. Ainsi, il<br />
est décidé, sur proposition de Cheikh Baba Haïdara, que les deux chefs religieux<br />
quitteront Dakar pour mettre fin au conflit et que, de Nioro même, viendra une<br />
personnalité pour prendre en main la direction locale du Hamallisme 27 .<br />
Le mouvement hamalliste n'a qu'une faible influence à Dakar. Cependant,<br />
ses divisions internes préoccupent largement l'administration parce que les luttes de<br />
clan aboutissent souvent à des incidents graves.<br />
V/LA CONFRERIE KADIRIYA.<br />
Elle est née en Mauritanie, dans la région de Boutilimit. Au Sénégal, elle est<br />
représentée par la famille des Kounta, installée au village de Ndiassane, à une dizaine<br />
de kilomètres de Tivaouane.<br />
Cette confrérie a été la première à compter des adeptes dans le Fouta Toro.<br />
Mais, le fait que son armature principale, c'est à dire ses cadres, soient de la famille<br />
25. op. Cit., p. 245.<br />
26. Rapport annuel de la Délégation de Dakar, Aff. polit. AOF, ANS, 2G 49-123, 1949.<br />
27. Aff. polit. AOF, ANS, Rapport 2G 48-117,1948.<br />
187
Ibrahima Marône note, qu'entre 1949 et 1951, c'est un total de 22.974.000 F<br />
CFA que l'administration distribue aux chefs religieux. De même, Moriba Magassouba<br />
note aussi des relations particulières entre l'administration et les chefs religieux en<br />
écrivant, à propos de la campagne du référendum de 1958 : « Les marabouts qui ne<br />
veulent pas entendre parler d'indépendance, trouvent un soutien résolu en la personne du<br />
gouverneur Lami dont la porte et les subsides leur étaient largement ouvertes. »37<br />
Cependant des nuages peuvent subsister dans les rapports entre<br />
l'administration et les chefs religieux. ce fut le cas, lorsque par arrêté, le gouverneur<br />
général, en juillet 1951, abaisse les limites d'âge scolaire en AOF. Les marabouts et<br />
l'ensemble des forces islamiques y voient un acte anti-islamique tendant à empêcher les<br />
enfants africains de suivre un enseignement coranique. A ce moment là, le climat est<br />
déjà tendu à la suite de la promulgation du décret Jacquinot sur la femme africaine alors<br />
qu'un député chrétien (Senghor) vient tout juste d'être élu au Sénégal. Ces mesures et<br />
ces faits donnent un tonus particulier à l'association "Combat pour la défense de<br />
l'Islam". Une conférence des chefs de l'Islam est convoquée à Dakar, le 8 janvier 1952,<br />
et conclut à « La gravité de l'heure » décidant en conséquence de développer une<br />
véritable réplique à cette "croisade anti-islamique". La situation est suffisamment<br />
inquiétante pour l'administration qui indique: « Le rapprochement des grands marabouts<br />
et leur plan d'action... ne sont pas sans importance. Ils risquent de créer une dangereuse<br />
psychose de "Défense de la religion" dans la population musulmane. »38 L'administration<br />
discernant le danger, s'active par la suite pour casser ce front islamique, en jouant<br />
surtout sur les rivalités des différentes composantes du mouvement. L'administration<br />
dispose aussi d'une autre carte maîtresse qui est l'organisation, sous sa tutelle, du<br />
pèlerinage aux lieux saints de l'Islam.<br />
Par cette responsabilité, elle peut accorder ou refuser le voyage à qui elle<br />
veut. Les services de sûreté sont étroitement mis à contribution pour la délivrance de<br />
ces véritables autorisations accordées au compte goutte. Moins de 100, au total, sont<br />
accordées en 1947 (52 pour un voyage par la voie maritime et 29 par l'avion). En 1949,<br />
103 autorisations sont accordées sur 250 demandeurs inscrits.<br />
Ce contrôle donne lieu à diverses démarches des chefs religieux auprès de<br />
l'administration ainsi qu'auprès des élus pour qu'il soit moins ctif. Les musulmans<br />
constatent que l'organisation du pélerinage est trop policière car les intéressés sont non<br />
seulement triés au départ, mais sont également surveillés pendant tout le pèlerinage.<br />
Les raisons du caractère restrictif imposé au pélerinage sont données par le<br />
chef de la mission du pèlerinage, en 1954, qui écrit: « '" Un moyen de contacts, une sorte<br />
de grandes assises où les idées sont confrontées et échangées, des mots d'ordre lancés en<br />
faveur de l'unité du monde arabe... Notre pays, l'Afrique noire, semble une cible de choix.<br />
37. Moriba Magassouba, L'Islam au Sénégal, 1985.<br />
38. Ra ort 4eme trimestre 1952, Délégation de Dakar, Aff polit. AOF, ANS Dakar, Service de police et sûreté.<br />
190
»39 L'auteur de ces propos est le chef de bataillon Amadou Fall. Haut cadre de l'armée<br />
coloniale, ce Sénégalais ne fait rien d'autre que mettre l'administration en garde sur les<br />
conséquences du pélerinage.<br />
Les marabouts ne tiennent pas leur puissance du seul soutien de<br />
l'administration. En effet, ils disposent de moyens économiques importants tirés de la<br />
culture de l'arachide dont ils sont les plus gros producteurs car, par le travail des<br />
Talibés, ils disposent d'une force de travail importante et gratuite. En outre, ces<br />
marabouts disposent aussi d'une part non négligeable des revenus urbains de leurs<br />
adeptes par le canal de ces diverses associations religieuses que sont les "dahiras". Paul<br />
mercier, chef de la mission sociologique de Dakar, note l'existence de 19 associations<br />
religieuses dans la capitale en 1955. Pour lui, ces associations, déclarées, ne sont que<br />
peu de choses au regard de celles qui ne sont pas déclarées : dans « La plupart des cas,<br />
les associations de cette nature n'étaient pas déclarées, donc ne pouvaient pas faire l'objet<br />
d'un recensement. »40 Ces associations constituent de solides piliers économiques et<br />
financiers des marabouts. Il est vrai aussi que, parfois, les marabouts doivent venir en<br />
aide aux talibés.<br />
Au total, les relations entre les confréries islamiques et l'administration ont<br />
joué un grand rôle dans le contexte des années 1945-1960. De manière générale, ces<br />
relations ont été bonnes. Mais, en certaines circonstances, des occasions de conflit ont<br />
existé. Cela s'explique par le fait que les intérêts convergent largement, surtout entre les<br />
chefs islamiques et cette administration.<br />
VII/ LE REFORMISME ISLAMIQUE<br />
L'UCM (Union Culturelle Musulmane) est créée à Dakar, en 1953, dans le<br />
but de réformer l'Islam en Afrique noire.<br />
Ses initiateurs sont des jeunes, anciens élèves boursiers des municipalités de<br />
Dakar et de Saint-louis, de retour au Sénégal. El Hadj Cheikh Touré, ancien élève de<br />
l'école Ben Badis de Constantine, centre de formation des maîtres de l'association des<br />
oulémas d'Algérie, en est le chef de file. Dès sa création, l'association lance un<br />
Manifeste qui est publié en français par l'imprimeur dakarois, A Diop. Le manifeste<br />
s'intitule: «Afin que tu deviennes un croyant. »41 J. C Froelich remarque que ce texte<br />
n'a jamais été publié dans un ouvrage européen, preuve du peu d'intérêt qu'il a<br />
représenté ou de la méfiance qui l'a entouré. L'intérêt du texte est pourtant évident. Le<br />
manifeste, après avoir fait le constat du retard des populations africaines, s'exprime ainsi<br />
: «Si l'on regarde attentivement, on constate [00'] que les maux dont elles souffrent [...] que<br />
39. C. Coulon, Le marabout et le Prince, 1981, p. 153.<br />
40. P. Mercier, Contributions à la sociologie, 1968, p. 129-130.<br />
41. J.C. Froelich, Le réformisme de l'Islam en afrique noire, Déc 1961, p. 83.<br />
191
président de l'UCM, comprend sept associations 43 dont l'UCM est la plus importante.<br />
Ces initiatives réformistes islamiques aboutissent à la convocation d'un congrès<br />
interterritorial qui se tient à Dakar du 22 au 25 décembre 1957. Le congrès débute ses<br />
travaux par un véritable meeting populaire, en plein coeur de la Médina, au cinéma<br />
Rex, boulevard de la Gueule Tapée, avec 800 auditeurs 44 .<br />
De hautes personnalités musulmanes sont présentes,; parmi elles, Seydou<br />
Nourou Ta1l 45 grande figure dakaroise et El Hadj Ibrahima Diop, grand Serigne de<br />
Dakar. La suite des travaux a lieu à la Maison des jeunes et de la culture de Dakar.<br />
l'importance du congrès tient au fait que c'est la première fois que le mouvement<br />
islamique, en AOF, tient une assise d'une telle envergure. d'importantes résolutions et<br />
motions sont adoptées. La résolution générale exige la suppression immédiate des<br />
importations de boissons alcooliques, dénonce l'action néfaste du bureau des affaires<br />
musulmanes dans son activité contre l'expansion de l'Islam en Afrique noire, condamne<br />
le colonialisme qui cultive le fatalisme chez les populations en refusant de combattre<br />
l'ignorance pour mieux asseoir sa domination. Le congrès demande aussi que le<br />
vendredi, jour saint de l'Islam, soit férié, chômé et payé pour permettre aux travailleurs<br />
musulmans de pouvoir accomplir leurs obligations religieuses. La guerre d'Algérie est<br />
dénoncée comme une entreprise colonialiste. Le congrès exige, en outre, que les<br />
responsables des événements sanglants de Bamak0 46 soient châtiés, rend hommage à<br />
Sékou Touré chef du gouvernement de Guinée pour sa sollicitude. Par son orientation<br />
et son activité, ce mouvement de l'UCM est aux yeux de l'administration, un mouvement<br />
extrêmiste, surtout lorsque, en 1958, aux côtés du P.AJ, du PRA-Sénégal, de l'UGTAN<br />
et des étudiants, elle prône le "non" au référendum. L'administration qui la considère<br />
comme un pion à la fois communiste et nassérien en Afrique, exerce une surveillance<br />
étroite sur les relations extérieures du mouvement. Cette surveillance va jusqu'à la<br />
confiscation des postes radio par lesquels certains membres peuvent capter Moscou et le<br />
Caire. c'est à une rude tâche de contrôle que se livre l'administration, en raison du<br />
nombre de postes radio, en accroissement, du reste dans la population africaine. Elle<br />
contrevient aussi à ses propres règles qui n'interdisent pas l'écoute d'une station de<br />
radio étrangère. Par contre, il lui est plus facile de censurer la presse écrite ce qui se<br />
traduit par la saisie des organes de presse imprimés, à caractère de propagande<br />
islamique, venant notamment d'Egypte ou du Liban. C'est ainsi que, entre les mois de<br />
mars et de mai 1953, la sûreté dakaroise confisque divers envois de journaux et<br />
brochures en langue arabe. Les journaux saisis sont: "AI AIam" (31 mars, 23 avril, 30<br />
43. Fiche 32.<br />
44. F. Quesnot, Op. Cit., p. 47.<br />
45. Seydou Nourou Tall, dans son allocution devant le congrès, remercie l'administration qui facilite le pèlerinage,<br />
construit des mosquées, arbitre les conflits et autorise les chants religieux.<br />
46. Les 17 et 18 mai 1957. Plusieurs morts. L'administration est soupçonnée d'être à la base des incidents.<br />
193
avril, 4 mai), "Afrique Levant" (30 avril et 4 mai)47. Des matériaux en provenance de la<br />
F.S.M, des mouvements culturels ou de la jeunesse des pays communistes et destinés à<br />
l'UCM sont également saisis par les autorités dakaroises.<br />
Un organe de la presse métropolitaine, "Revue de la Communauté France<br />
Eurafrique,,48, proche de la droite, explique l'importante activité de l'UCM par<br />
l'influence que les communistes y exercent. Le gouverneur général de l'AOF discerne,<br />
lui, une autre cause: « L'évolution a des bases d'idées proche-orientales et à tendance<br />
xénophobe et nationaliste. Le Wahabisme réfonniste a son influence la plus nette au sein<br />
des collectivités noires islamisées. »49<br />
Naturellement, il n'y a pas que l'administration qui essaie d'endiguer ce<br />
courant islamique réformiste. Les chefs islamiques locaux, eux-aussi, cherchent à freiner<br />
le mouvement dont le déploiement d'activités, particulièrement à Dakar, leur semble<br />
être une menace pour leur puissance établie.<br />
C'est la raison pour laquelle ils s'organisent en fondant, en 1957, un outil de<br />
riposte appelé "Ligue de défense de l'Islam". Cette nouvelle organisation est présidée<br />
par El Hadj Seydou Nourou Tall, porte-parole des traditionnalistes et homme<br />
particulièrement lié à l'administration; à ses côtés, on trouve aussi El Hadj Ibrahima<br />
Niasse, autre figure du tidjanisme, très influent dans le bassin arachidier. d'autres chefs<br />
islamiques de Tivaouane et de Dakar y participent. De ce point de vue, cette "Ligue de<br />
défense de l'Islam" apparaît comme une manoeuvre administration-confrérie tidjane.<br />
Cette ligue ne fait pas long feu car les dissensions internes la minent. Lorsque plusieurs<br />
des piliers de cette ligue glissent, un an plus tard, sur le terrain politique, par la<br />
constitution d'un parti politique islamique, on peut dire que le mouvement réformiste,<br />
engagé par l'DCM, peut avoir de longs jours devant lui puisque l'outil créé pour le<br />
contrer s'est effondré. Son développement ultérieur l'atteste. Ce réformisme islamique<br />
accorde une place de choix à l'enseignement qu'il dispense dans des écoles créées sur le<br />
modèle européen, à Dakar et dans le reste de l'AOF. Les ouvrages, utilisés dans ces<br />
établissements scolaires, sont importés d'Egypte surtout. L'état-major chiffre à un<br />
millier le nombre d'élèves qui est touché par cet enseignement à Dakar. A ceux-ci,<br />
s'ajoutent quelques milliers qui suivent tant bien que mal, l'enseignement dispensé aux<br />
portes des mosquées 50 .<br />
Pour ce mouvement réformiste, l'Islam est un facteur de progrès car « les<br />
pays arabes qui ont embrassé les premiers la religion musulmane passent pour les plus<br />
civilisés du monde.»51 Le réformisme est donc un mouvement puissant par ses activités<br />
aux dominantes anti-colonialistes et anti-maraboutiques.<br />
47. Aff. Polit AOF, ANSOM, carton 2230, dos4.<br />
48. N° de février 1959.<br />
49. R. de Benoist, l'Afrique occidentale, op. cit., p. 429.<br />
50. Fiche 32, p. 4, Notice état-major AOF.<br />
51. Ibidem.<br />
194
prêtres européens pour 11 autochtones)4. L'Eglise dakaroise accorde une grande place<br />
à la fonction d'enseignement et à la culture. Ses organes de presse, qu'il s'agisse de<br />
"Afrique Nouvelle" ou "Horizons Africains", publient régulièrement ses effectifs scolaires<br />
à Dakar, tout comme ses succès aux différents examens primaires et secondaires. Ces<br />
journaux traduisent ainsi ses multiples efforts dans le domaine de l'éducation. Ses<br />
moyens en la matière lui sont procurés, pour une large part, par le gouvernement<br />
général de l'AOF, sous la forme de subventions. Ceci ne manque pas d'attirer<br />
l'animosité sur l'Eglise dakaroise qui fut à plusieurs reprises violemment attaquée par<br />
des laïcs, par des syndicats d'enseignants, par le C.J.S, par les associations musulmanes<br />
etc... Sur ce point, les organes "Afrique Nouvelle" et "Horizons Africains" assurent une<br />
ferme défense de l'action éducative de l'Eglise. Des procès ont même été intentés à ce<br />
sujet, sans oublier les correspondances et circulaires aux responsables locaux à travers la<br />
fédérationS. L'Eglise dakaroise bénéficie aussi d'importants moyens financiers<br />
provenant des fonds du FIDES. Parfois, lorsque certains financements lui sont refusés<br />
par l'Assemblée Territoriale par suite de la pression des différents secteurs favorables à<br />
l'orientation de l'ensemble des crédits publics à l'école laïque, mais l'Eglise obtient<br />
toujours les financements sollicités par l'intermédiaire du FIDES.<br />
L'Eglise dakaroise entretient toujours d'étroites relations avec la hiérarchie<br />
musulmane sénégalaise. Le Père Roger de Benoîst confirme, en réponse à une question<br />
posée à ce sujet que la presse de l'Eglise évite toujours d'attaquer l'Islam, pour<br />
préserver les bons rapports entre les deux communautés religieuses dominantes. D'après<br />
lui, il est arrivé même que les journalistes locaux de cette Eglise refusent de publier des<br />
articles du chef de la chrétienté dakaroise, Mgr Lefèbvre, parce que ceux-ci sont jugés<br />
offensant à l'égard de l'Islam.<br />
Les conférences épiscopales, régulièrement tenues à Dakar ou ailleurs dans<br />
la Fédération, permettent à cette Eglise de se mettre au diapason sur les principaux<br />
événements politiques et syndicaux. Ainsi, elle intervient dans l'enseignement et dans la<br />
presse, tout comme dans les oeuvres sociales et dans le secteur de la jeunesse, l'Eglise<br />
accorde une grande importance aux relations dans le monde du travail. C'est ainsi que<br />
ses appuis vont à la centrale syndicale de la C.F.T.C (Confédération africaine des<br />
travailleurs croyants). Cette centrale syndicale a très souvent des positions contraires à<br />
celles de la CGT largement majoritaire dans le monde du travail dakarois. Mais, on<br />
remarque aussi qu'en certaines circonstances, les positions entre les syndicats ont<br />
convergé malgré des positions contraires de l'Eglise.<br />
En somme, l'Eglise catholique dakaroise a un rôle particulièrement<br />
important dans cette période. Sa solidité se perçoit notamment à travers un fait<br />
relativement anodin au départ, à Dakar, mais dont les conséquences ont, par la suite,<br />
4. Louis Axel, Les dangers du panislamisme en Afrique noire, 1958, pAl.<br />
5. Voir le contenu des journaux, ne partie, chap nI.<br />
197
des répercussions sur le gouvernement de Paris, lui- même. C'est la question du procès<br />
intenté à Dakar, au journal "Afrique Nouvelle", organe de l'Eglise dakaroise. Ce procès,<br />
est lié à la publication par le journal du déroulement d'un autre procès intenté à un<br />
autre journal dakarois, "Les Echos d'Afrique noire"; il a même failli entraîner la<br />
démission du gouvernement lorsque l'Assemblée Nationale française a décidé de le<br />
sanctionner pour son attitude dans cet événement. Le Père Roger de Benoîst insiste sur<br />
le fait que seule la situation politique particulière de l'époque n'a pas entraîné le<br />
renversement du gouvernement 6 . C'est dire à quel point les relations extérieures de<br />
l'Eglise dakaroise sont puissantes.<br />
Sur le plan politique, on note, à Dakar, d'une certaine manière, certes<br />
indirecte, une intervention de l'Eglise dans ce domaine. En effet, en 1958, la création<br />
dans la capitale fédérale du M.L.N (Mouvement de libération nationale) par d'anciens<br />
responsables étudiants catholiques, est perçue à Dakar comme une tentative de la<br />
hiérarchie catholique d'avoir, par ce parti, un outil politique spécifique.<br />
A Dakar, il existe aussi une Eglise protestante. Ses adeptes sont peu<br />
nombreux. La notice de l'état-major les chiffre, sur la base du recensement de 1955, à<br />
environ 500 personnes 7 . Cette Eglise protestante dispose, dans la capitale fédérale, d'un<br />
temple dans la rue Thiers, et d'une mission dans la rue de Bayeux. Son poids est faible<br />
aussi que celui de l'Eglise catholique de rite maronite qui recrute ses adeptes surtout<br />
dans la communauté libanaise de la capitale et qui dispose, depuis 1953, d'une chapelle:<br />
Notre Dame du Liban située dans la nouvelle zone urbaine, au Front de terre.<br />
6. Voir les problèmes de la presse, ne partie, chap III, entretien avec l'intéressé à Dakar en décembre 1988.<br />
7. Fiche 32, état-major de l'AOF, 1959.<br />
198
un mois à l'avance, elle se précipitera vers le garage pour commencer une journée de loisirs<br />
qui ne laisse place à aucun choix. »8 Cette "gentry" dakaroise ne dispose pas directement,<br />
d'un organe de presse. Cependant, l'officieux quotidien dakarois, "Paris-Dakar" qui<br />
traduit les positions de l'administration, exprime ainsi largement ses vues. D'autre part,<br />
cette "gentry" dispose dans la presse métropolitaine vendue à Dakar, d'appuis très<br />
solides avec des journaux comme "Climats" dont le fondateur, Chevance Bertin, députè,<br />
est un élu de la droite col9niale en Guinée. Cette publication, par sa défense acharnée<br />
de la colonisation pure et dure, est en plein accord avec les vues de cette "gentry"<br />
dakaroise. Chevance Bertin, lui-même, a largement pignon sur rue à Dakar où il est un<br />
très grand propriétaire foncier. Un autre organe de presse, "Marchés coloniaux", sert<br />
également de porte-parole à la "gentry" dakaroise. Chacun des articles que la rédaction<br />
consacre, régulièrement, aux problèmes de la Fédération, est un moyen d'expression de<br />
ce groupe, notamment ceux qui sont publiés autour de la bataille pour le code du travail<br />
et des allocations familiales. Ce "Tout Dakar" connaît parfois des difficultés internes à<br />
ses membres à cause des rivalités et de luttes d'influence. En ce sens, les conflits entre la<br />
SCIMPEX et l'UNISYNDI, au sujet des questions sociales des travailleurs prennent<br />
souvent un caractère de conflit ouvert nécessitant parfois même l'intervention des<br />
conciliateurs pour calmer la situation. C'est le cas, en mars 1949, lorsqu'il faut fixer les<br />
nouveaux salaires des employés européens, par suite de la hausse du coût de la vie. Dans<br />
le domaine administratif également, cette "gentry" dakaroise n'est pas exempte<br />
d'animosités et de conflits même s'ils sont moins feutrés. A ce sujet, Michel Jobert<br />
consate : « L'indiscipline était fréquente et je n'avais finalement que mépris pour ces<br />
fonctionnaires coloniaux qui, par lettres personnelles adressées à Paris, essayaient de saper<br />
l'autorité de leur chefsans avoir le courage de l'affronter. ))9 Cette couche de la population<br />
dakaroise n'exprime pas d'hostilité ouverte à l'égard du processus politique conduisant à<br />
l'indépendance. L'un de ses porte-parole les plus écoutés, Charles Henry Gallenca,<br />
président de la Chambre de commerce de Dakar, depuis la mort de Tascher, en 1955,<br />
manifeste toute la sérénité de ce milieu par ses propos : «... L'expérience de ces derniers<br />
mois nous a montré que telles sont et seront les caractéristiques du pouvoir des responsables<br />
des nouveaux Etats de l'Afrique noire d'expression française, et en même temps, nous les<br />
félicitons vivement. »)0 L'organe de la section sénégalaise du PAI voit dans ces<br />
félicitations que Gallenca adresse aux gouvernements africains de la Loi-Cadre, un<br />
indice de la soumission totale de ces pouvoirs aux grands intérêts économiques<br />
coloniaux.<br />
En somme, la "gentry" dakaroise joue un rôle très important dans la<br />
naissance et la manifestation de l'opinion publique de la ville; ce rôle est d'autant plus<br />
8. Revue internationale de la FOM, Mai 1957.<br />
9. Michel Jobert, Op. Cit.<br />
10. "Momsarew" N"2.3.<br />
201
grand qu'elle peut s'appuyer, largement, pour satisfaire ses intérêts, sur la couche<br />
inférieure de la population européenne de la ville.<br />
202
enquêtées reconnaissent cet aspect; preuve évidente de l'existence d'une forte solidarité<br />
des travailleurs blancs contre les travailleurs africains, notamment à l'encontre des<br />
autochtones qui ont poursuivi de hautes études.<br />
Au plan de l'habitat, ce petit colonat vit, à Dakar, dans son splendide<br />
isolement, exactement comme la "gentry" dakaroise, même si les zones sont loin d'être<br />
les mêmes à cause des différences de niveau de vie. Tout comme la "gentry", ce petit<br />
colonat organise aussi ses divertissements propres. C'est ainsi que de nombreuses<br />
associations sont constituées: Club breton, Club corse, Club des 3 "B" (Basque, Béarn,<br />
Bigorre) etc... A ce niveau, aussi, certaines associations traduisent une consécration de<br />
la promotion au sein même du groupement blanc comme par exemple la qualité de<br />
membre du Rotary club ou à défaut du Lions' club.<br />
Donc, isolement social, isolement géographique, tout ceci est renforcé par le<br />
fait que le colonat, en général, le petit particulièrement, ignore "superbement" les<br />
langues locales, se privant ainsi -à dessein- d'un moyen privilégié de communication et<br />
de compréhension avec les autochtones.<br />
Les femmes ne sont confrontées à aucun problème d'emploi - exactement<br />
comme les maris - car elles trouvent toujours un poste de secrétaire, de caissière,<br />
dactylo, de comptable, ou vendeuse etc... Cet emploi des femmes est important dans la<br />
mesure où il procure un second salaire au couple; il est généralement utilisé pour faire<br />
face aux dépenses courantes du ménage. Le salaire du mari, en général plus substantiel<br />
peut ainsi fournir d'importantes économies à transférer en métropole, dans la situation<br />
avantageuse du change entre le franc CFA et le franc métropolitain; ceci explique<br />
l'obsession des "économies" remarquée par Paul Mercier 4 . Michel Jobert a passé 20<br />
mois à la colonie en économisant sou par sou: «Rentré à Paris, avec les mêmes valises du<br />
départ, j'avais suffisamment économisé pour m'acheter une Dauphine et prendre des<br />
vacances »5.<br />
Dans ce groupement européen de la population dakaroise, on se reçoit<br />
beaucoup et toutes les études qui lui sont consacrées l'affirment. Tout cela autour d'une<br />
table où on met les petits plats dans les grands et où, pour un repas, tout jusqu'à la<br />
salade, vient de la métropole. On dispose même d'un boy cuisinier et d'une<br />
blanchisseuse africaine prouvant ainsi que l'on gravit les échelons de la structure sociale,<br />
surtout pour des gens qui viennent essentiellement des régions pauvres de France. Au<br />
cours des repas, les conversations vont bon train sur des sujets qui sont invariablement<br />
les mêmes: le nègre. Chacun cherche à surpasser l'autre dans les "preuves" de l'idiotie<br />
du "grand gamin". Ainsi, des histoires plus fantastiques, les unes<br />
-<br />
les autres circulent de<br />
salon en salon à travers la ville. Des journaux: propres à ce colonat ouvrent même de<br />
véritables concours à la "meilleure nouvelle". Les colonnes des "Echos d'Afrique noire"<br />
4. Ibidem, p. 135.<br />
5. Michel Jobert, Mémoires d'avenir, op. ciL, P.lll.<br />
204
CHAPITRE X : AUTRES GROUPES DE PRESSIONS<br />
Dans la période étudiée, on note aussi l'existence de divers autres groupes de<br />
pression dans la capitale fédérale de l'AOF. Ils sont soit régionaux, soit ethniques, soit<br />
tout simplement de ville ou autres... Leur importance dans la vie de la ville est souvent<br />
fonction des événements dans lesquels ils peuvent être plus ou moins impliqués.<br />
Il LES GROUPEMENTS A CARACTERE ETHNIQUES ET REGIONAUX<br />
On en compte un certain nombre dans la ville, comme, par exemple:<br />
- l'amicale des Oualo-Oualo : association créée à Dakar et regroupant<br />
uniquement dès originaires de cette région du Sénégal appelée le Oualo dont la ville<br />
principale est Dagana, sur la vallée du fleuve. Le président de cette association est<br />
Massogui Bâ. Selon les renseignements de police, cette association est née entre les<br />
deux guerres. Au début de décembre 1944, les services de police notent que dans une<br />
large fraction de l'opinion publique de la ville, l'association -mais particulièrement son<br />
président- est considérée comme étant un bon collaborateur de l'administration 1 . Le<br />
rapport fait état de l'esprit de la population à propos des événements ayant entraîné la<br />
mort de plusieurs tirailleurs africains dans le camp de Thiaroye, à l'aube de la nuit du 30<br />
novembre au 1 er décembre. Selon cette source, le président de l'amicale a reçu divers<br />
messages téléphonés anonymes dans lesquels l'attitude de l'association est<br />
vigoureusement dénoncée car elle n'a pas pris position contre la fusillade dont ont été<br />
victimes ces tirailleurs dont le seul tort était de revendiquer leurs droits. La sûreté<br />
dakaroise note aussi que Massogui Bâ a été l'objet de propos sarcastiques de la part de<br />
plusieurs notables de la ville qui se sont publiquement exprimés devant lui, et qu'il est<br />
reproché à l'Amicale d'avoir tenu, quelques jours avant la tuerie de· Thiaroye, une<br />
réunion à la Chambre de commerce de Dakar et à cette occasion, d'avoir voté à<br />
l'unanimité une motion de soutien et de loyalisme à l'égard de la France. Alors que<br />
lorsque des événements aussi graves concernent les Africains, elle garde le silence total.<br />
Cette association, par la suite, devient l'un des piliers de LS. Senghor et de<br />
son parti dans la capitale, particulièrement dans les années 1948-1956.<br />
1. Renseignements généraux 1944, dossier 1/2 D3 nO 21, Incidents de Thiaroye, Police el sûreté, Aff. polit. AOF<br />
207
- L'amicale des Toucouleurs: Elle regroupe une autre ethnie de la vallée du<br />
fleuve Sénégal, les Toucouleurs. Pendant de longues années, son président d'honneur, à<br />
Dakar, est le chef religieux El Hadj Seydou Nourou Tall. Cette grande figure du milieu<br />
toucouleur de la ville est un descendant direct du grand résistant et chef religieux, El<br />
Hadj Omar TalI. Ces Toucouleurs sont nombreux dans la ville puisque le recensement<br />
de 1955, indique qu'ils représentent 12,2 % de la population africaine de la capitale c'est<br />
à dire presque autant que l'élément lébou de la ville 2 . C'est une amicale aux activités<br />
nombreuses dans la capitale de l'AOF mais qui, par ses structures directionnelles, est<br />
proche de l'administration coloniale; tout particulièrement son président d'honneur qui<br />
est à plusieurs reprises, chargé, par l'administration, de missions diverses à travers la<br />
Fédération, notamment dans la fonction officielle d"'Imam général des troupes noires".<br />
Par cette charge, il parcourt les casernements, pendant la 2 eme guerre, pour prôner le<br />
loyalisme et la discipline dans l'armée coloniale.<br />
Dans les luttes politiques, cette amicale apporte un soutien non négligeable à<br />
la formation dissidente de la SFIO: c'est à dire le RD.S.<br />
On note également, à Dakar, l'existence de plusieurs groupements comme les<br />
associations de Sérères, de Baol-Baol, de Casamançais etc... Certaines associations<br />
divisent même leur communauté ethnique en structures rivales surtout dans les luttes<br />
politiques. Leur influence sociale est notable quoique elle ne soit pas toujours facile à<br />
cerner avec précision. D'autres groupements ethniques de non natifs du Sénégal sont<br />
notés dans la ville de Dakar dont les fonctions économiques et administratives<br />
entraînent la venue, dans la capitale, de nombreux Bambaras (3% de la population),<br />
Eburnéo-béninois (1 % de la masse africaine) et des Voltaïques. Ces groupements<br />
ethniques se sont constitués en diverses associations à Dakar.<br />
. Les associations léboues.<br />
Enfin, dans ces associations à caractère ethnique, incontestablement une<br />
place particulière revient à celles des Lébous dont l'influence est déterminante dans la<br />
politique de la ville.<br />
leurs associations sont de deux sortes:<br />
- les anciennes structures,<br />
- les nouvelles organisations.<br />
Ces associations sont à la fois ethniques et régionales dans leurs<br />
caractéristiques principales.<br />
Les anciennes structures:<br />
- Les diambours : ce sont les anciens, les vieux, dans le milieu lébou. Dans la<br />
politique et la vie sociale de la République léboue, ces hommes constituaient une<br />
2. Abdoulaye Diop, L'immigration Toucouleur à Dakar, 1959, p.13.<br />
208
accusés par certains lébous d'avoir la main-mise sur la Municipalité. Lamine Guéye<br />
n'échappe pas aux reproches puisque de nombreux Lébous l'accusent d'avoir facilité<br />
cette main-mise. Ils ne sont pas tous à la SFIO puisque dans le parti rival, le B.D.S, une<br />
association d'originaires de la ville de Saint-louis se constitue à Dakar. Les rapports de<br />
police notent en février 1949, deux organisations de vin d'honneur à Dakar par deux<br />
associations rivales de ressortissants saint-Iouisiens. L'un des vins d'honneur est organisé<br />
pour Senghor et l'autre est fait en hommage à Lamine Guéye. L'administration a même,<br />
en la circonstance, des soucis de sécurité puisque ces deux vins d'honneur sont organisés<br />
presque côte à côte dans le quartier de la Médina.<br />
Lorsqu'en en 1958, le transfert de la capitale du Sénégal de Saint-louis à<br />
Dakar par le gouvernement Mamadou Dia, entraîne une véritable atmosphère d'émeute<br />
dans la ville de Saint-louis, à Dakar même, la collectivité saint-Iouisienne s'associe à la<br />
dénonciation de cette décision dont les effets négatifs pour Saint-louis sont trop<br />
évidents.<br />
D'autres associations de Thiessois, de Kaolackois, de Diourbelois etc...<br />
pèsent aussi, plus ou moins fortement, sur la vie sociale à Dakar.<br />
III/ LE CONSEIL MONDIAL DE LA PAIX.<br />
Cette association est présente à Dakar. Ses activités sont attestées par<br />
certains organes de la presse locale et aussi par des sources administratives.<br />
"Reveil" titre: « Malgré le déploiement spectaculaire et provocateur des forces<br />
de répression, les partisans de la Paix dakarois rendent hommage aux fusillés de Thiaroye<br />
»5. Le journal note surtout le jeu de cache-cache par lequel ce groupement réussit à<br />
ridiculiser la sûreté dakaroise : « Le Haut commissaire a dû piquer une crise de rage<br />
lorsque ses inspecteurs, commissaires et autres lui ont rendu compte, en fin de matinée, que<br />
déjouant la police, les partisans de la Paix venaient de tenir la cérémonie prévue, mais non<br />
plus à Thiaroye, mais au monument aux morts, place Protêt, en plein centre de Dakar, à<br />
quelques mètres des directions des Affaires Politiques et de l'Intérieur et du Gouvernement<br />
Général ». Le lendemain, c'est au lieu initialement prévu que le Comité dépose, en toute<br />
tranquillité et solennellement une gerbe de fleurs. La police dakaroise qui pense que<br />
tout est terminé, a levé son impressionnant dispositif mis en place la veille. Jusqu'en<br />
1959, les activités de cette association sont encore signalées à Dakar. C'est ainsi que la<br />
revue de la Communauté France-Eurafrique indique qu'une cinquantaine de<br />
ressortissants d'AOF ont participé, à divers congrès internationaux de ce mouvement, de<br />
1941 à 1958. Parmi ceux-ci, 13 ont participé, à Stocholm au congrès sur le désarmement<br />
et la paix mondiale, en juillet 1958, et 7 autres en décembre 1957, à la conférence afro-<br />
5. "Réveil" du 27 février 1950.<br />
210
asiatique, organisée par le Conseil de solidarité des peuples d'Afrique et d'Asie, au<br />
Caire.<br />
La Délégation rapporte l'organisation d'une conférence tenue à Dakar, le 22<br />
septembre 1948, sous l'égide du Comité des Partisans de la Paix et à laquelle 800<br />
personnes participent. Le conférencier est le professeur Dresch de la Sorbonne, de<br />
passage à Dakar 6 . La notice de l'état-major insiste également sur les importantes<br />
activités de ce Comité en 1959 à Dakar, raison pour laquelle le professeur Abdoul<br />
Moumini, président du Conseil mondial de la Paix dakarois, est porté à la vice<br />
présidence de cette organisation internationale dont le siège est à Vienne. Avant lui,<br />
Ndéné Ndao, ancien fonctionnaire des P.T.T assure la présidence de la branche<br />
aofienne de ce mouvement mondial 7 . Mais ces activités ne plaisent pas à<br />
l'administration; le gouvernement général de Dakar interdit par l'arrêté nO 3366/int/<br />
AP du 31 décembre 1952, les revues et publications de ce Conseil mondial de la Paix,<br />
sur toute l'étendue du territoire de l'AüF. Ce conseil a exercé une certaine influence sur<br />
les activités du CI.S, du CI.A, des syndicats d'enseignants etc... C'est dire que son rôle<br />
fut loin d'être négligeable à Dakar, surtout dans la permanence du souvenir de Thiaroye<br />
comme Cimetière des martyrs. Cette influence s'est largement exercée sur les milieux<br />
nationalistes dakarois.<br />
IV/LE COMITE DE DEFENSE DES LIBERTES DEMOCRATIQUES.<br />
Il est créé à Dakar à l'annonce des événements d'Alger, en mai 1958. Il<br />
regroupe des forces de gauche, à Dakar, puisque le P.A.I, l'UGTAN, le C,J.A et le C,J.S,<br />
tout comme l'UGEAO, le Mouvement de la Paix et le Groupes d'Etudes et des Réalités<br />
africaines en sont membres. La création de ce comité s'explique par la peur que les<br />
événements d'Alger font naître dans les milieux progressistes dakarois. Ses initiateurs<br />
constatent : «Les fascistes préparent activement l'instauration d'un gouvernement de<br />
dictature. En Afrique, les panisans de la réaction appellent ouvertement à soutenir les<br />
contre-révolutionnaires d'Alger »8.<br />
Cette peur locale s'explique par le fait qu'une agitation assez intense<br />
parcourt la ville. Le colonat dakarois publie de nombreux tracts dans la ville et constitue<br />
même un Comité de Salut Public dans lequel des militaires, des civils et autres<br />
administratifs se retrouvent et appellent à soutenir les généraux d'Alger. Certes le<br />
gouverneur général Gaston Cusin multiplie les mises en garde à l'endroit de ce Comité<br />
211<br />
6. Rapport 2G 48-117,1948.<br />
7. A ne pas confondre avec son cousin Amadou Ndéné Ndao du CJ.S et du S.U.E.L, Inspecteur de l'enseignement,<br />
retraite.<br />
8. R. de BenoÎst, L'Afrique occidentale... op. cit., P.619.
CONCLUSION PARTIELLE.<br />
Outre ces principales forces passées en revue, il en existe à Dakar, d'autres<br />
qui sont de moindre importance, mais, toutes constituent des groupes de pression plus<br />
ou moins actifs. Les études du sociologue Paul Mercier, indiquent 215 associations<br />
africaines reconnues.<br />
Solange Faladé dans son étude sur la femme dakaroise10, MomarCoumba<br />
Diop parlant du mouvement mouride dans son mode d'implantation urbaine11,<br />
Ibrahima Marône se consacrant à la confrérie tidjane 12 , Christian Coulon analysant les<br />
relations entre marabouts et le pouvoir 13 , tout comme Colette La Cour Grandmaison se<br />
penchant sur les stratégies matrimoniales des femmes dakaroises etc... mettent l'accent<br />
sur l'importance de la vie associative en milieu africain à Dakar. Ces associations et ces<br />
groupements européens constituent des forces de pression. Exactement comme les<br />
partis politiques, les syndicats, les associations de jeunesse, les organisations d'étudiants,<br />
l'Eglise et les marabQuts, tout comme les organisations à caractère économique... Tout<br />
cela montre que Dakar des années 1945-1960, connait une multitude de groupes de<br />
pression ou "faiseurs" d'opinion. Certes, les influences de ces divers groupes de pression<br />
ne sont pas égales, mais tous s'activent et participent à la richesse de la scène dakaroise<br />
qui se comprend mieux en découvrant les moyens d'information, de communication et<br />
d'expression de ces groupes de pression.<br />
C'est l'objet de la partie suivante de notre étude.<br />
10. Solange Faladé, Femmes de Dakar et de son agglomération, 1960.<br />
11. Momar Coumba Diop, La confrérie mouride... 1980.<br />
12. Ibrahima Marône, Le Tidjanisme au Sénégal, janvier 1971.<br />
13. Christian Coulon, Le marabout et le prince, 1978.<br />
213
DEUXIEME PARTIE<br />
MOYENS D'INFORMATION, DE COMMUNICATION ET<br />
D'EXPRESSION.<br />
L'étude de ces moyens s'impose dans la mesure où, par leur intermédiaire,<br />
les groupes de pression ou "faiseurs d'opinion", interviennent pour la satisfaction de<br />
leurs intérêts propres. Ces moyens sont divers. Ce sont: la radiodiffusion, la presse, le<br />
téléphone, le télégraphe et le courrier, mais aussi à l'opposé de ces moyens modernes,<br />
les moyens traditionnels comme le tam-tam, la chanson, l'habillement et le "fanal". Ces<br />
derniers se nourrissent de l'insuffisance et/ou de l'inadéquation des premiers.<br />
214
217<br />
L'année 1950, marque une étape nouvelle dans le développement de Radio<br />
Dakar. En effet, à la suite de longues et difficiles négociations, le gouvernement général<br />
de l'AOF et l'agence Havas parvenaient à un accord par lequel l'agence Havas/France<br />
presse est chargée de confectionner un journal parlé présentable pour un programme<br />
quotidien de huit heures.<br />
Une nouvelle fois, la radiodiffusion déménage à Dakar en venant s'installer<br />
dans un local sis angle avenue de la République et de la rue Felix Faure. Dès lors, on<br />
peut entendre, à travers toute la fédération, ces mots «Ici Radio-Dakar à Dakar ».Dès<br />
l'année suivante, le quatrième déménagement a lieu. La radio vient s'installer au 58,<br />
Boulevard de la République où deux chaînes furent mises en route le nouvel immeuble<br />
de Radio-Dakar est achevé en 1953 avec les crédits du FIDES. Cette date est<br />
importante parce qu'elle marque vraiment la naissance d'une radiodiffusion digne de la<br />
capitale fédérale de l'AOF. Jacques Sol Rolland en est le directeur. Les deux chaînes<br />
permettent de toucher un public plus large. La chaîne" Inter" s'adresse surtout à<br />
l'élément européen de la fédération, par son programme en langue française. Certains,<br />
dans les milieux africains de la ville, l'appelaient la "radio des toubabs". La chaîne, dite<br />
régionale ou "radio des Africains", émettait dans diverses langues ouest africaines<br />
comme le Ouoloff, le Fon, le Mossi, le Soussou, le Bambara, le Baoulé, le Sarakollé<br />
etc...« Pour instruire, distraire et éduquer les populations autochtones»8. En 1957 cette<br />
chaîne régionale émettait pour 48 heures par semaine alors que l'autre n'émettait que<br />
24 heures. Elle utilisait deux émetteurs en ondes moyennes et en ondes tropicales, ce<br />
qui lui permettait essentiellement de couvrir le Sénégal, le sud de la Mauritanie, le nord<br />
de la Guinée.La chaîne inter ou fédérale disposait, elle, de quatre émetteurs couvrant<br />
toute l'étendue de l'AOF et émettant en ondes moyennes pour l'un et en ondes<br />
tropicales pour l'autre, les deux autres servant pour les ondes courtes 9 .<br />
Quotidiennement Radio-Dakar réalisait, à cette époque, cinq bulletins d'information.<br />
Les sources de l'animation sont variées comme l'indique la Revue internationale de la<br />
FOM consacrée au centenaire de la ville. Ce sont<br />
- des programmes métropolitains réalisés par la RTF (Radio Télévision<br />
française) pour l'auditoire métropolitain, mais dont une sélection est reprise par Radio<br />
Dakar. Durée 10 h et demi par semaine; soit environ 1/7 du temps d'émission total.<br />
- des émissions de variétés réalisées à Dakar<br />
- des éléments d'émission enregistrées dans les territoires à l'intention de la<br />
chaîne fédérale par les reporters et producteurs dakarois.<br />
Ces deux dernières catégories d'émission représentaient environ 60 heures<br />
par semaine.<br />
8. Ibidem<br />
9. Revue internationale de la FOM, Numéro spécial Centenaire de Dakar, Mai 1957.
Jacques Sol Rolland, directeur de Radio-Dakar indiquait, dans ce numéro<br />
spécial sur Dakar de la revue de la FOM, que dans des circonstances particulières, des<br />
émissions spéciales étaient réalisées par la radio comme ce fut le cas pour les élections<br />
du 31 mars 1956 renouvelant les assemblées territoriales.A cette occasion et pendant<br />
toute la durée du dépouillement, Radio-Dakar a pris contact, et en direct, toutes les dix<br />
minutes, avec un chef lieu de territoire. L'émission s'était poursuivie pendant 12 heures<br />
consécutives. Elle avait permis de faire connaître les résultats progressivement dans<br />
l'ensemble du territoire fédéral.Toujours d'après le directeur de la radiodiffusion de<br />
l'AOF, tous les dimanches, une émission spéciale était réalisée. Intitulée "Bonsoir<br />
l'Afrique, ici Dakar", elle constituait un lien entre les territoires, à partir de 20 heures<br />
30. Une station prenait en charge, l'émission pour une soirée; ce qui permettait à<br />
chaque territoire de présenter au reste de la Fédération son folklore, ses coutumes, ses<br />
événements marquants etc...<br />
C'est dire que progressivement, l'équipement arrive à la portée de tous les<br />
territoires de la Fédération. Selon J.P. Biyiti bi Essam, l'AOF était divisée en quatre<br />
grandes zones<br />
* l'Ouest Mauritanie-Sénégal-Guinée,<br />
* l'Est Togo-Dahomey,<br />
* le Nord Soudan-Haute Volta-Niger,<br />
* le Sud Côte d'Ivoire et territoires limitrophes.<br />
Dakar, Bamako, Abidjan et Cotonou étaient les centres d'émission, pour<br />
leurs zones respectives. Radio-Dakar continuait, bien entendu, à couvrir les besoins de<br />
toute l'étendue de la fédération. Tout ceci avait été facilité par l'installation, à<br />
Yeumbeul, dans la banlieue dakaroise, d'un puissant centre émetteur. Lorsque le 1er<br />
novembre 1958 la station régionale de Radio-Saint-Louis commence ses émissions, cette<br />
couverture radiophonique fut plus grande.<br />
Au point de vue administratif, le décret du 14 septembre 1954 portant<br />
organisation de la radiodiffusion Outre-mer, avait mis en place la SORAFOM (Société<br />
de Radiodiffusion de la France d'Outre-mer). L'objectif assigné à cette structure était<br />
de faciliter l'amélioration et le développement de la radio dans l'ensemble des<br />
territoires de la FOM.Un arrêté intervenu le 18 janvier 1956 portait application du<br />
décret de 1954 sur la SORAFOM. Pour la direction de la radiodiffusion dakaroise, la<br />
formation d'un personnel adéquat s'imposait. D'où l'envoi en métropole, dès septembre<br />
1955, d'une trentaine de stagiaires à l'école de Maison-Lafitte, près de Paris, pour la<br />
technique et l'animation des programmes. Ce stage dura 9 mois.<br />
Parlant du personnel de la radiodiffusion M.A de SuremaÏn écrit «<br />
L'encadrement syndical des journalistes était réduit. En AOF, il existait une section du<br />
syndicat national des journalistes de France, section qui ne regroupait qu'une quinzaine de<br />
218
membres dont beaucoup travaillaient à la radiodiffusion »10.Quant aux travailleurs<br />
africains de la radiodiffusion de Dakar, leurs conditions de vie et de travail étaient<br />
difficiles. Leur congrès, tenu à la mairie de Dakar du 1 er au 3 juillet 1957, avait<br />
regroupé une centaine de délégués. Diverses personnalités politiques avaient répondu à<br />
l'invitation des congressistes parmi lesquelles L.S. Senghor, Sékou Touré et Adandé le<br />
secrétaire général du parti de la Convention africaine. A propos de ce congrès,<br />
l'hebdomadaire parisien "Marchés Tropicaux" notait «... Le rapport introductif a<br />
constitué un véritable réquisitoire contre la SORAFOM et notamment contre son directeur<br />
général et en faveur d'une organisation en AOF, d'une radio africaine détachée de la<br />
métropole... Les congressistes ont insisté pour une africanisation des cadres et une mission<br />
plus éducative de la radiodiffusion )1.<br />
11/ LA QUESTION DE L'ECOUTE.<br />
En matière d'infrastructure, les progrès ont été importants pour la<br />
radiodiffusion de Dakar. Cette question n'a d'intérêt réel qu'en rapport avec les moyens<br />
d'écoute c'est à dire la réception; c'est la question de l'écoute.<br />
On peut dire que dans la population dakaroise, surtout indigène, la<br />
possession d'un poste récepteur était un fait rarissime, particulièrement dans les<br />
premières années de l'existence de la Radiodiffusion à Dakar. Il faut disposer de<br />
l'électricité à domicile ce qui n'est pas souvent le cas dans les habitations, ou alors d'une<br />
pile d'alimentation. A l'époque ces piles sont de taille encombrante et s'épuisent très<br />
rapidement, la recharge n'est pas facile et le coût de l'opération reste élevé. Le prix du<br />
poste, lui-même, n'est pas à la portée de tout un chacun. Ces difficultés nombreuses<br />
sont peu surmontables pour la grande masse de la population indigène de la ville. Par<br />
contre, l'élément européen de Dakar réunit dans sa quasi-totalité les conditions<br />
d'acquisition d'un poste radio récepteur habitat avec électricité, mais surtout relative<br />
aisance matérielle permettent cet équipement.<br />
Combien de postes récepteurs sont disponibles à Dakar?<br />
La réponse est fonction de la période considérée dans ces années 1945-1960.<br />
Quelques renseignements sont fournis par les sources administratives et en particulier la<br />
direction fédérale des postes qui a charge de percevoir la taxe annuelle de 1.000 F CFA<br />
dont chaque détenteur de poste Radio doit s'acquitter.<br />
En 1935, c'est à dire bien avant la création de la radiodiffusion de Dakar, il y<br />
avait, dans l'ensemble de l'AOF, 529 postes récepteurs 12 d'après le rapport du service<br />
des réseaux radiotélégraphiques de l'AOE<br />
10. MA de Suremaïn, L'indépendance politique du Sénégal, 1989, P.lO.<br />
11. "Marchés Tropicaux", n° 608 du 6 juillet 1957.<br />
12. Affaires politiques AOF, ANS, 2G 36-15. Année 1936.<br />
219
La situation était la suivante de 1935 à 1939 en AOF<br />
Années<br />
1935<br />
1936<br />
1938<br />
1939<br />
Nombre de postes récepteurs<br />
529<br />
808<br />
1529<br />
1961<br />
Après la fin de la seconde guerre mondiale, l'AOF connait une progression<br />
rapide dans l'équipement de ces postes récepteurs car dans desrapports de 1952, 1953<br />
et 1954, la direction fédérale des postes et télécommunications donne les chiffres<br />
suivants pour le nombre de postes récepteurs déclarés -elle précise bien "déclarés" ce<br />
qui laisse entendre que d'autres ne le sont pas- et leur répartition géographique.<br />
TERRITOIRES ANNEE ANNEE ANNE<br />
1952 1953 1954<br />
Délégation de Dakar 2726 - -<br />
Sénégal 1616 5114 7645<br />
Côte d'r"voire 934 1214 1610<br />
Guinée 13 597 977 1129<br />
Mauritanie 190 - -<br />
Niger 328 455 574<br />
Soudan 927 1232 1566<br />
Haute Volta 196 216 460<br />
Dahomey 268 402 475<br />
Totaux 7782 9610 12859<br />
A travers ces chiffres, la répartition des récepteurs entre Européens et<br />
Africains n'apparaît pas. Mais il paraît évident que les Européens, à au moins 90 à 95%,<br />
en sont les détenteurs dans la phase 1935-1939 surtout.Dans la phase 1945-1954,<br />
certainement le rapport s'atténua au profit des Africains peut-être avec 60 à 70 %. Pour<br />
la gestion 1952, nous remarquons l'importance du poste "Délégation" avec environ 35%<br />
des récepteurs (2726 sur 7782).14<br />
Les gestions 1953 et 1954 ne font pas ressortir le poste "Délégation" c'est à<br />
dire Dakar et sa banlieue. Tout laisse croire à son intégration à "Sénégal-Mauritanie"<br />
dont la progression est très importante (1952 Sénégal = 1616 et Mauritanie = 190;<br />
1953 = 5114 pour Sénégal-Mauritanie et 7045 en 1954). Cette progression dépassant les<br />
13. Affaires politiques AOF, ANS, 2G 52-22 (1 à 4) et 2G 54-11 qui concerne 1953 et 1954.<br />
220
400 % n'aurait pour seule explication qu'une intégration du poste "Délégation" à<br />
l'ensemble "Sénégal-Mauritanie" comme poste.<br />
Le regroupement Sénégal-Mauritanie en tant que poste n'est pas un fait<br />
particulier au service des postes et télécommunications. Il en est de même sur le plan<br />
syndical.<br />
Cette importante progression du nombre de postes récepteurs surtout en<br />
1953-1954 est due, d'après le rapport de la direction fédérale, au fait que d'importants<br />
travaux d'équipement ont été effectués, au profit des centres émetteurs et récepteurs<br />
fédéraux. La mise en service du centre de Yeumbeul au cours du 1er trimestre de 1954<br />
et le transfert à Rufisque du centre récepteur, au dernier trimestre de l'année, attestent<br />
de cet équipement. Ces différents travaux permirent au service de la radiodiffusion<br />
d'étendre plus largement la couverture du territoire de l'AOF.<br />
En moyenne, sur ces trois années, 1952, 1953 et 1954, il Y a 10.100 postes<br />
environ. Comparé à la population, ceci donne un poste pour 2000 habitants environ.<br />
Ceci traduit évidemment le caractère presque insignifiant de l'écoute radiophonique, en<br />
AOF, dans la période. Par contre la situation est meilleure à Dakar. Pour la Délégation,<br />
en 1952, il y a 2726 postes récepteurs pour une population chiffrée à 375.000 par la<br />
direction des affaires politiques 7,26 postes /1000 habitants.<br />
Sur le nombre de postes-récepteurs en Afrique, l'UNESCO a fait réaliser<br />
une étude en 1981-1982 pour les années 1960. L'étude "Nombre de postes-récepteurs en<br />
service et/ou de licences délivrées pour 1000 habitants" donne au poste "Sénégal<br />
1960 = 230 postes/lOOO hbts<br />
1970 = 268 postes/1000 hbts,<br />
c'est-à- dire 38 postes supplémentaires en moyenne pour 1000 habitants dans<br />
la décennie. Ceci est dû aux énormes efforts faits par le gouvernement du Sénégal dans<br />
les années 1957-1970 dans la politique d'équipement en postes-récepteurs avec ses<br />
moyens propres mais surtout ceux de la coopération internationale pour mener à bien<br />
sa politique d'animation rurale et urbaine.<br />
Un autre élément permet d'apprécier les efforts de l'équipement<br />
radiophonique en AOF dans la période 1945-1960. Les Comptes économiques de<br />
l'AOF pour l'année 1956 donnent en F CFA<br />
* Pour radio-émetteurs 38 millions<br />
* pour radio-récepteurs 81 millions<br />
* pour piles électriques 159 millions<br />
* pour pièces radio 20 millions 15<br />
Cette évolution permet d'aborder d'autre part, la question de l'écoute qui est<br />
aussi celle de la motivation, c'est-à-dire du désir des gens d'écouter les émissions de la<br />
15. Rapport n° II du Haut commissariat de l'AOF, Mars 1959.<br />
221
adio. C'est en d'autres termes, le problème de la préparation psychologique. A cette<br />
dernière, s'ajoute également un autre élément les émissions doivent être comprises et<br />
assimilées. Le facteur intellectuel est très étroitement lié au facteur psychologique.C'est<br />
très certainement pour répondre à ces deux facteurs que les autorités responsables, à<br />
Dakar, intègrent les langues locales dans les moyens de la diffusion des nouvelles<br />
comme l'affirme J. Sol Rolland, le directeur de Radio-Dakar., et que Alassane Diop<br />
directeur de la chaîne régionale de Radio-Dakar disait dans une interview au<br />
correspondant de la revue internationale de la FOM «... Pour ce qui est des informations<br />
diffusées sur la chaîne régionale... nous résumons les nouvelles internationales dans de brefs<br />
bulletins rédigés de façon simple et claire. Présentation différente de la chaîne fédérale »16.<br />
Bien entendu, l'administration dakaroise a cherché à pallier l'insuffisance de<br />
postes-récepteurs pour faire davantage passer les informations. C'est ainsi qu'elle a eu<br />
recours au système d'écoute collective qui existe dans la capitale fédérale dès la seconde<br />
guerre mondiale. En 1945 "Paris-Dakar", annonçait à l'occasion de la capitulation sans<br />
conditions de l'Allemagne nazie «Durant toute la journée, les haut-parleurs de Radio<br />
Dakar seront branchés en permanence. Les informations seront annoncées au fur et à<br />
mesure et entre temps, les concerts de musique militaire et de musique de danse seront<br />
donnés... Le gouverneur général parlera à la radio à 20 heures »17.En 1951, il y a encore<br />
des preuves de l'existence de cette écoute collective à Dakar. La revue "AOF", organe<br />
du gouvernement général, s'exprimait en ces termes «C'est la radio en langues<br />
vernaculaires ou en français qui s'adresse de ses haut-parleurs -un peu criards- aux masses<br />
illettrées arrivées hier de la brousse »18.Ces haut-parleurs permettant une écoute<br />
collective des informations se retrouvent dans la vie sociale de Dakar jusqu'à la<br />
proclamation de l'indépendance. Le gouvernement de l'autonomie interne a attaché<br />
une importance particulière à ce moyen de toucher les masses de la ville. Ils sont<br />
branchés aux places publiques les plus importantes des quartiers indigènes de la ville;<br />
ces milieux étant, évidemment, les plus nécessiteux en la matière.<br />
Par la suite, une certaine amélioration du système de l'écoute collective est<br />
opérée avec la télédiffusion dans les premières années de l'indépendance.Avec ce<br />
système, à partir d'un récepteur central, des maisons individuelles sont branchées par<br />
l'intermédiaire d'amplificateurs et de lignes de distribution. Cette expérience, de par les<br />
multiples problèmes qu'elle pose dans les maisons, est abandonnée par la suite.<br />
Quant à la qualité de l'écoute, des éléments de satisfaction ainsi que des<br />
critiques sont notés.<br />
Le rapport annuel de la Délégation en 1953 écrit «La radiodiffusion fédérale<br />
fait de gros efforts et beaucoup de ses récentes réalisations (programmes artistiques,<br />
16. Numéro spécial Centenaire de Dakar, Mai 1957.<br />
17. "Paris-Dakar" du 8 mai 1945.<br />
18. "AOf" n° 2, Mai 1951.<br />
222
etransmissions, reportages) ont élargi le cercle de ses auditeurs »19. En 1953 le journal<br />
"Afrique noire", dans un article intitulé "En écoutant Radio-Dakar" exprimait sa<br />
satisfaction en ces termes «C'est rendre juste hommage au dynamique autant que<br />
sympathique directeur de la radiodiffusion et des informations fédérales en AOF, que de<br />
souligner la complète transformation heureusement subie par les émissions du poste<br />
fédérab,)O. Il remerciait également Radio-Dakar, plus tard 21 , pour avoir tenu compte<br />
des suggestions qui ont été faites par son intermédiaire, sur l'annonce des titres des<br />
disques avant et après leurs émissions. Cependant il ne ménage pas ses critiques sur la<br />
qualité d'une des émissions «Ne dirait-on pas deux concierges de mon quartier parisien ».<br />
Il recommande la suppression de ce dialogue de "vieilles filles combien sottes et si peu<br />
séduisantes". Il demande aussi un peu de rythme et un peu de gaieté dans les<br />
émissions.En août 1953, il porte une critique plus virulente encore sur l'ensemble des<br />
émissions en écrivant « ... Au poste fédéral, le 'Je m'en foutisme" règne en maître »22.<br />
D'autres critiquent l'inadéquation du langage utilisé par Radio-Dakar.L'hebdomadaire<br />
"l'Action", organe central du M.P.S, à propos de l'information dit «Il faut regretter que<br />
l'information ne soit pas mieux adaptée à nos régions où domine l'analphabétisme et où le<br />
niveau de vie très bas ne pennet pas aux habitants de se procurer un poste radio. Alors, les<br />
discours officiels ne sont pas à la hauteur des masses »23. Peu avant l'indépendance, de<br />
multiples critiques portent sur le contenu politique des émissions de Radio-Dakar.<br />
"Echos d'Afrique noire,,24 écrit « Les Européens n'écoutent presque plus<br />
Radio-Dakar... La chaîne régionale est presque exclusivement réservée aux Africains. Nous<br />
demandons l'intervention du Haut commissaire pour que Radio-Dakar cesse d'être un poste<br />
communiste à peine voilé ».Dans une autre livraison, Maurice Voisin se plaignait de la<br />
prééminence trop grande du Sénégal sur Radio-Dakar «Les Sénégalais ont le tort de<br />
croire que toute l'Afrique leur appartient ».<br />
La radio devient un moyen de pression politique utilisé par les autorités<br />
coloniales qui exercent une véritable censure contre les nouvelles autorités de la loi<br />
cadre. C'est le cas par exemple dans le conflit ayant opposé Mamadou Dia, chef du<br />
gouvernement territorial du Sénégal, au Haut commissaire Gaston Cusin, en décembre<br />
1957. Le discours prononcé à l'ouverture de la session de l'assemblée territoriale par<br />
Mamadou Dia avait été refusé d'antenne par le chef de la fédération. Une vive<br />
polémique s'en était suivie. Entre autres éléments constituant cette polémique, il y a<br />
cette lettre particulièrement acerbe du chef du gouvernement territorial 25 .<br />
19. Affaires politiques ADF, ANS, Dakar, 2G 53-183.<br />
20. "Afrique noire" n° 26 du 1er Juillet 1953.<br />
21. Idem, N° 43.<br />
22. N° 42 du 17 août 1953.<br />
23. "L'Action" n° 1, Décembre 1955.<br />
24. N° du 13 janvier 1958.<br />
25. Mamadou Dia, Mémoires d'un militant...op. cit., PP.77-81<br />
223
Les "Echos d'Afrique noire" avaient titré à ce sujet «Le torchon brûle entre<br />
M. Dia et le Haut Commissaire. »26.<br />
Dans le domaine politique l'impact de la radiodiffusion est attesté par ces<br />
propos de Ernest Milcent ancien directeur du journal catholique "Afrique Nouvelle" «<br />
Lorsque le général de Gaulle débarque à Dakar le 26 août 1958, ce que l'on sait de l'accueil<br />
de Conakry a achevé de surchauffer les esprits en pleine ébullition »27.pour ce journaliste,<br />
il est évident que le discours de Sékou Touré mais aussi la réponse du général de Gaulle<br />
ont été particulièrement suivis dans la capitale fédérale, à travers la radiodiffusion.Le<br />
rôle des ondes dakaroises apparaissait aussi comme très important pour chacun des<br />
interlocuteurs de la place Protêt, ce 26 août 1958.<br />
Enfin, toujours au sujet de l'écoute, les éléments suivants -hors de notre<br />
étude, il est vrai- permettent de se faire une idée plus précise.<br />
Une enquête, menée à Dakar en 1962, indiquait que, dans les milieux<br />
salariés, les informations radiophoniques étaient écoutées par 85 % quotidiennement.<br />
23 % les écoutaient en ouolof, 26 % en français, 36 % tantôt en ouolof, tantôt en<br />
français.L'enquête indiquait que l'écoute en ouolof l'emportait très largement en<br />
fréquence sur l'écoute en français 28 .<br />
Une autre étude, réalisée à Dakar en 1964 par l'IFOP/Marconer, signale<br />
l'existence au Sénégal de 180.000 postes récepteurs avec 84 % des auditeurs écoutant la<br />
radio chez eux et 16 % hors de chez eux. Elle montre que la chaîne nationale touchait<br />
une population de 78,92 % des auditeurs alors que la chaîne internationale, elle, n'en<br />
touchait que 56,20 %, et que le public de la chaîne internationale était plus jeune et<br />
d'un niveau d'instruction plus élevé que celui de la chaîne nationale. Cette enquête<br />
réalisée à la demande du BOM (Bureau d'organisation et de méthode) de la Présidence<br />
de la République, indiquait qu'à Dakar, 4% de la population n'écoutaient pas la radio<br />
et 73 % l'écoutaient tous les jours, 16 % plusieurs fois par semaine et 7 % moins<br />
souvent.<br />
Enfin, on note aussi, à Dakar, entre 1945 et 1960, l'existence de liaisons<br />
radiophoniques à caractère privé ou à utilisation particulière. L'Etat-major de l'AOF,<br />
dans son étude sur la presqu'île du Cap Vert signale<br />
- Un système de télécommunication à "liaisons fixes" pour l'aéronautique<br />
avec 17 fréquences H.F réparties dans une gamme de 3000 à 21.000 kilocycles pour les<br />
échanges entre aérodromes, de messages météo et intéressant le trafic maritime<br />
- un système de "liaisons mobiles" avec 4 fréquences en radiotélégraphie<br />
réparties dans la gamme de 3000 à 12.000 kilocycles et la fréquences<br />
radiotéléphoniques dans la gamme de 3000 à 17.000 kilocycles<br />
26. "Echos" du 13 janvier 1958.<br />
27. Ernest Milcent, Aux carrefours des options. africaines, 1965, P.56.<br />
28. Enquête du centre d'études sociologiques de Paris, déjà citée.<br />
224
La presse confessionnelle était présente avec des journaux comme<br />
"Horizons africains" pour les milieux catholiques, "Réveil Islamique" pour les<br />
musulmans et "Maintenir", organe protestant.<br />
Des publications économiques comme les bulletins de la Chambre de<br />
Commerce, des publications scientifiques notamment celles de l'IFAN et de<br />
l'Université,une presse d'information et de loisirs avec des journaux comme<br />
"Bingo", "Ande-dieuf' ,des journaux sportifs paraissaient à Dakar qui avait aussi sa<br />
presse étudiante avec "Dakar Etudiant", "AGE-Presse", ou "Jeunesse d'Afrique"<br />
etc... , sa presse scolaire avec des organes comme "le Petit dakarois", "Gerbe<br />
d'AOF", "le Cap verdien" etc... tout comme aussi sa presse jeune comme "la voix<br />
des jeunes", "jeunesse-liaison" etc...<br />
En somme, une presse diversifiée existait à Dakar animant la vie<br />
politique, économique et culturelle des milieux "lettrés" des territoires ouest<br />
africains de l'Union française.<br />
III/ LA LIBERTE DE LA PRESSE<br />
Cette question revêt une grande importance dans le contexte. Certes,<br />
depuis la fin de la guerre, une législation assurant la liberté de la presse a été<br />
votée par les assemblées métropolitaines et promulguée!'en AOF. Mais entre la<br />
8<br />
législation, elle-même, et la réalité concrète, au niveau local, il y a un large<br />
décalage tout à fait naturel dans une situation coloniale où la totalité des pouvoirs<br />
est détenue par des administrateurs peu enclins à accepter la liberté d'expression<br />
des populations des territoires assujettis. Divers journaux paraissant à Dakar vont<br />
se battre pour le respect de la liberté de presse.<br />
devant les tribunaux,,5.<br />
1) Le procès d' "Afrique nouvelle"<br />
L'organe de la hiérarchie catholique dakaroise titrait ''Afrique nouvelle<br />
La raison de ce titre était «Afrique nouvelle ayant publié le 20 janvier<br />
1951 un article sur le procès des ''Echos d'Afrique noire" et la liberté de presse, le RP<br />
Patemot, directeur et RP Rummelhart rédacteur en chef, se voient assignés par le<br />
procureur de la République, devant le tribunal correctionnel pour le 8 mars 1951 ».<br />
De février à juin, le journal rend compte du procès et de ses suites.<br />
Dans l'édition du 24 février, le journal faisait état de la vive émotion<br />
que cette perspective de procès avait fait naître tant dans la population<br />
5. "Afrique nouvelle du 10 février 1951.<br />
228
européenne que dans la population africaine, aussi bien à Dakar qu'à travers toute<br />
la fédération. Cette émotion a été même partagée en métropole par l'association<br />
des rédacteurs en chef des journaux français qui s'en était saisie par une lettre de<br />
protestation envoyée au Président du Conseil et par divers milieux parlementaires<br />
l'organe annonçait que dix députés, membres de la commission des TOM «<br />
protestaient solennellement et se réservent le droit de porter "l'affaire Afrique nouvelle"<br />
devant l'Assemblée nationale »6.<br />
Après le procès, le journal publie la liste des témoins ayant défilé<br />
devant la barre du tribunal correctionnel pour apporter leur soutien à l'organe de<br />
presse ; les multiples mesures prises par la police et la gendarmerie dakaroise<br />
pour interdire, au public, l'accès au tribunal furent dénoncées.<br />
Le verdict ainsi annoncé «A la stupéfaction du public, ''Afrique<br />
nouvelle" est condamnée, le 15 mars aux dépens et à 50 F d'amende avec sursis pour<br />
le directeur et le rédacteur en chef »7, permet à l'organe catholique de publier<br />
divers témoignages du "plébiscite de la rue" à son égard et deux numéros successifs .<br />
du journal aux dates des 24 mars et 31 mars, firent le compte-rendu analytique du<br />
procès en correctionnelle. Dans la livraison du 21 avril, le journal publiait le texte<br />
d'une motion adoptée par le Conseil de la République, par 147 voix contre 127 qui<br />
demandait le respect de la liberté de presse, l'indépendance de la magistrature et<br />
le respect des règles de gestion des finances publiques dans les T.O.M. Elle était<br />
assortie d'une amputation d'une somme de 1000 F du budget du gouvernement, à<br />
titre de blâme, contre l'action du ministre de la FOMS et du Haut<br />
commissaire.Roger de Benoist confirmait, lors d'un entretien, le caractère<br />
symbolique de la sanction contre le ministre de la FOM qui a cherché à disculper<br />
le gouverneur général de Dakar. Pour lui, le gouvernement, suite à la sanction qui<br />
lui apparaissait comme morale, a voulu donner sa démission après l'adoption du<br />
texte par l'Assemblée nationale. Mais eu égard au contexte politique particulier, la<br />
sanction a été levée pour éviter une crise gouvernementale.L'ancien directeur de<br />
"Mrique nouvelle" expliquait cette sanction par la solidité des appuis du journal<br />
dans les milieux soucieux du respect de la liberté de presse. Il insistait sur le fait<br />
que c'était le seul procès que le journal ait connu.<br />
Les raisons véritables de ce procès seraient ailleurs d'après Me J.C<br />
Legrand du barreau de Casablanca venu à Dakar pour assurer la défense du<br />
journal catholique.<br />
A l'adresse du procureur, l'avocat s'était exprimé dans ces termes «Je<br />
vois ici le bras qui exécute, mais j'ai le droit de chercher la tête qui commande. Car<br />
6. "Afrique nouvelle" du 3 mars 1951.<br />
7. "Afrique nouvelle" du 17 mars 1951.<br />
8. François Mitterand à l'époque, actuel Président de la République française.<br />
229
pour abattre ''Afrique nouvelle" le gouverneur général entend se servir de ses juges. Son<br />
agent, c'est vous /», et n'occultant pas l'aspect politique du procès, l'avocat ajoutait<br />
« ''Afrique nouvelle" gêne le "Proconsul" de la section française de l'internationale<br />
socialiste»9.Le journal apportait diverses preuves du caractère singulier de la<br />
mesure qui le frappait par l'assignation devant la justice le quotidien "Paris<br />
Dakar" était cité comme ayant relaté, 19 fois de suite, entre le 24 janvier et le 23<br />
mars 1949, des débats judiciaires au sujet du procès Kravchenko, sans être<br />
inquiété. De même l "AOF" organe politique de la SFIO dakaroise et le "Réveil",<br />
organe de l'UDS/RDA, avaient publié plusieurs fois des éléments de ce procès<br />
sans être inquiétés par la justice dakaroise. Des procès avaient fait l'objet de<br />
compte-rendus dans des journaux sans que ceux-ci aient fait l'objet d'assignation<br />
alors qu'il s'agissait d'affaires en diffamation jugées à Dakar même.<br />
Ce procès intenté à "Afrique nouvelle" prouvait donc que la justice, à<br />
Dakar, utilisait "deux poids-deux mesures" envers un journal qui osait dénoncer les<br />
violations de la liberté de presse.<br />
2) Le procès des "Echos d'Afrique noire".<br />
En septembre 1950 l'organe titrait "Paul Béchard passe à la contre<br />
offensive et traduit Maurice Voisin devant les tribunaux pour défendre sa police/l lO .<br />
La rédaction du journal rappelait sa position «La police dakaroise ne<br />
défend pas les Blancs parce qu'elle n 'aJTête pas les crapules noires ». ce qui était à la<br />
base de cette assignation en justice.Elle insistait sur le fait que, sans "preuves<br />
solides", il n'aurait jamais attaqué la police. Son inquiétude s'était déjà exprimée<br />
en juillet 1950 par ces écrits<br />
« La police va t-elle protéger les Européens... Police, vous avez fait une<br />
nouvelle fois, preuve de votre incapacité et de votre volonté de ne sévir que contre les<br />
Européens... Tel est le régime actuel »11.La rédaction du journal annonçait aussi,<br />
dans la même édition, le projet de création d'une police supplétive pour faire<br />
respecter "la peau blanche': Malgré l'assignation, cet organe de la presse dakaroise<br />
avait multiplié les écrits sur la police. D'après lui on trouvait des policiers blancs<br />
dans tous les coins de la ville de Dakar, qu'ils ne faisaient rien, exactement<br />
comme lorsqu'ils n'étaient pas nombreux et que cette insuffisance servait à<br />
justifier l'inactivité de la police dakaroise et que maintenant les effectifs<br />
européens de la police avaient quintuplé dans la capitale fédérale 12.<br />
9. "Afrique nouvelle" du 10 mars 1951.<br />
10. "Echos d'Afrique noire" du 29 septembre 1950.<br />
11. "Echos d'Afrique noire" du 20 juillet 1950.<br />
12 "Echos d'Afrique noire du 15 Décembre 1950.<br />
230
En janvier 1951 il était jugé. Le rédacteur des "Echos" fut condamné à 4<br />
mois de prison ferme et à une amende. Pour avoir relaté ce procès en diffamation<br />
à son tour "Afrique nouvelle" fut assigné en justice.<br />
En décembre 1950 un fait insolite pour ne pas passer inaperçu fit titrer<br />
à la rédaction "Coup de force fasciste contre notre journal". Maurice Voisin faisait<br />
état d'une décision prise par la G.LA de ne plus imprimer son joumal 13 .A propos<br />
de cette décision, "Afrique nouvelle,,14 écrivait «... Sans aucune espèce<br />
d'explication, la G.IA s'est subitement refusée à imprimer les Echos d'Afrique noire<br />
bien qu'ayant été régulièrement payée ».Pour l'organe catholique, ces procédés<br />
étaient inadmissibles et traduisaient un désir d'empêcher la parution de cet organe<br />
qui ne plaisait pas à tout le "monde" à Dakar.<br />
Une question se posait dès lors, celle de savoir s'il y avait une<br />
quelconque relation entre ce refus d'imprimer "les Echos d'Afrique noire" et<br />
l'assignation du même journal devant le tribunal.Dans le contexte dakarois de<br />
l'époque on peut avancer l'hypothèse d'une pression exercée sur cette imprimerie,<br />
de la part du gouvernement général., mais d'autres sont également valables. Il est<br />
possible aussi qu'il n'y ait pas de pression du Palais et que la G.LA se décide à<br />
partir d'une initiative propre. La chose est fort probable si l'on tient compte du fait<br />
que cette imprimerie est l'un des maillons du gros capital dakarois dont Charles<br />
Breteuil son chef, est l'un des porte-parole. Les "Echos" s'opposent souvent à ce<br />
grand capital local.<br />
Possible aussi que ces pressions ne soient ni du Palais ni du grand capital, mais<br />
des milieux politiques 10caux."Echos d'Afrique noire,,15 constatait «Le Conseil<br />
Général du Sénégal, à la majorité, demande l'expulsion de Maurice Voisin ». Or, dans<br />
ce Conseil Général, les grands milieux d'affaires sont solidement présents, tout<br />
comme l'administration. Donc refus d'impression par pressions politiques ou<br />
administratives ou économiques ou par conjugaison de plusieurs à la fois, la réalité<br />
est que le journal ne manque pas d'ennemis dans la capitale. Cependant le journal<br />
continue à paraître à Dakar. En effet, "Afrique Noire" annonçait, en février 1951,<br />
que "Echos d'Afrique noire" se fait imprimer au Maroc. Roger de Benoist écrit<br />
dans "Situation de la presse" que l'organe dakarois a été imprimé de 1952 à 1958 à<br />
Casablanca, puis à Bordeaux avant de revenir à Dakar. Ceci n'avait pas été facile,<br />
surtout sur le plan financier, mais l'important, pour la rédaction, était de continuer<br />
à paraître. Il était certain que les moyens n'avaient pas fait défaut dans une telle<br />
opération.<br />
13. "Echos..." du 29 décembre 1950.<br />
14. N" du 24 février 1951.<br />
15. Du 29 décembre 1950.<br />
231
porter la protestation aux autorités mit l'accent sur le fait qu'elle intervenait à trois<br />
mois des examens et que Bâ Thierno tenait un cours à deux cycles CMl et CM2.<br />
Les enseignants du syndicat autonome de l'enseignement primaire de la<br />
Délégation intervinrent auprès des autorités pour exiger la levée de la décision<br />
affectant Bâ Thierno à Ziguinchor, et devant l'échec de leur démarche, ils<br />
arrêtèrent même le travail, plusieurs heures durant, à titre de protestation .De<br />
même le Comité Territorial d'Unité d'Action des enseignants du Sénégal<br />
Mauritanie, prit la défense de Bâ Thierno. Mais le gouverneur général de l'AOF<br />
refusa de recevoir leur délégation, exactement comme le gouverneur du Sénégal<br />
l'avait fait auparavant.Le parti politique U.D.S-R.D.A éleva une vive protestation<br />
contre cette mesure frappant l'un de ses principaux responsables.<br />
Toute l'agitation autour de cette mesure administrative était-elle<br />
justifiée simplement par le fait qu'un enseignant était la victime?<br />
En partie, si l'on considère les initiatives des parents d'élèves de Yoff<br />
mais aussi celles des syndicats d'enseignants. Mais, à travers l;enseignant,<br />
manifestement le journaliste était le plus visé. La preuve est que Bâ Thierno, muté<br />
à Ziguinchor, restait jusqu'à la fin de l'année, sans classe effective alors qu'il<br />
abandonnait une classe d'examen à Yoff.<br />
De plus, cette mesure intervenait dans un contexte marqué par toute<br />
une série de mesures administratives mutations arbitraires de militants actifs et<br />
responsables de l'U.D.S et même emprisonnements . Toutes ces mesures, pour<br />
l'U.D.S, rentraient dans la politique des autorités de la fédération qui ne<br />
pardonnaient pas, à la section territoriale du R.D.A, son refus de suivre la ligne de<br />
collaboration engagée par la direction du mouvement.Le rapport moral, au<br />
congrès de la section territoriale, en juillet 1955, passait longuement en revue ces<br />
mesures et concluait qu'elles avaient été sans succès puisque le redressement<br />
s'était opéré partout et que la section s'était consolidée .Il insistait sur les mesures<br />
prises, dans le secteur de la presse du parti, pour éviter tout impact négatif de la<br />
mutation du rédacteur en chef, et effectivement, "Réveil" continua à paraître.<br />
b) "Dakar-Etudiant" fut l'objet de diverses mesures arbitraires de<br />
l'administration. En 1957 sous le titre "Fausse alerte" les étudiants de Dakar<br />
écrivaient «... Ceux qui croyaient que le refus des imprimeurs locaux de faire notre<br />
bulletin signait l'acte de décès de Dakar Etudiant, se sont rendus compte, en<br />
entendant notre voix s'élever une nouvelle fois, de leur impuissance. Ont-ils conçu une<br />
machination plus efficace pour éteindre à jamais notre voix? »20.<br />
20. N" de mai-juin 1957.<br />
233
234<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1
235
236
237
238
239<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1
L'article se référait à l'arrêté n° 4392/API/du 2 mai 1957 du<br />
gouverneur général de l'AOF, interdisant la vente, la circulation, l'exposition sur<br />
les lieux publics, du journal des étudiants. La rédaction proclamait la ferme<br />
détermination des étudiants à continuer à publier leur organe de presse. Les<br />
propos apaisants tenus par le directeur de cabinet du Haut Commissaire selon<br />
lequel la dite mesure ne visait pas à interdire définitivement la parution du<br />
bulletin, n'étaient qu'une tactique à laquelle les autorités étaient contraintes,<br />
devant la détermination des étudiants.Contre le journal des étudiants de<br />
l'UGEAO les pressions ne cessèrent pas elles aboutirent même à la situation<br />
suivante que l'organe mettait bien en exergue par cet encadré «... Ce numéro du<br />
journal Dakar-Etudiant a été tiré sur les presses de l'imprimerie nationale à Conakry,<br />
République populaire et démocratique de Guinée (devenue indépendante) à 1000<br />
exemplaires»21.<br />
Un an plus tard il continue à se plaindre des violations de la liberté de<br />
la presse dans la capitale fédérale de l'AüF «Cent et une fois, Dakar-Etudiant a<br />
subi des menaces. Certains pouvaient rire sous cape. "Ils n'ont pas d'imprimerie, ils<br />
n'ont pas notre soutien financier... On n'entendra plus crier ce ghetto d'agitateurs<br />
politiques à l'université de Dakar»22. Ces mesures administratives n'avaient pas eu<br />
raison du journal.<br />
De plus, d'autres initiatives frappèrent indirectement les étudiants de<br />
Fann par les diverses interdictions du journal de la fédération des étudiants<br />
africains en France entre 1954 et 1960. Toutes ces mesures avaient un caractère<br />
administratif car appliquées par le Haut Commissaire de l'AOF à l'encontre de cet<br />
organe paraissant en métropole. Le 20 février 1958 la troisième saisie de cet<br />
organe donna lieu à un imposant meeting de protestation place de Mbott à<br />
Dakar, à l'initiative de plusieurs organisations étudiantes, politiques, de jeunesse,<br />
culturelles, syndicales etc...<br />
Ces diverses mesures contre "Réveil", "Dakar-Etudiant", "l'Etudiant<br />
d'Afrique noire"etc... mais aussi les procès contre "Echos d'Afrique noire" et<br />
"Afrique nouvelle", constituaient-ils des mesures isolées, même si elles furent<br />
nombreuses ? Apparemment pas. Les autorités de la fédération, directement ou<br />
indirectement, menèrent une politique d'ensemble contre la presse libre et<br />
critique. Beaucoup de faits le prouvaient. Cette circulaire du Gouverneur général<br />
de l'AOF relative à l'exercice du droit d'écrire dans la presse pour les<br />
fonctionnaires rentrait dans cette politique. Ce texte, signé du gouverneur général<br />
B. Cornut Gentille, disait<br />
21. "Dakar-Etudiant" Février 1959.<br />
22. "Dakar-Etudiant", nouvelle série nOI, Avrill960.<br />
240
« 10) Interdiction est faite à tout fonctionnaire, quel qu'il soit, mis en cause<br />
dans la presse, de répondre sans y avoir été expressément autorisé, soit par le haut<br />
commissaire ou le gouverneur secrétaire général à l'échelon fédéral, soit, dans les<br />
territoires par le chefdu territoire lui-même.<br />
2°) De même, aucun article rédigé par un fonctionnaire ne sera publié<br />
sans qu'il ait été préalablement soumis à l'approbation des mêmes autorités.<br />
3°) Les fonctionnaires appelés à prononcer une conférence autre que<br />
littéraire, en soumettront le texte à mon cabinet ou au cabinet du gouverneur.<br />
Ces instructions doivent être rigoureusement appliquées...<br />
Ces directives s'appliquent naturellement à tous les échelons de la<br />
hiérarchie administrative et je n'hésiterai pas à sanctionner sévèrement »23.<br />
Cette circulaire du Chef de la Fédération avait fait l'objet d'une vive<br />
controverse. Elle apparaissait, pour beaucoup, comme une véritable censure<br />
contre les fonctionnaires.La polémique qu'elle souleva fut telle que le Haut<br />
Commissaire crut devoir rédiger une nouvelle circulaire « pour préciser<br />
exactement le sens de la première... pas question de porter atteinte à la liberté de<br />
la presse » écrivait-il le 28 mai 1953.Malgré cette précision apportée par le<br />
"Palais", la polémique n'en continue pas moins, de plus belle. C'est dire à quel<br />
point, l'opinion publique avait été sensible à la circulaire du Haut Commissaire,<br />
perçue comme une véritable censure et donc une atteinte réelle à la liberté<br />
d'expression.En cela, on peut parler d'une politique délibérée des autorités locales<br />
pour éviter toute expression d'une presse démocratique, à Dakar et en AüF.<br />
IV/IMPRESSION, TIRAGE, COUT ET LECTORAT<br />
1) L'impression<br />
- historique<br />
Il faut remonter à la deuxième moitié du XIXeme siècle pour voir la<br />
gestation de l'imprimerie au Sénégal.<br />
La dépêche ministérielle approuvant le projet survînt quelques<br />
semaines avant la nomination de Faidherbe comme gouverneur de ce territoire.<br />
C'est donc lui qui organisa l'imprimerie entre 1855 et 1857. Son<br />
installation remonte précisément à 1856 même si la réglementation n'intervînt que<br />
plus tard.L'administration coloniale disposait ainsi d'un outil lui permettant non<br />
seulement de publier les arrêtés, décisions et ordonnances, mais aussi les premiers<br />
journaux au Sénégal.<br />
23. "Afrique noire" n"38 du 18 juillet 1953.<br />
241
périodiques politiques.Il imprimait aussi des journaux publiés à Paris et imprimés<br />
à Paris. C'était le cas de la revue "l'Etincelle" organe du R.P.F, mais aussi<br />
"Carrefour". L'imprimerie recevait, en double exemplaire les plans de ces<br />
journaux. Elle les imprimait en remplaçant le nom de l'imprimerie parisienne par<br />
le sien. Cette opération permettait un gain de temps appréciable dans la mesure<br />
où le journal était en kiosque la semaine même de sa parution à Paris. Mais<br />
surtout, le tirage pouvait être nettement plus élevé que le nombre des exemplaires<br />
envoyés de la métropole. Et par exemple, la revue "Etincelle" voyait ainsi sa<br />
diffusion en AOF passer de 750 exemplaires à plus de 5.0002 5 . Le groupe de la<br />
G.I.A s'appuyait, au niveau de la fédération, sur d'autres imprimeries moins<br />
importantes, en Guinée, au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Ainsi, "Paris-Dakar"<br />
qu'elle produisait était un maillon d'une chaîne plus vaste comptant la presse de<br />
Guinée, la presse du Cameroun, "Abidjan matin" et également "Bingo".<br />
Outre l'imprimerie de l'Eglise et celle de la G.I.A, il y avait aussi<br />
quelques petites imprimeries à Dakar. Comme l'imprimerie Diop dont "Echos<br />
d'Afrique noire" nous dit qu'elle avait été montée avec des capitaux du<br />
gouvernement général. Beaucoup d'organes de la presse syndicale ou de jeunesse<br />
sortaient de chez elle, entièrement ou partiellement, parfois seulement la page de<br />
garde si le reste était multigraphié.L'activité d'impression assurée par A. Diop<br />
suscitait l'hostilité du colonat. "Echos d'Afrique noire", un des porte-parole attitrés<br />
de ce milieu le dénonçait « ...Pendant ce temps, le même Diop imprime, à bas prix,<br />
le joumal anti-français, organe du Parti Africain de l'Indépendance "La lutte". Et les<br />
machines achetées par Diop l'ont été avec l'aide du FIDES ou de la CCFOM »26.Le<br />
journal de Maurice Voisin n'avait pas la même réaction à l'égard des autres<br />
organes que l'imprimerie réalisait à cette époque comme "Afrique noire" de Guy<br />
Etcheverry, "l'AOF" ou "Condition Humaine".<br />
La presse à Dakar comptait aussi sur des moyens d'impression situés<br />
hors du territoire de la fédération. Exemple, "Echos d'Afrique noire", après le<br />
refus d'imprimer de la G.I.A, avait été imprimé au Maroc, dès le mois suivant, et<br />
plus tard, en métropole même. Il en fut de même pour Dakar-Etudiant.<br />
Outre ces moyens, la presse dakaroise comptait aussi, en ce qui<br />
concerne les petites publications, sur des moyens rudimentaires comme la machine<br />
à écrire et la ronéo; ce qui se ressentait assez nettement sur la qualité de ces<br />
organes. Seuls, les moyens financiers dérisoires leur imposaient cette solution. La<br />
plupart des cas, ces organes ne disposaient même pas, à titre propre, de ces<br />
moyens. Abdoul Maham Bâ et Youssouf Diop, anciens haut-responsables de la<br />
jeunesse, insistaient sur les énormes difficultés qu'ils rencontraient, souvent, pour<br />
25. R. Bourgi, Le général de Gaulle et l'Afrique... 1980, op. cit., P.226.<br />
26. "Echos d'Afrique noire" du 12 mai 1958.<br />
243
et considère même «Maurice Voisin pris en flagrant délit de mensonge ».11 est vrai<br />
que ces écrits se situent dans une virulente querelle entre les deux rédacteurs en<br />
chef, par journaux interposés.<br />
L'organe de la hiérarchie catholique dakaroise tirait à 3.500<br />
exemplaires lors de sa création en 1947, pour atteindre les 5.000 numéros en 1950<br />
et les 7.000 en 1955. "Mrique nouvelle" monta à 12.000 exemplaires en 1957,<br />
15.000 en 1958 pour revenir à 12.000 en 1959.<br />
"Bingo" avec l'ensemble de ses trois éditions couvrant l'AOF et l'AEF,<br />
tirait à 20.000 exemplaires."L'Unité" de 5 à 6.000 numéros.<br />
"Lettre africaine" tirait à 5.50 exemplaires dont les 3/4 étaient, lus à<br />
Dakar, les administrations et services s'abonnant pour les 450 numéros. "La voix<br />
des jeunes" de 5.00 à 1500.<br />
Quant à "La lutte", organe central du P.A.I, elle tirait à 4.000<br />
exemplaires et "Momsarew", organe de la section territoriale du Sénégal à 1.000<br />
exemplaires.<br />
"Indépendance africaine" du P.R.A-Sénégal avait 4.000 numéros 30 et<br />
"l'Action" se situait à 2.000 exemplaires.<br />
"Dakar-Etudiant", tiré en Guinée en 1959, atteignait les 1.000<br />
exemplaires.<br />
Le quotidien "Paris-Dakar" était tiré à 15.000 exemplaires. Il était en<br />
fait le plus grand et le plus régulier des tirages de la presse dakaroise.<br />
Ces problèmes de tirage étaient en rapport étroit avec ceux de la vente,<br />
laquelle était subordonnée à divers éléments comme imprimé ou ronéotypé,<br />
régulier ou pas, organe politique ou non, etc... Dès 1943, à l'initiative de Charles<br />
de Breteuil, directeur de la G.I.A et de Pierre Douillet, avait été créée l'A.D.P<br />
(Agence de distribution de presse) chargée d'assurer la distribution, de la manière<br />
la plus large possible, au Sénégal comme dans les autres territoires, de la presse<br />
française, d'une partie de la presse locale, et autres produits de librairies 31 .<br />
L'agence avait son siège à Dakar. Elle percevait 20% sur le montant total des<br />
ventes. "Paris-Dakar" fit appel à ses services contrairement à d'autres, comme<br />
"Mrique nouvelle", le deuxième grand de la presse locale qui trouvait la<br />
rémunération trop élevée . Dans les budgets de cet organe catholique, une<br />
certaine somme était régulièrement inscrite, au titre de l'expédition du journal<br />
dans toute la fédération. En 1958-1959, cette somme fut de 5 millions de F. CFA<br />
A cette date, c'est par la voie aérienne que le journal est diffusé, mode<br />
relativement coûteux, mais la direction estimait que tout autre moyen était<br />
incompatible avec les impératifs de la diffusion hebdomadaire.<br />
30. Fiche 42 pour ces journaux politiques 1959.<br />
31. Abd. Thiongane, Le public de la presse locale et française à Dakar, 1982, P.19.<br />
245
L'ADP et ses tarifs sont inaccessibles à la majorité des journaux<br />
dakarois, irréguliers et à faible tirage. La seule possibilité de distribuer des<br />
journaux politiques, syndicaux, de jeunesse, étudiants, etc... était la vente militante<br />
comme le note M.A de Suremain dans une recherche sur cette presse. En février<br />
1958 "La lutte" consacrait un éditorial consacré à la question «... ces militants<br />
savent l'effort qu'il a fallu consentir pour faire sortir en un temps record... Ils<br />
connaissent les embarras financiers, les fatigues enthousiasmantes de la vente<br />
militante»32. D'après nos interlocuteurs Abdoul Maham Bâ et Youssouf Diop, la<br />
presse du Conseil de la jeunesse était répartie entre les différentes associations<br />
constitutives de cet organisme, par quota. Chaque association avait pour<br />
obligation de faire parvenir à la trésorerie du Conseil, la valeur totale des numéros<br />
reçus. Mais la vente militante à laquelle avait recours l'essentiel de la presse<br />
politique ou syndicale dakaroise, n'était pas sans difficultés majeures faiblesse du<br />
nombre des militants, éloignement, niveau de conscience etc...Le SYNEP, dans<br />
presque tous ses congrès, reconnaissait ces difficultés réelles mais avait la<br />
conviction qu'elle était la seule méthode possible.<br />
Abdoulaye Thiongane,indique que, plusieurs années après<br />
l'indépendance, à peine 30 % des organes de la presse dakaroise étaient vendus<br />
par l'intermédiaire de l'agence de presse 33 .<br />
3) Le coût et le lectorat.<br />
"Afrique Nouvelle" constatait, en octobre 1951, que les journaux étaient<br />
chers en raison des coûts prohibitifs du papier. Le prix du papier, 2230 F la tonne<br />
à la fin de 1939, avait vertigineusement grimpé après la guerre et à compter du<br />
1er octobre 1951, des hausses nouvelles étaient encore intervenues. La tonne de<br />
papier en bobine se vendait à 83.750 F et celle de papier en rame à 130.000 F. Le<br />
journal s'inquiétait surtout de la cadence des hausses des 16 derniers mois écoulés.<br />
Considérant surtout que c'étaient des produits étrangers, il rejetait la<br />
responsabilité de cette situation sur l'administration qui n'avait pas su pallier ces<br />
hausses, et arrivait à la conclusion suivante «La presse est devenue un produit de<br />
semi luxe réservé aux seuls aisés» et que les journalistes eux-mêmes en éprouvaient<br />
des soucis.<br />
Presque à la même période le rapport administratif soumis à la<br />
réflexion des délégués au Berne congrès territorial de la S.F.I.O, dénonçait les<br />
hausses dont la papeterie en général, avait été l'objet au cours de l'année écoulée.<br />
Il expliquait ainsi la cause des réductions, au strict minimum indispensable, des<br />
32. "La lutte" du 13 février 1958.<br />
.33. Abdoulaye Thiongane..., P.10?<br />
246
conditions de travail difficiles. En effet, le personnel ne disposait d'aucun jour de<br />
repos dans la semaine et s'en était plaint auprès des autorités. L'inspection du<br />
travail avait même envoyé à ce sujet une véritable mise en demeure à A Lauzé, le<br />
chef du bureau de l'AFP à Dakar. Mais ce chef prétexta par la suite le manque<br />
de qualification de ce personnel africain, pour opérer le licenciemené 4 et se<br />
débarrasser d'un personnel revendicatif.<br />
La réorganisation du bureau de l'agence Havas selon une formule<br />
nouvelle, ne changea en rien sa dépendance à l'égard du gouvernement général.<br />
La principale mission confiée à l'AFP consistait en la réalisation du bulletin<br />
quotidien d'information destiné à la radiodiffusion et au journal "Paris-Dakar",<br />
mais aussi à la vente au public.Ce bulletin réalisé par l'agence constituait le moyen<br />
d'information principal de la presse d'opinion.<br />
Cependant, tous les journaux paraissant à Dakar n'avaient pas les<br />
moyens financiers pour pouvoir obtenir un abonnement au bulletin de l'agence.<br />
C'était le cas des journaux de jeunes ou d'élèves, tout comme de plusieurs<br />
associations. Mais, pour d'autres organes, dans la mesure où ce bulletin était<br />
d'inspiration coloniale, il n'était nullement question de s'y abonner. C'était le cas<br />
des journaux politiques comme "Réveil", "l'Action", "Indépendance africaine", "La<br />
Lutte", "Dakar-Etudiant" etc...<br />
Les journaux qui, soit pour des raisons politiques ou économiques,<br />
n'étaient pas abonnés, comptaient sur d'autres sources, essentiellement en<br />
provenance des informations des militants. C'est ce que notait la rédaction de "La<br />
Lutte" «... Ils (les rédacteurs) connaissent les fièvres des tables de rédaction, les<br />
difficultés de la collecte des articles...»45. Moustapha Diallo expliquait que le<br />
bulletin de presse de l'AGED était constitué d'articles faits par les membres de<br />
l'association ou des articles repris de "l'Etudiant d'Afrique noire", organe de la<br />
FEANF ou d'informations en provenance de la presse des autres associations<br />
démocratiques. Abdoul Maham Bâ et Youssouf Diop confirmaient la même chose<br />
pour l'organe du C.J.S "Jeunesse Liaison".<br />
Un de nos interlocuteurs considérait que s'inspirer des informations de<br />
source coloniale, c'était une manière d'être au service de cette administration, ce<br />
qui enlevait toute crédibilité à une presse qui dénonçait le système colonial.<br />
En somme, ce bulletin de Havas n'avait pour utilisateurs, dans la presse<br />
dakaroise, que les organes d'Européens ou les publications de l'administration<br />
coloniale.<br />
2) Les rédacteurs de la presse dakaroise.<br />
44. Hervé Tenoux, ibidem, 1986.<br />
45. "La Lutte", éditorial du 13 février 1958.<br />
250
Dans son analyse de la presse en AOF, R. de Benoist note « La--'<br />
majorité des journalistes professionnels sont d'origine européenne. Les journalistes<br />
africains occupent des postes subalternes »46. M.A de Suremain remarquait « Il<br />
n'existe pas à l'époque d'école de journalisme en AOF; dans ces conditions, le<br />
journalisme constituait un champ d'expression ouvert aux individus, écrivant à<br />
l'occasion, dans des organes de presse de tendances parfois différentes »47.Parlant de<br />
l'encadrement syndical des journalistes, M.A. de Suremain disait « Il existait en<br />
A OF, une section du syndicat national des journalistes de France, section qui ne<br />
regroupait qu'une quinzaine de membres ». En fait, dans les organes de presse<br />
publiés à Dakar, la situation d'ensemble était complexe pour la qualité du<br />
personnel de rédaction.<br />
Les journaux européens comme "Paris-Dakar", "Afrique noire", "La<br />
Lettre africaine", "Echos d'Afrique noire" etc... avaient pour rédacteurs des<br />
professionnels formés au journalisme dans des écoles de la métropole. La presse<br />
de l'Eglise avait ses professionnels comme Ernest Milcent, Roger de Benoist... Les<br />
journaux catholiques firent même venir d'ailleurs, de la Fédération, des<br />
professionnels pour leur confier des responsabilités à Dakar. En 1958 "Afrique<br />
nouvelle" avait même obtenu une compensation financière de la part du<br />
gouvernement sénégalais qui avait débauché un rédacteur que la direction avait<br />
fait venir du Dahomey48.<br />
Par contre, une certaine presse, à Dakar, dépend d'une rédaction sans<br />
formation professionnelle. C'est le cas pour pratiquement tous les organes de<br />
jeunesse, d'étudiants, de syndicats et partis politiques. Du directeur de publication<br />
jusqu'au dernier de la rédaction en passant par les rédacteurs en chef, personne<br />
n'était journaliste de profession. Cependant, cette situation n'enlevait en rien sa<br />
valeur au journal même si M.A de Suremain remarque des lourdeurs, des phrases<br />
incorrectes, un style parfois incohérent dans cette presse. Le personnel de<br />
rédaction était formé sur le tas. Tout le monde pouvait être rédacteur dans<br />
certains organes de presse. Il suffisait d'être un militant lettré. C'était<br />
véritablement une presse militante par opposition à la presse européenne<br />
professionnelle.<br />
A voir même l'importance des articles anonymes dans cette presse,<br />
parfois jusqu'à près de la moitié des articles 49 ou les multiples changements des<br />
équipes rédactionnelles, cette qualité de personnel formé sur le tas était évidente<br />
46. R. de Benoist., La situation de la presse., 1960, P.128.<br />
47. MA de Suremain, PA<br />
48. Entretien avec R. de Benoist qui affirme que l'intéressé fut nommé chef de cabinet par A. Peytavin ministre des fi<br />
49. MA de Suremain, P.26.<br />
1<br />
251·
1) "Paris-Dakar"<br />
C'est le seul journal à paraître quotidiennement à Dakar. Les autres<br />
bulletins quotidiens -celui de l'AFP et celui de la Chambre de Commerce- s'y<br />
retrouvent largement ."Paris-Dakar" paraît à Dakar depuis février 1933 et jusqu'à<br />
la fin de notre période régulièrement car ses interruptions orit été presque<br />
insignifiantes. Il reçoit ses informations de l'AFP et les publie presque toujours<br />
comme telles. Cependant dans les périodes de tensions, les dépêches sont<br />
modifiées par la censure officieuse ou officielle. En janvier 1946 le journal<br />
indiquait «Au cours des 48 heures, les mouvements de grèves indigènes ont pris une<br />
ampleur accrue. La menace de grève générale se précise; seules les activités essentielles<br />
telles que le service de l'eau, de l'électricité et des transmissions pou"aient être<br />
assurées. Les troupes ont été consignées. La garde des principaux édifices a été<br />
renforcée. Un dispositif est mis en place pour assurer le ravitaillement de la population<br />
européenne et indigène. Le calme le plus complet règne »50. Il publiait ainsi une<br />
dépêche de l'AFP qui avait fait l'objet d'une remise en forme assez serrée puisque<br />
les termes suivants furent enlevés « Grève beaucoup plus politique que<br />
professionnelle... L'union des syndicats présentant des revendications volontairement<br />
i"ecevables pour maintenir l'agitation... Démonstration aviation et chars eut lieu ce<br />
matin »51. Sur cette information publiée par le journal après les "correctifs"<br />
apportés à la dépêche AFP, la rue Oudinot avait eu son mot à dire, malgré toutes<br />
les précautions prises<br />
«... Le cabinet du ministre de l'infonnation nous fait savoir que le ministre<br />
des colonies s'est ému de la publication dans nos feuilles d'une infonnation intitulée<br />
"les mouvements de grève indigène à Dakar" et demande qu'à l'avenir<br />
publiées à ce sujet<br />
1°) nous soyons extrêmement prudents dans les tennes des infonnations<br />
2°) nous notions dans une prochaine infonnation que des négociations<br />
sont en cours pour la reprise du travail<br />
3°) nous communiquions toute infonnation par téléphone à Mr Rétine du<br />
cabinet du Ministre des colonies avant publication»52.<br />
"Paris-Dakar", dès le lendemain, signale « la tenue de négociations se<br />
poursuivant à Dakar où le calme et l'ordre règnent».<br />
Le surlendemain, le quotidien dakarois en revenant sur cette grève,<br />
mettait surtout en avant les mesures de réquisitions décidées par l'administrateur<br />
50. "Paris-Dakar" du 14 janvier 1946.<br />
51. H. Tenoux, l'Agence Havas... 1 1986, P.75<br />
52. Idem, P.74<br />
253.
C'était une série d'articles contre le communisme qui rappelaient les<br />
positions de principe de l'Eglise, en traitant d'événements propres à la ville de<br />
Dakar 69 . L'ancien directeur se défendait pourtant que son organe ait fait preuve<br />
d'un anticommunisme systématique. Il donnait l'exemple d'une série d'articles<br />
publiés par le journal, au titre d'un reportage fait par les étudiants de l'AOF ayant<br />
séjourné en République populaire de Chine. Parmi ces étudiants, certains, comme<br />
Joseph Mathiam, étaient membres actifs des associations catholiques locales.<br />
Roger de Benoist insistait sur le fait que tous les articles furent publiés sans la<br />
moindre censure. Tout juste crut-il devoir faire un "article-complément" pour<br />
montrer le prix énorme que la Chine avait dû payer pour arriver aux succès que les<br />
étudiants vantaient 70 .<br />
Cependant, les propos de l'ancien directeur d'''Afrique Nouvelle" ne<br />
concordaient pas exactement avec la pratique même du journal qui avait souvent<br />
brocardé le R.D.A pour ses activités ou ses soutiens communistes et ceci jusqu'en<br />
1950. A partir de cette époque, le langage changea. Les conférences, meetings,<br />
déplacements du leader du mouvement interterritorial furent suivis plus<br />
positivement. Exemple le meeting de H. Boigny à Abidjan le 6 octobre 1951, était<br />
placé en première page. Ce reportage appréciait positivement les raisons avancées<br />
par le leader politique africain pour le désapparentement à l'égard du P.C.F. Selon<br />
le journal, 8.000 personnes étaient massées au stade d'Abidjan lorsque Houphouët<br />
déclarait «... La lutte contre le RDA de ces trois dernières années a distrait trop<br />
souvent l'exécutif local de son rôle principal qui doit être celui de guide, de conseiller,<br />
d'ami des populations dont il a la charge »71.<br />
"Afrique Nouvelle" accordait une grande importance aux questions<br />
sociales en Afrique. A propos du mariage, le journal titrait «Grâce au décret<br />
Jacquinot, la femme africaine cesse d'être une chèvre »72. Il se réjouissait du fait que<br />
les autorités parisiennes et d'AOF mettent, ainsi, en place, toute une législation<br />
pour imposer le mariage chrétien en Afrique noire. Le journal ne semblait pas<br />
s'apercevoir du caractère outrancier du titre de l'article, encore moins des<br />
bouleversements sociaux négatifs que cette législation coloniale allait entraîner. Il<br />
semblait aussi faire peu de cas de la position même des musulmans d'Afrique<br />
noire sur cette réglementation ignorant qu'au même moment, à Dakar, une<br />
riposte était examinée par divers milieux islamiques. Mieux, le journal catholique<br />
se vantait d'avoir été indirectement à la base de cette législation par toute une<br />
campagne menée dans ses colonnes, plusieurs mois auparavant.<br />
69. N" du 21 février 1956.<br />
70. Entretien.<br />
71. "Afrique nouvelle" du 21 octobre 1951.<br />
72. "Afrique nouvelle" du 6 octobre 1951.<br />
259 .
Il critiqua vivement les membres du Grand Conseil de l'AOF qui s'étaient<br />
prononcés en faveur du versement des allocations familiales à tous les enfants des<br />
travailleurs en considérant que ceci était « un exemple révoltant de favoritisme à<br />
l'égard de la caste des fonctionnaires polygames ». Il ridiculisait ceux qui, par cette<br />
polygamie, entretenaient une sorte de semi-esclavagisme et faisaient la chasse<br />
aux orphelins. Les fonctionnaires africains polygames étaient bien désignés. Toute<br />
cette ferme opposition du journal à la question des allocations familiales<br />
revendiquées par les centrales syndicales relevait en fait de deux considérations<br />
lutter contre le système de la famille africaine, mais aussi devenir un porte-voix du<br />
grand capital local fermement opposé à cette revendication des travailleurs<br />
d'Afrique noire.<br />
Les autres publications catholiques telles que "Horizons africains" ainsi<br />
que des organes du colonat dakarois comme "Echos d'Mrique noire" avaient la<br />
même position.<br />
Si "Mrique Nouvelle" avait, en général, défendu l'octroi d'un code du<br />
travail pour les TOM, diverses positions du journal comme la question des<br />
allocations familiales, constituaient, en fait, des ambiguïtés sur la ligne générale du<br />
journal. On imagine mal, comme position logique, une défense des intérêts des<br />
travailleurs en remettant en cause fondamentalement leur mode d'existence. Il est<br />
vrai que la défense des intérêts des travailleurs d'Mrique noire passait au second<br />
rang pour la rédaction. Les intérêts exclusifs de l'Eglise opposée à la polygamie<br />
du milieu et le soutien aux intérêts économiques du patronat passaient au premier<br />
plan.<br />
En somme, "Afrique Nouvelle" s'était vraiment intéressée à diverses<br />
questions et développait les positions de l'Eglise essentiellement, mais aussi celles<br />
du patronat en partie.<br />
4) Les "Echos d'Afrique Noire"<br />
Antérieurement, cet organe s'appelait "Echos guinéens". C'est à partir<br />
de 1948 que le journal est venu s'installer définitivement à Dakar et le titre<br />
devient "Echos d'Afrique noire". Dès 1953, il est doublé du "Petit Jules Illustré"<br />
fondé par Maurice Voisin, rédacteur en chef des "Echos d'Mrique noire".<br />
La directrice de publication était Mme Voisin, née Anne Mosseson.<br />
"Echos d'Afrique noire" était le véritable porte-parole des cercles les plus<br />
conservateurs du petit colonat. Par ses publications, le journal s'attaquait<br />
régulièrement à la haute administration dakaroise, jusqu'au chef de la fédération<br />
lui-même.<br />
'--<br />
262
Ainsi, à propos d'une affaire d'autorisation d'importation de frigidaires,<br />
la rédaction avait publié une lettre ouverte adressée au chef de l'AOF. Une autre<br />
fut adressée au parquet à la suite du silence du chef de la fédération. Pas plus<br />
heureux du côté du parquet, elle écrit au directeur de la SCOA83 espérant<br />
vainement une réaction directe et le journal publiait par la suite le rapport du<br />
contrôle financier de l'AOF qui mettait en cause les plus hautes autorités dans<br />
cette affaire. Ces dernières ne crurent même pas devoir réagir devant cette<br />
nouvelle initiative des "Echos d'Afrique noire" et l'accusation de gaspillage des<br />
deniers publics qui pesait sur les autorités ne fut pas éclaircie.<br />
C'est ce qui amenait "Echos d'Afrique noire", dans plusieurs livraisons<br />
consacrées à la question, à demander «Plus jamais démission Paul Béchard »84 .<br />
Ce dernier, Chef de la Fédération, était présenté comme le véritable bénéficiaire<br />
de l'opération frauduleuse qui lui aurait rapporté 1 million de francs CFA. Le<br />
journal ne fut pas plus tendre à l'égard de son successeur. A la suite de plusieurs<br />
révélations de gaspillage, il écrit<br />
« Bernard Comut Gentille fait beaucoup mieux que Béchard, en matière<br />
de gaspillage des deniers publics .85<br />
Le journal avait engagé une véritable campagne anti-libanaise dans ses<br />
colonnes, plusieurs numéros durant. "Une véritable invasion étrangère" considérait<br />
il à propos de l'afflux des levantins à qui il reprochait les problèmes coloniaux<br />
clairement, en ces termes «... Car, enfin, qui a donné le premier choc de<br />
l'ébranlement de notre Empire si ce n'est cette Syrie et ce Liban qui étaient le plus<br />
ancien joyau de notre couronne ».86 La rédaction de l'organe expliquait que la<br />
défense qu'elle assurait contre cette invasion était dans l'intérêt exclusif des<br />
populations africaines d'AOF. A la suite de la condamnation à trois mois de<br />
prison ferme prononcée contre lui par le parquet dakarois au sujet de cette affaire,<br />
il écrivait «... Pour avoir défendu les Africains contre les agissements de certains<br />
Libanais... j'irai en prison la tête haute... Les étrangers triomphent provisoirement ».<br />
Le journal se référait au verdict du tribunal, suite de la plainte déposée par le<br />
Consul du Liban à Dakar mécontent de cette campagne anti-levantine de Maurice<br />
Voisin. Le parquet avait statué sur cette plainte, le 22 décembre 1954. En écrivant<br />
que «Cordonnier n'est plus maître chez lui », le journal accusait les autorités<br />
fédérales de faire preuve de complaisance et de concussion à grande échelle, à<br />
l'égard des "Levantins. De plus il accusait la justice dakaroise de laxisme et de<br />
complaisance en ces termes «J'ai été attaqué par Moussa Bathily. Depuis 15 jours,<br />
83 "E h d'Af· ." d 7 14 2O··U<br />
84· c os nque nOire, es 1 et JUI et 1950.<br />
85. N° du 1/09/1950.<br />
86. N° 152.<br />
. N° du 1/01/1955.<br />
263
économiques et en cadres avertis, en insistant sur les divisions politiques, raciales<br />
etc... le journal, en fait, cherchait à créer un sentiment de peur devant<br />
l'indépendance. Le calcul profond était que ce sentiment de peur et d'abandon<br />
entraînerait une réaction opposée par laquelle les Africains feraient tout pour que<br />
la métropole restât, avec tous ses attributs de la phase du colonialisme triomphant.<br />
On constatait également que malgré la virulence des attaques dont la rédaction<br />
des "Echos d'Afrique noire" avait fait l'objet de la part des hommes politiques, des<br />
syndicalistes, des étudiants, des milieux de jeunesse, de personnalités, pour ses<br />
activités de presse jugées racistes, Maurice Voisin était demeuré, comme un roc, à<br />
Dakar, continuant à publier son journal tranquillement. Ceci posait évidemment la<br />
question de savoir quelles forces occultes constituaient le rempart pour cet homme<br />
tant décrié par les Africains.<br />
5) "Condition Humaine"<br />
Le premier numéro de ce journal parut à Dakar le Il février 1948 avec<br />
comme sous-titre "Au service de la révolution socialiste". Il était imprimé, en deux<br />
pages grand format, par l'imprimerie Diop. L.S. Senghor était le directeur de<br />
publication, et Amadou Arona Sy le rédacteur en chef.<br />
L'éditorial expliquait «Pourquoi ce nouveau journal, nous dira t-on<br />
comme s'il yen avait pas assez au SénégaL.. Notre réponse est qu'il n y a pas assez de<br />
journaux au Sénégal ». La décision de créer le journal remontait, aux assises du<br />
congrès de Kaolack, en septembre 1947. La section SFIO donnait, à cette date, à<br />
L.S. Senghor, l'opportunité de faire paraître unorgane de presse. Pour le député<br />
du Sénégal, ses vues sur la décentralisation, sur la paysannerie, sur les questions<br />
culturelles etc... trouvaient ainsi une plate-forme d'expression d'autant plus qu'il<br />
avait été lors de ce congrès de Kaolack, largement mis en minorité sur ces<br />
questions. Le nouveau journal fut d'abord bi-mensuel, puis hebdomadaire. Dès<br />
1949 "Condition Humaine" prit de l'importance après la rupture politique entre<br />
les deux députés du Sénégal.<br />
Pendant les quinze années de cette étude, le journal changea de nom à<br />
deux reprises en relation avec la recomposition du paysage politique, dans le<br />
territoire. En octobre 1956, avec la création du B.P.S alliance entre diverses forces,<br />
"Condition Humaine" disparaissait pour faire place à "l'Unité". Avec la naissance<br />
de l'U.P.S en 1958 traduisant la réconciliation entre les deux principaux leaders<br />
politiques sénégalais, "l'Unité" était remplacé par un nouvel organe appelé<br />
"l'Unité Africaine" qui garda ce nom jusqu'à la fin de 1960.<br />
L'orientation générale de "Condition Humaine" était indiquée dans la<br />
première édition «... Nos buts sont les mêmes que ceux des partis et mouvements<br />
267
politiques qui ont pour objet la réconciliation de l'Afrique dans le cadre de l'Union<br />
française. ... Nous disons autonomie et non indépendance. Nous sommes francs et<br />
nets sur ce sujet capitaL.. Nous affinnons que l'indépendance est un rêve... ». Au sujet<br />
des moyens à mettre en oeuvre, la rédaction affirmait «... Et sur le choix des<br />
moyens, nous nous séparons des autres journaux.. ». L'option fondamentale servait<br />
de conclusion à cet éditorial de présentation «... Nous sommes donc, socialistes ».<br />
"Condition Humaine" devînt, avec la création du RD.S, l'organe central<br />
de ce nouveau parti, après avoir été au début un journal de Senghor.<br />
Dans plusieurs livraisons de l'organe était nettement mis en relief, par<br />
un encadré, que «Condition humaine ,ce journal ne s'achète pas dans la rue. c'est<br />
un journal d'études et de combat ». Méprisant la vente de rue, c'est à dire la vente<br />
militante, un choix important était ainsi fait car le journal se voulait "haut de<br />
gamme" par rapport aux autres organes politiques paraissant à Dakar.<br />
En tant qu'organe politique il portait son intérêt sur une multitude de<br />
sujets développés, plus ou moins régulièrement. L'enseignement faisait l'objet<br />
d'une attention particulière. Très souvent, c'était le directeur de publication, le<br />
député Senghor, qui signait ces articles. Dès le premier numéro, il faisait paraître<br />
un article intitulé "La condition de notre évolution Réforme de l'enseignement".<br />
Senghor y indiquait qu'il avait déposé une proposition de loi devant le bureau de<br />
l'Assemblée nationale. Ce texte visait «de transférer le contrôle culturel c'est à dire<br />
technique et professionnel de l'enseignement» du ministère de la FOM aux autorités<br />
administratives locales d'outre-mer. Le député insistait sur le fait que dans sa<br />
proposition de loi, la rue Oudinot conservait le contrôle politique de<br />
l'enseignement. Il distinguait nettement la ligne de démarcation entre ces deux<br />
éléments contrôle politique d'une part, et de l'autre, contrôle technique et<br />
professionnel. Il laissait donc l'essentiel c'est à dire le pouvoir d'orientation, à la<br />
puissance coloniale. Le professeur et député faisait une description exhaustive de<br />
l'enseignement en AOF, chiffres à l'appui. Il indiquait qu'un enfant sur 20<br />
fréquentait l'enseignement élémentaire, que l'enseignement catholique intervenait<br />
pour le quart des effectifs dans cette Afrique noire française, qu'une part congrue<br />
était faite à l'enseignement technique, tant côté public que côté privé, et que les<br />
crédits étaient dérisoires. Mais comparant l'enseignement dans les deux<br />
fédérations d'AOF et d'AEF, il indiquait que «En AEF, l'organisation de<br />
l'enseignement est tout juste sortie de l'état embryonnaire»103, et par rapport aux<br />
autres dominations «En Afrique noire française, l'enseignement est moins répandu<br />
que dans les colonies anglaises et au Congo Belge».<br />
163. Base année 1945-1946.<br />
268-
égulièrement, dans la période 1948-1955, à Lamine Guèye, le principal adversaire<br />
politique, sur le thème de la défense de l'islam. C'est ainsi que sous le titre "Drôle<br />
de défenseur de l'Islam", la rédaction écrivait que Lamine a préféré pourtant «<br />
Une femme catholique à une musulmane, le code civil au code musulman, l'église à<br />
la mosquée, la bénédiction d'un prêtre à la khoutba d'un marabout ». Lamine Guèye,<br />
le musulman, était présenté en train de boire le champagne au bar du Palais<br />
Bourbon, à Paris.<br />
Outre l'enseignement et l'islam, "Condition Humaine" s'intéressait aussi<br />
à d'autres questions sociales celle des terres léboues était abordée en donnant la<br />
parole à Robert Delmas, grand conseiller de l'AOF au titre du Sénégal qui passait<br />
en revue la législation coloniale sur la terre et ses conséquences à Dakar.<br />
L'analyse du décret de novembre 1930 et de l'ordonnance de novembre 1945<br />
posaient des difficultés énormes aux populations locales dans ce contexte de<br />
domination coloniale. L'auteur montrait la volonté de coopérer des autorités<br />
léboues et la mauvaise volonté de l'administration coloniale 108 . Le directeur de la<br />
publication du journal, le parlementaire Senghor, était intervenu sur la même<br />
question foncière par un article intitulé "Le remembrement de la presqu'île du<br />
Cap Vert et le problème des terres léboues"l09. L'article ainsi titré occupait une<br />
page entière -la première- sur les deux du journal, marquant ainsi l'importance de<br />
la question à Dakar. Il estimait qu'il était « impolitique de dissimuler» l'impact<br />
social de cette réglementation qui entraînait un malaise réel.<br />
Autre problème social l'égalité des pensions pour les anciens<br />
combattants outre-mer avec ceux de la métropole. Senghor, lors d'une intervention<br />
à l'Assemblée nationale, avait présenté la situation d'inégalité comme une marque<br />
de discrimination raciale110. Plusieurs articles furent consacrés à la question dans<br />
les colonnes du journal.<br />
La question du commandement indigène retient longuement l'attention<br />
du rédacteur en chef du journal, Amadou Arona SY, de Mamadou Dia, secrétaire<br />
général du RD.S. et de Senghor. Ce dernier intervint sur cette question en signant<br />
un article intitulé "Du commandement indigène, il faut conclure".<br />
Une grande importance est donnée aux problèmes du monde du travail<br />
salarié. Les articles étaient souvent signés du député Abbas Guèye ou de Ibrahima<br />
Sarr, tous deux syndicalistes influents. Le premier avait été secrétaire général de la<br />
CGT de Dakar; ce qui avait pesé, pour beaucoup, dans son choix par Senghor en<br />
1951, comme co-listier. Le second avait conduit la longue grève des cheminots en<br />
270
6) "Réveil"<br />
Cet organe était celui de la section territoriale du R.D.A, au Sénégal<br />
l'U.D.S. Ce ne fut pas le cas au départ dans la mesure où, en 1945, Charles Guy<br />
Etcheverry en était le propriétaire et l'administrateur. "Réveil" était alors un<br />
organe d'opinion. A partir de 1947, il ouvrait les colonnes au R.D.A qui n'avait pas<br />
d'organe. Puis une partie du journal fut entièrement réservée au parti politique.<br />
Les problèmes politiques que la direction du R.D.A connut à partir de sa décision<br />
de désapparentement à l'égard du P.C.F, en 1950 , avaient eu des conséquences<br />
jusques et y compris au niveau de cet organe de presse dont d'Arboussier était<br />
devenu le rédacteur en chef. Un long et complexe conflit aux aspects politiques<br />
mais aussi juridiques, aboutit à ce que le journal passât entre les mains de la<br />
direction territoriale du mouvement politique, laquelle avait pris fait et cause pour<br />
Gabriel d'Arboussier. Dès lors, "Réveil" devenait un organe politique c'est à dire<br />
l'organe central de l'U.D.S, après une éclipse de quelques temps.<br />
Le journal, à partir de 1950 et jusqu'en 1955, s'était intéressé à divers<br />
sujets. En février 1950, il insistait longuement sur les manifestations organisées<br />
dans la capitale fédérale par les Partisans de la Paix. L'administration coloniale<br />
qui avait voulu empêcher ces manifestations -mais sans succès- avait été présentée<br />
par le journal comme ''seulement répressive, à l'imagination peu féconde". Il<br />
dénonçait les mesures de mutations arbitraires, d'emprisonnements et autres<br />
brimades engagées contre des militants de l'UDS. Il condamnait la répression<br />
contre le journal lui-même frappé par la mutation de son rédacteur en chef Bâ<br />
Thierno (cf liberté de la presse).<br />
Il condamnait le conseiller sénégalais de l'Union, Babacar Diop, de la<br />
SFIO, qui s'était rendu en Côte d'Ivoire avec le gouverneur général de Dakar au<br />
moment de la violente répression contre le R.D.A dans ce territoire «Honteuse<br />
manoeuvre de division. .. tendant à accréditer la monstrueuse idée que le Sénégal se<br />
désolidarisait des populations de Côte d'Ivoire »116.<br />
Au sujet de cette situation en Côte d'Ivoire, "Réveil" dénonçait les<br />
manoeuvres administratives tendant à priver l'union territoriale du soutien moral<br />
et politique de la section soeur du Sénégal. Le journal se référait au blocage, par<br />
le service fédéral des postes, des télégrammes envoyés par la section sénégalaise.<br />
La sectionU.D.S avait même, à ce sujet, envoyé un télégramme de protestation à<br />
Georges Bidault, à l'époque président du Conseil à Paris. TI publiait également<br />
une lettre de Modibo Keïta, secrétaire territorial du R.D.A au Soudan, dénonçant<br />
les mesures répressives du gouverneur du territoire contre le mouvement. Modibo<br />
116. "Réveil" du 27/02/1950.<br />
272
l'Afrique noire<br />
« JO) la lutte pour l'indépendance d'abord, et l'unification ensuite de<br />
2°) la réhabilitation de la femme noire, l'affirmation de sa personnalité<br />
et sa lutte sur le plan politique, économique, social et culturel ».<br />
Abdel Khader Fall qui se référait à la possibilité de choix au<br />
référendum s'en prenait vivement« à ceux qui ont osé repousser cette offre inespérée<br />
et sans précédent dans l'histoire de la colonisation»136 . Parlant de la communauté<br />
mise en place après les votes de septembre, Bachir Thioune, l'un des éditorialistes<br />
de "Momsarev" disait «La réalité est que nous sommes dans la Communauté, dans<br />
un état de soumission honteuse à l'impérialisme français »137.<br />
Le journal conviait les partis politiques sénégalais à une rencontre pour<br />
le 28 septembre 1959 afin de sceller l'unité nationale pour l'indépendance,<br />
puisque, un an auparavant, la chance n'avait pas été saisie.<br />
La place que le rédaction de "Mornsarev" accordait à la question de<br />
l'indépendance n'avait pas occulté les autres problèmes. C'est ainsi que les<br />
questions syndicales furent l'objet d'une attention notable. Ainsi, lorsque le maire<br />
de Dakar refusa à l'VGTAN, en grève, le terrain du Champ de Courses pour<br />
l'organisation d'un meeting, "Mornsarev" dénonça l'attitude du premier magistrat<br />
de la ville en termes très vifs et rendit un hommage appuyé au C.l.S qui, en la<br />
circonstance permit à la centrale syndicale d'utiliser son terrain I38 . Cet hommage<br />
à la jeunesse mettait en relief le fait que le Conseil ne s'était pas contenté de<br />
prêter son terrain, mais avait aussi organisé une grande soirée artistique dont la<br />
recette fut versée intégralement à l'VGTAN. Ce geste fut apprécié en raison des<br />
nombreux licenciements opérés par les autorités gouvernementales contre les<br />
grévistes.<br />
Lorsqu'à la SOCOCIM, importante unité industrielle de production de<br />
ciment, la grève éclate en novembre 1958, le journal qualifiait l'attitude des<br />
autorités gouvernementales -- qui avaient envoyé les forces de police contre les<br />
grévistes -- de geste de soumission au grand capital local. Le ministre de<br />
l'intérieur fut traité «d'agent zélé du colonialisme »139. Quant au directeur de cette<br />
unité industrielle, son comportement fut considéré comme celui d'un maître<br />
devant ses esclaves.<br />
L'homme avait élaboré, seul, un règlement intérieur et exigeait des<br />
ouvriers qu'ils le signent. Ce règlement intérieur comportait des mesures<br />
vexatoires telles que « Aller au ''besoin'' impliquait une demande obligatoire ». La<br />
grève dura un mois. "Mornsarev" salua le courage et la détermination, tout comme<br />
136 "M v" N°16<br />
nT omsare .<br />
138. N'I2.<br />
139 om .<br />
.m.<br />
277
la lucidité des travailleurs grévistes qui obtinrent aux élections du personnel<br />
organisées après la grève, six sièges de délégués du personnel sur sept. Le<br />
septième délégué devant, lui, représenter 12 employés africains de bureau et le<br />
personnel européen de l'usine. La victoire était totale dans cette unité industrielle<br />
pour ces travailleurs qui avaient osé et su se battre.<br />
Lorsqu'en fin 1958 début 1959, l'usine Valdafrique, toujours à Rufisque<br />
licencia la moitié de son personnel sans préavis, "Momsarev" dénonça l'inertie du<br />
gouvernement de l'autonomie interne pour la défense des intérêts légitimes des<br />
travailleurs. Le journal mit cette attitude en contradiction avec la rapidité par<br />
laquelle ce même gouvernement faisait intervenir ses forces de police et de<br />
gendarmerie pour défendre les intérêts des capitalistes. Nors que se multipliaient<br />
les grèves au Sénégal, l'organe l40 de la section territoriale du P.AI remarquait<br />
qu'au même moment, les travailleurs guinéens ne faisaient pas la grève, eux qui<br />
s'étaient battus pour obtenir leur indépendance. Le journal tirait également les<br />
enseignements de l'échec de la grève générale déclenchée par l'UGTAN, le 5<br />
janvier 1959. Seck Moussé Guèye trouvait plusieurs raisons à cet échec certes les<br />
pressions des autorités gouvernementales étaient évidentes par le biais des<br />
discours radiodiffusés du Chef de gouvernement menaçant les grévistes, les<br />
communiqués radiodiffusés publiés aussi par "Paris-Dakar", les arrestations des<br />
leaders syndicaux etc... mais l'UGTAN, elle-même avait montré des faiblesses. La<br />
direction de la centrale faisait preuve de trop de timidité et étouffait la lutte sous<br />
le poids de la "légalité". Le journal reprochait aussi à cette direction de comporter<br />
beaucoup de responsables trop portés à la politique. Cette situation apparaissait<br />
même inquiétante à plusieurs égards. Ces dirigeants syndicaux qui étaient en<br />
même temps responsables politiques dans un parti au pouvoir, en lutte contre les<br />
travailleurs, ne pouvaient pas conduire des actions concrètes de grève.<br />
"Momsarev" tirait plus tard une autre conclusion de cette situation d'ensemble du<br />
monde syndical dakarois « Un congrès extraordinaire s'avère opportun pour<br />
consolider l'unité territoriale du monde du travail du Sénégal, qui doit reprendre sa<br />
place dans le mouvement de libération nationale »141 ; il en appelait à un retour à la<br />
ligne syndicale définie par le congrès de juin 1958, à Kaolak car ils'in<br />
quiétait de la division qui était intervenue dans le monde syndical sénégalais, et<br />
qui fut étalée au grand jour le 1 er mai 1959 par l'organisation de deux meetings<br />
différents, raison pour laquelle les adversaires des travailleurs en lutte s'en<br />
réjouissaient dans la presse officielle et officieuse 142 . Les difficultés multiples des<br />
travailleurs sénégalais étaient expliquées par la place grandissante que les<br />
278
aciste, ne pouvant pas concevoir qu'un Blanc soit relativement sous les ordres d'un<br />
Nègre »147.<br />
A propos de la répression qui s'abat sur les membres du P.A.I et<br />
notamment sur les rédactions des journaux du parti, "Momsarev" qui avait donné<br />
beaucoup de détails sur les manifestations concrètes de cette répression, concluait<br />
en ces termes «Le Sénégal est hors la loi »148. Selon lui toute cette répression<br />
engagée par les autorités gouvernementales n'avait qu'un objectif briser le parti<br />
marxiste léniniste. "Momsarev" voyait dans la détermination, le courage,<br />
l'abnégation et le sacrifice des militants, la preuve que cette politique des autorités<br />
était, à coup sûr, vouée à l'échec.<br />
A partir d'août 1960, "Momsarev" s'engageait dans la parution<br />
clandestine après la dissolution administrative du P.AI consécutive aux élections<br />
municipales de la fin de juillet.<br />
14'7' "M ... N 0 lS<br />
148' omsarev .<br />
. N" 22bis.<br />
280<br />
• _ SU.Sii
CHAPITRE III. TELEPHONE, TELEGRAPHE, TELEX ET COURRIER.<br />
Ces moyens de communication modernes ont pris une importance réelle dans<br />
la ville de Dakar suite à l'accroissement de la population - surtout européenne - mais<br />
aussi au développement des multiples activités économiques, des hautes responsabilités<br />
administratives et militaires. Leur existence et leur développement dans la capitale<br />
fédérale de l'AOF sont étroitement liés aussi à la position de carrefour de la ville.<br />
Il BREF HISTORIQUE DU SERVICE DES POSTES.<br />
L'origine des relations postales entre la côte ouest africaine et la France<br />
remonte à 1626( 1 ). Deux villes du Sénégal, Gorée et Saint-louis, eurent leurs premiers<br />
bureaux de postes respectivement en 1842 et 1856, mais ce n'est qu'en 1879 que les<br />
compagnies de navigation maritime Fraissinet et Chargeurs réunis organisent un<br />
véritable service postal au Sénégal 2 , lequel est suivi dès 1894 par celui de la Côte<br />
d'Ivoire et en 1897 par ceux de Guinée et du Haut Sénégal. En 1903, est créée à Dakar<br />
une inspection fédérale des postes et télégraphes qui voit ses activités s'étendre dès le 10<br />
janvier 1910 lorsqu'un arrêté ministériel autorise l'envoi de colis postaux et mandats. La<br />
création dès 1949 de l'Office des Postes et Télécommunications élargit davantage les<br />
responsabilités de la poste qui regroupe désormais l'ensemble des moyens de<br />
transmission de toute la Fédération 3 .<br />
Ainsi, dès 1954, le service fédéral des postes compte 416 bureaux<br />
télégraphiques et 114 stations radioélectriques et 20.000 abonnés. Il véhicule 2.200.000<br />
télégrammes et 13.500.000 communications urbaines et 1.200.000 communications inter<br />
urbaines assurées par 6.191 fonctionnaires et agents répartis en 3 cadre. Les Européens<br />
occupent près de 100 % des emplois du cadre général qui recrute soit à partir des écoles<br />
Polytechnique et Centrale mais aussi 60 à 70 % du cadre commun supérieur où le<br />
diplôme exigé est le baccalauréat ou la hiérarchie de contrôleur. Les Africains<br />
représentent la quasi-totalité des effectifs du cadre local exigeant comme qualification le<br />
CEPE et parfois même aucune référence intellectuelle 4 . Pour répondre aux besoins de<br />
plus en plus grand de cadres qualifiés, l'Ecole Fédérale des postes est créée dès 1952 à<br />
Rufisque pour la formation des agents du cadre commun supérieur.<br />
1. La mise en valeur de l'ADF in Série "Réalités africaines", 1955, p. 277.<br />
2. Affaires politiques de l'ADF, ANS Dakar, Rapport 2G 54-11,1954.<br />
3. Arrêté n04641 D.P.T du 13 septembre 1949 du gouverneur général de l'ADF.<br />
4. Affaires politiques ADF, ANS Dakar, D.P.T, Rapport annuel 1954, 2G 54-11.<br />
281
Au niveau de Dakar, les progrès accomplis par le service des postes sont plus<br />
marquants surtout à partir de 1905, date à laquelle la liaison par câble sous marin est<br />
réalisée entre Dakar et Brest et que dès l'année 1908, une première station radio<br />
électrique fut installée au Cap des Madeleines, laquelle est suivie d'une autre plus<br />
grande, installée dans la banlieue à Rufisque dès 1920. Cette nouvelle station permettait<br />
à la capitale fédérale de pouvoir communiquer avec les principales localités de la<br />
Fédération. Dès 1928, d'importants efforts d'équipement permirent l'installation d'une<br />
nouvelle liaison radiotéléphonique entre la métropole et Dakar. Les premières années<br />
de l'après-guerre connurent des investissements plus importants. Au premier central<br />
téléphonique automatique de 200 lignes installé en 1943, vient s'ajouter dès 1949, un<br />
autre de 2.000 lignes et ensuite l'important central de Médina avec ses 3.000 lignes<br />
complète dès 1950, l'ensemble du dispositif téléphonique à une période où les autres<br />
grandes villes du Sénégal : Saint-louis, Thiès, Kaolack, Ziguinchor etc... se dotent de<br />
centraux manuels. La poursuite des investissements réalisés par le FIDES profite<br />
largement à la capitale fédérale dans le domaine des communications et<br />
particulièrement pour le téléphone.<br />
11/ POPULATION FACE AUX ACTIVITES DU SERVICE DES POSTES.<br />
Au 1 er janvier 1955, les services administratifs comptaient, pour la ville de<br />
Dakar, 4.005 postes principaux et 3.300 postes téléphoniques secondaires. 5.547.000<br />
communications étaient assurés, soit en moyenne 4,6 communications par abonné et par<br />
jour. Ceci traduit un progrès notable par rapport à l'année 1950 pour le nombre de<br />
téléphones 5 :<br />
Entité 1/1/50 1/1/53 1/1/55 Progression<br />
Dakar 4412 6574 7616 13%<br />
Sénégal 1686 3136 3356 7%<br />
AOF 9894 16285 19380 19%<br />
Cette progression pour la ville de Dakar pouvait aussi être comparée à<br />
l'équipement dans d'autres villes importantes de la fédération. Ainsi au 1/1/55, nous<br />
avons les données suivantes 6 :<br />
5. Rapports de 1950 à 1954, Direction fédérale des Postes.<br />
6. Ibidem<br />
282
Ville Postes principaux Postes secondaires<br />
Dakar 4005 3300<br />
Abidjan 975 1301<br />
Conakry 606 536<br />
du 1/1/55 :7<br />
283<br />
La situation se présentait, au niveau du trafic téléphonique urbain, à la date<br />
Villes Total communications Moyenne/1 /Personne<br />
Dakar 5.547.000 4,6<br />
Abidjan 1.328.000 4,5<br />
Conakry 817.000 4,5<br />
La Chambre de commerce de Dakar donnait les chiffres globaux suivants (<br />
sur toute la période de 1948 à 1958)8.<br />
Entité Postes principaux postes secondaires Total<br />
Sénégal 7389 6448 13875<br />
AOF 13690 11391 25351<br />
Bien entendu, ces chiffres n'avaient de signification que éomparés à la<br />
population pour savoir qui, effectivement, disposait d'un poste téléphonique. Pour toute<br />
l'AOF, la direction fédérale des postes et télécommunications, dans le rapport de<br />
gestion de 1952, estimait qu'il y avait en moyenne 1 poste pour 1.000 habitants. Ce qui à<br />
son avis était faible. A Dakar, à cette date, il y a 6574 appareils pour une population<br />
totale de 375.220 habitants (Dakar et sa banlieue), soit une moyenne de 1,7 poste pour<br />
1000 habitants. Une source militaire, le rapport de l'état-major de l'AOF considère que<br />
dans la ville, elle-même, en 1958, le nombre d'abonnés s'élevait à 10.000 sur une<br />
population totale de 350.000 habitants; soit en moyenne 1 poste pour 35 habitants 9 . Par<br />
7. Ibidem<br />
8. Syntbèse de la situation économique AOF, P.439.<br />
9. Fiche 21.
contre, Pierre Biarnes, ancien secrétaire général de la chambre de commerce de Dakar,<br />
écrit: «Les abonnés au téléphone passent de 1947 à 1956, de 4500 à 14.000 »10.<br />
Tous ces chiffres ne traduisent qu'une situation globale. Le détail permettait<br />
une appréciation plus significative de l'existence du téléphone comme moyen de<br />
communication dans la ville de Dakar.<br />
Le recensement démographique de la population africaine, effectué à Dakar,<br />
en 1955, comportait divers volets sur l'équipement dans le milieu africain. Le téléphone<br />
ne figurait pas dans les éléments à recenser, preuve qu'il occupait une place négligeable<br />
dans l'équipement de l'habitat indigène. Sinon, il aurait mérité l'attention des autorités<br />
sauf si ces dernières, à partir de leurs propres informations, n'avaient pas cru utile de<br />
faire figurer cet élément dans les renseignements qui leur étaient utiles. Toutefois, la<br />
répartition des abonnés téléphoniques par groupe racial par exemple, aurait pu<br />
intéresser les autorités à l'instar de l'équipement en appareils radio.<br />
En réalité, c'est l'extrême faiblesse de l'équipement téléphonique dans<br />
l'habitat indigène qui expliquerait son absence dans le répertoire des équipements établi<br />
dans le cadre des enquêtes relatives au recensement démographique de 1955. Ceci était<br />
d'autant plus vrai que, en 1959, il n'y avait que 10.000 abonnés pour la ville. En prenant<br />
en considération les administrations et services pour environ 70 à 80 % des<br />
abonnements, et également le milieu européen de la ville pour environ la à 20 % -tout<br />
en tenant compte du fait que les Européens disposaient également des lignes des<br />
administrations et services en quasi-liberté absolue, même pour les besoins personnels,<br />
l'insuffisance de l'équipement téléphonique en milieu indigène s'avérait être une réalité<br />
indéniable. Surtout si l'on intégrait dans cette analyse le coût des installations d'une<br />
ligne téléphonique ainsi que le coût des communications.<br />
Ainsi, il y avait, moins de 5 % d'Africains abonnés au téléphone à Dakar.<br />
Plusieurs informations permettent d'y croire. Dans le rapport soumis aux<br />
délégués au congrès de la SfIO, en mai 1951, à Thiès, il était signalé que le siège du<br />
parti n'avait pas de machine à écrire ni à ronéotyper. Cette situation avait déjà été<br />
signalée aux assises de 1950 et revenait dans le rapport de 1952. Il est à penser, dans ces<br />
conditions, que ce siège n'avait pas de téléphone non plus. Or, à cette époque,<br />
incontestablement, la SFIO était le parti tout puissant à Dakar. Hormis les journaux<br />
tenus par des Européens, "Paris-Dakar", "Echos d'Afrique noire" et "Afrique nouvelle",<br />
aucune rédaction ne signalait à l'intention de ses lecteurs, un numéro de téléphone, et<br />
pas davantage les journaux de partis ou de syndicats africains ni même les organes de<br />
jeunesse ou d'étudiants, étant donné leurs difficultés financières. De plus, quelques<br />
grandes personnalités de l'administration municipale dakaroise ne disposaient pas de<br />
téléphone. Ce qui était un handicap à la bonne marche du conseil municipal. Ainsi, lors<br />
10. Pierre Biarnes, Les Français en Afrique noire, op. cit., p.298.<br />
284
de la délibération du 17 juillet 1952, les difficultés de fonctionnement de ce conseil<br />
étaient apparues dans diverses interventions. Le conseiller Amadou Barry les résumait<br />
ainsi : « Beaucoup d'intervenants l'ont déjà dit avant moi... Si l'on a une affaire à<br />
soumettre, on ne peut toucher le maire ll . Il habite très loin. Il n'a pas de téléphone ». Déjà,<br />
à diverses reprises, en 1950, Paul Bonifay, faisant office de maire, était intervenu auprès<br />
de l'ingénieur chef du service technique des transmissions de la capitale, pour que<br />
l'adjoint au maire de Dakar, délégué aux affaires sociales et domaniales, ait une<br />
installation de ligne téléphonique. Il écrit, le 22 novembre 1950 à l'ingénieur chef: «J'ai<br />
l'honneur de vous rappeler ma lettre n° 814/SG du 26 octobre 1950, dans laquelle je vous ai<br />
demandé de vouloir bien faire installer, dans les meilleurs délais, au domicile de l'adjoint<br />
délégué aux affaires sociales et domaniales 'lie la commune, à Gorée, un appareil<br />
téléphonique, avec ligne directe de Dakar à Gorée...». Dans une autre délibération, au<br />
début de novembre 1950, l'adjoint au maire, chargé des affaires sociales et<br />
domaniales12 rapportait diverses plaintes de responsables municipaux, trop souvent<br />
dans l'impossibilité de le joindre, dans le cadre du service, pour des questions urgentes.<br />
En somme, le téléphone n'était manifestement pas un élément à la portée<br />
des indigènes, y compris de hauts responsables, dans la ville de Dakar.<br />
Sur la qualité du service téléphonique, quelques renseignements notent des<br />
insuffisances. La Chambre de commerce, à diverses reprises, émit des critiques, souvent<br />
même acerbes, contre le service des postes et télécommunications. A propos de<br />
l'annuaire téléphonique, un procès verbal de délibération disait : « La chambre de<br />
commerce est unanime à reconnaître le bien fondé des critiques... Les recherches des<br />
abonnés y sont très difficiles et souvent infrnctueuses par suite de nombreuses e"eurs et<br />
omissions qu'il comporle »13. L'Assemblée Consulaire prenait la décision d'engager, dans<br />
ce sens, une démarche urgente auprès des services compétents. Quatre mois plus tard, la<br />
chambre de commerce intervenait encore pour porter, à la direction des postes et<br />
télécommunications, les doléances de ses ressortissants en ce qui concerne le nouvel<br />
annuaire téléphonique. En réponse à sa démarche, elle s'entend dire que «les desiderata<br />
formulées ne peuvent pas avoir une suite immédiate pour les e"eurs et omissions qui sont<br />
reconnues comme réelles»14.<br />
A propos de la discrétion des communications, l'hebdomadaire "Marchés<br />
coloniaux,,15 écrivait : «... Enfin, le secret des communications radiophoniques. Des<br />
dispositifs mis en place... pour rendre incompréhensible la parole des co"espondants à<br />
quiconque capte la communication par un poste émetteur récepteur ordinaire. Des essais<br />
sont en cours pour étendre l'emploi de tels dispositifs aux liaisons radiotéléphoniques<br />
11. Il s'agit de Bâ Amadou, 1er adjoint faisant fonction de maire.<br />
12. Il s'agit de Thierno Amath Mbengue.<br />
13. Délibération du 28 février 1950<br />
14. Lettre de la direction de l'O.P.T en date du 19 mai 1950.<br />
15. N°l99 du 3 septembre 1949.<br />
285
Le professeur Jean Suret Canale parle lui aussi de l'existence d'une certaine<br />
censure à Dakar. Il indique qu'il avait reçu, de la métropole, deux lettres postées à la<br />
même période, à partir de deux villes différentes. Le contenu des deux lettres différait<br />
réellement. A sa grande surprise, lorsqu'elles lui parvinrent, elles étaient chacune dans<br />
l'enveloppe de l'autre. Ceci lui apportait la preuve que les deux correspondances avaient<br />
été lues. Peut-être dans une certaine précipitation et simple inattention, elles furent<br />
inversées au moment de la remise dans les enveloppes 20 . J.S Canale, militant<br />
communiste, avait eu, à Dakar, d'importantes responsabilités politiques mais surtout<br />
syndicales en tant que secrétaire général de l'union locale CGT de la Délégation. Ses<br />
activités n'avaient pas été pour plaire aux autorités dakaroises car beaucoup de grèves<br />
furent menées par la centrale syndicale dans la période. Il fut même expulsé de la<br />
Fédération, sur ordre du Haut Commissaire, le socialiste Bechard, par avion spécial.<br />
C'était certainement à cause des activités syndicales et politiques de Suret Canale que<br />
son courrier était censuré.<br />
Un haut fonctionnaire de l'administration coloniale dakaroise fit aussi état de<br />
la censure. Michel Jobert 21 qui a été directeur de cabinet du Haut commissaire de<br />
l'AOF, Gaston Cusin, profitait de ses nombreux déplacements à l'aéroport de Dakar<br />
Yoff où il accompagnait des hôtes de marque, pour envoyer son courrier, afin d'éviter la<br />
censure. La presse dakaroise aussi dénonce la censure. Ainsi dans son édition en date du<br />
28 avril 1955, "Echos d'Afrique noire" se demandait ce qui se passe aux P.T.T en AOF.<br />
Le journal s'en prenait à ces "messieurs de la censure" ou du "cabinet noir" qui ouvraient<br />
son courrier, à deux reprises. Il condamnait cette action illégale et imprudente. En<br />
somme, ces moyens modernes de communication, d'information et d'expression jouèrent<br />
un rôle important dans la vie sociale à Dakar dans cette période. Cependant, ils ne<br />
furent pas exempts d'insuffisances réelles liées surtout au contexte colonial. D'où la<br />
persistance et même le développement des moyens traditionnels plus disponibles pour la<br />
masse de la population africaine.<br />
20. Entretien avec l'intéressé.<br />
21. Fut ministre des affaires étrangères de France sous Giscard D'Estaing, in Mémoires d'avenir, 1974, p.98.<br />
287.
CHAPITRE IV : LES MOYENS TRADITIONNELS<br />
Il LA RUMEUR PUBLIQUE<br />
288<br />
Elle est définie par les chercheurs américains Gordon (W) Allport et Leo<br />
Potsman comme étant «une affinnation générale que l'on présente comme vraie, sans qu'il<br />
y ait des données concrétes pennettant de vérifier son exactitude»1.<br />
Alfred Sauvy la considère comme la transmission de l'information de "bouche<br />
à oreille". Pour lui, c'est ce qu'il convient d'appeler "les nouvelles orales,,2.<br />
1) Sa permanence<br />
Sa place a été importante dans les courants d'opinion de la ville de Dakar<br />
pendant la période 1945-1960 comme l'attestent diverses sources en particulier la presse<br />
et les rapports administratifs.<br />
Au début d'août 1948, dans un rapport qu'il dresse après les entretiens<br />
relatifs au renouvellement de la convention entre l'AFP et le gouvernement général de<br />
l'AOF, le négociateur de l'agence présente comme suit la position du gouvernement<br />
général en matière d'information: «... On est bien obligé de tenir compte de l'état mental<br />
arriéré de la masse africaine sensible à la moindre rumeur, parce que dénuée, aussi bien de<br />
sens de l'objectivité telle que nous le concevons, que de celui de la mesure»3<br />
En décembre 1944, de graves incidents ont lieu dans le camp militaire de<br />
Thiaroye, dans la banlieue dakaroise. Autorités militaires et administration tentent de<br />
faire en sorte qu'ils ne soient pas connus de la population indigène. Mais, vainement.<br />
La presse dakaroise aussi, par ses divers organes, prouve l'existence de cette<br />
rumeur publique. Ainsi, à propos d'un scandale financier dû à un trafic de licence<br />
d'importation, l'officieux "Paris-Dakar" dit : «... Toute la ville en parle... De bouche à<br />
oreille, les tuyaux courent... certains y croient dur comme fer» 4 .<br />
Lors d'un procès dans lequel diverses personnalités dakaroises sont<br />
impliquées, "Echos d'Afrique noire" écrit: «... Qu'ont dû penser les Africains présents dans<br />
la salle d'audience, car chez eux, les phrases circulent et se répandent »5. L'hebdomadaire<br />
catholique "Afrique nouvelle", à diverses reprises, a fait état de la rumeur publique<br />
1. Les bases psychologiques de la mmeur in Psychologie sociale, textes fondamentaux, Tl par Andre Levy, P.183.<br />
2. Alfred Sauvy, Que sais je? L'opinion publique, p. 24.<br />
3. Affaires politiques AOF, ANS, 9 AR-47.<br />
4. "Paris-Dakar" du 9 juin 1948.<br />
5. "Echos d'Afrique noire" du 7 juillet 1950.
comme élément d'information à Dakar. L'organe de la section sénégalaise du P.A.I<br />
communiste rapporte que commentaires et protestations se sont multipliés dans la<br />
Médina à propos d'un décret sur l'habitat: « Tout le monde en parle dans la ville ».<br />
Le contenu des diverses sources permet d'établir une typologie. Utilisant la<br />
classification de Gordon, Allport et Potsman qui différencient rumeurs hostiles et<br />
rumeurs diffusant la peur, nous classons les rumeurs circulant à Dakar dans la période<br />
étudiée en rumeurs ayant un fondement dans la réalité et en rumeurs s'appuyant sur le<br />
symbolique et l'imaginaire de la population.<br />
- 1er type : Les rumeurs ayant un fondement dans la réalité sont les plus<br />
nombreuses d'après nos sources. Leur fonction est bien particulière; elles sont un<br />
palliatif aux carences des canaux officiels et mieux qu'eux, elles dynamisent la vie<br />
sociale. La circulation de l'information fait naître le débat, donne aux gens les<br />
références qui leur manquent pour juger des problèmes traités et parfois aide à une<br />
prisd de conscience collective qui peut déboucher sur des structures d'organisation<br />
r<br />
revendicatives. Ainsi, en juillet 1959, la population de la Médina s'organise et s'oppose à<br />
l'application du décret mettant ce quartier à la disposition de l'OHLM qui veut y édifier<br />
des logements neufs. En 1990, il n'est pas encore appliqué.<br />
Elle sont positives quand elles aident la population à défendre ses intérêts et<br />
peuvent devenir hostiles quand la population se sent impuissante. Elles expriment alors<br />
la tristesse, la colère, l'agressivité mais aussi bien souvent tout cela se transforme en<br />
rires et en dérision car l'humour est très présent dans la mentalité et la vie quotidienne<br />
africaines.<br />
Le 1er décembre 1944, de graves incidents ont lieu au camp militaire de<br />
Thiaroye, dans la banlieue dakaroise. Autorités militaires et admiilistration tentent de<br />
faire en sorte qu'ils ne soient pas connus de la population indigène. Ce fut vain. Les<br />
rapports de police établissent que dès le lendemain, 2 décembre, la population.<br />
autochtone en est informée par la rumeur publique. Cette population dakaroise a connu<br />
les événements par la concordance de divers faits isolés rapportés dans les milieux<br />
indigènes par les subalternes de l'hôpital européen, par les habitants du village proche<br />
du camp, mais aussi par quelques soldats indigènes 6 . L'émotion créée est telle qu'une<br />
délégation de notables se rend auprès du chef de la Circonscription pour s'informer<br />
mais aussi demander justice pour les familles des tirailleurs assassinés pour avoir<br />
revendiqué leurs droits. Pendant des années, tristesse et colère entretenues par la<br />
rumeur publique se sont concrétisées par le dépôt d'une gerbe au cimetière par le<br />
Conseil de la Jeunesse du Sénégal et du Conseil Mondial de la Paix à Dakar.<br />
6. Affaires politiques AOF, ANS, dossier 1/2 D3, rIl21, Tirailleurs prisonniers de guerre rapatriés.<br />
289 .'.
voyez où ça nous mène leur indépendance ». Il s'agit, ici, de l'indépendance de la<br />
Fédération du Mali au sujet de laquelle, Mamadou Dia, dans un message radiodiffusé à<br />
l'occasion du nouvel an, avait dit: « 1959 a été l'année de l'autonomie interne, 1960 sera<br />
une année faste. 1960 ouvrira l'ère de l'indépendance »10. L'indépendance du Mali est en<br />
voie de réalisation puisque, à la date du 4 avril déjà, les accords entre autorités<br />
maliennes et françaises en ont fixé les grandes lignes. Existe t-il un lien de cause à effet<br />
entre cette indépendance du Mali prévue pour juin et cette rumeur de raz de marée à<br />
Dakar? Il est fort probable que l'origine de cette rumeur se trouve dans les milieux<br />
hostiles à l'indépendance, africains comme européens. Un sentiment général de peur et<br />
de panique aurait pu servir de levier à des forces hostiles au processus, pour une<br />
tentative de remise en cause. Ces milieux opposés à toute indépendance n'avaient pas<br />
cessé d'être actifs à Dakar, particulièrement en septembre 1958 et après. Que ces forces<br />
agissent donc ici par un autre moyen, c'est à dire en créant un sentiment de peur et de<br />
panique, il n'y a qu'un pas à faire.<br />
La rumeur devient une arme politique de taille. De ce point de vue, on peut<br />
considérer qu'elle diffuse la peur, mais qu'elle est aussi le reflet d'un désir: celui de<br />
faire en sorte que cette indépendance ne se réalise pas.<br />
Rapidité et solidité de "sa vérité" fondent la rumeur publique.<br />
- Rapidité. Le grand roman sénégalais Abdoulaye Sadji, à ce sujet, s'exprime<br />
ainsi: «... Le bruit qui courait à Dakar avait pris le sillage du train quelque temps après son<br />
départ. Or, un bruit, cela va plus vite que la fumée de la locomotive et ça brûle les gares. Il<br />
ne stationne pas. Bien au contraire »11.<br />
- Solidité. Un adage ouest africain dit que: « L'hyène proclame qu'elle ne<br />
connaft pas la vérité; mais qu'elle sait que ce que tout le monde dit est la vérité »12. En tout<br />
cas, le vendredi 13 mai 1960, aucun événement particulier n'eut lieu à Dakar dans le<br />
sens du raz de marée que la rumeur publique avait véhiculé. Les faits apportèrent la<br />
preuve que la rumeur était fausse. Ce qui ne veut pas dire que les objectifs des milieux à<br />
l'origine de la rumeur s'étaient assignés étaient sans valeur.<br />
Pourquoi donc une telle place à la rumeur publique à Dakar?<br />
2) Les causes<br />
a) Longue tradition de l'oralité.<br />
Dans cette société africaine traditionnelle, la place de l'écriture était très<br />
faible, dans les cas où elle existait. Ainsi dans le milieu lébou, toutes les décisions<br />
importantes étaient prises, après débat, par les assemblées représentatives (celles des<br />
10. "Paris-Dakar" du 2 janvier 1960.<br />
11. Abdoulaye Sadji, Maïmouna, p. 212.<br />
12. Traduction d'un adage qu'on trouve dans toutes les langues de l'ouest africain.<br />
292
Diambours et des Freys). Rien n'était consigné par écrit. L'éxécution des décisions<br />
n'était susceptible de se heurter ni à la moindre contestation ni au moindre doute. La<br />
diffusion de l'information se faisait oralement et dans les milieux adéquats c'est à dire<br />
intéressés. Le fait que diverses personnes pouvaient, individuellement, répondre des<br />
décisions prises donnait à l'oralité, comme moyen de circulation et d'information, tout<br />
son crédit et toute sa garantie. De plus, tout un ensemble de sanctions étaient prévues<br />
pour permettre de maintenir le caractére de véracité de l'information à véhiculer. Cette<br />
conception de l'oralité était -à quelques légères différences près- partagée par les autres<br />
groupes ethniques de la ville de Dakar.<br />
Bien entendu, la colonisation apporta ses moyens et canaux de<br />
communication et d'information, comme la presse, la radiodiffusion, le téléphone, le<br />
télégraphe etc... Or, ces moyens ont ceci de différent par rapport à l'information<br />
traditionnelle liée à l'oralité que la source de l'information devient très distante, pour le<br />
contrôle pour ne pas dire qu'elle devient impossible à contacter. Dans ce sens, si l'auteur<br />
de l'information dans le nouveau mode ne disparaît pas en tant qu'élément physique,<br />
son éloignement, par rapport à la masse africaine, en fait presque un élément<br />
"inexistant". D'autant plus que le contexte dakarois de domination coloniale, les<br />
responsables de l'information - qu'elle soit écrite ou parlée - sont essentiellement des<br />
Européens. Or ceux-ci vivent socialement dans leur"ghetto", totalement coupés de la<br />
grande masse africaine.<br />
Alfred Sauvy remarquait que « toute transmission comporte deux actes; une<br />
expédition et une réception »13. Dans le contexte dakarois, l'expéditeur est l'élément<br />
européen, le récepteur est l'élément africain. Or la distance économique, sociale,<br />
politique, culturelle étant très grande entre ces deux pôles, la communication est<br />
d'autant plus difficile. Cette situation fait que, grosso modo, chaque pôle est à la fois<br />
expéditeur et récepteur de ses informations.<br />
L'élément indigène de la population ne dispose, pour l'essentiel, que de son<br />
moyen traditionnel d'information: l'oralité.<br />
b) L'inadéquation des moyens modernes.<br />
Ces moyens modernes c'est à dire la presse, la radiodiffusion etc seront<br />
étudiés en détail dans les chapitres précédents. Ici, nous nous intéressons aux éléments<br />
d'explication de la persistance de l'oralité, c'est à dire le faible taux de scolarisation et<br />
l'inadéquation de ces moyens.<br />
Une enquête effectuée à Dakar par une équipe pluri-disciplinaire conduite<br />
par Marc Sankalé 14 en 1962, indiquait que 50 % des salariés dakarois ne savaient ni lire<br />
13. Alfred Sauvy, L'opinion publique, Que sais je ? 4eme édition, 1977, p. 23.<br />
14. Futur doyen de la Faculté de médecine de l'Université de Dakar. Voir Ouvrage Dakar en devenir... P.447.<br />
293 .
était différente selon que le tam-tam annonçait une cérémonie heureuse ou<br />
douloureuse.<br />
La lecture de la presse dakaroise dans la période montre l'importance de<br />
1 l'utilisation du tam-tam. L'organe "Réveil" en parlant du congrès du C.J.S à Thiès en<br />
1<br />
, 1954, insistait sur le fait que la séance d'ouverture avait été précédée par un grand tam-<br />
tam, exactement comme la séance de clôture.<br />
"Condition Humaine", parlant du meeting d'information animé au Parc<br />
municipal des sports de Dakar par les étudiants de la FEANF en vacances au Sénégal,<br />
indique que le tam-tam avait servi à l'animation avant, pendant et après le meeting. A<br />
cette occasion, les étudiants africains en métropole avaient développé, pour le public<br />
nombreux, divers thèmes sur leurs conditions de vie et de travail 16 .<br />
"Afrique nouvelle", relatant la finale de la coupe théâtrale organisée par le<br />
C.J.S lors de sa 3 eme rencontre territoriale exprime la joie du public venu très<br />
nombreux assister à la compétition. La clôture de la rencontre avait donné lieu à un<br />
imposant défilé à travers les rues de la Médina, au son et rythme du tam-tam 17 .<br />
Des sources administratives également, font état de l'importance de la place<br />
du tam-tam dans les activités politiques. Les rapports de police et sûreté rapportaient<br />
que les divers partis en compétition en 1953, avaient donné libre cours à une animation<br />
très intense de tam-tam18. Cette source rapportait même que l'organe de presse "Echos<br />
d'Afrique noire" du 1 er janvier 1953, regrettait que la police dakaroise soit incapable de<br />
faire taire les tam-tam en milieu indigène à Dakar, à partir de 22 heures.<br />
Les délibérations et autres activités du Conseil municipal attestaient bien de<br />
la place du tam-tam dans la ville, surtout sous son aspect d'information. Délibérant à la<br />
requête de l'administration, sur l'interdiction du tam-tam, dans la ville à partir de 22<br />
heures, le Conseil municipal avait estimé qu'il n'était aucunement en son pouvoir,<br />
encore moins dans son intention, d'interdire ces formes de manifestations. Cette<br />
démarche de l'administration avait été introduite, auprès du Conseil municipal parce<br />
que des éléments européens de la ville se plaignaient de la nuisance du tarn-taro en<br />
provenance des quartiers indigènes. Cette initiative était très certainement en rapport<br />
avec la publication par "Echos d'Afrique noire" d'une demande adressée, au début de<br />
janvier 1953, à l'administration afin qu'elle fasse taire les tam-tam à 22 heures.<br />
Cette administration coloniale, elle-même, utilisait parfois le tam-tam dans le<br />
cadre du fonctionnement de ses services 19 . Exemple: le Délégué du gouverneur du<br />
Sénégal à Dakar adressait au maire de la ville, à la date du 22 mars 1952, une lettre dans<br />
laquelle il demandait« de diffuser, par crieur public, dans tous les quartiers indigènes, l'avis<br />
295 .<br />
16. "Condition Humaine" du 22 septembre 1952.<br />
17. "Afrique nouvelle" Juin 1958<br />
18. Affaires politiques AOF, ANSOM, carton 2142 dos 6 sur les municipales de 1953.<br />
19. Il en est de même en métropole où dans les petites communes et encore à la fm des années 1960, le garde champ<br />
faisait très souvent office de crieur public.
informant la population, de la distribution des cartes électorales du 23 au 26 mars 1952 »20.<br />
Le Délégué du gouverneur souligna l'importance qu'il attachait à l'utilisation de ce<br />
moyen d'information et de communication en ces termes «... Vous serait bien<br />
reconnaissant si cette disposition était prise ». Quelques jours plus tard, inquiet de la<br />
lenteur du retrait des cartes par la population, le Délégué insistait encore auprès du<br />
maire de la ville, pour que le même moyen soit utilisé pour informer du report de la<br />
date limite du retrait.<br />
De même, les autorités gouvernementales de la Loi-Cadre accordèrent une<br />
grande place au tam-tam dans leur processus de communication et d'information.<br />
- Moyen d'animation<br />
Lors de la préparation de la réception du général De Gaulle au Sénégal en<br />
décembre 1959, ces autorités voulurent tout mettre en place pour faire oublier, au<br />
Général, l'accueil "incorrect" de l'année précédente, place Prôtet. Le rapport de la<br />
commission d'organisation de la réception indiquait que tous les groupes folkloriques<br />
avec leurs tam-tam, devaient accompagner les comités d'action mis en place pour la<br />
circonstance 21 . Toutes les réceptions de personnalités gouvernementales, politiques,<br />
administratives et mêmes culturelles et religieuses, congres et autres donnent lieu à<br />
l'utilisation du tam-tam comme forme d'animation populaire.<br />
Dans sa forme récréative, le tam-tam avait ce pouvoir particulier d'attirer<br />
très vite la foule, dans le schéma suivant: d'abord les enfants, puis les jeunes, les adultes<br />
et enfin les personnes d'âge mûr. Dans la mesure où hommes et femmes pouvaient se<br />
retrouver tout autour du tam-tam, sans distinction aucune, on comprend sa place<br />
particulière comme élément de réjouissance mais aussi de mobilisation. L'aspect<br />
réjouissance précédait toujours, dans le cadre de la mobilisation, la délivrance du<br />
message, objet de la mobilisation. Cette place importante du tam-tam allait,<br />
relativement de pair avec la chanson.<br />
2) La chanson<br />
Comme le tam-tam était important dans ce milieu urbain, la chanson qui lui<br />
était étroitement liée, avait une place de choix. Le rôle de la chanson comme élément<br />
de mobilisation dans le travail de groupe était évident. Elle était un élément<br />
particulièrement privilégié dans les luttes politiques, surtout lors des campagnes<br />
électorales.<br />
20. Archives municipales, Série 2G dos 40 H et 35 H<br />
21. Archives municipales, Série 2G, dos A/75 réception du général de Gaulle.<br />
296 :'
Iba Der Thiam a montré l'importance de la chanson politique dans la<br />
campagne des législatives de 1914 22 . Pour la première fois qu'un indigène, en la<br />
personne de Blaise Diagne, se portait, avec de fortes chances, comme candidat pour le<br />
siège du territoire au Palais Bourbon à Paris, la mobilisation avait été grande dans les<br />
milieux indigènes. Le succès électoral du candidat nègre s'expliquait, dans une large<br />
mesure à la mobilisation rythmée par la chanson composée en la circonstance. Plusieurs<br />
couplets des multiples chansons en l'honneur du candidat devenu député, Blaise Diagne,<br />
se terminaient par ces termes très significatifs de la dimension raciale que l'élection<br />
avait revêtu : « Le bélier noir a vaincu le bélier blanc »23. La chanson politique se<br />
développa encore entre les deux: guerres quand les candidats africains furent en<br />
compétition. A la fin de la deuxième guerre mondiale, lorsque les luttes politiques<br />
.reprirent de plus belle, elle devint plus importante encore, particulièrement avec<br />
l'élargissement progressif du corps électoral. Bakary Traoré montrait cette dimension<br />
car elle a «folklorisé l'action politique »24.<br />
Avec la chanson, la place du griot restait déterminante, en tant que batteur<br />
de tam-tam, mais surtout en tant que compositeur. Certaines grandes figures de la<br />
chanson marquèrent profondément et durablement la mémoire collective. C'est le cas<br />
de Gallo Mbaye, griot de talent dans l'entre deux: guerres. Son oeuvre de composition<br />
fut poursuivie par son fils Badara Mbaye Kaba. Plus talentueux encore que son père, il<br />
était le griot attitré du B.D.S et essentiellement de l'homme politique L.S. Senghor. Il<br />
dominait, incontestablement, la composition de la chanson politique de l'époque. Il était<br />
de toutes les multiples tournées du député Senghor à travers le territoire. Partout, c'était<br />
sa voix d'or qui précédait les meetings et réunions importantes. La chanson politique,<br />
c'était aussi des voix non moins renommées comme celles de Bou Counta Ndiaye, Omar<br />
Ndiaye Samb, Abdoulaye Nar Samb, Samba Diabaré Samb etc... Elle glorifiait les faits<br />
d'armes du leader sur le terrain politique, exactement comme ce fut le cas pour les faits<br />
d'armes sur le champ de bataille à l'époque des guerres.<br />
297·<br />
Si la place du griot compositeur était aux: côtés du chef politique, c'était pour<br />
qu'aucun fait important ne puisse lui échapper. Lors des discours du leader, à tout<br />
moment, il pouvait l'interrompre pour chanter un couplet à la gloire du nouveau chef en<br />
même temps donner le ton à l'éxécution d'un air de tam-tam et un morceau de danse.<br />
Le griot coordonnait tout ceci car il était le chef d'une équipe importante de batteurs de<br />
tarn-tam, de danseurs, mais aussi de chanteurs. La place des femmes dans ces équipes de<br />
griots était importante dans la danse et la chanson. Par contre, elles ne battaient pas le<br />
tam-tam par respect de la coutume. Ces griots étaient, de tradition, des personnes de<br />
22. Iba Der Thiam, l'Evolution politique et syndicale du Sénégal de 1840 à 1936, Thèse d'état Histoire, Université Par<br />
1983.<br />
23. Traduction des mots ouolofs.<br />
24. Bakary Traoré, Forces politiques en Afrique noire.
caste, surtout en milieu lébou et ouolof. Parlant de la place des femmes dans la<br />
popularité de leur "homme" ou héros, Djibo Hadiza écrivait : « Elles contribuent à la<br />
popularité du leader politique... Chantent une douce mélopée à la gloire de leur idole »25.<br />
Elle résumait en ces termes, la chanson pro-Lamine Guèye : « Bachelier es lettres,<br />
professeur, premier docteur en droit, premier avocat noir »26. Dans le principal camp<br />
adverse, c'est à dire celui du RD.S, la chanson tournait sur « Premier agrégé noir ».<br />
Evidemment, à travers ces chansons, on remarque la place importante accordée au culte<br />
du diplôme. Il contribuait à accuser le prestige des élites intellectuelles, dans un<br />
contexte global où le diplôme est l'exception de fait.<br />
La chanson politique revêtait des aspects très divers. Chaque camp n'hésitait<br />
pas à fredonner les airs des plus obscènes, des plus outrageantes, des plus perverses à<br />
l'égard de l'adversaire. Dans ce camp, par exemple, un air très connu disait du leader<br />
adverse « qu'il a engrossé sa propre mère et parce que n'ayant pas les moyens financiers<br />
nécessaires pour assurer le baptême à l'accouchement, se fondait en larmes. Que X ayant<br />
pitié de lui, lui demanda de cesser ses pleurs car lui-même lui donnerait l'argent dont il a<br />
besoin pourfaire face à la cérémonie ». Dans le camp Y la réplique était à la dimension:<br />
« X n'a pas de père. Sa mère couchait partout avec n'importe qui. Lui-même agissait ainsi et<br />
l'a prouvé puisqu'il venait de le faire publiquement à l'occasion d'une réunion avec ses<br />
militants. C'était pour prouver à ses partisans qu'il n'était nullement frappé d'impuissance<br />
sexuelle comme le clament les adversaires ».<br />
'Le camp X chantait que "la mère politique", c'est à dire la responsable des<br />
feinmes du camp adverse n'était rien d'autre que la« commandante des garces et putaines<br />
». Cette chanson répondait à l'initiative du camp Y disant que « Celles qui couchent à<br />
tour de bras, celles qui se prostituent, celles qui sont disponibles pour les orgies... sont les<br />
militantes du camp X »27.<br />
Cet air, fredonné en choeur dans le camp X, se proposait de mettre de la<br />
brillantine 28 sur la tête du leader bien aimé et de lui donner un baiser. Par contre, la<br />
tête de Y serait arrosée avec du pétrole puis mise à feu. Dans le camp Y, il était repris<br />
dans les mêmes termes, à la seule différence que Y devenait X, ce qui donnait bien<br />
l'inverse.<br />
A travers la violence verbale que véhiculait la chanson populaire, le débat<br />
politique, lui-même, était nettement absent. Tout se résumait à haïr ou aimer, du moins<br />
dans les apparences. Aucun programme, aucune stratégie. Paul Mercier, en analysant<br />
cette situation, concluait par ces termes « L'examen de ces cas individuels a montré que le<br />
contenu conscient de l'appartenance politique se réduisait à peu près entièrement à la<br />
25.Djibo Hadiza, La participation des femmes, P.137.<br />
26. Ibidem<br />
27. L'auteur de ce travail se rappelle ces chansons.<br />
28. Produit de luxe pour les cheveux.<br />
298
elation avec le leader »29. Djibo Hadiza, arrivait à une conclusion identique en analysant<br />
le rôle de la femme sénégalaise dans le développement de ce processus politique,<br />
largement véhiculé par la chanson. L'aspect vénération du chef politique apparaissait.<br />
299,.' .-<br />
Pour Amadou Ndéné Ndao, cette chanson pouvait bien traduire une<br />
adhésion complète à un programme politique et non pas seulement à un homme<br />
politique. Tout dépendait de la nature des formations politiques. L'intéressé cite<br />
l'exemple des hommes mais surtout des femmes de la zone de Kagué Chérif dans la<br />
subdivision de Foundiougne. L'U.D.S-R.D.A mena une longue et dure bataille contre<br />
l'administration coloniale qui avait donné en bail, pour un franc symbolique,<br />
d'immenses et riches terres à un commerçant originaire de Saint-louis. La pertinence<br />
des arguments et la hauteur de la mobilisation des populations locales avaient fait<br />
obtenir la suspension du dit bail. Lorsque les leaders du parti vinrent annoncer aux<br />
habitants de Kagué Chérif la nouvelle de la victoire ainsi obtenue, les femmes et les<br />
hommes composèrent beaucoup de chansons à la gloire du R.D.A et des options de ce<br />
parti politique.<br />
Pour Amadou Ndéné Ndao, les responsables du parti avaient<br />
particulièrement apprécié cette forme de reconnaissance. Mais, il insiste sur le fait que<br />
c'était le parti qui était chanté et non ses leaders 30 .<br />
Cependant dans la personnalisation de la chanson politique, la présentation<br />
physique du leader occupait une place non négligeable. Lamine Guéye avait des atouts<br />
de taille de ce point de vue; de haute stature, beau et élégant, cultivant l'art des salons, il<br />
ne laissait certainement pas les femmes indifférentes. A l'opposé, L.S.Senghor, par sa<br />
petite taille, ses manières très proches du "toubab", son attitude souvent distante dans les<br />
relations sociales, attirait peu les foules vers lui. De plus, il ne parlait que très mal le<br />
ouolof.<br />
Cette place de la chanson politique dans la période 1958-1960, devient moins<br />
importante avec la mise sur pied de la formation politique unitaire U.P.S regroupant<br />
partisans de L.S.Senghor et de Lamine Guèye. Certes, cette formation dominante avait<br />
face à elle des partis d'opposition comme le P.A.I et le PRA-Sénégal mais ces dernières,<br />
relativement nouvelles, n'avaient pas une influence assez grande sur les masses<br />
dakaroises, plus précisément sur le plan de la chanson.<br />
nouveau.<br />
Celle-ci traduisait l'intégration d'une donnée traditionnelle, à un contexte<br />
3) Habillement.<br />
29. Paul Mercier, La vie politique... Op. Cit., p.72.<br />
30. Entretien avec A. Ndéné Ndao.
En tant qu'aspect d'expression d'une appartenance politique, l'habillement<br />
avait eu une place importante dans la vie locale. Le renouveau des dernières années de<br />
la guerre pour les organisations politiques mais surtout les premières élections <br />
municipales et constituante- avaient donné une place de choix au Bloc Africain,<br />
rassemblement de diverses forces politiques plus ou moins importantes, avec comme<br />
chef de file Lamine Guèye. Les femmes dakaroises s'étaient confectionnées une tenue<br />
spéciale appelée "robe Bloc" longue, de couleur rouge, laissant l'épaule gauche<br />
complètement nue. Elles se transformaient ainsi en panneau publicitaire pour le succès<br />
politique du Bloc Africain. Cette "robe Bloc" s'était répandue dans les communes de<br />
plein exercice et à Dakar particulièrement. La campagne activement et fortement<br />
menée pour le droit de vote des femmes de ces communes de plein exercice, dirigée par<br />
l'avocat dakarois et surtout la satisfaction obtenue au terme de cette lutte avaient<br />
solidement assis le succès personnel du leader. Les femmes avaient massivement porté<br />
cette tenue "Bloc" en hommage à ce Bloc Africain qui s'était vaillamment battu pour<br />
elles. Par la suite, lorsque Lamine Guèye quitte de façon ostentatoire le Bloc Africain<br />
pour consolider la SFIO, les femmes des communes de plein exercice suivirent le leader.<br />
Elles assurèrent ainsi ses succès électoraux futurs, à Dakar notamment. La robe "Bloc"<br />
devint l'expression de l'appartenance à la formation laministe et était de toutes les<br />
manifestations politiques, surtout dans la période de 1945 à 1960. Lorsqu'en septembre<br />
1948, l'unité de la SFIO fût ébranlée par la rupture survenue entre Lamine Guèye et<br />
Senghor, la tenue, comme élément d'expression d'une appartenance politique, prenait<br />
une grande ampleur. La période 1948-1957, particulièrement dans ses temps forts de<br />
consultations électorales, donnait à l'habillement politique une dimension nouvelle.<br />
Désormais, les femmes et les hommes se réclamant du B.D.S se vêtirent en vert, couleur<br />
de la nouvelle formation politique. A l'opposé, les partisans de la SFIO portèrent le<br />
rouge pour non seulement la robe mais aussi d'autres vêtements comme la camisole et<br />
le pagne, ou le grand boubou et le mouchoir de tête etc...<br />
Le signe distinctif de l'habillement politique était la chemise et le béret de<br />
couleur rouge pour la SFIO et vert pour le B.D.S. Les rapports politiques de la période<br />
avaient bien consacré les expressions "bérets rouges" et "bérets verts" pour dire partisans<br />
de Lamine Guèye pour les premiers, de Senghor pour les seconds. Dans les fréquentes<br />
manifestations politiques dakaroises de l'époque, cortèges "vert" et cortèges "rouge" se<br />
croisaient régulièrement, provoquant ainsi, très souvent, des bagarres violentes<br />
desquelles, par impuissance ou par expectative, la police dakaroise restait souvent à<br />
l'écart, se contentant de constater les dégâts. A travers les organes de presse de l'époque<br />
se retrouvaient divers témoignages de cette violence, qualifiée selon les cas, de "bérets<br />
rouges" ou de "bérets verts". C'est ainsi que "Paris-Dakar" publiait une lettre du R.P.F<br />
prônant l'abstention dans les élections municipales d'avril 1953. Elle situait les<br />
300
l'on lisait:
indigène, telles que les danses et chants religieux. Parmi ces journaux, citons "Echos<br />
d'Afrique noire".<br />
Le fanal, comme l'habillement, la chanson et le tam-tam, représentaient bien<br />
des formes spécifiques d'information, de communication et d'expression du milieu<br />
africain de Dakar. Les moyens à la disposition de l'administration coloniale n'étant que<br />
très partiellement à la portée de la population indigène, celle-ci n'avait d'autre choix<br />
que de continuer à développer et utiliser ses propres instruments sociaux. Mais dans le<br />
contexte de domination, l'administration ne laissait subsister que ce qui rentrait dans la<br />
ligne globale de préservation de ses intérêts de dominant conformément à la logique<br />
coloniale.<br />
305
TROISIEME PARTIE:<br />
QUALITE DE LA VIE A DAKAR<br />
OU<br />
OPINION PUBLIQUE ET QUESTIONS SOCIALES<br />
Les questions sociales constituent des paramètres importants pour une<br />
connaissance de l'opinion publique de la ville.<br />
En effet, à travers les questions comme la propriété du sol, l'habitat,<br />
l'alimentation, la santé, la propreté, la sécurité, l'école, la condition de la femme, le<br />
transport, l'impôt etc... tous les groupes de pression interviennent plus ou moins<br />
directement sur la qualité de la vie à Dakar.<br />
306
CHAPITRE 1 : SOL ET PROPRIETE DU SOL<br />
Cette question reste largement posée à Dakar dans les années 1945-1960.<br />
Elle traduit concrètement un état de relations entre puissance coloniale et population<br />
dominée. Les milieux indigènes dakarois avaient tenté de s'opposer à la mainmise sur la<br />
terre par l'administration. Les initiatives sont, à ce sujet, nombreuses.<br />
Dans les années 1943-1944, l'administration réquisitionna des terres aux fins<br />
de construire un nouvel aéroport à Dakar-Yoff. Cette mesure n'avait pas plus aux<br />
Lébous. Ceux-ci s'étaient adressés aux autorités locales pour faire prévaloir leurs droits<br />
sur les terres en question. Comme personne ne semblait avoir la moindre attention pour<br />
leurs doléances au niveau de la Fédération, les milieux lébous avaient saisi les autorités<br />
du Gouvernement de la France combattante à Alger pour obtenir un renoncement aux<br />
réquisitions de terres, ou, pour être dédommagés de manière équitable dans le cas<br />
contraire. Lamine Guéye et Thierno Amath Mbengue qui avaient fait le déplacement à<br />
Alger n'avaient pas pu obtenir un engagement dans le sens du renoncement, mais une<br />
simple promesse que les Lébous seraient dédommagés, non suivie d'effet dans<br />
l'immédiat. En 1954, c'est l'agent d'affaires dakarois, Omar Ndoye, dornicïlié au 10 de la<br />
rue de Valmy, qui, agissant en son nom propre et en celui de ses mandataires lébous<br />
Moussa Ndoye et consorts, réclamait à l'administration la somme de 250 millions de<br />
F.CFA en indemnisation d'une réquisition vieille de plus de trente ans. Le terrain en<br />
question, d'une superficie de 85 ha, n'était autre que celui sur lequel le quartier de la<br />
Médina avait été édifié, pour des raisons sanitaires, à partir de 1914. Une épidémie de<br />
peste qui s'était déclenchée à Dakar avait conduit les autorités à isoler les indigènes,<br />
loin de la zone d'habitation des Européens 1 .<br />
En 1956, Amadou Sène Thiam, personnalité léboue mais demeurant à<br />
Tivaouane, réclamait le versement d'une indemnité pour le terrain immatriculé sous le<br />
n03050 du livre foncier de Dakar-Gorée. Ce terrain, d'une surface de 81 hectares, avait<br />
servi à l'installation de l'Institut des Hautes Etudes de Dakar. D'autres revendications,<br />
sur d'autres terrains, avaient été formulées par El Hadj Diène et Madame Kalomby<br />
Diop, autres personnalités lébous. Quelques années plus tard, en 1959, la Collectivité<br />
léboue de Dakar réclamait la restitution, à elle-même, de l'ensemble de tous les titres<br />
fonciers établis au nom de l'Etat français dans la totalité de la presqu'île du Cap Vert 2 .<br />
Outre ces principales revendications, on en notait également d'autres,<br />
formulées par les Lébous de Dakar. Ainsi, le Grand Sérigne de Dakar, au nom de toute<br />
1. Salleras Bruno, La peste à Dakar, 1980, p.118<br />
2. Bernard Moleur, Le droit de propriété sur le sol sénégalais, 1978, p.318<br />
307
la Collectivité léboue, avait demandé le dédommagement, à propos de la réquisition<br />
n06087 déposée par l'administration le 20 décembre 1950, au sujet d'un terrain de 62 ha,<br />
à Yeumbeul, dans la banlieue dakaroise. L'administration avait installé un centre<br />
récepteur de télécommunications sur ce terrain. Toujours à Yeumbeul, le Grand Sérigne<br />
de Dakar s'élevait contre la réquisition n06403 du 1 er août 1952, immatriculant un autre<br />
terrain de 15 hectares pour y installer un centre radio servant à la navigation aérienne.<br />
L'implication du grand Sérigne de Dakar dans le mouvement revendicatif de<br />
sa collectivité donnait un poids plus important à la contestation des procédures<br />
d'acquisition des terres menées par l'administration coloniale. Malgré les multiples<br />
pressions de l'administration, les milieux lébous maintinrent leurs réclamations.<br />
En définitive, c'est le tribunal de Dakar qui trancha, par un jugement en date<br />
du 6 septembre 1956. Sans exception aucune, le tribunal concluait "au non fondé" des<br />
plaignants qu'il débouta tous 3 .<br />
Mesurant le degré d'indépendance de cette justice dakaroise à l'égard de<br />
l'administration, particulièrement sur cette question, les Lébous opérèrent un recul. Ils<br />
proposèrent, de donner main levée, sur les terrains de Yeumbeul d'une superficie de 77<br />
hectares, moyennant une somme totale de 12 millions. L'administration donna son<br />
accord, espérant ainsi ne plus avoir d'opposition de la part des Lébous pour l'avenir.<br />
Mais avant même l'exécution de cet arrangement, alors qu'elle voulait, quelques mois<br />
plus tard, effectuer une réquisition sur 4900 m 2 pour édifier un forage dans la banlieue<br />
dakaroise, une nouvelle fois, les Lébous s'opposèrent à la réquisition.<br />
Donc, à travers la période, ily eut diverses oppositions entre milieux lébous<br />
et administration à propos de la question fondamentale de la propriété du sol à Dakar<br />
et sa banlieue. L.S. Senghor, député du Sénégal, reconnaissait que le problème des<br />
réquisitions de terres par l'administration, « avait créé un malaise qu'il serait impolitique,<br />
parce que vain, de dissimuler». IlIa mettait en garde: « On ne gagne rien à prolétariser un<br />
peuple autochtone» 4 .<br />
En fait, le décret du 23 octobre 1904 organisant le Domaine en AOF et en<br />
AEF, stipulait: « Le Domaine est propriétaire en AOF de toutes les te"es vacantes et sans<br />
maître ». Le décret introduisait néanmoins une restriction, au sujet des terres formant<br />
"propriété collective" des indigènes. Que signifiaient ces termes "terres vacantes et sans<br />
maître" ?<br />
Par là, il fallait entendre toute terre ni immatriculée, ni possédée suivant les<br />
règles du Code Civil français. Ainsi, à partir d'une telle interprétation, toute la terre<br />
d'AOF été propriétaire du Domaine de l'Etat français.<br />
3. Idem, p.320<br />
4. "Condition Humaine" W6, Mai 1948.<br />
308
Un autre décret, intervenu le 25 novembre 1930 et publié en AOF par<br />
l'arrêté du gouverneur général du 19 décembre 19305, stipulait que l'expropriation, pour<br />
cause d'utilité publique, s'opérait en AOF, sous l'autorité de la justice. Le texte en<br />
question donnait à l'administration le pouvoir, pour des raisons d'''intérêt général", de<br />
prononcer l'expropriation sur les terres appartenant aux collectivités indigènes. Selon<br />
que la superficie en question, était inférieure ou supérieure à 100 ha, intervenait soit le<br />
gouverneur du territoire, soit le gouverneur général pour le montant de l'indemnisation<br />
qui était prévue par le texte. Le 15 octobre 1935, une nouvelle modification intervint.<br />
Elle abandonnait, pour l'essentiel, les termes de "terres vacantes et sans maître" pour<br />
faire place à : «Appartiennent à l'Etat, les te"es qui, nefaisant pas l'objet d'un titre régulier<br />
de propriété ou de jouissance [...] sont inexploitées ou inoccupées depuis plus de 10 ans »6.<br />
Une vingtaine d'années plus tard, la législation subissait une nouvelle modification. En<br />
effet, le décret du 20 mai 1955 modifiait l'article 1 er du décret de 1935 qui obligeait les<br />
occupants, qui s'opposaient à une concession par l'Etat, à faire la preuve de l'existence<br />
de droits coutumiers sur la terre. Désormais, la législation stipulait qu'une concession<br />
était accordée « après une enquête publique et contradictoire, si cette enquête n'a pas fait<br />
apparaître l'existence de droits coutumiers sur la te"e ».<br />
En résumé, de 1904 à 1955, toutes les modifications intervenues dans la<br />
législation domaniale n'avaient eu pour unique but que celui d'affirmer la toute<br />
puissance du colonisateur, sur la terre, en AOF et à Dakar particulièrement. Du reste,<br />
c'était bien cela qui justifiait l'impossibilité dans laquelle se trouvait toute la Collectivité<br />
léboue, mais aussi, les individualités lébous, d'apporter des preuves tangibles au tribunal<br />
dakarois. Si ce tribunal déboutait toutes les oppositions de la période 1950-1956, par un<br />
seul arrêt, ceci était dû au fait que les preuves attendues par la justice n'avaient pas pu<br />
être apportées par les plaignants. Par manque de connaissance de la législation ou par<br />
impossibilité de faire la preuve que le législateur colonial avait pour vocation de donner<br />
satisfaction à l'occupant colonial; la dernière hypothèse paraissait plus plausible.<br />
Ces oppositions indigènes aux réquisitions de la terre étaient, en réalité, sans<br />
fondement, au regard du droit tout puissant de la puissance occupante. C'était du reste<br />
ce que constatait Bernard Moleur lorsqu'il écrivait, à propos des oppositions formulées<br />
au sujet des terres à Dakar, qu'elles apparaissaient comme « intempestives pour les<br />
autorités coloniales ».<br />
En somme, toute la législation coloniale n'avait pour but que d'asseoir la<br />
primauté absolue de l'Etat français sur la terre en AOF. Cette primauté absolue<br />
justifiait que l'Etat français pouvait aliéner sa propriété exactement comme bon lui<br />
semblait.<br />
S. Robert Delmas in "Condition Humaine" nOS, Avril 1948.<br />
6. E. Le Bris, Enjeux fonciers...1983, p.7S<br />
309
était la suivante:<br />
La situation domaniale, dans la presqu'île du Cap Vert, au 31 décembre 1951<br />
- 12.650 hectares immatriculées dans le Domaine de l'Etat<br />
- 3481 ha, propriété des indigènes et répartis en 1705 titres fonciers.<br />
De ses 12.650 hectares, l'Etat avait rétrocédé 957 hectares à des Européens<br />
et seulement 17,4 hectares aux indigènes7.<br />
La situation du quartier de la Médina était particulièrement significative. La<br />
terre avait été arrachée aux Lébous. Le terrain immatriculé était devenu propriété de<br />
l'Etat. Pendant 30 ans, les populations indigènes avaient considéré que leur occupation<br />
de la Médina, constituait un droit de propriété irrévocable. Mais, en juillet 1959, un<br />
décret fit passer toute la Médina sous l'administration et la gestion d'un Office des<br />
Habitations à Loyer Modéré (O.H.L.M) nouvellement créé. Le décret en question<br />
stipulait que le nouvel organisme prendrait possession des parcelles, selon les besoins de<br />
son programme. Le sort réservé aux occupants était:<br />
- être relogés dans des cités provisoires en attendant la fin des travaux pour<br />
ceux qui se porteraient candidats à l'acquisition de nouvelles cités<br />
- être dédommagées de leurs dépenses sur la base des tarifs fixés par une<br />
commission qui restait à mettre en place 8 .<br />
Abdel Khader Fall estimait dans un article de "Momsarev" que cette<br />
conception de l'intérêt des masses africaines était vraiment singulière. Il traduisait<br />
l'émoi des habitants du quartier à propos de ce décret. "L'adresse aux populations"<br />
demandait aux victimes de s'opposer vigoureusement à cette législation.<br />
Si la spéculation foncière s'était beaucoup développée à Dakar, comme<br />
divers organes de presse ou même les groupes de pression économiques comme<br />
l'Assemblée des Propriétaires et l'Association des Locataires avaient eu à la regretter,<br />
c'était, avant tout le résultat de cette législation coloniale sur la terre. Du reste,<br />
l'administration, elle-même, avait bien conscience de cette situation puisque le<br />
gouverneur général de l'AOF écrivait, à l'adresse du ministre, à Paris, à la date du 12<br />
mai 1952 ceci: «... Les propriétaires moyens et surtout de nombreux Africains, vendent leurs<br />
te"ains nus à d'importantes sociétés ou à des riches commerçants... base de graves<br />
inconvénients signalés dans la spéculation »9. En fait, cette question de la propriété du sol<br />
ne manquait pas d'avoir de l'importance aux yeux de l'administration qui lui avait<br />
consacré toute une série de textes. Les populations locales prirent conscience, avec<br />
amertume, ressentirent amèrement qu'elles étaient purement et simplement spoliées de<br />
leurs terres par la force, dans la mesure où pratiquement toutes leurs initiatives pour en<br />
7. Bernard Moleur, op.ciL, p.333.<br />
8. "Momsarev" N°15, article Abus ou spoliation<br />
9. Affaires politiques AOF, ANSOM, carton 2163 dos 2.<br />
310
ester les maîtres furent vouées à l'échec, comme le prouvait la décision de la justice<br />
dakaroise considérant toutes les oppositions aux réquisitions comme non fondées.<br />
Puissance de l'administration face à l'impuissance des populations, ce que<br />
Senghor considérait comme un «problème complexe en raison de la multiplicité et de<br />
l'importance des intérêts qui sont en jeu: intérêt de l'Etat, de l'AOF, du Sénégal, de la<br />
Municipalité de Dakar, de la Collectivité [éboue, il 1'est aussi par les conséquences politiques<br />
»10 n'était en fait qu'un problème très simple: avait toute la terre celui qui avait la<br />
force. On était en système colonial.<br />
Or, cette question de la propriété du sol conditionnait, incontestablement, le<br />
problème des terres de culture, mais surtout celui de l'habitat.<br />
10. "Condition Humaine" nOS,Mai 1948.<br />
311
Il L'HABITAT<br />
CHAPITRE II : L'HABITAT DAKAROIS<br />
Le recensement démographique de 1955 à Dakar, avait eu plusieurs volets<br />
secondaires. L'un s'intéressait à la qualité de l'habitat. Le résultat était le suivant:<br />
- 44.000 constructions de type africain<br />
- 12.740 habitations de type européen1.<br />
Cette répartition globale donnait, dans le détail, une situation plus précise<br />
quant à la qualité de l'habitat dans la capitale fédérale. En effet, les constructions de<br />
type africain étaient à 54 % constituées de baraques c'est à dire d'habitation en bois, à<br />
33 % de paillotes et seulement à 13 % de constructions en dur. Cet habitat indigène se<br />
constituait de 16.700 "carrés,,2, chaque carré regroupant généralement plusieurs foyers.<br />
L'analyse des données du recensement permettait à Assane Seck d'écrire que, dans la<br />
capitale fédérale, l'habitat de type traditionnel permettait à 165.000 personnes de se<br />
loger, contre 95.000 dans l'habitat de type moderne. La population européenne de la<br />
ville habitait ce dernier type, soit environ 25.000 habitants. Ceci permet de déduire qu'à<br />
peine 70.000 Mricains étaient logés dans des constructions de type moderne à Dakar.<br />
C'est dire qu'à peine le tiers des Mricains occupaient des logements de type moderne.<br />
Depuis la fin de la guerre, la question du logement avait été une des<br />
préoccupations centrales de divers secteurs de la ville, tant pour les autorités que pour la<br />
population elle-même. Le quotidien "Paris-Dakar"3, traduisait, en août 1946, cette<br />
préoccupation dans une série d'articles sous le titre: "Dakar... sous les ponts". Il écrivait:<br />
« Le problème du logement est actuellement l'un des plus délicats mais aussi l'un des plus<br />
urgents à Dakar. La population européenne de la ville est estimée à 30.000 personnes.<br />
Dakar en 1939 offrait la possibilité pour 6.000 à ZOOO Européens de se loger. Pendant la<br />
guerre, arrêt de la construction civile et réquisitions, en nombre impressionnant,<br />
d'appartements civils ». Le journal dakarois analysait la situation sous l'aspect unique de<br />
la population européenne. Mais ceci traduisait bien, un état de crise du logement pour<br />
ces métropolitains, dans la ville, et avant tout, pour les fonctionnaires. Quant aux<br />
fonctionnaires indigènes, c'était seulement en 1948 qu'il fut question, pour la première<br />
fois, de prévisions en leur faveur, dans le budget fédéral de l'AüF.<br />
L'habitat indigène n'échappa pas aux préoccupations, dans la période<br />
suivante, des plus hautes autorités coloniales de Dakar. Ainsi, le Haut Commissaire,<br />
gouverneur général traduisait cette préoccupation dans un discours prononcé le 13<br />
1. Assane Seck, Dakar, métropole ouest africaine, op. cit., p.%.<br />
2. Terme désignanlla concession faite à un chef de famille indigène et mesurant 20 m • 15 m.<br />
3. Numéros des 14, 17 et 30 Août 1946.<br />
312 .
l'éducation, la santé mais aussi l'habitat etc... Dans le domaine de l'habitat, les ambitions<br />
du programme étaient « de 46.000 pièces en immeubles collectifs et 18.000 habitations<br />
individuelles correspondant aux besoins les plus urgents. » 7 L'exécution de ce vaste<br />
programme rentrait dans la ligne de la politique d'investissement du FIDES.<br />
Divers organes de la presse métropolitaine comme locale tendaient à<br />
démontrer que cette masse de crédits constituait une oeuvre grandiose entreprise nulle<br />
part d'ailleurs par une puissance coloniale. Diverses personnalités officielles comme non<br />
officielles exprimaient cette opinion. Ainsi, Gerard Jacquet, ministre de la FOM,<br />
s'exprimant sur cette politique d'investissement, montrait que la France, à elle seule,<br />
avait fait pour l'ensemble de ses possessions d'outre-mer, mieux que la Banque<br />
Mondiale. Le ministre s'exprimait, à Dakar, lors d'une réception offerte par la Chambre<br />
de Commerce, le 3 mars 1958. «... En 10 ans, la France, de 1946 à 1956, le FIDES a<br />
dépensé, pour l'ensemble des rOM, un total de 625 milliards de francs métropolitains, soit 2<br />
fois plus que la Banque Mondiale qui, en 9 ans, a prêté 260 milliards aux pays sous<br />
développés du monde entier ». Selon Gérard Jacquet, dans les deux premiers plans<br />
quinquennaux « Les seuls territoires de l'AOF, ont bénéficié, au titre des diverses<br />
interventions, d'un montant de 280 milliards métro »8.<br />
Une source quasi officielle, la brochure "AOF" publiée par les services du<br />
Haut commissariat de Dakar, chiffre les investissements réalisés dans la Fédération, par<br />
le FIDES, à 86 milliards de F CFA, dont 22,3 milliards en direction du Sénégal. De cette<br />
somme investie dans ce territoire, 7,5 milliards l'étaient uniquement pour la ville de<br />
Dakar. Soit en pourcentage 6,43 % du total pour l'AüF et 33,66 % des sommes investies<br />
au Sénégal. "Marchés coloniaux", journal des milieux d'affaires métropolitains, dans un<br />
article signé par Robert Delmas, président de la commission permanente du Grand<br />
Conseil, chiffrait « de 1948 à 1957, 133 milliards 891 millions étaient prévus pour la<br />
Fédération. La répartition était la suivante:<br />
* 80 % aux dépenses économiques soit 100 milliards 175 millions<br />
* 18,35 aux dépenses sociales (santé, enseignement, urbanisme, habitat,<br />
cartographie etc)<br />
* 1,15 à la recherche scientifique. »9<br />
D'après la notice sur le Cap Vert, réalisé par l'Etat-Major, l'ardoise des<br />
investissements du FIDES à Dakar de 1947 à 1957, était de 7,879 milliards de F.CFA.<br />
Pierre Biarnès écrit «De 1947 à 1957, environ 400 milliards de francs français<br />
(valeur 1956) de fonds publics d'origine métropolitaine, allaient être investis en A OF, AEF,<br />
Cameroun et Togo ainsi qu'une cinquantaine de milliards de fonds privés. »10 Sur la<br />
7. Marchès Coloniaux n"363 du 25 octobre 1952.<br />
8. Bulletin C.CA.I du 31 mars 1958.<br />
9. Marchés Coloniaux nO 191 du 9 juillel1949<br />
10. Pierre Biarnès, Les Francais en Afrique noire, op. cit., p.297.<br />
314
question précise de l'habitat, le mensuel "Chronique d'Outre-Mer" paraissant à Paris,<br />
donne l'information suivante: « La SICAP, créée en 1951 et pour résoudre le problème du<br />
logement à Dakar, a édifié de 1951 à 1957, 2540 logements et quelques 6.000 pièces pour un<br />
investissement de 1 milliard 500 millions, règlant le problème du logement pour 20.000<br />
personnes...»1 J. Ganiaga et H. Deschamps parlant des investissements en matière de<br />
logement, écrivent: «... Surtout Dakar, capitale fédérale, bénéficie largement des crédits du<br />
FIDES et d'investissements privés. La ville gagne en hauteur et extension : gratte-ciel et<br />
monuments publics modernes bouleversèrent le centre, tandis que, pour la Médina, de<br />
nouveaux quartiers...»12<br />
Dans le cadre des festivités marquant le centenaire de la ville de Dakar, les<br />
autorités coloniales réalisèrent un film documentaire passant en revue les grandes<br />
réalisations, surtout au plan de l'urbanisme. Ce film fut largement projeté dans les salles<br />
de cinéma de la ville. L'hebdomadaire "Afrique Nouvelle" qualifiait le film d'oeuvre de<br />
pure propagande en ironisant : « Une ville hérissée de buildings, où des avenues ombragées<br />
et impeccablement bitumées reliant les piscines olympiques aux marchés aux fleurs, les<br />
plages ensoleillées aux jardins verdoyants. »13 L'organe catholique mettait en garde les<br />
invités et autres visiteurs venus pour la circonstance en ces termes «... Contre ces<br />
tournées bien préparées et des itinéraires savamment combinés ». Le journal, en parlant du<br />
sentiment des populations indigènes de la ville, à l'égard de ce film disait: « Qu'ils<br />
seraient fort surpris, d'apprendre que le temps où ils logeaient dans des taudis est fini et que<br />
tous, maintenant, ont des maisons modernes à leur disposition ». Pour la rédaction de<br />
l'hebdomadaire, il fallait comprendre que ce film ne reflétait nullement la réalité mais<br />
avait seulement pour objectif de soutenir une image de marque.<br />
Le journal "Les Echos d'Afrique Noire" publie une série de photos allant<br />
dans le même sens que le film. Le titre donné à l'article en question était bien<br />
significatif: "Et vous dites que la France n'a rien fait. Alors, les images parlent"14. L'organe<br />
du petit colonat, manifestement, s'adressait aux milieux nationalistes qui, à Dakar,<br />
dénonçaient la colonisation et réclamaient l'indépendance.<br />
A l'opposé des apologistes de cette politique d'investissements, des voix<br />
s'étaient faites entendre. Ainsi, "Présence Africaine" écrivait : « Le FIDES est une<br />
véritable institution d'exploitation au service des métropolitains installés outre-mer »15. Le<br />
journal, chiffres à l'appui, démontrait que les investissements réalisés en AOF étaient<br />
faits en fonction de la présence européenne. Il montrait que les sommes consacrées au<br />
Sénégal, à la Guinée, à la Côte d'Ivoire, représentaient les 3/4 des investissements. Or,<br />
cette zone côtière était, avant tout, la zone d'installation des métropolitains.<br />
11. "Chronique d'outre-mer" N° 51, décembre 1958.<br />
12. Histoire de l'Afrique au XXeme siècle. 1966, p.348.<br />
13. "Afrique nouvelle" du 1 er janvier 1958.<br />
14. "Echos d'Afrique noire" du 20 janvier 1958.<br />
15. PA., Fév-Mars 1957.<br />
315
Jacques Arnault, parlant du FIDES et de son action constatait: « 171<br />
milliards d'investissements faits sur fonds publics métropolitains aux frais de la masse des<br />
contribuables français, 150 milliards de transferts privés nets des TOM vers la métropole ont<br />
été entassés dans les caisses des monopoles... il en est pourqui les liens coloniaux sont des<br />
anneaux d'or»6. '<br />
Un organe de la presse dakaroise "Momsarev" estimait que, si les milieux<br />
d'affaires, regroupés dans la Chambre de Commerce, félicitaient le gouvernement du<br />
territoire du Sénégal, c'était bien parce que la politique des investissements continuait à<br />
leur être favorable.<br />
La politique d'investissements apportait-elle des changements positifs<br />
importants pour les populations des TOM et d'AOF plus particulièrement? "Marchés<br />
Coloniaux,,17 répondait affirmativement par ces termes: « Plus de 50.000 Africains,<br />
depuis 1946, ontpu être déplacés de la Médina surpeuplée vers de nouvelles zones assainies,<br />
convenablement urbanisées où ils ont pu trouver des conditions de vie décentes... grâce à la<br />
politique des grands travaux. »<br />
La réponse était du même genre dans la revue "AOF", tout comme dans la<br />
revue "Industries et Travaux d'Outre-Mer". Ce dernier journal exprimait la satisfaction<br />
éprouvée par le Haut Commissaire de Dakar, à la suite d'une visite des réalisations de la<br />
SICAP, à la fin de 1958. Pour d'autres milieux, la réponse était négative.<br />
Maurice Voisin, dans les "Echos d'Afrique Noire" indiquait que les Africains<br />
avaient été les laissés pour compte dans cette politique de l'habitat. L'organe prenait<br />
comme exemple spécifique le cas du Crédit Foncier, organisme de la Banque de<br />
l'Afrique Occidentale. Pour le journal, ces grands milieux financiers à travers leurs<br />
réalisations, ne faisaient qu'exploiter les Africains18. Le journal accusait même, les<br />
services administratifs de négligence voire de corruption pour avoir permis au Crédit<br />
Foncier de réaliser des habitations pas "respectueuses" des Noirs.<br />
Toujours dans le sens d'une réponse négative, le congrès constitutif des<br />
jeunes du B.P.S avait été très critique à l'égard de l'orientation de ces investissements.<br />
Le rapport introductif au congrès de ce mouvement de jeunesse remarquait, qu'une<br />
belle autoroute traversait la Médina mais que ses populations continuaient à connaître<br />
d'énormes difficultés pour pouvoir trouver de l'eau, ce minimum indispensable à la<br />
vie 19 .<br />
L'expérience des "Castors", tentée à Dakar, avait été considérée par les<br />
autorités administratives et par divers milieux comme d'un intérêt réel pour les<br />
Africains. Elle fut même, comme expérience, rapportée à la conférence tenue par le<br />
16. J. Arnault, Procès du colonialisme, 1958, p.257.<br />
17. N° du 22 août 1953.<br />
18. "Echos d'Afrique noire" du 3 août 1953.<br />
19. Congrès de Mars 1958, Résolution générale.<br />
316
lesquels furent déguerpis. Le témoignage suivant est apporté par le service d'hygiène de<br />
Dakar : « Le service du déguerpissement nous fut confié voici 15 ans... Aucun<br />
déguerpissement ne peut être fait sans décision de justice. Or, pas une démolition ou<br />
déguerpissement n'est nantie, à la base, d'une décision de justice. Toutes sont<br />
administratives. C'est souligner notre position illégale...»25 "L'Action", autre organe de la<br />
presse dakaroise fustigeait ces déguerpissements « Constructions de quartiers, percement<br />
de rues, d'un canal de déversement... On se contente d'invoquer à chaque instant, l'aspect<br />
social de la question... la nécessité de l'urbanisme, sans se soucier de son aspect humain »26<br />
Mais celle-ci revêtait un aspect tactique et stratégique de la part du pouvoir<br />
colonial. En effet, l'arrêté n046861APAI du 28 septembre 1949 du Délégué du<br />
gouverneur à Dakar, interdisait d'édifier, dans la ville, de nouvelles baraques et même<br />
de réparer les anciennes sans autorisation préalable du service d'hygiène.<br />
Incontestablement, cette décision créait un véritable malaise à Dakar où<br />
l'essentiel de l'habitat indigène était constituée par des baraques. Ce malaise explique la<br />
démarche du député Abbas Guèye auprès des autorités. Dans une lettre au Délégué du<br />
gouverneur, il constate « Que le refus systématique opposé par ce service, aux requêtes des<br />
propriétaires, les mesures draconiennes prises par ce même service pour l'application de ce<br />
même texte ont eu, pour résultat, l'aggravation du nombre des sans-logis dans la Médina et<br />
l'entassement de familles entières dans des taudis »27. Abbas Guèye estimait que cette<br />
décision de l'administration avait créé une situation grave. Il demandait l'abrogation<br />
dans l'immédiat du texte ou son remplacement par un autre plus humain.<br />
Sur la question du taux d'occupation par logement à Dakar, le Secrétariat<br />
Social faisait état des données suivantes, lors de ses deuxièmes journées, consacrées à<br />
"l'habitat africain à Dakar", en juillet 1958. François Faye rapportait les résultats d'une<br />
enquête prouvant l'existence d'un véritable entassement social:<br />
« 50 foyers occupent 1 pièce à 2 personnes<br />
38foyers occupent unepièce à 3 personnes<br />
26 foyers occupent unepièce à 4 personnes<br />
8 foyers occupent une pièce à 5 personnes<br />
1 foyer occupe unepièce à 7personnes<br />
2 foyers occupent une pièce à 8 personnes<br />
1foyer occupe une pièce à 9 personnes<br />
Et pour achever sa besogne, la misère poussera son insatiabilité jusqu'à entasser<br />
un foyer de 15 membres dans une pièce de 4,5 m * 3,5. »28<br />
25. A.N.S : Rapport 2G 57-33,1957.<br />
26"L'Action" du 31 octobre 1955.<br />
27. "Condition Humaine" du 20 octobre 1952.<br />
28. 20 personnes seulement sur les 425 interrogées avaient le privilège de se retrouver seules dans une pièce,<br />
c'est à dire 1 personne par pièce.<br />
318
1956: 40.000 m 3 par jour<br />
Pour cet organe de presse, durant toute cette période, les besoins de la ville<br />
restent nettement insatisfaits. En effet, alors que la ville produit 40.000 m 3 /jour, ses<br />
besoins sont évalués à 80.000 m 3 . C'est dire que seulement la moitié des besoins étaient<br />
couverts. Le journal présente la situation, en 1958 dans d'autres villes du Sénégal. Ainsi<br />
Thiès ne fournit que 1.100 m 3 /jour alors que ses besoins sont estimés à 4.000 m 3 et<br />
Saint-louis, pour des besoins de 6.000 m 3 , ne produit que 4.800 m 3 .<br />
La synthèse de la situation économique de l'AüF de 1948 à 1958, par la<br />
Chambre de Commerce, indique que « 20.000 personnes seulement, soit 1/8 de l'ensemble<br />
des occupants des lieux, jouit d'une alimentation directe d'eau dans les habitations du<br />
milieu africain à Dakar ». Cependant, elle souligne que grâce aux bornes-fontaines, l'eau<br />
peut être fournie aux habitations non raccordées au réseau de distribution.<br />
Selon la synthèse, 90 % des personnes occupant les habitations de type<br />
européen, jouissent de l'eau et de l'électricité 33 .<br />
Mahjmout Diop souligne que dans la ville de Dakar, 75% des Africains<br />
utilisent les bornes-fontaines et que chaque borne dessert en moyenne, un millier de<br />
personnes 34 . L'intéressé note comme explication, la pauvreté des habitants ne pouvant<br />
aucunement faire face aux frais d'installation de l'eau, mais aussi de location. Les<br />
incidences négatives d'une telle situation sur la vie quotidienne des Dakaroises<br />
n'échappent pas à cet auteur.<br />
G. Brasseur indique qu'en 1952, on compte 3200 abonnés à l'eau dans la ville<br />
de Dakar. Dans les quartiers indigènes de la ville, sans donner de chiffres, il estime à<br />
plusieurs centaines de maisons, celles dotées de branchements individuels. Il dénombre<br />
200 bornes-fontaines dans la ville, en 1952 utilisées seulement par la population<br />
africaine. Jamais de mémoire de Dakarois, on n'avait vu une Européenne faisant la<br />
queue à une borne-fontaine. Beaucoup de nos interlocuteurs ont souligné cet aspect. Les<br />
besoins en eau des Européens de Dakar étaient largement couverts. Ces besoins étaient,<br />
de loin, supérieurs aux moyennes de consommation. A. Jourdain, ingénieur général des<br />
travaux publics de la füM, écrit qu'ils sont de 250 à 400 litres par personne et par<br />
jow-3 5 .<br />
Le problème des bornes-fontaines fut, dans le cadre de la politique de l'eau<br />
pour la capitale, une question très importante ayant intéressé plusieurs organes de<br />
presse mais aussi le conseil municipal, des chefs de quartiers indigènes, des<br />
personnalités politiques, des associations etc... Le conseil municipal a consacré plusieurs<br />
séances à la question de l'eau tant dans son aspect social que dans ses conséquences<br />
33.P.298<br />
34. Mahjmout Diop, Histoire des classes sociales au Sénégal, 1972, p. 191.<br />
35. A. Jourdain, L'alimentation en eau de Dakar.<br />
320
Cette situation est perçue presque de manière identique par d'autres organes<br />
de presse comme "Réveil", "Condition Humaine", "l'AOF', "Echos d'Afrique Noire" etc...<br />
Même l'administration partage cette constatation en écrivant, dans le rapport du service<br />
d'hygiène, de l'année 1957 : « l...] L'eau est en général bonne mais douteuse et souvent<br />
souillée dans nombre de citernes privées...» 3 9 Le rapport des comptes économiques de<br />
l'AOF, Territoire du Sénégal, en parlant de l'eau, donne les informations suivantes: «<br />
20 F CFA le m 3 en moyenne, mais la distribution dans les villes n'était pas régulière. Les<br />
parleurs vendent l'eau à 5 F CFA la tonique de 20 litres, le prix du m 3 atteint 1.000 F CFA<br />
» 4 O. Cette même source indique pour l'année 1959, que le m 3 d'eau était vendu à 37,5 F<br />
CFA par la Compagnie des Eaux, prix trop élevé pour beaucoup d'habitants de la ville.<br />
2) L'électricité<br />
La Chambre de Commerce de Dakar, à propos de l'alimentation en<br />
électricité de la ville indique que « 50.000 personnes, soit un peu moins du tiers de ceux<br />
qui occupent les carrés recensés en disposent.»41 L'institution consulaire explique que ce<br />
chiffre était plus élevé que celui des abonnés en eau, en raison du fait que<br />
l'infrastructure électrique est plus étendue et développée. Pour elle, l'électricité ne peut<br />
pas parvenir dans les habitations ne disposant pas de l'équipement adéquat,<br />
contrairement à l'eau, par le système des bornes-fontaines.<br />
Mahjmout Diop insiste, lui, sur cette insuffisance de l'équipement de<br />
l'électricité, tout comme de l'eau et met le doigt sur le problème des frais d'installation<br />
et de location prohibitifs.<br />
L'Etat-Major détaille, pour la ville, la fourniture d'électricité à partir de<br />
l'usine de Bel-Air dans la zone portuaire 42 , en 1958 :<br />
- puissance installée: 37.670 KW<br />
- puissance normale disponible: 16.100 KW<br />
- énergie vendue:<br />
* éclairage: 10.913.000 KWIH<br />
* applications ménages: 8.263.000<br />
* force motrice H.T : 5.501.000<br />
* fourniture H.T : 44.767.000<br />
Total: 69.444.000<br />
39. Affaires politiques AOF, ANS, rapport 2G 57-33<br />
40. C.E.S 1956, rapport B 4849/2, pA8<br />
41. C.CAJ de Dakar: Synthèse situation 1948-1958.<br />
42. Fiche 21, les industries.<br />
323
Les Comptes Economiques du Sénégal indiquent pour l'année 1956, « une<br />
production de 91.567 KW et une vente de 74.288 KW dont 13.173 pour l'éclairage »43.<br />
D'après cette source, il y a 32.000 abonnés pour le territoire du Sénégal dont 26.000 à<br />
Dakar. A cette date, toute l'AOF comptait 60.000 abonnés.<br />
Les critiques de la presse à l'égard de la distribution de l'eau s'appliquent<br />
également à l'électricité. L'eau comme l'électricité sont vendues aux populations à des<br />
prix prohibitifs. les coupures fréquentes agitent aussi l'opinion puisque les journaux dont<br />
"Afrique noire", parlent même d'une politique de "je m'en foutisme" de la part des<br />
E.E.A.O. La revue "Partisans" écrit: « Un exemple suffit à montrer comment les<br />
capitalistes exploitent honteusement le Sénégal : la Compagnie des E.E. DA » 44 . Le<br />
rédacteur de l'article, Samba Seytane, met en relief le monopole de la Compagnie sur<br />
ces deux ressources capitales, mais surtout les bénéfices énormes qu'elle réalise. Ceux-ci<br />
sont passés de 100 à 818 (base 100 en 1951) en pourcentage et de 62 à 507 millions de F.<br />
CFA en valeur absolue, en une période de dix ans seulement: 1951-1960. "L'Etudiant<br />
d'Afrique Noire", organe de la FEANF, se scandalisait des énormes profits réalisés sur<br />
le dos des populations ouest-africaines. Il reprenait l'analyse d'un organe de la presse<br />
parisienne, "Fortune française" du 4 mars 1960. Ce journal montrait la progression<br />
suivante des profits réalisés par les E.E.O.A, sur la période 1950-1958. « Base 100 en<br />
1951, les bénéfices nets arrivaient en pourcentage à 580 en 1958. En valeur relative: de 62<br />
millions en 1951 et 360 millions en 1958 ».<br />
L'opinion reste réellement sensible aux questions de la tarification, de la<br />
régularité et de la qualité de la fourniture de l'eau et de l'électricité. De plus, elle est<br />
retenue également par l'utilisation de l'eau comme élément de chantage, entre les mains<br />
des autorités et aussi des capitalistes.<br />
Sembéne Ousmane, au sujet de la grève des cheminots de 1947-1948, retient<br />
cet aspect de l'utilisation de l'eau. En effet, à propos du rassemblement de protestation<br />
des femmes de la Médina devant le commissariat de police, il écrit : « Il y eut des<br />
bousculades tandis que les pompiers sautaient à terre et déroulaient les tuyaux. Les lances<br />
furent braquées. - Restez assises! hurla Mame Sophie. Il ny a pas d'eau pour les incendies<br />
mais, pour nous arroser, ily en a » 45 . Il fait allusion à l'incendie qui, la veille, a ravagé la<br />
Médina lors de la bagarre ayant opposé les femmes du quartier aux forces de l'ordre.<br />
Les pompiers ne se montrèrent pas.<br />
Autre exemple de cette utilisation comme moyen de chantage; Sembéne,<br />
dans la bouche de son héroïne Marne Sophie, s'adressant à la collégienne Ndéye Touti,<br />
place ses mots: «Fermer les boutiques et l'eau! ce n'est pas la vie?»<br />
43. Rapport B : 4849/2, pA8<br />
44. "Partisans" n"29/30, Mai-juin 1958.<br />
45. Sembéne Ousmane, Les bouts de bois de Dieu, 1960.<br />
324
Le romancier sénégalais traduit par là, la longue et pénible angoisse des<br />
ménagères de la Médina devant l'absence d'eau dans les bornes-fontaines, pendant<br />
plusieurs jours, situation créée sciemment par l'administration coloniale pour<br />
contraindre, indirectement, les épouses à faire pression sur les maris grévistes afin qu'ils<br />
reprennent le chemin des ateliers et bureaux du R.A.N.<br />
Autre exemple d'utilisation de l'eau comme moyen de pression, cette lettre<br />
adressée à la Chambre de Commerce de Dakar par la Compagnie des Eaux et<br />
Electricité, à la date du 12 août 1953. Elle informait la Chambre de Commerce, de sa<br />
décision de couper entièrement toute forme d'eau à la ville de Rufisque, à partir du 1 er<br />
octobre, si, à cette date, elle n'obtient pas de la dette que cette municipalité lui<br />
devait 46 .<br />
La société avait - elle mis effectivement à exécution sa menace? nos sources<br />
écrites ne nous ont pas permis de répondre à la question, aucune d'elles n'ayant parlé<br />
de cette application. Quant à nos interlocuteurs, ils ne se rappellent pas que la coupure<br />
ait eu lieu à la suite de cette menace. Très probablement, la Municipalité et la<br />
Compagnie ont trouvé un terrain d'entente. La Chambre de Commerce pouvait, en la<br />
circonstance, sur la base de l'information qui lui était fournie par les E.E.G.A, exercer<br />
une pression plus ou moins discrète sur l'équipe municipale pour préserver ses propres<br />
intérêts en jeu.<br />
Pour la même raison, la municipalité de Dakar, elle aussi a été l'objet de<br />
pressions très fortes de la part des E.E.G.A. Diverses délibérations le prouvent. Prenant<br />
la parole dans une séance en date du 22 juillet 1957, le conseiller d'origine européenne<br />
Sinibaldi s'exprime en ces termes: « La ville de Dakar doit 90.000.000 à la Compagnie<br />
des Eaux. Le m 3 vaut actuellement 27 F 50. Pénaliser encore les habitants de la ville de<br />
Dakar de 2 F 50 par m 3 d'eau pour payer la dette de la Commune, comme le suggère<br />
l'autorité de tutelle, c'est trop ». Le conseiller municipal Thierno Bâ, face à cette dette,<br />
propose même un refus de payer. Il évoque les tarifs exorbitants imposés par la<br />
Compagnie pour justifier sa position.<br />
Ces pressions de la Compagnie aboutissent à la situation suivante, comme<br />
l'écrit le journal "Condition Humaine" : «La mairie s'est endettée auprès de la compagnie<br />
des Eaux au point que celle-ci se trouve dans l'obligation de supprimer les bomesfontaines»<br />
47.<br />
L'endettement de la municipalité de Dakar vis-à-vis de la Compagnie des<br />
Eaux et de l'Electricité fut donc permanente de 1945 à 1960. Les délibérations du<br />
Conseil municipal, comme beaucoup de sources, le prouvent. Etait-il possible cependant<br />
que la Compagnie exerçât une pression sur la Municipalité dans le même sens qu'à<br />
Rufisque, jusqu'à couper toute alimentation? La chose, était, en elle même, peu<br />
46. C.CA.! de Dakar, Délibération du 27 août 1953.<br />
47. "Condition Humaine", Avril 1953.<br />
32-5
probable. Certes, Dakar était beaucoup plus endettée que Rufisque, mais elle<br />
représentait un enjeu qui, de par sa taille, n'avait rien de comparable à la situation de<br />
Rufisque. Le pouvoir s'exerçait entièrement à partir de la ville. La direction générale<br />
des E.E.O.A devait, par la force des choses, tenir compte de cet élément non<br />
négligeable. Outre le pouvoir administratif, il y avait également, dans la ville, une<br />
certaine opinion relativement solide, donc à prendre en compte. De plus les intérêts<br />
économiques industriels particulièrement, mais aussi maritimes avec l'avitaillement des<br />
bateaux, représentaient un poids suffisamment lourd pour dissuader toute action dans le<br />
sens d'une coupure effective de l'eau à toute la ville. Incontestablement, la municipalité,<br />
tout comme la Compagnie, se devait d'y regarder à plus d'une fois avant de prendre une<br />
responsabilité d'une telle dimension. Dakar était, à tous points de vue, d'un poids trop<br />
important pour qu'on y coupe l'eau, pour simple endettement de sa municipalité.<br />
326-
CHAPITRE III : LA QUESTION ALIMENTAIRE A DAKAR<br />
Il L'ALIMENTATION EN MILIEU INDIGENE<br />
Dans leur quasi unanimité, les sources s'accordent à reconnaître que la<br />
situation alimentaire, dans la ville, n'était pas bonne de manière générale. En effet,<br />
lorsqu'en 1945, le conflit mondial se termine, la ville avait connu presque six années de<br />
pénurie relative.<br />
Le gouvernement général pro-vichyste avait entretenu un climat officiel<br />
d'incitation à l'effort en faveur de la métropole. Ainsi, sommes d'argent comme produits<br />
alimentaires prirent régulièrement la mer. Une sorte de concurrence dans l'effort fut<br />
même stimulée par les autorités. "Paris-Dakar" rendait régulièrement compte des envois<br />
en direction de la "mère-patrie". Dans un discours radiodiffusé, le gouverneur général de<br />
l'AOF rappelait à la Fédération les objectifs définis depuis 1940 : « Je veux qu'on sache<br />
que l'Afrique Noire, dans tous les domaines, n'a qu'un souci : celui de venir en aide à la<br />
métropole »1. Cet effort en direction de la "mère-patrie" avait déjà atteint, dès janvier<br />
1941, son dixième million 2 sans compter les envois de toutes sortes et la mobilisation de<br />
tous les groupes de populations : Africains, Européens et Levantins. Le Chef de la<br />
Fédération pouvait même s'en orgueillir car, pour lui, la situation alimentaire locale<br />
était bonne
11948, les multiples grèves des travailleurs traduisent une sorte de ras le bol devant leur<br />
situation alimentaire. C'est du reste ce que constate le rapport annuel du Territoire, en<br />
1948, en ces termes: «La population autochtone est très mécontente. Elle s'étonne que les<br />
autorités ne prennent aucune mesure efficace pourstopper la hausse des prix et mettre fin au<br />
marché noir, lequel est plus florissant que jamais »4. Ce constat avait déjà été fait en 1946<br />
par cette même administration. Un autre rapport de l'administrateur de la capitale, en<br />
1953, met l'accent sur la baisse constante du niveau de vie des indigènes en raison du<br />
chômage qui ne cesse de croître. Tout ceci appelle l'attention des autorités sur les<br />
répercussions politiques probables de la situation. En 1957, l'administrateur de la<br />
Délégation arrive au même constat : « Deux mouvements importants de grève dont les<br />
fondements étaient essentiellement économiques, le coût de la vie ayant augmenté<br />
régulièrement et les salaires n'ayant pas été réajustés depuis longtemps »5.<br />
Des sources autres que l'administration, font le même constat sur la situation<br />
alimentaire. Dans son programme économique et financier, la SFIO-Sénégal, dans son<br />
rapport au g eme congrès de Kaolak en septembre 1947 remarque: « L'équilibre des<br />
prix et des salaires est en état perpétuel de rupture. Le parti socialiste estime nécessaire<br />
et équitable l'adaptation des bas salaires au coût de la vie pour permettre aux<br />
populations locales de mieux se nourrir »6.<br />
Le journal "Horizons Africains" dénonce la misère alimentaire dans la<br />
Médina, laquelle est largement perceptible chez les femmes et les enfants<br />
particulièrement, pour tout observateur qui viendrait à visiter ce quartier 7 .<br />
Le docteur Léon Palès, chef de la Mission Anthropologique de l'AOF de<br />
1945 à 1951, au terme de plusieurs enquêtes, arrive au constat suivant « Les Africains<br />
demeurent, pour l'immense majorité d'entre eux, à un stade alimentaire où l'apaisement de<br />
la faim et la satisfaction que procure la plénitude gastrique dominent toute autre<br />
considération ». Les travaux de Leon Palès ont fait dire à André Mayer, professeur<br />
honoraire au Collège de France et membre des Académies de Sciences Coloniales et de<br />
Médecine, dans la préface de l'ouvrage: «Le beau livre, probe, solide qu'on va lire<br />
contribuera à éclairer ceux que passionne cette oeuvre grandiose » 8 .<br />
Cette précarité nutritionnelle en Afrique Noire Française est mise en relief<br />
par la Délégation de l'AOF à la conférence interafricaine tenue à Dschang au<br />
Cameroun, en octobre 1949. Dans sa communication, elle constate: « Qu'un trouble<br />
survienne dans la vie du pays, mauvaise récolte, destruction partielle, incidence pathologique<br />
etc... et l'équilibre est rompu »9. Cette précarité explique même à Dakar,<br />
4. Affaires politiques, A.N.S, 2G 48-117, Délégation 1948.<br />
5. Affaires politiques AOF, A.N.S, Rapport 3994JAG du 20 mars 1958.<br />
6. "L'AOF du 21 août 1947.<br />
7. "Horizons africains" N"45, Juin 1951.<br />
8. Leon Palès, L'alimentation en AOF, 1955, p.9<br />
9. Abdoulaye Ly, Les masses africaines, 1956, p.200<br />
328
particulièrement, la prise d'un certain nombre d'initiatives pour y faire face, comme la<br />
création à Dakar d'une association groupant des syndicats d'employeurs et de salariés.<br />
L'objectif de cette association était la mise en place de "restaurants communautaires" en<br />
vue de fournir « Un repas sain et abondant, à un prix calculé, au plus juste et dans un<br />
cadre répondant aux règles d'hygiène. »10<br />
La Chambre de Commerce de Dakar, dès le départ, apporte son soutien à<br />
l'opération par une subvention de 100.000 F CFA Les autorités administratives, elles<br />
non plus, ne sont pas indifférentes à l'initiative de ces restaurants. Ainsi, lorsqu'en<br />
septembre 1952, le projet devint réalité, le gouverneur Geay, Chef du Territoire du<br />
Sénégal, vint le visiter. Au terme de cette visite, il exprime sa satisfaction et surtout ses<br />
encouragements, souhaitant que d'autres unités se multiplient dans la capitale ainsi qu'à<br />
l'intérieur du Sénégal. Même le gouverneur général manifeste son intérêt au projet en<br />
raison de la situation alimentaire des travailleurs, préoccupante à plus d'un titre. Bien<br />
sûr, des soucis de rentabilité des travailleurs - faibles physiquement comme le<br />
remarquaient les chefs d'entreprise - ne sont pas étrangers à la mise en place de ce<br />
projet.<br />
Cette expérience, n'eut pas une longue vie dans la mesure où les travailleurs<br />
des entreprises principales de la ville s'en détournèrent. A leurs yeux, les coûts des repas<br />
ne sont pas en rapport avec leurs salaires et leurs responsabilités sociales. Pour eux,<br />
manger au restaurant communautaire ne dispense en rien de donner "la quotidienne" à<br />
la maison. De ce point de vue, cette dépense pour acheter un repas au restaurant<br />
communautaire fait, en fait, double emploi et surtout, dépasse largement leurs moyens.<br />
Pour ces travailleurs, les salaires étaient déjà jugés insuffisants.<br />
Les 6 catégories de salaires, fixés le 1 er février 1948, donnent, pour ces<br />
Africains, manoeuvres dans leur grande majorité, donc aux 1 ere et 2 eme catégories ll<br />
enF.CFA:<br />
Catégorie Salaire horaire journalier mensuel<br />
1ere 10 80 2080<br />
2eme 12,2 97,20 2527,5<br />
Ces salaires comprenaient aussi la nourriture comme le spécifiaient la<br />
commission consultative du travail ainsi que la commission mixte ayant fixé ces salaires<br />
après consultation. La commission consultative avait aussi arrêté les tarifs des rations<br />
alimentaires au taux de 10 F par repas ou 20 F par jour selon que l'entreprise assurait<br />
10. Marchès coloniaux, N"332 du 22 mars 1952.<br />
11. Marchès coloniaux N"317, 7 février 1948.<br />
329
partiellement ou intégralement la nourriture fournie à ces travailleurs indigènes de la<br />
capitale. On remarque, dans ces conditions, qu'un travailleur de la première catégorie,<br />
pour avoir un repas, devait débourser l'équivalent d'une heure de travail: 10 F le repas<br />
= 10 F l'heure de travail. Avec deux repas journaliers, il devait dépenser 600 F<br />
mensuellement soit 1/3 de son salaire. Dans cette situation, il apparaît évident que le<br />
travailleur indigène ne pouvait pas manger à la cantine de son entreprise sinon il<br />
compromettait davantage la précarité de sa situation dans la mesure où plusieurs de ses<br />
dépenses étaient incompressibles: loyer, transport...<br />
Dans une étude sur la restauration en tant que secteur informel, Made B.<br />
Diouf 12 remarque qu'autour de toutes les grandes unités industrielles de Dakar, les<br />
travailleurs africains se restauraient auprès des gargotières africaines. Les prix pratiqués<br />
par celles-ci étant davantage à la portée des travailleurs et ceci d'autant plus que les<br />
possibilités de paiement étaient diverses: par semaine, par quinzaine ou par mois. Made<br />
B. Diouf montre que cette forme de restauration était aussi vieille que l'industrie<br />
dakaroise.<br />
Dans ces conditions, l'opération des restaurations communautaires ne<br />
pouvait se solder que par un échec parce qu'elle ne tenait pas compte du pouvoir<br />
d'achat réel du travailleur indigène. Le couple alimentation - salaire restait infernal<br />
pour les travailleurs indigènes de Dakar. Par exemple, pour les personnels domestiques<br />
et gens de maison, l'étude réalisée par Le Divelec Broussous 13 , montre que pendant la<br />
période 1945-1958, sur la base de l'indice 100 en 1945, la progression des salaires avit<br />
été de 466 pour les domestiques et 574 pour les gens de maison. Le coût de la vie avait,<br />
été quant à lui nettement le double dans la même période. Pour Régine N'guyen Van<br />
Chi Bonnardel 14 citant des résultats d'enquêtes menées à Dakar en 1961, l'alimentation<br />
représentait plus de la moitié -exactement 56 % - des budgets familiaux de la ville.<br />
Mais la faiblesse des salaires n'était pas le seul facteur de dégradation de la<br />
situation alimentaire dans la ville. En effet, la spéculation par le marché noir, jouait<br />
aussi un rôle très néfaste puisque les produits de première nécessité : riz, sucre, huile<br />
etc... furent l'objet de spéculation parfois très forte en certaines circonstances.<br />
Un rapport de l'administration, en 1955, souligne «Un autre aspect décevant<br />
de l'action engagée par le contrôle des prix, se révèle dans la vente du riz à Médina. ..<br />
Constamment, le contrôle aura à intervenir pour les raisons suivantes:<br />
al les prix réglementaires ne sont pas respectés par les petits commerçants<br />
(maures en général) que s'il y a présence effective des contrôleurs. Dès que ceux-ci quittent,<br />
ily a retour à la majoration.<br />
12. Dakar et son secteur informel: étude des restaurations de la zone industrielle, 1979.<br />
13. Les salaires en AOF, p.55.<br />
14. La vie de relations..., 1976, p.243.<br />
330
lLe petit commerçant est-il en mesure de respecter les prix fixés? la pratique<br />
généralisée de la vente à crédit est, à lui seulfacteur de hausse. ))15<br />
Ce rapport étalait, en fait, au grand jour la permanence de la spéculation. Un<br />
constat identique était établi par le service de la répression des fraudes et poids et<br />
mesures. En 1956, il avouait son incapacité totale à faire correctement sont travail à<br />
cause de l'insuffisance notoire de ses moyens humains et matériels. Le rapport insistait<br />
sur le fait que cette situation perdurait depuis de nombreuses années 16 .<br />
Des organes de la presse dakaroise n'étaient pas en reste sur cette<br />
dénonciation de la spéculation et du marché noir à Dakar pendant la période.<br />
"Momsarev,,17 écrit « Tout le monde se plaint. Le bon riz manque. Il fait l'objet d'une<br />
inadmissible spéculation de la part des grosses maisons importatrices et des Libano<br />
Syriens... Ainsi fleurit une spéculation lucrative qui pèse lourdement sur le coût de la vie et<br />
aggrave les conditions des petits salariés )). En somme, une situation alimentaire précaire<br />
pour les larges couches de la population indigène de la capitale fédérale.<br />
11/ L'ALIMENTATION DES EUROPEENS<br />
Dans l'ensemble, cette partie de la population ne connaissait pas le chômage.<br />
En 1953, par exemple, le Chef de la Sûreté Locale signale 200 Européens résidant dans<br />
la ville et se trouvant sans emploi. La chose était présentée comme "particulière" par le<br />
rapport annuel de la Délégation.<br />
Dans son étude sur le groupement européen de Dakar, Paul Mercier fait<br />
apparaître une situation de plein emploi dans cette partie de la population, même dans<br />
sa composante féminine : « Le nombre de salariées européennes représente, dans<br />
l'ensemble de la population non autochtone, en 1951, 16 % de la population active contre<br />
30 % en métropole et 14 % pour le reste de l'AOF))18. Non seulement ces Européennes<br />
travaillent, mais leurs salaires sont relativement importants pour permettre d'assurer le<br />
maintien d'un standing de "Blanc,,19. Le salaire du mari était thésaurisé pour le retour<br />
en métropole. Mercier remarquait que c'était dans les couches les moins favorisées que<br />
l'épouse travaillait pour apporter un deuxième salaire.<br />
Parlant de la vie alimentaire des Européens de Dakar, Pierre Biarnès<br />
constate: « On se recevait beaucoup, et l'on mettait alors les petits plats dans les grands,<br />
avec inévitablement du veau, du fromage et de la salade de France importée par avion...))20.<br />
15. Rapport 2G 55-119, Délégation de Dakar.<br />
16. Délégation, rapport 2G 56-86.<br />
17. N°lO.<br />
18. P. Mercier, Le groupement européen... op. ciL, p.139<br />
19. Expression de P. Mercier et P. Biarnès.<br />
20. P. Biarnès, Les Français en Afrique... op. cit., p.321<br />
331
Pierre Richard, lui aussi, ayant largement séjourné à Dakar, souligne la place<br />
très importante de ces dîners et cocktails dans l'élément européen de la population 21 .<br />
En effet, dans une ville où, selon Pierre Richard, le pourcentage d'Européennes au<br />
volant d'une voiture est le plus élevé, à coup sûr, l'alimentation n'était certainement pas<br />
une préoccupation pour la population européenne. Même dans les pires années<br />
immédiates de l'après-guerre, non seulement les travailleurs avaient des salaires<br />
substantiels, mais ils bénéficiaient même de fourniture en nature comme l'eau, la glace,<br />
l'électricité, tout ceci à des tarifs dérisoires dans les cas où il y avait retenue sur ces<br />
prestations.<br />
La population européenne de Dakar disposait d'une alimentation suffisante<br />
et de qualité. Son poids dans les importations était marquant. Les Comptes<br />
Economiques de l'AOF, pour l'année 1959, montrent que 15.000 familles européennes,<br />
installées au Sénégal, pesaient, à elles seules pour 12 milliards de F CFA sur 87,2<br />
milliards dans la consommation. Dans ce total, la moitié représentait les importations.<br />
La Situation Economique de l'année 1956 avait déjà fourni des indications<br />
presque identiques. Sur la base de cette consommation, une comparaison est possible :<br />
consommation européenne: 12 milliards de F CFA pour 15.000 familles européennes:<br />
- Moyenne de consommation par famille européenne<br />
Rapport = 12.000.000.000 = 800.000 F CFA<br />
15.000<br />
Consommation des 4 - Moyenne de consommation par famille africaine<br />
Consommation des 435.000 familles africaines: 75.200.000.000 F.CFA<br />
75.200.000.000 = 172.000 F CFA<br />
435.000<br />
Le rapport entre les deux moyennes de consommation permet de conclure<br />
qu'une famille européenne équivalait à 4,6 familles africaines. Une famille européenne<br />
large comprenait 4 personnes (père, mère et deux enfants). Une famille africaine était<br />
constituée au moins du double, c'est à dire 8 personnes en moyenne. En somme, pour<br />
une personne européenne =<br />
800.000 = 200.000 F.CFA<br />
4<br />
Pour une personne africaine =<br />
172.000 = 21.000 F.CFA<br />
8<br />
21. P. Richard, Revue Internationale de la FOM, Mai 1957.<br />
332
C'est dire que la consommation d'un Européen représentait en moyenne celle de dix<br />
Africains.<br />
Négativement, le poids de la consommation de l'élément européen se faisait<br />
ressentir comme le remarquait l'hebdomadaire "Marchés coloniaux,,22 : « La fédération<br />
de l'AOF reçoit plus de la moitié de ses importations de la métropole... Ce qui explique en<br />
partie, le coût de la vie qui n'a cessé d'augmenter car, en métropole, la hausse des prix est<br />
considérable ».<br />
Léon Palès note aussi les effets néfastes de ces importations alimentaires,<br />
surtout pour la capitale fédérale: « Dakar est dans une région naturelle où la culture<br />
industrielle de l'arachide a considérablement réduit les cultures vivrières... Le déficit en<br />
légumes et fruits n'arrive pas à être comblé malgré les importations d'Europe et des<br />
territoires voisins. »23 Dans ces importations en provenance de la métropole, le blé<br />
occupait une place de choix. Or pour Leon Palès « Le pain, malgré son prix élevé a un<br />
succès considérable et qui va croissant. La bonne nutrition et l'économie africaine ont peu à<br />
y gagner »24.<br />
III/ IMPORTATIONS ET ALCOOLS<br />
Dans le cadre des importations, un aspect particulier était celui des boissons<br />
alcoolisées. Cette question mérite un développement dans la mesure où diverses sources<br />
en dégagent le caractère néfaste pour les populations indigènes particulièrement. Le<br />
Chef de la Mission Anthropologique écrivait: «Les Africains consomment des boissons<br />
dont les alcools d'importation contre lesquels une campagne légitime s'est récemment<br />
engagée »25.<br />
En juin 1951, René Reive, dans un poème publié par "Horizons Africains",<br />
parlait des gens de la Médina qui ne rêvent que de digèns (femmes) et d'alcool.<br />
Un autre organe de la presse, "Echos d'Afrique Noire", posait, en juillet 1950<br />
à ceux qui prônaient la fin des importations d'alcool, la question de savoir ce que les<br />
caisses de "Pernod et fils", "Cinzano", "Whisky" etc deviendraient sans leur utilisation<br />
dans les habitations indigènes. Par là, le journal satirique dakarois ironisait qu'on ne<br />
pouvait pas se passer de l'importation de ces alcools dans la mesure où non seulement<br />
l'alimentation était satisfaite, mais également l'habitation.<br />
Le journal des étudiants africains en métropole s'alarmait de la progression<br />
importante de la consommation d'alcool. "L'Etudiant d'Mrique Noire" montrait<br />
22. N° du 13 mars 1948.<br />
23. Uon Palès, op. cit., p.142<br />
24. Ibidem, p.142<br />
25. Ibidem, p.307<br />
333
qu'entre 1938 et 1951, les exportations d'alcool de la métropole vers les territoires<br />
avaient été multipliés par 9 en AOF, 23 en AOF, 12 au Togo et 19 au Cameroun.<br />
En tonnages, pour l'AOF :<br />
Années Vins et Apéritifs Eau de vie et liqueurs<br />
1938 2238 tonnes 108 tonnes<br />
1951 13.969 tonnes 2214 tonnes<br />
Pour les étudiants africains, cette hausse vertigineuse n'était rien d'autre<br />
qu'une "politique délibérée d'alcoolisation" des populations 26 , entreprise par la<br />
domination coloniale. Pour prouver le bien fondé de cette information, le journal des<br />
étudiants se référait à une publication de la presse parisienne "Afrique Information"<br />
d'avril 1954 d'où il puisait les chiffres utilisés ci-dessus.<br />
Le journal "Afrique Noire", aussi, s'inquiétait de la progression des<br />
importations d'alcool. A plusieurs reprises, il avait publié des articles sur la question. En<br />
mai 1954, Guy Etcheverry titre : "Les ravages de l'alcool en Afrique Noire". Le<br />
rédacteur en chef se fait l'écho du cri d'alarme qu'il entend de partout. «Ainsi, les<br />
assemblées territoriales s'emparent de la question et expriment une vive inquiétude devant la<br />
prodigieuse ascension des importations d'alcool. C'est ainsi que l'Assemblée territoriale du<br />
Sénégal a adopté un voeu... tendant à engager le territoire dans une lutte énergique contre<br />
l'alcoolisme »27. Il constate la multiplication des cas de mort subite, de cécité partielle<br />
ou totale, de débilité physique propice à la tuberculose etc... tout cela à cause de la<br />
consommation sans cesse croissante d'alcool. Pour le journal, la campagne dans laquelle<br />
il s'engageait n'était pas solitaire puisque d'autres journaux comme "Afrique Nouvelle",<br />
"Horizons Africains" avaient mis en évidence le danger que représentait cet<br />
accroissement de la consommation en Afrique Noire et que les autorités coloniales<br />
avaient été particulièrement dénoncées comme responsable de cette politique<br />
d'alcoolisation par les étudiants musulmans d'Afrique noire. En effet, le congrès<br />
constitutif de leur association, A.M.E.A.N, dans le Manifeste adopté au terme de 4 jours<br />
de travaux, s'exprime ainsi: « Ils (les étudiants musulmans) s'alarment en constatant que<br />
malgré le nombre particulièrement important de musulmans en Afrique noire, et malgré les<br />
dispositions coraniques, la France déverse, sans scrupule, des milliers de tonnes de vins et de<br />
boissons alcoolisées sur les territoires d'outre-mer ».<br />
26. "L'Etudiant d'Afrique noire", Juin 1954<br />
27. "Afrique noire", 31 mai 1954<br />
334
L'A.M.E.A.N affirme que : « La politique d'alcoolisation des populations<br />
d'Afrique noire les touche profondément car elle met déjà sérieusement en danger l'existence<br />
de la race et favorise une transgression malencontreuse d'un impératifcoranique. »28<br />
Le géographe Richard Mol(ilrd s'inquiéte également de cette politique<br />
d'alcoolisation dans une série d'articles publiés par le Bulletin de l'IFAN en 1950 et<br />
1951. Dans l'un de ses articles, il rapporte les écrits d'un reporter du "Figaro" ayant<br />
parcouru l'Afrique Noire Française: « Tous les moyens, politiques, et autres sont bons<br />
pour mettre à la raison un gouverneur général qui tenterait de les contrer ». Le reporter<br />
désigne ainsi les vrais responsables de cette politique d'alcoolisation : le grand<br />
commerce. Le professeur Richard Molard n'en distinguait pas moins d'autres<br />
responsables même s'ils étaient secondaires : « Les Assemblées territoriales parce que<br />
parmi les recettes douanières, les alcools d'imporlations sont forl considérables. »29 Une<br />
voix célèbre, celle de l'agronome René Dumont, condamnait aussi l'alcoolisation des<br />
populations en constatant qu'en 1951, l'AOF importait 15 fois plus d'alcools qu'en 1938.<br />
Sur la base de l'année 1953, il donnait, à titre d'exemple,les chiffres suivants: «L'alcool<br />
représentait 8 % des imporlations de la Côte d'Ivoire, 9,6 % de celles du Dahomey»30.<br />
En plus des journaux, les organisations de jeunesse, les partis politiques, les<br />
organisations syndicales, les personnalités etc avaient fortement élevé la voix pour faire<br />
entendre leurs critiques. En métropole aussi, des politiques, des artistes, des hommes de<br />
sciences et de culture, des milieux religieux etc s'étaient joints à la condamnation de la<br />
progression de l'alcoolisation en Afrique.<br />
Devant ce concert de protestations d'origines diverses, les autorités<br />
gouvernementales furent mêmes obligées d'intervenir. Un décret, en date du 14<br />
septembre 1954, manifestait une volonté de lutter contre la progression des importations<br />
d'alcools en Afrique Noire et dans les TOM. Mais les grands milieux d'affaires<br />
exprimèrent leur opposition à cette réglementation particulière contre les importations<br />
d'alcools. Ainsi, lors de la réception offerte en l'honneur de Robert Buron, ministre de<br />
la FOM de passage à Dakar, ces grands milieux d'affaires locaux s'opposèrent<br />
ouvertement au décret. En effet, dans son discours - le président Charles Tascher étant<br />
absent - M. B Dubois, intérimaire, avait, au nom de son assemblée, exprimé leur<br />
position en ces termes:
gouvernementale (de Paris et aussi de Dakar) n'aurait pour résultat, qu'un<br />
accroissement du coût de la vie, des pertes importantes pour le fisc alors que le mal<br />
persisterait et même s'aggraverait. A la place de cette action, le porte-parole des milieux<br />
d'affaires suggérait plutôt de mener « une action d'éducation des jeunes et une action sur<br />
le plan psychologique, lesquelles actions fourniraient le meilleur remède. »Dans sa réponse,<br />
Robert Buron n'avait pas été insensible aux arguments des milieux d'affaires locaux. «<br />
La quantité d'alcool introduite dans les territoires d'Afrique noire a été sans cesse en<br />
accroissement dans les dernières années... Je suis d'accord avec vous... C'est que la lutte<br />
contre l'alcoolisme ne peut être seulement une question de réglementation; elle est aussi un<br />
état d'esprit. C'est une question de propagande, de formation ».<br />
La concordance de vue entre le ministre, haut responsable de l'AOF et les<br />
milieux d'affaires dakarois était manifeste. De ce fait, il était fort probable que Paris ne<br />
fasse effectivement pas grand chose pour arrêter ce déversement croissant d'alcool vers<br />
l'Afrique Noire. Dans les faits, ce que le président M.B. Dubois appelait "réserves"<br />
n'était rien d'autre qu'une opposition totale et ouverte à toute entrave à l'élargissement<br />
des importations d'alcool dans l'étendue de la Fédération.<br />
On remarque, entre 1954 et 1960, la permanence des dénonciations de la<br />
politique d'alcoolisation des populations. C'est bien la preuve que des quantités<br />
croissantes de ce produit continuaient à arriver en Afrique Noire. Les intérêts du grand<br />
commerce l'emportaient donc sur ceux des populations. Il en résultait une certaine<br />
précarisation de l'alimentation et de la santé des populations africaines.<br />
La question de savoir si la partie européenne de la population était<br />
négativement touchée par cet accroissement constant des importations et de la<br />
consommation ne manque pas d'intérêt. Pierre Richard, Paul Mercier, Pierre Biarnès,<br />
Léon Palès sont unanimes à indiquer la place de choix des alcools dans les multiples<br />
réceptions, dîners, cocktails etc dans les milieux européens de la capitale fédérale.<br />
Toutes ces sources sont aussi unanimes à dire qu'il s'agissait d'alcools importés. Par<br />
contre, aucune de ces sources ne parle explicitement d'aspects négatifs de cette<br />
consommation sur ce groupe de population.<br />
Un auteur africain, Sembéne Ousmane, nous en donne une idée dans un<br />
roman à grand succès 32 . Il décrit un Européen toujours ivre, s'introduisant dans les<br />
villas cossues réservées au personnel européen dans un quartier spécialement conçu par<br />
la direction de la Régie des chemins de fer. Cet homme se heurte à un ostracisme<br />
général de la part des Européens de Thiès. Si ce milieu en question n'accepte pas cet<br />
homme, ivre en permanence, ce n'est pas à cause de son alcoolisme mais bien à cause<br />
des idées anticoloniales que l'intéressé véhicule partout dans les "cercles blancs" où<br />
pourtant il n'est jamais convié mais il impose sa présence.<br />
32. Les bouts de bois de Dieu, 1960.<br />
336
Ces Européens avaient déjà une certaine familiarité avec l'alcool avant<br />
d'arriver en Afrique Noire. Il en résulte que ses effets semblent ne pas avoir été aussi<br />
néfastes pour eux; par contre sur les Africains pas ou peu habitués aux boissons<br />
alcoolisées, la consommation des alcools importés faisait des ravages.<br />
337
INDICATIONS SUR LA CONSOMMATION A DAKAR<br />
1) production maraîchère (Janvier à Mai 1957)<br />
Produit<br />
Choux<br />
Salades diverses<br />
Courges<br />
Carotte<br />
Tomate<br />
Aubergine<br />
Haricots verts<br />
Poireaux<br />
Pommes de terre<br />
Celeri<br />
Navet<br />
Choux fleurs<br />
Concombres<br />
Oignons verts<br />
Betterave<br />
Poirée<br />
Divers<br />
TOTAL<br />
Presqu'île.<br />
Quantité/T<br />
4000<br />
3000<br />
2100<br />
2000<br />
2000<br />
1600<br />
1000<br />
1000<br />
1000<br />
800<br />
800<br />
500<br />
400<br />
400<br />
300<br />
200<br />
500<br />
21.600 tonnes entièrement consommées dans la<br />
2) Arachide: 1.500 à 2.000 tonnes annuellement ( produites et consommées sur place).<br />
3) Pêche:<br />
- artisanale : 20 tonnes de poissons sont vendues chaque jour sur les marchés de Dakar.<br />
- industrielle du thon: largement exportée vers la France. Seule une faible part est<br />
consommée sur place.<br />
Années Production/T<br />
1955/56 1.300<br />
1956/57 6.000<br />
1957/58 9.000<br />
338
4) Viande: les abattoirs de Dakar traitent annuellement:<br />
35.000 boeufs, 40.000 moutons, 6.000 porcs et 1400 chevaux<br />
5) Les autres besoins de la presqu'île (viande, produits laitiers, farine etc... doivent être<br />
couverts par les productions des régions environnantes ou de France.<br />
6) En huile, boissons diverses (limonade, bière...), biscuits, chocolats, confiserie, pain<br />
etc... les industries alimentaires nombreuses dans la ville couvrent largement les besoins<br />
locaux et même de la Fédération.<br />
7) Le mil est largement consommé dans le milieu indigène de Dakar où en règle<br />
générale, cette céréale est la base du repas du soir. Le tonnage de la consommation<br />
reste difficile à connaître au niveau de la ville dans la mesure où il provient de<br />
l'intérieur du Sénégal et souvent hors circuits commerciaux.<br />
8) Le riz, tout comme le mil est avant tout consommé par les milieux africains. Certes<br />
une faible production locale alimente les circuits commerciaux mais avant tout, il est<br />
importé par les soins de l'administration coloniale, à partir d'Indochine.<br />
339
CHAPITRE IV : SANTE, PROPRETE ET SECURITE<br />
Il SANTE ET PROPRETE<br />
1) La santé<br />
La lecture de la presse dakaroise et diverses sources administratives<br />
dépeignent à quel point la situation sanitaire était précaire dans la ville.<br />
Les investissements dans le domaine de la santé étaient chiffrés par la<br />
Chambre de Commerce, pour la période 1948-1958, pour l'ensemble de l'AOF, et du<br />
Sénégal 1 , tout comme de Dakar, de la façon suivante:<br />
- pour l'AOF pendant le 2 eme plan du FIDES, c'est à dire de 1953 à 1957;<br />
4,752 milliards ainsi répartis:<br />
* ressources locales: 1,663 milliards<br />
* section générale du FIDES: 0,052 milliards<br />
* section locale du FIDES: 3,037 milliards.<br />
- Pour la ville de Dakar, pendant toute la période des 1 er et 2 eme plan allant<br />
de 1947 à 1957, la masse totale des investissements en matière de santé s'élevait à 586<br />
millions de F CFA. A titre de comparaison, la ville de Kaolack, capitale du bassin<br />
arachidier sénégalais, recevait, dans la même période la somme de 65 millions dont<br />
l'essentiel était destiné à la construction d'une formation sanitaire 2 .<br />
La revue "Présence africaine" faisait remarquer que les priorités accordées<br />
dans la politique des investissements, par le FIDES, étaient loin d'aller dans le sens de<br />
la lutte contre les maladies tropicales et contre l'analphabétisme. La rédaction de cette<br />
revue chiffre à 17 % des sommes globales affectées à ces aspects sociaux contre 83 % à<br />
la défense. Au total, 5,7 milliards allaient à la santé et à l'enseignement des TOM ,soit<br />
exactement le montant des investissements en direction de la seule gendarmerie 3 . Pour<br />
l'organe de presse, il ne pouvait en être autrement dans la mesure où le secteur social<br />
apparaissait très secondaire dans les préoccupations coloniales. Le journal se référait à<br />
des propos tenus par Bernard Cornut Gentille, Haut Commissaire, gouverneur général<br />
de l'AOF, à Paris, devant le Comité Supérieur de la FOM, à savoir que: « L'impératifde<br />
progrès économique paraît devoir être limité par les impératifs de la défense nationale. »<br />
Ces données confirmaient simplement les faits : la faiblesse des<br />
investissements dans le domaine de la santé en AOF. Pour la ville de Dakar, le docteur<br />
Moustapha Diallo, ancien président de l'AGED, remarquait que, entre 1945 et 1960,<br />
1. C.CA.I, Synthèse de la situation économique, p.221<br />
2. Ibidem, p.236<br />
3. "Presence Africaine" Fév-Mars 1957<br />
340
- Centre hospitalier de Fann (en voie d'achèvement avec 1000 lits)<br />
Au total général (civils et militaires), la ville de Dakar disposait de 2275 lits.<br />
L'état-major indiquait également que 3 cliniques chirurgicales étaient en<br />
chantier sous l'égide de l'armée.<br />
Pour apprécier correctement l'état de couverture sanitaire de la population,<br />
il faut se rappeler que l'hôpital Principal était exclusivement réservé à une infime partie<br />
de la population : les Européens et les fonctionnaires africains des hauts cadres, peu<br />
nombreux. Par contre, les Africains ordinaires devaient se contenter de l'hôpital Aristide<br />
Le Dantec. D'où cette distinction ancrée dans la mentalité de la population: hôpital des<br />
"Toubabs" d'une part et hôpital africain d'autre part.<br />
La revue "Présence Africaine" traduisait cette distinction en montrant qu'il y<br />
avait une ségrégation raciale ou par l'argent. Les facultés financières des populations<br />
respectives obligeaient les Africains à se contenter des dispensaires mal propres et<br />
insuffisants. Par contre, les Européens étaient admis dans des hôpitaux propres, bien<br />
équipés, avec un personnel compétent et vanté par les actualités cinématographiques 6 .<br />
Parlant de cette couverture sanitaire en termes de capacité d'accueil, le journal "Réveil"<br />
considérait qu'il y avait en moyenne 1 lit pour 500 personnes7. Le journal passait en<br />
revue la situation de l'hôpital indigène en ces termes: «A la maternité, la situation est<br />
inquiétante. Les femmes sont obligées, faute de place, de rentrer chez elles le deuxième jour<br />
de leur accouchement ». "Réveil" expliquait cette situation comme le résultat des diverses<br />
modifications opérées sur les locaux : «A la première division, sur 55 lits, 30 ont été<br />
supprimés et la place qu'ils occupaient antérieurement, aménagée en bureaux. A la<br />
deuxième division, il y a transformation complète. Il n'y a plus que des employés européens,<br />
de la dactylo au patron, et chacun a son bureau propre. C'est dire qu'il y a très peu de<br />
places... base d'une spéculation de toute sorte ».<br />
Cet aspect de la situation de la maternité de l'hôpital indigène était confirmé<br />
par un rapport administratif de la Délégation: « Le trop bref séjour des malades dans<br />
notre service, 3 jours en moyenne, ne nous permet guère, au demeurant, d'observer ·la<br />
plupart des maladies endémiques »8. Le docteur Paul Corréa qui signait cette partie<br />
relative à la maternité dans le rapport d'ensemble de l'hôpital, montrait plus loin la<br />
permanence de cette situation par ces termes : « Les grandes lignes que nous avions<br />
exposées dans notre précédent rapport restent valables. Notre situation en personnel et en<br />
matériel ne s'est point améliorée en 1955». Dans la division "Analyses médicales et<br />
recherches pathologiques", le chef, dans son rapport, soulignait : « Tous les jours, on<br />
refuse du monde faute de place ».<br />
6. "Présence Africaine", Fév-Mars 1957<br />
7. "Réveil" n04, Janvier 1954<br />
8. Affaires politiques AOF, A.N.S, Rapport 2G 55-65,1955<br />
342
Le service d'oto-rhino pharyngologie et d'ophtalmologie exprimait une<br />
situation plus préoccupante encore : « Il est curieux qu'un service comme le nôtre n'ait<br />
connu, depuis sa création, qu'une sorte de dédain et d'abandon. » Le docteur Amoussou,<br />
chef de la division de psychiatrie de l'hôpital indigène, exprimait une indignation aussi<br />
virulente par ces mots : « Comme si rien de cette division ne devait être pris au sérieux...<br />
Les rapports précédents restent sans suite». Parlant des malades, il ajoutait: « Dans cette<br />
enceinte ignoble, vivent pourtant des hommes et des femmes sans distinction de sexe.<br />
L'indispensable même leur est refusé: une natte de jonc pour se coucher... Tels des chiens<br />
enragés, jour après jour, ils vivent impuissants ces scènes dramatiques qui les conduisent,<br />
inexorablement, au rang d'animaux ». La situation n'est bonne nulle part dans l'hôpital<br />
indigène puisque le service de pédiatrie signalait qu'il y avait une infirmière pour 20<br />
enfants alors qu'en métropole, la moyenne était d'une infirmière pour 4 enfants.<br />
Dans sa partie "Synthèse", le rapport général sur la situation de l'hôpital<br />
indigène, pour l'année 1955, ne dégageait autre chose que les négligences et le laisser<br />
aller. « Tout ce qui a été dit dans nos rapports précédents, depuis dix ans, reste de plus en<br />
plus valable... La capacité hospitalière de Le Dantec n'a pas suivi la course ascendante de<br />
la population de Dakar. Une rupture d'équilibre - si jamais il avait existé - s'en est suivie ».<br />
Expliquant les facteurs d'encombrement au niveau de l'hôpital indigène, le rapport en<br />
retenait, principalement, deux: « - La ville de Dakar manque d'asiles pour accueillir les<br />
chroniques et les incurables. Ceux-là, ramassés par la police - très souvent - sont conduits<br />
automatiquement sur Le Dantec et ils y réduisent le nombre de places disponibles pour les<br />
maladies aiguës.<br />
- Le Dantec reçoit quantité de malades étrangers à Dakar venant de territoires<br />
quelque fois très éloignés ».<br />
Parlant du personnel, le rapport insistait sur son dévouement tout en faisant<br />
ressortir qu'il était débordé et surmené. Le rapport se terminait en ces termes: « J'attire<br />
à nouveau l'attention sur cette situation particulièrement défavorable dans un hôpital<br />
d'enseignement ».<br />
En somme, ce rapport était particulièrement intéressant comme descriptif de<br />
l'hôpital indigène de la ville. Les synthèses partielles, tout comme la synthèse générale,<br />
dépeignaient une situation grave et qui n'était pas nouvelle. Cette situation révélait des<br />
crédits dérisoires, des locaux: non entretenus, un personnel qui fait défaut<br />
qualitativement comme quantitativement, un nombre de places insuffisant, des malades<br />
pas toujours acceptés, des séjours trop brefs pour les malades hospitalisés, un niveau de<br />
guérison problématique etc... Cet hôpital était, pourtant, un centre d'enseignement<br />
universitaire pour les élèves infirmiers, les sages-femmes et les étudiants de l'école de<br />
médecine de l'Institut des Hautes Etudes de Dakar.<br />
Dans cette situation d'ensemble, quelle pouvait être la signification exacte<br />
des chiffres donnés par le rapport ?<br />
343"
Nombre de lits = 917<br />
hospitalisés = 14.078<br />
journées d'hospitalisation = 333.780<br />
consultants = 21.215<br />
Le moins que l'on puisse dire dans ce contexte, est que la santé des indigènes<br />
était, en fait, laissée pour compte par l'administration coloniale. Surtout, à la lumière de<br />
la comparaison des situations entre les hôpitaux pour Indigènes et pour Européens.<br />
En effet, l'hôpital Principal de Dakar avait été créé en 1920 sous le nom<br />
d'''Ambulance de Dakar" et entrait dans le cadre d'un ensemble d'hôpitaux mis en place<br />
au Sénégal, au début du siècle, à Saint-louis, Gorée et Rufisque. A l'origine de ces<br />
hôpitaux militaires, il y avait l'application d'une ordonnance royale du 15 août 1681 pour<br />
recevoir les officiers et les soldats qui tomberaient malades. Le développement rapide<br />
de la population européenne de la ville de Dakar, au début du siècle surtout, expliquait<br />
l'importance du développement de cet hôpital, essentiellement grâce à la politique<br />
d'investissement du FIDES dans les années 50. L'hôpital était placé sous administration<br />
militaire et hospitalisation civile. Son personnel était essentiellement composé de<br />
militaires et de civils français. On notait aussi des religieuses de diverses nationalités,<br />
des Françaises en majorité. Quant au personnel subalterne, il était constitué<br />
d'autochtones.<br />
Contrairement à l'hôpital indigène, Principal ne recevait pas d'indigènes. Ne<br />
pouvaient y accéder que des militaires, des fonctionnaires des hauts cadres et ceux qui<br />
pouvaient payer eux-mêmes les frais. Les militaires admis, étaient entièrement pris en<br />
charge par leur armée. Pour les fonctionnaires, l'admission s'y faisait sur la base<br />
d'imputations budgétaires pour lesquelles le 1/4 des frais était à leur charges et les 3/4 à<br />
la charge de l'administration. Quant aux particuliers, leurs dépenses leur étaient<br />
totalement imputées. La durée minimale d'admission pour laquelle, au préalable, ils<br />
devaient s'acquitter des 60 % du montant était de 5 jours.<br />
L'Etat-Major donnait, pour cet hôpital, un chiffre de 300 lits en 1959, à quoi<br />
s'ajoutait un chiffre presque équivalent de 297 lits sous administration militaire dans les<br />
diverses infirmeries des armées, soit 597 lits au tota1 9 .<br />
Dans sa thèse de doctorat de médecine consacrée à cet hôpital, Marne<br />
Thierno Aby Sy donnait le chiffre de 562 lits pour l'année 1968, c'est à dire dix ans plus<br />
tard10. Cette source indiquait pour l'année 1960, 175.298 journées d'hospitalisation. Le<br />
chiffre de 1959 était de 173.460. Le taux moyen d'hospitalisation était évalué à 89,4% et<br />
le taux de non occupation seulement de 1,6 %. D'autres paramètres comme celui de<br />
l'occupation/population, étaient dégagés par ce travail universitaire. Pour le Cap Vert,<br />
9. Fiche 21.<br />
10. Marne Thierno Aby Sy, l'hôpital Principal de Dakar: contribution à l'élaboration d'une doctrine hospitalière<br />
sénégalaise, 1971, p.44.<br />
344
l'indice lit/population se situait à 5,92 lits pour 1.000 habitants. Pour l'hôpital Principal,<br />
cet indice était seulement 1,85 lit pour 1.000 habitants.<br />
Ces chiffres étaient donnés pour la période post coloniale. Cependant, dans<br />
une large mesure, ils traduisaient bien la situation des années 50 puisque, de ce point de<br />
vue, les choses n'avaient pas beaucoup changé. Peut-être même avait -elle empiré en<br />
raison de l'accroissement de la population par rapport à la capacité hospitalière de la<br />
ville.<br />
2) Hygiène et propreté.<br />
Ce problème ne traduisait pas moins une situation préoccupante pour la<br />
période. Les rapports de l'administration ainsi que la presse dakaroise en apportaient<br />
des témoignages réels.<br />
Le rapport annuel du service d'hygiène de la Délégation, en 1956, qualifiait<br />
son personnel "d'insuffisant", ses crédits de "dérisoires" et son matériel technique de "très<br />
insuffisant". La carence des moyens logistiques n'était pas oubliée11. Pourtant cette<br />
structure était rattachée, depuis 1953 12 , à la direction générale de la santé publique de<br />
l'AOF mais constituée en organisme autonome. Ce rattachement avait pour objectif<br />
d'améliorer la situation de ce service, laquelle n'était pas brillante au moment où il<br />
dépendait de l'hôpital central indigène. Un autre rapport de ce même service, pour<br />
l'année 1957, montrait qu'aucune amélioration n'était notée par rapport à l'année<br />
d'avant. A propos du personnel, il appréciait: «Insuffisant et de qualification très basse ».<br />
La situation était analysée, pour les effectifs « 12 agents techniques de santé, 67 infinniers<br />
d 'hygiène alors qu'il en faudrait 100, 167manoeuvres alors qu'il en faudrait 250. »13 Quant<br />
aux crédits affectés au service, le rapport mettait particulièrement l'accent sur leur<br />
baisse vertigineuse et constante «Il faut signaler la diminution d'année en année de nos<br />
crédits de fonctionnement.<br />
1952 = 36.765.000 F CFA<br />
1953 = 23.900.000 F CFA<br />
1957 = 20.000.000FCFA<br />
1958 = 15.675.000 F CFA»<br />
Le rapport annuel du service d'hygiène de Dakar insistait sur le fait que la<br />
ville manque de lieu d'isolement en cas d'épidémie. Le service dégageait, dans ces<br />
conditions, toute responsabilité sur les conséquences fâcheuses qui pourraient en<br />
résulter en cas d'épidémie. Le rapport signalait que, suite à la diminution des crédits, la<br />
lutte anti-pestance avait particulièrement souffert depuis 3 ans.<br />
11. Rapport 2G 56-46, Institut d'hygiène sociale de Dakar, 1956.<br />
12. Arrêté N° 3553/SP/du 23 juillet 1953.<br />
13. A.N.S: 2G 57-33, Rapport d'ensemble de la Délégation de Dakar, 1957.<br />
345
"augias" qui devait aboutir à faire sortir la capitale de son lamentable état de saleté »22. Le<br />
journal notait la puanteur, les moustiques, la fumée, les tas d'ordures remués, les égouts<br />
aux odeurs pestilentielles etc...<br />
Le Conseil municipal de la ville se saisit lui-même de la question de façon<br />
permanente entre 1945 et 1960, prouvant ainsi qu'aucune solution adéquate et durable<br />
n'était trouvée. Dans une séance en date du 18 décembre 1950, le conseiller Paye Djigo,<br />
au sujet de la question du nettoiement de la ville, constatait: «Je vois que ça marche<br />
mal, surtout dans la Médina. les poubelles restent quelques fois 10jours sans être enlevées. »<br />
Un autre conseiller, Abbas Guèye, militant du B.D.S, refuse de s'associer à la majorité<br />
SFIO de l'instance, dans la campagne contre Maurice Voisin dont les articles étaient<br />
présentés comme racistes par plusieurs conseillers : « En cherchant les moyens de nous<br />
déban-asser de lui (Maurice Voisin), nous devons chercher les moyens de redresser notre<br />
municipalité... Nos mes sont sales... Notre personnel ne fait rien. »<br />
La question de la propreté de la ville constitua une pomme de discorde entre<br />
le Conseil municipal, à dominante SFIO, et le gouvernement de l'autonomie interne mis<br />
en place par le parti adverse, le B.P.S. En effet le gouvernement Mamadou Dia voulut<br />
placer le service de nettoiement de la ville, sous la responsabilité directe du ministère de<br />
l'intérieur. La municipalité opposa un refus catégorique au projet 23 . Une longue<br />
procédure s'engageait ainsi sur le problème des compétences, officiellement, même si<br />
d'autres raisons inavouées servaient de soubassement à l'argumentation, de part et<br />
d'autre. En tout cas, ce 24 janvier 1958, le débat était tranché par un vote. La majorité<br />
de l'institution refusa le transfert du service de nèttoiement de la ville, de la commune<br />
au ministère de l'intérieur. Pourtant la question n'était pas tranchée définitivement car<br />
même le camp socialiste de l'équipe municipale ne pouvait pas s'empêcher de constater<br />
qu'il y avait un problème sérieux à ce niveau. Dans ces conditions, dès le 5 avri11958, le<br />
Conseil plancha, à nouveau, sur la question. L'importance de cette séance est attestée<br />
par la longue intervention du maire ouvrant la séance : «Lorsque je me promène dans<br />
Dakar, même seul dans ma voiture [...J, j'ai de la peine à regarder devant moi et autour de<br />
moi, ces tas d'ordures. Cette saleté que les circonstances nous ont imposés à subir [...JLa<br />
ville n'est pas tenue aussi proprement qu'on l'aurait souhaité...» Insistant sur la taille de la<br />
ville, l'insuffisance des moyens de tous genres, le maire en arrivait à une proposition<br />
pour conclure: « Le Conseil Municipal, Après avoir entendu l'exposé de son maire...<br />
l'exécution du service du nettoiement des ordures ménagères et du nettoiement de la ville de<br />
Dakar sera confiée à l'entreprise (!!!). A cet effet, un appel d'offres devra être lancé... donne<br />
mandat à Monsieur le Maire... ».<br />
L'intervention du maire mais surtout sa proposition donnèrent lieu à un long<br />
débat au terme duquel un scrutin intervint. Sur les 37 membres du conseil municipal,<br />
22. "Afrique nouvelle" du 18 juillet 1958<br />
23. Délibération du 24 janvier 1958, Conseil Municipal de Dakar.<br />
347
seuls 24 étaient présents. Le vote donnait les résultats suivants: 22 voix pour, une voix<br />
contre et une abstention. La proposition du maire fut donc entérinée. Elle donna lieu,<br />
séance tenante, à la constitution d'une commission de 7 membres, chargée d'étudier les<br />
modalités pratiques de l'exécution et ceci sur la proposition du conseiller Abdoulaye<br />
Fofana 24 . La mise à exécution de ce projet ne fut pas immédiate car plusieurs réunions<br />
convoquées à cet effet ne purent se tenir, faute de quorum. Ceci, parce que des<br />
événements très importants occupaient la scène politique : ceux d'Alger et leurs<br />
répercussions en métropole et à Dakar.<br />
Bien après le Référendum, le conseil municipal put se réunir, pour reprendre<br />
la question. En sa séance du 30 octobre 1958, Diaw Djibril, adjoint au maire,<br />
responsable du nettoiement, fit l'exposé sur la situation de son service, avec, à l'appui,<br />
des chiffres, tant pour le personnel que pour les moyens matériels disponibles.<br />
Années 1951 1958 En moins<br />
bennes 160 121 39<br />
Personnel<br />
alayage 625 275 350<br />
Total 785 396 389<br />
Au résultat, l'adjoint délégué au nettoiement montrait que cette diminution<br />
des effectifs humains et matériels, était lourde de conséquence pour une tâche aussi<br />
immense, la ville étant si grande. Il montrait, en termes très nets, que cette diminution<br />
avait été imposée à la Municipalité, et concluait à la gravité de cette situation. Après son<br />
exposé, deux questions restèrent au centre des interventions :<br />
- le cahier des charges de la convention<br />
- la forme administrative de l'appel d'offres.<br />
Un vote sanctionna la discussion, permettant la mise en route du projet de<br />
privatisation du service du nettoiement de la ville de Dakar. Ainsi, prenait fin, une<br />
longue discussion mais surtout une longue procédure. Certes, le conseil municipal avait<br />
opposé un refus catégorique à la proposition gouvernementale de faire dépendre le<br />
nettoiement directement de la tutelle du ministère de l'intérieur mais acceptait<br />
l'établissement d'une convention avec une société privée. Par là, le conseil atteignait un<br />
objectif de taille : ne plus être indirectement responsable du nettoiement, tout en<br />
gardant une possibilité de contrôle sur ce service. C'est dire qu'il avait pris conscience de<br />
l'insuffisance de ses moyens à accomplir la tâche. Mais surtout, il prenait acte des<br />
diverses critiques formulées au sujet du nettoiement, lesquelles n'étaient pas toutes<br />
formulées par simple calcul politique. Ce choix de l'équipe municipale lui offrait bien<br />
24. Il fut par la suite, PDG de la SOADIP, la société créée à cet effet.<br />
348
une issue de secours. Le conseil aurait été sans moyens adéquats de s'opposer à une<br />
décision du gouvernement si ce dernier avait placé d'office le nettoiement de la ville<br />
sous sa propre responsabilité, par voie législative. Le contexte politique de majorité<br />
absolue du BPS, parti gouvernemental à l'Assemblée du Territoire, le permettait. Mais<br />
surtout, la détermination du gouvernement Mamadou Dia à transférer immédiatement<br />
la capitale du Sénégal à Dakar, accentuait le poids de la décision. En somme, les enjeux<br />
étaient de taille, de part et d'autre.<br />
De ce point de vue, cette décision de mettre en gérance privée le service de<br />
nettoiement de la ville, préservait les intérêts politiques de la municipalité et donnait<br />
satisfaction à ses adversaires par la même occasion. Elle était, somme toute, salutaire<br />
pour chacune des parties impliquées.<br />
Bien entendu, les changements intervenus au plan politique avec la naissance<br />
de l'U.P.S, issu du regroupement entre le BPS et le P.S.AS, permirent de trouver au<br />
niveau municipal, cette issue de secours que fut la mise en gérance du service de<br />
nettoiement de Dakar, à l'initiative même du conseil municipal de la ville.<br />
11/ LA SECURITE A DAKAR<br />
De manière générale, la période qui nous concerne est caractérisée par un<br />
calme réel, à quelques rares exceptions près, comme la fin du mois d'août 1958.<br />
Comment était assurée la sécurité de la ville?<br />
L'Etat-Major donne de précieuses indications sur cette question en<br />
présentant le dispositif d'ensemble de la sécurité établi dans la capitale fédérale:<br />
1. La sécurité dans la région du Cap Vert était placée sous les ordres d'un<br />
commissaire divisionnaire ayant sous sa responsabilité les services suivants:<br />
- une section de renseignements généraux (information et contrôle de la<br />
circulation des étrangers)<br />
l'émigration)<br />
- une section de police judiciaire (recherches des crimes et délits)<br />
- un commissariat spécial du port (contrôle de l'immigration et de<br />
- un commissariat de l'aéroport.<br />
2. Quant aux commissariats de police,<br />
- un commissariat central ( avec un personnel en civil et un personnel en<br />
uniforme) compétent sur l'ensemble de la presqu'île du Cap Vert<br />
- 7 commissariats d'arrondissements<br />
- 1 commissariat à Rufisque<br />
- 1 poste. de police à Gorée.<br />
3. Pour la gendarmerie:<br />
349
de l'AOFjTogo<br />
- 1 commandement du détachement de la gendarmerie de la zone de défense<br />
-le groupe de gendarmerie du territoire du Sénégal<br />
- l'escadron de gendarmerie de Dakar pour l'ensemble de la presqu'île ( y<br />
compris les brigades maritime et aérienne de Dakar et Ouakam)25.<br />
Cette source, peut-être pour des raisons de sécurité, ne donne aucun chiffre<br />
sur l'importance numérique des forces de ce dispositif de sécurité. Cependant, à travers<br />
quelques autres sources administratives, quelques indications apparaissent et permettent<br />
une appréciation du poids numérique de ces forces. Exemple, le service des<br />
renseignements généraux (chargé particulièrement de la recherche et de l'exploitation<br />
des renseignements intéressant l'ordre public, la sûreté du territoire, la surveillance des<br />
étrangers, des partis politiques et groupements professionnels, mais aussi de la police<br />
administrative) était considéré par un rapport comme ayant « un effectif insuffisant, eu<br />
égard au développement de la ville impériale et à l'accroissement de la population, ces<br />
dernières années »26. Cette source, elle aussi, n'avance pas de chiffre, qui permette une<br />
comparaison.<br />
"Echos d'Afrique noire" donne une indication qui, pour significative, n'en<br />
demeure pas moins vague. En effet, ce journal estime que les effectifs de la police<br />
dakaroise avaient quintuplé et qu'on trouvait des policiers blancs à tous les coins de<br />
rues 27 . L'organe qualifiait pourtant cette même police d'incapable 28 . Evidemment pour<br />
la rédaction du journal, cette police était simplement "partisane" à vrai dire et non<br />
inefficace et incapable. D'où le projet nourri à un moment donné de créer une police<br />
privée à Dakar, aux fins de préserver la sécurité des Européens ainsi que leurs biens,<br />
tâche "négligée" par la police de la ville. Un autre organe, "Afrique noire" note une<br />
inefficacité de la police dakaroise, ce qui expliquait le développement d'une pègre dans<br />
la ville : « Heureusement, elle n'atteint pas encore - Dieu merci - la haute école de la<br />
malfaisance. Ce n'est encore qu'une voyouterie adolescente [...J le tout, assaisonné d'une<br />
belle audace et d'une grande aisance. »29 "Condition Humaine", aussi, se plaint que la<br />
police dakaroise ne fasse pas correctement son travail puisqu'elle laissait en quasi<br />
impunité les bandes des "bérets rouges" armés à travers la ville. S'ils étaient arrêtés, la<br />
police s'empressait de les remettre immédiatement en liberté, surtout lorsque ces<br />
bandes pillaient les domiciles d'opposants, en pleine campagne électorale de 1953.<br />
Parlant de la situation sociale dans la capitale, l'organe du BDS écrit: « Trop de vauriens<br />
sy promènent, trop de malades sy coudoient, trop d'indigents entravent la circulation, trop<br />
25. Fiche 31.<br />
26. Affaires politiques AOF, A.N.S, Rapport annuel2G 47-29, Délégation de Dakar, 1947.<br />
27. "Echos d'Afrique noire" du 15 décembre 1950<br />
28. N° du 30 août 1954<br />
29. "Afrique noire" du 15 août 1953.<br />
350
n'en avait pas vu depuis 45 ans. Pendant 5 heures d'affilée, il était tombé 236 mm d'eau.<br />
2000 sinistrés et 400 cases détruites étaient dénombrés. A quoi s'ajoutait un noyé de 14<br />
ans 36 . Pour la ville indigène, construite sur la zone marécageuse, la violence de la pluie<br />
avait, de toute évidence, des conséquences néfastes sur l'hygiène.<br />
En somme, la ville de Dakar connaissait surtout dans sa partie indigène, des<br />
problèmes nombreux de sécurité même si une situation de véritable catastrophe ne se<br />
dégage pas de nos sources.<br />
36. "Paris-Dakar" du 29 août 1946.<br />
353
CHAPITRE V : ECOLE ET PROBLEMES CULTURELS<br />
Il L'ECOLE<br />
1) Investissements. effectifs. résultats<br />
Cette question était l'une des plus importantes pour la population de la ville.<br />
On peut considérer que la longue bataille des étudiants de l'Institut avait fait ressortir<br />
les problèmes du niveau de l'enseignement supérieur. Pour l'essentiel, ces problèmes<br />
étaient : enseignement de qualité, moins d'échecs, formation pour un plus grand<br />
nombre, liberté pour les contacts extérieurs, plein emploi en AOF etc... Dès lors, l'école<br />
dans ses niveaux primaire et secondaire restait à étudier. Dans la période, nombreux<br />
étaient ceux qui vantaient l'oeuvre coloniale à l'égard de cette école. Cependant, non<br />
moins nombreux étaient ceux qui n'en retenaient d'essentiel, que ses aspects "misérable"<br />
et "aliénant".<br />
"Paris-Dakar" rapporte les travaux de la conférence des gouverneurs<br />
généraux et gouverneurs d'Afrique Noire Française tenue à Paris en mars 1947. Cette<br />
conférence, présidée par Ramadier, président du Conseil, et le ministre de la FOM,<br />
était consacrée aux problèmes de l'éducation dans les territoires. La conférence<br />
adoptait, après plusieurs jours de travaux, un plan décennal tendant à donner aux<br />
autochtones la possibilité d'accéder à tous les diplômes, à toutes les hiérarchies, à toutes<br />
les carrières. Son financement global était arrêté à la somme de 19,755 milliards de F<br />
CFA1. Ce plan d'organisation et de financement de l'enseignement en Afrique Noire<br />
Française avait-il atteint ses objectifs?<br />
Selon la Chambre de commerce de Dakar, un total de 10,610 milliards de F<br />
avaient été investis dans la décennie 1947-1957 dans toute la fédération de l'AOF. Cette<br />
somme, quant à ses origines, se répartissait ainsi:<br />
- 5,299 milliards du FIDES<br />
- 5,311 milliards en ressources locales.<br />
Ce financement global était allé tant à l'enseignement public que privé.<br />
Sur les prévisions de 19,755 milliards, le reste, c'est à dire les 9,145 milliards,<br />
serait-il allé vers les autres ensembles AEF, Madagascar, Cameroun? La chose paraît,<br />
en soit, peu probable au regard de l'importance de l'AüF par rapport aux autres<br />
ensembles. La conclusion qui semblait ici s'imposer était que les objectifs du plan<br />
n'avaient pas été atteints intégralement.<br />
1. "Paris-Dakar" du 22 mars 1947<br />
354
Etudiants Africains, faute de place en 1954, c'étaient 2.800.000 enfants qui n'allaient pas<br />
à l'école en AOF. Pour la rédaction du journal, il ne pouvait pas en être autrement dans<br />
la mesure où seulement 208.538.000 F CFA soit 0,67 % du budget général de l'AOF<br />
étaient investis dans l'école. Le journal reconnaissait pourtant la faible progression du<br />
budget scolaire de l'année suivante, 1953, mais seulement pour un rapport de 0,98 % du<br />
budget au lieu de 0,67 % antérieur. Ces chiffres étaient donnés dans le message<br />
commun délivré par la FEANF et l'AGED, au 43 eme congrès de l'UNEF, en Avril 1953<br />
à Toulouse.<br />
"Présence Africaine,,6 indiquait, pour l'ensemble des TOM, les chiffres<br />
suivants pour la scolarisation:<br />
1946 1953<br />
11,6 % 19,16 %<br />
1954<br />
20,4 %<br />
1955<br />
22%<br />
Les auteurs de cet article avaient bien raison de parler de "misère de<br />
l'enseignement". Le journal donne, pour l'année 1952, les chiffres que voici pour les<br />
investissements en matière de constructions scolaires dans l'ensemble de la Fédération 7<br />
- budget fédéral: 205.538.000 F CFA<br />
- budgets des territoires: 3.505.051.000 F CFA<br />
- Plan FIDES: 725.000.000 F CFA<br />
La rédaction montrait qu'en réalité, le FIDES ne représentait qu'un faible<br />
élément dans cet investissement global.<br />
La délégation des enseignants d'AOF, dans son rapport à la conférence<br />
mondiale des enseignants tenue à Varsovie, en août 1957, indiquait que le taux de<br />
scolarisation dans le territoire n'était que de 10 %.<br />
Roland Colin donnait des chiffres différents dans sa thèse, à propos de la<br />
scolarisation au Sénégal:<br />
1948: 6 %<br />
1954: 15 %<br />
1957: 20 %<br />
L'intéressé insistait sur les efforts notoires faits par les autorités puisque en<br />
l'espace d'une décennie, le taux de scolarisation avait plus que triplé (6 % en 1948 et<br />
20% en 1957)8. Pour Roland Colin, en 1954, la population du Sénégal était de 2.092.000<br />
habitants. Les scolarisables se chiffraient à 313.920 enfants, 56.192 allaient à l'école et se<br />
répartissaient ainsi:<br />
6. "Présence Africaine", Décembre 1956-janvier 1957<br />
7. Ibidem, Oct-Nov 1957.<br />
8. R. Colin, pAlS.<br />
356
apport considére que « Le plan quinquennal de développement de l'enseignement<br />
primaire, établi en 1951, a été jusqu'à présent respecté [...] Une légère avance, pour<br />
1953/1954, avec la situation de 221 classes réalisées alors que 218 étaient prévues. »9<br />
L'inspection, par ailleurs déplorait la situation regrettable de ne pouvoir ouvrir aucun<br />
CP nouveau à la rentrée 1953/1954 dans la mesure où aucune classe de libre n'était<br />
disponible. A cette occasion, on escompterait 49 classes de CP, exactement comme à la<br />
rentrée 1952/1953. Cette situation était dépeinte, comme grave, par le rapport, dans la<br />
mesure où, à ce niveau, le retard était appréciable. Le plan prévoyait 66 classes de CPI<br />
et il n'yen avait que 49, soit 17 classes manquantes, c'est à dire 25 % des prévisions. Le<br />
chef de la circonscription scolaire regrettait d'autant plus cette situation, qu'à son avis, la<br />
population de Dakar ne cessait de croître et que certaines couches sociales prenaient<br />
davantage conscience de l'avenir de leurs enfants. Il s'inquiétait de l'afflux massif<br />
d'enfants de 6 à 8 ans à la rentrée suivante, situation devant laquelle il n'y aura, en fait,<br />
aucun remède.<br />
Se basant sur une étude démographique sommaire, le rapport prévoyait<br />
qu'en l'espace de 5 ans - durée du plan -, les élèves à recruter passeraient de 3400 en<br />
1952 à 6900 en 1956, terme du plan, c'est à dire en moyenne annuellement, un millier<br />
d'élèves supplémentaires. Pour l'inspecteur de la 4eme circonscription, logiquement, il<br />
faudrait disposer de 394 classes à la rentrée de 1955/1956, soit 208 classes nouvelles par<br />
rapport à 1951 c'est à dire 35 écoles de 6 classes chacune.<br />
En somme, par ces 2 rapports, la situation de l'école dans la ville apparaissait<br />
clairement au nombre d'écoles, de classes, d'élèves etc... Mais ces rapports étaient<br />
instructifs aussi sur la qualité même des infrastructures scolaires. En effet, le rapport de<br />
1948/1949 citait 6 écoles sur les 32 de la Circonscription scolaire, comme étant<br />
constituées de baraques provisoires dans lesquelles il faisait terriblement chaud les<br />
après-midi. Ces écoles se localisaient, toutes, dans le quartier indigène de la Médina. La<br />
source ajoutait, plus loin: « Les anciennes écoles de la ville sont vétustes et exiguës et ne<br />
répondent plus aux besoins actuels. Les plus belles écoles de la Médina et surtout Malick 5y<br />
ont besoin d'entretien (vitres, peinture, portes à refaire, magasins etc... » Parlant de la<br />
situation de l'école de la rue Thiong
examens:<br />
-entrée en 6 eme : 485 succès dont 196 Mricains<br />
-brevet: 148<br />
- 2 eme bac: 83<br />
Le journal "Horizons africains"11, organe de l'église catholique dakaroise,<br />
chiffrait pour l'enseignement privé au Sénégal:<br />
1951/1952 1954/55<br />
, , , , , , , , , , , , , , , , ,<br />
CEPE 134 """" 262<br />
""""""""<br />
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,<br />
Entrée en 6eme 105 103<br />
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,<br />
Brevet 56 38<br />
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,<br />
1er Bac 11 11<br />
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,<br />
2eme Bac 7 3<br />
, , , , , , , , , , , , , , , ,<br />
Total """"""" 313 """"'" 417<br />
Ces chiffres concernaient l'ensemble du Sénégal. Cependant, pour l'essentiel,<br />
Dakar où les infrastructures étaient dominantes, intervenait.<br />
Un autre journal catholique "Mrique Nouvelle"12, donnait pour l'année<br />
scolaire 1955, dans l'Archevêché de Dakar:<br />
- CEPE : 251 succès soit 153 garçons et 98 filles<br />
- entrée en 6 eme : 99 succès.<br />
Pour l'année scolaire 1955/1956, des chiffres plus complets sont donnés:<br />
- total des élèves de l'archevêché : 6463 dont 3570 garçons et 2893 filles13. A<br />
la fin de l'année scolaire, le journal 14 publiait les résultats aux examens du secondaire:<br />
avait:<br />
Bac série A = 1 Série B = 12 / Série philo = 13<br />
Pour l'année scolaire suivante (1956/57), au niveau du baccalauréat, il y<br />
CEPE : 212 garçons et 99 filles, total: 311<br />
entrée en 6 eme : 79 garçons et 79 filles soit 158<br />
Ces élèves provenaient d'un enseignement élémentaire qui comptait, à cette<br />
date, 7586 élèves.<br />
Au secondaire, cet enseignement comptait 486 garçons et 493 filles soit un<br />
total de 979.<br />
11. ml, Janvier-février 1953 et N'79 Juin-juillet 1955.<br />
12. N" du 28 février 1956.<br />
13. Ibidem<br />
14. "Afrique Nouvelle" du 6 novembre 1956<br />
360
ase minimale à atteipdre pour pouvoir exercer des responsabilités dans les<br />
organisations syndicales nouvellement autorisées aux colonisés. R.Colin cite une<br />
enquête, menée dans la capitale, et relève ces propos: « Un jeune instituteur de l'école de<br />
Médina nous disait un peu désabusé: "Quand l'élève franchit le seuil de l'école, tout ce qu'il<br />
a fait dans la journée est oublié, il entre dans un autre monde.»17<br />
Les renseignements, indiqués par le recensement démographique de 1955<br />
dans la ville, montraient que 53 % des enfants de fonctionnaires et commerçants allaient<br />
à l'école, contre 37 % chez les employés, 28 % chez les sans-profession, 23 % chez les<br />
ouvriers et 19 % chez les cultivateurs. Par rapport aux principales ethnies de la<br />
population de Dakar, ces scolarisés représentaient 35 % chez les Ouolofs, 45 % chez les<br />
Lébous, 26% chez les Séréres, 52 % chez les Casamançais, 31 % chez les Toucouleurs,<br />
28 % chez les Peuls, 56 % chez les Bambaras et 32% chez les Sarakollés 18 . A partir de<br />
ces deux éléments, profession des parents et groupe ethnique, une remarque s'impose :<br />
la majorité des enfants de Dakar n'allaient pas à l'école du colonisateur, la seule qui<br />
permettait d'accéder à l'emploi dans la fonction publique ou même dans le secteur privé<br />
moderne. Or, cette école chassait l'école coranique - indirectement, il est vrai - dans la<br />
mesure où le colonisateur mettait beaucoup d'embûches à la fréquentation de cette<br />
dernière qui, pourtant, se faisait dans la journée seulement après l'école française, dans<br />
les familles africaines. Ainsi, par exemple sous le prétexte que les enfants n'étaient pas<br />
suffisamment attentifs à l'école française, l'administration découragea la fréquentation<br />
de l'autre école. L'argument insidieusement avancé était qu'il y avait surcharge de<br />
travail pour ces enfants, qu'ils dormaient en arrivant à l'école française. Les parents<br />
devaient choisir s'ils voulaient que leurs enfants réussissent leurs études et accèdent aux<br />
diplômes coloniaux.<br />
Dans la circonscription scolaire de Dakar et banlieue, l'insuffisance notoire<br />
des infrastructures est rapportée par des sources administratives spécialisées, des<br />
organes de presse, des partis et mouvements d'étudiants et de jeunesse. Pourtant, de<br />
nombreux éléments attestent l'intérêt manifesté par la population : le rapport de la<br />
4 eme circonscription de 1949 le dit clairement, tout comme celui de 1953. Les longues<br />
queues devant les écoles dakaroises à la veille des inscriptions nouvelles traduisaient ce<br />
désir réel d'envoyer les enfants à l'école. On remarquait aussi que malgré les conditions<br />
peu dignes de certaines écoles, les parents persévéraient à y envoyer leurs enfants (cas<br />
de la rue de Thiong). Autre témoignage de l'intérêt de la population pour l'école: la<br />
création de l'association des parents d'élèves. Le geme congrès du SYNEP fixait cet<br />
objectif « Il faut que partout, soit organisée une association des parents d'élèves ou un<br />
comité de défense de l'école, que chaque militant du SYNEP aura à coeur d'aider» 19.<br />
17. Ibidem<br />
18. Ibidem<br />
19. "SYNEP-liaison", congrès de Saint-louis, août 1950<br />
362
demander d'agir rapidement, et sous les formes qu'ils jugeraient les meilleures, auprès<br />
des autorités de Dakar et de Paris, tant gouvernementales qu'universitaires, pour<br />
obtenir la réintégration de ces élèves de Rufisque. Parents d'élèves de la Délégation<br />
mais aussi du Sénégal et d'autres régions de la Fédération s'étaient joints à la<br />
protestation. Tout comme les journaux politiques et les organisations de jeunesse. La<br />
diversité de ces marques d'indignation et leur unanimité à exiger le retour immédiat des<br />
14 élèves-maîtresses et la cessation du climat de persécution dans cette école, avaient<br />
amené les autorités administratives à lever les sanctions en question et même à prendre<br />
diverses mesures pratiques en faveur de ces élèves. Le gouverneur du Sénégal<br />
s'engageait à faire réintégrer immédiatement les élèves en question, mais aussi à ce que<br />
ne figurât pas sur le dossier des intéressées, la moindre trace de cette sanction. Mieux,<br />
Colombani, chef du Territoire, prenait même des mesures concrètes pour que ces élèves<br />
ne soient pas victimes, lors du déroulement de leur examen de sortie, d'éventuelles<br />
manoeuvres rancunières de la part du personnel enseignant et administratif de<br />
l'établissement. Des enseignants africains probes furent associés au jury d'examen. Le<br />
Chef du Territoire s'engageait même - par écrit tout cela - à garantir l'emploi comme<br />
monitrices, dans la fonction publique, des élèves dans le cas éventuel d'un échec à leur<br />
examen. "L'Etudiant d'Afrique Noire,,22 tirait de tout ceci la conclusion qu'une grande<br />
victoire avait été remportée contre les autorités et dans le sens de la défense des intérêts<br />
des élèves.<br />
Autre exemple pour illustrer cette condition des élèves : le cas de la grève<br />
générale du lycée Van Vo de Dakar. "Dakar-Etudiant" écrivait à ce sujet: « Depuis un<br />
certain temps, ce lycée était le théâtre d'incidents malheureusement à sens unique, accablant<br />
exclusivement les élèves noirs internes des classes du premier cycle. »23 Le journal des<br />
étudiants de Dakar condamnait le malaise créé dans cet unique lycée d'enseignement<br />
général de la ville, le 16 février 1956. Pour le journal, 9 élèves avaient été renvoyés «<br />
pour n'avoir pas pris leur soupe qu'ils n'avaient pas pris à leur goût. » Devant<br />
l'intransigeance des autorités à maintenir leur décision, tous les élèves internes de<br />
l'établissement décidèrent une grève générale de la faim. Diverses manoeuvres<br />
d'intimidation furent développées contre les élèves. Le journal citait, à ce propos, des<br />
personnalités comme Léon Boissier Palun, président du Grand Conseil de l'AOF, le<br />
Recteur Directeur Général de l'enseignement, des parlementaires et homtnes politiques<br />
etc... La détermination des élèves amena l'autorité, en fin de compte, à faire marche<br />
arrière. L'organe des étudiants de Dakar tirait comme conclusion, que l'incident était<br />
banal et la dimension qui lui fut donnée par les autorités, grave. Le journal, en arrivant à<br />
une réflexion plus globale, se demandait si, en définitive, toute l'agitation dans les<br />
établissements scolaires et secondaires, n'était pas orchestrée en cette période politique<br />
22. N" spécial, Juin-sept 1956<br />
23. "Dakar-Etudiant", Mars 1956<br />
364
de mutations. Dès le mois suivant, le journal approfondissait son analyse sur le malaise<br />
en milieu scolaire dans l'espace de deux à trois mois écoulés, à Dakar. Sa conclusion<br />
était la suivante : « Ces milieux sont inquiets et désemparés par l'arbitraire : sanction<br />
disciplinaire, fantaisie sur les emplois du temps, réglements intérieurs, composition des<br />
conseils cie discipline, trousseau des élèves, bourses etc...»<br />
Un organe de la presse métropolitaine, "Marchés Tropicaux", s'intéressait<br />
aussi, de près, à cette situation dans les établissements scolaires : « Or, depuis quelques<br />
temps, un vent d'insubordination et même de révolte, passe une certaine rafale sur certains<br />
collèges africains: ConaJay, Libreville, Dahomey, Niamey etc... »24 Le journal des grands<br />
milieux d'affaires métropolitains s'étendait plus longuement sur la situation du lycée<br />
Maurice Delafosse. Ce lycée technique fédéral comptait 1520 élève. Il fut fermé le 5<br />
février 1959 pour plusieurs jours, à la suite d'une manifestation collective. D'après le<br />
journal, le point de départ était le refus collectif des élèves d'une classe de seconde<br />
commerciale d'assister à un cours d'anglais. La sanction prise contre les intéressés<br />
entraîna immédiatement la grève générale dès le lendemain. Tirant les enseignements<br />
de toute cette agitation dans plusieurs territoires de la fédération, le journal<br />
métropolitain s'exprimait dans ces termes : « Si les ministres africains n y mettent bon<br />
ordre, les maîtres refuseront d'enseigner en Afrique. Les élèves doivent changer de mentalité.<br />
Ils doivent se plier à la discipline rigoureuse et se voir interdire toute manifestation politique<br />
[. ..f Un pays où les collégiens commandent un gouvernement, est un pays voué à l'anarchie<br />
».<br />
"Marchés Tropicaux" demandait - directement - aux nouvelles autorités d'agir<br />
fermement contre les élèves du secondaire. Un de nos interlocuteurs insiste sur la<br />
répression policière dans ce lycée technique lors de la grève générale. Ceci n'était pas<br />
une nouveauté contre les élèves en grève. C'est ainsi qu'à Saint-louis, en février 1957, la<br />
police avait violemment chargé les élèves sur les rails, dans le quartier de Sor. La<br />
violence de la répression avait créé une véritable atmosphère d'émeute dans la ville. Les<br />
pêcheurs du quartier de Guet Ndar s'étaient particulièrement mobilisés en faveur des<br />
élèves 25 . Le chercheur Roger de Benoist qualifia "d'émeutes" les journées des 12 et 13<br />
février 1957, à Saint-louis. Le gouverneur général de l'AOF avait même cru devoir<br />
s'adresser à la population et aux élèves sur les ondes de Radio-Dakar. A l'égard des<br />
élèves, ses propos furent très durs : « La licence de votre conduite n'apparaît pas aux<br />
autres comme une manifestation de l'esprit révolutionnaire, mais au contraire comme une<br />
mesure de l'esprit conservateur... C'est seulement en servant qu'on acquiert le droit de<br />
commander »26. La dimension des manifestations de grèves dans les établissements de<br />
la Fédération avait conduit les ministres de l'Education des gouvernements de<br />
24. W612, 14 février 1959<br />
25. L'auteur de cette recherche fut blessé lors de cette action policière.<br />
26. "Afrique nouvelle" du 19 mars 1957<br />
365
l'autonomie, réunis à Conakry du 18 au 20 novembre 1957, à condamner les grèves<br />
qualifiées de "futiles" dans leurs revendications de nourriture, vêtements, bourses etc...<br />
Le journal parisien "Climats", parlant de grèves en AOF dans les<br />
établissements scolaires, avançait une explication tout autre : «Prenez 20 écoliers de<br />
brousse qui vivent dans leurs familles, misérables et nus. Rassemblez-les dans un internat<br />
moderne et neuf Logez-les, habillez-les, nourrissez-les au delà de leurs rêves les plus<br />
ambitieux. Quinze jours plus tard, ils se mettent en grève pour ne plus faire leur lit le matin<br />
ou réclamer de l'argent de poche. »27 Pour le journal des milieux de la droite colonialiste<br />
française, les élèves en Afrique Noire n'étaient pas lucides. Ils étaient égoïstes, mus par<br />
intérêts personnels et mesquins. Ils manquaient également de maturité, raison pour<br />
laquelle ils engageaient souvent des grèves fréquentes et sans fondement objectif. En<br />
somme, les établissements secondaires de la Fédération en général et de Dakar plus<br />
particulièrement, connurent une agitation très intense dans la période 1956-1960<br />
surtout.<br />
Mais la "grève pour la grève" n'était nullement l'objectif fondamental des<br />
élèves. Par ces manifestations, en fait, ils démontraient leur attachement à l'institution<br />
coloniale dans laquelle Ils fondaient beaucoup d'espoir. Cette espérance exigeait d'eux<br />
qu'ils défendent leurs intérêts légitimes. Peut-être que le contexte était particulier, dans<br />
la mesure où des responsabilités étaient déléguées par la puissance coloniale dans le<br />
cadre de la réforme de la Loi-Cadre, mais l'agitation scolaire n'avait nullement une base<br />
politique comme certaines sources tendaient à en faire accréditer la thèse. Ces élèves<br />
avaient des objectifs bien nobles.<br />
Paul Mercier, après des enquêtes effectuées dans plusieurs écoles primaires<br />
de la capitale fédérale faisait ressortir ces ambitions: « Entre 65 et 80 % se prononcent<br />
pour les professions intellectuelles (enseignement, professions libérales, avocats, médecins<br />
etc... »2 8. Mais entre ces souhaits et la réalité quotidienne des établissements, quel était<br />
le sort des élèves de Dakar?<br />
Le Secrétariat Social de Dakar apportait un élément de réponse dans sa<br />
réflexion relative à la question de l'emploi dans la capitale. Les renseignements obtenus<br />
auprès des maîtres et pour la fin du cycle élémentaire indiquaient que:<br />
- Dans une école publique de la Médina, sur 42 élèves sortis de 2 classes:<br />
24 élèves ont obtenu le CEPE et parmi ceux-ci :<br />
* 3 continuent leurs études au lycée technique<br />
* 3 au centre d'apprentissage<br />
* 1 au cours normal<br />
* 5 sont employés dans une imprimerie<br />
27. "Climats" du 7 mai 1952.<br />
28. Paul Mercier, Contribution à la sociologie... op. ciL, p.197<br />
366
* Tous les autres apprennent la dactylographie, occupent des emplois divers.<br />
Certains sont perdus de vue par leurs anciens maîtres.<br />
- Dans une école privée:<br />
39 reçus au CEPE sur 41 candidats:<br />
* 7 ont réussi à l'entrée en 6eme<br />
* 14 continuent leurs études dans un cours commercial privé<br />
* 1 est apprenti mécanicien<br />
* les autres sont perdus de vue.<br />
A travers ces données, quelques conclusions sont évidentes : la faiblesse<br />
notoire du nombre des enfants accédant aux lycées et collèges à la fin de ce cycle<br />
élémentaire. D'autre part, l'immense majorité perdue de vue, par les maîtres, signifiait,<br />
pour l'essentiel, des enfants dans la rue. Sinon, très probablement, les familles et les<br />
maîtres auraient gardé le minimum de contacts et ces derniers auraient su exactement<br />
ce que leurs élèves de l'année précédente, étaient devenus.<br />
La condition des élèves apparait, en définitive, dans toute sa précarité :<br />
conditions de travail difficiles, infrastructures insuffisantes mais aussi l'agitation presque<br />
permanente, débouchés incertains mais surtout échecs massifs; tout cela, en réalité,<br />
répondait à une logique de système colonial.<br />
3) Subventions et enseignement privé<br />
Cette question fut un centre d'intérêt pour des syndicats d'enseignants,<br />
associations de parents d'élèves, de jeunesse, d'étudiants, de personnalités etc... Elle<br />
était donc bien présente dans le débat autour des questions sociales dans la ville. Par<br />
exemple, le congrès du SUEL de 1956, dans son rapport moral, disait à ce sujet: «Point<br />
premier de notre plate-fonne revendicative : "la suppression de toutes les subventions aux<br />
écoles privées f. ..] la position de principe des enseignants: "pas un centime aux écoles<br />
privées" ». Deux ans plus tard, dans une résolution votée par son congrès de juillet 1958,<br />
le SUEL regrettait vivement que la quasi totalité des crédits destinés aux oeuvres<br />
privées, aille aux écoles privées confessionnelles. Le congrès s'élevait aussi contre la<br />
répartition irrationnelle des crédits alloués par le FIDES. La situation des maîtres du<br />
privé laïc était jugée difficile à cause de l'insuffisance des moyens financiers. Le rapport<br />
demandait en conséquence que ces écoles ne soient pas privées de ces crédits alors que<br />
les écoles privées confessionnelles en recevaient largement.<br />
Cette position de principe et ses appréciations n'étaient pas chose nouvelle<br />
dans les milieux syndicaux enseignants de Dakar et du Sénégal. En effet, en août 1950,<br />
déjà, les enseignants de Sénégal-Mauritanie, dans leur rapport de congrès, faisaient état<br />
d'un ordre du jour voté par le bureau du SYNEP et demandant à l'Assemblée<br />
367
Territoriale du Sénégal de n'accorder aucune subvention aux congrégations et de se<br />
pencher avec une plus grande sollicitude sur l'école publique devenue indigente.<br />
Le rapport au congrès notait que malgré la motion de protestation, mais<br />
aussi le rejet de la demande de 125 millions de F CFA de subvention, par l'Assemblée<br />
Territoriale, par le biais de la subvention du FIDES, l'Eglise avait obtenu entière<br />
satisfaction. Tout ceci faisait dire au rapport que les adversaires de l'école laïque ne<br />
désarmaient pas et qu'il était impératif de mener conséquemment le combat contre les<br />
saboteurs de l'école de tous. Plus de 8 ans après la réaffirmation de ces principes, les<br />
enseignants de l'école publique du Territoire, réunis en congrès à Thiès, exigeaient que<br />
la répartition des crédits alloués aux territoires par le FIDES soit entièrement laissée à<br />
la discrétion de ces territoires en toute souveraineté. C'est dire que jusqu'à la veille de<br />
l'indépendance, la question restait une préoccupation des enseignants parce que les<br />
subventions continuaient à s'orienter massivement vers les congrégations comme le<br />
confirme "Marchés Tropicaux" en 1959 : « Les missions religieuses et oeuvres privées<br />
bénéficieront, au titre du fond d'aide et de coopération - nouvelle appellation du FIDES· de<br />
75 millions de subventions dont 52, en première urgence. Ces sommes serviront à bâtir,<br />
notamment 76 classes primaires, 5 dispensaires, 2 maternités, 2 foyers ruraux et à achever le<br />
cours normal catholique de Thiès. »29<br />
Autre protestation contre les crédits alloués à l'enseignement privé: celle du<br />
Conseil de la Jeunesse du Sénégal, demandant que cesse l'affectation massive de crédits<br />
au privé lorsque l'enseignement public était laissé pour compte. Le texte, adopté par le<br />
congrès du c.J.S de juillet 1955, exigeait que la primauté absolue, en matière de crédits,<br />
soit accordée à l'enseignement public. Le Congrès de la Jeunesse du Sénégal concluait,<br />
après une longue analyse, que l'école en AOF était victime d'une politique de sabotage<br />
systématique avec sa masse globale de 1,79 % des crédits du budget fédéral pendant que<br />
6,32 % de ce même budget allaient aux forces de répression. Autre dénonciation des<br />
subventions : le congrès des Femmes de l'Ouest Africain, réuni à Bamako, demandait<br />
que les subventions cessent d'aller à l'école privée pour que tous les fonds soient<br />
exclusivement consacrés à l'école de tous.<br />
Notons aussi que cette bataille pour la suppression des subventions aux<br />
écoles des congrégations à Dakar et ailleurs dans la Fédération n'était pas, une initiative<br />
nouvelle dans la capitale fédérale. Avant même la fin de la seconde guerre mondiale,<br />
elle avait laissé des marques indélébiles. En effet, la conférence de l'enseignement,<br />
réunie à Dakar au milieu de 1944, en présence de Delage, Inspecteur-Conseil près du<br />
Commissaire des Colonies à Alger, avait voté un certain nombre de voeux en direction<br />
des autorités gouvernementales de la France Combattante. Le premier de ceux-ci<br />
recommandait que le monopole de l'enseignement en Afrique Noire Française, soit<br />
29. "Marchés Tropicaux" m16, 1er août 1959.<br />
36-8
confié à l'Etat. Le deuxième voeu demandait que la réglementation de l'enseignement,<br />
en vigueur à la date du 16 juin 1940, soit rétablie.<br />
Ces voeux n'avaient pas plu à l'Eglise dakaroise que l'un des hauts<br />
responsables qualifiait de "fondées sur le mensonge". Ils devaient être transmis à Alger<br />
comme documents officiels. Contre ces voeux, s'était violemment et publiquement élevé<br />
le Père Bertho, responsable supérieur de l'enseignement catholique en AOF. Très amer<br />
à l'égard de ces voeux, l'intéressé considérait que le journal "Réveil" n'avait pas été<br />
étranger à cette orchestration. Selon lui, ce deuxième voeu, adopté par la conférence de<br />
Dakar, ressemblait comme une goutte d'eau, au texte que ce journal avait publié bien<br />
avant la conférence 30 . Avec force l'Eglise s'était jetée dans la bataille pour préserver<br />
ses positions incontestablement menacées par une éventuelle adoption de ces voeux. Le<br />
Père Bertho adressait en conséquence à l'inspecteur Cros de l'enseignement du Sénégal,<br />
une longue lettre polémique le journal "Côte d'Ivoire Chrétienne" publiait. C'était<br />
même, au sujet de cette question des voeux sur l'enseignement, que naquit le projet de<br />
l'Eglise Dakaroise, d'avoir son journal pour publier ses positions. La création d"'Afrique<br />
nouvelle", trois ans plus tard, matérialisait le projet. En 1951, cette question des<br />
subventions occupait une place nouvelle sur la scène locale. Dans la nuit du 14 au 15<br />
décembre, une grande affiche fut placardée dans la ville. "Afrique Nouvelle" ne se<br />
contentait pas de qualifier ceci de « Nouvelle campagne de mensonges contre<br />
l'enseignement privé en AOF »31. Il annonçait qu'une plainte avait été déposée auprès<br />
des autorités judiciaires. Pour le journal catholique, le vrai responsable de cette<br />
campagne était« Un inspecteur primaire du Sénégal dont nous tairons le nom. » Le procès<br />
eut lieu. La hiérarchie s'estimait heureuse du jugement qui condamnait le syndicat de<br />
l'enseignement laïc à 1 F symbolique et à la publication du verdict dans 5 journaux<br />
différents, à ses frais. On le voit, la question des subventions à l'enseignement privé<br />
restait au centre d'une grande controverse dans toute la période 1945-1960.<br />
Cette question avait aussi un rapport plus ou moins direct avec le fait que<br />
l'Eglise formait à part ses maîtres avec la création de son école de moniteurs à Ngazobil<br />
dès 1949 et de son école d'instituteurs, dix ans plus tard, à Thiès. Or, ces promotions<br />
d'enseignants, par la nature des engagements souscrits auprès de l'Eglise restaient à<br />
l'écart du mouvement syndical laïc, dans leur quasi totalité.<br />
De plus, beaucoup de gens percevaient cette école privée catholique de<br />
Dakar comme l'école d'une minorité de nantis et de favorisés par le système colonial. A<br />
ceci s'ajoutait, une réelle conscience du fait indubitable que l'école publique était<br />
misérable. Certainement aussi à travers cette question des subventions à l'école,<br />
apparaissait un aspect non exprimé: des relents de conflits religieux; l'école de la masse<br />
était l'école publique donc l'école négligée par les pouvoirs publics, par opposition à<br />
30. "Réveil" du 26 mai 1944, 5éme page, 3eme colonne.<br />
31. "Afrique nouvelle" du 22 décembre 1951<br />
369
l'école de la minorité, favorisée dans la répartition des crédits. Cette école était<br />
essentiellement chrétienne. On notait en tout cas qu'à travers cette question des<br />
subventions, la toute puissance de l'Eglise locale apparaissait évidente.<br />
4) Conditions de travail des maîtres<br />
Dans l'ensemble, elles n'étaient pas bonnes surtout pour le personnel<br />
indigène. Diverses sources permettent de l'affirmer.<br />
Faisant l'analyse de la situation, le rapport introductif au congrès des<br />
enseignants du syndicat de l'enseignement primaire, écrit: « Nos revendications sabotées<br />
stagnent dans les bureaux et garnissent leurs hécatombes paperassières... L'opposition du<br />
gouvernement fédéral aux revendications des fonctionnaires s'intégre dans la politique du<br />
gouvernement français. » Dans la partie du rapport intitulée "Revendications générales",<br />
la question du logement est évoquée en premier lieu: «Aucune solution n'a été apportée<br />
à cette revendication intéressant l'ensemble de la Fédération. Le personnel enseignant<br />
continue à être mal logé. » Sur les questions pédagogiques, ce congrès de Saint-louis<br />
regrettait l'application brutale des programmes et diplômes métropolitains en AOF sans<br />
qu'une transition ait été prévue, ce qui avait des conséquences néfastes tant sur les<br />
élèves que sur les maîtres. Certes c'était le syndicat SYNEP, le leur, qui, depuis<br />
longtemps, avait revendiqué cela, mais la période transitoire sur laquelle il avait insisté,<br />
n'avait pas été retenue comme solution par l'administration. Or ceci représentait une<br />
condition sine qua non du succès de la réforme. Plus loin, le rapport dénonce les<br />
mesures arbitraires ayant frappé les enseignants de la 4 eme circonscription scolaire<br />
(celle de Dakar), mutés pour des raisons extra-professionnelles. Ces victimes étant,<br />
comme instituteurs, irréprochables d'après le rapport. Cette partie du rapport reproche<br />
vivement à l'administration coloniale de ne pas respecter la liberté d'opinion des<br />
enseignants africains et d'utiliser contre eux les mutations arbitraires et constantes.<br />
Autre preuve : au congrès des enseignants d'AOF, à Bamako, en 1954, la<br />
délégation du Sénégal rapporte qu'en 1947, l'administration avait été principalement,<br />
responsable de la division des enseignants sur une base raciale. Par ses manoeuvres, elle<br />
avait réussi à soustraire tous les Européens du syndicat unique, ce qui favorisait un<br />
climat de suspicion et de méfiance entre les enseignants. Par suite de cette situation, la<br />
période 1947-1950 avait été marquée par d'énormes difficultés pour les enseignants<br />
autochtones. Un constat est fait par le congrès de 1950 : « Ces années attestèrent une<br />
température basse de la force de notre syndicat J...] et nos revendications étudiées par nos<br />
chefs avec le plus grand mépris. » Le rapport note comme une preuve de cette situation,<br />
l'échec lamentable de la grève des enseignants de la Délégation, pour s'opposer à la<br />
370
mutation arbitraire de Thierno Bâ, instituteur de C M 2 à Yoff, déplacé à Ziguinchor 3 2.<br />
Les raisons de cet échec situaient certes les responsabilités propres aux enseignants dans<br />
l'insuffisance de la préparation de la grève, mais surtout les manoeuvres d'intimidation,<br />
de toutes sortes, entreprises par l'administration coloniale pour amener beaucoup<br />
d'enseignants à ne pas s'associer au mouvement.<br />
Sous les autorités de la Loi-Cadre, la réalité fut pratiquement la même que<br />
sous celles de la colonisation quant à la situation des enseignants. En effet, leur organe<br />
SUEL-liaison écrit: «Les mesures abusives auxquelles se livre le gouvernement du Sénégal<br />
contre les enseignants, viennent d'atteindre, par décision en date du 2/2/1960 quatre<br />
professeurs africains de Saint-louis, tous militants du SUEL. »33 Ces professeurs avaient<br />
été révoqués. Le bulletin de liaison des enseignants africains publiait aussi une lettre des<br />
enseignants de Dakar au ministre de l'Education. Cette lettre faisait part du trouble<br />
profond suscité par la mesure en question chez les enseignants en tant que<br />
fonctionnaires, mais aussi en tant que citoyens. Toujours sur cette condition des<br />
enseignants africains, Mamadou Dia, ancien instituteur et plus tard président du<br />
Conseil, écrit: « Les médecins africains, eux, avaient une situation meilleure que celle des<br />
instituteurs qui étaient socialement les parias. Notre état de parias expliquait notre<br />
révolte.» 3 4 Un autre instituteur, très connu dans le monde des lettres et des arts,<br />
. Abdoulaye Sadji témoigne sur la condition des enseignants en écrivant : « L'instituteur<br />
indigène n'a aucun prestige dans son milieu. A la ville, il fait piètre figure» 3 5. Il dénonçait<br />
ainsi les salaires misérables payés aux enseignants.<br />
Les sources administratives, aussi, témoignent dans le sens de cette situation<br />
mauvaise de la condition enseignante. Le rapport de l'inspecteur de la 4eme catégorie<br />
administrative du Sénégal, en 1948/1949 note: « La question du logement est loin d'être<br />
satisfaisante. Nombre de logements obtenus de la Délégation du Sénégal, du gouvernement<br />
général et de la mairie de Dakar = 14, ce qui porte à 23 le nombre de logés parmi les<br />
instituteurs sur les 150 maîtres en service à Dakar et Médina. »<br />
A peine 16 % des maîtres africains de Dakar étaient logés par<br />
l'administration. Pendant ce temps, la totalité des maîtres européens étaient, eux, logés.<br />
Les 84 % devaient, d'eux-mêmes, trouver un logement dans ce contexte de crise et de<br />
cherté des loyers. Au sujet de la qualification professionnelle des maîtres, le congrès des<br />
enseignants d'AOF, réuni à Bamako, dénonçait l'administration dans sa pratique<br />
européen très instable, (souligné en rouge dans le rapport) et africain très médiocre dans<br />
l'ensemble, à des suppléants mal rémunérés, pour assurer la garde des enfants. Cette<br />
situation compromet gravement les résultats scolaires. »36<br />
Sur le personnel enseignant européen, diverses sources indiquent la<br />
"progression" qui lui était assurée dans la colonie. Les instituteurs étaient bombardés<br />
professeurs, les professeurs de lycée, professeur d'université etc...Les étudiants de<br />
l'Institut des Hautes Etudes, dans leur lettre au gouverneur général de l'AOF - laquelle<br />
lettre avait suscité de violentes réponses des académies de Bordeaux et de Paris - s'en<br />
plaignaient. P. Mercier, dans ses enquêtes sur le groupement européen de Dakar et P.<br />
Biarnès, dans son étude sur les "Français en Afrique noire", arrivent, eux aussi, aux<br />
mêmes conclusions sur la qualité du personnel enseignant européen: la médiocrité.<br />
En rapport avec cette condition des maîtres, il faut noter une question<br />
préoccupante à Dakar: à savoir comment ils étaient encadrés au plan administratif. A<br />
travers le syndicalisme enseignant, cette question des maîtres était nettement posée. Le<br />
2 eme congrès du SUEL, réuni à Saint-louis en août 1955, adoptait, entre autres<br />
résolutions, celle-ci qui exigeait le départ de la Fédération, du chef de la circonscription<br />
scolaire de Dakar. Le congrès considérant « L'importance de la circonscription et la<br />
nécessité d'avoir à sa tête un inspecteur alliant de solides qualités professionnel/es et morales<br />
à un sens aigu de l'équité et un respect de la personne des enseignants [. ..J demande le<br />
départ de Condette de la Fédération qui n'a que faire d'un chefdont les agissements revêtent<br />
un racisme inadmissible. » Le congrès assurait les enseignants de la Délégation de sa<br />
solidarité effective dans les actions qu'ils seraient amenés à entreprendre, pour le<br />
triomphe de cette revendication. Cinq ans auparavant, le SYNEP en congrès expliquait<br />
la création de ce syndicat par « la nécessité de combattre l'opportunisme et le favoritisme<br />
basé sur la coloration de l'épidenne. »<br />
Ces éléments montrent bien que l'administration scolaire, dakaroise en<br />
particulier, était loin d'assurer une paix sociale en milieu enseignant. Si l'on ajoute à<br />
cela les conditions matérielles difficiles et l'insuffisance de la qualification, on<br />
comprend, dès lors, facilement la position de combat prise par les enseignants pour<br />
défendre leurs revendications légitimes, négligées par l'administration. Cet ordre de<br />
bataille, réaffirmé par le congrès du SUEL réuni à Mbour du 5 au 7 octobre 1956 «<br />
Notre dernier congrès avait été unanime à reconnaître la nécessité, cette année, d'user de<br />
nouveaux moyens pour la satisfaction des revendications que nous présentons d'année en<br />
année et que nous répétons, comme une ritournelle dans nos motions et résolutions )),<br />
traduit bien un véritable ras le bol des enseignants : aucune de leurs multiples<br />
revendications ne trouvait satisfaction. Preuve aussi de cette précarité de la situation en<br />
milieu enseignant indigène. Cette précarité n'avait certainement pas été étrangère à<br />
36. Affaires politiques AOF, AN.S, 2049-127,1949.<br />
372
l'engagement de bon nombre d'enseignants africains dans les luttes politiques de<br />
l'époque. Cet engagement était, dans une large mesure, à l'origine de la prise en charge<br />
des problèmes de l'école, par les organisations politiques. Ainsi, le rapport moral,<br />
soumis aux congressistes du SUEL réunis à Mbour, en 1956, réserve un chapitre spécial<br />
"Enseignants et les partis politiques" à la question : « Il suffit de prendre les différentes<br />
professions de foi présentées par les candidats aux élections législatives du 2 janvier 1956<br />
pour reconnaître la part que les partis réservent à l'école dans leurprogramme. )) Le rapport<br />
recommandait aux délégués d'élever la voix pour exiger, des élus, qu'ils étudient les<br />
propositions faites par les enseignants et que, de manière conséquente, ils les défendent<br />
effectivement.<br />
En fait, malgré toute cette agitation et ces actions, pourquoi l'administration<br />
coloniale avait-elle accordé, si peu d'attention, à la condition de l'enseignant indigène?<br />
Pour diverses raisons:<br />
- les moyens en direction de l'école publique étaient faibles comme des<br />
investissements dans le secteur scolaire école le prouvaient. L'école des congrégations,<br />
par l'intermédiaire des subventions, était prise en considération, plus que l'école<br />
publique.<br />
- Une certaine inefficacité de l'action syndicale n'était pas à écarter dans la<br />
mesure où les querelles de personnes n'étaient pas absentes au niveau de la directioJ}<br />
des organisations syndicales enseignantes, elles-mêmes. Ces failles ci constituaient un<br />
point d'appui solide pour l'administration coloniale.<br />
- Une certaine ambiguïté dans cette situation mêlant politique et<br />
syndicalisme (par leur formation, les enseignants étaient de hauts responsables dans les<br />
partis politiques) permettait à l'administration de frapper, à n'importe quel moment,<br />
sans qu'il soit possible de savoir si, à travers la personne, c'était l'homme politique qui<br />
était visé ou le syndicaliste. Ces circonstances constituaient une situation difficile pour<br />
cerner correctement le champ même dans lequel il fallait organiser la riposte adéquate.<br />
- Lorsqu'avec le gouvernement de l'autonomie interne, beaucoup de cadres<br />
syndicaux enseignants étaient devenus cadres gouvernementaux ou hauts responsables<br />
dans l'appareil administratif, les enseignants avaient pu nourrir quelques espoirs<br />
d'amélioration de leur condition. Cependant, la continuité coloniale étant la règle dans<br />
cette période; dans la réalité, presque rien de positif ne put être enregistré dans<br />
l'amélioration de la condition même des enseignants. La permanence des mêmes<br />
revendications l'atteste.<br />
373
5) L'orientation de l'enseignement<br />
Cette question d'importance capitale n'eut pas dans le contexte dakarois,<br />
l'attention qu'elle méritait. Tout juste de manière subsidiaire, elle apparait surtout dans<br />
la presse.<br />
Exemple, le 5 février 1949, le président Tascher, à la réception offerte au<br />
ministre de la FOM, Paul Coste Floret, avait suscité une protestation des élus présents,<br />
manifestée par la publication d'un communiqué de presse 3 7. Contre cette<br />
manifestation, "Marchés Coloniaux" estimait que « le président de la Chambre de<br />
commerce avait dit tout haut, ce que beaucoup pensaient tout bas. »38 "Condition<br />
Humaine", organe du BDS de L.S Senghor, titrait, au sujet de ce discours : « Tascher<br />
contre l'Union Française". La rédaction écrivait « Tascher, président de la Chambre de<br />
commerce a grossièrement offensé les élus d'Afrique Noire en étalant, sans vergogne, sa<br />
hargne de colonialiste. » 39 . Le texte, publié par cet organe de presse, de la protestation<br />
des parlementaires parlait seulement de « termes discourtois, de critiques qu'ils jugent<br />
absolument déplacées à l'égard des grandes réformes constitutionnelles. » De quoi<br />
s'agissait-il exactement? Le président de la Chambre Consulaire exprimait les voeux des<br />
grands milieux d'affaires de voir s'engager une réforme de l'enseignement, de manière à<br />
donner à ces milieux d'affaires les cadres nécessaires à leurs besoins. Ces cadres<br />
n'étaient, pour la Chambre, que de niveau très faible: cultivateurs, maçons, menuisiers,<br />
forgerons, électriciens etc... Elle dénonçait aussi l'association des maîtres et élèves à la<br />
préparation et à l'exécution des programmes. En somme, la Chambre demandait toute<br />
une réorientation de l'enseignement technique sur d'autres bases. Ce point de vue <br />
malgré la protestation des parlementaires africains - était immédiatement pris en<br />
considération par l'administration. En effet, la Chambre de Commerce de Dakar<br />
recevait, du Recteur, Directeur Général de l'enseignement, une invitation pour une<br />
commission de travail, sur l'orientation à donner à l'enseignement technique 40 . Elles<br />
s'empressait de répondre favorablement et désignait un représentant dans ce groupe de<br />
travail.<br />
S'agissait-il d'une simple coïncidence entre cette initiative du chef de<br />
l'enseignement en AüF et ce discours du président de la Chambre de Commerce ?<br />
Difficile de retenir l'idée d'une simple coïncidence. Plutôt, la direction générale de<br />
l'enseignement se faisant l'exécutant fidèle des desiderata des milieux économiques, sur<br />
les problèmes de l'orientation de l'enseignement. Pourtant les hommes politiques<br />
présents à la réception avaient compté bénéficier de l'appui du ministre de la FOM. Ce<br />
37. "Condition Humaine" du 8 février 1949<br />
38. "Marchés Coloniaux" du 5 Mars 1949<br />
39. "Condition Humaine" du 8 février 1949<br />
40. "Marché Coloniaux" du 26 mars 1949<br />
374
l'administration appelle les professions de luxe pour l'Afrique. »44 Certes, le 28 octobre<br />
1958, la commission permanente du Grand Conseil de l'AOF votait un crédit d'aide<br />
pour le cinéma. Mais le montant était dérisoire - 5 millions de F CFA - pour qu'on<br />
puisse parler d'une action concrète et conséquente en direction du cinéma. De plus,<br />
c'était la première fois que ces crédits étaient votés dans le budget fédéral. Aucune<br />
production locale n'existait. Les salles d'AOF étaient alimentées essentiellement par des<br />
films en provenance de la métropole mais aussi des Etats-Unis, de l'Inde et de l'Egypte.<br />
Ces films s'articulaient, dans leur contenu, sur la violence, le sexe, le rêve etc... Du<br />
reste, divers milieux en Afrique dénonçaient leur médiocrité et leur caractère nocif.<br />
Ainsi, les évêques catholiques du Soudan et de Haute Volta, dans une lettre du 1 er mars<br />
1954, à l'adresse du chef de la Fédération, remarquaient que les films en AOF étaient «<br />
des films licencieux ». Pour eux, si les choses continuaient à aller ainsi, le rôle de l'Eglise,<br />
en AOF, deviendrait plus difficile notamment dans son action d'éducation des<br />
populations 45 . Mamadou Sarr, président du ciné-club des étudiants d'outre-mer, à<br />
Paris, au nom de son organisation, publiait un communiqué de presse dénonçant l'aspect<br />
dominant du cinéma en Afrique Noire: le porno, le western et la violence. Le sénateur<br />
Ouezzin Coulibaly élevait la voix contre ce cinéma assimilé à «l'apothéose des caids ».<br />
C'était en présence du ministre de la FOM, à l'occasion de l'inauguration du lycée de<br />
Cocody à Abidjan.<br />
Quelques éléments d'appréciation de la qualité de ce cinéma en Afrique<br />
Noire apparaissaient dans les objectifs et les activités de l'A.S.S.E.A ( Association<br />
Sénégalaise pour la Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence). Cette association,<br />
créée à Dakar, conformément à la loi de 1901 régissant les associations, avait un<br />
caractère strictement privé. Le Rotary Club de Dakar avait été à l'origine de sa<br />
gestation 4 6. Plusieurs personnalités dakaroises en étaient membres. L'association<br />
s'activait, entre autre, contre la mauvaise qualité des films programmés à Dakar.<br />
Le journal "Jeunesse d'Afrique", organe des étudiants catholiques de l'Institut<br />
des Hautes Etudes de Dakar, titrait "Alerte au cinéma". L'organe indique qu'il y avait<br />
une vingtaine de salles de cinéma à Dakar et que chaque soir, des milliers de spectateurs<br />
s'y pressaient. Rapportant les résultats d'une enquête menée dans les salles de cinéma<br />
de la Médina, le journal nous apprend que certains spectateurs fréquentaient 3 fois en<br />
moyenne dans la semaine ces salles et que d'autres y étaient plus réguliers. Dans<br />
chacune des salles, une vingtaine d'enfants se retrouvaient chaque soir. Le caractère<br />
nocif de cette fréquentation par des enfants était illustré par des résultats d'enquêtes<br />
auprès de la justice. Il en ressortait qu'en 1956, dans la ville, une trentaine d'enfants<br />
44. "Présence Africaine", Avril-Mai 1957<br />
45. Roger de Benoîst, l'Afrique Occidentale francaise, op. ciL,<br />
46. "Afrique Nouvelle", 27 juin 1958<br />
376
en décembre 1988 sous le titre de "Camp de thiaroye". Toujours à ce sujet,<br />
l'administration coloniale mit en oeuvre tous les moyens pour oublier ce massacre. Le<br />
journal "Réveil" parlait de l'impressionnante mobilisation de la police et de la<br />
gendarmerie dakaroises, en février 1950, pour empêcher la cérémonie organisée au<br />
cimetière de Thiaroye, par les Partisans de la Paix.<br />
Nos interlocuteurs Abdoul Maham Bâ et Youssou, tout comme Thierno Bâ<br />
insistent sur ces affrontements violents entre les forces de sécurité et les jeunes du C.J.S,<br />
chaque fois que ces derniers cherchaient à commémorer ce souvenir de Thiaroye.<br />
L'arrêté du gouverneur général interdisant aux fonctionnaires d'écrire dans la<br />
presse - sans autorisation - ressortit également à cette forme à peine voilée de<br />
censure 51 .<br />
L'insuffisance notoire de salles pouvant abriter des conférences et autres<br />
débats, relevait aussi d'une certaine politique visant à marginaliser toute possibilité de<br />
contestation publique réelle. La construction par l'église dakaroise, de la salle Daniel<br />
Brottier (500 places) en 1957 - seulement - vint certes pallier cette faiblesse. Cependant<br />
cette salle située juste, en face et à deux pas du Commissariat Central de Dakar, ne<br />
pouvait recevoir qu'une certaine forme d'expression durant la période. Ceci, malgré ce<br />
qu'en dit le Père Roger de Benoist insistant sur le fait que la parole était donnée à tout<br />
le monde dans cette salle, même les marxisants. Pour la jeunesse, l'absence de Maison<br />
de Jeunes à Dakar pendant longtemps ne peut pas être interprétée autrement que<br />
comme une certaine forme de limitation de ses activités culturelles. Surtout que les<br />
travaux de cette Maison des Jeunes traînèrent en longueur pour des raisons qui ne<br />
pouvaient être "qu'administratives et colonialistes".<br />
La question des échanges extérieurs restait handicapée par le problème de la<br />
délivrance des passeports. En cela, le C.J.S eut à payer lourdement un tribut à son<br />
activité non conformiste. Le refus des subventions relevait dela même politique. Bref,<br />
les problèmes culturels souffraient d'entraves multiples pendant la période, alors que<br />
l'école était manifestement à la traîne.<br />
51. Voir liberté de presse.<br />
378
CHAPITRE VI : LA CONDITION DE LA FEMME DAKAROISE<br />
Telle qu'elle se dégage des renseignements sur l'école, l'emploi, mais aussi la<br />
vie quotidienne, elle était difficile dans l'ensemble. Mais, il n'en était pas ainsi pour<br />
toutes les couches de la population.<br />
Il A TRAVERS LES TEXTES<br />
La population dakaroise était considérée comme citoyenne depuis l'érection<br />
de la ville en commune de plein exercice. Mais pour l'élément indigène de la<br />
population, comment se présentait cette situation de manière concréte ?<br />
Dès 1945, une question fondamentale se posa avec acuité: celle de savoir si<br />
les femmes indigènes auraient, ou pas, le droit de vote reconnu aux femmes<br />
métropolitaines, au sortir de la guerre. Le décret du 19 février 1945 portait adaptation à<br />
l'AOF et au Togo de certaines dispositions de l'ordonnance du 21 avril 1944 sur<br />
l'organisation des pouvoirs publics, en France après la Libération. L'article 4 de ce<br />
décret stipulait : « Seront inscrites sur les listes électorales de leur résidence coloniale, les<br />
citoyennes françaises qui auraient pu prétendre, à leur inscription, sur la liste électorale de la<br />
métropole ou de l'un des territoires ». Le texte excluait, donc, de son champ d'application<br />
les femmes sénégalaises citoyennes des communes de plein. exercice parce qu'elles<br />
n'étaient ni en métropole ni dans l'un de ses territoires. Le Sénégal était encore au<br />
statut de colonie à cette date.<br />
Si l'on appliquait ce texte, même en cas d'élections municipales organisées<br />
dans ces communes de plein exercice, les Françaises d'origine métropolitaine résidant<br />
dans les villes de Dakar, Rufisque, Gorée et Saint-louis avaient entière possibilité de<br />
voter. Mais les citoyennes françaises originaires de ces villes n'auraient pas, elles, cette<br />
possibilité de voter pour désigner les responsables des communes où elles étaient nées<br />
et vivaient.<br />
Cette réglementation créait ainsi, deux catégories distinctes de Françaises.<br />
Cette situation parut très vite paradoxale. Elle fut ressentie immédiatement, dans les<br />
communes de plein exercice, notamment à Dakar, comme un véritable affront. La<br />
réaction ne se fit pas attendre. Lamine Guèye indique qu'elle donna naissance à<br />
l'organisation immédiate de meetings de protestations pour dénoncer l'iniquité « Ceci<br />
dans une atmosphère de colère et de nervosité indescriptibles. »1 Au coeur même de la<br />
contestation, l'avocat dakarois conduisit une délégation de personnalités locales pour<br />
transmettre, au Chef de la Fédération, les protestations indignées de la population. Dès<br />
1. Lamine Guèye, Itinéraire africain, p.I25<br />
379
la sortie de l'audience avec le gouverneur général, Lamine Guèye reçut mandat des<br />
membres de la délégation pour adresser, au Palais de Dakar, une lettre dans laquelle les<br />
arguments développés à l'adresse du gouverneur général étaient intégralement repris.<br />
L'intention était de disposer ainsi d'un document écrit dont l'importance pouvait être<br />
capitale ultérieurement. Dans cette lettre en date du 1 er mars 1945, l'avocat dakarois<br />
écrit : «Au cours de notre entretien de ce matin, je n'ai pas manqué de souligner l'injustice<br />
et le caractère vexatoire à notre endroit, d'une telle mesure [...] C'est frapper les Sénégalais<br />
d'une humiliation aussi injustifiée qu'exorbitante du droit commun, en régime<br />
démocratique. J'ai la certitude absolue qu'il n y a pas dix Sénégalais dans toute la colonie<br />
pour admettre une telle monstruosité. »<br />
Un mois après cette audience et cette lettre, rien n'était encore fait pour<br />
corriger les effets de la mesure. Me Lamine Guèye prit l'avion pour Paris afin de<br />
s'adresser directement au ministre des Colonies, car la situation locale commençait à<br />
devenir explosive. De retour à Dakar où il rendit compte de sa démarche à Paris,<br />
Lamine Guèye rapporte la joie des populations des quatre communes, à l'annonce que<br />
la rue Oudinot reconsidérait favorablement la revendication des autochtones. En tout<br />
cas, le 30 mai 1945, un nouveau décret était rendu public. Il abrogeait l'article 4<br />
précédent qui avait été à l'origine de la fronde au Sénégal. Le nouvel article était ainsi<br />
rédigé : « Les femmes citoyennes françaises sont électrices dans les mêmes conditions que<br />
les citoyens français. » Une injustice avait donc été réparée. Les femmes des communes<br />
de plein exercice du Sénégal retrouvaient exactement les mêmes droits que leurs<br />
homologues de la métropole. Lamine Guèye avait joué un rôle déterminant dans la<br />
modification de cette réglementation portant haut une revendication populaire. Il avait<br />
contribué à l'éclairer sous ses aspects juridiques. Son audience personnelle n'en fut que<br />
plus grande, surtout dans ce contexte où l'électorat était appelé, dans un proche avenir,<br />
à jouer un rôle important. Cette audience fut particulièrement grande dans les milieux<br />
féminins de la capitale, qui lui savaient gré de la réparation de l'injustice qui sur le<br />
moment les avait écartés des urnes.<br />
L'activité de l'avocat dakarois n'était certainement pas étrangère à cette<br />
remarque faite par toutes les études sociologiques sur la ville de Dakar: l'attachement<br />
de l'électorat féminin de la ville à l'égard de Lamine Guèye. Cet attachement est l'un<br />
des facteurs essentiels du maintien de Lamine Guèye, comme maire de la ville pendant<br />
plus de 15 ans ( de 1945 à 1961).<br />
Le corps électoral féminin dans les TOM en général, subissait une autre<br />
modification dans le sens de son élargissement. En effet, le 23 mai 1951, une nouvelle<br />
loi était adoptée. Elle stipulait : « Sont électeurs en particulier les mères de 2 enfants<br />
vivants ou morts pour la France et les pères de famille payant des impôts. » Cette loi<br />
ajoutait, au corps électoral, toutes les femmes ayant "deux enfants vivants ou morts pour<br />
la France". Sans nous attarder sur le caractère manifestement ambiguë de cette<br />
380
déclarée et totale de la loi coloniale sur la coutume, sur un domaine proprement social,<br />
dans l'objectif d'imposer le code de la Métropole avec une volonté évidente<br />
d'assimilation. Une lecture de la presse dakaroise de l'époque permet de penser que les<br />
pressions de l'Eglise n'étaient pas étrangères à cette réglementation.<br />
Toute la presse catholique, "Afrique Nouvelle", "Horizons Africains", "Savoir<br />
pour agir", "Jeunesse d'Afrique", préparait le terrain pour cette réglementation du<br />
mariage chrétien à imposer à l'Afrique Noire. Ces journaux fourmillaient d'articles plus<br />
ou moins violents contre le mariage coutumier et le mariage islamique. "Horizons<br />
Africains" s'exprime dans ces termes : « [...] Les coutumes sont tout de même<br />
remarquablement uniformes quant à cette conception générale qui assimile le mariage à un<br />
achat [...] les femmes jouets de leurs propriétaires, jouets séduisants. » La rédaction, en<br />
parlant de l'Islam, ajoute: « Notons que sur le plan religieux, l'islamisme est extrêmement<br />
nocif. Il sclérose les coutumes (du mariage) en leur état actueL »4 Dans les livraisons<br />
suivantes, le journal exposait les raisons pour lesquelles le mariage chrétien était la<br />
seule voie de salut pour l'Afrique Noire Française.<br />
Sur la question de la dot, autre coutume en rapport direct avec le mariage,<br />
l'organe dakarois avait publié plusieurs études et témoignages, avec un objectif bien<br />
précis que le journal livre en ces termes « Cependant, un objectif important reste à<br />
atteindre, l'usage de la dot [...] n'a plus aucune raison. »5 Pour ce journal catholique,<br />
coûte que coûte, il fallait modifier juridiquement, le sort de la femme africaine<br />
conformément au sort de sa collègue métropolitaine. Pierre Debeauce, l'un' des<br />
premiers à avoir lancé cette campagne contre l'islam et les coutumes du mariage local,<br />
exprime toute son argumentation en fonction de l'Européen qui arrive pour la première<br />
fois en Afrique noire. Celui-ci était particulièrement surpris de la grande différence<br />
entre le statut social de la femme européenne et celui de la femme africainé. Après<br />
toute cette campagne, la presse catholique dakaroise ne pouvait qu'exprimer sa joie, de<br />
voir une nouvelle réglementation, intervenir. Il s'agissait du décret Jacquinot publié par<br />
le J.O. du 18 septembre 1951. "Afrique Nouvelle" constatait : « Grâce au décret<br />
lacquinot, la femme africaine a fini d'être une "chèvre" >J. Le décret Jacquinot n'était, en<br />
fait qu'un maillon supplémentaire dans le processus de christianisation et<br />
d'européanisation du mariage en Afrique Noire. Cette presse catholique trouvait<br />
d'autres raisons de pourfendre encore un autre aspect du mariage en Afrique, la<br />
polygamie. "Afrique Nouvelle" qualifiait la polygamie en ces termes : «[...] demi<br />
esclavagisme qu'est la polygamie [...] l'avilissante condition du harem »8<br />
4. "Horizons Africains" N"2, Mai 1947.<br />
5. "Horizons Africains" N"4, 4 juillet 1947.<br />
6. "Horizons Africains" N"2, Mai 1947<br />
7. "Afrique Nouvelle" du 6 Octobre 1951<br />
8. "Afrique nouvelle" du 1er décembre 1951.<br />
382
juste, à la veille de la 2 eme guerre mondiale que le système colonial, en AOF, chercha à<br />
élever la jeune fille africaine à un niveau semblable à celui des garçons.<br />
Vincent G. Simiyu donnait les chiffres suivants pour souligner la faiblesse de<br />
la scolarisation des filles 14 donne:<br />
Années 1938 1946 1949-1950<br />
% de la scolarisation 2,35 3,35 4,15<br />
(garçons et filles) par<br />
rapport à la population<br />
% des filles par rapport - 19 20<br />
aux garçons<br />
Vincent G. Simiyu rapporte ces chiffres donnés par le docteur Aujoulat,<br />
ministre de la FOM dans les années 50 :<br />
- 23.489 filles scolarisées<br />
- contre 97.000 garçons<br />
- soit 120.489 élèves au total.<br />
Ces chiffres sont relatifs à l'année 1950. Ils confirment le retard énorme, pris<br />
par les filles vis à vis des garçons, dans la fréquentation scolaire comme en France à<br />
cette même période. L'organe catholique dakarois confirme le peu de cas fait de la<br />
promotion de la jeune fille africaine. En effet, pour l'admission à l'Ecole des Sages<br />
Femmes Africaines de Dakar, pour l'année 1951, seulement 20 candidates avaient été<br />
admises pour toute la Fédération.<br />
Les inscriptions des jeunes filles à l'Ecole des Infirmiers et Infirmières d'Etat,<br />
située aussi à Dakar, avaient été peu nombreuses pour la même année, seulement 18<br />
places étaient mises en concours avec la répartition suivante:<br />
- élèves internes: 8 filles et 4 garçons<br />
- élèves externes: 6 garçons et filles15<br />
Dans le rapport présenté aux premières journées sociales de Dakar, en mai<br />
1956, l'un des conférenciers du Secrétariat Social, Jean Servant, introduisant le thème<br />
"emploi des jeunes à Dakar, problèmes d'orientation, de formation et de débouchés"<br />
donne pour l'année 1956 dans l'école élémentaire : 19.805 filles et 18.803 garçons<br />
(secteur public et privé confondus). A la lecture de ce rapport, on remarque que le<br />
nombre des filles est supérieur à celui des garçons, à ce niveau de l'enseignement.<br />
Malheureusement, au niveau du secondaire, la répartition entre garçons et filles<br />
n'apparait pas dans le rapport. Mais on peut considérer qu'au niveau du premier cycle,<br />
14. V. G. Simiyu, l'Assemblée de l'Union française, 1975, pp.492-493<br />
15. "Afrique Nouvelle" du 10 Novembre 1951. Il s'agit de la l ere promotion.<br />
385
du Sénégal qui devint Assemblée Territoriale, la situation ne fut guère différente. En<br />
conséquence, aucune ne put être membre du Grand Conseil de l'AOF, en raison du<br />
mode de représentation au sein de cette institution. Au conseil municipal de Dakar, la<br />
situation de la femme était identique. Les hommes occupaient tous les postes de<br />
candidats et d'élus et ceci au temps de la toute puissance de la SFIO dans cette instance<br />
aussi bien qu'au temps où l'opposition B.P.S s'y affirmait, exactement comme avec la<br />
fusion des deux grandes formations B.P.S et P.S.AS avec la création de l'U.P.S en 1958.<br />
De même les femmes étaient absentes au sein des institutions entièrement contrôlées<br />
par les Européens, comme la Chambre de commerce de Dakar.<br />
Dans les partis politiques et les syndicats, les choses allaient de la même<br />
manière. Les femmes étaient absentes à presque tous les niveaux de responsabilité.<br />
Quelques exceptions - confirmation de la règle - parmi les 23 signataires du Manifeste<br />
annonçant la création du P.A.I, en septembre 1957, Madame Basse était la seule femme<br />
de l'équipe 20 . Autre exception: aux élections municipales de Dakar en 1945, Madame<br />
Gaspard Kâ, épouse d'un notable, fut inscrite 22 eme sur la liste conduite par Lamine<br />
Guèye. Ceci fut considéré à l'époque comme une marque de promotion de la femme<br />
africaine.<br />
Cependant, l'absence des femmes dakaroises dans les instances dirigeantes<br />
n'était nullement synonyme de leur rôle insignifiant dans les secteurs en question. Si la<br />
SFIO et Lamine Guèye furent omnipuissants à la municipalité de Dakar après chaque<br />
élection, ils le devaient essentiellement à la forte mobilisation des femmes dans leur<br />
camp. Jusqu'aux synthèses de police et sûreté qui mettent en évidence cette influence<br />
des femmes en faveur de l'avocat, jusqu'aux études sociologiques faites sur la ville à<br />
cette période, jusqu'aux études de sciences politiques et recherches historiques, tout<br />
confirme cette place déterminante des femmes dans la mobilisation. De même, le rôle<br />
joué par les femmes dans les luttes syndicales est jugé unanimement, comme<br />
déterminant. Par exemple, dans le conflit syndical le plus long que la fédération ait<br />
connu dans l'après-guerre, avec la grève des cheminots du R.A.N (Réseau d'Afrique<br />
Noire). c.c. Vidrovitch montre le caractère social de ces revendications à la base de la<br />
grève, mais surtout la place éminente prise par les femmes dans le déroulement du<br />
conflit 21 . Falilou Diallo, n'insiste pas moins sur ce rôle des femmes dans le Sénégal<br />
d'après-guerre 22 . G. Martens, dans son étude sur les questions syndicales pendant la<br />
période, met aussi en exergue le rôle déterminant des femmes pour soutenir les hommes<br />
dans les conflits 23 . Dans le domaine littéraire, Sembène Ousmane illustre parfaitement<br />
20. Voir liste dans "Gëstu" N"24, Août 1987, p.9.<br />
21. c.c. Vidrovitch, Permanences et ruptures, 1985, p.334.<br />
22. Falilou Diallo, Histoire du Sénégal 1944-1948.<br />
23. G. Martens in Le mois en Afrique, N"205/206, Fév-Mars 1983.<br />
387
ce rôle des femmes dans la grève des cheminots 24 de 1947-1948. Dans un dialogue entre<br />
Hadramé, le commerçant maure, et la ménagère, Ramatoulaye, on trouve ces propos:<br />
« - Hadramé, tu sais que j'ai toujours payé mon dû. Et puis c'est toi qui nous a<br />
acheté nos bijoux. Tu peux me donner au moins 2 kg de (riz)<br />
- Dites à vos hommes de reprendre le travail (répond le boutiquier maure).<br />
Vous allez crever de faim; cette grève, c'est la guerre entre des oeufs et des cailloux [...] Je<br />
sais que si vous, les femmes, cessez de les soutenir, ils reprendront le chemin des ateliers. »25<br />
Dans la ville de Thiès, centre principal de la Régie, Sembène Ousmane<br />
donne la parole à l'une des femmes. Penda s'adresse à l'assemblée des grévistes, en ces<br />
termes: « Je parle au nom des femmes. Pour nous, cette grève, c'est la possibilité d'une vie<br />
meilleure [. ..J Nous vous demandons de garder la tête haute et de ne pas céder. Et demain,<br />
nous allons marcher jusqu'à N'dakaru [...] et les toubabs verront si nous sommes des<br />
concubines. »26 Cette initiative des femmes constitua la pierre angulaire du<br />
dénouement. Elles partirent très nombreuses de Thiès, dans la fatigue, la soif et la faim.<br />
Lors des étapes de Sébikotane et Rufisque, elles furent particulièrement bien reçues par<br />
les femmes de ces villes. Les marcheuses eurent droit, par contre, dans les abords<br />
immédiats de la capitale, à une répression sanglante. Dès le lendemain, toute la ville de<br />
Dakar était paralysée par une grève générale de soutien au mouvement des marcheuses<br />
et des cheminots. Les autorités coloniales durent intervenir puissamment contre la<br />
direction de la Régie pour l'obliger à entamer des négociations sérieuses qui aboutirent<br />
à la fin du conflit.<br />
2) La femme face à l'emploi<br />
Rapportant les résultats d'une enquête menée à Dakar dans la période, sur<br />
un échantillon de 336 femmes mariées, Colette La Cour Grandmaison 27 écrit:<br />
commerce etc) : 100<br />
« - femmes sans activité: 130<br />
- femmes indépendantes c.a.d ayant une activité de type traditionnel (tissage,<br />
- femmes salariées: 106. »<br />
Dans une intervention faite au 6 éme séminaire international organisé par<br />
l'université d'Ibadan au Nigéria, en juillet 1964, D. Van Der Vaeren Aguessy donne les<br />
conclusions d'une étude sur la place des femmes dakaroises dans le secteur des activités<br />
des marchés dans la ville : « Les femmes dakaroises occupent 60 % de cet emploi en<br />
1959.»28 Au même moment, les proportions étaient 83 % à Lagos, 85 % à Accra, 66 %<br />
24. Sembéne Ousmane, Les bouts de bois de Dieu, 1960.<br />
25. Ibid, p.75.<br />
26. Ibid, p.288.<br />
27. Stratégies matrimoniales... p.202<br />
28. D. Van Der Vaeren Aguessy, Les femmes commerçantes de détail sur les marchés dakarois, p.244.<br />
38-8
à Brazzaville, remarquait la communication. Pour son auteur, si les femmes occupent<br />
une place dans ce commerce de détail, c'est pour améliorer le niveau de vie familial.<br />
Elles visent aussi à acquérir plus d'indépendance personnelle. Analysant ce que rapporte<br />
cette occupation aux femmes en question - lequel apport est relativement faible <br />
Aguessy en conclut que ces Dakaroises constituent une nouvelle partie du prolétariat<br />
urbain qui se développe avec l'accroissement constant de la population de la ville.<br />
Colette La Cour Grandmaison évalue la part du salariat féminin dans la capitale à 7,5 %<br />
par rapport à la population féminine. Elles étaient 13.700 salariées. Cette étude qui date<br />
de 1964, traduit une situation qui, dans l'ensemble, n'a pas beaucoup changé par rapport<br />
à la décennie antérieure. La répartition, issue de l'enquête, indique:<br />
- professeurs d'enseignement secondaire: 30<br />
- secrétaires de direction: 50<br />
- sages-femmes: 70<br />
- institutrices: 300<br />
- infirmières diplômées: 90<br />
- employées des P.T.T : 50<br />
- dactylos et filles de salles: 300<br />
- domestiques: 1.000<br />
- ouvrières en usines: 790.<br />
Pour c.L. Grandmaison, les 3/4 du salariat féminin dans la ville de Dakar<br />
étaient constitués de domestiques et assimilés. Les emplois de bureau et le grand<br />
commerce représentaient près du 1/4. Par contre, le travail industriel féminin ne<br />
représentait que 0,4 % de la population féminine active. On retrouve ces femmes, en<br />
quasi-totalité, dans les conserveries de poissons. Elles étaient recrutées souvent de façon<br />
saisonnière, au moment des grandes pêches. 1.000 employées domestiques seulement<br />
étaient déclarées et payées sur la base du SMIG mais en réalité les femmes domestiques<br />
étaient beaucoup plus nombreuses. Elle se chiffrait à 5.000 sur l'ensemble des 10.000<br />
femmes salariées estimées pour tout le territoire du Sénégal. Cette prédominance du<br />
travail domestique salarié chez les femmes se justifiait, d'après C.La Cour Grandmaison,<br />
par la faible scolarisation; seulement 5 % des femmes, à Dakar, savaient lire et écrire le<br />
Français. En 1965, on compte dans la ville à peine une vingtaine à détenir un titre<br />
universitaire, dont 3 étaient magistrats. Deux femmes seulement étaient universitaires et<br />
une était député. L'enquête montre aussi:<br />
- femmes indépendantes<br />
commanditaires de tisserands: 200<br />
marchandes de poisson: 500<br />
vendeuses de produits maraîchers: 1.300<br />
vendeuses sur les marchés: 1.200<br />
389
étaient «des indices de transfonnation des structures économiques, sociales, mentales et des<br />
habitudes de vie. »31 Chez ces femmes dakaroises, il est évident que la situation de<br />
l'emploi n'était pas brillante,par suite des bouleversements introduits par le système<br />
colonial, en particulier l'école. Cependant, ces difficultés eurent pour conséquences une<br />
activité réelle en vue de chercher une amélioration des conditions de vie. Sur ce point, la<br />
femme africaine de Dakar a cherché à prendre en main son propre destin.<br />
111/ MARIAGE, FAMILLE, PROSTITUTION ET ENFANCE ABANDONNEE.<br />
1) Le mariage.<br />
Dans la partie relative à la situation de la femme définie dans les textes, on<br />
note que l'administration coloniale avait introduit toute une législation et<br />
réglementation sur le mariage. Cependant, comment, dans la réalité, se présentait la<br />
question?<br />
P. Mercier constate qu'il n'y avait pratiquement pas de mariages mixtes<br />
(Européens et Africains), célébrés sur place. Evidemment, ceci ne signifiait pas que des<br />
couples mixtes n'existaient pas à Dakar. Certains étudiants africains étaient revenus de<br />
métropole avec des épouses européennes. Numériquement, cela représentait quelque<br />
chose de très faible. Du reste, l'opinion publique dans l'ensemble était hostile à cet état<br />
de fait. En effet, diverses organisations en condamnaient la pratique. Du côté africain, il<br />
y avait le C.l.S, l'U.F.S et l'U.F.O.A (Union des femmes ouest-africaines). Dans ces<br />
conditions, les Africains se mariaient entre eux, mais aussi les Européens entre eux car<br />
ils considèrent le mariage inter-racial comme l'atteinte essentielle au prestige de<br />
l'Européen. P. Mercier rapporte « La presque totalité de nos interviewés expriment une<br />
nette réprobation de tels mariages. » et que « Les relations entre membres du groupement<br />
européen et couples mixtes sont rares. »3 2<br />
Paul Mercier indique que 71 % des ménages à Dakar étaient constitués par<br />
des entités dans lesquelles les hommes et les femmes appartenaient à la même ethnie.<br />
Ainsi, 29 % seulement des ménages étaient constitués d'hommes et femmes d'ethnies<br />
différentes 33 .<br />
Colette La Cour Grandmaison, dépouillant des enquêtes sur un échantillon<br />
de 336 femmes mariées, en conclut que le mariage le plus recherché à Dakar était celui<br />
au sein de la parenté "m'boka", soit en lignée maternelle, soit en lignée paternelle 34 .<br />
Elle remarque que les cas d'exogamie étaient très rares.<br />
31. D. Van Der Vaeren Aguessy, op. cit., p.247<br />
32. P. Mercier, L'agglomération dakaroise, op cit. 1954.<br />
33. P. Mercier, Le groupement européen de Dakar, 1955, p.140.<br />
34. Colette Lacour Grandmaison, op. cit., p.202.<br />
391
liens étroits de cette parenté, des éléments intervenaient pour que le mariage ne soit pas<br />
seulement une opération mercantile.<br />
Soeur André Marie, parlant de l'attitude de la femme vis à vis du mariage,<br />
écrit: « Habituée par des siècles de servitude à une apparente passivité, la femme africaine<br />
n'avait aucune notion de sa responsabilité morale, ni de sa dignité humaine et trouvait<br />
nonnal de ne pas s'appartenir. » Pour Soeur André Marie, parce que l'homme achète sa<br />
femme en Afrique, le mariage étouffait l'âme de l'Africaine. De la jeune fille africaine,<br />
elle écrit « Devenue grande, elle se laisse aller à la douceur d'être aimée. Son entourage<br />
même lui offre les complicités qui favorisent sa licence. Sa mère lui apprend à dissimuler ses<br />
fugues, comme elle lui enseigne l'art de rapiner et de satisfaire ses caprices. »40 M. Bertaud<br />
parle de la jeune fille africaine, en des termes peu différents de ceux de Soeur André<br />
Marie: «A peine née, la fille est l'objet de convoitises, elle subit l'homme dont elle est la<br />
servante née [...Jses parents, ses frères, son père, sa mère surlout provoquent et favorisent ses<br />
amours dont ils tirent profit. »41 Pour ces derniers auteurs, le mariage en Afrique n'était<br />
que le couronnement logique de l'exploitation de cette valeur marchande qu'était la<br />
femme africaine.<br />
Evidemment la question était de savoir le degré d'indépendance de ces<br />
chercheurs en question comme de tant d'autres par rapport aux hautes préoccupations<br />
des grands milieux économiques coloniaux. On remarque que ces "spécialistes" de la<br />
condition de la femme africaine, officiaient à une période de vaste campagne contre la<br />
famille africaine lancée par divers cercles, mais surtout exactement dans la ligne<br />
directrice de ces milieux en question. Soeur Marie André, par exemple, était invitée, le 6<br />
juin 1952, devant le haut parterre de l'Académie des Sciences Coloniales. On note qu'au<br />
terme de la longue discussion qui suivit son exposé "scientifique" comme le qualifiait un<br />
intervenant, c'est à l'unanimité que l'institution décidait de faire rédiger un voeu à<br />
l'adresse des autorités gouvernementales. Ce voeu avait trait à la question du paiement<br />
des allocations familiales aux travailleurs salariés en Afrique. Il demandait que ces<br />
allocations soient versées uniquement pour une femme: la première. En Afrique Noire<br />
Française, ces allocations avaient constitué une revendication fondamentale des<br />
travailleurs. A travers l'argumentation de ces "spécialistes" des questions sociales<br />
africaines - genre M. Bertaud ou Soeur André Marie - les grands milieux coloniaux<br />
recherchaient bien les moyens de refuser toute satisfaction aux revendications des<br />
travailleurs. En cela, ces "spécialistes" constituaient simplement les lits moelleux des<br />
intérêts des grands milieux d'affaires. Un certain racisme pointait, du reste, dans<br />
l'approche de cette question du mariage.<br />
40. Cité par "Présence Africaine" N" AV-Mai 1957, p.B3.<br />
41. Ibidem<br />
39'4
2) Famille<br />
L'enquête menée à Dakar et dont les résultats furent présentés lors des<br />
deuxièmes journées organisées par le Secrétariat Social sur l'habitat, avait mis l'accent<br />
sur la taille très importante de la famille africaine. Du reste, ce même constat était déjà<br />
fait lors des premières journées, deux ans auparavant, à partir de l'observation de<br />
l'emploi.<br />
D'autres sources avaient également mis l'accent sur ce fait: la grande taille<br />
de la famille en milieu indigène dakarois. Par exemple, V. Martin, étudiant la chrétienté<br />
dakaroise, en 1955, indique que chaque foyer comprenait en moyenne 4 personnes.<br />
Refaisant le même travail, 5 ans plus tard, il constate que la taille de la famille s'était<br />
accrue en passant de 4 personnes en 1955, à 4,6 personnes en 1960. La moyenne des<br />
enfants par ménage était de 2,7. V. Martin constate que cette moyenne est variable<br />
selon les ethnies, selon le niveau social de la famille, mais selon que le mariage a été<br />
célébré ou non à l'église, ou à l'état civil.<br />
Y. Mersadier, étudiant en 1954/55 les budgets familiaux dans les 3<br />
principales villes sénégalaises (Saint-louis, Thiès et Dakar) donne les chiffres suivants<br />
quant aux tailles des familles, selon les catégories socio-professionnelles 42<br />
Catégories professionnelles 1 Nombre de personnes*<br />
Ouvriers 6,3<br />
Employés 5,2<br />
Manoeuvres 5<br />
Plantons 5,7<br />
Artisans 7,5<br />
Cultivateurs 10,2<br />
L'étude indique cependant que les étrangers étaient peu nombreux dans ces<br />
familles puisque les chiffres les plus bas étaient 0,1 et les plus élevés 1,2 en moyenne.<br />
La revue "Marchés Coloniaux" aussi s'était intéressée à la taille de la famille,<br />
surtout chez le travailleur africain. Dans un article intitulé" Comment vit un travailleur<br />
africain au Sénégal" - article signé "un de nos informateurs dakarois" - le journal donne<br />
le chiffre de 5 personnes en moyenne par famille.<br />
42. Y. Mersadier, Budgets familiaux tableau II, p.42.<br />
• Ces chiffres incluent, outre les parents et les enfants, les étrangers.<br />
395
Le journal fait la distinction entre la famille "étroite" (à l'européenne) et la<br />
famille "étendue". La différence réside pour la revue, dans le fait qu'à la famille<br />
"étroite", le salarié africain ajoute trop d'étrangers sous le prétexte d'hospitalité.<br />
L'organe de presse ajoute: « Il s'agit là, d'un grave problème social aboutissant à faire<br />
vivre aux dépends d'un élément actif, tout un groupe improductif et plus ou moins<br />
parasite.»44 Cet article n'était que l'un de toute une série. "Marchés coloniaux"<br />
dénonçait la taille démesurée de la famille des salariés africains intégrant trop de<br />
nouveaux venus "parents". Dans ces conditions, le journal déniait aux travailleurs<br />
africains la légitimité de leurs revendications sur les salaires et les nouvelles indemnités<br />
et allocations puisque les avantages obtenus étaient sans cesse annulés par la croissance<br />
constante de la famille. Pour l'organe des grands milieux d'affaires coloniaux, c'était<br />
l'environnement familial qui était à l'origine des difficultés de vie du travailleur africain.<br />
En conséquence, tout effort d'augmentation des salaires était voué à l'échec.<br />
Evidemment, le contexte expliquait bien les véritables fondements de cette<br />
argumentation. Dans cette période 1950-1953, le coût de la vie à Dakar avait<br />
vertigineusement augmenté. Les travailleurs indigènes, misérables, se battaient pour un<br />
code du travail garantissant à tous points de vue une situation décente. Devant cette<br />
bataille revendicative, les milieux économiques en partie, responsables de cette situation<br />
des travailleurs, multipliaient les arguments en faveur de "l'inutilité d'un effort salarial".<br />
Etudes économiques, sociales etc... tout était mis à profit pour atteindre l'objectif<br />
fondamental: exploiter au maximum la force de travail africaine. La famille africaine<br />
était ainsi présentée, largement, comme un véritable frein au développement du<br />
travailleur africain. Le système des salaires n'y était pour rien.<br />
Cette famille africaine était elle solide?<br />
L'étude de Colette La Cour Grandmaison fait apparaître que 100 femmes<br />
dakaroises avaient divorcé de 150 hommes. Dans cette étude, les femmes de la tranche<br />
d'âge 50-60 ans, avaient, en moyenne, chacune contracté deux mariages. Dans la tranche<br />
d'âge des 30 ans, 8 % en moyenne des femmes mariées avaient déjà divorcéS. Ainsi,<br />
selon l'auteur de cette enquête, les risques de divorce étaient plus élevés dans les 4<br />
premières années du mariage.<br />
Cette solidité plus ou moins grande de la famille, à Dakar, était en rapport<br />
étroit avec la polygamie. Mais cette pratique était relativement peu importante puisque<br />
« Le nombre d'hommes polygames représente 18 % de la population masculine<br />
dakaroise.»46 L'enquête indiquait que dans les ethnies de la ville, la polygamie était plus<br />
grande chez les Lébous avec 26 %. Au total, 10 % des foyers lébous avaient au moins<br />
deux ménages.<br />
44. "Marchés coloniaux" N°406, Avril 1953.<br />
45. Colette La Cour Grandmaison, op. cit., p.213.<br />
46. Ibidem, p.209 citant Paul Mercier.
quartiers indigènes. Celle-là était la petite prostitution au point de vue de son<br />
organisation et des tarifs pratiqués. Selon ces interlocuteurs, à plusieurs reprises, des<br />
bruits - qu'ils ne peuvent étayer de preuves évidentes - avaient couru, dans la capitale,<br />
faisant état de réseaux organisés pour expédier en métropole des jeunes filles africaines<br />
qu'on lançait dans la prostitution. Ces affirmations ne nous semblent pas sans<br />
fondement étant donné le caractère répétitif de ces rumeurs qui laissaient percer une<br />
certaine inquiétude des milieux africains de la ville. D'autre part, lorsque la rédaction<br />
des "Echos d'Afrique Noire" parle d'opération anti-corse montée par la police de la ville<br />
avec ce que le journal présentait comme le "prétexte" « histoire d'enlèvements de mineurs<br />
et de séquestration »54, il est fort à parier qu'une relation existait entre ces rumeurs et ce<br />
"prétexte". Un autre organe "Condition Humaine" titrait "Offre d'emploi" dans une de<br />
ses livraisons. A la lecture de l'article, il était question de la circulaire N D<br />
585/DIR/cab<br />
du Chef du Territoire du Sénégal, à la date du 9 juillet 1952. La circulaire du gouverneur<br />
rappelait à l'ordre les responsables administratifs qui sapaient leur propre autorité en<br />
cédant à des considérations de complaisance. Le journal, explicitant la circulaire,<br />
indique que les commandants de cercles, de subdivisions et autres responsables, usant<br />
de leur autorité, entretenaient des relations de bas niveau avec des filles africaines.<br />
L'organe du BDS dénonce ainsi l'organisation d'une certaine forme de prostitution dans<br />
l'administration elle-même. Cet article, plein d'humour et de sarcasme, montre qu'à<br />
partir des bureaux de ces autorités administratives, les filles africaines pouvaient « avoir<br />
accès directement aux appartements privés du commandant qui, en ce qui le concerne saura<br />
étouffer sa haine du nègre.»55 L'organe du BDS insiste aussi sur le fait que les<br />
responsables SFIO orchestraient une certaine forme de prostitution dans le cadre de<br />
leurs manifestations de réjouissance : "khawarés", "tannebers", "fanaux" etc... Pour<br />
"Condition Humaine", les activités laministes étaient l'équivalent de perversions. En<br />
retour, le journal laministe "AOF' montrait que les véritables organisateurs de la<br />
perversion étaient ceux du BDS. Pour les uns comme pour les autres, celle-ci se situait<br />
dans le camp adverse. Christianisme et Islam, religions dominantes à Dakar,<br />
condamnent la prostitution. Mais à travers l'utilisation de cette arme morale dans la<br />
lutte politique, chaque camp cherchait à attirer les faveurs des autorités religieuses. Le<br />
recours à cette arme montre bien que le milieu social condamne la prostitution qui<br />
même non acceptée, était pourtant bien présente à Dakar.<br />
54. Ibidem<br />
55. "Condition Humaine" du 21 août 1952.<br />
400
: L'enfance abandonnée.<br />
Elle était présente à Dakar de manière évidente avec les Eurafricains dans la<br />
ville. Combien étaient-ils ? Faute de sources précises et de chiffres crédibles, une<br />
réponse est difficile à donner.<br />
Pour l'ensemble de l'AEF, en tout cas, le chiffre de 5 à 6.000 Eurafricains est<br />
avancé, avec une majorité résidant au Gabon qui était la plus ancienne des colonies de<br />
ce groupe de territoires. Ce chiffre est avancé par un des animateurs de Radio<br />
Brazzaville lors d'une conférence donnée à Dakar et rapportée dans ces grandes lignes,<br />
par les journaux catholiques de la ville 56 . Les conclusions de cette conférence indiquent<br />
que le phénomène de l'existence des Eurafricains était largement fonction de<br />
l'ancienneté de la présence française. Or, le Sénégal était la plus ancienne de toutes les<br />
colonies françaises au sud du Sahara, ce qui par voie de conséquence, donne des<br />
indications sur le développement local probable du phénomène. Cette importance était<br />
également attestée par la création d'une association reconnue par les autorités<br />
administratives. Elle avait son siège social à Dakar et étendait ses compétences à<br />
l'ensemble de la Fédération d'AOF et au Togo. Cette association publiait à Dakar, un<br />
bulletin intitulé "l'Eurafricain". Ses activités étaient diverses : organisation de<br />
conférences, distributions de secours, organisation de cours de couture et cuisine, prise<br />
en charge d'enfants eurafricains, participation à des congrès internationaux de métis...<br />
Elles étaient largement relatées dans les colonnes du bulletin de liaison.<br />
Les subventions octroyées par l'administration, sans difficulté aucune,<br />
permettaient à l'association de pouvoir faire face à l'organisation de ces activités.<br />
Parlant de ces Eurafricains, "Horizons Mricains,,57 écrit « Les enfants de la misère, qui<br />
errent trop nombreux dans la cité. »<br />
L'Eglise catholique dakaroise accueillait beaucoup de ces enfants dans ses<br />
oeuvres comme Saint Joseph du Cluny, route de Ouakam dans la Médina. Elle faisait<br />
appel, pour faire face à cette situation, à des aides financières ou matérielles diverses.<br />
L'Eglise avait également conscience que ces Eurafricains pouvaient jouer un rôle<br />
important, dans la communication sociale entre les groupes raciaux de la ville. Aussi<br />
s'évertuait-elle à créer les conditions d'instauration d'un dialogue entre Européens,<br />
Mricains et Eurafricains. Mais, l'enfance abandonnée, dans la capitale fédérale, n'était<br />
pas seulement l'enfance eurafricaine. Diverses sources parlent d'enfants africains<br />
abandonnés, dans les quartiers indigènes, souvent par leurs mères, elles aussi,<br />
abandonnées par les hommes responsables de ces grossesses. Les oeuvres sociales<br />
catholiques jouaient un rôle non négligeable dans la récupération de ces enfants et par<br />
la suite leur éducation.<br />
56. "Afrique nouvelle" et "Horizon Africain", Mars 1951.<br />
57. N°42, Mars 1951.<br />
401
\" L<br />
A propos de cette enfance abandonnée, la responsabilité de certains<br />
marabouts était évidente: ils précipitaient dans la misère beaucoup de petits talibés <br />
élèves coraniques - qui leur étaient confiés. Ces enfants quémandaient l'aumône du<br />
matin au soir. Ils en profitaient, aussi souvent, pour rapiner par-ci et par-là. Pour<br />
expliquer l'importance du phénomène de l'enfance abandonnée, l'insuffisance notoire<br />
des infrastructures scolaires est un facteur de taille. Trop d'enfants ne pouvaient pas<br />
aller à l'école. Beaucoup étaient périodiquement rejetés hors de l'école, chaque fin<br />
d'année, par un système éducatif incohérent, inadapté et qui montrait peu d'intérêt à<br />
éduquer le plus grand nombre.<br />
Toute ces catégories d'enfants constituaient la masse des jeunes délinquants.<br />
La presse locale dénonce très souvent la délinquance juvénile importante dans la<br />
capitale fédérale. Une conférence, donnée à Dakar par le magistrat Benglia, président<br />
du tribunal pour enfants mineurs, illustrait parfaitement certains des mécanismes<br />
conduisant de l'enfance abandonnée à l'enfance délinquante à Dakar. La presse<br />
dakaroise, en particulier catholique, avait fait largement écho à cette conférence. Parmi<br />
les facteurs d'explication, un était naturellement déterminant: la condition déplorable<br />
que connaissait la femme dakaroise qui, quotidiennement, subissait des pesanteurs très<br />
lourdes.<br />
On le voit, prostitution et enfance abandonnée avaient une réelle ampleur<br />
dans la ville. Incontestablement, les maux du système colonial s'ajoutaient - sur le plan<br />
arithmétique - à ceux de la société africaine traditionnelle, bouleversée par la<br />
domination étrangère, facteur fondamental d'explication.<br />
4) Une journée de la femme dakaroise.<br />
Dans les pages précédentes, les conditions de l'habitat, de la santé, de l'école<br />
etc... ont été passées en revue. On peut en conclure que, pour la grande masse de la<br />
population, la situation d'ensemble était précaire. A l'opposé, une minorité avait une<br />
existence décente et même enviable. Dans cette situation globale, comment se déroulait<br />
la journée de la femme dakaroise ?<br />
Pierre Richard, en parlant de la femme européenne de la "gentry" dakaroise,<br />
écrit que la première chose qu'elle faisait, au réveil, était de consulter son agenda, puis<br />
elle commençait une journée de loisirs 58 .<br />
La femme africaine, elle, avait « réveillé le soleil à la borne fontaine »59.<br />
Solange Faladé remarque que cette corvée d'eau lui demandait plusieurs allées et<br />
venues et que la longue queue d'attente à la borne fontaine entamait largement sa<br />
patience. "Condition Humaine" traduit cette situation en remarquant que cette femme<br />
58. Pierre Richard, Revue internationale de la FOM, Mai 1957.<br />
59. "Condition Humaine" du 11 avril 1953, article: "Mon quartier accuse".<br />
402
qui avait « réveillé le soleil », avait déjà l'astre au dessus de la tête alors que la corvée<br />
n'était toujours pas terminée.<br />
Dès que celle-ci se terminait, elle avait autre chose à faire: préparer les<br />
enfants qui devaient aller à l'école - s'ils y avaient de la place -, s'atteler au ménage de la<br />
chambre avant de vaquer à cette tâche moralement pesante et redoutée : aller au<br />
marché. Véritable angoisse de la femme dakaroise puisqu'il était obligatoire de passer<br />
d'abord chez le boutiquier maure du coin pour trouver le riz et l'huile indispensable.<br />
Rarement ces denrées pouvaient être considérées comme acquises d'avance. Le<br />
problème de la qualité n'intervenant que dans le cas où il y avait possibilité financière<br />
d'en avoir. La spéculation était souvent de règle aussi bien sur la qualité que sur la<br />
quantité.<br />
Le nécessaire de ces denrées quotidien en main, elle pouvait se diriger alors<br />
vers le marché. C'était une étape de calvaire dans la mesure où ses 200 à 300 F CFA<br />
devaient obligatoirement suffire à acheter les condiments et autres: oignons, tomates,<br />
poisson, - très rarement de la viande trop chère - carottes, pomme de terre ou patate,<br />
charbon, pétrole etc... Tout ceci en quantité suffisante pour pouvoir préparer les deux<br />
repas de la journée et pour une large famille. Difficile opération en tout cas.<br />
Le chemin qui menait de la maison au marché était redoutable dans la<br />
mesure où pour cette femme, manifestement ses moyens étaient insuffisants pour<br />
pouvoir faire face aux nécessités. Mais il fallait coûte que coûte trouver ce minimum<br />
pour faire manger "correctement" la famille. Ainsi souvent, ce bout du chemin était fait<br />
avec la voisine, ce qui permettait d'échanger les impressions réciproques sur les cours de<br />
tel ou tel produit, sur la gymnastique financière opérée pour pouvoir acheter telle chose<br />
au lieu de telle autre, ou avec telle autre etc... La calebasse moitié vide - ou moitié<br />
pleine, comme on voudra - après mille et une palabres avec les vendeurs de détail du<br />
marché, il fallait alors retourner à la maison. En cours de route, les deux compagnes ne<br />
manquaient que très rarement l'occasion de médire de telle ou telle autre voisine ou co<br />
épouse. C'était alors un divertissement par rapport à ces soucis permanents liés au<br />
marché.<br />
Pendant ce temps, Madame l'Européenne avait fini depuis longtemps de<br />
dicter ses ordres à la bonne ou au boy indigène ou aux deux parfois. Alors, au volant de<br />
sa voiture personnelle ou à l'arrivée de la voiture de fonction du mari, ou du service du<br />
mari, elle commençait une journée professionnelle ou une journée de plaisir, selon les<br />
cas. Dans un cas comme dans l'autre, le repas était fin prêt au retour de Madame, la<br />
maison bien entretenue, le linge lavé et repassé etc... Si Madame avait une journée<br />
professionnelle, à coup sûr, elle avait, sous ses ordres soit, les institutrices, soit les<br />
infirmières, soit les dactylos, soit les employées africaines qui exécutaient ses ordres,<br />
directives et instructions.<br />
403
La femme indigène avait aussi des soucis de santé pour les enfants. Où les<br />
faire consulter et espérer des soins corrects ? Une peur bleue de l'ordonnance la<br />
tenaillait. Elle savait bien qu'il n'y avait pas d'argent pour l'acheter. La nourriture du<br />
midi et du soir était déjà un problème épineux. Le petit déjeuner, lui, n'était pas<br />
toujours considéré comme partie intégrante de l'alimentation quotidienne dans de<br />
nombreux foyers.<br />
Au soir d'une journée qui n'avait pas été de tout repos, aller au lit signifiait<br />
rejoindre sa case ou sa baraque dans la plupart des cas. Elle était hantée par la crainte<br />
permanente que le quartier ne connaisse un incendie cette nuit là, parce que tout le<br />
voisinage n'était qu'un bidonville qui pouvait s'enflammer facilement. Une chose était<br />
certaine: il ne fallait pas compter sur l'électricité pour s'éclairer. Au mieux il y avait une<br />
lampe tempête ou une bougie. A coup sûr aussi, il y avait beaucoup de monde dans la<br />
chambre. Le lit était en bois grossièrement taillé si ce n'était pas la natte. Dans le ca où<br />
il y avait un matelas, celui-ci était fait de paille de riz ou d'autres herbes. Bien entendu,<br />
la Dakaroise se couchait sans lire quoi que ce soit puisqu'elle était, en règle générale,<br />
analphabète. Les informations radiodiffusées ? Dans la chambre sinon dans toute la<br />
concession, il n'y avait pas de poste récepteur. Les informations de la journée se<br />
limitaient souvent à ce qu'elle avait vu ou entendu sur le chemin du marché ou à la<br />
borne fontaine. En somme, une information peu "informante" sur l'actualité dans la ville<br />
et à plus forte raison sur le reste du monde.<br />
Une fois au lit, dormait-elle aussitôt? Rien n'était moins sûr. Les enfants<br />
étaient peut-être encore dans la rue à s'amuser avec les camarades d'âge. Apparemment<br />
rien ne pouvait arriver de fâcheux mais sait-on jamais? surtout dans ces ruelles du<br />
quartier où l'électricité était absente. D'autres soucis se bousculaient dans la tête. Le<br />
mari, parti depuis la première aube, n'était souvent pas encore de retour au foyer. Avait<br />
il trouvé ou non un emploi de journalier aujourd'hui? Etait-il resté en journée continue<br />
à l'usine ou au chantier ou aux docks du port? L'homme ne s'était-il pas simplement<br />
attardé à la "grand'place" avec les autres de sa génération. Etait-il passé voir la 2 eme , la<br />
3 eme sinon la 4 eme épouse? Si elle était dans un ménage polygame et qu'elle était de<br />
"tour", l'idée ne manquait pas de l'effleurer que son homme serait passé rendre une<br />
visite de "courtoisie" à l'autre ou aux autres. Si elle apportait une réponse à toutes ces<br />
interrogations qui la tenaillaient, alors, seulement, elle pouvait espérer pouvoir dormir<br />
d'un sommeil réparateur. C'était possible, si évidemment, un tam-tam n'était pas<br />
organisé cette nuit dans le voisinage à l'occasion d'un baptême, d'un mariage, de<br />
fiançailles ou d'autres motifs comme le milieu n'en manquait pas.<br />
De quoi serait faite la journée de demain? Cet aspect la préoccupait moins.<br />
A sa quasi certitude, elle serait dure comme celle qui venait de s'achever. Aucun espoir<br />
réel qu'elle soit une journée différente, apportant de réelles raisons morales et<br />
matérielles de satisfaction. Par ailleurs, les enfants avaient-ils appris les leçons du<br />
404
lendemain - s'ils avaient cette chance d'aller à l'école - ? Elle ne pouvait nullement<br />
contrôler, puisqu'elle n'avait jamais "fait les bancs" de l'école. Tout juste savait-elle que<br />
les enfants retourneraient demain matin à l'école ou peut-être demain après-midi selon<br />
qu'ils étaient ou non dans une classe à mi-temps. Ce système, l'administration coloniale<br />
l'avait introduit largement pour pallier le manque de salles de classe. Il n'était en<br />
vigueur que dans la partie indigène de la ville 60 .<br />
Pendant ce temps, comment se terminait la journée de Madame<br />
l'Européenne? Elle venait juste de ranger sa voiture dans le garage, pour prendre<br />
l'escalier menant au bel appartement du building si ce n'était pas la villa cossue du<br />
Plateau ou de Fann Résidence ou du Point E. Electricité, eau, aucun souci. Madame<br />
avait encore dans l'haleine les meilleurs vins importés qui clôturaient la soirée chez<br />
l'industriel ou le banquier ou le haut fonctionnaire. Evidemment à table on avait<br />
beaucoup changé les plats. Problèmes d'école ou de santé pour l'enfant? Nullement,<br />
puisque les privilégiés du système étaient là. Le boy et/ou la bonne indigène avait déjà<br />
tout mis en ordre dans la chambre à coucher de Madame qui pouvait dormir<br />
tranquillement. Le tam-tam, à·coup sûr, ne résonnait pas à plusieurs lieues à la ronde.<br />
Incident? presque hors de l'imagination. Tout juste Madame vérifiait si le téléphone<br />
était bien à son chevet. Souci d'argent? Oui peut être, mais en tout cas, pas pour les<br />
dépenses dans la colonie6 1 . Peut-être tout juste rêvait-elle avant de dormir, à la belle<br />
villa que le couple s'achèterait après le séjour colonial, objectif en vue duquel un gros<br />
salaire était économisé: celui de Monsieur.<br />
A travers cette journée de la femme dakaroise, l'échantillon se limitait aux<br />
deux groupes dominants de la population : le groupe indigène et le groupe européen.<br />
Dans chacun de ces groupes, c'est la femme-type qui a été campée ici car comme le<br />
disait Madame Sira Diop, présidente de l'Union des Femmes du Soudan, ouvrant, le 20<br />
juillet 1959 à Bamako, le congrès des Femmes Ouest Africaines: « De l'océan atlantique<br />
au Tchad, du sahara au Golfe de Guinée [...] Les conditions offertes à la femme africaine<br />
sont identiques. »62 Solange Faladé, premier président de la FEANF et chercheur à<br />
l'IFAN de Dakar, à son retour en Afrique, avait, après une étude minutieuse de la<br />
condition de la femme dakaroise, fait un constat presque identique: « Certes le paysage a<br />
subi beaucoup de modifications [...] l'introduction des progrès techniques n'en a pas moins<br />
laissé presque intactes les conditions matérielles de l'existence des femmes [...] pennanence<br />
du mode de vie de leur mère ou grand-mère. »63<br />
60. R. de Benoist, l'Afrique Occidentale francaise, op.ciL, p.410.<br />
Cette expérience est tentée à Dakar depuis le 3 janvier 1955 puis abandonnée.<br />
Plus de 30 ans après, l'expérience est reprise au Sénégal dans le cadre de la politique éducative du ministre Iba Der<br />
61. A.N.S: 2G 52-22, Rapport annuel de la direction fédérale des P.T.T, 1952.<br />
La moyenne par compte de déposant était de 27.045 F CFA pour un Européen et de 3619 F CFA pour un Africain.<br />
Les Européens étaient titulaires de 9,6% des comptes pour 25% du capital des 82.010 comptes de déposants.<br />
62. "Afrique-document" W48-49, 1959.<br />
63. Solange Faladé, Femmes de Dakar... p.206.<br />
405
A l'opposé, Madame - la femme européenne - le milieu colonial et la logique<br />
du système lui créaient, de facto, toutes les conditions qui lui permettaient de se<br />
différencier de la femme africaine, matériellement en tout cas, et à son avantage.<br />
406
Il TRANSPORT<br />
CHAPITRE VII : LE TRANSPORT ET L'IMPOT<br />
Parce que la ville était le principal centre industriel et commercial de la<br />
Fédération et que les services y étaient importants, la question des transports ne<br />
manquait pas d'être un problème angoissant, surtout pour cette population indigène<br />
déguerpie loin du centre-ville.<br />
Cette grande métropole, Dakar, était reliée par chemin de fer à Saint-louis1,<br />
à Linguère 2 , à Kaolack 3 et à Bamako 4 au Soudan. Par ce rail, la ville avait vu passer en<br />
1954 3.249.000 passagers et 735.000 tonnes de marchandises 5 (arrivées et départs.) Le<br />
port ne manquait pas de dynamisme car si en 1956, il Y avait eu 40.055 passagers<br />
embarqués et débarqués, ce chiffre était passé à 55.713 en 1957 et à 62.534 en 1958.<br />
L'aéroport avait vu s'embarquer et débarquer 100.347 passagers en 1956 et 118.539 en<br />
1957. L'année 1958 voyait ce chiffre atteindre 129.019. Un réseau routier dense<br />
desservait la ville. Le parc automobile de la capitale, au 31 décembre 1957, se composait<br />
de 17.482 véhicules dont 10.625 voitures particulières et 904 autobus et autocars. L'âge<br />
moyen des véhicules dépassait 6 à 7 ans. Pour l'année 1958, c'étaient 959 voitures<br />
particulières et commerciales qui étaient nouvellement immatriculées dans la presqu'île.<br />
L'intensité de la circulation automobile était attestée, en 1959, par ces chiffres:<br />
- 4.000 véhicules par jour à la sortie de l'autoroute Dakar-Rufisque<br />
- 10.000 véhicules par jour au pont de la Gueule Tapée, dans la Médina,<br />
- 20.000 véhicules au carrefour de la place Protêt, au centre du Plateau 6 .<br />
Ces chiffres d'immatriculation et de moyenne circulation traduisent, tout<br />
juste un niveau d'équipement pour la capitale de l'ADF. L'important est de savoir<br />
comment la population réagissait par rapport au problème quotidien du transport.<br />
Différents éléments montrent que la question du transport était épineuse<br />
dans cette vaste agglomération. "Paris-Dakar,,7 faisait état d'une lettre adressée au<br />
Délégué du gouverneur à Dakar. Des habitants de Rufisque et Bargny se plaignaient des<br />
tarifs décidés par les pouvoirs publics, à compter du 1 er octobre 1948. Ils trouvaient trop<br />
élevés les tarifs suivants:<br />
- 30 F entre Dakar et Rufisque<br />
1. 263 km<br />
2.321 km<br />
3. 225 km<br />
4.1230 km<br />
5. Fiche N"21, notice état-major.<br />
6. Fiche 32, Infrastructures.<br />
7. N° du 17 novembre 1948.<br />
407
- 35 F entre Dakar et Bargny<br />
Les plaignants constataient que, sur ces mêmes trajets, une hausse de 5 F<br />
était intervenue. Ils soulignaient les nouvelles difficultés nées de ces majorations<br />
entraînant une nouvelle ponction, non négligeable sur le pouvoir d'achat. La lettre<br />
remarquait que cette situation était d'autant plus sensible que ces travailleurs, obligés,<br />
quotidiennement d'effectuer la navette, étaient dans leur écrasante majorité des<br />
ouvriers dont les salaires variaient entre 3280 et 5720 F CFA par mois. Le coût du<br />
transport était ainsi chiffré à 1500 F CFA par mois soit 45 % des bas salaires et près de<br />
26 % des salaires élevés. Les plaignants mettaient en relief un autre facteur. Ne pouvant<br />
faire quotidiennement 4 fois le même trajet, ils étaient obligés de se mettre en demi<br />
pension, à midi, dans la capitale. Ceci entraînait, en moyenne, une dépense<br />
supplémentaire de 500 F par mois. Ces habitants de Rufisque et Bargny en arrivaient à<br />
se demander ce qu'il leur resterait, dans ces conditions, pour pouvoir nourrir leurs<br />
familles. Bien sûr, à travers cette lettre transparait la condition souvent misérable de ces<br />
travailleurs. Mais, on remarque que ceux qui se plaignaient ainsi étaient des travailleurs<br />
salariés aux revenus certains. Il était évident que ces hausses de tarifs des transports<br />
créaient pour les non salariés, obligés de faire la même navette quotidienne, des<br />
problèmes difficilement surmontables. Salariés et non salariés subissaient donc,<br />
amèrement, ces hausses.<br />
Près d'une dizaine d'années plus tard, un véritable conflit surgit entre<br />
l'administration et les fonctionnaires, à propos de ce même problème du transport; la<br />
cause en était l'arrêté n09.489-SET du 2 novembre 1956 du gouverneur général de<br />
l'AOF. Celui-ci ordonnait la hausse des prix du transport au profit de la Régie des<br />
Transports du Cap Vert 8 .<br />
Dans une lettre adressée au gouverneur général, le président de l'Association<br />
des fonctionnaires africains de la ville exprimait toute l'indignation ressentie par les<br />
membres de son association. Moussa SalI, médecin africain et président de cette<br />
association, regrettait que la démarche faite par son bureau pour rencontrer les<br />
autorités à propos de ces mesures de hausse, se soit heurtée à une fin de non recevoir.<br />
La lettre n° 17.526/cab/CA/C du directeur du cabinet civil du Haut Commissaire<br />
confirmait ce refus. Cette démarche, introduite avant même que l'arrêté soit publié,<br />
était l'occasion de faire pression avant que le projet ne devienne réalité. C'était dès le 16<br />
octobre 1956. La hausse des tarifs concernait uniquement la Régie des Transports du<br />
Cap Vert, laquelle société avait vu le jour en avril 1951, à l'initiative de l'administration.<br />
La décision mettait, à la charge complète du fonctionnaire, une somme de 1.000 F par<br />
mois pour son transport par les moyens de la Régie. Les épouses des fonctionnaires<br />
également devaient acheter des carnets de couleur verte pour leur transport au prix de<br />
8. "l'AOF du 15 décembre 1956.<br />
408
1000 F, exactement comme les domestiques travaillant en milieu européen dakarois.<br />
Pour l'association des fonctionnaires, ces nouvelles mesures décidées par<br />
l'administration revêtaient un caractère injuste, sur un double plan:<br />
- depuis avril 1951 c'est à dire la création de la Régie, les tarifs étaient en<br />
hausse constante pour le fonctionnaire. En effet, au début, son transport était gratuit. A<br />
partir de janvier 1952, il avait dû payer 400 F pour son transport. La hausse, intervenue<br />
en octobre 1956, représentait 150 % par rapport au prix de 1952. Son épouse, par<br />
rapport à la même période subissait une hausse de 100 % pour son transport: 1000 F au<br />
lieu de 500 F. Pour elle aussi la hausse avait été progressive; de 500 F le prix avait passé<br />
à 700 F en 1953 pour aboutir à 1000 F en 1956.<br />
Ces hausses apparaissaient à l'égard des fonctionnaires, comme trop fortes,<br />
avec des incidences incontestablement néfastes, pour le pouvoir d'achat, surtout lorsque<br />
le tableau du minimum vital n'était pas revu à la hausse.<br />
- Sur les principes, les fonctionnaires constataient la vitesse vertigineuse avec<br />
laquelle les avantages acquis étaient progressivement rognées par l'employeur, c'est à<br />
dire l'administration. Ils faisaient remarquer que la ville de Dakar, depuis la fin de la<br />
guerre, avait connu un net accroissement de son espace, au moment même où ces<br />
avantages diminuaient dans un sens inversement proportionnel à cette extension. D'un<br />
transport entièrement gratuit, on était passé à une étape où le fonctionnaire devait<br />
payer 400 F et où l'administration prenait en charge le complément, 800 F. Puis toute la<br />
charge de son transport lui était revenue. En somme, un renversement complet de la<br />
situation était ainsi opéré.<br />
Ce mécontentement des fonctionnaires s'articulait sur d'autres hausses<br />
concernant l'eau et l'électricité. La conjonction de ces diverses hausses, faisait dire à<br />
l'association « Qu'on cherchait à démolir de plus en plus l'équilibre dans les familles des<br />
fonctionnaires africains, mais même de tous les Africains dans la mesure où les<br />
répercussions évidentes étaient générales. » Les fonctionnaires craignaient de voir les<br />
hausses opérées par l'administration faire boule de neige dans la mesure où les tarifs de<br />
transport étaient de 20 F par trajet dans la capitale, et ceux des "cars rapides", transports<br />
privés, de 15 F. « Cette anomalie va appeler à très brève échéance, une réaction des<br />
transporteurs privés qui majoreront leur tarif sans que vous ayez la possibilité de vous y<br />
opposer par le fait même que vous avez donné l'exemple » écrivait le président Moussa<br />
SaIl à ce sujet au gouverneur général.<br />
Il réfutait les arguments développés pour justifier ces hausses, à savoir une<br />
situation déficitaire de la société de transports publics, pour ne retenir qu'une volonté<br />
délibérée de porter atteinte au niveau de vie des fonctionnaires africains. En effet,<br />
constate la lettre, les fonctionnaires européens et leur famille n'étaient aucunement<br />
touchés par ces hausses et ceci « en raison des privilèges de toutes sortes que le régime<br />
(leur) accorde. » Le président Moussa SaIl détaillait ces privilèges en matière de<br />
409
transport de la manière suivante: la femme du fonctionnaire européen pouvait partir au<br />
marché avec son boy, ou avec ses enfants à la plage par exemple, dans une voiture de<br />
l'administration. Le mari, évidemment, n'avait aucune difficulté à utiliser la voiture de<br />
son service. En outre, estiment le président et les membres de son association, ces<br />
hausses étaient d'autant plus inquiétantes qu'elles s'inscrivaient dans une logique<br />
coloniale, concrétisée par les plans d'urbanisation de la capitale fédérale : « Les<br />
Européens se déplacent, de plus en plus, de la banlieue vers la ville et les Africains, de<br />
Dakar vers les quartiers périphériques et la banlieue. »<br />
L'association des fonctionnaires africains n'hésitait pas à faire part au Haut<br />
Commissaire de la stratégie d'opposition qui serait développée par la suite : « Notre<br />
association est décidée à employer tous les moyens, afin d'éveiller la conscience des<br />
fonctionnaires à défendre jusqu'au bout leurs droits constamment foulés au pied et leurs<br />
intérêts de plus en plus menacés... boycott des cars de la Régie au profit des transporteurs<br />
particuliers jusqu'à ce que les autorités se penchent sur notre situation. » L'autre aspect de<br />
la stratégie que l'association comptait développer était une réponse unitaire sur la<br />
question dans la mesure où des contacts allaient être établis avec toutes les centrales<br />
syndicales intéressées par ces hausses des tarifs de transport. Les uns et les autres<br />
mèneraient ainsi, ensemble, des actions concrètes de lutte. Cette lettre, adressée au<br />
gouverneur général, traduisait bien un véritable ras le bol des milieux indigènes sur la<br />
question du transport urbain.<br />
Du reste, des enquêtes, menées en 1952 et 1953 par A. Hauser, membre de<br />
l'équipe sociologique de Dakar, sur les industries de transformations, faisaient<br />
apparaître qu'une seule entreprise transportait son personnel 9 . La banlieue s'étendait<br />
sur 30 km. Dans une autre étude sur le mode de vie du travailleur africain, menée en<br />
1953 à Dakar, aucun élément ne permet d'affirmer que dans le secteur privé, la question<br />
du transport du personnel africain était prise en considération10.<br />
Par contre, un fait insolite est signalé; des entreprises qui, en temps normal<br />
ne transportaient pas leur personnel, le faisaient pour des non grévistes. A ce sujet,<br />
"Marchés tropicaux"ll, parlant des grèves de plusieurs semaines dans la capitale<br />
fédérale au milieu de l'année 1957, écrivait: « Les véhicules des entreprises transportant<br />
les non grévistes sont toujours pris à partie par les grévistes qui leur lancent des pierres »<br />
Sous le gouvernement de la loi-cadre, les coûts des tarifs de transport<br />
connaissaient de nouvelles hausses. Ainsi, par arrêté du ministre de l'économie générale<br />
du Sénégal, les tarifs suivants étaient homologués le 1 er février 1958 :<br />
25 F Dakar - Pikine<br />
50 F Dakar - Rufisque<br />
9. A. Hauser, Les industries de transformation... p.73<br />
10. "Marchés Coloniaux" 0°406, TI août 1953.<br />
11. N" 617, 7 septembre 1957.<br />
410
65 F Dakar - Bargny<br />
Cette nouvelle hausse fut à l'origine d'un véritable mécontentement de la<br />
population. Ainsi, lorsque les grèves générales éclatèrent quelques mois plus tard, l'une<br />
des revendications centrales, tant chez les fonctionnaires que dans le secteur privé, porta<br />
sur la réduction, à défaut de la suppression pure et simple de ces mesures du 1 er février<br />
1958.<br />
Elles concernaient les transports urbains de Dakar et des autres villes, mais<br />
également le transports automobiles inter-urbains, tout comme les transports<br />
ferroviaires. Or, la situation générale des chemins de fer n'avait jamais été mauvaise.<br />
Bien au contraire. Par exemple, en 1948, la Régie des Chemins de Fer avait dégagé un<br />
bénéfice de 138 millions de F CFA12. Or, cette même année, un long conflit social avait<br />
paralysé ce moyen de transport, près de 6 mois durant, sur la quasi totalité du réseau.<br />
La question du transport restait une préoccupation réelle dans la capitale<br />
fédérale. Les travailleurs, dans le secteur public, comme dans le secteur privé, avaient<br />
eu, diverses occasions de traduire leur mécontentement.<br />
Le rôle de l'administration comme responsable de ces hausses - souvent<br />
disproportionnées par rapport aux revenus - donnait bien l'impression d'une politique<br />
appliquée sciemment. La situation des non salariés, face au difficile problème du<br />
transport à Dakar, apparait à travers ces protestations des salariés des secteurs public et<br />
privé, comme plus dramatique encore. Seuls avaient été pris en considération dans ces<br />
hausses, les intérêts de la Régie des Transports et des hauts milieux économiques<br />
locaux.<br />
11/ L'IMPOT<br />
Cette question apparaît comme l'un des paramètres d'appréciation de la<br />
prise de conscience de la population, mais aussi, de l'efficacité des structures<br />
d'imposition et de recouvrement; tout comme de l'importance de la liberté de<br />
manoeuvre de l'équipe municipale, ainsi que du niveau de vie de la population dans la<br />
capitale fédérale.<br />
"Echos d'Afrique Noire", pendant toute la période 1948 à 1960, a consacré<br />
toute une série d'articles à cette question de l'impôt. La rédaction du journal demandait<br />
aux Africains, s'ils voulaient profiter de la civilisation, de payer d'abord les impôts13. Le<br />
journal insistait sur le fait que les Européens en avaient assez d'être les seuls à payer les<br />
impôts. Dans une autre livraison, le journal accusait la Municipalité de Dakar<br />
"d'arroser" toutes ses réceptions, avec le champagne provenant de l'impôt payé par les<br />
seuls Européens. Plus tard à propos des investissements faits par le FIDES, la rédaction<br />
12. "Marchés Coloniaux" N"199, 3 septembre 1948.<br />
13. "Echos d'Afrique noire", Août 1950.<br />
411
Le rapport de la Cour des Comptes, après avoir passé au crible les exercices<br />
budgétaires de 1945 à 1950, retenait aussi, entre autres causes de cette situation, une<br />
certaine complaisance des services municipaux, dans le recouvrement des impôts et<br />
taxes 21 . D'autres organes de la presse dakaroise avaient fait, eux aussi, le même constat,<br />
comme "Echos d'Mrique noire", "Condition Humaine", "Réveil" etc...<br />
Mais sur cette question précise de la fuite et du retard du paiement de<br />
l'impôt, le maire de Dakar réfutait l'essentiel des arguments développés contre ses<br />
services en écrivant: « Il ne faut pas perdre de vue que les recettes ne dépendent nullement<br />
de la Municipalité de Dakar et encore moins le recouvrement. » Le maire le rappelait en<br />
1953, au Haut Commissaire et en 1954 au ministre de la FOM. En fait, les services du<br />
receveur général de l'AOF étaient seuls chargés du recouvrement des impôts et taxes<br />
directes et indirectes au titre de la municipalité de Dakar, et ceci en application de la loi<br />
créant les communes de plein exercice du Sénégal.<br />
Parmi les raisons de cette situation, une certaine impunité à l'égard des<br />
mauvais payeurs. Par exemple si des contribuables solvables, avertis du rôle social de<br />
l'impôt, comme les membres du barreau de Dakar, s'acquittaient de leurs impôts avec<br />
des retards importants, c'était bien parce qu'ils bénéficiaient de l'impunité. Du reste,<br />
lorsque la Cour des Comptes recommandait d'user à leur égard de "discrétion" pour<br />
faire rentrer les impôts, c'était parce que leur poids social les autorisait à un tel<br />
comportement à l'égard de l'impôt. Autre élément d'explication, le le fait qu'à cette<br />
période, ils étaient Européens dans leur quasi totalité.<br />
Quant à la masse des indigènes, diverses raisons jouaient à la fois:<br />
- la complaisance des services municipaux. Le rapport de la Cour des<br />
Comptes en faisait état. Il prenait comme preuve, la gestion des halles et stalles des<br />
marchés de la ville. Les comptes avaient fait apparaître des entrées de 243.000 F pour<br />
l'année 1950. La somme qui aurait dû être versée s'élevait à 637.500 F CFA c'est à dire<br />
2,62 fois plus.<br />
- Le caractère flottant d'une large fraction de la population de la ville. Des<br />
études, menées pendant cette période, chiffraient entre 10 à 15 % cette population non<br />
fixe. La forte immigration dans la capitale pendant les années 50, est l'explication de<br />
cette importance de la population flottante.<br />
- Un certain aspect de prolétarisation progressive de cette masse de la<br />
population. Ceci entraînait des difficultés réelles, sinon une impossibilité, pour de larges<br />
couches de s'acquitter de l'impôt.<br />
D'autre part, comme le remarquent quelques uns de nos interlocuteurs,<br />
certains habitants de Dakar, continuaient à payer l'impôt au niveau de leur village<br />
d'origine en raison de l'exigence du commandant de cercle, du chef de canton ou du chef<br />
21. Carton 2129, dos 7.<br />
414
de village... Les parents, demeurés sur place, n'avaient aucun moyen de refuser de payer<br />
pour les leurs partis à la capitale. Ceux-ci se devaient obligatoirement d'envoyer<br />
l'argent.<br />
Sous tous ces aspects: retard et fuite, la question de l'impôt ne manquait pas<br />
de peser lourdement sur les problèmes de la gestion financière et matérielle de la<br />
Commune de Dakar. Au point de vue politique, cette gestion restait un point central,<br />
particulièrement lors des compétitions municipales, pour la direction de la ville.<br />
L'administration, tout comme l'Assemblée Territoriale du Sénégal, étaient impliquées<br />
directement dans ce débat. C'est dire à quel point le problème de l'impôt revêtait une<br />
importance capitale à cette période.<br />
415
QUATRIEME PARTIE<br />
GESTION ET ORIENTATION<br />
INTRODUCTION<br />
Avec les problèmes de la gestion de la municipalité de Dakar et aussi la<br />
validité des consultations électorales, reste posée la question de la conception du<br />
pouvoir surtout dans les années qui ont suivi la loi-cadre. Pour l'essentiel, une continuité<br />
coloniale se dessine dans le nouvel appareil étatique au regard de son orientation<br />
politique, économique et sociale.<br />
416
CHAPITRE 1 LA GESTION DE LA MUNICIPALITE DE DAKAR<br />
Il LES RESPONSABLES MUNICIPAUX<br />
La période 1945-1960 est marquée par une permanence de la présence du<br />
parti SFIO à la direction des affaires municipales. La présence d'une opposition faible et<br />
tardive au sein de l'équipe municipale n'est jamais en mesure d'empêcher la SFIO de<br />
mener à terme ses activités en raison de son quasi monopole de l'ensemble. Cependant,<br />
cette longue gestion donne lieu à de multiples critiques. Les responsables municipaux<br />
sont issus d'élections dont les caractéristiques globales laissent une large place à la<br />
contestation. (Voir questions électorales, chap. suivant).<br />
1) Le maire et ses adjoints<br />
Lamine Guèye avait conduit toutes les listes électorales SFIO à la conquête<br />
de la municipalité. Avocat de formation, cet homme politique est très connu dans les<br />
milieux dakarois de l'entre-deux guerres à cause de ses plaidoiries contre<br />
l'administration et le grand commerce. Relativement en marge de la résistance pendant<br />
la guerre, il n'est tout de même pas compromis dans la collaboration avec le vichysme.<br />
Sa stature lui ouvre, à Dakar particulièrement, les portes politiques après la guerre. Aux<br />
premières élections municipales de l'après-guerre en 1945, sa liste "Bloc Africain"<br />
remporte la victoire contre celle du maire sortant Alfred Goux, malgré le passé notoire<br />
de résistant de ce dernier. A la tête de la municipalité de Dakar, en octobre 1947, il<br />
confirme largement la victoire acquise deux ans plus tôt. En avril 1953, tout comme en<br />
novembre 1956, il obtient de nouveaux: succès électoraux. Au niveau même du conseil<br />
municipal, il n'a d'opposant au poste de maire qu'en novembre 1956, date à laquelle se<br />
présente contre lui son ancien adjoint, Bâ Amadou, passé à l'opposition B.P.S un an<br />
auparavant. Mais le rapport de force au niveau de l'équipe municipale élue pour la<br />
première fois à la proportionnelle, lui permet de garder son poste de maire1.<br />
Pour diverses raisons, Lamine Gueye ne fut que très rarement présent aux<br />
délibérations de son conseil municipal. En effet, il est député du Sénégal de 1945 à juin<br />
1951, et cette responsabilité exercée au Palais Bourbon, à Paris, le retient souvent loin<br />
de son conseil municipal. D'autre part, l'exercice de sa profession d'avocat, notamment<br />
lors du procès des députés malgaches accusés par l'administration coloniale d'avoir<br />
fomenté, en 1947, la rébellion dans la Grande Ile, l'empêche d'être présent à Dakar, car<br />
1. Délibération spéciale du Conseil Municipal, 24 Novembre 1956.<br />
417
il circule alors entre Tananarive et Paris. Une autre raison de sa longue absence de<br />
Dakar, vient des hautes responsabilités qu'il exerce dans les instances dirigeantes de la<br />
SFIO à Paris, où longtemps, la section d'AOF/Togo dont il est le chef, est la sixième<br />
fédération par ordre d'importance . De plus l'homme assume aussi des responsabilités<br />
ministérielles. II est sous-secrétaire d'Etat à la présidence du conseil dans le<br />
gouvernement Léon Blum, du 17 décembre 1946 au 22 janvier 1947 2 . La durée de cette<br />
activité gouvernementale est brève mais elle le retient à Paris. II est aussi chargé de<br />
diverses missions aux Nations Unies, à Genève et en Afrique comme par exemple lors<br />
de la préparation du voyage du Président de la République Vincent Auriol en Afrique<br />
noire en Avril 1947 3 .<br />
Des raisons politiques le retiennent largement à Paris entre 1951 et 1952 car<br />
il doit suivre la procédure qu'il a engagée auprès des instances parisiennes pour<br />
contester sa défaite électorale. A ces multiples causes d'absence, s'ajoutent des raisons<br />
personnelles de santé qui l'immobilisent de longs mois durant à Paris 4 pendant l'année<br />
1952. Tout cela explique donc que Lamine Guèye soit souvent porté "absent excusé" sur<br />
les procès-verbaux de délibération du conseil municipal de Dakar. Du reste, lui-même<br />
reconnait cet état de fait dans une importante intervention devant l'équipe municipale,<br />
dans les termes suivants «l...] Je n'ai pas eu l'occasion de présider si souvent que je le<br />
souhaiterais les délibérations de notre conseil municipal et ceci à cause de mes nombreuses<br />
obligations. »5<br />
Ces longues et fréquentes absences de Lamine Guèye, maire de Dakar, ne<br />
manquèrent pas d'avoir des répercussions néfastes sur le fonctionnement même de<br />
l'administration municipale. En effet, les limites objectives liées à toute délégation de<br />
pouvoir mais surtout les rivalités de personnes au sein même de l'équipe dirigeante, en<br />
particulier entre ses divers adjoints, se conjuguent pour rendre parfois la situation<br />
difficile. Celle-ci est même réellement explosive en certaines circonstances. Ainsi, à<br />
plusieurs reprises en 1948 et 1949, des rapports de police et de sûreté mettent largement<br />
en exergue cette mésentente au sein des responsables. La synthèse d'août 1948 de ces<br />
services écrit «[...] Les querelles d'influence au sein du conseil municipal entre conseillers<br />
lébous et conseillers saint-louisiens se poursuivent sans arrêt l...] en l'absence du maire<br />
titulaire»6. La même source notait un an plus tard, toujours à ce sujet «Deux clans se<br />
sont formés au conseil municipal le clan Bonifay 1er adjoint et le clan BâAmadou... »7 En<br />
1952, encore la situation atteint presque un point de non retour dans la mesure où un<br />
véritable acte de défiance est même voté par plusieurs conseillers contre l'adjoint<br />
2. "Paris-Dakar" du 17 décembre 1946 et 27 janvier 1947.<br />
3. "Paris-Dakar" du 5 mars 1947 et du 1er avril 1947.<br />
4. Lettre de Thierno Amath Mbengue à Lamine Guèye à Paris, Septembre 1952.<br />
5. Délibération du conseil municipal, Dakar, 5 avril 1958.<br />
6. Affaires politiques AOF, Délégation rapport 1948, ANS, dos 2G 48-117.<br />
7. Ibidem, 1949, dos 2G 49-123.<br />
418
délégué faisant fonctions de maire 8 . Les signataires d'un document intitulé "injonctions"<br />
-- s'articulant en 8 points -- exigent purement et simplement la fin de la délégation pour<br />
le "faisant fonctions" Amadou Bâ. Ce texte est envoyé au maire titulaire, se trouvant à<br />
l'époque à Paris, mais aussi au délégué du gouverneur du Sénégal à Dakar, au<br />
gouverneur à Saint-louis et au Haut commissaire de l'AOF. Le conseiller lébou Thierno<br />
Amath Mbengue, adjoint délégué aux: affaires sociales et domaniales, qui conduit la<br />
rébellion, exige l'abrogation immédiate de la délégation faite à Bâ Amadou et le<br />
remplacement par le 1 er adjoint Paul Bonifay, dans la lettre expédiée d'urgence au<br />
maire. II demande même à Lamine Guèye «Si votre état de santé vous le permet, [. ..J de<br />
venir à Dakar pour quelques jours pour régler cette affaire qui nous préoccupe au mieux des<br />
intérêts de notre parti. » Pour cet adjoint, le maire titulaire doit se décider rapidement car<br />
« Les événements ont pris brusquement une tournure, tellement dangereuse, avec une telle<br />
'd" 9<br />
rapi Ife... »<br />
Cependant Lamine Guèye, à chacun de ses retours à Dakar, a suffisamment<br />
de ressources pour mettre de l'ordre dans l'équipe municipale. Les rapports de police et<br />
sûreté confirment ce poids moral du maire de Dakar. Par exemple, une synthèse, à la<br />
date du 12 août 1949, écrit « Lamine Guèye, de retour à Dakar, à son domicile, a tranché<br />
le différend qui opposait certains conseillers municipaux [. ..J a définitivement fixé les<br />
attributs de chacun dans l'administration de la commune. » Mais la bonne volonté du<br />
maire et sa carrure politique n'empêchent pas, à diverses occasions, les disputes et<br />
querelles de rebondir surtout sur les questions de la gestion de la ville ou à l'occasion<br />
des renouvellements des structures municipales. Dès lors, une question se pose.<br />
Comment sont élus ces adjoints au maire?<br />
Une délibération en date du 2 mai 1953 donne une réponse. En effet, après<br />
les élections municipales du 26 avril, l'assemblée communale tient sa première session.<br />
Un seul point figure à l'ordre du jour l'élection du maire et de ses adjoints. Toute<br />
l'équipe municipale est élue au scrutin majoritaire sur la liste SFIO. Si Lamine Guèye<br />
est candidat unique au poste de maire et obtient les suffrages des 36 présents, l'élection<br />
des adjoints est une véritable compétition, qui manifeste la rivalité et la jalousie qui<br />
existent entre ces élus de la même liste, ainsi qu'un manque de coordination dans les<br />
rangs laministes. Les vainqueurs se disputent chaudement les postes par suite du climat<br />
qui règne au sein de l'équipe municipale pendant l'année 1953 . En effet, cette période<br />
est marquée par divers conflits de personnes, par exemple ceux: qui opposent Bara Diop<br />
et Amadou Bâ, ou Thiemo Amath Mbengue et Amadou Bâ, sans oublier celui de la<br />
défiance ouverte de divers conseillers à l'égard d'Amadou Bâ faisant fonctions de<br />
maire. En effet, lors de cette séance du 2 mai 1953, après que Paul Bonifay est élu -<br />
candidat unique -- comme 1 er adjoint, il y a<br />
8. Délibération du 17 septembre 1952.<br />
9. Dossier A/42, Archives municipales, Mairie de Dakar.<br />
419
scrutin.<br />
3 candidats pour le poste de 2eme adjoint<br />
3 à celui de 3eme adjoint<br />
3 candidats pour le poste de 4eme adjoint.<br />
Il faut même un 2eme tour de scrutin pour départager les candidats.<br />
3 candidats pour le poste de 5eme adjoint, ce qui nécessite un second tour de<br />
5 candidats pour celui de 6eme adjoint<br />
4 candidats pour le poste de 7eme adjoint<br />
6 pour celui de 8eme adjoint<br />
4 pour celui de geme adjoint<br />
5 pour le poste de lOeme adjoint<br />
3 pour celui de lIerne adjoint<br />
5 candidats pour le poste de 12eme adjoint<br />
Tout ceci donne une moyenne de 3,14 candidats par poste pour l'ensemble<br />
du bureau municipal. En considérant la diversité des candidats, pour les postes en<br />
compétition, des données de simple démocratie ne suffisent pas à expliquer l'âpreté<br />
d'une telle lutte entre élus de la même liste. Un autre scrutin relatif à cette équipe<br />
municipale permet de se faire une idée de cette situation de féroce compétition. En<br />
effet, après les élections municipales du 18 novembre 1956, le conseil élu pour la<br />
première fois à la proportionnelle, par suite de la modification de la loi électorale,<br />
comprend 3 partis politiques P.S.A.S et R.D.A alliés, et le B.P.S constituant<br />
l'opposition. Le parti laministe pouvant se prévaloir de la majorité absolue, use<br />
largement de cette arme pour opposer une fin de non recevoir à la proposition des<br />
adversaires B.P.S. qui souhaitent constituer un bureau municipal englobant les trois<br />
formations représentées au conseil
du budget. Il décide alors de s'abstenir totalement lors du vote, et la majorité socialiste<br />
du conseil fait adopter le budget par 26 voix contre 9.<br />
Quant au fonctionnement des commissions de travail du conseil municipal,<br />
l'analyse des résultats de la délibération du 27 mai 1953 devant désigner les membres<br />
des 10 commissions, fait apparaître<br />
Total des commissaires 164<br />
Nombre de membres du conseil 37<br />
Chaque conseiller était membre de 4,4 commissions en moyenne.<br />
Ces commissions sont chargées de faire le travail préparatoire soumis à la<br />
délibération de l'assemblée municipale ; étant donné le caractère technique et<br />
l'importance des travaux, il en résulte effectivement une véritable surcharge de travail<br />
individuel. Tout ceci alors que le conseil, de sa propre initiative, décide d'élargir le<br />
nombre de membres par commission, en alléguant les difficultés du travail. Il contourne<br />
ainsi d'ailleurs l'article 59 de la loi du 5 avril 1884 qui fixe le nombre en rapport avec<br />
l'importance numérique des conseillers municipaux.<br />
Une plus grande surcharge individuelle dans le travail apparait en novembre<br />
1956 lorsque seul le parti laministe - 21 conseillers sur 37 - écarte les membres de l'autre<br />
formation, B.P.S, de la constitution des commissions, après avoir accaparé tous les<br />
postes du bureau municipal. Tout compte fait, même avec les 8 commissions au lieu des<br />
10 arrêtées en 1953, la surcharge de travail individuel est encore plus nette à cette<br />
période. Les effets négatifs apparaissent vite. L'analyse des procès-verbaux des travaux<br />
des commissions permet d'apprécier l'effectivité de la présence des conseillers dans<br />
l'exécution de leurs tâches<br />
- la moyenne de présence aux séances se situe entre 20 et 26 avec les<br />
absences excusées et les autres absences nombreuses.<br />
- diverses séances sont reportées faute de quorum. Exemple celle du 12 mars<br />
1951 13 présents, 5 excusés et 17 absents. Or cette séance doit être importante car la<br />
semaine précédente l'assemblée s'est séparée dans un climat de confusion totale, après<br />
avoir discuté d'une proposition de résolution présentée par Abbas Guèye et relative au<br />
projet municipal de nomination des chefs de quartier. La discussion est si vive et confuse<br />
que le procès-verbal, rédigé à la fin de la réunion, donne lieu à de vives contestations<br />
particulièrement de la part de Abbas Guèye qui adresse une lettre au maire à ce sujet.<br />
Cette surcharge devient plus évidente quelques années plus tard lorsque le<br />
parti larniniste, simplement majoritaire en 1956, s'empare de la totalité des<br />
commissions. Les 21 élus du parti doivent seuls garnir les 8 commissions. De toute<br />
évidence, cette situation crée en elle-même une obligation de présence trop lourde aux<br />
réunions et ne permet plus l'efficacité nécessaire au travail municipal des élus.<br />
421
2) Quelques caractéristiques de l'équipe municipale.<br />
A travers quelques documents comme la liste des candidats SFIO aux<br />
municipales de 1953, il est possible de faire une analyse sociologique du conseil<br />
municipal 10. Au total, il y a 37 membres dont 31 Africains et 6 Européens. Tous sont de<br />
sexe masculin.<br />
ans.<br />
a) Au plan professionnel<br />
- à la retraite = 3<br />
- administration générale = 12<br />
- employés banque, commerce = 8<br />
- commerçants et agriculteurs (service personnel) = 7<br />
- professions libérales = 4<br />
- propriétaires = 3<br />
- directeur de société = 1<br />
- anciens militaires (officiers en retraite) = 2<br />
b) Age des conseillers<br />
Le plus âgé a 69 ans. Il est Africain alors que le plus jeune, un Européen, a 34<br />
De 30 à 35 ans = 1<br />
36-40 ans = 2<br />
41-45 ans = 6<br />
46-50 ans = 9<br />
51-55 ans = 8<br />
56-60 ans = 4<br />
61-65 ans = 6<br />
66 ans et plus = 1<br />
L'âge moyen des conseillers municipaux élus en avril 1953 est de 50 ans. Ils<br />
sont relativement âgés. Cependant, comparativement aux caractéristiques du milieu<br />
lébou notamment, ceci correspond à l'âge de responsabilité parce que c'est celui de<br />
maturité. En effet, l'âge moyen des Diambours -- principale assemblée de ce groupe -est<br />
la cinquantaine.<br />
10. Commune de Dakar, élections municipales du 26 avril.<br />
Candidats - liste socialiste SFIO-Républicaine.<br />
422
c) Lieu de naissance<br />
17 conseillers sont nés à Dakar, Gorée et banlieue c'est-à-dire dans<br />
l'ensemble de la presqu'île du Cap vert.<br />
6 sont nés à Saint-louis<br />
4 en d'autres lieux du Sénégal<br />
5 sont nés ailleurs en Mrique<br />
4 sont nés en métropole<br />
1 sans précision aucune.<br />
On remarque que les conseillers nés à Dakar et dans sa banlieue, constituent<br />
numériquement près de la moitié des membres 17 sur le total de 37 élus. Les Saint<br />
louisiens représentent un groupe non négligeable avec un total de 6, c'est le deuxième<br />
par ordre d'importance. Des conflits éclatent fréquemment entre ces deux principaux<br />
groupes de l'équipe municipale, surtout dans la période 1945 à 1953 et divers rapports<br />
municipaux et administratifs, ainsi que divers articles de presse l'attestent. Le maire,<br />
Lamine Guèye, Saint-Iouisien d'origine -- même s'il est né au Soudan -- arbitre<br />
difficilement ces querelles. Lorsque l'adjoint délégué faisant fonction de maire est<br />
Amadou Bâ, autre Saint-Iouisien, de nombreux Lébous, membres du conseil municipal<br />
ou non, pensent que ce groupe "nord" pèse d'un poids trop lourd sur "leur" ville. Ceci<br />
explique leurs multiples protestations. Pourtant, Lamine Guèye s'est adjoint un Lébou<br />
influent comme second responsable de la municipalité en la personne de Omar Ndir.<br />
Mais, au décès de ce dernier, en juillet 1947 11 , il ne rétablit pas l'équilibre par le choix<br />
d'un autre Lébou comme 1 er adjoint. Incontestablement cette situation est dans une<br />
certaine mesure à la base des dénonciations du clan saint-Iouisien par les Lébous. Les<br />
attaques du clan lébou dirigé par Thierno Amath Mbengue contre Bâ Amadou, en 1952,<br />
sont l'expression d'une des phases de la lutte d'influence entre les deux villes, dans le<br />
conseil municipal de Dakar.<br />
d) Niveau culturel<br />
Sur cette question, la base d'appréciation est la profession exercée, dans la<br />
mesure où aucun critère plus précis n'était disponible. La liste des candidats SFIO en<br />
avril 1953 permet de distinguer<br />
- sans C.E.P.E = 4<br />
- C.E.P.E = 10<br />
- Brevet = 14<br />
- Baccalauréat = 5<br />
11. "Paris-Dakar" 1 er et 2 juillet 1947.<br />
423
- Université = 4<br />
On peut estimer que le niveau culturel du conseil municipal se situe à celui<br />
du Brevet et au-delà, ce qui traduit pour la période, des dispositions non négligeables.<br />
Leur âge moyen est une garantie de leur connaissance solide des mécanismes de<br />
fonctionnement d'un conseil municipal.<br />
e) Décorations<br />
10 membres du conseil municipal sont titulaires de la médaille de chevalier<br />
de la légion d'honneur et autres distinctions. Deux (Européens) sont officiers retraités<br />
de l'armée. C'est en somme, une équipe appréciée du colonisateur.<br />
f) Comment ces conseillers sont-ils choisis?<br />
La connaissance de la manière dont le choix est fait pour figurer sur la liste<br />
du parti ne manque pas d'intérêt. Sur les 37 membres du conseil municipal, 15 sont<br />
effectivement les représentants des milieux lébous de la ville. Ils sont désignés comme<br />
candidats de la manière suivante<br />
- 1 représentant par quartier traditionnel ou "pinth" soit au total 12. Selon des<br />
critères propres, chaque village ou quartier traditionnel désigne son propre<br />
représentant.<br />
- 1 représentant pour chacune des assemblées traditionnelles léboues (les<br />
Principaux, les Diambours et les Freys) soit 3. Ces représentants des assemblées<br />
traditionnelles sont choisis au cours d'assises de l'ensemble de la collectivité léboue 12 .<br />
Les villages de la banlieue c'est-à-dire Ouakam, Ngor, Yoff, Cambérène... désignent 3<br />
autres représentants.<br />
Au total, sur les 37 sièges, les Lébous de la ville et de la banlieue occupent 18<br />
sièges au conseil municipal, soit près de la moitié. Cette situation fait que les milieux<br />
lébous de la ville considèrent le conseil municipal comme étant, de fait, leur chose<br />
propre. Ceci explique qu'ils revendiquent le poste de 1 er adjoint responsable de<br />
l'administration de la municipalité. Ce sentiment de "propriétaire" apparait en diverses<br />
circonstances de l'histoire de la ville dans ces années 1945-1960. Par exemple lorsque<br />
l'administration informe le conseil municipal, à la fin de 1953, par lettre, de son<br />
intention de procéder à un nouveau sectionnement électoral de Dakar, accepté déjà par<br />
une délibération de l'assemblée territoriale, elle se heurte à une vive résistance des<br />
milieux lébous. Toùs les grands dignitaires de la Collectivité organisent deux assemblées<br />
extraordinaires sur la question en l'espace d'une semaine. Au cours de ces réunions, des<br />
12. P.V, réunion du 16 avril 1953 chez le Ndeye djirev<br />
pour désigner les candidats lébous aux municipales du 26 avril 1953.<br />
424
propos particulièrement durs sont tenus à l'égard des hautes administrations territoriale<br />
et fédérale et même du parti politique B.D.S. Lors de la première réunion tenue dans le<br />
quartier de Santhiaba chez El Hadj Diagne Mbor, maire indigène, ils expriment leur<br />
indignation en ces termes « L'administration assez gênée dans sa politique de déposséder<br />
la Collectivité de ses te"es [...] trouve mieux de contourner la difficulté en éliminant la<br />
Collectivité léboue de toute représentation forte au sein des assemblées, particulièrement<br />
dans la municipalité de Dakar. »13 . La collectivité léboue voit dans ce projet du<br />
gouverneur du Sénégal une manière de donner à la population européenne de la ville<br />
une représentation plus importante que celle des milieux lébous par la détermination<br />
des 4 secteurs en question et surtout par le poids donné au secteur du Plateau, lieu<br />
d'habitat des métropolitains dans le sectionnement proposé.<br />
Le 1 er secteur (celui du Plateau) = 18 conseillers<br />
le 2eme (la Médina) = 6<br />
le 3eme ( le Grand Dakar) = 6<br />
le 4eme ( toute la banlieue) = 7<br />
Le conseil municipal de Dakar, à la demande des autorités léboues refuse de<br />
suivre l'administration dans son projet de sectionnement de la capitale fédérale. Dans<br />
l'immédiat, l'opposition des Lébous et du conseil municipal empêche l'exécution du<br />
projet.<br />
Quant aux autres membres non lébous du conseil municipal, ils sont désignés<br />
à la candidature par la direction de la SFIO locale selon divers paramètres dont celui<br />
des alliances politiques. Par exemple aux élections municipales d'avril 1953 à Dakar, 35<br />
conseillers portent l'étiquette socialiste, les deux autres sont des Européens radicaux<br />
socialistes alliés à Lamine Guèye maire sortant. Sur les 37 candidats, 6 sont des<br />
Européens dont l'un, Paul Bonifay devient 1 er adjoint après la victoire SFIO, ce qui est<br />
significatif du poids de ces Européens dans l'arène politique. Ces alliances tiennent lieu<br />
de stratégie globale face au principal adversaire c'est-à-dire le B.D.S qui lui, trouve des<br />
alliés locaux dans le R.P.F, le parti gaulliste.<br />
Une autre caractéristique de ce conseil municipal est le rôle très important<br />
que joue Paul Bonifay. Ce riche avocat des milieux d'affaires dakarois est le 1 er adjoint<br />
au maire de juillet 1948 à la fin de 1956. Très influent dans la gentry dakaroise, il ne<br />
manque pas de poids non plus dans les milieux indigènes qui le surnomment « Bouna<br />
Faye»14 -- simple déformation de son nom en un prénom et un nom locaux faite par<br />
sympathie ou par dérision. Ce poids de Me Paul Bonifay apparait dans les luttes entre<br />
adjoints au maire mais aussi dans celles qui opposent la communauté léboue et les<br />
Saint-Iouisiens. Au plus fort de ces luttes intestines, en 1952, il devient, en fait, un<br />
recours incontournable. Thierno Amath Mbengue, à la tête des signataires du "factum" à<br />
13. Délibération de la collectivité léboue en date du 3-01-1954. Archives municipales, Dakar.<br />
14. P. Biarnès, Les Francais en Afrique noire, 1987, op. cit., p.326.<br />
425
l'adresse de Amadou Bâ, exprime bien cette situation «Notre volonté de voir ue Bonifay<br />
prendre la direction des affaires municipales [. ..J Tel est l'avis de l'opinion publique ».<br />
D'autre part, pour l'administration coloniale, Paul Bonifay est l'homme qu'il faut à la<br />
place qu'il faut. Divers rapports officiels louent sa volonté et son courage à assainir la<br />
gestion municipale15. Il est, au niveau de la SFIO et surtout de la municipalité, le<br />
pendant exact de Léon Boissier PaluA - autre Européen - au B.D.S et au Grand Conseil<br />
de l'AOF. Ce dernier passe pour le "faiseur" des listes de son parti politique. Paul<br />
Bonifay est l'homme des grandes décisions au conseil municipal même si cela ne<br />
manque pas de lui attirer de réelles inimitiés. Une synthèse de police, en fin 1953, dit à<br />
propos des licenciements massifs de personnel opérés par lui «[...J Ceci suscite certaines<br />
critiques dans les milieux SFIO car on l'accuse de faire porter les économies sur les<br />
manoeuvres et petits salariés alors que le "personnel politique" n'est pas atteint»16<br />
En somme le poids de "Bouna Faye" au conseil municipal de Dakar est<br />
important et se fait sentir en diverses circonstances, notamment lors des nombreuses<br />
luttes de clans au sein de l'équipe municipale. Force est de constater que sa qualité<br />
d'Européen -- riche et généreux de surcroît -- et ses solides relations, fondent la toute<br />
puissance du personnage, et lorsqu'en novembre 1956, il perd le poste de 1 er adjoint au<br />
profit d'une grande figure léboue, Amadou Assane Ndoye, c'est très vraisemblablement<br />
que l'impérieuse nécessité de mettre un représentant lébou à ce niveau apparait alors à<br />
Lamine Guèye comme l'ultime moyen de garder un électorat indispensable à son<br />
maintien à la tête de la municipalité. Bonifay n'a cependant nullement perdu sa<br />
confiance.<br />
11/ LA GESTION<br />
L'étude du contenu de la presse dakaroise nous apprend que les critiques à<br />
l'égard de la gestion municipale représentent l'essentiel des commentaires. Très rares<br />
sont les éléments de satisfaction. Ces critiques donnent le point de vue de secteurs très<br />
divers de l'opinion publique dakaroise.<br />
Dans cette partie de l'étude nous présentons la gestion municipale surtout<br />
sous un autre angle, celui des relations entre la municipalité et l'administration<br />
coloniale. Cette dernière est très intéressée par les problèmes du budget communal, du<br />
personnel municipal et de l'utilisation de l'un et de l'autre. Elle réagit souvent tant à<br />
son niveau local que saint-Iouisien et même parisien. Face à l'administration, le conseil<br />
municipal, confronté à des réalités financières, humaines mais aussi politiques<br />
spécifiques, défend son point de vue fermement et avec doigté. Ainsi ce sont des<br />
15. Rapports en Conseil privé les 21 sept et 8 déc 1953.<br />
Synthèse de police et de sûreté, 3eme trimestre 1953.<br />
16. Affaires politiques AOF, ANSOM, Synthèse de police et sûreté, 3eme trimestre de 1953, carton 2230 dos 4.<br />
426
problèmes de fond qui se posent avec acuité à travers cette question de la gestion<br />
municipale.<br />
1) Le budget municipal<br />
Il faut garder en mémoire qu'à partir de 1946, la Circonscription a été<br />
supprimée pour être rattachée directement au territoire du Sénégal. Les moyens<br />
budgétaires de la Circonscription sont, par le décret supprimant cette entité, transférés à<br />
Saint-louis, chef-lieu du territoire. La ville de Dakar n'en garde pas moins ses<br />
caractéristiques de grande métropole, et ses responsabilités de capitale fédérale de<br />
l'AOF. Tout ceci se traduit dans son budget municipal, d'autant plus que dès le 1 er<br />
juillet 1946, une réforme des communes de plein exercice transfère aux municipalités<br />
divers services supplémentaires comme le bureau militaire, l'hygiène municipale, la<br />
petite voirie, la police municipale17 etc... C'est dans ces conditions d'ensemble que le<br />
budget municipal doit être élaboré et exécuté. Le contexte politique général du Sénégal<br />
a, lui aussi, des répercussions plus ou moins importantes, surtout après 1952.<br />
a) Evolution du montant.<br />
Pour quelques exercices budgétaires, des documents disponibles permettent<br />
de voir l'évolution du budget de la municipalité. Cependant, les renseignements relatifs<br />
aux budgets additionnels restent fragmentaires.<br />
Tableau établi à partir de diverses sources sur<br />
l'évolution du budget de la commune de Dakar<br />
Budgets en F.CFA 1952 1953 1957<br />
primitif<br />
additif<br />
total<br />
463.211.000 492.208.500 762.611.200<br />
337.789.000 268.742.247 189.200.000<br />
800.000.000 760.951.247 951.811.200<br />
17. Affaires politiques AOF, A.N.S, Dakar, Rapport annuel de la Délégation, 1946.<br />
427
L.S. Senghor, lors d'un meeting électoral tenu au cinéma Rialto de Dakar, le<br />
8 avril 1953, dit «Les recettes de la municipalité sont 500 millions. Avec une bonne<br />
gestion, elles pou"aient être portées à 800 millions sans qu'il Y ait à faire payerplus d'impôts<br />
»18. Quant au maire de Dakar, il situe l'enveloppe de 1952 pour Dakar à environ 800<br />
millions 19 tant en budget primitif qu'additif. Le gouverneur du Sénégal, au sujet du<br />
budget primitif de l'exercice 1952, donne le chiffre de 463.211.000 F dans une réponse<br />
faite au référé du 1 er président de la Cour des comptes à Paris. Quant au budget de<br />
1953, un rapport fait par le gouverneur du Sénégal en Conseil privé, le 13 octobre 1953,<br />
donne, pour son budget primitif, la somme de 492.208.500. Pour ce même exercice<br />
budgétaire, une réunion du Conseil privé autour du chef du territoire détaille le budget<br />
additif ainsi<br />
- dépenses ordinaires<br />
- dépenses extraordinaires<br />
Total<br />
266.479.326<br />
2.263.421<br />
268.742.747<br />
Une autre réunion du Conseil privé en date du Il février 1954 indique un<br />
autre budget additif de la municipalité de Dakar pour un montant de 39.411.548 F. Le<br />
conseil municipal, en sa délibération du 4 octobre 1956, adopte un budget additif de<br />
327.432.599 F. De même, par une autre délibération en date du 13 octobre 1957, il<br />
approuve un budget primitif de 732.611.200 F dans la section ordinaire et de 30.000.000<br />
en dépenses extraordinaires, soit au total 762.611.200 F.<br />
En considérant simplement les budgets primitifs des exercices 1952, 1953 et<br />
1957, l'évolution du budget municipal était évidente. Cette évolution en 1957, sur la base<br />
100 en 1952 était de 171% soit une augmentation très nette.<br />
b) Confection du budget.<br />
Un certain nombre de critiques sont formulées par les services compétents de<br />
l'administration du territoire à Saint-Louis, sur la confection du budget municipal de<br />
Dakar.<br />
En août 1953, le Bureau des communes indique avoir reçu, à la date du 22<br />
juillet 1953, le budget de la commune de Dakar délibéré et voté le 6 juillet c'est-à-dire<br />
quelques 2 semaines auparavant. A son sujet, l'administration remarque qu'il est<br />
accompagné du procès-verbal de délibération, d'un exposé des motifs et d'un<br />
18. "Paris-Dakar" du 9 avri11953.<br />
19. Lettre du maire de Dakar au Haut commissaire de l'AOF, 21 juin 1953.<br />
428
développement des dépenses de personnel 20 . Elle ajoute «Ce document a été réclamé<br />
au moins 20 fois à la municipalité et il a été question, à un moment donné, de l'établir<br />
d'office ». Le Bureau des communes a même pris des dispositions conservatoires dans ce<br />
sens puisqu'il écrit dans ce rapport à l'adresse du gouverneur du Sénégal «Il est à<br />
signaler que les grandes lignes ont été établies depuis le mois de juin, les seTVices du Haut<br />
commissaire en ont été infonnés depuis début juillet ». Sur cette question un autre rapport<br />
à l'adresse du gouverneur du Sénégal en Conseil privé le 21 septembre 1953, s'exprime<br />
ainsi en son introduction «Ce rapport de présentation du budget de la commune de Dakar,<br />
paTVenu le 1 er septembre, ne sera pas absolument orthodoxe. » La conclusion du rapport<br />
est que «Ce budget est malheureusement influencé par les élections du 26 avril qui ont<br />
empêché qu'il soit présenté plus tôt à l'approbation. »<br />
Un autre rapport, en Conseil privé, en date du 13 octobre 1953, relatif au<br />
budget de la commune de Dakar, pour l'exercice 1953 remarque «Il doit être signalé<br />
toutefois [. ..) la carence des municipalités et aussi le fait que les budgets primitifs sont<br />
établis avec un retard considérable. » Ce rapport recommande cependant, au gouverneur<br />
du territoire d'approuver la délibération du conseil municipal du 25 août portant sur ce<br />
budget. Toujours au sujet de l'élaboration du budget communal, un rapport<br />
administratif, soumis au Conseil privé du 26 janvier 1954, sur une délibération<br />
municipale de Dakar pour un budget additionnel, constate «Les prévisions budgétaires<br />
étant insuffisantes pour assurer le fonctionnement nonnal des seTVices durant la période<br />
d'exécution du budget, il est indispensable de procéder à un renforcement de ces prévisions.»<br />
Un rapport destiné au chef du territoire, en Conseil privé le 2 février 1954,<br />
recommande l'annulation, par arrêté, de la délibération du Conseil municipal de Dakar<br />
créant, à la date du 30 décembre 1953, 20 centimes spéciaux dont le produit est destiné<br />
au paiement de 54 millions de dépenses d'hospitalisation. Le Bureau des communes<br />
justifie cette proposition par le fait que cette délibération de l'assemblée municipale<br />
n'est pas conforme à la législation arrêtée par l'assemblée territoriale et que de plus, la<br />
commune n'a pas cru devoir solliciter l'approbation préalable de l'autorité de tutelle. De<br />
même, à propos d'un budget additionnel délibéré par la commune de Rufisque, un<br />
rapport de l'administration remarquait, en Conseil privé le 11 février 1954 «Les autres<br />
communes de plein exercice Saint-Louis et Dakar, sont d'ailleurs dans la même situation.<br />
C'est le propre de ces collectivités de gager des dépenses sur des recettes incertaines,<br />
accumulant ainsi, d'année en année, un passif dont on n'envisage pas qu'il puisse être, un<br />
jour résorbé. »<br />
En somme, dans cette période des années 50, le budget de Dakar fait<br />
régulièrement appel à des rallonges sous forme de budget additionnel. L'élaboration de<br />
ces budgets se réalise avec beaucoup d'incertitudes. Les retards sont fréquents et la<br />
20. Affaires politiques AOF, ANSOM, Rapport Bureau des communes. Gouvernement territoire Sénégal, Août 1953.<br />
Carton 2118, dos 1.<br />
429
- un senJÏce de nettoiement qui fonctionne comme un bureau de<br />
bienfaisance, comme une caisse de secours,<br />
besoins<br />
technique des agents,<br />
- un nombre important de surveillants... ne co"espondant pas aux<br />
- des avancements ne paraissant guère être justifiés par la qualification<br />
- l'absence d'actions concrètes de l'autorité de tutelle pour limiter les<br />
dépenses non justifiées de toutes sortes... »23<br />
Le premier président insiste sur le fait que cette situation n'est pas spécifique<br />
à la ville de Dakar puisque toutes les communes de plein exercice sont dans la même<br />
situation.<br />
Le député L.S. Senghor, critiquant la gestion municipale lors d'un meeting<br />
électoral en avril 1953 , s'attire une réponse publique de la municipalité 24 . Mais cette<br />
réponse est la bienvenue puisque l'opposant politique use de son droit de réponse dans<br />
le même journal et précise ses critiques. « Tout le monde sait que, dans un budget, ne<br />
figurent pas des journaliers payés sur la rubrique du matériel [...] Je ne parle pas des<br />
340.000.000 de francs que la municipalité de Dakar doit au territoire du Sénégal... Le .<br />
député du Sénégal ajoute
qui se manifestent dans la gestion des communes l...] Le mal est plus profond et ses causes<br />
sont ailleurs que dans l'administration municipale. »<br />
Pour le maire t ces causes se trouvent surtout dans les insuffisances de<br />
l'administration incapable de faire rentrer de manière suffisante et régulière les recettes<br />
budgétaires. L'année 1952 est' prise en exemple puisque 75% seulement des<br />
recouvrements sont effectués au terme de l'exercice budgétaire. Le maire dégage toute<br />
responsabilité dans cette situation dans la mesure où « les recettes ne dépendent<br />
nullement de la municipalité à laquelle échappe totalement la détennination de la masse<br />
imposable et encore moins de son recouvrement. » Il indique que les exercices 1950 et<br />
1951 ont eu les mêmes caractéristiques en matière de recouvrement que l'exercice 1952.<br />
Au sujet du personnel t le maire fait état d'une compression massive opérée<br />
en 1952 et portant sur 1200 agents. C'est dire qu'il est sensible aux critiques relatives à la<br />
question du personnel. Mais le maire attire fortement l'attention du gouverneur général<br />
sur les inévitables conséquences de tous genres parce que « les fournisseurs non payés<br />
refusent de livrer à la mairie et ont été autorisés à intenter des actions contentieuses. Le<br />
selVice du nettoiement risque d'être particulièrement arrêté. » Le premier magistrat<br />
communal ne précise certes pas qui a autorisé les fournisseurs à engager des poursuites,<br />
mais il lui apparait évident que les autorités administratives ne peuvent pas être<br />
étrangères à ces initiatives contre la commune. Lamine Guèye dégage une autre cause<br />
de cette mauvaise gestion et l'impute à l'administration «1. 'absence totale de subventions<br />
et de fonds de concours imposent à notre municipalité un immobilisme préjudiciable à<br />
l'intérêt généraL »<br />
Il met en relief la réduction du personnel communal imposée à son équipe et<br />
qui fait passer les effectifs de 4.000 en 1952 à 2.700 en 1954 pour mieux insister sur « il<br />
n'est plus possible de poursuivre cette politique de licenciement qui préjudicierait au<br />
fonctionnement de ses selVices et pourrait avoir des conséquences sociales sérieuses. »<br />
Chiffres à l'appui, le maire met le doigt sur les responsabilités de l'Assemblée<br />
territoriale qui avait imposé à la municipalité une réduction drastique des centimes<br />
additionnels. Ceci a pour conséquence un écart de l'ordre de 200 millions entre les<br />
prévisions en recettes et l'encaisse réelle dans les exercices 1952 et 1953. Pour 1954 t la<br />
situation se dégrade davantage. En conséquence t Lamine Guèye dénonce cette pression<br />
fiscale néfaste et préjudiciable au bon fonctionnement des services communaux. Pour<br />
conclure, il émet le point de vue suivant sur le projet de réforme municipale «Dans ces<br />
conditions, il ne peut être question, à mon avis, de vouloir imposer aux communes des<br />
dépenses obligatoires supplémentaires comme l'envisage la commission des Affaires<br />
financières de l'Assemblée de l'Union françm.se. ».<br />
L'essentiel de cette argumentation réapparaît dans une autre lettre que le<br />
maire adresse au ministre de la FOM31.<br />
31. Lëttre n0860 - 1Îs/SG du 16.04.1954.<br />
435
D'autres éléments témoignent aussi d'une réelle volonté de la commune<br />
d'avoir une gestion correcte et honnête. L'adjoint Bara Diop, dans le conflit qui l'oppose<br />
à Bâ Amadou, écrit «Pour mettre fin à ces scandales, le maire principal qui avait de sa<br />
mission une singulière conception plus élevée que la vôtre, n'hésitait pas à imposer des<br />
mesures susceptibles de tarir les sources par où coulaient les biens de la commune au profit<br />
de quelques individus. » Il rappelle que son action de contrôle sur l'essence, le bois, le<br />
ciment, le fer etc... est entreprise à la demande de Me Paul Bonifay mais aussi à la<br />
requête de El Hadj Bibi Ndiaye, secrétaire général de la municipalité.<br />
Pour faire travailler normalement le personnel des initiatives multiples sont<br />
prises et des efforts déployés. Ainsi, la note de service n° 1792/SG du 17 septembre 1955<br />
du maire, à l'adresse de tous les chefs de bureaux et de services rappelle les horaires de<br />
travail en insistant particulièrement «Il y a lieu de tenir dans chaque bureau ou service<br />
un carnet de présence pour y consigner les retards constatés journellement et qui doivent<br />
faire l'objet d'une sanction confonnément à la réglementation en vigueur. » La note de<br />
service en question s'appuie sur une décision municipale de l'année précédente fixant<br />
les horaires de travail 32 . Dans le même sens le chef du nettoiement responsabilise les<br />
chefs de benne dans leurs équipes avec obligation pour chacun d'eux de rendre compte<br />
de toute absence momentanée constatée pendant le temps de travail. Le sérieux à<br />
apporter à la gestion financière et administrative du personnel n'échappe pas à Thiam<br />
Ibrahima Abdoulaye, l'adjoint faisant fonctions de maire, lorsque dans une lettre<br />
circulaire aux chefs de bureaux et de services, à la date du 14 octobre 1955, il écrit «<br />
Dans les décisions relatives à la refonte du statut municipal et au reclassement [... ] il a été<br />
en effet constaté beaucoup d'anomalies (... ] C'est pourquoi j'ai chargé ensemble MM les<br />
chefs du bureau du personnel et des finances d'effectuer à nouveau un travail de<br />
redressement... »<br />
En somme, l'étude de cette gestion municipale de Dakar fait apparaître<br />
d'énormes faiblesses. Souvent, celles-ci ne sont pas du tout imputables à la municipalité<br />
elle-même. Très souvent les jugements formulés à l'encontre de cette gestion reposent<br />
sur une comparaison avec l'activité municipale en métropole alors que le statut colonial<br />
influençe fortement les données sénégalaises. Cependant ceci ne signifie aucunement<br />
que ces faiblesses ne sont pas crées, voulues et entretenues parfois par tel ou tel<br />
personnage municipal, tel ou tel clan, ou même toute l'équipe municipale. Des<br />
considérations politiques partisanes expliquent beaucoup des faiblesses de cette<br />
municipalité SFIO dans un contexte territorial globalement acquis au RD.S.<br />
Mais les faiblesses n'effacent pas pour autant les forces qui sont évidentes et<br />
solides. Il est indéniable que des considérations qui se situent à un niveau élevé,<br />
participent fortement aux entreprises de dénonciations de la gestion municipale. Cela<br />
transparaît dans cette position de la direction du contrôle financier de Paris qui estime à<br />
32. Archives muniCipales, Séne 2G, dos Hj40, note n0558jP du 22 juillet 1954.<br />
43.6
dernière catégorie du reclassement concerne 24 personnes au salaire mensuel de 3.000<br />
F 38 .<br />
La nomination de ces chefs donne très souvent lieu à des contestations<br />
jusqu'au niveau le plus élevé dans la hiérarchie de la Collectivité léboue, et dans le<br />
cadre des relations entre administration et municipalité. El Hadji Moussé Diop,<br />
domicilié au 16, rue Blanchot à Dakar, écrit à l'administrateur de la circonscription de<br />
Dakar, le 22 mars 1945 en ces termes «Par décision municipale n0161jF du 14 avril 1942<br />
de Mr le gouverneur des colonies F. Martine, alors maire de Dakar, je fus nommé, en tant<br />
que Sérigne Ndakarou, chefsupérieur des agents auxiliaires d'hygiène des quartiers indigènes<br />
de la commune en remplacement du défunt Alpha Diole [...] Or, depuis l'arrivée de Mr<br />
Alfred Goux Maire [...] Je me vois déparli de mes fonctions dans des conditions dont j'ose<br />
considérer illégales, par l'absence totale d'une nouvelle décision révoquant mes<br />
attributions... ». Le chef supérieur de la Collectivité léboue considère Ibrahima Diop,<br />
bénéficiaire des attentions du nouveau maire, Alfred Goux, comme un "usurpateur". Il<br />
dénonce l'attitude du maire car elle crée ainsi « la situation équivoque qui règne parmi la<br />
collectivité léboue [...] ces fonctions ne pouvant être exercées que par un seul titulaire. ».<br />
Cette querelle, au sujet de la plus haute fonction en milieu lébou, se terllÙne à<br />
l'avantage de El Hadj Ibrahima Diop confirmé chef supérieur de la Collectivité . En<br />
mars 1950, il écrit au maire de Dakar en cette qualité pour lui faire part de son intention<br />
d'effectuer une tournée en banlieue de Dakar comme le lui imposent ses obligations. Il<br />
demande au maire « Je vous serai reconnaissant de bien vouloir en faire parl aux autorités<br />
locales, notamment à Mr le Haut Commissaire, gouverneur général de l'ADF, à Mr le<br />
Délégué du gouverneur du Sénégal et à la sûreté locale... »<br />
Une autre haute fonction en milieu lébou est l'objet d'une contestation. Il<br />
s'agit de la présidence du conseil des notables Diambours, une des 3 assemblées de la<br />
Collectivité. En effet, le 9 mai 1955, dans le bureau du maire adjoint délégué aux<br />
affaires sociales et coutullÙères de la commune, les chefs des 12 pinths ou quartiers<br />
traditionnels de Dakar se réunissent, et le procès-verbal de cette réunion indique<br />
l'objectif que les intéressés se sont assignés «Les signataires ci-dessous, en vue de<br />
rappeler au maire de Dakar la nomination de El Hadj Ismaila Guèye comme président du<br />
Conseil des notables Diambours, en remplacement de El Hadj Ousmane Diop révoqué pour<br />
faute grave, relevé de ses fonctions.... »<br />
Les dignitaires lébous souhaitent que l'intéressé puisse bénéficier de tous les<br />
avantages dont jouissait son prédécesseur pendant qu'il était en fonction. Pour donner<br />
plus de poids à leur proposition, les participants à la réunion demandent en particulier<br />
un acte de nomination à compter du mois d'août 1954, date à laquelle El Hadj Ousmane<br />
Diop a cessé ses fonctions d'auxiliaire municipal d'hygiène. Le texte est transmis aux<br />
autorités compétentes. L'adjoint au maire porte son visa sur le document. Il motive son<br />
38. Archives municipâles Dakar, série 2G dos H/35.<br />
439
chefs, le groupe qui réussit à obtenir l'acte municipal est le gagnant de la compétition.<br />
C'est en ce sens que le poids des institutions municipales est déterminant dans la<br />
question des chefferies de quartier. En rapport direct avec cet aspect de la nomination,<br />
il n'est pas rare que le leader du clan qui n'a pas réussi à obtenir son acte de nomination<br />
passe, avec partie ou totalité de ses supporters, dans le camp politique adverse. Ou bien<br />
l'intéressé continue à mener contre le chef nommé une sorte de guérilla politique en<br />
contestant son autorité de manière plus ou moins ouverte. Il en résulte parfois que la<br />
municipalité et l'administration coloniale soient placées dans une situation<br />
embarrassante. C'est ce qui fait dire au gouverneur de la circonscription, dans une lettre<br />
à l'adresse du maire de Dakar « il serait d'ailleurs superflu que je souligne l'intérêt qui<br />
s'attache en ce qu'en la matière, nos deux administrations adoptent les mêmes principes [. ..]<br />
la même attitude générale. 41». Cette lettre évoque la situation de trouble - d'après le<br />
chef de la Circonscription - créée dans le village de Yoff où le nommé Talla Diagne<br />
cherche à renverser le chef du village en fonction. Des cas identiques sont multiples.<br />
- Le deuxième atout important dont dispose la Municipalité est la<br />
rémunération de la fonction de chef de Quartier ou de village. Elle l'utilise au mieux de<br />
ses intérêts. Au cours de la période, les autorités municipales sont saisies de diverses<br />
démarches pour cette rémunération. Elles émanent de chefs de quartier demandant, soit<br />
un classement dans le tableau des chefs de quartier payés, soit un reclassement dans la<br />
hiérarchie des quartiers. Cette hiérarchie comprend plus d'une dizaine de niveaux<br />
assimilés aux grades et échelles du corps des agents du service d'hygiène. Comme le<br />
salaire du chef du village ou de quartier - pour ceux qui sont payés - est fonction de la<br />
place occupée dans cette hiérarchie, les récriminations sont nombreuses à ce sujet et ne<br />
laissent pas la mairie indifférente. Du reste, c'est pour y mettre fin dans une certaine<br />
mesure, que le conseil municipal, au cours de sa première séance suivant les élections<br />
d'avril 1953, met sur pied une commission de 20 membres chargés d'étudier la<br />
délimitation géographique des quartiers et leur classification. Par exemple Ibrahima<br />
Ndiaye, chef du quartier de Potou Biscuiterie, dans le Grand Dakar, écrit au maire, le 5<br />
mai 1953 pour « l'obtention d'une faveur exceptionnelle pour un "classement" dans le<br />
tableau des chefs de quartier payés. 42» Parmi les arguments développés, une longue<br />
carrière sous le drapeau français, une situation familiale et un état de santé précaires<br />
mais également - et principalement - un long passé et une activité débordante dans le<br />
parti SFIO. D'autres engagent des démarches identiques. Cette question de la<br />
rémunération ne laisse pas l'administration coloniale insensible puisqu'elle y voit une<br />
marque de puissance. C'est ainsi que l'administrateur de la Circonscription attire<br />
l'attention du maire sur la situation du village de Yoff en ces termes « [...] S'agissant de<br />
ce village où reste à régler l'épineuse question de la nomination du chef, j'estime imprudent<br />
41<br />
42' Lettre du 20 octobre 1944) 0°414 ACO.<br />
. Archives municipales, sérIe 2G dos H/40.<br />
442
d'accorder une rétribution aux deux candidats. Il convient d'attendre que la désignation soit<br />
aite... . 43<br />
»<br />
fi<br />
En somme l'attitude des autorités municipales à l'égard de la question des<br />
chefs de quartiers ou de villages est rendue difficile par les divisions politiques, inter<br />
ethniques ou autres qui existent dans la population indigène de la capitale, à cette<br />
période. Mais il reste que la municipalité, au delà des apparences, en tire un profit non<br />
négligeable pour sa pérennité.<br />
43. Archives municipales, série 2G dos H/40, lettre du 21 novembre 1945.<br />
443
CHAPITRE II : REGULARITE DES ELEcrI0t'lS A DAKAR<br />
Une des préoccupations politiques principales de l'opinion publique et de<br />
l'administration coloniale, reste celle de la régularité des élections dans la ville de<br />
Dakar. On remarque que dans la période considérée, les consultations sont nombreuses,<br />
le corps électoral sans grande expérience pratique, la législation et son application<br />
souvent en porte en faux avec les réalités locales. En conséquence, il n'est certainement<br />
",--=---pas<br />
exagéré de parler d'une permanence de la contestation au sujet de la pratique<br />
électorale à Dakar dans ces années.<br />
Il LE CORPS ELECTORAL ET LA PARTICIPATION ELECTORALE<br />
Les consultations électorales<br />
- Référendums = 3<br />
- Juin 1946 : adoption du 1er projet de la constitution<br />
- 13 Octobre 1946 : adoption du 2ème projet de la IVeme<br />
- République<br />
- 28 Septembre 1958: adoption du projet de la VèmeRépublique<br />
- Législatives = 4<br />
Octobre 1945<br />
17 juin 1951<br />
Janvier 1956<br />
Mars 1959<br />
- Cantonales = 3<br />
Mars 1947<br />
30 mars 1952<br />
22 mars 1957<br />
- Municipales = 5<br />
30 juin 1945<br />
10 octobre 1947<br />
26 avril 1953<br />
18 novembre 1956<br />
30 juillet 1960<br />
444
On remarque, la faiblesse du corps électoral dakarois. Il n'a jamais atteint 50<br />
% de la population totale de la ville (voir évolution de la population dans la première<br />
partie) .<br />
L'évolution de ce corps électoral est influencée par une série des facteurs<br />
dont les plus importants demeurent la législation en matière électorale et de<br />
citoyenneté, l'intérêt des populations à participer à ces consultations en s'inscrivant sur<br />
les listes pour les habitants auxquels ce droit est reconnu - et les réalités administratives<br />
locales. Quant à la participation électorale réelle, elle traduit une situation plus<br />
significative encore. Les pourcentages des votants par rapport aux inscrits lors des<br />
élections municipales - 57 % en 1947, 39 % en 1953, 83 %en 1956 et 85 % en 1960 <br />
indiquent une évolution en dents de scie. Des facteurs politiques précis en sont les<br />
éléments d'explication.Ainsi, en 1947, l'unité de la SFIO est encore totale au Sénégal.<br />
La population de la ville, dans sa partie inscrite sur les listes électorales, trouve intérêt à<br />
reconduire presque entièrement l'équipe élue en 1945. Les élections de 1953, se<br />
déroulent elles dans un contexte particulier. Des législatives ont eu lieu en juin 1951 et<br />
des cantonales en mars 1952. Celles-ci sont reprises par suite de l'annulation de leurs<br />
résultats par le Conseil du contentieux administratif de l'AOF. Moins d'un an, plus tard<br />
une nouvelle consultation a lieu. L'effet de saturation ...; mais surtout l'âpreté de la<br />
compétition due au fait que les deux principaux leaders politiques s'affrontent<br />
directement à ce niveau local, constituent des facteurs importants d'explication de la<br />
faible participation électorale. Le problème de l'identification de l'électeur qui est au<br />
centre des difficultés lors de la distribution des cartes joue un rôle notable dans la<br />
faiblesse de la participation effective des populations au scrutin.<br />
Quant aux municipales de Novembre 1956, la tension est certes encore vive<br />
entre les deux principales formations concurrentes,la SFIO et le RD.S., mais sous la<br />
pression de l'administration, un modus viventi a été trouvé entre elles. Ceci a en partie,<br />
détendu le climat ce qui permet un pourcentage élevé de la participation: 83 % . Pour<br />
les élections municipales de juillet 1960, tout comme pour les législatives" de mars 1959<br />
et le référendum de septembre 1958, la politique locale est marquée par une<br />
recomposition globale. Les anciens adversaires "SFIO" et "BPS" ont conjugué leurs<br />
efforts pour obtenir ces résultats élevés. L'U.P.S., née de la fusion, est devenue le parti<br />
gouvernemental organisateur des consultations. Cette situation a pour conséquence un<br />
accroissement global de la participation dans la frange de la population inscrite sur la<br />
liste électorale.<br />
Au regard de la participation électorale, il reste que l'évolution constante de '<br />
la liste des électeurs appelle des remarques importantes. Au sortir de la guerre et<br />
jusqu'en 1950, seuls participent aux élections, les citoyens, c'est à dire les métropolitainS<br />
et les habitants de 4 communes. Un élargissement de ce corps électoral intervient en<br />
1951 avant les législatives, exactement comme en 1956. Les sources disponibles n'ont<br />
446
pas permis de chiffrer ceux qui accèdent, à Dakar, en particulier, à cette nouvelle<br />
possibilité qu'est le droit de participer aux élections. Cependant le nombre des inscrits<br />
sur les listes électorales de la ville a beaucoup évolué sans qu'il soit possible d'affirmer<br />
que ce soit en relation directe avec la loi électorale. De 1950 à 1956, on observe<br />
l'évolution suivante; 76.023 inscrits en 1952, 81.525 en 1953 soit une augmentation de<br />
plus de 5000 personnes en l'espace d'un an alors qu'aucun fait nouveau, d'ordre<br />
législatif, n'est intervenu pendant cette période.<br />
La consultation de novembre 1956 voit le corps électoral se réduire de façon<br />
drastique. Il passe de 81.525 inscrits en 1953 à 50.371 en 1956 soit une diminution de<br />
près de 40 %. Ici également aucune donnée législative n'en est l'explication. Celle ci doit<br />
être recherchée dans les données pratiques guidant l'élaboration de cette liste<br />
électorale. Mais, on note qu'aucune révision spéciale de la liste électorale n'est<br />
intervenue entre les deux dates. Du reste un télégramme du Ministre des colonies au<br />
Haussaire de Dakar, le 5 novembre 1955, dit à ce sujet: ''En ce qui concerne la révision<br />
spéciale de l'ensemble des listes électorales du Sénégal (...) je vous rappelle que vous aviez<br />
convenu avec moi de son impossibilité...) (1 ).Le Ministre fait état d'un télégramme qui lui<br />
a été envoyé, la veille, par le gouverneur général de l'AOF. Ce télégramme, transmet le<br />
compte rendu du gouverneur du Sénégal relatant des difficultés rencontrées par<br />
l'administration" du fait de l'obstrnction qui lui a été opposée à ce sujet par la mairie de<br />
Dakar." Juste un mois plus tard, c'est à dire le 6 décembre 1955, le ministre parle de<br />
cette question en ces termes: "le premier devoir des autorités de tutelle consistait à veiller<br />
en pennanence à la bonne tenue des listes électorales; or, c'est le désordre, reconnu par tous,<br />
de ces listes ... "(2) Le chef du territoire du Sénégal, dans un rapport, écrit en parlant de la<br />
confecti.on de la liste électorale de Dakar: "La municipalité, présidée par Lamine Guèye,<br />
bat certainement les records de malthusianisme électoraL.. "(3) Le gouverneur s'étonne<br />
que la liste des électeurs inscrits à Dakar connaisse une "diminution inexplicable" à un<br />
moment où de nouvelles catégories d'électeurs sont venues s'ajouter aux électeurs<br />
traditionnels. En parlant de la diminution du corps électoral, "Afrique Nouvelle", organe<br />
de la presse dakaroise, titre ceci : "Cimetière électoral" dans l'une de ses livraisons(4).<br />
Quant à l'évolution du corps électoral qui passe de 50.371 en 1956, à 91.643<br />
en septembre 1958, puis à 90.087 en mars 1959 et ensuite à 135.330 en juillet 1960 elle<br />
s'explique par un fait déterminant: c'est l'application du suffrage universel issu de la<br />
réforme introduite par la loi Gaston Defferre de juin 1956. Tous peuvent voter pour la<br />
première fois. Cependant, la très forte progression du corps électoral passant de 90.087<br />
en mars 1959 à 135.330 en juillet 1960 soit 45.243 électeurs en valeur absolue et 50 % en<br />
valeur relative pose des interrogations sérieuses. Cette progression se fait en l'espace<br />
d'un an alors qu'aucune donnée nouvelle n'est interveue dans la détermination du corps<br />
électoral.<br />
44·7
Toute cette évolution en dents de scie du corps électoral dakarois traduit, de<br />
façon globale, une absence de maîtrise des listes électorales. Il est à craindre que trop<br />
de données non objectives, de "politique politicienne", interviennent dans leur<br />
confection. Dans ces conditions, l'équipe municipale, dirigée par Lamine Guèye dans<br />
toute la période de 1945 à 1960, porte une part très importante de responsabilité dans<br />
cette situation aux paradoxes multiples. Mais il est aussi certain qu'une part des<br />
responsabilités incombe à l'administration coloniale elle-même. Le ministre de tutelle<br />
met l'accent, sur ce fait en 1953, en s'adressant au chef de la fédération(5). Une part de<br />
responsabilité revient à la population dakaroise, elle même, du moins dans sa frange<br />
électrice. En effet, lorsque le corps électoral subit une diminution de 40 % environ entre<br />
1953 et 1956, comment comprendre que des citoyens antérieurement inscrits, n'élèvent<br />
pas de protestation véhémente? Nos sources ne font état ni de protestation ni de<br />
réclamation tant auprès des services municipaux qu'au niveau des autorités judiciaires.<br />
Alors, pourquoi une telle absence de revendications ? Il est difficile de savoir<br />
exactement. Est-ce le niveau de prise de conscience ou le manque d'intérêt pour les<br />
consultations municipales ? Ces raisons sont difficilement compréhensibles dans le<br />
contexte politique dakarois où les luttes revêtent un caractère exacerbé.<br />
Une autre donnée à prendre en considération dans l'évolution de<br />
cette liste électorale, est le sérieux dans son élaboration pratique. Cet aspect a fait<br />
l'objet, à diverses reprises, d'empoignades particulièrement rudes à Dakar. C'est ainsi<br />
qu'à la veille des municipales d'Avril 1953, le député L.S. Senghor, tête de liste du<br />
B.D.S., déclare, dans un exposé fait au cinéma Rialto: ''Nous abordons cette troisième<br />
lutte électorale, dans des conditions difficiles car sur 83.000 électeurs inscrits à Dakar, nous<br />
avons un handicap de 30.000 fausses inscriptions. "(6) La série d'attaques débitées contre<br />
la municapilité SFIO de Dakar par LS.Senghor, enchaîne une réponse vigoureuse.<br />
"Paris-Dakar", mettant en relief son souci d'impartialité - il a fait le compte rendu du<br />
meeting B.D.S.- publie le point de vue de la Municipalité de Dakar. Sur la question<br />
précise des fausses inscriptions, la mairie s'étonne de la grossiereté du propos qui<br />
accuse gratuitement et la municipalité, et l'administration en même temps. La réponse<br />
met l'accent sur la conformité de la liste avec la loi électorale en vigueur, celle du 23<br />
mai 1951, plaçant sous la responsabilité directe de l'administration, la distribution des<br />
cartes électorales (7) La mairie ajoute que les représentants des partis politiques en<br />
compétition contrôlent la distribution des cartes en toute indépendance. Pour les<br />
responsabilités de l'équipe municipale à laquelle la loi fait charge de constituer cette<br />
liste, une remarque s'impose: "Ce serait, du fait même, impliquer la complaisance ou<br />
l'aveuglement des divers représentants des partis siègeant au sein des commissions de<br />
distribution." Tout compte fait, pour la mairie, l'accusation de Senghor ne peut donc<br />
qu'être une simple manoeuvre de bas étage(8) maladroite de surcroît. La conclusion de<br />
cette réponse tout en marquant la volonté municipale de ne pas engager une polémique,<br />
448
mais simplement de répondre à des propos dépourvus d'objectivité, est la suivante: "Si<br />
la critique est permise faut-il encore pour être valable qu'elle soit fondée sur des faits<br />
objectifs dûment contrôlables et non sur des affirmations purement subjectives et gratuites<br />
qu'il est toujours aisé, en définitive, de réduire à néant. "<br />
En somme, le sérieux de la confection de cette liste donne lieu à des<br />
contestations entre les partis politiques en lice dans les consultations au niveau de la<br />
capitale fédérale. L'administration coloniale, en dénonce elle aussi, durant la période,<br />
le caractère souvent peu sérieux de l'élaboration. Dans un rapport spécial sur les<br />
élections ayant eu lieu de 1947 à 1953, elle regrette que des inscriptions fantaisistes<br />
émaillent les listes, si le malthusianisme ne l'emporte pas (9).<br />
En plus de l'élaboration de la liste électorale, la question de la distribution<br />
des cartes, elle-même, fait souvent l'objet d'énormes difficultés à la veille de toutes les<br />
consultations, surtout dans la phase 1951-1956 pendant laquelle l'affrontement SFIO<br />
RD.S. est total. Au centre de cette question, il yale problème de l'identification de<br />
l'électeur. Dans un rapport adressé le 13 avril 1953 au Haut commissaire, gouverneur<br />
général de l'AOF, le chef du territoire du Sénégal reconnaît qu'il se trouve placé dans<br />
une situation particulièrement difficile devant les prises de position des partis en<br />
compétition. Il insiste surtout sur le fait qu'il se voit même contraint de faire la navette<br />
entre Saint-Louis et Dakar, pour trouver avec les chefs des partis, une solution<br />
acceptable pour tous. Il indique les positions respectives de ces formations sur<br />
l'identification de l'électeur. " Position SFIO: possibilité d'utiliser bulletins ou extraits de<br />
naissance car maints électeurs, femmes surtout n'ont aucune piéce d'identité. Position<br />
B.D.S. : rejette toute possibilité d'utiliser des extraits ou bulletins de naissance. Exige pièce<br />
d'identité uniquement." Le chef du territoire a t-il trouvé avec les intéressés une solution<br />
acceptable? En tout cas, il envoie les instructions suivantes aux présidents des bureaux<br />
de distribution des cartes électorales de Dakar mais aussi de Rufisque et Saint-Louis.<br />
"A : si électeur connu de tous, même sans pièce d'identité: oui.<br />
B : si muni d'un titre d'identité: port d'arme, carte d'étudiant, carte<br />
ancien combattant, passeport, livret famille pour les femmes: oui<br />
extrait, bulletin, ancienne carte électorale, certificat de mariage: non.<br />
e : Electeur sans pièce d'identité, si 2 témoins ayant leur identité<br />
certifient cela avec consignation sur le registre, de l'identité des témoins: oui. Mais refus des<br />
témoins professionnels à ce sujet. "(11).<br />
Le Haut Commissaire, s'adressant au ministre de tutelle, dans un rapport<br />
faisant le point sur le déroulement de la campagne et des élections, affirme qu'à Dakar,<br />
cette distribution des cartes a donné lieu à des conflits très aigus (12). Le Ministre de la<br />
P.O.M. lui-même, reconnait que cette question de la confection de la liste électorale et<br />
également de la distribution des cartes a pris trop d'importance à Dakar. Dans une<br />
lettre adressée au chef de la Fédération, il fait part de ses griefs suivants : " n est<br />
449
egrettable que des problèmes mineurs, tels ceux posés par la confection de listes électorales<br />
d'une commune, si importante soit-elle, n'aient pas reçu une solution satisfaisante sur le<br />
plan local et que le réglement ait nécessité l'intervention du pouvoir central" (13)<br />
Après la confection de la liste électorale et la distribution des cartes<br />
d'électeurs, une question annexe a aussi longuement occupé, avant les scrutins,<br />
l'attention des autorités compétentes : c'est celle du déroulement même de la<br />
consultation. Ainsi, à la veille des minicipales d'avril 1953, L.S. Senghor, chef du RD.S.,<br />
interroge, dans une lettre en date du 26 mars, le ministre de la FOM. Il expose les<br />
préoccupations suivantes:<br />
" 1°) Les délégués des partis politiques seront ils présents dans les<br />
bureaux de vote pour contrôler les opérations électorales.<br />
2° ) Ces délégués pourront-ils être expulsés par le président du bureau<br />
de vote qui sera forcément un amipolitique du maire sortant.<br />
3° ) Instructions données à Haut Commissaire de Dakar pour<br />
combattre la fraude électorale qui sévit dans les communes de plein exercice, depuis la<br />
libération ?" (14)<br />
Le député du Sénégal annonce au ministre, qu'il considérait toute réponse<br />
négative de sa part comme "une preuve de la volonté du gouvernement de la République de<br />
s'opposer à la sincérité des opérations électorales au Sénégal." La menace de porter la<br />
question devant l'Assemblée Nationale est même annoncée dans l'éventualité d'une<br />
telle hypothèse. Cette démarche du chef du B.D.S. n'est pas sa seule initiative sur la<br />
question. En effet, une lettre du haussaire de Dakar à son chef, le 5 février 1953, fait<br />
état d'une proposition de loi dûe à l'initiative de L.S. Senghor et de son groupe. Le<br />
haussaire écrit : "Cette proposition de loi m'apparaît comme satisfaisante dans son<br />
ensemble en ce sens qu'elle consacre le renforcement des pouvoirs de l'autorité de tutelle<br />
ainsi qu'il avait été demandé à plusieurs reprises dans mes précédentes correspondances et<br />
notamment mon rapport n01215/cab/AP du 4/12/1952. "(15)<br />
Les principaux axes de cette proposition de loi apportent des modifications<br />
profondes à la législation en vigueur. En effet, une note technique de la direction des<br />
affaires politiques de l'AOF - 2ème bureau - s'en félicite dans la mesure où, elle donne à<br />
l'administration "toutes les attributions actuellement détenues par les municipalités. "Pour<br />
les affaires politiques, ces dispositions particulières visent "à assurer la sincérité des<br />
opérations électorales. "(16)<br />
Dans une interview au quotidien "Paris-Dakar", Lamine Guèye exprime sa<br />
totale opposition à la proposition de Senghor : "Nos adversaires veulent que les pouvoirs<br />
attribués aux maires de France soient, au Sénégal, attribués à l'administration qui aurait le<br />
pouvoir de dissoudre les municipalités pour des raisons extra-municipales. Modifier les<br />
conditions actuelles dans le sens qu'ils veulent serait une régression. "(17) A l'opposé, le<br />
450
président du Grand Conseil de l'AOF, Léon Boissier Palun, trouve, lui, dans cette<br />
proposition, une garantie de sincérité des élections(18)<br />
Le groupement européen de Dakar donne également son point de vue sur la<br />
question comme le rapporte "Paris-Dakar"(19) : ''Nombreux parmi les Européens de<br />
Dakar, instruits par l'expérience, que les élections de dimanche 26 avril n'apporteraient<br />
rien car la loi a mis entre les mains de la municipalité la liste électorale et que la fraude est<br />
pratique courante dans les mairies socialistes, particulièrement de Dakar... "<br />
Le quotidien rapporte aussi dans la même livraison la prise de position du<br />
parti gaulliste de Dakar : le R.P.F., lequel parti politique a passé alliance avec la<br />
formation senghorienne. Ainsi, il traduit une certaine inquiétude qui est semblable aux<br />
préoccupations exprimées par le chef du B.D.S.<br />
En somme, les contestations sont nombreuses autour de la liste électorale et<br />
de l'organisatin pratique des consultations qui se déroulent à Dakar. Le sérieux de ces<br />
contestations apparait nettement dans l'appréciation que portent sur les résultats<br />
électoraux de la capitale fédérale les autorités compétentes du Conseil d'Etat.<br />
n/ VALIDITE DES CONSULTATIONS<br />
Un fait demeure permanent au Sénégal dans les années 1945-1960 : c'est<br />
celui de la contestation des résultats électoraux. A Dakar particulièrement, surtout lors<br />
des consultations municipales où cette contestation revêt une grande dimension. Le<br />
gouverneur du Sénégal, dans un long rapport sur la consultation du 17 juin 1951, tire les<br />
principaux enseignements suivants : "les élections du Sénégal se caractérisent<br />
traditionnelement par des incidents et des fraudes courantes. "(20)<br />
A travers quelques résultats électoraux, il est possible de cerner de plus près<br />
les fondements mêmes de cette permanente contestation. Certaines élections ont surtout<br />
donné lieu à diverses initiatives pour faire accréditer ou pour invalider les résultats<br />
proclamés; il s'agit:<br />
-des législatives du 17 janvier 1951<br />
-des cantonales de mars 1952<br />
-des municipales d'avril 1953 et de novembre 1955<br />
-du réferendum de septembre 1958.<br />
La variété de ces consultations et la constante contestation de leurs<br />
résultats indiquent une possibilité de fraude électorale.<br />
451
C'est ainsi par exemple que le haussaire a envoyé des télégrammes dans ce sens à tous<br />
les chefs de territoire, et de même, le gouverneur du Sénégal a fait autant en direction<br />
des commandants de cercles, de subdivisions et du Délégué à Dakar. Le rapport indique<br />
aussi un autre raison de la neutralité administrative. Il s'agit de "l'ignorance totale" de<br />
l'incident de Bakel. Au cours d'une altercation dans cette ville de la vallée du fleuve<br />
Sénégal, le député candidat, Lamine Guèye, a giflé le chef de la subdivision. Certes, le<br />
fait aurait pu, s'il était connu, avoir des incidences subjectives sur le comportement du<br />
personnel administratif du commandement remarque le rapport de synthèse. Le chef du<br />
Territoire affirme: 'Très nombreux étaient les Européens même occupant de hauts postes<br />
dans l'administration qui, 8 jours après, je l'ai, personnellement, constaté, ignoraient tout de<br />
ce petit drame. " La presse, elle aussi, semble avoir ignoré ou négligé, jusqu'aux élections,<br />
ce fait de Bakel, comme l'affirme le gouverneur qui indique que seul l'organe "Afrique<br />
nouvelle"(23) a fait un entrefilet de 4 lignes à ce sujet et ceci, la veille même de la<br />
consultation.<br />
Neutralité totale de l'administration, responsabilités correctement<br />
assumées, loi électorale démocratique par laquelle les partis exercent un contrôle total,<br />
à toutes les phases etc... rien ne manquerait donc à un déroulement normal de cette<br />
consultation. Aux yeux du chef du territoire, les véritables raisons de la victoire de L.S.<br />
Senghor et de son co-listier Abbas Guèye sur le tandem Lamine Guèye Ousmane Socé<br />
Diop pour les 2 sièges du Sénégal à l'Assemblée nationale française sont les suivantes:<br />
-"le parti SFIO a été victime de la nouvelle loi (24) qui a triplé le nombre<br />
des électeurs (les nouveaux inscrits paysans et ouvriers étant la clientèle attitrée du B.D.S) de<br />
la maladresse de ses dirigeants qui lui aliénèrent notamment les principaux marabouts, du<br />
"lâchage" de ses principaux supporters qui travaillèrent, en dessous, mais très efficacement<br />
contre lui. "<br />
-"C'est le vote de la Casamance qui donne le coup degrâce à la SFIO" (25)<br />
Eric Makédonsky donne une autre raison à la victoire électorale du<br />
B.D.S. lorsqu'il écrit: ''Après la création du B.D.S., toute la brousee suit le député des<br />
"badoolos" les déshérités. En vue de la campagne des législatives de juin 1951, il parcourt<br />
10.000 Km du terroir, tient 450 meetings.C'en est fini de la prédominance de la ville sur la<br />
vie politique sénégalaise." (26) Bakary Traoré remarque que les ruraux, intéressés par<br />
l'arachide ont été particulièrement sensibles à la promesse faite partout par L.S.<br />
Senghor de faire payer le 'barigo n'diouni" (27). Bakary Traoré écrit: "vêtu de kaki,<br />
coiffé d'un calot qui deviendra légendaire, une voiture jeep, Senghor visite<br />
systèmatiquement tout le Sénégal, de l'Est à l'ouest, du nord au sud (...) devant les<br />
paysans, partout, il brandit dans sa main un billet de 5000 F CFA et s'écrie "barigo<br />
n'diouni" (28)<br />
Moriba Magassouba s'accorde avec Bakary Traoré et le gouverneur<br />
du Sénégal puisqu'il écrit: ''Le fondateur du BDS (...) délaisse les villes bastion traditionnel<br />
453
La contestation des résultats de juin 1951<br />
La loi électorale en vigueur marginalise l'immense majorité de la<br />
population du Sénégal dans la consultation. Un autre rapport de l'administration,<br />
également consacré aux élections à l'Assemble nationale du 17 juin 1951, donne des<br />
renseigments sur cette participation (33).<br />
-Les c.P.E. : (Commune de plein exercice)<br />
Dakar: 31,3 % de la population totale<br />
Saint-Louis: 20,6 % de la population totale<br />
Rufisque: 55,4 % de la population totale<br />
Banlieue de Rufisque: 34 % de la population<br />
totale.<br />
-Les 11 cercles du Sénégal:<br />
* 7 cercles ont un taux de participation inférieur à 10 % (Matam,<br />
Linguère, Diourbel, Louga, Tambacounda, Kédougou et Zinguinchor)<br />
Kaolack)<br />
* 3 cercles se situent entre 10 et 12,6 % (Bas -Sénégal, Thiès et<br />
* 1 seul atteint 24,6 % (celui de Podor)<br />
Il est à remarquer que la participation est plus forte dans les villes<br />
et particulièrement dans les communes de plein exercice que dans les cercles du<br />
Sénégal. D'autre part, dans la participation des cercles, il serait intéressant de disposer<br />
des chiffres de répartition entre les villes de ces cercles et le reste du terroir; par<br />
exemple, pour le cercle de Kaolack qui compte 44.324 inscrits. -sur une population de<br />
424.621 habitants combien d'inscrits et combien de votants se concentrent dans la ville<br />
de Kaolack elle-même. Faute de renseignements, il est difficile de fonder un jugement<br />
valable sur cet aspect. Mais nous savons, que les villes de ces cercles représentent la<br />
majorité de la population, et que ce sont elles surtout qui s'expriment dans cette<br />
consultation électorale. En conséquence, est difficile de croire à une "revanche" des<br />
campagnes sénégalaises sur les villes. Les analystes ayant corroboré cette thèse semblent<br />
n'avoir pas retenu l'essentiel de l'explication des résultats de cette consultation: une<br />
manipulation par les divers niveaux des structures administratives locales. Le niveau réel<br />
de la manipulation est certes difficile à établir avec précision, mais divers indices<br />
laissent apparaître la chose elle-même. On constate une contradiction évidente entre<br />
deux rapports de l'administration consacrés à la consultation du 17 juin 1951. Le rapport<br />
classé dans le carton 2171 dos 7 donne les chiffres du cercle de Ziguinchor qui" a donné<br />
le coup de grâce à la liste SFIO":<br />
51.007 suffrages exprimés<br />
46.409 pour la liste B.D.S<br />
4.598 pour la SFIO.<br />
455
Dans le rapport classé au carton 2179 dos.8, le même cercle de<br />
Ziguinchor a 312.759 habitants et 12.133 inscrits , ce qui donne un pourcentage<br />
d'électeurs de 3,8 % par rapport à la population totale: Une analyse des chiffres de ce<br />
dernier rapport fait apparaître que dans la totalité des cercles du Sénégal, nulle part, le<br />
nombre des électeurs inscrits n'atteint 25 % de la population sauf à Podor ; ce<br />
pourcentage moyen est au maximum de 10 %. Si comme l'indique le rapport 2171 dos. 7,<br />
le cercle de Ziguinchor a 51.007 suffrages - donc plus d'inscrits, cela signifie qu'il a au<br />
moins 16 % d'inscrits par rapport à sa population totale. La chose n'est pas impossible<br />
en soi, car Podor par exemple a 24,6 % d'inscrits sur 84.789 habitants. Ce cas du cercle<br />
du Ziguinchor représente véritablement, dans le cadre des résultats proclamés de cette<br />
consultation électorale, une question qui mérite un approfondissement réel, pour mieux<br />
expliquer la victoire du B.D.S.<br />
En tout cas, nous constatons que, à la tête du cercle de Ziguinchor,<br />
l'administrateur en place est un ancien du vichysme qui ne porte que haine et mépris<br />
(34) à la SFIO de l'après-guerre. Il ne serait pas étonnant, loin s'en faut, que sa patte ait<br />
marqué le résultat du cercle. Surtout dans le contexte d'un gouvernement de droite à<br />
Paris. En effet, l'administration SFIO largement prépondérante dans les structures de<br />
Dakar et de Saint-Louis auparavant, subit un fort remaniement avant les élections de<br />
juin 1951. Ainsi, le gouvernement général de l'AOF, le député socialiste Béchard quitte<br />
Dakar à la veille de la consultation électorale. L'intérim est assuré par le général<br />
Chauvet. D'autre part, le chef du territoire du Sénégal, lui aussi, est remplacé par un<br />
intérimaire à la même période. Il n'est pas impossible que, dans cette situation générale,<br />
la F.O.M dirigée par la droite - le M.R.P - laisse les consultations électorales à la<br />
discrétion et aux "manoeuvres" de l'administration locale.<br />
La SFIO, proclamée battue, a beau fournir ses preuves de<br />
manipulations, et compter sur de solides appuis parisiens le résultat officiel n'est pas<br />
changé. Le bureau de l'Assemblée Nationale française conclut à la validité du scrutin.<br />
Dans cette décision, le poids des alliés de Senghor, le R.P.F. est déterminant puisque les<br />
8 commissaires de la formation gaulliste s'ajoutent à 7 autres pour faire la différence par<br />
15 voix contre 13 (35) lors du vote d'arbitrage. Les communistes se sont abtenus.<br />
Le journal "Echos d'Afrique noire", fait état du soutien<br />
particulièrement actif apporté par son rédacteur en chef dans la campagne<br />
d'information et d'opinion pour la validation des résultats de ces législatives. En effet,<br />
Maurice Voisin écrit dans une lettre ouverte à L.S. Senghor ''Nous avions aidé, risquant<br />
notre vie, aux élections législatives dernières, engloutissant dans la bataille des dizaines et<br />
des dizaines de mille francs, en tracts, en circulaires, en numéros spéciaux. Nous pensons<br />
qu'il fallait finir avec la SFIO, Rappelez-vous notre voyage à Paris alors que Lamine Guèye<br />
prétendait faire casser les élections de 1951. Nous avons inondé l'Assemblée nationale de<br />
nos appels. Nous avions multiplié nos contacts." (36). La direction de l'organe insiste sur<br />
456
le fait que Abbas Guèye lui doit une certaine reconnaissance pour l'activité déployée en<br />
faveur du RD.S. Bien entendu, cette dernière remarque de Maurice Voisin s'adresse<br />
aussi à l'homme politique Senghor. Cette victoire, légitimée par l'Assemblée nationale,<br />
est, avant tout, sa chose. Abbas Guèye n'est qu'un "obscur" homme politique, porté à la<br />
candidature à la députation par la stratégie politique de Senghor soucieux de s'attirer<br />
l'électorat lébou de Dakar, mais aussi les voix des travailleurs. En effet, ce co-listier de<br />
Senghor est d'origine léboue, mais c'est aussi un haut responsable syndical de la CGT<br />
dakaroise. Il a été élu conseiller municipal de Dakar en 1947 sur la liste SFIO et il est<br />
passé à la dissidence RD.S. pour des mobiles plus personnels que politiques. Très tôt<br />
d'ailleurs, les relations entre les deux députés se détériorent pour aboutir à la rupture<br />
totale faisant ainsi le grand joie de divers milieux du colonat dakarois et des adversaires<br />
politiques.<br />
2) Les consultations cantonales et municipales de 1952<br />
à 1956<br />
-Les cantonales de mars 1952 doivent désigner les membres de<br />
l'Assemblée Territoriale locale. Une nouvelle loi votée le 25 janvier 1952 et promulguée<br />
le 6 février met en place cette structure. Les Assemblées territoriales, nouvellement<br />
créées en remplacement des conseils généraux, doivent, d'après la nouvelle loi, être<br />
élues au scrutin majoritaire à un tour, par circonscription et de liste. La Délégation de<br />
Dakar et banlieue constitue l'une des douze circonscriptions électorales dans lesquelles<br />
l'affrontement entre le RD.S et la SFIO a lieu. Le R.D.A. est candidat mais son poids<br />
est faible sur l'échiquier local. Le déroulement de la consultation se traduit par la<br />
situation suivante au Sénégal: le B.D.S qui a remporté les législatives de juin 1951,<br />
gagne toutes les circonscriptions électorales sauf celles de Dakar et de Saint-Louis. En<br />
effet, la SFIO obtient la majorité des voix sur les ''33.799 cartes distribuées et 43.122<br />
suffrages exprimées" (37) à Dakar.<br />
Le Conseil du Contentieux administratif de l'AOF estime que les<br />
élections sont irrégulières et, par décision en date du 16 septembre 1952, les annule<br />
pour la capitale fédérale. Leur reprise donne lieu au même résultat. La SFIO de Lamine<br />
Guèye envoie à l'Assemblée Territoriale 9 élus contre 41 au RD.S. En la circonstance,<br />
chose importante, le député Abbas Guèye, tête de la liste RD.S à Dakar, n'est pas élu<br />
(38) tout comme le conseiller Djim Momar Guèye.<br />
-Quand aux élections municipales d'avril 1953, elles représentent la<br />
3eme occasion pour les populations des 3 communes de plein exercice, de renouveler<br />
leurs représentants. La liste SFIO emporte la municipalité de Dakar par 21.113 voix<br />
contre 10.521 à sa rivale conduite par L.S. Senghor. Cet affrontement au plan local des<br />
deux principaux leaders politiques, constitue une partie de revanche pour les vaincus de<br />
45.7
conditions la maîtrise des municipalités est fort réduite, elles deviennent alors, les cibles<br />
toutes désignées des adversaires politiques et de l'administrtion à la fois.<br />
Cette situation fait même dire à certains, que les municipalités des<br />
communes de plein exercice sont placées dans une logique d'échec devant démontrer<br />
l'immaturité du nègre colonisé à s'administrer. Que la philosophie coloniale est en<br />
somme de créer les conditions de la survie du système colonial. L'organe politique du<br />
B.D.S ne dit pas autre chose lorsqu'on y lit: '1es précautions prises par l'administration<br />
ont abouti toutes, et sans doute à dessein, à favoriser la fraude... A la vén'té nos gouvernants<br />
sont les gagnants de la compétition électorale. "(42) Pour le journal du parti de Senghor, il<br />
est clair que l'équivoque n'est plus possible sur cette question.<br />
Autre insuffisance de la loi électorale qui alimente dans une<br />
certaine mesure la contestation: l'application du scrutin proportionnel à la veille des<br />
municipales de novembre 1956. En effet, après les consultations, le journal "AOF"<br />
analyse les résultats des partis tant en voix qu'en sièges pour l'ensemble des 9 communes<br />
élevées au rang de plein exercice (les 4 anciennes et Thiès, Louga, Diourbel, Kaolack et<br />
Ziguinchor). La rédaction arrive à la conclusion: ''De quelque manière qu'on interpréte<br />
les résultats, que l'on mette en ligne de compte le nombre de suffrages obtenus ou le nombre<br />
des sièges, il est révélé qu'en aucun cas, le B.P.S n'est arrivé à doubler la SFIO." (43) La<br />
rédaction de l'organe met ainsi l'accent sur l'iniquité" de la loi électorale.<br />
Autre fait de contestation de la loi: le sectionnement électoral de<br />
la capitale fédérale à la veille de la consultation de novembre 1956. Sur proposition de<br />
l'administration, l'Assemblée Territoriale du Sénégal vote un sectionnement électoral<br />
de Dakar. La municipalité s'oppose au projet, tout comme la collectivité léboue. Ces<br />
oppositions furent vaines, et le projet fut finalement voté.<br />
L'enquête, organisée pour avoir le point de vue de la population de<br />
la ville, est menée dans des conditions largement contestables: réelle précipitation et<br />
listes des électeurs favorables échaffaudées de manière fort douteuse par le délégué à<br />
l'enquête s'appuyant sur le B.D.S.(44) . Tout compte fait, le sectionnement est effectué<br />
malgré l'opposition manifestée par plusieurs milieux. Lamine Guèye et ses partisans<br />
politiques, mais aussi la Collectivité léboue dans son ensemble, saisissent les mobiles<br />
réels de l'opération : une dissolution de la municipalité élue mais aussi une plus grande<br />
représentation de la partie européenne de la ville au conseil municipal. Le maire de la<br />
ville, interrogé par le quotidien "Paris-Dakar" sur la question, est, on ne peut plus clair<br />
dans son affirmation: "le sectionnement, comme chacun le sait, n'a pas recueilli l'adhésion<br />
de la majon'té des dakarois." (45)<br />
-La pratique électorale<br />
Elle est à l'origine de divers arguments - et certainement des plus<br />
solides - de la contestation des résultats électoraux de Dakar.<br />
459
Le Conseil d'Etat décide en juillet 1955, d'annuler, à la requête de<br />
L.S.Senghor (46), les résultats d'avril 1953. L'institution se base sur les arguments<br />
suivants: " (...) Considération qu'il résulte de l'instfUction que de nombreuses personnes<br />
ont été admises à voter sans que leur identité ait été réellement contrôlée et que dans<br />
plusieurs bureaux de vote, aucun électeur n'est passé par l'isoloir (...) qu'ainsi le requérant<br />
est fondé à soutenir que c'est à tort que le Conseil du Contentieux administratifde l'ADF a<br />
rejeté sa protestation (...) décide (...) annulation (...r. Deux ans auparavant, au niveau de<br />
la capitale fédérale, les juges retenaient : "(...) Considérant que le requérant base son<br />
argumentation (...) sur les cartes retirées sans justification d'identité...<br />
Considérant l'arrêté du gouverneur du 22 avril 1953 que la production<br />
d'une pièce d'identité n'est pas nécessaire (...) qu'ainsi donc qu'aucun des griefs articulés<br />
n'est susceptible d'être recueilli (...) "(47).<br />
Principe de la loi électorale contre application locale de la loi<br />
électorale: La question est ainsi posée. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le secret<br />
du vote n'a jamais été au plan local, une caractéristique des consultations. Cependant,<br />
selon les circonstances, la question est agitée. Par exemple, le C.C.A annule les<br />
municipales du 19/10/1947 à Saint-Louis parce que les isoloirs n'ont pas existé dans<br />
cinq bureaux de vote sur six. A Dakar, en juin 1953, le C.C.A rejette la demande en<br />
annulation déposée par Senghor et fondée sur le non respect du secret du vote lors de<br />
la consultation électorale. Pourtant, en 1951 Lamine Guèye et la SFIO, ont mis cet<br />
aspect en première ligne avec force détails à l'appui. Cependant, cette demande, elle, est<br />
rejetée par le Conseil d'Etat.<br />
Après les municipales de 1947 à Dakar, le R.P.F demande<br />
l'annulation du scrutin. Dans son argumentation écrite pour la Cour, le chef de la<br />
formation gaulliste, à Dakar, R. Lattes reproche au Haut Commissaire, gouverneur<br />
général Barthes, à Brun, directeur de la sûreté locale, et à Mr Pasquini d'avoir,<br />
ostentiblement voté avec un bulletin SFIO (48). La cour de Dakar ne retient pas le bien<br />
fondé des arguments développés par le requête de R. Lattes. Cependant même si<br />
l'accusation n'est pas retenue, elle reste très significative du climat politique dakarois.<br />
Le R.P.F qui argumente l'accusation laisse les autres électeurs faire la déduction qui<br />
s'impose. L'acte constitue pour les subordonnés de ces hautes autorités un<br />
encouragement à voter dans le même sens. Ceci est d'autant plus logique que durant<br />
cette période où la SFIO règne en maîtresse absolue à la FOM, le gouverneur général<br />
de Dakar est logiquement un socialiste grand teint, tout comme le gouverneur du<br />
Territoire et le gouverneur délégué à Dakar. En effet, au moment où Béchard, le<br />
remplaçant de Barthes, est chef de la fédération, Wiltord, socialiste comme lui, occupe<br />
le palais de Saint-Louis. Claude Michel, socialiste, est remplacé à la tête de la<br />
Délégation par Jacquemin Vergnet, autre socialiste (49). En fonction de l'influence que<br />
ces chefs peuvent avoir dans les rouages directs de leur administration, on comprend<br />
460
toute la gravité de l'accusation. Lorsque le journal "AOF' tire la leçon du scrutin<br />
municipal d'avril 1953, il met en exergue l'absence de neutralité du chef de la sûreté<br />
dakaroise, donc un élement important de l'administration. La rédaction écrit : ''Le<br />
commissaire Bloch n'a pas mérité notre confiance au cours de cette campagne électorale.<br />
Nous lui demandons une stricte neutralité. "(50).<br />
Lamine Guèye, leader SFIO aux élections de 1953 à Dakar, dans<br />
une adresse de remerciements aux électeurs qui lui permettent, pour la troisième fois<br />
après la guerre, de diriger la municipalité, reproche à l'administration et à ses protégés<br />
un manque de neutralité dans les diverses étapes: "(...) Ce verdict rendu en conformité de<br />
la loi d'exception, voulue, rédigée et interprétée par nos adversaires eux-mêmes, est<br />
suffzsament éloquent... " (51)<br />
L'interprétation de la loi est, avant tout, du ressort de<br />
l'administration. Cette dernière est accusée de chercher à garantir la sincérité du vote à<br />
Dakar et à Saint-Louis et de fermer les yeux sur toutes les violations de régularité<br />
partout ailleurs, au même moment (52)<br />
La question de la direction "politique" de la fédération ou du<br />
Sénégal, n'est pas neutre dans la relation avec le déroulement des élections. En effet, on<br />
remarque que, lorsque le chef de la fédération et le chef du territoire du Sénégal se<br />
trouvent être des socialistes, la SFIO est toute puissante dans les assemblées<br />
représentatives de Paris, de Saint-Louis ou de Dakar. Or, cette situation existe<br />
exactement au moment où la FOM est dirigée par la SFIO. Très souvent, lorsque la<br />
FOM passe en d'autres mains, Dakar change de titulaire, tout comme Saint-Louis et par<br />
voie de conséquence la Délégation de Dakar. A cette situation correspond exactement,<br />
au plan de la politique locale, la puissance des adversaires politiques de la SFIO: ceux<br />
du B.D.S. Or ce B.D.S est partie intégrante des I.O.M, eux-mêmes alliés du M.R.P qui a<br />
assumé longuement la responsabilité de la FOM. De tout ceci, il se dégage que: le poids<br />
"politique" de l'administration sur les consultations électorales est une réalité indéniable.<br />
C'est dire en quoi la pratique électorale, pêche lourdement. Cette pratique dakaroise est<br />
d'abord faussée par ces manifestations plus ou moins directes, mais il y a également les<br />
autres multiples pressions indirectes. La rédaction de "L'AOF", tirant les conclusions du<br />
scrutin de novembre 1956, dénonce les pressions exercées sur l'électorat et met l'accent<br />
sur les responsabilités de l'administration, agissant en faveur de ses "protégés" : ''Nos<br />
adversaires devraient, pour assainir le climat politique de ce pays, intervenir fermement<br />
auprès de leurs amis (la haute administration) et leur faire respecter scrupuleusement la<br />
liberté de vote. Ces pressions et ces violences exercées aujourd'hui en leur faveur, se<br />
retourneront tôt ou tard contre eu.x."(53)<br />
Pourtant, dans la période 1948-1951, c'est le B.D.S qui se plaint des<br />
pressions qu'exerce l'administration entièrement aux mains de la SFIO. L'organe du<br />
parti, "Condition Humaine" dénonce ''un gouverneur nommé par qui on sait et pour faire<br />
461
vote. Puisque l'organisation des élections en 1947, 1952 et 1953 par la municipalité SFIO<br />
a donné naissance à des contestations et des annulations, il en résulte que la<br />
responsabilité de ce parti politique est largement engagée.<br />
Pourtant, diverses autres élections dakaroises de la période 1945<br />
1960 n'ont pas été annulées, ce qui n'est pas une preuve absolue qu'elles aussi n'ont pas<br />
été entachées d'irrégularités de taille à situer au niveau de l'équipe municipale<br />
dakaroise . En effet, avant 1947, une contestation n'a qu'une très faible chance d'être<br />
entendue. Il en est de même entre 1957 et 1960 à Dakar. La raison en est que les<br />
principaux protagonistes de la scène politique dakaroise, c'est à dire le RD.S et la<br />
SFIO, ont partie liée pendant ces périodes là. Dans ces conditions, les leviers sur<br />
lesquels les intéressés s'appuient sont si puissants et si solides qu'aucune contestation<br />
des résultats n'a la moindre chance d'aboutir. C'est par exemple le cas en septembre<br />
1958. Les forces ayant préconisé le "non" au référendum élèvent leur protestation contre<br />
la pratique du scrutin. Administration coloniale et coalition politique nouvelle de<br />
l'U.P.S qui se sont largement déployées pour un vote favorable à de Gaulle, ne laissent<br />
la moindre possibilité d'être entendue à la protestation. Pourtant, maints observateurs<br />
indépendants considèrent ce scrutin comme entâché d'irrégularités énormes et<br />
flagrantes.<br />
Ici, contrairement à d'autres moments où les élections ont été<br />
annulées, l'enjeu ne met pas, face à face, des adversaires de taille identique. En<br />
septembre 1958, au Sénégal comme en métropole, l'indépendance immédiate du<br />
territoire n'est pas concevable aux yeux des tenants de l'appareil politico-administratif.<br />
Cette pratique électorale mettant en cause la municipalité de Dakar dans les<br />
irrégularités, se dégage d'une multitude des documents de nature fort diverse. Quelques<br />
exemples illustrent bien cette réalité. Dans un télégramme envoyé par le sénateur<br />
Mamadou Dia, secrétaire général du RD.S., au ministre de la FOM et que ce dernier<br />
répercute à son haussaire de Dakar, 4 jours plus tard, il est dit que les "listes de la<br />
commune de Dakar (...) ont été truquées (...) répartition des électeurs faite non suivant le<br />
domicile ou résidence réelle, mais d'après un calcul de dosage tendant à gonfler telle section<br />
au détriment de telle autre... " (60) En conséquence de ce télégramme, le locataire de la<br />
rue Oudinot à Paris donne, ordre au chef de l'AOF, de mettre en application les<br />
instructions qui ont été arrêtées lors du passage de ce dernier à Paris. Il lui demande, en<br />
outre, de lui rendre compte, de toutes les mesures qui ont été prises à cet effet.<br />
Bien entendu, cette situation dénoncée par le Sénateur Mamadou<br />
Dia ne peut avoir, - si elle existe - qu'un seul responsable: la municipalité de Dakar<br />
dans le cadre de ses attributions en matière d'organisation d'élections, attributions<br />
conférées par la loi elle-même. Dans une déclaration publique, le député L.S.Senghor<br />
met en relief cette responsabilité de la municipalité de Dakar dans l'irrégularité de<br />
l'organisation des consultations surtout lorsque celles-ci revêtent un caractère municipal<br />
463
ou cantonal. Parlant de l'arrêt du conseil d'Etat de juillet 1955, le candidat vaincu de<br />
1953 s'exprime en ces termes: "(...) Le second argument est de poids. Tant que les<br />
présidents de bureau de vote se refuseront à identifier les électeurs, c'est à dire à leur<br />
demander une pièce d'identité, le conseil d'Etat, faisant son devoir, continuera d'annuler<br />
nos élections. (61) Il reste que ces présidents de bureau de vote sont proposés à la<br />
désignation de l'autorité administrative par la municipalité de Dakar. Leur neutralité<br />
reste difficile à observer. Quelques faits rapportés par des services administratifs ou des<br />
délibérations d'instance, confirment cette pratique électorale largement marquée par la<br />
fraude au niveau de la capitale. Ainsi, un rapport du gouverneur du Sénégal, établi le Il<br />
juillet 1951, dégage des fraudes manifestes dans plusieurs bureaux de vote de Dakar lors<br />
de la consultation du 17 juin. "(...) Le cas du bureau de vote de Dakar-Yoff est<br />
parliculièrement troublant. Le nombre des enveloppes trouvées dans l'ume dépasse non<br />
seulement celui des votants, mais même celui des inscrits (inscrits : 1021. émergement :<br />
1299. enveloppes trouvées: 1304.<br />
Ont obtenu: SFIO: 1104 voix; BDS : 180, RPF: 15.<br />
Dans ce bureau de vote, la liste SFIO, à elle seule a obtenu plus de suffrages<br />
qu'il ny avait d'électeurs inscrits... " (62)<br />
Un autre élément troublant pour le chef de Territoire: le cas du<br />
bureau de vote de Dakar-Fann. La liste électorale, pour ce bureau, comporte 5535<br />
inscrits. Mais, le jour du scrutin, seulement 223 sont venus manifester leur existence en<br />
venant voter. Où réside l'explication d'un tel phénomène? Est-ce seulement l'abstention<br />
des électeurs? Difficile de croire que dans la population inscrite dans ce quartier, la<br />
prise de conscience ou l'intérêt soit à ce point si bas pour que moins de 5 % se donne la<br />
peine de venir faire preuve de leur existence. Il se trouve que le quartier de Fann est<br />
essentiellement une zone résidentielle européenne, et cette catégorie de la population<br />
dakaroise ne se sent pas concernée par les activités politiques locales. Plusieurs<br />
rapports administratifs, ainsi que les divers organes de presse et des nombreuses études<br />
ont mis l'accent sur la faiblesse de la participation des Européens aux consultations<br />
électorales de la ville. Cependant ceci ne suffit pas à expliquer que moins de 5 % des<br />
électeurs potentiels participent à ce scrutin. De plus, ce quartier et toute la zone voisine<br />
comprennent aussi une part non négligeable de résidents d'origine africaine, dont, la<br />
participation est relativement importante: Contrairement aux Européens, ces Africains<br />
sont plus concernés; Par ces élections, il s'agit de désigner les représentants locaux au<br />
Conseil municipal de la ville ou à l'Assemblée Territoriale ou au Parlement français. Il<br />
est donc peu probable qu'une telle abstention existe réellement.<br />
Alors quel autre élément avancer pour expliquer une telle situation.<br />
L'hypothèse d'une manipulation de la liste électorale ne peut être rejetée d'un simple<br />
revers de main, surtout quand on sait la place que cet aspect occupe dans la<br />
contestation, tant au niveau local qu'en métropole.<br />
464
En somme, la pratique électorale à Dakar est entachée de<br />
fréquentes irrégularités et partant la sincérité du scrutin est remise en cause. Dès lors, il<br />
s'agit d'essayer d'en connaître les raisons; c'est à dire de savoir qui trouve intérêt dans<br />
l'irrégularité des consultations. Il est certain que l'administration coloniale ne manque<br />
pas d'avoir des intérêts à ce que les hommes et femmes qui lui sont soumis sortent<br />
vainqueurs de ces consultations. Jean Suret Canale remarque: "C'est surtout panni les<br />
fonctionnaires et à travers les mandats électoraux (municipalités, assemblées locales,<br />
assemblées parlementaires) que l'autorité coloniale recherche les intermédiaires nouveaux<br />
qui pourront suppléer, sinon relayer la chefferie usée et discréditée... " (63) En effet, les<br />
fonctionnaires restent le principal élément bénéficiaire des mandats électoraux, dans<br />
tous les territoires de la Fédération mais surtout à Dakar. Le Haut Commissaire,<br />
gouverneur général de l'AOF, Bernard Cornut Gentille, dans un rapport sur la fonction<br />
publique locale remarque : "Les fonctionnaires de l'AOF représentent 1/60 de la<br />
population, se partagent 1/7 du revenu national (...) Cette "caste de privilégiés" qui fournit<br />
dans l'ensemble, élus et grands électeurs, joue un rôle prépondérant au moment où nous<br />
sommes dans l'évolution politique et sociale de l'A OF. "(64) La place de ces<br />
fonctionnaires dans les structures nouvellement mises en place en 1952 pour remplacer<br />
les conseils généraux - les Assemblées territoriales - est prépondérante. En effet, ils sont<br />
72 % des élus au Sénégal pour 59,3 % en Côte d'Ivoire, 70,8 % au Niger et 60 % en<br />
Haute Volta.<br />
Pour l'essentiel, ces fonctionnaires sont avant tout des enseignants<br />
portés à ces assemblées. Au Sénégal, 32 % des élus sont diplômés de l'Ecole Normale<br />
William Ponty pour 43,7 % en Côte d'Ivoire, 17,5 % en Haute Volta et 8,3 % au Niger.<br />
Les fonctionnaires occupent également dans le principal parti politique du Sénégal, une<br />
position dominante. François Zuccarelli écrit dans son étude sur l'u.P.S : ''Au comité<br />
directeur du B.P.S en 1956, sur les 85 membres, 49 sont des fonctionnaires parmi lesquels<br />
25 enseignants en majon'té des instituteurs." (65) Cette Ecole Normale William Ponty qui<br />
pourvoie ces assemblées, de manière aussi importante, est présentée par Chistophe<br />
Batch comme ''un rouage du colonialisme" (66) eu égard aux objectifs que le système de<br />
domination lui a assignés depuis sa création. Cette école apparaît comme un outil<br />
privilégié dans l'assimilation des cadres ainsi formés. Un ancien directeur de l'éducation<br />
en AOF, Georges Hardy, dit de l'école coloniale: ''L'enseignement est l'instrument de la<br />
conquête morale de l'Afrique". (67)<br />
Ces fonctionnaires l'AOF occupent une place plus grande encore<br />
aux élections à ces mêmes assemblées 5 ans plus tard. En effet lorsque après cette<br />
consultation les gouvernements de l'autonomie interne sont mis en place en juillet 1957<br />
l'importance numérique et qualitative des fonctionnaires leur permet d'occuper 52 %<br />
des postes ministériels en AOF et 56 % en AEF. Au Sénégal, le gouvernement<br />
Mamadou Dia se compose de 27 % des membres appartenant aux professions libérales,<br />
465
36 % de fonctionnaires et agents de l'administration et 36 % d'enseignants. Au total, ce<br />
gouvernement comprend 72 % de fonctionnaires. Sur ses Il membres, 7 sont issus de<br />
l'Assemblée Territoriale ainsi élue avec 4 seulement qui ne sont pas des parlementaires.<br />
Cette prépondérance de fonctionnaires parmi les élus aux<br />
consultations sénégalaises fait d'eux de manière plus ou moins directe, des éléments<br />
sur lesquels l'administration coloniale peut exercer dans une large mesure, sa très<br />
grande influence. Ainsi, par exemple, les élus qui ne sont pas assurés d'une réélection<br />
n'ont d'autres choix que le retour de la fonction publique coloniale. Mais,ce retour dans<br />
la plupart des cas, n'est pas conçu comme un retour à la place initiale. Il en résulte qu'il<br />
faut compter sur l'administration pour espérer obtenir un poste plus lucratif que celui<br />
qui était occupé antérieurement. Ainsi la toute puissance de l'administration s'affirme. Il<br />
s'ensuit que c'est à tout moment - avant, pendant et après le mandat électoral mais<br />
surtout pendant - que le fonctionnaire doit chercher les grâces du colonisateur.<br />
La représentation élective devient, très souvent, une étape certes de<br />
force, mais surtout de faiblesse de l'élu par rapport à cette administration. RS.<br />
Morgenthau écrit en parlant des élus, après 1952 : ''Pour le conseillers territon'aux B.n.S.,<br />
il ny eut des postes réservés dans les organismes dingeants des sociétés de prévoyance. "(68)<br />
L.S.Senghor remarque, très amer, en 1958, lors du renouvellement du bureau du Grand<br />
Conseil de l'AOF et des représentants de cette assemblée dans les institutions<br />
économiques fédérales: "Plusieurs des sociétés sont sur notre tem'toire et régulièrement, les<br />
représentants du Sénégal sont écartés (...) Si c'est un acte politique, qu'on le dise': (69) Est<br />
ce la défense des intérêts du territoire du Sénégal ou celle des intérêts des élus RD.S. ?<br />
Difficile à dire. Cependant, cette prise de position intervient à un moment où l'homme<br />
et ses partisans viennent d'essuyer un revers politique de taille. Contre leur candidat à la<br />
tête du Grand Conseil de l'AOF, Djibodé Aplogan, soutenu par le P.R.A, c'est le<br />
candidat du RD.A, Gabriel d'Arboussier qui est élu. De plus, les autres postes du<br />
bureau sont allés aux formations RD.A et l'V.P.M de Mauritanie par suite de la<br />
position négative adoptée par les uns et les autres face à la proposition d'une répartition<br />
équitable les responsabilités du bureau. Mais une chose est, ici, particulièrement<br />
remarquable. La présence d'élus du Sénégal à ces postes importants, apparaît, comme<br />
une nécessité. Pour ces représentants B.D.S au Grand Conseil. Il est certain que les<br />
intérêts financiers et divers autres tirés de cette position à l'Assemblée du Grand<br />
Conseil et dans les organismes économiques fédéraux représentent des avantages dont<br />
ces élus du Sénégal ne peuvent que difficilement se passer, surtout quand on sait que<br />
depuis la mise en place de ces structures, les représentants du Sénégal en ont toujours<br />
eu la part belle.<br />
La situation d'élu offre maints avantages tant au niveau du Grand<br />
Conseil que de l'Assemblée Territoriale de même qu'au Conseil Municipal de Dakar car<br />
466
lettre adressée à son chef à Paris, le 7 mai 1953, soit quelques jours seulement après la<br />
défaire du B.D.S aux municipales du mois d'avril, il recommande l'attitude à avoir à<br />
l'égard de cette formation politique vaincue: "(...) En cette circonstance, il faut souligner,<br />
une fois de plus, le danger que représenterait une attitude officiellement hostile au B.D.S,<br />
tendant à rejeter le mouvement dans une opposition hargneuse. Il faut, au contraire, lui<br />
faire bon visage et aider les quelques leaders qui sont pnulents et désirent le rester, à<br />
conserver le contrôle de leurs troupes." (72) Cette recommandation revêt une importance<br />
particulière si on se rappelle que, deux ans auparavant, cette formation politique a reçu,<br />
un coup de pouce important pour enlever les deux sièges de député du Sénégal à<br />
l'Assemblée Nationale à Paris. Ce coup de pouce lui provenait de l'administration<br />
locale.<br />
En somme, dans toute la période, l'irrégularité plus ou moms<br />
prononcée des consultations est dûe, dans une large mesure, à la manière même de<br />
concevoir l'activité politique chez de nombreux individus. C'est la conception du clan<br />
politique qui doit gagner le maximum pour distribuer à une infime minorité de<br />
partisans. En cela, elle est très proche de ce que F.e. Bailey remarque en parlant de la<br />
politique en Inde: "(...) Une année de mercenaires, ayant les yeux fixés sur le butin (...)<br />
L'année ne combattra pas s'il n'y a pas de perspectives de butin et changera promptement<br />
de côté si la perspective de butin semble meilleure dans l'autre camp." (73) La seule<br />
différence ici est que dans cette politique, la perspective de butin est permanente, pour<br />
ceux qui le recherchent. Les miettes, laissées à ces hommes par l'administration,<br />
représentent, pour eux, un gain considérable et qu'ils ne peuvent dans aucun cas,<br />
dédaigner. R.e. Morgenthau écrit en parlant de la formation de Senghor : ''Après la<br />
victoire, le B.D.S utilise au maximum le patronage. Pour l'élite instruite du parti, il y a des<br />
places dans coopératives et les organismes arachidièrs. Pour les fonctionnaires loyaux il y<br />
eut des promotions. Pour les dignitaires religieux et les chefs traditionnels, des facilités de<br />
prêts et des décorations." (74)<br />
En conclusion, il apparaît nettement que l'organisation des élections est peu<br />
sérieuse et les résultats peu crédibles pendant cette période 1945-1960.<br />
468
NOTES DU CHAPITRE II.<br />
1. Af. polit. AOF. ANSOM. Carton 2205, dos 2, Elections<br />
mtmicipales dans les 3 communes de plein exercice,<br />
Rapport de 1955.<br />
2 . Télégramme du ministre de la FOM au haussaire à Dakar.<br />
Affaires politiques AOF, ANSOM, carton 2205, dos 2,<br />
1955.<br />
3 Af. polit. AOF. ANSOM. Carton 2171, rapport du Il<br />
juillet 1951, 16 pages et annexe.<br />
4 N° du 7 juillet 1951.<br />
5 Télégramme du 5 novembre 1953. du MFOM à Haussaire<br />
de Dakar.<br />
6. "Paris-Dakar" du 9 avril 1953.<br />
7 . Article 17 de la loi du 6 février 1952.<br />
8. "Paris-Dakar" du 13 avril 1953.<br />
9. Af. polit. AOF. ANSOM Carton 2143, dos 2, rapport 1953.<br />
10 Affaires politiques AOF, ANSOM, carton 2143 dos 2,<br />
Rapport de 1953 du gouverneur du Sénégal.<br />
11 Lettre du Haut Commissaire de Dakar au ministre de la<br />
FOM, 7 mai 1953.<br />
12 Lettre du ministre de la FOM au hussaire à Dakar,<br />
6 décembre 1955.<br />
13 Af. polit. ANSOM lettre in carton 2205 dos 2, Mars 1953<br />
14 Carton 2143 dos.2, proposition de loi n05309 déposée le<br />
20/01/1953.<br />
15 Note direction affaires politiques, 27/02/1953.<br />
16 Ibidem.<br />
17 N° du 23 avril 1953.<br />
18 N° du 23 avril 1953<br />
19. Af. pol. AOF, ANSOM, carton 2171 dos.7, Rapport du 11<br />
juillet 1951.<br />
20. Af. pol. AOF. ANSOM, carton 2171 dos.7, Rapport du 11<br />
juillet 1951.<br />
21. Af. polit. AOF, ANSOM, carton 2171 dos.7, rapport<br />
juillet<br />
22. Afrique Nouvelle N° du 16 juin 1953.<br />
469
1989, p.146.<br />
44. "Paris-Dakar" du 13 septembre 1955.<br />
45. Il est ministre dans le gouvernement français à<br />
l'époque. Une relation existerait-elle entre cette<br />
position et ce résultat dans le contexte?<br />
46. Décision n° 30 du C.C.A de l'AOF 26 juin 1953.<br />
47. R. Bourgi, op. cit.<br />
48. Ibidem.<br />
49. "AOF" du 9 mai 1953.<br />
50. "Paris-Dakar" du 27 avril 1953.<br />
51. "AOF" du 4 mai 1953.<br />
52. "L'AOF" du 15 décembre 1956.<br />
53. "Condition Humaine" du 4/01/1949. Il s'agit du<br />
gouverneur Wiltord.<br />
54. "Condition Humaine" du 11 décembre 1948, éditiorial..<br />
55. "Echos d'Afrique noire" du 16 mai 1955.<br />
56. "Afrique Nouvelle" du 23 juin 1951.<br />
57. "Paris-Dakar" du 2 juillet 1945.<br />
58. AFF. pol. AOF ANS, Résultats du référendum, communiqué<br />
de l'UGTAN, 31 sept 1958.<br />
59. J.S. Canale, Géographie des capitaux en Afrique<br />
tropicale d'influence française, 1984, p. 142.<br />
60. F. Zuccarelli, Un parti politique africain: l'Union<br />
progressiste sénégalaise, 1970.<br />
61. C. Batsch Un rouage du colonialisme: L'Ecole Normale<br />
d'instituteurs de l'AOF, 1973.<br />
62. Cité par Ibrahima Baba Kaké, R.F.I, Rencontres de<br />
Dakar du 17 au 20 décembre 1984.<br />
63. "Afrique-documents" n° 48-49, 1959.<br />
64. Cité par C. Coulon, élections, factions et idéologies<br />
au Sénégal, 1978, p.177.<br />
65. Condition Humaine 6 mai 1953. Article ''Triomphe de la<br />
politique d'équilibre par Ousmane Alioune Sylla.<br />
66. Aff. Polit. AOF. ANSOM rapport du gouverneur du Sénégal<br />
sur les élections de 1959, carton 2142 dos. 2<br />
67. Cité par C. Coulon, Elections, factions et idéologies<br />
au Sénégal, 1978, p. 151<br />
68. Idem<br />
471
1960<br />
CHAPITRE III: ORIENTATION POLITIQUE ET SOCIALE DE 1957 A<br />
Nettement perceptible dès les années 40, cette orientation se précise<br />
surtout à partir de 1957, date à laquelle un nouvel état se met progressivement en<br />
place. Mais, de par le contexte général (politique, économique et social) il est<br />
simplement une continuité de l'administration coloniale à la seule différence que<br />
ses dirigeants sont les hommes politiques autochtones. Ainsi, ceux-ci assument en<br />
fait l'héritage de l'ancienne puissance administrante. Cette situation globale se<br />
remarque à travers les conceptions des relations avec la métropole et de l'unité,<br />
mais aussi de la consolidation de ce nouvel Etat. Au moment, de l'accession à la<br />
souveraineté en 1960, tout indique que les masses urbaines et rurales ne sont<br />
d'aucun poids déterminant sur l'appareil d'Etat aux mains de la minorité à laquelle<br />
la métropole a bien voulu laisser le legs. Il en résulte un divorce nettement<br />
perceptible entre appareil d'Etat et masses populaires, soulignant ainsi la fragilité<br />
relative du nouvel Etat. La précipitation de la transmission de l'héritage dans un<br />
contexte chaotique, à quoi s'ajoute un réel désir, des tenants d'hier à assurer une<br />
mainmise indirecte sont les raisons essentielles, de toute absence de perspectives<br />
nationales claires dans l'immédiat.<br />
Il CONCEPTION DES RELATIONS AVEC LA METROPOLE ET DE L'UNITE.<br />
1). Relation avec la métropole<br />
On distingue 4 étapes principales dans ces relations:<br />
la toute puissance du système d'administration coloniale totale qUl<br />
domine les années 1945 à 1956,<br />
une période de semi-autonomie brève, 1957 à 1958, suivie de celle de<br />
l'autonomie complète, 1958 à 1960, et enfin une période d'indépendance à partir de<br />
juin 1960.<br />
Chacune de ces étapes est riche en expressions de conceptions politiques<br />
diverses quant aux relations avec la métropole.<br />
472
- l'étape de 1945 à 1956.<br />
Au sortir de la 2ème guerre mondiale, la France puissance coloniale a<br />
défini une nouvelle conception de ses relations avec les possessions par les<br />
conclusions de la conférence de Brazzaville du 30 janvier au 8 février 1944. A cette<br />
conférence tenue en terre africaine, n'ont participé que des adminisctrateurs<br />
coloniaux et hommes politiques métropolitains. Aucune représentation des<br />
populations autochtones en fut prévue et n'eut lieu. La conférence écartait dès le<br />
début de ses travaux, toute idée d'indépendance et même toute autonomie. (1). Elle<br />
ne prévoyait qu'un processus de relations à bien des égards identique à celui d'avant<br />
l'éclatement du deuxième conflit mondial. En ce sens, tout indique qu'aux yeux de la<br />
métropole, rien de fondamental n'avait changé dans les années de guerre. Appareil<br />
colonial et personnel restèrent solidement en place, limitant par voie de<br />
conséquence, toute possibilité d'expression d'une conception différente les relations<br />
entre la métropole et les possessions. Certes, des modifications relativement<br />
mineures, intervinrent : ainsi à la place de l'Empire colonial français, on parle<br />
désormais de l'Union Française. Le chef de l'AOF avait troqué son titre officiel de<br />
gouverneur général contre celui de Haut commissaire, gouverneur général. La<br />
Circonscription de Dakar et Dépendances fut supprimée et l'entité autonome<br />
qu'elle constituait depuis 1924 est rattachée directement au gouvernement au<br />
territoire du Sénégal, revenant ainsi à la situation antérieure à son détachement de<br />
ce territoire. Un gouverneur, dépendant de celui de Saint-Louis y exerçait la<br />
fonction de Délégué, (2) avec des pouvoirs réduits.<br />
Bref, rien de vraiment important n'avait changé au plan de<br />
l'administration locale.<br />
Les principaux leaders politiques autochtones du territoire considérait ce<br />
système de relations comme un élément viable et partant, à préserver en tout état<br />
de cause. Ainsi Lamine Guèye, sous secrétaire d'Etat sous Léon Blum déclarait à<br />
Rufisque lors d'un grand rassemblement à son honneur et en présence du Haut<br />
Commissaire de Dakar: "Nous pouvons tout par la France, tout par la République...<br />
jamais rien sans la France, jamais rien sans la République." (3). Cette conception fut<br />
répétée le lendemain à Saint-Louis comme elle avait été développée la veille à<br />
1. J. Arnault. Du socialisme au socialisme. 1966.<br />
2. Le décret 46-1108 du 17 mai 1946, supprimait la Circonscription et rattachait son territoire au Sénégal.<br />
Le Délégué du gouverneur n'eut plus le go attributs dévolus au chef de la circonscription lequel<br />
administrait cette entité presque comme un territoire de l'AüF.<br />
3. Paris Dakar du 29 décembre 1947.<br />
473
Dakar lors du vin d'honneur offert par la municipalité à son premier magistrat porté<br />
à la dignité de membre du gouvernement de la métropole. Parlant en la<br />
circonstance, Omar N'Dir exprimait l'adhésion générale aux thèses de celui qu'il<br />
seconde directement dans l'équipe municipale de la capitale fédérale de l'AOF:<br />
"Lamine Guèye a su rallier autour de lui, à Dakar et au Sénégal, les meilleurs" (4).<br />
Lamine Guèye principale figure politique sénégalaise de cette période<br />
réclamait l'assimilation totale! L'oeuvre parlementaire marquée par l'adoption de<br />
deux lois dont il fut l'initiateur, traduit cette recherche de l'assimilation (5) pour la<br />
population de l'Afrique noire française dans le cadre de la gestion par la métropole<br />
des territoires de l'Union Française. Le long passé colonial du territoire du Sénégal<br />
servait de justification à cette revendication.<br />
Léopold Sédar Senghor, député du Sénégal dès 1945, avec l'appui de<br />
Lamine Guèye, lui aussi se faisait un chantre de cette assimilation. Il écrivait dans<br />
l'un de ses poèmes: (6)<br />
"Oui, Seigneur, pardonne à la France qui hait l'occupation et m'impose<br />
l'occupation si gravement.<br />
Car j'ai une grande faiblesse pour la France."<br />
Cet homme politique, il est vrai, prononça les paroles suivantes lors<br />
d'une interview accordée au journal parisien Gavroche:<br />
"... Nous sommes prêts, s'il le fallait en dernier recours à conquérir la<br />
liberté par tous les moyens fussent-ils violents" (7)<br />
Senghor n'engagea aucun combat réel dans le sens dégagé par cet<br />
interview. Au contraire, parlant le 20 mars 1947 devant le Conseil National SFIO, il<br />
affirme:<br />
"... cela m'amène à dire que si la volonté d'autonomie correspond à une<br />
réalité géographique, biologique et historique, la volonté d'indépendance totale, par<br />
contre n'est que l'expression d'un mirage." (8)<br />
Dans l'action de Léopold Sédar Senghor rien ne fut de nature à<br />
constituer la moindre raison d'inquiétude pour le colonisateur. Bien au contraire<br />
puisqu'il fut même nommé secrétaire d'Etat à la recherche scientifique dans un<br />
4. Paris Dakar. '19/12/1947.<br />
5. Il s'agit des lois sur la citoyenneté et "salaire égal à travail égal".<br />
6. Osties noires. Avril 1945.<br />
7. Gavroche. 8 septembre 1946.<br />
8. Le journal "l'AOF, 2 mai 1947.<br />
474
gouvernement de la métropole dirigé par Edgar Faure (9). Si le député du Sénégal<br />
fut très critique à l'égard de l'oeuvre parlementaire de son parrain Lamine Guèye à<br />
partir de 1948, ceci s'explique simplement par la rupture intervenue entre les deux<br />
hommes, le premier acceptant très difficilement - par ambition - d'être simplement<br />
un "second". Il fut ardent défenseur de l'assimilation, autant sinon plus que Lamine<br />
Guèye.<br />
Parmi les formations politiques les plus importantes à cette période sur<br />
l'échiquier du Sénégal et de Dakar plus particulièrement, seule l'UDS, c'est-à-dire<br />
la section territoriale du RDA, pose en termes clairs et nets, la question de<br />
l'indépendance de l'AOF. Mais cette formation présentée par les rivales SFIO et<br />
BDS comme un parti "ivoirien" pour mieux la marginaliser n'eut qu'un poids très<br />
faible au Sénégal comme l'attestent les résultats des consultations électorales de<br />
l'époque. Du reste, de multiples rapports administratifs indiquent la faible influence<br />
de cette section prônant l'indépendance. La SFIO laministe et le BDS senghoriste<br />
rivalisèrent longuement à qui défendra mieux la continuité coloniale.<br />
Les organisations d'étudiants tout comme celles de la jeunesse firent de<br />
la remise en cause de la domination coloniale leur objectif fondamental. Cependant<br />
en raison de leur nature même, ces groupes de pression n'inquiétèrent pas outre<br />
mesure, par ce choix, l'administration. Mais leur refus systématique de se laisser<br />
orienter par celle-ci entrava, à bien des égards les initiatives coloniales comme ce<br />
fut le cas à Dakar avec le débat autour des centres culturels.<br />
Tout comme les organisations d'étudiants et de jeunesse, les<br />
regroupements syndicaux développèrent des revendications nationalistes. Le<br />
cheminement vers l'indépendance, leur apparaissait comme une étape dans laquelle<br />
il fallait obligatoirement s'orienter. De ce point de vue, la forme de politisation des<br />
syndicats, organisations d'étudiants, de jeunesse, de femmes, etc n'était rien d'autre<br />
que la suite du contexte politique et administratif. Immanuel Wallerstein remarque,<br />
du reste, à ce sujet:<br />
"De toute évidence même lorsque l'indépendance le but, on ne la<br />
réclamait pas habituellement de prime abord... Des revendications en chaîne,<br />
chacune amenant la suivante." (10). Pour ces organisations, le slogan général<br />
devient "politique d'abord" pour s'opposer à la thèse coloniale" apolitisme". Il<br />
résulte de cette situation d'ensemble que les leaders syndicaux, étudiants et de<br />
jeunesse se retrouvèrent très nombreux dans la formation politique qui prône<br />
9. Du 13 au 29 novembre 1955, il garda ce porte-feuille ministériel. Lamine Guèye lui, avait été sous-<br />
secrétaire pour 2 mois fm 1946, début 1947.<br />
10. Immanuel Wallerstein : L'Afrique et l'indépendance, 1968, p. 66, traduit de l'américain par A. Lesquen.<br />
475
l'immédiat, d'autres secteurs de l'opinion s'incrivent en faux contre elles. Ainsi, le<br />
PAl communiste propose à toutes les formations politiques d'Afrique noire réunies<br />
à Paris en février 1958 l'adoption d'un texte recommandant l'unification de tous les<br />
efforts pour obtenir l'indépendance immédiate. Ce parti cherche ainsi à faire<br />
partager la position exprimée dans son manifeste: "une situation qui plaide pour un<br />
seul mot d'ordre, l'indépendance nationale." (15). Cet objectif est également celui<br />
fixé par le congrès constitutif de l'Union des syndicats du Sénégal tenu à Kaolack du<br />
20 au 22 juin 1958 car la résolution générale spécifie: "la tâche des organisations<br />
syndicales doit être la conquête de l'indépendance nationale pour l'institution d'un<br />
système économique socialiste." (16).<br />
Quand aux étudiants de Dakar ou de la métropole, leurs positions vont<br />
dans le même sens. Ainsi le 8e congrès de la FEANF tenu à Paris du 27 au 31<br />
décembre 1957 réaffirme comme objectif fondamental "la lutte pour l'indépendance<br />
nationale". (17). Le ge congrès de l'organisation reconfirme et renforce cette prise<br />
de position des étudiants. Le Conseil de la jeunesse du Sénégal, tout comme le<br />
Conseil de la jeunesse d'Afrique s'incrivent dans la même ligne.<br />
Mais ce ne sont pas seulement des forces autochtones qui s'expriment en<br />
faveur de l'indépendance. Les organes de presse sous contrôle d'Européens<br />
adoptent la même démarche, même si l'objectif réel n'est pas le même. Le journal<br />
Echos d'Afrique Noire organe d'une partie du petit colonat local plaide pour<br />
l'indépendance immédiate à cette époque. Cependant l'organe de Maurice Voisin<br />
en présentant l'indépendance comme un épouvantail, cherche à obtenir l'effet<br />
contraire de ce qu'il écrit. Des multiples cercles de la presse métropolitaine,<br />
adoptent la même stratégie. C'est le cas des journaux comme Climats, Marchés<br />
Tropicaux, Paris-Match, etc. Du reste, le rédacteur en chef de ce dernier organe a<br />
effectué en 1953 une tournée en Afrique noire française. Le Quay d'Orsay comme<br />
la rue Oudinot, ont adressé des instructions pressantes aux plus hautes autorités de<br />
la Fédération à Dakar pour que ce voyage de reportage soit entouré de la plus<br />
grande attention, eu égard à "l'importance du tirage, la diffusion à l'étranger et<br />
l'autorité de Cartier". (18). A l'adresse du Haut commissaire de Dakar, le MFOM<br />
précise davantage les objectifs en ces termes: "Ce voyage de Raymond Cartier est<br />
de nature à lui donner une idée exacte de la nature de notre oeuvre en Afrique... en<br />
15. Manifeste du PAl-Thiès. 15 septembre 1957. Voir Gëstu n° 24.<br />
16. Gëstu n° 24. Août 1987. 30e anniversaire PAl.<br />
17. L'Etudiant d'Afrique noire. 1er trimestre 1958.<br />
18. Af. pol. AOF. ANSOM. carton 2118 dos. 4. lettre du Ministre des Af. étrangères à MFOM. 23 juin 1953.<br />
477
direction de l'opinion mondiale" (19). Paris-Match s'engage déjà au même moment<br />
dans une campagne au nom célèbre de "cartérisme" (20).<br />
L'administration dakaroise elle aUSSI évoque à cette époque<br />
l'indépendance de l'Afrique pour des "raisons stratégiques". Ainsi le Haut<br />
Commissaire Gaston Cusin exprime lors d'une conférence de presse donnée à<br />
Dakar le 19 février 1958: "Il faut parler d'indépendance parce qu'il faut, avec la<br />
franchise, voir que ce problème est posé et qu'il ne faut pas qu'on agite ce mot<br />
d'indépendance comme un chiffon rouge excitant les extrémistes, mais il faut que<br />
très rapidement nous exorcisions cette formule, que nous la vidions de son sens<br />
politique pour lui restituer sa valeur véritable". (21). Le Chef de la fédération<br />
rendant compte le 21 février 1958 des travaux de la conférence des présidents et<br />
vice-présidents de gouvernement revient sur la question abordée pendant les<br />
travaux et affirme: "les Constituants de 1946 se sont engagés à accorder cette<br />
indépendance dès que la situation la rendra possible." (22)<br />
Après que les événements de la mi-mai 1958 à Alger porte de Gaulle de<br />
nouveau à la tête du gouvernement à Paris, les relations métropole - territoires<br />
d'outre-mer connaissent une nouvelle évolution. Une naissance symbolique de<br />
l'Etat africain autonome intervient par l'ordonnance du 26 juillet 1958. Désormais<br />
les vice-présidents des conseils - les lers des ministres africains - remplacsssssent à<br />
la présidence les chefs des territoires qui représentent l'Etat français (23). Mais une<br />
réforme plus profonde de ces relations intervient avec l'adoption des conclusions du<br />
Comité Consultatif Constitutionne mis en place par de Gaulle avec la participation<br />
de 4 Africains tous partisans notoires de la domination coloniale.<br />
Un autre africain - Houphouët Boigny en tant que ministre - participe<br />
aux travaux du Comité. Lui aussi est un ardent défenseur du maintien de l'essence<br />
des relations entre Métropole et T.a.M.<br />
Uopold Sédar Senghor constate que les travaux de ce c.c.c. offrent la<br />
possibilité d'accéder à l'indépendance et à l'unité africaine. "Le général a fait droit à<br />
nos revendication" conclut-il (24) en expliquant la position adoptée par son parti:<br />
19. Lettre MFOM à Re. 18 juillet 1953. même dossier.<br />
20. Doctrine politique déftnie par R. Cartier. Elle prône l'indépendance immédiate des colonies. Ainsi la<br />
métropole débarrassée de ce fardeau consacrerait toutes ses ressources à son propre développement.<br />
21. Revue internationale de la F.O.M. nO 341. Avril 1958.<br />
22. R. de Benoist. L'AfriQue Occidentale française, 1978, p. 568.<br />
23. Colloque: la politique africaine du général de Gaulle: 1958-1969. Paris octobre 1979.<br />
24. L.S.S. Position sur le référendum de 1958 : les cahiers de la République. Octobre 1958. Liberté 2.<br />
478
le P.R.A, laquelle position n'est différente de celle du parti rival: le RDA que sur<br />
des aspects fort secondaires et se résumant à "liens directs ou indirects" avec la<br />
métropole. Aucune remise en cause de la dépendance n'est revendiquée par ces<br />
représentants de l'Afrique noire au sein de ce Comité Consultatif Constitutionnel.<br />
Ainsi lorsque la campagne pour le référendum s'ouvre, tous ces partis prônent le<br />
"oui" pour rester au sein du nouvel ensemble colonial réformé proposé par la<br />
métropole. La victoire électorale acquise en faveur de cette réforme a pour<br />
conséquence immédiate la mise en place des structures de la Communauté<br />
Française en remplacement de celles de l'Union Française. La résolution adoptée le<br />
25 novembre 1958 par l'Assemblée territoriale du Sénégal stipule: "Le territoire du<br />
Sénégal adopte le statut d'Etat membre de la Communauté. Il décide d'adhérer en<br />
outre à la fédération qui sera formée entre les anciens territoires d'Afrique noire<br />
qui auront fait la même option." (25). Une cérémonie riche en couleurs et<br />
hautement orchestrée le 14 juillet 1959 voit le Président de la République française<br />
remettre à chacun des chefs des gouvernements africains le drapeau de la<br />
Communauté Française, lequel n'est rien d'autre que la bannière tricolore frappée<br />
de la devise française: "Liberté - Egalité - Fraternité" symbole on ne peut plus<br />
partant comme la remarque Abdoulaye Ly (26). Les nouveaux états autonomes<br />
d'Afrique noire française sont encore solidement rivés au char colonial français<br />
artificiellement rebaptisé.<br />
- L'étape 1959-1960.<br />
La dominante reste une consolidation quelque peu masquée du maintien<br />
de relations de dépendance. Certes, en 1960, une cascade d'indépendances<br />
intervient en Afrique noire française. La métropole a appliqué une stratégie<br />
nouvelle qui consiste à "pousser" les états vers la souveraineté dans des conditions<br />
d'accords de coopération préservant ses intérêts fondamentaux.<br />
En début 1959, Sénégalais et Soudanais mirent en place une fédération à<br />
deux, faute de pouvoir y englober un plus grand nombre, suite aux défections des<br />
Voltaïques et Dahornrens et face à la mise en place d'un ensemble articulé autour<br />
d'Abidjan: le Conseil de l'Entente regroupant les états de Côte d'Ivoire, du Niger,<br />
du Dahomey et de la Haute-Volta. La rivalité Senghor-Houphouët Boigny joua<br />
ainsi jusqu'au bout après avoir revêtu un caractère de parti à un moment donné<br />
(querelle PRA/RDA) dans la mesure où chacun des 2 principaux leaders appuie sur<br />
un appareil politique à sa dévotion. Cette fédération du Mali, poussée par le<br />
25. Paris. Dakar. 27/1/58.<br />
26. Abdoulaye Ly. Emergence du néo-colonialisme au Sénégal. 1981. p. 42.<br />
479
contexte général, et surtout par le militantisme plus progressiste de la partie<br />
soudanaise, s'engage rapidement dans la voie de la recherche de l'indépendance<br />
négociée avec la puissance coloniale. C'est aussi que dès le 4 avril 1960, à Paris,<br />
négociateurs français et maliens (27) bouclent avec une rapidité notoire, le dossier<br />
du transfert des compétences permettant de la sorte, à la Fédération d'accéder<br />
rapidement et pacifiquement à l'indépendance. Senghor lui-même exprime sa<br />
grande joie de la compréhension manifestée par la métropole (28). Par contre, le<br />
PAl, constate qu'à travers cette rapide négocisation, les représentants du Mali ont<br />
simplement enregistré le "diktat" de la partie française (29). Monsarew passe en<br />
revue les accords en question pour mettre en exergue leur caractère d'inégalité<br />
totale car ils mettent en place une nouvelle forme de dépendance.<br />
Outre cet aspect des accords, lorsque le 20 juin 1960, sur le palais du<br />
gouverneur général de l'AOF à Dakar, le drapeau tricolore français est baissé pour<br />
être immédiatement remplacé par les couleurs du Mali (30) officiellement, la<br />
domination coloniale prend fin d'autres points importants, d'ombres restent. Les<br />
parties prenantes de la Fédération du Mali n'ont pas mis en place toutes les<br />
structures importantes du nouvel Etat. La présidence de la nouvelle république,<br />
entre autre, n'a pas fait l'objet d'un accord entre Sénégalais et Soudanais. Chacune<br />
des composantes de la fédération cherche à faire élire son leader politique à la<br />
magistrature suprême. Or chacun de ces leaders occupe déjà un poste fort<br />
important: Senghor préside l'Assemblée Fédérale et Modibo Keita est le Chef du<br />
gouvernement. De même, la direction de l'armée fédérale devient un élément de<br />
conflit ouvert puisque chacune des parties a son candidat et que tous les 2 candidats<br />
ont le même grade: colonel. Toute nomination au poste de chef d'Etat major<br />
fédéral suppose un acte du ministre fédéral de la sécurité et de la défense c'est-à<br />
dire du Sénégalais Mamadou Dia mais un tel acte ne peut avoir de valeur que<br />
revêtu de la signature du Soudanais Modibo Keita chef du gouvernement fédéral.<br />
Ce conflit ouvre donc une réelle crise dans l'appareil d'Etat malien d'autant plus<br />
qu'il se produit exactement au moment même où les tractations entre Sénégalais et<br />
27. Il s'agit de Michel Debré pour la partie française, et Modibo Keita et Mamadou Dia pour le Mali.<br />
28. Paris-Dakar. 5 avril!960 résume ces accords.<br />
29. Monsarew. Mai 1960.<br />
30. vert-jaune et rouge avec un idéogramme au milieu du jaune.<br />
480
Soudanais pour régler la question litigieuse de la présidence fédérale sont<br />
réellement au point mort. (31)<br />
Ainsi, dans la nuit du 19 au 20 août 1960, la fédération du Mali éclate<br />
seulement après deux mois de souveraineté (32). Cette existence éphémère malgré<br />
les serments de fidélité à la "patrie africaine" clamés lors de la constitution du Mali<br />
marque en réalité une mésentente fondamentale autour du concept même de<br />
l'indépendance. Etait-il possible à ceux qui hier encore plaidaient si chaudement et<br />
partout les intérêts de la métropole, de concevoir une accession à une indépendance<br />
réelle?<br />
La réponse à cette question est non. De plus, en 1953 encore Senghor<br />
estime que l'indépendance ne peut par intervenir avant 10, 20, ou 30 ans (33) et<br />
prône l'apprentissage de la démocratie au sein des assemblées mises an place par la<br />
puissance coloniale. Cet homme politique lui même reconnait lors d'une conférence<br />
de presse donnée à Dakar en août 1960 que les Soudanais et les Sénégalais -parties<br />
prenantes de la fédération - "n'avaient pas été formés à la même école politique...<br />
que les Soudanais sont pour des méthodes plus totalitaires, tandis que les Sénégalais<br />
sont pour des méthodes plus libérales". (34). Cette formation et cette orientation<br />
différentes constituaient, pour l'homme politique Sénégalais, les raisons profondes<br />
des divergences ayant entraîné la rupture de la fédération du Mali.<br />
En fait la raison fondamentale de la dislocation de cet ensemble fédéral<br />
est que Senghor n'est pas prêt à se séparer de la métropole par quelque forme<br />
d'indépendance qu'il soit. Trop longtemps il a plaidé pour la préservation des<br />
relations établies par la puissance coloniale. Le contexte politique global de<br />
l'Afrique noire a certes influencé les positions du leader politique mais pas jusqu'à<br />
l'amener à accepter un bouleversement de ces relations. Si l'ensemble fédéral du<br />
Mali s'est néanmoins orienté vers l'indépendance - et dans les conditions que l'on<br />
sait - c'est que le poids des hommes politiques de la partie soudanaise y est très<br />
certainement pour l'essentiel. Du reste, la période comprise entre août (date de la<br />
rupture de la fédération) et la fin de l'année 1960, marque une certaine continuité<br />
de la domination coloniale au Sénégal malgré les apparences de souveraineté. En<br />
31. Le 20 août 1960, une réunion préparatoire devrait se tenir à Dakar pour préparer les élections du 27<br />
courant pour les postes de présidences de la Fédération et de l'Assemblée Fédérale. Une seule<br />
candidature: ceUe de Senghor avait été officieUement enregistrée d'après Paris-Dakar du 17 août 1960.<br />
32. Paris-Dakar. 20 août 1960.<br />
33. Afrique Nouvelle. 4 mars 1953.<br />
34. Paris-Dakar. 23 août 1960.<br />
481
effet, ni sur le plan économique, ni sur le plan social encore moins sur les plans<br />
militaire et culturel, aucune mesure de remise en cause de la situation n'est prise<br />
pour Senghor devenu chef de l'Etat depuis le 5 septembre 1960 date à laquelle "à<br />
l'unanimité des 118 votants L.S. Senghor a été élu Président de la République du<br />
Sénégal" (35) ni par Mamadou Dia qui conduit le nouveau gouvernement (36).<br />
L'accession du Sénégal à la souveraineté internationale ne modifie donc pas de<br />
manière réelle, les relations avec l'ancienne métropole.<br />
Le chef de l'Etat et son gouvernement mettent tout en oeuvre pour<br />
réduire au silence toute expression en faveur d'une indépendance réelle.<br />
2).La question de l'unité.<br />
Comme le problème de l'indépendance, la question de l'unité est un<br />
point central pendant les années 1945-1960. Partis et hommes politiques,<br />
organisations syndicales, de jeunesse et de femmes, etc... l'abordent largement.<br />
L'administration coloniale elle aussi, lui attache une grande importance.<br />
Cependant, les raisons des uns et des autres sont loin d'être les mêmes.<br />
En 1960, on peut constater que la réponse apportée à la question est<br />
essentiellement donnée par la métropole. Les intérêts coloniaux ont été pour<br />
beaucoup de chose dans cette approche définitive. L'Afrique française est<br />
balkanisée et à la place des ensembles fédéraux, une multitude d'Etats accèdent à<br />
l'indépendance dans des conditions peu viables.<br />
, . La phase 1945-1955 :<br />
La métropole exerce une autorité sans partage. La vie politique est à<br />
peine introduite dans l'ensemble de la Fédération exception faite des 11 communes<br />
de plein exercice qui sont toutes sénégalaises. Les multiples réformes introduites<br />
par le gouvernement français dans les années 1943-1944 mais surtout dès la fin du<br />
2e conflit mondial servent de soubassement à cette activité politique nouvelle en<br />
AüF. La question de l'unité est déjà posée. Ainsi le RDA dont la gestation a été<br />
étroitement soutenue par le Parti Communiste Français (P.C.F) se fixe dès le départ<br />
l'objectif d'une solide assise unitaire à travers toute la Fédération. Mais les<br />
principaux leaders politiques sénégalais, Lamine Guèye et Léopold Sédar Senghor<br />
signataires du texte de base, refusent, en définitive d'être parmi les fondateurs du<br />
35. Paris-Dakar. 6 septembre 1960.<br />
36. Paris-Dakar. 7 septembre 1960. Mamadou Dia conduit le gouvernement territorial depuis l'application<br />
de la Loi-Cadre.<br />
482
RDA. Les pressions des milieux gouvernementaux et surtout de la F.O.M ont<br />
dissuadé ces élus S.F.r.O d'honorer leur engagement.<br />
Ce fait constitue pour la trame historique des événements à venir, la<br />
toile de fond du débat sur l'unité en AOF. Ainsi lorsque le RDA développe ses<br />
activités dans l'ensemble de l'AOF en installant de solides sections dans la plupart<br />
des territoires, il crée ainsi un outil très puissant car pour la première fois, la<br />
possibilité est ainsi offerte aux Africains de s'organiser sur toute l'étendue de la<br />
Fédération.<br />
Mais très tôt, le RDA est durement combattu par l'adllÙnistration<br />
coloniale et son apparentement au P.C.F ne constitue qu'accessoirement la<br />
cause. (37). Au niveau du territoire du Sénégal et plus particulièrement dans la<br />
capitale fédérale de l'AOF, l'UDSjRDA est visée par la répression coloniale<br />
surtout lorsque la direction du Rassemblement décide de changer de cap en 1950 et<br />
que sa section sénégalaise refuse de suivre la nouvelle orientation.<br />
Avec la SFIO, la création du groupe des Indépendants d'Outre-Mer<br />
(rOM) après le congrès de Bobo-Dioulosso en février 1953 met sur la scène<br />
politique de l'AOF deux formations concurrentes en RDA. Dès lors, dans les<br />
relations entre les forces politiques africaines mais aussi dans leurs relations<br />
extérieures, la position de l'unité est posée: Organisations syndicales de jeunesse, de<br />
femmes, d'étudiants et autres s'en préoccupent longuement. Les solutions<br />
préconisées par les uns ne manquent pas d'échos chez les autres et ceci dans un<br />
contexte où la puissance coloniale cherche à orchestrer l'ensemble du jeu.<br />
Cette question de l'unité de la Fédération est posée sous diverses formes.<br />
Ainsi dans les travaux du Grand Conseil de l'AOF, elle est présente à travers les<br />
débats autour du poste budgétaire de la "Délégation de Dakar". Elle est soulevés<br />
toutes les fois que la haute assemblée locale se penche sur le budget de l'ensemble<br />
colonial. Les revendications éllÙses pour faire de la ville de Dakar une entité<br />
fédérale comme l'est le district de Washington aux USA ressortent en partie d'un<br />
désir d'asseoir la fédération sur des bases solides et égalitaires entre tous les<br />
territoires. En effet, certains représentations comprennent mal que la suppression<br />
de la "Circonscription de Dakar et Dépendances" et son remplacement en 1946 par<br />
la "Délégation" opérés par l'adllÙnistration confèrent au territoire du Sénégal des<br />
avantages substantiels particuliers. En réclamant ce statut fédéral, leur objectif n'est<br />
37. Le poète et homme politique Aimé Césaire a consacré à cette répression un poème: "RDA qui se bat<br />
pour la conquête des libertés africaines". Il immortalise Dimbokro, Bouaké, Séguela: principaux centres<br />
de la répression coloniale contre la Rassemblement.<br />
483
pas de s'en prendre au Sénégal (38). contrairement à ce que les répliques des<br />
représentants de ce territoire laissent croire.<br />
En 1955 L.SQ Senghor pose la question de l'unité de l'ensemble fédéral<br />
de l'A.O.F en préconisants "la constitution de 2 territoires économiquement viables,<br />
- articulés l'un autour de Dakar - et constitué de Snégal, Mauritanie, Soudan et<br />
Guinée - et l'autre autour d'Abidjan - et comprenant: Côte d'Ivoire, Dahomey,<br />
Haute Volta, Niger." (39).<br />
Il change d'opinion dans les années 1957-1960 se proclamant défenseur<br />
zélé de l'AOF. On remarque cependant qu'au moment où Léopold Sédar Senghor<br />
préconise la division de l'ensemble colonial, il est membre du gouvernement<br />
français dans le cabinet d'Edgar Faure. Cette position lui a peut-être fait épouser les<br />
vues des cercles dirigeants coloniaux. Lorsqu'il quitte le gouvernement, il<br />
l'abandonne.<br />
Comme Léopold Sédar Senghor en 1955, d'autres hommes politiques<br />
dans la période 1945-1955, souhaitent la dislocation des ensembles coloniaux<br />
d'Afrique noire. Ainsi, le Sénateur ivoirien Djaumont disait: "nos tam-tam sont<br />
impatients de saluer la mort du gouvernement général" (40). Le député et grand<br />
conseiller du Dahomey Justin Ahomadegbé dénonce "l'hydre de Dakar" (41).<br />
Cette question de l'unité de la fédération de l'AOF ne laisse pas<br />
insensibles le gouvernement français et les plus hautes autorités administratives et<br />
économiques de la Fédération. Dès janvier 1945, un des gouverneurs, en réponse à<br />
une consultation, adresse à son chef à Dakar un mémorandum dans lequel il<br />
préconise la suppression du gouvernement général et son renplacement par 4 unités<br />
territoriales.<br />
Le Directeur général des affaires économiques de l'AOF Charles Jarre<br />
demande lui aussi, en 1950, le morcellement de l'AOF en "3 grandes colonies<br />
économiques et un territoire saharien". En 1953, Louis Delmas homme des grands<br />
milieux d'affaires locaux représentant du Sénégal au Grand Conseil et rapporteur<br />
de sa commission des finances développe, devant cette assemblée, le caractère de<br />
pauvreté notoire de la Fédération dont 6 des 8 territoires sont régulièrement<br />
déficitaires et engloutissent des recettes en provenances des 2 autres (Côte d'Ivoire<br />
38. Fily Dabo SÏssoko du Soudan, Sourou Migan Apitby du Dahomey ont été parmi les principaux<br />
adversaires de l'ensemble fédéral.<br />
39. Roger de Benoist. L'Afriqu Occidentale francaise. 1978. p.337.<br />
40. Roger de Benoist. l'Afrique Occidentale Française, 1978, p. 124.<br />
41. L'Afrique Nouvelle. 22 novembre 1955.<br />
484
et Sénégal). Au même moment Jean Delafose autre représentant des milieux<br />
d'affaires et membre de la haute assemblée locale se plaint que son territoire - la<br />
Côte d'Ivoire - soit obligé de payer trop cher sa solidarité avec les autres territoires<br />
de l'AOF. (42).<br />
Quelques années plus tard le MFOM, charge l'inspecteur général<br />
Sauner d'un projet de réforme des structures de l'AOF. Ce dernier conclut à la<br />
nécessité de morceler l'ensemble colonial: "l'AOF est trop grande et le territoire<br />
trop petit." et cette opinion est développée à la réunion présidée le 21 juillet 1955 à<br />
Dakar par le Ministre de la FOM, Tietgen lui-même. Devant les gouverneurs et<br />
directeurs généraux de la Fédération, le conseiller du ministre présente l'AüF<br />
"comme un ensemble fr démesuré et misérable" (43) et préconise son morcellement<br />
en 3 groupes de territoires dont le Haut Commissaire ne serait plus qu'un<br />
coordinateur résidant à Paris et non plus à Dakar et serait un conseiller du<br />
gouvernement.<br />
En somme les années 1945-1955 sont dominées par la question de savoir<br />
si oui ou non il faut conserver l'ensemble fédéral de l'AüF. La période de 1956 à<br />
1960 voit le débat se prolonger et prendre de l'ampleur, surtout à partir de la<br />
réforme constitutionnelle de juin 1956 plus connue sous le nom de Loi-Cadre ou Loi<br />
Gaston Defferre.<br />
L'étape 1957. 1960.<br />
Le 23 juin 1956, le Ministre de la France d'Outre-Mer, Gaston Defferre<br />
fait adopter par l'Assemblée nationale française un texte de réforme de l'Union<br />
Française. Le contexte, il est vrai, oblige car dès le 1er novembre 1954, et alors qu'à<br />
peine la France sort affaiblie de la guerre d'Indochine, le F.L.N. ouvre un autre<br />
conflit armé en Algérie. Devant cette 'bourrasque" (44) le gouvernement n'a dans<br />
l'immédiat qu'une solution: "on ne transige pas lorsqu'il s'agit de défendre la paix<br />
intérieure de la Nation et l'intégrité de la République" comme le dit le 12 novembre<br />
le Président du Conseil. Mais cette volonté affichée n'est pas suffisante tant<br />
l'opinion française se divise sur la question au point que l'Assemblée Nationale est<br />
dissoute et de nouvelles élections organisées en janvier 1956. Elles permettent<br />
l'investigature du gouvernement Guy Mollet le 5 février 1956. Dans ce cabinet,<br />
42. Roger de Benoist. L'Afrigue Occidentale Francaise. 1978, p 331 et suivantes.<br />
43. Roger de Benoist. L'Afrigue Occidentale Française. p. 338<br />
44. J. P. Rioux. La France de la Ouatrième République, 1980, T. II. p. 66.<br />
485
Gaston Defferre, qui prend en charge la France d'Outre-Mer est pressé de trouver<br />
une réforme susceptible de sauver l'essentiel, d'autant plus que le conflit algérien<br />
s'éternise et s'internationalise et que la Maroc et la Tunisie voisins soutiennent<br />
fortement le F.L.N auquel ils offrent de précieuses possibilités de repli, de<br />
concentration et de stockage de l'armement. Pour Gaston Defferre, les événements<br />
dictent une attitude urgente et courageuse: "En agissant vite, nous ne serons pas à<br />
la remorque des événements. Il existe actuellement outre-mer un certain malaise et<br />
il importe de dissiper par une action efficace pour rétablir un climat de<br />
confiance" (45). Le gouvernement et le parlement vont vite dans le processus de<br />
réforme, la loi est adoptée dès le 23 juin 1956 et ses décrets d'application pris moins<br />
de 2 mois plus tard. Le gouverneur général de l'AOF estime que cette réforme "était<br />
impérative et urgente" en se référant à la situation "l'AOF était le théâtre d'un<br />
conflit de plus en plus aigu" (46).<br />
L'application de cette Loi-Gaston Defferre ou Loi-Cadre permet en<br />
Afrique Noire française, la mise en place de gouvernements territoriaux et engage<br />
un processus de "balkanisation". A ce sujet des voix diverses se sont élevées.<br />
Léopold Sédar Senghor dénonce les 'Joujoux et les sucettes". Mahjmout Diop écrit:<br />
"c'est en tant que député que j'ai participé aux discussions sur la Loi-Cadre. Cela<br />
m'a permis de soutenir Senghor plus efficacement et plus vigoureusement dans la<br />
lutte contre la balkanisation de l'Afrique" (47). Mamadou Dia dénonce la Loi-Cadre<br />
qui a fait "proliférer en Afrique Noire (..) quelques deux cents ministres, directeurs<br />
et chefs de cabinet dans la même situation que celle des "Deux cents familles" en<br />
France" (48). Il considère la Loi-Cadre comme "le lest jeté aux Africains pour<br />
endiguer le torrent irréversible (l'indépendance)". Le manifeste du PAl communiste<br />
dénonce la Loi-Cadre en ce sens qu'elle perpétue - indirectement - la domination<br />
coloniale: "le record fut battu au Sénégal où un ministre et tous les directeurs de<br />
cabinet sans exception, sont d'anciens hauts fonctionnaires coloniaux d'origine<br />
métropolitaine" (49). La formation marxiste reproche aux grands partis politiques<br />
"d'accepter dans les faits la balkanisation de l'Afrique Noire c'est-à-dire le rejet de<br />
l'unité nationale" (50). Le docteur Roseta, leader politique de la Grande île, dans<br />
45. Afrique Nouvelle. 6 mars 1956.<br />
46. Roger de Benoist L'Afrigue Occidentale Française. 1978. p. 456.<br />
47. Mamadou Dia. Mémoires d'un militant du Tiers-monde. 1985. p. 70.<br />
48. Mahijmout Diop. Contribution à l'étude du problème politique. 1959. p. 256.<br />
49. Gëstu n° 24. Août 1987.<br />
50. Item.<br />
486
un "Appel au peuple malgache en octobre 1957" écrit: "Elle (la France) nous a<br />
octroyé unilatéralement la Loi-Cadre, loi qui a pour but de perpétuer le<br />
colonialisme et d'abusear le monde de la prétendue générosité de la France envers<br />
e"<br />
ses colonisés" (51). BessiQre, vice-président du gouvernement de Tamatave se<br />
demande si la Loi-Cadre n'est pas un "marché de dupes" minant l'unité de la<br />
Grande Ile. Il considère: "Madagascar est un territoire, il doit le demeurer. La<br />
présence de six exécutifs est une source permanente de conflits qui iront en<br />
s'aggravant" (52). Cette Loi-Cadre est également condamnée par diverses<br />
organisations. Les travailleurs regroupés dans l'UGTAN pensent qu'elle "est une<br />
mystification, une façade qui ne trompe personne; elle a pour seul but de nous<br />
diviser, de masquer et de perpétuer le régime colonial" (53). Les étudiants africains<br />
en France regroupés dans la FEANF dénoncent les manoeuvres de diversion et de<br />
mystification entreprises par la France et condamnent fermement les élus africains<br />
qui se font les instruments de cette politique. S'associant à eux, à ce sujet, l'UGEAO<br />
et le C.J.A présent aux travaux de leur VIlle congrès en décembre 1957. Le IX<br />
congrès de l'organisation réuni à Paris les 21, 22 et 23 juin 1958 réaffirme la<br />
condamnation de la division de l'Afrique Noire opérée par la réforme de la Loi<br />
Cadre. Le Grand Conseil de l'AOF vote le 28 juin 1956, une motion adoptée à<br />
l'unanimité et réclamant le maintien de l'échelon fédéral. La délégation de 4<br />
membres désignés par la Commission Permanente de cette assemblée pour<br />
défendre à Paris cette motion auprès du M.F.O.M n'obtient aucun résultat positif.<br />
Du reste, à sa session budgétaire de novembre 1956, se produit ce que le Père<br />
Roger de Benoist a appelé "la révolte du Grand Conseil". A à cause de sa démarche<br />
négative à Paris l'Assemblée décide le 4 décembre, de surseoir au vote le budget de<br />
la fédération parce qu'elle ne dispose pas d'informations sur les décrets et leurs<br />
conséquences financières. (54) Paris publie, le jour même, les décrets d'application<br />
de la Loi-Cadre indiquant ainsi sa volonté totale de réformer l'Union Française sans<br />
avoir à consulter le Grand Conseil de l'AOF à ce sujet. Les Assemblées territoriales<br />
du Soudan, du Sénégal, de la Guinée et du Dahomey se solidarisent avec le Grand<br />
Conseil de l'AüF dans sa démarche concernant la Loi-Cadre mais cette révolte<br />
n'eut pas de lendemain car dès mars 1957, de nouvelles élections renouvellent les<br />
assemblées de territoire et aussi le Grand Conseil. En raison de la percée électorale<br />
importante du RDA qui obtient 19 des 40 sièges de l'Assemblée de la place<br />
51. Présence Africaine. Décembre 1957.<br />
52. Déclaration faite au journal Combat le 15 février 1958.<br />
53. Travaux du Congrès de Cotonou, 16 janvier 1957.<br />
54. Item.<br />
487
Tascher (55) et dont le leader Houphouët Boigny, ministre du gouvernement<br />
français, défenseur acharné de la Loi-Cadre pour laquelle il a contribué<br />
effectivement à l'élaboration et à l'adoption, la prise de position du Grand Conseil<br />
est contrée par les événements, en particulier l'élection du leader ivoirien à sa<br />
présidence dès la 1ère session après le renouvellement des membres.<br />
La mise en place des gouvernements de la Loi-Cadre dès mai 1957 et<br />
surtout, la volonté de la France de disloquer les ensembles fédéraux qu'elle a mis<br />
sur pied en AOF, en AEF et à Madagascar dès l'achèvement de la conquête à la fin<br />
du 1ge siècle - début 20e, portent un rude coup à l'unité, surtout après l'arrivée du<br />
Général de Gaulle au pouvoir. La nouvelle réforme constitutionnelle de septembre<br />
1958 précipite la dislocation de ces fédérations avec le passage des territoires de<br />
l'étape de la semi-autonomie à celle de l'autonomie complète dès 1958. Diverses<br />
tentatives de maintenir l'unité se soldent par des résultats peu élogieux comme par<br />
exemple le projet de création du Mali avec les 4 territoires parties prenantes au<br />
départ et qui ne furent que 2 en définitive et l'éclatement par la suite.<br />
Désormais le processus de la dislocation est engagé. Dès le 5 mars 1959,<br />
suite aux travaux de. la 2e session du Comité Exécutif de la Communauté, se tient à<br />
Paris une réunion des chefs de gouvernement africains sous la présidence du Haut<br />
Commissaire général de l'AOF Pierre Messmeer. Cette réunion adopte dans les<br />
grandes lignes, le principe du partage des biens de la fédération. L'inspecteur<br />
général des affaires économiques, le gouverneur Risterruci est nommé président de<br />
la Commission des Transferts et liquidation. Celle-ci tient sa première réunion à<br />
Dakar dès mars 1959 et une 2e début juin. L'accord est fait sur le principe de<br />
répartition géographique tant pour les immeubles que pour biens meubles. Chaque<br />
territoire garde ce qui se trouve dans ses limites. Mais comme la moitié des<br />
immeubles fédéraux se trouve à Dakar, la Commission arrête que le Sénégal doit<br />
verser aux autres territoires la somme de 4 milliards de F.CFA (56). Les discussions<br />
ultérieures courant 1959 et début 1960 aboutissent à "la solution à l'africaine"<br />
(expression rapportée de l'un des participants) (57) qui ramène la dite somme à un<br />
montant total de 1,4 milliard. La seconde tâche de la commission, la liquidation des<br />
services publics (archives, imprimerie de Rufisque, service des logements, Régie des<br />
transports, garage central, building administratif) imposée par la disparition du<br />
gouvernement général est accomplie parce qu'ils sont supprimés ou transférés à<br />
55. Il s'agit du Grand Conseil de l'AOF ainsi appelé à cause de la place qui lui fait face et porte le nom de<br />
l'ancien Président de la CCAI de Dakar.<br />
56. Marchés Tropicaux. 17 octobre 1959.<br />
57. Afrique Nouvelle. 30 mars 1960.<br />
488
l'Etat fédéral du Mali. (58). Quelques rares structures fédérales sont néanmoins<br />
conservées comme le Centre de recherche sur les grandes endémies situé en Haute<br />
Volta (59). L'acheminement séparé vers l'indépendance des Etats, du Conseil de<br />
l'Entente et aussi de la fédération du Mali consacre la rupture définitive de la<br />
Fédération de l'AOF que la Guinée par son vote négatif au référendum de<br />
septembre 1958 a déjà quittée, à un moment où la Mauritanie regarde de plus en<br />
plus vers les états arabes du nord. La cascade des indépendances en juin et août<br />
1960 marque le terme du processus de la dislocation de l'AOF.<br />
Dès lors, la question de l'unité ne se pose plus, dans les termes du<br />
maintien des ensembles fédéraux édifiés par le colonisateur. Dans l'immédiat, les<br />
états issus de la dislocation sont directement en rapport avec la France dans le<br />
cadre de la Communauté Française. Leur poids politique, économique,<br />
démographique en fait des nains comparativement à la France. Cette situation<br />
traduit incontestablement un succès de la politique de l'ancienne puissance<br />
coloniale car elle obtient, sans coup férir, et avec la complicité notoire de maints<br />
hommes politiques africains, une situation favorable de "face à face" entre elle et<br />
des "Etats nains" (60). La rapidité de ce processus de dislocation et de "marche<br />
forcée" vers l'indépendance n'ont pas manqué de retenir l'attention de l'opinion en<br />
métropole. Ainsi, en parlant de la précipitation avec laquelle la Fédération de<br />
l'Ouest est démantelée, la Revue Internationale de la F.O.M écrit : "Le sigle de<br />
l'AOF a déjà disparu des en-têtes administratifs, sur les instructions officielles<br />
venues de Paris. Cette hâte, à vrai dire, nous paraît surprenante... Tout se passe<br />
comme si l'on avait hâte d'accélérer, d'approfondir l'émiettement d'une fédération<br />
vieille de plus de 50 ans". La rédaction de la revue remarque "qu'on voulait pousser<br />
à l'extrême les conséquences des divisions crées par la Loi-Cadre". Dans une autre<br />
publication de la revue, un mois plus tard, il est fait état des frictions que la<br />
conférence de dévolution du poste de Radio-Inter de Dakar a créées entre le Haut<br />
Commissaire général et certains ministres du Mali (61). Ces derniers reprochent au<br />
Chef de la fédération la précipitation de ses mesures. Marchés Tropicaux autre<br />
organe de la presse parisienne fait état d'un véritable conflit apparu lors de cette<br />
conférence au cours de laquelle, les ministres maliens évoquant même l'éventualité<br />
d'utiliser la force pour s'opposer aux positions du Palais de Dakar. Le<br />
gouvernement du Mali prend dès le 6 avril 1959 un décret pour s'attribuer le poste<br />
58. Roger de Benoist. L'Afrique Occidentale Francaise. 1978. p. 753.<br />
59. Ce centre Jamot a été préservé de la dévolution par la conférence des 7 ministres de la santé.<br />
60. Revue internationale de la F.O.N n° 351, février 1959.<br />
61. Item. n° 355. Mars 1959.<br />
489
de Radio-Inter et une série de réunions seront nécessaires pour régler le litige. (62).<br />
La droite coloniale française peut manifester sa joie au sujet de cette balkanisation,<br />
elle dont l'organe "Climats" a demandé la "mort aux gouvernements généraux"<br />
plusieurs années durant.<br />
L'unité de l'AOF ne résiste donc pas aux multiples pressions<br />
métropolitaines mais aussi locales. La loi Gaston Defferre ou Loi-Cadre a précipité<br />
le processus de division.<br />
II. La consolidation du nouvel état<br />
Le vote de la Loi-Cadre en juin 1956 et sa mise en application en mai<br />
1957 se traduisent au niveau du Sénégal par la constitution du gouvernement de la<br />
semi-autonomie, puis de l'autonomie et ensuite de l'indépendance. Les relations<br />
avec les diverses forces vives du Territoire sont marquées par de nombreux heurts<br />
plus ou moins importants avec la nouveau pouvoir, laissant présager un réel divorce<br />
surtout avec le monde du travail salarié, une des bases essentielles du nouvel état en<br />
édification.<br />
Mamadou Dia qui a constitué le gouvernement à la demande pressante<br />
de Léopold Sédar Senghor qui trois mois durant à ""travailler" mes amis de façon à<br />
m'arracher mon acceptation" (63). Les ministres ont été choisis, d'après le Chef du<br />
gouvernement, selon des critères de dévouement, de désintéressement et de<br />
compétence et en toute liberté (64). Sept sont parlementaires contre quatre non<br />
parlementaires, ce qui indique la place importante d'un parlementarisme naissant.<br />
Fait important, les 2 ministres d'origine métropolitaine sont André<br />
Peytavin titulaire de la charge des finances et Boissier Palun au porte-feuille du<br />
Plan et de l'Economie générale. Philippe Guillemin insiste dans son étude sur la<br />
structure des premiers gouvernements locaux en Afrique, (65), sur le fait qu'il n'y a<br />
eu "aucune pression des services de la F.O.M dans ces choix" car il remarque que<br />
dans la quasi totalité des cas, des ministres de race blanche sont installés à la tête de<br />
ces secteurs clefs.<br />
62. Marchés Tropicaux du 25 avri11959.<br />
63. Mamadou Dia. Mémoires... 1985. p. 71.<br />
64. Ibidem<br />
65. Philippe Guillemin. in Afrique. documents. cahiers n° 48-49.1959.<br />
490
Mamadou Dia lui-même reconnaît cette importance particulière des<br />
portefeuilles laissés aux mains des ministres d'origine métropolitaine. Parlant de<br />
l'ancien président du Grand Conseil de l'AOF Boissier Palun, il qualifie de "Super<br />
ministère" le poste qu'il occupe dans son gouvernement. Du reste, lorsque Dia<br />
remanie à la fin de 1957, son équipe en scindant ce ministère en deux (Plan et<br />
Economie Générale) Boissier Palun prend mal la chose et démissionne (66). Le<br />
manifeste du P.A.I critique la présence des ministres d'origine métropolitaine à ces<br />
postes-clefs tout comme le choix de directeurs de cabinet européens pour<br />
l'ensemble des ministères: "En vérité nul cadeau merveilleux et aucune aussi bonne<br />
surprise ne pouvaient être faits à l'administration coloniale." (67). L'organe de la<br />
section sénégalaise de ce parti marxiste léniniste fustige ces européens milliardaires<br />
qui gouvernent le pays (68) et cite entre autres, Boissier Palun. Un autre organe de<br />
la presse dakaroise "Echos d'Afrique Noire" dénonce par contre la toute puissance<br />
que la Loi-Cadre a apporté aux Indigènes et qui fait que "les fonctionnaires<br />
européens sont réduits au rôle de larbins qui tremblent devant le pouvoir d'un<br />
simple planton." (69)<br />
L'application de la Loi-Cadre pose, dès les premiers mois des problèmes<br />
sérieux dans la répartition des compétences entre le gouvernement territorial et les<br />
autorités coloniales métropolitaines locales: ceci a un point tel que les nouveallX<br />
responsables sénégalais se plaignent de pratiques non conformes à l'esprit de la loi.<br />
Ainsi, dans une communication devant le Conseil du gouvernement, Mamadou Dia<br />
dénonce la situation crée par les instructions de la F.O.M, transmises par le chef du<br />
Territoire le 28 août 1957 et qui aboutissent à ce que "des ministres, considérés non<br />
comme les chefs des administrations dont ils ont le contrôle mais comme des élus en<br />
mission, se voient refuser, par des textes restrictifs, des délégations dont jouissent<br />
encore des fonctionnaires qui leur sont, en principe subordonnés". (70). Le<br />
gouvernement Dia dénonce les contradictions de l'Administration divisée en<br />
services d'Etat et en services territoriaux ce qui permet au Haut Commissaire de<br />
garder la haute main sur la marche du Territoire. (71).<br />
66. Mamadou Dia Mémoires... 1985. p. 55.<br />
67. Gëstun n° 24. Août 1987. p. 5.<br />
68. Monsavew n° 9. 1959.<br />
69. Echos d'Afrique Noire. 24 août 1958.<br />
70. Mamadou Dia Mémoires... 1985. p. 75<br />
71. La sécurité, l'armée, la monnaie, la diplomatie, l'enseignement supérieU!, etc... sont encore du domaine<br />
d'Etat c'est-à-dire de la responsabilité unique du Chef du Territoire, représentant la métropole.<br />
491
Pour ce gouvernement, il apparaît indispensable de dépasser l'étape de<br />
la semi-autonomie pour celle de l'autonomie interne. L'arrivée au pouvoir du<br />
Général de Gaulle en 1958 et les diverses réformes engagées dans le cadre des<br />
institutions se traduisent dès octobre 1958 par cette évolution politique qui fait que<br />
le premier des ministres africains, de vice-président jusque là, devient le président<br />
du gouvernement de son territoire, remplaçant ainsi le Haut Commissaire c'est-à<br />
dire l'ancien gouverneur colonial qui dans la Loi-Cadre assume cette charge. Ainsi<br />
c'est donc une responsabilisation supplémentaire des autorités locales qui est<br />
décidée par la métropole.<br />
Mamadou Dia explique qu'il a beaucoup lutté, comme quelques autres<br />
chefs de gouvernement territoriaux comme Sékou Touré en Guinée pour que soit<br />
mis fin à cette dichotomie "cette dyarchie entre un chef du territoire nommé par le<br />
ministre de la France d'Outre-Mer et un vice-président qui, lui, était élu par<br />
l'Assemblée territoriale" (72). Mais il n'en reconnaît pas moins que le gouverneur<br />
Lami s'est montré très ouvert et coopératif et qu'il s'est toujours effacé devant lui<br />
sauf "lorsque nos sommes arrivés au bout du tunnel, au bout du processus, il ait eu<br />
un comportement qui jurait avec l'attitude qu'il avait eu antérieurement." (73)<br />
La mise en place de la Communauté permet cependant à la métropole<br />
de garder encore l'essentiel des pouvoirs dans la période fin 1958 mi 1960. La<br />
proclamation de l'indépendance de la fédération eu Mali d'abord en juin 1960 et<br />
celle du Sénégal en août de la même année marquent une étape importante dans le<br />
processus de consolidation du nouvel Etat. Dès début septembre 1960, toutes les<br />
structures d'un Etat indépendant sont créées avec l'élection par l'Assemblée,<br />
teritoriale de L. S. Senghor comme Président de la République et la constitution<br />
d'un gouvernement à la tête duquel il confirme Mamadou Dia. Le premier<br />
ambassadeur étranger accrédité au Sénégal est celui de France (74). Il devient par<br />
la suite le Doyen du corps diplomatique ce qui traduit la solidité des nouveaux<br />
rapports entre un Sénégal accédant à la souveraineté internationale et son ancienne<br />
puissance coloniale.<br />
Les rapports entre le nouvel état et les appareils politiques existant, de<br />
même qu'avec le monde du travail, tout comme avec la jeunesse et les intellectuels<br />
permettent d'éclairer la nature de cet état. Pour l'essentiel ces relations sont<br />
marquées par de nombreux conflits souvent très violents et qui aboutissent à créer<br />
des déceptions profondes chez ceux qui pensaient que le cheminement et l'accession<br />
72. Mamadou Dia Mémoires... 1985. CDOp. 72.<br />
73. item. p. 73.<br />
74. Paris-Dakar. 7 septembre 1960.<br />
492
à la souveraineté apporteraient des modifications positives dans leurs conditions de<br />
vie et de travail. La période de 1957 à 1960 c'est-à-dire celle de responsabilité des<br />
élites locales est riche en enseignements de toutes sortes sur les relations du pouvoir<br />
et ces diverses forces préludant ce que ces rapports seraient dans la période à venir<br />
c'est-à-dire les premières années de l'indépendance.<br />
A.Nouvel appareil d'Etat et forces politiques et syndicales de 1957 à<br />
A.1 Relation avec les partis.<br />
Avec l'application de la Loi-Cadre, le BPS, parti politique de Senghor a<br />
constitué un gouvernement approuvé par l'Assemblée Territoriale dans laquelle<br />
cette formation politique avec 47/60 des sièges est très largement majoritaire. La<br />
création de l'UPS, parti né de la fusion des deux principaux partis rivaux du<br />
Sénégal (75) en 1958 et la constitution d'un gouvernement entièrement composé<br />
des membres de cette nouvelle formation dans un contexte de mutations politiques<br />
très rapides et dictées par la métropole pose les jalons du parti unique - de fait - au<br />
Sénégal. Dès lors, les relations entre ce pouvoir et les diverses autres formations<br />
politiques sont largement marquées par une tendance à la monopolisation du<br />
pouvoir engagée par les nouveaux responsables gouvernementaux.<br />
Mamadou Dia, dès son discours d'investiture devant l'Assemblée<br />
territoriale, le 18 mai 1957, définit ainsi les objectifs de son gouvernement face à<br />
tout ce qui peut apparaître comme pressions externes: "nous sommes résolu à<br />
opposer une résistance farouche à toute tentative d'ingérence dans nos affaires<br />
intérieures, à toute pression directe ou indirecte, à toute manoeuvre tendant à<br />
alliéner l'indépendance du gouvernement local" (76). Ces propos peuvent être<br />
entendus dans le sens d'une lutte contre des pressions d'origine étrangère c'est-à<br />
dire menées de l'extérieur du territoire, mais également on peut les considérer<br />
comme une volonté affichée de mener son action sans avoir à tenir compte<br />
effectivement de critiques d'une quelconque opposition politique au niveau du<br />
territoire.<br />
Les formations politiques constituant l'opposition c'est-à-dire le P.AI (de<br />
1957 à 1960) et le P.S.S (de 1958 à 1959, mais aussi le P.R.A Sénégal (de 1958 à<br />
1960) eurent une existence particulièrement rude en raison de la politique menée<br />
75. BPS de Senghor et PSAS de Lamine Guèye. Fusionnent dans l'UPS.<br />
76. Paris-Dakar. 19 mai 1957.<br />
493
En somme, au plan politique le pouvoir s'est fait fort et absolu. Toute<br />
forme d'opposition reste difficile à exprimer et tout indique que cette situation ne<br />
peut que s'aggraver par la suite.<br />
A.2 Relation avec les syndicats<br />
Le monde syndical est traversé, au niveau de la Fédération, par les<br />
querelles de l'autonomie syndicale juste au moment où la bataille pour obtenir le<br />
Code du Travail aboutit. La mise en place des gouvernements de l'autonomie<br />
interne survient dans cette phase de querelles. La balkanisation de l'ensemble<br />
fédéral met donc, au niveau de chaque territoire, les organisations syndicales face<br />
au nouveau pouvoir, ce qui se traduit, au Sénégal par une lutte très intense. Il en<br />
résulte que le mouvement syndical se morcelle et s'affaiblit.<br />
En effet, dans le gouvernement de Mamadou Dia installé en mai 1957,<br />
Latyr Camara militant du B.P.S mais surtout leader syndical U.G.T.A.N occupe le<br />
portefeuille de la Fonction Publique, preuve d'un intérêt manifesté par le nouveau<br />
pouvoir d'associer le monde du Travail à la gestion des affaires publiques. Du reste,<br />
la tendance est la même dans plusieurs territoires car Abdoulaye Diallo haut<br />
responsable de la centrale D.G.T.A.N est nommé ministre du travail au Soudan;<br />
en Guinée pendant que Sékou Touré très connu dans le monde syndical pour les<br />
hautes responsabilités occupées au sein de la CGT puis de la CGTA et de<br />
l'UGTAN devient chef du gouvernement autonome, Camara Bengali autre leader<br />
syndical prend en charge le ministère du Travail (78). Par là-même, le syndicat<br />
africain est organiquement lié aux partie politiques au pouvoir.<br />
Cependant cette situation ne dure pas car dès le référendum de<br />
septembre 1958, la centrale syndicale majoritaire en AOF et particulièrement au<br />
Sénégal appelle à voter en faveur du "non" et fait campagne dans ce sens avec<br />
diverses autres forces. Or, le gouvernement de Mamadou Dia s'est prononcé lui,<br />
pour le vote du "non". Latyr Camara ministre de la Fonction Publique démissionne<br />
donc, du gouvernement à l'instar des autres qui ont les mêmes positions.<br />
Un autre syndicaliste militant du BDS dès la création en 1948 le<br />
remplace, dès le 23 décembre 1958 (79); c'est Ibrahima SaIT dont le nom reste<br />
attaché à la longue et dure grève des cheminots d'Afrique Noire d'octobre 1947 à<br />
mars 1948. Cette nomination a lieu sur fond de grève massivement suivie des 2100<br />
78. Seydou Guèye. La loi-Cadre et l'éclatement de l'AOF 1956-1960.1974. p. 42.<br />
79. Malick N'Diaye: La crise politique Sénégalaise de décembre 1962.1984. p. 239.<br />
495·
postiers de Dakar et du Sénégal en cette fin d'année 1958 marquée par une réelle<br />
agitation sociale due aux revendications des centrales syndicales en particulier de<br />
l'UGTAN. Le début de l'année 1959 est dominée par une vague de grèves<br />
déclenchée par la centrale dans le service des postes, dans la Fonction publique,<br />
dans les activités des hydrocarbures, dans le secteur du commerce, etc (80). Les<br />
mesures contre les grévistes indiquent la détermination des pouvoirs publics à ne<br />
pas tolérer l'agitation sociale. Ainsi, tous les 260 travailleurs du Mobil-Oil sont<br />
licenciés à l'exeption de 3 (81) pour avoir déclenché la grève "avant l'épuisement<br />
des procédures de conciliation et d'arbitrage". Quant aux grévistes de la Fonction<br />
Publique le gouvernement décide leur licenciement immédiat et la suspension des<br />
salaires alloués aux permanents syndicaux après avoir décrété que les grèves sont<br />
illégales et procédé à des réquisitions devant la généralisation du mouvement de<br />
grèves (82). La centrale syndicale est même interdite de meeting le 8 janvier 1959<br />
lorsque les autorités municipales de Dakar lui refusent le lieu traditionnel: le Parc<br />
municipal des sports. Le Haut Commissaire général de l'AOF se met aussi de la<br />
partie car un arrêté général du 7 janvier 1959 décide d'appliquer les mêmes mesures<br />
que le Sénégal aux grévistes ,du gouvernement général et que d'importantes forces<br />
de gendarmerie et de police dispersent violemment les participants au meeting<br />
organisé par l'U.G.T.A.N le 8 janvier au terrain prêté par le C.J.S. L'assemblée du<br />
Sénégal adopte une loi permettant au gouvernement de pouvoir réquisitionner, sans<br />
exception, tous les travailleurs (83).<br />
La revue Marchés Tropicaux exprime sa satisfaction en ces termes<br />
devant toutes ces mesures prises à l'encontre des grévistes: "ces diverses mesures<br />
mettent fin à l'agitation sociale entretenus par l'UGTAN pour de motifs<br />
politiques" (84).<br />
Lamine Guèye et L.S. Senghor hommes politiques influents du parti<br />
gouvernemental UPS condamnent la grève. Le Comité Directeur de cette formation<br />
dénonce "les revendications sans nombre ni fin... il n'est pas raisonnable de<br />
consacrer 65% du revenu national à 5% de la population car 8 sur 14 milliards du<br />
budget vont à la Fonction Publique". Parlant de ces grèves l'ancien chef du<br />
gouvernement Mamadou Dia écrit : Par leur motivation profondes, par leur<br />
80. Marchés Tropicaux. 3 janvier el 10 janvier 1959.<br />
81. Marchés Tropicaux. 10 janvier 1959.<br />
82. Malick N'Diaye : la crise politique sénégalaise de 1962. 1984. p. 236.<br />
83. Paris-Dakar. 10/1/1959.<br />
84. Marchés Tropicaux. 17/1/1959.<br />
496
stratégie, par leur objectif, par leurs implications complexes, elles furent une vaste<br />
entreprise de sabotage des structures et des institutions nouvellement mises en<br />
place... l'opposition de gauche (...) estime que les grèves étaient une occasion<br />
inespérée d'abattre le régime." (85) Il désigne aussi d'autres responsables "en ces<br />
nostalgiques du système colonial... mais aussi ceux du secteur privé qui ne me<br />
pardonnaient pas leur défaite lors de la bataille de l'arachide de la 1ère année de la<br />
Loi-Cadre" (86). Il reconnaît cependant que les travailleurs nourrissent depuis<br />
longtemps leurs revendications de salaires, de revalorisation des cadres de<br />
fonctionnaires et aussi de la publication d'un statut pour les non-fonctionnaires.<br />
Mais il se félicite d'avoir utilisé la force contre le mouvement de revendication<br />
sociale (87) ce qui a été, d'après lui salutaire pour les institutions du jeune Etat.<br />
Cette agitation sociale offre au gouvernement de Mamadou Dia<br />
l'occasion de briser l'UGTAN. Une première manoeuvre indirecte est l'obligation<br />
faite à la centrale à vocation fédérale, de demander, par écrit, une autorisation du<br />
ministère de l'Intérieur du Sénégal pour pouvoir continuer à exercer ses activités<br />
dans ce pays. Le prétexte avancé est que l'organisation a fixé son siège à l'étranger<br />
(Conakry, depuis l'indépendance de ce pays). (88). Puis d'autres manoeuvres sont<br />
engagées dans le sens de la division du mouvement syndical au Sénégal. Déjà le<br />
Chef du gouvernement distingue deux catégories de syndicalistes: les syndicalistes<br />
ouverts et patriotes (...) qui participent à la tâche exaltante qu'est la construction<br />
d'une nation.... et la catégorie de syndicalistes qui continuent à vivre dans un univers<br />
peuplé de mythes de l'ancien régime." (89). Senghor dénonce les dirigeants<br />
syndicalistes du Sénégal "qui n'ont jamais eu le courage de dire comme Sékou Touré<br />
et Djibo Bakary, la vérité aux travailleurs... On ne peut réclamer en même temps<br />
l'indépendance et une augmentation des salaires." Devant le congrès constitutif du<br />
P.f.A (Parti de la Fédération Africaine) à Dakar le 1er juillet 1959, il s'en prend<br />
vivement aux fonctionnaires, qui ne cessent jamais de revendiquer, alors qu'ils sont<br />
1% de la population et reçoivent 48% du budget (90). Il exige que l'UGTAN se<br />
reconvertisse, ses orientations n'étant plus de saison. Cette ligne politique de<br />
dénigrement des organisations et méthodes syndicales est développée dès lors que<br />
85. Mamadou Dia Mémoire... 1985. p. 99.<br />
86. item. p. 101.<br />
87. item. p. 103.<br />
88. Malick N'Diaye. La crise politique sénégalaise de 1962.<br />
89. Mamadou Dia. discours au congrès de l'UPS. Dakar. 21 février 1958. Paris-Dakar du 22/2/58.<br />
90. Paris-Dakar. 2 et 3 juillet 1959.<br />
497
le pouvoir ne semble pas en mesure d'empêcher l'expression des revendications et<br />
surtout le déclenchement des grèves. Amadou Babacar Sarr ministre du Travail<br />
s'exprime en ces termes, dans un appel pour éviter les grèves de cette fin d'année<br />
1958 : "Les conflits sociaux qui viennent d'éclater et ceux qu'en perspective on<br />
prépare pour ce pays risquent de compromettre dangereusement l'harmonieuse<br />
évolution du des jeune Etat sénégalais. Le moment est venu de procéder à une<br />
véritable reconversion des méthodes jusqu'ici employées. Il n'y a aucune place pour<br />
le désordre et l'anarchie" (91).<br />
Du reste, l'UGTAN est très tôt confrontée à des dissidences, très<br />
probablement orchestrée en sous main par le pouvoir lui-même. En effet, Abbas<br />
Guèye ancien député au Palais Bourbon de 1951 à 1956, passé à la dissidence du<br />
BDS pour créer ensuite une éphémère parti avant de rejoindre Lamine Guèye en<br />
1957 et, en 1958, la formation unitaire de l'UPS (dont il devient le trésorier adjoint),<br />
est à l'origine sans le contexte des grèves du début 1957, à une première fracture de<br />
l'UGTAN, par la création de l'UGTAN-autonome. Il explique cette action par le<br />
fait que la centrale mère s'est engagée "dans des manoeuvres déloyales contraires<br />
aux intérêts des travailleurs" (92). Une autre fracture se produit le 31 mars 1959 à<br />
l'initiative de Alioune Cissé l'un des principaux responsables de la centrale au<br />
Sénégal qui crée l'UGTAN-Unitaire et s'oppose au syndicalisme revendicatif hérité<br />
de la période coloniale, exactement comme Abbas Guèye.<br />
UGTAN-Autonome et UGTAN-Unitaire face à l'UGTAN tentent<br />
d'occuper le terrain syndical mais dans un contexte de confusion totale pour la<br />
plupart des travailleurs salariés, mais aussi, pour le pouvoir lui-même. L'initiative de<br />
David §oumah, secrétaire général de la C.A.T.C d'oeuvrer à la création d'un<br />
"Comité syndical unitaire et apolitique" le 31 mars 1959 trouve des échos favorables<br />
dans les diverses centrales syndicales et dans les partis politiques. Le gouvernement<br />
parce que l'UPS souscrit à la démarche, soutient l'initiative discrètement. Ainsi, les<br />
9 et 10 mai 1959, une conférence syndicale se tient à Thiès pour assainir le climat<br />
social et réaliser l'unité syndicale engageant ainsi un processus qui aboutit à la<br />
tenue du congrès constitutif d'une nouvelle et unique centrale unitaire. Ce congrès a<br />
91. Paris-Dakar. 29 novembre 1958.<br />
92. La Vigilance. Organe de l'UGTAN autonome. n° 3.16 juillet 1959.<br />
498
lieu à Thiès du 23 au 25 octobre 1959. Il donne naissance à "Union des Travailleurs<br />
du Sénégal": U.T.S. (93).<br />
Le pouvoir espère ainsi domestiquer la mouvement syndical sénégalais<br />
pour mettre un terme aux revendications du monde du travail salarié. Cependant,<br />
les assises du 3e conseil national exécutif de la nouvelle centrale ruine tous ses<br />
espoirs. En effet, malgré la présence d'une forte délégation gouvernementale et<br />
d'une non moins importante délégation de l'UPS (parti gouvernemental conduite<br />
par le secrétaire politique Ousmane N'Gom), la Centrale réaffirme sa position .<br />
d'indépendance à l'égard de tout gouvernement et de tout parti ainsi que ses<br />
revendications pour l'amélioration des conditions salariales des travailleurs. Parlant<br />
de ce qu'il appelle "expédition" Malick N'Diaye écrit: "le gouvernement et la parti<br />
quitteront Thiès avec le sentiment d'une défaite car ils ne pouvaient pas compter<br />
vraiment sur l'U.T.S tant qu'elle resterait une force autonome." (94). L'affiliation de<br />
l'U.T.S. à la C.N.S.M (confédération nationale syndicale du Mali) n'apporte qu'une<br />
preuve de plus au pouvoir sénégalais que placer des espoirs en cette centrale<br />
syndicale est irréaliste. En effet, le 1er mai 1960, lors du 1er défilé organisé par la<br />
C.N.S.M. à Dakar avec les forces conjuguées de l'U.T.S de la CASL, du syndicat des<br />
travailleurs du Dakar Niger etc.. cette manifestation historique en ce sens qu'elle<br />
réalise l'unité de la classe ouvrière, se prononce pour l'indépendance à l'égard des<br />
gouvernements et partis et aussi contre l'apolitisme syndical. Le défilé réclame par<br />
ses pancartes, l'augmentation générale des salaires et traitements, le blocage et le<br />
contrôle des prix, condamne les essais nucléaires sur le sol d'Afrique, exige que<br />
l'impérialisme sorte du continent noire (95) et dépose une gerbe de fleurs en<br />
l'honneur des travailleurs victimes de répression sous le régime colonial.<br />
C'est dire que le mouvement syndical est certes affaibli par des divisions,<br />
ses échecs et la répression gouvernementale, mais il garde son orientation<br />
fondamentale de lutte: contre toute domestication pour mieux défendre les intérêts<br />
des travailleurs dans un état indépendant. Dans ces conditions générales, lorsqu'en<br />
juin 1960, l'Etat du Mali recouvre le souveraineté, ses orientations ne cadrent pas<br />
entièrement avec celles des masses des travailleurs regroupés dans les centres<br />
syndicales, particulièrement celle de l'U.T.S. mais aussi de l'UGTAN orthodoxe.<br />
93. U.T.S : Union des travailleurs du Sénégal est née de la fusion de CATC, de l'UGTAN-Autonome, de<br />
l'UGTAN-Unitaire et du syndicat des cheminots qui s'y associe tout en gardant son indépendance. Seme<br />
reste à l'écart l'UGTAN orthodoxe.<br />
94. Malick N'Diaye : La crise politique de 1962. 1984. p. 247.<br />
95. item.<br />
499
Pourtant, le pouvoir politique ne manque pas de proclamer sa foi dans la<br />
,<br />
recherche de solutions aux maux dont souffre le monde salarié du travail. Ainsi,<br />
Ibrahime SaIT ministre du Travail déclare devant l'Assemblée législative du Sénégal<br />
: "le véritable problème, c'est donner de l'ouvrage à tout le monde" (96). Le chef du<br />
gouvernement déclare à Louga que "c'est essentiellement vers les travailleurs que<br />
sont dirigés les efforts du gouvernement" (97). La Fédération du Mali demande, son<br />
admission à l'Organisation Internationale du Travail, appuyée en cela par la<br />
délégation gouvernementale française. (98). Le gouvernement fédéral de Dakar<br />
manifeste ainsi une volonté de baser son action, dans le domaine du travail, sur les<br />
grands principes de l'organisation de Genève. De la même manière, il a déjà<br />
accepté la proposition de l'UGTAN-Autonome qui s'est engagé à réviser les formes<br />
de lutte syndicale héritées de la période coloniale d'établir un calendrier " de<br />
rencontres périodiques syndicats-gouvernement pour un règlement paisible de<br />
toutes les questions intéressant les travailleurs, compte-tenu de toutes les réalités<br />
africaines." (99). Cette proposition a été formulée dans la résolution générale<br />
adoptée par la conférence constitutive de l'Union Régionale des syndicats UGTAN<br />
Autonome de Thiès le 30 mai 1959.<br />
La rupture de la Fédération du Mali en Août 1960, se traduit, plan<br />
syndical, par un "face à face" D.T.S/gouvernement sénégalais car la CNSM éclate<br />
sur des bases étatiques. Tout ceci ne manque pas d'influencer le pouvoir dans le<br />
sens d'une plus grande recherche du soutien des travailleurs. Mais ceux-ci observent<br />
les courbes des prix et des salaires et s'en inquiètent: "Les prix montent sans arrêt<br />
et ils montent de plus en plus vite (...) les salaires par contre sont insignifiants par<br />
ràpport à cette montée incontrôlée des prix surtout dans les quartiers<br />
ouvriers" (100) a déjà déploré l'organisation de la centrale de Abbas Guèye en juin<br />
1959. Monsarev dénonce "Dia-pain cher" (101) et s'inquiète pour les travailleurs, de<br />
la satisfaction publiquement exprimé par le patronat en la personne de Charles<br />
Gallenga, Président de la Chambre de commerce de Dakar, à l'égard des nouvelles<br />
autorités du Sénégal, lors de la réception offerte par la Chambre consulaire aux<br />
participants au colloque organisé à Dakar sur la recherche scientifique et technique.<br />
%. Paris-Dakar. 13 janvier 1960.<br />
97. Paris-Dakar. 31 mai 1960.<br />
98. Paris-Dakar. 23 juin 1960.<br />
99. La Vigilance. 16 juin 1959.<br />
100. item.<br />
101. Monsarev. n° 23.<br />
500
L'année 1960 s'ouvre dans un réel climat de tension sociale. Les<br />
revendications des travailleurs reprennent de l'ampleur et l'UGTAN restée à l'écart<br />
du processus d'unification syndicale canalise le mécontentement. Du reste, plusieurs<br />
militants et responsables de l'U.T.S se lancent dans des manifestations traduisant<br />
leurs "raz le bol". Une fois de plus, le député syndicaliste, Abbas Guèye, est monté<br />
au créneau contre l'U.T.S. Au début de Novembre 1960, il rompt ainsi avec cette<br />
organisation qu'il n'a pas pu orienter dans un sens plus favorable au pouvoir. Le<br />
secrétaire général de l'UGTAN, Abdoulaye Thiaw est arrêté le 25 novembre pour<br />
avoir appelé à la grève générale dans un tract distribué 3 jours plus tôt (102). Le<br />
gouvernement sort la grande artillerie contre les travailleurs qui préparent le grève.<br />
Le ministre du Travail et de la Fonction Publique lance sur les ondes de Radio<br />
Dakar des menaces à peine voilées: "... le gouvernement met en garde les<br />
travailleurs, contre les conséquences qui ne manqueraient pas de résulter de leur<br />
participation à une grève exclusivement politique" (103). La nécessité de continuer<br />
les "efforts" est alléguée comme devant impérativement justifier que les<br />
revendications syndicales soient abandonnées par les travailleurs au nom de l'intérêt<br />
supérieur de l'Etat en édification.<br />
En somme, les relations gouvernement sénégalais-syndicats n'ont cessé<br />
de se dégrader dans cette période de l'autonomie interne. L'indépendance acquise<br />
par le pays à la mi-1960 ne modifie en rien le caractère conflictuel de ces relations<br />
dans la mesure où le pouvoir cherche, au nom de l'unité nationale, à amener toutes<br />
les forces vives à composer, si non, à disparaître. Or les travailleurs, de par leurs<br />
organisations syndicales comprennent que la politique du nouvel Etat leur apporte<br />
avant tout des difficultés. aussi refusent-ils de faire les frais de l'édification en tant<br />
que monde du travail pendant que le monde politique chausse les bottes du<br />
colonisateur d'hier, appuyé en cela par le monde du capital étranger tout puissant<br />
dans le pays:<br />
CONCLUSION DU CHAPITRE<br />
La période 1957-1960 est largement marquée par un divorce entre d'une<br />
part, pouvoir gouvernemental mis en place par la Loi-Cadre et d'autre part,<br />
l'opposition. Par leurs pratiques les nouvelles autorités ont surtout cru que la force<br />
devait prévaloir dans les relations avec les autres forces politiques, organisations<br />
syndicales, de jeunesse, culturelles, etc... Elles ont également utilisé la division et la<br />
102. Malick N'Diaye : la crise politique. p. 246.<br />
103. Paris-Dakar. 25 novembre 1960.<br />
501
corruption pour fragiliser toute OpposItIOn déclarée. Cependant, au-delà des<br />
apparences, ces pratiques n'ont pas créé au pouvoir une réelle solidité. C'est dire<br />
que l'orientation politique et sociale du nouveau régime porte en elle-même de<br />
mauvais gerbes pour l'avenir.<br />
502
CONCLUSION GENERALE<br />
Par cette recherche, nous avons étudié l'importance des groupes de<br />
pression et "faiseurs d'opinion" et aussi les diverses réactions de ces groupes devant<br />
les multiples événements qui marquent l'histoire de Dakar dans la période 1945<br />
1960.<br />
Dakar est une ville qui, en l'espace d'un siècle est passée du stade de<br />
petit village de pêcheurs fondé sur la partie la plus occidentale de la côte africaine,<br />
à celui de grande métropole militaire, politique, administrative, culturelle, etc... Le<br />
très rapide développement de cette ville est donc à la fois lié à la conjonction de<br />
multiples facteurs parmi lesquels la position de carrefour sur les routes maritimes et<br />
aériennes est certainement l'élément déterminant. Ce rapide développement en fait<br />
seulement 30 ans après l'installation des Français, une ville à laquelle déjà la<br />
métropole accorde le statut de commune de plein exercice, permettant ainsi, à sa<br />
population de pouvoir administrer ses propres affaires par l'intermédiaire de<br />
représentants élus. Cette distinction est pourtant très parcimonieusement attribuée<br />
par la puissance coloniale car seules 4 villes de l'Afrique française ont été élevées à<br />
ce rang. Dès la fin du XIXe siècle, Dakar devient la capitale de la Fédération<br />
d'AOF. Elle coordonne l'administration des 8 territoires regroupés, après la<br />
conquête, dans cet ensemble nouvellement mis en place comme structure de<br />
gestion. Son développement explique ce choix porté sur elle car d'autres villes<br />
comme Gorée, Saint-Louis et Rufisque lui sont antérieures comme base de la<br />
présence française.<br />
Dans la période immédiate de l'après 2e guerre mondiale, une politique<br />
de grands travaux est entreprise dans la ville qui a montré à la métropole son<br />
importance stratégique pendant le conflit. Aussi ces grands travaux attirent<br />
davantage une population aussi bien européenne qu'africaine ou levantine ce qui<br />
pose de sérieux problèmes à résoudre pour l'administration: trouver des logements,<br />
du travail, des activités culturelles, etc.. à une nombre toujours plus grand<br />
d'habitants.<br />
Les multiples problèmes liés à l'étape historique de la Loi-Cadre de 1956<br />
et dont la conséquence principale est la balkanisation politique de l'ensemble<br />
fédéral de l'AOF ont aussi des implications économiques non négligeables. En effet,<br />
les infrastructures industrielles créées pour satisfaire les besoins de l'ensemble de la<br />
Fédération deviennent ainsi l'armature du seul territoire du Sénégal ce qui se<br />
traduit par de réelles difficultés à gérer ces équipements surdimentionnés.<br />
503
f<br />
Une intense activité est déployée par diverses forces: partis politiques,<br />
syndicats, organisations de jeunesse ou d'étudiants mais aussi groupes à caractère<br />
économique ou religieux ou racial ou ethnique. Ces groupes s'activent tous dans un<br />
contexte colonial et ont avec l'administration des relations soit conflictuelles, soit de<br />
coopération et/ou de coopération selon les circonstances. La puissance dominante<br />
soucieuse des rapports de forces mais surtout de ses intérêts utilise telle ou telle<br />
ligne politique dans ces rapports. Ainsi, elle peut encourager, combattre, corrompre,<br />
rester indifférente ou parfois conjuguer divers éléments à la fois, l'important pour<br />
elle étant de rester, en permanence, maîtresse du jeu. La variété et l'importance des<br />
moyens mis à contribution (puissance policière ou militaire ou hiérarchique, argent,<br />
promotion par les distinctions honorifiques, emploi, etc.) répondent certes à<br />
l'objectif que se fixe la puissance coloniale, mais aussi à l'évolution de la situation<br />
aussi bien au plan local que métropolitain et même international.<br />
La contribution ou non de groupes de pression à la réalisation de<br />
l'objectif du colonisateur est largement fonction de la nature même de ceux-ci, mais,<br />
aussi de leur niveau de prise de conscience de la nature du système de domination.<br />
C'est pourquoi les relations entre l'administration et les groupes de pression restent<br />
complexes même si on peut distinguer globalement des forces acceptant de<br />
composer et d'autres qui refusent. On remarque qu'une évolution peut intervenir<br />
dans tel sens ou dans tel autre, parce que si l'administration à ses objectifs, ses<br />
méthodes, ses pratiques et ses moyens, les groupes aussi ont les leurs et parfois il y a<br />
recoupements, parfois divergences.<br />
Les moyens dont dispose ces forces en présence pour exprimer leurs vues<br />
sont différents. Globalement les moyens modernes comme la radiodiffusion, la<br />
presse, le téléphone, télégraphe, télex, etc, sont entre les mains des groupes de<br />
Français d'origine métropolitaine. Par contre les autochtones colonisés s'appuient<br />
sur des moyens traditionnels comme la rumeur publique, les tam-tam, la chanson,<br />
l'habillement, le "fanal", etc. Cependant, les Africains ont recours à ces moyens<br />
modernes selon leurs besoins, leurs moyens matériels et financièrs, etc, mais aussi<br />
leur degré d'organisation ou leur niveau d'intégration dans la superstructure ou<br />
l'infrastructure du colonisateur. Les groupes de pression "européens" n'hésitent pas,<br />
si le besoin se fait sentir, à faire appel aux moyens traditionnels. Cependant pour<br />
\ l'essentiel, ces moyens d'information de communication et d'expression restent<br />
distincts car ceux modernes ne sont pas, en général, à la portée des autochtones<br />
t chez lesquels l'alphabétisation reste faible empêchant ainsi de lire les journaux ou<br />
d'écouter les informations radiophoniques qui utilisent avant tout le français comme<br />
langue. Le cas de la radiodiffusion est certainement à ce niveau, un l'exemple<br />
significatif. Le coût d'un poste récepteur radio tout comme ses conditions<br />
d'installation et d'entretien dépasse largement les faibles disponibilités financières<br />
504
Ces élites s'engagent dans la gestion népotiste et du laisser-aller créant<br />
même, dans une certaine mesure, les conditions du gaspillage de l'héritage reçu. Les<br />
masses urbaines surtout mais également celles de campagnes sont marginalisées<br />
dans ce contexte. Et pourtant, un certain langage nationaliste a cours puisque les<br />
nécessités de la construction d'un "Etat national" sont largement invoquées.<br />
Cependant, les efforts et sacrifices exigécl; des masses pour cette édification ne<br />
concernent pas ces héritiers qui font les loïl, les appliquent sans contre-poids aucun.<br />
En orchestrant la division dans les mouvements politique, syndical, de<br />
jeunesse, de femme, associatif, étudiant, etc... dans le but de mieux contrôler, le<br />
pouvoir crée ainsi des bases réelles de sa survie ; mais par là-même, de manière<br />
inconsciente certes, il fragilise les fondements de cet Etat au nom duquel tout est<br />
justifié.<br />
En somme, dans cette période 1945-1960, la vie quotidienne n'a pas été<br />
facile pour la grande masse de la population. Certes, à l'étape colonial, cette<br />
situation est une logique car, avant tout, comptent les intérêts du dominateur. Dans<br />
un processus de marche vers l'indépendance, normalement la tendance doit se<br />
renverser mais à condition que le colonisateur ne choisisse pas et n'installe pas son<br />
remplaçant. Or, c'est bien cette situation qui se produit: les élites politiques<br />
choisies et conseillées ont charge, sous les apparences de l'indépendance, de<br />
conduire la barque "Sunugal" (104).<br />
A travers cette étude nous avons tenté de cerner les conditions<br />
d'ensemble de la vie quotidienne de la population dakaroise. Divers facteurs<br />
influencent cette manière de vivre: parmi eux les plus importants restent la volonté<br />
du colonisateur et la capacité des autochtones à prendre en charge leur propre<br />
destin. Par cette étude de la vie quotidienne à Dakar, nous avons voulu apporter<br />
une simple contribution à une recherche dont l'objectif serait de savoir comment le<br />
phénomène historique de la colonisation influence le devenir des peuples dominés.<br />
104. Terme wolof qui signifie notre pirogue. Il fonde l'une des hypothèses de l'origine du nom du pays<br />
Sénégal.<br />
506
ANNEXES.<br />
507
Même dossier.<br />
M.F.O.M Direction af. polit. 2e bureau.<br />
1949-1953. Nombre de pèlerins AOF/Togo (avion et bateau).<br />
Années AOF/Togo Sénégal<br />
1950 359<br />
1951 449 292<br />
1952 642 180<br />
1953 849<br />
1954 1020<br />
509
MUNICIPALITE DE DAKAR<br />
Effort en matière de bourses scolaires.<br />
de 1947 à 1957<br />
Source: dos IF17. Archives. Mairie de Dakar.<br />
1. Etudiants ayant terminé leurs études<br />
Ingénieurs: 8<br />
docteurs en droit: 3<br />
docteurs en médecine: 13<br />
licenciés es lettres: 17<br />
TOTAL: 41<br />
2. Poursuivant encore les études<br />
enseignement supérieur: 24<br />
enseignement Secondaire: 31<br />
établissement locaux/Sénégal : 10<br />
TOTAL: 65<br />
510
VILLE<br />
CANDIDATS CONSEILLERS MUNICIPAUX LEBOUS DE DAKAR-<br />
Pour les Elections Municipales du 26 Avril 1953<br />
sur la liste du Parti Socialiste S.F.I.O<br />
====================<br />
La Collectivité Lébous de DAKAR, par la voie de ses Représentants<br />
Coutumiers, réunis à Dakar, le Jeudi 16 avril 1953, à 10 heures du matin, Chez EI<br />
Hadji M'BOR DIAGNE, "N'DEYEDJIREV" A Dakar Santhiaba.<br />
A décidé la désignation de ses Candidats Conseillers Municipaux pour<br />
les Elections Municipales du 26 Avril 1953 et sur la Liste du parti Socialiste S.F.I.O.<br />
Ont été choisis à cet effet les personnes dont les noms sont cités ci<br />
après suivant les milieux qui les ont désignés./-<br />
_1°/_ POUR LES PRINCIPAUX DE DAKAR: M'BENGA Amat dit<br />
Thierno, Conseiller sortant;<br />
Conseiller sortant;<br />
Notable;<br />
Conseiller sortant;<br />
_2°/_ POUR LES DIAMBOURS<br />
SENE Boubacar (El-Hadji).<br />
_3°/_ POUR LES FREYS GAYE SOUCLEYMANE, Propriétaire<br />
_4°/_ POUR LES PINTH DE KAYE-FINDIW<br />
DIOP Samba,<br />
_5°/_ POUR LE PINTH DE THIEDEME El-Hadji M'Baye<br />
M'BENGUE, Propriétaire, Notable;<br />
Conseiller sortant;<br />
-6°/- POUR LE PINTH DE SANTHIABA BARRY Amadou,<br />
-1"/- POUR LE PINTH DE M'BAKEUNDA SY Abdoulaye dit<br />
Amadou, Conseiller sortant;<br />
_8°/_ POUR LE PINTH DE GOUYE - SALANE: El-Hadji GASSAMA<br />
Cheik, Interprète Judiciaire à Dakar;<br />
-9°/- POUR LE PINTH DE M'BOTH : PAYE Djigo, Conseiller sortant.<br />
511
_10°/_ POUR LE PINTH DE KHOCK : El-Hadji GUEYE Mamadou,<br />
Commis Cadre Commun-Supérieur;<br />
_11°/_ POUR LE PINTH DE N'GARAFF : DIACNE Abdoul-Hamid,<br />
Propriétaire Notable de Dakar;<br />
_12°/_ POUR LE PINTH DE YAKHADIEUF : CISSE Omar dit El<br />
Hadji N'Galla, Conseiller sortant;<br />
_13°/- POUR LE PINTH DE DIECKO : DIAGNE Arthur, Commis<br />
Expéditionnaire;<br />
_14°/_ POUR LE PINTH DE THIEF-IGNE FAIL Abou Adolphe,<br />
Commis à Direction Générale de l'Enseignement;<br />
- 15°/_ POUR LE PINTH DE KAYE OUSMANE DIENE : DIENE<br />
Babacar, Propriétaire à Dakar./-<br />
SIGNATAIRE:<br />
A DAKAR, LE 16 AVRIL 1953.<br />
GRAND SERIGNE:<br />
512
etraite, S.F.I.O.<br />
d'honneur, S.F.I.O.<br />
--- -----<br />
ELECTION MUNICIPALES DU 26 AVRIL 1953<br />
COMMUNE DE DAKAR<br />
CANDIDATS DE LA LISTE SOCIALISTE S.F.I.O. -REPUBLICAINE<br />
1. - Lamine GUEYE, Avocat, S.F.I.O.<br />
2. - ANDREI Dominique, Assureur, Radical-Socialiste.<br />
3. - BA Amadou, Commis principal hors classe des Trésoreries en<br />
4. - BA Magatte (El Hadj), Commerçant, Chevalier de la Légion<br />
5. - BARRY Mamadou (El Hadj), Chef de service à la Régie des<br />
Chemins de Fer de l'A.O.F., S.F.I.O.<br />
S.F.I.O.<br />
6.. BONIFAY Paul, Avocat, Chevalier de la Légion d'honneur, S.F.I.O.<br />
7. - CAHUZAC Paul, Employé de commerce, S.F.I.O.<br />
8. - CISSE Oumar dit N'GALLA (El Hadj), Chef-Comptable à la E.C.A.,<br />
9. - DIAGNE Abdoul Hamid, Propriétaire, S.F.I.O.<br />
10. - DIALLO Demba, Chef de bureau des Services Financiers, Chevalier<br />
de la légion d'honneur, S.F.I.O.<br />
des Douanes, S.F.I.O.<br />
11. - DIAW Guibril, Commis principal hors classe du Cadre supérieur<br />
12.• DIOP Amadou, Commis principal à la E.A.O., S.F.I.O.<br />
13. - DIOP Bara (El Hadj), Chef du bureau d'études à la Direction<br />
générale des Travaux Publics, S.F.I.O.<br />
14. - DIOP Momar Marième, Commerçant, S.F.I.O.<br />
15. - DIOP Samba, Commis principal hors classe du Cadre Supérieur des<br />
Services administratifs, S.F.I.O.<br />
16. - FALL Abou Adolphe, Commis à la Direction générale de<br />
l'Enseignement, S.F.I.O.<br />
S.F.I.O.<br />
17. - GASSAMA Cheikh (El Hadj), Interprètre judiciaire, S.F.I.O.<br />
18. - GUEYE Abdoulaye Bamar, Propriétaire de l'AO.F., S.F.I.O.<br />
19. - KONATE Mamadi, Instituteur du Cadre supérieur de l'A.O.F.,<br />
20. - LY Ousmane, Employé principal du Cadre commun supérieur à la<br />
Direction du Service de Santé de l'A.O.F., S.F.I.O.<br />
21. - MAILLAT Adolphe, Officier d'artillerie en retraite, Chevalier de la<br />
Légion d'honneur, S.F.I.O.<br />
513
S.F.I.O.<br />
Douanes, S.F.I.O.<br />
22.• M'BACKE Amadou, Instituteur du Cadre Supérieur de l'A.O.F.,<br />
23. - M'BENGUE Moctar dit M'BAYE (El Hadj), Propriétaire, P.T.T.<br />
24.• M'BENGUE Paute, Commerçant, S.F.I.O.<br />
25. - M'BENGUE Thierno Amath, Comptable, S.F.I.O.<br />
26. - N'DIAYE Guibril dit DJIM, Commerçant, S.F.I.O.<br />
27. - N'DIAYE Mamadou (El Hadj), Commerçant, S.F.I.O.<br />
28. - NIANG Amadou (El Hadj), Commerçant, S.F.I.O.<br />
29. - PAYE Djibril dit DJIGO, Electricien, S.F.I.O.<br />
30. - SA.M Malick, Commis principal hors classe du Cadre Supérieur des<br />
31. • SENE Boubakar (El Hadj), Clerc de notaire, Chevalier de la<br />
Légion d'honneur, S.F.I.O.<br />
32. - SINIBALDI Jean, Retraité F.O.M., Officier de réserve, Croix de<br />
guerre, Officier d'académie, Radical-Socialiste.<br />
33.• SY Abdoulaye dit MiADOU, Employé de commerce, S.F.I.O.<br />
34. - THIAW Ibra Abdoulaye (El Hadj), Agriculteur, chevalier de la<br />
Légion d'honneur, S.F.I.O.<br />
d'honneur, S.F.I.O.<br />
35. - THIAM Marne Bocar, Propriétaire, Chevalier de la Légion<br />
36.. THURET André, Directeur de Société, membre du bureau de la<br />
Chambre de Commerce de Dakar, Chevalier de la Légion d'honneur Croix de<br />
Guerre.<br />
37.. TRAORE Mamadou, Médecin africain principal.<br />
514
Le ministre de la France d'Outre-Mer<br />
à<br />
Monsieur le Haut-Commissaire de la République<br />
Gouverneur Général de l'Afrique Occidentale Française<br />
DAKAR<br />
Objet:<br />
Elections Municipales.-<br />
J'ai attendu que la promulgation de la Loi du 18 Novembre 1955 ait<br />
mis un terme, que je désirerais définitif, aux préoccupations nées de l'annulation par<br />
la le Conseil d'Etat des Elections Municipales de Dakar, pour vous faire connaître<br />
mon sentiment sur une affaire qui a trop longtemps retenu l'attention du<br />
Département.<br />
Je vous avais déjà exprimé dans mon télégramme du 5 novembre 1955<br />
à quel point j'estimais regrettable que des problèmes mineurs, tels que ceux posés<br />
par la confection des listes électorales d'une commune si importante soit-elle,<br />
n'aient pu recevoir une solution satisfaisante sur le plan local, et que leur règlement<br />
ait nécessité l'intervention du pouvoir central.<br />
Même dans un système fortement centralisé, il serait difficilement<br />
admissible que des questions de cette nature soient déférés pour décision au<br />
Gouvernement.<br />
Comme vous le savez, notre organisation politique et administrative<br />
est fondée sur un partage des responsabilités entre diverses autorités; son bon<br />
fonctionnement implique que chacune de ces autorités exerce pleinement la totalité<br />
des attributions qui sont siennes. Lorsque le pouvoir central se voit obligé de<br />
prendre des responsabilités qui incombent normalement aux autorités<br />
subordonnées, il en résulte le plus souvent des situations préjudiciables à la bonne<br />
marche de l'Administration comme à la saine gestion des affaires publiques. Ainsi<br />
que le relevait déjà mon télégramme précité du 5 Novembre, de telles pratiques<br />
font perdre aux autorités décentralisées leur raison d'être, leur prestige et leur<br />
efficience. Les administrés, et surtout leurs élus, prennent l'habitude fâcheuse de<br />
porter leurs affaires directement à l'échelon du pouvoir central alors que la solution<br />
se trouve dans la quasi totalité des cas à leur portée immédiate, c'est-à-dire à<br />
l'échelon des autorités locales. Ainsi la notion même d'autonomie administrative se<br />
trouve-t-elle peu à peu vidée de son contenu.<br />
515
Dans l'affaire des Elections Municipales de Dakar, je ne sauraIs<br />
admettre que les autorités de tutelle puissent repousser la responsabilité qui leur<br />
incombe en tirant argument de l'annulation par le Conseil d'Etat des opérations<br />
électorales du 26 Avril 1953, annulation survenue quelques mois seulement avant la<br />
mise en application de la nouvelle Loi municipale et quelques semaines avant le<br />
début de la révision normale des listes électorales.<br />
Le premier devoir de ces autorités de tutelle consistait à veiller en<br />
permanence à la bonne tenue des listes électorales: or, c'est le désordre, reconnu<br />
par tous, de ces listes qui est à l'origine même de l'affaire, et qui a contraint<br />
l'Administration, à tous ses échelons, à des efforts presque acrobatiques pour éviter<br />
les fâcheuses conséquences de cette carence initiale.<br />
La révision des listes électorales est un acte administratif sur<br />
l'importance duquel plusieurs circulaires ministérielles ont appelé régulièrement<br />
votre attention, vous invitant à donner les instructions nécessaires en la matière. De<br />
plus, c'est un acte administratif annuel: le contrôle de sa bonne exécution ne saurait<br />
donc être entrepris seulement à la veille d'élections générales ou partielles.<br />
Je n'ignore pas que le Président de l'Assemblée de territoriale du<br />
Sénégal n'a pas fait diligence pour adresser au Gouverneur du Sénégal le procès<br />
verbal de la séance au cours de laquelle fut adoptée la délibération du 14 Décembre<br />
1954 portant sectionnement électoral de Dakar.<br />
Mais, il apparaît que, du 29 Janvier 1955, date de la notification de la<br />
délibération précitée, au 31 Mars 1955, date de la clôture des listes électorales,<br />
aucune injonction n'a été adressée au Maire de Dakar afin que les commissions<br />
administratives dressent les listes électorales par section avant leur clôture.<br />
Au surplus, si l'annulation des opérations des commissions<br />
administratives de la commune de Dakar avait été demandée, en son temps, au<br />
Tribunal civil de Saint-Louis par le Gouverneur du Sénégal dans les deux jours qui<br />
suivaient la réception du tableau rectificatif, le Tribunal n'aurait pas manqué<br />
d'annuler les opérations effectuées, si j'en juge par les indications que vous m'avez<br />
données. Le Tribunal aurait pu dès lors fixer le délai dans lequel les opérations<br />
annulées auraient dû être reprises.<br />
En résumé, l'ensemble des difficultés dont vous avez fait état auraient<br />
été sans doute évitées, si les autorités locales, sous votre contrôle hiérarchique et<br />
516
PROCES-VERBAL<br />
de la réunion de la COLLECTIVITE LEBOUE, tenue<br />
le Dimanche 3 Janvier 1954 chez M. El-Hadji<br />
M'Bor DIAGNE, Maire Indigène de le Collectivité<br />
================<br />
Etaient présents: M.M.<br />
- El-Hadji fbrahima DIOP, Grand Sérigne,<br />
- El-Hadji Alié Codou N'DOYE, Diaraffe,<br />
- El-Hadji Amadou Lamine DIENE, Grand Imam,<br />
- El-Hadji Amadou Assane N'DOYE,<br />
- El-Hadji Cheickou DIOP<br />
- El-Hadji Amadou Ousmane M'BENGUE,<br />
- El-Hadji Ibrahima SOW,<br />
Les 12 Chefs de Quartiers de Dakar ainsi que les Chefs de la Banlieue;<br />
Ouakam - N'Gor - Yoff - Cambèrène, Yeumbeul - Thiaroye - M'Bao<br />
Les conseillers Municipaux: PAYE Djigo - DIOP Samba, - El-Hadji<br />
Amadou N'DIAYE - ABdoulaye GUEYE Bamar - El-Hadji Amadou NIANG <br />
DIOP Mamadou Doudou - DIOP Mornar Marième et F ALL Abou Adolphe qui est<br />
chargé de rédiger le Procès-Verbal.<br />
M. El-Hadji M'bor DIAGNE, ouvre la séance en demandant à toute<br />
l'Assemblée, de procéder à la récitation de la prière traditionnelle avant d'aborder<br />
les débats. Puis, il passe la parole à M. BAYE Djigo, Adjoint au Maire.<br />
M. PAYE Djigo, prenant la parole exprime tous ses remerciements à<br />
l'ensemble des notables venus nombreux répondre aux convocations qui leur ont été<br />
adressées. Par votre présence, il est désormais démontré que la Collectivité Léboue<br />
est résolument décidée à surmonter toutes les difficultés pour parvenir au but<br />
suprême de la réconciliation et ceci dans un esprit de franchise et d'honnêteté.<br />
L'objet de la convocation, poursuit-il est le suivant: M. Le Maire de<br />
Dakar et la Mairie de DAKAR ont été invités par l'Autorité de Tutelle, M. le<br />
Gouverneur GOUJON, exécutant un projet de délibération du Conseil Territorial<br />
du Sénégal à l'effet de sectionner la Ville de DAKAR en 4 circonscriptions<br />
territoriales pour les prochaines élections. Selon le projet, DAKAR par ce<br />
découpage aurait sa représentation complètement modifiée et ceci au plus grand<br />
désavantage de la Collectivité Léboue. Ce découpage comprendrait désormais la<br />
physionomie suivante: de l'Avenue Gambetta, l'Avenue Maginot jusqu'au Cap<br />
Manuel et vers le port, appelé le 1er Secteur, serait attribué 18 Conseillers, de<br />
l'Avenue Gambetta, l'Avenue Jauréguibéry, l'Avenue Clémenceau, l'Avenue Blaise<br />
5-18
DIAGNE jusqu'à la route des Puits vers la mer, devenant le 2 0<br />
secteur avec la<br />
possibilité d'élire 6 conseillers, le même côté droit jusqu'à la route des Puits<br />
deviendrait le 3 0<br />
Secteur pour élire également 6 conseillers; de la route des Puits<br />
vers N'Gor et jusqu'à M'Bao en somme toute la Banlieue deviendrait le 4 0<br />
avec la possibilité d'élire 7 conseillers.<br />
Secteur<br />
Tout ceci ne vise en dernier ressort que la Collectivité Léboue qui a la<br />
possibilité, de par ses traditions de choisir au sein des quartiers les différents<br />
Conseillers groupant pour l'ensemble de Dakar et sa Banlieue 18 Conseillers.<br />
L'Administration du Sénégal assez gênée dans sa politique de déposséder la<br />
Collectivité de ses terres, après de l'échec de Begnoul, trouve mieux de contourner<br />
la difficulté en éliminant la Collectivité Léboue de toute représentation forte au<br />
sein des Assemblées particulièrement dans la Municipalité de Dakar.<br />
De par cette situation s'en est fait de toute représentation Léboue. Ce<br />
qui conduira dans un bref avenir à l'éviction de la Collectivité dans l'une des plus<br />
importantes Assemblées: le Conseil Municipal.<br />
Les conseillers Léboues en parfaite communauté d'idée avec M. le<br />
Maire BONNIFAY et l'ensemble de leurs collègues, ressortissants et Européens ont<br />
marqué leur entière solidarité avec la Collectivité Léboue et ont rejeté<br />
unanimement la proposition soumise par le Gouverneur du Sénégal. Ne voulant pas<br />
seulement s'en tenir à cette situation, ses Collègues et lui-même avaient jugé utile<br />
d'en rendre compte aux différentes Notabilités de la Collectivité Léboue sans<br />
distinction d'étiquette politique, afin que celles-ci puissent à leur tour prendre leur<br />
responsabilité par une action vigoureuse de protestation.<br />
M. El-Hadji Amadou Assane N'DOYE, demande la parole et déclare<br />
que dès qu'ils ont été avertis de cette proposition, ses camarades et lui ont été<br />
rendre visite d'abord à MO BOISSIER-PALUN pour s'informer; celui-ci ne leur<br />
ayant donné aucun renseignement précis, ils sont ensuite allés voir M. Robert<br />
DELMAS qui leur explique avoir une vague souvenance de cette affaire, mais qu'il<br />
lui était impossible de donner des précisions très détaillées.<br />
A son avis, la ville de Dakar par son étendue et sa population n'a pas<br />
encore atteint le stade des grandes villes Métropolitaines telles que PARIS, LYON<br />
et MARSEILLE pour être divisé en Arrondissements et Secteurs. Ceci, poursuit-il<br />
ne vise qu'à détruire la Collectivité Léboue que l'Administration tant du<br />
Gouvernement Général que du Gouvernement du Sénégal trouve trop gênante. Car<br />
seule la Collectivité Léboue de par sa situation de détentrice d'une importante<br />
partie du domaine de la Presqu'Ile du Cap-Vert avait la possibilité jusqu'à présent<br />
de choisir ses Conseillers parmi ses enfants issus des divers quartiers de Dakar et de<br />
la Banlieue. Devant une pareille situation pleine d'incertitude pour l'avenir, il se<br />
519
solidarise avec ses collègues Conseillers Municipaux et qu'il les approuve<br />
entièrement dans leur refus de sectionner la Ville comme l'avait proposé le<br />
Gouverneur du Sénégal. A son avis, poursuit-il, il conviendrait à ce que les<br />
Conseillers Municipaux puissent leur donner communication du dossier relatif à<br />
cette affaire afin de pouvoir exprimer une opinion sans équivoque et en toute<br />
connaissance de cause. Admettre cette situation conclut-il conduirait à jeter par<br />
dessus bord tout le sacrifice consenti si douloureusement à travers notre brillante<br />
histoire locale tout ce qui a fait la grandeur de la Collectivité et qui nous a valu tant<br />
d'admiration de la part de Européens comme de nos frères Africains des autres<br />
territoires.<br />
M. PAYE Djibo, demande la parole pour rendre hommage à son aîné<br />
Amadou N'DOYE, qui de par sa clairvoyance et son esprit de bon sens a su déceler<br />
sans difficulté l'objectif visé par l'Administration qui a voulu profiter d'une situation<br />
politique confuse pour saper les bases mêmes de la société africaine. Tant que<br />
Goujon et sa bande seront à la tête de ce pays, nous devons nous attendre à des<br />
difficultés sans cesse croissantes et qui conduiront fatalement à cet incendie<br />
destructeur qui consume l'une des plus belles fleurs de l'Union Française.<br />
M. El-Hadji Ibrahima SOW, demande ensuite la parole pour poser<br />
quelques questions: la de par qui émane la proposition de sectionnement de Dakar<br />
? de l'Assemblée Territoriale lui répond PAYE Djigo.<br />
M. EI-Hadjou Amadou Ousmane M'BENGUE s'étonne qu'aucun<br />
Conseiller ne puisse apporter par devers lui le projet de sectionnement, alors que<br />
pendant qu'il était Conseiller Municipal chaque projet de délibération comportait<br />
un dossier qui était distribué à l'ensemble du Conseil Municipal et<br />
individuellement; il serait impossible poursuit-il d'exprimer une opinion sérieuse, ce<br />
qui a pour résultat de compromettre la solution de cette si importante affaire.<br />
M. El-Hadji Cheickou DIOP, approuvant pleinement M. M'BENGUE<br />
demande de suspendre cette réunion à laquelle tout caractère sérieux est désormais<br />
enlevé.<br />
M. PAYE Djigo, proteste et recommande à ses collègues de<br />
s'entourer d'un maximum de courtoisie afin de ne pas par des propos inconsidérés<br />
provoquer la susceptibilité de leurs camarades du Conseil Municipal, qui ont avec<br />
une franche et parfaite honnêteté expliqué à toute la Collectivité Uboue sans<br />
considération d'étiquette politique le véritable danger qui menace cette même<br />
Collectivité à laquelle ils font partie intégrante. Pour ce qui concerne la<br />
communication du dossier, il venait de téléphoner chez M. le Maire pour le lui<br />
520
éclamer, mais que malheureusement celui-ci était absent, par conséquent, ils<br />
s'engage, dès Lundi matin à le réclamer à M. le Maire pour ensuite le remettre à M.<br />
El-Hadji Amadou Assane N'DOYE pour que celui-ci en donne lecture et<br />
explication à la prochaine réunion.<br />
M. DIOP Samba, répondant à M. M'BENGUE Amadou Ousmane,<br />
explique que du fait que le dossier n'était qu'à l'échelon projet de délibération ce<br />
qui suppose s'il n'était pas définitivement adopté, M. le Maire ne pouvait pas ou n'a<br />
pas dû juger utile de soumettre cette affaire au Conseil Municipal en communiquant<br />
individuellement à chaque Conseiller le dossier. Néanmoins, ses Collègues<br />
Conseillers Municipaux Lébous peuvent facilement obtenir communication de tout<br />
ou partie de ce dossier pour ensuite le communiquer à la Collectivité.<br />
M. El Hadji Ibrahima DIOP - Grand Sérigue - intervenant à son tour<br />
recommande à l'Assemblée à ce que chaque Lébou puisse mesurer la portée de ses<br />
propos afin de ne pas détruire le caractère important de cette affaire, il demande<br />
surtout de ne pas entourer cette affaire d'un caractère passionnel. Car, poursuit-il<br />
l'histoire nous jugera demain soit pour nous féliciter soit pour nous condamner. A<br />
son avis il y avait pas lieu de continuer à demander la parole pour exprimer les<br />
mêmes propos, ce qui nous conduira fatalement à rendre inutile cette réunion.<br />
L'essentiel de cette affaire a été dit par M.M. N'DOYE et PAYE.<br />
M. El-Hadji Ousmane DIOP - N'Dèye y N'Diambour - arrivant demande<br />
la parole pour s'excuser de son retard et rendre compte à l'Assemblée dans quelle<br />
situation humiliante M. DIOP Bara, Conseiller Municipal veut le conduire, du fait<br />
qu'un de ses locataires, repris de justice et employé municipal ayant été sévèrement<br />
frappé par des Gendarmes auxquels il avait volé du linge, s'apprête à le traduire<br />
devant le Tribunal pour coups et blessures. Il ne pourra y avoir de réconciliation<br />
parfaite qu'autant que le Lébou sera respecté en tant que tel sans considération<br />
d'étiquette politique. Sinon, il préférerait continuer la lutte contre certains<br />
Conseillers Municipaux.<br />
M. El-Hadji Amadou Assane N'DOYE. déclare que du fait que M.<br />
Ousmane DIOP a porté cette affaire devant la plus haute instance de la Collectivité,<br />
cette affaire devrait à son avis être confiée à ses Collègues Conseillers Municipaux<br />
pour qu'ils mettent fin aux agissements de leur collègue DIOP Bara.<br />
M. PAYE Djiggo, au nom de ses collègues et en son nom personnel<br />
prend l'engagement d'instruire cette affaire pour lui trouver une solution.<br />
521
M. El-Hadji M'Bor DIAGNE, intervenant à son tour demande à<br />
l'Assemblée de témoigner ses félicitations aux Conseillers Municipaux qui ont su<br />
avec un courage sans égal rejeter la proposition du Gouverneur du Sénégal et en<br />
même temps rendre hommage aux: différents orateurs qui ont tour à tour pris la<br />
parole, notamment M. El-Hadji Amadou Assane N'DOYE qui a su avec<br />
clairvoyance expliquer l'essentiel de cette situation. Dans ces conditions, pour que<br />
notre action puisse porter ses fruits, il convient de communiquer à l'Assemblée le<br />
dossier de cette affaire.<br />
M. El-Hadji Amadou N'DIAYE, intervient pour indiquer que M. le<br />
Gouverneur ayant indiqué comme délai limite le 31 Décembre 1953, il y avait lieu à<br />
son avis de prendre position dans les plus brefs délais, que tout ce qu'il faut faire, il<br />
yale facteur temps. Aussi une réunion très prochaine et dont il convient d'en fixer<br />
la date immédiatement était indispensable.<br />
Certains notables ayant proposé la date de Dimanche 10 janvier <br />
notamment M.M. El-Hadji Cheikhou DIOP et Ousmane DIOP; M. Diogal SAMBE<br />
Chef du Village de N'Gor, intervenant propose de trouver un jour intermédiaire<br />
entre Mardi et Dimanche.<br />
M. El-Hadji Amadou Assane N'DOYE, demande la parole et déclare<br />
que la journée de Jeudi pouvait largement convenir à tout le monde d'autant plus<br />
qu'indépendamment de la communication du dossier par PAYE Djigo, ses<br />
camarades et lui-même se doivent de s'informer auprès des différents Bureaux<br />
administratifs (soit à la Délégation, soit au Gouvernement Général) afin de<br />
posséder une certaine documentation qu'ils se proposent de soumettre à<br />
l'Assemblée.<br />
L'Assemblée étant d'accord sur la journée de Jeudi pour la prochaine<br />
réunion, on propose de lever la séance qui a effectivement eu lieu à 13 heures.<br />
Après que M.le Maire Indigène El-Hadji M'Bor DIAGNE ait proposé de retenir<br />
un grand nombre parmi l'Assemblée à dîner chez lui.<br />
FAIT à DAKAR, le 3 Janvier 1953<br />
Le Conseiller Municipal, Secrétaire de séance<br />
FALL Abou Adolphe<br />
522
Caricature VII. Caricature sur l'exploitation coloniale7.<br />
Le pêcheur de capitaux: une caricature de .La LUt1e-, stigmatisantrexploitation cok:>niale<br />
7. Extrait de la "Lutte" repris par "Gëstu" N°24, Août 1987.<br />
537
BIBLIOGRAPHIE<br />
538
I. Ouvrages généraux<br />
539<br />
Alliot (Marie Michelle) La décision politique = attention, une<br />
république peut en cacher une autre. Paris. P.U.F. - 1983.<br />
264.p.<br />
Arnault (Jacques) Procès du colonialisme<br />
Paris - Editions Sociales - 1958 - 324 pages + bibliog.<br />
Benot (Yves) Idéologies des indépendances africaines<br />
Paris. Maspero. 1969 - 427 pages.<br />
Biarnès (Pierre) Les Francais en Afrique Noire (de Richelieu à<br />
Mitterrand. 350 ans de présence francaise au Sud de Sahara.<br />
Paris. Armand Colin. Mai 1987. 448p.<br />
Borrela (François) L'évolution politique et juridique de<br />
l'Union francaise depuis 1944. Paris. Librairie générale de<br />
droit et de jurisprudence. 1958. 499 pages.<br />
Brunschwig (Henri) L'avènement de l'Afrique noire)<br />
Armand Colin. 1963. 248 pages.<br />
Paris.<br />
Bourgi (Robert) Le général de Gaulle et l'Afrique noire de 1940<br />
à 1969. Paris Librairie générale de droit et de<br />
jurisprudence. Dakar. N.E.A. 1980. 515 pages<br />
Canale (J.Suret) Afrique noire. de la colonisation aux<br />
indépendances. Paris. Editions Sociales. Sept. 1972. 420 pages.<br />
Canale (J.Suret) Essai d'histoire africaine - de la traite des<br />
Noirs au néocolonialisme. Paris. Editions<br />
Sociales. 1980 . 270 pages<br />
Cauche (Gérard) Les pionniers de l'indépendance. Paris<br />
Imprima 1975. 171 pages.<br />
Chaffard (Georges) les carnets secrets de la décolonisation<br />
Paris. Calman Levi. 1965. 346 pages. lere édition.<br />
Chailley (Marcel) Histoire de l'Afriaue Occidentale<br />
française Paris. Berger Levrault. 1968. 580 pages<br />
Copans (J) Les marabouts de l'arachide Paris. Editions le<br />
Sycomore. 1980. 263 pages.<br />
Coulon (Christian) Le marabout et le prince. Islam et<br />
pouvoir au Sénégal. Paris. Editions Pédone. 1981. 317 pages.<br />
Davidson (Basil) Les voies africaines. Paris Maspero.<br />
1965. 281 pages traduit de l'anglais. par A.<br />
Chassigneux.<br />
Debat (Jean) Evolutions en Afrique noire Paris. Editions de<br />
l'Epargne. Fév. 1962 112 pages.<br />
Deschamps (Hubert) La fin des empires coloniaux.<br />
Que sais-je? n° 404. PUF 1969 127 pages. Nouvelle
Edition.<br />
Dia (Mamadou) Mémoires d'un militant du Tiers-Monde.<br />
Paris. Publisud. 1985. 245 pages.<br />
Dia (Mamadou) Réflexions sur l'économie de l'Afrique noire<br />
Paris. Présence africaine. 1961. 210 p.<br />
Diop (Ousmane Soce) L'Afrique à l'heure de l'indépendance<br />
New-York 1960 Paris. Nouvelles Editions latines. 1963.<br />
Diop (Mahjmout) Contribution à l'étude des problèmes<br />
politiques en Afrique noire. Paris. Présence africaine. 1959.<br />
267 pages.<br />
Diop (Mahjmout) Histoire àe classes sociales en Afriaue de<br />
l'ouest. (2) Le Sénégal. Paris<br />
Maspero. 1972. 172 pages.<br />
Dumont (René) L'Afrique est mal partie. Paris. 1962.<br />
Froelich (J.C) Les musulmans d'Afrique noire. Paris.<br />
Editions de l'Oronte. 1962. 406 pages.<br />
Gaulle (général Charles de) Mémoires de guerre<br />
T. III. Le salut. 1944. 1946. Paris. 1959. 564p.<br />
Gérard (Claude) les pionniers de l'indépendance. Paris<br />
Editions Imprima - 1975. 171 pages.<br />
Guéye (Lamine) Itinéraire africain. Paris. Présence<br />
africaine. 244 pages. année 1966.<br />
Guillaume (Pierre) Le monde colonial XIX - XX siècle<br />
Paris. Armand Colin 1974. 196p.<br />
Hesseling (Gerti) l'histoire politique au Sénégal.<br />
Institution - Droit - et Société Paris Leiden (Pays<br />
Bas) 1985. 442 pages. Traduction. thèse de doctorat<br />
de droit. Soutenue en mai 1982.<br />
Huret (Arno) La radiodiffusion. Puissance mondiale.<br />
Paris. Gallimard. 1937.<br />
Jobert (Michel) Mémoires d'avenir. Paris. Grasset.<br />
1974. 310 pages.<br />
Kaffener (Jean Noël) Rumeurs. Le plus vieux média du<br />
monde Paris. Seuil. 1987. 318 pages<br />
Ki - Zerbo (Joseph) Histoire de l'Afrique noire.<br />
Paris, Hatier. 1987. 702p.<br />
Lakroum (Monique) Le travail inégal. Paysans et salariés<br />
sénégalais face à la crise économiaue des années trente.<br />
Paris. L'Harmattan. 1983. 189 p.<br />
Lavroff (Dimitri Georges) Les partis politiques en Afrique<br />
noire. Que sais-je? n01380 - Paris. PUF 1970. 125p.<br />
Lô (Magatte) L'heure du choix. Paris. L'Harmattan. 1985<br />
107 pages.<br />
Ly (Abdoulaye) Les masses africaines et l'actuelle condition<br />
540
III Thèses<br />
Benoist (Roger de) L'Afrique occidentale francaise = de la<br />
conférence de Brazzaville (1944) à l'indépendance (1960)<br />
Thèse de doctorat. IIlé cycle Paris. EHESS 1978<br />
Blanchet (Gilles) Elites et changements dans une perspective<br />
africaine. Le cas du Sénégal. doctorat lIIé cycle.<br />
Paris X. juin 1977. 389 pages.<br />
Bonnardel (Régine N'Guyen Von Chi) La vie de relations au<br />
Sénégal. La circulation des biens. doctorat d'Etat. . Paris<br />
VII. 1976. 920 pages. in mémoires de l'IFAN. n090<br />
Dakar. 1976.<br />
Bouzerand (Jacques) La presse écrite à Dakar. Sa diffusion<br />
son public. doctorat IIIé cycle. Université de<br />
Dakar. 1967. 190 pages. Enquête pour le Centre de Recherche<br />
psycho-sociologique.<br />
Camara (Sylvain Soriba) Guinée : Fondements de la politique<br />
extérieure. 1958 - 1963. Conflit franco-guinéen. doctorat.<br />
Paris. 1975. Fondation nationale des sciences politiques.<br />
Canale (J.S.) Géographie de capitaux en Afrique tropicale d'<br />
influence francaise. Doctorat d'Etat. Paris<br />
VII, 1984. 975 pages + annexes et notices.<br />
Codo (Bellarmin Coffi) La presse dahomèenne face aux<br />
aspirations des "évolués". La voix du Dahomey. 1927. 1957.<br />
Doctorat du IIIé cycle. Paris VII. 1978. 460 pages.<br />
Colin (Roland) Systèmes d'éducation et mutations sociales :,<br />
continuité et discontinuité dans la dvnamiaue socio-éducative.<br />
Le cas du Sénégal. Doctorat de sociologie. Paris V. Déc. 1979.<br />
1011 pages.<br />
Diagouraga (Modibo) Le combat politique de Modibo Keita<br />
Doctorat IIIè cycle. Paris V. 1986. 659 pages.<br />
Diallo Falilou • Histoire du Sénégal de la conférence de<br />
Brazzaville à la fondation du Bloc Démocratique Sénégalais.<br />
1944-1948. Doctorat III e cycle. Paris Panthéon - 1983 - 318<br />
pages.<br />
Diop (Momar Coumba) La confrérie mouride. organisation<br />
politique et mode d'expression urbaine. Doctorat Ille cycle.<br />
Université de Lyon. 1980. 273 pages.<br />
Djibo (Hadiza) La participation des femmes africaines à<br />
la vie politique. Le cas du Sénégal et du Niger.<br />
Doctorat III cycle. Paris V. 1981. 700 pages.<br />
543
Duval (Yves Biju) Les élites catholiques d'outre-mer.<br />
Afrique noire francaise - Madagascar Viet-Nam.<br />
Doctorat IIIé cycle. Paris. 1957/58. 252 pages.<br />
Fall (Babacar) Analyse du mouvement social. Les syndicats en<br />
Afrique de l'ouest et au Sénégal. Diplôme EHESS.<br />
Paris. Mai 1984 - 188p.<br />
Fall (Papa dit Amadou) Industrialisation et mutations sociales<br />
en Afrique occidentale francaise. Le cas du Sénégal. 1920 <br />
1946. Doctorat III é cycle. Paris VII. Oct 1981-635 p.<br />
Guillerme (Philippe) La Républigpe populaire et révolutionnaire<br />
de Guinée. 1958-1978. Doctorat Ille cycle Paris VII. date non<br />
précisée.<br />
Kaadam (Sabah) Nationalisme et prise de conscience nationale en<br />
AOF : cas de la Guinée, Côte d'Ivoire, Dahomey. Doctorat d'Etat<br />
Paris 1. juin 1985 - 727 p.<br />
Koffi (Amoussou) L'immigration noire en France depuis 1945 : le<br />
cas du Sénégal - doctorat d'Etat Paris VIII - 1976 - 225 p.<br />
Lakroum (Monique) Chemins de fer et réseaux d'affaires en<br />
Afrique Occidentale : le Dakar-Niger - doctorat d'Etat - Paris<br />
VII - juillet 1987 - 920 p.<br />
Lokosso (Clément Koudessa) La presse au Dahoméy 1894-1960.<br />
Evolutions et reactions face à l'administration<br />
coloniale. Doctorat Ille cycle. Paris EHESS. Janvier 1976.<br />
336p.<br />
Mercier (Paul) contribution à la sociologie des villes du<br />
Sénégal occidental à la fin de la période coloniale.<br />
Thèse complémentaire de doctorat d'Etat. Paris.196B. 27B p.<br />
Moleur (Bernard) Le droit de propriété sur le sol sénégalais<br />
Analyse historique du XVII siècle à l'indépendance.<br />
Doctorat d'état. Université de Dijon. 1978. 369p. 2 volumes.<br />
Ndaot (Séraphin) Les relations politiques entre le France et<br />
l'Afrique noire de 1944 à 1956. Doctorat de spécialité. Paris<br />
VII. Date non précisée 220 pages.<br />
N'Diaye (Malik) La crise politique sénégalaise. de décembre<br />
1962. Doctorat de III é cycle. Paris III<br />
1983/84. 411.<br />
Pruneddu (Jacky) Le ralliement des forces politiques.<br />
économiques et spirituelles francaises à la<br />
décolonisation du continent noir. Doctorat III é cycle.<br />
Paris EHESS 1982. 766 p.<br />
Rabearimanama(Lucile) La presse d'opinion à Madagascar<br />
de 1947 à 1956. Contribution à l'histoire de nationalisme.<br />
Malgache du lendemain de l'insurrection à la veille de la<br />
loi cadre. Doctorat IIIé cycle. Paris EHESS. 1978. 445 P. +<br />
544
générale de droit et jurisprudence. 1970 - 401p.<br />
IV MMémoires<br />
Agier (Michel) Urbanisation et pratiques sociales en ville<br />
africaine. Le cas du groupe marchand. D.E.A. EHESS. Paris.<br />
1968. 45 pages.<br />
Allagbo (Eden E.K.) La presse africaine en France<br />
D.E.A. Paris VII 1984. 102 pages.<br />
Batsch (Christophe) Un rouage du colonialisme. La formation de<br />
l'élite africaine en AOF avant 1914. L'Ecole normale des<br />
instituteurs de l'AOF . (William Ponty) Maîtrise. Paris VII.<br />
1972/75. 100 pages.<br />
Bettever (née Chazeau Armelle) Forces politiques anticoloniales<br />
et les obstacles à l'indépendance de la<br />
Martinique depuis 1945. Maîtrise d'Histoire. Paris VII.<br />
1974/75. 155 pages.<br />
Bernarht (Florence) Les milieux coloniaux en AEF et la<br />
décolonisation 1940 - 1960. D.E.A. Paris VII. Juin<br />
1987. 81p.<br />
Bollinger (Nicole) Le travail féminin en Afrique noire.<br />
Maîtrise. Paris-EHESS juin 1969. 51p.<br />
Bollinger (Nicole) Le travail féminin en Afrique noire.<br />
Maîtrise. Paris-EHESS juin 1969. 51p.<br />
Cohen (Elie) La presse et le fait divers<br />
Maîtrise. Paris VII. 1984/85. 114 pages.<br />
Co Trung Yung Marina La participation des femmes sénéqalaises<br />
à la vie politique de 1945 à 1960. D.E.A. Paris I. 1979/80 - 37<br />
pages.<br />
Danfakha (Papa Waly) Les hommes d'affaires sénégalais.<br />
1930 - 1960. D.E.A. Paris VII. 1985 36 pages.<br />
Daniako (Abdoulaye Charles) les partis politiques au Mali de<br />
1945 à 1960. Rapport de recherche D.E.A. Paris VII. Oct.<br />
1981. 37 pages.<br />
Diaïte (Ibou) Le réferendum de septembre 1958 au<br />
Sénégal Mémoire D.E.S. Université Paris 1964.<br />
Diallo (Mohammed Malick) Guinée. L'idéologie politique à<br />
l'épreuve des réalités socio-économiques du développement de<br />
1958 à nos jours. Maîtrise. Paris VII. Sept 83.<br />
Diallo (Kalidou) Syndicat unique de l'Enseignement Laïc du<br />
Sénégal. (SUEL) contribution à l'étude du mouvement syndical à<br />
la veille et au début des indépendances. DEA. Université de<br />
Dakar. 1986.<br />
546
Diallo (Falilou) Le Sénégal sous Vichy 1940-1943.<br />
contribution à l'étude du régime politique du gouvernement de<br />
Vichy au Sénégal. Maîtrise. Paris I. 1979/80. 310 pages.<br />
Diouf (Gustave Pathe) La ségrégation spatiale et sociale<br />
dans les villes coloniales et son évolution depuis les<br />
indépendances. Les cas de Dakar et Abidjan.<br />
Certificat d'ethnologie africaine. Paris V. 1985/86. 41p.<br />
Diouf (Made B) Dakar et son secteur informel. Etude des<br />
restauratrices de la zone industrielle. Mémoire EHESS. Paris<br />
1979. 131 pages.<br />
Didier (Baron) L'idéologie coloniale dans la chanson<br />
française. Maîtrise - Histoire - Paris VII 1981/82 - 177<br />
pages.<br />
Dulucq (Sophie) Les investissements publics français dans les<br />
villes d'Afrique noire francophone. 1953 - 1986.<br />
DEA. Paris VII. 1985/86.<br />
Fausther (Juliette ép. N'Gala) Aspects du syndicalisme en<br />
Afrique noire francophone Maîtrise. Paris VII 1981/<br />
63 pages.<br />
Faye (Cheikh Faty) L'opinion publique dakaroise. 1940-44<br />
Maîtrise. Université de Dakar-1973 63 pages.<br />
Georges ( Pincon René) Le général de Gaulle et la<br />
décolonisation en Afrique noire francophone. 1944-1960.<br />
Maîtrise paris VII. 1973/74. 73 pages et annexes.<br />
Gueye Seydou La loi cadre et l'éclatement de l'AOF 1956-60 Maît<br />
rise. Paris I. 1974. 110 pages.<br />
Guillerme (Philippe) La pensée politique de Sékou Touré<br />
1958 - 1976 Maîtrise Paris VII. 1978.<br />
Kaba (Moussa) L'idéologie marxiste de certains dirigeants<br />
africains dans la lutte de libération nationale. Maîtrise.<br />
Paris VII. 103 pages. Date non indiquée.<br />
Kanté (Abdoulaye) La loi-cadre et la presse. Histoire de<br />
relations internationales. Maîtrise. Paris VII. 1980/81. 63<br />
pages<br />
Kouadio (Sibaki) Le mouvement communiste international et la<br />
question coloniale en Afrique noire francaise. 1945-1952.<br />
Maîtrise. Paris VII Juin 1963- 145p.<br />
Lê (Mamadou) L'Union progressiste sénégalaise (UPS)<br />
Mémoire de DES - Sciences politiques. Paris 1965.<br />
Nadia (Nicolas) L'opinion publique martiniquaise devant la loi<br />
d'assimilation de 1946. Maîtrise. Paris l 1973. 157 P.<br />
Riou (Claire) Les rapports entre les partis et syndicats en<br />
France de 1904 à 1914. L'Humanité un lieu de<br />
547
Bergevin (Daniel de)."Dakar = dix ans de buildings"<br />
in Europe-France d'outre -mer. n0368- juillet 1960. page 42 à<br />
45.<br />
Billen (M) et le Guérinal (N) et Moreigne (JP) . "Les<br />
associations de jeunes à DAKAR. approche d'un fait social<br />
objectif" in. Psychologie africaine n03<br />
1967-page 373 à 400.<br />
Bismuth (H) et Menago (C)."Etude sur le consommation<br />
africaine dans les débits de boisson à Dakar" Paris. Haut<br />
comité d'Etude et information sur l'alcoolisme.23 pagesronéoté-microfilm.<br />
Bibliothèque du musée de l'Homme (date non<br />
indiquée) .<br />
Brasseur (Gérard) "Le problème de l'eau au Sénégal"<br />
in Etudes Sénégalaises. N° 4.Bulletin de l'IFAN.<br />
Saint Louis 1952. 99 pages.<br />
152 Broussous (Le Divelec) "Les salaires en AOF. Salaires<br />
minima hiérarchisés" au 28 février 1958 - Dakar - Haut<br />
Commissariat de l'AOF - 96 pages.<br />
Canale (J.Suret) "La grève des cheminots africains. 1<br />
947-1948" in cahier d'histoire. n 28. 1978. pages 82 à<br />
124.<br />
canale (J. S. ) "Les groupes d'étude communistes en Afrique n<br />
oire" 1943-1950. 34 pages-non publié<br />
Charpy (Jacques) "Dakar a cent ans". Catalogue de<br />
l'exposition établi par le service d'archives du haut<br />
commissariat de l'AOF. Dakar-déc.1957-ronéoté 37 pages<br />
Coulon (Christian) "Elections, factions et pouvoir en Afri<br />
que noire". in Aux Urnes l'Afrique. Institut d'étude politique<br />
de Bordeaux. n 0 8. Paris. Pedone.1978.<br />
Crowder (Michael) "Sénégal- a study in french assimilation p<br />
olicy" London - Institute of race relations. Oxford university<br />
press. 1952- 104 pages.<br />
Dadié (Bernard) "Misère de l'enseignement en AOF".<br />
Dakar. Bulletin de l'IFAN-déc. 1956 janvier 1957.<br />
Decraène ( Philippe) "Permanence de l'histoire et renouveau<br />
politique au Sénégal" in Monde diplomatique. Paris. Mai 1981<br />
Dia (Mohamed Fadel) " La presse et le combat pour<br />
l'émancipation politique au Sénégal". 1956-1960. in La<br />
Gazette de la presse francaise n029 Et 30 - janvier-avril<br />
1975.<br />
Diaïté (Ibou) "Le statut administratif des capitales.<br />
l'exemple de Dakar". in Annales africaines 1976. page 25-51.<br />
Diop (Abdoulaye) "L'immigration toucouleur à Dakar. Enquête<br />
1958-1959". Dakar. Bulletin de l'IFAN. déc 1959- 98p.<br />
549
Eyquem (Cathérine) "Dakar entre la tradition et le<br />
modernisme". in Afrique Littéraire et Artistique. n° 32-Août<br />
1977 p. 58-75.<br />
Faladé (Solange) "Femmes de Dakar et de son agglomération" in<br />
Femmes d'Afrique noire Paris-Mouton et Cie 1960.<br />
Faysse (G) "Les moyens de la communication sociale au<br />
au Sénégal". in le Journaliste démocratique Revue de<br />
l'organisation internationale des journalistes. Prague. 1973.<br />
n° 5. pp 7 à 10<br />
Fischer (Georges) "Syndicats et décolonisation"<br />
Présence africaine oct. 1960-janv.1961.<br />
Paris-<br />
Frenkel (Matvei) "Premiers courants radicaux dans le<br />
nationalisme africain" in Afrique : Recherche des savants<br />
soviétiques. 1984- pages 22 à 103<br />
Froelich (J.C.) "Sectes musulmanes et civilisations<br />
africaines". in le mois en Afrique n° 5. Mai 1966<br />
105.<br />
page 98 à<br />
Froelich (J.C.) "Le réformisme de l'Islam en Afrique noire de<br />
l'ouest" in Revue de Défense nationale n025<br />
oct-déc 1961 pp 77-91.<br />
550<br />
Gastellu (Jean Marc) "L'égalitarisme économique des Sereres d<br />
u Sénégal". Paris. Orstom. travaux et documents n0128- 1981<br />
Guillemin (Philippe) " Les structures des gouvernements locaux<br />
en Afrique noire Contribution à l'étude d'un parlementarism<br />
e naissant". in Afrique- documents. n° 48/49-1959 pp. 131<br />
144.<br />
Hauser (A) "Les industries de transformation dans la région d<br />
akaroise". in Bulletin de l'IFAN. Etudes sénégalaises. n05.<br />
Saint Louis 1954.<br />
Jourdain: "L'alimentation en eau de Dakar". in Industries<br />
et Travaux d'Outre-Mer- n053- Avril 1958 pp 189-199<br />
La Cour Grandmaison ( Colette)- "Les activités économiques des<br />
femmes dakaroises". in journal of the International<br />
African Institute n° 2 April 1969. London- Oxford university<br />
Press.<br />
Lombard (Jacques) "Activités traditionnelles et pouvoirs<br />
européens en Afrique noire". in cahiers de la Fondation<br />
Nationale de sciences politiques. n° 152. Paris- Armand Colin<br />
- 1967- 292 pages<br />
La Cour Grandmaison (Colette) "Les stratégies matrimoniales<br />
des femmes dakaroises." in Cahier de l'ORSTOM. Vol VIII. n02.<br />
Paris. 1972. pp. 201-220.<br />
Lianzu (Claude) "Situation coloniale et opinion publique. Peti
ts blancs et socialistes pendant trente<br />
ans de luttes électorales". Tunis. Cahier de Tunisie. n°<br />
87/88 1974.<br />
Lisette (Gabriel) "Le combat du Rassemblement démocratique<br />
africain (RDA) pour la décolonisation de l'Afrique noire et<br />
l'unité africaine" in Mondes et Cultures. Tome XXXVIII. n°<br />
4. 1978. pp. 68-70.<br />
Mabileau (Albert) et Meyriat (Jean) "Décolonisation et<br />
régimes politiques en Afrique noire". in cahier Fondation<br />
Nationale des Sciences Politiques. n° 161. Paris Armand<br />
Colin. 1967.<br />
Marie André de Sacré Coeur (Soeur) "Evolution de la famille e<br />
n Afrique noire". in Bulletin de l'Académie des sciences<br />
coloniales séance du 6 juin. 1952. pp. 287-302.<br />
Marône (Ibrahima) "Le tidjanisme au Sénégal" in Bulletin<br />
de l'IFAN. n° 1. Tome XXXVII Dakar. janvier 1971. pp. 156-215.<br />
Martens (Georges) "Révolution ou participation = syndicat et<br />
partis politique au Sénégal". in le Mois en Afrique n°<br />
205/206 et 209/210. Février. Mars 1983.<br />
Mercier (Paul) "Analyse des élites sénégalaises" in Bulletin<br />
international des sciences sociales. Paris 1956. pp. 448-460.<br />
Mercier (Paul) "Le groupement européen de Dakar = orientation<br />
d'une enquête". in Cahiers internationaux de<br />
sociologie. Volume XIX Paris. 1965. pp. 130. 146.<br />
Mercier (Paul) "La vie politique dans les centres<br />
Sénégal. étude d'une période de transition".<br />
Cahiers internationaux. de sociologie n° 26/27.<br />
juillet-déC. 1959 pp. 55.84.<br />
urbains du<br />
in<br />
Paris.<br />
Mercier (Paul) "L'agglomération dakaroise. Quelques aspects<br />
démographiques et sociologiques". in Bulletin de l'IFAN. Etudes<br />
sénégalaises. n° 5. Saint Louis. 1954.<br />
Mersadier (Yvon) "Budgets familiaux africains. Etudes de 136<br />
familles de salariés dans 3 centres urbains du Sénégal."<br />
Bulletin de l'IFAN. Saint-Louis 1957.<br />
Meynaud (Jean) "Les groupes de pression" in Cahiers Fondation<br />
Nationale des Sciences politiques. Paris Armand Colin. 1962.<br />
Molard (J. Richard) "Les progrès de l'alcoolisme en Afrique n<br />
oire française". in Bulletin de l'IFAN n° 4. Dakar. oct.<br />
1951. pp. 841-844.<br />
O'Brien (R.C.) "Les relations raciales au Sénégal"<br />
in Psychopathologie africaine. Vol. XI. Paris. 1975. pp. 55<br />
à 130.<br />
Orrit (Jean Claude) "L'engagement chez Sembène Ousmane". in<br />
Recherche pédagogique et culture. Mosaïque n° 47/48. Paris<br />
551
Mai-Août 1980. pp. 33-40.<br />
Poncet (Jean) "Mouvement de Libération nationale. Quelques<br />
réflexions". Paris. in Cahiers du Centre d'Etudes et de<br />
Recherches marxistes. n° 41 date non indiquée 27 pages.<br />
Sarr (A) Fofana (1) et Benny (K) "Esprit et situation de<br />
l'enseignement en AOF". in Bulletin de l'IFAN. déc. 1956.<br />
janvier 1957. Dakar.<br />
Sylla (Assane) "Une république africaine au XIXé siècle (1795<br />
- 1857)" in Présence Africaine. Mars 1975. pp. 47-65.<br />
Thiam (Doudou) ="De l'avenir des institutions coutumières en<br />
Afrique noire". in Présence Africaine.<br />
Mars 1955. pp. 36-46.<br />
Thiondoun (Mgr) "L'action de Mgr Lefebvre à Dakar" in le Soleil<br />
le juillet 1988. Dakar.<br />
Thomas (L.V.) "La croissance urbaine au Sénégal. pour une<br />
analyse sociologique de Dakar". in Croissance urbaine en<br />
Afrique noire et Madagascar. Paris 1972. T II. pp. 1015 - 1028<br />
Touré Moustapha : "Retour cahotique. Itinéraire de Dakar à la<br />
Mecque". in le Soleil. Dakar 22/8/86<br />
197 Vallée (Olivier) "Je salue Dakar". in Revue Autrement.<br />
oct. 1984 - pp. 18 à 19.<br />
198 Vieyra (Paulin) "Quand le cinéma français parle au nom de<br />
l'Afrique noire". in Présence Africaine. Paris. janvier 1957.<br />
199 Vieyra (Paulin) "Où en sont le cinéma et le théâtre<br />
africains?" in Présence Africaine. Avril/Mai 1957. pp.<br />
143-146.<br />
200 Zecchini (Laurent) = "Le mal-vivre au Sénégal .. Dakar la<br />
ville la plus française des villes d'Afrique". in leMonde.<br />
Paris 9/4/87.<br />
Sans Auteurs<br />
"Le communisme et l'influence soviétique en AOF"<br />
in Revue de la Communauté franco-Eurafrigue-Union Francaise<br />
et Parlement. n° 100 - Paris 1959.<br />
552
"Le FI.D.E.S. et les territoires d'outre-mer".in Présence<br />
Africaine. Paris - janvier 1957 pp. 48 à 56 et pp. 142 à 163.<br />
VI Conférences - rapports - Discours - séminaires -<br />
colloques - congrès symposiums.<br />
- Diop (Issa) Etude sur la situation de la jeunesse au<br />
Sénégal.-avis n° 66-0 6 du ConSEil Economique et Social.<br />
Dakar. 1966. 257 pages.<br />
- Dreyfuss (Jean) Une expérience d'auto-construction à<br />
Dakar. in travaux du colloque. 2è session - conférence<br />
inter-africaine. Nairobi. 1959.<br />
-Gouse (Françoise) et Bathily (Arona) Réflexions sur<br />
l'Education. Impact de l'Ecole importée in travaux<br />
séminaire du CRDI et de ENDA. Dakar-Février 1976<br />
- Hauser (A) L'émergence des cadres de base africains dans<br />
l'industrie:. Le cas du Sénégal. in travaux colloque<br />
d'Ibadan. Bulletin IFAN. Dakar. juillet 1964.<br />
- N'Sougan (Agblémagnon) Responsabilités des élites dans la<br />
prise de conscience des problèmes actuels. in travaux<br />
colloque de psychologie des élites d'Afrique noire face<br />
au monde technique. Paris C.H.E.A.N. Mars 1965.<br />
-d'Arboussier (Gabriel) L'Afrique vers l'unité. Dakar.<br />
discours programme à la session du Grand Conseil de<br />
l'AOF. Dakar. 3 avril 1958. Editions Saint Paul 15 pages.<br />
- Olivier (Laurent) Dakar et ses banlieues in travaux<br />
colloque organisé par l'université de Bordeaux. Talence.<br />
sur la croissance urbaine. Sept. 1972.<br />
- Pasquier (Roger) La formation des cadres syndicalistes.<br />
L'exemple de la C.F.T.C. in travaux colloque problèmes de<br />
la décolonisation de l'Empire français. Paris. oct. 1984.<br />
- Radio France-Internationale et Présidence de la République du<br />
Sénégal (.. ) Rapport sur l'étude de l'auditoire de<br />
l'O.R.T.S. (Office de Radiodiffusion Télévision du Sénégal)<br />
Dakar 1976 75pages.<br />
- Radio France Internationale et Présidence de la<br />
République du Sénégal (... ) Rapport sur l'étude de la<br />
radiodiffusion nationale de Sénégal. étude d'auditeurs.<br />
Dakar 1972. 163 p.<br />
- Sylla (Ousmane) = structures familiales et mentalités<br />
religieuses des Lébous. Colloque de psychiatrie. Dakar.
BOS et d'autres partis. Il revient<br />
_ L'unité<br />
organe du BPS (Bloc Populaire Sénégalais) paraît à Dakar de<br />
1956 à 1958 date à laquelle une nouvelle fusion entre<br />
diverses formations politiques, aboutit à la création d'un seul p<br />
arti appelé U.P.S. (Union Progressiste Sénégalais) avec une<br />
autre journal ayant pour titre<br />
L'Unité Africaine<br />
organe central de l'UPS (UNion Progressiste Sénégalais) paraît<br />
à Dakar de 1958 à 1960<br />
Réveil<br />
Journal d'information politique qui devient progressivement<br />
organe central du R. D. A. , (Rassemblement Démocratique<br />
Africain) paraît à Dakar durant la période 1945-1956.<br />
est imprimé Après le désapparentement du RDA, Réveil restera l<br />
'organe de la section sénégalaise exclue du Parti et qui est<br />
l'UDS (Union Démocratique Sénégalaise)<br />
"Trait d'Union"<br />
bulletin intérieur de liaison de la section sénégalaise du RDA<br />
- l'UDS.<br />
L'Action<br />
Organe central de la section sénégalaise du RDA, cree après<br />
l'exclusion de l'UDS. Il est donc l'organe du MPS<br />
(Mouvement Populaire Sénégalais). Paraît à Dakar de 1954 - à<br />
1956.<br />
La Lutte<br />
Organe central du P.A.I. (Parti Africain de l'Indépendance)crée<br />
à partir de Octobre 1957. paraît à Dakar - jusqu'en<br />
1960 imprimé au départ, il sera surtout rénéotypé et<br />
essentiellement. -à partir de la clandestinité de ce parti<br />
politique.<br />
Monsarew<br />
Organe de la section sénégalaise du P.A.I. publié à Dakar à<br />
partir de Février 1958. Parution clandestine par la suite. Mais<br />
paraît durant toute la période 1958-1960.<br />
Defarsarew<br />
Revue théorique et politique du Comité Central du<br />
P.A.I. Paraissant à Dakar. Publiquement d'abord et<br />
clandestinement par la suite.<br />
Indépendance Africaine<br />
Organe central du P.R.A. (Parti du Regroupement<br />
Africain) paraît de la fin 1958 à 1960 (suite à la scis<br />
sion intervenue dans l'U.P.S. avec le réferendum de<br />
1958)<br />
555
X Journaux d'information et d'opinion<br />
Paris-Dakar:<br />
Quotidien, publié à Dakar toute la période 1945-1960<br />
imprimé.<br />
Echos d'Afrique Noire<br />
Sous-titre : Le grand hebdomadaire de défense<br />
française -anciennement :Echos de Guinée. puis<br />
Echos Africains : Dakar 1947 à 1950 il devient<br />
par la suite Echos d'Afrique noire. paraît à Dakar<br />
de 1950 à 1960. imprimé à Dakar puis au Maroc et<br />
ensuite à Dakar.<br />
Petit Jules Illustré<br />
paraît en rapport avec Echos d'Afrique noire dont<br />
il a le même fondateur Maurice Voisin. paraît à<br />
Dakar. imprimé.<br />
Annales Coloniales<br />
Dakar 1949. Hebdomadaire.<br />
Réveil<br />
(Voir liste des journaux de partis politiques).<br />
8frigue Nouvelle<br />
organe hebdomadaire de la hiérarchie catholique<br />
dakaroise paraît de juin 1947 à 1960. imprimé<br />
Afrigue noire<br />
hebdomadaire politique, économique, culturel, sportif<br />
-sous-titre: l'hebdomadaire de l'élite. paraît durant<br />
toute la période imprimé<br />
L'Eurafricain<br />
Bulletin d'information et de liaison de l'Union des<br />
Eurafricains d'AOF et du Togo. paraît à Dakar - imprimé<br />
1947 à 1960.<br />
Horisons Africains<br />
Revue de la hiérarchie catholique. paraît mensuellement à<br />
Dakar Mars 1947 à 1960.<br />
Informations Africaines<br />
Hebdomadaire économique et financière paraît à Dakar<br />
dès 1947. deviendra de 1959 à 1960 Guid'Ouest Africain.<br />
La Dépêche de Dakar<br />
Journal libanais paraissant à Dakar de 1953 à 1955<br />
Echos de Dakar bi-mensuel paraît en 1950<br />
556
XI Les journaux d'étudiants<br />
Dakar- Etudiant<br />
organe de l'Association générale des Etudiants de<br />
Dakar. paraît à Dakar en 1951 et jusqu'en 1960.<br />
Renéotypé durant toute la période .<br />
AGE-Presse:<br />
Bulletin de l'Association générale des Etudiants<br />
Français en Afrique noire. Paraît à Dakar.<br />
Imprimé.<br />
Jeunesse D'Afrique<br />
organe mensuel de l'Association des étudiants<br />
catholiques de Dakar. paraît à partir de 1955<br />
et jusqu'en 1960. imprimé<br />
L'Etudiant d'Afrique Noire:<br />
Organe de la FEANF (Fédération des Etudiants<br />
d'Afrique Noire en France) est publié à Paris<br />
de 1953 à 1960.imprimé<br />
La voix de l'Afrique noire:<br />
Bulletin mensuel de l'Association des Etudiants<br />
RDA. Publié à Paris début 1951 jusqu'en 1957.<br />
XII Journaux de Jeunesse<br />
Organe du Conseil de la jeunesse du Sénégal (C.J.S)<br />
publié à Dakar à partir de 1953 et jusqu'en 1960.<br />
ronéotypé.<br />
Jeunesse:<br />
Organe du Progrès de Dakar Théâtre - sport - musique<br />
paraît à Dakar à partir de 1952. ronéotypé.<br />
SAVOIR pour agir<br />
Bulletin mensuel publié à Dakar pour les secrétariats<br />
sociaux de Dakar et de Saint-Louis. paraît de 1954<br />
- à 1957. ronéotypé au départ, il sera imprimé pour<br />
la suite puis à partir de 1958, il deviendra<br />
Afrique - documents:<br />
paraît à Dakar jusqu'en 1960.<br />
anciennement = savoir-pour-agir.<br />
5'..; 7'
Bulletin - des Equipes enseignantes d'Afrique<br />
paraît à Dakar de 1953 à 1960.<br />
Lettres de la province<br />
Bulletin de l'association des scouts de France et<br />
d'AOF/Togo. paraît à Dakar 1955 à 1960.<br />
Le Cap-Verdien<br />
mensuel 1952<br />
Le Cocotier<br />
1951 à 1952 - Ronéotypé. Dakar<br />
Echos de la brousse :<br />
1952. Dakar<br />
Le Petit dakarois:<br />
1952 - 1953. Dakar<br />
Gerbe de l'AOF:<br />
Dakar - 1952.<br />
Rio:<br />
Rufisque 1951 - 1953<br />
XIII Publications à caractère syndical<br />
Journal de l'U.S.C.I.<br />
(Union syndicale des commerçants indépendants)<br />
paraît à Dakar. 1957 à 1960. ronéotypé.<br />
SUEL - Liaison<br />
Bulletin du Syndicat Unique de l'enseignement Laïc<br />
1955. paraît à Dakar. ronéotypé.-deviendra par la suite<br />
L'Ecole Sénégalaise<br />
Bulletin mensuel de liaison et d'information du<br />
syndicat unique de l'enseignement laïc.<br />
Le Travailleur d'Afrique noire<br />
Publié par l'UGTAN de 1956 à 1958.<br />
Le Mouvement Syndical africain<br />
Publié par l'UGTAN. 1958 à 1959<br />
La Vigilance<br />
Organe de l'UGTAN. Dakar. 1959. (UGTAN autonome)<br />
Le Travailleur du Sénégal<br />
Organe section UGTAN du Sénégal.<br />
La Voix du postier<br />
558
Organe de la fédération postale<br />
Le douanier<br />
Organe de la fédération des douaniers.<br />
Le Travailleur du parquet<br />
Organe du syndicat du même nom.<br />
Afrique - Police<br />
Organe du syndicat de policiers. Dakar juillet<br />
XIV Autres publications et études<br />
1958.<br />
Revue le Mali : publié à Dakar par la Direction de<br />
l'information de la fédération du Mali. Juillet 1959<br />
- Août 1960.<br />
Revue Série "Exposition" : La presse au Sénégal des<br />
origines à l'indépendance 1856 - 1960 par C.R.D.S.<br />
de Saint-Louis du Sénégal Saint-Louis. Exposition de<br />
1978<br />
Afrique histoire.<br />
paraissant à Dakar-trimestrielle. 1981 imprimé<br />
Gëstu.<br />
Revue de recherches marxistes<br />
mensuel.<br />
paraissant à Dakar. bi-<br />
Documents centraux<br />
(collection) publiés par le c.c. du P.r.T.Sénégal (Parti de<br />
l'indépendance du travail) à partir de 1984.<br />
Andë Sopi.<br />
a paru à Dakar de 1975 à 1980. mensuel. imprimé.<br />
directeurs de publication: Mamadou Dia et Maguette Thiam<br />
Le Soleil<br />
quotidien national du Sénégal. anciennement Dakar-Matin<br />
antérieurement Paris-Dakar.<br />
Jeune Afrique<br />
hebdomadaire - Paris<br />
Jeune Afrique Economie<br />
559.
XIV INTERVIEWS<br />
Jean Suret Canale: Professeur d'histoire à<br />
l'université de Paris VII. Paris. le 10 décembre<br />
1986. le 17 décembre 1986.<br />
Joseph Roger de Benoist : Historien-journaliste<br />
chercheur à l'IFAN de Dakar. Dakar les 30 novembre<br />
1988 et décembre 1988 et déc. 1988.<br />
Moustapha Diallo : Docteur, ancien président de l'AGED<br />
Association générale des étudiants de Dakar) ancien<br />
responsable de la FEANF (Fédération des étudiants<br />
d'Afrique noire en France). Dakar: le décembre 1988<br />
le 30 novembre 1988<br />
Abdoul Maham Bâ/expert géomètre et Youssou Diop<br />
administrateur civil Bâ: ancien président du Conseil<br />
de la jeunesse du Sénégal. Diop: ancien secrétaire<br />
général et ancien président du Conseil de la jeunesse<br />
du Sénégal. Dakar: le 24 janvier 1989 Interview réalisée<br />
avec les 2 de façon<br />
conjointe.<br />
Amadou N'dene N'dao : Inspecteur de<br />
l'enseignement en retraite homme politique - homme de<br />
culture.- ancien responsable syndical enseignant au<br />
niveau de l'AOF- ancien responsable du mouvement de la<br />
jeunesse. Dakar le 24 novembre 1988.<br />
Omar Kâne : Historien - professeur Université de<br />
Dakar. faculté des Lettres Dakar 12 Novembre 1988.<br />
Obéye Diop : journaliste - ancien ministre du Sénégal<br />
Paris - 27 Février 1989.<br />
Thierno Bâ : Homme de culture - homme politique <br />
ancien ministre du Sénégal - ancien syndicaliste<br />
enseignant. Dionewar - le 23 janvier 1988.<br />
_ Mohamed Faye : Directeur des études et des recherches<br />
à O.R.T.S. (Office de Radiodiffusion Télévision du<br />
Sénégal) Dakar - 13 Septembre 1986.<br />
_ Thierno Arnath Dansokho : Homme politique - ancien<br />
responsable de l'UGEAO (Union générale des Etudiants<br />
Afrique occidentale) Dakar-divers entretiens 77/88.<br />
Maquette Thiam : Homme politique - syndicaliste<br />
professeur - faculté des sciences Université de Dakar.<br />
Dakar septembre 1988.<br />
563
_ Saliou M'Baye : Directeur des des archives nationales<br />
du Sénégal. Building administratif Dakar - Octobre 1989.<br />
.. Ismaïla Niang : Inspecteur du trésor - ambassade<br />
Sénégal Paris. Le 2/4/1990.<br />
Entretiens : dans le cadre de la recherche pour la<br />
préparation de la mémoire de maîtrise mais largement<br />
utilisables pour cette thèse.<br />
-ont lieu de Mars à juin 1973 à Saint-Louis,<br />
Dakar, Rufisque, Bargny - Diourbel avec 15<br />
personnalités politiques, syndicales, anciens<br />
combattants, anciens militaires, responsables<br />
municipaux f marabouts, etc .<br />
Bâ Mactar -<br />
Bathily (El Hadj Mamadou) <br />
Diouf Adama -<br />
Diallo (El Hadj Doudou) <br />
Guèye (Doudou)<br />
M'Bengue (El Hadj Thierno Amath) <br />
Menedge (Léon) -<br />
N'Diaye (Adbou) -<br />
Sagna (Mamadou) -<br />
Sarr (Moustapha) -<br />
Vidal (Paul)<br />
XVI Emissions radiophoniques<br />
-Les porteurs de pancartes<br />
par O.R.T.S. - Dakar - chaîne Internationale.<br />
Sept 1987. Plusieurs invités - témoins de l'histoire. Sur<br />
l'arrivée de de Gaulle à Dakar le 26 août 1958.<br />
-Mémoire d'un continent<br />
Radio France Internationale.<br />
Paris - 13 juin 1988 - Djibo Bakary sur le référendum du 28<br />
sept. 1958<br />
-RFI 28 juin 1990 = émission spéciale sur le rapport de la Cour<br />
de Comptes sur la gestion 1989 des services et entreprises<br />
d'Etat en France.<br />
-Livre d'or<br />
Radio France Internationale. Paris. 25 oct. 1986<br />
Invité = Léopold Sédar Senghor<br />
-Confidences autour d'un micro<br />
Radio Sénégal - chaîne Internationale - Invité = Obèye Diop.<br />
-RFI. L'Afrique d'hier = invité = Seydou Badian Kouyateancien<br />
ministre du Mali. le 22/5/1990
Radio France Internationale<br />
Gaston Defferre s'éteint par Dembo Dieng<br />
Paris le 10 mai 1986.<br />
Radio France Internationale<br />
Le Centenaire de la Commune de Dakar. entretien avec Mamadou<br />
Diop. maire de Dakar. Paris 21 décembre 1987.<br />
RFl. Mémoire d'un continent<br />
L'itinéraire intellectuel et politique d'un militant du RDA.<br />
invité = Doudou Guèye. animateur l.B. Kaké. date: le 11/4/1979<br />
RFl : Mémoire d'un continent<br />
date: le 29 mai 1989. invité = Madame Claude Gérard <br />
animation = Ibrahima Baba Kaké. journaliste Agence de<br />
documentation, ancienne de la résistance.<br />
Défense des nationalistes malgaches, du RDA et du FLN.<br />
Création de l'"Afrique Information" "Afrique documents"<br />
"Inter Afrique Presse" = agence<br />
France Culture = la bataille d'Alger et la torture<br />
date = 17 juin1989.participation : général Massu - Ahmed Ben<br />
Bella - Mme Tillon, Yassef Sa'adi chef de la zone autonome<br />
d'Alger.<br />
France Culture<br />
9 mai 1990 "les oubliés de l'annistice"<br />
animateur - Elikia M'bokolo<br />
565
ADANDÉ<br />
ARBOUSSIER (Gabriel d')<br />
AURIOL (Vincent)<br />
BA (Abdoul Maham)<br />
BA (Amadou)<br />
BA (Massagui)<br />
BA (Thierno)<br />
BARTHES<br />
BECHARD (Paul)<br />
BENOIST (Roger de)<br />
BIARNES (Pierre)<br />
BIDAULT Georges<br />
BLUM (Léon)<br />
BOISSON (Pierre)<br />
BONIFAY<br />
BaUNAMA<br />
BOURGI (Robert)<br />
BRanlER (Daniel)<br />
BURON (Robert)<br />
CAMARA (Latyr)<br />
CANALE (Jean Suret)<br />
CARTIER (Raymond)<br />
CHAUVET (P.L. Gabriel)<br />
CISSÉ (Alioune)<br />
COLIN (Roland)<br />
CORRÉA{Joseph)<br />
COSTE-FLORET (Paul)<br />
COULON (Christian)<br />
COURNARIE<br />
CUSIN (Gaston)<br />
DEFFERRE (Gaston)<br />
DELMAS (Robert)<br />
DIA (Mamadou)<br />
INDEX<br />
219<br />
75/76/79/80/81/83/272/275/466<br />
57/254/418<br />
566<br />
9/128/129/135/141/237/239/243/246/250/378<br />
32/417/418/419/423/426/432/433/434/436<br />
207/441<br />
77/78/232/233/321/32.5/371/378/420<br />
25/60/460<br />
25/36/60/189/230/260/263/313/352/456<br />
22/26/74/97/162/164/197/198/226/227/<br />
229/231/236/237/238/242/244/251/258/365/<br />
378/454/487<br />
199/200/203/284/314/331/336<br />
272<br />
254/418<br />
186/195/206/226<br />
200/285/321/351/419/425/426/436<br />
392<br />
63<br />
236/239/242/245<br />
33/335/336<br />
74/75/91/123/363/495<br />
60/74/76/106/109/203/287/398<br />
477<br />
25/456<br />
498<br />
96/132/145/356/361/362<br />
74<br />
374<br />
213/454<br />
25/73/104/1 32/1 43<br />
25/26/199/223/287/478<br />
25/34/266/447/485/486/490<br />
33/56n2/200/270/314<br />
24/28/30/45/62/65/66/67nO/87/89/90/<br />
91/94/97/99/118/136/157/182/185/189/210/22<br />
3/224/256/270/292/347/371/413/463/476/479/<br />
482/486/490/491/492/493/494/495/496/497
SENGHOR (Léopold Sédar)<br />
SINIBALDI (Jean)<br />
SOUMAH (David)<br />
SOUSTELLE (Jacques)<br />
SY (Babacar)<br />
SY (Cheikh Tidiane)<br />
SY (El Hadj Abdoul Aziz)<br />
SY (El Hadj Malick)<br />
SV (El Hadj Mansor)<br />
570<br />
29/30/33/34/43/44/45/46/52/60/61/62/63/64/<br />
65/66/67/68(70(71 (72(75/90/97/98/99/100/102/<br />
114/135/136/139/141/143/156/183/207/209/<br />
219/256/260/264/267/269/275/279/286/297/<br />
299/300/304/308/355/374/428/431/448/450/<br />
453/456/457/458/460/463/466/468/474/476/<br />
478/479/480/482/484/486/490/492/496/497<br />
434<br />
498<br />
64<br />
91/182/183<br />
43/45/46/94/95/96/183/494<br />
43/183/188<br />
21/91/181/182/183/358<br />
182/188<br />
TALL (El Hadj Omar) 181/186/188/208<br />
TALL (El Hadj Seydou Nourou) 88/193/194/208<br />
TASCHER (Charles) 173/201/286/335/374/488<br />
THIAM (Awa) 23<br />
THIAM (Iba Der) 297<br />
THIAW (Ibra) 321<br />
THIONGANE (Abdoulaye) 246/247<br />
TOURÉ (El Hadj Cheikh) 162/191<br />
TOURÉ {Sékou) 91/112/124/193/219/224/492/497<br />
TRAORE (Bakary) 30/453<br />
VIDROVITCH (C.C.)<br />
VOISIN Maurice)<br />
VAN (Vollenhoven)<br />
VIEYRA (Paulin)<br />
VERRIERES (Louis)<br />
ZUCCARELLI (François)<br />
387<br />
64/70/102/135/177/205/223/230/231/237/<br />
238/243/245/247/256/257/262/263/264/<br />
267/291/316/346<br />
74/105/1 28/1 43/364/367383/<br />
399/413/456/457<br />
375<br />
13<br />
61
TABLE DES MATIERES<br />
I. Dédicace<br />
II. Remerciements<br />
III-V Sigles<br />
Introduction générale<br />
La problématique<br />
La question des sources<br />
Propos uréliminaires Considérations générales<br />
sur la ville de Dakar<br />
Dakar: population, statut et responsabilités<br />
1. Population: importance numenque<br />
II. Population : composition raciale et religieuse<br />
III. Statut<br />
PREMIERE PARTIE:<br />
LES GROl1PES DE PRESSION ET "FAISEURS"<br />
D'OPINIONS<br />
Chapitre l : les partis politiques<br />
Le renouveau des années 1943-45<br />
1. Remarques générales sur les partis<br />
II. Présentation des partis politiques<br />
SFIO (49-67), BAS (61-73), UDS/RDA (73-82)<br />
MPS/RAA (82-84), PAl (85-90) - PRA Sénégal<br />
(90-92), MLN (92-94), PSS (94-96), PFA (96-100)<br />
RPF (100-102)<br />
Chapitre II : Les syndicats<br />
Introduction<br />
I. Monde syndical et modes d'organisation<br />
II. La représentativité<br />
III. Relations extérieures des centrales syndicales<br />
Chapitre III : Les organisations de jeunesse<br />
1. Naissance et organisation<br />
2. Relations du C.J.S.<br />
571<br />
1 - 1 1<br />
1 - 2<br />
3 - 1 1<br />
12-37<br />
13 -37<br />
13 - 15<br />
16-23<br />
24 -37<br />
38-213<br />
39-103<br />
39-41<br />
42-49<br />
49-103<br />
104-125<br />
104-106<br />
107-114<br />
115-121<br />
121-125<br />
126-142<br />
126-130<br />
130-142
Chapitre IY : Les organisations d'étudiants<br />
1. De l'Institut à l'Université<br />
II. Les organisations étudiantes<br />
1. De l'AGED à l'UGEAO<br />
2. l'AGEFAN<br />
3. L'association des étudiants catholiques<br />
4. Les étudiants musulmans<br />
5. La FEAJ\TF<br />
6. Etudiants catholiques africains en France<br />
('J .<br />
,1?I2Itre V : Les groupes<br />
économique<br />
1. la Chambre de commerce<br />
2. L'Assemblée des propriétaires<br />
3. Le Comité de défense des locataires<br />
Chapitre VI : Confréries et marabouts<br />
1. Les layènes<br />
2. Les tidjanes<br />
3. Confrérie mouride<br />
4. Confrérie hamallite<br />
5. Confrérie kadiriya<br />
6. Relations islam-administration<br />
7. Le réformisme islamique<br />
Chapitre VII : L'église catholique<br />
Chapitre VIII : La gentry dakaroise<br />
Chapitre IX Les" petits blancs"<br />
Chapitre X Autres groupes de pression<br />
572<br />
143-169<br />
143-145<br />
145-169<br />
146-157<br />
158-159<br />
159-161<br />
161-162<br />
162-168<br />
168-169<br />
de pression à caractère<br />
170-178<br />
1. Groupements à caractère ethniques et régionaux<br />
II. Groupements d'originaires de villes<br />
III. Conseil Mondial de la Paix<br />
IV. Le Comité de Défense des libertés démocratiques<br />
Conclusion partielle premjère partie<br />
170-174<br />
]74-175<br />
175-178<br />
179-194<br />
180<br />
181-183<br />
183-186<br />
186-187<br />
187-188<br />
188-191<br />
191-194<br />
175-198<br />
199-202<br />
203-206<br />
207-212<br />
207-209<br />
209-210<br />
210-211<br />
211-212<br />
213
DEUXIEME PARTIE:<br />
MOYENS D'INFORMATION, DE COMMUNICATION<br />
ET D'EXPRESSION<br />
Introduction<br />
Chapitre 1 : La radiodiffusion<br />
I. Historique<br />
Il. La question de l'écoute<br />
Chapitre II : La presse<br />
1. Leur importance<br />
Il. La classification des journaux<br />
1II. La liberté de la presse<br />
1) Le procès d'" Afrique Nouvelle"<br />
2) Le procès des "Echos d'Afrique Noire"<br />
3) Les actions de l'administration contre<br />
"Réveil" et "Dakar-Etudiant"<br />
IV. Impression, tirage, coût et lectorat<br />
1) Impression<br />
2) Tirage<br />
3) Coût et lectorat<br />
V. Sources d'information et rédacteurs<br />
1) Les sources d'information<br />
2) Les rédacteurs<br />
VI. Contenu<br />
1) Paris-Dakar<br />
2) Afrique Noire<br />
3) Afrique Nouvelle<br />
4) Echos d'Afrique Noire<br />
5) Condition humaine<br />
6) Réveil<br />
7) Monsarev<br />
Chapitre III : Téléphone, télégraphe, télex<br />
et courrier<br />
1. Bref historique<br />
II. Population face aux activités des postes<br />
573<br />
214-305<br />
214<br />
215-225<br />
215-219<br />
219-225<br />
226-280<br />
226-227<br />
227-228<br />
228-241<br />
228-230<br />
230-232<br />
232-241<br />
241-249<br />
241-244<br />
244-246<br />
246-249<br />
249-252<br />
249-250<br />
250-252<br />
- 252-280<br />
253-255<br />
255-257<br />
258-262<br />
262-267<br />
267-274<br />
272-275<br />
275-280<br />
281-287<br />
281-282<br />
282-287
Chapitre IV : Les moyens traditionnels<br />
1. La rumeur publique<br />
1) Sa permanence<br />
2) Les causes<br />
II. Tam-tam, chanson, habillement et "fanal"<br />
1) Le tam-tam<br />
2) La chanson<br />
3) Habillement<br />
4) "Fanal"<br />
TRQISIEJViE PARTIE;<br />
OPINION PUBLIQllE ET QUESTIONS SOCIALES<br />
ou QUALITÉ DE LA VIE<br />
Chapitre 1 : Sol et propriété du sol<br />
Législation coloniale<br />
Réaction des populations locales<br />
Chapitre II : L'habitat àakarois<br />
1. L'habitat<br />
2. Eau et électricité<br />
a) L'eau<br />
b) L'électricité<br />
Chapitre III : L'alimentation<br />
1. En milieu indigène<br />
II. En milieu européen<br />
II 1. Importations et alcools<br />
Indications sur la consommation<br />
Chapitre IV : Santé, propreté et sécurité<br />
1. Santé et propreté<br />
1) Santé<br />
2) Hygiène et propreté<br />
II. Sécurité<br />
574<br />
288-305<br />
288-294<br />
288-292<br />
292-294<br />
294-305<br />
294-296<br />
296-299<br />
299-301<br />
301-305<br />
306-415<br />
307-311<br />
312-326<br />
312-319<br />
319-326<br />
319-323<br />
323-326<br />
327-339<br />
327-331<br />
331-333<br />
333-337<br />
338-339<br />
340-353<br />
340-349<br />
340-345<br />
345-349<br />
349-353
Chapitre II : Régularité des élections<br />
1. Corps électoral et participation<br />
II. Validité des consultations<br />
1. Consultation du 17 juin 1951<br />
2. Cantonales et municipales<br />
Chapitre III : Orientation politique et sociale<br />
1. Conception des relations avec la métropole<br />
el l'unité<br />
1) Relations avec la métropole<br />
2) La question de l'uni té<br />
II. Consolidation du nouvel Etat<br />
A.1. Relations avec les partis<br />
A.2. Relations avec les syndicats<br />
Conclusion générale<br />
Annexes<br />
Bibliographie<br />
Index<br />
Table des matières<br />
576<br />
444-471<br />
444-451<br />
451-468<br />
451-457<br />
457-468<br />
472-501<br />
472-490<br />
472-482<br />
482-490<br />
490-501<br />
493-495<br />
495-501<br />
503-506<br />
507-537<br />
538-565<br />
566-570<br />
571-576