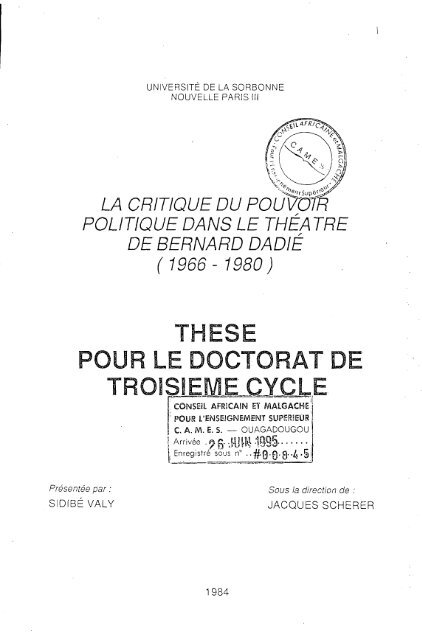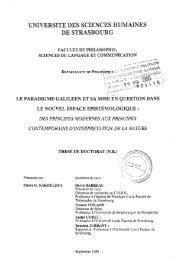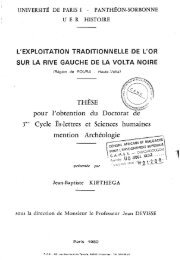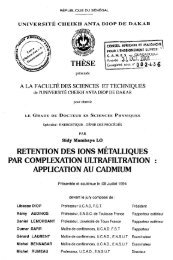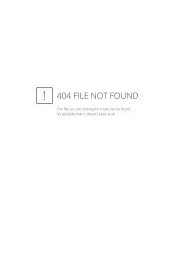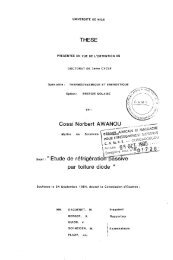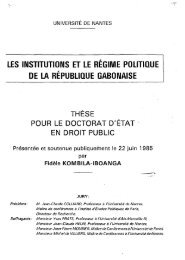( 1966 - 1980) these pour le doctorat de troisieme" cycle
( 1966 - 1980) these pour le doctorat de troisieme" cycle
( 1966 - 1980) these pour le doctorat de troisieme" cycle
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Cl. ct.. XLi.<br />
l - 2. Assémien Déhylé, roi du Sanwi ou la<br />
réhabilitation <strong>de</strong> l'organisation<br />
pol i t i que sanwi p . 5 l<br />
II - Les sources <strong>de</strong> l'engagement <strong>de</strong> B. Dadié<br />
II - 1. La réorientation <strong>de</strong> B. Dadié<br />
vers <strong>le</strong> théâtre<br />
II - 2. La pérennité du thème <strong>de</strong> pouvoir<br />
dans <strong>le</strong> théâtre <strong>de</strong> B. Dadié<br />
Chapitre III - Le concept <strong>de</strong> pouvoir et ses<br />
différents aspects mis en scène<br />
l - Définition du concept <strong>de</strong> pouvoir<br />
l - 1. Généralité<br />
l - 2. Conception africaine du pouvoir<br />
l - 3. Conception akan du pouvoir<br />
l - 4. De la confusion <strong>de</strong>s pouvoirs<br />
II - Les différentes manifestations du pouvoir<br />
dans <strong>le</strong> théâtre <strong>de</strong> B. Dadié<br />
II - 1. Pouvoir néo-colonial<br />
II - 1. 1. Pouvoir néo-colonial civil<br />
II - 1. 2. Pouvoir néo-colonial militaire<br />
II - 2. Pouvoir bureaucratique<br />
p. 62<br />
p. 64<br />
p. 68<br />
p. 70<br />
p. 72<br />
p. 77<br />
DEUXIEME PARTIE L'EXERCICE DU POUVOIR ET SA REMISE<br />
EN CAUSE<br />
Chapitre l - Le fonctionnement du pouvoir<br />
p. 78<br />
p. 80<br />
p. 93<br />
p. 110<br />
l - La stratification socia<strong>le</strong> dans <strong>le</strong>s oeuvres p. 130<br />
l - 1. La classe dominante p. 132<br />
l - 2. La classe dominée p. 133<br />
l - 3. La conquête du pouvoir p. 140<br />
II
.11 - La concentration du pouvoir<br />
III - La personnalisation du pouvoir<br />
III - 1. Le mécanisme <strong>de</strong> la personna<br />
lisation du pouvoir<br />
III - 2. Les moyens <strong>de</strong> renfort du<br />
pouvoir personnel<br />
III - 2. 1. La mystification<br />
p. 143<br />
p. 154<br />
p. 156<br />
p. 170<br />
III - 2. 2. La vio<strong>le</strong>nce p. 176<br />
Chapitre II - Devin et marabout: une fonction<br />
ambiguë auprès du pouvoir p. 185<br />
l - Définition p. 186<br />
l - 1. Subaka fin ou sorcier noir p. 187<br />
l - 2. Subaka gbè ou sorcier blanc p. 188<br />
II - Devin et marabout, supports du pouvoir<br />
politique p. 190<br />
III - Devin et marabout, <strong>de</strong>s contre-pouvoirs<br />
redoutés p. 202<br />
IV - Apport du personnage <strong>de</strong> <strong>de</strong>vin au théâtre<br />
<strong>de</strong> Dadié p. 212<br />
Chapitre III - La femme ou <strong>le</strong> véritab<strong>le</strong> contre-<br />
pouvoir dans <strong>le</strong> théâtre <strong>de</strong> Dadié p. 228<br />
l - La place historique <strong>de</strong> la femme auprès<br />
<strong>de</strong> l'homme politique p. 229<br />
l - 1. La femme, origine du pouvoir dans<br />
la société akan<br />
l - 2. La femme ou la dominante politique<br />
effacée<br />
II - La femme ou <strong>le</strong> contre-pouvoir dans <strong>le</strong><br />
théâtre <strong>de</strong> Dadié<br />
p. 232<br />
III<br />
p. 236
TROISIEME PARTIE: ESSAI D'ANALYSE CRITIQUE<br />
Chapitre r - La <strong>de</strong>struction <strong>de</strong>s dictatures<br />
r - Techniques dadiéennes <strong>de</strong> la critique<br />
r - l. L'utilisation <strong>de</strong> l'histoire<br />
r - l. l. Les anachronismes<br />
r - l. 2. Le parallélisme<br />
r - 2. L'exploitation <strong>de</strong>s aspects du<br />
théâtre traditionnel<br />
r - 3 . L'espace et <strong>le</strong> temps<br />
r - 3 . l. La structure du temps<br />
r - 3 . 2 . L'espace<br />
II - La dégradation du pouvoir<br />
II - 1. Itinéraire du héros dadiéen<br />
II - 2. Signification <strong>de</strong> la mort du héros<br />
Chapitre II - Idéologie et projet <strong>de</strong> société<br />
<strong>de</strong> Dadié<br />
l - L'idéologie <strong>de</strong> Dadié<br />
II - Le projet <strong>de</strong> société <strong>de</strong> Dadié<br />
II - 1. La direction idéologique<br />
II - 2. La direction dramatique<br />
III - Critique <strong>de</strong> l'idéologie dadiéenne<br />
BILAN ET PERSPECTIVES<br />
BIBLIOGRAPHIE<br />
p. 255<br />
p. 259<br />
p. 264<br />
p. 272<br />
p. 277<br />
p. 280<br />
p. 285<br />
p. 286<br />
p. 290<br />
p. 296<br />
p. 30 l<br />
p. 304<br />
p. 308<br />
p. 312<br />
p. 318<br />
p. 324<br />
IV
REMERCIEMENTS<br />
Tout au long <strong>de</strong> notre travail, nous avons été guidé,<br />
accompagné, suivi, aidé)soutenu par ceux qui ont accepté<br />
<strong>de</strong> nous apporter <strong>le</strong>ur soutien moral et matériel <strong>pour</strong><br />
l'élaboration <strong>de</strong> cette thèse. Au moment où nous soumet-<br />
tons notre mo<strong>de</strong>ste contribution à l'appréciation <strong>de</strong> nos<br />
Maîtres, nous ne pouvons que <strong>le</strong>ur adresser ces quelques<br />
mots <strong>de</strong> sincères remerciements en guise <strong>de</strong> notre profon<strong>de</strong><br />
reconnaissance.<br />
A notre Maître, <strong>le</strong> Professeur Jacques<br />
Scherer, qui a bien voulu accepter la<br />
direction <strong>de</strong> notre thèse et qui nous a<br />
toujours mis en confiance en trouvant<br />
<strong>de</strong>s remè<strong>de</strong>s à nos inquiétu<strong>de</strong>s et dont <strong>le</strong><br />
suivi et la constante disponibilité<br />
nous ont permis d'effectuer notre premier<br />
pas dans <strong>le</strong> champ <strong>de</strong> la recherche<br />
A Monsieur Kotchy Barthélémy, notre Maître<br />
à penser, qui n'a ménagé aucun effort<br />
<strong>pour</strong> nous apporter son ai<strong>de</strong> matériel<strong>le</strong><br />
et mora<strong>le</strong>, puisse ce "bourgeon" être <strong>le</strong><br />
symbo<strong>le</strong> <strong>de</strong> notre alliance intel<strong>le</strong>ctuel<strong>le</strong><br />
Aux vieux Sages <strong>de</strong> Krindjabo qui ont<br />
voulu qu'un enfant comme nous, ait eu<br />
l'audace <strong>de</strong> <strong>le</strong>s interroger sur <strong>le</strong>ur<br />
"Culture Mère"<br />
A nos amis Bamba Sou<strong>le</strong>ymane<br />
Bakayoko Karamoko, Diabaté<br />
Sékou, Bandjan Camara, Rokia<br />
Kouyaté, Diallo Sidiki, Roger<br />
Ohouot, qui restèrent un réseau<br />
fidè<strong>le</strong> d'informations
ABREVIATIONS<br />
Pour <strong>de</strong>s raisons pratiques, nous utiliserons tout<br />
au long <strong>de</strong> notre travail, <strong>le</strong>s abréviations suivantes se<br />
rapportant aux oeuvres théâtra<strong>le</strong>s ci-<strong>de</strong>ssous mentionnées.<br />
Thôgô-gnini Monsieur Thôgô-gnini<br />
Les Voix Les Voix dans <strong>le</strong> vent<br />
Béatrice Béatrice du Congo<br />
I<strong>le</strong>s I<strong>le</strong>s <strong>de</strong> tempête<br />
Assémien Assémien Déhylé<br />
Papassidi Papassidi maître escroc<br />
Mhoi-Ceul Mhoi-Ceul
4<br />
<strong>de</strong> son contexte africain que l'auteur ne prend jamais<br />
en compte, cette étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>vient un peu superficiel<strong>le</strong>.<br />
Excepté ce travail, aucune autre étu<strong>de</strong> n'envisage<br />
comme centre d'intérêt <strong>le</strong> thème du Pouvoir dans sa<br />
globalité, susceptib<strong>le</strong> d'être exploité à fond, uniquement<br />
dans l'ensemb<strong>le</strong> <strong>de</strong>s pièces théâtra<strong>le</strong>s <strong>de</strong> Dadié.<br />
Même si nos travaux ont <strong>de</strong>s points <strong>de</strong> rencontre,<br />
<strong>le</strong> nôtre se veut une analyse <strong>de</strong>s aspects caractéristiques<br />
du Pouvoir pris dans <strong>le</strong> contexte africain, afin <strong>de</strong> mieux<br />
cerner son mécanisme <strong>pour</strong> montrer sa dynamique. Mais<br />
quels sont <strong>le</strong>s facteurs déterminants qui nous ont guidé<br />
à jeter notre dévolu sur Bernard Dadié et plus particu-<br />
lièrement sur son théâtre?<br />
000<br />
Le choix <strong>de</strong> B. Dadié trouve sa source profon<strong>de</strong> dans<br />
notre formation scolaire; avec l'intégration <strong>de</strong> la litté-<br />
rature africaine au programme <strong>de</strong> l'enseignement, nous<br />
avons découvert l'écrivain à travers <strong>le</strong>s extraits <strong>de</strong><br />
Climbié et Le pagne noir, dans <strong>le</strong>s petits fascicu<strong>le</strong>s nommés<br />
Pages africaines, publiés par C.E.D.A. (1). Nous chantions<br />
<strong>le</strong>s noms <strong>de</strong>s écrivains comme Camara Laye, Aké Loba en<br />
signe d'admiration.<br />
Mais la découverte du théâtre <strong>de</strong> Dadié remonte à<br />
l'année 1969, alors élève <strong>de</strong> la classe <strong>de</strong> quatrième au<br />
Lycée Houphouët-Boigny <strong>de</strong> Korhogo, nous nous intéressions<br />
(1) Centre d'Edition et <strong>de</strong> Diffusion Africaine à<br />
Abidjan (C.E.D.A.)
6<br />
Bandiagara, Tierno Bokar, il s'agit <strong>pour</strong> Dadié <strong>de</strong><br />
"par<strong>le</strong>r aux gens à la mesure <strong>de</strong> <strong>le</strong>ur enten<strong>de</strong>ment".<br />
Nous ne saurons clôre cette motivation sans nous<br />
étendre un peu sur la pério<strong>de</strong> historique <strong>1966</strong>-<strong>1980</strong>, qui<br />
nous intéresse particulièrement <strong>pour</strong> notre travail.<br />
000<br />
Le choix <strong>de</strong> cette pério<strong>de</strong> revêt <strong>pour</strong> nous une doub<strong>le</strong><br />
signification. D'une part, c'est à partir <strong>de</strong> cette épo-<br />
que que nous avons connu <strong>le</strong>s écrits <strong>de</strong> Dadié, d'autre<br />
part, cette pério<strong>de</strong> marque notre ouverture vers <strong>le</strong> mon<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> la <strong>le</strong>cture. Mais au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> ces considérations person-<br />
nel<strong>le</strong>s, l'ère historique <strong>1966</strong>-<strong>1980</strong> a vu l'éclosion du<br />
théâtre ivoirien dans <strong>le</strong> vrai sens du terme. Depuis<br />
"novembre 1959, un arrêté officiel du gouvernement créait<br />
en Côte d'Ivoire l'Eco<strong>le</strong> d'Art Dramatique. Cette éco<strong>le</strong><br />
- signa<strong>le</strong> Touré - fut dirigée par Mme Jagu-Roche, secon-<br />
dée dans sa tâche par Ml<strong>le</strong> Wilt " (1). Après <strong>le</strong>s Indé-<br />
pendances, il faudra attendre l'arrivée <strong>de</strong> "Albert Botbol,<br />
expert <strong>de</strong> l'U.N.E.S.C.ü., à qui revient <strong>le</strong> doub<strong>le</strong> mérite<br />
d'avoir fait naître l'Institut National <strong>de</strong>s Arts en<br />
rassemblant et en formant <strong>de</strong> jeunes comédiens ivoiriens" (1)<br />
<strong>pour</strong> assister à la naissance véritab<strong>le</strong> du théâtre ivoirien.<br />
Selon un artic<strong>le</strong> publié dans Fraternité-Matin du 10 novem-<br />
bre <strong>1966</strong>, Albert Botbol affirmait avec vigueur l'orien-<br />
tation <strong>de</strong> l'Institut en écrivant que "l'Institut National<br />
<strong>de</strong>s Arts se propose <strong>de</strong> promouvoir l'avènement d'un réper-<br />
toire dramatique ivoirien, s'inspirant <strong>de</strong>s sources tradi-<br />
(1) Touré Aboubakar, Le théâtre négro-africain<br />
ou vérité esthétique, p. 158.<br />
paradoxe
7<br />
tionnel<strong>le</strong>s nationa<strong>le</strong>s et du patrimoine universel. Il Dans<br />
Naissance d'un théâtre, texte révélant la motivation<br />
profon<strong>de</strong> <strong>de</strong> Botbol, toute l'idéologie <strong>de</strong> la création<br />
d'un théâtre national est exprimée, ayant <strong>pour</strong> fonction<br />
essentiel<strong>le</strong>, la formation <strong>de</strong>s acteurs professionnels<br />
"dans <strong>le</strong>s différentes disciplines <strong>de</strong>s arts du spectac<strong>le</strong><br />
et d'offrir aux amateurs la tentation <strong>de</strong> la création<br />
artistique. Cel<strong>le</strong> - <strong>pour</strong>suit-il - <strong>de</strong> promouvoir un public,<br />
<strong>de</strong> répondre à son attente souvent informulée, <strong>de</strong> l'uti<strong>le</strong><br />
et du beau, et <strong>de</strong> faciliter la prise <strong>de</strong> conscience <strong>de</strong><br />
la place qui revient dans la Cité à cet art du témoignage<br />
actif et <strong>de</strong>_ la participation Il (1). C'est dans cette<br />
optique souligne Touré qu'lien septembre 1967, avec<br />
Georges Toussaint naît la première création <strong>de</strong> l'Eco<strong>le</strong><br />
<strong>de</strong> Théâtre: Monsieur Thôgô-gnini, oeuvre <strong>de</strong> Bernard<br />
Dadié. Le 30 septembre 1967 à Abidjan, la presse lVOl-<br />
rienne salua l'oeuvre comme un "authentique acte <strong>de</strong><br />
naissance" du théâtre national ivoirien. Jusqu'en 1969<br />
- <strong>pour</strong>suit Touré - l'Eco<strong>le</strong> <strong>de</strong> Théâtre ne fera que Monsieur<br />
Thôgô-gnini soit à Abidjan, soit surtout à l'intérieur<br />
<strong>de</strong> la Côte d'Ivoire, aussi à l'extérieur dans <strong>le</strong>s pays<br />
africains vois ins " (2). Mais <strong>le</strong>s activités ne s' arrête-<br />
ront pas là, malgré <strong>le</strong> délaissement affiché volontairement<br />
par <strong>le</strong>s responsab<strong>le</strong>s politiques et administratifs qui<br />
(1) Albert Botbol, Naissance d'un théâtre, monographie<br />
<strong>de</strong> l'I.N.A.<br />
(2) Touré A., op. cit., p. 164-165.
B<br />
n'ont point d'yeux <strong>pour</strong> cet art <strong>de</strong> la scène. En 1971-<br />
1972, "Jean Favarel instaure <strong>pour</strong> la première fois à<br />
Abidjan et partout en Côte d'Ivoire une saison théâtra<strong>le</strong><br />
fournie et régulière... <strong>de</strong> décembre 1971 à juin 1972" (1)<br />
Il faut souligner avec J.F. Eyou "qu'incontestab<strong>le</strong>ment,<br />
la pério<strong>de</strong> comprise entre 1972 et 1979 est la plus riche<br />
du théâtre i voir ien <strong>de</strong>s Indépendances " (2) . Cette pério-<br />
<strong>de</strong>, selon Bernard Ahua "connaîtra d'une part un regain<br />
d'activités <strong>de</strong>s troupes privées, et d'autre part, un<br />
déploiement en force <strong>de</strong> toute une génération <strong>de</strong> dramatur-<br />
ges - comme - Zadi Zaourou, Sou<strong>le</strong>ymane Koly, Miézan<br />
Bognini, Amadou Koné, Kourouma Moussa, etc ... " (2).<br />
Signalons au passage que <strong>le</strong> mois d'avril 1979 a vu la<br />
fermeture <strong>de</strong> l'Eco<strong>le</strong> <strong>de</strong> Théâtre, suite au refus d'un<br />
statut intégrant <strong>le</strong>s enseignants et <strong>le</strong>s comédiens à la<br />
Fonction Publique. Aucune autre raison n'est évoquée<br />
<strong>pour</strong> justifier cette fermeture.<br />
Tous ces éléments ont retenu notre attention et<br />
motivent en gran<strong>de</strong> partie <strong>le</strong> choix <strong>de</strong> cette pério<strong>de</strong> (<strong>1966</strong>-<br />
<strong>1980</strong>), laquel<strong>le</strong> vit non seu<strong>le</strong>ment l'apogée du théâtre<br />
ivoirien, mais aussi celui <strong>de</strong> Dadié. Après <strong>le</strong> succès <strong>de</strong><br />
Monsieur Thôgô-gnini, "<strong>le</strong> seigneur <strong>de</strong>s <strong>le</strong>ttres ivoirien-<br />
nesN<strong>pour</strong> reprendre une expression <strong>de</strong> R. Cornevin, publie-<br />
ra successivement cinq pièces <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> envergure.<br />
Plongeant dans la tradition, cel<strong>le</strong>s-ci prolongent<br />
(1) Touré A., op. cit., pp. 164-165.<br />
(2) B. Ahua, "Séminaire sur <strong>le</strong> théâtre ivoirien", in<br />
Fraternité-Matin <strong>de</strong>s 8 et 9 mai 1982, pp. 23-24.
Î Î<br />
sociologiques. Ainsi avons-nous exploité <strong>de</strong>s écrits<br />
théoriques d'auteurs <strong>de</strong> toutes tendances et <strong>de</strong> critiques<br />
d'art dramatique, <strong>de</strong>s artic<strong>le</strong>s <strong>de</strong> journaux, <strong>de</strong> périodi-<br />
ques se rapportant au théâtre, au thème du Pouvoir et<br />
aux oeuvres <strong>de</strong> Dadié.<br />
Nous avons emprunté à toutes <strong>le</strong>s métho<strong>de</strong>s "tout<br />
en acceptant que <strong>le</strong> critique s'informe <strong>de</strong> toutes <strong>le</strong>s<br />
métho<strong>de</strong>s utilisées <strong>pour</strong> <strong>le</strong>s autres littératures, qu'il<br />
puisse s'en inspirer ... " (1). Mais il faut insister ici<br />
sur <strong>le</strong> fait que nous ne perdrons jamais <strong>de</strong> vue dans<br />
notre analyse, <strong>le</strong> fonds <strong>de</strong> culture et <strong>de</strong> civilisation<br />
ora<strong>le</strong>s sur <strong>le</strong>quel repose toute la production théâtra<strong>le</strong><br />
<strong>de</strong> B. Dadié. Car nous savons que "<strong>le</strong>s métho<strong>de</strong>s critiques<br />
nouvel<strong>le</strong>s que l'Occi<strong>de</strong>nt applique à sa propre littérature<br />
sont jugées intéressantes quant à <strong>le</strong>ur objet mais insuf-<br />
fisantes <strong>pour</strong> rendre compte <strong>de</strong> tous <strong>le</strong>s aspects d'une<br />
oeuvre africaine" (1). Par peur d'embriga<strong>de</strong>r notre<br />
étu<strong>de</strong> dans une métho<strong>de</strong> systématique, noUS avons plutôt<br />
fait une synthèse <strong>de</strong> cel<strong>le</strong>s qui pouvaient nous servir<br />
à rendre plus explicite notre démarche.<br />
Depuis <strong>1980</strong>, conciliant notre fonction d'enseignant<br />
et <strong>de</strong> chercheur, nous avons col<strong>le</strong>cté <strong>de</strong>s informations<br />
sur <strong>le</strong> thème du Pouvoir dans la société Agni qui nous<br />
intéresse. Soucieux <strong>de</strong> donner une interprétation fidè<strong>le</strong><br />
au mot Pouvoir, nous nous sommes rendus sur <strong>le</strong> terrain<br />
à Krindjabo, capita<strong>le</strong> <strong>de</strong> l'ancien royaume Sanwi (région<br />
(1) Présence Africaine : Le critique africain et son<br />
peup<strong>le</strong> comme producteur <strong>de</strong> civilisation, Colloque<br />
<strong>de</strong> Yaoundé, p. 13.
12<br />
qui a vu naître Dadié) afin <strong>de</strong> poser <strong>de</strong>s questions<br />
précises sur <strong>le</strong> rapport Pouvoir / Féticheur <strong>le</strong>s mardi<br />
17 et mercredi 18 février 1981, pendant <strong>le</strong>s congés <strong>de</strong><br />
printemps. Nous en &tions à notre quatrième voyage. Cette<br />
col<strong>le</strong>cte empirique auprès <strong>de</strong>s grands notab<strong>le</strong>s fut fruc<br />
tueuse. El<strong>le</strong> nous a permis malgré <strong>le</strong>s barrières linguis<br />
tiques <strong>de</strong> déce<strong>le</strong>r une partie du mystère qui entoure<br />
<strong>le</strong> Pouvoir du chef. Par manque <strong>de</strong> technique d'enquête<br />
en matière <strong>de</strong> traditions ora<strong>le</strong>s, nous ne disposions que<br />
d'un petit magnétophone à cassettes, <strong>le</strong>quel fut<br />
accepté souvent avec beaucoup <strong>de</strong> méfiance, car <strong>le</strong> sujet<br />
était choquant. Il faut noter que cette région <strong>de</strong> la<br />
Côte d'Ivoire reste profondément éprouvée par ce qui<br />
fut appelé "l'Affaire du Sanwi". Sur <strong>le</strong> Royaume Sanwi<br />
la thèse <strong>de</strong> Diabaté Henriette nous a profusément éclairé<br />
par d'importantes informations sur <strong>le</strong> Pouvoir.<br />
Au niveau <strong>de</strong> la documentation, nos problèmes furent<br />
nombreux. Sur Dadié, nous l'avons déjà souligné, peu<br />
d'ouvrages critiques existent. Le théâtre africain con<br />
temporain souffre d'une grave pénurie <strong>de</strong> travaux critiques<br />
capab<strong>le</strong>s d'ai<strong>de</strong>r <strong>le</strong> chercheur. A notre connaissance,<br />
jusqu'à présent, il n'existe que trois ouvrages <strong>de</strong> réfé<br />
rence indispensab<strong>le</strong>s :<br />
- l'ouvrage <strong>de</strong> Bakary Traoré publié en 1958 chez<br />
Présence Africaine sous <strong>le</strong> titre Le théâtre négro-africain<br />
et ses fonction socia<strong>le</strong>s, qui est une étu<strong>de</strong> sociologique<br />
au <strong>de</strong>meurant plus théorique que critique;<br />
- <strong>le</strong> second est celui <strong>de</strong> Robert Cornevin publié en
13<br />
1970 chez <strong>le</strong> Livre Africain, intitulé Le théâtre en<br />
Afrique noire et à Madagascar, qui paraît être un bilan<br />
historique, traçant <strong>le</strong>s premiers jalons <strong>pour</strong> la (re)décou<br />
verte du théâtre négro-africain dans son ensemb<strong>le</strong>;<br />
- <strong>le</strong> <strong>de</strong>rnier <strong>pour</strong> <strong>le</strong> moment est un recueil d'étu<br />
<strong>de</strong>s publié chez Présence Africaine, rassemblant <strong>le</strong>s<br />
travaux du Colloque d'Abidjan sur <strong>le</strong> théâtre africain,<br />
sous <strong>le</strong> titre Le théâtre négro-africain, Actes du Collo<br />
que d'Abidjan 1970.<br />
Toutes <strong>le</strong>s autres étu<strong>de</strong>s traitant du théâtre africain<br />
en général, ne sont que <strong>de</strong>s artic<strong>le</strong>s épars, insérés sou<br />
vent dans <strong>de</strong>s ouvrages généraux sur la littérature<br />
africaine ou <strong>de</strong>s textes isolés, publiés dans certains<br />
périodiques (dont certains n'existent plus) ou quoti<br />
diens locaux, qui, très souvent laissent <strong>le</strong> chercheur<br />
sur sa soif, car ces travaux sont parfois l'oeuvre <strong>de</strong><br />
"critiques" journalistes qui connaissent mal <strong>le</strong>s oeuvres;<br />
et certains <strong>de</strong> ces critiques bril<strong>le</strong>nt souvent par <strong>le</strong>ur<br />
ignorance <strong>de</strong>s lois et métho<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la représentation <strong>de</strong>s<br />
pièces théâtra<strong>le</strong>s. Même si nous avons reçu <strong>de</strong>s documents<br />
<strong>de</strong> l'I.F.A.N. <strong>de</strong> Dakar et <strong>de</strong>s Archives Nationa<strong>le</strong>s <strong>de</strong><br />
notre pays, notre tâche ne fut pas <strong>pour</strong> autant faci<strong>le</strong>.<br />
000<br />
Pour élaborer notre thèse, qui ne se veut point<br />
exhaustive, nous avons été orienté par <strong>le</strong>s démarches<br />
suivantes<br />
- la première consistera à étudier d'abord <strong>le</strong>s<br />
contextes socio-historique et politico-culturel <strong>de</strong>s
14<br />
oeuvres choisies, car nous pensons avec <strong>le</strong> Professeur<br />
NGal que "... <strong>le</strong>s rapports entre création et culture<br />
sont spécifiques: la culture n'est pas un simp<strong>le</strong> décor<br />
extérieur, un cadre permettant à la création <strong>de</strong> se<br />
déployer. Toute.création - <strong>pour</strong>suit-il - tout comme <strong>le</strong><br />
langage à partir duquel el<strong>le</strong> prend naissance, est une<br />
réalité <strong>de</strong> culture. On ne peut donc séparer la littéra-<br />
ture du milieu culturel. Prétendre qu'on peut cerner<br />
la création littéraire en l'isolant du contexte dont il<br />
dépend est certainement illusoire. L'oeuvre naît dans<br />
et à partir <strong>de</strong> la culture. (... ) par <strong>le</strong> contenu qu'il<br />
développe, l'artiste "dépend" <strong>de</strong> la culture dans laquel<strong>le</strong>-<br />
il vit. La culture - conclut NGal - lui fournit <strong>de</strong>s<br />
"déjà-là" auxquels il va donner <strong>de</strong>s variations indivi-<br />
duel<strong>le</strong>s appelées communément cachet individuel. Et c'est<br />
ce cachet individuel qui constitue la littérature" (1)<br />
Refuser <strong>de</strong> prendre en charge ce contexte, <strong>pour</strong> toute<br />
approche critique, c'est nier l'essence qui fait l'oeuvre<br />
théâtra<strong>le</strong> <strong>de</strong> Dadié. Notre démarche se veut donc SOCIO-CRITIQUE,<br />
mais pas systématique dans son application.<br />
- Dans un second temps, nous définirons <strong>le</strong> thème<br />
du Pouvoir en <strong>le</strong> plaçant dans son contexte africain. Puis,<br />
nous nous interrogerons sur <strong>le</strong>s différents aspects du<br />
Pouvoir mis en scène, à partir <strong>de</strong>squels nous abor<strong>de</strong>rons<br />
(1) M. A. n , NGal :"L'artiste africain: tradition,<br />
cr i tique et 1 iberté créatric e ," in Colloque <strong>de</strong> Yaoundé<br />
1977, pp. 57-58.
15<br />
l'étu<strong>de</strong> du chef politique dans ses rapports avec <strong>le</strong>s<br />
masses. Dans cette perspective, nous ne <strong>pour</strong>rons séparer<br />
<strong>le</strong> Pouvoir <strong>de</strong> son corollaire religieux, dans la mesure<br />
où ce <strong>de</strong>rnier semb<strong>le</strong> être exploité à <strong>de</strong>s fins politiques.<br />
Cela nous amènera à analyser <strong>le</strong>s liens Pouvoir / Devin.<br />
- Enfin, nous étudierons un chapitre non moins<br />
important la femme et <strong>le</strong> Pouvoir, avant <strong>de</strong> dégager <strong>le</strong><br />
projet <strong>de</strong> société <strong>de</strong> l'auteur.<br />
Pour conclure cette brève introduction, signalons<br />
que notre travail s'efforce avant tout <strong>de</strong> mettre en<br />
lumière <strong>le</strong>s mécanismes du Pouvoir critiqué par Dadié,<br />
et la vision prophétique qui s'en dégage. Le théâtre<br />
étant une sorte d'exploration <strong>de</strong> la vision du mon<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> l'être humain, exploration <strong>de</strong> la vie, .<strong>de</strong>s us et cou<br />
tumes <strong>de</strong>s peup<strong>le</strong>s, tout ethnocentrisme est à écarter<br />
<strong>de</strong> nos conclusions.<br />
Notre travail <strong>de</strong> recherche a <strong>pour</strong> objectif fondamen<br />
tal <strong>de</strong> sou<strong>le</strong>ver <strong>de</strong>s questions sur un thème comp<strong>le</strong>xe qui<br />
domine l'ensemb<strong>le</strong> <strong>de</strong>s oeuvres théâtra<strong>le</strong>s <strong>de</strong> Bernard<br />
Dadié. Et notre souhait ar<strong>de</strong>nt serait que <strong>le</strong>s conclusions<br />
<strong>de</strong> notre mo<strong>de</strong>ste contribution, puissent servir à <strong>de</strong>s<br />
chercheurs qui <strong>le</strong>s prolongeront.
PREMIERE PARTIE<br />
CONTEXTE SOCIO-HISTORIQUE ET<br />
CONCEPT DE POUVOIR
16<br />
Cette première partie s'ouvre sur un chapitre qui<br />
nous a paru nécessaire dans la mesure où, son étu<strong>de</strong> nous<br />
permettra d'appréhen<strong>de</strong>r non seu<strong>le</strong>ment <strong>le</strong>s éléments réfé<br />
rentiels, mais aussi <strong>le</strong>s événements qui ont marqué Dadié<br />
et dont nous trouvons quelques traces dans <strong>le</strong>s écrits<br />
du dramaturge. Il faut en tenir compte d'une part, parce<br />
que ceux-ci peuvent nous apporter <strong>de</strong> profonds éclaircis<br />
sements sur <strong>le</strong> contenu <strong>de</strong>s oeuvres <strong>de</strong> l'auteur, d'autre<br />
part, parce que nous pensons que tout artiste étant<br />
membre d'une société, ne peut être étudié en <strong>de</strong>hors <strong>de</strong><br />
cel<strong>le</strong>-ci. Partant <strong>de</strong> cette hypothèse, notre étu<strong>de</strong> peut<br />
s'étendre à l'ensemb<strong>le</strong> du milieu dont l'écrivain est<br />
issu et dans <strong>le</strong>quel il a vécu. Nous n'entendons pas<br />
faire ici oeuvre d'historien ou <strong>de</strong> géographe, mais nous<br />
tenterons une approche analytique <strong>de</strong> ce "passé récent"<br />
<strong>de</strong> Bernard Dadié afin d'apporter <strong>de</strong>s élémen±s précieux<br />
qui permettront la compréhension <strong>de</strong> notre travail.<br />
Dans cette optique, nous jeterons premièrement un<br />
bref coup d'oeil sur <strong>le</strong> mon<strong>de</strong> Sanwi par <strong>le</strong> biais <strong>de</strong> son<br />
histoire, <strong>de</strong> son économie et <strong>de</strong> son organisation poli<br />
tique d'antan. Dans un <strong>de</strong>uxième temps, nous nous inter<br />
rogerons sur <strong>le</strong>s événements que <strong>le</strong> Sanwi a vécus; enfin,<br />
nous verrons <strong>le</strong>s influences possib<strong>le</strong>s <strong>de</strong> tous ces faits<br />
sur la production littéraire <strong>de</strong> l'auteur.<br />
D'abord, faisons la connaissance <strong>de</strong> Bernard B. Dadié.
17<br />
PRESENTATION DE L'AUTEUR<br />
Né en 1916 à Assinie, dans la région Sud-Est <strong>de</strong> la<br />
Côte d'Ivoire, Bernard Dadié est Agni-Nzima, groupe<br />
ethnique qui fournit <strong>le</strong> premier intel<strong>le</strong>ctuel diplômé<br />
d'Etu<strong>de</strong>s Supérieures <strong>de</strong> Côte d'Ivoire. Les premiers <strong>le</strong>ttrés<br />
<strong>de</strong> cette partie du territoire seront formés par <strong>le</strong>s<br />
Missions d'Assynie et <strong>de</strong> Grand-Bassam. Dadié fut l'élève<br />
<strong>de</strong> l'E.P.S. <strong>de</strong> Bingervil<strong>le</strong> et <strong>de</strong> la section administrative<br />
<strong>de</strong> l'Eco<strong>le</strong> Norma<strong>le</strong> William Ponty <strong>de</strong> Gorée (Sénégal).<br />
Contre la volonté d'un père qui désirait faire <strong>de</strong><br />
lui "un mé<strong>de</strong>cin, profession fort lucrative" (1), Dadié,<br />
<strong>pour</strong> <strong>de</strong>s raisons personnel<strong>le</strong>s, car il ne pouvait "... sup<br />
porter la vue du sang, moins encore l'o<strong>de</strong>ur spécia<strong>le</strong> <strong>de</strong>s<br />
hôpitaux d'alors", va s'orienter vers <strong>de</strong>ux voies:<br />
"l'Enseignement et l'Administration. L'Enseignement,<br />
signa<strong>le</strong>-t-il, fut éliminé en 1932, quand, lors <strong>de</strong> la<br />
première Fête d'Enfance, je vis gif<strong>le</strong>r l'instituteur qui<br />
nous conduisait. M'étant tourné vers l'Administration,<br />
je souhaitais, à ma sortie, pouvoir travail<strong>le</strong>r dans une<br />
bibliothèque. J'eus la chance, <strong>pour</strong>suit Dadié, d'être<br />
affecté à Dakar à l'Inspection Généra<strong>le</strong> <strong>de</strong> l'Enseignement<br />
<strong>pour</strong> être ensuite mis à la disposition <strong>de</strong> M. André<br />
Villard, jeune archiviste-paléographe, qui venait d'être<br />
recruté <strong>pour</strong> la réorganisation <strong>de</strong>s services <strong>de</strong>s Archives<br />
et <strong>de</strong> la Bibliothèque du Gouvernement" (1). De 1936 à<br />
(1) C. Quillateau, op. cit., pp. 149-150.
1 8<br />
à 1947, Dadié va travail<strong>le</strong>r à l'I.F.A.N. <strong>de</strong> Dakar.<br />
En 1947, il rentre en Côte d'Ivoire <strong>pour</strong> prendre<br />
part aux luttes émancipatrices <strong>de</strong> son pays. Délégué<br />
à la presse et au Comité Directeur du P.D.C.I.- R.D.A. -<br />
parti <strong>de</strong> lutte <strong>de</strong> Côte d'Ivoire - l'écrivain se fera<br />
remarquer par la vio<strong>le</strong>nce du verbe et son acharnement<br />
contre l'injustice et la servitu<strong>de</strong>. Le 6 février 1949,<br />
à la suite d'une altercation avec <strong>le</strong> Pouvoir colonial,<br />
Dadié et sept membres du Comité Directeur sont arrêtés<br />
et incarcérés à la prison <strong>de</strong> Bassam. De cette prison,<br />
naîtront poèmes, artic<strong>le</strong>s divers et un précieux ouvrage<br />
retraçant cet événement : Carnet <strong>de</strong> prison (1); dans<br />
l'introduction <strong>de</strong> cet écrit, Dadié affirme son désir<br />
en <strong>de</strong>s termes clairs "Nous souhaitons que ce livre<br />
né en prison donne à celui qui <strong>le</strong> touchera, 2 celui qui<br />
<strong>le</strong> feuil<strong>le</strong>tera, à celui qui <strong>le</strong> lira, <strong>le</strong> goût <strong>de</strong> la plé-<br />
nitu<strong>de</strong>, la soif <strong>de</strong> la liber té" et surtou t la haine <strong>de</strong><br />
l'arbitraire" (1). Le séjour en prison meubla l'expé-<br />
rience<strong>de</strong> Dadié. Cette <strong>de</strong>rnière lui servira d'arme <strong>pour</strong><br />
<strong>le</strong>s luttes futures "Je viens, écrira-t-il, <strong>de</strong> vivre<br />
un autre aspect <strong>de</strong> la vie. Très instructif et riche en<br />
expérience. Mes adversaires politiques m'ont enrichi<br />
sans <strong>le</strong> vouloir et sans <strong>le</strong> savoir. J'ai compris ce que<br />
sont Pouvoir et Justice " (1).<br />
Après sa libération, Oadié travail<strong>le</strong>ra d'abord à<br />
(1) Bernard Oadié, Carnet <strong>de</strong> prison, Abidjan, C.E.O.A.,<br />
1981, pp. 15-185.
20<br />
- Ministre <strong>de</strong>s Affaires Culturel<strong>le</strong>s <strong>de</strong> Côte d'Ivoi<br />
re <strong>de</strong>puis <strong>le</strong> 20 juil<strong>le</strong>t 1977,<br />
- Directeur <strong>de</strong> la Commission Nationa<strong>le</strong> <strong>de</strong> la Fonda<br />
tion Félix Houphouët-Boigny (Institut Africain<br />
<strong>de</strong> Recherches Historiques et Politiques) ,<br />
Romancier, poète et dramaturge, B. Dadi6 est auteur <strong>de</strong><br />
plusieurs ouvrages dont ceux qui feront l'objet <strong>de</strong><br />
notre analyse. Après cette rapi<strong>de</strong> présentation <strong>de</strong> l'écri<br />
vain, pénétrons maintenant <strong>le</strong> milieu socio-culturel qui<br />
l'a mo<strong>de</strong>lé.
25<br />
80.000 habitants" (1). C'est dans ce cadre enchanteur<br />
qu'est né Bernard Dadié. Certains poèmes <strong>de</strong> l'écrivain<br />
ivoirien chantent la beauté <strong>de</strong>s lagunes miroitantes<br />
<strong>de</strong> cette région.<br />
l - 2. Aspects économiques <strong>de</strong> la région<br />
Le pays Sanwi, région au sol riche, outre <strong>le</strong>s cul-<br />
tures vivrières taros, maniocs, ignames, banane plantain,<br />
a vu se développer <strong>le</strong>s cultures extensives d'exportation<br />
tel<strong>le</strong>s <strong>le</strong> café, <strong>le</strong> cacao et l'ananas. Selon <strong>le</strong>s chiffres<br />
avancés par <strong>le</strong> Ministère <strong>de</strong> l'Agriculture en 1979, la<br />
région produit environ 53% du café et du cacao et plu?<br />
<strong>de</strong> 80% <strong>de</strong>s bananes et <strong>de</strong>s ananas. Au niveau <strong>de</strong> l'infra-<br />
structure routière, "<strong>le</strong> réseau <strong>de</strong> communications est <strong>de</strong>nse<br />
et la mise en va<strong>le</strong>ur ancienne. Le pays Akan est, signa<strong>le</strong><br />
Samir Amin, par excel<strong>le</strong>nce <strong>le</strong> pays <strong>de</strong>s plantations afri-<br />
caines riches, faisant appel à <strong>de</strong> la main d'oeuvre<br />
salariée immigrée... " (2). C'est aussi l'aire <strong>de</strong> la<br />
civilisation <strong>de</strong> l'igname qui est l'aliment <strong>de</strong> base et<br />
qui, en tant que tel, fait l'objet d'un culte très impor-<br />
tant, théâtralisant la société entière dans une grandiose<br />
manifestation annuel<strong>le</strong> : la Fête <strong>de</strong>s Ignames.<br />
Le sous-sol est riche en or. Selon <strong>le</strong> témoignage <strong>de</strong><br />
Diabaté H., "<strong>le</strong>s Agni qui pratiquaient déjà l'orpaillage<br />
(1) Diabaté Henriette, La formation du Royaume Sanwi<br />
(1700-1843), T.lo, p. 15.<br />
(2) Samir Amin, op. cit., p. 20.
28<br />
]0 <strong>le</strong>s sociétés <strong>de</strong> démocratie villageoise, sans<br />
chefferie, ni Etat, qui englobent <strong>le</strong>s sociétés à<br />
classes d'âge du Sud-Est (Adioukrou, Ebrié, Attié,<br />
etc... ) et <strong>le</strong>s sociétés sans classes d'âge du<br />
groupe dit Krou (Bété, Dida, Godié, Bakwé, Néyo,<br />
etc... ) ." (1)<br />
Les Agni du Sanwi appartiennent à la première catégorie<br />
<strong>de</strong> ce classement. Ils formaient une structure socia<strong>le</strong><br />
bien stratifiée, fondée sur "la parenté utérine et <strong>le</strong><br />
caractère sacré <strong>de</strong> la royauté, avec ses "tabourets<br />
fétiches", sa cour, ses ornements d'or, ses anciens<br />
sacrifices... , symbo<strong>le</strong>s d'une brillante civilisation." (2)<br />
l - 4. La monarchie aristocratique Agni<br />
Peup<strong>le</strong> commun à la Côte d'Ivoire et au Ghana, <strong>le</strong>s<br />
Akan "pratiquent en général <strong>le</strong> matrilignage et ont <strong>de</strong>s<br />
clans et <strong>de</strong>s groupes <strong>de</strong> <strong>de</strong>scendants qui s'i<strong>de</strong>ntifient<br />
par <strong>le</strong>s mêmes symbo<strong>le</strong>s totémiques dans toute l'aire<br />
culturel<strong>le</strong> akan. (... ) ils révèrent <strong>le</strong>s ancêtres <strong>de</strong> <strong>le</strong>ur<br />
lignage dans <strong>le</strong> cadre <strong>de</strong> <strong>le</strong>urs pratiques religieuses,<br />
qui sont fondées sur une cosmologie traditionnel<strong>le</strong> dans<br />
laquel<strong>le</strong> l'homme serait en contact permanent avec <strong>le</strong>s<br />
ancêtres, une multitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> dieux secondaires et un Etre<br />
suprême qui serait <strong>le</strong> créateur du mon<strong>de</strong>. (... ) Les insti-<br />
tutions politiques akan portent la marque d'un modè<strong>le</strong><br />
(1) N. Kotchy et H. Memel-Foté, "La critique dans l'Afrique<br />
traditionnel<strong>le</strong>", lli Colloque <strong>de</strong> Yaoundé 1977, p. 156.<br />
(2) H. Deschamps, op. cit., p. 8.
29<br />
commun. Chaque village, groupe <strong>de</strong> villages ou Etat est<br />
dirigé par un chef et un groupe <strong>de</strong> conseil<strong>le</strong>rs représen-<br />
tant <strong>le</strong> peup<strong>le</strong>. En tant qu'institution politique cen-<br />
tra<strong>le</strong>, la chefferie a survécu à <strong>de</strong> nombreux changements<br />
radicaux et sa réputation se maintient en bonne place<br />
dans l'échel<strong>le</strong> <strong>de</strong>s va<strong>le</strong>urs ... " (1).<br />
A l'origine <strong>de</strong> l'histoire akan, la gran<strong>de</strong> tribu<br />
était concentrée entre <strong>le</strong>s mains d'un roi unique. Mais<br />
ce roi, note <strong>le</strong> Professeur Niangoran Bouah "n'exerce pas<br />
son Pouvoir <strong>de</strong> façon absolue; quoique divinisé, ce n'est<br />
point l'individu qu'on respecte en lui, mais plutôt <strong>le</strong><br />
Pouvoir, c'est-à-dire la fonction du chef "(2). Le<br />
Professeur Niangoran cite à cette occasion <strong>le</strong>s vieux<br />
qui disent que "ce n'est pas l'individu que nous respec-<br />
tons, c'est parce que <strong>le</strong> Pouvoir est matérialisé qu'on<br />
<strong>le</strong> respecte." Hors <strong>de</strong> cette fonction, <strong>pour</strong>suit N. Bouah,<br />
l'individu n'est plus rien. Et ce Pouvoir lui a été donné<br />
par ses concitoyens... Cette autorité est symbolisée<br />
par <strong>le</strong> Siège Royal appelé BlA, qui est <strong>le</strong> symbo<strong>le</strong> <strong>de</strong><br />
l'Etat", l'équiva<strong>le</strong>nt actuel<strong>le</strong>ment du drapeau mais avec<br />
une connotation plus <strong>de</strong>nse <strong>de</strong> sens. Dans la société akan<br />
et plus particulièrement chez <strong>le</strong>s Sanwi, "<strong>le</strong> BlA (ou siège)<br />
est l'insigne par excel<strong>le</strong>nce du Pouvoir et <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong><br />
comman<strong>de</strong>ment... Diabaté Henriette explique plus loin que<br />
<strong>le</strong> BlA pose <strong>le</strong> problème général <strong>de</strong>s insignes du comman<strong>de</strong>-<br />
(l) George Hagan, "Le concept <strong>de</strong> pouvoir d ans la culture<br />
akan", in Le concept <strong>de</strong> pouvoir en Afrique, Les Presses<br />
<strong>de</strong> l'UNESCO, 1981, p. 56.<br />
(2) Niangoran Bouah, "Cours d'Anthropologie culturel<strong>le</strong>",<br />
licence L.M., Fac. <strong>de</strong> Lettres, Université d'Abidjan,<br />
1976.
33<br />
et tourner cel<strong>le</strong>s-ci en dérision par l'intermédiaire<br />
du théâtre. Conscients <strong>de</strong> la richesse du Sanwi, <strong>de</strong><br />
son histoire, certains intel<strong>le</strong>ctuels Agni vont choisir<br />
comme voie) la sécession en déc<strong>le</strong>nchant ce qui fut<br />
appelé "l'Affaire du Sanwi".<br />
II - LES EVENEMENTS RECENTS<br />
Au pays <strong>de</strong> B. Dadié, ce ne sont pas <strong>le</strong>s événements<br />
qui manquent. Tous peuvent permettre aux écrivains aver<br />
tis d'y puiser <strong>de</strong>s éléments <strong>pour</strong> étoffer <strong>le</strong>urs écrits.<br />
Parmi ces faits récents, nous ne retiendrons que <strong>de</strong>ux<br />
qui ont marqué la pério<strong>de</strong> historique que nous avons<br />
choisie comme tréfonds aux pièces du dramaturge ivoirien.<br />
D'abord, ce qui fut appelé "l'Affaire Sanwi", puis "<strong>le</strong><br />
complot <strong>de</strong> 1962-1963" et <strong>le</strong>s petits mouvements qui ont<br />
émaillé toute l'ère <strong>de</strong> <strong>1966</strong> à <strong>1980</strong>. L'évocation <strong>de</strong> ces<br />
faits, nécessité oblige, permettra au critique d'al<strong>le</strong>r<br />
au-<strong>de</strong>là du texte théâtral <strong>de</strong> Dadié, <strong>pour</strong> justifier cer<br />
taines affirmations sur <strong>de</strong>s traits pertinents puisés dans<br />
l'expérience <strong>de</strong> l'auteur. A ce propos, il faut signa<strong>le</strong>r<br />
que toutes <strong>le</strong>s pièces <strong>de</strong> Dadié à quelques exceptions près,<br />
tirent <strong>le</strong>ur substance <strong>de</strong> la vie quotidienne, <strong>de</strong> l'actua<br />
lité.<br />
II - 1. L'Affaire du Sanwi<br />
Cette affaire prend sa source dans l'histoire colo<br />
nia<strong>le</strong> <strong>de</strong> la Côte d'Ivoire. En effet, <strong>le</strong> Sanwi a été la<br />
zone favorite <strong>pour</strong> la pénétration française en Côte
34<br />
d'Ivoire. Et <strong>le</strong> Royaume Sanwi à cette époque était déjà<br />
un Etat bien structuré, ayant son organisation politique,<br />
économique et socia<strong>le</strong>. Selon Jacques Baulin, ancien<br />
Conseil<strong>le</strong>r à la Prési<strong>de</strong>nce <strong>de</strong> la République, "cette<br />
région constitue précisément <strong>le</strong> talon d'Achil<strong>le</strong> <strong>de</strong> la<br />
Côte d'Ivoire. Comme l'Iboland au Nigéria, <strong>pour</strong>suit<br />
Baulin, c'est une pépinière d'intel<strong>le</strong>ctuels." (1) Si l'on<br />
s'en tient à la thèse <strong>de</strong> Diabaté Henriette, cette "Affaire<br />
du Sanwi" serait l'acte "d'intel<strong>le</strong>ctuels Agni animés<br />
d'idéologie séparatiste tels Ehounou Bi<strong>le</strong>, Me Benzeme,<br />
Ernest Attié, Brou Quoiho, qui considéraient, en effet,<br />
que <strong>le</strong> traité signé <strong>le</strong> 4 juil<strong>le</strong>t 18t3 avec la France<br />
était non pas un traité <strong>de</strong> protectorat colonial, mais<br />
un traité <strong>de</strong> protectorat <strong>de</strong> gens qu'ils comparaient à<br />
celui qui régit <strong>le</strong>s rapports entre la France et la prin-<br />
cipauté <strong>de</strong> Monaco... Au moment <strong>de</strong> la signature du traité,<br />
note Diabaté, <strong>le</strong>s représentants <strong>de</strong> la France avaient<br />
négocié d'égal à égal avec <strong>le</strong>s autorités du Sanwi qui<br />
était déjà une entité territoria<strong>le</strong> dotée d'un gouverne-<br />
ment et qui possédait ses traditions et sa langue. Tant<br />
qu'ils <strong>de</strong>meuraient liés à la France, affirmaient <strong>le</strong>s<br />
séparatistes, <strong>le</strong> Sanwi et la Côte d'Ivoire avaient subi<br />
la même autorité, mais dès lors qu'il s'est agi <strong>de</strong> déci-<br />
<strong>de</strong>r <strong>de</strong> <strong>le</strong>ur autonomie, <strong>le</strong> Sanwi n'entendait pas voir la<br />
Côte d'Ivoire relayer la France; il voulait retourner<br />
à la situation d'avant 1843 ... " (2)<br />
(1) J. Baulin, La politique africaine d'Houphouët-Boigny,<br />
p. 23.<br />
(2) 0 iabaté H., op. cit., pp. 76- 7 7 .
35<br />
Les événements vont prendre une tournure amère<br />
<strong>pour</strong> <strong>le</strong> Sanwi et <strong>pour</strong> <strong>le</strong>s dissi<strong>de</strong>nts. Baulin signa<strong>le</strong><br />
que <strong>le</strong> "7 janvier 1959, toute la région est secouée<br />
par <strong>de</strong> vio<strong>le</strong>nts inci<strong>de</strong>nts et <strong>le</strong>ur cortège <strong>de</strong> tués, <strong>de</strong><br />
b<strong>le</strong>ssés, d'incendies. Le 12 février, <strong>le</strong> roi Sanwi<br />
Amon NDouffou III <strong>de</strong>man<strong>de</strong> la garantie <strong>de</strong> l'intégrité<br />
du territoire sanwi; à cette fin, remarque Baulin, il<br />
envoie <strong>le</strong> 1er mars <strong>de</strong>ux plénipotentiaires à Paris <strong>pour</strong><br />
rencontrer <strong>le</strong> Général <strong>de</strong> Gaul<strong>le</strong>. Le 12 avril suivant,<br />
contrairement au <strong>pour</strong>centage national, seuls 3.202<br />
é<strong>le</strong>cteurs sur 14.831 inscrits, participeront aux é<strong>le</strong>c<br />
tions législatives. Le3 mai 1959, c'est l'annonçe <strong>de</strong><br />
la constitution d'un "gouvernement du Sanwi". Ses pro<br />
moteurs, inculpés d'atteinte à la sûreté <strong>de</strong> l'Etat,<br />
sont <strong>pour</strong>suivis. Certains <strong>de</strong>s principaux responsab<strong>le</strong>s<br />
se réfugient au Ghana." (1) Selon beaucoup d'informateurs,<br />
la répression fut sévère; la protection par <strong>le</strong> gouverne<br />
ment Nkrumah <strong>de</strong>s dissi<strong>de</strong>nts Sanwi, lui vaudra la rupture<br />
tota<strong>le</strong> entre Accra et Abidjan. Le gouvernement provisoire<br />
en exil, émettait à partir du Ghana en direction <strong>de</strong> ceux<br />
qui n'avaient pas quitté <strong>le</strong> Sanwi. A ce propos, Baulin<br />
souligne que "M. Erneste Attié <strong>de</strong>venu "premier ministre"<br />
du Sanwi déclara <strong>le</strong> 8 février 1960 déclaration rapportée<br />
par "Radio Abidjan" "Nous sommes originaires du Ghana.<br />
Nous voulons nous réunifier avec... cet Etat Sanwi, Etat<br />
indépendant <strong>de</strong>puis trois cents ans, n'a pas été conquis<br />
par la France ou par Houphouët ... " (1)<br />
(1) J. Baulin, op. cit., pp. 23-24.
36<br />
Mais <strong>le</strong> cours <strong>de</strong>s faits historiques ne ménagera<br />
pas du tout <strong>le</strong>s dissi<strong>de</strong>nts. En <strong>1966</strong>, un coup d'état<br />
militaire renverse <strong>le</strong> Dr Nkrumah. Le "nouveau gouverne<br />
ment militaire, note Diabaté, dans un but <strong>de</strong> réconcilia<br />
tion avec la Côte d'Ivoire, renvoie par avion spécial<br />
tous <strong>le</strong>s dirigeants du mouvement sanwi qui s'etaient<br />
réfugiés au Ghana. A partir <strong>de</strong> ce moment, massivement ou<br />
par petits noyaux, <strong>le</strong>s autres émigrés se présentent aux<br />
frontières et regagnent <strong>le</strong>urs villages. Mais la réaction<br />
du représentant du gouvernement à Aboisso indispose<br />
tant certains d'entre eux qu'ils préfèrent repartir <strong>pour</strong><br />
<strong>le</strong> Ghana. En fait, <strong>pour</strong>suit Diabaté, <strong>le</strong>s retours défini<br />
tifs au Sanwi s'échelonnent entre 1970 et 1975. Dans<br />
certaines régions, <strong>le</strong>s ressentiments n'ont pas encore<br />
tota<strong>le</strong>ment disparu contre <strong>le</strong>s ennemis d'hier... et la<br />
crainte <strong>de</strong>s autorités gouvernementa<strong>le</strong>s est encore vive. "<br />
(1). Il faut ajouter à ces informations, que ce n'est<br />
qu'au <strong>de</strong>rnier semestre <strong>de</strong> l'année 1981 que <strong>le</strong>s grands<br />
dignitaires Agni <strong>de</strong> la région du Sanwi, sous la direc<br />
tion <strong>de</strong> certains intel<strong>le</strong>ctuels nouvel<strong>le</strong>ment intégrés au<br />
Pouvoir, sont venus chez <strong>le</strong> "père <strong>de</strong> la Nation" enterrer<br />
définitivement cette "Affaire". Le pardon <strong>le</strong>ur fut accor<br />
dé paternel<strong>le</strong>ment.<br />
Mais parallè<strong>le</strong>ment aux agitations créées par cette<br />
"Affaire Sanwi", d'autres événements sociaux menaçaient<br />
<strong>le</strong> calme tant souhaité par <strong>le</strong>s autorités politiques. Le<br />
plus important sera <strong>le</strong> fameux complot <strong>de</strong> 1962-1963 dont<br />
(1) Diabaté H., op. cit., p. 79.
39<br />
l'écrivain ivoirien, celui que Moune <strong>de</strong> Rivel apprécie<br />
en ces termes : "Cet écrivain ivoirien est un grand<br />
parmi <strong>le</strong>s grands <strong>de</strong> la littérature africaine contempo-<br />
raine. La pensée <strong>de</strong> Dadié, affirme-t-il, est claire,<br />
riche, dépouillée d'artifices, el<strong>le</strong> nous fait pénétrer<br />
directement dans un mon<strong>de</strong> vivant <strong>de</strong> traditions, un<br />
mon<strong>de</strong> qui apporte une sorte d'humanisme au tourbillon<br />
insolite vers <strong>le</strong>quel nous nous trouvons parfois entraînés<br />
malgré nous" (1). Successivement, Dadié va publier<br />
Monsieur Thôgô-gnini, Béatrice du Congo, Les voix dans<br />
<strong>le</strong> vent, I<strong>le</strong>s <strong>de</strong> tempête, Papassidi maître-escroc et<br />
enfin, plus récemment, Mhoi-Ceul qui n'épargne personne<br />
dans la critique.<br />
Toutes ces pièces font écho à l'expérience <strong>de</strong> l'au-<br />
teur et el<strong>le</strong>s plongent, malgré <strong>le</strong> voi<strong>le</strong> historique qui<br />
enveloppe certaines d'entre el<strong>le</strong>s, dans l'actualité.<br />
El<strong>le</strong>s épousent toutes l'époque <strong>de</strong> Dadié et traduisent<br />
<strong>le</strong>s problèmes cruciaux <strong>de</strong> l'Afrique contemporaine. Cela<br />
se justifie par <strong>le</strong> fait que <strong>le</strong> dramaturge ivoirien con-<br />
çoit que "chaque être doit s'exprimer lorsqu'il en sent<br />
la nécessité. Que ce soit par la musique, par la danse,<br />
en écrivant ou en peignant. Le conteur, l'artiste,<br />
affirme-t-il, a besoin <strong>de</strong> faire partager son émotion; il<br />
se raconte, il raconte son pays, son époque et l'image<br />
que cel<strong>le</strong>-ci grave en lui " (1). On comprendra peut-être<br />
à la lumière <strong>de</strong> cette affirmation, la nécessité <strong>pour</strong> <strong>le</strong><br />
(1) Moune <strong>de</strong> Rivel, "Bernard Dadié à bâtons rompus" .i!l<br />
Bingo n° 272, septembre 1975, pp. 32-33.
40<br />
chercheur <strong>de</strong> fouil<strong>le</strong>r minutieusement <strong>le</strong> contexte <strong>de</strong><br />
la production littéraire <strong>de</strong> Bernard Dadié.<br />
A ce sta<strong>de</strong> <strong>de</strong> notre recherche, on peut s'interroger<br />
sur la part <strong>de</strong>s influences possib<strong>le</strong>s <strong>de</strong>s éléments,<br />
qu'ils soient contextuels au niveau historique ou cul<br />
turels sur <strong>le</strong>s oeuvres théâtra<strong>le</strong>s <strong>de</strong> notre auteur. A<br />
partir <strong>de</strong> ces données, peut-être nous découvrirons <strong>le</strong>s<br />
sources profon<strong>de</strong>s <strong>de</strong> l'engagement <strong>de</strong> cet écrivain qui<br />
ne cesse <strong>de</strong> nous émouvoir.
43<br />
souvenirs et <strong>de</strong> découvertes Il (l).Le fon<strong>de</strong>ment même <strong>de</strong><br />
cette didactique s'ordonne autour <strong>de</strong> quatre éléments<br />
essentiels que Dadié classe ainsi<br />
"- la prévoyance appliquée à l'économie,<br />
- l'organisation politique,<br />
- <strong>le</strong>s traditions mora<strong>le</strong>s : pru<strong>de</strong>nce, hospitalité,<br />
politesse, discrétion, etc... ,<br />
la recherche <strong>de</strong> la connaissance et du développement<br />
artistique Il (l).<br />
Ces quatre pô<strong>le</strong>s qui constituent une sorte <strong>de</strong> dynamique<br />
<strong>de</strong>s oeuvres <strong>de</strong> Dadié, foisonnent partout et limitent<br />
souvent par <strong>le</strong>ur présence la part réservée à l'imaginaire<br />
<strong>de</strong> l'écrivain. L'auteur reste toujours animé par <strong>le</strong> souci<br />
constant <strong>de</strong> dire la réalité, <strong>le</strong>s faits vrais, <strong>le</strong>s faits<br />
<strong>de</strong> tous <strong>le</strong>s jours. Ce souci l'amène régulièrement peut<br />
être à recourir aux légen<strong>de</strong>s, <strong>pour</strong> faire passer son<br />
message.<br />
Mû par <strong>le</strong> but qu'il vise, l'écrivain met un accent<br />
particulier sur la fonction didactique <strong>de</strong> la légen<strong>de</strong><br />
en affirmant que "... dans tous <strong>le</strong>s pays <strong>le</strong>s légen<strong>de</strong>s<br />
concourent au même but, instruire <strong>le</strong>s enfants, <strong>le</strong>s hommes,<br />
<strong>le</strong>s instruire en <strong>le</strong>s amusant. rl importe, insiste Dadié,<br />
<strong>de</strong> souligner que dans l'esprit <strong>de</strong>s peup<strong>le</strong>s, du moins<br />
chez <strong>le</strong>s Africains, il n'y a guère <strong>de</strong> différence entre<br />
légen<strong>de</strong> et conte. La distinction doit provenir d'un souci<br />
récent <strong>de</strong> préciser <strong>le</strong>s genres. Ce qui compte <strong>pour</strong> <strong>le</strong><br />
(l) B. Dadi é, op. cit., pp. 165 à 167.
45<br />
Il ne faut pas voir dans ces propos une aspiration<br />
<strong>de</strong> Dadié à un certain passéisme anti-prDgressiste et<br />
rétrogra<strong>de</strong>. Il s'agit <strong>pour</strong> l'écrivain ivoirien d'élaguer<br />
<strong>le</strong>s éléments sclérosés <strong>de</strong> ce patrimoine culturel et <strong>de</strong><br />
revitaliser ceux qui sont dynamiques et susceptib<strong>le</strong>s <strong>de</strong><br />
fournir une nourriture culturel<strong>le</strong>, autonome et origina<strong>le</strong><br />
aux générations futures. Selon Dadié, en accomplissant<br />
cet acte d'analyse synthétique <strong>de</strong> notre fonds culturel,<br />
"nous saurons apporter aux autres ce que nos anciens<br />
nous ont légué. Nous <strong>le</strong> ferons avec ferveur puisant à<br />
p<strong>le</strong>ines mains dans ce sol prodigieusement riche <strong>de</strong> for<br />
mes, <strong>de</strong> sagesse que sont <strong>le</strong>s légen<strong>de</strong>s. Ainsi-nous voici<br />
amenés à nous affirmer et à nous défendre à la fois.<br />
Et nous n'y parviendrons, conclut Dadié, qu'en habillant<br />
notre fond <strong>de</strong> formes nouvel<strong>le</strong>s, après l'avoir enregis<br />
tré." (1)<br />
L'écrivain révè<strong>le</strong> ainsi l'un <strong>de</strong>s éléments <strong>de</strong> sa ou<br />
<strong>de</strong> ses sources d'inspiration. L'analyse profon<strong>de</strong> <strong>de</strong>s<br />
pièces théâtra<strong>le</strong>s <strong>de</strong> Dadié montre que cel<strong>le</strong>s-ci, au<br />
niveau <strong>de</strong> <strong>le</strong>ur structure, relèvent plus du conte drama<br />
tisé que du théâtre selon la signification que <strong>le</strong>s Occi<br />
<strong>de</strong>ntaux donnent à ce mot. Sur <strong>le</strong> plan <strong>de</strong> l'écriture<br />
romanesque ou théâtra<strong>le</strong>, l'écrivain ivoirien reste tri<br />
butaire dans une large mesure du conteur traditionnel<br />
agni.<br />
(1) B. Dadié, op. cit., pp. 173-174.
46<br />
Les propos <strong>de</strong> Dadié sont révélateurs sur ce plan<br />
"Tout ce que j'ai publié, dit-il, ce sont <strong>de</strong>s poèmes,<br />
<strong>de</strong>s contes, <strong>de</strong>s récits, <strong>de</strong>s nouvel<strong>le</strong>s. Je dis récits<br />
et mieux encore <strong>de</strong>s réf<strong>le</strong>xions sur <strong>le</strong>s cultures <strong>de</strong>s<br />
peup<strong>le</strong>s. Climbié est <strong>le</strong> premier. Un Nègre à Paris en est<br />
un... Paris à la loupe, La vil<strong>le</strong> où nul ne meurt, Patron<br />
<strong>de</strong> New-York. En tout cas, ce ne sont pas <strong>de</strong>s romans.<br />
C'est <strong>pour</strong>quoi, <strong>pour</strong>suit Dadié, je ne me considère pas<br />
comme un romancier. Dans toutes ces oeuvres, il n'y a<br />
pas un personnage imaginé que nous puissions suivre à<br />
travers ses intrigues et <strong>le</strong>s péripéties <strong>de</strong> sa vie. Au<br />
contraire, c'est un personnage réel, toujours moi, qui<br />
regar<strong>de</strong>, qui examine <strong>le</strong>s coutumes, <strong>le</strong>s moeurs, la cul<br />
ture d'un peup<strong>le</strong> (français, italien, américain) et juge<br />
relativement aux coutumes, aux moeurs et à la culture<br />
<strong>de</strong> mon peup<strong>le</strong>, <strong>pour</strong> y discerner <strong>le</strong>s différences et <strong>le</strong>s<br />
points communs dans la perspective <strong>de</strong> l'humanisme<br />
universel. Nul<strong>le</strong> fiction, conclut Dadié, si ce n'est<br />
dans <strong>le</strong> personnage <strong>de</strong> Climbié et cela dans une certaine<br />
mesure seu<strong>le</strong>ment... " (l).Cette tendance semb<strong>le</strong> aussi<br />
visib<strong>le</strong> au niveau du théâtre <strong>de</strong> Dadié. Le souci constant<br />
<strong>de</strong> montrer la réalité peut à notre avis, limiter la part<br />
<strong>de</strong> la fiction théâtra<strong>le</strong>. Même si chez Dadié, conte<br />
et poésie fusionnent <strong>pour</strong> donner naissance au théâtre)<br />
Cette fusion <strong>de</strong>s genres qui ne peuvent se définir diffé<br />
remment, prolonge <strong>le</strong> cadre imaginaire et créatif du<br />
(1) C. Quillateau, op. cit., p. 152.
47<br />
dramaturge ivoirien. Cela trouve sa justification dans<br />
<strong>le</strong> fait que <strong>le</strong>s limites entre <strong>le</strong> conte, <strong>le</strong> théâtre et<br />
la poésie sont insignifiantes. C'est d'ail<strong>le</strong>urs cet<br />
aspect qui fait du théâtre <strong>de</strong> B. Dadié, un art total.<br />
Exprimant son souci d'originalité et explicitant <strong>le</strong><br />
rapport théâtre/conte, l'écrivain affirme dans un<br />
artic<strong>le</strong> intitulé "non pays et son théâtre" que "Chez<br />
nous, si par théâtre on entend un spectac<strong>le</strong> dans un<br />
lieu approprié, avec <strong>de</strong>s spectateurs payants et <strong>de</strong>s<br />
acteurs payés, avec <strong>de</strong>s décors, <strong>de</strong>s accoutrements, <strong>de</strong>s<br />
maquillages, avec <strong>de</strong>s répétitions, <strong>de</strong>s réclames tapa-<br />
geuses, évi<strong>de</strong>mment rien <strong>de</strong> tel en pays bgni, encore<br />
qu'il y ait <strong>de</strong>s lieux préférés à d'autres <strong>pour</strong> <strong>le</strong> théâ-<br />
tre, et qu'il y ait <strong>de</strong>s masques et que <strong>le</strong>s bons conteurs<br />
et <strong>le</strong>s musiciens, signa<strong>le</strong> Dadié, s'ils ne reçoivent pas<br />
d'argent, ne soient pas insensib<strong>le</strong>s aux ca<strong>de</strong>aux en<br />
nature... encore qu'ils sachent soigner <strong>le</strong>ur popularité,<br />
se faire attendre et désirer ... Ces contes sont mimés<br />
et dansés. Chacun <strong>de</strong>s gestes <strong>de</strong> nos danses a un sens.<br />
Ce sens, <strong>pour</strong>suit Dadié, échappe souvent aux Européens,<br />
parce qu'il est seu<strong>le</strong>ment ébauché, stylisé; il y a <strong>de</strong>s<br />
conventions dans <strong>le</strong> théâtre indigène comme <strong>le</strong> théâtre<br />
français, mais, conclut Dadié, el<strong>le</strong>s sont plus diffici<strong>le</strong>s<br />
à saisir parce que <strong>le</strong> village vivant tout entier d'une<br />
même vie, vie réel<strong>le</strong> et vie mystérieuse, point n'est<br />
besoin d' expliquer, <strong>le</strong> moindre geste suggère " (1). Partant<br />
(1) B. Dadié, "Mon pays et son théâtre" in Assémien Déhylé,<br />
présentation Vinciléoni, pp. 25 à 27.
50<br />
cette vision du mon<strong>de</strong> saisi topiquement en une succes-<br />
sion <strong>de</strong> tab<strong>le</strong>aux perçus dans <strong>le</strong>ur vivante théâtralité." (1)<br />
Toutes <strong>le</strong>s pièces <strong>de</strong> B. Dadié répon<strong>de</strong>nt dans cette<br />
perspective à une structure fondamenta<strong>le</strong>ment reconnais-<br />
sab<strong>le</strong> dès la première <strong>le</strong>cture: situation initia<strong>le</strong> du<br />
héros, quête d'un désir suivie d'une satisfaction, in-<br />
gratitu<strong>de</strong> du héros, déchéance tota<strong>le</strong> qui débouche sur<br />
sa mort considérée comme sanction suprême. C'est ici<br />
que <strong>le</strong> ta<strong>le</strong>nt du conteur éclate en p<strong>le</strong>in jour en associant<br />
dans une harmonie tota<strong>le</strong> dictons, proverbes, énigmes,.<br />
etc... tirés du terroir natal; il ne faut pas voir là<br />
une attitu<strong>de</strong> "copiste" <strong>de</strong> l'écrivain ivoirien. Il ne<br />
fait qu'habil<strong>le</strong>r "notre fond <strong>de</strong> formes nouvel<strong>le</strong>s... "<br />
selon <strong>le</strong>s propres termes <strong>de</strong> l'auteur. C'est la source<br />
du théâtre africain d'aujourd'hui. Car, "si <strong>le</strong> théâtre<br />
africain est <strong>de</strong>venu genre autonome, ce n'est pas par la<br />
simp<strong>le</strong> imitation d'une expression littéraire occi<strong>de</strong>nta<strong>le</strong>,<br />
c'est d'abord P?r la volonté du narrateur <strong>de</strong> réduire au<br />
minimum son compte-rendu journalistique <strong>pour</strong> permettre<br />
aux hommes <strong>de</strong> s'observer directement, sans médiation,<br />
dans l'espoir que ce rejeu <strong>de</strong> <strong>le</strong>ur propre existence, <strong>de</strong><br />
<strong>le</strong>urs conduites socia<strong>le</strong>s, <strong>de</strong> <strong>le</strong>urs attitu<strong>de</strong>s éthiques<br />
suscitera en eux <strong>le</strong> rêve, une vision d'altérité à la fois<br />
non-être dans la lai<strong>de</strong>ur du présent et thérapeutique<br />
<strong>de</strong> guérison par et dans l'au-<strong>de</strong>là du présent" (1). Dans<br />
(1) Thomas Melone, "La vie africaine et <strong>le</strong> langage théâtral"<br />
in Le théâtre négro-africain, Actes du Colloque<br />
d'Abidjan, 1970, Présence Africaine, pp. 146-147.
52<br />
immédiates. Un témoignage historique parlant du trans-<br />
fert <strong>de</strong> la capita<strong>le</strong> <strong>de</strong> Bingervil<strong>le</strong> à Abidjan, nous<br />
donne une idée sur <strong>le</strong> contenu <strong>de</strong> la pièce: "Décrété<br />
<strong>le</strong> 10 août 1933, <strong>le</strong> transfert effectif, signa<strong>le</strong> J. NGolo<br />
Coulibaly, eut lieu <strong>le</strong> 1er juil<strong>le</strong>t 1934 ... et marqua<br />
tragiquement <strong>le</strong> sort <strong>de</strong> Bingervil<strong>le</strong>. L'opinion publique<br />
était divisée au sein <strong>de</strong>s Noirs ... la vil<strong>le</strong> se vida <strong>de</strong><br />
tous ses fonctionnaires européens et indigènes. Des<br />
non-fonctionnaires suivirent éga<strong>le</strong>ment <strong>le</strong> mouvement<br />
d'émigration en raison <strong>de</strong> la cherté <strong>de</strong> la vie, et aussi<br />
dans l'espoir <strong>de</strong> trouver un emploi salarié dans la nou-<br />
vel<strong>le</strong> capita<strong>le</strong> dont l'avenir_était prometteur. La popu-<br />
lation restante se sentit frustrée. Alors qu'Abidjan<br />
<strong>de</strong>venait capita<strong>le</strong> politique et capita<strong>le</strong> économique <strong>de</strong> la<br />
colonie, <strong>pour</strong>suit Coulibaly, Bingervil<strong>le</strong>, après trente<br />
quatre ans <strong>de</strong> règne et <strong>de</strong> gloire, ne <strong>de</strong>vint que <strong>le</strong> chef-<br />
lieu du cerc<strong>le</strong> <strong>de</strong>s lagunes. Ainsi déchue, la vil<strong>le</strong> s'ané-<br />
miait. Toutes <strong>le</strong>s activités connurent un marasme dont<br />
el<strong>le</strong>s se re<strong>le</strong>vèrent diffici<strong>le</strong>ment " (1). C'est ce même<br />
sort tragique qu'ont connu Assinie, vil<strong>le</strong> nata<strong>le</strong> <strong>de</strong><br />
Dadié, Grand-Bassam... Ces différents transferts sous-<br />
ten<strong>de</strong>nt la pièce Les vil<strong>le</strong>s dont <strong>le</strong> texte fut perdu<br />
dans <strong>de</strong>s circonstances diffici<strong>le</strong>s à expliquer.<br />
Après la prison à Grand-Bassam, Dadié est retourné<br />
à Agbovil<strong>le</strong> où étaient ses affaires et <strong>le</strong> manuscrit<br />
Les vil<strong>le</strong>s: "Jeudi 23 mars 1950, écrit-il, retour à<br />
(1) J. NGolo Coulibaly, "Bingervil<strong>le</strong> à l'époque <strong>de</strong>s Gouverneurs",<br />
i.n.Anna<strong>le</strong>s <strong>de</strong> l'Université d'Abidjan,<br />
Série r (Histoire), T. X, 1982, pp. 194-195.
54<br />
théâtre, <strong>le</strong> thème du personnage historique peut-être<br />
sans <strong>le</strong> savoir, dans une perspective <strong>de</strong> la réhabilita<br />
tion <strong>de</strong>s va<strong>le</strong>urs africaines piétinées par <strong>le</strong> colonisa<br />
teur.<br />
Par souci d'originalité ou d'efficacité, Dadié<br />
va fouil<strong>le</strong>r dans <strong>le</strong> fin fond <strong>de</strong> la tradition ora<strong>le</strong> du<br />
pays sanwi <strong>pour</strong> créer une pièce qui tire tout <strong>de</strong> l'his<br />
toire du peup<strong>le</strong> Akan. Assémien Déhylé est la transposi<br />
tion sur scène d'un fait vécu et connu <strong>de</strong> tous. Selon<br />
Vinciléoni, "<strong>le</strong> sous-titre <strong>de</strong> la pièce, "Chronique Agni",<br />
marque d'une part que cette pièce entend relater <strong>de</strong>s<br />
événements historiques--qu-i.. suivent l'ordre <strong>de</strong>s temps<br />
et d'autre part, rapporter la réalité même <strong>de</strong> la vie<br />
du peup<strong>le</strong> Agni. L'emprunt nécessaire à la chronique<br />
ora<strong>le</strong>, soutient Vinciléoni, garantit une certaine authen<br />
ticité et surtout ces événements permettent <strong>de</strong> traduire<br />
à la fois en épaisseur et en surface <strong>de</strong>s aspects consti<br />
tutifs d'une culture." (1)<br />
Cette oeuvre précoce est déjà annonciatrice d'un<br />
Idéal qui animera <strong>le</strong>s grands militants <strong>de</strong> la Négritu<strong>de</strong><br />
et en même temps d'un nouveau courant littéraire qui<br />
fera naître <strong>de</strong>s pièces tr-éâtra<strong>le</strong>s d'inspiration histori<br />
que mieux élaborées tel<strong>le</strong>s L'exil d'Alboury du sénégalais<br />
Cheikh NDao et La mort <strong>de</strong> Chaka du malien Seydou Badian.<br />
C'est <strong>pour</strong> toutes ces raisons que cette pièce <strong>de</strong><br />
(1) N. Vinciléoni, op. c i.t , , p. 15.
58<br />
tout cela...<br />
- Où vend-on ce livre ?<br />
- On ne <strong>le</strong> vend pas. Si on me <strong>le</strong> voyait entre<br />
<strong>le</strong>s mains, on me jetterait en prison.<br />
- Donc, il y a <strong>de</strong>s ouvrages qu'on ne doit pas<br />
lire.<br />
- Moi je te dis qu'il faut tout lire, et c'est<br />
<strong>pour</strong>quoi j'ai tenu à te montrer ce bouquin." (1)<br />
Après la <strong>le</strong>cture <strong>de</strong> ce long dialogue entre l'onc<strong>le</strong> et<br />
son neveu, on s'étonne <strong>de</strong> la myopie intel<strong>le</strong>ctuel<strong>le</strong> <strong>de</strong><br />
certains critiques qui sont allés jusqu'à affirmer,<br />
comme M. Honsch, que "l'engagement politique et littéraire<br />
<strong>de</strong> Dadié ne peut se justifier par son origine socia<strong>le</strong>,<br />
.. puisque-son- père-est receveur puis exp Loitarrt vfor-esti.er "<br />
(2). Ayant hérité du goût <strong>de</strong> la <strong>le</strong>cture d'un père conscient<br />
<strong>de</strong> la formation culturel<strong>le</strong> <strong>de</strong> son enfant, B. Dadié,<br />
poussé par une curiosité exacerbée, va meub<strong>le</strong>r son esprit<br />
par plusieurs <strong>le</strong>ctures ayant trait à la condition humaine.<br />
Mais tout <strong>le</strong> fon<strong>de</strong>ment <strong>de</strong> cette culture repose<br />
sur la tradition ora<strong>le</strong>, substrat qui a été et reste la<br />
sève vivifiante qui cou<strong>le</strong> dans <strong>le</strong>s oeuvres écrites <strong>de</strong><br />
l'écrivain. Ce substrat ancestral est étoffé par l'auteur<br />
d'éléments puisés dans ses <strong>le</strong>ctures. Cel<strong>le</strong>s-ci permettent<br />
<strong>de</strong> voir à fond <strong>le</strong>s influences sur Dadié <strong>de</strong> certains au-<br />
teurs lus même s'il refuse <strong>de</strong> reconnaître l'existence<br />
d'un maître modè<strong>le</strong>: "J'ai beaucoup lu d'auteurs, dit-il,<br />
mais d'aucun je n'ai éprouvé l'envie, <strong>le</strong> désir, <strong>le</strong> besoin<br />
<strong>de</strong> faire un fixe modè<strong>le</strong>... A chacun j'ai <strong>de</strong>mandé <strong>de</strong>s<br />
(1) B. Dadié, op. cit., p. 196.<br />
(2) M. Honsch, Le pouvoir et l'argent dans l'oeuvre romanesque<br />
et théâtra<strong>le</strong> <strong>de</strong> Bernard Dadié, p. 10.
61<br />
février 1950 ... 16 H 30. Mockey reçoit du C.D.L.P. (1)<br />
<strong>de</strong>s livres communistes ... c'est un événement important<br />
que <strong>de</strong>s livres communistes soient entrés dans la<br />
prison... " (2) Des références au prologue <strong>de</strong>s Communistes<br />
d'Aragon, <strong>de</strong>s artic<strong>le</strong>s divers <strong>de</strong> L'Humanité sont mention<br />
nés dans <strong>le</strong> Carnet <strong>de</strong> prison du dramaturge ivoirien.<br />
Tous <strong>le</strong>s fruits <strong>de</strong> cette formation intel<strong>le</strong>ctuel<strong>le</strong> qui<br />
ont marqué la lutte militante <strong>de</strong> Dadié ne constituent<br />
ils pas <strong>le</strong>s premiers maillons favorab<strong>le</strong>s à la prise <strong>de</strong><br />
position <strong>de</strong> l'écrivain face à tout ce qui rabaisse<br />
l'homme?<br />
Malgré <strong>le</strong> désapparentement du groupe par<strong>le</strong>mentaire<br />
R.D.A. d'avec <strong>le</strong> Parti Communiste Français en 1951,<br />
<strong>de</strong>s intel<strong>le</strong>ctuels ivoiriens comme Dadié, feu J. B. Mockey<br />
gardèrent une profon<strong>de</strong> alliance inavouée avec <strong>le</strong>s<br />
communistes, même s'ils ont peut-être peur <strong>de</strong> <strong>le</strong> mention<br />
ner. Consciemment ou inconsciemment, toutes ces données<br />
historiques déterminent en profon<strong>de</strong>ur l'engagement<br />
du dramaturge ivoirien. L'intégration <strong>de</strong> Dadié au gou<br />
vernement actuel est perçu par bon nombre d'Ivoiriens<br />
comme une démission <strong>de</strong> la part <strong>de</strong> l'écrivain. C'est dans<br />
un tel contexte riche d'enseignements et d'événements<br />
que <strong>le</strong>s oeuvres <strong>de</strong> B. Dadié vont se déployer. Ces repères<br />
historiques constituent <strong>de</strong>s clés <strong>pour</strong> l'analyse <strong>de</strong> la<br />
production littéraire <strong>de</strong> notre auteur. Les omettre ou<br />
(1) C.D.L.P. : Centre <strong>de</strong> Diffusion du Livre Populaire.<br />
(2) B. Dadié, op. cit., p. 172.
63<br />
théâtre peut s'y prêter, et il s'y prête bien." (1)<br />
Au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> sa fonction ludique, ce théâtre se veut réel<br />
au service d'une cause nob<strong>le</strong> et expression <strong>de</strong>s faits<br />
sociaux observés avec minutie dans la vie courante.<br />
Ce qui ne fait que renouer <strong>le</strong>s liens du théâtre africain<br />
contemporain avec la tradition africaine qui considère<br />
l'art comme l'expression <strong>de</strong> la col<strong>le</strong>ctivité tout entière.<br />
Il s'agit <strong>pour</strong> <strong>le</strong>s écrivains africains <strong>de</strong> porter une vue<br />
critique et objective sur <strong>le</strong>ur société. Dans cette pers-<br />
pective, l'écrivain antillais Césaire affirmera:<br />
"J'aimerais réactualiser la culture noire <strong>pour</strong> en assurer<br />
la permanence, <strong>pour</strong> qu'el<strong>le</strong> <strong>de</strong>vienne une culture qui<br />
contribuerait à l'édification d'un ordre nouveau, d'un<br />
ordre révolutionnaire où la personnalité africaine<br />
<strong>pour</strong>rait s'épanouir... je veux un théâtre actuel en<br />
prise directe sur nos problèmes" (2). Les pierres fon-<br />
datrices d'un théâtre militant, engagé, sont ainsi<br />
posées. Le théâtre ivoirien avec son <strong>le</strong>a<strong>de</strong>r Bernard<br />
Dadié ne <strong>de</strong>meurera pas en marge <strong>de</strong> ce mot d'ordre.<br />
Poussé par la force <strong>de</strong>s choses, mû et b<strong>le</strong>ssé par<br />
toutes <strong>le</strong>s souffrances et <strong>le</strong>s désillusions <strong>de</strong>s Indépen-<br />
dances, Dadié va fondre politique, poésie, roman et conte<br />
dans un même genre <strong>le</strong> théâtre. Cette nouvel<strong>le</strong> orienta-<br />
tion lui permettra <strong>de</strong> dépeindre avec art, <strong>le</strong>s transfor-<br />
mations socio-économiques qui s'opèrent dans la société<br />
(1)<br />
F. Beloux, "Un poète politique: Aimé Césaire",<br />
Magazine Littéraire N° 34, 1969, pp. 27-32.<br />
(2) J. Chevrier, "Aimé Césaire" i.!}. Littérature Nègre,<br />
p. 175.<br />
in -
68<br />
CHAPITRE III<br />
LE CONCEPT DE POUVOIR<br />
ET SES DIFFERENTS ASPECTS MIS EN SCENE<br />
l - DEFINITION DU CONCEPT DE POUVOIR<br />
l - 1. Généralité<br />
Comment définir succinctement <strong>le</strong> POUVOIR?<br />
Lorsque l'on prononce <strong>le</strong> mot POUVOIR, il renvoie<br />
toujours et régulièrement à ceux qui sont chargés <strong>de</strong> la<br />
régulation d'un groupe social, d'une communauté ou d'une<br />
col<strong>le</strong>ctivité quel<strong>le</strong> que soit son homogénéité ou son hété<br />
rogénéité. Sous cet aspect, <strong>le</strong> mot évoquera <strong>le</strong> Roi,<br />
<strong>le</strong> Prési<strong>de</strong>nt, <strong>le</strong> Chef, <strong>le</strong> Ministre... Le mot prend tout<br />
son sens avec <strong>le</strong>s différents corollaires liés aux diffé<br />
rentes fonctions ci-<strong>de</strong>ssus citées.<br />
Dans <strong>le</strong>s sociétés mo<strong>de</strong>rnes, <strong>le</strong> Pouvoir appartient<br />
à une instance suprême que l'on nomme communément l'Etat.<br />
C'est aussi, dira Louis-Vincent Thomas "non seu<strong>le</strong>ment <strong>le</strong><br />
pouvoir central qui exerce son autorité par l'intermédiaire<br />
d'appareils idéologico-répressifs tels que l'éco<strong>le</strong>, l'ar<br />
mée, la police, mais ce sont aussi <strong>le</strong>s pouvoirs périphé<br />
riques qui se manifestent par <strong>le</strong> biais <strong>de</strong>s notab<strong>le</strong>s,<br />
<strong>de</strong>s bureaucrates, pouvoirs-relais s'appuyant sur <strong>le</strong>s<br />
appareils d'Etat, <strong>le</strong>s uns renforçant <strong>le</strong>s autres." (1)<br />
(1) L.V. Thomas, Mort et pouvoir, p. sa.
69<br />
Mais quel<strong>le</strong>s que soient <strong>le</strong>s manifestations <strong>de</strong> ce<br />
pouvoir, il apparaît toujours comme étant uœvéritab<strong>le</strong><br />
"activité socia<strong>le</strong> qui se propose d'assurer par la force,<br />
généra<strong>le</strong>ment fondée sur <strong>le</strong> droit, la sécurité extérieure<br />
et la concor<strong>de</strong> intérieure d'une unité politique particu-<br />
lière en garantissant l'ordre au milieu <strong>de</strong> luttes qui<br />
naissent <strong>de</strong> la diversité et <strong>de</strong> la divergence <strong>de</strong>s opinions<br />
et <strong>de</strong>s intérêts <strong>de</strong>s groupes." (1)<br />
On voit ainsi que <strong>le</strong> pouvoir se situe toujours<br />
dans une perspective <strong>de</strong> la cohésion du groupe. Et très<br />
souvent, c'est un petit groupe d'individus qui s'appro-<br />
prie ce pouvoir <strong>pour</strong> dominer <strong>le</strong>s autres membres <strong>de</strong> la<br />
communauté au nom d'un idéal particulier; <strong>le</strong> pouvoir<br />
apparaît alors comme se rapportant " ... à ce type précis<br />
<strong>de</strong> rapports sociaux qui est caractérisé par (<strong>le</strong> conflit),<br />
par la lutte <strong>de</strong> classes, c'est-à-dire à un champ à l'in-<br />
térieur duquel, <strong>de</strong> par l'existence précisément <strong>de</strong> classes,<br />
la capacité <strong>de</strong> l'une <strong>de</strong> réaliser par sa pratique ses<br />
intérêts propres est en opposition avec la capacité et<br />
<strong>le</strong>s intérêts d'autres classes. Ceci détermine un rapport<br />
spécifique <strong>de</strong> Domination et <strong>de</strong> Subordination <strong>de</strong>s prati-<br />
ques <strong>de</strong> classes, qui est précisément caractérisé comme<br />
rapport <strong>de</strong> pouvoir." (2)<br />
Dans <strong>le</strong>s sociétés occi<strong>de</strong>nta<strong>le</strong>s avancées où la divi-<br />
sion du travail est nette, on assiste à une séparation<br />
(1) J. Freund, Qu'est-ce que la politique, p. 177<br />
(2) N. Poulantzas, Pouvoir politique et classes socia<strong>le</strong>s, 1<br />
T. r , pp. 107-109.
11<br />
détient et qui la sert en s'en servant; el<strong>le</strong> est moins<br />
liée à la personne mortel<strong>le</strong> du souverain qu'à sa charge<br />
postulée éternel<strong>le</strong>. Ainsi voit-on comment <strong>le</strong> pouvoir<br />
au plan politique et <strong>le</strong>s pouvoirs au plan religieux<br />
opèrent conjointement, selon <strong>le</strong>s "lois" d'une sorte<br />
d'économie généra<strong>le</strong> <strong>de</strong>s forces. Toutes <strong>le</strong>s représentations<br />
africaines, <strong>pour</strong>suit Balandier, à <strong>de</strong>s <strong>de</strong>grés divers<br />
<strong>de</strong> comp<strong>le</strong>xité et <strong>de</strong> systématisation, manifestent <strong>le</strong><br />
pouvoir politique sous ces <strong>de</strong>ux aspects: celui d'une<br />
puissance <strong>de</strong> domination, celui d'une composante <strong>de</strong>s<br />
forces qui régissent l'univers et y conservent la vie.<br />
El<strong>le</strong>s associent l'ordre du mon<strong>de</strong>, imposé par <strong>le</strong>s dieux<br />
au cours <strong>de</strong>s processus <strong>de</strong> création, à l'ordre <strong>de</strong> la so-<br />
ciété, instauré par <strong>le</strong>s ancêtres du commencement et ou<br />
<strong>le</strong>s fondateurs <strong>de</strong> l'Etat. Le rituel assure l'entretien<br />
du premier, l'action politique <strong>le</strong> maintien du second.<br />
Les <strong>de</strong>ux démarches sont estimées parentes. El<strong>le</strong>s affir-<br />
ment, conclut Balandier, la solidarité du sacré et du<br />
politique, car tous <strong>de</strong>ux contribuent à imposer la con-<br />
formité à un ordre global, reconnu comme la condition <strong>de</strong><br />
toute vie... et <strong>de</strong> toute existence col<strong>le</strong>ctive <strong>de</strong>s<br />
homme s ." (1)<br />
A la lumière <strong>de</strong> cette longue réf<strong>le</strong>xion, on comprend<br />
mieux l'immense <strong>de</strong>nsité du Pouvoir pris dans sa conception<br />
africaine et la multiplicité <strong>de</strong>s sphères qu'il recouvre.<br />
(1) G. Balandier, in Préface <strong>de</strong> : Le Pouvoir et <strong>le</strong> Sacré<br />
chez <strong>le</strong>s Hadjeray du Tchad, <strong>de</strong> J.F. Vincent, pp. VII,<br />
VIII et IX.
73<br />
à la fois <strong>le</strong> pouvoir juridique et politique, mais aussi<br />
<strong>le</strong>s pouvoirs religieux qui regroupent sorciers, <strong>de</strong>vins,<br />
marabouts, guérisseurs, en fonction <strong>de</strong> <strong>le</strong>ur TUMI jugé<br />
nécessaire à l'entretien et à la protection <strong>de</strong> l'homme<br />
du pouvoir. Car, <strong>le</strong> TUMI, slil signifie Pouvoir, il re<br />
couvre par extension toutes <strong>le</strong>s puissances aùssi bien<br />
visib<strong>le</strong>s qu'invisib<strong>le</strong>s. Et ce TUMI est présent dans<br />
toute chose <strong>de</strong>s plantes à l'homme. Souvent <strong>le</strong> terme est<br />
employé comme synonyme d'un autre terme: <strong>le</strong> SUNSUN ou<br />
Esprit. Dans <strong>le</strong>s cérémonies rituel<strong>le</strong>s, par exemp<strong>le</strong>,<br />
l'offran<strong>de</strong> <strong>de</strong> nourriture à tel ou tel objet a <strong>pour</strong> effet<br />
principal, <strong>le</strong> renforcement.<strong>de</strong> son TUMI ou <strong>de</strong> son SUNSUN.<br />
Il Y a une interaction généra<strong>le</strong> <strong>de</strong> toutes <strong>le</strong>s choses<br />
<strong>de</strong> la terre <strong>le</strong>s unes sur <strong>le</strong>s autres par l'intermédiaire<br />
<strong>de</strong> <strong>le</strong>ur TUMI. Dans <strong>le</strong> domaine social, explique G. Hagan,<br />
"<strong>le</strong> tumi <strong>de</strong> l'homme est i<strong>de</strong>ntifié à son sunsun qui est<br />
une <strong>de</strong>s composantes immatériel<strong>le</strong>s <strong>de</strong> l'homme. Les Akan<br />
par<strong>le</strong>nt habituel<strong>le</strong>ment d'une personne dotée d'un fort<br />
charisme comme <strong>de</strong> quelqu'un qui a un grand pouvoir<br />
(tumi). On <strong>pour</strong>rait dire <strong>de</strong> cette personne qu'el<strong>le</strong> a un<br />
esprit puissant (sunsun), qu'el<strong>le</strong> est donc capab<strong>le</strong> <strong>de</strong><br />
dominer <strong>le</strong>s autres, en bien ou en mal, <strong>de</strong> protéger <strong>le</strong>s<br />
siens et <strong>de</strong> détruire ses adversaires. Ce type <strong>de</strong> tumi,<br />
<strong>pour</strong>suit Hagan, passe <strong>pour</strong> un don personnel, mais, croit<br />
on, il peut être renforcé ou acquis au moyen <strong>de</strong> diverses<br />
techniques. La connaissance <strong>de</strong> ces techniques accroît<br />
<strong>le</strong> tumi et est "perçue" comme un pouvoir." (1)<br />
(1) G. Eaqa n , op. c i t . , p. 59.
74<br />
On comprend à partir <strong>de</strong> cette explication, l'usage<br />
courant à la cour <strong>de</strong>s dictateurs <strong>de</strong> l'Afrique mo<strong>de</strong>rne,<br />
<strong>de</strong> sor8iers, <strong>de</strong> marabouts, <strong>de</strong> <strong>de</strong>vins chargés d'appor-<br />
ter <strong>le</strong>urs diverses puissances au renforcement du tumi<br />
personnel du chef <strong>de</strong> l'Etat. Ce masque est porté par<br />
plusieurs dirigeants qui cachent <strong>le</strong>ur médiocrité et <strong>le</strong>ur<br />
(<br />
ignorance en matière <strong>de</strong> politique <strong>de</strong>rrière <strong>le</strong> mysticis-<br />
me du pouvoir. Nous aurons l'occasion d'y revenir.<br />
Dans la conception akan, <strong>le</strong> pouvoir <strong>de</strong> la communau-<br />
té col<strong>le</strong>ctive est supérieure à tous <strong>le</strong>s pouvoirs rassem-<br />
blés d'un seul individu. Car <strong>le</strong> Tumi <strong>de</strong> la col<strong>le</strong>ctivité<br />
entière est émanation dlreëte du mon<strong>de</strong> invisib<strong>le</strong> <strong>de</strong>s<br />
Ancêtres défunts, et ce Tumi cou<strong>le</strong> vers la communauté<br />
future en passant évi<strong>de</strong>mment par cel<strong>le</strong> <strong>de</strong>s vivants déjà<br />
existante. Ce Tumi col<strong>le</strong>ctif entouré <strong>de</strong> plusieurs inter-<br />
dits, préserve l'unité socia<strong>le</strong> contre la dictature d'un<br />
seul dans la mesure où "selon la pensée akan, un gouver-<br />
nement, doté <strong>de</strong> pouvoirs <strong>de</strong> sanction rituel<strong>le</strong> et maté-<br />
riel<strong>le</strong>, est fait <strong>pour</strong> préserver la liberté <strong>de</strong> la société<br />
et empêcher l'individu <strong>de</strong> l'asservir." (1)<br />
C'est <strong>pour</strong>quoi <strong>le</strong> pouvoir est matérialisé par <strong>le</strong><br />
siège ou BlA, expression vivante <strong>de</strong> l'i<strong>de</strong>ntité et <strong>de</strong><br />
l'existence col<strong>le</strong>ctives du groupe. Toute l'idéologie po-<br />
litique akan est fondée sur <strong>le</strong> TUMl incarné dans <strong>le</strong> siège<br />
royal. Celui-ci exige du futur chef ou roi, une perfec-<br />
tion physique et mora<strong>le</strong> <strong>de</strong> sa personne. La personne<br />
(1) G. Hagan, op. cit., pp. 61-63.
77<br />
aucun profit du substrat ancestral dont el<strong>le</strong>s ont hérité<br />
et el<strong>le</strong>s appliquent encore mal la démocratie <strong>de</strong> type occi<br />
<strong>de</strong>ntal dont el<strong>le</strong>s ignorent ou refusent <strong>le</strong>s principes <strong>de</strong><br />
base. Il en résulte alors une confusion <strong>de</strong> pouvoir qui<br />
se manifeste sous divers masques <strong>pour</strong> mystifier <strong>le</strong> peup<strong>le</strong>,<br />
sur <strong>le</strong> dos duquel la classe dirigeante crée son bonheur.<br />
Cet aspect sera dévoilé par <strong>le</strong> dramaturge ivoirien au<br />
moyen du théâtre.<br />
l - 4. De la confusion <strong>de</strong>s pouvoirs<br />
Dans <strong>le</strong> théâtre <strong>de</strong> Bernard Dadié, il ressort que<br />
<strong>le</strong>s Etats nouvel<strong>le</strong>ment indépendants qui sont toujours re<br />
mis en cause, n'ont pas encore recouvré <strong>le</strong>ur autonomie<br />
politique et économique. De cette situation se dégage une<br />
sorte <strong>de</strong> conjugaison <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux modè<strong>le</strong>s <strong>de</strong> comman<strong>de</strong>ment qui<br />
ne peut mener qu'à la dictature; la plupart <strong>de</strong>s dirigeants<br />
<strong>de</strong> ces jeunes Etats indépendants, n'ont fait que plaquer<br />
<strong>le</strong> mo<strong>de</strong> occi<strong>de</strong>ntal <strong>de</strong> gouvernement en partie, en récupé<br />
rant certains aspects du pouvoir traditionnel autochtone.<br />
De cette confusion <strong>de</strong>s pouvoirs créée et voulue par la<br />
classe dirigeante, apparaît un trait pertinent caractéri<br />
sant ces gouvernements : <strong>le</strong> néo-colonialisme et ses<br />
variantes. Ce type <strong>de</strong> pouvoir prend sa source dans <strong>le</strong> fon<br />
<strong>de</strong>ment même <strong>de</strong>s luttes d'indépendance. Remontant à l'ori<br />
gine du système qui lui donna naissance, l'historien<br />
Gbagbo Laurent signa<strong>le</strong> que "parce que l'Assemblée Terri<br />
toria<strong>le</strong> ne donne que <strong>de</strong>s miettes <strong>de</strong> pouvoir à la bour<br />
geoisie ivoirienne qui est décidée à ne pas en <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r<br />
plus; parce que cette bourgeoisie ivoirienne servira
78<br />
désormais d'écran entre <strong>le</strong> peup<strong>le</strong> ivoirien et ses vérita-<br />
b<strong>le</strong>s exploiteurs installés en France <strong>pour</strong> l'essentiel;<br />
parce que l'impérialisme français continuera d'avoir la<br />
haute main sur <strong>le</strong>s affaires du pays, notamment en ce qui<br />
concerne l'économie, la monnaie, la défense, la diplomatie,<br />
nous disons, conclut Gbagbo, que la Loi-Cadre constitue<br />
<strong>le</strong> début <strong>de</strong> l'installation d'un pouvoir néo-colonial... "<br />
(1) Peint sous différentes formes, ce type <strong>de</strong> pouvoir<br />
apparaîtra comme la dominante <strong>de</strong> la critique <strong>de</strong> l'écrivain<br />
ivoirien Bernard Dadié. Il va dénoncer avec véhémence <strong>le</strong>s<br />
différentes manifestations du pouvoir à partir <strong>de</strong> son<br />
origine traditionnel<strong>le</strong> et dans son adéquation aux nouvel<strong>le</strong>s<br />
institutions politiques mises en scène dans son théâtre.<br />
II - LES DIFFERENTES MANIFESTATIONS DU POUVOIR DANS<br />
LE THEATRE DE DADIE<br />
Cette étape <strong>de</strong> notre travail a <strong>pour</strong> objectif fonda-<br />
mental <strong>de</strong> démasquer <strong>le</strong>s différentes formes <strong>de</strong> pouvoir<br />
mises en jeu par <strong>le</strong> dramaturge. Dans ce jeu profond <strong>de</strong><br />
signification, par<strong>le</strong>r <strong>de</strong> politique <strong>de</strong>vient synonyme <strong>de</strong><br />
pratique politique, dans la mesure où cel<strong>le</strong>-ci nous per-<br />
mettra <strong>de</strong> dévoi<strong>le</strong>r <strong>le</strong>s carences et <strong>le</strong>s multip<strong>le</strong>s faces du<br />
pouvoir tel<strong>le</strong>s qu'el<strong>le</strong>s apparaissent dans <strong>le</strong> théâtre <strong>de</strong><br />
Dadié. Car, dans <strong>le</strong>s pièces <strong>de</strong> l'écrivain ivoirien, l'hom-<br />
me politique ne peut être mieux cerné qu'à travers l'usage<br />
(1) Gbagbo Laurent, Côte d'Ivoire, économie et société<br />
à la veil<strong>le</strong> <strong>de</strong> l'Indépendance (1940-1960) ,Paris,<br />
L'Harmattan, 1982, p. 157.
79<br />
qu'il fait du pouvoir. Cette pratique est un primat qui<br />
peut déterminer <strong>le</strong> type <strong>de</strong> système politique critiqué.<br />
Sachant que toute institution ne vaut que par ceux<br />
qui l'incarnent, Bernard Dadié va peindre dans <strong>le</strong> détail<br />
<strong>le</strong>s aspects pertinents caractérisant chaque type <strong>de</strong><br />
pouvoir, en mettant un accent particulier sur la conception<br />
politique du dirigeant. Il résulte <strong>de</strong> cette <strong>de</strong>scription<br />
que nous allons voir, une extraordinaire confusion et<br />
un mélange <strong>de</strong> formes institutionnel<strong>le</strong>s anciennes et mo<strong>de</strong>r<br />
nes. Mais toutes s'inscrivent dans une optique dictato<br />
ria<strong>le</strong> voire tyrannique. Une approche plus profon<strong>de</strong> <strong>de</strong> ces<br />
formes, révè<strong>le</strong> l'existence d' au moins troi-s-types <strong>de</strong><br />
pouvoir<br />
- <strong>le</strong> pouvoir traditionnel en mutation qui se conver<br />
tira en un pouvoir néo-colonial avec Béatrice du Congo;<br />
- <strong>le</strong> pouvoir <strong>de</strong> type tyrannique avec Les voix dans<br />
<strong>le</strong> vent, que nous exploiterons plus loin;<br />
- une variante du pouvoir néo-colonial incarnée dans<br />
la dictature militaire avec I<strong>le</strong>s <strong>de</strong> tempête; enfin, <strong>le</strong><br />
pouvoir bureaucratique dans Mhoi-Ceul, pièce qui semb<strong>le</strong><br />
clore la critique du pouvoir.<br />
Que ce soit l'une ou l'autre, toutes ces pièces ont<br />
<strong>pour</strong> point commun <strong>le</strong> pouvoir oppresseur, personnel. Nous<br />
nous proposons d'analyser ici <strong>le</strong>s différentes faces avant<br />
d'en révé<strong>le</strong>r <strong>le</strong>ur fonctionnement.
BD<br />
II - 1. Le pouvoir néo-colonial<br />
Ce type <strong>de</strong> pouvoir présente <strong>de</strong>ux formes précises<br />
exploitées dans <strong>le</strong> théâtre <strong>de</strong> Dadié. La première relève<br />
du pouvoir civil néo-colonial et la secon<strong>de</strong> du pouvoir<br />
néo-colonial militaire; tous ces types se greffent cepen-<br />
dant sur un noyau commun avec <strong>le</strong>s mêmes carences et <strong>le</strong>s<br />
mêmes séquel<strong>le</strong>s.<br />
1. 1. Pouvoir néo-colonial civil<br />
Dans ce premier cas, l'analyse <strong>de</strong> Dadié part <strong>de</strong><br />
l'Occi<strong>de</strong>nt. Les premières didascalies dans Béatrice..<br />
sont révélatrices-et el<strong>le</strong>s explicitent dès <strong>le</strong> début <strong>de</strong>- la<br />
pièce, la victoire <strong>de</strong>s Européens sur -<strong>le</strong>s Maures musulmans<br />
'?1Usique occi<strong>de</strong>nta<strong>le</strong> qui domine musique arabe.<br />
Appels <strong>de</strong> muezzins entrecoupés <strong>de</strong> faib<strong>le</strong>s sons<br />
<strong>de</strong> cloches espacés; battements <strong>de</strong> mains, la mu<br />
sique arabe faiblit; la musique occi<strong>de</strong>nta<strong>le</strong><br />
croit; en sourdine, <strong>le</strong>s sons <strong>de</strong> cloches plus pré<br />
cipités <strong>pour</strong> <strong>de</strong>venir tocsin... " (1).<br />
Ces didascalies nous introduisent déjà dans un mon<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
conflit qui caractérise <strong>le</strong> théâtre <strong>de</strong> Dadié. El<strong>le</strong>s montrent<br />
aussi que <strong>le</strong> Bitanda, pays européen, libéré du joug <strong>de</strong>s<br />
Maures, va à son tour étendre son impérialisme sur l'Afri-<br />
que. Ce projet se réalisera surtout par <strong>le</strong> biais <strong>de</strong> la<br />
religion; "<strong>le</strong>s sons <strong>de</strong> cloches" évoquent <strong>le</strong> Christianisme<br />
qui fut l'arme privilégiée du colonisateur. C'est au nom<br />
<strong>de</strong> ce Christianisme ravageur que <strong>le</strong>s premiers Bitandais<br />
(1) Béatrice... , acte 1, tab<strong>le</strong>au I, p. 9.
85<br />
Le Roi (du Zaïre)<br />
IrVous avez raison. Je veux que mon palais ait <strong>le</strong><br />
même luxe que celui <strong>de</strong> mon frère du Bitanda...<br />
que ma capita<strong>le</strong> ait <strong>le</strong> même aspect que la capi<br />
ta<strong>le</strong> du Bitanda... <strong>de</strong>s capita<strong>le</strong>s jumel<strong>le</strong>s. Ir (1)<br />
Par un processus <strong>de</strong> dévoi<strong>le</strong>ment <strong>le</strong>nt et sûr, Dadié expri-<br />
me ici l'ambition qui anime tout dirigeant fantoche dont<br />
<strong>le</strong> premier souci est d'abord <strong>de</strong> paraître, en édifiant<br />
<strong>de</strong>s Versail<strong>le</strong>s miniaturisés ou <strong>de</strong>s New-York en puissance,<br />
alors que l'arrière-pays croupit dans la misère la plus<br />
tota<strong>le</strong>. Un tel fait est d'ail<strong>le</strong>urs remarquab<strong>le</strong> dans tous<br />
<strong>le</strong>s pays néo-colonialistes qui ne font que masquer <strong>le</strong>ur<br />
misérab<strong>le</strong>co.ndition-d-'exploités par <strong>de</strong>s LnsLqne s fictifs<br />
<strong>de</strong> croissance. La classe dirigeante <strong>de</strong> ces pays, vivant<br />
dans un luxe injurieux, où l'on préfère <strong>le</strong> marbre à la<br />
terre battue, parce qu'il est moins salissant, ruine<br />
ainsi toute la masse monétaire accumulée par <strong>le</strong>s contri-<br />
buab<strong>le</strong>s locaux. Se joignent à ces usages abusifs, <strong>le</strong>s<br />
nombreux détournements <strong>de</strong> fonds impunis. La viru<strong>le</strong>nce <strong>de</strong><br />
la critique <strong>de</strong> Dadié aura plus d'effet sur <strong>le</strong> spectateur<br />
parce qu'el<strong>le</strong> puise tous ses éléments dans la réalité <strong>de</strong><br />
tous <strong>le</strong>s jours. L'écrivain n'épargne aucun aspect <strong>de</strong>s<br />
faits sociaux dans son analyse. Il ne parodie pas seu<strong>le</strong>-<br />
ment <strong>le</strong>s rois nègres, mais aussi ceux qui cautionnent<br />
<strong>le</strong>urs comportements; <strong>le</strong> passage que nous avons choisi,<br />
nous renvoie à plusieurs présupposés possib<strong>le</strong>s "... avoir<br />
une plantation modè<strong>le</strong>... la plus large possib<strong>le</strong>... " suppo-<br />
(1) Eéatrice... , acte II, tab<strong>le</strong>au 1, p. 80.
88<br />
sion extérieure qu'el<strong>le</strong> ne l'était vingt ans plus tôt;<br />
el<strong>le</strong> l'est davantage... Les transferts totaux - visib<strong>le</strong>s<br />
(40 milliards) et cachés dans la structure inéga<strong>le</strong> <strong>de</strong>s<br />
prix (100 milliards) - soit 140 milliards, représentent<br />
40 % du produit! Il n'est pas exagéré <strong>de</strong> dire que tout<br />
<strong>le</strong> surplus engendré en Côte d'Ivoire - et au-<strong>de</strong>là - est<br />
transféré vers <strong>le</strong>s centres du système capitaliste<br />
mondial." (1)<br />
Comment ne pas réagir face à toutes ces exactions,<br />
lorsqu'on attribue à son art une fonction <strong>de</strong> lutte et <strong>de</strong><br />
dénonciation <strong>de</strong> tout ce qui étouffe <strong>le</strong>s masses au profit<br />
d'une minorité assoiffée <strong>de</strong> gain?<br />
Une autre pratique qui irrite l'écrivain ivoirien,<br />
est que tous <strong>le</strong>s dirigeants fantoches <strong>de</strong> l'Afrique sont<br />
entourés <strong>de</strong> conseil<strong>le</strong>rs techniques européens qui ne font<br />
que dicter <strong>le</strong>s intérêts du capitalisme international. Le<br />
roi local <strong>de</strong>vient ainsi une marionnette vivante, théâtra-<br />
lisant la scène politique en un jeu fantastique tout en<br />
ignorant <strong>le</strong>s règ<strong>le</strong>s du jeu auquel il participe. Cette<br />
attitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> certains roite<strong>le</strong>ts, masque <strong>le</strong>ur immaturité<br />
politique voire <strong>le</strong>ur manque total <strong>de</strong> conscience nationa<strong>le</strong>.<br />
Cordon ombilical <strong>de</strong> l'impérialisme exploiteur, et simp<strong>le</strong><br />
pantin du capitalisme international, <strong>le</strong> dirigeant néo-<br />
colonialiste ne peut durer au pouvoir qu'en approfondissant<br />
ce qui est communément appelé "coopération", un terme<br />
galvaudé, vidé <strong>de</strong> son sens; cette coopération est <strong>le</strong><br />
(1) Samir Amin, Le développement du capitalisme en Côte<br />
d'Ivoire, pp. 287-288.
90<br />
privés français. Il s'agit éga<strong>le</strong>ment, <strong>pour</strong>suit O. Bach,<br />
d'éviter toute remise en cause <strong>de</strong> l'ai<strong>de</strong> non négligeab<strong>le</strong><br />
que la Côte d'Ivoire reçoit <strong>de</strong> la France, en dépit du<br />
courant " c a riériste" entretenu par <strong>le</strong>s échecs et <strong>le</strong>s<br />
difficultés <strong>de</strong> la politique française en Indochine et en<br />
Algérie." (1)<br />
Conscient <strong>de</strong> l'inefficacité d'une tel<strong>le</strong> coopération,<br />
Oadié a <strong>de</strong>puis <strong>1966</strong> tiré sur la sonnette d'alarme à tra-<br />
vers ses oeuvres théâtra<strong>le</strong>s, <strong>pour</strong> que <strong>le</strong>s dirigeants<br />
puissent prendre <strong>le</strong>ur responsabilité. Mais cela ne fut pas<br />
fait; <strong>le</strong>s soubressauts économiques actuels semb<strong>le</strong>nt lui<br />
donner largement raison. En effet, "en s e p t erribr e <strong>1980</strong>, <strong>le</strong><br />
gouvernement français ne soutient pas l'octroi à la Côte<br />
d'Ivoire <strong>de</strong> l'ai<strong>de</strong> financière exceptionnel<strong>le</strong> qu'el<strong>le</strong> sol-<br />
licite, à un taux privilégié, auprès <strong>de</strong>s banques françaises.<br />
L'Etat ivoirien fait alors face à <strong>de</strong>s difficultés <strong>de</strong> tré-<br />
sorerie provoquées par la chute bruta<strong>le</strong> <strong>de</strong>s cours du<br />
cacao concomittante à un échec <strong>de</strong> la politique sucrière<br />
et à l'en<strong>de</strong>ttement extérieur, du fait <strong>de</strong> la nécessité <strong>de</strong><br />
rembourser <strong>de</strong>s prêts contractés <strong>pour</strong> la réalisation <strong>de</strong><br />
grands projets." (2) Touché par un tel agissement <strong>de</strong> la<br />
part d'un bon partenaire, l'Etat exprimera son amertume<br />
en <strong>de</strong>s termes clairs sur "l'évolution <strong>de</strong>s rapports avec<br />
la France "l'Afrique aux Africains ne doit pas être un<br />
vain mot. Les Africains doivent compter sur eux-mêmes,<br />
(l) O. Bach, "L' insertion i voir ienne dans <strong>le</strong>s rapports<br />
internationaux", in Etat et bourgeoise en Côte d'Ivoire,<br />
p. 9l.<br />
(2) O. Bach, op. cit., pp. 119-120.
92<br />
<strong>le</strong>s yeux, l'Etat néo-colonial est mû par une conscience<br />
".. . investie d'Une tendance puissante à l'imitation, à la<br />
reproduction <strong>de</strong>s habitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> consommation, <strong>de</strong>s schèmes<br />
<strong>de</strong> pensée impérialistes. La proto-nation, signa<strong>le</strong> Zieg<strong>le</strong>r,<br />
est une société hétérogène où la bourgeoisie compradore,<br />
qui est <strong>le</strong> noyau dirigeant <strong>de</strong> la proto-nation, est obligée<br />
<strong>de</strong> négocier son pouvoir avec d'autres forces socia<strong>le</strong>s.<br />
Exemp<strong>le</strong>: au Cameroun, <strong>pour</strong>suit Zieg<strong>le</strong>r, <strong>le</strong> prési<strong>de</strong>nt<br />
Ahidjo, chef <strong>de</strong> fi<strong>le</strong> <strong>de</strong> la bourgeoisie compradore, doit<br />
négocier chacune <strong>de</strong> ses décisions importantes non seu<strong>le</strong><br />
ment avec <strong>le</strong> pouvoir français, mais aussi avec <strong>le</strong>s puis<br />
sants chefs musulmans qui au Cameroun détiennent une<br />
parcel<strong>le</strong> considérab<strong>le</strong> du pouvoir autochtone... " (1)<br />
Nous débouchons ainsi sur une véritab<strong>le</strong> confusion <strong>de</strong>s pou<br />
voirs au niveau <strong>de</strong> ces Etats néo-coloniaux, fait que nous<br />
évoquions plus haut.<br />
Cet aspect se lit dans <strong>le</strong> personnage du roi Mani<br />
Congo, caricature du dirigeant néo-colonialiste qui a vu<br />
son pouvoir se transformer en un pouvoir oppresseur, car<br />
lui-même s'est laissé corrompre par l'impérialisme étran<br />
ger. Ne jouant plus qu'une fonction margina<strong>le</strong> (toutes <strong>le</strong>s<br />
décisions étant dictées par <strong>le</strong>s conseil<strong>le</strong>rs techniques,<br />
véritab<strong>le</strong>s pions du capitalisme), <strong>le</strong> roi va assister au<br />
gaspillage organisé <strong>de</strong> toutes <strong>le</strong>s richesses du Zaîre. Les<br />
propos <strong>de</strong> Lopez sont à ce niveau révélateurs :<br />
(1) Jean Zieg<strong>le</strong>r, op. cit., pp. 16-17.
94<br />
<strong>de</strong>s systèmes politiques <strong>de</strong> l'Afrique. Ce pouvoir, dans<br />
son fon<strong>de</strong>ment, ne diffère pas entièrement du néo-colonia-<br />
lisme civil. Mais ici <strong>de</strong>s précisions pertinentes viennent<br />
compléter l'image <strong>de</strong> l'Etat néo-colonial, entamée dans<br />
Monsieur Thôgô-gnini et Béatrice du Congo, et qui trouvera<br />
son aboutissement<br />
l'écrivain: Mhoi-Ceul.<br />
dans la toute <strong>de</strong>rnière pièce <strong>de</strong><br />
Comme l'explicite Dadié, tout pouvoir néo-colonial<br />
militaire naît d'une crise, crise <strong>de</strong> légitimité ou crise<br />
socia<strong>le</strong>. Et ce type <strong>de</strong> pouvoir, à l'image <strong>de</strong> celui <strong>de</strong><br />
Toussaint Louverture, reste toujours dépendant <strong>de</strong> l'exté-<br />
rieur. A partir <strong>de</strong> ce moment, ..l'accession <strong>de</strong> l' a rrriè eiati<br />
pouvoir serait <strong>le</strong> résultat <strong>de</strong> manoeuvres étrangères <strong>de</strong>s-<br />
tinées d'une part, à mettre fin à un régime dont <strong>le</strong>s<br />
comportements politiques et idéologiques sont conçus comme<br />
étant <strong>de</strong> nature à compromettre <strong>le</strong>s intérêts d'autres puis-<br />
sances et corrélativement d'autre part, à mettre en place<br />
un nouveau gouvernement susceptib<strong>le</strong> <strong>de</strong> ne pas menacer,<br />
sinon <strong>de</strong> <strong>pour</strong>voir à la protection <strong>de</strong> ces intérêts." (1)<br />
C'est sous cet ang<strong>le</strong> que la prise <strong>de</strong> pouvoir <strong>de</strong> Toussaint<br />
Louverture et son refus catégorique <strong>de</strong> proclamer l'indé-<br />
pendance, dans <strong>le</strong> but <strong>de</strong> la sauvegar<strong>de</strong> <strong>de</strong>s intérêts fran-<br />
çais à Saint-Domingue, peuvent être considérés comme une<br />
attitu<strong>de</strong> néo-colonialiste. L'entretien entre Toussaint<br />
Louverture et Dessalines nous permet <strong>de</strong> saisir cette<br />
(1) Michel-L. Martin, La militarisation <strong>de</strong>s systèmes<br />
politiques africains, 1960-1972, une tentative<br />
d'interprétation, p. 109.
100<br />
Mercure :<br />
"Il faut vous en assurer, et faites tout <strong>pour</strong> <strong>le</strong><br />
mettre au nom <strong>de</strong> Martin, mon neveu... Il n'est<br />
pas très compétent, mais je <strong>de</strong>man<strong>de</strong>rai au Géné<br />
ral Toussaint Louverture <strong>de</strong> lui donner une place<br />
<strong>de</strong> choix, la confiance n'a-t-el<strong>le</strong> pas <strong>le</strong> pas sur<br />
la compétence? ... Rattraper <strong>le</strong> temps perdu!<br />
Que chacun sache que je suis un très haut person<br />
nage . . . " (1)<br />
Le personnage <strong>de</strong> Mercure représente <strong>le</strong> prototype <strong>de</strong>s nou-<br />
veaux bourgeois que <strong>le</strong> pays <strong>de</strong> Dadié a connu au <strong>le</strong>n<strong>de</strong>main<br />
<strong>de</strong>s Indépendances. Sous <strong>le</strong> couvert du dirigeant politique<br />
en place, cette classe s'est appropriée <strong>le</strong>s riches planta<br />
tions .etanciens-domai-nes du colonisateur, taus· entretenus·<br />
par <strong>de</strong>s ouvriers sous-payés; <strong>le</strong>s membres <strong>de</strong> cette classe<br />
ont la main mise sur tout ce qui relève du domaine immo-<br />
bilier, etc... , comme l'exprime implicitement ici Mercure.<br />
Les sources <strong>de</strong> revenu <strong>de</strong> cette classe sont alimentées par<br />
<strong>le</strong>s fréquents détournements <strong>de</strong> <strong>de</strong>niers publics, <strong>de</strong> pots<br />
<strong>de</strong> vin reçus <strong>de</strong>s représentants du grand capital interna-<br />
tional. Ainsi <strong>le</strong>s cités nouvel<strong>le</strong>s construites sur <strong>le</strong>s<br />
terrains <strong>de</strong>s pauvres (qui n'ont jamais été dédommagés<br />
après <strong>le</strong>s différents déguerpissements) <strong>le</strong>ur sont-el<strong>le</strong>s en<br />
retour louées à <strong>de</strong>s prix exorbitants.<br />
Tandis que d'un côté, l'on est en face d'une popula<br />
tion démunie, affamée, sque<strong>le</strong>ttique, <strong>de</strong> l'autre, c'est<br />
la classe dirigeante repue, qui s'embarrasse <strong>de</strong> ses<br />
richesses, vivant dans la paresse, <strong>le</strong> luxe et l'abondance<br />
(1) I<strong>le</strong>s ... , tab<strong>le</strong>au IV, scène 2, pp. 60-61.
106<br />
s'emparer du contrô<strong>le</strong> <strong>de</strong> diverses autres sociétés...<br />
la colonisation fut l'une <strong>de</strong>s formes <strong>le</strong>s plus bruta<strong>le</strong>s <strong>de</strong><br />
contrô<strong>le</strong>; <strong>le</strong> néo-impérialisme en est une forme plus sub-<br />
ti<strong>le</strong>. A l'occupation militaire se sont substitués <strong>le</strong>s<br />
accords <strong>de</strong> défense, aux compagnies <strong>de</strong> commerce se sont<br />
substituées <strong>de</strong>s sociétés anonymes et fina<strong>le</strong>ment, la coer-<br />
cition a fait place à la manipulation et à la persuasion.<br />
Seu<strong>le</strong> peut-être la nature <strong>de</strong>s commodités a changé.<br />
L'uranium a succédé à l'or, <strong>le</strong> pétro<strong>le</strong> a succédé à<br />
l'hévéa, la base <strong>de</strong> Kagnew à cel<strong>le</strong> <strong>de</strong> Fachoda. Par consé-<br />
quent, conclut H. L. Martin, tous <strong>le</strong>s changements <strong>de</strong><br />
nature à perturber, ou tout au moins perçus comme tels,<br />
<strong>le</strong> flux <strong>de</strong> ces commodités, soient-el<strong>le</strong>s économiques,<br />
stratégiques ou intel<strong>le</strong>ctuel<strong>le</strong>s, et <strong>de</strong> nature à entraîner<br />
une modification dans l'organisation <strong>de</strong>s échanges inter-<br />
nationaux et la structure du comp<strong>le</strong>xe continental, sont<br />
susceptib<strong>le</strong>s par voie <strong>de</strong> conséquence <strong>de</strong> provoquer une<br />
réaction <strong>de</strong> la part <strong>de</strong>s puissances en position <strong>de</strong> domina-<br />
tion, en vue du rétablissement du statu quo ante." (1)<br />
Le cas récent <strong>de</strong> la République <strong>de</strong> Centre-Afrique est<br />
à ce niveau évocateur. Toussaint Louverture n'échappera<br />
pas à la règ<strong>le</strong>. Toussaint qui croyait plus à la bonne<br />
foi <strong>de</strong> Bonaparte, qu'à la détermination <strong>de</strong> son peup<strong>le</strong> <strong>pour</strong><br />
l'indépendance tota<strong>le</strong>, sera fait prisonnier par la métro-<br />
po<strong>le</strong>. La pièce <strong>de</strong> l'écrivain ivoirien fait ainsi écho à<br />
bon nombre <strong>de</strong> régimes militaires africains qui se sont<br />
(1) M. L. Martin, op. cit., p. 110.
109<br />
au théâtre, <strong>pour</strong> favoriser la véritab<strong>le</strong> prise <strong>de</strong> conscience<br />
libératrice. C'est d'ail<strong>le</strong>urs la fonction fondamenta<strong>le</strong><br />
<strong>de</strong> la littérature africaine. Car, comme l'affirme <strong>le</strong><br />
Professeur Kotchy, "toute littérature en même temps que<br />
par sa pratique, el<strong>le</strong> a <strong>de</strong>s implications économiques,<br />
par son contenu, el<strong>le</strong> dégage une certaine orientation<br />
idéologique; puisque cette discipline a <strong>pour</strong> première<br />
mission: la prise <strong>de</strong> conscience nationa<strong>le</strong> et la formation<br />
du citoyen. Ainsi donc la littérature nationa<strong>le</strong> débarrasse<br />
l'homme noir <strong>de</strong> toute gangrène aliénante, car il n'y a<br />
rien <strong>de</strong> pire que cette dépendance culturel<strong>le</strong> qui façonne<br />
--l' e s p.r.i-t.c.<strong>de</strong> servitu<strong>de</strong>" (1). La fonction qui s'attache<br />
alors au théâtre ne peut qu'être une fonction <strong>de</strong> désalié-<br />
nation tota<strong>le</strong> d'abord <strong>de</strong>s dirigeants <strong>de</strong>s "proto-nations",<br />
afin d'aboutir à une véritab<strong>le</strong> autonomie politique, écono-<br />
mique et culturel<strong>le</strong>; l'avenir <strong>de</strong> l'Afrique en dépend<br />
énormément, et <strong>le</strong> salut <strong>de</strong>s institutions africaines est<br />
à ce prix.<br />
Mais si <strong>le</strong> théâtre <strong>de</strong> Dadié peint dans ses moindres<br />
détàils <strong>le</strong> pouvoir néo-colonial militaire, il n'épargne<br />
pas une variante <strong>de</strong> ce même type <strong>de</strong> pouvoir, <strong>le</strong> pouvoir<br />
bureaucratique, cultivé et entretenu par <strong>le</strong>s nouveaux<br />
dirigeants <strong>de</strong> l'Afrique mo<strong>de</strong>rne. Quels sont <strong>le</strong>s mécanismes<br />
qui mettent en mouvement ce type <strong>de</strong> pouvoir ?<br />
(1) B. Kotchy, "L'enseignement <strong>de</strong> la littérature négroafricaine,<strong>pour</strong>quoi<br />
faire ?" in Présence Africaine,<br />
N° spécial, Paris, 1971, p. 365.
1 13<br />
publique, parce que protégée par un Ministre ou un Dépu-<br />
té. L'écrivain ivoirien ne ménage pas ces arrivistes<br />
grandiloquents. Il touche du doigt <strong>le</strong>s fon<strong>de</strong>ments <strong>de</strong><br />
l'administration ivoirienne en particulier. Tous ceux<br />
qui gravitent autour <strong>de</strong> Mhoi-Ceul, ont été installés là<br />
par <strong>de</strong>s mains expertes: ce sont <strong>le</strong>s intouchab<strong>le</strong>s. C'est<br />
ce que dévoi<strong>le</strong> <strong>le</strong> personnage <strong>de</strong> La-Nièce :<br />
Mhoi-Ceul<br />
"Vous <strong>de</strong>vez être terrib<strong>le</strong>ment pistonnée ?"<br />
La-Nièce :<br />
"On dit maintenant "protégé", Monsieur <strong>le</strong> Direc<br />
teur. Il faut être <strong>de</strong> son temps, Monsieur <strong>le</strong><br />
Directeur. Si nos pères disaient "pistonnés",<br />
nous, nous disons "protégés ", Animaux protégés,<br />
hommes protégés. Chacun a ses protégés. Même<br />
<strong>le</strong>s plantons ont <strong>le</strong>urs protégés. Une véritab<strong>le</strong><br />
inflation <strong>de</strong> protégés et <strong>de</strong> protecteurs, Monsieur<br />
<strong>le</strong> Directeur. Vou<strong>le</strong>z-vous que je vous protège ?"<br />
(1)<br />
Avec sa volonté <strong>de</strong> tout révolutionner, Mhoi-Ceul s'est<br />
rendu compte <strong>de</strong> l'inefficacité d'une tel<strong>le</strong> ambition. Dans<br />
la mesure où il va se trouver seul ligué contre un sys<br />
tème <strong>pour</strong>ri, installé et entretenu par <strong>le</strong>s dirigeants po-<br />
litiques, populairement connus sous <strong>le</strong> terme <strong>de</strong> "grands<br />
types". Il faut noter ici avec Médard que "cette distinc-<br />
tion n'oppose pas seu<strong>le</strong>ment <strong>le</strong>s pauvres et <strong>le</strong>s riches,<br />
mais ceux qui sont près du pouvoir et <strong>le</strong>s autres. Les<br />
petits (du moins <strong>le</strong>s citadins) sont très bien informés sur<br />
<strong>le</strong>ur propre société et sur <strong>le</strong>s "grands types". Ils sont<br />
(1) Mhoi-Ceul, tab<strong>le</strong>au II, p. 28.
11 5<br />
qui cautionne non seu<strong>le</strong>ment ce type <strong>de</strong> conduite, mais<br />
aussi la stratification socia<strong>le</strong>; dans <strong>le</strong> cas précis <strong>de</strong> la<br />
Côte d'Ivoire, écrivent Fauré et Médard "dans la mesure<br />
où c'est la proximité du pouvoir politique qui conditionne<br />
la politique <strong>de</strong> distribution <strong>de</strong>s ressources publiques<br />
et <strong>le</strong>s possibilités d'accès aux sources d'enrichissement<br />
il est compréhensib<strong>le</strong> que c'est sur l'accès à ces couches<br />
stratégiques que se cristallisent <strong>le</strong>s conflits. La réponse<br />
du système est donc beaucoup plus <strong>de</strong> gérer <strong>de</strong>s ressources<br />
publiques <strong>de</strong> façon à maximiser <strong>le</strong>s soutiens politiques<br />
que <strong>de</strong> trouver une solution aux problèmes sociaux par <strong>de</strong>s<br />
réformes visant à plus <strong>de</strong> justice et d'égalité. D'où<br />
l'importance d'un recours à la cooptation au sein <strong>de</strong> la<br />
classe dirigeante. Ainsi, <strong>pour</strong>suivent ces auteurs, se<br />
dégage l'impression (... )que la bourgeoisie politico-<br />
administrative constitue à la fois <strong>le</strong> noyau <strong>de</strong> la classe<br />
dirigeante et la véritab<strong>le</strong> classe dominante <strong>de</strong> la Côte<br />
d'Ivoire." (1)<br />
C'est cette classe, assoiffée <strong>de</strong> biens matériels et<br />
<strong>de</strong> distinctions honorifiques, que Oadié dépeint à travers<br />
<strong>le</strong> personnage <strong>de</strong> Mhoi-Ceul. Outre cette critique, Oadié<br />
touche ici <strong>le</strong> problème du fonctionnaire ivoirien, qui<br />
n'est pas seu<strong>le</strong>ment fonctionnaire, mais homme d'affaires,<br />
responsab<strong>le</strong> politique ou ethnique, etc... Sa fonction <strong>de</strong><br />
citoyen au service <strong>de</strong> la nation ne vient qu'en second ordre.<br />
C'est ce que l'écrivain reproche aux pouvoirs publics par<br />
(1) Fauré et Médard, "Classe dominante ou classe dirigeante"<br />
in Etat et Bourgeoisie en Côte d'Ivoire, p. 136.
121<br />
qu'el<strong>le</strong> révè<strong>le</strong> qu'aux "formes inusitées <strong>de</strong> constitution<br />
d'un capital primitif va s'ajouter l'accès officiel aux<br />
fonds bancaires, privés ou publics, d'autant plus aisé<br />
qu'il concerne cette bourgeoisie d'Etat et qu'il sera<br />
obtenu avec force recommandations et appuis... Ces pra<br />
tiques économiques ont donc représenté un moyen efficace<br />
d'enrichissement <strong>de</strong> la classe bureaucratique dirigeante.<br />
Par <strong>le</strong> niveau <strong>de</strong> ses revenus et ressources, la bourgeoisie<br />
a pu mener grand train <strong>de</strong> vie : <strong>le</strong>s signes ostentatoires<br />
<strong>de</strong> ce pacto<strong>le</strong> se sont multipliés par une consommation<br />
somptuaire, largement inspirée <strong>de</strong>s modè<strong>le</strong>s occi<strong>de</strong>ntaux"<br />
(l) •<br />
Pour asseoir <strong>le</strong>ur domination et <strong>le</strong>ur célébrité, <strong>le</strong>s<br />
bureaucrates usent <strong>de</strong> tous <strong>le</strong>s moyens. Les mass-média<br />
sont sollicités, corrompus, <strong>pour</strong> dresser un portrait<br />
géant, mélioratif du dirigeant ou du directeur, masquant<br />
ainsi une médiocrité congénita<strong>le</strong> et une véritab<strong>le</strong> ambition<br />
à franchir toutes <strong>le</strong>s étapes <strong>de</strong> l'échel<strong>le</strong> socia<strong>le</strong>, en un<br />
laps <strong>de</strong> temps. Dans <strong>le</strong> cas particulier <strong>de</strong> la Côte d'Ivoi<br />
re, Dadié révè<strong>le</strong> que cela était évi<strong>de</strong>nt, dans la mesure<br />
où ces directeurs, représentants directs du capitalisme<br />
d'Etat, avaient <strong>le</strong>s p<strong>le</strong>ins pouvoirs, fixant eux-mêmes <strong>le</strong>urs<br />
salaires et <strong>le</strong>urs in<strong>de</strong>mnités <strong>de</strong> responsabilité, gérant<br />
<strong>de</strong>s corps d'employés qui n'existaient que sur <strong>le</strong> bor<strong>de</strong>reau<br />
<strong>de</strong> Monsieur <strong>le</strong> Directeur. Toutes ces exactions étaient<br />
couronnées par une folie <strong>de</strong>s gran<strong>de</strong>urs, se traduisant par<br />
(1) C. <strong>de</strong> Miras, op. cit., p. 213.
124<br />
fixation <strong>de</strong> la crédibilité et <strong>de</strong> l'importance <strong>de</strong> l'image<br />
grandiloquente du bureaucrate bourgeois. Par <strong>le</strong> grossisse<br />
ment <strong>de</strong> l'image <strong>de</strong> la classe bureaucratique, Bernard<br />
Dadié exprime implicitement une pensée du Prési<strong>de</strong>nt ivoi<br />
rien qui, sans rien se reprocher, affirma en <strong>1980</strong>, que<br />
la faillite <strong>de</strong>s sociétés d'Etat incombait aux dirigeants<br />
<strong>de</strong> cel<strong>le</strong>s-ci: "trop d'entreprises publiques ou privées<br />
ont sombré parce que <strong>le</strong> premier souci <strong>de</strong> <strong>le</strong>urs responsab<strong>le</strong>s<br />
avait été <strong>de</strong> s'entourer <strong>de</strong>s signes extérieurs du pouvoir<br />
et <strong>de</strong> la richesse quand ils ne confondaient pas <strong>le</strong>s avoirs<br />
<strong>de</strong> <strong>le</strong>ur société avec <strong>le</strong>urs biens propres dans <strong>le</strong> sens<br />
que l'on <strong>de</strong>vine et_qu'ils préféraient la calme opu<strong>le</strong>nce<br />
<strong>de</strong> <strong>le</strong>urs bureaux climat{sés à la surveillance <strong>de</strong> la<br />
bonne exécution <strong>de</strong>s travaux qui <strong>le</strong>ur: avaient été confiés "<br />
Cependant, il faut reconnaître que tous <strong>le</strong>s direc<br />
teurs à l'image <strong>de</strong> Mhoi-Ceul, n'avaient fait que répondre<br />
à un slogan mieux connu: "enrichissez-vous", lancé par<br />
la classe dirigeante. Ce fait fut cautionné par l'Etat,<br />
jusqu'au moment où <strong>de</strong>s économistes comme Valy Diarrassouba<br />
et Samir Amin avaient réaffirmé <strong>le</strong> déclin du libéralisme;<br />
c'est alors que <strong>le</strong>s dirigeants politiques, sous <strong>le</strong> couvert<br />
d'un assainissement, ont été amenés à dissoudre purement<br />
et simp<strong>le</strong>ment <strong>le</strong>s sociétés d'Etat, <strong>le</strong>s ex-directeurs gar<br />
dant cependant <strong>le</strong>urs privilèges. C'est dans un tel contexte<br />
que s'inscrit la critique <strong>de</strong> la bureaucratie dans l'oeuvre<br />
(1) Cité par C. <strong>de</strong> Miras, op. cit., p. 223.
Bernard Dadié.<br />
127<br />
La constance <strong>de</strong> la caricature <strong>de</strong> l'homme politique<br />
dans <strong>le</strong> théâtre dadiéen, permet <strong>de</strong> mieux voir <strong>le</strong>s bouffons<br />
qui entrent sur la scène politique. Cette caricature,<br />
souligne <strong>le</strong> Professeur Balandier, "... c'est aussi, sur-<br />
tout, <strong>le</strong> portrait-charge qui ridiculise <strong>le</strong>s gens <strong>de</strong><br />
pouvoir et <strong>le</strong>s transforme en Bouffons du peup<strong>le</strong>... " (1)<br />
Cette métho<strong>de</strong> véhicu<strong>le</strong> une <strong>le</strong>çon <strong>de</strong> pratique politique<br />
chez Dadié. Car, <strong>pour</strong> lui, "dans un mon<strong>de</strong> <strong>de</strong> tyrannie,<br />
réclamer la liberté <strong>pour</strong> un individu ou un peup<strong>le</strong> asservi<br />
est <strong>le</strong> <strong>de</strong>voir sacré <strong>de</strong> tout homme libre et conscient." (2)<br />
Cette fonction, Da-diél'attribue au théâtre.· Il montre·<br />
ainsi que dans une Afrique en profon<strong>de</strong> mutation, où notre<br />
vie quotidienne est mue par <strong>de</strong>s besoins nouveaux qui<br />
échappent à notre contrô<strong>le</strong>, qu'il soit politico-économique<br />
ou socio-culturel, l'artiste ne saurait se dérober à la<br />
mission qui lui incombe.<br />
C'est <strong>pour</strong>quoi, outre la critique du pouvoir militaire<br />
et ses carences, l'écrivain ivoirien parodie tout type<br />
<strong>de</strong> pouvoir néo-colonialiste voire mimétique. Son théâtre<br />
dévoi<strong>le</strong> que <strong>le</strong> pouvoir <strong>de</strong> certains pays africains se<br />
sert d'idéologie tribaliste comme moyen privilégié <strong>de</strong><br />
domination politique; toute une panoplie <strong>de</strong> moyens insi-<br />
dieux <strong>de</strong> vulgarisation, est mise en place <strong>pour</strong> inculquer<br />
méthodiquement ce germe à la masse. La passion <strong>de</strong> pouvoir<br />
qui anime alors la classe dirigeante, la pousse à mystifier<br />
(1) G. Balandier, op. cit., p. 88.<br />
(2) B. Dadié, Opinions d'un Nègre, Dakar, N.E.A., 1979,<br />
p. 160.
128<br />
<strong>le</strong> peup<strong>le</strong> par <strong>de</strong>s images grandiloquentes faites "selon<br />
un mo<strong>de</strong> qui associe la tragédie, dont <strong>le</strong>s peup<strong>le</strong>s souffrent,<br />
et <strong>le</strong> grotesque autocratique, dont <strong>le</strong>s gouvernants parent<br />
<strong>le</strong>ur médiocrité " (l).Ce mécanisme est bien analysé par<br />
Dadié, <strong>pour</strong> mieux montrer <strong>le</strong> visage réel <strong>de</strong> ces carica-<br />
tures <strong>de</strong> pouvoir, nourries d'idéologie rétrogra<strong>de</strong>. Ces<br />
pratiques, entretenues par l'Etat à parti unique surtout,<br />
débouchent sur la dictature autocratique. . (2)<br />
Après cette <strong>de</strong>scription <strong>de</strong>s différents types <strong>de</strong><br />
pouvoir, nous nous proposons maintenant <strong>de</strong> déce<strong>le</strong>r <strong>le</strong>ur<br />
fonctionnement.<br />
(1) G. Balandier, op. cit. p. 21.<br />
(2) Voir l'aspect <strong>de</strong>scriptif <strong>de</strong> ce type <strong>de</strong> pouvoir dans<br />
notre mémoire <strong>de</strong> maîtrise, Le pouvoir dans <strong>le</strong> théâtre<br />
<strong>de</strong> Dadié, p. 25 et suivante.
DEUXIEME PARTIE<br />
L'EXERCICE DU POUVOIR<br />
ET SA REMISE EN CAUSE
132<br />
la structure économique, sont <strong>de</strong>venus la force exploiteuse<br />
<strong>de</strong> la majorité populaire qui croupit dans la misère.<br />
L'indépendance aura donc renforcé la lutte <strong>de</strong>s classes<br />
dans <strong>le</strong>s sociétés africaines. Le tan<strong>de</strong>m dominant-dominé,<br />
<strong>de</strong>venu un schéma classique, est toujours présent dans <strong>le</strong><br />
théâtre <strong>de</strong> Dadié.<br />
l - 1. La classe dominante<br />
El<strong>le</strong> apparaît plus homogène et est constituée <strong>de</strong><br />
l'ancienne bourgeoisie féoda<strong>le</strong> qui travailla <strong>de</strong> concert<br />
avec <strong>le</strong>s représentants coloniaux du Grand Capital Inter<br />
national. Selon <strong>le</strong> Professeur Kotchy, "<strong>le</strong> colonialisme<br />
<strong>pour</strong> perpétuer la main-mise sur l'économie nationa<strong>le</strong>, ne<br />
s'est pas contenté <strong>de</strong> former à sa dévotion <strong>de</strong>s auxiliaires<br />
<strong>de</strong> la trempe <strong>de</strong> Thôgô-gnini, il s'est doté d'autres repré<br />
sentants soit auprès <strong>de</strong> la bourgeoisie féoda<strong>le</strong>, soit<br />
auprès <strong>de</strong> la royauté. Le capitalisme ayant ainsi réussi<br />
à domestiquer ces souverains ou dignitaires africains,<br />
il en a fait ses alliés et après l'indépendance, nous<br />
voyons nettement <strong>de</strong>ux classes socia<strong>le</strong>s, la bourgeoisie<br />
nationa<strong>le</strong> et <strong>le</strong> peup<strong>le</strong>." (1) Cette bourgeoisie, composée<br />
<strong>de</strong> riches commerçants, <strong>de</strong> grands planteurs, <strong>de</strong> courtiers,<br />
s'assimi<strong>le</strong> faci<strong>le</strong>ment à la classe dirigeante qui détient<br />
<strong>le</strong>s rênes du pouvoir politique et économique. El<strong>le</strong><br />
représente ainsi la force économique dominante, la force<br />
idéologique dominante et la force juridico-politique<br />
(1) B. Kotchy, op. cit., pp. 157-158.
dominante.<br />
133<br />
c'est <strong>pour</strong>quoi nous l'appel<strong>le</strong>rons classe dominante,<br />
c'est-à-dire <strong>le</strong> groupe social qui, <strong>de</strong> par la position<br />
privilégiée et stratégique qu'il occupe dans la structure<br />
socia<strong>le</strong>, dicte sa volonté à l'autre groupe social qui<br />
occupe une position défavorisée, donc dominé par rapport<br />
au premier. Disposant du pouvoir d'Etat et <strong>de</strong> tous <strong>le</strong>s<br />
moyens d'influence, la classe dominante est <strong>de</strong>venue la<br />
classe dirigeante, mise en cause par <strong>le</strong> dramaturge ivoirien.<br />
Nous <strong>le</strong> verrons plus loin, el<strong>le</strong> usera <strong>de</strong> tous ces moyens,<br />
<strong>pour</strong> faire obstac<strong>le</strong> à toute idée progressiste en voie<br />
d'éclosion, fût-ce au prix dB la vio<strong>le</strong>nce. En résumé,<br />
il faut retenir que la classe dominante est aussi la<br />
classe dirigeante dans <strong>le</strong> théâtre <strong>de</strong> Dadiéj la bourgeoisie<br />
commercia<strong>le</strong> et la bourgeoisie bureaucratique ne sont en<br />
fait que ses féaux. Dans <strong>le</strong>s pièces <strong>de</strong> Dadié, aucune<br />
différenciation n'est possib<strong>le</strong> entre <strong>le</strong> pouvoir et ses<br />
féaux.<br />
l - 2. La classe dominée<br />
El<strong>le</strong> est moins homogène, moins structurée que la<br />
classe dominante. C'est el<strong>le</strong> que Dadié appel<strong>le</strong> "<strong>le</strong> peup<strong>le</strong>"<br />
avec toute la dimension que ce mot recouvre. Cette classe<br />
souffre <strong>de</strong> l'exploitation et <strong>de</strong> l'oppression organisées<br />
<strong>de</strong> la première. La <strong>de</strong>scription que l'écrivain ivoirien<br />
en donne est très émouvante :
139<br />
monter <strong>le</strong>s appels du tam-tam, c'est <strong>pour</strong><br />
tenir évei. l.Lés <strong>le</strong> s dieux... 1/ ( 1)<br />
A travers ces répliques, l'hérolne <strong>de</strong> la pièce <strong>de</strong> B. Dadié<br />
dénonce vivement <strong>le</strong> christianisme qui favorisa l'instal-<br />
lation d'une société inégalitaire. Au niveau même <strong>de</strong> son<br />
langage, la structuration topographique <strong>de</strong> la société,<br />
<strong>de</strong>vient une structuration idéologique: l'espace occupé<br />
géographiquement par <strong>le</strong>s riches, est aussi l'espace du<br />
Pouvoir, où dirigeants et riches commerçants cohabitent<br />
dans un luxe époustouflant. Cet espace clos symbolise<br />
l'instrument d'oppression, d'asservissement, dans la<br />
mesure où, superposé à la structure socia<strong>le</strong>, il est <strong>le</strong><br />
ref<strong>le</strong>t patent du mon<strong>de</strong> bourgeois qui tient <strong>le</strong>s rênes du<br />
pouvoir politique et économique; c'est donc un mon<strong>de</strong><br />
hiérarchisé. Opposés à cet espace, ce sont <strong>le</strong>s bidonvil<strong>le</strong>s<br />
crasseux évoqués par Béatrice, où vit la plèbe avec ses<br />
misères, ses maladies, sa famine. Cet aspect <strong>de</strong>s sociétés<br />
africaines fut bien observé par <strong>le</strong>s sociologues et <strong>le</strong>s<br />
anthropologues africanistes. Analysant ce fait, G. Balan-<br />
dier écrit: "Jusqu'à présent, <strong>le</strong>s Brazzavil<strong>le</strong>s noires<br />
dépendantes <strong>de</strong> la vil<strong>le</strong> européenne occupent une position<br />
"déjetée" par rapport à cette <strong>de</strong>rnière. Une sorte <strong>de</strong><br />
"no man's land" à peine touchée par <strong>le</strong>s extensions récentes<br />
<strong>le</strong>s sépare. Et <strong>le</strong> contraste s'affirme <strong>de</strong> plus en plus<br />
entre la vil<strong>le</strong> où s'élèvent, se multiplient constructions<br />
et immeub<strong>le</strong>s et <strong>le</strong>s centres qui conservent l'allure <strong>de</strong><br />
(1) Béatrice... , acte III, tab<strong>le</strong>aux l et IV, pp. 118, 138<br />
et 144.
142<br />
scalies peignent bien cette étape :<br />
"Transpirant, lance au poing, arc et carquois<br />
en bandoulière, besace <strong>de</strong> vivres aussi, chasse<br />
mouches sous l'aissel<strong>le</strong>, <strong>le</strong>s jambes en sang<br />
labourées par <strong>le</strong>s épineux, il avance.. ," (1)<br />
Après avoir franchi tous <strong>le</strong>s obstac<strong>le</strong>s, Nahoubou atteint<br />
la grotte du sorcier. Pour révé<strong>le</strong>r la mystique qui entou<br />
re <strong>le</strong> pouvoir, B. Dadié décrit <strong>le</strong> repa:re du sorcier, comme<br />
étant un univers lugubre, en cOillffiunion intime avec <strong>le</strong>s<br />
forces <strong>de</strong> la nature. La présentation <strong>de</strong> ce lieu mystérieux<br />
sous <strong>le</strong>s faisceaux lumineux <strong>de</strong> la scène, donne plus <strong>de</strong><br />
poids à la crédibilité du personnage du sorcier<br />
-ffLumière SUI' une grotte, <strong>de</strong>s meub<strong>le</strong>s rudimen<br />
taires, <strong>de</strong>s masques, un feu allumé. Bacoulou,<br />
un vieil homme est assis SUI' un tabouret; <strong>de</strong>vant<br />
lui, SUI' un autre tabouret : Nahoubou. PaY' inter<br />
val<strong>le</strong>s, on entend croitre et décroitre <strong>le</strong>s bruits<br />
<strong>de</strong> la forêt. Bacoulou souvent fixera <strong>le</strong>s flam<br />
mes, comme <strong>pour</strong> y puiser son inspiration." (1)<br />
Cette <strong>de</strong>scription fait écho aux consultations <strong>de</strong>s féti-<br />
cheurs, auxquel<strong>le</strong>s s'adonnent quotidiennement certains<br />
hommes politiques, <strong>de</strong> la trempe <strong>de</strong> Nahoubou 1. Ce fait<br />
montre implicitement que <strong>le</strong> pouvoir acquis dans <strong>de</strong> tel<strong>le</strong>s<br />
conditions, malgré <strong>le</strong>s mises en gar<strong>de</strong> du sorcier, débou<br />
che toujours sur l'autocratie. Alors, on procè<strong>de</strong> à <strong>de</strong>s<br />
sacrifices humains, <strong>le</strong>s plus odieux, <strong>pour</strong> affermir <strong>le</strong><br />
trône. Ainsi Nahoubou <strong>de</strong>vra-t-il sacrifier son frère et<br />
sa mère, sous l'ordre du sorcier; nous y reviendrons plus<br />
loin.<br />
(1) Les Voix... , pp. 50-51.
143<br />
Oadié dêvoi<strong>le</strong> ainsi, comme <strong>le</strong> fait remarquer Marta<br />
Harnecker qu''' ... il se peut donc que certains éléments<br />
idéologiques se transmettent d'une formation socia<strong>le</strong> à une<br />
autre; mais ces éléments sont toujours mis au service <strong>de</strong>s<br />
intérêts <strong>de</strong>s classes dominantes, auxquel<strong>le</strong>s ils servent<br />
d'instruments <strong>de</strong> lutte." (1) Nous reviendrons sur cette<br />
idée. On voit ainsi que la profon<strong>de</strong> mutation qu'a connue<br />
l'Afrique n'a pas empêché la continuité <strong>de</strong> certaines pra<br />
tiques liées au pouvoir traditionnel.<br />
Après avoir décrit brièvement <strong>le</strong> processus <strong>de</strong> la<br />
quête <strong>de</strong> pouvoir, nous nous proposons maintenant d'analy<br />
ser <strong>le</strong> fonctionnement <strong>de</strong> ce pouvoir. Comment l'homme<br />
politique use-t-il <strong>de</strong> ce pouvoir ? Et quels sont <strong>le</strong>s<br />
traits dominants <strong>de</strong> ce pouvoir?<br />
II - LA CONCENTRATION OC POUVOIR<br />
En effet, dans <strong>le</strong>s pièces <strong>de</strong>Oadié, tous <strong>le</strong>s héros<br />
politiques sont mis dans une situation dramatique, qu'ils<br />
créent et conditionnent eux-mêmes. Arrivés au pouvoir<br />
dans <strong>de</strong>s pério<strong>de</strong>s <strong>de</strong> crise, ces dirigeants exercent <strong>le</strong><br />
comman<strong>de</strong>ment d'une main autoritaire, aidés en cela par<br />
<strong>de</strong>s courtisans et <strong>de</strong>s alliés vénaux. Cette attitu<strong>de</strong> débou<br />
che sur un fait constant dans <strong>le</strong> théâtre <strong>de</strong> Oadié: la<br />
concentration du pouvoir.<br />
Ce phénomène se manifeste selon <strong>le</strong> Professeur Sylla,<br />
par l'hypertrophie <strong>de</strong> l'exécutif au détriment du<br />
(1) Marta Harnecker, op. cit., p. 83.
154<br />
par la déification du chef politique. Ce procédé minutieu-<br />
sement cultivé, débouche sur la personnalisation du pouvoir<br />
que <strong>le</strong> dramaturge remet d'ail<strong>le</strong>urs en cause.<br />
111- LA PERSONNALISATION DU POUVOIR<br />
Tout pouvoir à direction unique, <strong>pour</strong> légitimer sa<br />
domination, se réfère à plusieurs processus tendant à la<br />
mise en ve<strong>de</strong>tte du chef. Cet aspect est mis en relief<br />
dans <strong>le</strong>s pièces <strong>de</strong> Dadié, et semb<strong>le</strong> être la conséquence<br />
immédiate <strong>de</strong> toute concentration du pouvoir. Pour mieux<br />
cerner ce phénomène qui pousse à l'extrême personnalisa-<br />
tion du pouvoir, il convient d'abord <strong>de</strong> définir ce <strong>de</strong>rnier<br />
terme.<br />
Nous entendons par personnalisation du pouvoir ou<br />
mieux, par pouvoir personnalisé, tout pouvoir incarné<br />
par un seul individu qui, en tant que tel, se croit l'élu<br />
<strong>de</strong>s dieux, chargé <strong>de</strong> prési<strong>de</strong>r au <strong>de</strong>stin <strong>de</strong> son peup<strong>le</strong>.<br />
Ici, <strong>le</strong> terme est dépouillé <strong>de</strong> toute idée <strong>de</strong> textes juri-<br />
diques pré-établis, dictant la conduite du chef sous <strong>le</strong><br />
contrô<strong>le</strong> <strong>de</strong>s mortels. Notre définition s'oppose ainsi<br />
à cel<strong>le</strong> du Professeur J. Dehaussy qui affirme que "dire<br />
que <strong>le</strong> pouvoir est personnalisé... peut en effet signifier,<br />
d' abord, que <strong>le</strong> pouvoir <strong>de</strong> gouvernement - au sens large<br />
est effectivement concentré, <strong>de</strong> par <strong>le</strong>s institutions du<br />
droit positif, entre <strong>le</strong>s mains d'un homme." (1) Mais <strong>le</strong><br />
pouvoir personnalisé tel qu'il apparaît dans <strong>le</strong>s oeuvres<br />
(1) J. Dehaussy, "Ouverture du colloque", in La personnalisation<br />
du pouvoir, p. 3.
158<br />
quels il se prête. Le portrait légitime ainsi non seu<strong>le</strong>-<br />
ment sa fonction politique perçue comme éternel<strong>le</strong>, mais<br />
aussi et surtout sa place <strong>de</strong> surhomme dans <strong>le</strong>s consciences<br />
col<strong>le</strong>ctives.<br />
Le personnage <strong>de</strong> Diogo révè<strong>le</strong> bien que <strong>le</strong> portrait,<br />
au niveau politique, joue une fonction primordia<strong>le</strong> dans<br />
l'endoctrinement idéologique <strong>de</strong>s masses; il apparaît aussi<br />
comme sources <strong>de</strong> profits économiques réalisés sur <strong>le</strong> dos<br />
du peup<strong>le</strong> par <strong>le</strong> dirigeant et par celui qui fait la publi-<br />
cité du même portrait en <strong>le</strong> reproduisant sur <strong>le</strong>s pagnes.<br />
On peut affirmer avec Solange Ouvard que "<strong>le</strong> portrait<br />
fonctionne ici comme un opérateur idéologique : il permet<br />
la mise en discours <strong>de</strong> la passion figurée iconiquement<br />
selon une appropriation transformée <strong>de</strong>s va<strong>le</strong>urs idéologi-<br />
ques plus ou moins explicitement exprimée dans ces récits;<br />
il Y a une fonction instructrice <strong>de</strong>s récits en un doub<strong>le</strong><br />
sens informatif et formateur : il enseigne <strong>le</strong> sujet,<br />
l'informe et l'éduque." (1) Le portrait chez Dadié résume<br />
<strong>le</strong>s ambitions du tyran exploiter <strong>le</strong>s masses et amasser<br />
une fortune colossa<strong>le</strong>, ensuite légitimer cette exploitation<br />
par une publicité mensongère. Mo<strong>de</strong>lé ainsi, <strong>le</strong> roi ne<br />
tar<strong>de</strong>ra pas à s'ériger en omnipotent, maintenant <strong>le</strong> pays<br />
dans <strong>le</strong>s fers. Toute volonté qui n'est pas la sienne est<br />
réprimée. Le théâtre <strong>de</strong> Dadié dénonce avec vigueur la gri-<br />
serie du pouvoir, qui suit, selon Hampaté Bah, trois étapes<br />
(1) Solange Ouvard, "L'assujettissement au portrait",<br />
(Deuxième partie, scènographie <strong>de</strong> La princesse <strong>de</strong> Clèves),inDia<strong>le</strong>ctiques,<br />
n ? 20,1977, p. 49.
159<br />
essentiel<strong>le</strong>s liées au phénomène même du pouvoir. Le pou<br />
voir, dit Hampaté Bah, "est, hélas, comme l'alcool. Après<br />
<strong>le</strong> premier verre, on est joyeux comme un agneau. Au second,<br />
c'est comme si on avait mangé du lion. On se sent si<br />
fort qu'on n'accepte plus d'être contesté. On veut tout<br />
imposer à tout <strong>le</strong> mon<strong>de</strong> comme <strong>le</strong> lion dans la savane.<br />
Au troisième verre, on est comme <strong>le</strong> cochon, on ne peut<br />
f aire que <strong>de</strong>s cochonnerie s ." (l) Poursuivant son analyse,<br />
Hamapaté Bah signa<strong>le</strong> que "<strong>le</strong> premier <strong>de</strong>gré correspond à<br />
la pério<strong>de</strong> où <strong>le</strong> chef est doux et gentil comme un agneau.<br />
Le second, c'est <strong>le</strong> moment où <strong>le</strong> chef, se prenant <strong>pour</strong> un<br />
monarque absolu, <strong>de</strong>vient redoutab<strong>le</strong>. Mais alors il n'est<br />
que craint. Enfin, quand <strong>le</strong> chef atteint <strong>le</strong> troisième<br />
<strong>de</strong>gré <strong>de</strong> son pouvoir, il est non seu<strong>le</strong>ment craint, mais<br />
détesté par son peup<strong>le</strong>." (1)<br />
Tous <strong>le</strong>s dirigeants politiques mis en jeu dans <strong>le</strong><br />
théâtre dadiéen suivent ces différentes étapes décrites<br />
par <strong>le</strong> sage Hampaté Bah; grisés par <strong>le</strong>s honneurs et la<br />
gloire, <strong>le</strong>ur souci premier est <strong>de</strong> s'insérer à tout prix<br />
dans l'histoire. On assiste alors à. une "routinisation"<br />
<strong>de</strong> la personnalisation du pouvoir qui atteint son point<br />
culminant dans Les Voix dans <strong>le</strong> vent, avec la construction<br />
d'un personnage monstrueux qui veut soumettre tous <strong>le</strong>s<br />
éléments <strong>de</strong> la nature à sa volonté :<br />
(1) S. Diallo, op. cit., p. 89.
161<br />
charrier) <strong>le</strong>s drainer... coups <strong>de</strong> fusil) marque<br />
essentiel<strong>le</strong> <strong>de</strong> la puissance. Que s'élèvent <strong>de</strong><br />
partout p<strong>le</strong>urs) supplications) prières) râ<strong>le</strong>s<br />
d'agonie... Je ne veux plus rien entendre) ex<br />
cepté l'écho <strong>de</strong> ma voix) <strong>de</strong> ma voix impéria<strong>le</strong>."<br />
(1)<br />
Pour cautionner ces types <strong>de</strong> dictature, <strong>le</strong>s dirigeants<br />
procè<strong>de</strong>nt à un endoctrinement pur et simp<strong>le</strong> <strong>de</strong>s peup<strong>le</strong>s,<br />
marqués par l'oppression et réduits au rô<strong>le</strong> <strong>de</strong> sujets.<br />
Les nouveaux Etats révolutionnaires africains illustrent<br />
bien ces données. Les paro<strong>le</strong>s du grand thaumaturge inon-<br />
<strong>de</strong>nt toutes <strong>le</strong>s masses, fraient <strong>le</strong> chemin à tout discours<br />
politique, à tout journal parlé <strong>pour</strong> étoffer l'image<br />
du monstre habillé en "sauveur", en "père <strong>de</strong> la Nation".<br />
Le Mani Congo, chef divinisé, <strong>le</strong> montre bien dans Béatrice<br />
du Congo, en s'enfonçant dans la bêtise humaine:<br />
Le Roi<br />
'Vurez tous <strong>de</strong> me suivre en tout et partout.<br />
En tant que père <strong>de</strong> la Nation) j'intime l'ordre<br />
à tous <strong>de</strong> me suivre aveuglément."<br />
La Fou<strong>le</strong><br />
'Wous <strong>le</strong> jurons 1" (2)<br />
Dans <strong>de</strong> pareil<strong>le</strong>s situations, <strong>le</strong> peup<strong>le</strong> dépenaillé, apeuré,<br />
exploité, n'ayant d'autre moyen, va suivre dans une abné-<br />
gation tota<strong>le</strong>, "<strong>le</strong> gui<strong>de</strong> suprême <strong>de</strong> la Nation", croyant<br />
pouvoir ainsi atteindre son accomplissement et la réalisa-<br />
tion <strong>de</strong> ses idéaux. On voit ici l'une <strong>de</strong>s faces <strong>de</strong> la<br />
"routinisation" du charisme, qui débouche sur un paterna-<br />
(1) Les Voix , pp. 95, 141-142.<br />
(2) Béatrice , acte II, tab<strong>le</strong>au 1, p. 78.
162<br />
lisme bon enfant que <strong>le</strong> peup<strong>le</strong> voue à son dirigeant<br />
c'est la domination"patrimonia<strong>le</strong>" <strong>pour</strong> reprendre un terme<br />
cher à M. Weber. Selon C. Coulon, "la domination "patri-<br />
monia<strong>le</strong>" est la forme la plus courante <strong>de</strong> domination<br />
"traditionnel<strong>le</strong>". El<strong>le</strong> se caractérise par l'obéissance<br />
et la fidélité à un chef qui perpétue "l'éternel d'hier".<br />
L'autorité patrimonia<strong>le</strong> est donc personnel<strong>le</strong>. Le chef<br />
est un seigneur, non un magistrat. Ce pouvoir lui appar-<br />
tient en vertu d'attributs personnels conférés par la<br />
tradition." (1) Cet aspect est minutieusement exploité<br />
par <strong>le</strong>s dirigeants africains actuelsi car, s'i<strong>de</strong>ntifiant<br />
au père mythique <strong>de</strong> la communauté, <strong>le</strong> chef s'approprie<br />
tous <strong>le</strong>s attributs religieux du pouvoir, <strong>pour</strong> parfaire<br />
sa stature <strong>de</strong> "père <strong>de</strong> la Nation". Tous <strong>le</strong>s éléments se-<br />
ront réunis <strong>pour</strong> asseoir cette image méliorative, qui<br />
subira une enflure grotesque chez certains courtisansi<br />
<strong>le</strong> dramaturge ivoirien dévoi<strong>le</strong> <strong>le</strong> mécanisme à travers <strong>le</strong><br />
roi Nahoubou 1er, qui, s'adressant à sa cour, veut se<br />
faire accepter par <strong>le</strong> peup<strong>le</strong>, comme ayant une origine<br />
divine :<br />
Nahoubou 1er<br />
"Il importe que <strong>le</strong> peup<strong>le</strong> sache <strong>de</strong> quel<strong>le</strong> écla<br />
tante naissance est son macadou; qu'on sache<br />
enfin d'un bout à l'autre du royaume que je<br />
<strong>de</strong>scends ... que disais-je encore? ... du<br />
génie Kaiman. (S'adressant à Kablan <strong>le</strong> courti<br />
san). On ne sait pas encore assez qui je suis.<br />
Par<strong>le</strong> <strong>de</strong> moi partout. Que personne n'ignore<br />
(1) Christian Coulon, Le marabout et <strong>le</strong> prince, p. 102.
164<br />
ceptib<strong>le</strong>s <strong>de</strong> lui procurer <strong>le</strong> bonheur. Cet aspect nous<br />
semb<strong>le</strong> profusément utilisé par <strong>le</strong>s dirigeants actuels<br />
<strong>pour</strong> asseoir <strong>le</strong>ur crédibilité sous <strong>le</strong> manteau <strong>de</strong> divers<br />
phénomènes qui masquent <strong>le</strong> pouvoir.<br />
Cette récupération <strong>de</strong>s aspects du pouvoir tradition<br />
nel n'échappe pas à Dadié. Il <strong>le</strong> révè<strong>le</strong> ici par l'inter<br />
médiaire du théâtre, <strong>pour</strong> insister sur l'impact du re<br />
ligieux sur <strong>le</strong>s dirigeants politiques africains et <strong>le</strong>ur<br />
peup<strong>le</strong>. A ce propos, <strong>le</strong> Professeur G. Balandier signa<strong>le</strong><br />
que "tantôt la dramaturgie politique traduit la formula<br />
tion religieuse, el<strong>le</strong> fait <strong>de</strong> la scène du pouvoir une<br />
réplique ou une manifestation <strong>de</strong> l'autre mon<strong>de</strong>. La hié<br />
rarchie est sacrée... et <strong>le</strong> souverain relève <strong>de</strong> l'ordre<br />
divin, y appartenant ou en tenant son mandat. Tantôt,<br />
<strong>pour</strong>sùit Balandier, <strong>le</strong> passé col<strong>le</strong>ctif, élaboré en une<br />
tradition, en une coutume <strong>de</strong>vient la source <strong>de</strong> légitima<br />
tion. Il est une réserve d'images, <strong>de</strong> symbo<strong>le</strong>s, <strong>de</strong> modè<strong>le</strong>s<br />
d'action; il permet d'employer une histoire idéalisée,<br />
construite et reconstruite selon <strong>le</strong>s nécessités, au ser<br />
vice du pouvoir présent. Ce <strong>de</strong>rnier gère et assure ses<br />
privilèges, par la mise en scène d'un héritage." (1)<br />
Ce procédé bien démasqué ici par Balandier, ne peut que<br />
renforcer effectivement <strong>le</strong> pouvoir personnel <strong>de</strong> certains<br />
chefs "mo<strong>de</strong>rnes" africains qui, tout en affirmant l'au<br />
thenticité africaine, se contentent <strong>de</strong> récupérer <strong>le</strong>s<br />
attributs sclérosés du pouvoir traditionnel à <strong>le</strong>ur profit<br />
(1) G. Balandier, op. cit., pp. 16-17.
165<br />
<strong>pour</strong> maintenir <strong>le</strong>ur peup<strong>le</strong> dans <strong>le</strong>s fers. Une tel<strong>le</strong><br />
attitu<strong>de</strong> dévoilée par B. Dadié, traduit <strong>le</strong> manque d'es-<br />
prit d'initiative et <strong>de</strong> création <strong>de</strong> la part <strong>de</strong> ces<br />
dirigeants fantoches. On arrive à une tel<strong>le</strong> confusion<br />
<strong>de</strong>s pouvoirs que <strong>le</strong>s chefs traditionnels, cooptés par <strong>le</strong><br />
nouveau pouvoir en place, se sentent trompés, déçus. Le<br />
résultat final, c'est <strong>le</strong> si<strong>le</strong>nce apeuré que nous avons<br />
évoqué plus haut. Cette gran<strong>de</strong> confusion <strong>de</strong>s pouvoirs est<br />
manifeste dans <strong>le</strong> comportement même <strong>de</strong>s dirigeants; ils<br />
agissent au gré <strong>de</strong> <strong>le</strong>ur volonté, en écartant systématique-<br />
ment la plupart du temps <strong>le</strong>s aspects positifs du pouvoir<br />
traditionnel et <strong>le</strong>s nouveaux textes qu'ils ont élaborés<br />
et qu'ils appel<strong>le</strong>nt "constitution" ou "co<strong>de</strong>s civils".<br />
Dadié <strong>le</strong> dénonce avec humour à travers <strong>le</strong>s propos <strong>de</strong><br />
Mhoi-Ceul, ref<strong>le</strong>t patent <strong>de</strong> l'abus <strong>de</strong> pouvoir; nous dé-<br />
couvrons <strong>le</strong> personnage dans ce dialogue avec un <strong>de</strong> ses<br />
employés qu'il veut licencier arbitrairement<br />
Taco <strong>le</strong> Vieux (l'employé)<br />
nIl y a <strong>de</strong>s textes . . . . tant qu'il est en<br />
vigueur.> un texte <strong>de</strong>meure un texte. n<br />
Mhoi-Ceul<br />
"Les textes ? C'est noue qU1.- <strong>le</strong>s interprétons<br />
nous qui <strong>le</strong>s appliquons. Nous sommes <strong>le</strong>s mat<br />
tres <strong>de</strong>s textes.<br />
Homme d'une autre époque! Un texte n'a qu'une<br />
va<strong>le</strong>ur relative J<br />
toute relative. On peut faire<br />
dire à un texte tout ce qu'on veut.<br />
Croire encore au pouvoir <strong>de</strong>s textes. Hum !<br />
Mais ouvrez donc <strong>le</strong>s yeux J bon sang ! Le pou<br />
voir J c'est nous J <strong>le</strong>s textes J
167<br />
Le Notab<strong>le</strong><br />
"Que tu es <strong>le</strong> Macadou suprême) que toutes <strong>le</strong>s<br />
intelligences ici réunies ne va<strong>le</strong>nt pas ton<br />
intelligence.<br />
Prends gar<strong>de</strong>! Le pouvoir plus que l'alcool<br />
enivre et conduit à la mort. Gar<strong>de</strong>-toi<br />
surtout <strong>de</strong> traiter en ennemis) <strong>de</strong>main) tes<br />
amis d'aujourd'hui.<br />
Souviens-toi) on gouverne avec <strong>le</strong> coeur et non<br />
avec <strong>de</strong>s caprices) <strong>de</strong>s fureurs) <strong>de</strong>s rancoeurs.<br />
Le malheur <strong>pour</strong> un macadou est <strong>de</strong> se croire <strong>le</strong><br />
maitre <strong>de</strong> l'univers parce qu'il règne sur la<br />
conscience <strong>de</strong> quelques hommes. Apprends donc<br />
à être) juste) équitab<strong>le</strong>... " (1)<br />
Comment ne pas voir dans ces mots l'essence d'un pouvoir<br />
à visage humain? Mais hélas, <strong>le</strong>s nouveaux chefs ne l'ont<br />
jamais compris. Dadié démontre en se référant à la socié-<br />
té Sanwi, comme nous l'avons explicité plus haut, que <strong>le</strong><br />
chef n'est que <strong>le</strong> délégué du peup<strong>le</strong>, qu'il pouvait être<br />
révoqué dès que sa conduite divorçait d'avec <strong>le</strong> serment<br />
populaire. Aucune place n'était faite à tout ce qui pou-<br />
vait conduire au caractère irrévocab<strong>le</strong> du pouvoir, à la<br />
personnalisation ou à la déification du dirigeant. Dans<br />
<strong>le</strong> cas par exemp<strong>le</strong> <strong>de</strong>s Malinké, <strong>le</strong>s griots et <strong>le</strong>s cousins<br />
à plaisanterie ou sanankun, constituaient un véritab<strong>le</strong><br />
couteau à doub<strong>le</strong> tranchant <strong>pour</strong> <strong>le</strong> chef. Selon Hampaté<br />
Bah, "avec <strong>le</strong>s sanankun, nos pouvoirs traditionnels dis-<br />
posaient <strong>de</strong> contrepoids judicieux et efficaces. Il y<br />
(1) Les Voix... , pp. 71-72-73, voir aussi supra<br />
<strong>de</strong> gouvernement du Sanwi.<br />
Le mo<strong>de</strong>
168<br />
avait <strong>de</strong>s gens à qui il était permis <strong>de</strong> dire ses quatre<br />
vérités au roi sans risque aucun." (1)<br />
A partir <strong>de</strong> tous ces éléments, on découvre que la<br />
critique <strong>de</strong> l'écrivain ivoirien se fon<strong>de</strong> en gran<strong>de</strong> partie<br />
sur <strong>le</strong> manque total d'esprit <strong>de</strong> création <strong>de</strong>s dirigeants<br />
politiques, à partir <strong>de</strong> notre patrimoine traditionnel.<br />
Car, comme il <strong>le</strong> montre bien, il existe une richesse<br />
africaine en matière d'institution politique; exploitée<br />
scientifiquement, cel<strong>le</strong>-ci <strong>pour</strong>ra donner à l'Afrique<br />
<strong>de</strong>venue terrain <strong>de</strong> la violation <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> l'homme,<br />
un visage plus humain et même une spécificité politique.<br />
Tous <strong>le</strong>s pouvoirs mis en place après <strong>le</strong>s Indépendan<br />
ces ne sont qu'à <strong>de</strong>s exceptions près, <strong>de</strong>s caricatures <strong>de</strong><br />
dictatures avec <strong>le</strong>ur cortège <strong>de</strong> répression, <strong>de</strong> torture,<br />
<strong>de</strong> manque total <strong>de</strong> liberté d'expression. Analysant ce<br />
nouveau type <strong>de</strong> <strong>de</strong>spotisme, Omar Konaré signa<strong>le</strong> que "la<br />
personnalisation traditionnel<strong>le</strong> du pouvoir a fait place<br />
au pouvoir personnel. A la gérance du pouvoir s'est sub<br />
stitué un pouvoir monocratique, souvent intolérant et<br />
improductif. Malgré tout, <strong>le</strong> pouvoir traditionnel et <strong>le</strong><br />
pouvoir contemporain coexistent toujours. Le pouvoir tra<br />
ditionnel, <strong>le</strong> plus influent, travail<strong>le</strong> dans l'ombre. Et<br />
<strong>le</strong> pouvoir contemporain, <strong>le</strong> pouvoir <strong>le</strong> plus en vue, est<br />
subi... Quand un chef <strong>de</strong> circonscription convoque la<br />
population ou ses représentants <strong>pour</strong> un débat, <strong>pour</strong>suit<br />
Konaré, c'est un si<strong>le</strong>nce "égrené" qui se termine par un<br />
(1) S. Diallo, op. cit., p. 89.
169<br />
"OUI" tel que <strong>le</strong> désire <strong>le</strong> pouvoir, mais un "OUI" non<br />
engageant. Pour certaines missions, se faire accompagner<br />
par un représentant <strong>de</strong> l'Administration, c'est courir<br />
à l'échec, <strong>le</strong> pouvoir étant perçu comme une force <strong>de</strong> ré-<br />
pression, au même titre que l'impôt et <strong>le</strong>s cotisations.<br />
Voter, conclut Konaré, c'est "éviter <strong>de</strong>s histoires", c'est<br />
faire comme <strong>le</strong>s représentants du pouvoir <strong>le</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>nt." (1)<br />
On comprend alors que tous ceux qui se pavanent sous<br />
<strong>le</strong> couvert <strong>de</strong> démocratie ou d'authenticité nègre, ne sont<br />
en réalité que <strong>de</strong>s potentats en puissance, assoiffés <strong>de</strong><br />
!<br />
sang, d'honneur et <strong>de</strong> glorio<strong>le</strong> à l'image <strong>de</strong> Nahoubou 1er.<br />
Ils sont tous grisés par <strong>le</strong> pouvoir comme·<strong>le</strong> montre ici<br />
Toussaint Louverture<br />
Toussaint Louverture (s'admirant dans<br />
une glace)<br />
"La vie! Hier cocher J<br />
mépriséj aujourd'hui J<br />
Général J honoré J et si je <strong>le</strong> veux J <strong>de</strong>main J<br />
Roi J<br />
empereur avec couronne et carrosse. Ce que<br />
ne comprendra jamais Moyse. Je suis <strong>le</strong> maitre<br />
ici." ( 2 )<br />
Dans ces propos plane encore l'ombre d'un Bokassa 1er,<br />
symbo<strong>le</strong> <strong>de</strong> la griserie du pouvoir. Les dirigeants du<br />
même acabit, par <strong>le</strong>ur cupidité exacerbée, <strong>le</strong>urs mensonges<br />
et <strong>le</strong>ur irresponsabilité, plongent chaque jour <strong>le</strong>ur peu-<br />
p<strong>le</strong> dans <strong>le</strong> scepticisme total. Face à tous ces maux,<br />
l'écrivain ivoirien B. Dadié ne peut <strong>de</strong>meurer dans un<br />
mutisme atterrant. C'est <strong>pour</strong>quoi il a choisi <strong>le</strong> théâtre<br />
(1) Omar Konaré, "La notion <strong>de</strong> pouvoir dans l'Afrique traditionnel<strong>le</strong><br />
et l'aire culturel<strong>le</strong> man<strong>de</strong>n en particulier",<br />
iD Le concept <strong>de</strong> pouvoir en Afrique, pp. 164-165.<br />
(2) I<strong>le</strong>s . . . , tab<strong>le</strong>au IV, scène 3, p. 70.
170<br />
<strong>pour</strong> traduire <strong>le</strong>s nouvel<strong>le</strong>s préoccupations du continent<br />
africain. Ancien militant communiste, Dadié sait plus<br />
que quiconque que l'oeuvre littéraire, expression patente<br />
<strong>de</strong> la réalité culturel<strong>le</strong> d'une époque, d'un lieu et d'un<br />
peup<strong>le</strong>, "doit être au service <strong>de</strong> la liberté et <strong>de</strong> l'homme.<br />
El<strong>le</strong> doit refléter <strong>le</strong>s caractères et la problématique<br />
du peup<strong>le</strong> qui l'inspire et auquel el<strong>le</strong> s'adresse si el<strong>le</strong><br />
veut réel<strong>le</strong>ment être saine et intéresser, luttant unie<br />
à son peup<strong>le</strong> en ses entrail<strong>le</strong>s mêmes, <strong>pour</strong> <strong>le</strong> triomphe <strong>de</strong><br />
la vérité et <strong>de</strong> la justice." (1) Epousant entièrement<br />
cette mission, <strong>le</strong> théâtre <strong>de</strong> Dadié ne se contente pas<br />
seu<strong>le</strong>ment d'une <strong>de</strong>scription servi<strong>le</strong> du ·pouvoir; il montre<br />
au-<strong>de</strong>là du mécanisme déc<strong>le</strong>nché par <strong>le</strong> dictateur ou <strong>le</strong><br />
<strong>de</strong>spote, tous <strong>le</strong>s moyens exploités méticu<strong>le</strong>usement <strong>pour</strong><br />
incarner l'image idéalisée du jirigeant charismatique<br />
dans <strong>le</strong>s consciences. Ces moyens sont multip<strong>le</strong>s, et tous<br />
servent à renforcer <strong>le</strong> pouvoir personnel.<br />
III - 2. Les moyens <strong>de</strong> renfort du pouvoir personnel<br />
2. 1. La mystification<br />
El<strong>le</strong> est fondée en gran<strong>de</strong> partie sur un fait marquant<br />
accompli par <strong>le</strong> dirigeant dans la pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> crise : par<br />
exemp<strong>le</strong>, l'accès à "l'indépendance" avec Toussaint Louver-<br />
ture, ou <strong>le</strong> coup d'Etat avec Nahoubou Ier. Quel<strong>le</strong> que soit<br />
la nature du pouvoir, la mystification a <strong>pour</strong> objet final<br />
l'endoctrinement pur et simp<strong>le</strong> <strong>de</strong>s masses <strong>pour</strong> qu'el<strong>le</strong>s<br />
(1) José Marti, N. Amérique, vol. 11, p. 363, cité par<br />
RAY Autra in la préface à Chaka <strong>de</strong> Djibril, T.N.,<br />
p. 16.
1 71<br />
acceptent l'homme politique comme "<strong>le</strong> sauveur" patenté.<br />
El<strong>le</strong> a toujours été <strong>le</strong> moyen privilégié <strong>de</strong> domination<br />
<strong>pour</strong> tout pouvoir autoritaire voire monocratique.<br />
Au niveau du théâtre <strong>de</strong> Dadié, la fonction mystifi-<br />
catrice se confond avec <strong>le</strong> courtisan ou <strong>le</strong> journaliste,<br />
griot mo<strong>de</strong>rne en Afrique. Tout en renforçant l'image <strong>de</strong><br />
marque du dictateur, <strong>le</strong> courtisan renforce sa propre<br />
richesse. Car <strong>le</strong> système est bien connu, il s'agit <strong>pour</strong><br />
lui <strong>de</strong> tenir <strong>de</strong>s propos élogieux, hissant <strong>le</strong> <strong>de</strong>spote<br />
sur un pié<strong>de</strong>stal. Ce procédé fut bien exploité par <strong>le</strong><br />
personnage <strong>de</strong> Mhoi-Ceul (1). Tous <strong>le</strong>s nouveaux moyens<br />
d'information permettent au tyran <strong>de</strong> "propager son portrait<br />
partout, cultivant ainsi <strong>le</strong>ntement mais sûrement un con-<br />
ditionnement culturel, chargé <strong>de</strong> maintenir <strong>le</strong> peup<strong>le</strong><br />
dans la soumission. Cet acte permet au dirigeant d'assu-<br />
rer la pérennité <strong>de</strong> son règne dans <strong>le</strong>s consciences. Selon<br />
Chamber lan, "la religion ne suffisant plus à tenir <strong>le</strong>s<br />
peup<strong>le</strong>s en main, <strong>le</strong>s régimes monarchistes ont été contraints<br />
d'inventer <strong>de</strong> nouvel<strong>le</strong>s mystifications: ainsi, ont pous-<br />
sé <strong>le</strong> mythe <strong>de</strong> la patrie (qui comprend généra<strong>le</strong>ment celui<br />
<strong>de</strong> la race) et <strong>le</strong> culte <strong>de</strong> la personnalité du chef, tous<br />
<strong>de</strong>ux moyens très efficaces <strong>pour</strong> créer une conscience<br />
col<strong>le</strong>ctive obéissante, et tous perfectionnés... par <strong>le</strong>s<br />
dictateurs du vingtième sièc<strong>le</strong>." (2) Nahoubou 1er avait<br />
déjà exigé <strong>de</strong> ses courtisans <strong>de</strong> faire sa publicité. Son<br />
(1) Voir supra, Le pouvoir bureaucratique.<br />
(2) Alan Chamberlan, Les personnages <strong>de</strong> chefs politiques<br />
dans <strong>le</strong> théâtre français 1919-1943, p. 236.
173<br />
mystification <strong>pour</strong> domestiquer l'adhésion populaire.<br />
Tel<strong>le</strong> qu'el<strong>le</strong> nous est présentée par <strong>le</strong> courtisan Kablan,<br />
l'image du monocrate, enflée, ne peut que mystifier <strong>le</strong><br />
peup<strong>le</strong>, surtout <strong>le</strong> peup<strong>le</strong> africain qui adhère faci<strong>le</strong>ment<br />
à ce type d'image mystificatrice; <strong>pour</strong> lui, la réalité<br />
est non seu<strong>le</strong>ment ce que nous voyons, ce que nous touchons<br />
mais aussi et surtout, ce dont nous sentons <strong>le</strong>s effets.<br />
c'est par cette philosophie que <strong>le</strong> pouvoir se trouve tou-<br />
jours défini <strong>de</strong>puis l'aube <strong>de</strong>s temps. Abreuvé donc d'ima-<br />
ges fulgurantes ayant <strong>pour</strong> support l'expérience col<strong>le</strong>ctive)<br />
<strong>le</strong> peup<strong>le</strong> ne peut que vouer toute sa confiance et son<br />
indéfectib<strong>le</strong> attachement au chef charismatique. Dadié<br />
révè<strong>le</strong> ici que "la quasi-totalité <strong>de</strong>s savoirs sous-<br />
tendant ces discours constituent <strong>de</strong>s opérateurs idéolo-<br />
giques <strong>de</strong> première force sur <strong>le</strong> pouvoir et <strong>pour</strong> <strong>le</strong> pouvoir."<br />
(1) Ainsi s'opère une sorte <strong>de</strong> détournement <strong>de</strong>s savoirs<br />
au seul profit <strong>de</strong>s dirigeants qui "... sont présentés,<br />
exhibés, encensés et investis (face à ceux qui ne savent<br />
pas, et qui n'ont pas <strong>le</strong> pouvoir <strong>de</strong> savoir et <strong>pour</strong><br />
savoir... ) <strong>de</strong> l'autorité et du pouvoir exclusifs <strong>de</strong> dire<br />
et <strong>de</strong> redire, d'égrener, <strong>de</strong> répéter et <strong>de</strong> discourir, <strong>de</strong><br />
crier, <strong>de</strong> vociférer et <strong>de</strong> "perroquetiser" sur ce savoir."<br />
(2) On débouche sur une "ve<strong>de</strong>ttisation" du chef politique<br />
qui, grisé par la glorio<strong>le</strong>, cultive la propagan<strong>de</strong> non<br />
seu<strong>le</strong>ment parce que son pouvoir l'exige, mais surtout<br />
<strong>pour</strong> occulter et mystifier <strong>le</strong> peup<strong>le</strong> en lui brandissant<br />
(1) L. Sylla, op. c i t , , p. 92.<br />
(2) Abdallah Baroudi, Idéologie, savoir, pouvoir dans<br />
l'institution capitaliste, pp. 8-9.
175<br />
L'Homme (un étranger)<br />
"Un uér-itab<strong>le</strong> don du cie l.:" (1)<br />
De ces propos, il ressort que <strong>le</strong> pouvoir et <strong>le</strong> savoir<br />
sont liés. Le savoir permet au pouvoir non seu<strong>le</strong>ment <strong>de</strong><br />
se maintenir mais aussi <strong>de</strong> se faire craindre. Le dirigeant,<br />
à travers <strong>le</strong>s propos du courtisan, apparaît comme " . . . ré<br />
cipient ontologique <strong>de</strong>s va<strong>le</strong>urs (<strong>de</strong> toutes <strong>le</strong>s va<strong>le</strong>urs) ,<br />
se proclamant <strong>de</strong> la raison, du savoir, <strong>de</strong> la science,<br />
se suggérant comme portant un <strong>de</strong>ssein universel et mes-<br />
s ianique... " (2) Un tel endoctrinement pousse <strong>le</strong>s masses<br />
à abdiquer <strong>le</strong>ur pouvoir <strong>de</strong> discernement <strong>de</strong> la vérité<br />
d'avec <strong>le</strong> mensonge, <strong>pour</strong> suivre <strong>le</strong> chef "illumineux"<br />
dans <strong>de</strong>s entreprises <strong>le</strong>s plus horrib<strong>le</strong>s. Dans <strong>le</strong> théâtre<br />
<strong>de</strong> Dadié, l'alliance savoir/pouvoir se situe uniquement<br />
au niveau <strong>de</strong> la pure mystification; l'auteur n'y croit<br />
pas du tout. Il semb<strong>le</strong> penser que c'est un stratagème<br />
utilisé par <strong>le</strong> pouvoir <strong>pour</strong> exploiter la crédulité du<br />
peup<strong>le</strong> en masquant sa propre médiocrité. C'est à ce niveau<br />
que <strong>le</strong> dramaturge insiste sur la récupération par la<br />
nouvel<strong>le</strong> classe dirigeante <strong>de</strong> certains attributs du pou<br />
voir traditionnel, qui voulaient que <strong>le</strong> chef soit à la<br />
fois chef politique, religieux et économique. Cette réma<br />
nence <strong>de</strong>s institutions traditionnel<strong>le</strong>s est exploitée<br />
surtout à <strong>de</strong>s fins <strong>de</strong> domination et <strong>de</strong> mystification.<br />
Face à cette attitu<strong>de</strong> aberrante <strong>de</strong>s nouveaux dirigeants,<br />
Mérand P. et Dabla S. affirment que la littérature afri<br />
caine "ne peut se faire que didactique et critique. Le<br />
(1) Les Voix... , p. 129.<br />
(2) Abdallah Baroudi, op. cit., p. 35.
116<br />
problème majeur reste toujours et encore celui du réveil<br />
<strong>de</strong>s consciences ignorant un peu trop souvent la cruauté<br />
<strong>de</strong> <strong>le</strong>ur condition d'exploités et <strong>de</strong> dupes." (1)<br />
A travers <strong>le</strong>s moyens d'exploitation <strong>de</strong>s consciences,<br />
Dadié révè<strong>le</strong> que <strong>le</strong>s mystificateurs <strong>de</strong> cour constituent<br />
une classe <strong>de</strong> prostitués intel<strong>le</strong>ctuels qui mettent <strong>le</strong>ur<br />
savoir-faire au service <strong>de</strong>s nouveaux dictateurs. Ils ont<br />
ainsi supplanté <strong>le</strong>s conseil<strong>le</strong>rs <strong>de</strong> cour d'autrefois, qui<br />
étaient <strong>de</strong>s gens conscients, pouvant porter un jugement<br />
critique sur <strong>le</strong> dirigeant et sur <strong>le</strong> contenu <strong>de</strong> sa politi-<br />
que dans l'intérêt <strong>de</strong> celui-ci et dans l'intérêt du peu-<br />
p<strong>le</strong>. Ces temps sont révolus. -Nous sommes à l' heure <strong>de</strong><br />
l'Afrique mo<strong>de</strong>rne, où la quête exacerbée du bien-être<br />
matériel, signe <strong>de</strong> distinction socia<strong>le</strong>, étouffe la vertu,<br />
renforçant <strong>le</strong>s plus forts et asphyxiant <strong>le</strong>s plus démunis.<br />
Ceux-ci, victimes résignées <strong>de</strong> la mystification <strong>de</strong>s diri-<br />
geants, sont aussi l'enclume sur laquel<strong>le</strong> s'exerce la<br />
vio<strong>le</strong>nce ou <strong>le</strong>s vio<strong>le</strong>nces, instrument privilégié <strong>de</strong>s dic-<br />
tateurs <strong>de</strong>s temps mo<strong>de</strong>rnes.<br />
2. 2. La vio<strong>le</strong>nce<br />
Outre la mystification, la vio<strong>le</strong>nce apparaît aussi<br />
comme l'un <strong>de</strong>s moyens sûrs <strong>pour</strong> légitimer la domination<br />
du prince. En effet, tous <strong>le</strong>s pouvoirs totalitaires,<br />
qu'ils soient bureaucratique, néo-colonial civil ou mili-<br />
taire, usent <strong>de</strong> la vio<strong>le</strong>nce comme système <strong>de</strong> gouvernement;<br />
(1) Mérand P. et Dabla Sewanou, Gui<strong>de</strong> <strong>de</strong> littérature africaine<br />
<strong>de</strong> langue française, Paris, l'Harmattan, 1979,<br />
p. 16.
177<br />
c'est d'ail<strong>le</strong>urs l'un <strong>de</strong>s traits communs à tous <strong>le</strong>s<br />
types <strong>de</strong> pouvoir décr.its par B. Dadié. Là 00 <strong>le</strong> pouvoir<br />
<strong>de</strong> persuasion, fondé surtout sur <strong>le</strong> caractère religieux<br />
<strong>de</strong> la puissance du tyran échoue, la force <strong>de</strong> répression<br />
réussit toujours, ne serait-ce qu'un court moment, à<br />
instal<strong>le</strong>r une paix, si fragi<strong>le</strong> soit-el<strong>le</strong>. Dès lors, la<br />
vio<strong>le</strong>nce apparaît comme un véritab<strong>le</strong> moyen, ayant ".. . <strong>pour</strong><br />
cause inévitab<strong>le</strong> la conclusion d'un type <strong>de</strong> paix précaire<br />
qui correspond seu<strong>le</strong>ment à une absence <strong>de</strong> conflit armé,<br />
sans progrès <strong>de</strong> la justice, ou pis, une paix fondée sur<br />
l'injustice et la violation <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> l'homme." (1)<br />
La vio<strong>le</strong>nce tel<strong>le</strong> qu'el<strong>le</strong> apparaît dans l'oeuvre théâtra-<br />
<strong>le</strong> <strong>de</strong> l'écrivain ivoirien, épouse intimement la <strong>de</strong>rnière<br />
partie <strong>de</strong> cette définition. Le pouvoir personnel n'accep-<br />
tant jamais que ses ordres soient discutés, et n'ayant<br />
prévu aucun système pouvant établir un dialogue franc<br />
et sincère, se maintient par la répression. aveug<strong>le</strong> et par<br />
<strong>le</strong> massacre; après avoir liquidé physiquement à coups<br />
<strong>de</strong> fusil tous <strong>le</strong>s opposants à sa politique, voici l'ordre<br />
intimé par Nahoubou 1er, prototype <strong>de</strong>s nouveaux dictateurs<br />
d'Afrique.<br />
Nahoubou 1er<br />
"... Gar<strong>de</strong>s., je vous charge <strong>de</strong> faire la <strong>le</strong>ssive<br />
du royaume; que dans nul<strong>le</strong> case ne reste une<br />
tête qui ne pense comme moi; je suis la vérité.,<br />
la seu<strong>le</strong> vérité... Que <strong>le</strong>s corps soient tous<br />
abandonnés aux vautours <strong>pour</strong> qu'on sache enfin<br />
que ma <strong>de</strong>vise est et <strong>de</strong>meure "<strong>de</strong>s serviteurs et<br />
non <strong>de</strong> e homme e "." ( 2 )<br />
(1) Alain Joxe, "Introduction" à La vio<strong>le</strong>nce et ses causes,<br />
UNESCO, <strong>1980</strong>, p. 10.<br />
(2) Les Voix... , pp,]09-110
183<br />
tats qui se succè<strong>de</strong>nt sur la scène politique, la société<br />
dadiéenne est <strong>le</strong> lieu perpétuel d'un drame conflictuel<br />
où sont mêlées toutes <strong>le</strong>s composantes socia<strong>le</strong>s. Seu<strong>le</strong> la<br />
classe dominante qui est aussi la classe dirigeante,<br />
émerge <strong>de</strong> ces luttes socia<strong>le</strong>s en imposant son ordre par<br />
la mystification ou par <strong>le</strong>s vio<strong>le</strong>nces <strong>le</strong>s plus barbares.<br />
Cautionné par l'inertie <strong>de</strong>s masses et par tous <strong>le</strong>s<br />
si<strong>le</strong>nces (si<strong>le</strong>nce <strong>de</strong>s vieux, <strong>de</strong> la jeunesse, <strong>de</strong>s syndicats<br />
"<strong>de</strong> participation"), <strong>le</strong> pouvoir, hermétiquement tenu dans<br />
<strong>le</strong>s mains d'un seul individu omnipotent qui s'érige en<br />
démiurge, <strong>de</strong>vient une affaire personnel<strong>le</strong>, liée à "l'illus<br />
tre naLs s anc e" du dictateur. Dadié, en dévoilant qu 1 une<br />
tel<strong>le</strong> confiscation du pouvoir débouche sur <strong>le</strong> culte <strong>de</strong><br />
la personnalité, attaque <strong>de</strong> front <strong>le</strong>s partis uniques qui<br />
dirigent certains Etats africains dont <strong>le</strong> sien. Pour lui,<br />
tous <strong>le</strong>s régimes à direction unique, refusant l'établisse<br />
ment d'un consensus pouvant donner naissance à un parti<br />
d'opposition, sont à quelques exceptions près, <strong>de</strong>s dic<br />
tatures modè<strong>le</strong>s vingtième sièc<strong>le</strong>. L'existence d'une<br />
opposition est considérée comme un frein à l'évolution,<br />
comme un obstac<strong>le</strong> majeur à l'exercice du pouvoir. D'où<br />
l'exécution publique <strong>de</strong> tous <strong>le</strong>s opposants.<br />
En dénonçant tous ces faits, Bernard Dadié dévoi<strong>le</strong><br />
non seu<strong>le</strong>ment la confiscation du pouvoir, mais aussi<br />
la confusion <strong>de</strong> tous <strong>le</strong>s pouvoirs. Les anciens attributs<br />
sclérosés du pouvoir traditionnel qui ont une trace indé<br />
lébi<strong>le</strong> dans <strong>le</strong>s mentalités populaires, sont exploités à<br />
<strong>de</strong>s fins d'embriga<strong>de</strong>ment et d'endoctrinement <strong>de</strong>s masses,
184<br />
<strong>pour</strong> masquer <strong>le</strong>s carences et la médiocrité <strong>de</strong> l'homme<br />
politique. Car, <strong>pour</strong> régner éternel<strong>le</strong>ment sur <strong>le</strong>s<br />
consciences affirmera <strong>le</strong> personnage <strong>de</strong> Nahoubou 1er, il<br />
faut "un peup<strong>le</strong> doci<strong>le</strong>", marqué par "la cécité" et par<br />
"<strong>le</strong> mutisme". Pour atteindre cette tota<strong>le</strong> inertie <strong>de</strong>s<br />
masses, <strong>le</strong> pouvoir se sert <strong>de</strong> plusieurs moyens qui ont<br />
déjà fait <strong>le</strong>ur preuve et qui lui seront d'un support pri<br />
mordial. Outre la vio<strong>le</strong>nce et la propagan<strong>de</strong> idéologique<br />
révè<strong>le</strong> Dadié, <strong>le</strong> dirigeant use abondamment "<strong>le</strong> fétichis<br />
me" et "<strong>le</strong> maraboutage" <strong>pour</strong> légitimer sa domination.<br />
Ce <strong>de</strong>rnier aspect du pouvoir revêt une signification pro<br />
fon<strong>de</strong> dans <strong>le</strong> théâtre du dramaturge ivoirien. Nous<br />
essaierons <strong>de</strong> mieux cerner cette face du pouvoir, en nous<br />
interrogeant sur la ou <strong>le</strong>s fonctions que peuvent jouer<br />
<strong>de</strong>vins, féticheurs et marabouts auprès <strong>de</strong> l'homme politi<br />
que dans <strong>le</strong> théâtre dadiéen.
185<br />
CHAPITRE II<br />
DEVIN ET MARABOUT, UNE FONCTION AMBIGUE<br />
AUPRES DU POUVOIR<br />
En effet, <strong>le</strong>s pièces <strong>de</strong> Dadié mettent en jeu non<br />
seu<strong>le</strong>ment <strong>le</strong> dirigeant politique dans ses relations avec<br />
<strong>le</strong>s masses, mais aussi dans ses rapports avec un personna<br />
ge riche qu'il serait intéressant d'étudier: <strong>le</strong> sorcier<br />
ou <strong>le</strong> <strong>de</strong>vin couramment appelé "<strong>le</strong> féticheur". Tous ces<br />
termes pLofonds <strong>de</strong> signification mystique, renvoient à<br />
un même personnage aux fonctions multip<strong>le</strong>s que nous dési<br />
gnerons par <strong>le</strong> mot DEVIN. Nous préférons ce terme qui<br />
englobe en même temps Savoir et Pouvoir, faisant du per<br />
sonnage un être craint par <strong>le</strong>s malfaiteurs, et considéré<br />
comme protecteur <strong>de</strong> la communauté dans sa globalité; <strong>le</strong><br />
<strong>de</strong>vin cumu<strong>le</strong> à lui seul <strong>le</strong> savoir scientifique <strong>de</strong> guéris<br />
seur et <strong>le</strong> savoir magique <strong>de</strong> prédire l'avenir et d'entrer<br />
en contact avec toutes <strong>le</strong>s forces <strong>de</strong> la nature et avec<br />
<strong>le</strong>s ancêtres défunts qui lui dictent sa conduite, et<br />
l'ai<strong>de</strong>nt dans sa tâche. Au personnage <strong>de</strong> <strong>de</strong>vin se joindra<br />
<strong>le</strong> marabout, <strong>le</strong>s <strong>de</strong>ux partageant <strong>le</strong>s mêmes fonctions à<br />
<strong>de</strong>s variantes près. Riches <strong>de</strong> théâtralité dans <strong>le</strong>urs pra<br />
tiques dans la société africaine, que dans <strong>le</strong>s oeuvres<br />
théâtra<strong>le</strong>s qui nous <strong>le</strong>s révè<strong>le</strong>nt, ils exercent une gran<strong>de</strong><br />
influence sur la classe dirigeante. Ils apparaissent, (nous<br />
<strong>le</strong> verrons), comme un collaborateur patent <strong>de</strong> l'homme
189<br />
un certain nombre <strong>de</strong> recettes qu'il accroît régulièrement<br />
par <strong>de</strong> nouveaux achats clan<strong>de</strong>stins, effectués auprès <strong>de</strong>s<br />
sorciers. La considération dont jouit un komea dans la<br />
société es t f onction <strong>de</strong> sa célébri té" (1). Sa présence<br />
dans <strong>le</strong> théâtre <strong>de</strong> l'écrivain ivoirien n'est pas neutre;<br />
el<strong>le</strong> est liée à l'essence même du pouvoir. Dans notre<br />
travail, ce personnage important sera désigné sous<br />
l'appellation générique <strong>de</strong> DEVIN.<br />
Quant au personnage du marabout, terme que nous gar-<br />
<strong>de</strong>rons et qui veut dire prêtre mahométan, en malinké kara-<br />
moko, il emboîte <strong>le</strong> pas au <strong>de</strong>vin; <strong>le</strong>s <strong>de</strong>ux cumu<strong>le</strong>nt <strong>le</strong>s<br />
mêmes fonctions la plupart du temps. En effet, "on entend<br />
en général par marabout un prêtre mahométan, mais il faut<br />
aussi comprendre dans cette catégorie tout homme recomman-<br />
dab<strong>le</strong> par ses bonnes moeurs et pratiquant toutes <strong>le</strong>s<br />
observances <strong>de</strong> la loi... Ces hommes moralisent <strong>le</strong> peup<strong>le</strong>,<br />
donnent généra<strong>le</strong>ment <strong>de</strong>s conseils <strong>de</strong> paix et <strong>de</strong> concilia-<br />
tion" (2). Les marabouts sont consultés au même titre que<br />
<strong>le</strong> <strong>de</strong>vin, <strong>pour</strong> tout ce qui touche la vie <strong>de</strong>s hommes dans<br />
la société. Ils se réfèrent constamment au Coran <strong>pour</strong> tel<strong>le</strong><br />
ou tel<strong>le</strong> recette médicina<strong>le</strong>. Ils connaissent <strong>le</strong>s versets<br />
du Coran par coeur et y trouvent tous <strong>le</strong>s remè<strong>de</strong>s à tous<br />
<strong>le</strong>s problèmes. Au terme <strong>de</strong> cette définition, on peut<br />
s'interroger maintenant sur <strong>le</strong> rô<strong>le</strong> que peuvent jouer <strong>de</strong>vin<br />
(1) Amon d'Aby, op. cit., p. 54<br />
(2) L'Abbé Boilat, cité par C. Coulon in Le Marabout et<br />
<strong>le</strong> Prince, p. 62.
199<br />
fournit à la masse <strong>de</strong> ses fidè<strong>le</strong>s une certaine image<br />
<strong>de</strong> ses dirigeants, plus attirante que cel<strong>le</strong> attachée<br />
aux rô<strong>le</strong>s du Sous-Préfet ou du représentant local du<br />
P.D.C.I. <strong>le</strong> prophète ne procè<strong>de</strong> pas à la vente <strong>de</strong> car-<br />
tes du parti, il ne recueil<strong>le</strong> pas <strong>le</strong>s cotisations obli-<br />
gatoires <strong>pour</strong> la construction <strong>de</strong>s édifices religieux,<br />
il protège ou guérit; ses bons rapports avec <strong>le</strong> pouvoir<br />
sont bien <strong>le</strong> signe <strong>de</strong> sa réussite; si l'action du pro-<br />
phète est bénéfique et si ses rapports avec <strong>le</strong> pouvoir<br />
sont bons, c'est que la nature du pouvoir est bonne.<br />
A la limite, conclut M. Augé, (<strong>le</strong> prési<strong>de</strong>nt) et Albert<br />
Atcho sont tous <strong>de</strong>ux ensemb<strong>le</strong> l'incarnation <strong>de</strong> la force<br />
et du droit. Le prophète-médiateur fournit au gouver-<br />
nement une image idéa<strong>le</strong> <strong>de</strong>s gouvernés et inversement." (l)<br />
A la lumière <strong>de</strong> cette analyse, on comprend aisément la<br />
mise en scène régulière du personnage <strong>de</strong> <strong>de</strong>vin dans <strong>le</strong><br />
théâtre <strong>de</strong> Bernard Dadié. Toutes ses pièces plongent<br />
<strong>le</strong>urs racines dans <strong>le</strong> terroir natal. Ce type <strong>de</strong> rapport<br />
entre <strong>le</strong> pouvoir politique et <strong>le</strong>s pouvoirs occultes,<br />
il l'a aussi vécu au Sénégal à travers <strong>le</strong>s relations que<br />
l'Etat tissait avec <strong>le</strong>s confréries maraboutiques. Comme<br />
<strong>le</strong> <strong>de</strong>vin, <strong>le</strong> marabout joue un rô<strong>le</strong> prédominant dans la<br />
vie politique <strong>de</strong>s dirigeants. Il est considéré comme<br />
un support réel du pouvoir.<br />
En Afrique, <strong>le</strong> personnage du marabout est né avons-<br />
nous signalé, <strong>de</strong> l'islamisation <strong>de</strong>s peup<strong>le</strong>s <strong>de</strong> la région<br />
(1) M. Augé, Théorie <strong>de</strong>s pouvoirs et idéologie<br />
<strong>de</strong> cas en Côte d'Ivoire, p. 260.<br />
étu<strong>de</strong>
201<br />
qui favorise l'arrivée sur la scène politique <strong>de</strong>s démons<br />
comme Nahoubou 1er. Ces pratiques ne font qu'accentuer<br />
<strong>le</strong> mythe du pouvoir et <strong>le</strong> culte <strong>de</strong> la personnalité.<br />
D'autre part, il faut noter que l'éducation occi<strong>de</strong>nta<strong>le</strong><br />
reçue dès l'éco<strong>le</strong> n'a rien changé dans <strong>le</strong> recours constant<br />
à l'ordre magico-religieux <strong>de</strong>s classes dirigeantes.<br />
Selon Christian Coulon, "<strong>de</strong>rrière la faça<strong>de</strong> occi<strong>de</strong>nta<strong>le</strong> J<br />
<strong>le</strong>s dirigeants africains restent souvent profondément<br />
attachés aux pratiques ancestra<strong>le</strong>s... <strong>le</strong>s tensions socia<br />
<strong>le</strong>s et psychologiques propres à <strong>le</strong>ur situation d'accul<br />
turés, ainsi que l'univers <strong>de</strong> compétition dans <strong>le</strong>quel<br />
ils vivent, encouragent <strong>le</strong> recours à la magie et à la<br />
religion." (1)<br />
La remise en cause <strong>de</strong> ces pratiques dans <strong>le</strong> théâtre,<br />
<strong>de</strong> Dadié répond à une réalité socia<strong>le</strong> <strong>de</strong>venue troublante;<br />
<strong>le</strong>s accusations fétichistes <strong>pour</strong> déce<strong>le</strong>r <strong>le</strong>s comploteurs<br />
contre <strong>le</strong> pouvoir sont monnaie courante. On liqui<strong>de</strong> par<br />
ce biais <strong>de</strong> pauvres innoncents qui n'ont souvent aucun<br />
rapport avec ce dont on <strong>le</strong>s accuse. Ainsi <strong>de</strong>vin et<br />
marabout peuvent-ils être considérés comme <strong>de</strong>s "pouvoirs<br />
périphériques", apportant <strong>le</strong>ur renfort au pouvoir central.<br />
Mais ces pouvoirs représentent <strong>pour</strong> <strong>le</strong> dirigeant poli<br />
tique un couteau à doub<strong>le</strong> tranchant : relégués au second<br />
plan, <strong>de</strong>vin et marabout sont <strong>de</strong>s contre-pouvoirs poten<br />
tiels; c',est <strong>pour</strong>quoi, <strong>le</strong> pouvoir passe par tous <strong>le</strong>s<br />
moyens soit <strong>pour</strong> <strong>le</strong>s coopter, soit <strong>pour</strong> <strong>le</strong>s éliminer<br />
(1) C. Coulon, op. cit., pp. 230-231.
203<br />
Au niveau <strong>de</strong>s é<strong>le</strong>ctions par exemp<strong>le</strong>, <strong>le</strong> marabout<br />
et ses discip<strong>le</strong>s, <strong>le</strong> <strong>de</strong>vin et ses clients, sont un poids<br />
non négligeab<strong>le</strong> <strong>pour</strong> l'homme politique qui veut gagner<br />
la batail<strong>le</strong>. Le cas du prophète Atcho en Basse Côte<br />
d'Ivoire est un exemp<strong>le</strong> patent. Atcho a non seu<strong>le</strong>ment la<br />
masse populaire, <strong>pour</strong> qui il est l'incarnation <strong>de</strong> la<br />
justice et "soldat <strong>de</strong> Dieu", mais aussi une force écono-<br />
mique et politique. Marc Augé fait remarquer que" Atcho<br />
est... une puissance politique. plus exactement, son<br />
influence s'étend assez largement en Côte d'Ivoire <strong>pour</strong><br />
que <strong>le</strong> pouvoir politique compte avec lui... Le nom<br />
d'Albert Atcho est parfois associé à celui du prési<strong>de</strong>nt<br />
Houphouët-Boigny, voire à celui du prési<strong>de</strong>nt Hamani Diori.<br />
Ensemb<strong>le</strong> et avec l'ai<strong>de</strong> <strong>de</strong>s "soldats <strong>de</strong> Dieu", ils barrent<br />
la route <strong>de</strong> l'individu mal intentionné qui, "en doub<strong>le</strong>"<br />
ou "en diab<strong>le</strong>", s'apprêtait à attaquer son prochain et<br />
se vit foudroyer par infiniment plus fort que lui." (1)<br />
Ainsi <strong>le</strong>s puissants <strong>de</strong> ce mon<strong>de</strong> recourent-ils à ces<br />
"pouvoirs périphériques" qui, tout en n'exerçant pas<br />
<strong>le</strong> pouvoir politique, contribuent largement à son maintien<br />
et à son épanouissement.<br />
Mais lorsque ces pouvoirs <strong>de</strong>viennent encombrants<br />
ou s'ils refusent <strong>de</strong> suivre <strong>le</strong> mot d'ordre, compromettant<br />
ainsi l'autorité politique, <strong>le</strong> dirigeant ne lésine pas<br />
avec <strong>le</strong>s moyens qui sont à sa disposition. Dans un tel<br />
cas, il a <strong>de</strong>ux solutions<br />
(l) M. Aug é, op. cit., p. 254.
207<br />
dans une perspective d'auto-protection, il faut<br />
éliminer définitivement par <strong>de</strong>s morts vio<strong>le</strong>ntes<br />
très souvent dissimulées, tous <strong>le</strong>s é16ments qui<br />
peuvent compromettre voire limiter la toute<br />
puissance du dictateur.<br />
Cette prise <strong>de</strong> position ferme <strong>de</strong> la part du dirigeant<br />
face aux "pouvoirs périphériques", révè<strong>le</strong> bien <strong>le</strong>ur poids<br />
sur l'exercice du pouvoir. Il faut signa<strong>le</strong>r ici que<br />
presque toutes <strong>le</strong>s exécutions <strong>de</strong> <strong>de</strong>vin, dans <strong>le</strong>s pièces<br />
qui nous intéressent, ont lieu au palais; lieu clos et<br />
.discret par excel<strong>le</strong>nce, <strong>le</strong> palais est ainsi transformé<br />
en un abattoir <strong>de</strong> crâhes humains, comme <strong>le</strong> montre bien<br />
Nahoubou 1er. Toutes ces exactions font écho à l'actua<br />
lité que <strong>le</strong>s peup<strong>le</strong>s vivent sous <strong>le</strong>s régimes autoritai<br />
res d'Afrique noire. Certains propos <strong>de</strong> Nahoubou 1er<br />
renvoient immanquab<strong>le</strong>ment aux événements <strong>de</strong> 1963 que <strong>le</strong><br />
pays <strong>de</strong> Dadié a connus : marabouts et féticheurs sous <strong>le</strong>s<br />
accusations <strong>de</strong>s sorciers <strong>de</strong> la cour du chef, y ont lais<br />
sé <strong>le</strong>urs plumes. Dès lors on peut affirmer que <strong>le</strong>s<br />
"pouvoirs périphériques" représentent une force plus<br />
redoutée que l'opposition politique si el<strong>le</strong> existe.<br />
En actualisant cette affirmation, on constate par exemp<strong>le</strong><br />
que l'intégration ou <strong>le</strong> maintien <strong>de</strong>s <strong>de</strong>vins et marabouts<br />
dans <strong>le</strong> sillage du pouvoir politique en Afrique n'est<br />
pas un acte <strong>de</strong> simp<strong>le</strong> gratitu<strong>de</strong>. Cette cooptation répond<br />
bien à une exigence voire à un impératif politique. Le<br />
cas <strong>de</strong>s prophètes Atcho et Papa Nouveau en Côte d'Ivoire<br />
est à cet égard profondément significatif. Le prophète
209<br />
influencé Bernard Dadié, est i<strong>de</strong>ntique à cel<strong>le</strong> du grand<br />
marabout <strong>de</strong> Gagnoa, Yacouba Sylla, un Sarakolé <strong>de</strong> Nioro<br />
(Mali), exilé en Côte d'Ivoire <strong>de</strong>puis l'époque colonia<strong>le</strong><br />
à la suite <strong>de</strong>s troub<strong>le</strong>s portant atteinte à l'ordre ins<br />
tauré par <strong>le</strong> colonisateur. Associé à la lutte d'indé<br />
pendance du R.D.A., ce mystique, outre son pouvoir <strong>de</strong><br />
grand marabout, est aujourd'hui plus une puissance écono<br />
mique qu'une puissance mystique. Son parc auto-car <strong>de</strong><br />
transports dépasse largement la centaine; il dispose <strong>de</strong><br />
plusieurs sal<strong>le</strong>s <strong>de</strong> cinéma dans <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s vil<strong>le</strong>s impor<br />
tantes (Gagnoa, Sinfra, Bouaflé) et <strong>de</strong> plusieurs planta<br />
tions <strong>de</strong> café et <strong>de</strong> cacao. Grand actionnaire dans <strong>le</strong>s<br />
sociétés d'exploitation forestière, il gouverne une cour<br />
<strong>de</strong> plus <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux mil<strong>le</strong> discip<strong>le</strong>s. Cet impact économique<br />
lié au mysticisme religieux, quoique non dévoilé par<br />
l'écrivain ivoirien, influence bien <strong>le</strong>s hommes politiques<br />
dans <strong>le</strong>ur prise <strong>de</strong> décision à l'égard <strong>de</strong>s "pouvoirs péri<br />
phériques". Cela explique en réalité la cooptation <strong>de</strong> ces<br />
personnages mystérieux qu'il est diffici<strong>le</strong> <strong>de</strong> définir<br />
succinctement. L'analyse <strong>de</strong> <strong>le</strong>ur fonction suggère une<br />
profon<strong>de</strong> ambiguïté. Dans <strong>le</strong> cas <strong>de</strong>s marabouts, rapporte<br />
Christian Coulon, "tout l'art politique <strong>de</strong>s marabouts<br />
consiste à jouer sur l'ambiguïté <strong>de</strong> <strong>le</strong>ur position dans<br />
la société politique; d'un côté en utilisant <strong>le</strong>s ressour<br />
ces que <strong>le</strong>ur procure l'Etat, <strong>de</strong> l'autre en marquant, <strong>le</strong><br />
cas échéant, <strong>le</strong>urs distances à l'égard <strong>de</strong> celui-ci. En<br />
pério<strong>de</strong> norma<strong>le</strong> ou en cas <strong>de</strong> crise limitée, ils <strong>pour</strong>ront<br />
se faire plutôt <strong>le</strong>s collaborateurs <strong>de</strong> l'Etat. Mais si
210<br />
la crise dure et si un mécontentement populaire se déve-<br />
loppe, <strong>le</strong>s marabouts, sans al<strong>le</strong>r jusqu'à apparaître<br />
ouvertement comme <strong>de</strong>s opposants, se montreront plus réti-<br />
cents envers <strong>le</strong> gouvernement. Car, conclut C. Coulon,<br />
<strong>de</strong>puis fort longtemps <strong>le</strong>s saints et <strong>le</strong>s chefs soufis sont<br />
associés à un rô<strong>le</strong> <strong>de</strong> protection contre <strong>le</strong> pouvoir<br />
oppressif." (1) Ceci est aussi vrai <strong>pour</strong> <strong>le</strong>s <strong>de</strong>vins et<br />
prophètes, car en tant qu'intermédiaires entre l'Etre<br />
Suprême et <strong>le</strong>s hommes, ils sont <strong>le</strong> garant <strong>de</strong> l'ordre<br />
social. Celui-ci doit al<strong>le</strong>r forcément dans <strong>le</strong> sens <strong>de</strong> la<br />
justice et <strong>de</strong> l'équité. C'est ce qui explique la hargne<br />
du guérisseur contre <strong>le</strong> pouvoir sanguinaire <strong>de</strong> Nahoubou<br />
1er dans Les Voix...<br />
Le Guérisseur<br />
"Le pays va bientôt pouvoir respirer. Il sera<br />
rendu justice <strong>de</strong> tes injustices." (2)<br />
Cette fonction historique du <strong>de</strong>vin comme contre-pouvoir,<br />
Dadié ne l'a pas perdu <strong>de</strong> vue. Force est <strong>de</strong> constater que<br />
<strong>le</strong> pouvoir qu'il critique doit être perçu comme une sorte<br />
"d'élément-somme" amalgamant <strong>le</strong>s pratiques politiques<br />
importées et <strong>le</strong>s pratiques religieuses qui étaient <strong>le</strong><br />
support potentiel du pouvoir traditionnel. Mais il faut<br />
signa<strong>le</strong>r que l'exploitation du patrimoine traditionnel<br />
ne se fait qu'en fonction <strong>de</strong>s intérêts <strong>de</strong> la classe domi-<br />
nante. En effet, cel<strong>le</strong>-ci ne récupère <strong>de</strong> la tradition que<br />
<strong>le</strong>s aspects susceptib<strong>le</strong>s <strong>de</strong> légitimer sa domination en se<br />
(1) C. Coulon, op. cit., p. 286.<br />
(2) Les Voix ... , p. 117.
212<br />
sur l'apport <strong>de</strong> ce personnage riche <strong>de</strong> théâtralité aux<br />
oeuvres <strong>de</strong> l'auteur dramatique ivoirien.<br />
IV - APPORT DU PERSONNAGE DE DEVIN AU THEATRE DADIEEN<br />
Le <strong>de</strong>vin, <strong>de</strong> par sa fonction socia<strong>le</strong>, exerce un<br />
grand impact non seu<strong>le</strong>ment sur l'homme politique à qui<br />
il apporte son savoir, mais aussi sur <strong>le</strong>s masses qui voient<br />
en lui <strong>le</strong> porte-paro<strong>le</strong> <strong>de</strong>s forces supérieures. Dans <strong>le</strong><br />
théâtre <strong>de</strong> Dadié, <strong>le</strong> <strong>de</strong>vin détient la trame <strong>de</strong> l'action<br />
dramatique, principa<strong>le</strong>ment dans Les voix dans <strong>le</strong> vent et<br />
dans Béatrice du Congo. Il n'apparaît la plupart du temps<br />
qu'aux temps forts <strong>de</strong> l'action à la faveur <strong>de</strong> laquel<strong>le</strong><br />
ses paro<strong>le</strong>s, ses gestes... brodés <strong>de</strong> proverbes et d'énig-<br />
mes profon<strong>de</strong>s, miroir <strong>de</strong> la conscience col<strong>le</strong>ctive, <strong>de</strong>vien-<br />
nent <strong>de</strong>s moments mystérieux et sacrés; ces pério<strong>de</strong>s ten-<br />
dues au niveau même du suspens renvoient au premier moment<br />
<strong>de</strong> la création du mon<strong>de</strong>, rejoué par <strong>le</strong> <strong>de</strong>vin. Car son<br />
"langage, toutefois, n'est pas seu<strong>le</strong>ment instrument <strong>de</strong><br />
communication; il est ex-pression, par excel<strong>le</strong>nce <strong>de</strong><br />
l'être-force, déc<strong>le</strong>nchement <strong>de</strong>s puissances vita<strong>le</strong>s et<br />
principe <strong>de</strong> <strong>le</strong>ur cohésion. Sur <strong>le</strong> plan métaphysique, <strong>le</strong><br />
verbe est créateur par la paro<strong>le</strong> <strong>de</strong> Dieu et création<br />
continuée par <strong>le</strong> souff<strong>le</strong> humain, c'est-à-dire l'âme." (1)<br />
Cet instant privilégié qui donne toute la saveur<br />
africaine au théâtre <strong>de</strong> l'auteur dramatique ivoirien,<br />
est vécu par <strong>le</strong> roi et <strong>le</strong> <strong>de</strong>vin qui interrogent l'avenir<br />
(1) L. V. Thomas, R. Luneau et J. L. Doneux, Les religions<br />
d'Afrique noire, p. 17.
214<br />
<strong>de</strong>vin retient <strong>pour</strong> faire durer <strong>le</strong> suspens, donnent plus<br />
<strong>de</strong> poids au message qu'il va livrer et qui <strong>le</strong> libérera.<br />
Ainsi, médium entre <strong>le</strong> mon<strong>de</strong> invisib<strong>le</strong> et <strong>le</strong> mon<strong>de</strong> VlSl-<br />
b<strong>le</strong>, <strong>le</strong> <strong>de</strong>vin voit-il sa fonction intensifiée par la<br />
<strong>le</strong>nte progression <strong>de</strong> son art qui fuit la sphère profane<br />
<strong>pour</strong> s'intégrer tota<strong>le</strong>ment au mon<strong>de</strong> sacré avant <strong>de</strong> faire<br />
jaillir <strong>le</strong> Verbe tant attendu à la face du mon<strong>de</strong> réel<br />
<strong>pour</strong> qu'il soit décodab<strong>le</strong> par tous. C'est l'extase, mieux,<br />
la possession du <strong>de</strong>vin par la "Paro<strong>le</strong>-mère", qui lui<br />
permettra <strong>de</strong> libérer la vérité. C'est cette même extase<br />
affirmera Senghor, "qui est <strong>le</strong> moyen majeur d'aiguiser<br />
"la vision", <strong>de</strong>.rendre aux sens <strong>de</strong>venus dictionnaires,<br />
<strong>le</strong>ur fonction véritab<strong>le</strong>, qui est <strong>de</strong> fairè comprendre la<br />
va<strong>le</strong>ur analogique, significative <strong>de</strong>s signes-images et <strong>de</strong><br />
<strong>le</strong>urs supports... " (1)<br />
Exploitant profusément ce moyen, l'épiso<strong>de</strong> du <strong>de</strong>vin,<br />
transposé à la scène, permet à Dadié d'acquérir l'adhé-<br />
sion tota<strong>le</strong> du public en se fondant sur sa mentalité.<br />
Les différentes parabo<strong>le</strong>s qui affluent alors dans <strong>le</strong> dis-<br />
cours du <strong>de</strong>vin, permettent non seu<strong>le</strong>ment d'éveil<strong>le</strong>r la<br />
sensibilité <strong>de</strong>s spectateurs, mais aussi <strong>de</strong> montrer comme<br />
<strong>le</strong> dit Senghor que "toute paro<strong>le</strong> qui n'est pas fabulation,<br />
ennuie." Nous découvrons ainsi chez <strong>le</strong> dramaturge ivoirien,<br />
une rémanence du ta<strong>le</strong>nt du conteur traditionnel agni,<br />
qui sait associer plusieurs images-symbo<strong>le</strong>s <strong>pour</strong> expri-<br />
mer <strong>de</strong>s situations précises. Par <strong>le</strong> biais <strong>de</strong> ce procédé,<br />
(1) L.S. Senghor, La paro<strong>le</strong> chez Paul Clau<strong>de</strong>l et chez<br />
<strong>le</strong>s Négro-africains, Dakar, N.E.A., 1973, p. 29.
217<br />
dans la <strong>de</strong>rnière image "<strong>le</strong> boa se laisse manger par la<br />
brebis" ...<br />
A travers <strong>le</strong> message <strong>de</strong> la prêtresse Marna Chimpa<br />
Vita qui sera relayée par sa fil<strong>le</strong> Dona Béatrice, l'auteur<br />
dramatique ivoirien révè<strong>le</strong> un aspect <strong>de</strong> la pensée symbo-<br />
lique africaine. Cel<strong>le</strong>-ci souligne Louis-Vincent Thomas,<br />
"joue ... sur <strong>le</strong>s <strong>de</strong>ux tab<strong>le</strong>aux: celui <strong>de</strong> la représenta-<br />
tion ou <strong>de</strong> l'expression, celui <strong>de</strong> l'intervention... El<strong>le</strong><br />
a une quadrup<strong>le</strong> finalité: un sens économique puisqu'el<strong>le</strong><br />
résumer con<strong>de</strong>nser rapproche; une fonction opératoire,<br />
car c'est un véritab<strong>le</strong> jeu <strong>de</strong> permutations qu'el<strong>le</strong> rend<br />
possib<strong>le</strong> -(-glissement <strong>de</strong> la chose symbolisée aux divers<br />
éléments du champ symbolique); une va<strong>le</strong>ur d'usager <strong>pour</strong>-<br />
suit L. V. Thomas, qui rappel<strong>le</strong> <strong>le</strong>s règ<strong>le</strong>s <strong>de</strong> l'action<br />
et montre l'union <strong>de</strong> l'obligation et du désirab<strong>le</strong>; une<br />
fonction <strong>de</strong> suggestion (el<strong>le</strong> frappe l'imagination) ou<br />
d'explication (el<strong>le</strong> est l'indice <strong>le</strong> plus sûr <strong>de</strong>s corres-<br />
pondances et <strong>de</strong>s participations). En tant qu'imager el<strong>le</strong><br />
est figure; en tant que hiérophanie, el<strong>le</strong> <strong>de</strong>vient puis-<br />
sance." (1) C'est <strong>pour</strong>quoi Dadié se sert régulièrement<br />
<strong>de</strong> cette pensée symbolique par <strong>le</strong> biais du <strong>de</strong>vin <strong>pour</strong><br />
mieux formu<strong>le</strong>r sa critique. Il établit ainsi entre <strong>le</strong>s<br />
différents éléments symboliques qu'il donne au spectateur,<br />
une relation <strong>de</strong> correspondance <strong>pour</strong> bien expliciter la<br />
situation que vit <strong>le</strong> Zaïre. L'interrogation du <strong>de</strong>vin est<br />
à ce niveau profondément révélateur :<br />
(1) L. V. Thomas, R. Luneau et J. L. Doneux, op. cit. /<br />
p. 31.
222<br />
Ces phrases <strong>de</strong>nses <strong>de</strong> sens et riches <strong>de</strong> présupposés,<br />
révè<strong>le</strong>nt bien la critique viru<strong>le</strong>nte <strong>de</strong> l'écrivain ivoirien<br />
à l'égard <strong>de</strong>s possédants <strong>de</strong> ce mon<strong>de</strong>. Dadié ne cesse<br />
<strong>de</strong> remettre en cause l'opu<strong>le</strong>nce, l'égoïsme et l'auto<br />
satisfaction <strong>de</strong> la bourgeoisie africaine, enfermée dans<br />
sa cupidité et suçant <strong>le</strong> sang <strong>de</strong>s masses <strong>le</strong>s plus démunies.<br />
Toutes ces sangsues sont mieux vues par <strong>le</strong>s <strong>de</strong>vins qu'el<strong>le</strong>s<br />
fréquentent régulièrement <strong>pour</strong> maintenir <strong>le</strong>ur oppression.<br />
L'exploitation du <strong>de</strong>vin donne un regain <strong>de</strong> force à la<br />
critique dadiéenne et la rend plus crédib<strong>le</strong> auprès du<br />
public. Car, ordinairement, "ces personnes qui utilisent<br />
justement_. <strong>le</strong>s images-analogies sont <strong>le</strong>s maîtres <strong>de</strong> la<br />
paro<strong>le</strong>... <strong>le</strong>urs propos dépassent la simp<strong>le</strong> image-équation.<br />
Et <strong>le</strong>s mots ne signifient plus ce qu'ils représentent."<br />
( 1)<br />
Cet aspect astucieusement exploité, montre que <strong>le</strong><br />
théâtre <strong>de</strong> Dadié, loin d'être une pure copie du théâtre<br />
occi<strong>de</strong>ntal, est africain <strong>de</strong> par son contenu. Ce qui est<br />
irréfutab<strong>le</strong>, notons-<strong>le</strong>, c'est la véritab<strong>le</strong> conscience<br />
que l'écrivain ivoirien a <strong>de</strong> contribuer par l'intermédiaire<br />
du <strong>de</strong>vin à la structuration d'un mon<strong>de</strong> tel que la col<strong>le</strong>c<br />
tivité africaine se la représente. Ce caractère merveil<br />
<strong>le</strong>ux, transposé à la scène, ne peut que favoriser la<br />
prise <strong>de</strong> conscience dans la mesure où la communauté adhère<br />
faci<strong>le</strong>ment à la paro<strong>le</strong> du <strong>de</strong>vin, considérée comme venant<br />
<strong>de</strong>s forces supérieures, dépouillée <strong>de</strong> toutes scories. Le<br />
(1) B. Kotchy, op. cit. p. 285.
224<br />
Toutes ces parabo<strong>le</strong>s, riches d'images-symbo<strong>le</strong>s ont<br />
<strong>de</strong>s rapports certes avec la situation que vivrâ l'Afri<br />
que <strong>de</strong> l'ère colonia<strong>le</strong>, mais aussi l'Afrique <strong>de</strong> l'époque<br />
néo-colonia<strong>le</strong>; car <strong>le</strong> colonisateur interviendra toujours<br />
<strong>pour</strong> mieux exploiter <strong>le</strong>s guerres triba<strong>le</strong>s, montrant au<br />
mon<strong>de</strong> que <strong>le</strong>s colonisés sont incapab<strong>le</strong>s <strong>de</strong> se gouverner.<br />
Le cas du Biafra et mieux, celui du Shaba au Zaïre, est<br />
évocateur. Etablissant régulièrement <strong>de</strong>s liens entre<br />
l'imaginaire et <strong>le</strong> réel, la paro<strong>le</strong> <strong>de</strong> Dadié par <strong>le</strong> <strong>de</strong>vin<br />
interposé, est une paro<strong>le</strong>-image. Et <strong>le</strong>s symbo<strong>le</strong>s qui<br />
la sous-ten<strong>de</strong>nt, lui donnent plus <strong>de</strong> poids, plus <strong>de</strong> cré<br />
dibilité aux yeux du spectateur averti. Chez <strong>le</strong> dramatur<br />
ge ivoirien, signa<strong>le</strong> Kotchy "<strong>le</strong> symbo<strong>le</strong> est une image<br />
surréel<strong>le</strong>. Il sert à voi<strong>le</strong>r et à dévoi<strong>le</strong>r <strong>de</strong>s situations<br />
délicates. Par la magie du Verbe, <strong>le</strong> symbo<strong>le</strong> se fait pro<br />
verbe. Et <strong>de</strong> même que l'image-analogie contribue à la<br />
connaissance et à la compréhension du cosmos, <strong>le</strong> prover<br />
be est aussi un procédé gnomique dans la société tra<br />
ditionnel<strong>le</strong>, c'est un instrument efficace d'éducation...<br />
il critique sans b<strong>le</strong>sser, il s'attaque ... avec finesse<br />
aux situations mora<strong>le</strong>s, socia<strong>le</strong>s, politiques." (1) On<br />
comprend alors <strong>pour</strong>quoi <strong>le</strong> théâtre <strong>de</strong> Bernard Dadié,<br />
conçu comme une critique <strong>de</strong> l'Afrique mo<strong>de</strong>rne, exploite<br />
<strong>le</strong>s ressources du théâtre traditionnel en imaginant d'au<br />
tres langages et d'autres moyens d'expression qui ont un<br />
grand impact sur <strong>le</strong> public africain mo<strong>de</strong>rne. Dès lors,<br />
(1) B. Kotchy, op. cit., pp. 285-286.
226<br />
traduit une volonté <strong>de</strong> rénovation <strong>de</strong> l'art dramatique<br />
dadiéen.<br />
CONCLUSION<br />
Cette partie <strong>de</strong> notre travail a paru peut-être trop<br />
longue; mais notre but était <strong>de</strong> montrer avec plus <strong>de</strong><br />
précision un aspect du pouvoir qui fut jadis passé sous<br />
si<strong>le</strong>nce par quelques critiques. Loin <strong>de</strong> fournir ici une<br />
étu<strong>de</strong> exhaustive, nous nous sommes astreint à dévoi<strong>le</strong>r<br />
l'essentiel <strong>de</strong>s rapports qui lient <strong>le</strong>s "pouvoirs péri<br />
phériques" au pouvoir central, celui qui est plus mani<br />
feste"dans <strong>le</strong>s oeuvres· théâtra<strong>le</strong>s choisies <strong>pour</strong> ceite<br />
étu<strong>de</strong>.<br />
Le dirigeant politique dans <strong>le</strong> théâtre <strong>de</strong> Dadié<br />
exploite tous <strong>le</strong>s moyens <strong>de</strong> coercition et <strong>de</strong> domestica<br />
tion <strong>de</strong> la vio<strong>le</strong>nce <strong>pour</strong> légitimer son pouvoir. A cet<br />
effet, certains procédés comme <strong>le</strong>s recours constants au<br />
<strong>de</strong>vin ou au marabout, <strong>le</strong>squels ont un grand impact sur<br />
la mentalité populaire, sont profusément utilisés à <strong>de</strong>s<br />
fins <strong>de</strong> domination. Le personnage <strong>de</strong> <strong>de</strong>vin, tout comme<br />
celui <strong>de</strong> marabout, exerce une fonction ambiguë et diffi<br />
ci<strong>le</strong>ment détachab<strong>le</strong> <strong>de</strong> <strong>le</strong>ur rô<strong>le</strong> social respectif. Nous<br />
l'avons vu, ces personnages apparaissent d'abord comme<br />
<strong>de</strong>s "donateurs" <strong>pour</strong> reprendre une expression <strong>de</strong> Propp,<br />
dans la mesure où ils interviennent en temps <strong>de</strong> crise<br />
et permettent au dirigeant d'accé<strong>de</strong>r au pouvoir en lui<br />
donnant une parcel<strong>le</strong> <strong>de</strong> <strong>le</strong>ur puissance mystique. A ce<br />
niveau, nous <strong>le</strong>s avons considérés comme <strong>le</strong> support patent
228<br />
CHAPITRE III<br />
LA FEMME OU LE VERITABLE CONTRE-POUVOIR<br />
DANS LE THEATRE DE DADIE<br />
Ce chapitre entend montrer l'importance capita<strong>le</strong><br />
<strong>de</strong> la femme dans <strong>le</strong> théâtre <strong>de</strong> Dadié. En effet, presque<br />
toutes <strong>le</strong>s pièces <strong>de</strong> l'auteur dramatique ivoirien mettent<br />
en jeu à <strong>de</strong>s variantes près, la femme dans ses rapports<br />
avec <strong>le</strong> pouvoir. Cette présence réitérée est-el<strong>le</strong> simp<strong>le</strong><br />
fidélité à une réhabilitation <strong>de</strong> l'image féminine?<br />
Ne prend-el<strong>le</strong> pas sa source dans l'histoire akan ? Quel<strong>le</strong><br />
fonction Bernard Dadié attribue-t-il à la femme ?<br />
Pour donner <strong>de</strong>s éléments <strong>de</strong> réponse à toutes ces<br />
questions, nous nous proposons <strong>de</strong> fouil<strong>le</strong>r dans l'histoire<br />
du peup<strong>le</strong> Akan afin <strong>de</strong> saisir la fonction spécifique<br />
<strong>de</strong> la femme auprès <strong>de</strong> l'homme politique dans <strong>le</strong> théâtre<br />
dadiéen. Cette démarche nous évitera <strong>de</strong> tomber dans l'er<br />
reur <strong>de</strong> certains arguments sexistes, qui n'ont toujours<br />
vu qu'un aspect <strong>de</strong> la fonction féminine dans <strong>le</strong>s sociétés<br />
africaines, au point que <strong>le</strong>ur langage se réduit à <strong>de</strong>ux<br />
thèmes principaux la femme soumise, la femme procréa<br />
trice ou la femme au foyer.<br />
Mais cet argument généralisateur n'est qu'un ref<strong>le</strong>t<br />
d'une fonction plus importante qui reste à moitié inex<br />
ploitée. Rappelons que la société qui nous intéresse ici<br />
est une société matrilinéaire où la femme tient une place<br />
\
232<br />
du pouvoir. C'est <strong>pour</strong>quoi el<strong>le</strong> <strong>de</strong>meure<br />
toujours dans l'ombre du roi .. . " (l )<br />
L'histoire du peup<strong>le</strong> ashanti qui occupe la même aire<br />
culturel<strong>le</strong> que <strong>le</strong>s Agni <strong>de</strong> Côte d'Ivoire, révè<strong>le</strong> aussi<br />
l'existence <strong>de</strong>s "femmes-chefs" qui auraient dirigé la<br />
communauté Ashanti avant <strong>le</strong>s différentes métamorphoses<br />
socio-culturel<strong>le</strong>s. Tous nos informateurs et informatrices<br />
sont unanimes à reconnaître <strong>le</strong> rô<strong>le</strong> primordial joué par<br />
la femme auprès du pouvoir politique. El<strong>le</strong> est considérée<br />
comme support <strong>de</strong> l'idéologie du pouvoir et à ce titre,<br />
el<strong>le</strong> transmet <strong>le</strong> pouvoir qui a <strong>pour</strong> support matériel <strong>le</strong><br />
BIA ou "siège-trône" chez <strong>le</strong>s Sanwi. C'est ce doub<strong>le</strong><br />
aspect qui lui donne plus <strong>de</strong> poids dans la société matri-<br />
linéaire; el<strong>le</strong> est non seu<strong>le</strong>ment la source originel<strong>le</strong><br />
du pouvoir, mais aussi l'élément structurateur <strong>de</strong> la<br />
société agni.<br />
Mais génitrice et procréatrice, la femme peut-el<strong>le</strong><br />
exercer <strong>le</strong> pouvoir? Où se situe-t-el<strong>le</strong> dans <strong>le</strong>s prises<br />
<strong>de</strong> décision globa<strong>le</strong>s ?<br />
l - 2. La femme ou la dominante politique effacée<br />
Au niveau <strong>de</strong> la conception du pouvoir, la femme<br />
cumu<strong>le</strong> tous <strong>le</strong>s rô<strong>le</strong>s qu'ils soient rituels ou politiques.<br />
Cela relève <strong>de</strong> l'idéologie même du pouvoir. Au Sanwi,<br />
<strong>le</strong> support du pouvoir incarnant l'autorité féminine est<br />
plus vénéré et plus craint que celui symbolisant l'auto-<br />
(1) Assalé Amah, entretien du 10/4/1981, à Krindjabo.<br />
Cassette nO 4. La vieil<strong>le</strong> s'est refusée à tout commentaire<br />
sur <strong>le</strong> rô<strong>le</strong> <strong>de</strong> la femme akan auprès <strong>de</strong> ( .. '/' .. )
234<br />
conseils sont sollicités par <strong>le</strong>s aînés du lignage.<br />
Lorsque se produit une crise <strong>de</strong> succession d'une certai-<br />
ne amp<strong>le</strong>ur, il arrive qu'une dihye <strong>de</strong>vienne un personnage<br />
<strong>de</strong> premier plan, révélant <strong>de</strong>s capacités <strong>de</strong> dirigeant"<br />
(l) •<br />
Conservatrice <strong>de</strong> la tradition, la femme est l'élément<br />
capital <strong>de</strong> l'exercice du pouvoir, tout en <strong>de</strong>meurant<br />
dans l'ombre <strong>de</strong>s hommes qui dirigent la société agni.<br />
El<strong>le</strong> peut être considérée comme <strong>le</strong> gui<strong>de</strong>, voire l'aver-<br />
tisseur <strong>de</strong> conscience <strong>de</strong> l'homme au pouvoir. Selon<br />
Perrot, "<strong>le</strong>s femmes anyi d' aujourd' hui - dont certaines,<br />
planteurs, chefs d'entreprises, dirigent <strong>de</strong>s équipes<br />
<strong>de</strong> manoeuvres - ont donc <strong>de</strong>s <strong>de</strong>vancières ... A travers<br />
cel<strong>le</strong>s-ci est rendue tangib<strong>le</strong> la relation <strong>de</strong>s femmes<br />
au pouvoir dans l'ancienne société. El<strong>le</strong>s se trouvaient<br />
dans la proximité, mais à une certaine distance du pouvoir,<br />
norma<strong>le</strong>ment exercé par <strong>le</strong>s hommes. Mais dans <strong>le</strong>s pério<strong>de</strong>s<br />
critiques, poussées en avant par la nécessité <strong>de</strong> défen-<br />
dre <strong>le</strong>ur lignage affaibli et menacé, el<strong>le</strong>s se portaient<br />
au premier plan et occupaient la place dévolue ordinaire-<br />
ment aux hommes." (2)<br />
Dans l'ancienne société Agni-Sanwi, la présence <strong>de</strong><br />
la femme est indispensab<strong>le</strong> au rituel du pouvoir et à son<br />
maintien dans la pureté. Ce rô<strong>le</strong> religieux lui incombe<br />
et semb<strong>le</strong> trouver son explication dans l'origine même du<br />
(1) Clau<strong>de</strong>-Hélène Perrot, "Femmes et pouvoir politique<br />
dans l'ancienne société anyi-n<strong>de</strong>nye" in Cahiers d'Etu<strong>de</strong>s<br />
Africaines, 73-76, XIX-1-4, p. 220.<br />
(2) ibi<strong>de</strong>m, op. cit., p. 223.
235<br />
pouvoir. En effet, toutes <strong>le</strong>s cérémonies rituel<strong>le</strong>s liées<br />
au pouvoir sont exécutées et guidées par <strong>le</strong>s femmes.<br />
Cet aspect est très important surtout dans <strong>le</strong>s introni<br />
sations du roi ou d'un chef supérieur en milieu agni.<br />
Par exemp<strong>le</strong>, la fête d'igname qui est une occasion <strong>de</strong><br />
théâtraliser la société entière, permet <strong>de</strong> mieux déce<strong>le</strong>r<br />
la fonction <strong>de</strong> la femme auprès du pouvoir. Presque tous<br />
<strong>le</strong>s actes <strong>de</strong> purification du trône et <strong>de</strong>s assistants<br />
sont effectués par el<strong>le</strong>.<br />
Avec ce cumul <strong>de</strong> fonctions, la femme <strong>de</strong>vient <strong>le</strong><br />
noyau <strong>de</strong> tout ce qui gravite autour du pouvoir. Car,<br />
signa<strong>le</strong> Amon d'Aby, "<strong>le</strong>s véritab<strong>le</strong>s propriétaires <strong>de</strong> la<br />
chaise (l 'odijabia ), ce sont <strong>le</strong>s femmes, qui, seu<strong>le</strong>s,<br />
peuvent la transmettre à <strong>le</strong>ur postérité. Devenant par<br />
voie <strong>de</strong> succession la mère <strong>de</strong> tout <strong>le</strong> groupe, la reine<br />
<strong>de</strong> la tribu <strong>de</strong>vient du même coup propriétaire <strong>de</strong> cette<br />
chaise dans <strong>le</strong>s limites définies par la coutume. C'est<br />
<strong>pour</strong>quoi el<strong>le</strong> est en définitive la dépositaire <strong>de</strong> tous<br />
<strong>le</strong>s pouvoirs spirituels et temporels qu'en raison <strong>de</strong><br />
l'impureté et <strong>de</strong> la faib<strong>le</strong>sse <strong>de</strong> son sexe, el<strong>le</strong> délègue<br />
à l'afilié-kpangni. Le patriarche r e p r ê s e n t ev-La force,<br />
l'autorité, et la reine <strong>de</strong> la tribu, l'origine du droit."<br />
(1)<br />
Dans l'exploitation du personnage féminin à <strong>de</strong>s fins<br />
théâtra<strong>le</strong>s, Bernard Dadié n'oubliera jamais ce fonds<br />
culturel agni dans <strong>le</strong>quel il puise son inspiration aussi<br />
(1) Amon d'Aby, op. cit., p. 136.
236<br />
bien sur <strong>le</strong> plan <strong>de</strong> l'action que sur <strong>le</strong> plan du choix<br />
<strong>de</strong> la femme qui incarnera toujours la justice, <strong>le</strong> droit.<br />
Au niveau du drame, il se tisse entre <strong>le</strong> théâtre <strong>de</strong> Dadié<br />
et la culture akan une complicité patente qui permet<br />
<strong>de</strong> dévoi<strong>le</strong>r <strong>le</strong>s différentes faces du pouvoir et <strong>le</strong>s nou<br />
vel<strong>le</strong>s exploitations dont el<strong>le</strong>s font l'objet dans <strong>le</strong>s<br />
républiques indépendantes <strong>de</strong> l'Afrique mo<strong>de</strong>rne. Ce bref<br />
aperçu socio-historique <strong>de</strong> la fonction <strong>de</strong> la femme dans<br />
la société Akan nous amènera à mieux cerner <strong>le</strong> rô<strong>le</strong> qui<br />
est dévolu au personnage féminin dans <strong>le</strong> théâtre du<br />
dramaturge ivoirien.<br />
II - LA FEMME OU LE CONTRE-POUVOIR DANS LE THEATRE<br />
DE DADIE<br />
En effet, l'emploi du personnage féminin auprès <strong>de</strong><br />
l'homme politique n'est pas un fait nouveau, surtout<br />
dans <strong>le</strong>s sociétés matrilinéaires africaines. Cependant,<br />
chez <strong>le</strong>s Akan <strong>de</strong> Côte d'Ivoire, si la femme est considé<br />
rée comme la source du pouvoir, el<strong>le</strong> se révè<strong>le</strong> aussi<br />
comme <strong>le</strong> contre-pouvoir <strong>le</strong> plus craint et <strong>le</strong> plus effica<br />
ce. Aucun règne, dit-on, ne peut résister à une révolte<br />
<strong>de</strong> femme. Toute révolte féminine est considérée comme<br />
une menace. Mais el<strong>le</strong> est nécessaire dès que <strong>le</strong> droit<br />
qui régit la société se trouve mis en cause. Par exemp<strong>le</strong>,<br />
chez <strong>le</strong>s Abbey <strong>de</strong> Côte d'Ivoire, sous-groupe Akan, ce<br />
sont <strong>le</strong>s femmes qui poussent <strong>le</strong> chef à prendre ses res<br />
ponsabilités lorsque la menace pèse sur la communauté.<br />
C'est ainsi que "... lors <strong>de</strong>s litiges qui opposèrent <strong>le</strong>s<br />
Mossi (travail<strong>le</strong>urs <strong>de</strong>s plantations) aux Abbey autochtones
239<br />
Le Contremaître, s'adressant aux femmes<br />
"Pourquoi n'y a-t-il que vous <strong>le</strong>s femmes <strong>pour</strong><br />
protester dans cet î-mmense royaume ?"<br />
Première femme<br />
"Parce que c'est nous qui savons souffrir <strong>pour</strong><br />
donner la vie aux hommes ... "<br />
Deuxième femme<br />
"C'est souvent au prix <strong>de</strong> notre vie que la vie<br />
<strong>pour</strong>suit son cours ... " (1)<br />
Dadié dévoi<strong>le</strong> dans <strong>le</strong>s propos <strong>de</strong> ces personnages féminins<br />
la légitimité <strong>de</strong> <strong>le</strong>ur révolte contre l'injustice et l'ex<br />
ploitation qui sont <strong>de</strong>venues <strong>le</strong> lot <strong>de</strong> la population<br />
africaine. La rébellion <strong>de</strong>s femmes, quoique symbolique,<br />
est considérée comme un grand danger <strong>pour</strong> la société.<br />
Par l'inversion même <strong>de</strong>s rô<strong>le</strong>s sociaux, <strong>le</strong>s femmes exi-<br />
gent ainsi l'acceptation et la reconnaissance <strong>de</strong> <strong>le</strong>urs<br />
fonctions socia<strong>le</strong>s. C'est <strong>pour</strong>quoi, <strong>le</strong> seul cri conscient<br />
qui s'élèvera dans <strong>le</strong>s pièces politiques <strong>de</strong> l'auteur<br />
dramatique ivoirien proviendra souvent d'une femme; c'est<br />
ainsi que Dona Béatrice donnera son nom à l'une <strong>de</strong>s pièces<br />
<strong>le</strong>s plus politiques <strong>de</strong> l'écrivain ivoirien. Ce personnage<br />
historique surnommé "La Jeanne d'Arc Congolaise", fut<br />
une illustre figure qui marqua l'histoire <strong>de</strong> l'actuel<br />
Zaïre. Son choix au niveau du théâtre dadiéen est révéla-<br />
teur. Car, Dona Béatrice préfigure aussi la militante<br />
africaine. Parlant <strong>de</strong> ce personnage, <strong>le</strong> Professeur lbra<br />
himaBaba Kaké affirme que parmi <strong>le</strong>s femmes qui jouèrent<br />
un rô<strong>le</strong> important au Congo, "nul<strong>le</strong>... ne s'est é<strong>le</strong>vée<br />
(1) Acte II, tab<strong>le</strong>au l, p. 84.
241<br />
avec <strong>le</strong> Bitanda est un accord d'intérêt...<br />
ni <strong>le</strong> coeur, n& l'esprit...<br />
Le F.oi :<br />
"J'interdis à quiconque <strong>de</strong> par<strong>le</strong>r ainsi.<br />
Ah, si vous saviez tout ce qu'il projette <strong>de</strong><br />
faire <strong>pour</strong> la gran<strong>de</strong>ur <strong>de</strong> ce pays ?<br />
Dona Béatrice :<br />
"L'excès <strong>de</strong> pouvoir aveug<strong>le</strong>rait-il? Nous vo<br />
yons <strong>le</strong>s prétenduS frères chrétiens, s'infil<br />
trer partout. Bientôt nous vivrons tous sous<br />
<strong>le</strong> joug étranger, si cela n'était déjà. Nous<br />
avons <strong>le</strong> <strong>de</strong>voir <strong>de</strong> prévenir... <strong>de</strong> nous battre<br />
et nous nous battrons... " (1)<br />
Consciente du rô<strong>le</strong> qu'el<strong>le</strong> doit assumer, Dona Béatrice<br />
ne cessera <strong>de</strong> dénoncer et <strong>de</strong> dévoi<strong>le</strong>r <strong>le</strong>s conséquences<br />
<strong>de</strong> toute alliance fondée sur l'exploitation <strong>de</strong> la majori-<br />
té au profit d'une minorité assoiffée <strong>de</strong> gain et <strong>de</strong> glo-<br />
rio<strong>le</strong>. Exprimant toute l'idéologie <strong>de</strong> Dadié, Dona Béatrice<br />
ira jusqu'à traduire au roi <strong>le</strong> poids <strong>de</strong> l'histoire dans<br />
l'action politique. Pour el<strong>le</strong>, l'oppression et la déma-<br />
gogie mensongère ne sont que <strong>de</strong>s masques qui ne peuvent<br />
freiner <strong>le</strong> cours <strong>de</strong> l'histoire <strong>de</strong>s peup<strong>le</strong>s. Militant <strong>pour</strong><br />
une action orientée vers <strong>le</strong> futur proche, Béatrice se<br />
heurtera toujours à l'entêtement forcené du roi Mani Congo<br />
qui ne comprend pas que toute politique assimilationniste<br />
ou néo-colonialiste est une forme plus élaborée <strong>de</strong> la<br />
servitu<strong>de</strong> humaine. Ici, l'héroîne donne une véritab<strong>le</strong><br />
<strong>le</strong>çon <strong>de</strong> mora<strong>le</strong> politique au roi qui reste imperméab<strong>le</strong><br />
(1) Béatrice .... , acte II, tab<strong>le</strong>au r , p. 87.
243<br />
(Les gens accourent.)<br />
Homme <strong>de</strong>s barracons et <strong>de</strong>s baraquements J tous<br />
en marge <strong>de</strong> la vie J hommes <strong>de</strong>s cantonnements<br />
et <strong>de</strong>s relais J<br />
voici se <strong>le</strong>ver <strong>le</strong> so<strong>le</strong>il.<br />
menant la vie d'étape en étape J<br />
(Se dressent ceux qui étaient couchés.)<br />
Qu'ils sachent J<br />
nos maitres <strong>de</strong> toutes cou<strong>le</strong>urs J<br />
que nous allons nous admirer cette nuit dans<br />
la clarté <strong>de</strong>s incendies... /1 (1)<br />
Pour Dona Béatrice, tout comme <strong>pour</strong> Dadié, la seu<strong>le</strong><br />
issue possib<strong>le</strong> <strong>pour</strong> échapper à toute dictature qui se<br />
pérennise, c'est <strong>de</strong> la détruire par la vio<strong>le</strong>nce. Le fait<br />
que cette vio<strong>le</strong>nce soit toujours exprimée par la bouche<br />
d'une femme, revêt une doub<strong>le</strong> signification. D'une part,'<br />
Dadié nous renvoie consciemment ou inconsciemment à la<br />
fonction primordia<strong>le</strong> dévolue à la femme dans la société<br />
akan, fonction qui exige d'el<strong>le</strong> une réaction efficace<br />
en temps <strong>de</strong> crise aiguë, d'autre part, l'écrivain dévoi<strong>le</strong><br />
explicitement la démission tota<strong>le</strong> <strong>de</strong>s hommes face à la<br />
dictature <strong>de</strong> l'autocrate qu'ils considèrent comme une<br />
calamité naturel<strong>le</strong>. Force est <strong>de</strong> constater que c'est en<br />
bravant <strong>le</strong>s hommes que Dona Béatrice affirme sa féminité<br />
et au-<strong>de</strong>là, la fonction qu'el<strong>le</strong> doit assumer dans la<br />
société :<br />
Dona Béatrice :<br />
/ILes femmes ont <strong>le</strong>vé l'étendard <strong>de</strong> la dignité<br />
parce que l'amour <strong>de</strong> l'argent a tué <strong>le</strong> courage<br />
dans <strong>le</strong> coeur <strong>de</strong>s hommes J parce que <strong>le</strong>s hon-<br />
neurs ont corrompu <strong>le</strong>s hommes ... Ils sont nombreux<br />
(1) Béatrice... ,. acte III, tab<strong>le</strong>au l, p. 115.
la bête <strong>de</strong> somme.<br />
248<br />
Dans cette lutte constante <strong>pour</strong> la restauration<br />
d'un humanisme sans fard, Dadié s'imprègne <strong>de</strong> la vie <strong>de</strong><br />
son peup<strong>le</strong> et évoque dans son oeuvre théâtra<strong>le</strong> l'instinct<br />
<strong>de</strong> vie, <strong>de</strong> liberté et d'égalité qui est <strong>le</strong> sien. Cet<br />
aspect s'exprime mieux dans <strong>le</strong> personnage féminin. A<br />
travers Dona Béatrice, l'image <strong>de</strong> la femme militante<br />
qui a soif <strong>de</strong> liberté et <strong>de</strong> justice socia<strong>le</strong>, porte-paro<strong>le</strong><br />
<strong>de</strong> l'écrivain ivoirien, peut être vu <strong>le</strong> doub<strong>le</strong> <strong>de</strong><br />
la princesse sanwi,Mlan Alua ou la Blahima (reine-mère)<br />
<strong>de</strong>s Agni-Sanwi.<br />
En effet, en pays sanwi, <strong>le</strong>s fonctions attribuées<br />
à ce personnage sont considérab<strong>le</strong>s au niveau <strong>de</strong>s institu<br />
tions et <strong>de</strong> l'exercice du pouvoir. Une similitu<strong>de</strong> patente<br />
se tisse entre la Blahima et Dona Béatrice. On peut affir<br />
mer que la Béatrice <strong>de</strong> Dadié est non seu<strong>le</strong>ment Béatrice<br />
du Congo, mais aussi Mlan Alua, princesse renommée du<br />
Sanwi <strong>de</strong>s temps anciens. Toutes <strong>de</strong>ux cumu<strong>le</strong>nt <strong>le</strong>s fonc<br />
tions <strong>de</strong> reine-mère (même si cette. première fonction est<br />
moins évi<strong>de</strong>nte dans la pièce <strong>de</strong> l'écrivain) et <strong>de</strong> prêtres<br />
se du royaume. En tant qu'avertisseuse <strong>de</strong> conscience<br />
col<strong>le</strong>ctive, Dona Béatrice s'est vue chargée <strong>de</strong> la mission<br />
qui incombait à la Blahima, à savoir, conduire l'homme<br />
politique sur <strong>le</strong> droit chemin et <strong>le</strong> mettre en gar<strong>de</strong> contre<br />
tout dérapage <strong>pour</strong> reprendre une expression actuel<strong>le</strong>.<br />
C'est au nom <strong>de</strong> cette fonction qu'el<strong>le</strong> s'adressera toujours<br />
au Roi :
249<br />
Dona Béatrice :<br />
"C'est un ordre que J'ai reçu. Les anciens<br />
m'ordonnent toujours <strong>de</strong> vous dire la vérité...<br />
Nous avons <strong>le</strong> <strong>de</strong>voir <strong>de</strong> prévenir... " (1)<br />
Dadié prend ainsi à son propre compte l'histoire <strong>de</strong> la<br />
Blahima du Sanwi qui, en tant que responsab<strong>le</strong> <strong>de</strong> toutes<br />
<strong>le</strong>s femmes du pays, " est encore l'intermédiaire entre<br />
<strong>le</strong>s vivants et <strong>le</strong>s morts, el<strong>le</strong> dirige <strong>le</strong>s cérémonies<br />
sacrées: c'est el<strong>le</strong> qui détermine avec <strong>le</strong> grand prêtre<br />
la date <strong>de</strong> la fête d'igname... Détentrice <strong>de</strong> la tradition...<br />
el<strong>le</strong> est la principa<strong>le</strong> responsab<strong>le</strong> du choix d'un roi ...<br />
El<strong>le</strong> doit <strong>le</strong> gui<strong>de</strong>r et lui dire ce qu'il faut faire ou<br />
ne pas f aire <strong>pour</strong> être dans <strong>le</strong> droit chemin." (2)<br />
Dans <strong>le</strong> cas plus précis <strong>de</strong> la princesse du Sanwi, <strong>le</strong><br />
pouvoir traditionnel qui lui était conféré par la coutu-<br />
me fut doublé par un don personnel qui faisait d'el<strong>le</strong><br />
<strong>le</strong> Komian, c' est-à-dire une personne douée d'un pouvoir<br />
surnaturel reçu d'un génie.<br />
Doublée donc <strong>de</strong> ce pouvoir, on comprend bien l'in-<br />
fluence et <strong>le</strong> poids qu'une tel<strong>le</strong> femme peut exercer sur<br />
l'homme politique. Son exploitation dans <strong>le</strong> théâtre<br />
<strong>de</strong> Dadié redonne certes <strong>le</strong> caractère merveil<strong>le</strong>ux au Pou-<br />
voir, mais répond aussi à une constante qui anime <strong>le</strong><br />
dramaturge ivoirien, cel<strong>le</strong> <strong>de</strong> réhabiliter l'image <strong>de</strong> ces<br />
gran<strong>de</strong>s figures, qui ont marqué l'histoire <strong>de</strong> l'Afrique.<br />
Cette réhabilitation trouve sa justification dans un<br />
doub<strong>le</strong> contexte qui a marqué l'écrivain ivoirien:<br />
(1) Béatrice... , acte II, tab<strong>le</strong>au l, pp. 86-87.<br />
(2) Diabaté H., "Mlan Alua, Blahima du Sanwi", in Bul<strong>le</strong>tin<br />
<strong>de</strong> l'I.F.A.N., t. 39, série B, N° 2, 1977, p-:- 321.
250<br />
1. Appartenant à une société fondée sur <strong>le</strong> matrili<br />
gnage, Dadié dévoi<strong>le</strong> par <strong>le</strong> rô<strong>le</strong> qu'il attribue<br />
au personnage féminin dans son théâtre, que la<br />
femme, contrairement à ce que pensent <strong>le</strong>s détrac<br />
teurs généralistes <strong>de</strong> l'Afrique, assuma une fonc<br />
tion politique très importante. Au Sanwi, par<br />
exemp<strong>le</strong>, "la blahima symbolise <strong>le</strong> vrai pouvoir;<br />
el<strong>le</strong> est l'image <strong>de</strong> la première ancêtre du clan<br />
royal, cel<strong>le</strong> qui lui a donné naissance. El<strong>le</strong> re<br />
présente <strong>le</strong> Mlata qui a permis la survie <strong>de</strong> ce<br />
clan, sous la direction duquel <strong>le</strong> peup<strong>le</strong> Sanwi<br />
a résisté aux guerres et échappé à la 4ésagrégation,<br />
ce clan grâce auquel <strong>le</strong> pays a prospéré. A ce<br />
titre la blahima est un personnage sacré, plus<br />
considéré que <strong>le</strong> roi lui-même, sans <strong>le</strong>quel on est<br />
persuadé que <strong>le</strong> groupe perdrait <strong>de</strong> sa substance,<br />
<strong>de</strong> sa force ... " Cl)<br />
Sa présence dans <strong>le</strong>s textes <strong>de</strong> Dadié traduit<br />
consciemment ou inconsciemment l'idée <strong>de</strong> continui<br />
té <strong>de</strong> la lutte <strong>de</strong> la femme aux côtés <strong>de</strong> l'homme.<br />
2. On peut y voir aussi l'expression d'une reconnais<br />
sance implicite adressée aux militantes du R.D.A.<br />
qui ont été fermes dans la lutte émancipatrice<br />
du pays <strong>de</strong> Dadié. Car el<strong>le</strong>s se sont révélées com<br />
me un véritab<strong>le</strong> contre-pouvoir dont <strong>le</strong> dynamisme<br />
a ébranlé l'administration colonia<strong>le</strong>; surtout lors<br />
(1) Diabaté H., in Bul<strong>le</strong>tin <strong>de</strong> l'I.F.A.N., op. cit. p. 339.
251<br />
<strong>de</strong> l'internement <strong>de</strong> Bernard Dadié et sept autres<br />
militants du R.D.A. à la prison <strong>de</strong> Grand-Bassam)<br />
à la suite <strong>de</strong>s événements du 6 février 1949. La<br />
marche <strong>de</strong>s femmes sur Bassam est restée un fait<br />
profondément historique qui est toujours d'actua<br />
lité.<br />
Dans tous <strong>le</strong>s cas, la présence réitérée du personnage<br />
féminin dans <strong>le</strong> théâtre dadiéen répond à une fidélité<br />
à l'image méliorative <strong>de</strong> la femme africaine. Paraphrasant<br />
Madame <strong>de</strong> Maintenon, nous pouvons affirmer que ce sont<br />
<strong>le</strong>s femmes qui font et défont <strong>le</strong> pouvoir dans <strong>le</strong> théâtre<br />
<strong>de</strong> Dadié, si nous nous référons aux sources originel<strong>le</strong>s<br />
du Pouvoir.<br />
CONCLUSION<br />
L'exploitation du personnage féminin à <strong>de</strong>s fins<br />
théâtra<strong>le</strong>s, permet à Bernard Dadié <strong>de</strong> dévoi<strong>le</strong>r <strong>le</strong> vérita<br />
b<strong>le</strong> dédoub<strong>le</strong>ment <strong>de</strong> la femme. Auprès <strong>de</strong> l'homme politi<br />
que sur <strong>le</strong>quel el<strong>le</strong> exerce une influence considérab<strong>le</strong>)<br />
la femme est en effet source du pouvoir et obstac<strong>le</strong> à ce<br />
même pouvoir. Cette doub<strong>le</strong> fonction fait d'el<strong>le</strong> un contre<br />
pouvoir redoutab<strong>le</strong> comme <strong>le</strong> <strong>de</strong>vin.<br />
Cerveau <strong>de</strong> toutes <strong>le</strong>s révoltes dans Les Voix...<br />
et dans Béatrice... , <strong>le</strong> personnage féminin apparaît com<br />
me "<strong>le</strong> grenadier voltigeur" en terme militaire, c'est-à<br />
dire <strong>le</strong> fantassin chargé <strong>de</strong> mener <strong>le</strong> combat principa<strong>le</strong>ment<br />
par <strong>le</strong> mouvement et par <strong>le</strong> choc. Cette fonction capita<strong>le</strong><br />
que Dadié attribue à la femme fait d'el<strong>le</strong> l'élément cata-
253<br />
point exhaustive, nous pensons que la mort <strong>de</strong> Béatrice<br />
au bûcher revêt une doub<strong>le</strong> signification: d'une part,<br />
cette mort est la préfiguration d'une désagrégation tota<strong>le</strong><br />
<strong>de</strong>s institutions politiques africaines fondées sur un<br />
support matériel garantissant <strong>le</strong> droit; d'autre part,<br />
avec Béatrice est enterrée définitivement peut-être<br />
l'image <strong>de</strong> la femme militante convaincueiqui se donne<br />
en sacrifice <strong>pour</strong> la survie <strong>de</strong> toute une col<strong>le</strong>ctivité<br />
entière.
TROISIEME PARTIE<br />
ESSAI D'ANALYSE CRITIQUE
254<br />
Cette <strong>de</strong>rnière partie <strong>de</strong> notre travail s'intitu<strong>le</strong>ra,<br />
faute <strong>de</strong> mieux, Essai d'analyse critique. El<strong>le</strong> a <strong>pour</strong><br />
objectif principal <strong>de</strong> nous interroger brièvement sur<br />
<strong>le</strong>s techniques dramatiques qui permettent à Dadié <strong>de</strong> stig<br />
matiser <strong>le</strong> pouvoir et <strong>de</strong> révé<strong>le</strong>r en même temps ce que<br />
<strong>de</strong>viendra <strong>le</strong> dirigeant politique.<br />
Signalons qu'il ne s'agit pas <strong>pour</strong> nous <strong>de</strong> nous en<br />
gager dans une étu<strong>de</strong> exhaustive <strong>de</strong> l'esthétique dadiéenne,<br />
dans la mesure où, Dadié, comme bon nombre d'écrivains<br />
africains, privilégie plus <strong>le</strong> didactisme au détriment <strong>de</strong><br />
l'esthétisme considéré dans la situation actuel<strong>le</strong> comme<br />
secondaire. Cela n'exclut <strong>pour</strong>tant pas l'existence d'une<br />
esthétique théâtra<strong>le</strong> propre au dramaturge ivoirien.<br />
Dans un second temps, nous nous attacherons à déga<br />
ger <strong>le</strong> projet <strong>de</strong> société et l'idéologie dominante qui<br />
<strong>le</strong> sous-tend. En <strong>de</strong>rnière analyse, nous nous intéresserons<br />
plus particulièrement à la position socia<strong>le</strong> que Bernard<br />
Dadié occupe aujourd'hui dans son pays; cel<strong>le</strong>-ci est<br />
présentement l'objet <strong>de</strong> nombreuses interrogations dans<br />
<strong>le</strong>s milieux intel<strong>le</strong>ctuels ivoiriens.
256<br />
forcément <strong>pour</strong>riture." (1)<br />
Se fondant sur cette théorie, <strong>le</strong> théâtre <strong>de</strong> Dadié<br />
établit un véritab<strong>le</strong> pont entre <strong>le</strong> passé et <strong>le</strong> présent<br />
dans la perspective d'une approche critique <strong>de</strong> l'histoire.<br />
Il ne retient <strong>de</strong> cel<strong>le</strong>-ci que <strong>le</strong>s éléments dynamogènes<br />
susceptib<strong>le</strong>s <strong>de</strong> favoriser la prise <strong>de</strong> conscience et une<br />
meil<strong>le</strong>ure appréhension <strong>de</strong>s problèmes du moment. Il ne<br />
s'agit pas <strong>pour</strong> <strong>le</strong> dramaturge ivoirien <strong>de</strong> faire une apo-<br />
logie <strong>de</strong> l'histoire, mais <strong>de</strong> la passer au peigne fin,<br />
<strong>pour</strong> mieux déce<strong>le</strong>r <strong>le</strong>s erreurs fatidiques, qu'il faut<br />
éviter: "C'est dans cette perspective, signa<strong>le</strong> Kotchy,<br />
que Dadié considère Toussaint Louverture. Peu lui importe<br />
ses succès militaires. Ce sont <strong>le</strong>s erreurs <strong>de</strong> son gouver-<br />
nement qui attirent son attention : ses relations avec<br />
la métropo<strong>le</strong>, avec <strong>le</strong> mon<strong>de</strong> paysan, avec ses généraux<br />
Moyse et Dessalines... Dadié soulignera davantage <strong>le</strong>s<br />
passages propres à émouvoir <strong>le</strong> public africain d'aujour-<br />
d'hui; à l'ai<strong>de</strong>r à reconstruire sa propre histoire." (2)<br />
Cette utilisation <strong>de</strong> l'histoire permet à l'écrivain<br />
<strong>de</strong> vitupérer <strong>le</strong>s dirigeants politiques actuels. Ce recul<br />
nécessaire par rapport à l'actualité donne un ferment <strong>de</strong><br />
rénovation au théâtre dadiéen. Celui-ci fixera au <strong>le</strong>cteur-<br />
spectateur une marge plus large <strong>de</strong> projection non seu<strong>le</strong>-<br />
ment dans <strong>le</strong>s méandres <strong>de</strong> l'histoire, mais aussi dans <strong>le</strong>s<br />
turpitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> l'actualité vues à la lumière d'expérience<br />
(1) Bandja Kouyaté, Entretien sur <strong>le</strong> rô<strong>le</strong> du griot dans la<br />
société malinké, Minignan <strong>le</strong> 10/7/1981, cassette nO 3.<br />
(2) Kotchy B., op. cit., p. 228.
257<br />
vraie permettant <strong>de</strong> cerner <strong>le</strong>s contours d'une société<br />
future à construire. Cette projection n'interdit pas<br />
du tout <strong>le</strong> processus d'i<strong>de</strong>ntification qui doit forcément<br />
déboucher sur la prise <strong>de</strong> conscience immédiate du spec<br />
tateur. En cela, Dadié conserve <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ttes envers Brecht.<br />
C'est l'ironie, métho<strong>de</strong> plus subti<strong>le</strong>, élaborée à<br />
la brechtienne, qui sous-tend en gran<strong>de</strong> partie l'analyse<br />
du capitalisme post-colonial dans <strong>le</strong>s pièces <strong>de</strong> l'écri<br />
vain ivoirien. Sous <strong>le</strong> couvert <strong>de</strong> la métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> distan<br />
ciation, l'histoire se voit utilisée par Dadié comme<br />
un instrument privilégié <strong>de</strong> combat contre tout pouvoir<br />
autocratique, totalitaire. On peut affirmer aussi que<br />
c'est <strong>le</strong> meil<strong>le</strong>ur moyen <strong>pour</strong> <strong>le</strong> dramaturge d'échapper<br />
à la censure qui sévit dans son pays. C'est <strong>pour</strong>quoi <strong>le</strong>s<br />
éléments historiques tels <strong>le</strong>s titres <strong>de</strong> nob<strong>le</strong>sse ou<br />
noms d'emprunt comme "Dom Carlos 1er, Grand Duc <strong>de</strong>... ,<br />
Baron, Marquis <strong>de</strong>... , Comte <strong>de</strong> ... " qui, à eux seuls évo<br />
quent une pério<strong>de</strong> historique précise, ne sont qu'un<br />
trompe-l'oeil efficace sous <strong>le</strong> couvert duquel Dadié<br />
caricature la cohorte <strong>de</strong>s dirigeants fantoches africains,<br />
obnubilés par <strong>le</strong> mimétisme <strong>de</strong> l'Occi<strong>de</strong>nt. ç'est à ce<br />
niveau que l'on comprend l'affirmation <strong>de</strong> Dailly selon<br />
laquel<strong>le</strong> "nos auteurs se veu<strong>le</strong>nt avant tout <strong>de</strong>s créateurs<br />
doués d'une sensibilité délicate et d'un sens esthétique<br />
poussé. Ils sont conscients, <strong>pour</strong>suit Dailly, <strong>de</strong>s embûches<br />
que l'histoire dresse sans arrêt sur <strong>le</strong>ur chemin. Seu<strong>le</strong><br />
la vérité historique <strong>le</strong>s intéresse. Ils veu<strong>le</strong>nt s'appuyer<br />
sur el<strong>le</strong>, <strong>pour</strong> faire oeuvre d'imagination sans oublier
258<br />
qu'ils ont un message à transmettre à <strong>le</strong>ur peup<strong>le</strong>." (1)<br />
L'exploitation du personnage <strong>de</strong> Dona Béatrice par<br />
exemp<strong>le</strong> permet à Dadié <strong>de</strong> dévoi<strong>le</strong>r la doub<strong>le</strong> dimension<br />
<strong>de</strong> cette figure historique. D'une part, il s'agit <strong>pour</strong><br />
<strong>le</strong> dramaturge <strong>de</strong> révé<strong>le</strong>r en cette héroïne l'image <strong>de</strong> la<br />
Blahima traditionnel<strong>le</strong>, vénérée par <strong>le</strong>s Agni Sanwi, et<br />
support réel du système matrilinéaire; d'autre part, <strong>de</strong><br />
recréer l'image <strong>de</strong> la femme militante progressiste <strong>de</strong>s<br />
années cinquante tel<strong>le</strong>s Awa Kéita du Hali ou Sery Koré<br />
<strong>de</strong> Côte d'Ivoire. Ces personnages féminins, implicitement<br />
présents dans la personne même <strong>de</strong> Béatrice, préfigurent<br />
la femme africaine émancipée en butte à l'oppression<br />
<strong>de</strong>s nouveaux dirigeants.<br />
Aussi Dadié se sert-il <strong>de</strong> Dona Béatrice <strong>pour</strong> mieux<br />
stigmatiser toutes <strong>le</strong>s turpitu<strong>de</strong>s du Roi Mani Congo,<br />
caricature du dirigeant néo-colonialiste. C'est avec<br />
Béatrice que <strong>le</strong> dramaturge crée <strong>le</strong> mythe du grand futur<br />
p<strong>le</strong>in d'espoir et qui verra la réhabilitation <strong>de</strong> l'homme<br />
africain et l'instauration d'une plus gran<strong>de</strong> justice<br />
faite <strong>de</strong> Liberté. Les <strong>de</strong>rnières paro<strong>le</strong>s <strong>de</strong> l'héroïne nous<br />
plongent dans la dimension profon<strong>de</strong> <strong>de</strong> l'épopée, tendant<br />
à faire resurgir dans <strong>le</strong>s consciences, <strong>de</strong>s images fulgu-<br />
rantes qui ont émaillé <strong>le</strong>s diffici<strong>le</strong>s parcours du peup<strong>le</strong><br />
africain en lutte <strong>pour</strong> sa libération tota<strong>le</strong> <strong>de</strong> toute<br />
dictature qu'el<strong>le</strong> soit interne ou externe. A travers <strong>le</strong>s<br />
mots prononcés par Dona Béatrice, se cristallise toute<br />
(1) Dailly Christophe, "L'histoire", in Théâtre négroafricain,<br />
Actes du Colloque d'Abidjan, p. 88.
260<br />
écharpes, <strong>le</strong>s bibelots... , la publicité... " révélant<br />
implicitement la coopération avec l'Europe et la person<br />
nalisation du pouvoir, renvoient plus à l'Afrique post<br />
colonia<strong>le</strong> qu'à l'Afrique précolonia<strong>le</strong> ou colonia<strong>le</strong>.<br />
Dadié dévoi<strong>le</strong> par ce biais que ceux qui ont embrigadé<br />
ses écrits dans <strong>le</strong> cadre simpliste du procès <strong>de</strong> la colo<br />
nisation se sont en partie trompés. Les pièces du drama<br />
turge ivoirien dépassent la simp<strong>le</strong> parodie voire la<br />
simp<strong>le</strong> polémique dressée contre <strong>le</strong> colonisateur. Certaines<br />
expressions pertinentes, utilisées dans la vie quoti<br />
dienne se retrouvent dans <strong>le</strong>s textes dadiéens. El<strong>le</strong>s ont<br />
en fait <strong>pour</strong> rô<strong>le</strong> <strong>de</strong> ne pas trop éloigner <strong>le</strong> spectateur<br />
<strong>le</strong>cteur <strong>de</strong> la réalité qui est la sienne. Aussi Dadié<br />
recourt-il en <strong>le</strong>s synthétisant aux slogans qui inon<strong>de</strong>nt<br />
<strong>le</strong>s différentes presses. Les expressions comme "Père<br />
<strong>de</strong> la Nation" ou "<strong>le</strong> Libérateur" sont extraites <strong>de</strong>s dis<br />
cours glanés chaque jour, <strong>pour</strong> créer autour du chef<br />
<strong>le</strong> mythe du père fondateur sans <strong>le</strong>quel il n'y aurait pas<br />
<strong>de</strong> société. Ces expressions endormeuses voi<strong>le</strong>nt <strong>le</strong>s mul<br />
tip<strong>le</strong>s erreurs <strong>de</strong>s dirigeants qui fon<strong>de</strong>nt <strong>le</strong>ur comporte<br />
ment sur <strong>le</strong> "après moi <strong>le</strong> chaos, <strong>le</strong> déluge" exprimé par<br />
<strong>le</strong> Mani Congo. Selon G. Conac, ces hommes politiques se<br />
font accepter ainsi par <strong>le</strong>s masses comme "bâtisseur <strong>de</strong><br />
la Nation, gui<strong>de</strong> <strong>de</strong> la révolution, libérateur, ré<strong>de</strong>mpteur,<br />
grand timonier ... Ils estiment avoir <strong>le</strong> droit d'exiger<br />
<strong>de</strong> <strong>le</strong>urs concitoyens une fidélité tota<strong>le</strong> en raison <strong>de</strong>s<br />
services qu'ils <strong>le</strong>ur ren<strong>de</strong>nt et <strong>de</strong> l'aptitu<strong>de</strong> dont ils<br />
font preuve <strong>pour</strong> <strong>le</strong>s diriger. Le pouvoir dans <strong>le</strong>s Etats<br />
d'Afrique, conclut Conac, reste ainsi marqué par la
263<br />
Le dramaturge ivoirien, tout en révélant l'erreur histo<br />
rique <strong>de</strong> Toussaint Louverture, dévoi<strong>le</strong> implicitement cel<strong>le</strong><br />
d'un Bokassa 1er ou d'un Macias NGuema. Le Toussaint<br />
<strong>de</strong> Dadié, loin d'être un martyr, est un dictateur qui<br />
évoque <strong>le</strong>s généraux galonnés du XXème sièc<strong>le</strong>. Il diffère<br />
ainsi <strong>de</strong> celui que Césaire considère comme un martyr.<br />
Car, écrit-il, "ce rô<strong>le</strong> <strong>de</strong> martyr, Toussaint l'accepta,<br />
mieux, alla au-<strong>de</strong>vant <strong>de</strong> lui, parce qu'il <strong>le</strong> croyait<br />
indispensab<strong>le</strong> en effet. Je n'irai pas jusqu'à dire que<br />
la reddition <strong>de</strong> Toussaint fut une manière <strong>de</strong> <strong>de</strong>votio à<br />
l'antique: l'abandon d'une vie, la sienne, cel<strong>le</strong> d'un<br />
chef, en un acte <strong>de</strong> foi; <strong>pour</strong> <strong>le</strong> salut du peup<strong>le</strong>. J'y vois<br />
mieux qu'un acte mystique: un acte politique. Oui,<br />
<strong>pour</strong>suit Césaire, ce voyage qui <strong>le</strong> conduisait à la<br />
captivité et à la mort, il <strong>le</strong> conçut comme son <strong>de</strong>rnier<br />
acte pol i tique et, sans doute l'un <strong>de</strong>s plus féconds." (1)<br />
Alors que chez Dadié, Toussaint est un chef omnipotent<br />
qui écope <strong>le</strong>s châtiments relatifs aux erreurs <strong>de</strong> sa<br />
politique néo-colonialiste et arbitraire.<br />
La fusion intime <strong>de</strong>s faits puisés dans l'actualité<br />
et projetés dans un passé révolu, mais proche, permet à<br />
la critique dadiéenne <strong>de</strong> s'épanouir et <strong>de</strong> brouil<strong>le</strong>r <strong>le</strong>s<br />
pistes à la censure.. Ce qui frappe chez Dadié, c'est que<br />
<strong>le</strong>s éléments anachroniques, harmonieusement intégrés à<br />
l'action dramatique, donnent une immense possibilité<br />
au dramaturge <strong>de</strong> changer <strong>de</strong> ton d'une situation à une<br />
(1) Aimé Césaire, op. cit., p. 313.
267<br />
recherchant dans <strong>le</strong>s événements passés, <strong>de</strong>s <strong>le</strong>çons <strong>de</strong><br />
conduite <strong>pour</strong> la construction d'un présent meil<strong>le</strong>ur.<br />
Le parallélisme mettant en lumière <strong>le</strong>s situations<br />
<strong>de</strong> Napoléon et <strong>de</strong> Toussaint Louverture débouche sur une<br />
sorte <strong>de</strong> mora<strong>le</strong> politique. Cel<strong>le</strong>-ci sera énoncée par<br />
Napoléon Bonaparte qui, apprenant que Toussaint Louverture<br />
a été incarcéré et mort au Fort <strong>de</strong> Joux, se rendra compte<br />
<strong>de</strong> son erreur politique, et découvrira par la même occa<br />
sion que tous <strong>le</strong>s <strong>de</strong>ux, ils avaient <strong>le</strong> même <strong>de</strong>stin<br />
commun :<br />
Napoléon :<br />
!'Au fort <strong>de</strong> Joux dans <strong>le</strong> Jura, lui qui était<br />
<strong>de</strong>s tropiques ! Le so<strong>le</strong>il doit lui manquer<br />
comme me manquent <strong>le</strong> froid et la neige...<br />
(Après un long si<strong>le</strong>nce).<br />
Nous étions tous <strong>de</strong>ux <strong>de</strong>s {<strong>le</strong>s. Nous avons<br />
tous <strong>de</strong>ux eu à lutter contre <strong>le</strong>s mêmes puissances.<br />
Il est mort sur <strong>le</strong> continent." (1)<br />
A travers ces paro<strong>le</strong>s, se lit une profon<strong>de</strong> idée <strong>de</strong> cul<br />
pabilité, implicitement exprimée. Le dictateur français<br />
se reproche en fait d'avoir créé la situation tragique<br />
qu'a vécue Toussaint Louverture au Fort <strong>de</strong> Joux, sous la<br />
gar<strong>de</strong> du geôlier Bail<strong>le</strong> qui, mieux que quiconque, a su<br />
peindre <strong>le</strong> calvaire <strong>de</strong> Toussaint. Pour révé<strong>le</strong>r l'erreur<br />
historique <strong>de</strong> Napoléon en matière <strong>de</strong> politique, Dadié<br />
a exploité en profon<strong>de</strong>ur l'aveu <strong>de</strong> l'Empereur. Celui-ci,<br />
avant <strong>de</strong> mourir, reconnut ses abus; parlant <strong>de</strong> Saint-<br />
(1) I<strong>le</strong>s ... tab<strong>le</strong>au VII, pp. 132-134.
270<br />
aussi <strong>le</strong> "flash-back" ou retour en arrière dans <strong>le</strong> récit.<br />
Ce procédé cinématographique est habi<strong>le</strong>ment employé<br />
dans Les Voix dans <strong>le</strong> vent, <strong>pour</strong> montrer au spectateur<br />
<strong>le</strong> passé sinistre <strong>de</strong> Nahoubou roi et <strong>de</strong> Nahoubou enfant.<br />
Il s'agit ici <strong>pour</strong> Dadié <strong>de</strong> susciter <strong>le</strong> raisonnement cri<br />
tique chez <strong>le</strong> spectateur-<strong>le</strong>cteur, en juxtaposant <strong>le</strong>s <strong>de</strong>ux<br />
pério<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la vie du héros. La rémanence <strong>de</strong> ces images<br />
ne laisse pas Nahoubou indifférent. Il <strong>le</strong> traduira lui-<br />
même :<br />
Nahoubou 1er<br />
"Voici <strong>le</strong> passé qui surnage J<br />
remonte en gros<br />
ses bul<strong>le</strong>s du fond <strong>de</strong> la vase ! Je <strong>le</strong> croyais<br />
à jamais enseveli. Il n'était qu'assoupi." (1)<br />
Par <strong>le</strong> procédé du "flash-back", la résurgence du passé<br />
lugubre <strong>de</strong> Nahoubou donne à Dadié la possibilité <strong>de</strong> révé-<br />
1er <strong>le</strong>s sources profon<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la criminalité qui va mar<br />
quer <strong>le</strong> règne du potentat. Cette soif <strong>de</strong> sang qui anime<br />
<strong>le</strong> personnage, trouve sa justification dans sa tendre<br />
enfance. La mère du héros <strong>le</strong> dévoi<strong>le</strong> dans une conversa-<br />
tion avec Papa-Nahoubou<br />
Nabli (mère <strong>de</strong> Nahoubou)<br />
"Ton fils est en train <strong>de</strong> mal tourner... Il<br />
est plus dévastateur qu'une division <strong>de</strong><br />
sauterel<strong>le</strong>s.<br />
(1) Les Voix ... , p. 12.<br />
plus diab<strong>le</strong> que <strong>le</strong> diab<strong>le</strong> J<br />
ton fils !<br />
il a dans <strong>le</strong> village tué <strong>le</strong>s lézards J <strong>le</strong>s oi<br />
seaux J <strong>le</strong>s chats J <strong>le</strong>s chiens J tout.
4.0.0_" 22 U.At:4W4!.,UJtCi •. nlfiiAW px.•..<br />
273<br />
comique par un simp<strong>le</strong> déplacement d'accent. Il y a toute<br />
une part <strong>de</strong> jeu et <strong>de</strong> représentation dans l'activité<br />
du sorcier... " (1)<br />
Son utilisation dans <strong>le</strong> théâtre du dramaturge ivoi-<br />
rien, avons-nous dit, traduit un souci d'originalité<br />
africaine. Ce même souci incite Dadié à présenter Nahou-<br />
bou Ier, sous l'apparat d'un roi traditionnel. Les<br />
éléments du décor, tels "l'auvent, <strong>de</strong>ux joueurs <strong>de</strong> cor,<br />
un porteur <strong>de</strong> crachoir, un chasse-mouches" renvoient<br />
au pouvoir traditionnel. Mais c'est sous <strong>le</strong> masque <strong>de</strong><br />
cet apparat que <strong>le</strong> dramaturge caricature son héros,<br />
prototype du roi nègre qui, en p<strong>le</strong>ine pério<strong>de</strong> <strong>de</strong>s indé-<br />
pendances acquises, ressuscite un passé mimétique, vou-<br />
lant à tout prix créer la dynastie <strong>de</strong>s Nahoubou.<br />
Au niveau <strong>de</strong> la scène proprement dite, Dadié<br />
exploite à fond la musique qui sous-tendra tous <strong>le</strong>s<br />
actes et mouvements <strong>de</strong>s personnages. Aucune pièce du<br />
dramaturge ne masque la présence du rythme endiablé<br />
du tam-tam et <strong>de</strong> la danse. Dans I<strong>le</strong>s <strong>de</strong> tempête, <strong>le</strong> chant<br />
<strong>de</strong>s esclaves ponctuent <strong>le</strong> rythme <strong>de</strong> travail, entrecoupé<br />
par <strong>le</strong>s coups <strong>de</strong> pied et <strong>de</strong> fouet <strong>de</strong>s nouveaux maîtres<br />
du régime Toussaint Louverture. En général, chants et<br />
GIDrtams interviennent toujours aux temps forts <strong>de</strong> l'ac-<br />
tion. Cette place primordia<strong>le</strong> attribuée au chant et à<br />
la danse est mieux expliquée par Cuche. Selon cet auteur,<br />
(1) F. X. Cuche, "L'utilisation <strong>de</strong>s techniques <strong>de</strong> théâtre<br />
traditionnel africain dans <strong>le</strong> théâtre négro-africain<br />
mo<strong>de</strong>rne", in Théâtre négro-africain, pp. 139-140.
274<br />
"<strong>le</strong> chant, la danse, la musique sont conçus comme <strong>de</strong>s<br />
instruments <strong>de</strong> communion, <strong>de</strong> participation, d'intégration<br />
<strong>de</strong> tous à la représentation. Ils soulignent <strong>le</strong>s moments<br />
importants <strong>de</strong> la représentation, <strong>le</strong>s mettent en va<strong>le</strong>ur,<br />
<strong>le</strong>s expliquent, <strong>le</strong>s font vivre avec une gran<strong>de</strong> intensité.<br />
Surtout, ils fon<strong>de</strong>nt la col<strong>le</strong>ctivité dans l'union, ils<br />
font entrer dans <strong>le</strong> même jeu acteurs et spectateurs." (1)<br />
A la lumière <strong>de</strong> ce jugement, on comprend la prédominance<br />
du tam-tam et <strong>de</strong> la danse dans <strong>le</strong> théâtre dadiéen. Ils<br />
font <strong>de</strong> son oeuvre théâtra<strong>le</strong> un art total où se déploient<br />
tous <strong>le</strong>s rythmes qui agencent la vie <strong>de</strong>s hommes en com<br />
munauté. Seu<strong>le</strong> la <strong>de</strong>rnière pièce du dramaturge ivoirien<br />
(Mhoi-Ceul) donne peu <strong>de</strong> place â la musique. Les autres<br />
restent beaucoup tributaires du théâtre traditionnel;<br />
chants, danse et rythme, considérés comme <strong>de</strong>s effets spé<br />
ciaux, prolongent <strong>le</strong> temps <strong>de</strong> la fiction théâtra<strong>le</strong> et<br />
celui <strong>de</strong> la représentation; ils permettent <strong>de</strong> dévoi<strong>le</strong>r<br />
amp<strong>le</strong>ment un pan <strong>de</strong> la réalité quotidienne vécue et<br />
revécue par <strong>le</strong> spectateur.<br />
Ces différents procédés prennent â <strong>le</strong>ur propre<br />
compte <strong>le</strong>s multip<strong>le</strong>s proverbes qui bro<strong>de</strong>nt <strong>le</strong> langage<br />
théâtral dadiéen. Ce mo<strong>de</strong> d'expression traditionnel, énoncé<br />
dans <strong>de</strong>s circonstances nouvel<strong>le</strong>s, donnent un sang nouveau<br />
au théâtre <strong>de</strong> Dadié. Les proverbes dans <strong>le</strong>s écrits du<br />
dramaturge sont <strong>le</strong> ref<strong>le</strong>t d'une culture traditionnel<strong>le</strong><br />
bien assimilée et renouvelée à chaque occasion. Ils ont<br />
(1) F. X. Cuche, op. cit., pp. 139-140.
279<br />
est aussi l'expression du pouvoir néo-colonial qUl<br />
caractérise la pério<strong>de</strong> <strong>de</strong>s "so<strong>le</strong>ils <strong>de</strong>s indépendances".<br />
Quant à I<strong>le</strong>s <strong>de</strong> tempête, el<strong>le</strong> renvoie non seu<strong>le</strong>ment<br />
à la dictature napoléonienne et son idéologie esclava<br />
giste et colonialiste, mais el<strong>le</strong> traduit à travers Tous<br />
saint Louverture <strong>de</strong>ux événements cruciaux qui ont marqué<br />
l'histoire du peup<strong>le</strong> noir: la lutte <strong>de</strong> l'Esclave contre<br />
<strong>le</strong> Maitre, <strong>le</strong>s difficultés <strong>de</strong> l'indépendance nationa<strong>le</strong>.<br />
Ce personnage historique, ref<strong>le</strong>t <strong>de</strong>s années soixante,<br />
résume <strong>le</strong>s méandres et <strong>le</strong>s déboires <strong>de</strong>s révolutionnaires<br />
idéalistes et intransigeants qui sont tombés dans <strong>le</strong>s<br />
-erreurs qu'ils reprochaient aux anciens maîtres. On<br />
voit aussi à travers Toussaint Louverture l'image atté<br />
nuée du Roi Christophe <strong>de</strong> Césaire à la seu<strong>le</strong> différence<br />
que <strong>le</strong> héros dadiéen n'endosse pas l'étiquette roya<strong>le</strong>.<br />
Mais en actualisant la pièce, Toussaint Louverture sym<br />
bolise une époque, cel<strong>le</strong> <strong>de</strong>s dictatures militaires qui<br />
étouffent certains pays africains.<br />
Enfin, avec Nahoubou 1er et Mhoi-Ceul, c'est la<br />
caricature grotesque d'une époque, cel<strong>le</strong> <strong>de</strong>s premières<br />
décennies où <strong>le</strong>s Africains ayant conquis <strong>le</strong>ur indépendance<br />
politique, sont appelés à assumer <strong>le</strong>s nouvel<strong>le</strong>s respon<br />
sabilités et à faire <strong>le</strong>ur propre histoire. C'est l'époque<br />
<strong>de</strong>s nouveaux tyrans. Si Nahoubou 1er est l'image éblouis<br />
sante d'un Bokassa 1er, symbo<strong>le</strong> grotesque <strong>de</strong> la griserie<br />
du pouvoir, Mhoi-Ceul lui, est l'incarnation <strong>de</strong> la bureau<br />
cratie paralysante qui caractérise <strong>le</strong> nouveau pouvoir<br />
africain.
284<br />
Cette analyse fait découvrir que la structuration<br />
spatia<strong>le</strong>, plus importante que cel<strong>le</strong> du temps, est pro-<br />
fondément idéologique chez Dadié. El<strong>le</strong> répond à l'objec-<br />
tif que s'est fixé <strong>le</strong> dramaturge ivoirien, celui <strong>de</strong><br />
dévoi<strong>le</strong>r dans <strong>le</strong>s moindres détails <strong>le</strong>s rouages du pouvoir.<br />
C'est <strong>pour</strong>quoi tous <strong>le</strong>s moyens proprement scéniques sont<br />
mis en oeuvre <strong>pour</strong> donner une plus gran<strong>de</strong> efficacité à<br />
la dénonciation <strong>de</strong> l'abus du pouvoir et <strong>de</strong> ses conséquen-<br />
ces négatives. Dadié veut ainsi offrir au public une<br />
oeuvre à laquel<strong>le</strong> <strong>le</strong> spectateur doit donner un prolon-<br />
gement en dépistant tous <strong>le</strong>s éléments susceptib<strong>le</strong>s <strong>de</strong><br />
voi<strong>le</strong>r la réalité du pouvoir. Aussi la signification<br />
globa<strong>le</strong> <strong>de</strong> l'espace fait-el<strong>le</strong> percevoir que la clôture<br />
spatia<strong>le</strong> tire toute son essence <strong>de</strong> la mystique qui<br />
entoure <strong>le</strong> pouvoir; celui-ci étant considéré comme <strong>le</strong><br />
domaine <strong>de</strong> la science, du savoir, il y a lieu <strong>de</strong> <strong>le</strong> voi<strong>le</strong>r,<br />
<strong>de</strong> <strong>le</strong> réserver à <strong>de</strong>s initiés. Cependant, si <strong>le</strong> dirigeant<br />
politique occupe un grand espace au niveau topologique<br />
<strong>de</strong>s pièces, il n'empêche que cet espace s'effrite, <strong>pour</strong><br />
se réduire entièrement au palais, à l'apogée du chef.<br />
Cette pério<strong>de</strong> qui est <strong>le</strong> summum <strong>de</strong> l'ascension du héros<br />
dadiéen, est traduite par l'espace étriqué qu'il inves-<br />
tit, coupé <strong>de</strong> son peup<strong>le</strong> et décidant tout contre lui.<br />
Il faut que l'espace soit clos <strong>pour</strong> rendre <strong>le</strong> pouvoir<br />
plus craint, plus crédib<strong>le</strong>. La structuration spatia<strong>le</strong><br />
paraît ainsi rendre plus explicites <strong>le</strong>s rapports conflic-<br />
tuels entre <strong>le</strong> peup<strong>le</strong> et son dirigeant (1).<br />
(1) Voir supra <strong>de</strong>uxième partie, chapitre l, Le fonctionnement<br />
du pouvoir.
285<br />
Le procès <strong>de</strong> l'espace rejoint ainsi <strong>le</strong> procès du<br />
pouvoir. L'espace du pouvoir dans <strong>le</strong> théâtre <strong>de</strong> Dadié<br />
est <strong>le</strong> ref<strong>le</strong>t <strong>de</strong> l'égoïsme, <strong>de</strong> la cupidité et <strong>de</strong> l'igno<br />
minie <strong>de</strong>s dirigeants. Cela est visib<strong>le</strong> au niveau <strong>de</strong>s<br />
pièces que nous avons choisies. C'est cet espace hermé<br />
tiquement clos, symbo<strong>le</strong> <strong>de</strong> solitu<strong>de</strong>, qui préfigure déjà<br />
au niveau <strong>de</strong> la signification profon<strong>de</strong>, la déchéance<br />
du héros politique. Par ce cheminement, l'écrivain ivoi<br />
rien révè<strong>le</strong> que la dégradation du pouvoir que nous ana<br />
lyserons dans <strong>le</strong> chapitre suivant, prend sa source<br />
dans l'investissement même <strong>de</strong> l'espace occupé par <strong>le</strong><br />
chef par rapport à son peup<strong>le</strong>. Aussi Dadié limite-t-il<br />
l'espace réel du pouvoir au palais, au bureau.<br />
II - LA DEGRADATION DU POUVOIR<br />
Toutes <strong>le</strong>s pièces du dramaturge ivoirien sont l'ex<br />
pression du combat mené sans cesse par <strong>le</strong>ur auteur <strong>pour</strong><br />
la justice et la liberté. Cela explique l'intérêt pri<br />
mordial que l'écrivain porte au thème du pouvoir. Lieu<br />
<strong>de</strong> conflit perpétuel entre dominant et dominé, l'oeuvre<br />
théâtra<strong>le</strong> <strong>de</strong> Dadié met un accent particulier sur <strong>le</strong>s<br />
rapports gouvernants/gouvernés en dénonçant <strong>le</strong>s tares<br />
et <strong>le</strong>s carences du mécanisme oppressif du pouvoir. Le<br />
chef politique y apparaît toujours sous la caricature<br />
grotesque du potentat grisé par une ascension vertigineuse.<br />
Mais exerçant son pouvoir par la vio<strong>le</strong>nce et la<br />
mystification, il sera victime <strong>de</strong> sa propre politique.<br />
Car, prenant conscience <strong>de</strong> son état d'exploité, <strong>le</strong> peup<strong>le</strong>
287<br />
sous-ten<strong>de</strong>nt l'idéologie <strong>de</strong> l'auteur et déterminent<br />
la structure dramatique <strong>de</strong>s pièces.<br />
- La première phase est cel<strong>le</strong> <strong>de</strong> la conquête du<br />
pouvoir qui peut être assimilée à une quête. C'est<br />
à ce niveau qu'intervient <strong>le</strong> personnage du <strong>de</strong>vin<br />
comme "donateur", <strong>pour</strong> permettre au héros quêteur<br />
d'atteindre son objectif final. Dans cette quête,<br />
<strong>le</strong> héros dadiéen ne lésine pas avec <strong>le</strong>s moyens;<br />
il recourt même au sacrifice humain comme par<br />
exemp<strong>le</strong> Nahoubou 1er <strong>pour</strong> acquérir la puissance<br />
dominatrice. Cette étape est toujours franchie<br />
avec succès.<br />
- La secon<strong>de</strong> phase, c'est l'exercice du pouvoir<br />
acquis <strong>de</strong> façon empirique la plupart du temps.<br />
C'est <strong>le</strong> temps fort <strong>de</strong> la critique dadiéenne. Le<br />
héros, placé sur un pié<strong>de</strong>stal par <strong>de</strong>s courtisans<br />
vénaux, se coupe du peup<strong>le</strong> qui l'a porté au<br />
pouvoir. Devenu <strong>le</strong> pô<strong>le</strong> d'attraction d'où provien<br />
nent toutes <strong>le</strong>s décisions régissant la vie socia<strong>le</strong>,<br />
<strong>le</strong> dirigeant politique convertit <strong>le</strong> pouvoir en un<br />
pouvoir <strong>de</strong> répression et d'oppression <strong>de</strong>s masses.<br />
Transgressant <strong>le</strong>s postulats fondamentaux <strong>de</strong> tout<br />
pouvoir populaire, à savoir la liberté et la justice<br />
socia<strong>le</strong>, <strong>le</strong> héros tombe dans la monstruosité bur<br />
<strong>le</strong>sque, en instituant <strong>le</strong> tan<strong>de</strong>m exploitation<br />
répression comme vertu politique. Ne pouvant plus<br />
supporter <strong>le</strong>s exactions du tyran, <strong>le</strong> peup<strong>le</strong> réagit<br />
vio<strong>le</strong>mment, déc<strong>le</strong>nchant la <strong>de</strong>rnière phase du règne<br />
du potentat.
290<br />
fermer <strong>le</strong>s yeux... Rien à léguer, hormis <strong>le</strong>s<br />
cha-înes et <strong>le</strong>s transes... "<br />
(Il s'écrou<strong>le</strong>. ) (1)<br />
Parallè<strong>le</strong>ment à Toussaint, Napoléon souffre <strong>de</strong> la même<br />
situation:<br />
Napoléon :<br />
"Deux mi He lieues <strong>de</strong> l'Europe, cinq cents<br />
lieues <strong>de</strong> tout continent... une -î<strong>le</strong> brûlée<br />
<strong>de</strong> so<strong>le</strong>il, <strong>le</strong> climat <strong>le</strong> plus contraire à ma<br />
santé. C'est bien la haine qui a présidé au<br />
choix <strong>de</strong> Sainte-Hélène.<br />
Un si<strong>le</strong>nce<br />
si<strong>le</strong>nce <strong>de</strong>s<br />
du mon<strong>de</strong> !<br />
étouffant. Si<strong>le</strong>nce <strong>de</strong>s gazettes<br />
amis, si<strong>le</strong>nce <strong>de</strong> l'Europe, si<strong>le</strong>nce<br />
Moi, je mourrai ici, dans une grange, surveillé<br />
par <strong>de</strong>s geôliers irrrpu<strong>de</strong>nts ... "<br />
(Napoléon porte la main à son ventre et<br />
s'écrou<strong>le</strong>... ). (1)<br />
Tous <strong>le</strong>s héros politiques dadi8ens partagent ainsi <strong>le</strong><br />
même <strong>de</strong>stin tragique comme une sorte <strong>de</strong> fatalité. A ce<br />
niveau, on est en droit <strong>de</strong> s'interroger sur la signi-<br />
fication profon<strong>de</strong> que l'on peut tirer <strong>de</strong> cette situation<br />
dramatique du dirigeant politique.<br />
II - 2. Signification <strong>de</strong> la mort du héros<br />
Dans <strong>le</strong> théâtre <strong>de</strong> Bernard Dadié, tout <strong>le</strong> drame <strong>de</strong><br />
l'homme politique décou<strong>le</strong> <strong>de</strong> la rupture qu'il crée entre<br />
lui et <strong>le</strong> peup<strong>le</strong>. Se voulant "la seu<strong>le</strong> référence et la<br />
(1) I<strong>le</strong>s... , tab<strong>le</strong>au IV, pp. 132-133-134.
291<br />
seu<strong>le</strong> justice" comme <strong>le</strong> proclame Toussaint Louverture,<br />
<strong>le</strong> pouvoir du héros dadiéen n'a pas <strong>de</strong> limite. Symbo<strong>le</strong><br />
<strong>de</strong> la démesure et du pouvoir bur<strong>le</strong>sque, l'homme politique<br />
doit tout au peup<strong>le</strong>. Mais son ascension tout comme son<br />
règne, se fait au détriment <strong>de</strong>s gouvernés. S'enlisant<br />
dans <strong>le</strong> mimétisme et dans l'arbitraire, son <strong>de</strong>stin ne<br />
peut être que tragique. C'est ce que déclarera Moyse à<br />
Toussaint<br />
"Général Toussaint Louverture) <strong>le</strong> drame<br />
<strong>de</strong> l'homme au pouvoir) c'est <strong>de</strong> tenter<br />
d'imiter et <strong>le</strong>s autres et <strong>le</strong>s monarques <strong>de</strong>s<br />
légen<strong>de</strong>s. " (1)<br />
Tous <strong>le</strong>s crimes commis <strong>pour</strong> asseoir sa gloire et son<br />
image <strong>de</strong> marque, conduisent <strong>le</strong> héros dadiéen vers la<br />
déchéance tota<strong>le</strong>. Alors désemparé, seul face à tous,<br />
il finit dans la solitu<strong>de</strong> où aucune présence humaine ne<br />
lui est secourab<strong>le</strong>. Pour mieux montrer <strong>le</strong> calvaire du<br />
héros déchu, Dadié <strong>le</strong> place dans une prison, avec auprès<br />
<strong>de</strong> lui un geôlier indifférent au sort du détenu. Le dia<br />
logue qui se dérou<strong>le</strong> par exemp<strong>le</strong> entre Toussaint Louver<br />
ture et <strong>le</strong> geôlier sert à souligner en profon<strong>de</strong>ur l'im-<br />
possib<strong>le</strong> communication avec <strong>le</strong>s êtres,et l'absence tota<strong>le</strong><br />
<strong>de</strong> toute cha<strong>le</strong>ur humaine susceptib<strong>le</strong> <strong>de</strong> réconforter <strong>le</strong><br />
héros. Ce <strong>de</strong>rnier vit ainsi la réalité <strong>de</strong> la déréliction<br />
avant <strong>de</strong> s'écrou<strong>le</strong>r comme une bête féroce atteinte par<br />
<strong>le</strong> coup mortel. C'est dans une tel<strong>le</strong> condition que Dadié<br />
fait mourir simultanément Toussaint et Napoléon. Quant<br />
(1) I<strong>le</strong>s... , tab<strong>le</strong>au IV, scène 3, p. 84.
292<br />
au sanguinaire Nahoubou 1er, sa fin ultime est annoncée<br />
par <strong>de</strong>s Il explosions <strong>de</strong> lumière, <strong>de</strong> cri s ... Il (l) <strong>pour</strong><br />
révé<strong>le</strong>r au mon<strong>de</strong> que toute dictature finit toujours par<br />
exploser sous la colère populaire. La sanction suprême<br />
réservée au héros politique répond à un idéal du drama<br />
turge ivoirien. Il s'agit <strong>pour</strong> Dadié <strong>de</strong> détruire systé<br />
matiquement en la dénonçant, l'image <strong>de</strong> la tyrannie<br />
bien élaborée par <strong>le</strong>s monarques du Xxème sièc<strong>le</strong>.<br />
Cet idéal <strong>de</strong> <strong>de</strong>struction était déjà explicite dans la<br />
structuration étriquée <strong>de</strong> l'espace qui finit par gommer<br />
<strong>le</strong> dictateur. C'est <strong>pour</strong>quoi tous <strong>le</strong>s héros politiques<br />
dadiéens revivent la rupture qu'ils avaient créée entre<br />
eux et <strong>le</strong> peup<strong>le</strong>. Ils meurent dans la solitu<strong>de</strong> parce<br />
que <strong>le</strong> divorce d'avec <strong>le</strong>s masses s'oppose à la dia<strong>le</strong>cti<br />
que même du pouvoir. Comme <strong>le</strong> souligne <strong>le</strong> Professeur<br />
Kotchy, <strong>le</strong>s dirigeants fantoches <strong>de</strong> la trempe <strong>de</strong> Nahoubou<br />
1er, du Mani Congo, <strong>de</strong> Toussaint Louverture et <strong>de</strong> Mhoi<br />
Ceul "... oublient que dans la société africaine, la<br />
dia<strong>le</strong>ctique du pouvoir impose comme principe fondamental<br />
que l'art <strong>de</strong> gouverner est total: ou on choisit <strong>de</strong><br />
s'é<strong>le</strong>ver avec son peup<strong>le</strong>, en même temps que son peup<strong>le</strong>,<br />
et on <strong>de</strong>meure au pouvoir; ou on déci<strong>de</strong> <strong>de</strong> s'é<strong>le</strong>ver seul<br />
au-<strong>de</strong>ssus du peup<strong>le</strong>, entouré <strong>de</strong> conseil<strong>le</strong>rs étrangers<br />
indifférents au sort du peup<strong>le</strong>, <strong>de</strong> courtisans cupi<strong>de</strong>s<br />
on est alors entouré d'une véritab<strong>le</strong> murail<strong>le</strong> et <strong>de</strong> son<br />
palais majestueux, on déci<strong>de</strong> seul <strong>de</strong> la vie du peup<strong>le</strong>,<br />
souvent loin <strong>de</strong> ses besoins, <strong>de</strong> ses aspirations profon<strong>de</strong>s;<br />
(l ) Le s Vo i x ... , p. 167.
293<br />
lorsqu'on tombe, on tombe seul; très vite abandonné<br />
par tous ces griots et conseil<strong>le</strong>rs<br />
ne sert plus <strong>le</strong>s intérêts." (1)<br />
intéressés dont on<br />
L'ambition <strong>de</strong> Dadié, c'est <strong>de</strong> dégager une <strong>le</strong>çon <strong>de</strong><br />
conduite politique <strong>de</strong> ces différentes erreurs commises<br />
par <strong>de</strong>s gran<strong>de</strong>s figures comme Toussaint Louverture. C'est<br />
<strong>pour</strong>quoi un accent particulier est mis sur cet aspect<br />
<strong>pour</strong> conscientiser <strong>le</strong>s dirigeants actuels. Par cette<br />
stigmatisation du chef politique, Dadié démontre que<br />
tout pouvoir, fondé sur la répression et l'exploitation<br />
est voué à l'échec; c'est un pouvoir mort-né; car ne<br />
dépendant que <strong>de</strong> l'extérieur et incapab<strong>le</strong> <strong>de</strong> résoudre<br />
ses problèmes internes, il ne peut que mourir <strong>de</strong> ses<br />
propres contradictions. Les cas <strong>de</strong> Toussaint Louverture<br />
et du Mani Congo sont révélateurs. Enfin la mort du<br />
héros dadiéen signifie la condamnation énergique et sans<br />
fail<strong>le</strong> <strong>de</strong> tout modè<strong>le</strong> <strong>de</strong> dictature.<br />
CONCLUSION<br />
Au terme <strong>de</strong> cette approche, on découvre que Dadié<br />
utilise toutes <strong>le</strong>s techniques littéraires <strong>pour</strong> révé<strong>le</strong>r<br />
<strong>le</strong> visage réel du pouvoir. Le dramaturge incite incessam-<br />
ment <strong>le</strong> spectateur-<strong>le</strong>cteur à découvrir <strong>le</strong>s faits dans<br />
<strong>le</strong>ur réalité criante)en <strong>le</strong>vant <strong>le</strong> voi<strong>le</strong> historique qui<br />
<strong>le</strong>s masque. Cette métho<strong>de</strong> permet à Dadié <strong>de</strong> montrer qu'on<br />
ne peut pas dissocier <strong>le</strong>s faits socio-historiques du fait<br />
(1) B. Kotchy, "Le temps et l'espace dans <strong>le</strong> théâtre <strong>de</strong><br />
Dadié", in Ann. Univ. Abidjan, série D (Lettres),<br />
t. 12, 19'79, p. 280.
294<br />
dramatique. Et seul, <strong>le</strong> théâtre par sa structuration,<br />
lui semb<strong>le</strong> capab<strong>le</strong> <strong>de</strong> dévoi<strong>le</strong>r en <strong>le</strong>s exposant, <strong>le</strong>s<br />
problèmes <strong>de</strong> notre temps.<br />
Aussi l'oeuvre <strong>de</strong> Dadié pose-t-el<strong>le</strong> un doub<strong>le</strong> regard<br />
sur notre société: celui <strong>de</strong> l'historien tourné vers <strong>le</strong><br />
passé révolu et celui du citoyen dont <strong>le</strong>s yeux sont<br />
ouverts sur <strong>le</strong> présent qui est en train <strong>de</strong> s'accomplir.<br />
Evitant la chronologie anecdotique et produisant une<br />
transformation active <strong>de</strong> la matière historique, Bernard<br />
Dadié plonge son public dans l'actualité en l'invitant<br />
à tirer une <strong>le</strong>çon objective <strong>de</strong> ce qui lui est montré.<br />
Car chaque héros dadiéen est une aventure col<strong>le</strong>ctive<br />
qui engage la liberté et la vie <strong>de</strong> tout un peup<strong>le</strong>.<br />
La critique que <strong>le</strong> dramaturge fait <strong>de</strong> sa propre<br />
société révè<strong>le</strong> que <strong>le</strong> long exercice d'un pouvoir absolu<br />
finit par dénaturer son origine et son essence; c'est<br />
<strong>pour</strong>quoi on assiste à une forte dégradation du pouvoir<br />
<strong>de</strong>s dictateurs. Cet aspect traduit en profon<strong>de</strong>ur <strong>le</strong><br />
souci constant <strong>de</strong> Dadié. Il détruit pièce par pièce<br />
l'image grotesque <strong>de</strong> l'autocratie qui étouffe <strong>le</strong>s peup<strong>le</strong>s.<br />
Cela justifie peut-être l'échec du héros dadiéen et la<br />
condition atroce qu'il vit à la fin <strong>de</strong> chaque pièce.<br />
Enfin, loin <strong>de</strong> manifester une désaffection <strong>pour</strong> <strong>le</strong>s<br />
problèmes socio-politiques qui déchirent <strong>le</strong> continent<br />
africain, <strong>le</strong> théâtre <strong>de</strong> Dadié, engagé dans l'histoire<br />
et la réalité <strong>de</strong> son temps, traduit <strong>le</strong>s angoisses et <strong>le</strong>s<br />
espoirs <strong>de</strong>s générations contemporaines. Le désir constant<br />
<strong>de</strong> s'écarter <strong>de</strong> la réalité concrète en recourant souvent
295<br />
à l'histoire, ne tue en aucun moment l'idéal social<br />
<strong>de</strong> l'écrivain et l'idéologie dominante qui <strong>le</strong> sous-tend.<br />
Aussi serait-il intéressant <strong>de</strong> nous interroger maintenant<br />
sur cette idéologie et sur <strong>le</strong> projet <strong>de</strong> société qui<br />
peut en décou<strong>le</strong>r.
296<br />
CHAPITRE II<br />
IDEOLOGIE ET PROJET DE SOCIETE DE DADIE<br />
Dans ce chapitre, nous entendons nous interroger<br />
sur la pensée profon<strong>de</strong> qui sous-tend <strong>le</strong>s pièces qui ont<br />
été l'objet <strong>de</strong> notre étu<strong>de</strong>. Ce projet s'avère indispen<br />
sab<strong>le</strong> dans la mesure où nous pensons que toute oeuvre<br />
littéraire répond implicitement ou explicitement à un<br />
projet idéologique. Aussi cette analyse nous permettra<br />
t-el<strong>le</strong> <strong>de</strong> déce<strong>le</strong>r l'idéal <strong>de</strong> société exprimé consciemment<br />
ou inconsciemment par <strong>le</strong> dramaturge ivoirien.<br />
Enfin, <strong>pour</strong> clore cette étu<strong>de</strong>, nous porterons une<br />
vue critique sur Bernard Dadié par rapport aux textes<br />
dramatiques qu'il nous offre. Mais avant <strong>de</strong> nous engager<br />
dans cette approche, il serait intéressant <strong>de</strong> savoir ce<br />
que nous entendons par Idéologie.<br />
l - L'IDEOLOGIE DE DADIE<br />
Dans <strong>le</strong> cadre <strong>de</strong> cette thèse, nous entendons par<br />
idéologie, l'ensemb<strong>le</strong> <strong>de</strong>s idées-forces qui fon<strong>de</strong>nt et<br />
sous-ten<strong>de</strong>nt l'oeuvre dramatique <strong>de</strong> l'écrivain ivoirien.<br />
Pour nous, tout acte et en particulier l'acte <strong>de</strong> création<br />
est idéologique. Il résulte du mûrissement d'un système<br />
d'idées bien élaboré par l'artiste. La modulation <strong>de</strong>s<br />
thèmes au niveau sémantique et l'exploitation que l'écri<br />
vain en fait, répon<strong>de</strong>nt bien à une attitu<strong>de</strong> idéologique.
297<br />
Ainsi l'idéologie <strong>de</strong> l'artiste se fera-t-el<strong>le</strong> sentir<br />
souvent en filigrane sous chaque phrase voire sous chaque<br />
mot que l'écrivain produit. L'idéologie imprègne donc<br />
consciemment ou inconsciemment toutes <strong>le</strong>s activités<br />
humaines aussi bien dans la pratique économique que dans<br />
la pratique politique.<br />
Nous pouvons donc affirmer que l'oeuvre théâtra<strong>le</strong><br />
<strong>de</strong> Dadié est <strong>le</strong> fruit d'une réaction idéologique du dra<br />
maturge face aux turpitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la classe dominante que<br />
représentent l'Etat et ses appareils idéologiques.<br />
Les idées-forces <strong>de</strong> l'écrivain se traduiront d'abord<br />
dans <strong>le</strong> choix <strong>de</strong>s divers problèmes sociaux, en particulier<br />
celui du pouvoir politique. L'exploitation profon<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
ce <strong>de</strong>rnier choix dévoi<strong>le</strong>ra la vision dadiéenne du mon<strong>de</strong>.<br />
C'est à travers cel<strong>le</strong>-ci que nous pouvons déce<strong>le</strong>r <strong>le</strong>s<br />
contours exacts du projet <strong>de</strong> société du dramaturge. Abor<br />
dant donc <strong>le</strong> problème du pouvoir, Dadié implique <strong>le</strong><br />
spectateur-<strong>le</strong>cteur dans <strong>le</strong>s conflits qui régissent <strong>le</strong>s<br />
rapports sociaux dans <strong>le</strong>s nouveaux Etats indépendants<br />
d'Afrique.<br />
En effet, après <strong>le</strong>s Indépendances, <strong>le</strong>s auteurs comme<br />
Bernard Dadié, qui ont connu l'humiliation, la prison, la<br />
répression sous toutes ses formes, ont été déçus par<br />
l'explosion <strong>de</strong>s partis uniques en Afrique. Sidérés <strong>de</strong>vant<br />
<strong>de</strong> tels faits, ils assistent au règne <strong>de</strong> l'arbitraire et<br />
<strong>de</strong> la dictature, à la répétition <strong>de</strong>s brutalités et <strong>de</strong>s<br />
exactions jadis reprochées aux colonisateurs. Cette décep<br />
tion sur laquel<strong>le</strong> nous nous étendrons un peu, oriente et
29B<br />
explicite en gran<strong>de</strong> partie l'idéologie <strong>de</strong>s pièces <strong>de</strong><br />
Dadié. Pour <strong>le</strong> dramaturge, il ne s'agit plus <strong>de</strong> s'atta-<br />
quer à un colonialisme déca<strong>de</strong>nt, mais à un "colonialisme"<br />
autochtone qui s'est substitué au statu quo ante. Dès lors<br />
la critique se fera vio<strong>le</strong>nte, en choisissant <strong>pour</strong> pierre<br />
d'achoppement <strong>le</strong> pouvoir <strong>de</strong>s nouveaux dirigeants qu'il<br />
faut jugu<strong>le</strong>r par la force. Aussi, la rémanence consciente<br />
ou inconsciente <strong>de</strong> l'image du militant communiste (<strong>de</strong>s<br />
années quarante-six), en butte à l'oppression et à l'ex-<br />
ploitation sous toutes ses formes, se réveil<strong>le</strong>ra-t-el<strong>le</strong><br />
<strong>de</strong>s profon<strong>de</strong>urs <strong>pour</strong> resurgir à la surface <strong>de</strong> l'écriture<br />
dadiéenne. plusieurs indices présents dans <strong>le</strong>s textes du<br />
dramaturge, dévoi<strong>le</strong>nt l'emprise <strong>de</strong> l'idéologie communiste<br />
sur Dadié. Cela légitime peut-être <strong>le</strong> si<strong>le</strong>nce qu'il affi-<br />
che lorsqu'on l'interroge sur l'essence profon<strong>de</strong> <strong>de</strong> ses<br />
oeuvres.<br />
Mais quel<strong>le</strong> que soit l'alternative, reconnaissons<br />
avec Wondji et Bailly qu'il "serait injuste et faux <strong>de</strong> ne<br />
pas mentionner l'action <strong>de</strong>s G. E. C. (Groupes d'Etu<strong>de</strong>s<br />
Commun i s t.es ), qui contribuèrent à la formation politique<br />
<strong>de</strong>s dirigeants du R.D.A. et à la mise en place organisa-<br />
tionnel<strong>le</strong> du mouvement." (1) Mo<strong>de</strong>lé dans ce cadre idéolo-<br />
gique et ayant une sensibilité poussée qui lui permet<br />
d'al<strong>le</strong>r au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> l'analyse simpliste <strong>de</strong>s choses, Bernard<br />
Dadié va se dresser en justicier malgré ses faib<strong>le</strong>s moyens,<br />
contre <strong>le</strong>s monstruosités et <strong>le</strong>s crimes commis par <strong>le</strong>s<br />
(1) C. Wondji et Sery Z. Bailly, B. Dadié, l'homme <strong>de</strong><br />
<strong>le</strong>ttres et <strong>le</strong> militant, 45 pages dactylographiées,<br />
pp. 44
299<br />
dirigeants africains. C'est <strong>pour</strong>quoi il opposera à la<br />
vio<strong>le</strong>nce <strong>de</strong>s nouveaux chefs, la vio<strong>le</strong>nce verba<strong>le</strong> tout en<br />
réaffirmant son aspiration à une société fondée sur la<br />
liberté et l'équité.<br />
Toute la révolte et la prise <strong>de</strong> position énergique<br />
<strong>de</strong> Dadié face aux injustices <strong>de</strong> ce mon<strong>de</strong>, sont sous<br />
tendues par l'héritage communiste. En 1951, dès qu'il<br />
s'est agi du désapparentement du R.D.A. d'avec <strong>le</strong> P.C.F.,<br />
Dadié n'a pas masqué son refus alors qu'il était, avec<br />
J. Mockey, interné à la prison <strong>de</strong> Grand-Bassam. Mais<br />
hélas <strong>le</strong> R.D.A. avait tendu la main à l'oppresseur.<br />
Dadié a vu dans ce geste, une véritab<strong>le</strong> lâcheté <strong>de</strong> la<br />
part du <strong>le</strong>a<strong>de</strong>r du R.D.A. Le dramaturge n'a jamais digéré<br />
cette défaite. L'idéologie qui sous-tendait sa lutte<br />
contre l'oppresseur étant ainsi écartée à jamais, refusant<br />
<strong>de</strong> se renier, Bernard Dadié rejoindra l'opposition tout<br />
en sauvegardant son éthique.<br />
Compte tenu <strong>de</strong> ce refus, Dadié sera purement et sim<br />
p<strong>le</strong>ment écarté <strong>de</strong>s organes dirigeants et éloigné <strong>de</strong> tout<br />
moyen permettant <strong>de</strong> communiquer ou d'inculquer l'idéolo<br />
gie militante à la masse. Dans cette même optique, ne<br />
lui seront confiés dans l'administration, que <strong>de</strong>s postes<br />
techniques, voire effacés politiquement. Mais si cela<br />
porta un coup dur au Dadié militant, <strong>le</strong> refuge <strong>de</strong> l'auteur<br />
dramatique dans la littérature et la production littéraire<br />
qui s'en est suivie permet d'affirmer que <strong>le</strong> dramaturge<br />
est resté un adversaire et ne s'est pas <strong>pour</strong> autant éteint.<br />
Sa langue <strong>de</strong>meure toujours amère; il exprime sa déception
304<br />
II - 1. La direction idéologique<br />
Pour Dadié, tout pouvoir doit, s'il veut être popu<br />
laire et s'il veut réussir dans sa lutte politique, éco<br />
nomique et socia<strong>le</strong>, se fon<strong>de</strong>r sur l'essence du peup<strong>le</strong>;<br />
c'est-à-dire un fon<strong>de</strong>ment sociologique existant dans et<br />
par <strong>le</strong> peup<strong>le</strong>. Au niveau idéologique, aucun type <strong>de</strong> pou<br />
voir mis en jeu dans <strong>le</strong> théâtre <strong>de</strong> Dadié ne peut se récla<br />
mer d'un pouvoir populaire autonome, structuré autour<br />
d'une idéologie fort élaborée prenant en compte la <strong>de</strong>s<br />
tinée et l'indépendance réel<strong>le</strong>s du peup<strong>le</strong>. Pourtant,<br />
<strong>le</strong>s sociétés africaines ne manquent pas d'éléments poli<br />
tiques qui, mieux exploités, peuvent apporter un véritab<strong>le</strong><br />
regain <strong>de</strong> force aux nouvel<strong>le</strong>s institutions. Mais hélas!<br />
Pour éviter un tel travail qui exige un effort intel<strong>le</strong>c<br />
tuel, <strong>le</strong>s prototypes <strong>de</strong> dirigeants africains comme Nahou<br />
bou 1er ou Toussaint Louverture, cachent <strong>le</strong>ur médiocrité<br />
congénita<strong>le</strong> <strong>de</strong>rrière une caricature <strong>de</strong> société occi<strong>de</strong>n<br />
ta<strong>le</strong>; ici, <strong>le</strong> respect <strong>de</strong>s droits <strong>le</strong>s plus élémentaires<br />
<strong>de</strong> l'homme est relégué au second plan; <strong>le</strong>s princes <strong>de</strong>s<br />
"so<strong>le</strong>ils <strong>de</strong>s indépendances", se livrant à <strong>de</strong>s brutalités<br />
inouïes plus que cel<strong>le</strong>s qu'ils reprochaient au colonisa<br />
teur. Ces répressions sauvages assurent <strong>le</strong> maintien d'un<br />
Etat-factice, fondé sur <strong>de</strong>s structures institutionnel<strong>le</strong>s<br />
branlantes.<br />
On peut affirmer que l'Etat post-colonial résulte<br />
purement d'un bricolage institutionnel. Celui-ci vise à<br />
plaquer à l'Afrique <strong>de</strong>s formes <strong>de</strong> gouvernement qui ne<br />
tiennent compte ni <strong>de</strong>s réalités culturel<strong>le</strong>s, ni <strong>de</strong>s exi-
305<br />
gences politiques <strong>de</strong>s pays concernés. Le pouvoir qui<br />
régit ces types d'Etat ne peut bril<strong>le</strong>r que par la répres<br />
sion et <strong>le</strong> manque <strong>de</strong> toute force-source qui serait<br />
idéologiquement structuratrice <strong>de</strong>s nouvel<strong>le</strong>s sociétés<br />
africaines.<br />
Cette force-source était <strong>le</strong> moteur <strong>de</strong>s institutions<br />
politiques traditionnel<strong>le</strong>s; el<strong>le</strong> était une véritab<strong>le</strong><br />
idéologie permettant au peup<strong>le</strong> d'avoir un pouvoir <strong>de</strong> con<br />
trô<strong>le</strong> sur <strong>le</strong>s organes dirigeants <strong>de</strong> l'Etat. Dès lors,<br />
toute tentative <strong>de</strong> tomber dans l'excès <strong>de</strong> pouvoir, person<br />
nalisation ou concentration <strong>de</strong> pouvoir était ainsi<br />
atténuée. Le peup<strong>le</strong> représentait ainsi une sorte <strong>de</strong> contre<br />
poids servant à tempérer en profon<strong>de</strong>ur <strong>le</strong> pouvoir du<br />
chef. Plusieurs mécanismes, dont la rumeur publique per<br />
sistante, servaient <strong>de</strong> moyens critiques élaborés et<br />
acceptés par <strong>le</strong> peup<strong>le</strong>.<br />
Mais tous <strong>le</strong>s héros politiques dadiéens, prototypes<br />
du dirigeant post-colonial, sont en porte-à-faux avec<br />
cet héritage politico-culturel. Aucun effort, aucun esprit<br />
critique n'a été mis en place <strong>pour</strong> exploiter scientifi<br />
quement ce patrimoine qui n'attend que <strong>de</strong>s chercheurs<br />
luci<strong>de</strong>s <strong>pour</strong> se revigorer. Aussi, Dadié dévoi<strong>le</strong>-t-il<br />
l'inculture <strong>de</strong> certains dirigeants que <strong>le</strong>s détracteurs<br />
<strong>de</strong> l'Afrique taisent sous prétexte <strong>de</strong> multiplicité<br />
d'ethnies qui serait aujourd'hui un problème mineur, si<br />
<strong>de</strong>s structures idéologiques populaires, mettant l'accent<br />
sur <strong>le</strong> nationalisme au détriment du tribalisme, avaient<br />
été vraiment cultivées dans <strong>le</strong> coeur <strong>de</strong>s Africains au
L. I_Z."<br />
306<br />
<strong>le</strong>n<strong>de</strong>main même <strong>de</strong>s indépendances. On s'est contenté <strong>de</strong><br />
reproduire une structure politique déca<strong>de</strong>nte accentuant<br />
plus l'oppression <strong>de</strong>s masses. La rupture du chef avec <strong>le</strong><br />
peup<strong>le</strong> s'approfondit <strong>de</strong> jour en jour <strong>de</strong> tel<strong>le</strong> sorte que<br />
<strong>le</strong>s masses vont jusqu'à regretter l'ancien colonisateur.<br />
Le mimétisme <strong>de</strong> l'Occi<strong>de</strong>nt est <strong>de</strong>venu tel<strong>le</strong>ment frappant<br />
que <strong>le</strong>s intel<strong>le</strong>ctuels éclairés préfèrent l'exil intérieur<br />
sachant que <strong>le</strong>urs voix seront toujours étouffées par <strong>le</strong>s<br />
nouveaux dictateurs. C'est contre ce mimétisme exacerbé<br />
<strong>de</strong>venu maintenant schéma classique <strong>de</strong>s pouvoirs africains,<br />
que se dresse Bernard Dadié.<br />
La critique du dramaturge ivoirien présente au niveau<br />
implicite l'image d'une société socialiste fondée sur un<br />
socialisme africain, original, qui ne saurait voir <strong>le</strong> jour<br />
que si <strong>le</strong>s Africains se réveil<strong>le</strong>nt <strong>de</strong> <strong>le</strong>ur léthargie,<br />
<strong>pour</strong> mettre fin au néo-colonialisme ankylosé qui ne fait<br />
que tuer toute initiative origina<strong>le</strong>ment africaine. Ce<br />
socialisme dont nous parlons, doit prendre sa source dans<br />
<strong>le</strong> coeur même du peup<strong>le</strong> africain et être en adéquation<br />
étroite avec ses profon<strong>de</strong>s aspirations.<br />
Cet objectif ne peut être atteint sans la prise en<br />
charge réel<strong>le</strong> <strong>de</strong> notre culture. La création ou la re-créa<br />
tion d'une Afrique véritab<strong>le</strong>ment africaine passe par<br />
l'exploitation scientifique <strong>de</strong> notre patrimoine culturel.<br />
Ce travail diffici<strong>le</strong> éviterait <strong>de</strong> faire <strong>de</strong> notre continent<br />
une caricature <strong>de</strong> l'Europe. C'est un tel idéal qui sous<br />
tend la critique <strong>de</strong> Bernard Dadié. En effet, <strong>le</strong> dramaturge<br />
ne fait pas <strong>le</strong> procès <strong>de</strong>s nouvel<strong>le</strong>s institutions africaines
309<br />
vio<strong>le</strong>nce érigée en loi. Les exécutions publiques <strong>de</strong>s<br />
éléments éclairés comme Moyse dans I<strong>le</strong>s <strong>de</strong> tempête, sont<br />
monnaie courante.<br />
La scène politique est ainsi transformée en véritab<strong>le</strong><br />
tragédie baroque où la vio<strong>le</strong>nce physique et mora<strong>le</strong> per<br />
met à ceux qui exercent <strong>le</strong> pouvoir <strong>de</strong> perpétuer <strong>le</strong>qr domi<br />
nation. Alors <strong>le</strong> peup<strong>le</strong> écrasé, terrorisé, ploie sous <strong>le</strong><br />
far<strong>de</strong>au du potentat qui s'établit dans l'arbitraire et<br />
la démagogie verba<strong>le</strong>. La métamorphose <strong>de</strong> tous ces types<br />
<strong>de</strong> pouvoir, ne peut conduire qu'à la dictature perpétuel<strong>le</strong><br />
dans la mesure où tous ces différents dirigeants sont<br />
<strong>le</strong>s féaux <strong>de</strong>s puissances impérialistes. S'arrogeant tous<br />
<strong>le</strong>s pouvoirs, ces chefs, à l'image <strong>de</strong> Toussaint Louverture,<br />
se veu<strong>le</strong>nt la seu<strong>le</strong> référence, <strong>le</strong> modè<strong>le</strong> absolu avec<br />
<strong>le</strong>quel une nouvel<strong>le</strong> réalité fait jour : la dictature <strong>de</strong>s<br />
rois nègres. Enfoncés dans <strong>le</strong> grotesque et la grandilo<br />
quence, certains, comme Nahoubou 1er, bril<strong>le</strong>nt par <strong>le</strong>ur<br />
pouvoir ravageur sans borne . Comment ne peut-on pas en<br />
arriver là, si l'incompétence, la médiocrité et <strong>le</strong> népo<br />
tisme sont érigés en mora<strong>le</strong> politique?<br />
Dans une tel<strong>le</strong> situation, chaque jour qui naît,<br />
apporte son cortège <strong>de</strong> drames : drame politique, drame<br />
social. Conscient <strong>de</strong> cette calamité qui pèse sur sa socié<br />
té, l'écrivain doit se convertir en avertisseur <strong>de</strong> cons<br />
cience, dénoncer au grand jour toutes <strong>le</strong>s tares <strong>de</strong>s nou<br />
veaux chefs. L'objectif principal étant d'ai<strong>de</strong>r <strong>le</strong>s peu<br />
p<strong>le</strong>s à mieux appréhen<strong>de</strong>r <strong>le</strong>ur situation d'opprimés, en<br />
se débarrassant <strong>de</strong>s marionnettes que sont <strong>le</strong>s Mani Congo
314<br />
pensée dans la pratique jusqu'au bout. Il ne s'agit pas<br />
<strong>de</strong> diagnostiquer simp<strong>le</strong>ment <strong>le</strong>s maux <strong>de</strong> la société, mais<br />
aussi d'apporter par son action efficace la thérapeutique<br />
requise. L'écrivain ne doit pas se dérober à la mission<br />
qui lui incombe. L'écrit <strong>pour</strong> nous reste un premier pas<br />
dans <strong>le</strong> combat <strong>pour</strong> la liberté, mais il ne suffit pas;<br />
encore faut-il <strong>le</strong> lier à la pratique active, dans <strong>le</strong><br />
sens d'une transformation globa<strong>le</strong> <strong>de</strong> la société; il ne<br />
s'agit pas d'interpréter seu<strong>le</strong>ment <strong>le</strong>s faits sociaux du<br />
haut <strong>de</strong> sa tour d'ivoire, mais <strong>de</strong> <strong>le</strong>s transformer dans<br />
un sens progressiste <strong>de</strong> l'Histoire. Action sans laquel<strong>le</strong><br />
l'écrivain serait un simp<strong>le</strong> prêcheur dans <strong>le</strong> désert.<br />
Nous pensons contrairement à Dailly que la prise<br />
<strong>de</strong> position <strong>de</strong> l'écrivain, liée à la mise en pratique <strong>de</strong><br />
l'idéal qu'il traduit, lui permet d'assumer face à l'his<br />
toire sa lour<strong>de</strong> responsabilité. Sinon, s'enlisant dans<br />
la compromission, quel sens aurait son oeuvre <strong>pour</strong> <strong>le</strong>s<br />
générations futures ? Peut-on apporter un changement sou<br />
haité tout en s'engageant dans une attitu<strong>de</strong> dichotomique?<br />
Pour nous, l'intel<strong>le</strong>ctuel critique, conscient <strong>de</strong> sa<br />
fonction d'avertisseur <strong>de</strong> conscience dans la cité, n'a<br />
pas sa place auprès du pouvoir, mais auprès <strong>de</strong> ceux qui<br />
subissent ce pouvoir. Il est <strong>le</strong> véhicu<strong>le</strong> <strong>de</strong> la vérité,<br />
partant, il se trouve dans l'opposition même si cel<strong>le</strong>-ci<br />
n'existe pas. Il exercera ainsi une fonction éminemment<br />
socia<strong>le</strong>. Il nous apparaît dès lors que toute participation<br />
<strong>de</strong> l'intel<strong>le</strong>ctuel (au sens large) au pouvoir est une<br />
esquive. Nous adhérons à la conception d'Alain <strong>de</strong> Benoist
315<br />
selon laquel<strong>le</strong> "l'intel<strong>le</strong>ctuel... n'a pas à entretenir<br />
<strong>de</strong> relation privilégiée (même négative) avec <strong>le</strong> pouvoir<br />
ni avec qui que ce soit. Il dit, il écrit ce qu'il pense,<br />
à propos du pouvoir comme du reste. Si l'existence du<br />
pouvoir lui tourne la tête, si la position politique<br />
qu'il occupe affecte son jugement, il n'est qu'un impos-<br />
teur ou un paras i te." (1) Dans <strong>le</strong> cas précis <strong>de</strong> l' écri-<br />
vain ivoirien, <strong>le</strong>s oeuvres futures permettront <strong>de</strong><br />
vérifier notre jugement. Pour <strong>le</strong> moment, <strong>le</strong> dramaturge<br />
reste dans la contradiction. Car <strong>le</strong> système qu'il a<br />
tant critiqué <strong>de</strong>meure et Dadié y collabore.<br />
Au niveau du projet <strong>de</strong> société dadiéen, <strong>le</strong> grand<br />
espoir rose glané par <strong>le</strong> dramaturge nous enfonce aussi<br />
dans la contradiction. Le recours constant au religieux<br />
<strong>pour</strong> légitimer <strong>le</strong> pouvoir, comme nous l'avons démontré<br />
tout au long <strong>de</strong> cette étu<strong>de</strong>, reste un point culminant<br />
<strong>de</strong> la contradiction dadiéenne. Car l'auteur semb<strong>le</strong> ino-<br />
cu<strong>le</strong>r une crédibilité réel<strong>le</strong> au pouvoir mystique du<br />
<strong>de</strong>vin ou marabout (qu'il ne condamne pas) au détriment<br />
du droit. Toutes ces pratiques mystiques, vues comme<br />
un re<strong>le</strong>nt d'authenticité favorab<strong>le</strong> à l'instauration<br />
d'un socialisme spiritualiste, nous semb<strong>le</strong>nt négatives<br />
dans la mesure où el<strong>le</strong>s renforceraient plus <strong>le</strong> clienté-<br />
lisme et <strong>pour</strong>raient déboucher sur <strong>le</strong> fanatisme intégris-<br />
te. Nous pensons avec Yves Benot que "<strong>le</strong> socialisme en<br />
Afrique ne peut s'appuyer sur <strong>le</strong> corps étranger qu'est<br />
(1) "L'intel<strong>le</strong>ctuel et <strong>le</strong> pouvoir <strong>de</strong> Platon à Glucksmann",<br />
Magazine Littéraire, n° 183, Avril 1982, p. 48 .
318<br />
BILAN ET PERSPECTIVES<br />
Au terme <strong>de</strong> cette approche du Pouvoir, nous ne<br />
saurons affirmer avoir épuisé <strong>le</strong> sujet. Notre travail<br />
laisse certains points <strong>de</strong> réf<strong>le</strong>xion inachevés; cela est<br />
lié à la comp<strong>le</strong>xité même <strong>de</strong> la problématique du pouvoir<br />
africain. Tout au long <strong>de</strong> cette étu<strong>de</strong>, notre intention<br />
était doub<strong>le</strong>: d'une part, dévoi<strong>le</strong>r <strong>le</strong>s sources profon<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> la critique du pouvoir et ses corollaires, d'autre<br />
part, dépister certains éléments pertinents qui permettront<br />
une meil<strong>le</strong>ure compréhension <strong>de</strong> l'oeuvre théâtra<strong>le</strong> <strong>de</strong><br />
Bernard Dadié. Aussi notre analyse met-el<strong>le</strong> <strong>de</strong> côté tout<br />
finalisme réducteur susceptib<strong>le</strong> d'empêcher l'approfondis<br />
sement <strong>de</strong> certains points <strong>de</strong> vue.<br />
Sur <strong>le</strong> plan <strong>de</strong> la métho<strong>de</strong>, nous avons appliqué une<br />
démarche dont l'efficacité nous a obligé à accumu<strong>le</strong>r<br />
un maximum <strong>de</strong> documents anthropologiques, historiques et<br />
politiques <strong>pour</strong> mieux cerner <strong>le</strong> thème. Cette technique<br />
consiste d'abord à partir <strong>de</strong> la conception du pouvoir en<br />
pays akan, <strong>pour</strong> déboucher sur la modulation du thème dans<br />
la création artistique <strong>de</strong> Dadié. Cette démarche révéla<br />
la constance et l'orientation <strong>de</strong> la critique dadiéenne.<br />
Pour donner plus <strong>de</strong> poids à nos affirmations, nous sommes<br />
allé sur <strong>le</strong> terrain <strong>pour</strong> compléter certaines informations<br />
extra-textuel<strong>le</strong>s. Cel<strong>le</strong>s-ci nous permirent <strong>de</strong> dissiper<br />
certaines zones d'ombre dans l'oeuvre du dramaturge
319<br />
ivoirien. Ainsi avons-nous découvert que toute la critique<br />
du pouvoir actuel tire son fon<strong>de</strong>ment du contexte socio<br />
culturel <strong>de</strong> l'écrivain.<br />
Mettant un accent particulier sur <strong>le</strong>s rapports entre<br />
<strong>le</strong> dirigeant politique et <strong>le</strong>s pouvoirs périphériques,<br />
nous avons démontré qu'il existait là un lien <strong>de</strong> clienté<br />
lisme non négligeab<strong>le</strong>. Cet échange réciproque entre <strong>le</strong><br />
politique et <strong>le</strong> mystique révè<strong>le</strong> que <strong>le</strong>s nouveaux dirigeants<br />
n'ont pas entièrement rompu avec <strong>le</strong> pouvoir traditionnel<br />
africain. Ce n'est donc pas une largesse <strong>de</strong> voir certains<br />
chefs d'Etat participer à la construction d'édifices<br />
religieux ou à l'intronisation d'un chef traditionnel...<br />
Cet acte est fondé sur la crainte <strong>de</strong>s gouvernants à<br />
l'égard <strong>de</strong>s chefferies qui ont toujours gardé un pouvoir<br />
mystique. Cet aspect explique en profon<strong>de</strong>ur <strong>le</strong> recours<br />
constant du dirigeant politique actuel aux pouvoirs péri<br />
phériques que sont <strong>de</strong>vin et marabout. Ceux-ci, "vus d'en<br />
haut, <strong>de</strong>s sommets <strong>de</strong> l'Etat... sont <strong>de</strong>s alliés un peu<br />
gênants... dont on voudrait bien se passer, mais qu'on ne<br />
peut écarter faci<strong>le</strong>ment et sans risques politiques. Vus<br />
d'en bas ... ils sont plus que jamais <strong>de</strong>s héros populaires,<br />
<strong>de</strong>s protecteurs indispensab<strong>le</strong>s, <strong>le</strong>s gardiens <strong>de</strong> la cita<br />
<strong>de</strong>l<strong>le</strong> du bien." (1). Exploitant cette réalité du pouvoir<br />
africain, Bernard Dadié dévoi<strong>le</strong> que la cooptation <strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong>vins et marabouts permet à la classe dirigeante non<br />
(1) C. Coulon, op. cit., p. 266.
317<br />
thèse selon laquel<strong>le</strong> <strong>le</strong> dramaturge ivoirien serait<br />
<strong>de</strong>venu un agent <strong>de</strong> mise au pas idéologique. Pour bon<br />
nombre d'intel<strong>le</strong>ctuels <strong>de</strong> son pays, il a terni son image<br />
<strong>de</strong> "plume amère". Car, conunent concevoir un théâtre au<br />
service du peup<strong>le</strong> tout en collaborant avec ceux qui l'ex<br />
ploitent profusément?<br />
Etant donc en porte-à-faux avec ce qu'il écrit,<br />
nous pensons que Bernard Dadié produit <strong>de</strong>s oeuvres qui<br />
restent un édifice inachevé, où l'idéologie dominante<br />
peut apparaître conune un trompe-l'oeil efficace au service<br />
<strong>de</strong>s dominants.
321<br />
L'échec du chef dadiéen n'est dû ni à sa singularité<br />
d'homme politique, ni à son caractère maudit; mais à<br />
l'inadéquation entre l'idéologie dominante qu'il représente<br />
et <strong>le</strong>s aspirations profon<strong>de</strong>s du peup<strong>le</strong> qu'il conduit. Cette<br />
contradiction détermine la structure dramatique du héros<br />
dadiéen. Cel<strong>le</strong>-ci fait <strong>de</strong>s pièces théâtra<strong>le</strong>s <strong>de</strong> l'écrivain<br />
ivoirien un triptyque présentant <strong>de</strong>s aspects différents<br />
d'un même schéma: quête du pouvoir (motivée par une<br />
réel<strong>le</strong> soif <strong>de</strong> gloire) toujours réussie, suivie <strong>de</strong> l'exploi-<br />
tation du peup<strong>le</strong> qui débouche sur la dégradation <strong>de</strong> la<br />
puissance du monocrate. La déchéance du dirigeant politi-<br />
que résulte <strong>de</strong> son divorce d'avec <strong>le</strong> peup<strong>le</strong>. Ce <strong>de</strong>rnier,<br />
personnage important du théâtre dadiéen est moins anonyme<br />
d'une pièce à l'autre. Il incarne l'idéal du dramaturge.<br />
Comme Dadié, <strong>le</strong> peup<strong>le</strong> aspire toujours à la justice<br />
socia<strong>le</strong> et à la liberté.<br />
Aussi, face à une Afrique politiquement dégradée,<br />
où certains régimes frisent <strong>le</strong> fascisme, <strong>le</strong> théâtre<br />
dadiéen se veut-il un théâtre <strong>de</strong> combat, chargé <strong>de</strong> dyna-<br />
mites. Pour Dadié, tout comme <strong>pour</strong> Senghor, "faire<br />
oeuvre d'art, c'est non seu<strong>le</strong>ment percer la croûte <strong>de</strong>s<br />
apparences <strong>pour</strong> accé<strong>de</strong>r à la vie du réel, qui est mouvement,<br />
mais aussi débri<strong>de</strong>r la sclérose <strong>de</strong> "l'état <strong>de</strong> choses<br />
actuel", mais transformer notre vision du mon<strong>de</strong>, donc<br />
transformer <strong>le</strong> mon<strong>de</strong>" (1). Cet idéal <strong>de</strong> transformation<br />
globa<strong>le</strong> <strong>de</strong> la société africaine sous-tend toute la criti-<br />
(1) L. S. Senghor, Liberté 1. Négritu<strong>de</strong> et Humanisme,<br />
p. 156.
l'écrivain.<br />
323<br />
Une étu<strong>de</strong> stylistique du texte dadiéen mérite d'être<br />
faite. C'est dans ce domaine que nous comptons <strong>pour</strong>suivre<br />
nos recherches. Nous n'y avons fait que <strong>de</strong> brèves allusions,<br />
car nous nous étions interdit toute analyse susceptib<strong>le</strong><br />
<strong>de</strong> nous éloigner <strong>de</strong> notre choix fondamental.<br />
Aussi, <strong>pour</strong> clore cette conclusion, faut-il signa<strong>le</strong>r<br />
que notre contribution qui ne se veut point exhaustive,<br />
entend ouvrir la voie à d'autres chercheurs qui s'inté<br />
ressent à l'oeuvre <strong>de</strong> Bernard Dadié.
GRAH Mel F.<br />
HONSCH Marlène<br />
HOUEDANOU Lucien<br />
HOUNDJAGO J. Kpadé<br />
KAMISSOKO Gaoussou<br />
KANTERS Robert<br />
KAURILSKY Françoise<br />
KODJO Léonard<br />
KOTCHY Barthélémy<br />
ID.<br />
ID.<br />
ID.<br />
328<br />
"Il <strong>le</strong> méritait... ", Fraternité<br />
Matin, 1er avril <strong>1980</strong>.<br />
Le Pouvoir et l'Argent dans l'oeuvre<br />
romanesque et théâtra<strong>le</strong> <strong>de</strong> Bernard<br />
Dadié, 3ème Cyc<strong>le</strong> Lettres, Paris<br />
III, <strong>1980</strong>-1981 sous la direction<br />
<strong>de</strong> P; Citron.<br />
"Dadié : <strong>le</strong>s jeunes écrivains<br />
plus favorisés", Bingo, n? 356,<br />
sept. 1982.<br />
"Quelques gran<strong>de</strong>s figures historiques<br />
vues par Bernard Dadié<br />
dans Béatrice du Congo", Ann. <strong>de</strong><br />
l'Université du Bénin, série Lettres,<br />
vol. 5, n ? l, 1978.<br />
"Alger : triomphe <strong>de</strong> Monsieur<br />
Thôgô-gnini ", Abidjan, Fraternité<br />
Matin, n? 1407, 31 juil. 1969.<br />
"Les bons sauvages d'Avignon<br />
(Béatrice du Congo)", L'Express,<br />
26 juil<strong>le</strong>t - 1er août 1971.<br />
"La foire aux spectac<strong>le</strong>s (Béatrice<br />
du Congo), Le Nouvel Observateur,<br />
26 juil<strong>le</strong>t - 1 août 1971.<br />
"Les personnages du.théâtre <strong>de</strong><br />
Ponty ", Revue <strong>de</strong> Littérature et<br />
d'Esthétique négro-africaine (I.L.E.N.A.)<br />
nO 3, Abidjan, NEA, 1981.<br />
La Satire socia<strong>le</strong> dans l'oeuvre<br />
théâtra<strong>le</strong> <strong>de</strong> Bernard Dadié , 3ème Cyc<strong>le</strong><br />
Lettres, Paris-Vincennes 1976,<br />
sous la direction <strong>de</strong> J. Levaillant,<br />
387 p.<br />
11Monsieur Thôqô-qrrini:" , Ann.· <strong>de</strong> l'Université<br />
d'Abidjan, série D (Lettres)<br />
t. 3, 1970.<br />
"Les contes dans la société africaine<br />
(B. Dadié et Birago Diop)",<br />
Paris, Présence Africaine, n ? 86,<br />
2ème trim. 1973.<br />
"Le temps et l'espace dans <strong>le</strong><br />
théâtre <strong>de</strong> Dadié", Ann. <strong>de</strong> l'Université<br />
d'Abidjan, Série D (Lettres),<br />
t. 12, 1979.
KOUAME J.B.<br />
ID.<br />
KOUASSY Guy<br />
ID.<br />
ID.<br />
ID.<br />
ID.<br />
K. K. Man Jusu<br />
LEMARCHANo Jacques<br />
MARCABRU Pierre<br />
MERCIER R. et<br />
BATTESTINI M. et S.<br />
MURY Gilbert<br />
NEBA Bienvenu<br />
NGUESSAN G. Bertin<br />
ID.<br />
329<br />
"Séminaire sur <strong>le</strong>s oeuvres <strong>de</strong><br />
B. oadié", Fraternité-Matin)<br />
24 mars <strong>1980</strong>.<br />
"Une rencontre fructueuse malgré<br />
quelques faib<strong>le</strong>sses", Abidjan,<br />
Fraternité-Matin) 1er avril <strong>1980</strong>.<br />
"Béatrice du Congo) une pièce à une<br />
voix dans <strong>le</strong> vent du passé",<br />
Abidjan, Fraternité-Matin) n° 3277,<br />
14 oct. 1975.<br />
"Le théâtre ivoirien", Fraternité<br />
Matin) 28 août 1973.<br />
"Le théâtre ivoirien", Abidjan,<br />
Fraternité-Matin) 4 sept. 1973.<br />
"Le théâtre ivoirien", Abidjan,<br />
Fraternité-Matin) 11 sept. 1973.<br />
"Le théâtre ivoirien", Abidjan,<br />
Fraternité-Matin) 25 sept. 1973.<br />
"Carnet <strong>de</strong> prison <strong>de</strong> B. oadié : <strong>le</strong><br />
message <strong>de</strong>s aînés", Fraternité<br />
Matin) 8 décembre 1981.<br />
"Autour du Palais <strong>de</strong>s Papes,<br />
(Béatrice du Congo) ", Le Figaro)<br />
30 juil. 1971.<br />
"Béatrice du Congo", France-Soir)<br />
20 juil. 1971.<br />
Bernard Dadié, Paris, Nathan,<br />
1964, 64 p.<br />
"Climbié", L'Humanité) 26 mars 1956.<br />
"Néba Bienvenu par<strong>le</strong> <strong>de</strong> Béatrice<br />
du Congo", Abidjan, Fraternité<br />
Matin) n° 241, 21 septembre 1975.<br />
"A propos <strong>de</strong> Monsieur Thôgô-gnini " ,<br />
Abidjan, Fraternité-Matin) n ? 1254,<br />
23 janv. 1969.<br />
"A propos du Festival d'Alger",<br />
Abidjan, Fraternité-Matin) n ? 1416,<br />
12 août 1969.
DELEUZE Gil<strong>le</strong>s<br />
DORT Bernard<br />
FANCHETTE Jean<br />
GENETTE Gérard<br />
LARTHOMAS Pierre<br />
LIOURE Michel<br />
MAURON Char<strong>le</strong>s<br />
33B<br />
Logique du sens, coll. "Critique"<br />
Paris, Les Ed. <strong>de</strong> Minuit, 1969,<br />
392 p.<br />
Théâtre en jeu - essais <strong>de</strong> critique<br />
1970 - 1978, coll. "Pierres vives",<br />
Paris, Seuil, 1979, 328 p.<br />
Psychodrame et théâtre mo<strong>de</strong>rne, Paris,<br />
Buchet-Chastel, 1971, 347 p.<br />
Figures III, coll. "Poétique", Paris,<br />
Seuil, 1972, 285 p.<br />
Le langage dramatique, Paris, P. U. F. ,<br />
<strong>1980</strong>, 478 p.<br />
Le drame <strong>de</strong> Di<strong>de</strong>rot à Ionesco, Paris,<br />
Armand Colin, 1973, 279 p.<br />
Psychocritique du genre comique, Paris,<br />
Ed. Corti, 1964, 188 p.<br />
MERANO P. et SEWANOU O.: Gui<strong>de</strong> <strong>de</strong> Littérature africaine, co11.<br />
"Encre Noire", Paris, 1979, 219 p.<br />
NANTET Jacques<br />
PISCATOR Erwin<br />
PRESENCE AFRICAINE<br />
PROPP Vladimir<br />
REVUE Dia<strong>le</strong>ctiques<br />
REVUE d'Esthétique<br />
SCHERER Jacques<br />
SENGHOR L. S.<br />
Panorama <strong>de</strong> la Littérature noire<br />
d'expression française, Paris, Fayard,<br />
1972, 278 p.<br />
Le théâtre politique su&v& <strong>de</strong> supplément<br />
au théâtre politique, Paris,<br />
L'Arche Editeur, 1972, 275 p.<br />
Le critique africain et son peup<strong>le</strong><br />
comme producteur <strong>de</strong> civilisation,<br />
Colloque <strong>de</strong> Yaoundé, 16 - 20 avril<br />
1973, Paris, Présence Africaine,<br />
1977, 547 p.<br />
Morphologie du Conte, co11. "Points",<br />
Paris, Seuil, 1965 et 1970, 254 p.<br />
"Théâtre : Vitez, Ouvrard,<br />
Kaisergruber", Dia<strong>le</strong>ctiques n ? 14,<br />
3ème trim. 1976, p. E à 39.<br />
"L'envers du théâtre", Revue<br />
d'Esthétique 1 - 2, 2ème trim. 1977,<br />
Paris, Union Généra<strong>le</strong> d'Editions,<br />
443 p.<br />
La dramaturgie classique en France J<br />
Paris, Nizet, 1950, 488 p.<br />
Liberté I: Négritu<strong>de</strong> et Humanisme,<br />
Paris, Seuil, 1964, 444 p.
- 4 -<br />
En conclusion, il faut retenir que dansil'oeuvre<br />
théâtra<strong>le</strong> <strong>de</strong> Bernard Dadié, c'est <strong>le</strong> pouvoir politique,<br />
s'appuyant sur <strong>le</strong>s forces occultes, qui détermine <strong>le</strong> pou<br />
voir économique et non l'inverse. Ainsi, l'€nsemb<strong>le</strong> <strong>de</strong>s<br />
oeuvres dramatiques <strong>de</strong> Dadié forme-t-il un triptyque pré<br />
sentant <strong>de</strong>s aspects différents d'un même schéma: soif <strong>de</strong><br />
pouvoir"; exploitation abusive d'un peup<strong>le</strong>, révolte popu<br />
laire suivie <strong>de</strong> la déchéance du héros dadiéen. Cette struc<br />
ture dramatique est symétrique à la structure interne <strong>de</strong>s<br />
pièces théâtra<strong>le</strong>s étudiées. Ce qui nous a permis d'affirmer<br />
qu'on ne peut séparer <strong>le</strong> fait politique du fait théâtral,<br />
moins encore <strong>le</strong> fait socio-historique du fait dramatique.