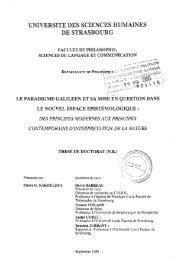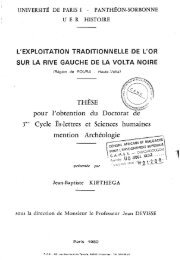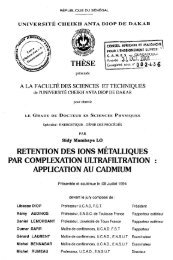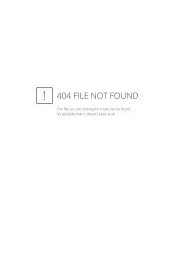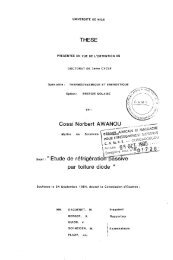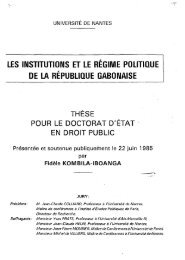L'A.FR IQUf suaSA HA R'ENNE DEPUIS 1958
L'A.FR IQUf suaSA HA R'ENNE DEPUIS 1958
L'A.FR IQUf suaSA HA R'ENNE DEPUIS 1958
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
UNIVERSITE DE PARIS X - NANTERRE<br />
LA<br />
ET<br />
<strong>L'A</strong>.<strong>FR</strong> <strong>IQUf</strong> <strong>suaSA</strong> <strong>HA</strong> R'ENN E<br />
<strong>DEPUIS</strong> <strong>1958</strong><br />
THESE POUR LE DOCTORAT D1ETAT EN SCIENCES POLITIQUES<br />
Présentée et soutenue publiquement par Abdoulaye DIARRA<br />
Sous la direction de Ronsieur le Professeur Hugues PORTBLLI<br />
(J.<br />
Année univeFsitaire 1988-1989
UNIVERSITE DE PARIS X<br />
THESE SOUTENUE LE<br />
MEMBRES DU JURY<br />
NANTERRE<br />
THESE POUR LE DOCTORAT D'ETAT EN SCIENCES POLITIQUES<br />
Présentée et soutenue publiquement par Abdoulaye DIARRA<br />
Sous la direction de Xonsieur le Professeur Hugues PORTELLI<br />
Année universitaire 1988-1989
PRE FI ACE
- l -<br />
Le choix de la Gauche française en matière de relations franco<br />
africaines n'est pas pour nous un fait du hasard. Il est la suite logique<br />
des oirconstances. En effet, nous avions tenté d'interroger la Gauche<br />
française dans un thème de recherche il y a de cela plusieurs années. Nos<br />
déboires et insuffisances incontestables jadis relevés nous ont<br />
naturellement conduit à recentrer notre réflexion sur un champ<br />
relativement restreint.<br />
L'objectif recherché est-il, ici, atteint ? Nous doutons<br />
toujours, conscients du fait que la perfection dans ce domaine comme dans<br />
bien d'autres relève du mythe. Loin de nous cette prétention. Tout est<br />
relatif et il faut toujours relativiser. La Gauche française et l'Afrique<br />
est un thème fort ancien. Il est aussi actuel et n'est pas sans présenter<br />
des perspectives futures. Ici, comme ailleurs, la réflexion sur le présent<br />
est subordonnée à l'interrogation du passé et ceci en vue d'abord de pou<br />
voir situer le thème pour ensuite essayer l'analyse. S'agit-il au fond de<br />
la Gauche française ou des Partis politiques dits de gauche en France ?<br />
Est-il possible d'appréhender les éléments pris isolément sans<br />
s'interroger sur le tout? Peut-on s'intéresser aux éléments sans poser la<br />
question relative à leurs rapports ? Nous avons pris volontairement le<br />
risque de nous interroger aussi bien sur les éléments que sur leur somme<br />
dans un cadre circonscrit: la Gauche française et l'Afrique subsaharienne<br />
depuis <strong>1958</strong>. Force est de constater aussi que certains partis politiques<br />
français, compte tenu de leur évolution récente, ont plus que d'autres joué<br />
un rôle essentiel dans la vie politique française. Ce qui explique la place<br />
de choix accordée au Parti socialiste français au sein de la Gauche<br />
_française dans la présente-thèse.
- II -<br />
Les difficultés ci-dessus mentionnées soulignent, pour notre part,<br />
que la valeur de la présente réflexion se situe moins au niveau de nos<br />
. constats et conclusion introductive qu'au niveau des critiques et des<br />
réactions qu'elle suscitera suite à nos insuffisances théoriques et<br />
pratiques.<br />
Cette thèse n'aurait pas vu le jour sans l'apport des Amis tant<br />
Africains que Français. Pour ne pas en oublier, je ne dresserais pas ici<br />
de liste. Qu'ils retrouvent tous ici l'expression de ma profonde<br />
reconnaissance.<br />
Je voudrais très humblement remercier Monsieur le Professeur Hugues<br />
PORTELLI qui n'a ménagé aucun effort pour nous faciliter nos recherches.<br />
Son apport pour nous permettre de rencontrer telle ou telle personnalité,<br />
les nombreuses démarches qu'il a entreprises pour nous introduire auprès<br />
de centres de recherches spécialisés tant à Paris qu'ailleurs furent pour<br />
nous indispensables.<br />
Enfin, je dois ce travail au Peuple de mon pays auquel je dois tout.
- 3 -<br />
TROISIEXH PARTIE : La Gauche au pouvoir et les grands problèmes<br />
auxquels l'Afrique est confrontèe 294<br />
Chapitre l - De la place et du rôle de l'Afrique subsaharienne<br />
dans les relations économiques internationales .... 295<br />
A - Le niveau euro-africain............................. 297<br />
1· La Gauche française et la convention CEE/ACP .... 297<br />
2· Le cas de l'Internationale Socialiste........... 309<br />
B - La réforme des Institutions internationales et ses<br />
limites en Afrique subsaharienne 322<br />
1· La réforme des i ns t I tutions internationales 322<br />
2· Les réformes de structures et les politiques d'ajustement<br />
en Afrique subsaharienne : l'état actuel<br />
de la réflexion au sein du Parti socialiste. . . . . . 330<br />
Chapitre rI - La Gauche française et l'Afrique Australe.. 342<br />
A - Evolution du problème : enjeux internes, régionaux<br />
et internationaux , .. , . . . . . . . . . . 344<br />
1· Les enj eux internes et régionaux , . . . . 344<br />
2· Les enjeux internationaux; la stratégie des<br />
puissances 349<br />
B - Les cas de l'Internationale Socialiste et du Parti<br />
Socialiste français 354<br />
1· L'Internationale Socialiste et l'Afrique<br />
australe 354<br />
2· Le Parti Socialiste français et l'Afrique<br />
australe 360<br />
COICLUSION GHBERALE 369<br />
SIGNIFICATION DES SIGLES UTILISES 0<br />
BIBLIOGRAPHIE 0<br />
•• 0 374<br />
•••••••• 0 •••••••••••••• 0 • 0 •• , 379<br />
AJlfEXHS ..... 0 •••••••• 0 ••• 0 ••••••••••••••••• 0 •• , • • • • • • • • • • • • • • 392
- 4 -<br />
INTRODUCTION GENERALE
- 6 -<br />
et les taxes douanières sont imposées comme seules ressources propres<br />
aux colonies. L'Etat colonial assure la garantie des entreprises privées<br />
notamment dans le domaine "des services à finalité économique" (1), Cette<br />
orientation économique aboutit aux résultats suivants : désarticulation<br />
des sociétés africaines, primauté des cultures "d'exportation", etc...<br />
La France traverse une récession économique dès le début des<br />
années 20. Les grands équilibres sont rompus et les colonies constituent<br />
les seuls remparts. Albert Sarrault, Ministre des colonies, élabore en<br />
1920 son programme colonial centré sur les grands projets en vue de<br />
conjurer la crise française. Le terme "association" fait son apparition.<br />
La défense des intérêts français en constitue la toile de fond. Le<br />
Ministre lui-même en donne la signification politique "1 'opéra tian<br />
coloniale française, conçue pour le bien des deux parties, n'est plus une<br />
spoliation d'une race par une autre, mais bien une association, suivant la<br />
formule heureuse qui est devenue la devise de notre politique coloniale.<br />
Les colonies ne sont pas des régions pouvant étre exploitées sans<br />
scrupules. Il s'agit bien d'une partie de la France, qui doit également<br />
participer au progrès scientifique et économique la politique indigène<br />
doit accorder plus de priorité à l'éducation et à l'a.ssistance médicale<br />
parce que le potentiel travailleur est 14 clé de la mise en exploitation<br />
des colonies" (2). <strong>L'A</strong>frique a non seulement participé à la guerre mais<br />
elle doit aussi et surtout participer à la reconstruction de la France. En<br />
1929, suite à la grande crise, l'économie française s'effondre. L'Etat<br />
colonial intervient auprès des entreprises coloniales touchées par la<br />
crise. Le Parlement intervient en 1931 en autorisant "l'émission de deux<br />
(1) Claude <strong>FR</strong>BUD, - op. cft , page 10<br />
(2) Albert'-SARRAULT cité par Claude <strong>FR</strong>EUD - op. cit. pàge-12<br />
C'est nous qui soulignons
- 7 -<br />
emprunts garantis par l'Etat qui font supporter l'essentiel de la dette<br />
sux territoires d'outre-mer plongés élU même moment dans la crise" (1).<br />
Ensuite, toute une série de mesures économiques devaient favoriser, au<br />
prix d'une récession profonde dans les colonies 1 le redressement de la<br />
balance extérieure métropolitaine, La seconde guerre éclate et les mêmes<br />
méthodes, participation africaine accrue à l'effort de guerre, sont<br />
reprises à quelques différences préG, Les dirigeants de Vichy abandonnent<br />
l'ancienne stratégie fondée sur l'intervention de l'Etat colonial pour<br />
financer le développement des colonies. En 1941, un plan décennal est<br />
élaboré mais ne sera jamais appliqué. Une relative autonomie se fait<br />
sentir dans les colonies. Après la guerre, le Général de Gaulle reprend le<br />
concept d'association lors d'une conférence restée célébre à Brazzaville<br />
en 1944. Il Y aurait enfin une possibilité pour le gaullisme naissant<br />
d'associer les colonies à la gestion de leurs affaires. L'Etat doit jouer<br />
son rôle au niveau des investissements pour le développement deG colonies<br />
et ceci en plus de son intervention sous forme ct 'aide aux entreprises<br />
coloniales en procédant aux emprunts. <strong>L'A</strong>sie bouge, elle est incertaine,<br />
l'Afrique reste le continent à portée de main (2). Le 30 avril 1946, une<br />
loi crée un plan "de développement économique et social des territoires<br />
d'outre-mer" (3), L'Etat va élargir ses domaines d'interventions. De nou-<br />
veaux moyens s'imposent. Plusieurs mécanismes ou instruments sont créés :<br />
le Fonds d'Investissement pour le Développement Economique et Social des<br />
territoires d'Outre-mer
- 8 -<br />
des entreprises coloniales et l'accroissement du pouvoir d'achat des t.ra-<br />
travailleurs métropolitains dans les colonies. L'épargne qui en résulte<br />
profite à la métropole. Les projets coloniaux sont financés et l'économie<br />
coloniale se redresse
- 9 -<br />
pendance pour les Etats qui voteront "non" au référendum du 4 octo-<br />
bre <strong>1958</strong>. L'objectif essentiel des fédéralistes africains était d'éviter<br />
une balkanisation du continent. Les nationalistes, eux, préféraient la<br />
balkanisation à la tutelle française. En fin de compte, le concept de<br />
communauté est choisi et proposé aux: Etats qui voteront "oui". Cette<br />
stratégie communautaire était de faire des Etats des entités autonomes<br />
liées à la France. L'indépendance leur serait accordée s'ils la<br />
souhaitaient et la demandaient. En d'autres termes, ils pouvaient quitter<br />
ou demander le transfert de la compétence de la communauté (1). La France<br />
veut autonomiser mais non rompre. Ce qui conduit aux indépendances<br />
massives des années 60 après celle unique de la Guinée en <strong>1958</strong> qui vota<br />
"non", Les différentes instances communautaires et constitutionnelles sont<br />
largement sous le contrôle métropolitain : le Sénat de la Communauté, le<br />
Conseil exécutif, la Cour arbitrale et la Présidence de la Communauté. Le<br />
Président de la République française préside la Communauté, il nomme les<br />
membres de la Cour arbitrale i le rôle du Conseil exécutif est limité au<br />
débat sur les décisions prises par le Président qui est élu "par un<br />
colIége de notables où l'outre-mer ne compte que pour 5 %" (2). Le Sénat<br />
est entièrement sous contrôle métropolitain car constitué "aux deux-tiers<br />
de délégués français" (3). De 1g59 à 1963 , l'Afrique est ?alkanisée et la<br />
communauté disparaît. Les accords et les traités dans presque tous les<br />
domaines vont suivre. Les concepts "aide" et "coopération" apparaissent.<br />
Les instruments relatifs sont élaborés. Les anciens concepts sont adaptés<br />
à la nouvelle situation : le FIDES est transformé en FAC (Fonds d'Aide et<br />
de Coopération), la eCFOM est transformée en eCCE (Caisse Centrale de<br />
Coopération Economique). Il n'y a plus, Outre-mer, d'administrateurs colo-<br />
(1) Hugues PORTELLI - op. cit. - page 53<br />
(2) Ibid - page 54<br />
(3) Ibid - page 54 -
-:- 11 -<br />
A la différence du PCF et de la SFIO. le Parti socialiste unifié<br />
(PSU) va dès sa création faire du tiers-monde un thème central. La<br />
politique gaulliste et celle de la SFIO sont condamnées. la domination<br />
Mimpérialiste" des deux puissances est relevée et condamnée.<br />
La fin des années 60 et les années 70 furent marquées par<br />
l'intégration des partis politiques français. à l'exception du PCF. au<br />
mécanisme et moeurs de la Ve République (1). Le parlementarisme de la<br />
IVe République n'est plus qu'un souvenir. Les Partis à l'image du régime se<br />
présidentialisent et se transforment en partis électoraux. La lutte<br />
politique pour l'acquisition du pouvoir devient la stratégie commune.<br />
Le Parti Socialiste français CPS> fondé en 1971 va très bien<br />
intégrer le système en tant que formation politique modérée, réformiste et<br />
traversée par des courants divers. Le6 relations franco-africaines<br />
préoccupent mais ne font l'objet d'aucun projet politique cohérent. Là<br />
encore, seuls les spécialistes occupent le terrain. Présidential1sé, le<br />
Parti le restera sous le contrôle de son Premier Secrétaire, François<br />
Mitterrand de 1971 à 1981. La connaissance de certains dossiers (le<br />
premier secrétaire a exercé de hautes responsabilités en matière de<br />
relations franco-africa1nes) et l'apport des nouveaux spécialistes ont-ils<br />
permis au PS d'élaborer un véritable projet franco-africain?<br />
(1) Confert :<br />
- Olivier DU<strong>HA</strong>MEL - La gauche et la Ve République - PUF Paris - 1980<br />
- Hugues PORTELLI : La présidentialisation des Partis français<br />
Pouvoirs n' 14 - 1980 - pages 97-106<br />
- Jean-Louis QUHRXONNE - Un gouvernement présidentiel ou un gouvernement<br />
partisan - Pouvoirs n' 20 - 1982 - pages 67-86<br />
(2) Pour tous ces points : cf. Le Monde "Dossiers et Documents" cité
- 13-<br />
Le Parti socialiste soutient l'intégration européenne et<br />
l'association CEE/ACP à travers les Conventions de Lomé. La CEE serait un<br />
cadre propice pour l'application des théories socialistes en Afrique<br />
subsahar-tanna. L'application sans faille des théories de développement<br />
socialistes à travers les mécanismes de la CEE est fort limitée et ceci<br />
en raison de la structure même de la coopération ACP/CEE et de<br />
l'internationalisation des économies. Les Socialistes ont également hérité<br />
d'une certaine politique française en matière de conflits en Afrique<br />
subsaharienne Angola, Afrique du Sud, etc... La signature de la France<br />
fut respectée et faute d'un projet cohérent et d'une possibilité de<br />
l'appliquer, la politique sud-africaine de la gauche socialiste reste<br />
arabtguë. Elle se heurte de surcroît à des obstacles.<br />
La Gauche française et l'Afrique subsaharienne est un thème<br />
complexe. Il n'y a donc pas une voie unique pour tenter ct 'en cerner les<br />
différents contours. Nous proposons l'itinéraire Guivant :<br />
PREKIERE PARTIE<br />
La Gauche française et l'Afrique subsaharienne de <strong>1958</strong> à 1981<br />
DEUX IEKE PART IE<br />
La Gauche au pouvoir et l'héritage de la Ve République<br />
TROI8IEKB PARTIE<br />
La. Gauche au pouvoir et les grands problèmes<br />
auxquels l'Afrique est confrontée<br />
.-
- 14 -<br />
LA GAUCHE <strong>FR</strong>ANCAISE<br />
ET L-A<strong>FR</strong>IQUE SUBSA<strong>HA</strong>RIENNE<br />
DE <strong>1958</strong> à.. 1981<br />
DU DEBAT SUR LA DECOLONISATION<br />
AU CONCEPT DE COOPERATION
- 17 -<br />
C<strong>HA</strong>PITRE 1<br />
LES DIFFERENTES COMPOSANTES DE LA GAUCHE <strong>FR</strong>ANCAISE<br />
FACE A LA DECOLONISATION<br />
DE <strong>L'A</strong><strong>FR</strong>IQUE SUBSA<strong>HA</strong>RIENNE<br />
DONNEES INTERNES<br />
ET ORIENTATIONS EXTERIEURES<br />
<strong>1958</strong> - 1971
- 18 -<br />
La S. F. 1. O. et le P. C. furent profondément affectés par la<br />
Résistance. D'ailleurs celle-ci demeure pour les grandes formations<br />
politiques françaises l'une des références historiques fondamentales.<br />
A cette réalité aux conséquences internes et internationales<br />
s'ajoutent les effets politiques et économiques de la Guerre froide.<br />
Les différents projets français concernant l'avenir politique de<br />
l'Afrique furent structurés dés la fin de la Seconde guerre mondiale.<br />
"Il est important de rappeler que les modalités de l'octroi de<br />
l'indépend8nce à ses possessions africaines et la conception que la<br />
France se faisait de ses colonies furent élaborées et affirmées au<br />
coeur même de la seconde guerre mondiale" (1).<br />
L'importance socto-économique, politique et stratégique des<br />
colonies pour la 11 béra t i on de la France a fait l'objet de plusieurs<br />
recherches. <strong>L'A</strong>frique dès 1940 intégra l'analyse de la situation<br />
internationale de la France. le concept de "chasse gardée" (2) a donc<br />
des origines lointaines. N'était-il pas à cette époque synonyme<br />
d'intérêt national 7 Par conséquent, deux idées-forces s'imposaient au<br />
sein de la classe politique française. Les colonies et la Xétropole<br />
devaient d'une part, former un front uni et d'autre part, il était<br />
devenu indispensable de conserver l' influence française en dénonçant<br />
les tentations anglaises ou américaines. Comment définir une nouvelle<br />
procédure politique non contradictoire avec les impératifs ci-dessus<br />
évoqués. Telle semble l'une des questions politiques essentielles à<br />
Cl) Les Dossiers de l'Histoire - N° 25 - Mai-Juin 1980 - P 23<br />
(2) Le Général de Gaulle affirmait dans ses mémoires de guerre "La<br />
libération nationale, si elle était un jour accomplie gr&ce aux forces<br />
de l'Empire, établirait entre la métropole et les terres d'Outre-mer<br />
des liens de cO.mmtJnauté. Âu. contraire, que la guerre finît sans que<br />
l'Empire eût rien tenté pour sauver la mère-patrie, c'en serait fait<br />
sans nul doute de l'oeuvre africaine de la France w • Ibid - P 23
- 19 -<br />
laquelle les grandes formations de Gauche se doivent d'apporter une<br />
solution. L'enjeu est interne et international. Or ces formations,<br />
communiste et non<br />
politiques pour le<br />
communiste, laissent appara ï tre des options<br />
moins divergentes sur<br />
les grands problèmes de<br />
l'époque. Prenons quelques exemples: rapports de farce politique dans<br />
la métropole, discours sur les relations Est-Ouest, place et rôle de<br />
l'Afrique, etc... C'est dire que la dimension du débat politique sur<br />
la décolonisation et la coopération transgressait le cadre strict des<br />
relations futures entre la France et ses anciennes colonies<br />
subsahariennes. Raisons pour lesquelles nous proposons la trajectoire<br />
suivante :<br />
A - LE CAS DE LA GAUCHE NON COMMUNISTE<br />
B - LE P.C.F. FACE A LA DECOLONISATION DE <strong>L'A</strong><strong>FR</strong>IQUE SUBSA<strong>HA</strong>RIENNE<br />
C - LA PROBLEMATIQUE DE LA COOPERATION
- 24 -<br />
internationale de la S.F.I.O. en 1945 était moins centrée sur<br />
l'Afrique subsaharienne que sur les rapports Est-Ouest. Selon Blum,<br />
entre l'U.R.S.S. et ses alliés et les Etats-Unis d'Amérique, le choix<br />
des U.S.A. relevait de l'évidence. Cependant les concepts: corps in-<br />
ternational, coopération, entente entre nations intègrent la structure<br />
de son discours (1). Léon Blum confronté aux problèmes coloniaux s'est<br />
rendu compte que l'application de son projet colonial se heurtait à<br />
des obstacles à l'époque incontournables: obstacle politique, obsta-<br />
cle économique, voire "idéologique", etc... Aux contraintes nationales<br />
se substituèrent dès 1946 les conséquences de la guerre froide. Marius<br />
Koutet, ancien Ministre des colonies dans le Gouvernement du Front<br />
populaire, est chargé une fois de plus de la question coloniale. Il ne<br />
fut pas un novateur dans le domaine. D'ailleurs, l'impossibilité poli-<br />
tique d'appliquer le projet colonial socialiste à l'épreuve des faits<br />
exigeait une nouvelle stratégie non antinomique avec les intérêts<br />
français dans la société internationale. Guy Mollet repense sa<br />
doctrine coloniale de nouveaux concepts interviennent certaines<br />
conditions politiques pour assurer la présence de la France en Afrique<br />
noire en particulier et dans ses autres colonies en général sont sug-<br />
gérées. H La détention des terri toires jadis colonisés, dit Guy Mollet,<br />
n'est plus admissible que dans la mesure où la fonction colonisatrice<br />
se résout en fonction civilisatrice et éducatrice. Elle ne peut étre<br />
poursuivie contre la volonté du peuple col otiieé" (2). Cette propo-<br />
sition, non conservatrice, n'est pourtant pas dépourvue d'ambiguité6.<br />
Il s'agit de réformer mais pas d'abandonner définitivement la France<br />
(1) Blum propose alors la "construction d'un corps international assez<br />
vigoureux, doté d'instruments de contrainte assez puissants pour assurer<br />
l'existence, la coopération et l'entente entre les nations"<br />
Le Populaire du 4 octobre 1945. C' est nous qui soulrgnone.<br />
(2) Cf. ! Les Dossiers de l' Histoire - N° 7 - 1977 - P 56
- 27-<br />
autres "le droit absolu à l'indépendance et à l'épanouissement"<br />
culturel, linguistique, spirituel des peuples et collectivités de<br />
l'Union. Les ressortissants des pays et territoires d'outre-mer<br />
devaient conserver leur statut avec la possibilité d' y renoncer. La<br />
loi fixe les conditions d'élection des députés des Territoires<br />
d'Outre-mer à l'Assemblée Nationale. Les députés africains participent<br />
certes à l'élaboration de la politique générale mais le Conseil de<br />
l'Union est présidé par le Président de la République. Article 90 :<br />
"Le Conseil de l'Union française est présidé par le Président de la<br />
République et se réunit eu moins une fois par an. J 1 est<br />
obligatoirement consulté sur j'orientation d'ensemble de la politique<br />
rel s t i ve aUX Terri toires d'Outre-mer". Les concepts-clés de ce proj et<br />
s'inscrivent dans une philosophie de l'histoire, une vision du monde.<br />
L'article 2 distingue "le peuple français" des peuples des Territoires<br />
d' Outre-mer et ceux des territoires sous protectorat ou sous mandat.<br />
L'union des peuples libres serait donc la consécration de l'unité dans<br />
la diversité. Cette union n'est pas concevable sans le respect de la<br />
légalité, de l'égalité entre les peuples aux origines et croyances<br />
différentes. L'emploi de la force est condamné et la coopération en<br />
vue d'une évolution pacifique des relations franco-africaines est<br />
conseillée. En outre, l'article 85 ci-dessus mentionné reconnaît "le<br />
droit absolu" à l'indépendance des peuples et des "collectivités".<br />
Mai6 ce droit ne doit pas compromettre la "cohésion de l'Union<br />
française". L'indépendance n'est donc pas ici synonyme de rupture<br />
totale avec la métropole. Néanmoins il apparaît ici une volonté<br />
politique de faire renaître et appliquer les vertus d'un socialisme<br />
démocratique non contraire à l'intérêt national mais contre les<br />
tentations communistes en Afrique noire. Le projet de constitution
- 28 -<br />
de la SFIO était certes novateur dans certains domaines mais<br />
l t ambigui té des concepts ne fut pas sans impact sur la Constitution<br />
française de 1946. Le titre VIII, relatif à l'Union française et lar<br />
gement conforme au projet de la S.F.I.O. est contradictoire avec le<br />
préambule même de la Constitution. D'abord le préambule "Le peuple<br />
français" réaffirme "les droits inaliénables et sacrés" de tous les<br />
êtres humains. "La Nation" a pour mission d'oeuvrer à "l'égalité de<br />
tous les français". HLa République française" n'utilisera jamais la<br />
force contre la liberté d'aucun peuple. Les trois alinéas se caracté<br />
risent par leur confusion juridique, voire politique: confusion entre<br />
individus et peuple, confusion entre citoyens des colonies et citoyens<br />
français, "j uxtapositlon" de l'idée fédérale de l' égalité des<br />
collectivités nationales à l'idée assimilation de l'égalité entre les<br />
êtres humains relevant du domaine français (1),<br />
Considérons les alinéas en question:<br />
"La France f.orme azac les peuples d'Outre-mer une Union<br />
fondée· sur l'égalité des droits et des devoirs, sans distinction de<br />
race ni de religion.<br />
L'Union française est composée de nations et de .Qeuples qui<br />
mettent en COI11111un ou coordonnent leurs ressources et leurs efforts<br />
pour développer leurs civilisations respectives, accroître leur bien<br />
être et assurer leur sécurité. "<br />
Fidèle li sa "mission traditionnelle. la France entend<br />
conduire les peuples dont elle li pris 18<br />
s'administrer eux-mêmes<br />
propres affaires:<br />
et de gérer<br />
0) Cf.- :,-Alfred GROSSER - op cit - P 44 et au Ivarrtes ':
- 33-<br />
l'évolution politique des territoires d' Outre-mer même si certains<br />
d'entre eux furent mis au second plan par des autorités politiques non<br />
socialistes. Citons, entre autres, la liberté de la presse, la liberté<br />
de réunion et d'association, la suppression de l'indigénat, du travail<br />
forcé et de la justice indigène en matière pénale, la création des<br />
assemblées territoriales et des grands conseils, l'instauration du<br />
collège unique l'octroi aux médecins africains des mêmes indemnités<br />
qu'aux autres fonctionnaires des cadres généraux, l'octroi de<br />
l'égalité de traitement et d'indemnité à tous les fonctionnaires<br />
civils et militaires de l'Union française, l'adoption d'un décret<br />
promulgant le Code de Travail d'Outre-mer Cl).<br />
La S. F. 1. O., on le voi t, était donc un part i de réformes<br />
progressives. Sa méthode était de procéder graduellement à la mise au<br />
point pacifique d'une forme de coopération appropriée en vue d'instau-<br />
rer un système politique d'abord confédéral et ensuite fédéral.<br />
L'objectif n'était pas de transformer radicalement les rapports socio-<br />
politiques et économiques mais de faire participer à la gestion des<br />
affaires publiques de l'Union les ressortissants des Territoires<br />
d'Outre-mer. La méthode a changé car les faits ont évolué depuis 1945<br />
mais l'axe central de la théorie reste le même. Il n'y a donc pas,<br />
ici, la réal i té d'un progrès théorique en matière de relation franco-<br />
africaine. "Le progrès théorique suppose l'intégration de données<br />
nouvelles au prix d'une mise en question critique des fondements de la<br />
théorie que les données nouvelles mettent à l'épreuve (, .. ) le<br />
raffinement de la grille de déchiffrement ne se poursuit jamais à<br />
l'infini mais s'achève toujours dans la substitution pure et simple<br />
(1) Cf. 'Résolution portant programme d'action du P.S. dans les Territoires<br />
d'Outre-mer - Bulletin interieur du PS-SFID n' 51- OURS - Paris
- 36-<br />
de l'Union" et des besoins "mondiaux". L'organisation du mouvement<br />
coopératif de l'économie rurale et le relèvement du niveau de vie des<br />
producteurs seraient, selon la S.F.I.O., subordonnés à une organisation<br />
nouvelle du marché. A cette série de réformes devaient se substituer<br />
l'intégration de l'enseignement agricole par la création d'une école<br />
agricole par Territoire, une mécanisation inteneive de l'agriculture et le<br />
respect des coutumes.<br />
Lors de la Conférence Nationale de la SF 10, pour le "Relèvement<br />
de la condition humaine Outre-mer", conférence tenue à Suresnes les 3 et<br />
4 mars 1951, les socialistes font le constat amer de la détérioration des<br />
rapports socio-politiques et économiques dans ces territoires. Comment<br />
donc concevoir l'avenir ? L'unicité autour des points essentiels est<br />
encore une fois acquise mais les propositions ne manquent pas de<br />
divergences profondes. Les contraintes internationales ne cessent de<br />
peser. Les socialistes ont souscrit à la Charte de San Francisco.<br />
L'inquiétude de Marius MOUTET résume presque la position délicate de la<br />
SFIO. "Aujourd'hui, une politique à l'égard des territoires d'Outre-mer est<br />
définie par l'Union française. Nais l'Union française, ça n'est qu'un l110t<br />
si on ne la fait pas vivre. L'Union française ne peut être qu'un élément<br />
de la grande politique internationale. Les pays d'Outre-mer n'échapperont<br />
pas plus à une tourmente qui viendrait à éclater main tenant qu'ils n'y ont<br />
échappé antérieurement" (l).<br />
Lucien COFFIN, Secrétaire d'Etat à la France d'Outre-mer, relève<br />
lui aussi le constat d'échec de l'Union et demande au parti de poursuivre<br />
l'oeuvre de réforme pour une Union française conforme à la réalisation du<br />
(l) Cf. Bulletin Intérieur du PS-SFIO - -Kiri 1951 - page 10
- 37 -<br />
bien commun "des hommes d'Outre-mer et aussi des hommes de la<br />
métropole."<br />
L'Union n'a donc pas fonctionné. Là aussi, la césure entre la<br />
théorie et l'action politique fut une réalité. Les Socialistes vont<br />
néanmoins persévérer dans leurs oeuvres de réformes sous forme de<br />
propositions d'abord et ensuite dans la pratique. Ce qui entraîna, non<br />
sans peine, la loi-cadre Gaston DEFFERRE en 1956. On a beaucoup dit et<br />
écrit sur cette 101. Inutile d'y revenir ici encore. Notons simplement<br />
ceci : malgré les résultats du référendum sur la communauté, référendum<br />
qui a fait lui aussi l'objet d'innombrables travaux de recherche, la SFIO<br />
croit toujours à la réhabilitation de ses options politiques en matière de<br />
relations franco-africaines. Le Congrès Bational de la SFIO en 1959<br />
formule que le Parti "poursuivra ses efforts afin que les Territoires<br />
d'Outre-Ker ayant opté pour le maintien de leur statut bénéficient<br />
pleinement, dans les domaines politique, économique et social, des<br />
réformes promulguées par la loi-cadre Gaston Defferre et les décrets<br />
d'application" (1). Désormais, la SFIO parlera des relations entre la<br />
"Communauté et les Pays sous-développés" et des propositions sont<br />
élaborées pour un éventuel gouvernement à direction socialiste.<br />
Un constat, pour nous fondamental, s'impose ici à la lumière de<br />
ce rappel historique. Il est d'autant plus essentiel qu'il sera au coeur de<br />
la théorie sur les relations franco-africaines pour plus de la moitié de<br />
la Gauche non communiste française (ceci tout au long des années GO-70).<br />
Les Socialistes français sont historiquement. politiquement,<br />
(1) Cf. 5te congrès SFIO - Bulletin intérieur PS-SFIO N° 112 - Juin 1959
- 38-<br />
économiquement, stratégiquement et "idéologiquement" fédéralistes, un<br />
fédéralisme conforme au pluralisme démocratique et au respect des droits<br />
socialistes de l 'homme. Léon BLUM ou Jean JAURES ? Les deux à la fois.<br />
C'est dire que les structures de l 'Uni on française et plus tard le contenu<br />
de la loi DEFFERRE étaient d'inspiration jaursssienne. Car selon Jaurès,<br />
"11 n y .3 que trois manières d'échapper à 18 patrie, à la loi des partis.<br />
Ou bien il faut dissoudre chaque groupement historique en groupements<br />
minuscules, sans lien entre eux, sans ressouvenir et sans idée d'unité :<br />
ce sereit: une réaction inepte et impossible, à laquelle d'ailleurs aucun<br />
révolutionnaire n fa songé ,. car ceux-Là même qui veulent remplacer l'Etat<br />
centralisé par une fédération ou des communes ou des groupes<br />
professionnels transforment la patrie " ils ne la suppriment pas ; et<br />
Proudhon était français furieusement... Ou bien il faut réaliser l'unité<br />
humaine par la subordination de toutes les patries à une seule. Ce serait<br />
un césarisme monstrueux, un impérialisme effroyable et oppresseur dont le<br />
rêve ne peut effleurer l'esprit moderne. Ce n'est donc que plir la libre<br />
fédération de nationS autonomes. répudiant les entreprises de la force et<br />
se soumettant à des règles de droit. que peut etre réalisée l'unité<br />
humaine" (1). Il s'agit là d'un système de propositions qui se veut<br />
cohérent, articulé et non contradictoire. Ce système a servi de projet<br />
politique pour la SFIO face à la décolonisation en Afrique noire. Le but<br />
central de l'Union française ou de la loi-cadre était de faire régner le<br />
droit, la raison, la justice outre-mer c'est-à-dire laisser aux territoires<br />
d'outre-mer la libre disposition d'eux-mêmes dans l'ensemble français afin<br />
de permettre aux individus la libre disposition d'eux-mêmes à l'intérieur<br />
des territoires d'Outre-mer. La primauté du droit et de la raison était<br />
pour la SFIO le moyen politique d'éviter les mouvements de libération<br />
(1) Jean 'JAURES - Pages choisies - Ed , Rieder 1922 - p. 444<br />
C'est nous qui soulignons -
- 40 -<br />
devient une réalité. La SFIO, radicale et républicaine va s'opposer au<br />
Général de Gaulle dès <strong>1958</strong>. "L'siiticommunteme, l'atlantisme, républicanisme<br />
et laïcité, tels sont donc les éléments prédominants d'une idéologie<br />
reâicsIe de la Ille République. On comprend que dans ce désert idéologique<br />
les réflexions originales soient introuvables : les éléments qui gardent<br />
quelque culture socialiste ou tout simplement quelque esprit critique ont<br />
quitté le SFIO dès 1947-1950, les derniers le feront lors de la scission<br />
du PSA en <strong>1958</strong> ; c'est donc bors du Parti que se développe une réflexion<br />
socialiste sur le néo-capita 11sme. ] 'évo] uijon des classes sociales ou les<br />
relations sociales" (1). La situation va radicalement changer en Afrique<br />
noire de <strong>1958</strong> à 1961. En effet, en moins de trois années, quinze pays<br />
d'Atrique noire vont accéder à l'indépendance. Ils sont immédiatement<br />
reconnus par plus de la moitié de la communauté internationale et admis à<br />
l'Organisation des Nations Unies. Non seulement les transferts des<br />
compétences de la Communauté se sont imposés mais aussi et surtout la<br />
France va stratégiquement tisser des accords de coopération dans presque<br />
tous les domaines avec les jeunes républiques. Les quinze pays ayant<br />
obtenu leur souveraineté internationale 1 souveraineté non dépourvue<br />
de contradictions 1 constituent ou ont const!tué pour la France une zone<br />
stratégique sans équivoque. Le tableau ci-après le démontre amplement.<br />
(1) Hugue;; PORTELLI - op. cit. - page 84 - C'est nous qui soulignons
Etats sous tutelle<br />
- 41 -<br />
CHRONOLOGIE DR LA DECOLONISATION<br />
DE <strong>L'A</strong><strong>FR</strong>IQUE JUIRE <strong>FR</strong>ANCAISE (1)<br />
Transfert Proclamation Accord Admission<br />
des compé- de de à<br />
tences de la l' 1ndépen- coopération l'ONU<br />
communauté dance<br />
- Cameroun 01/01/1960 13/1111960 1311111960<br />
- Togo 27/0411960 20/0811960<br />
Afrlqueoccidentale<br />
- Guinée 30/09/<strong>1958</strong> 1211211960<br />
- Sénégal 04/0411960 20/0611960 22/06/1960 12/1211960<br />
- Mali
- 42-<br />
La SFIO, siège de contradictions politiques le plus souvent in-<br />
conciliables, va affronter la nouvelle situation de manière quasi<br />
spécifique. La relative cohérence politique et idéologique des années<br />
1945-1957 n'est plus qu'une donnée de l'histoire politique d'un Parti à la<br />
recherche désespérée de son unité sur tous les plans. L'Union africaine et<br />
la Communauté version <strong>1958</strong> furent plus qu'éphémères, surtout au niveau<br />
pratique. Le pacifisme a certes triomphé mais l'avenir reste pour le moins<br />
incertain. La vieille maison va évoluer en ordre dispersé. Seuls les<br />
individualités vont désormais s'exprimer sur un sujet d'une importance<br />
nationale particulière. Guy Mollet, politiquement en difficulté, assimile le<br />
communisme français au bolchevisme soviétique. C'est l'une des raisons<br />
essentielles de la "troisième force" inventée lors d 'une rencontre avec<br />
des leaders tels que Pierre Uri, Maurice Faure
- 43-<br />
internationales. Nous y reviendrons. En effet, Blum fait allusion, ici, non<br />
seulement au congrès historique de Tours, mais aussi et surtout au soutien<br />
communiste à la politique soviétique internationale. Paradoxalement, le<br />
leader de la SFIO va encore soutenir 1'esprit unitaire avec les<br />
communistes en 1962 en optant pratiquement pour une ouverture. Guy Kollet<br />
et avec lui une bonne partie de la SFIO sont restés de <strong>1958</strong> à 1962<br />
anticommunistes et anti-atlantistes, position politique largement<br />
compromise au fil du temps. Aucune réflexion nouvelle ct 'ensemble n'est<br />
imaginée sur l'Afrique noire. En matière de politique internationale les<br />
thèmes vont surgir individuellement dans le Populaire et lors des débats<br />
parlementaires sur les points centraux suivants<br />
l'impact du gaullisme sur les plans interne et international<br />
- le colonialisme et les moyens d'y mettre fin pacifiquement;<br />
- la lutte contre l'autoritarisme international c'est-à-dire la<br />
politique internationale soviétique et de ses alliés ;<br />
- les modes de rupture avec le capitalisme international.<br />
Les 51e et 52e congrès de la SFIO, tenus respectivement en<br />
juillet <strong>1958</strong> et juillet 1959 firent apparaitre des positions politiques<br />
contradictoires entre la droite du Parti (Max Lejeune, Robert Lacoste) et<br />
la gauche du Parti (Christian Pineau, Georges Guille, Albert Gazier). Les<br />
raisons, politiques et sociologique, de cette césure vont avoir des<br />
conséquences profondes sur la vie du Parti notamment sur les réflexions<br />
désormais parcellaires sur le continent africain.<br />
D'abord les raisons politiques : "Avec l'entrée en vigueur de la<br />
Constitution de <strong>1958</strong>, la SFIO connaît donc une ultime scission i une de<br />
trop, devrait-on· dire, dans la mesure où: désormais le parti socialiste ne<br />
joue plus qu'un rôle de second plan dans la vie pol i i ique française, rédui t
- 44-<br />
à moins de 15 Z de l'électorat. Jfëme si, sur le plan c1ienté1aire, la<br />
Gauche non com1Jwniste reste représentée essentiellement par le parti<br />
socialiste, l'essentiel de la réflexion politique socialiste est conduit en<br />
dehors de la SFIO" (l). Ce constat n'est pas sans conséquence sur la<br />
question subsaharienne. Car "la réflexion politique socialiste" comprend<br />
aussi les orientations extérieures.<br />
Raison sociologique ensuite : fi" .L'ebeetice d'adhésions nouvelles,<br />
le vieillissement général du Parti aboutissant j ne maintenir à la SFIO<br />
qu'un squelette de noteblee et de responsables qui ont suivi le même<br />
itinéraire de carrière que Guy Hollet et qui lui sont liés par des<br />
rapports affectifs, idéologiques ou de clientèle. Aucun renouvellement de<br />
la base ou du personnel politique de la SFIO n'ét8.nt venu, en vingt ans,<br />
troubler cette hiérarchie, celle-ci a pu se perpétuer jusqu'au décès<br />
collectif en 1969" (2). Cette permanence sociologique n'est-elle pas l'un<br />
des facteurs de la constance des positions du Parti sur l'Afrique<br />
subsaharienne, constance relative compte-tenu da l'absence d'une cohésion<br />
politique et du "décès collectif de 1969".<br />
Raison "idéologique" enfin : Dans ces conditions les réflexions<br />
éparses sur les relations internationales en général et sur l'Afrique<br />
subsaharienne en particulier ne peuvent que difficilement concevoir pour<br />
le Parti une vision cohérente. Comment les leaders de la SFIO vont-ils<br />
donc individuellement se pencher sur la coopération, le tiers-mondisme<br />
et l'aide au développement dans la Revue socialiste, puisdaus Le<br />
Populaire ?<br />
(1) Hugues PORTELLI - op. dt.c- pagé 81<br />
(2) Ibid'- op. c1t. - page 85
- 45 -<br />
L'Histoire s'impose ici encore. La SFIO en votant pour le<br />
référendum de <strong>1958</strong> et en participant aux affaires publiques la même année<br />
a approuvé par conséquent la politique communautaire du Général de Gaulle.<br />
La communauté, selon la SFIO, est non seulement libérale, politiquement<br />
conforme à la philosophie socialiste, mais aussi et surtout peut pact-<br />
fiquement conduire li l'épanouissement des Etats africains. "Elle contient<br />
en elle, en ses principes comme en sa forme, une orientation largement<br />
libérale, où s'affirme la sincérité française. La communauté ne ligote pas<br />
les Etats parttcipstite, Des dispositions constitutionnelles très souples<br />
prouvent combien fut grand le souci de maintenir les possibilités<br />
d'adaptation aux circonstances, eu» aspirations qui pourraient, dans la<br />
suite, se manifester" (1). Ce libéralisme quant à la structure politique de<br />
la Communauté et à son évolution est approuvé pal' la SFIO lors de son<br />
congrès en juillet 1960. La décolonisation entière et sans équivoque ne<br />
fait pas l'objet d'une réflexion politique approfondie. C'est plus tard que<br />
le concept fit son apparition dans le discours socialiste (2). Quelques<br />
spécialistes de la SFIO en matière internationale vont entreprendre des<br />
recherches dans les domaines de la coopération, du sous-développement et<br />
de l'aide aux pays sous-développés. Sur ces thèmes, un document essentiel<br />
est élaboré par Albert Gazier, ancien ministre et membre influent de la<br />
SFIO. Les recherches d'A. Gazier sont rendues publiques lors d'une confé-<br />
rence et en présence de nombreuses personnalités du Comité directeur de<br />
la SFIO. De nombreux travaux de recherche auxquels nous avons pu accéder<br />
ne mentionnent pas ce texte qui pourtant nous semble indispensable (3).<br />
(1) André BIDET : "La Communauté en évolution" La Revue socialiste n ' 130<br />
La Revue socialiste n· 130 - Février 1960<br />
(2) Cf. : Pour la SFIO et le Tiers-monde - Françoise DELA<strong>HA</strong>YE "La SFIO et<br />
le Tiers-monde" - Mémoire de DEA d'Etudes Politiques<br />
Université de.PARIS X Nanterre - 1981-1982<br />
. (3) Cf. Centre National d'Etudes socialistes - "Les pays sous-développés"<br />
Supplêment à la documentation socialiste - N· 143 - 1962
- 46 -<br />
L'analyse fait ressortir trois centres ct 'intérêt : d'abord les raisons du<br />
sous-développement i ensuite, les différents problèmes que les pays sous-<br />
développés affrontent, et enfin "les différentes solutions" qu'il juge<br />
"concevables".<br />
Ces pays se distinguent par une surpopulation incontestable par<br />
rapport au reste du monde. Sur 3 milliards d 'habitants que compte la<br />
planète, on estime que près de 2 milliards vivent dans des conditions<br />
médiocres, inhumaines, "dans ce qu'on appelle les pays sous-développés, ou<br />
les pays en voie de développement, ou les pays neufs ou encore, le tiers-<br />
monde' (1). Le tiers-monde échappe visiblement à un concept unique : pays<br />
sous-développés, pays en voie de développement, pays neufs. L'accent est<br />
mis sur le niveau de vie très bas de ces populations notamment en ce qui<br />
concerne le cas particulier de l'Afrique noire. L'allusion est faite sur la<br />
détérioration des tennes de l'échange. "Beaucoup de produits, surtout ceux<br />
qui sont importés, sont vendus dans ces pays à un prix beaucoup plus<br />
élevé qu'en France, de sorte que, d'une manière très grossière, très<br />
approximative, on peut dire que dans le calcul du niveau de vie, le Franc<br />
CFA vaut li peu près 1,5 ancien franc métropolitain" (2). Dans ces pays, la<br />
durée moyenne de la vie se situe entre 30 à 35 ans contrairement aux<br />
pays industrialisés où elle est estimée à 67 ans. A ce facteur s'ajoute<br />
l'absence presque totale de structures solides d'instruction. La question<br />
démographique selon Gazier est d'autant plus préoccupante que la natalité<br />
est "extrêmement" élevée. La conséquence qu'il tire de cette réalité est<br />
visiblement malthusienne. Car, en évoquant le cas des pays industrialisés<br />
(baisse de la mortalité, chute de la natalité et croissance économique),<br />
(1)- Albert GAZIER - op. cit.-- page 2<br />
(2) - Ibid,- page 3
- 48-<br />
unique s'effondre totalement" (1) . La monoculture imposée par la<br />
colonisation pour la satisfaction, moins coûteuse des besoins de la<br />
métropole. attire néanmoins l'attention de l'auteur.<br />
Quant aux secteurs secondaire et tertiaire, ils se caractérisent<br />
respectivement par la faiblesse de l'industrie et un relatif développement<br />
du commerce et des transports. L'investissement est une réalité en net<br />
progrès dans les pays industrialisés tandis qu'elle est pratiquement<br />
inexistante dans les pays pauvres. Sur le plan philosophique, Gazier et<br />
avec lui plus d'un membre de la SF IO ne croient pas aux conséquences<br />
marxistes d'une paupérisation excessive des plus pauvres. Mais selon<br />
Gazier, "il est certain que les prophéties de }[arx se seraient réalisées<br />
si le progrès technique ainsi que l'action socialiste et syndicaliste n'a<br />
vaient pas mis un terme 8 la peupérieation absolue du prolétariat" (2).<br />
Ainsi, la réforme de la canditian humaine en Afrique subsaharienne doit<br />
être poursuivie. Car le prolétariat mondial est bien celui des pays les<br />
plus pauvres du monde.<br />
La colonisation n'est pas ioi considérée comme un phénomène<br />
politique globalement négatif, mais "le poste négatif" l'emporte sur<br />
l'aspect positif. Les conséquences du fait colonial sont centralisées<br />
autour des points suivants : le développement des cultures non vouées à<br />
une consommation locale le pacte colonial. c'est-à-dire le refus<br />
systématique des anciennes métropoles de créer des industries dans les<br />
Ipays coloniaux ; les investissements ne devaient servir que les industries<br />
coloniales le "cartiérisme" Œ. Raymond Cartier avait dénoncé les<br />
investissements en Afrique), etc...<br />
- 53-<br />
adopter une attitude politique différente ? Le PSU et le tiers-monde, y<br />
compris naturellement l'Afrique. et la décolonisation est l'objet de notre<br />
interrogation 6uivante.<br />
2- Le Parti Socialiste Unifié : PSU<br />
Le Parti Socialiste Autonome est la suite logique des contradictions<br />
le plus souvent inconciliables, que la SFra maintenait, non sans peine, en<br />
son sein depuis de longue date. La naissance et les premières mesures<br />
internes et internationales de la Ve République vont précipiter l'éclosion<br />
politique de ces contradictions non maîtrisées par la SF ra. La gauche du<br />
Parti
- 54 -<br />
parti jeune qui prend place entre la SFIO et le Parti communiste. Le PSU<br />
s'est fait remarqué dès son jeune âge par son opposition idéologique à<br />
Guy Mollet et par son anticommunisme, même si un rapport politique sain<br />
est souhaité avec le PCF. "L'idéologie du PSU li toujours été caractérisée<br />
par une sorte d'intégrisme révolutionnaire... " (1). L'axe central de la<br />
doctrine du PSU est l'autogestion. c'est-à-dire la participation de tous<br />
les travailleurs à la gestion des entreprises. Il s'agit donc, entre<br />
autres, d 'une responsabilisation effective des travailleurs et des<br />
populations à tous les niveaux et ceci pour une rupture complète avec<br />
l'exploitation tant interne qu'internationale des peuples" (2). Pierre<br />
Mendès-France dont l'influence politique s'effrite progressivement quitte<br />
le PSU en 1968. Lors du Conseil National d'Orléans en 1974, la majorité<br />
se prononce contre l'intégration et ce fut le tour de Michel Rocard et<br />
Robert Chapuis de démissionner afin de rejoindre le Parti Socialiste né<br />
en 1971. Ces considérations, si sommaires soient-elles, ne sont pas sans<br />
impact sur la lecture du PSU des relations internationales en général et<br />
en particulier et sur sa conception sur la nature et l'évolution du<br />
tiers-monde. Car la conception que le PSU a du tiers-monde est<br />
inséparable, pour notre part, de l'évolution du continent africain et de<br />
ses principes généraux sur la décolonisation.<br />
a) Le P.S.U. et l'Afrique<br />
Dès sa création, le PSU s'est distingué de la SFIO par sa<br />
politique assez claire, cohérente à l'égard du tiers-monde. La<br />
condamnation de la politique gaulliste et du soutien de la SFIO à cette<br />
(1) Cf. Jean TOUC<strong>HA</strong>RD - op. cit. p. 318<br />
(2) Pour la conception politique du PSU - Cf. Guy <strong>HA</strong>NIA : Un parti de la<br />
Gauche : Le PSU - Librairie Gédalge 1966 - Pp. 140 et suivantes<br />
Voir également les archives du PSU au siège du PSU : 9, rue Borromée<br />
75015 PAEIS
sentimentale. Elle résulte aussi "<br />
- 58 -<br />
de la constatation que le capitalisme<br />
orgeuisse S8. progression sur une base européenne et mondiale... Nous sou-<br />
tenons activemerJt la lutte du peuple vietnanien contre l'impérialisme<br />
américain, et celle du peuple palestinien qui défend son droit d se<br />
reconnaître dans une entité nationale et qui représente une force<br />
révolutionnaire importante au Noyen-Orient" (1). Aussi, l'action concrète<br />
avec les mouvements de libération nationale est, selon Rocard, la<br />
condition essentielle d'une solidarité non théorique mais pratique. La<br />
réalisation du projet interne (l'autogestion) exigerait la fin de la<br />
colonisation c'est-à-dire une transformation des rapports sacio-politiques<br />
a l'échelle mondiale, transformation conforme aux principes du socialisme<br />
autogestionnaire. L'importance du tiers-monde dans le combat politique<br />
global est nettement soulignée. "Dans l'ensemble du tiers-monde, les mou-<br />
vements populaires d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie, qu: se battent<br />
pour leur indépendance politique et économique, et aussi pour d'autres<br />
structures, cherchent avec angoisse un soutien actif dans les pays<br />
développés. Le PSU est l'lin de leurs correspondants. La meeee de rapports<br />
que nous entretenons avec des organisations de ces régions du monde, nous<br />
confirme que nous sommes à la pointe d'un combet: qui â une dimension<br />
mondiale, et qui pourra peuc-ëtre éviter la grande conflagration entre<br />
pays nantis et pays pauvres, qu'un cepitelieue absurde est en train de<br />
nous préparer" (2). Néanmoins, cette participation active auprès des<br />
mouvements populaires en lutte dans l 'ensemble du tiers-monde n'est pas<br />
synonyme d'absence d'ordre. Il s'agit donc de libérer les peuples sous<br />
l'emprise capitaliste et autoritaire pour un ordre nouveau, le modèle<br />
politique préconisé par le PSU sur le plan interne. Certes, l'autodéter-<br />
(1) Michel ROCARD : Le Projet socialiste<br />
ln : Le PSU. - Epi 1971 - Pp 211-222<br />
(2) Kiche-l ROCARD - Ibid - p. 222
- 60-<br />
L'analyse se fonde sur l'expérience en matière de décolonisation. Le<br />
parlementarisme fut incapable de résoudre pacifiquement le conflit<br />
algérien. Le PSU ne sépare pas cette impuissance politique, dÛ8 en grande<br />
partie au refus des Parlementaires coloniaux, de la situation de l'Afrique<br />
subsaharienne des années 60. C'est le cas surtout du régime raciste et<br />
inhumain d'Afrique du Sud. "La guerre d'Algérie a ms ni ieeté L'impuieesnce<br />
du système parlementaire bourgeois à résoudre les problèmes de la<br />
décolonisation... Entre le Parlement où dominaient les intérêts des<br />
couches eocisIee anachroniques et les nécessités du néo-coloniel ieme, se<br />
développait insidieusement un conflit euouol le "1 S Na]" a brutaleIIIent<br />
donné une issue inattendue" (1) dit Serge Mallet. Là aussi, il n'y a pas<br />
seulement divergence entre la SfIO et 18 PSU sur les modes de la<br />
décolonisation, il y a aussi et surtout une contradiction essentielle<br />
entre les deux comportements tant théoriques que pratiques. Car la lutte<br />
que mènent le "néocapitalisme privé" et le "capitalisme d'Etat" dès les<br />
années 60, lutte interne et internationale, ne favorise qua difficilement<br />
la négociation comme mode de rupture avec le colonialisme dans certains<br />
pays d'Afrique subsaharienne. : l'Angola, le Congo, l'Afrique du Sud, etc...<br />
Le PSU ne condamne pas la forme de la communauté instaurée par la<br />
Ve République. Néanmoins, le fonctionnement de la communauté n'altère pas,<br />
selon le PSU, les rapports de domination. Ainsi, une réelle décolonisation<br />
de ca fonctionnement serait la transformation de la communauté en<br />
association d'Etats pleinement souverains en vue d'une coopération dénuée<br />
de toute tentative d'exploitation. La résolution de 1962 précise sur ce<br />
point : "Vis-à-vis des pays qui constituent aujourd 'hui 18 "communauté", la<br />
coopération technique, économique et culturelle ne peut (jtre envisagée que<br />
dans lB mesure Où ces pays ont pu librement se déterminer et dans 18<br />
(1) Sers>" KALLET- Express du 30 mars 1961
- 62 -<br />
sur la décolonisation de l'Afrique subsaharienne. Le Parti a entrepris dès<br />
sa création des stratégies théoriques mais aussi pratiques. L'originalité<br />
du tiers-mondisme du PSU, c'est également l'absence dans la structure de<br />
ses discours du nationalisme. Néanmoins ses discours et ses pratiques ne<br />
furent pas neutres quant à l'avenir politique de l'Afrique subsaharienne.<br />
Le parti communiste français est l'une des plus grandes<br />
formations politiques occidentales depuis 1945. Il est, au lendemain de la<br />
libération de la France de l'occupation nazie, le premier parti de France<br />
avec cinq millions de voix lors des élections pour la première assemblée<br />
constituante le 21 octobre 1945. Ce renouveau quantitatif serait pour une<br />
large part dû à l'apport qualitatif du PCF pour la libération de la<br />
France. Les Communistes ont occupé une place de choix dans la Résistance<br />
contre l'Allemagne hitlérienne mais ont perdu près de 75 000 de leurs<br />
membres fusillés lors de la Résistance. De 1945 à 1960, le PCF n'est pas<br />
resté en dehors de la question coloniale. Pendant cette période, le PCF<br />
sur le plan interne a aussi subi une mutation. C'est pourquoi la question<br />
coloniale telle qu'elle fut analysée par le PCF retient ici notre<br />
attention. Ainsi de la version communiste et des pratiques communistes<br />
pour la décolonisation de l'Afrique subsaharienne.<br />
B - LE PeF FACE A LA DECOLOILSATION DE <strong>L'A</strong><strong>FR</strong>IQUE SUBSA<strong>HA</strong>RIBBIE<br />
Le parti communiste français a différemment évolué face aux<br />
gouvernements français de 1945 à <strong>1958</strong>, et ceci en raison de la<br />
participation ou non à la direction des affaires publiques. Le PCF a<br />
participé au Cabinet Félix Gouin du 23 janvier 1946 au 2 juin 1946. En<br />
revanche, la participation communiste au Ministère Ramadier qui du<br />
28 janvier. 1947 au 19 .novembre - 1947 fut éphé.roér:e car les dirigeants<br />
communistes sont exclus du Gouvernement dès mai 1947. L'évolution
- 63-<br />
intérieure du PCF n'est pas l'axe central de notre interrogation.<br />
Néanmoins, la mutation interne du PCF n'est pas globalement sans impact<br />
sur notre problématique à savoir la vision communiste des relations<br />
internationales en général, et en particulier le discours communiste sur<br />
la décolonisation donc sur le tiers-monde. Un bref rappel historique<br />
s'impose ici à plus d'un titre avant de s'interroger sur la question<br />
subsaharienne dans la pensée communiste des années soixante.<br />
1· Le PCF et l'Afrique avant <strong>1958</strong><br />
La position communiste sur l'Afrique avant <strong>1958</strong> est une<br />
dimension importante de la nature et de l'évolution du tiers-monde. Le<br />
Parti communiste français fut instable sur la question coloniale et par<br />
rapport aux processus de la décolonisation à travers le tiers-monde,<br />
L'instabilité politique du Parti communiste français face aux problèmes<br />
coloniaux et son hésitation permanente sur l'avenir des colonies résulte<br />
pour une part non moindre de sa position politique par rapport aux<br />
différents gouvernements qui se sont succédés. Dès 1944, les communistes<br />
français adoptent une attitude pour le moins complexe sur la question<br />
africaine, "Si les populations de la France d'Outre-mer ont le droit de se<br />
séparer de la métropole, cette séparation serait, à l'heure présente. allée<br />
à l'encontre des intérêts de ces populations : les communistes français,<br />
soucieux du réél, le disent avec netteté et sans équivoque. Les Nord-<br />
Africains par exemple ne font pas partie évidemment de la Nation<br />
française telle que nous l'avions définie ; ils ont intérêt à lier leur<br />
destinée à celle de la france nouyelleu (1). Pourtant, le Parti communiste<br />
français affirme que ses positions restent fondées sur le marxisme sur le<br />
(1) Cours de l'Ecole élémentaire du PCF - 4e Leçon - La Nation française<br />
Paris - 1,944- -- P. 12 C'est nous qui soulignons
- 67 -<br />
terribles effusions de sang" (1). Monsieur Feix va plus loin en dénonçant<br />
insidieusement pour la première fois et publiquement ce qu'on peut appeler<br />
la confusion totale du discours communiste sur le fait colonial car son<br />
appel n'est pas seulement une incitation à la révision mais aussi et<br />
surtout une mise en garde des communistes français devant le danger. Il<br />
ne fallait plus hésiter ni battre en retraite devant une situation devenue<br />
désormais irréversible. La reconversion communiste s'impose d'autant plus<br />
que l 'histoire montre qu'un peuple décidé à se libérer est "invincible",<br />
que la colonisation ne peut que prendre fin. Les peuples des "départements<br />
français", des "protectorats" et des "territoires français" vivent, selon<br />
lui dans les mêmes conditions que ceux des colonies (2). Ainsi le concept<br />
"vieilles colonies" est sans fondoment. Maurice Thorez avait nettement<br />
souligné dans son rapport au XIIe Congrès du PCF certaines des faiblesses<br />
qui avaient résisté aux forces du changement : hésitation de certains<br />
communistes à reconnal:tre "le droit du peuple vietnamien et de tous les<br />
peuples coloniaux et indépendants" à la libre disposition, hésitation<br />
devant "l'affirmation des sentiments d'amitié et de confiance li l'égard de<br />
l'Union so\-iétique". Ainsi, dès le XIIe Congrès, le constat au sein du PCF<br />
d'une certaine rupture avec l'Internationalisme prolétarien était mis en<br />
relief. Le XIIIe Congrès fait le constat de la même réalité politique. La<br />
faiblesse communiste sur le plan culturel est également relevée par Léon<br />
Faix dans un texte de 1954. Car il devenait de plus en plus indispensable<br />
de "détruire" des "arguments" sur lesquels reposaient le fait colonial<br />
Cl) Léon FEIX - texte cité - page 4<br />
(2) Il faut faire comprendre que "dans les circonstances présentes, un<br />
peuple décidé à lutter pour sa liberté est un peuple invincible, y compris<br />
pour admettre que les peuples de Tunisie, d'Algérie, du Haroc, d'Afrique<br />
noire, de Nadagascar, des "vieilles coloniesH (Kartinique, Guadeloupe,<br />
Réunion) sont des peuples opprimés, même si on qualifie ces pays de<br />
"départements français", _de "protectorats", de "territoires d 'Outr-e-mer"<br />
Texte cité - page 4 _.
- 68 -<br />
notamment sa légitimation sur le plan interne. D'où sa référence aux<br />
manuels coloniaux rédigés par XX. Maurice Kuhn et René Ozouf, manuels<br />
destinés aux élèves de la "classe de fin d'études primaires" pour<br />
justifier le fait colonial Cl). Ainsi les Communistes n'avaient pas pu et<br />
su combattre le colonialisme sur le plan culturel et économique. Les<br />
profits souvent inestimables étaient presque proportionnels à la "misère<br />
atroce" dans les colonies. Les communistes devaient également revoir le<br />
concept de "mission civilisatrice" du fait colonial. Là, l'auteur fait<br />
référence à Staline et ceci en vue probablement d 'une adhésion massive<br />
aux thèses nouvelles' qu'il tente de défendre. La domination culturelle<br />
dans les colonies en raison de la primauté du français et la mise au<br />
second plan des langues nationales sont condamnées : "Cela ne saurai t<br />
d'ailleurs nous étonner, Staline ayant montré, il y a déjà longtemps, que<br />
l'étouffement de la langue nationale, de La culture nationale est l'une des<br />
marques essentielles de l'oppression" (2).<br />
Ce discours nouveau sur le tiers-monde en général et sur<br />
l'Afrique en particulier a-t-il résisté à l'épreuve des faits internes et<br />
internationaux ?<br />
Le PCF s'est toujours timidement opposé au colonialisme donc<br />
aux mouvements populaires dans les pays du tiers-monde. Le peF va faire<br />
des concessions en votant les pleins "pouvoirs spéciaux en Algérie". Le<br />
pacte de Varsovie est créé en 1955 par le "camp socialiste" en riposte à<br />
la création de l'OTAN. En 1956, les dirigeants communistes approuvent<br />
(1) Léon FEIX cite une bonne partie de ces manuels coloniaux dans son<br />
texte. Il fait également mention des journaux (Aurore, Le Figaro, Franc<br />
Tireur) qui partageaient et propageaient l'idéologie véhiculée par ces<br />
manuels - Cf. pages 4-6 de son texte cité<br />
(2) Texte.. cité -:... page 7
- 69-<br />
l'intervention soviétique en Hongrie. La décision communiste est condamnée<br />
par la majorité des intellectuels communistes. La Nouvelle critique, née en<br />
1948, est la revue du Parti. La question interne et les problèmes interna-<br />
tionaux y sont largement étudiés, surtout sur le plan idéologique. De 1948<br />
à 1950, l'Ecole Normale Supérieure fut le siège d'une majorité de commu-<br />
nistes philosophes et scientifiques ? A partir de 1956, nombreux furent<br />
ces intellectuels à s'opposer rigoureusement à la politique internationale<br />
du PCP, politique non contraire à la politique extérieure de l'Union<br />
soviétique. En 1956, le rapport Kroutchev fut axé sur la "déstalinisation"<br />
tant interne qu'internationale. Continuité ou rupture ? Au XIVe Congrès du<br />
PCP (Le Havre, 1956), K. Feix va légèrement modifier ses prises de<br />
positian antérieures en déclarant "les liens entre la France et chaque<br />
pllys d'Outre-mer ne peuvent être que le résultat d'une négociation entre<br />
le Gouvernement français et les représentants qualifiés de ces pays. Et<br />
l'Union que nous préconisons doit ét re envisagée comme l'ensemble de ces<br />
liens, sans doute extrêmement divers sur les plans politique, économique<br />
et culturel... Les peuples d'Outre-mer se trouven t être placés dès leur<br />
libération devant d'immenses problèmes économiques, culturels... qu'une en-<br />
tente avec la France aiderait à régler dans les meilleures conditions"(l).<br />
Le PCF va refuser de reconnaître concrètement l'idée de l'indépendance<br />
effective de l'Algérie, indépendance revendiquée par le FLN. Cette attitude<br />
face à un mouvement de libération nationale est-elle dissociable du sort<br />
des autres peuples encore sous domination coloniale ? L'ambiguité du PCF<br />
revient encore une fois officiellement (2), Les préoccupations de la<br />
politique interne sont déterminantes. Comment déceler un réel discours sur<br />
le cas précis de la décolonisation de l'Afrique subsaharienne ?<br />
(1) Léon FEIX - cité par Henri GRIMAL - op. cit. page 147<br />
. (2) Cf. L'intervention de Jacques DUCLOS à l'Assemblée Nationale<br />
- Le 12 mars 1956
- 70-<br />
2" <strong>L'A</strong>frique subsaharienne dans le débat du PCF<br />
la décolonisation<br />
Les antécédents des leaders communistes ne rendent pas facile<br />
la permanence d'une option politique consistante sur la décolonisation de<br />
l'Afrique subsaharienne. Le passé domine encore la vie intérieure du Parti,<br />
les alliances surtout. Ainsi le cas précis de l'Afrique subsaharienne se<br />
dilue dans une conception générale et imprécise sur le tiers-monde. Les<br />
déclarations et résolutions parues dans les "Cahiers du communisme"<br />
traitent beaucoup<br />
définition d'une<br />
subsaharienne. C'est ce<br />
démontrer.<br />
plus des questions<br />
ligne politique pour<br />
nationales que<br />
la décolonisation<br />
ct 'une réelle<br />
de l'Afrique<br />
que nous voudrions maintenant tenter de<br />
Victoire de la paix, défense de la Nation, importance des<br />
élections pour le Parti, tels sont, entre autres, les points capitaux du<br />
discours communiste à la fin des années soixante. "Le Parti réaffirmera<br />
que, pour remédier aux maux qui accablent le pays, il est nécessaire de<br />
pratiquer une politique d'indépendance nationale et de paix, de liberté et<br />
de progrée social" (1). La fin de la guerre dans les colonies, la lutte<br />
contre la misère restent subordonnées à la réalisation de ce que les<br />
communistes appellent le socialisme en France. A ce nationalisme "la se<br />
substituer un électoralisme pour la conquête et l'exercice du pouvoir<br />
politique. La paix internationale est-elle réalisable sans la libération<br />
des colonies où se battent les mouvements de libération nationale ? La<br />
politique coloniale est condamnée en bloc mais on note l'absence presque<br />
totale d'une stratégie communiste originale pour la libération, la décolo-<br />
(1) Les Cahiers du Communisme - Mai 1956 - Page 18
- 72-<br />
"l'existence du camp du socialisme a contribué à la formation d'une zone<br />
de paix comprenant également d'autres pays, à la désagrégation du systeme<br />
colonial de l'impérialisme, à l'essor du mouvement ouvrier international, à<br />
la cohésion des partisans de la paix dans le monde"
- 73 -<br />
haute banque et des monopoles" Cl). C'est la phase du "capitalisme<br />
monopoliste d'Etat". Quant aux dirigeants socialistes, ils ont renié "la<br />
tradition socialiste de lutte anticoloniale qui fut celle de Jules Guesde<br />
et de Jean Jaurès" et ils auraient "contribué à répandre l'idéologie du<br />
colonialisme et du chauvinisme" (2). Que popose alors le PCF pour la<br />
décolonisation de l'Afrique subsaharienne en 1959 ?<br />
La place qu'occupait le PCF dans la Communauté politique<br />
française est en 1959 plus que compromise. Le parti perd peu à peu son<br />
audience nationale et l'électorat communiste se réduit progressivement en<br />
raison de la montée du gaullisme. Cette chute de l'électorat communiste<br />
immédiatement après l'instauration de la Ve République serait due à<br />
l'évolution de la politique interne et des relations internationales.<br />
Ainsi, les intellectuels, du moins une partie non négligeable abandonne<br />
définitivement le Parti dès 1956. Le Nationalisme, thème jadis revendiqué<br />
par le PCF. devient aussi le thème essentiel du gaullisme naissant et<br />
triomphant. Dès <strong>1958</strong>, le PCF durcit ses positions idéologiques fondées<br />
sur le marxisme version stalinienne. Les rapports internationaux ont, eux<br />
changé. La marche des peuples colonisés vers l'autonomie politique est une<br />
réalité incontournable. Elle poursuit progressivement son chemin. La<br />
Droite est au pouvoir en France et bénéficie de la durée. Tous les Partis<br />
politiques, notamment les grandes formations, vont désormais s'adapter à<br />
une nouvelle stratégie électorale pour dominer l'opposition ou soutenir le<br />
pouvoir. La radicalisation du discours communiste interne explique la<br />
radicalisation des positions communistes sur les problèmes interna-<br />
(1) Projet de thèses soumis par le Comité central à la discussion du<br />
Parti pour la préparation du XVe Congrès du PCF tenu à Ivry du 27<br />
au 31 mai 1959. In Supplément au Bulletin de propagande et d'information<br />
édité par le C.C. du P.C.F. - N° 22 Mars-Avril 1959<br />
(2) Ibid - page 6
- 78 -<br />
avant 1960 sont menées par presque les mêmes leaders de la SFIO : Gérard<br />
Xorel, André Ferrat, Albert Gazier, Sépenal, Raoul Prebich, etc ... (1)<br />
Les divergences déjà soulignées entre ces leaders sur le tiers-monde<br />
persistent à nouveau. Le sous-développement est, selon Albert Gazier la<br />
suite logique d'une surpopulation inquiétante dans certains pays. la Chine<br />
est citée en référence. C'est le cas d'un éventuel "péril jaune" sur lequel<br />
le leader met l'accent (2) • La démographie est donc l'un des facteurs<br />
explicatifs de la pauvreté dans les pays sous-développés d'une part et<br />
d'autre part cette pauvreté est encore accentuée par la détérioration des<br />
termes de l'échange et la sous-alimentation. On détermine d'abord les<br />
causes pour chercher ensuite les remèdes. Les causes ayant peu varié, le<br />
discours de la SFIO ne fait pas apparaître des solutions radicalement<br />
. nouvelles. "On voit, dans de nombreux territoires, de petits enfants bien<br />
jolis, agiles, mais avec le ventre gonflé, victimes d'une série de maladies<br />
intestinales. Ils ne vivront pas très vieux. Les morts par la ftJ1m et par<br />
le froid sont importaiitee dans les capitales asiatiques" (3) dit Albert<br />
Gazier. Le cas de l'Afrique 6ubsaharienne n'est pas totalement différent<br />
de ce constat. Dans la mesure où. selon Albert Gazier, la population joue<br />
sur la production, une solution centrale serait l'application des thèses<br />
malthusiennes. Mais, comme le souligne fort bien Françoise Delahaye,<br />
l'auteur semble écarter la responsabilité historique des pays<br />
industrialisés, notamment les métropoles pour expliquer le sous-<br />
développement. La monétarisation des économies traditionnelles, fait<br />
(1) Cf. les articles de la Revue socialiste et le débat parlementaire sur<br />
la question entre 1960 et 1966.<br />
(2) Cf. Intervention de Albert GAZIER le 29 mars 1961 devant le Cercle<br />
d'Etudes Socialistes. - Revue Socialiste n° 146 - octobre 1961 "La conception<br />
socialiste de la décolonisation"<br />
Pour cette période 1960-1969 CL également Françoise DELA <strong>HA</strong>YE<br />
Xémoire cité - pages 49 et suivantes<br />
(3) Ibid '
- BO-<br />
che des solutions. Des concepts tels que "démographie", "Peur" vont, parmi<br />
tant d'autres, infléchir la nouvelle réflexion aur l'aide. "Ce seraitune<br />
erreur de croire que l'intérêt des pays industriels consiste 8 extraire<br />
des pays sous-développés des produits primaires au plus bas prix<br />
possible. Cette politique mercantile, égoïste, à courte vue, est li la<br />
longue extrémemeiit dangereuse. Elle aboutit, en effet, à ruiner la majeure<br />
partie du monde, li restreindre de plus en plus sa capacité à acheter des<br />
produits fabriqués et à préparer ainsi de graves crises de surproduction<br />
dans les pays industriels. L'intérêt bien compris de ceux-ci consiste, en<br />
réalité, à développer le marché mondial, à organiser une économie mondiale<br />
intégrée où la puissance d'achat serait le plus élevée possible" (1). Trois<br />
remarques, pour notre part, s'imposent ici.<br />
Prenons d'abord la question économique. Il ne s'agit pas de<br />
rompre définitivement avec le capitalisme mais d'organiser le marché à<br />
l'échelle internationale en corrigeant les méthodes coloniales. La crise<br />
économique internationale exigerait pour une solution juste et durable,<br />
l'élévation du niveau de vie non seulement dans les pays occidentaux mais<br />
aussi et surtout dans les pays sous-développés. La voie menant à cette<br />
solution, est ici la croissance du pouvoir d'achat, clé essentielle pour le<br />
redémarrage des investissements, en vue d'une croissance économique.<br />
L'apport des pays sous-développés est plus qu'utile pour les pays<br />
industriels en crise, il est indispensable et incontournable.<br />
La question politique ensuite: la démocratie politique est une<br />
donnée historique en Occident. Il conviendrait de l'expliquer et de<br />
l'étendre sans tarder aux pays sous-développés, notamment dans les<br />
(1) André' FERRAT "La Politique française d'aide aux pays sous-développés"<br />
La Revue socialiste - N· 174 - Juin 1964
- 82 -<br />
économique : la réalisation du profit. D'où la complexité du discours de<br />
certains leaders de la SFIO. "L'aide privée aux pa.ys sous-développés,<br />
ejsurtout l'aide américaine, n'a obtenu... au mieux que des demi-succès<br />
quand elle n'aboutit pas à des échecs. Injecté? dans des économies débiles<br />
a structure eeni-TéoâeIe, elle consolidait les forces socialistes<br />
réactionnaires dominantes, empêchait en définitif le progrès économique,<br />
social et poli t i que" (1) dit André Ferrat. L'aide privée n'est pas<br />
totalement écartée dans la mesure où elle peut être facteur de progrèG<br />
économique si elle s'oriente vers un "réinvestissement" des bénéfices dans<br />
les pays sous-développés en établissant des rapports étroits avec l'aide<br />
publique. Le débat sur l'aide publique divise également les leaders dt? la<br />
SF 10. L'aide publique mise au point par- l'ONU et les organisations<br />
internationales spécialisées (2) dans ce domaine permet certes d'aboutir à<br />
la rèalisation des grands équipements d'intérêt public dans Jas pays<br />
bénéficiaires mais elle s'est avérée souvent impuissante à cause de ses<br />
circuits complexes et parfois incontrôlables. Au caractère multiple des<br />
canaux de distribution se substitue, selon A. Ferrat, dans bien dos cas<br />
des "éléments de paternalisme et de néo-capitalisme" qui entament<br />
largement son efficacité dans les pays du tiers-monde. On voit une<br />
volonté politique de concevoir une fonnule ct 'aide aux pays sous-<br />
développés. Mais dans plus d'un article sur la question 1 le cas précis de<br />
l'Afrique subsaharienne n'est pas mentionné avec clarté (3). La<br />
Cl) André FERRAT : "Pourquoi et comment aider les pays sous-développés ?"<br />
Revue Socialiste - N· 157 - Novembre 1962 - Sur ces points cf. Françoise<br />
DELA<strong>HA</strong>YE - Mémoire cité - Pp 56 et suivantes<br />
(2) ONU - OIT - OMS - UNESCO - BIRD<br />
(3) Cf. André FERRAT : article cité -<br />
Gérard XOREL : "L'ONU aide les gouvernements qui, par leur forme même,<br />
constituent un obstacle au développement du pays c'est le cas de<br />
certains états d'Amérique latine, de l'Arabie saoudite, de l'Iran, entre<br />
autres" : La Revue SOCialiste - N° ,_146 - Octobre 1961 "L'aide aux pays en<br />
voie de &éveloppement"
- 83 -<br />
problématique de l'aide n'est donc pas séparable de celle relative à<br />
l'influence française dans le monde sur le plan politique et s tratégtque.<br />
Intérêt national et efficacité de l'aide ne font qu'un. L'unité de la<br />
politique intérieure et de la politique extérieure (l'aide) est largement<br />
partagée par les leaders de la SFIO à l'instar de bien d'autres partis<br />
politiques français à partir de 1960. Mais ce que nous relevons ici et qui<br />
nous semble fondaraerrtal c'est la réalité d'un discours de la SFIO sur la<br />
coopération et l'absence d'un projet cohérent en matière de coopération<br />
franco-subsahartenne. Le parti "vieillissant" ne renouvelle pas<br />
intégralement la structure de son discours. Cette absence de projet est<br />
d'autant plus man ifeste que les différentes déclarations des principaux<br />
leaders de la SFIO sur la question restent divergentes sinon<br />
contradictoires. Tel semble le cas en ce qui concerne l'aide bilatérale et<br />
ses conséquences. Guy Mollet lui-même va tenter de s'expliquer sur la<br />
question lors de sa déclaration de politique étrangère le 11 juin 1966 :<br />
"... L'assistance, quelle qu'en soit la forme et peut-être quelle qu'en soit<br />
l'arrière-pensée -méme si elle est généreuse- mène très l'ite à l'ingérence<br />
étrangère. L'aide économique, si elle est bilatérale suppose
- 84-<br />
internationale. C'est un nouvel instrument monopolisé par les grandes<br />
puissances dans le dessein de perpétuer leur influence économique,<br />
politique, financière et milJ.taire. Elle peut donc paraître dangereuse. La<br />
SFIO fait état d'une certaine prudence quant à la détermination du<br />
montant de l'aide française aux pays sous-développés surtout en direction<br />
des pays subsahariens.<br />
André Ferrat souligne l'effort du contribuable français en<br />
matière d'aide aux pays africains depuis 1956 et évalue le montant de<br />
cette aide à "420 milliards d'anciens francs" en 1962 (1). D'ailleurs dés<br />
19151, Albert Gazier préconisait une autre stratégif? en matière d'aide afin<br />
dt: preserver le pouvoir d'achat du cont.rIbuabIe français d'où La d/:fen:':.e<br />
de l'intérêt national. "...Si on ne veut pas que les investissements, qui<br />
pour eire efficaces doivent être massifs se tradu.isen t par un abaissement<br />
du niveau de vie des pays développéss, ils doivent étre prélevés sur<br />
l'accroissement de la production de ces pays... " (2). Il s'agit d'une<br />
volonté po l i t i que de réduction du montant d'aide aux pays subsahariens<br />
indépendants. La France doit désormais s'aligner sur les autres pays<br />
industrialisés en la matière. Car l'augmentation du montant de l'aide peut<br />
constituer un danger socio-politique voire économique pour la france.<br />
M. Sépenal déclara dans ce sens à l'Assemblée Nationale le 23 oc to-<br />
bre 1964: "La France est déjà le pays qui, proportionnellement à ses<br />
ressources, fournit l'effort d'assistance le plus élevé. Nous ne saurions<br />
l'augmenter sans danger: quand celui de nos voisins, amis et néanmoins<br />
concurrents, est sensiblement plus faible" (3). Donc pour la SFIO l'aide<br />
- 87 -<br />
guère aux populations en cause" 0). Le discours oppositionnel de la SFIO,<br />
du moins chez certains leaders, se tradu i t vis ibleruent par une sorte de<br />
tentation. Cette tentation, même théorique, ne peut que r enforcar un<br />
nationalisme contraire à l'esprit de solidarité. Du Gouvernement à<br />
l'opposition, les discours de la SFIO se situent presque aux antipodes.<br />
Cette solidarité internationale, définie par Guy Mollet lui-même, fait<br />
l'objet d'une motion votée au Congrès de la SFIO en 1963. "Un tel pacte,<br />
précise le texte, Cl 'a de sens et d 'eificecité que :<br />
a) s'il est fondé sur le principe d'une égalité totale entre les<br />
peuples qui apportent leur aide et les peuples bénéficiaires;<br />
o ) s'il assure lIne solution juste et dura b1e au problème de la<br />
stabilisation du cours des matiéres premières et permet d'assurer des<br />
débouchés aux produits intéressés ;<br />
c) s'il permet de développer une politique internationale<br />
â'Lnveetiesemetite progressifs, publics DU privés, et d. 'aide t ecbn i que ;<br />
d ) s'il se préoccupe d'êta blir par une planification in ter--<br />
nationale, une répartition des richesses mondiales" (2).<br />
L'aide multilatérale serait plus conforme à la logique du<br />
socialisme démocratique. Ainsi le6 difficultés liées à l'incapacité da<br />
l'aide bilatérale trouveraient leurs solutions dans la conception d'une<br />
aide multilatérale sur deux volets, c'est-à-dire au niveau européen d'abord<br />
et ensuite, si possible, au niveau mondial. La construction eur-opèenne<br />
n'est efficace politiquement et durable stratégiquement que lorsque<br />
l'Europe intègre en son sein, par une coopération plus large, l'ensemble du<br />
Cl) La Revue SOCialiste - N· 173 - Mai 1964 "La politique internationale<br />
et Gan évolution" Christian PINEAU - Cité par Françoise DELA<strong>HA</strong>YE<br />
Op. ctt , page 75. C'eEDt nous qui soulignons<br />
(2) SFIO - Motion votée par le Congrès national du Parti socialiste<br />
30 mai - 2 juin 1963
- 90-<br />
le sous-développement. Ambiguë au sein de la SFIO, difficilement<br />
opérationnelle dans un contexte international conflictuel, la conception<br />
de la SFIO en matière de mondialisation de l'aide s'est avérée largement<br />
entamée. Ainsi, de 1960 à 1969 la SFIO tenta vainement de faire adopter<br />
un discours aux structures anciennes dans une situation internationale<br />
autre. Les mêmes causes entraînèrent presque les mêmes effets. Les<br />
spécialistes restent les mêmes face A la coopération avec l'Afrique<br />
subsaharienne, les discours résistent à la rénovation et aux critiques.<br />
Par conséquent, le "tiers--mondisme" de la SFIO est resté timide. L'intérêt<br />
national et sa défense ont conduit à un nationalisme peu compatible avec<br />
l'aide désintéressée. En définitive, on peut noter que c'est le<br />
"nationalisme" et le "patriotisme" qui ont largement altéré, au sein de la<br />
SFIO, un internationalisme pourtant mise en relief. Cette ambiguït.é serait<br />
due à la position de la SFIO par rapport au pouvoir politique. Ici aussi<br />
le discours dans l'opposition diffère de celui lié à l'exercice du Pouvoir.<br />
"LB politique de la SFIO parait donc liée aux rapports de forces qu'elle<br />
peut avoir au sein du système politique français. Il n'a pu résoudre la<br />
contradiction entre son désir d'internationalisme, voire même d'abandon<br />
d'une part de la souveraineté nationale et son "patriotisme". Cela s'est<br />
traduit au niveau de l'I.S. par une opposition constante du Lebour et des<br />
pays scandina.ves", écrit Patrice Buffotot avant de conclure : "idéologique"<br />
au sein de 1'IS et "pragmatique" dans la. vie intérieure, la SFIO n'a pas<br />
réussi li avoir une ligne "cobérentie" au sein de 1 'IS, du fait une vision<br />
essentiellement européenne de la politique internationale" (1). Instable<br />
sur le plan interne, la SFIO le fut aussi au sein de l'I.s. en matière de<br />
. (1) Patrice BUFFOTOT Le Parti socialiste SFIO et l'Internationale<br />
Socialiste
- 91 -<br />
politique internationale, politique, pour notre part, indis_sociable du cas<br />
préeis de l'Afrique subsaharienne. La position du PSU est-elle diffé-<br />
rente ? Comment ce nouveau parti a-t-il évolué face à la problématique de<br />
la coopération dans les années soixante et les premières années des<br />
années soixante-dix? Cette périodisation s'impose d'autant plus que Il?<br />
PSU ne fut réellement structuré qu'à partir des années soixante. Les<br />
projets et discours aussi.<br />
2· Le PSU : Evolution ou constance ?<br />
Le PSU, on l'a vu, est le siège d'une consistance théorique et<br />
ceci dans les domaines économique, politique et social. Le parti consolide<br />
sa position internationale et multinationale au service de la Gauche non<br />
communiste et ceci en raison d'une adhésion massive des intellectuels<br />
venus d 'horizons divers : universitaires, écrivains, etc...
- 92 -<br />
d'une action internationale plus rigoureuse et mieux structurée. Les<br />
grands problèmes internationaux tels que le Pacte atlantique, le Koyen-<br />
Orient, le Vietnam 1 la question européenne, vont donc faire l'objet d'une<br />
analyse non dissociable de celle relative au tiers-monde. "Les prises de<br />
position du PSU dans le domaine int.ernetional apparaissent encore comme<br />
une juxtaposition d'analyses correctes mais partielles et eéperéee.i, Il<br />
n'est en particulier pas possible d'éluder une réflexion sérieuse sur le<br />
rôle de la Chine et de l'URSS ainsi que sur les rapports entre les mouve-<br />
ments de libération du tiers-monde et la révolution prolétarienne" (1). La<br />
crise économique internationale est celle d'un système. C'est le "système<br />
capitaliste M international qui de par son fonctionnement entraîna "la<br />
crise monétaire internationale" (2), La crise du système monétaire<br />
international affecte non seulement les échanges commerciaux entre pays<br />
capitalistes développés mais aussi elle influe négativement sur les<br />
rapports économiques entre ceux-ci et le tiers-mande. Car le système,<br />
conçu par les "pays capital1stes" permet d 'harmoniser et de développer les<br />
échanges de marchandises, de services et de capitaux. La crise aux<br />
conséquences mondiales, selon le PSU, met en relief une contradiction<br />
essentielle la contradiction entre la socialisation de la production et<br />
le "libre usage des capitaux par les dirigeants des firmes<br />
internationales" (3). Ainsi les mécanismes monétaires internationaux sont<br />
non seulement contraires à l 'esprit du socialisme autogestionnaire dans<br />
les pays industrialisés d'Europe mais constituent aussi un handicap pour<br />
le développement des pays du tiers-monde. Ils renforcent la domination<br />
américaine, compromettent la puissance financière de l'Europe, assurent<br />
(1) Cf. Rapport politique présenté par le Bureau national et soumis au 7e<br />
congrès du PSU - Juin 1971 - Page 27<br />
(2) La crise du système monétaire capitaliste : PSU documentation <br />
Y' 27-28 - Novembre-Décembre 1971 - 16 pages<br />
(3) Ibid -; page 1
- 93 -<br />
le financement des investissements américains par les "pays capitalistes"<br />
et leurs alliés. Car le système monétaire international, tel qu'il<br />
fonctionnait avant la crise de 1971, était un "instrument de<br />
l'impérialisme politique iriI: taire, économique et même cul ture1 des USA" et<br />
".. .permettait aux USA de rejeter une partie des charges de L'impérisl t sme<br />
sur d'autres pays" (1). La socialisation des rapports financiers franco<br />
subsahariens restait donc subordonnée à la place que devait occuper la<br />
France au sein du Système Monétaire International. Le PSU souligne certes<br />
la nécessité de l'indépendance économique de la France pour l'instauration<br />
d'une nouvelle relation financière franco-africaine non "impérialiste" mais<br />
à l'opposé de la SFIO, l'analyse est plus globale car les questions<br />
financières sont d'abord et surtout internationales. Aussi, à la différence<br />
d 'un nationalisme ambigue de la SFIO, le PSU dès 1971 préconisait un<br />
internationalisme plus élaboré. Au niveau précis du tiers-monde ce<br />
système est à double titre néfaste. Le système est contôlé par les pays<br />
capitalistes les plus riches qui dominent presque entièrement les<br />
organismes financiers internationaux tels le Fonds Monétaire<br />
International, la Banque mondiale, les marchés financiers, la Banque des<br />
règlements inter.:. nationaux . Ainsi les pays sous-développés restent<br />
entièrement absents des centres de décision. L'épargne du tiers-monde est<br />
orientée inévitablement vers les banques des pays riches. Contrairement à<br />
la SFIO, le PSU intégra dans son analyse les conséquences financières de<br />
l'instauration par la France de la Zone Franc dans ses anciennes colonies<br />
d'Afrique subsaharienne. Car la zone Franc fonctionne à l'avantage de la<br />
France sur le plan international. Elle permet à la France "de payer<br />
"l'aide" avec sa propre monnaie que les pays de la Zone Franc laissent en<br />
dépôt en France, de contraindre en pratique ces pays à réserver la<br />
(1) Ibid,- page 4,
- 94 -<br />
majeure partie de leurs ecbste à l'ancienne métropole et de dévaluer leur<br />
monnaie quand le franc dévs Iue." (l) La Zone Franc est donc, selon le PSU,<br />
pour la France ce que le dollar est pour les Etats-unis au sein du<br />
Système international.<br />
La crise de 1971 fut globale échec des mécanismes de<br />
l'économie mondiale, crise monétaire, remise en cause de la division<br />
internationale du travail, etc... Ce fut aussi une crise politique : échec<br />
des politiques de développement économique et social.<br />
Les sociétés IDUlti nationales assuraient la domination<br />
économique des pays industrialisés et des grandes banques à travers le<br />
monde et ceci en s'opposant à toutes les réformes socie-économiques dans<br />
les pays faibles. Elles ne pouvaient être, selon le PSU, facteurs du<br />
développement dans les pays sous-développés. Là aussi, le PSU est moins<br />
ambigu que la SF ID. Selon le PSU, "le système monétaire international<br />
fonctionnait au profit des grandes firmes capitalistes. Elles s'en<br />
servaient pour utiliser toutes les possibilités offertes par l'inégal<br />
développement: des pays et des régions et pour étendre sans cesse la<br />
diversification de leurs sources de profit afin de ne jaJ1Jais étre<br />
affectées par les difficultés économiques ou les luttes sociales dans un<br />
pays âétierminé" (2).<br />
La stratégie internationale du PSU se caractérise par une<br />
originalité notoire par rapport aux autres tendances de la gauche non<br />
communiste. Sur le plan théorique, l'analyse des rapports internationaux<br />
laissent nettement apparaître une mutation. L'impérialisme est pluriel. La<br />
(1) et (2) Ibid - pages 3 et 9
- 96-<br />
Kadagascar, Antilles, Nouvelle-Calédonie), de la Grande-Bretagne (Koyen-<br />
Orient, Inde, Pakistan, Afrique) mais de plus en plus de l'Allemagne<br />
(Amérique latine, Afrique) et du Japon (Asie)" (1). Différente de la<br />
stratégie de la SFIO, la stratégie du PSU l'est-elle aussi de celle du<br />
parti communiste ? Les relations économiques internationales sont<br />
conditionnées par des rapports de classe. Néanmoins la stratégie<br />
internationale ne doit, selon le PSU, se fonder uniquement sur la<br />
formation d'une alliance anti-américaine. Elle doit également transgresser<br />
le cadre du nationalisme, c'est-à-dire qu'elle ne doit plus être fonction<br />
de l'instauration "de la démocratie avancée sur le plan national". La<br />
décolonisation ne fut pas dans bien des cas synonyme d'indépendance<br />
économique mais elle a modifié les données du problème. Les conflits<br />
internes restent liés aux conflits internationaux mais une analyse<br />
approfondie de la situation internationale nouvelle devrait se situer au-<br />
delà des contraintes internes aux Etats. L'influence extérieure reste<br />
déterminante dans les pays sous-développés. "...de même que le capitalisme<br />
européen préserve ses profits par la socialisation des coûts indirects de<br />
la production et d'une partie des consommations intermédiaires de base<br />
(énergie, transports, etc... ), de même le capitalisme néo-colonial est<br />
rendu possible per le financement public des infrastructures grëce aux<br />
mécanismes de "coopération" (2). La réalité de ce constat "néocolonial"<br />
s'expliquerait par le fait que la décolonisation économique n'a pas suivi<br />
la décolonisation juridique. La problématique de la décolonisation<br />
économique exigerait une autre analyse sur la nature véritable du nouvel<br />
Etat national issu de la décolonisation juridique. ". ..la bourgeoisie au<br />
pouvoir s'allie avec l'impérialisme étranger. Elle se substitue aux couches<br />
Cl) Texte cité<br />
(2) Kanuel BRIDIER - Pour un débat sur la stratégie internationale<br />
Critique socialiste - PSU - juin-juillet 1971 - Page 69
- 95-<br />
politique "impérialiste" des USA conduit, selon le PSU, à une colonisation<br />
économique et culturelle de l'Europe par les Etats-Unis. C'est<br />
l'impérialisme principal dont le développement s'est imposé après la<br />
seconde guerre mondiale. "L'impérialisme est la traduction du capitalisme<br />
dans les relations internationales... l'impérialisme est la façon dont le<br />
ce pi te l ieme se traduit dans les rapports entre états: les entreprises des<br />
pays les plus puissants imposent aux autres des échanges dans lesquels<br />
les produits exportés per les pays sous-développés sont achetés au-<br />
dessous de leur valeur, les produits les plus élaborés sont vendus éJU-<br />
dessus de leur valeur, et l'inégalité ne fait que s'aggraver"
- 97 -<br />
moyennes et subalternes de la colonisation pour exploiter son propre<br />
peuple comme intermédiaire de l'impérialisme. C'est l'exemple cerncré-:<br />
ristique des régimes néo-colonialistes en Afrique..."
- 99-<br />
puissance étrangère, le soutien leur est acquis dans la mesure où ils<br />
remettent en cause l'impérialisme (et pas seulement l'occupation<br />
.étrangère) et où ils représentent réellement les luttes des travailleurs<br />
du pays" (1). Ainsi la politique intérieure "néo-coloniale" constatée<br />
exigerait une prudence dans l'action contre le PSU. Le soutien<br />
inconditionnel du Parti est réservé aux mouvements de lutte contre<br />
"l'impérialisme". Les luttes "contre l'impérialisme" français doivent<br />
s'inscrire dans le même cadre en vue d'un soutien du PSU. L'action du PSU<br />
doit permettre d'aider les mouvements de lutte qui centrent leurs<br />
stratégies sur la rupture avec le "capitalisme" pour l'instauration ou<br />
l'évolution vers le socialisme. On peut donc dire que le discours du PSU<br />
n'est pas neutre sur le plan politique. Dans le domaine des rapports<br />
sociaux le PSU à l'inverse de la SFIO élahora aussi une théorie sur<br />
l'immigration (2). Il s'agit là d'un aspect non moins important en matière<br />
de coopération franco-africaine. La question relative aux travailleurs<br />
immigrés est à la fois sociale et économique pour ainsi dire politique.<br />
"Le recours à l'importation de travailleurs immigrés correspond à une<br />
nécessité vitale pour le capitalisme actuel dans les pays développés<br />
aussi bien que pour les bourgeoisies locales au pouvoir dans les pays<br />
sous-développés, qui y trouvent à la fois les avantages économiques et<br />
politiques" (3). C'est donc le "capitalisme" qui fut à la base de<br />
l'immigration pour la production à bas prix et la satisfaction de ses<br />
besoins fondamentaux du moment : en 1969, près de 300 000 travailleurs<br />
immigrés étaient en activité dans les entreprises françaises. Aprés la<br />
seconde guerre mondiale la reconstruction européenne (française et alle-<br />
(1) Cf. Texte du Bureau national: les Tâches internationales du Parti<br />
Congrès de Juvisy - 1972<br />
(2) Série Analyse Sociale : Les travailleurs immigrés<br />
PSU Documentation - N° 16 - Septembre 1970<br />
(3) Ibid :. pages 1 et 2
mande surtout)<br />
-100-<br />
exigeait l'apport des travailleurs étrangers. Les<br />
conditions de travail des immigrés sont spécifiques différence de<br />
salaires considérable à travail égal dans les mêmes entreprises, maintien<br />
de la sous-qualification des immigrés et quasi-impossibilité pour ceux-ci<br />
de bénéficier de la titularisation, mensualisation subordonnée à une durée<br />
d'ancienneté "trop forte".<br />
L'immigré est donc, selon le PSU 1 sur-exploité. "Le principal<br />
avantage (pour les capitalismes d'accueil), c'est bien sûr la eurexploi-<br />
tation des travailleurs importés, sur-exploitation directe par le sous<br />
réouméretion délibérée, l'imposition de conditions de travail aggravées, et<br />
sur-exp1oitation indirecte par l'imposition de conditions d'existence<br />
souvent inhumaines" Cl). Ainsi l'immigré vit pratiquement sans aucune<br />
protection par la législation du travail. L'absence de garantie d'emploi<br />
est d'autant plus entière que la durée des contrats délivrés est fonction<br />
des besoins précis et périodiques des employeurs. D'où des licenciements<br />
permanents qui se substituent aux embauches "frauduleuses n et<br />
difficilement contrôlables. Les grandes entreprises ont donc géré, selon<br />
le PSU, à leur profit, l'incertitude des travailleurs immigrés, incertitude<br />
dûe, pour une large part, au chômage qui sévit dans leur pays d'origine :<br />
logements insalubres, durée de travail prolongée ("22 :Z' dans le bëtimetit<br />
pour 49 heures et 17,1 Z dans les industries extrnctives pour 48 ,6 b,<br />
contre 3,3 Z dans les industries po1ygraphiques et le pétrole pour<br />
43,7 b et 44.2 b": (2). La définition à une action internationale passe<br />
aussi par la prise en compte de cette réalité, réalité qui met en lumière<br />
"les contradictions du capitalisme français" des années soixante. La<br />
(1) Document cité - page 3<br />
(2-) Ibid L page 3
-101-<br />
gestion de ce personnel est s imp Io , son coût est faible. L'avantage n'est<br />
pas seulement économique et aussi et surtout politique souligne le PSU.<br />
'Sur ce point André Gorz écrit "L'appe1 massif à la main d'oeuvre<br />
étrangère permet de modifier fondamentalement et artificiellement la<br />
structure sociale et politique de la production autochtone. Le recours aux<br />
travailleurs étrangers permet notamment : d'exclure une partie importante<br />
du prolétariat de l'action syndicale i de diminuer fortement le poids<br />
politique et électoral de la classe ouvrière i de diminuer encore plus<br />
fortement son poids et sa cohésion idéologique, en un mot de<br />
dénationaliser des secteurs décisifs de la classe ouvrière, installée à<br />
demeure, par un prolétariat importé, économiquement et politiquement<br />
marginalisé, privé de tous droits politiques syndicaux et civiques" Cl).<br />
Approuvant une telle conception sur l'immigration, Je PSU va intégrer Je<br />
phénomène migratoire dans sa stratégie globale de lutte contre les<br />
"impérialismes" et ceci afin de résoudre la question politique et<br />
syndicale par la recherche de l'unité des travailleurs, unité compromise<br />
par le statut particulier qui frappe les immigrés. L'argument fondé sur 13<br />
concurrence entre les travailleurs nationaux et étrangers est donc<br />
irrecevable selon le PSU. ".Le développement de la lutte solidaire du<br />
prolétariat: français et étranger s'inscrit donc directement dans la lutte<br />
anticapitaliste défini par le mouvement eociel iet:e et révolutionnaire" (2).<br />
Le Front socialiste, différent du Front anti-monopoliste, n'est réalisable<br />
qu'à condition d'associer le fait migratoire aux stratégies de lutte<br />
interne. C'est donc une des dimensions essentielles du socialisme<br />
autogestionnaire. Car pour le PSU, les relations franco-africaines font<br />
apparaître ct 'un côté la réalité du "capitalisme ct 'état" et de l'autre le<br />
(1) André GORZ - Temps modernes - Mars 1970 - In document cité - page 5<br />
(2) Document cite - page 7
-106-<br />
par Lénine d'avoir fait triompher dans 18 vie les idées du socialisme<br />
scientifique... Aujourd'hui, quand on contemple les résultats obtenus, quand<br />
on constate que les peuples soviétiques se sont attaqués à la réalisation<br />
du rêve poursuivi pendant des millénaires par 1 'humanité -la construction<br />
du cosmunieme- ce qui frappe n'est pas que la révolution socialiste ait<br />
déjà. eu Li eu, mais qu'il fallut seulement cinquante ans (et malgré<br />
l'intervention étrangère, malgré la guerre bi t Iérietitie) pour mener à. bien<br />
cette oeuvre gigantesque" (l). L'Union soviétique reste donc le modèle en<br />
matière de politique internationale, elle est le guide du mouvement<br />
ouvrier international. Les problèmes politiques et économiques<br />
subsahariens sont analysés a partir de cette option fondamentale.<br />
D'ailleurs, en ce qui concerne le cas précis de l'Afrique subsaharienne,<br />
les thèses communistes développées dans les revues et périodiques<br />
laissent apparaître, au-delà des interprétations différentes, les mêmes<br />
axes centraux (2). Le discours communiste sur les relations franco-<br />
africaines s'articule entre autres, autour de deux paramètres essentiels :<br />
la lecture communiste de ces relations c'est-a-dire la nature des rapports<br />
franco-africains et les solutions politiques envisageables dans le cadre<br />
de "l'internationalisme prolétarien".<br />
Prenons d'abord le premier volet. L'indépendance telle qu'elle<br />
fut donnée aux anciennes colonies françaises est confuse voire totalement<br />
dénuée de toute aspiration à une réelle indépendance économique et<br />
Cl) li'aldeck ROCHET "Cinquante ans après le tournant décisif d'Octobre<br />
1917" Cahiers du Communisme - Octobre-Novembre 1967 - Page 20<br />
(2) Cf. M. HINCKER : "Indépendance politique et développement économique<br />
en Afrique" In Economie et politique - juillet-Décembre 1960 -Pp 15-35<br />
J .P. MEYNARD et A. PREJEAN "Marché commun et néocolonialisme en Afrique"<br />
In Economie et Politique Janvier-juin 1962 - Pp 47-64<br />
R. BARBE "Problèmes de l'orientation du développement économique en<br />
Afrique n'lire" In Economie et Politique - Janvier-Juin 1962 - Pp 179-197
-108-<br />
reflètent aussi cette tendance. Le PCF, sur le plan interne aux Etats<br />
africains, approuve les expériences malienne et guinéenne (1), expériences<br />
centrées sur une volonté d'indépendance totale. Nous y reviendrons. Par<br />
contre, certains pays tels que le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon,<br />
etc... sont demeurés pendant les années soixante des foyers<br />
d'épanouissement des groupes monopolistes et ceci à cause des liens<br />
néocoloniaux tissés dans tous les domaines avec la France et ct 'autres<br />
pays "impérialistes". La conférence des gouvernements des pays de la CEE<br />
tenue à Paris en décembre 1961 avai t pour mobile essentielle l'intégration<br />
presque "autoritaire" des pays africains dans la CEE contrôlée par les<br />
monopoles. "Voici déjà plus de dix ans que Robert Schuman, porte-parole<br />
des trusts sidérurgiques lorrains et à l'époque Président du Conseil,<br />
annonçait que "la France apportera l 'Airique en dot" dans le mariage avec<br />
les groupes monopolistes européens (ceux de l'Allemagne de l'Ouest en<br />
premier lieu) dont "la petite Europe" est l'expression. En effet, lors de<br />
la réalisation du NHarché commun", les territoires africains sous<br />
domination française furent "eeeociée" d'autorité li la CEE" (2). Les<br />
groupes financiers internationaux implantés en Afrique noire dans les<br />
années soixante, ont conduit ainsi à une différenciation marquée de la<br />
société africaine. L'avenir de ces trusts résidait donc selon le PCF, à la<br />
formation et au développement d'une "bourgeoisi8 locale" en tant que<br />
support matériel et moral. D'où la nécessité, dans les premières heures<br />
des indépendances, d'un compromis que ces groupes se sont vus dans<br />
l'obligation de tisser avec les notables et chefs traditionnels (3). Cette<br />
stratégie visait, selon le PCF des objectifs politiques, économiques et<br />
financiers précis maintenir et garantir l'existence des sociétés<br />
(1) Cf, R, BARBE - article cité - page 48<br />
(2) R. BARBE .- article cité - Page 49<br />
(3) Ibiâ - page 55
-109-<br />
"coloniales" qui vont désormais monopoliser l 'exploitation des sous-sols,<br />
la commercialisation des produits agricoles, assurer les "banques<br />
métropolitaines et les sociétés de crédit" qui vont entièrement maîtriser<br />
"le secteur financier privé" et l'épanouissement du capital, orienter les<br />
investissements en conformité avec les intérêts des "puissances<br />
coloniales", contrôler l'évolution monétaire des jeunes états, etc... Par<br />
conséquent l'intégration des Etats africains dans la CEE telle qu'elle est<br />
ne peut que renforcer les facteurs de dépendance de ces pays et garantir<br />
"l'internationalisation du capitalisme monopoliste d'état". La CEE n'est<br />
pas le cadre idéal permettant un réel développement de l'Afrique<br />
subsaharienne, elle constitue une "menace" selon R. Barbé. Les rapports<br />
inégaux franco-africains et euro-africains sont dans ce sens. "Il est 8<br />
prévoir que seuls les projets Il 'entrant pas en contradiction avec les<br />
intérêts européens seront approuvés. La difficulté quasi-Lneurmotitoble<br />
rencontrée jusqu'a présent pour mettre sur pied une industrie de base en<br />
5 'adressant pour une partie du financement, aux grands groupes<br />
sidérurgiques ou chimiques européens ne feront que e'eccroître pour la<br />
rsison bien simple que la "rentabilité" de telles industries, pendant une<br />
longue période, ne peut être assurée tant que le jeu du marché capitaliste<br />
s'exercera. Cela signifie que, pour l'essentiel de l'équipement de base<br />
(produits de l'industrie sidérurgique et des industries mécaniques) et de<br />
la fourniture des industries chimiques (en particulier des engrais) les<br />
pays africains resteront dépendants de leurs importations"
-110-<br />
pays sous-développés, loin de s'intégrer dans une perspective de<br />
développement autonome des pays bénéficiaires, garantit la rentabilité des<br />
grandes entreprises françaises qui profitent des conditions imposées à<br />
ces pays pauvres suite aux codes d'investissement pour le moins inutiles.<br />
L'aide multilatérale favorisera, elle aussi, la mondialisation des<br />
économies ouest-africaines. Dans la mesure où l'économie internationale<br />
demeure sous le contrôle du capital financier international, la<br />
mondialisation de ces économies s'imposait en tant que traduction<br />
concrète dans les pays africains d'une stratégie nouvelle. L'agriculture<br />
africaine post-coloniale n'a pas évolué, elle reste centrée sur les plans<br />
coloniaux qui se situent à l'antipode des besoins réels des peuples. Ainsi<br />
l'association juridique des pays africains à la CEE réconforte le "néo<br />
colonialisme" tant dans les domaines politique, économique, financier que<br />
commercial. La coopération bilatérale et multilatérale s'inscrit ainsi dans<br />
un cadre purement "néo-colonial" 1 cadre stratégiquement protégé par des<br />
accords d'assistance militaire pour la sécurité de la présence étrangère<br />
dans les pays sous-développés. "L'aide technique et flnan cière sur<br />
laquelle comptaient les pays seeociée au Nercbé commun n'est pas<br />
seulement au-dessous de ce qui était attendu, au-dessous du niveau<br />
indispensable pour éviter une détérioration continuelle de la situation<br />
économique. Elle ne peut. dans sa forme actuelle. ni arrêter le<br />
désinvestissement et l'exportation des revenus privés ni s'orienter vers<br />
les secteurs industriels les plus nécessaires au développement d'une<br />
économie africaine indépendante" (l) soulignent J.P. Meynard et A. Pr éjean<br />
avant de s'interroger sur la question militaire. "D'une Façon générale au<br />
demeurant sur les vastes crédits que le budget français .2 lui seul, le<br />
plus obéré sous ce rapport: fournit aux pays de l'Union africaine et<br />
(1) J.P. KEYNARD et A. PREJEAN - Article cité - Page 192
-111-<br />
malgache au titre de l'assistance bilatérale ou multilatérale -c'est-ll-dire<br />
au titre purement français ou au titre de la CEE- l'assistance militaire<br />
demeure maximum : près de 200 milliards d'anciens francs pour les années<br />
1960 et 1961 ... 80 .3 90 milliards encore en 1962." Le discours du PCF sur<br />
les relations franco-africaines et euro-africaines en souscrivant aux<br />
modèles politiques malien, guinéen et ghanéen (1) n'est pas, loin s'en<br />
faut, un discours neutre. Il obéit à une logique politique. Les différentes<br />
solutions préconisées par le PCF dans le cadre de ces relations<br />
l'attestent particulièrement. Car le PCF ne dissocie pas les problèmes<br />
socio-économiques subsahariens des contradictions internes de la société<br />
française d'une part et d'autre part des contradictions est-ouest des<br />
années soixante. Le Parti communiste français des années soixante est<br />
patriote voire nationaliste. Il souscrit pourtant entièrement aux thèses<br />
soviétiques sur les relations internationales. L'URSS demeure selon le PCF<br />
l'avant-garde du mouvement communiste mondial. La transformation des<br />
rapports néocoloniaux serait donc subordonnée à la victoire sur le plan<br />
international des "forces révolutionnaires dirigées" par l'URSS. Une telle<br />
stratégie ne limite-t-el1e pas un apport concret et spécifique du PCF en<br />
direction des mouvements en lutte pour l'indépendance totale en Afrique<br />
subsaharienne. La doctrine internationale du PCF 1 au-delà de la relative<br />
mutation dûe à la réalité interne française, est restée constante pendant<br />
les années soixante. " ... Le parti communiste français, qui unit<br />
indissolublement le patriotisme et l'internationalisme prolétarien, se<br />
considère responsable devant la classe ouvriére et le peuple de France et,<br />
en même temps, devant l'ensemble du mouvement communiste et ouvrier, li<br />
l'égal de tous les partis-frères. Dans ce cadre, la conférence [des partis<br />
communistes] de 1960 a réaffirmé le rôle d'avant-garde du glorieux Parti<br />
Cl) Cf. R-: BARBE---article cité - Pages 47-49
-112-<br />
commuidet:e de l'Union soviétique, détachement le plus aguerri du<br />
mouvement communiste qui a dirigé la première révolution socialiste<br />
victorieuse et qui a accumulé une expérience considérable dans la lutte<br />
pour l'édification du socialisme et pour la construction en grand du<br />
communisme"
-113-<br />
l'opposé du camp socialiste, camp des forces du progrès, demeurent les<br />
instruments du capitalisme, des monopoles et de l'impérialisme sous la<br />
conduite des Etats-Unis. L'internationalisme, on le sait, nous y<br />
reviendrons, s'est avéré historiquement incapable de résoudre les<br />
problèmes coloniaux. Le mythe international des années soixante n'a-t-il<br />
pas altéré une action globale et concrète bilatérale entre le PCF et les<br />
mouvements opérant en Afrique subsaharienne ? L'essentiel de cette action<br />
devait revenir à l'U.R.S.S. en tant "qu'avant-garde de la lutte<br />
prolétarienne". L'internationalisme ambigu et le nationalisme intérieur ont<br />
donc oblitéré les discours communistes sur l'Afrique subsaharienne.
-114-<br />
C<strong>HA</strong>PITRE II<br />
LES GRANDES MUTATIONS AU SEIN DE LA<br />
GAUCHE <strong>FR</strong>ANCAISE ET LEURS IMPACTS SUR<br />
L'ELABORATION D'UNE THEORIE DES RELATIONS<br />
<strong>FR</strong>ANCO-A<strong>FR</strong>ICAINES 1971 - 1981<br />
CAS DE <strong>L'A</strong><strong>FR</strong>IQUE SUBSA<strong>HA</strong>RIENNE
-115-<br />
Le paysage politique international a subi une nette évolution<br />
pendant les années soixante-dix.<br />
Plusieurs facteurs expliquent cette réalité. Relevons entre<br />
autres, la crise économique tant dans les pays du tiers-monde que dans<br />
les pays industrialisés et la revendication d'un nouvel ordre économique<br />
mondial. La nouvelle structure de la société internationale inséparable<br />
des préoccupations politiques internes ne fut pas sans influence sur les<br />
mutations politiques au niveau international. La restructuration de la<br />
Gauche française en 1971 modifia très sensiblement les règles du jeu en<br />
matière de politique interne et internationale.<br />
L'existence d'une théorie de Gauche sur les relations franco<br />
africaines à partir de 1971 s 'inscrit dans ce cadre et est l'objet de ce<br />
Chapitre Il :<br />
Les grandes mutations au sein de la Gauche française<br />
et leurs impacts sur l'élaboration d'une théorie<br />
des relations franco-africaines - 1971-1981<br />
Cas de l'Afrique subsabarienne<br />
A - Le nouveau parti socialiste français<br />
le système politique français<br />
B - Le PCF<br />
ou Constance ?<br />
nature et évolution dans<br />
Questions internes et orientations externes Evolution
-117-<br />
structuration du mouvement socialiste français en 1971 exigeait une<br />
concertation entre les anciennes composantes de la Gauche socialiste pour<br />
la conquête du pouvoir politique. Notre objectif n'est pas ici de prétendre<br />
faire une analyse exhaustive du Nouveau Parti socialiste (1). Il s'agit<br />
tout simplement de voir comment des groupes sociaux aux origines<br />
politiques diverses peuvent dans leur action commune concevoir un projet<br />
de politique interne et l'appliquer aux relations internationales. D'où la<br />
nécessité de faire apparaltre les axes centraux du nouveau parti sur les<br />
plans socio-économiques et politiques. Considérons d'abord les données<br />
sociologiques au sein du Parti (2). le Parti socialiste français, issu de<br />
la société industrielle est le parti des notables originaires de la SF 10<br />
et des classes moyennes. La société industrielle a donc imprimé au<br />
nouveau parti des traits sociologiques spécifiques. L'ascension des<br />
couches moyennes s'expliquerait par l'abondance sur le plan économique et<br />
le développement du phénomène bureaucratique. Ces classes moyennes<br />
dominent "le secteur tertiaire français". Il s'agit donc, dès sa naissance,<br />
d'un parti interclassiste avec une hégémonie nette des classes moyennes.<br />
Ce quine fut pas Gans impacts sur la nature de l'électorat socialiste et<br />
des militants. "Depuis Epinay, en effet, écrit Hugues Portelli en 1981, le<br />
recul des couches populaires et traditionnelles a été compensé par l'ir-<br />
résistible ascension des nouvelles classes moyetinee salariées... la base<br />
(1) Cf. entre autres:<br />
J. DROZ : "Le socialisme démocratique" A. Colin Paris - 1966 - 360 pages<br />
J. DEPREUX : "Renouvellement du socialisme"<br />
Calmann-Lévy Paris - 1966 - 212 pages<br />
S.C. KOLM : "Solutions socialistes à propos de la transitian socialiste"<br />
Ramsay Paris - 1978 - 495 pages<br />
R. SEDILWT : "Histoire du socialisme" - Guy Authier Paris - 1977 - 465 p.<br />
J. TOUC<strong>HA</strong>RD - op. cit: - pages 353-395<br />
H. PORTELLI - Op. cit.<br />
F. LAGUERRE - Mémoire cité - pages 22-32<br />
(2) Cf. Revue française- de Sciences politiques - N' 2 - avril 1978 . - "La<br />
-c- sociologiJa du Parti socialiste" - pages 201"':312
-118-<br />
du parti connaît une présence massive d'enseignants. Et surtout au sein du<br />
parti a entraîné un déplacement hiérarchique : désormais, les instituteurs<br />
ne sont plus que 40 Z de l'ensemble des enseignants socialistes (et 5 Z<br />
des effectifs> Les professevrs du secondaire et les enseignants du<br />
supérieur sont majoritaires" (1). Le Parti socialiste n'est donc pas un<br />
parti d'ouvriers, ce n'est pas un parti de masse.<br />
A la différence des militants protestants de la SFIO, ceux du<br />
nouveau parti socialiste sont des catholiques. L'intégration massive des<br />
catholiques au sein du PS en 1971, 1972 et 1973 a fourni BU Parti une<br />
grande partie de ses militants venus du PSU (2).<br />
Sur le plan politique, le nouveau parti présente une structure<br />
hétérogène car y cohabitent les militants di? la Convention des<br />
institutions républicaines élaborée en 1964, les militants issus de la<br />
Fédération de la branche démocratique créée en 1965, les notables de la<br />
SFIO et à partir de 1974 quelques militants du PSU (3).<br />
Créée par 275 délégués d'une cinquantaine de c Iubs, la<br />
Convention des Institutions Républicaines (CIR) regroupait des chrétiens,<br />
des laïques, des marxistes et des radicaux. Il s'agissait donc de<br />
rassembler les républicains; opposés aux inst1tutions de la Ve République.<br />
En ce qui concerne la Fédération de la Gauche Démocratique et Socialiste<br />
(F.G.D.S.) l'ambition électorale l'emportait sur une réelle structuration<br />
politique durable . "...Cette fédération, pur cartel électoral qui conclura<br />
(1) Hugues PORTELLI - op. cit. - page 125<br />
(2) Ibid - page 131<br />
(.3) Confert: Les dossiers de l'Histoire - PARIS - Janvier-Février 1978<br />
Hugues PORTELLI - op. cH. -Pp 143-150
-119-<br />
une alliance avec le Parti communiste pour les législatives de 1967, est<br />
bien modérée : son idéologie est encore marquée par la IVe République et<br />
ses conceptions en matière internationale sont nettemant li droite du<br />
Gaullisme" (1).<br />
Le nouveau parti n'a pas une base syndicale. La marginalisation<br />
des classes populaires renforça la position des intellectuels. Ce qui a<br />
entraîné un "embourgeoisement" de l'appareil politique tout entier. La<br />
question culturelle au sein du Parti est liée à cette réalité sociologique.<br />
Car la culture dominante est celle des couches intellectuelles. "Les cadres<br />
politiques constituent au sein du PS une véri ta b1e aristocratie<br />
sociale" (2). L'adhésion des militants chrétiens n'a pas profondément<br />
modifié cette tendance. Cette adhésion s'explique politiquement par<br />
plusieurs facteurs. Les années soixante se caractérisent aussi par la<br />
réalité d'une nouvelle relation entre les chrétiens et les communistes. La<br />
conception marxiste de l'évolution sociale rencontre par conséquent les<br />
valeurs humanistes du christianisme. La culture marxiste se substitua<br />
dans une certaine mesure à la culture catholique traditionnelle. Deux<br />
autres phénomènes ont largement contribué à l'intégration des chrétiens<br />
au sein du PS. Il s'agit d'une part, des conséquences du mouvement social<br />
de Mai 1968 en France et de la réalité d'un discours tiers-mondiste et,<br />
d'autre part, du pluralisme économique, politique et sociologique qui<br />
s'exprime désormais au sein du Parti. le Parti est laïc du sommet à la<br />
base. Seul le courant rocardien fait exception à cette règle et ceci<br />
depuis les assises du socialisme en octobre 1974. Ainsi, l'adhésion<br />
massive des chrétiens n'a pas infléchi la nature de la vie politique du<br />
(1) Hugues PORTELLI - op. cit.<br />
(2) Hugues PORTELLI - op> c i t . page 127
liberté, la parfaite<br />
-[22-<br />
connaissance des dossiers économiques<br />
technologiques, le pluralisme politique ne font qu'un pour le socialisme<br />
démocrat Iq ue.<br />
b) le discours tdere-mmâiet:e<br />
DU la rupture par rapport: li la SFJO<br />
Le nouveau discours tiers-mondiste du Parti socialiste, sui te à<br />
la spécialisation de certains leaders, s'artic:ule autour des vieux thèmes<br />
du socialisme démocratique. Ces thèmes sont adaptés voire approfondis en<br />
raison de la nature particulière de la société internationale. Parm i ces<br />
thèmes on peut, ici, mettre l'accent sur la paix, la sécurité collective, le<br />
désarmement, la justice sociale politique et économique. Françofs<br />
Mitterrand lui--même les souligne très tôt. "POliT tout socialiste la<br />
conetruction de la paix est inséparable de la trilogie "arbitrage<br />
in ternetioneIrdeeernemen t e imuI tané et contrôlé-sécurité collecti ve" (1).<br />
L'équilibre international est rompu. L'effectivité des trois paramètres ci-<br />
dessus évoqués supposerait un ordre autre que celui négocié à Yalta au<br />
lendemain de la seconde guerre mondiale. Cet ordre est fondé, selon<br />
François Mitterrand, sur la primauté r-éc i pr-oque "de l'équilibre<br />
démocratique américain" et "1'autorité du Parti communiste russe" (2). Cet<br />
ordre de Yalta n'est pas corapatIbIe avec la paix et la liberté au sens<br />
que le socialisme démocratique attribue à ses concepts. La construction<br />
européenne sera i t le moyen le plus efficace pour l'instauration à l'échelle<br />
internationale d'un nouvel ordre de justice, de paix et de progrès<br />
économique. Le nouveau discours tiers-mondiste est indissociable de ces<br />
principes généraux. "Les difficultés du tiers-monde ne tiennent pas<br />
(l) François KITTERRAND - op. dt - page 297<br />
(2) Ibid »- page 301
-123-<br />
seulement aux conditions du développement économique, on s'en doute. H,lis<br />
si les pays industriels n'en prennent pas la mesure, ils ne seront plus<br />
eux-mémee et d'ici peu à 18 taille du péril"
-128-<br />
assistons, semble-t-il, II un retour éclatant aux droits de l'homme comme<br />
libertés. Ce qui paraît prioritaire, exigible absolument, ce sont les<br />
libertés personnelles fondamentales" (l) écrit Pierre Antoine.<br />
Le second paramètre essentiel du discours du nouveau Parti est<br />
l'Europe et son apport au niveau international. Là ce sont les mécanismes<br />
collectifs en matière de relations avec le tiers-monde qui saisissent<br />
l'attention. L'Europe, à travers les structures de la Communauté<br />
économique, peut jouer un rôle de premier plan dans le développement<br />
économique du tiers-monde. "L'Europe, "'u lieu de se perdre dans des<br />
querelles entre insulaires et continentaux, ne devrait-elle pas plutôt<br />
consolider son potentiel agricole dans le monde ? Et ceci non pour faire<br />
un moyen de chantage, mais pour disposer d'un instrument efficace de<br />
politique et de développement" (2). Les socialistes héritent ct 'une longue<br />
traditian européenne. La construction européenne a en effet longtemps<br />
préoccupé les précurseurs des socialistes français. Les réflexions sur la<br />
"réorganisation" de l'Europe, le concept "Etats-Unis d'Europe", la<br />
recherche sur le fédéralisme européen furent au centre des préoccupations<br />
socialistes dès le XIXe siècle (3). Le socialisme français a donc opté<br />
très tôt pour le fédéralisme européen. Ainsi, la Communauté Economique<br />
Européenne et ses mécanismes de fonctionnement offrent aux socialistes un<br />
cadre idéal pour la conception et la défense de leur discours tiers-<br />
mondiste. Les différentes conventions de Lomé, nous y reviendrons 1 ne<br />
feront que renforcer cette tendance (4). Claude Cheysson et bien d'autres<br />
responsables socialistes vont progressivement faire de la Commission des<br />
(1) Pierre ANTOINE : Retour aux libertés - In Projet 151 - 1981 - P.76<br />
(2) Claude CHEYSSON : L'Europe face au désordre alimentaire mondial<br />
In Politique internationale n' 3-1979 - page 64<br />
(3) Cf. Régis DEBRAY - op. c i t . - page 62<br />
(4) Cf. Abdoulaye DIARRA - Thèse citée - Pages 53-66
-129-<br />
Communautés européennes un instrument privilégié de dialogue avec le<br />
tiers-monde. L'accent sera mis sur le désordre alimentaire mondial et la<br />
nécessisté pour l'Europe d 'y faire face par le moyen d'une coopération<br />
mieux adaptée avec l'ensemble du tiers-monde. Le nouvel ordre alimentaire<br />
mondial est à ce prix. Car l 'agriculture reste, selon les socialistes, plus<br />
que jamais la base du développement économique et social des Etats du<br />
tiers-monde en général et ceux du continent africain en particulier.<br />
L'articulation d'un tel projet et souvent sa mise en application constitue<br />
une novation par rapport aux silences de la SFIO en la matière. "C'est une<br />
évidence que de répéter que tout modèle de développement est lié él la<br />
place essentielle et t'ondemen teIe de l'agriculture. Elle est fondamentale<br />
car c'est dans le monde rural qu'existe la réalité des peuples. C'est là.<br />
que les peuples se sont formés, qu'ils ont défini leurs cultures, qu'ils<br />
ont structuré leurs sociétés... C'est dans le monde rural que se trouve<br />
l'essentiel de l'emploi pour les pays du tiers-monde, un emploi qu'il faut<br />
tenter de stabiliser pour éviter ou retarder les excès d'urbanisation.<br />
C'est une évidence d'a.ffirmer que le monde rural est BU centre de la<br />
survie et du développement du tiers-monde" (l). Il s'agit là, au-delà de<br />
la pure description des faits, d'un modèle de développement proposé au<br />
tiers-monde. Car la promotion de l'agriculture c'est aussi et surtout la<br />
lutte contre l'exode rural et le maintien des populations sur leurs<br />
terres peut favoriser l'épanouissement culturel. Le développement de<br />
l'agriculture est donc une des canditians du développement culturel. Kais<br />
l'action européenne dans ce domaine n'est possible sans une remise en<br />
cause des structures internes aux Etats du tiers-monde, structures<br />
souvent imposées de l'extérieur et entretenues pour diverses raisons à<br />
l'intérieur. Le modèle ainsi proposé en tant que modèle politique de<br />
(l)Claud? CHEYSSON - op_. cft , -pages 56-57
-130-<br />
développement s'inscrit au sein d'une vision générale de l'évolution des<br />
sociétés. Cette vision est celle du socialisme démocratique. .Michel Rocard<br />
n'en dit pas moins lorsqu'il écri t "Le tiers-monde tout entier aspire à<br />
un développement plus euioceiitré, moins âépetuissi t des modèles de<br />
coneonme i ion, de production et de technologie de l'occident. Il commence à<br />
récuser les choix économiques et/ou technologiques qui lui sont imposés<br />
per les formes d'aide des occidentaux, et aggravent sa dépendance. De plus<br />
en plus, les pays du tiers-monde cherchent .:i mettre en commun leur force<br />
pour augmenter leur autonomie. Cette tendélnce, qui se marque par le pacte<br />
andin ou le marché commun de l'Afrique de l'Ouest doit être encouragée :<br />
elle peut être un contre-poids efficace à la pression des multinationales.<br />
Et naturellement, l'Europe aussi 8 vocation à €.ltre une zone de<br />
coâéveloppement:" Cl). Le système capitaliste n'est donc pas apte à<br />
concevoir une coopération planifiée capable d'autonomiser les Etats du<br />
tiers-monde. En outre, l'Europe doit élider les Etats du tiers-monde pour<br />
la structuration et la consolidation de la coopération Sud-Sud<br />
coopération qui reste l'un des moyens les plus efficaces d'indépendance<br />
par rapport aux puissances économiques et financières internationales. La<br />
lutte contre les effets pervers des multinationales dans le tiers-monde<br />
est donc devenu une réalité dans les discours socialistes. La communauté<br />
doit, pour contribuer à vaincre la faim, orienter et organiser l'aide<br />
autrement. Les socialistes, souligne Claude Cheysson, ont pour mission,<br />
conformément à la tradition, de lutter contre la misère, la faim dans le<br />
monde. Une Europe solidaire avec le tiers-monde aiderait<br />
l'accomplissement de cette mission. Encore Claude Cheysson "Les<br />
recherchee ne suffisent pas Il faut disposer de vulgarisateurs, d 'bcmmee<br />
de terrain. La génération de l'époque coloniale est éteinte. Les pays<br />
,<br />
(1) Michel ROCARD - In Faire - op. cit. page 35
-13i-<br />
européens n'ont plus les responsabilités directes d'autrefois." Notre<br />
effort de coopération urternstilonsle sur ce plan doit aller eensiblement:<br />
au-delà du cadre européen"
-133-<br />
internationale encore moins de la politique franco-africa.ine. Pour<br />
l'essentiel, il a maintenu l'héritage dans ce dernier domaine. "Comme<br />
Président de la République, Georges Pompidou suit l'exemple de son<br />
prédécesseur Le politique extérieure est de son domaine"
-134-<br />
juin 1977. Cette conférence, largement soutenue par le Président, regroupa<br />
les représentants de 26 pays et de la CEE. Le thème du "Nouvel Ordre<br />
économique international" devient le pivot du discours officiel sur les<br />
relations Nord-Sud avant de diparaitre progressivement à la fin du<br />
septennat et ceci à cause de l'insuccès constaté. En matière d'aide au<br />
développement l'action française est surtout bilatérale. "Environ 7 des<br />
10 milliards de Francs de l'aide publique française ressortissent de<br />
relations bilatérales. Sur ces 7 milliards. 4.3 vont aux pa.ys de l'Afrique<br />
subsabarienne" (l). On comprend dès lors que le mondialisme n'a pas été<br />
confirmé par les faits. Le troisième président est aussi l'initiateur des<br />
"sommets franco-africains" qu'il institutionalise. Ces sommets sont,<br />
depuis, annuels et se tiennent alternativement à Paris ou en Afrique. A la<br />
différence de ses prédécesseurs 1 Valéry Giscard d'Estaing va nouer avec<br />
certains chefs d'Etat africains des relations particulières et<br />
personnelles. Il finança le couronnement de Bokassa le
-142-<br />
telle est la leçon de la vie en toutes choses. Un socialiste pensera que<br />
la fonction de 1 'homme, j'allais écrire sa noblesse, est au contraire, de<br />
refuser "le cours des choses", de partir à la recherche des chemins de<br />
sa liberté, d'inventer le monde où il s'épanouira et d'organiser la<br />
Société"
-145-<br />
coopération et l'échec des politiques en la matière dans plus d'un<br />
domaine. C'est la première dimension. <strong>L'A</strong>frique au sud du Sahara, partie<br />
essentielle du' tiers-monde, se caractérise spécialement par une série<br />
fondamentale de crises crise écologique
-146-<br />
politique, culturel et militaire. La défense de chacun de ces intérêts<br />
procure à la France une place de premier plan sur la scène internationale.<br />
Les instruments pour la conservation et l'extension de ces intérêts furent<br />
structurés, on l'a vu, depuis l'époque coloniale.<br />
Selon les Socialistes, la politique de Giscard d'Estaing<br />
relevait d'un "conservetieme politique et économique, associé à une<br />
stratégie d'expansion élu-delà de l'aire d'influence traditionnelle,<br />
facilitée un temps par le désintérêt relatif des autres puissances<br />
occidentales"
-147-<br />
conservation des liens solides avec le régime raciste sud-africain et<br />
tentative d'établir avec les pays foncièrement opposés au système raciste<br />
d'Afrique du Sud une relation politique, etc... Cette politique "s ca ndaleu-<br />
se, dangereuse, et archaïque" a terni l'image de la France et réduit consi-<br />
dérablement son apport en matière de développement économique des pays<br />
subsahariens. Les moyens diffus de cette politique expliquent, selon les<br />
socialistes, les finalités de type néo-colonial qui se résument ainsi (1):<br />
" - la restructuration des intérêts économiques français en Afrique,<br />
sous l'égide des grands groupes financiers comme Suez et Paribas :<br />
- l'abandon, ou la mise en sommeil, par les firmes, des activités<br />
directement productives, méme dans l'industrie, et il un moindre degré les<br />
mines, au profit d'activités plus lucratives, en amont (l'ingeneering,<br />
fourniture d'usines) et en aval (transports, services). Bref, on met en<br />
avant le taux des bénéfices et non le développement: :<br />
- l'évolution très sensible des fonctions de La "coopération" :<br />
Certes, elle concerne une façade tiraâi t iontiell e d'aide publique au<br />
développement et à la formation, mais cela, destiné à maintenir un climat<br />
de relation, et, à la limite, à donner quelques aumônes, cède de plus en<br />
plus le pas à un appui aux intérêts privés. Le FAe 11 autourd'hui sensible-<br />
meut mains d'im,Qortance que la Caisse centrale de coopération écoDOI1Jique,<br />
qui toue le rôle de poisson-pilote et de financier pour 1% opérations au<br />
bénéfice des firmes privées. L'esprit mercantile a pris totalement le pas<br />
sur le souci des intérêts IDa ieurs des peuples africains et les "opérations<br />
- Niveau sectoriel<br />
-152-<br />
projet pour la valorisation "des matières premières 10-<br />
cales" notamment agricoles<br />
Industries de transformation plus "évolutives" diversi-<br />
fiées "et d'innovations vérifiées.<br />
- 1Uveau structurel :<br />
. Transfert de technologie pour une meilleure politique<br />
d'investissement... "Les contrats d'assistance technique" serviront à<br />
assurer leur viabilité à long terme tant dans les domaines de l 'appr-ovt-<br />
sionnement que dans celui de la gestion, de l'exploitation de la<br />
commercialisation et de la formation et "garantissant les droits et<br />
obligations entre partenaires" j<br />
des joint-venture: "participation en capital, qui<br />
renforceront les disponibilités en capitaux propres des projets et la<br />
responsabilité du partenaire extérieur dans les pays d'accueil à économie<br />
libérale"<br />
un système financier cohérent...<br />
des investissements à "rentabilité satisfaisante"<br />
priorité aux petites et moyennes entreprises Cl).<br />
En matière de coopération socio-culturelle, une nouvelle<br />
politique mettra l'accent sur la promotion de la femme, son rôle dans le<br />
développement économique et social d'une part et ct 'autre part sur la<br />
rénovation culturelle. La langue ne doit plus servir d'instrument de<br />
"domination et ct 'impérialisme" mais de communication mutuelle et dont le<br />
choix incombera désormais aux Etats africains (2).<br />
(1) Ibid - page 33<br />
(2)- Ibid e: page 33
-153-<br />
Le Parti socialiste entretient des rapports politiques avec<br />
d'autres formations ou mouvements politique à travers le monde. Il n'est<br />
donc pas sans intérêt de s'interroger ici sur le cas précis des<br />
partenaires africains du PS.<br />
b) les parteoairee africains du Parti socialiste<br />
Le soutien des mouvements de libération nationale au nom des<br />
d.roits de l'homme, est une donnée très ancienne dans les discours<br />
socialistes sur les relations internationales. Les socialistes condamnent<br />
la ségrégation raciale en Afrique du Sud et reconnaissent le bien-fondé<br />
de la lutte que mène l'A.» .C. Nous y reviendrons. Cette même vision est<br />
appliquée en Afrique du Nord-Est au nom du droit des minorités en<br />
Ethiopie. La fonction officielle du parti tranche ici avec l'ambigulté<br />
d'antan. "Le parti socialiste, qui reconnaît le fait ne i ional érythréen et<br />
le droit de ce peuple .à Peiitodét.ernitiation, entretient des rapports<br />
amicaux et suivis avec le FPLE
-154-<br />
discours selon lequel le monde reste divisé en bIocs impérialiste et non<br />
impérialiste. Néanmoins, le soutien aux mouvements de libération nationale<br />
sous-tend la nécessité de mettre en place des régimes politiques<br />
respectueux des droits occidentaux de l 'homme. Il s'agit donc ct 'aider les<br />
mouvements ou organisations dans leur lutte cantre le capitalisme d'état<br />
et le socialisme version soviétique. L'impérialisme est un concept pluriel.<br />
Les "impérialismes A américain et soviétique, du moins dans leur<br />
manifestation dans les pays du tiers-monde, ne permettent ni la<br />
reconnaissance des droits de l'homme ni leur rspect. Le Parti socialiste<br />
français reconnaît le mouvement de résistance populaire de la République<br />
centrafricaine, mouvement modéré et opposé au système politique<br />
gabonnais. Le Parti entretient également des rapports avec le mouvement<br />
de redressement national du Gabon.<br />
Le nouvel internationalisme du PS veut que le Parti accorde son<br />
soutien à tous les mouvements populaires qui luttent contre les dictatures<br />
de toute nature. If... Notre soutien inconditionnel aux luttes d'indépendance<br />
nationale ne peut aujourd'bui éluder toute référence BUX structures eocio<br />
politiques dont elles sont porteuses et aux menaces de dictature ou de<br />
totalitarisme qu'elles peuvent révéler" (1) déclare Michel Rocard. Il<br />
s'agit non plus de maintenir des relations politiques avec les Etats mais<br />
de concevoir de nouveaux rapports avec les composantes des sociétés,<br />
c'est-A-dire l'ensemble des forces démocratiques telles que l/?s<br />
collectivités territoriales, les mouvements associatifs etc... "...
-157-<br />
B -. LE PeF - ORIENTATIONS EXTERNES : EVOLUTION OU CONSTANCE?<br />
La création du Parti Socialiste français, l'évolution des<br />
institutions de la Ve République, la crise internationale des années<br />
soixante-dix ne furent pas sans conséquences sur les orientations<br />
internes et externes du Parti Communiste Français. Sur le plan européen le<br />
dialogue entre, partis communistes d'Europe occidentale Œur-ocoramun Ls.meï<br />
constitue aussi un axe de réflexion sur les orientations internationales<br />
du Parti Communiste Français. La coopération internationale s'inscrit<br />
dans cette réalité de la société internationale. C'est pourquoi nous nous<br />
proposons d'abord de nous interroger sur la lecture des relations inter-<br />
nationales du PCF en essayant ensuite de mettre un accent particulier SUT<br />
les effets de la stratégie unitaire
-160-<br />
le soutien constant qu'il apporte aux regimes les plus dictatoriaux dans<br />
le monde"
-161-<br />
allemande, pour la réalisation des accords. Selon le Parti C.ommuniste<br />
Français, l'intégration des pays africains dans les mécanismes de la<br />
Communauté Economique Européenne est une stratégie conforme à la vision<br />
social-démocrate . des relations internationales Cici, il s'agit, bien<br />
entendu, de la social-démocratie européenne (1).<br />
Partant de cette lecture des accords de Lomé, le Parti<br />
communiste français adopte une attitude critique à l'égard de La<br />
Convention et de son évolution. L'accent est rois sur les insuffisances des<br />
deux accords (Lomé I et Lomé II) tant au niveau des structures qu'au<br />
niveau d., leur fonctionnement. Selon les Communistes, les accords n'ont<br />
pas empêché la détérioration des termes de l'échange et les échanges<br />
commerciaux entre les ACP et la CEE ont régressé au détriment des<br />
premiers. La part de la CEE dans les importations des pays ACP aurait<br />
augmenté de 5,5 % en 1973 à 7,3 % en 1978, tandis qu'au même moment la<br />
proportion des produits ACP drainés vers le marché communautaire a chuté<br />
de 7,4 % A 6,7 %. Quant à l'aide financière de la CEE, elle est passée,<br />
selon les communistes, de 3 466 millions à 5 607 millions d'unités de<br />
compte tandis qu'en 1975, la demande des Etats ACP était de l'ordre de<br />
BOO millions d'unités de compte (2). L86 communistes concluent que les<br />
accords CEE/ACP restent non contraires à l'intérêt des entreprises multi-<br />
nationales.<br />
Que propose le PCF ? Le nouvel internationalisme, à la<br />
différence des autres, fait ressortir trois axes principaux: L'Lnda-<br />
(l) Intervention de Françoise CREPEL - L'impérialisme français d'aujourd'hui<br />
- page 135<br />
(2) Robert MONTDARGENT : Séance parlementaire du 21 mai 1980
-164-<br />
communiste, se situe aussi à l'antipode des méthodes jusque là pratiquées.<br />
L'application de cette orientation nouvelle en m.;üière de<br />
coopération est subordonnée à l'acquisition du pouvoir et à son exercJ.ce.<br />
Les communistes<br />
théorie ?<br />
ont-ils les moyens de mettre en application cette<br />
2· L'impact de la stratégie unitaire<br />
gouvernement<br />
le programme commun de<br />
L'élection du Président de la République au suffrage universel<br />
direct, l'intégration des partis aux moeurs de la IVe république, la<br />
bipolarisation, certes relative, mais bien réelle de la classe politique en<br />
dernière instance lors des élections présidentielles sont, parmi tant<br />
d'autres, des paramétres qui exigeaient et exigent encore le regroupement<br />
communistes et socialistes (1). Au-delà de l 'ambition d'exercer le pouvoir<br />
politique, le Parti socialiste comporte des courants de pensée favorables<br />
à cette union. Au niveau socialiste, les raisons de cette union sont<br />
surtout stratégiques faciliter l'accès de la Gauche au pouvoir et<br />
contenir l'expansion du communisme. Au niveau communiste, la programme<br />
commun devait conduire à une série de conséquences parmi lesquelles<br />
l'ancrage des socialistes à gauche et la part i jci patIon à l'exercice du<br />
pouvoir en cas de victoire. Le relatif changement interne au sein du ?CF<br />
(fin des années 60 , début des années 70) rendait possible le<br />
regroupement. On peut citer d'abord la déstabilisation progressive du PCF,<br />
l'abandon de la dictature du prolétariat et ensuite le discours unitaire<br />
désormais soutenu par le PCF. Les raisons de l'Union sont donc fondamen-<br />
(l) Cf. Catherine NAY - Le noir et le rouge ou l'histoire d'une ambition<br />
Grasset et Fasquelle - Paris - Pp 356-370 : l'Alliance avec le diable
-168-<br />
3' Les partenaires africains du PeF<br />
Les rapports que le PCF entretient avec ses partenaires a<br />
travers le monde entier, partenaires au pouvoir 1 dans l 'opposition légale<br />
ou dans la clandestinité, sont fondés, selon le PCF, sur le concept<br />
politique de solidarité internationale ; la solidarité internationale à la<br />
différence de l'internationalisme prolétarien d'avant 1976, veut dire une<br />
politique autonome à l'égard des partenaires internationaux mais conforme<br />
à la théorie selon laquelle la lutte des classes est internationale. Au-<br />
delà de l'indépendance affichée par rapport à l'URSS dans ce domaine. Le<br />
peF obéit à une orthodoxie en la matière, "Notre parti iei t: preuve d'un<br />
internationalisme qui lui est quasiment congénital" (l). La lutte contre le<br />
Capitalisme Monopoliste d'Etats
-169-<br />
mouvements de libération en lutte contre le colonialisme et le racisme<br />
sont des partenaires de premier plan selon le PCF. En outre la solidarité<br />
internationale exigerait dans une large mesure le soutien des actions<br />
internationales de "paix, de progrès et pour le socialisme" entreprises<br />
par les pays socialistes donc par l'URSS. "... la lutte des classes est<br />
mondiale. Dans cette lutte, les pays eocie l istes jouent un rôle essentiel.<br />
Par leur poids et leur influence dans le monde, ils empêchent les teuteore<br />
de guerre de recourir à l'aventure nucléaire. Ils ont imposé, non sans mal,<br />
que s'instaurent dans les relations itit.erne t ituiel ee des rapports de co-<br />
existence pacifique. Ils constituent donc une gartwtie pour la paix..;" (1).<br />
Dans ces conditions, les partenaires des uns sont et doivent demeurer<br />
les partenaires des autres. Le combat est commun à l'échelle mondiale.<br />
Parm i les partenaires africains (2) de l'Afrique suhsaharienne, du<br />
moins ceux qui ont officiellement participé au XX IVe congrès du peF, on<br />
peut citer :<br />
- M.P.L.A., Parti du travail d'Angola<br />
- African National Congress (Afrique du Sud)<br />
- Parti de la révolution du peuple du Bénin<br />
- Front patriotique Oubanguien - Parti du travail de<br />
Centrafrique<br />
- Parti congolais du travail<br />
- Comité d'organisation du Parti des travailleurs d'Ethiopie<br />
- Parti démocratique de Guinée-Bissau et du Cap-Vert<br />
- Parti démocratique de Guinée<br />
- Front national de défense de la révolution de Madagascar<br />
(1) Ibid - pages 69-70<br />
(2) Cea : mouvements, par-t i e , organisations, fronts sont soit au pouvoir,<br />
soit dansr l'opposition légale ou dans la clandestinité "
-170-<br />
- Front malien de la révolution et de la démocratie<br />
- Front de libèration du Mozambique (<strong>FR</strong>ELIMOJ<br />
- Mouvement de Libération de la Namibie (SWAPO)<br />
- Parti socialiste du peuple travailleur du Nigeria<br />
- Front Polisario (Sahara occidental)<br />
- Parti de l'Indépendance et du travail du Sénégal<br />
- Front de Hbération nationale du Tchad
-171-<br />
Deu:x::lèxne pa.:rt:le<br />
LA GAUCHE <strong>FR</strong>ANCAISE AU POUVOIR<br />
ET L"HERITAGE DE LA Vs REPUBLIQUE
-173-<br />
La Gauche au pouvoir n'a-t-elle pas ici les moyens ct 'appliquer<br />
une politique franco-africaine conforme à son projet ? Cette question,<br />
sans nul doute, en appelle bien d'autres qu'il convient maintenant de<br />
mettre en relief. Le projet, on le sait, est un moyen de combat politique,<br />
l'application d'un programme est le plus souvent fonction de plusieurs<br />
paramètres parmi lesquels les circonstances, c'est-à-dire l'imprévu ou<br />
l'imprévisible, l'héritage, etc...<br />
Ainsi, notre deuxième partie<br />
LA GAUCHE AU POUVOIR<br />
lIT L'HERITAGE DE LA Ve REPUBLIQUE<br />
s'articulera autour de deux axes fondamentaux<br />
Chapitre l L'Héritage de la Ve République et la politique m.ilitaire<br />
de la Gauche française en Afrique subsaharienne.<br />
Chapitre II La pratique de la Coopération de Jean-Pierre Cot à<br />
Guy Penne.
-174-<br />
C<strong>HA</strong>PITRE 1<br />
L'HERITAGE DE LA Ve REPUBLIQUE<br />
ET LA POLITIQUE MILITAIRE<br />
DE LA GAUCHE <strong>FR</strong>ANCAISE<br />
EN A<strong>FR</strong>IQUE SUBSA<strong>HA</strong>RIENNE
-175-<br />
La politique internationale française de 1945 à 1981 fut conçue<br />
et appliquée en conformité avec une certaine logique et une vision<br />
philosophique des relations internationales. La constance s'expliquerait<br />
par l'adhésion plus ou moins unanime des divers gouvernements qui se sont<br />
succédés à une ou à des théories des relations internationales. Il n'est<br />
pas question ici d'analyser ces théories en tant que fondements d'une<br />
politique étrangère. Tel n'est pas notre sujet. Cependant, il nous semble<br />
essentiel de faire apparaître ici quelques traits généraux afin de mieux<br />
situer notre interrogation relative à la gestion autre d'un héritage pour<br />
le moins solide. La France est une puissance et elle a même une politique<br />
de puissance à travers le monde. Elle fait partie du Conseil de sécurité.<br />
Or, qu'est-ce que la puissance '? "J'appelle puissance sur la scène<br />
internationale la capacité d'une unité politique d'imposer sa volonté<br />
politique aux autres unités" Cl) écrit Raymond ARON. Cette imposition<br />
s'est faite traditionnellement par les armes. L'héritage de la Ve Répu-<br />
bUque en matière de coopération comporte la présence militaire de la<br />
France en Afrique. Mais la puissance n'est pas seulement liée à la force<br />
des armes. Elle est aujourd'hui liée, entre autres, à la présence<br />
économique et à la préservation des intérêts économiques d'un pays dans<br />
un autre ou dans d'autres. "De tous temps, le progrès de ses armes a servi<br />
el la domination de l'homme sur 1 'homme. Kais le monde est entré dans une<br />
ère nouvelle : en ce domaine, un véritable bond qualitatif a bouleversé<br />
l'échelle traditionnelle de la puissance en remplaçant le facteur de force<br />
déduit du nombre de la population et des armées mobilisables par celui du<br />
potentiel technique fondé sur la prospérité économique et l'innovation<br />
scientifique" (2). La puissance est liée aussi aujourd'hui à la présence<br />
(1) Raymond ARON - Paix et guerre entre nations - Calmann-Lévy 1962-P.58<br />
(2) Alain PLANTEY : "Diplomatie et Ar:mements" In Défense nationale<br />
Mars ,1984 z: Paris -Pp 31-50 - Pàge 3'1-'
-183-<br />
le rayonnement de la France à travers le monde. La France Ngénéreusç;:" a.<br />
une mission civilisatrice à accomplir en Afrique. De cette politique<br />
dépend la place de la France sur la scène internationale. Cette po littque<br />
africB.ine gaulliste a germé depuis 1940. La France est occupée et l'Afri-<br />
que devait servir de point central pour "une légitiJl1ité de 1.9 France<br />
sans référence à Vichy" (l). Les raisons stratégiques se situent, d'une<br />
part, au niveau de la fourniture des matières premières; et d'autre part,<br />
l'Afrique a servi de réservoir de combattants . Au<br />
moment des indépendances massives des années 60, cette vision est<br />
articulée autrement autour des même:::; objectifs mais l'axe central est<br />
resté le même. La France se devait d'affirmer vaille que vaille sa<br />
présence en Afrique afin de placer ce continent hors des convoitises des<br />
deux puissances. "LE fondemen t conceptuel de toute coopéra t ion française<br />
avec J'Afrique est désormais posé, il ne variera guère jusqu'a nos jours :<br />
la France se doit d'établir des liens aussi denses que possible avec ses<br />
anciennes colonies ; c'est son tritérët. sur la scène internationale et, si<br />
elle y renonce, l'un des deux super-grands s'engouffrera dans le vide<br />
provoqué" (2).<br />
Il n'y a pas de communauté économique viable sans une<br />
communauté de défense. Les deux vont généralement ensemble, Le problème<br />
est nettement posé dès le 7 janvier 1959. "L'armée chargée de la défense<br />
de la communauté est une. Elle est placée sous une organisation unique de<br />
commandement:" (3). La défense des intérêts économiques n'est possible<br />
sans une même conception franco-africaine sur le plan mil!taire français.<br />
La structure du "Comité de défense" créé au niveau de chaque état<br />
(1l Pascal C<strong>HA</strong>IGNEAU - op. cit. page 19<br />
(2) Ibid - page 20<br />
(3) H. VE,ILLY - cité par Pascal C<strong>HA</strong>IGNEAU - op. cit. - page 21
-185-<br />
L'intégration institutionnelle se fera progressivement par<br />
négociations (1). C'est ainsi qu'est née l'Union africaine et malgache<br />
(U.A.M.) sous forme de "pacte" liant près de 12 Etats membres et<br />
comprenant :<br />
- un Conseil dirigé par la Conférence des Chefs d'état,<br />
- un Etat-major commun,<br />
- un Secrétariat avec siège à Ouagadougou.<br />
A cette structure technique s'est substituée une politique<br />
commune de formation
-186-<br />
Quant aux accords de défense, leur champ d'application renforce<br />
la position française Cl) 0 La défense extérieure est généralement assurée<br />
par la .France. De plus, l'ambigulté des concepts et leur interprétation<br />
donne libre cours à toute stratégie qu'impose la circonstance ; d'où la<br />
signature des conventions spéciales et secrètes entre la France et ses<br />
partenaires africains. Deux domaines d'intervention sont, ici, précisés :<br />
les conventions relatives à la défense extérieure et celles concernant la<br />
défense intérieure nommées "Conventions en matière de maintien de<br />
l'ordre". Ce qui conduit au constat suivant : "Le Gouvernement français a,<br />
dès lors, les mains libres pour une protection militaire de régimes amis<br />
menacés par l'extérieur ou méme par UDe opposition intérieure dont il sera<br />
toujours possible d'évoquer ses ramifications ou ses soutiens il<br />
l'étranger" (2). La renégociation des accords n'entamera pas l'orientation<br />
générale de la politique militaire en Afrique subsaharienne. Aucune<br />
particularité ne modifiera son sens. Le réaménagement suivra néanmoins le<br />
cheminement suivant :<br />
- Maintien du système de 1960<br />
Volta, Gabon i<br />
Centre-Afrique, Côte d'Ivoire, Haute-<br />
- Maintien du système de 1960 et légère réforme Sénégal (accord du<br />
29 mars 1974)<br />
- Etats soucieux du renforcement de leurs droits souverains par<br />
l'abandon du concept même -d'aocord de défense" (coopération et non<br />
défense) :<br />
Cl) Ibid - page 28<br />
(2) Ibidv-: page- 28<br />
Madagascar C4 juin 1973),<br />
Le Congo Cler janvier 1974),<br />
Le Cameroun C21 février 1974),
-187-<br />
Le Bénin (27 février 1975),<br />
Le Tchad (accord de coopération militaire et convention de<br />
soutien logistique: 6 mars et 19 juin 1976),<br />
Le Togo (23 mars 1976),<br />
La Mauritanie (2 septembre 1976),<br />
Le Niger (19 février 1977 : accord de coopération et soutien<br />
logistique "prioritaire des forces armées françaises".<br />
En plus de la zone traditionnellement française, la France va étendre<br />
son influence au Zaïre, au Burundi et au Rwanda :<br />
. Zaïre : accord de coopération militaire et technique<br />
(Kai 1974)<br />
Rwanda (juillet 1973),<br />
Burundi (7 octobre 1969) accord de défense et "échanges de<br />
lettres" en 1974.<br />
L'assistance militaire quelles que soient ses formes et quel<br />
que soit le pays maintient l'influence française face aux deux grands.<br />
<strong>L'A</strong>frique est aussi le continent où s'acheminent les armements.<br />
Les pays africains ont considérablement gonflé leurs dépenses en<br />
armements. En 1983, l'Afrique occupait le 2e rang parmi les pays du<br />
tiers-monde en matière d'importation d'armements (1). Nous y reviendrons.<br />
Le nombre de conseillers militaires en Afrique ne cesse de croître.<br />
-190-<br />
grsiiâe desseins. Dans le monde d 'aujourd 'hui, quelle plus haute exigence<br />
pour notre tiempe que de réaliser la. nouvelle alliance du socialisme<br />
et de la liberté, quelle plus belle ambition que l'offrir au monde de<br />
demain ?" (l). L'affirmation reprend la formule du Général de Gaulle. "La<br />
France, parce qu'elle le peut, parce que tout l'y in vite, parce qu'elle est<br />
la France, doit mener au milieu du monde une politique qui soit mon-<br />
diele" (2). L'identité de vue ne fait guère de doute. La France, partout<br />
dans le monde, se doit d'affirmer sa puissance en défendant<br />
systématiquement ses intérêts vitaux. D'ailleurs, la conception de<br />
François Mitterrand, quatrième président de la Ve République ne présente<br />
pas d'ambiguIté en ce qui concerne l'action militaire française en Afrique.<br />
C'est là que la France puise les sources essentielles de sa puissance à<br />
travers le monde. La France dans le monde n'est possible sans la France<br />
en Afrique. Il s'agit d'une nécessité historique et d'un impératif pour<br />
l'avenir de la nation française. La conservation de l'acquis et la<br />
recherche d'autres alliances sur le plan militaire s 'expliquent par cette<br />
logique incontournable selon le pouvoir socialiste. Allier le socialisme à<br />
la liberté est le souhait. La réalité des faits imposerait la permanence<br />
de la doctrine militaire en Afrique. Le pré-carré (l'Afrique francophone)<br />
devient plus que jamais le centre pour la défense de la sécurité française<br />
du moins dans plus d'un domaine. François Mitterrand écrit "Je me<br />
réjouis de ce que, sur notre planète rétrécie, s'élargisse le champ du<br />
contrat. Nais il est des domaines non négligeables, un pré-carré dont je<br />
revendique, lorsqu'il est empiété, qu'il soit reconnu et rendu à la France.<br />
Dans ce pré-carré, je distingue en premier notre langue, notre industrie<br />
et notre sécurité, qui sont autant de fronts où garder nos défenses sans<br />
(1) François MITTERRAND - Réflexion sur la politique extérieure de la<br />
France - op. cit. - page 140<br />
(2) Charles de GAULLE - cité par R. LUCK<strong>HA</strong>M - op. cit. page 60
-193-<br />
- Sénégal 1 200<br />
- Gabon 500<br />
- Cameroun 60 environ<br />
- R. C. A. 1 100<br />
- Côte d'Ivoire 400<br />
Les conseillers militaires français à la même date, en poste en<br />
Afrique subsaharienne se répartissaient par pays comme suit<br />
- Djibouti 158 - Côte d'Ivoire 111<br />
- Gabon 132 - Sénégal 40<br />
- Cameroun 75 - R.C.A. 32<br />
- Togo 71 - Mauritanie 44<br />
-- Niger 63 - Bénin 0<br />
- Congo 8 - Madagascar 7<br />
- Mali 5 - Guinée 0<br />
- Burundi 17 - Rwanda 8<br />
- Haute-Volta - Zaïre 128<br />
Œurkina-Faso) 18<br />
RESIDENTS <strong>FR</strong>ANCAIS PAR PAYS<br />
- Djibouti 26 824 - Haute-Vol ta 3 782<br />
- Gabon 51 233 - Bénin 2 398<br />
- Côte ct'Ivoire 18 704 - Congo 5 863<br />
- Sénégal 16 052 - Madagascar 17 868<br />
- R.C.A. 3 856 - Mali 3 000<br />
- Niger 5 890 - Zaïre 5 233<br />
-195-<br />
tion ? Certainement. Nais encore le poids écrasant d'une longue<br />
tradition étatique. Un horizon bouché. L'incapacité de se défaire<br />
graduellement du pouvoir nouvellement acquis pour le transférer aux<br />
associations régionales, locales, aux syndicats, aux mouvements sociaux ..<br />
en bref, aux hommes" (l). Les conséquences de cette primauté de l'ancien<br />
sur le nouveau ont donc entraîné le maintien des structures néocoloniales,<br />
voire "impérialistes" en Afrique subsaharienne. Et ceci dans tous les<br />
domaines. Nous y reviendrons. Selon Jean-François Bayart, la présence<br />
française en Afrique subsaharienne a pris une dimension incontestablement<br />
nouvelle sous le pouvoir socialiste. Les zones ct 'influence traditionnelles<br />
furent non seulement maintenues mais progressivement étendues. Les liens<br />
dénoncés par le parti dans l'oppasitian furent consolidés par le pouvoir<br />
socialiste. La real-politique a prévalu. L'accent est, ici, mis sur le lien<br />
étroit entre la politique subsaharienne de la gauche et les anciennes<br />
pratiques du ministère de la France d 'Outre-mer de 1951. "On s'est gaussé,<br />
écrit Jean-François Bayart, de ce que Monsieur Nitterrand se soit placé<br />
dans la continuité de ses prédéceeeeure. Il serait plus juste de dire que<br />
ceux-ci ont assumé la voie que Monsieur Jt{itterrand avait ouverte en 1951,<br />
en détenant la rupture entre le Rassemblement démocratique africain et le<br />
Parti communiste français, et que Nonsieur Defferre avait entérinée en<br />
présentant sa loi-cadre de 1956. La vraie continuité est plus ancienne que<br />
ne le dit la Droite, elle va de Monsieur Xitterrand au Général de Gaulle<br />
et à ses successeurs" (2). Ainsi en matière de présence française en<br />
Afrique subsaharienne, la gauche au pouvoir n'a pas globalement appliqué<br />
une nouvelle politique. L'héritage a été maintenu, voire renforcé. <strong>L'A</strong>frique<br />
subsaharienne reste le théâtre de nombreux conflits "régionaux". La Gauche<br />
(1) Jean ZlEGLER - op. c i t . - page 42<br />
(2) Jean-'François BAYART - op. c i t , - page 52
-196-<br />
va également se confronter à de multiples dossiers dans ce domaine. Parmi<br />
ceux-ci le cas du Tchad occupe une place toute spécifique.<br />
2' La Gauche et les confl!ts régionaux : le cas du Tchad<br />
La guerre au Tchad a fait l'objet de multiples recherches et<br />
ceci dans tous les domaines. Nous nous limiterons donc, ici, à l'essentiel<br />
en mettant un accent particulier sur l'apport, au double sens du terme, de<br />
la Gauche au pouvoir depuis 1981. Mais pour mieux cerner les positions du<br />
pouvoir socialiste, un regard sur l 'histoire s'impose. Prenons d'abord les<br />
forces en présence au Tchad.<br />
- C.D.R. Conseil Démocratique et Révolutionnaire<br />
- F.A.N. Forces Armées du Nord<br />
- F.A.O. Forces Armées Occidentales<br />
- F.A.P. Forces Armées Populaires<br />
- F.A.T. Forces Armées Tchadiennes<br />
- M.P.L.T. : Mouvement Populaire pour la Libération du Tchad<br />
- UJ/.D. : Union Nationale et Démocratique<br />
- U.N.I.R. Union Nationale pour l'Indépendance et la<br />
Révolution.<br />
Les socialistes français ont leur lecture sur l'évolution du<br />
problème tchadien Cl). Le Tchad est un fait colonial. Sa création<br />
répondait à la mise en application de la stratégie coloniale française en<br />
Afrique. Le Tchad devait servir de point de contact entre l'Algérie,<br />
l'Afrique Occidentale Française et l'Afrique Equatoriale Française. Il<br />
s'agissait par conséquent de renforcer l'influence française en essayant<br />
(1) Cf, Le Poing et la rose Spécial Responsables - n' 172 du 10/09/1983<br />
"Problème tchadien - rappel historique"<br />
Cf. Politique africaine n' Hl - décembre 1984 - pages 9-14
-19'7-<br />
de réduire au maximum les ambitions britanniques et allemandes dans 1.3<br />
région. On comprend dés lors pourquoi les questions économiques occupé<br />
rent le second rang. La situation géographique du Tchad fait de ce pays<br />
un point vital sur le plan stratégique entre "le monde arabe et l'Afrique<br />
noire". Les conséquences sociologiques de cette création arbitraire<br />
sont multiples. Les communautés aux cultures différentes, sinon opposées,<br />
furent contraintes de coexister dans un environnement artificiel. Il<br />
5 'agit surtout des nomades sahariens constitués de Toubous ou Goranes de<br />
souche noire, et les paysans des régions tropicales mérldionales. Ici corn-<br />
me ailleurs en Afrique, les problèmes sociologiques relatifs à la naissan<br />
ce des nations sont les mèmas . Les intérêts stratégiques, idéologique,="<br />
même l'emportent ; la question nationale viendra apr ès . On comprend aisé<br />
ment que toutes les luttes de libération nationale dans le continent ont<br />
leurs racines dans cette contradiction coloniale. Car la séparation orga<br />
nisée des corps sociaux, la préférence accordée à certains par rapport à<br />
d'autres, la corruption des locaux furent et restent les moyens des colons<br />
pour asseoir leur domination en terre étrangère. C'est le cas du Tchad où<br />
ce sont les deux groupes nordistes qui luttent pour le pouvoir politique.<br />
"Une coupure culturelle sépare les sociétés sahariennes et sahéliennes,<br />
islamisées, des sociétés méridionales, restées attachées aux cultes<br />
ancestraux et partiellement christianisées"
-198-<br />
le plan culturel. Cette nouvelle donnée sociologique favorisa sur le plan<br />
économique le Sud qui collabora avec le colonisateur, notamment les<br />
"sara". Initiés à l'école, aux politiques administratives, les Sudistes ont<br />
dès l'indépendance
-200-<br />
culture arabe. Ainsi, la déchristianisation du continent et la lutte contre<br />
la présence israélienne en Afrique explique pour une large part<br />
l'engagement libyen au Tchad. "Très logiquement, la rupture des rapports<br />
privilégiés entre le Tchad et Israël allait donc figurer l'lU coeur de la<br />
nouvelle politique extérieure libyenne. Très logiquement ms is: sans aucune<br />
origin8lité dans la mesure où l'ensemble des Etats arabes se donnaient<br />
pour objectif primordial l'élimination des influences israéliennes au sud<br />
du Sahara" (1). Ainsi la main-mise sur le Tchad devrait permettre au<br />
dirigeant libyen de concrétiser sa stratégie anti-israélienne dans la<br />
région i d'où son soutien modéré au chef des Toubous en rébellion, car ce<br />
soutien loin d'être une fin était un moyen au service d 'une politique plus<br />
globale : la politique saharienne du colonel Kaddhafi. La réalité de la<br />
contestation au sens du <strong>FR</strong>ELIMO, contestation soutenue et amplifiée par la<br />
Libye en raison de son soutien à Goukouni Oueddëi devenu chef du mouve-<br />
ment dissident, obligea le gouvernement tchadien à reconnaître l 'O.L.P.<br />
(l'Organisation pour la Libération de la Palestine). Conforme au projet<br />
libyen, cette mutation entraîna la normalisation des relations entre le<br />
Tchad et la Libye, de l'octroi par le Tchad d'une promesse d'aide finan-<br />
cière de 23 milliards de francs CFA (2). C'est ainsi que la Libye occupa<br />
librement la bande d'Aouzou en 1973 et ceci sans protestation des forces<br />
en présence. "Lracceptiatiion du fait accompli libyen était quasi-générale.<br />
L'unique proposition sérieuse au coup de force libyen devait venir des FAN<br />
de Hissène Habré, et encore, seulement: lorsque les troupes libyennes<br />
allaient tenter de pousser plus lW Sud. Avec l'occupation de 18 bande<br />
d'Aouzou, la politique tcbeâieuoe de la Libye prenait une dimension nou-<br />
velle : la nature de ses déterminants se modifiait en méme temps que ses<br />
(l) R. OTAYEK- op. cit. - pages 68-69<br />
(2) Ibid - page 70
-201-<br />
objectifs" (1). Selon les autorités de Tripoli, les frontières libyennes<br />
s'étendent, contrairement à celles internationalement reconnues à 150 ki-<br />
lomètres au-delà de la ligne officielle et à l'intérieur du Tchad (2). Ce<br />
raisonnement fait de la bande d'Aouzou une possession libyenne. Aouzou<br />
oouvre une superficie de 100 000 km2 et recèlerait des ressources<br />
minières, en l'occurence de l'uranium. Au-delà de ces ressources, Aouzou<br />
est stratégique de part sa situation géographique. En occupant Aouzou et<br />
en mettant cette bande en valeur, la Libye s'est imposée en tant que<br />
puissance régionale face à l'ancienne puissance coloniale: la France.<br />
La politique tchadienne de la France sous Valéry Giscard<br />
d'Estaing (3) allait-elle infléchir le sens des réalités ? La diplomatie<br />
franco-tchadienne a certes subi sa mutation mais la situation n'a pas<br />
évolué et ceci en dépit des interventions militaires françaises pour la<br />
défense des intérêts français. Pourquoi? En raison de la faiblesse du<br />
régime tchadien, le pouvoir giscardien adopta une attitude de méfiance à<br />
l'égard des autorités de N'Djamena. L'absence de Tombalbaye au sommet<br />
franco-africain de Bangui en 1975 est la traduction concrète de cette<br />
méfiance de Paris à l'égard de N'Djamena. Le 13 avril 1975 Tombalbaye est<br />
évincé par un coup d'Etat militaire en laissant une situation politique et<br />
économique catastrophique (4). La France fut-elle étrangère à ce<br />
renversement politique ? Le 20 avril 1975, le Commandant Kamougue, l'un<br />
des hommes forts du nouveau régime, déclara "L'ancien président<br />
Tombalbaye était un grand naïf, 11 payait des mercenaires pour nous<br />
(1) Ibid - page 70<br />
(2) Cette analyse libyenne s'appuie en effet sur un traité 1talo-français<br />
de 1935, traité non ratifié<br />
(3) N. )fOURrC - La politique tchadienne de la France sous Valéry Giscard<br />
d'Estaing - In Politique africaine n' 16 - Décembre 1984 - Pages 86- à 101<br />
(4) Cf. N. MOURIC - op. cit . - page 87 et" suivantes
-203-<br />
mettre fin à l'affaire Claustre après la livraison à Hissène Habré d'une<br />
partie des armes par Pierre Claustre, le mari de l'otage. Face à l 'offen-<br />
sive de. Goukouni Oueddei , offensive soutenue par la Libye, la France est<br />
intervenue militairement au Tchad en mars 1978. "Un corps expéditionnaire<br />
d'environ 2 500 hommes, soutenu par des moyens aériens suffisants pour<br />
lui donner la maîtrise de la situatian s'activa au Tchad jusqu'au début du<br />
mois de juin, date à laquelle les combats cessèrent" (1). Engagée de part<br />
et d'autre l'action française visait moins un renversement complet de la<br />
situation que la recherche d'une solution politique débouchant sur des<br />
négociations en vue de réconcilier les tendances en présence. Il fallait<br />
donc associer les parties en présence à l'exercice du pouvoir. Contesté à<br />
l'intérieur de son mouvement, Hissène Habré se retira au Soudan pour<br />
renforcer par la suite sa position. Un accord négocié entre Hisséne Habré<br />
et le CMS intervint sous les auspices du Soudan le 25 août 1978. Hissène<br />
Habré est nommé Premier Ministre suite à la promulgation de la nouvelle<br />
constitution fondée sur la "charte fondamentale". Hissène Habré rompt six<br />
mois plus tard avec le pouvoir central de Malloum. Ce désaccord politique<br />
entraîna la guerre civile au contenu religieux et ethnique entre Nordistes<br />
et Sudistes. Les forces politiques en présence se désintègrent. Le colonel<br />
Kamougué crée, au nom des Sudistes, un Comité permanent. Le nouvel "organe<br />
pol1tico-administratif" se Illet en rapport avec les forces armées tcha-<br />
diennes qui jouent désormais le rôle de forces armées du Sud. "La France<br />
tenta alors, par l'intermédiaire du général Forest d 'empêcher la victoire<br />
du Nord. Encore une fois, il ne fallait ni vainqueur , ni vaincu" (2).<br />
Néanmoins, le Frolinat nordiste avec la coalition des forces armées<br />
populaires de Goukouni (FAP) et des forces armées du Nord de Hissène<br />
(1) N. MOURIC - op. cit. - page 94<br />
(2) N. MOURIC -op._ cit. - page 98
-204-<br />
Habré
-205-<br />
un effort de maximisation des avantages avant la tsiee en oeuvre de<br />
l'obligatoire solution négociée" (1). Bn attendant la Libye conforte sa<br />
position au Tchad et le commerce continue avec Tripoli. La Gauche hérite<br />
de cette situation pour le moins confuse de part et d'autre. A-t-elle<br />
appliqué une nouvelle stratégie au Tchad ? Certes, l'ancien Ministre<br />
français de la France d'Outre-mer n'est pas tout à fait le nouveau Présf.-<br />
dent de la République mais la politique tchadienne de François Mitterrand<br />
constitue à plus d'un titre la copie revue et légèrement corrigée de la<br />
politique tchadienne de Monsieur Giscard d'Estaing (2) . Bn effet, la<br />
politique tchadienne de Monsieur Mitterrand se caractérisa au début de sa<br />
fonction présidentielle par une certaine originalité dont les résultats<br />
tranchaient avec ceux de ses prédécesseurs. Mais le nouvel élan fut très<br />
vite altéré par la force des choses. En mai 1981, la France était, straté-<br />
giquement et politiquement, absente au Tchad. En revanche, la Libye au<br />
même moment brillait au Tchad par la présence de près de 100 000 Libyens<br />
pour épauler Monsieur Goukouni et chasser définitivement Monsieur Habré<br />
de N'Djamena. L'opération de la nouvelle équipe française au pouvoir à<br />
Paris était d'autant plus incertaine que celle-ci ne disposait que de peu<br />
d'éléments d'appréciation sur les· forces. en présence dans l'ancienne<br />
colonie. Il a donc fallu immédiatement coopéré avec le Parti Socialiste<br />
Ouvrier de l'Espagne spécialisé en la matière. "L'équipe africaine de<br />
Nonsieur Kitterrand sveit: du mal à se Former une opinion précise sur le<br />
problème tchadien car les bomnee de confiance de l'ancien président avait<br />
emporté l'essentiel des dossiers alors que les Socialistes Irençsie<br />
n'entretenaient pas de relations suivies avec les "tendances" au pouvoir à<br />
(l) R. OTAYEK - op. cit. - page 75<br />
(1) Cf. R. BUUTBNHUIJS : L'art de ménager la chèvre et le chou - La politique<br />
tchadienne de François Kitterrand - In Politique africaine n' 16<br />
décembre 1984 - Pages 102-117<br />
et Jean-François BAYART - op. c1t. - pages 42-43, 66-67. 72 à 130
'-.<br />
-206-<br />
N'Djlll!1eIla et notamment avec celles issues du PRDLINAT" (1). Le gouverne-<br />
ment socialiste va d'abord centrer son action sur le gouvernement d'union<br />
nationale de transitian en tant qu'expression de l'unité tchadienne<br />
et soutenue par l'Organisation de l'Unité Africaine et ce depuis son<br />
sommet de Nairobi tenu en juin 1981. L'une des premières stratégies<br />
socialistes consista à intégrer l'Afrique (l'OUA) dans le processus de<br />
négociation sur le Tchad en vue d'obtenir, le plus vite possible,<br />
l'évacuation du Tchad des troupes libyennes. Ces troupes devaient être<br />
remplacées par une Force inter-africaine
-207-<br />
Dans ces conditions, l'appui militaire de cette force par le régime<br />
socialiste français ne pouvait compenser la carence historique (1) de<br />
l'OUA donc de sa force. Nous y insistons. Certains membres de cette force<br />
ont nettement affiché, au mépris du consentement unanime obtenu peu de<br />
temps avant, leur préférence pour Monsieur Habré. Ces pays sont le<br />
Nigeria, le Sénégal et le zai"re. D'ailleurs, cette force n'avait de<br />
militaire que de nom car à l'exception du Nigéria, elle est restée s1len-<br />
cieuse pendant les différentes opérations militaires. Aussi la solution<br />
africaine comme toujours et cette fois-ci avec l'apport français a<br />
lamentablement échoué. En effet, contrairement à la mission qui leur était<br />
dévolue avec la bénédiction du gouvernement socialiste français, cette<br />
force théorique a peut-être aidé les Forces armées du Nord de Monsieur<br />
Habré. un se peut donc qu'il y ait eu, à ce niveau, des complicités en<br />
fa.veur des FAN" (2), complicité de la FIA. Pour notre part, la<br />
responsab1lité africaine dans l'échec de cette nouvelle approche française<br />
au Tchad est immense. C'est le moins que l'on puisse en dire. Comme au<br />
temps de la diplomatie giscardienne, les annes vont une fois de plus<br />
trancher au Tchad. Hissène Habré réorganisa ses troupes avec l'aide<br />
américaine et soudanaise. La France s'interposa en vain et ceci malgré<br />
l'assurance donnée par les U.S.A. et le Soudan. Hissène Habré s'empara de<br />
ll'Djamena dès le début de juin 19B2 et le chef de l'exécutif français fut<br />
contraint de reconnaître officiellement la légitimité du nouveau pouvoir<br />
de Monsieur Habré lors du sommet franco-africain de Kinshasa (Zaïre) en<br />
octobre 1982. La France refusa donc d'intervenir dans un conflit qu'elle<br />
considère interne au Tchad. Le GUHT n'a pas résisté, il capitula tout<br />
(1) Sur l'OUA et les confl!te africains : cf. Edmond JOUVE : L'organisation<br />
de l'Unité Africaine - PUF - Paris 19B4 - 284 pages - Pages 109-184<br />
Analyse consistante et diversifiée, bibiiographie importante, etc...<br />
(2) R. BUIJTENHUIJS - op. cit. - page 108
-210-<br />
François Bayart insiste sur le fait que Konsieur Mitterrand "entendait<br />
surtout rappeler au Colonel Kaddhafi que l'opération Hanta ne visait pas 8<br />
le déstabiliser et ne relevait pas de la stratégie de la tension de<br />
rlashington, laquelle venait de rebondir sous la forme d'un nouvel inc1den t<br />
aérien dans le golfe de Syrte, le 1er août 1983" (1). En outre, dans la<br />
mesure où la nouvelle politique de coopération exigeait des relations sui-<br />
vies avec les pays situés en dehors de la zone d'influence traditionnelle<br />
de la France, l'opération MANTA ne pouvait que rendre son application plus<br />
ou moins difficile. Car le Bénin, le Mozambique, Madagascar et le Congo<br />
soutenaient le GUNT et faisaient pression sur la France. L'opération<br />
Hanta, non voulue sur le plan strictement politique par les autorités<br />
françaises mais rendue inévitable par les circonstances, a encore une fais<br />
montré la division des Africains face aux affaires africaines. La volonté<br />
politique des dirigeants français n'a pas résisté à l'épreuve des faits.<br />
Ainsi, la politique tchadienne de Monsieur Mitterrand a abouti au niveau<br />
de la pratique politique aux mêmes scénarios que oelle de son<br />
prédécesseur. "...la Gauche a laissé la question politique, lW sens plein du<br />
terme, des droits de 1 'homme et de la démocratie sur le continent,<br />
s'étioler en humanisme feutré tissé d'interventions discrètes et<br />
ponctuelles "au plus haut niveau"... alors que l'attitude française à<br />
l'égard de l'Afrique du Sud semble 'moins ferme que certains L'auraient<br />
souhaité" (2). Ce constat global est aussi celui du cas du Tchad où la<br />
défense des droits de l'homme a cédé le pas à une politique<br />
interventionniste caractérisée par l'opération Kanta, un Barracuda de<br />
(1) Jean-François BAY ART - op. cit. - page 79. Il écrit d'autre part: "Si<br />
la politique tchadienne de Monsieur Kitterrand él été incontestablement<br />
équilibrée et a sauvegardé l'économie générale de sa diplomatie jusqu'à<br />
l'été 1984, elle· n'en reste pas moins décidée au jour le jour, san<br />
perspectives précises. Tout (ou presque) a déjà été essayé au Tchad e<br />
,r.r;"ien n'a réussi" - page 80<br />
(1) R. ,BUIJTENHUIJS -op_. ctt: -"page '103
-214-<br />
ques équipées de "Jaguar", de "Transall" et des avions de reconnaissance<br />
"Bréguet-Atlantique" en tant que composantes de l'Aéronavale. L'importance<br />
de cette rénovation réside dans le fait que la France, mieux que n'importe<br />
quelle puissance, est désormais apte à intervenir le plus rapidement<br />
possible et rigoureusement en Afrique pour la défense de ses intérêts. La<br />
France, est à juste titre "le gendarme de l'Afrique". "Quoi qu'il en soit,<br />
l'Afrique francophone a été, sinon le moteur, du moins l'élément clé dans<br />
l'évolution, la structuration et le développemen t des forces<br />
d'intervention. <strong>L'A</strong>frique est. en effet, le coeur du système mondial de<br />
communications stratégiques et militaires pour les sutiori tée<br />
françaises"
-216-<br />
louines a confirmé l'intérêt de tels appuis extérieurs. En 1982, nous<br />
avons, Outre-mer, 18 910 personnels, 76 aéronefs, 50 bâtiments de la<br />
marine dans les Dom-Tom et à l'étranger grâce à des facilités accordées<br />
par des nations qui ont passé des accords avec nous, tels que Djibouti,<br />
Sénégal, Gabon, Côte d'Ivoire, République Centrafricaine... Ces forces ne<br />
suffisent pas toujours à résoudre tous les problèmes survenant outre-mer<br />
et dans ces pays. Aussi, disposons-nous de forces d'assistance rapide de<br />
manière à pouvoir agir à la demande de façon quasi-immédiate... Pour<br />
valoriser ces forces, qui participent au rayonnement 'de la France à<br />
l'Etranger, nous cherchons à renforcer leurs équipements" (1), On voit<br />
ainsi que la dimension africaine est fondamentale dans l'articulation de<br />
la pensée militaire de Monsieur Hernu. Chaque concept utilisé y joue un<br />
rôle essentiel. La vision patriotique du discours socialiste en matière<br />
militaire va donc réellement l'emporter. Ce qui n'est pas sans influence<br />
sur le choix des hommes chargés de mettre en application cette politique<br />
de continuité, voire conservatrice. Les manoeuvres franco-africaines vont<br />
suivre leur cours et la liste des interventions françaises opérées va<br />
s'allonger inévitablement. Quel est en fait le but de ces manoeuvres<br />
régulières en terre africaine ? "...de telles melnoeuvres ont pour but de<br />
contrôler périodiquement la capacité d'intervention et de lei perfectionner<br />
sans cesse. Elles expliquent que la France, bénéficiant ainsi d'une large<br />
expérience sur le terrain, apparaît sulourâ'hui comme le premier pays oc-<br />
cidental dans son aptitude à intervenir militliirement su Sud du Sahara"<br />
(2). Des années 50 à nos jours, plus d'une dizaine de manoeuvres franco-<br />
africaines eurent lieu, dont celles sous la gauche au pouvoir (manoeuvres<br />
franco-sénégalaises de 1980 et 1982), Les interventions militaires offi-<br />
(1) Charles HERNU, Kinistre d8 la Défense - cité par Pascal C<strong>HA</strong>IGNEAU<br />
. Op. c i t . - page 90<br />
(2) Pascal C<strong>HA</strong>IGNEAU - op. cit. page 92
-217-<br />
ciellement opérées furent poursuivies Cl'opération MANTA au Tchad). A ces<br />
facteurs, il faudrait incontestablement ajouter les opérations directes qui<br />
relèvent du secret militaire. C'est pourquoi la grille ci-dessous (1)<br />
proposée par P. Chaigneau est d'une importance particulière car elle<br />
confirme à plus d'un titre que le concept "intervention" est pluriel et que<br />
derriére le mot se cachent des réalités complexes :<br />
- "les interventions militaires de mise en place",<br />
- "les interventions de déstabilisation" 1<br />
- "la réduction des menaces internes",<br />
- "la riposte aux ingérences étrangères et la défense des zones<br />
stratégiques" .<br />
Là aussi la Gauche au pouvoir a opté très concrètement pour la<br />
raison d'Etat au détriment, bien entendu, de la raison socialiste. La<br />
spécialisation des socialistes en matière internationale leur avait<br />
permis, sans doute, de détecter dans l'opposition la nature véritable des<br />
objectifs que visaient la panoplie militaire française en Afrique et son<br />
renforcement. Au fond, il s'agissait d'une stratégie coloniale pour le<br />
maintien des intérêts néo-coloniaux et ceci au détriment de l'intérêt'<br />
supérieur des populations. En outre, l'idée que les Socialistes se<br />
faisaient, avant d'accéder au pouvoir, de la présence soviétique et<br />
américaine en Afrique après la décolonisation contrastait avec celle<br />
soutenue par le pouvoir politique français de 1971 à 1981 (2). "Trés<br />
simple dans ses grandes lignes, la politique des anciennes puissances<br />
coloniales et principalement de la France, a été de maintenir les<br />
(1) Pascal C<strong>HA</strong>IGNEAU - op. c i t , pages 99-100<br />
/(2) cr, -R:- LUCK<strong>HA</strong>.M -op. cit. pagés 50-71 /
-219-<br />
paraît frappant Où les Soviétiques ont armé non pas Mugabe mais N'Koao,<br />
l 'homme des compromis avec Jan Smith et le porte-parole d'une bourgeoisie<br />
africaine naissante. En Erythrée même, si puissante que soit son aide aux<br />
militaires éthiopiens, il n'est pas sûr qu'elle cherche II en finir le plus<br />
vite possible avec les mouvements de Libération:., Dans l'état actuel,<br />
l'influence soviétique paraît totale dans certains pays dans la seule<br />
mesure où elle n'est pas sérieusement et honnêtement concurrencée ; elle<br />
n'est pourtant nulIement: irréversible C011Jme en témoigne l'évolution de<br />
l'Egypte et de la Somalie" (1). Ainsi la stratégie épousée par le pouvoir<br />
socialiste ne se fonde sur aucun aspect de l'analyse socialiste. Selon les<br />
Socialistes, l'Union soviétique et ses alliés politiques n'ont pas une<br />
conception stratégique d'ensemble sur le continent. africain. C'est<br />
pourquoi cette percée communiste en Afrique ne préoccupe pas tant les<br />
Etats-Unis. Néanmoins, cette vision a profondément changé avec l'arrivée<br />
des conservateurs au pouvoir aux Etats-Unis. D'où la collaboration franco<br />
air1caine sous Monsieur Giscard d'Estaing en vue de renforcer les<br />
positions traditionnelles des occidentaux en Afrique contre le<br />
Communisme et leur leader potentiel l'Union Soviétique. Les tensions et<br />
les crises renaissent en Afrique. Les Américains ont largement contribué<br />
au succès des interventions militaires françaises en Afrique sous<br />
Monsieur Giscard d'Estaing. "La France avait non seulement la volonté<br />
â 'sgir au nom des autres puissances occidentales, mais elle le faisait en<br />
consultation très étroite avec elles: au Shaba, en 1978, où les avions de<br />
transport et le soutien logistique des Etats-Unis jouèrent un rôle crucial<br />
dans le succès de l'opération i lors de la coordination CIA-Services<br />
secrets français dans la tentative de déstabiliser .le gouvernement du<br />
(1) -lbtd - page 7
-221-<br />
France doit pleinement jouer son rôle en Afrique en mettant tout en<br />
oeuvre pour réduire l'influence stratégique des autres puissances. Elle<br />
doit continuer ainsi à assumer pleinement ses responsabilités historiques<br />
en Afrique entre l'Est et l'Ouest, le Sud et le Nord, etc... D'ailleurs les<br />
arguments avancés par le pouvoir socialiste pour défendre cette<br />
continuité tous azimuts sont des arguments conservateurs importance du<br />
Continent pour la France dans tous les domaines, sécurité des<br />
ressortissants français en Afrique, maintien de l'héritage culturel,<br />
défense de tous les partenaires français sans exception, etc". L'une des<br />
raisons avancées par Monsieur Luckbam pour expliquer la permanence de ce<br />
conservatisme stratégique retient notre attention. " La politique<br />
gaulliste est enracinée dans des réflexes nationalistes et dans le<br />
fonctionnemen t du système présidentiel. Sous les gouvernements<br />
précédents, les critiques du Parlement ou du public sur le fond étaient<br />
peu nombreuses, tant pour les ventes d'armes que pour les interventions<br />
(et elles l'étaient encore moins pour le programme de coopération<br />
militaire)" (2). En définitive, le pouvoir socialiste n'a pas résisté à la<br />
tentation. Il s'est intégré au jeu des anciens stratèges français en<br />
abandonnant totalement, face à une opinion française encore majoritaire et<br />
conservatrice, sa doctrine stratégique, ambiguë mais différente. En outre,<br />
ce personnel ancien ne fut pas totalement écarté. Le pouvoir socialiste a<br />
finalement fait sienne la doctrine du cbef de bataillon Laboureix qui<br />
disait: "Le France, pariiculiêreüent: datis le domaine mi l i iedre, " un rôle<br />
éminent à jouer suprée des républiques africaines et malgache... ce que 18<br />
France ne fera pas, d'autres le feront 8 sa place, qui parviendront einei<br />
Cl) Ibid - page 67-68
-224-<br />
ces (cas des USA, du Canada et de l'Australie) et ceux qui restent<br />
dépendants de ces ressources (pays d'Europe occidentale et le Japon) (1).<br />
Ainsi, la France, hier comme aujourd'hui, mène en Afrique une<br />
politique d'approvisionnement en matières premières. La France tire du<br />
continent 60 % de son approvisionnement en matières premières (2).<br />
Certes, Monsieur Luckham relativise le profit économique que la France<br />
bénéficie en Afrique francophone aujourd'hui il n'en demeure pas moins<br />
qu'il met l'accent sur la dimension des investissements français en<br />
Afrique. Car les traités de défense, les accords militaires signés par la<br />
France avec les Etats africains en général, et subsahariens en particulier<br />
furent accompagnés dès le début des années 60 par des "traités accordant<br />
8 la France l'accès privilégié aux matières premières stratégiques et le<br />
droit d'en limiter ou d'en interdire les exportations dans l'intérêt de la<br />
défense commune. Ces accords on t tous expiré ou ont été renégociés" (3).<br />
La présence militaire française a toujours rassuré les régimes<br />
peu portés vers la démocratie. En outre, les grandes entreprises<br />
coloniales françaises ont largement maintenu leur influence. Les noms ont<br />
dans certains cas changé mais les structures demeurent, le fonctionnement<br />
n'a pas non plus varié. Ces entreprises opèrent toujours dans un<br />
environnement inchangé tant sur le plan financier que politique. Les<br />
rapports néocoloniaux élaborés dès l'aube des indépendances perpétuent ce<br />
système. "Bien que les grandes maisons de commerce coloniales aient rela-<br />
tivement décliné par rapport. 8 d'autres secteurs du capital français,<br />
Cl) Ibid - page 58<br />
-229-<br />
Le pouvoir socialiste, très tôt, et sous l'impulsion de Jean-<br />
Pierre Cot, a procédé<br />
reviendrons Cl).<br />
à l'application d'une autre politique. Nous y<br />
D'une manière générale, et sur les plans militaire, économique<br />
et stratégique, la politique française en Afrique au sud du Sahara n'a pas<br />
varié. L'analyse de M. Ziegler est, sur ces points, fort intéressante (2).<br />
La France de 1981 compte près de 2 millions de chômeurs. Les équilibres<br />
économiques ne tiennent plus. Le franc est dévalué à trois reprises de<br />
1981 à 1985. Les investissements industriels régressent. La balance<br />
ccmmer-cfaIe française connaît un déficit historique. L€ pouvoir socialiste<br />
face à ces contraintes internes va mettre en application une politique<br />
africaine non contraire à celle critiquée. Monsieur Ziegler insiste<br />
particulièrement sur le fait que le pacte néo-colonial entre la France et<br />
l'Afrique subsaharienne s'est particulièrement renforcé sous le pouvoir<br />
socialiste. L'échange inégal est maintenu et la France a continué d'en<br />
tirer d'énormes bénéfices. Les multinationales du commerce et de<br />
l'industrie n'ont affronté aucune résistance politique. Les banques ont<br />
continué A spéculer sur le prix des mati$res premières. L'exploitation<br />
économique de certains pays tels que le Gabon et le Za"ire n'a pas été<br />
interrompue, elle s'est même renforcée car les conditions sont devenues<br />
telles qu'aucune comparaison n'est possible. "...L'empire néo-colonial en<br />
Afrique garantit l'approvisionnement à bon compte en Il1éltiéres premières<br />
minérales et agricoles des marchés priviliégiés pour les biens<br />
manufacturés ; un rendement élevé pour les capitaux investis. Pas question<br />
donc dans ces conditions de démanteler l'empire, de rompre avec les<br />
(1) Cf. Chapitre II<br />
(2) Jean ZIEGLER - op. cit. - pages 47-73
-230-<br />
dictatures satellites, les satrapes eanguinsiree qui assurent la docilité<br />
des travailleurs africains ! La raison d'Etat impose impérativement aux<br />
socialistes le maintien de l'empire néo-colotüsI"
-232-<br />
de la République Centrafricaine, etc... (l).<br />
La force d'action rapide (FAR) est mieux équipée et mieux<br />
structurée depuis 1984 (2). En outre, Monsieur Ziegler insiste sur le<br />
ralliement non voilé du pouvoir socialiste sur la Real Politik de Monsieur<br />
Reagan car la France socialiste a souvent rassuré ses alliés en les<br />
maintenant au pouvoir face aux agitations populaires. Notons enfin que<br />
)'Ionsieur Zieg1er n'adhère pas tatalament aux thèses de Monsieur Bayart.<br />
Monsieur Mitterrand, depuis la création de la Ve République a une autre<br />
"vision" mais le pouvoir socialiste n'a pas infléchi le sens de l'Histoire,<br />
notamment en matière de relations franco-africaines. Pour notre part, les<br />
thèses en présence, loin de S8 contredire, sont complémentaires.<br />
(1) Jean ZIEGLER écrit : "La France socialiste continue de contrôler la<br />
politique étrangère et de défense des régimes néo-coloniaux. Avec ses<br />
satellites, elle a conclu des accords de coopération militaire, de défense.<br />
Au Sénégal, au Gabon, en République Centrafricaine, la <strong>FR</strong>ance maintient des<br />
bases aériennes et terrestres, dont une, Oualrham, près de Dakar, compte<br />
parmi les plus importantes de tout son système de défense. Ces accords<br />
assurent la survie des dictatures satellites : un despote menacé par la<br />
révolte de son peuple invoque l'accord, et les parachutistes français le<br />
réinstallent dans son ps Ieds:"<br />
Op. c rt, - pages 50-51<br />
(2.) Ibid - page 51
-234-<br />
Dans le doma ine économique, le pouvoir socialiste s'est<br />
affronté à la fois aux puissances dominantes africaines Oes groupes ou<br />
classes sociales) et aux entreprises multinationales privées (françaises<br />
et autres). L'analyse de Monsieur Bayart sur ces points est fort<br />
révélatrice (1). Les grandes entreprises qui opèrent en Afrique au sud du<br />
Sahara se soucient moins de l'intérêt des pays d'accueil que du<br />
renforcement de leurs capitaux. Le Continent reste leur terre de<br />
prédilection. La décolonisation n'a pas entraîné une prise en compte de<br />
l'industrialisation des pays africains. C'est en termes de marché, de<br />
rentabilité, et de concurrence internationale que ces grosses sociétés<br />
abordent les questions économiques. Le terrain économique n'est pas<br />
seulement convoité mais occupé aussi par les entreprises américaines,<br />
japonaises, canadiennes, brésiliennes, sud-coréennes, etc... Nous y<br />
reviendrons (2). Globalement, l'environnement interne et la réal!té<br />
économique internationale ont imposé, ici aussi, leur logique à la Gauche<br />
au pouvoir. Le pouvoir a changé politiquement mais les contraintes écono-<br />
miques n'ont pas évolué. "La difficulté des partis de Bauche à réaliser<br />
une politique africaine en harmonie avec leur déclaration antérieure n'est<br />
qu'un des aspects des contradictions inhérentes d un gouvernement eocie-<br />
liste dans un système capitaliste. Kéme si des secteurs substantiels de<br />
l'industrie et de la finance sont nationalisés. ils sont obligés d'opérer à<br />
l'intérieur de la logique de l'économie capitaliste et de faire face à la<br />
compétition internationale. Les pressions pour adhérer au mercantilisme et<br />
utiliser le pouvoir de l'état afin d'assurer une expansion économique<br />
internationale sont aussi fortes, sinon plus encore, sous le régime so-<br />
Cl) Jean-François BAYART - op. cit. - pages 84 et suivantes<br />
Cf. aussi M.C. SMOUTS : "France et l'industrialisation du Tiers-monde<br />
une vision kaléidoscopique"<br />
Revue française de science politique.33 (5) octobre 1983<br />
(2) Cf. Chapitre suivant
-235-<br />
cialiste que sous les régimes libéraux d'hier. Et cela plus encore dans le<br />
secteur militaire où la compétition pour les débouches est étroitement<br />
liée aux objectifs conventionnels de l'Etat-Nation" (l) écrit R. Luckham.<br />
Cette remarque est d'autant plus fondamentale qu'elle ne fut pas sans<br />
solides impacts sur l'application d'une théorie politique authentique en<br />
matière de relations franco-africaines. Tout se tient en effet. La culture<br />
économique qui prédomine et les conséquences socio-politiques qu'elle a<br />
engendrées en Afrique subsaharienne sont loin de faciliter un renouveau.<br />
Revenons ici sur la formule de Monsieur Mitterrand : l 'Histoire de la<br />
France au XXle siècle dépend de la présence française aujourd'hui en<br />
Afrique. Cela veut dire que si les autres puissances peuvent économique-<br />
ment et politiquement se désintéresser relativement du continent jadis<br />
colonisé, il demeure encore et pour longtemps vital pour la France (2).<br />
L'exception confirme cette règle conforme à une idée fort ancienne de la<br />
France dans le monde. L'application exceptionnelle d'une autre logique des<br />
rapports euro-africains en général et franco-subsahariens en particulier<br />
fut l'oeuvre de Monsieur Jean-Pierrre Cot, premier Ministre socialiste<br />
délégué à la Coopération et au Développement. Son expérience mérite qu'on<br />
s'y arrête. D'abord pour nous. interroger sur ses fondements, ensuite<br />
tenter de mettre en lumière les raisons de sa remise en question. D'où le<br />
cheminement choisi :<br />
Chapitre rr<br />
La pratique de la Coopération de Jean-Pierre COT li Guy PENIfE<br />
A - Renouveau de la coopération franco-africaine ?<br />
B - Le concept de domaine réservé ou les limites d'Une politique de<br />
coopération<br />
(1) R. LUCK<strong>HA</strong>M - op. cit. - page 69 (l'importance du constat vaut qu'il<br />
soit cité en entier)<br />
(2) Cf. Régis DEBRAY - op. cit. pagB 143 et suivantes<br />
-,
-236-<br />
Dès sa nomination au Ministère de la Coopération et du<br />
Développement, Monsieur Jean-Pierre COT afficha une volonté politique de<br />
redresser la situation générale de la coopération franco-africaine.<br />
L'entreprise s'est d'emblée avérée possible et difficile politiquement.<br />
Possible, parce que la force politique, légitime des socialistes sur la<br />
scène politique ne fait guère de doute. Difficile parce que le Ministère de<br />
la coopération fut politiquement géré pendant près de 23 ans en fonction<br />
d'une logique "non socialiste". A ces différents facteurs, il convient sans<br />
nul doute, de substituer l'intégration des forces politiques, au pouvoir ou<br />
dans l'oppasitian, dans les moeurs de la république née en <strong>1958</strong> et la<br />
diversité des responsabilités et des compétences en matière de relations<br />
franco-africaines. La volonté politique de M. Jean-Pierre Cot s'articulait<br />
visiblement autour des axes centraux suivants : ancrage de la coopération<br />
à gauche, fidélité au projet socialiste, choix sans arobigu'1té en matière<br />
économique, culturelle, etc... Cette ambition, au demeurant légitime,<br />
appelait nécessairement un renouveau des relations franco-africaines,<br />
renouveau politique sur lequel il n'est pas sans intérêt de s'interroger.<br />
Le poids de l'héritage et la réalité d'une culture politique en matière de<br />
coopération franco-africaine incitent consécutivement à s'interroger aussi<br />
sur les conséquences politiques d'un tel volontarisme. Car ce volontarisme<br />
politique implique la rupture avec le passé et la continuité, déjà mise en<br />
relief, exige qu'on tente ici de dégager les limites imposées à la nouvelle<br />
politique franco-africaine.
-237-<br />
A - RENOUVEAU DES RELATIONS <strong>FR</strong>AJCfrA<strong>FR</strong>ICAIHBS<br />
La coopération franco-africaine, il convient de le répéter ici,<br />
est un tout. C'est un système socio-économique, stratégique et politique.<br />
Prenons d'abord les aspects socio-économiques sous la direction de<br />
Monsieur Jean-Pierre Cot (1).<br />
1" Les questions économiques et sociales<br />
Le nouveau dirigeant de la coopération est un socialiste. Il<br />
souscrit par conséquent aux valeurs du socialisme démocratique. Sa lecture<br />
des relations franco-africaines peut aider à saisir les fondements de ce<br />
qu'on peut appeler la nouvelle pratique des relations euro-africaines.<br />
Jean-Pierre Cot s'interroge d'abord sur le concept même de l'indépendance<br />
et ses conséquences socio-économiques, politiques et idéologiques. Car<br />
l'inégalité en tant que phénomène global serait la Buite logique d'une<br />
philosophie de l'indépendance dont l'ambigultè ne fait plus de doute de<br />
part l'évolution des rapports entre les anciennes colonies et leurs<br />
métropoles respectives. "L 'indépendance n 'ave: t pas été conçue comme une<br />
rupture. l11aisdomme une novation du tissu serré de rapports de tous<br />
ordres qui liaient la métropole et les nouveaux états africains. Dans<br />
cette perspective, les tiers n'avaient pas de place et moins encore les<br />
organisations internationales perçues comme politiquement inopportunes et<br />
techniquement mel gérées. Si des structures multilatérales étalent néces-<br />
saires, il convenait de les créer de toutes pièces pour faciliter la coo-<br />
-238-<br />
péretion entre la France et son Afrique : la Communauté, la Zone Franc,<br />
les banques centrales d'émission, les espaces économiques COIDIIIuns,<br />
l'agence de coopération culturelle et technique. Quant à la politique<br />
européenne de développement inscrite dans le traité de Rome à la demande<br />
de la France, elle devait ajouter un complément de financement à<br />
destination des seuls états d'Afrique francophones et ne troublait donc<br />
pas le tête-à-tête" (l) écrit Jean-Pierre Cot. Il s'agit bien là d'une<br />
autre conception global1ste des relations franco-africaines. Car<br />
l'indépendance politique donc économique, financière et militaire des<br />
nouveaux Etats africains ne pouvait. dans ces conditions, qu'être<br />
aléatoire, voire mythique. Le renforcement des relations bilatérales<br />
dirigées vers des objectifs précis fut fonction de la stratégie selon<br />
laquelle seule la France a le droit de déterminer sur la scène internatio-<br />
nale le sens de l'évolution politique de ses anciennes possessions.<br />
L'ostracisme, voire l'obscurantisme, en matière d'aide au développement<br />
trouvait sa source politique dans cette conception traditionnelle de la<br />
politique de coopération. D'ailleurs. cette aide théoriquement destinée aux<br />
pays les plus pauvres fut au début orientée vers d'autres régions. "Dans<br />
les années 60, l'essentiel de l'aide française allait a nos anciennes<br />
colonies du Xaghreb et de l'Afrique noire. Le Jrfinistère de la Coopération,<br />
créé à cette fin, gérait un important volume de crédits cependant que la<br />
conclusion de l'accord de Yaoundé entre la Communauté européenne et les<br />
Etats d'Afrique noire francophones assurait un relais européen à cette<br />
exclusivité. Les conditions particulières de la décolonisation du Magbreb<br />
en faisait un interlocuteur du Xinistère des Affaires étrangères. Mais<br />
l'essentiel des crédits de coopération culturelle et technique se trouvait<br />
affecté à l'Algérie, à la Tunisie et au Naroc" (2). Ce constat sans com-<br />
(1) Jean-Pierre COl - op. cit. page 104<br />
(2) Ibid - page 37
-239-<br />
plaisance de l'ancienne politique de coopération est révélateur d'une autre<br />
perception philosophique.<br />
Monsieur Giscard d'Estaing a certes marqué de ses intentions<br />
personnelles certaines structures de la coopération franco-africaine mais<br />
l'essence est restée identique. Au-delà de la théorie, la pratique de la<br />
coopération sous Monsieur Giscard d'Estaing a largement altéré les<br />
relations franco-africaines : personnalisation des rapports, dépenses de<br />
prestige néfastes, construction en Afrique de palais et de nouvelles<br />
)<br />
capitales africaines, etc... Le "copinage" érigé en principe politique en<br />
matière de coopération répondait surtout à la volonté de part et d'autre<br />
de préserver des intérêts particuliers parfois mercantiles. Les droits de<br />
l'homme ne préoccupaient guère. " En Afrique noire, la politique<br />
identifiée au nom de Jacques FCJClJrt continuait pour l'essentiel, faite de<br />
soutien systématique aux élites en place quel que soit le mépris parfois<br />
affiché à leur endroit, et de violation trop systématique des droits<br />
élémentaires. La coopération policière active à Paris, la surveillance des<br />
opposants, l'action des réseaux, l'intervention directe en cas de coup dur<br />
formaient un système pérenne et efficace"
-240-<br />
contribution (2 à 3 % ne favorisait en aucune façon une présence ef-<br />
fective dans le système. Par conséquent, nul ne pouvait prévaloir ses<br />
idées sur les projets et les mécanismes de leur mise en application,<br />
Ainsi, la France entendait maintenir et renforcer bilaté-<br />
ralement ses acquis historiques sur le continent. Ceci pouvait être de<br />
nature à réduire au maximum la dimension de la concurrence des<br />
entreprises multilatérales opérant en Afrique. "La contribution française<br />
au Fonds Européen de Dévelopemeni: (FED) est, à l'époque comme aujourd 'hui,<br />
du même ordre de grandeur que la dotation annuelle du Fonds d'Aide et de<br />
Coopération (FAC) , En d'autres termes, la France finance autant de projets<br />
de déveIopemetit: par l'institution européenne que par l'aide bilatérale en<br />
Afriquf!' (1).<br />
Une autre contradiction, non moins importante, rendait<br />
inopérationnelle toute coopération au vrai sens du terme. La mauvaise<br />
coordination des administrations s'est substituée aux structures<br />
administratives inadéquates et dépassées. Le paradoxe est que le respon-<br />
sable politique du développement ne pouvait rien avancer en matière de<br />
développement car 11 n'est pas juridiquement compétent en la matière (2).<br />
Monsieur Jean-Pierre Cot met également l'accent sur ce qu'on peut appeler<br />
le champ clos de la coopération, un champ limité à l'ancienne France<br />
d'Outre-mer. L'adminis.jtration actuelle (de 1971 à 1980) est le reflet<br />
direct de celle de la France d'Outre-mer et les agents de carrière y<br />
occupent toujours une place dominante. Les concepts ont changé, les<br />
hommes sont restés.<br />
(1) Ibid - page 104.<br />
(2) Ibid - page 109
-241-<br />
Il est donc logique que le6 organes ou organisations placés<br />
sous la tutelle du Ministère et orientés vers la coopération répondent à<br />
das aspirations bien précises. Les Instituts français de la recherche<br />
scientifique sont :<br />
- le Centre National de la Recherche Scientifique
-242-<br />
durable les crises africaines. On ne fera jamais une nouvelle politique de<br />
la coopération avec des armes coloniales. Au service de l'extraversion des<br />
économies africaines, ces organes appartiennent au passé, ils sont dépas<br />
sés. Dans l'ensemble, le Ministère de la Coopération est un bel amalgame<br />
du passé et du nouveau. Il s'agit d'un bricolage qui rassemble, des<br />
éléments de l'ancien ministère de la France d'Outre-Mer (rue Oudinot), des<br />
services des autres ministères, des représentants du secteur privé, etc ...<br />
Par conséquent, le Ministère n'élabore pas, il exécute des projets arrêtés<br />
ailleurs. Les inconséquences relevées en la matière ne furent pas l'objet<br />
ct 'une réflexion sérieuse. Les rapports non plus. "Les rapports Jeanneney,<br />
Gorse et Abelin plaident avec vigueur la cause [la réforme) mais restent<br />
dans les tiroirs -DU parfois dans les coffres-. On sait que le rapport<br />
Gorse fut tenu secret jusqu'en 1981 tant la perspective proposée parais<br />
sait hérétique. Le lobby africain qui tenait l'Elysée paralysait 18<br />
réforme" Cl).<br />
En outre, sur le plan de la procédure décisionnelle, les<br />
distorsions, les hégémonies et les luttes d'influence entre les<br />
personnalités chargées de l'ensemble de la politique extérieure française<br />
réduisaient la portée des grandes décisions. L'unité de la politique<br />
extérieure était par ces faits compromise.<br />
Ainsi se dégageaient sans nuances les grandes lignes politiques<br />
que Jean-Pierre Cot entendait désormais mettre en application : l'autosuf<br />
fisance alimentaire, la satisfaction des besoins réels, le développement<br />
énergétique et l'essor des petites et moyennes entreprises, la prise en<br />
compte de l'action des organisations non gouvernementales, le contrôle ri-<br />
(1) Jean-Pierre COT --op. cit. page 200
-244-<br />
plan local, par l'importance des communautés de base .. au plan national,<br />
par un contenu international, par un renforcement de la coopération entre<br />
les Etats du Tiers-monde" (1). L'application concrète d'une telle stratégie<br />
de développement exigeait donc une révision des habitudes et instruments<br />
de part et d'autre. L'autosuffisance alimentaire n'est possible sans la<br />
lutte contre la politique jadis pratiquée par les exportateurs de céréales,<br />
politique économique centrée sur les cultures d'exportation (2). Un<br />
comportement responsable tant du côté africain que français s'est avéré<br />
nécessaire. Car la logique ci-dessus évoquée fait des pays eux-mêmes les<br />
principaux acteurs du développement à la base. L'agriculture devrait être<br />
à même de produire localement afin de pouvoir vendre en fonction des<br />
besoins précis du monde agricole. La division internationale du travail<br />
fait des pays pauvres les réservoirs de matières premières. Là aussi, le<br />
développement autocentré est l'autre nom de l'indépendance économique et<br />
industrielle. Selon M. Cot, la nouvelle politique industrielle est aussi<br />
fonction de certains critères incontournables : la maîtrise de l'ensemble<br />
du processus, le transfert de technologie adaptée, la définition d'un<br />
programme de formation, un circuit adapté de commercialisation, la prise<br />
de conscience d'une classe d'entrepreneurs "prête à investir, à prendre<br />
des risques" (3). Le développement endogène c'est la prise en compte des<br />
aspirations légitimes des paysans. Ainsi une transformation des relations<br />
de pouvoir, relations centrées sur des profits individuels, est plus<br />
qu'indispensable pour sa réalisation. Le développement autocentré suppose<br />
(1) Jean-Pierre cor - Intervention au Forum des ONG - 27/06/1981<br />
(2) " .. .Le développement: de-J'autosuffisance alimentaire va li l'encontre<br />
des intiérëtie évidents des principaux exportateurs de céréales dans le<br />
monde, qui trouvent dans l'aide alimentaire un débouché immédiat et<br />
l'instrument pour' créer un marché captif 8 leur avantage. Un arbitrage<br />
politique est ici nécessaire, à nous comllle à nos partenaires".<br />
Jean-Pierre cor - A l'épreuve du pouvoir - page 56<br />
-(3) Jean-Pierre cor - A l'épreuve du pouvoir--page 58
-245-<br />
aussi une régionalisation sans nuance. La coopération organisée sud-sud<br />
peut palier aux carences constatées au niveau international. M. Jean-<br />
Pierre Cot va aussi poser 1 en termes nets, et devant le Consellllconomique<br />
et Social français les questions relatives à la transformation des<br />
mécanismes de la coopération, mécanismes tissés en fonction du pacte<br />
colonial. "...Des pays aux riches reJltes minières ont été dépossédés au<br />
profit de quelques grandes firmes multinationales et pour le plus grnnd<br />
bénéfice des pays industriels. Nous en avons profité nous-mêmes,<br />
obonâamment.,., Pas plus au niveau international qu'en france, il n'y à.<br />
d'origine naturelle ou divine, des chanceux ou malchanceux. les uns riches<br />
et les autres pas. Il y li des pays comllle il y Cl des couches sociales, qui<br />
se sont enrichis sur le dos des autres, et le plus souvent par la force.<br />
Développement et sous-développement ne sont que les deux faces d'une<br />
unique médaille. celle du ra.pport de force qui conduit au phéno11Wl.e<br />
impérialiste' (l), Une telle prise de position s'impose par son<br />
originalité et ceci par la nature de l'auditoire habitué à d'autres fonnes<br />
de déclarations officielles en matière de coopération d'une part, et<br />
d'autre part en raison de l'analyse politique nouvelle. Ici encore, le<br />
volontarisme de Monsieur le Ministre échnppe à toute équivoque. Une<br />
nouvelle politique économique vers l'Afrique est désormais possible, c'est<br />
un choix, une option politique. Partant de cette ligne économique. le<br />
Président de la République Monsieur Mitterrand va lui aussi s'employer à<br />
rassurer les partenaires africains lors de la conférence franco-africaine<br />
de Paris (3 et 4 novembre 1981). "Nous refusons l'égoïsme à courte vue du<br />
"chacun pour soi, le marché pour tous". Les; rapports Nord-Sud doivent être<br />
équilibrés et plus solidaires... Entre le Nord et le Sud, laisser jouer la<br />
(1) Jean-Pierre COT OUnistre de la Coopération et du développement <br />
Discours devant le Conseil Economique et social - Paris - 9/06/1981.<br />
C'est nous-qui soulignons
-246-<br />
seule loi du marché, c'est laisser les plus forts se débarrasser sur les<br />
plus faibles du poids de la crise. Rééquilibrer les rapports Nord-Sud,<br />
c'est d'a bord accepter d'en parler franchement et globalement entre<br />
égaux : la France n'attendra pas l'issue des négociatiione globales pour<br />
agir" (1). Ainsi, en condamnant officiellement le "capitalisme marchand",<br />
donc l 'efficacité des firmes multinationales, la déclaration présidentielle<br />
ne contredit pas l'explication du Ministre de la Coopération (2).<br />
La conférence des Nations-Unies sur les pays les moins avancés<br />
(P.M.A.) tenue à Paris du 1er au 14 septembre 1981 fut pour les dirigeants<br />
français chargés de la politique extérieure et de la coopération<br />
d'internationaliser davantage leur politique de coopération. Monsieur<br />
Jean-Pierre Cot présida la conférence. Le cadre s 'y prêtait. En effet, sur<br />
31 PMA, 21 étaient des pays d'Afrique noire, soit (3):<br />
- Afrique de l'Est : Burundi, Comores, Ethiopis, Ouganda,<br />
Tanzanie, Rwanda, Soudan<br />
- Afrique de l'Ouest et du Centre : Bénin, Cap-Vert, Gambie,<br />
Guinée, Guinée-Bissau, Mali, Niger<br />
Haute-Volta (aujourd'hui Burkina-Faso>,<br />
République Centrafricaine, Tchad, Somalie<br />
- Afrique australe Botswana, Lesotho, Malawi.<br />
(l) François MITTERRAND - Conférence franco-africaine de Paris -3-4 novembre<br />
1981 - Cf. Afrique contemporaine n· 118 - Nov.Déc. 1981- Paris<br />
(2) Cf. Abdoulaye DIARRA - Thèse de 3e cyèle citée - Pp. 24 et suivantes<br />
(3) Cf. Jacques BELOTEAU : "Les 21 PMAd'Afrique Noire" - In Afrique<br />
contemporaine n· 119 - Janvier-Février 1982 - Pages 1-9<br />
- Voir aussi: "Marchés tropicaux et méditerranéens" - 18/09/1981<br />
Paris- pages 23-63 ..
-247-<br />
Cette conférence, en proposant comme ordre du jour les<br />
négociations globales dans le cadre du Nouvel Ordre Economique mondial,<br />
était conforme au projet sur la coopération franco-africaine. La France a<br />
mis en relief sa nouvelle politique en matière d'aide : le cantinent<br />
africain en 1981-1982 a presque bénéficié de plus de la moitié de la<br />
totalité de l'aide française au développement: 57,5 %1 sait 4,5 des<br />
9,4 milliards au total. Quant aux pays francophones d'Afrique, leur part<br />
s'est élevée à 83,7 % de l'ensemble des crédits africains (1), La nouvelle<br />
politique d'aide est, à partir de 1981-1982, appliquée, politique qui<br />
diffère à plus d'un titre de celle pratiquée auparavant. Les tableaux<br />
suivants en témoignent.<br />
(1) Cf. Brigitte MASQUET - France-Afrique : Dépasser les contradictions <br />
In Afrique contemporaine n" 119 - Janvier-Février 1982
-250-<br />
Le tableau I montre sans nuance l'évolution du volume de l'aide publique<br />
au développement en dehors des départements et territoires d'Outre-mer.<br />
Globalement, elle a progressé de 0,34 r. du PNB à 0,45 % entre 1979 et<br />
1982. On constate également une régression relative de l'aide<br />
multilatérale (30 'Z du montant global de l'APD en 1979) à 27 % en 1982.<br />
Les institutions financières internationales. composantes de l'aide<br />
multilatérale, passèrent de 15 % en 1979 à 11 % en 1982. La solidarité<br />
s'est surtout orientée vers les pays touchés par la sécheresse. "Parmi les<br />
pays d'Afrique francophone au sud du Sahara, il faut distinguer la dizaine<br />
de pays les moins avancés pour lesquels nous avons pris l'engagement de<br />
doubler notre aide d'ici à 1985. Durement éprouvés par 18 sécheresse des<br />
années soixante-dix au Sahel, parfois accablés par la chute des cours<br />
mondiaux, cherchant néanmoins à redresser 'leur économie et 8 l'engager<br />
dans la voie du développement, ils méritent toute notre assistance. S'il<br />
est UIl lieu où la solidarité socialiste doit se traduire en programmes<br />
d'aide, c'est bien celui-là" (1). L'aide bilatérale a elle aussi évolué<br />
progressivement de 1979 à 1952. La part de la coopération technique est<br />
passée de 42 OZ en 1979 à 31 OZ en 1982. Quant aux organismes de recherche<br />
CORSTOK et GERDAT). leur part a subi une régression remarquable passant<br />
de 14 % en 1979 à 10 % en 1952. Par cantre la Caisse Centrale de Coopé<br />
ration économique a maintenu sa position dominante (5 % en 1979, 12 % en<br />
1982) par rapport au Fonds d'Aide et de Coopération
-251-<br />
que a régressé de 20 % en 1979 à 15 % en 1981. L'aide a Ltmentat re a connu<br />
une augmentation relative passant de 1 % en 1979 à 2 % en 1981 et 1982.<br />
Les prêts du Trésor ont subi particulièrement une progression notoire<br />
(11 % en 1979, 20 % en 1981 et 18 % en 1982). Ainsi, au niveau de l'aide<br />
bilatérale, les prêts financiers furent nettement renforcés.<br />
D'une manière générale, l'aide bilatérale occupa une place de<br />
choix. Ceci s'expliquerait pour une large part, par la gestion des<br />
coopérants et l'efficacité de cette forme d'aide. "Les traits structurels<br />
du budget d'aide au tiers-monde permettent de préciser la nature de<br />
l'effort français. Les prévisions pour 1983 marquent d'abord une<br />
prépondérance à l'aide bilatérale. Sur la vingtaine de milliards de Francs<br />
consacrés à L'siâe publique, plus des deux-tiers sont affectés à cette<br />
[orme d'aide... Le véritable argument en Laveur de L'a ide bi ls térele se<br />
trouve... dans la nature méme de l'instrument politique mis en place.<br />
Expression d'une volonté politique, la relation bilaiérsIe sert<br />
immédietenetit: les conceptions que nous avons du développement de nos<br />
partenaires. Elle pèse d'un poids politique sans commune mesure avec<br />
l'intervention multilatérale, aux desseins plus flous" (1). La répartition<br />
géographique de cette aide fut fondée sur les préférences ci-dessus<br />
mentionnées tranchant ainsi avec l'ancienne conception en la matière.<br />
Considérons maintenant les tableaux suivants<br />
(1) Jean-Pierre COT - op. cit. - pages 41-42
-252-<br />
III - AIDE PUBLIQUE <strong>FR</strong>AICAISE <br />
Versements en 1981<br />
En millions En millions ';' du total<br />
de Francs de Dollars de l'APD<br />
Aide bilatérale 10 654 1 960 76<br />
DONT :<br />
- Afrique subsaharienne 5 565 1 024 40<br />
- Bassin Méditerranéen 1 756 329 12<br />
- Amérique 1 053 194 7<br />
- Proche-Orient Asie du Sud 625 115 5<br />
- Extrême Orient - Océanie 537 99 4<br />
- Aide non ventilée 1 088 200 8<br />
Aide multilatérale 3 432 632 24<br />
TOTAL A.P.D. 14 086 2 592 100<br />
AIDE AUX DOX-TOX 8 612 1 585
-253-<br />
IV - AIDE BILATERALE VERSEMENTS NETS EN 1981<br />
En millions En miIl ions % du total<br />
de Francs de dollars de l'APD<br />
Coopération technique<br />
et culturelle 4 372 805 41<br />
Aide aux investissements 4 878 898 46<br />
Aide économique et<br />
financière 1 404 258 13<br />
(dont aide alimentaire) (202) (37)<br />
TOTAL APD BILATERALE 10 654 1 960 100<br />
Source Ministère de l'Economie et des Finances<br />
Direction du Trésor - Paris
-254-<br />
v - FORDS D'AIDE HI DE COOPERATION
-255-<br />
Les versements en 1981 relatifs à l'Aide Publique française au<br />
Développement
-256-<br />
ensemble de décisions isolées, parcellisées, sans cohérence. Il offre aussi<br />
aux ititéréte sectoriels mille occasions de s'insinuer, de peser au juste<br />
moment pour emporter l'affaire sans considération de son utilité pour<br />
l'ensemble"
J.<br />
-258-<br />
VII - AIDE KULTILATERALB <strong>FR</strong>ANCAISE<br />
Versements nets en 1981<br />
En millions En millions<br />
de Francs; de dollars<br />
CoIllllllJ nau té Economique Européenne 1 901 350<br />
dont :<br />
- F.E.D. 855 157<br />
- B. E. 1. 9 2<br />
- Aide alimentaire 711 131<br />
- Divers 326 60<br />
Groupe de la Banque mondiale 950 175<br />
dont :<br />
- A. 1. D. 891 164<br />
-S.F.I. 59 11<br />
Banques régionales 251 52<br />
Institutions des Bations Unies<br />
et Autres 300 55<br />
dont :<br />
- P. N. U. D. 135 25<br />
- Autres Nations Unies 165 30<br />
- F. 1. D. A. - -<br />
TOTAL AIDE MULTILATERALE 3 402 632<br />
A. 1. D.<br />
F. E. D.<br />
B. E. 1.<br />
S. F. 1.<br />
P.If. D.D.<br />
F.I.D.A.<br />
Source<br />
Agence Internationale du Développement<br />
Fonds Européen de Développement<br />
Banque Européenne d'Investissement<br />
Société Financière Internationale<br />
Programme des Nations Unies pour le Développement<br />
Fonds international pour le Développement de l'Agriculture<br />
Kinistère de l'Economie et des Finances<br />
Direction du Trésor - Paris<br />
-- -
-259-<br />
La Caisse Centrale de Coopération Economique, selon M. Jean-<br />
Pierre Cot, doit progressivement se transformer en un nouvel instrument<br />
au service du développement des partenaires. Il fallait donc l'orienter<br />
vers les secteurs centraux favorisant un développement équilibré capable<br />
de préserver l'avenir des relations franco-africaines. Au service des<br />
entreprises privées et des banques privées, le développement économique<br />
opéré par les interventions de la Caisse a entraîné un endettement et une<br />
dépendance accrue des partenaires africains. Car sa logique fut incontes-<br />
tablement centrée jadis sur le développement de la liberté commerciale.<br />
"L'endettement sans précédent des pays en développement qu.i aboutit<br />
aujourd'hui a la crise mondiale que l'on sait a joué dans le méne eene.<br />
Nis en oeuvre avec imprudence par le système bancaire privé, encouragé<br />
par les pouvoirs publics, il a engendré plus de mal développement que de<br />
développement, encouragé des dépenses inutiles et dispensé de l'effort de<br />
cohérence qu'implique le développement" (1). La nouvelle politique a donc<br />
consisté à réorienter la caisse vers les secteurs plus productifs dans le<br />
sens de l'autosuffisance alimentaire. Car l'ancienne situation est, selon<br />
Jean-Pierre Cot, avantageuse pour la France à court terme mais dangereuse<br />
et inutile pour le long terme et ceci pour tous les partenaires en<br />
présence (2). L'appareil productif français dans les pays du tiers-monde<br />
ne doit plus se cantonner à la préservation des intérêts français. Car il<br />
n'y aura pas de solution à la crise mondiale sans une participation<br />
effective du sud et donc sans la solution aux problèmes économiques que<br />
connaît le sud. "La solidarité pour le développement avec l'ensemble du<br />
tiers-monde m'apparaît, dit N. Nitterrand, tout à la fois la clef de notre<br />
(1) Jean-Pierre cor - op. dt. - page 51<br />
(2) "Nous avons le choix entre nous cramponner à une situation présente<br />
avec les avantages qu'elle nous offrira pendant quelque temps encore, ou<br />
préparer les nécessaires adaptations structurelles au monde de demain"<br />
Ibid - page 47
-261-<br />
volonté politique ainsi affirmée exigeait une autre vision de l'activité de<br />
la Caisse centrale de coopération économique. Car ses engagements ne<br />
devaient guère favoriser automatiquement les intérêts français.<br />
L'ambigulté de l'action multilatérale résulte pour une large<br />
part de la complexité des circuits internes aux organisations<br />
multilatérales. Nombreux furent les projets agencés et discutés au sein<br />
des organismes multilatéraux qui sont restés sans suite. La Banque<br />
Mondiale (l) et le Fonds Monétaire international ne peuvent, tels qu'ils<br />
sont et tels qu'ils fonctionnent, entrainer un réel développement des<br />
partenaires du sud. La philasophie véhiculée par ces organismes ne<br />
pouvait favoriser un dialogue constructif entre leurs dirigeants et un<br />
gouvernement de gauche (2). Toute action économique qui ne conduit pas 8.<br />
l'instauration d'un marché favorable aux profits n'intègre pas les<br />
préoccupations essentielles de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire<br />
International. Car il s'agit d'intégrer les pays démunis dans les<br />
mécanismes financiers internationaux et ceci en dehors d'une prise de<br />
conscience effective de leur niveau de développement économique. Les<br />
méthodes de redressement économique mises en application par le Fonds<br />
dans les pays en voie de développement se sont avérées inaptes à conjurer<br />
le mal-développement. "Le Fonds a, en la matière, une religion toute faite<br />
qui entraîne souvent des résultats désastreux. Pour rétablir l'équilibre<br />
extérieur, il préconise un ralentissement du train de vie de l'Etat, une<br />
réduction de son activité écotiomique, une dévaluation immédiate, en un mot<br />
une âétIs t ion généralisée. Or; la structure des économies de très nombreux<br />
pays du tiers-monde rend le remède inopérent: et catastrophique. Les<br />
0) Cf. J.L. AMSELLE - La politique de la Banque mondiale en Afrique au<br />
sud du Sahara - In Politique africaine n° 10 - juin I980 - pages 113-118<br />
(2) Cf. Jean-Pierre COT - op. c1t. - page 114
-263-<br />
et de nos peuples, à promouvoir le développement économique et social de<br />
l'intégration de nos économies en vue d'accroître l'auto-indépendance et de<br />
favoriser un développement endogène et auto-entretenu" (1). Le diagnostic<br />
de Lagos s'articule autour des idées-forces parmi lesquelles : l'existence<br />
en Afrique des potentialités économiques, la continuité de l'exploitation<br />
coloniale, les promesses non tenues des organismes et organisations au<br />
niveau international, la persistance des crises socio-économiques dûes aux<br />
problèmes internes et aux influences externes, l'instabilité des cours des<br />
matières premières, le caractère vulnérable du continent, etc... Ainsi la<br />
responsabilité de l'Afrique et celle des puissances est mise en relief.<br />
Seule une action concertée portant sur le court, le moyen et le long terme<br />
serait en mesure de conjurer la crise. Il convenait donc de responsa-<br />
biliser l'OUA. En ce qui concerne les solutions, l'OUA s'est engagée, entre<br />
autres, à créer un marché commun africain, à améliorer la situation<br />
alimentaire sur le continent, à élaborer un projet de création de la cora-<br />
munauté économique africaine, à activer le processus d'industrialisation<br />
des états africains, etc... (2), On comprend dès lors pourquoi Jean-Pierre<br />
Cot se rallie à ces positions africaines sur les problèmes du développe-<br />
ment. L'objectif commun est, ici, le développement auto-centré et la mise<br />
au point au niveau international des accords de co-développement par des<br />
contrats entre le Nord et le Sud (3). Les thèses de Jean-Pierre Cot, au-<br />
(1) Cf. Edmond JOUVE - op. cit. pages 191-198 - Le Plan de Lagos<br />
(2) "Le principe de la cooperetion et de l'autonomie collective que les<br />
étLJts membres ont reconnu, énonce que, concernant le perfectionnement et<br />
L'uti l ieation des ressources humaines, les états membres doivent s'aider<br />
individuellement et collectivement dans leurs efforts pour 1LJ survie et le<br />
progrès. Cependant, l'appui internLJtionLJ1 en faveur du développement des<br />
ressources humaines est souhaitable pour étayer les efforts d'autonomie<br />
africaine. L'assistance doit' être considérée comme reiitorçsut: les efforts<br />
nationaux, régionaux et multilatéraux de développement que les états membres<br />
doivent déployer afin de faciliter le développement et le progrès.. H<br />
Plan d'action de Lagos, cité par Edmond JOUVE - op. dt. - p. 195<br />
(3) Cf. Jean-Pierre COT: "Une dimension internationale au plan"<br />
Le Monde du 29 décembre 1981
-267-<br />
politiquement de ,:;ette stratégie du passé, Monsieur Jean-Pierre Cot a<br />
tenté de faire prévaloir une autre stratégie économique sous-tendue par<br />
une vision politique. "Un développement auto-centré, cela l'eut dire quoi ?<br />
Dans mon esprit, cela veut dire des espaces physiques, économiques, so-<br />
claux et lIne organisation des échans-es. Cela veut dire une revit"liSéltion<br />
des sociétés productives, et notamment: des paysanneries .. cela veut dire<br />
une e.''.oloitation endogène et indigène des espaces et des richesses. Ces<br />
trois principes C .. ) prennent èI contre-pied ceux qui souhaitent renforcer<br />
la division internationale du travail, la tit érnrobiest ton des espaces, la<br />
polarisation des échanges" (1) dit Monsieur Jean-Pierre Cot. Cette<br />
conception qui tranche avec le néo-libéralisme fondé sur l'interdépendance<br />
constitue une originalité politique par rapport à d'autres conceptions<br />
défendues au sein du Gouvernement socialiste. Bien entendu l'exploitation<br />
indigène et endogène n'est pas assimilable dans l'esprit de Monsieur Jean-<br />
Pierre Cot à l'instauration d'une économie communiste ou à la victoire de<br />
la stratégie communiste internationale dans le6 pays africains. <strong>L'A</strong>frique<br />
subsaharienne est inserrée dans les mécanismes financiers internationaux.<br />
Les puissances économiques y sont plus que jamais présentes. Le constat<br />
de certaines réalités va imprimer au discours une articulation autre. Mon-<br />
sieur Jean-Pierre Cot opte enfin pour le développement indépendant (2),<br />
développement qui serait conforme à un non-alignement politique et<br />
économique des états subsahariens. Mais le non-alignement de ces états ne<br />
signifie pas, selon Jean-Pierre Cot, l'absence totale de la France en<br />
Afrique. Or une telle présence, on l'a vu, est à la fois politique,<br />
économique et stratégique. La présence française devrait être fonction de<br />
-268-<br />
l'observation d'un certain nombre de principes
-269-<br />
les opérateurs privés par le développement en commun de tel ou tel projet<br />
elle implique des "paye ciblés", désormais nommés "points d'appui", tels<br />
que le Kexique, l'Algérie, l'Inde et, au sud du Sahara, le Zimbabwé et le<br />
Nigéria. La pratique, là aussi, a été décevante" (l), Cette stratégie que<br />
nous appelons intermédiaire s'est naturellement confrontée à des réalités<br />
économiques et financières entièrement sous le contrôle de la Banque<br />
mondiale et du Fonds Jll:onétaire International. La Banque Mondiale a systé-<br />
matiquement transformé le paysage économique et social des pays qu'elle a<br />
investis depuis la crise des annèes soixante-dix. Véritable "Ministère de<br />
le Fonds ont entraîné de par leur leadership sur le continent, un renfor-<br />
cement accru de la présence amérIcafne donc des entreprises multinatio-<br />
nales sous tutelle B.méricaine. Ils sont présents dans tous les secteurs<br />
économie, fonction publique, système scolaire et universitaire, etc...<br />
En s'infiltrant insidieusement et profondément dans les struc-<br />
tures socio-économiques et financières en Afrique, la Banque Mondiale et<br />
le F.X,!. restent au service d'une conception politique qui ne peut, de par<br />
sa logique, favoriser le co-développement, encore moins le développement<br />
indépendant. "... la Banque mondiale poursuit deux objectifs complémeti-:<br />
taires : l'insertion des économies des pays en voie de développement: dans<br />
l'économie mondiale sous la larme de la spécialisation selon "1'avantage<br />
comparatif" et les ajustements en réponse aux prix internationaux ; lB<br />
dissolution des zones d'influence prépondérantes des anciennes métropoles<br />
coloniales et leur ouverture.9 l'influence américaine" (3 j. La primauté de<br />
(1) Jean-François BAY ART - op. cit. page 89<br />
(2) Ibid - page 92<br />
(3) Ibid - pages 92-93
-270-<br />
la Banque Mondiale en Afrique subsaharienne ne fait guère de doute depuis<br />
la publication du rapport Berg (1). On le sait, on l'a dit, nous le répé-<br />
tons : la Banque mondiale et le Fonds Monétaire International il 'ont rien<br />
entrepris qui va dans le sens de la satisfaction des besoins de l'énorme<br />
majorité des populations africaines.<br />
Coincée entre la nécessité de préserver la présence française<br />
et la primauté d'autres puissances en Afrique, la stratégie du co-<br />
développement ou plus concrètement du développement indépendant est<br />
restée sans efÏet pour le long terme, La multiplicité des centres de<br />
décision, centres souvent en désaccord, ne rendait pas l'opération facile.<br />
Car au-delà des ambiguités des textes qui recommandent "des<br />
collaborations et des co-financements" avec les organismes multilatéraux,<br />
ces textes sont structurés à la direction du Trésor "dont les<br />
Îonctionnaires sont en majorité acquis ou résignés aux thèses du F,M.I."<br />
(2). On pense, dès lors, aisément que le développement indépendant qui est<br />
bien entendu un choiX politique (3) ne pouvait être concrétisé avec l'aide<br />
de ces hauts fonctionnaires de l'Etat français.<br />
Outre les contraintes internationales, la stratégie de Monsieur<br />
Jean-Pierre Cot était aussi subordonnée à une restructuration des services<br />
chargés de la coopération. Nous y reviendrons.<br />
(1) Cf. également : Jean-Loup AIŒELLE<br />
La politique de la Banque Mondiale en Afrique au Sud du Sahara<br />
op. cit. pages 117 et suivantes<br />
Analyse centrée sur les conclusions du rapport Berg<br />
(2) Jean-François BAYART - op. cit page 93<br />
(3) Monsieur Jean-Pierre COT insiste et écrit "Le développement<br />
indépendant ou auto-centré, ce n'est pas seulement un choix économique...<br />
C'est une volonté de structurer et de renforcer patiemment une société<br />
pour lui. permettre de résister au choc international et aux mécanismes de<br />
dépendance qui jouent sur le plan monâie)" - op. cit. page 59
-271-<br />
Notons, ici, que cette réorganisation du Ministère de la<br />
Coopération fut réalisée suite à. une action concertée du Ministère de la<br />
Coopération et du Ministère des Affaires extérieures. Entreprise dès 1981,<br />
cette restructuration du Ministère de la Coopération fut officialisée par<br />
le décret du 30 juillet 1982 (1).<br />
La Présidence de la République reste au centre de l'action<br />
extérieure de la France. Le concept de "domaine réservé" a très fortement<br />
limité la stratégie de type réformiste de Monsieur Jean-Pierre Cot. Il<br />
convient maintenant d 'y mettre un accent particulier. Car le concept de<br />
"domaine réservé" pose un problème institutionnel, et il n'est pas sans<br />
influencer sérieusement les rapports politiques entre le Parti, le<br />
Gouvernement et la Présidence elle-même.<br />
B - LE CONCEPT DU "DOMAINE RESERVE" OU LES LIXITES D'lf1ΠPOLITIQUE DE<br />
COOPERATION<br />
L'élaboration et l'application de la politique extérieure ou<br />
étrangère des grandes puissances peuvent varier au niveau des moyens.<br />
Dans le domaine de la finalité, la politique extérieure des Etats repose<br />
sur la recherche et la préservation de l'intérêt national. C'est pourquoi<br />
l'Etat occupe toujours une place de choix en matière de politique<br />
extérieure ou internationale. Il est certes difficile, sinon impossible, de<br />
soutenir l'existence d'une théorie universelle relativa à l'élaboration des<br />
politiques extérieures ou internationales des Etats mais la primauté des<br />
dirigeants placés aux sommets des Etats est un fait historique et tou-<br />
(1) Jean-Pierre COT - op. cit.
-273--<br />
l'Homme et du Citoyen de 1789. Comment s'expHque donc la primauté<br />
accordée à l'exécutif en matière de politique extérieure ? Un bref rappel<br />
historique nous semble ici indispensable. Prenons quelques-unes des<br />
Constitutions françaises depuis 1789 (1).<br />
La Constitution française du 3 septembre 1791 avait mis un<br />
accent particulier sur le rôle du corps législatif et sur celui du Rai en<br />
matière de politique extérieure «Ar-ticle 3 "Il appartient au corps<br />
législatif de ratifier les trnttée de paix, d'alliance et de commerce ; et<br />
aucun traité n'aura d'effet que par cette rett t icetion'», La représentation<br />
populaire est donc ici un acteur potentiel en matière extérieure car le<br />
commerce avec l'extérieur y occupe une place particulière. La diplomatie<br />
est menée par le Rai qui signe les traités dont la validité est subor-<br />
donnée à la ratification du pouvoir législatif (Chapitre IV - Section III).<br />
"Artic1e Premier Le Roi peut entretenir des relations<br />
politiques au dehors, conduire les négociations, faire des préparatifs de<br />
guerre proportionnés à ceux des Etats voisins, distribuer les forces de<br />
terre et de mer ainsi qu'il jugera convenable et en régler 18 direction en<br />
cas de guerre".<br />
"Article 3 ; Il appartient au Roi d'arréter et de signer avec<br />
toutes les puissances étrangères, tous les traités de paix, d'alliance et<br />
de commerce, et autres conventions qu'il jugera nécessaires au bien de<br />
l'Etat, sauf la ratification du corps législatif" (2).<br />
(1) Les Constitutions de la France depuis 1789 - Présentation par Jacques<br />
GODECHOT, Doyen de la faculté des Lettres et Sciences humaines de<br />
Toulouse - Flammarion - Paris 1979 - 499 pae;es<br />
(2) Constitution de 1791· - Chapitre IV - Section III - Articles 1 et 3<br />
C'e:ô;t nous qui soulignons
-274-<br />
La Conv-snt.ton na t IonaIe a décI-été la fin de la royauté en<br />
Fran('8 (décret de", 21-22 septembre 17921. La République est proclamée<br />
(décret, du 25 '3eptembre 1792), La Constitut:ion de 1793 reprend Ia<br />
déclaration des Droits de l 'Horn me et du Citoyen et les pouvoirs du corps<br />
législatif sont renforcés fabrication des monnaies de toutes espèces, la<br />
rJ.éfense du territoire, }'3 rattfication des troités, nom t nat Lon Rt<br />
desl:itution des commandants en chef des armées, etc,« Il est donc de':enu<br />
lE' centre de l'élaboration ."t; de l'application de La politique extèri.8ure<br />
de La République française (1),<br />
En Hl'!anche, ta Constitution du 22 août 1795 r'?staure la<br />
situation et accorde la primauté du Directoire exécutif en matière<br />
internationale, LBS articles 329, 331 et 333 du Titre XII stipulent<br />
respectivernen t "Le Directoire seul peut entretenir des reIe i iotie<br />
politiques au-dehors, conduire les négociations, distribuer les forces de<br />
t.erre et de mer, ainsi qu'il le juge convenable et en régLer Ls direction<br />
en cas de guerre", "Le Directoire exécutif errét.e, signe ou fait s igner<br />
alrec les puissances ét.renger-ee, tous les traités de paix, d'alliance, de<br />
t r éve, de neutralité, de commerce et autres con\rentions qu'.i1 Juge<br />
nécessaires au bien de l'Etat,. Ces traités et conventions sont négociés au<br />
nom de 18 République française, par les grands agents diplomatiques<br />
nommés par le Directoire exécutif, et chargés de ses instructions", "les<br />
traités ne sont valables qu'après avoir été examinés et ratifiés par le<br />
corps législat,if<br />
;&L 1e Dicectau»Il (2).<br />
(1) Constitution de 1793 - Article 55<br />
(2) Const i tut.ton du 22 août 1795 - Titr-e XIIe<br />
Articles 329, 331 et 333
-277-<br />
Considérons maintenant la Constitution de la IVe république,<br />
c'est-A-dire celle du 27 octobre 1946. Le Président de la République n'est<br />
évoqué qu'au niveau du Titre V, les quatre premiers étant_ réservés<br />
respectivement et probablement par ordre d'importance à la Souveraineté,<br />
au Parlement, au Conseil économique et aux Traités diplomatiques. Ce qui<br />
confère incontestablement un pouvoir accru au Parlement par rapport A la<br />
Présidence de la République et ceci dans presque tous les domaines. "<strong>L'A</strong>s-<br />
eeiublée nationale vote seule la loi. Elle ne peut déléguer ce droit" (1).<br />
Selon les termes de l'article 27 "les traités relatifs à l'organisation<br />
internationale, les traités de paix, de co.m.merce, les traités qui engagent<br />
les finances de l'Etat, ceux qui sont relati.fs à l'état des personnes et au<br />
droit de propriété des Français à l'étranger, ceux qui modifient les lois<br />
internes françaises, ainsi que ceux qui comportent cession, échange,<br />
adjonction du territoire ne sont définitifs qu'après avoir été ratifiés en<br />
vertu d'une loi" (2) • Le Président de la République est sous la<br />
subordination politique du Parlement car l'article 29 précise que le<br />
Président de la République est élu par l'Assemblée Nationale. Il est<br />
simplement informé des négociations internationales, signe et ratifie les<br />
traités. L'Union française
-278-<br />
térêt de la France métropolitaine au sein du système international. En<br />
définitive, le concept de "domaine réservé" n'a pas préoccupé les<br />
constituants de 1946. Néanmoins, le cas de l'Union française ne fut pas<br />
dissocié de l'avenir de la France métropolitain et ceci dans plus d'un<br />
domaine.<br />
La Constitution du 4 octobre <strong>1958</strong>, celle aujourd'hui en vigueur,<br />
mérite ici une mention particulière. Nombreux furent les facteurs tant sur<br />
le6 plans interne qu'externe au territoire français qui ont nettement<br />
influé sur la structure de la loi fondamentale française de <strong>1958</strong>. On peut<br />
sommairement citer : les revendications des peuples colonisés de 1956 à<br />
Bandoung ; la crise algérienne et ses conséquences 6ur le plan africain et<br />
\<br />
au niveau international<br />
les travaux du Comité de décolonisation des<br />
Nations-Unies, la guerre froide et ses conséquences sur le plan<br />
international ; les conséquences de l'instabil1té gouvernementale sous la<br />
IVe République, etc... Il convient de noter ici que ces facteurs ont joué,<br />
directement ou indirectement, sur la nature et le fonctionnement des<br />
rapports que la France entendait entretenir avec le continent africain.<br />
Nous parlons de l'Etat et du rôle du Président de la République française<br />
en matière internationale au sein d'une société internationale en quête<br />
d'une stabilité politique, économique et stratégique. Structurée en un<br />
préambule, quinze titres et 92 articles, la Constitution de <strong>1958</strong> est l'une<br />
des plus longues que la France ait connues. La Déclaration des droits de<br />
l'Homme est réaffirmée, la République française et les peuples des<br />
territoires d'Outre-mer forment une communauté et ceci suite à un acte de<br />
"Li bre détermination". La volonté de restaurer la capacité de l'Etat est<br />
nettement mise en relief par la structure même de la Constitution. Sant<br />
respectivement -traités et sûrement par ordre d'importance après le
-279-<br />
préambule, la Souveraineté, le Président de la République. le Gouvernement,<br />
le Parlement, etc... Cet ordre est significatif en matière de politique<br />
interne et internationale. Les pouvoirs du Président de la République sont<br />
particulièrement renforcés. Il est le gardien de la Constitution. Il joue<br />
le rôle d'arbitre face au fonctionnement général et régulier des pouvoirs<br />
publics tout en assurant la garantie de l'indépendance nationale. Il nomme<br />
le Premier Ministre. Il peut. sous condition, dissoudre l'Assemblée<br />
Nationale. Il est le Chef des armées et préside le Conseil supérieur de la<br />
magistrature. L'article 16 confère au Président des pouvoirs exceptionnels<br />
en cas de crise généralisée. Il peut recourir au référendum -article 11-<br />
Cl) HLe gouvernement a des pouvoirs immenses, et mal définis, mais bornés<br />
par sa responsabilité devant le parlement" (2) écrit Jacques Godechot.<br />
C'est le gouvernement qui détermine et conduit la politique d'ensemble de<br />
la Nation. Il assure les pouvoirs exécutif et réglementaire. Quant aux<br />
rapports entre le Président de la République, la loi du 6 novembre 1962,<br />
relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel<br />
fait apparaître la primauté présidentielle du fait même de son élection au<br />
suffrage universel direct pour sept ans. Quelle est donc la nature du<br />
régime issu de la Constitution de <strong>1958</strong> ? Selon Jacques Godechot ..... le<br />
Général de Gaulle a écarté nettement tout régime "présidentiel" modelé sur<br />
les Constitutions de 1848 et de 1862 ou sur celle des Etats-Unis. Le ré-<br />
gime reste parlementaire, mais plus proche des régimes présidentiels Bmé-<br />
ricains que du parlementarisme "orléaniste" de 1875 ou celui de 1946" (3).<br />
Ce présidentialisme au second degré ne peut que pose la question du<br />
"domaine réservé" en matière internationale. Le titre XII de la Constitu-<br />
(1) Cf. Constitution du 4 octobre <strong>1958</strong> - Titre II "Le Président de la<br />
République<br />
(2) Jacques GODECHOT : Les Constitutions de la France - op. cit. page 417<br />
Cf également : Constitution du4 octobre <strong>1958</strong> - TITRE III Le gouvernement<br />
(3) Jacques GODECHOT - op. cit. page 414
-280-<br />
tution de <strong>1958</strong> ne change point la nature de cette question. Car les<br />
indépendances massives des années soixante ont profondément modifié la<br />
structure politique de la communauté et les institutions de la communauté<br />
ont progressivement été remplacés par des accords bilatéraux et<br />
multilatéraux entre les membres de la communauté ou entre la métropole et<br />
ses anciennes colonies devenues indépendantes. Il s'agit là aussi d'un<br />
héritage théorique de la Ve République pour la gauche au pouvoir. Qu'en<br />
est-il de la pratique du concept du «domaine réservé« ? La pratique en la<br />
matière du Premier Président de la Ve République est sans équivoque car<br />
le Général de Gaulle passa de la contestation du "domaine réservê" à son<br />
adoption (1). A l'instar du Chef de l'Etat des Etats-Unis, du Chef de<br />
Gouvernement de la Grande-Bretagne et de la République fédérale allemande<br />
et du Premier Secrétaire du parti unique de l'Union soviétique, la<br />
politique extérieure française devient une affaire personnelle du Général<br />
de Gaulle. Sa place et son rôle en matière de politique franco-africaine<br />
se sont imposés de part les institutions et la situation qui prévalait sur<br />
le continent de manière sans nuance. Il le confirma lui-même en écrivant;<br />
"Si, dans le champ des affaires, il n 'y a pas pour moi de domaine qui soit<br />
négligé, ou réservé, je ne manque évidemment pas de me concentrer sur les<br />
questions qui revêtent la plus grande importance générale. Au point de vue<br />
politique, ce sont, au premier chef, celles qui concernent l'unité<br />
nationale ainsi du problème de l'Algérie, des rapports d'association qui<br />
remplacent notre souveraineté dans l'Union française. Notre setion<br />
extérieure requiert mon impulsion puisqu'elle engage notre pays à longue<br />
échéance et d'une manière vitisIe ; au demeurant, la Constitution rend<br />
explicitement le Président de la. République garant de l'indépendance et<br />
spécifie qu'il négocie et rst i t ie les traités, fait de nos Ambassadeurs<br />
(1) Cf. Marcel JŒRhE - op. cit. pages 309 et suivantes
-281-<br />
ses représentants personnels et disposent que ceux des états étrangers<br />
sont accrédités auprès de lui. Il va de soi, enfin, que j'imprime ma<br />
marque à notre défense, dont la transformation est tracée suivant ce que<br />
j'indique et ou la morale et la discipline de tous font partie de mon<br />
ressort : cela pour d'évidentes raisons qui tiennent à mon personnage,<br />
mais aussi parce que, dans nos institutions, le Président répond de<br />
"l'intégrité du territoire", qu'il est "le Chef des Armées", qu'il préside<br />
"les conseils et comités de la défense nationale" (1). Cette primauté du<br />
Chef de l'Etat en matière extérieure est d'autant plus significative<br />
qu'elle va désormais s'inscrire dans la durée du fait de l'élection pour<br />
sept ans du Chef de l'Etat. Les relations franco-africaines furent et<br />
demeurent organisées en fonction de cette réalité devenue désormais une<br />
coutume incontournable. Car au-delà des accords et des textes ce sont les<br />
hommes qui vont imprimer de façon spécifique leur marque à la politique<br />
africaine de la France. Cette politique n'échappera point à la<br />
personnalisation aux conséquences souvent imprévues et non légitimes, Ce<br />
fut le cas de second Président de la République française Valéry Giscard<br />
d'Estaing. Aidé par une équipe personnelle et presque autonome installée à<br />
l'Elysée, Monsieur Giscard d'Estaing fut le principal auteur des grandes<br />
actions internationales françaises durant son septennat. <strong>L'A</strong>frique occupe<br />
parmi celles-ci une place centrale les interventions militaires en<br />
Afrique, le tissage de relations particulières avec les dirigeants<br />
africains la conception du tragique et éphémère empire centrafricain,<br />
etc... Dans le cas précis du continent africain il a notamment affirmé ;<br />
"Lorsque des questions étaient posées, on disait : les Affaires étrangères<br />
/'le..<br />
déclarent que cëvéont: pas elles, la Coopération dit que ce n'est pas elle,<br />
(1) Le Général de GAULLE, cité par Marcel MERLE - op. cit. page 309<br />
La dimension politique de l'observation vaut qu'elle solit citée en<br />
entier .
-282-<br />
c'est l'Elysée. J'occupe cette responsabilité parce que j'estime qu'en effet<br />
il Y a des grandes orientations politiques qu'il faut prendre. Ces<br />
orientations de la politique française figureront parmi celles qui seront<br />
à l'actif de la période actuelle... J'ai pris, par exemple, en Afrique, des<br />
risques que peu de gens auraient pris à ma place et que tous ceux qui<br />
étaient autour de moi ont paru ne pas vouloir prendre, ni même partager<br />
quelquefois" (l). Ces actions personnelles, ces risques et leurs suites<br />
feront partie de l'histoire des relations franco-africaines. C'est aussi un<br />
héritage en matière de "domaine réservé".<br />
Le Premier Secrétaire du Parti socialiste français, Monsieur<br />
François Mitterrand, hostile à la Constitution de <strong>1958</strong>, déclara devant<br />
l'Assemblée Nationale, le 24 avril 1964 que "le secteur réservé violait la<br />
Constitution". Elu confortablement Président de la République le 10 mai<br />
1981, François Mitterrand va immédiatement mettre en application les<br />
institutions de la Ve république, du moins celles qui concernent le<br />
Président de la République et faire sienne la pratique du "domaine<br />
réservé". Dès juillet 1981, le Président lui-même donne le sens politique<br />
de ce domaine en précisant : "Nul n'ignore, au sein du gouvernement comme<br />
ailleurs, que le Président de la République peut li tout moment faire<br />
prévaloir l'opinion qu'il a de l'intérêt national ... Le Président de la<br />
République exerce un pouvoir éminent, particulièrement dans le domaine des<br />
relations extérieures et de la défense. Cette répartition des rôles<br />
n'implique aucune exclusive contre quiconque. Elle reflète 11Ia volonté<br />
légitime de contrôler personnellement tout ce qui touche à la sécurité du<br />
(1) Entretien télévisé avec J.P. Elkabach le 27 novembre 1976<br />
Cité par Karcel MERLE - op. cit. page 310<br />
Cf. également : La France en mai 1984 - Tome V "L'Etat et le citoyen"<br />
Documentation française - décembre L98_1 - pages 30 et suivantes
-283-<br />
pays Cl). Là aussi, la continuité de l'interprétation présidentielle de la<br />
Constitution est sans équivoque. Le Président reprendra progressivement<br />
et en d'autres termes les formules de ses prédécesseurs. C'est dire que le<br />
quatrième Chef de l'Etat français domine depuis 1981 la conception,<br />
l'application et le contrôle de l'action internationale de la France et en<br />
particulier les rapports franco-africains. La situation conflictuelle entre<br />
la présidence de la République et le Ministère de la Coopération va<br />
prendre une dimension consistante compte tenu de la fidélité du nouveau<br />
ministère chargé de la coopération au programme du parti socialiste<br />
\<br />
notamment en ce qui concerne la réorientation de la politique africaine de<br />
la France. Paradoxalement, la continuité de cette situation conflictuelle<br />
mais toujours à l'avantage du Chef de l'Etat sera entretenue suite aux<br />
déclarations de Monsieur François Mitterrand lui-même "La majorité<br />
politique de 18 France vient de s'identifier il S8 majorité sociale" (2) en<br />
ajoutant quelques jours après "J'exercerai dans leur plénitude les<br />
pouvoirs que me confère la Constitution. Ni plus ni moins les institutions<br />
n'étaient pas faites à mon intention. Hais elles sont bien faites pour<br />
moi. J'y vois quand méme quelques défauts. Je crois avoir écrit quelque<br />
chose la-dessus" (3).<br />
L'ossature du programme socialiste Nord-Sud en général et en<br />
particulier franco-africain fut largement ob l Ltérée par la continuité de<br />
la primauté présidentielle et du poids sans cesse croissant de la<br />
nouvelle équipe autour du nouveau Président de la République. La permanen-<br />
(1) François MITTERRAND - Interview au Monde le 2 juillet 1981<br />
(2) François MITTERRAND - Le Monde du 11 mai 1981<br />
(3) François MITTERRAND - Le Monde du 2 juillet 1981<br />
Cf. également Jean-Louis QUERMONNE : Un gouvernement présidentiel ou<br />
un gouvernement. partisan - In Revue "Pouvoirs" n ' 20 - 1982 - Pp 67-88<br />
Nous y reviendrons
-284-<br />
ce du "domaine réservé" a incontestablement limité le sens politique que<br />
Monsieur Jean-Pierre Cot a voulu imprimer aux relations franco-africaines.<br />
Les ordres permanents de la cellule élyséenne en la matière et la contrôle<br />
politique des actions du Ministre de la Coopération par celle-ci<br />
écourtèrent l'expérience Cot. L'action de Monsieur Jean-Pierre Cot fut<br />
constamment revue et mise à jour par l'Elysée sous la conduite du<br />
Conseiller pour les affaires africaines, Monsieur Guy Penne, un proche du<br />
Président de la République. D'où la démission acceptée de Monsieur Cot en<br />
décembre 1982 et son remplacement immédiat par le même Guy Penne. Ici<br />
aussi, la continuité a emporté sur la volonté du changement. Le rappel<br />
historique, si sommaire sait-il, semble prendre ici une signification<br />
profonde. Les attributions autrefois conférées aux rois français et<br />
aujourd'hui presque reconnUES aux présidents de la République, donc<br />
adaptées aux exigences du temps, montrent la constance en matière<br />
internationale.<br />
Ainsi de 1981 à 1982
-285-<br />
un rôle de premier plan et chose inédite sous la Ve République, de nature<br />
politique, put constater au fil des semaines que l'essentiel de ses<br />
prérogatives lui échappait et que maintes de ses initist ivee étaient<br />
neutralisées" (1). Les questions économiques et le droit de l'Homme, on l'a<br />
vu, furent au centre de la "démarche Cot". Quant à l'Elysée, elle concentra<br />
ses forces sur la dimension géopolitique et stratégique, dimension<br />
d'ailleurs non négligée par Monsieur Cot. Le nouveau responsable de la<br />
Coopération, Monsieur Nucci, devait par suite lever toute équivoque "Le<br />
Président l'a dit et répété : c'est lui seul qui, après consultation,<br />
détermine les axes de notre politique extérieure. Moi, j'applique. Tout cela<br />
est d'une simplicité absolue et je n'ai aucun drame de conscience cl ce<br />
sujet" (2). Ce conformisme exemplaire ne fut pas sans conséquence t ragi -<br />
que. Les affaires ont repris et certaines d'entre elles compromettent de<br />
nos jours la crédibilité du successeur immédiat de Monsieur Cot. C'est le<br />
cas de "l'Affaire du Carrefour du Développement". Malgré les déboires liés<br />
à cette continuité, le Président de la république persista et signa en<br />
déclarant : "C'est moi qui détermine la politique étrangère de la France,<br />
pas mes Ministres (, .. ) Il n'est pas interdit aux Ministres de penser ou<br />
d'avoir une opinion (... ) Il D'est pas concevable qu'une politique soit mise<br />
en oeuvre sans mon accord, plus exactement Sélns mon impulsion" (3). Le<br />
concept de "domaine réservé" a donc résisté à l'effet du temps. Les<br />
institutions le renforcent et les hommes continuent d 'y imprimer leurs<br />
propres marques, marques critiquées, contestées et contestables.<br />
0) Jean-François BAYART - op. cit. page 45<br />
Cf également : Jeune Afrique du 22 décembre 1982 "Départ de Cot les<br />
Africains y gagnent-ils 7"<br />
(2) Cité par Jean-François BAYART - op. cit , page 48<br />
(3) Ibid - page 4_8
-286-<br />
L'expérience Cot a mis aussi en relief un aspect moins important en<br />
matière d'élaboration et d'application de la politique étrangère. Il s'agit<br />
des liens entre le Président, le Parti socialiste et le Gouvernement.<br />
2· Rapports PS-Gouvernement-Présldence<br />
L' intervention des partis dans l'élaboration et l'application<br />
de la politique nationale est Ul1 phénomène relativement récent en<br />
Occident (1). Car les partis se situaient jadis en dehors des lois<br />
fondamentales. Le "parlementarisme rationalisé" ne fait son apparition<br />
qu'après la première guerre mondiale modifiant par conséquent les règles<br />
du jeu dans la vie politique. Ainsi le parlementarisme et le droit<br />
parlementaire devinrent des réalités difficilement contournables en Europe<br />
occidentale. Les partis sont par la suite devenus de véritables acteurs de<br />
la vie politique. "Le fonctionnement du parlementarisme est intimement lié<br />
au problème des partis. Et c'est peut-être un des phénomènes les plus<br />
intéressants du droit constitutionnel nouveau que l'apparition de partis<br />
politiques sur la scène du droit écrit. 18 "rationalisation" a poussé les<br />
auteurs des constitutions à reconnaftre la qualité<br />
constitutionne.l1e aux partis politiques" (2). L'action des partis 1 action<br />
juridiquement reconnue, conféra au concept démocratie une dimension<br />
supplémentaire et fondamentale (3).<br />
Les partis politiques seront reconnus par les textes constitu-<br />
tionnels après la seconde guerre mondiale, reconnaissance qui ne sera pas<br />
sans conséquence sur l'évolution des rapports entre les institutions et<br />
(1) Cf. Pierre AVRIL - Essais sur les partis - L.G.D.J. Paris 1986<br />
209 pages - "Partis et constitution" pages 103-123<br />
(2) B. MIRKINE-GUETZEVICH cité par Pierre AVRIL - op. cit. page 105<br />
(3) Pierre AVRIL - ibid - page 105 et suivantes
-287-<br />
les acteurs politiques dans les pays d'Europe occidentale concernés.<br />
L'article 4 de la Constitution française du 4 octobre <strong>1958</strong> stipule "Les<br />
partis et groupements politiques concourent à l'expression du. suffrage.<br />
Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter<br />
les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie" Cl).<br />
Ainsi la Ve République reconnaît constitutionnellement aux<br />
partis politiques le rôle essentiel de "concourir à l'expression du<br />
sufÏrage" (2). Les partis sont donc des appareils électoraux au sens<br />
constitutionnel du terme. L'Etat et le Parti constituent ici, et dans<br />
l'esprit des péres fondateurs de la Vs République, deux réalités<br />
distinctes. Cependant l'évolution des rapports Etat et Partis dans les<br />
démocraties occidentales en général et dans la démocratie française en<br />
particulier pose en réalité la question relative aux rapports entre le<br />
parti (groupe parlementaire>, le gouvernement et la presidence de<br />
république. La primauté présidentielle en Illatière de politique franco-:<br />
africaine, primauté qui résiste aux aléas du temps, altèrent sérieusement<br />
la place et le rôle des groupes parlementaires voire dans une certaine<br />
mesure du gouvernement dans l'élaboration et l'application de la politique<br />
îranco-africaine. La gauche française au pouvoir s'est confrontée aussi a<br />
ce phénomène aux conséquences multiples (3). Ce qui expliquerait, pour<br />
(1) Article 4 de la Constitution française du 4 octobre <strong>1958</strong><br />
(2) Ibid<br />
(3) Confert documents suivants ;<br />
- Hugues PORTELLI ; La présidentialisation des partis français <br />
Pouvoirs n· 14 - 1980 - Pages 97-106<br />
- Olivier DU<strong>HA</strong>MEL : 1981 : la Ve achevée sur dix caractéristiques du<br />
régime - Pouvoirs n· 20 - 1982 - Pages 127-135<br />
- Pierre AVRIL ; "Chaque institution a sa place..." - Le Président, le<br />
Parti et le Groupe - Pouvoirs n ' 20 - 1982 - Pages 115-126<br />
Jean-Louis QUERMONNE Un Gouvernement présidentiel ou un<br />
Gouvernement partisan? Pouvoirs n" 20 - 1982 - Pages 67-86<br />
- Samy COHEN : "Les hommes de l'Elysêe - Pouvoirs n ' 20 - 1982<br />
pages 87-100
-288-<br />
notre part, la difficulté politique du groupe parlementaire socialiste<br />
voire du gouvernement, ministère de la Coopération et du Développement, de<br />
faire appliquer ou d'appliquer le projet socialiste en matière de<br />
coopération franco-africaine. Jean-François Bayart ne dit pas autre chose<br />
lorsqu'il écrit: "Dans l'affaire du Tchad
-289-<br />
a entraîné dans une certaine mesure la dépendance du Parti socialiste par<br />
rapport au Chef du courant dominant, ce qui n'est pas sans conséquences<br />
politiques sur les projets du Parti et sur la structure du ·programme<br />
gouvernemental, et d'autre part la stratégie présidentielle au sein du<br />
Parti et l'action du Président une fois investi échappe dans plus d'un<br />
domaine au contrôle de l'appareil politique qu'est le Parti. Car dès<br />
Juillet 1981, le nouveau Président socialiste met l'accent sur la<br />
particularité du pouvoir du Président de la République par le message<br />
suivant au Parlement aussi duquel le groupe social détient la majorité des<br />
sièges. "Le changement que j'ai proposé au pays pendant la campagne<br />
présidentielle que les Françaises et les Français ont approuvé, que la<br />
majorité de l'Assemblée Nationale a fait sienne comma.nde désormais vos<br />
démarches... mes engagements constituent la charte de l'action<br />
gouvernementale. J'ajouterais, puisque le suffrage universel s'est prononcé<br />
une deuxième fois, qu'ils sont devenus la charte de votre action<br />
législative" Cl). Ainsi la volonté politique théoriquement exprimée en<br />
<strong>1958</strong> de mettre les Partis à l'extérieur de l'Etat fait désormais partie de<br />
l'histoire. La réalité d'aujourd'hui est toute autre. Lorsque "le Parti<br />
dominant" se transforme en "Parti du Président", 11 ne peut être, en fin<br />
de compte, qu'un parti sans la domination de la présidence (2). Par<br />
conséquent, le Parlement et le Parti jouent certes leur rôle, mais pour<br />
l'essentiel ils sont relégués au second plan. Le Président contrôle alors<br />
strictement les centres de pouvoir. Ce fut le cas de Georges Pompidou e t<br />
celui de François Mitterrand de 1951 à 1986. "Dans un cas comme dans<br />
l'autre, en effet, les deux Présidents ont puisé dans le vivier de leur<br />
(1) François MITTERRAND - Kessage au Parlement le 8 Juillet 1981<br />
Cité par Olivier DU<strong>HA</strong>MEL - op. dt. page 129<br />
(2) Cf. Jean-!-ouisQUERMONNE La Présidence de la République et le<br />
système de parti - In Pouvoirs n' 41 - 1987 - pages 93-113
·-290-<br />
parti respectif les hommes (et plus rarement les femmes) placés au poste<br />
de responsabilité... Ils ont exercé leur arbitrage entre les candidats à la<br />
Présidence de l'Assemblée nationale. Ils ont, en fait, désigné eux-mêmes<br />
les principaux responsables de l'appareil du Parti dominant et son propre<br />
groupe parlementaire. Au sein du Parlement, ils n'ont pas hésité à<br />
influencer l'élection des présidents de commissisons" (l). Cette absence<br />
d'autonomie du Parlement, du moins du Groupe parlementaire socialiste,<br />
substituée au domaine réservé fait de la présidence de la République, le<br />
centre de la politique nationale, notamment dans le cas précis des<br />
relations franco-africaines. Par conséquent, la cellule élyséenne du<br />
Président structure, oriente et contrôle la politique de coopération menée<br />
par le Ministre de la Coopération. Le Parti, sur le plan pratique devient<br />
un "relais", voire un "instrument de pouvoir" incapable dans une large<br />
mesure d'influer sur le cours de la politique franco-africaine (2), Le<br />
Groupe parlementaire ne peut que difficilement faire prévaloir la position<br />
du Parti. Il est politiquement contraint d'avaliser la politique gouverne-<br />
mentale. C'est dire en fin de compte que le débat parlementaire, par<br />
exemple, sur la coopération ne compromet pas la ligne présidentielle. La<br />
collaboration étroite entre le Président du Groupe socialiste et le<br />
Ministre chargé des relations avec le Parlement lors des débats parlemen-<br />
taires renforce la faiblesse du Parti dans un rapport de force favorable<br />
au Gouvernement (3) donc au Président de la République par le jeu du<br />
Cl) Ibid - page 103 - En outre, il convient de noter que le Président en<br />
déterminant le délai d'application de ces engagements limite sans nul<br />
doute la portée du Parlement. "S'agissant de mes engagements, il<br />
m'appartient de veiller à. leur mise en oeuvre, notamment quant au<br />
calendrier de leur réalieet.ion" F. MITTERRAND - Conseil des Ministres du<br />
23 septembre 1981, cité par Pierre AVRIL, op. dt. page 117<br />
(2) "Les relations qu'il [le Parti socialiste] entretient avec ses dirigeants,<br />
reproduisent sur un autre plan, celles du Président de la République.<br />
avec le Premier Ministre, et dessinent une queet-conet.ltution parallèle<br />
qui vient étayer Le Cotiet.itirtion écrite... Il P. AVRIL - op. ctt , p. 118·<br />
(3) Pierre AVRIL - op. cit. page 121
-291-<br />
"domaine réservé". C'est pourquoi l'essentiel de la politique franco-<br />
africaine était articulé à l'Elysée par les "Hommes du Président" (1). A<br />
l'instar de ses prédécesseurs, Monsieur Mitterrand mit au ·point la<br />
nouvelle équipe présidentielle, caractérisée d'abord par sa fidélité au<br />
Président (2). Guy Penne, médecin de formation dirigea de 1981 à la<br />
démission de Monsieur Cot, les affaires africaines. Le retrait partiel,<br />
voire total dans certains cas (domaine euro-africain) du Parti et du<br />
Gouvernement est aussi un héritage légué par la Ve république, héritage<br />
politiquement et stratégiquement nuisible à toute rénovation en matière<br />
internationale. Il peut être de nature à détériorer les relations entre le<br />
Premier Ministre, le Ministre chargé de la Coopération, le Parti, la<br />
cellule élyséenne et le Parlement. "...Le pouvoir présidentiel colonisé par<br />
le Premier Secrétisire du Parti paraît de plus en plus recouvrer la<br />
physionomie du pouvoir régalien. A ce titre, ses prérogatives, son<br />
autonomie, son autorité, et jusqu'à. son image, semblent davantage<br />
s'inscrire dans la continuité de la Ve République qu'en rupture avec elle.<br />
Et s'il existe, du côté de l'Assemblée Nationale, plus qu'avant le 10 mai,<br />
un pouvoir partisan désireux de s'incarner dans une majorité<br />
parlementaire plus active, il n'en reste pas moins que ce pouvoir semble<br />
être déjà équilibré par un pouvoir présidentiel ancré dans la permanence<br />
de I Bt.at:" (3). La continuité ainsi mise en relief n'est pas sans poser de<br />
sérieux problèmes au niveau de l'élaboration technique des grandes<br />
orientations de la coopération : préparation des projets d'intervention<br />
dans le domaine économique, élaboration du budget des affaires étrangères,<br />
-293-<br />
relation franco-africaine est coloniale (1). La gauche au pouvoir et face<br />
à l'héritage de la Ve République a-t-elle 6ubstanciellement modifié la<br />
tendance? La question est complexe et, on l'a vu, la réponse l'est aussi.<br />
La gestion de l'héritage n'est pas seulenent; franco-africaine, elle est<br />
aussi internationale l'Afrique subsabarienne dans les relations<br />
internationales. La·· question sud-africaine reste aussi l'un des grands<br />
problèmes auxquels le continent est confronté.<br />
"La gauche au pouvoir et les grands problèmes africains" est<br />
l'axe central de notre troisième partie. structurée comme suit:<br />
Chapitre I : De la place et du rôle de l'Afrique subsaharienne<br />
dans les relations économiques internationales<br />
Chapitre II La Gauche française et l'Afrique subsaharienne<br />
(1) "Libéralietse laïc et perlemen taire, patriotisme militaire et colonial,<br />
confiance ms.joriteire du suffrage universel, progrès économique et<br />
social : tels sont donc. sprée trente ans d'existence, les quatre piliers<br />
d'une "tradition républicaine" vivante, puisqu'elle est çapable de réaliser<br />
la
-294-<br />
Troisiè:m.e partie<br />
LA GAUCHE AU POUVOIR<br />
ET LES GRANDS PROBLEMES<br />
AUXQUELS L-A<strong>FR</strong>IQUE EST CON<strong>FR</strong>ONTEE
-295-<br />
C<strong>HA</strong>PITRE l<br />
DE LA PLACE ET DU RDLE<br />
DE <strong>L'A</strong><strong>FR</strong>IQUE SUBSA<strong>HA</strong>RIENNE DANS<br />
LES RELATIONS ECONOMIQUES INTERNATIONALES
-296-<br />
L'intégration du continent africain dans les mécanismes<br />
économiques internationaux date de l'annexion du continent par l'Europe.<br />
Elle a fait l'objet d'innombrables recherches et ceci dans presque tous<br />
les domaines. Deux périodes, au demeurant inséparables, ont généralement<br />
retenu l'attention: l'époque coloniale et l'acquisition des indépendances<br />
(les années soixante) à nos jours. Ici, comme ailleurs, il nous semble<br />
impossible de bien étayer le présent sans une investigation historique.<br />
L'histoire éclaire le présent. Cette observation difficilement contournable<br />
pose, pour notre part, plus d'un problème. La Gauche française a-t-elle une<br />
pratique spécifique en matière de relations euro-africaines ? Quels sont<br />
les moyens dont dispose la Gauche française pour la mise en application<br />
d'une théorie de gauche des relations euro-africaines?<br />
Notre intention n'est pas ici de prétendre analyser dans Ga<br />
globalité l'évolution des relations euro-africaines. Nous tenterons de nous<br />
limiter a l'action de la gauche française donc à l'action des hommes<br />
politiques ou à leurs discours critiques, dans le cadre de la Convention<br />
CEE/ACP d'une part, et, d'autre part nous pensons qu'il n'est pas sans<br />
intérêt d'interroger l'Internationale socialiste dont le Parti socialiste<br />
est membre. C'est le niveau Euro-africain. Les rapports euro-africains<br />
s'inscrivent, nous l'avons souligné, dans un cadre plus vaste et mouvant<br />
qu'est la société internationale. D'où la structuration de notre<br />
Chapitre l : De la place et du rôle de l'Afrique subsaharienne dans les<br />
relations économiques internationales<br />
A - Le niveau euro-africain<br />
B - Le niveau international
A - LE NIVEAU EURD-A<strong>FR</strong>ICAII<br />
-297-<br />
1" La Gauche française et la Convention C.E.E.lA.C.P.<br />
L'intégration des états indépendants d'Afrique, du Caraïbe et du<br />
Pacifique au sein de la CEE répond à des préoccupations à la fois<br />
économiques, stratégiques et politiques. Il s'agit au fond d'une relation<br />
d'interdépendance dont les racines s'inscrivent dans l'histoire. Au-dela<br />
des performances économiques non négligeables résultant de cette forme de<br />
coopération, l'Afrique subsaharienne reste confrontée à des problèmes écu-<br />
nomiques les plus divers dans une monde en crise presque permanente (1).<br />
L'évolution actuelle des relations économiques internationales limite dans<br />
plus d'un domaine la portée de l'association CEE/ACP. Elle doit s'adapter<br />
aux circonstances afin de mieux répondre aux besoins des pays en<br />
présence. Le bilan n'est pas, sur le terrain africain, globalement positif.<br />
Le traité signé le 22 avril 1970 renforça le pouvoir du Parlement<br />
européen dans le domaine budgétaire. L'élection du parlement européen au<br />
suffrage universel consolida la position des Partis au sein de la CEE car<br />
désormais impliqués dans l'élaboration de la politique communautaire. Le<br />
parlement européen est donc devenu, pour la gauche française
-299-<br />
pement (FED), le Centre pour le Développement Industriel (COI), le Comité<br />
de Coopération Industrielle (CCI> Cl). Ainsi, conformément au Titre V des<br />
accor-ds de Lomé, les moyens financiers suivants furent prévus au titre de<br />
la Coopération financière et technique<br />
- LOME 1 .<br />
- LOME Ir<br />
:3 ,4 m1l11ards d'Ecus<br />
5,7 milliards d'Ecus<br />
Ces moyens sont gérés soit par la Commission, soit par la BEI.<br />
L'agriculture. dans ce'3 conditions, occupe le second plan. Dans<br />
la mesure où plus de la majorité des populations africaines concernées<br />
sont des paysans ne disposant que de moyens rudimentaires, l'industrta-<br />
li.sation ne peut résorber les problèmes économiques auxquels ces<br />
populations restent confrontées. "Le nombre â'opérst ions concourant à<br />
l'industrialisation (énergie et mines incluses), auxquelles ont été<br />
associés des financements communautaires
-300-<br />
Les projets industriels l'ont largement emporté sur le reste<br />
des préoccupations car 27,4 % des engagements de Lomé I y furent<br />
consacrés et 34,3 % en ce qui concerne le cas de Lomé II. La ventilation<br />
des projets par secteur d 'activité est centrée surtout sur le domaine de<br />
l'agro-industrie. Les états associés n'interviennent, de façon autonome<br />
qu'au niveau de l'orientation des financements BEI (l), Cette poEtique<br />
destinée à la promotion des petites et moyennes entreprises des pays ACP<br />
fut renforcée en raison de l'accroissement des possibilités d'actton du<br />
CDI et ceci conformément aux termes de L'art i c l.e 79 de la Convention de<br />
Lomé II. Selon cet article, la CDI "contribue à établir et .4 renforcer les<br />
entreprises industrielles des états AC?"" en mettant tout peri.icu-<br />
l i érement: l'accent sur l'identification et l'exploitation des possibilités<br />
d'entreprises communes". Opérant en concertation avec les Banques de<br />
développement des Pays ACP, la BEI, de par sa politique à l'égard des PM l<br />
et PME, a contribué à créer des emplois dans des secteurs tels que<br />
l'agro-industrie, industries manufacturières, textiles et cuirs, industrie<br />
métallique, métallurgique et mécanique. Ici apparaît un problème de fond :<br />
la rationalisation des orientations économiques et financières qui sous-<br />
tend une option culturelle du développement industriel. Ces activités<br />
industrielles, concentrées en général dans les centres urbains, ne peuvent.<br />
transformer les modes de vie dans les campagnes et redresser la situa-<br />
tion économique des paysans. Le bilan est par conséquent négatif (2).<br />
(1) Europe Information-Développement - Août 1984 - page 23<br />
(2) "Dans leur politique de développement industriel, les Btie ts: .4CP ont<br />
généralement accordé la priorité 8 des entreprises relativement<br />
surdimentionnées, à 18 substitution d'articles importés, aux technologies<br />
occiden ta l ee importées telles quelles, à une protection excessive et/ou à<br />
la eubei diet i oti directe ou indirecte opérant la gestion, la productivité<br />
et la compétitivité. En général, Ie PNE n'B pas retenu l'attention des<br />
responsables et 8 pâti des politiques commerciales, douanières, fiscales<br />
_ et d'investissement menées au profit des entreprises plus grandes".<br />
-Europe Information-Développement - Août 1984 -- page 29
-303-<br />
Exerçant des fonctions importantes au sein de la CEE, quelques<br />
socialistes français vont tenter de faire appliquer des stratégies en<br />
direction des pays en développement. Il n'est pas sans intérêt ici de<br />
faire état de leurs théories et pratiques en la matière. Prenons les cas<br />
de Claude Cheysson, Edgar Pisani et Jacques Delors (1). L'aide alimentaire<br />
et la redynamisation de l'agriculture constitue l'ossature de leur option.<br />
Le STABEX n'a pas conjuré la famine ni entraîné une industria-<br />
lisation des Aep. Les organisations internationales restent défaillantes<br />
(2). La question alimentaire est plus que prioritaire. Selon Claude<br />
Cheysson. la solution résiderait dans un nouvel ordre alimentaire mondial.<br />
"On a beau fouiller dans le flot statistique que déversent régulièrement<br />
les organisations internationales, il est difficile d'échapper à un cons-<br />
tdt la situation alimentaire mondiale est préoccupante. ELle ira, selon<br />
toute probebili ié, en s'aggravant. Une telle affirmation relève de la<br />
banalité, car la mal-nutrition de centaines de millions de personnes en<br />
Asie et en Afrique est malbeureusement une donnée constante. Au bas mot,<br />
450 millions de personnes n'atteignent pas actuellement ce que la F.A.O.<br />
appelle le seuil critique en matière d'apport calorique minimum" (3).<br />
Il faut par conséquent orienter l'aide européenne vers ce secteur où se<br />
joue l'avenir de l'humanité. Ce constat réduit aussi à leur plus simple<br />
expression les politiques jusque-là entreprises par la Communauté euro-<br />
péenne en Afrique noire, politiques centrées sur une minorité et oubliant<br />
les campagnes. Une autre logique serait d'investir dans l'agriculture.<br />
(1) Claude Cheyssaon , Edgar Pisani 1 Jacques Delors. socialistes français 1<br />
vont assurer la présidence de la Commission des Communautés Européennes<br />
en des moments déterminés<br />
(2) Cf. Abdoulaye DIARRA - Thèse citée - page 59 et suivantes<br />
. (3) Claude CHEYSSON : "L'Europe f1:i,ce_ au désordre alimentaire mondial"<br />
In Politique internationale - n" 3 - 1979 - page 56
-305-<br />
capable d'assurer le développement (1) dans les pays concernés mais le<br />
système présente des limites qu'il convient d'analyser. Au système du<br />
STABEX il faudrait, selon Monsieur Cheysson, subsituter une "stabilisa-<br />
t Ion" et une croissance régulière des prix agricoles. Au fond, il s'agit de<br />
corriger "l'anarchie des échanges commerciaux" en instaurant un nouvel<br />
ordre commercial de'droit. Le droit contractuel, base de la Convention de<br />
Lomé doit embrasser le secteur agricole en vue d'assurer l'autosuffisance<br />
alimentaire. En somme, le contrat de solidarité serait la clé de l'épa-<br />
nouissement de la coopération euro-africaine.<br />
Président de la Commission des Communautés européennes, Edgar<br />
Pisani, fait le bilan critique de deux décennies du développement en<br />
proposant de nouvelles méthodes d'action notamment en Afrique au sud du<br />
Sahara (2). "Pendant vingt ans, écrit Edgar Pt eeni , l'aide que les pays<br />
industrialisés ont apportée aux pays en voie de développement a reposé<br />
sur une illusion, une image simplificatrice et convaincante... " (3). Ce<br />
constat expliquerait le bilan négatif de plus de vingt années de coopéra-<br />
tion pour le développement, l'échec des grands sommets internationaux, la<br />
difficulté de mener à bien les négociations globales et la crise de 1'as-<br />
sociation internationale du développement. Paradoxalement, l'ancien ordre<br />
colonial résiste encore sous une autre forme car "l'actuelle division<br />
(1) "La plus importante novation se place dans le cadre de la Convention<br />
de Lomé. En stabilisant les recettes d'exportation, la Communautié<br />
européenne protège les pays des pays ACP de fluctuations anormales de<br />
leurs recettes, de leurs revenus dues à des accidents climatiques et à des<br />
variations sur le marché. En d'autres termes, si dans un pays membre de<br />
la Convention de Lomé, le revenu d'une culture d'exportation baisse, le<br />
Fonds Européen de Développement compense. Il paie la différence, c'est un<br />
don pour les plus défavorisés, un prêt sans intérêt pour les sutiree"<br />
Claude CHEYSSON - op. cit. - page 59<br />
(2) Edgar PISAN l - Memorandum sur la politique communautaire de développement<br />
- Bruxelles - 1984 - 24 pages<br />
(3) Edgar PISANI - La main et l'outil - Le développement_ du tiers-monde<br />
et l'Europe - Robert Laffont - Paris - 1984 - 241 pages - page 33
-307-<br />
ter les difficultés. C'est la responsabilisation des partenaires lm<br />
pr ésence , La stratégie al imentaire est moins fondée sur l'aide que sur la<br />
"méthode", c'est-à-dire la concertation politique, la prise en compte et<br />
l'analyse des plans de développement agricole. des pays africains et<br />
l'apport de l'Europe pour surmonter les difficultés (l). Selon M. Pisani,<br />
l'objectif de l'a.ide alimentaire conforme à la stratégie alimentaire en<br />
198 J. permet, de passer du "transfert d'outils" au développement de la<br />
main. La question centrale n'est plus de posséder mais de pouvoir créer.<br />
"Le développement nécessaire appelle un renversement d'attitude. Il nous<br />
faut passer de l'aide à l'outil à l 'eiâe à la main. Jusque récemmen t , nous<br />
evotie privilégié l'outil un barrage est un outil, tout comme un hôpital,<br />
li!Je route, une usine, une écale. Ce qu '11 faut aider, c'est 18 société des<br />
nommee, les structures sociales. Ls vie locale ; en un JIJot, la main capa-<br />
ble de saisir l'outil" (2). Le développement du secteur agricole engendre<br />
J.e développement industriel. Dans ces conditions 1 l'Europe doit mener une<br />
po l t t Ique industrielle conforme à ses intérêts mais non contraire au<br />
développement industriel du tiers-monde. L'industrialisation des pays du<br />
tiers-monde reposerait, selon M. Pisani, sur 3 critères : la satisfaction<br />
des besoins nationaux et régionaux, la transformation des matières pre-<br />
rnières locales, et l'exploitation de sites à main d'oeuvre bon marché. Les<br />
deux premiers critères sont essentiels (3). La politique de développement<br />
communautaire doit aussi s'appuyer sur des projets à long terme touchant<br />
les domaines suivants : la lutte contre la désertification, la conserva-<br />
tian dos forêts tropicales, la gestion des sols et des ressources naturel-<br />
les et énergétiques, le développement d'une capacité autonome de recherche<br />
scientifique et technique et la lutte contre les grandes endémies (4).<br />
(1) Edgar PISANI - op. cit. page 103<br />
(2) Ibid - page' 67<br />
(3) (4) Edgar PISAN l - Kemorandum ciÜf - page 19
-308-<br />
<strong>L'A</strong>frique subsaharienne, dit Edgar Pisani, doit être le champ<br />
d'action prioritaire d'une telle politique de développement communautaire<br />
et. ceci en raison de sa situation socio-économique et financière<br />
particulière. L'échec des politiques antérieures en matière de coopération<br />
exige une nouvelle approche fondée sur la région, c'est-à-dire le<br />
regroupement d'un ensemble de pays ayant les mêmes problèmes et capables<br />
de les résorber. Il n'est pas sans importance de mettre l'accent sur<br />
J. 'originalité d'une telle stratégie en matJ.ére de coopération ACP/CEE. La<br />
dimension rurale a pris ici toute son importance du moins en ce qui<br />
concerne J.e cas de certains pays subsahariens (1).<br />
Les conditions ct 'application prolongée d'une telle orientation<br />
de la politique communautaire en direction de l'Afrique subsaharienne sont<br />
Hm i tées. Ces limites, économiques, politiques, financières voire<br />
stratégiques, se situent aussi bien en Europe qu'en Afrique subsaharienne.<br />
Les conséquences de la crise internationale sur la construction de<br />
l'Europe, l'accroissement du chômage dans les pays d'Europe occidentale, la<br />
question essentielle des prix agricoles entre les pays européens membres<br />
de la CEE, la primauté du dollar et son impact sur les investissements<br />
européens restent, entre autres, des facteurs qui rendent aléatoires et<br />
pour longtemps encore l'observation d'une stratégie cohérente du<br />
développement en Afrique subsaharienne. En outre, la durée du mandat du<br />
Président de la Commission des Communautés européennes ne permet pas<br />
d'inscrire une telle politJ.que dans la durée. Les limites au niveau<br />
africain sont multiples. Edgar Pisani lui-même, met en relief la réalité<br />
suivante<br />
décevant<br />
"Les p8.ys du tiers-monde ont aussi leur part dans ce bilan<br />
dJ.fficul tés dans la gestion, priorité à l'appareil d'état, à la<br />
(1) Cf. Edgar PISANI - op. cit. page 93 et suivantes
-311-<br />
un gouvernement autonome pourra être établi"
-313-<br />
une coopération technique consistante. Un séminaire est organisé sur "la<br />
coopération en Asie et en Afrique". Ce fut un succès sur le plan de la<br />
participation africaine. Le Dahomey, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Kenya,<br />
le Nigèria, le Sénégal, le Tchad y participant officiellement. Les leaders<br />
africains sont présents y compris Julius Nyeréré (1). La coopération<br />
cult:urelle va se substituer à cette coopération technique création à<br />
Tel-Aviv en 1959 d'un "institut afro-asiatique" qui regroupa près de<br />
300 étudiant::; africains. Le conseil de l 'IS se tient en Israël en 1960 et<br />
pour la première fois les délégués africains part.i.c i pent à part entière à<br />
un conseil de l'IS. Les délégués africains s'adressent au Conseil. La<br />
politique co Ion Iale brrt.ann tque et f'rança i ae est dénoncée. La poHti'J,ue<br />
de la SFIO en Algérie est vivement désavouée et critiquée (2). Les<br />
nouvelles revendications africaines sont claires : indépendance totale et<br />
immèdi.ate, aide économique inconditionnelle, etc .. , L'attitude constr-uct.Lvc<br />
d'Israël dans ce sens contraste avec le comportement ambigü des<br />
socialistes européens. L'ouverture de l' 13 était-elle amorcée ? La<br />
stratégie unitaire, plus constructive, fut définie par le BLF. Il faudrait<br />
selon ce parti, "dégager une définition des principes socialistes qui<br />
rende le socialisme capable de répondre aux problèmes qui sont posés a<br />
ces organisations dans leurs territoires respectifs" (3) . Cette<br />
proposition devrait être analysée à la prochaine conférence afin de poser<br />
la question relative à la situation afri.caine. Une "déclaration sur Les<br />
tâches nouvelles de la démocratie socialiste", déclaration élaborêe par<br />
M.D. Ennals secrétaire international du BLP, est soumis au conseil de l'r8<br />
à Haïfa. Le texte est adopté et ne concerne que "des forces socialistes"<br />
(l) Cité par Guillaume DEVIN - op. c i t . page 261<br />
(2) Ibid - page 262<br />
(3) Ibid - page 264
-316-<br />
- en Afrique anglophone : Ghana, Nigér1a, Rhodésie du Nord et<br />
du Sud, Nyasaland, Kenya, Tanganyika, Ouganda (1).<br />
Les rapports de mission montrent nettement que le problème<br />
fondamental se situe au niveau politique. Les conséquences de la<br />
Conférence de Bandoeng en 1955 sont certaines en Afrique, surtout au<br />
niveau des mouvements nationalistes. C'est la promotion du non-alignement.<br />
Le choix du parti unique rend encore plus difficiles, sinon incertaines,<br />
les futures relations avec l'18. C'est la notion même de démocratie qui<br />
constitue le point de désaccord essentiel i celle-ci suppose non seulement<br />
la tolérance mais aussi un autre type de traitement des opposants que<br />
celui presque généralement observé en Afrique élimination souvent<br />
systématique des opposants, primauté de l'Etat dans tous les domaines,<br />
persécution voilée des minorités dans certains cas. L'IS reste donc<br />
toujours réticente pour une collaboration stricte avec les mouvements<br />
nationalistes africains (2). D'ailleurs, l 'IS va constamment protester<br />
contre la manière dont les opposants sont traités en Afrique. En 1962, ce<br />
fut le cas du Kali où le gouvernement de K. Kodibo Keita "venait de<br />
condamner à mort Fily Dabo Sissoko et Hamadoun D1cko" (3) opposés au<br />
régime.<br />
L'expérience tanzanienne, au niveau de ses objectifs. attire<br />
quelque peu l'Internationale Socialiste. Kais le refus tanzanien du<br />
parlementarisme de type occidental et du pluralisme rend sceptiques les<br />
socialistes de l'18. Ainsi les années soixante furent riches en<br />
perspectives africaines de l'IS, mais le ra"pprochement, voire l'affiliation<br />
(1) Cité par Guillaume DEVIN - page 270<br />
(2) Ibid - page 271<br />
(3) Ibid ..:. page 274
-317-<br />
systématique n'a pu aboutir (1). Le colonialisme, le racisme et les autres<br />
fonnes de domination sont dénoncées sans équivoque mais l'intégration<br />
africaine présente toujours des risques politiques.<br />
L'IS va donc tenter d'internationaliser sa stratégie en<br />
s'ouvrant à des partis situés hors d'Europe occidentale. L'ancienne IS plus<br />
européo-centriste cède la place à une Internationale plus souple quant aux<br />
critères d'adhésion et plus apte à une étude approfondie des relations<br />
Nord-Sud afin de trouver une solution socialiste à la césure Nord-Sud.<br />
La commission Nord-Sud fonctionna de façon autonome en dehors de l'1S<br />
mais sous la présidence du Président de l'IS, K. 'Willy Brandt. Ainsi, la<br />
Commission Nord-Sud ainsi que la Commission pour le désarmement furent<br />
largement fonction des thèses de la Social-Démocratie (2). Le rapport<br />
Nord-Sud a permis aux pays du tiers-monde de participer, au niveau inter-<br />
national, aux différentes négociations les concernant. L'IS a également<br />
adopté, pendant les années 70, des déclarations sans équivoque sur<br />
l'Afrique du Sud. Blle noua des contacts avec les mouvements de libération<br />
nationale en lutte contre le racisme et le développement séparé. Les<br />
différentes résolutions vont donc insister sur le boycott de livraisons<br />
de pétrole et des investissements en Afrique du sud où sévit le racisme.<br />
L'IS a reconnu et soutient le Front Polisario qui lutte pour<br />
l'autodétermination du peuple saharoui. "... L'IS s'est en quelque sorte<br />
transformée en tribune où les positions des différents protagonistes élU<br />
conflit (c'est-Ii-dire le Polisario, l'Algérie, le ](aroc et la Mauritanie) se<br />
sont affrontés. Ce rôle de 1'IS qui consiste à rassemble autour d'une méme<br />
table de négociation les adversaires et de rendre ainsi possible la<br />
(1) Pour le cas de l'Afrique du Sud: cf. Chapitre II - Section II CB)<br />
paragraphe l "L'IS et l'Afrique australe" _<br />
- (2) Cf. Raimund SEIDELJlANN - op. cit. page 122- et suivantes
-318-<br />
recherche d'un compromis est décisif (en ]'occurence, un errët: des tioeti-<br />
lités et l'indépendance du Ssbers occiâeriiel )" (1). Contre l'autoritarisme<br />
et le monolitisme politique l' IS opte pour le pluralisme et le réspect des<br />
Droits de l'Homme. Notons que les droit.s , ici reconnus, sont reconnus par<br />
les régimes libéraux et capitalistes d'Occident. A ce niveau, la<br />
convergence est pr-esque nette. La prise en compte des réalités africaines<br />
fut, dans bien des cas, fonction de l'engagement personnel du nouveau<br />
président de l'IS, M. Willy Brandt à partir de 1976. Il a pris directement<br />
contact avec les peuples dominés et leurs représentants tels que le<br />
Congrès National Africain (ANC) et l'Organisation Populaire Sud-Ouest<br />
africaine (SWAPO). Le 13e congrès de l'IS fut donc celui de la<br />
reconnaissance des mouvements de libération opérant en Afrique (2).<br />
Cependant, le continent africain est peu représenté au sein de l'ISo Pour<br />
l'instant, seuls deux pays africains sont représentés : le Parti socialiste<br />
sénégalais et le Parti socialiste voltai"que (aujourd 'hui Burkina-Faso) de<br />
M. Joseph Ki Zerbo. 1'IS n'approuve pas le monopartisme. Sur l'initiative<br />
de M. Senghor (Président du Sénégal à l'époque) et de M. Bourguiba<br />
(Président de la Tunisie) l'Inter-africaine socialiste est crée. Elle<br />
regroupait le Parti socialiste destourien, le PS sénégalais) l'Union<br />
socialiste des forces populaires du Soudan. L'internationale socialiste ne<br />
reconnaît pas l'Inter-africaine socialiste. L'Internationale Socialiste a<br />
tenu sa première conférence en Afrique en 1983 et avec la participation<br />
des Etats de la ligne de front et quelques mouvements de libération na-<br />
tionale. Lors de cette conférence et sous la conduite de M. Olof Palm une<br />
"plate-forme N de combat fut adoptée contre le régime raciste sud-africain.<br />
Ce qui entraîna la "création d'un Comité africain" de l'Internationale<br />
(1) Raimund SEIDELMANN - op. cit. page 132<br />
(2) Cf. Jean ZIEGLER : L"Internationale Socialiste et l'Afrique<br />
Le .Monde diplomatique - Septembre '19'85 - Paris
-319-<br />
socialiste sous la direction de M. Joop Van Uyl , chef du Parti du travail<br />
hollandais. Le 26 février 1986, M. Olof Palm est assassiné et immédiate-<br />
ment M. Brandt s'est rendu au Botswana en vue de maintenir le contact<br />
politique avec les pays de la ligne de front. Lors de ce voyage politique<br />
une déclaration politique fut adoptée, articulée sur les points suivants :<br />
- abolit Iqn de l'apartheid ;<br />
- législation de l'ANC et des organisations syndicales noires<br />
et métisses i<br />
- libération sans condition de M. Mandela et de tous les<br />
prisonniers politiques;<br />
- condamnation de l'attitude ambiguë de la CEE en Afrique<br />
du Sud;<br />
- exigence du blocus économique et financier complet de<br />
l'Afrique du Sud;<br />
- l'indépendance sans condition de la Namibie i<br />
- refus de l'engagement constructif (doctrine américaine pour<br />
l'Afrique du Sud, etc...<br />
Ces différents points furent défendus par M. Brandt lors de<br />
son voyage en Afrique du Sud en avril 1986 (1).<br />
Ainsi les rapports entre l'rs et la "vieille maison" rénové€<br />
qu'est le Parti socialiste français ne pouvait évoluer sans poser de<br />
problèmes politiques et stratégiques de fond, et ceci tant au niveau de la<br />
lutte politique pour l'instauration du socialisme en France qu'au niveau<br />
international (2). Le PS, on l'a vu, est marqué dès sa naissance, en 1971,<br />
(1) Cf. Jean ZIEGLER - op. c i t.,<br />
(2) . Hugues PORTELLr - Le Parti socialiste et l'rs<br />
op. cft. pages 137-145-- page 138 et suivantes
-323-<br />
son fonctionnement) et ses institutions spécialisées dans tous les<br />
domaines. Prenons ici quelques exemples :<br />
- O.N.U. : Organisation des Nations Unies<br />
F.M.T. : Fonds Monétaire International
-325-<br />
Gouvernement ou liés au Gouvernement) incite à s'interroger de nouveau sur<br />
son impact sur la scène internationale. Il est inutile ici de revenir sur<br />
certains aspects du problème. Quelques références officielles nous<br />
semblent suffisantes pour les besoins de l'analyse (l). L'accent est mis<br />
non seulement sur la nature des institutions internationales mais aussi<br />
et surtout sur l'urgènce de leur réforme. La détérioration des termes de<br />
l'échange, la primauté du dollar et ses conséquences, l'impact des accords<br />
financiers inégaux au niveau international demeurent les questions<br />
essentielles dont les solutions se situeraient au niveau de la<br />
restructuration de l'économie mondiale. L'état du développement dans les<br />
pays du tiers-monde témoigne de l'inefficacité, voire de l'inutilité de<br />
plus d'une institution internationale en oeuvre depuis plus de 30 ans. Le<br />
bilan des dix dernières années est catastrophique. La pauvreté s'est<br />
approfondie dans presque tous les pays du tiers-monde, notamment en<br />
Afrique. "C'est parmi ces plus pauvres que les progrès sont les plus<br />
faibles. Depuis dix ans, les pays les moins avancés marquent: le pas et<br />
voient leur croissance économique suivre avec peine le mouvement de leur<br />
population ... L'ensemble du tiers-monde exportait en 1930 dix millions de<br />
tonnes de céréales. En 1978, il en importe soixante millions" (2). L'ONU<br />
et ses institutions, dites spécialisées, ne sont donc pas parvenues à<br />
faire face à leur objectif fondamental, et l'on peut dire que dans la<br />
philosophie qui guide leur action, la logique économique, financière et<br />
(1) - Discours du Président de la République prononcé lors de la séance<br />
inaugurale de la Conférence de Paris sur les pays les moins avancés, le<br />
1er septembre 1981 i<br />
- Discours prononcé par Son Excellence Monsieur Michel ROCARD,<br />
Ministre de l'Agriculture devant le Conseil Mondial de l'Alimentation, le<br />
27 juin 1983 ;<br />
- Intervention de Monsieur Louis LE PENSEC, Secrétaire National aux<br />
Relations Internationales du PS à la Journée de politique africaine, le<br />
7 février 1987.<br />
Ces documents sont en Annexes de la présente thèse.<br />
(2) François MITTERRAND' --discours cité
-328-<br />
La logique du marché qui oriente le fonctionnement de la<br />
majeure partie des institutions financières internationales paralyse le<br />
développement des pays sous-développés. Car elle repose sur la 101 du<br />
plus fort. C'est le cas de la Banque Mondiale, du FMI, du GATT, etc... La<br />
conception et la gestion de la dette restent subordonnées à des<br />
impératifs qui, loin ,de favoriser une renaissance économique, perpétue la<br />
dépendance financière des pays en développement à court, moyen et long<br />
termes (l). La dette se transforme par conséquent en ressource pour<br />
alimenter les économies développées. Les blocages réguliers des<br />
négociations sur le commerce international résulte de l'incapacité de<br />
l'institution (GATT) à se libérer de la logique du profit pour intégrer<br />
dans ses analyses les critères essentiels d'un nouvel ordre commercial<br />
international. tI...D'ordinaire, au GATT, on perIe des droits de douane mais<br />
pas des restrictions quantitatives, encore moins des normes ou des<br />
standards, et surtout pas d'une orgnnl.es t ion concertée des marchés. Ce<br />
dont les pa.ys du tiers-monde ont pourtant besoin, c'est de prix<br />
couveneblee et stables pour leurs exporta.tions agricoles et minières" (2).<br />
La crise est par conséquent globale. Elle est à la fois écono-<br />
mique, sociale et politique. Elle reste essentiellement liée à un modèle<br />
d'organisation économique sous-tendu par une vision politique. La réforme<br />
des structures doit se situer par rapport à cette réalité et ceci tant au<br />
nord qu'au sud. Le6 conséquences de la crise sont multiples dans les pays<br />
(l) "Il est indéniable que beaucoup de gouvernements du tiers-monde ont<br />
été d'une évidente Iégér-etié dans l'acceptation d'un endettement excessif.<br />
Mais il est encore plus indéniable que les pays développés ont fait<br />
n'importe quoi, qu'ils ont laissé leurs banques pousser sans mesure, dans<br />
le seul appât: du gain et sans réfléchir li l'avenir, cl une coneommei.ioti de<br />
crédits insoutenable"<br />
Michel ROCARD - Congrès de l'15 à Lima
-330-<br />
sophie des institutions internationales. La réforme de cel Ies-ci se pose,<br />
ici, en termes politiques. La société internationale est une société<br />
politique, caractérisée par des rapports de force politiques. Ces- rapports<br />
commandent les prises de décision à l'échelle mondiale. Revendiquée par<br />
les pays en voie de développement et par certains du nord, la restruc-<br />
turation des organisations régionales, continentales et de l'ONU pose plus<br />
d'un problème. Nous y reviendrons.<br />
Les réformes de structures et des politiques d'ajustement<br />
furent tentées ou sont en train de se mettre en oeuvre en Afrique<br />
subsaharienne. Il n'est pas sans intérêt de s'interroger sur leurs impacts<br />
réels et de mettre en lumière les grands axes de la nouvelle réÎlexion<br />
socialiste.<br />
2· Les réformes de structures et les politiques d'ajustement en<br />
Afrique subsaharienne : l'état actuel de la réflexion au sain du Parti<br />
Socialiste<br />
L'année 1986 nous semble une date essentielle. Le bilan du<br />
dialogue nord-sud demeure dérisoire et les politiques d'ajustement tentées<br />
en Afrique subsabarienne soulèvent plus de problèmes qu'elles n'en<br />
résorbent. La Gauche, au pouvoir depuis 1981, perd la majorité à<br />
l'Assemblée nationale désormais dominée par les députés non socialistes<br />
et communistes
-331-<br />
devenu force politique d'opposition. Résumons en quelques mots cette<br />
nouvelle donnée.<br />
- Le dialogue Nord-Sud piétine pour diverses raisons. Le débat<br />
théorique sur les négociations globales s'enlise à cause des positions<br />
politiques diffic1Jement conciliables. L'endettement des grandes<br />
puissances est préoccupant. Le cours des matières premières est en chute<br />
continue. Prenons le cas du sucre : il passe de 65,5 centimes de dollar en<br />
1974 à 2,35 centimes en juillet 1985 pour atteindre près de 7 centimes en<br />
1987
-332-<br />
rieur, etc... En 1987, le Zs.ïre devait rembourser près de 5 milliards de<br />
dettes (1). Par conséquen t 1 la politique d'ajustemen t pour redresser la<br />
politique zaïroise sous la conduite du FMI n'a rien rapporté ... Dans un<br />
rapport d'activité à l'intention du groupe consultatif pour le Zaïre<br />
CBanque. mondiale), on peut relever le constat suivant : "Il est important<br />
que les investisseur.p zaïrois soient les premiers à montrer qu'ils ont
-333-<br />
Le Gouvernement socialiste français, on l'a vu, est intervenu a<br />
plusieurs reprises auprès des bailleurs de fonds en vue de mener à bien<br />
les négociations entre les pays subsahariens et les bailleurs cre fonds :<br />
le Fonds Monétaire International et la Banque mondiale. Les interventions<br />
de ces bailleurs de fonds n'est pourtant pas fonction de la logique<br />
socialiste et ceci' tant au niveau de la méthode que des objectifs<br />
poursuivis. "Les interventions du FNI s'inscrivent dans un contexte macro-<br />
économique de stabilisation à court terme de l'économie. Le Fonds ne<br />
prend pas en compte les impl ice tions sur la répartition in terne (en tre<br />
individus ou entre agents) des gains ou des pertes économiques<br />
qu'engendreraient les mesures de stabilisation mecro-écotiomique proposées.<br />
Ces problèmes sont censés être pris en charge par des politiques<br />
intérieures appropriées " (1).<br />
Quant à la Banque mondiale, elle met l'accent sur les causes de<br />
la faible croissance du produit intérieur brut dans les pays subsahariens.<br />
La cible ici privilégiée est le secteur public compression des<br />
personnels, réforme de la politique industrielle, investissements dits<br />
productifs, nouvelle forme de crédit agricole, révision des codes<br />
d'investissement et de la fiscalité. L'intégration des pays en voie de<br />
développement dans le commerce international serait pour la Banque<br />
mondiale le meilleur moyen d'élever leur niveau de vie. Car "sur le plan<br />
de la politique d'ajustement structurel, la Banque préconise une série de<br />
mesures qui vont toujours dans le sens d'un alignement des prix locaux<br />
sur les prix internationaux, et ce afin d'exploiter au maximum les "gains<br />
(1) Cf. Claude <strong>FR</strong>EUD<br />
Quelle coopération? Un bilan de l'aide au développement<br />
Editions Karthala - Paris - 1988 - page 206
-334-<br />
du commerce international" (1). La politique de défense des intérêts<br />
financiers nationaux pratiquée par les puissances industrialisées ne<br />
facilite guère les choses. Paradoxalement, nombreux restent Ies, pays du<br />
sud qui financent les déficits budgétaires des pays du nord.<br />
L'interdépendance n'est donc que théorique en matière de relations<br />
financières nord-sud .... Face à cette réalité presque conservatrice, le parti<br />
socialiste va reconsidérer son diagnostic et ceci en prenant en compte<br />
les déboires enregistrés pendant l'exercice du pouvoir politique 1981-1986<br />
en matière de coopération franco-africaine. Cette nouvelle réflexion,<br />
constituant l'approche officielle du Parti, se veut globale et critique.<br />
Elle touche différents domaines tels que l'actualité de l'Afrique, la<br />
crise et les mutations, la démocratie et les droits de l'homme, la dette,<br />
l'Afrique anglophone, la coopération euro-africaine, la famine et l'aide<br />
alimentaire, la francophonie, les organisations non-gouvernementales, la<br />
politique de coopération, le racisme et l'apartheid. les relations franco-<br />
africaines, les accords de sécurité et de défense. la Zone Franc, etc.. (2).<br />
En reconnaissant leurs échecs dans plus d'un domaine, les Socialistes<br />
admettent le constat fondamental suivant "L'expérience de ces cinq<br />
Bnnées de gouvernement a montré que nous étions, dans le doisa ine de la<br />
politique africaine, prisonniers d'une contradiction qui n'a pas toujours<br />
pu être résolue. Je veux parler de cette tension entre les contraintes, la<br />
logique des relations d'Etat à Etat et la logique militante tournée, elle,<br />
vers les exigences démocratiques" (3). Il faudra par conséquent tenter de<br />
(1) Claude <strong>FR</strong>EUD - op. c i t , page 209<br />
Le livre de Claude <strong>FR</strong>EUD nous semble fondamental. Tous les problèmes liés<br />
à la politique de coopération sont actualisés tant aux niveaux francoafricain<br />
qu'international. La démarche générale n'est pas contraire à celle<br />
préconisée par la Gauche socialiste<br />
(2) Louis LE PENSEe (Dir) Vingt questions sur l'Afrique Des<br />
Socialistes répondent - L'Harmattan - Paris -1988 - 288 pages<br />
(3) Ibid ...: page Il
-335-<br />
préserver la place économique, politique et stratégique de la France dans<br />
le continent en s'appuyant désormais sur les forces sociales<br />
représentatives de l'Afrique. La connaissance profonde de ces nouvelles<br />
forces serait plus que nécessaire en vue de les intégrer dans une vision<br />
politique autre. L'analyse classique, centrée sur les ethnies, mériterait<br />
d'être revue et complétée. Les Etats africains n 'ont plus les moyens<br />
nécessaires à leurs politiques. Les principes qui gouvernent leurs<br />
actions, loin de favoriser l'épanouissement des paysans, conduisent à<br />
taxer les produits agricoles donc à appauvrir davantage la population<br />
paysanne. L'Etat est donc en question en Afrique subsaharienne tant sur le<br />
plan structurel que sur le plan de son fonctionnement. Le désordre socio<br />
économique et financier est érigé paradoxalement en principe de<br />
gouvernement. L'orientation des choix économiques et industriels est<br />
presque non contrôlable. <strong>L'A</strong>frique occuperait le dernier rang dans le<br />
commerce international. Les pouvoirs publics ne parviennent plus à faire<br />
face à leur mi.ssion primordiale : la gestion des sociétés. La corruption<br />
est généralisée les agents publics, faute d'être payés à temps et<br />
normalement se rémunèrent eux-mêmes ; les activités lucratives menées par<br />
les agents publics emportent sur le véritable sens de l'Etat. Les intérêts<br />
étrangers prédominent (1). La crise de l'Etat en Afrique serait antérieure<br />
à la crise économique. "La sécurité, l'ordre, la loi, la question des<br />
frontières C01JJJIJe l'éducation ou la santé, la gestion du patrimoine où les<br />
pouvoirs publics ont droit et devoir d'intervenir, ne sont pas seulement<br />
mis: en cause par les métei ts de tel ou tel régime despotique, par les<br />
déviances et les excès de pouvoir, mais plus généralement par une<br />
faiblesse que la flagornerie, Psutrr-célébrs i ion, pas plus que les<br />
atteintes croissantes aux droits de 1 'Homme, ne peuvent plus masquer" (2).<br />
(-1) et (2) Louis LE PENSEe - op. cit. page 30-et SUivantes
-336-<br />
La crise politique de l'Afrique "en ce XXe siècle finissant" se situerait<br />
au niveau du caractère despotique de certains régimes (l). Les politiques<br />
d'ajustement, telles qu'elles sont appliquées, sont ici condannées car la<br />
réduction des dépenses sociales réduit la "capacité productive" des pays<br />
et relègue l'homme au second plan.<br />
Dans le domaine des relations culturelles, la gauche au pouvoir<br />
n'est pas parvenue à inverser la tendance classique de la francophonie.<br />
Car la francophonie n'est pas seulement un instrument de coopération<br />
culturelle, elle est aussi politique, économique, voire stratégique au<br />
service de la France. Elle serait toujours un moyen de domination<br />
politique et économique. "Force est bien de constater, malheureusement, que<br />
l'intérêt nouveau apporté par .les Socialistes à ces institutions [les<br />
institutions de la francophonie] n'a guère permis de changer l'esprit. Ce<br />
sont le plus souvent les memes hommes et les mêmes idées qui donnent .5<br />
la francophonie instituée les couleurs de la nostalgie" (2). Les insti-<br />
tutions de la francophonie sont : l'Association des Universités de Langue<br />
française CAUPELF) ; l'Association des Parlementaires de Langue française<br />
(AIPLF) l'Agence de Coopération Culturelle et Technique CACCT) ; la<br />
Conférence des Ministres de l'Education nationale d'expression française<br />
CCONFEMEN) et la Conférence des Jeunes de pays d'expression française<br />
(CŒIFEJES). Le poids accru du Canada en matière de coopération culturelle<br />
avec l'Afrique est souligné. "Le Franco-centrisme africain sera-t-il doublé<br />
par un Canada-centrisme ?" (3). Le continent, quoiqu'on dise ou soutienne,<br />
reste un enjeu culturel important.<br />
Cl) Louis LE PENSEC - op. c i t , page 35<br />
(2) Ibid - page 87<br />
(3) Ibid -:. page 91
-337-<br />
La Gauche au pouvoir a largement contribué à l'essor des<br />
organisations non gouvernementales en Afrique subsaharienne (1). Les<br />
D.N .G. avaient pour mission de lutter contre la faim dans _les années<br />
soixante. L'Eglise y jouait à cette époque un rôle important. Elles<br />
devaient par la suite prendre en compte le développement des pays<br />
pauvres. C'est dire que leur mission s'est nettement élargie dans les<br />
années ,:;oixante-dix : aide aHmentaire, aide médicale, solidarité avec le<br />
tiers-monde dans différents domaines. La logique essentielle est celle du<br />
monde associatif qui occupe une place de choix dans le discours<br />
socialiste. L'objectif est de palier aux carences de la coopération gouver-<br />
nementale en mettant l'accent sur "la société civile". L'action est centrée<br />
sur les petits projets. La Gauche au pouvoir, compte tenu du nombre<br />
croissant des ONG en Afrique subsaharienne (160 ONG Françaises environ),<br />
a créé la Commission Coopération et Développement (2) chargée de gérer<br />
les rapports pouvoirs publics - ONG et ceci sous la conduite du Ministère<br />
de la Coopération. Ce qui entraîna une nouvelle structure de l'action des<br />
DNG. Il existe désormais des relations suivies entre cinq grandes<br />
organisations suite à la création commune et en collaboration avec le<br />
crédit coopératif d'un "fonds commun de placement faim et développement".<br />
Ce fonds est directement affecté aux projets de développement (3). Il<br />
s'agit du Comité Catholique Faim et Dévelopement (CCFD), du Comité<br />
Français contre la Faim (CFCF) 1 de la Cimade, Frères des Hommes, Terre<br />
des Hommes. Certaines organisations françaises et étrangères ont aussi<br />
élaboré une société j'investissement et de développement internationale<br />
(SIDI) en vue de réaliser des investissements et participer à la<br />
(1)<br />
(3 )<br />
Cf. Louis LE PENSEC CDir) - op. c i t , pages 129-156<br />
Commission Coopération et Développement<br />
27. rue Blomet - 75015 PARIS<br />
Cf. Louis LE PENSEC CDir) - op. cit.- page 129 et suivantes
--341-<br />
importantes. Néanmoins, force est de constater que la politique de<br />
coopération n'a pas encore concrètement évolué par rapport à celle de<br />
1986-1988, et ceci tant au niveau du choix des hommes qu'au niveau des<br />
structures de coopération. La primauté présidentielle en la mat Ièr'e est<br />
strtctement conservée. Le discours sera-t-il conforme à la réalité?<br />
<strong>L'A</strong>frique reste toujours confrontée, dans sa partie australe, BU<br />
colonialisme le plus classique dans sa structure et le plus cynique dans<br />
son fonctionnement. Cette réalité inique est due au racisme érigé en<br />
principe de gouvernement en Afrique et à ses répercussions sur<br />
l'ensemble de la sous-région. Comment ce conflit est-il analysé par la<br />
Gauche non communiste et quelles solutions préconise-t-elle ?
--342-<br />
C<strong>HA</strong>PITRE II<br />
LA GAUCHE <strong>FR</strong>ANCAISE<br />
ET <strong>L'A</strong><strong>FR</strong>IQUE AUSTRALE
-34-3-<br />
La libération des peuples sous le joug du colonialisme, du<br />
racisme et de l'esclavage est un vieux thème dans les résolutions des<br />
partis de gauche d'Europe occidentale. L'extension, tant recherchée, par<br />
les Socialistes, du socialisme démocratique n'est pas possible sans la<br />
démocratie politique et la liberté dans le domaine économique.<br />
<strong>L'A</strong>frique australe est cette partie africaine où les conflits<br />
ideologiques, le racisme érigé en principe de gouvernement , le<br />
colonialisme le plus cynique et le plus traditionnel défient les valeurs<br />
fondamentales du socialisme démocratique.<br />
L'internationalisation des conflits locaux en Afrique est une<br />
donnée désormais irréfutable et ceci en raison des enjeux économiques,<br />
politiques et stratégiques. <strong>L'A</strong>frique, on l'a souvent dit et il convient d'y<br />
insister ici, est longtemps entrée dans la géostratégie des puissances. La<br />
répression coloniale qui sévit en Afrique Australe n'est plus un facteur<br />
analysable sur le plan strictement régional. Il faut tenir compte des<br />
rapports de force à l'échelle mondiale. La dimension Nord-Sud est<br />
indissociable des aspects Est-Ouest.<br />
La nature politique des conflits en Afrique australe a<br />
nettement évolué ces dernières années. Car la ségrègation raciale en<br />
Afrique 'du Sud, traditionnelle dans seG prinoipes de base, fait apparaître<br />
des critères nouveaux dans une situation internationale autre. Par<br />
conséquent, le rappel sommaire des traits qui caraotérisent la situation<br />
actuelle en Afrique australe (enjeux internes et internationaux) peut être<br />
de nature à mieux situer les positions de l'Internationale Socialiste et<br />
du Parti Socialiste français.
-346-<br />
des libertés supposent leur existence. Il n 'y a pas de liberté pour le<br />
Noir en Afrique du Sud. L'arsenal juridique dans l'esprit des dirigeants<br />
de Pretoria doit se renforcer, afin de rendre immuable le. SYStèJD8<br />
politique sud-africain. Car en fait "il s'agit, dans la pbi Ioeophie de<br />
l'apartheid, d'une solution optimale et permanente il la coexistence écono--<br />
mique et politique de groupes de population d'or.igines ethniques diverses.<br />
La classification en races présumées est en effet envisagée comme la clef<br />
de voûte de devoirs et des droits séparés, Justifiés par des<br />
considérations classiques sur la supériorité raciale du groupe blanc" (1).<br />
Le régime sud-africain n'a pas seulement perfectionné la<br />
répression à l'intérieur de territoires sud-africains l il a aussi mis en<br />
place un système de sabotage et de déstabilisation des régimes politiques<br />
voisins. Là aussi une actualLsation des données s'impose. La nouvelle<br />
stratégie régionale de Pretoria consiste à mener une guerre ouverte contre<br />
les Etats de la ligne de Front : l'Angola, le Mozambique, la Zambie, le<br />
Zirnbabwé et la Tanzanie (2). Les dirigeants sud-africains aident et<br />
arment les rebelles de l'Union nationale pour l'indépendance de l'Angola<br />
(l'UNITA). L'UNITA a une sensibilité politique américaine et reçoit l'aide<br />
des USA. Les pays de Front sont politiquement et économiquement affaiblis<br />
par les pressions constantes de l'Afrique du Sud. Les réfugiés<br />
mozambicains affluent au Zimbabwé, en Zambie et en Tanzanie. Le Mouvement<br />
national de résistance (MNR ou Renamo ï opposé au pouvoir en place au<br />
Mozambique est soutenu par Pretoria. La Tanzanie est menacée d'où une<br />
mobilisation constante du parti toujours dirigé pour la circonstance par<br />
Julius Nyeréré. Le coût pour les Etats en présence en vue de se défendre<br />
(1) Cf. Jean-Claude BARBIER - Olivier DESOUCHES - op. cit. page 19<br />
(2) Cf. Le Monde diplomatique -. février 1955- Afrique du Sud la<br />
stratégie-des puis6ances
-347-<br />
s'est élevé entre 1980 et 1986 à près de 25 milliards de dollars. Le<br />
Mozambique y consacre la moitié de son budget. Le Zimbabwé, pour assurer<br />
sa défense dépense près de 300 000 dollars par jour. Pour dab raisons<br />
diverses les Etats furent obligés de rompre leurs relations avec le FM 1.<br />
Ce qut rdevat t conduire à la création en 1980 d'un Comité de Coordination<br />
réunissant les Et.ats de Front, le Botswana, le Malawi, le Lesotho et le<br />
Swaziland. Reconnu sur le plan international ce comité bénéficie du<br />
soutien d'une certain nombre de pays et d'organisations internationales<br />
telles que la Scandinavie et la CEE. Une étude quantitative des forces<br />
armées, des populations et du Produit National Brut par pays a fourni les<br />
résultats suivants Cl) :<br />
ANGOLA<br />
NAMIBIE<br />
BOTSWANA<br />
ZAMBIE<br />
- 8,8 millions d'habitants<br />
- P.N.B. : 4 IDilliards de dollars<br />
- Troupes : 53 000<br />
- 35 000 Cubains<br />
- UNITA : 26 000<br />
- Sud-Africains : 6 000<br />
- 1,13 millions d 'habitants<br />
- P.N .B. : 1,66 milliards de dollars<br />
- Troupes : 22 000<br />
- Sud-Africains : 30 000<br />
- 1,1 million d 'habitants<br />
- P.N.B. : 900 millions de dollars<br />
- Troupes : 3 500<br />
- 6,7 millions d'habitants<br />
- P.N.B. : 2,6 milliards de dollars<br />
- Troupes : 15 000<br />
Cl) Le Monde diplomatique cité<br />
Source: The WorldBank Atlas - 1987 Washington<br />
The military balance 1987-1988 Londres
ZI1ŒABIiE<br />
SWAZILAND<br />
LESOTHO<br />
TANZANIE<br />
){OZAMB IQUE<br />
MALAWI<br />
-348-<br />
- 8,4 millions d'habitants<br />
- P.N.B. : 2,6 milliards de dollars<br />
- Troupes : 47 000<br />
- 760 000 habitants<br />
- P.N.B. : 490 millions de dollars<br />
- Troupes : 5 000<br />
- 1,5 million d'habitants<br />
- P.N.B. : 730 millions de dollars<br />
- Troupes : 4 000<br />
- 22,2 millions d'habitants<br />
- P.N.B. : 5,84 milliards de dollars<br />
- Troupes : 40 000<br />
- 13,8 millions d'habitants<br />
- P.N.B. : 2,5 milliards de dollars<br />
- Troupes : 30 000<br />
- Tanzaniens : 2 000<br />
- 7 millions d 'habitants<br />
- P.N.B. : 1,16 milliard de dollars<br />
- Troupes : 5 000<br />
L'importance de la présence militaire sud-africaine dans la<br />
région ne fait guère de doute. Certains pays furent contraints de signer<br />
des traités de non agression avec l'Afrique du Sud en vue de préserver la<br />
stabilité de leur régime. Tels furent les cas de la Tanzanie en février<br />
1954 et du Mozambique en mars de la même année. Le régime raciste de<br />
Pretoria parvient aussi à nouer des relations commerciales et économiques<br />
avec des pays africains membres de l'O.U.A. (l),<br />
Cl) Cf. Le Monde diplomatique cité
-349-<br />
<strong>L'A</strong>frique du Sud maintient la Namibie dans une situation de<br />
colonisation pure et simple et ceci contrairement à toutes les résolutions<br />
de l'Assemblée Générale des Nations-Unies (l). Le conservatiSlDe sud-<br />
africain en Namibie est dû à la nature stratégique de la région. La<br />
Namibie' joue un rôle important dans le développement économique de<br />
l'Afrique du Sud. Le 'sous-sol namibien est riche en ressources minières :<br />
uranium, diamant, or, cuivre, etc... Le tiers des exportations sud-<br />
africaines d'uranium "provient de la Namibie". Tels sant, sommairement<br />
réunis, les enjeux sur les plans interne et résional auxquüls sont<br />
confr-orrtées Ies forces de gauche en France et l'Internationale Socialiste.<br />
A ces enjeux, se substitue la dimension internationale des conflits en<br />
Afrique, dimension qui n'est pas sans impact sur les positions a.ctuelles<br />
des partis qui nous concernent.<br />
2· Les enjeux internationaux : la stratégie des puissances<br />
<strong>L'A</strong>frique du Sud, sans nul doute, occupe une place de choix<br />
dans la stratégie géo-politique des puissances. La crise financièree de<br />
ces dernières années a considérablement renforcé cette tendance. La<br />
richesse de l'Afrique du Sud en ressources minières stratégiques explique<br />
pour une large part cette primauté dans le commerce international.<br />
Prenons, ici, quelques repères essentiels (2).<br />
(1) Question Namibienne : Cf. La Namibie<br />
Defense et Did Fund for South Africa - Londres<br />
Traduction des Nations-Unies<br />
(2) Cf. Claud BARBIER, Olivier DESOUCHES<br />
op. ctt., - pages 48-80<br />
Les faits <br />
1980<br />
International
plus recherchées :<br />
-350-<br />
<strong>L'A</strong>f rIqua du Sud est un réservoir des ressources minières les<br />
Ressources minières Cl) % de la Production % des réserves<br />
mondiale mondiales<br />
Chrome 39 73<br />
Mll.nganèze 22 78<br />
Platine 48 77<br />
Or 55 51<br />
Vanadium 34 49<br />
Diamants 18 21<br />
Charbon 4 10<br />
<strong>L'A</strong>îrique du Sud considère l'Occident comme un allié naturel<br />
tant dans les domaines économique, financier que politique, voire<br />
idéologique. Elle se comporte en garant financier du monde occidental. La<br />
loi sur la répression du communisme, adoptée en Afrique du Sud depuis<br />
1950, alimente aussi leur discours sur l'appartenance au monde occidental.<br />
Le système politique sud-africain, au niveau thématique, est calqué sur<br />
l'exemple européen. "Le système politique sud-africain 1ui - même,<br />
d'inspiration européenne, est issu du parlementarisme britannique, modifié<br />
par la suite dans le sens du présidentialisme avec l'adoption de la<br />
nouvelle constitution en 1983 ,. le système juridique va dans le même sens,<br />
ainsi que l'appareil de 18 presse. A tous les niveau:...c, on peut noter une<br />
(1) Cf. Jean-Claude BARBIER, Olivier DESOUCHES - op. cit - page 48<br />
Voir également le tableau reproduit page 57, qui donne la puissance<br />
minière sud-africaine par rapport aux autres producteurs du monde<br />
accidenta1- et à l'ensemble des producteurs dans le monde.;
-351-<br />
parenté avec des principes et des pratiques démocratiques, à l'exception<br />
massive près que les Noirs en sont exclus" (1). C'est donc l'orientation<br />
et la pratique du racisme qui constitueraient la différenca.. La<br />
responsabilité occidentale en Afrique du Sud est donc politiquement<br />
évidente. Comment l'Afrique du Sud peut-elle revendiquer les valeurs<br />
politiques occidentales 'pour les "bafouer" en ignorant le respect des<br />
droits de l'homme ? (2). En outre, l'Afrique du Sud, depuis la seconde<br />
guerre mondiale, entretient officieusement des relations avec les Néo-<br />
nazis et l'extrême droite européenne.<br />
Dans les domaines militaire et stratégique, l'Afrique du Sud<br />
occupe le premier plan pour les occidentaux. La route du Cap passe par<br />
l'Afrique du Sud, ce qui fait de ce pays un lieu stratégique pour<br />
l'approvisionnement de l'Occident en matières premières 60 ";. des<br />
approvisionnements en Pétrole des pays d'Europe et 20 % de ceux des USA<br />
passent par le Cap, 70 % des matériaux stratégiques de l'OTAN Y<br />
transitent. Près de 2 500 navires occidentaux "empruntent" la route du<br />
Cap. Pourtant un rapport du Gouvernement américain a prouvé que l'Afrique<br />
du Sud n'était plus "la clé de la sécurité des lignes de cornmunication de<br />
(1) Ibid - page 51<br />
(2) Sur ce point, la thèse américaine est la suivante : "Ce qui place<br />
l'Afrique du Sud li part des autres pays qui ont des politiques aussi<br />
oppressives en ce qui concerne les droits de l'homme, c'est que sa<br />
politique est fondée sur la race, ."légalisée" par la loi et justifiée au<br />
nOlll de la défense de l'Occident contre le commun issme",<br />
Commission gouvernementale américaine - 1981 - Ibid page 52
-356-<br />
des Travaillistes britanniques est critiquée. Leurs rapports politiques<br />
avec le gouvernement raciste sont vivement condamnés par les délégués<br />
africains. Les sanctions économiques sont insuffisantes -seIon la<br />
délégation africaine. Il fallait y substituer une intervention militaire.<br />
En 1965 une conférence des experts de l' IS s'est tenue sur le thème "le<br />
développement économique de la pensée et l'action du socialisme<br />
démocratique dans les jeunes Nations"(l). Ce thème fait ensuite l'objet<br />
d'une déclaration adoptée à l'unanimité mais sans référence à la<br />
"déclaration unilatérale d'indépendance" de lan Smith. Les participants<br />
africains avaient pourtant proposé la censure du gouvernement britannique.<br />
La question sud-africaine pose des problèmes internes à l'IS. En somme ,<br />
les problèmes africains sont étudiés mais les conditions de la présence<br />
africaine reste à déterminer. <strong>L'A</strong>frique, selon M. Devin, reste<br />
impénétrable (2). Le XIe congrès de lrIS se tient à Eastbourne en 1969. La<br />
résolution adoptée condamne le racisme en Afrique australe ainsi que le<br />
colonialisme portugais en tant que conséquence de la dictature interne au<br />
Portugal. Ce qui confortera la position politique de la délégation afri-<br />
caine influencée par la "Déclaration de Lusaka". Cette déclaration adoptée<br />
par la cinquième conférence des Etats d'Afrique centrale et d'Afrique de<br />
l'Est en 1969, est devenue une véritable "charte des luttes de libération"<br />
pour les Africains nationalistes. La stratégie de la lutte armée est pour<br />
l'Afrique la dernière alternative (3). Le Président, K. Kaunda ira jusqu'à<br />
réclamer des Socialistes la condamnation des "restes du fascisme" et du<br />
"colonialisme dans les pays en voie de développement" (4). A la différence<br />
des Socialistes d'Europe du Sud, ceux du Nord ont noué très tôt des rela-<br />
(1) Ibid - page 281 et suivantes<br />
(2) Ibid: "<strong>L'A</strong>frique impénétrable" - pages 433-448<br />
(3) Ibid - page 438 et suivantes<br />
(4) Cité par Guillaume DEVIN· --op. cit. page 348
·-357-<br />
tions pratiques avec les mouvements de libération d'Afrique australe. Les<br />
socio-démocrates suédois et finlandais apportaient déjà assistance et<br />
aide financière aux mouvements suivants le Mouvement Popolaire de<br />
Libération de l'Angola (MPLA), le Front de Libération du Mozambique<br />
-358-<br />
bération nationale. Le <strong>FR</strong>ELIXO et le KPLA sont présents au XIIe Congrès<br />
de l 'IS à Vienne en 1972 et la première conférence sur la Namibie s'est<br />
tenue à Bruxelles en 1972. Mais c'est l'année 1976 qui semble la plus<br />
importante politiquement. L'action de son président d'alors, M. Brandt, fut<br />
déterminante. En 1983 se tient la première conférence de l'18 en Afrique.<br />
<strong>L'A</strong>frique australe sera au centre du débat car tous les peuples de la<br />
ligne de Front sont présents. La condamnation systématique de l'apartheid<br />
est plus soutenue au sein de l' IS et l'action en faveur de8 mouvements de<br />
libération plus concrète.<br />
La deuxième conférence internationale sur la Namibie s'est<br />
tenue à Bruxelles, les 5, 6 et 7 mai 1986 (1) .. L'importance de cette<br />
conférence se situerait à différents niveaux. Elle coïncide à la fois<br />
avec le vingtième anniversaire du mandat de l'Afrique du Sud sur la<br />
Namibie et le vingtième anniversaire du déclenchement de la lutte "armée<br />
héroïque du peuple namibien au colonialisme de l'apartheid et à<br />
l'occupation illégale" de la Namibie par l'Afrique du Sud (2). Les<br />
relations entre Washington et Pretoria sont dénoncées et condamnées. La<br />
politique américaine du linkage (subordonner l'indépendance de la Namibie<br />
à l'évacuation des troupes cubaines d'Angola) est jugée "honteuse". La<br />
politique américaine dans la zone est vivement attaquée. L'indépendance<br />
totale de la Namibie est revendiquée. Ernest Glinne président de la<br />
conférence fait observer "Notre conférence doit alerter la conscience<br />
démocratique, surtout en Europe, et contribuer à une mise en oeuvre<br />
immédiate de la résolution 435 du Conseil de Sécurité, seul fondement<br />
d'une vériteble autodétermination du peuple namibien libre" (3). Le choix<br />
Cl) Cf. Socialisme n 195-196 Mai-Août 1986 - Bruxelles - pages 253-276<br />
(2) Ibid - page 253<br />
(3) Ibid·.-"_page 260
-361-<br />
de missiles anti-chars ENTAC comme mer-mer Exocet" (1). Le secteur nu-<br />
cléaire va connaître un essor considérable sous le septennat de M. Valéry<br />
Giscard d'Estaing (1974-1981>. Car le consortium français constitué de<br />
Framatome, Spie-Batignolles et Alsthom remporta en 1976 le "contrat du<br />
siècle" - relatif à la production de l'énergie électrique à Koeberg en<br />
Afrique du Sud. Le, premier réacteur à eau légère sous pression d'une<br />
puissance de 922 mégawatts est opérationnel depuis 1984. Le second le fut<br />
en 1985. <strong>L'A</strong>frique du Sud reste le terrain le plus propice pour les<br />
bailleurs de fonds occidentaux. Pour l'ensemble des dettes extérieures<br />
sud-africaines, estimation de 1985, 10,5 % concernaient le cas des seules<br />
banques françaises. En 1982, le Fonds Monétaire International concéda à<br />
l'Afrique du Sud un prêt de un milliard de dollars. La France occupe le 4e<br />
rang mondial des créanciers de l'Afrique du Sud (2).<br />
La firme TOTAL
-362-<br />
pour donner la position officielle de son Parti (l). Le Premier secrétaire<br />
du Parti est sans équivoque : la situation générale en Namibie est dénon-<br />
cée. La Namibie est illégalement occupée en violation de toutes les lois<br />
internationales. Le Parti socialiste soutient les résolutions 431 et 436<br />
du Conseil de Sécurité. Le Parti est favorable aux sanctions contre<br />
l'Afrique du Sud et. demande l'arrêt de tout commerce avec la Namibie<br />
notamment l'importation de l'uranium. Le Parti exige la réduction des<br />
importations en provenance de l'Afrique du Sud et demande l'interruption<br />
des investissements publics et des aides consenties aux entreprises<br />
pri vées (2).<br />
Le Parti demande au gouvernement d'apporter son soutien<br />
politique et diplomatique aux réfugiés militants d'Afrique et Sud et de<br />
Namibie.<br />
La résolution 435 du Conseil de Sécurité des Nations-Unies<br />
s'articule autour des points-clés suivants : retrait de l'administration<br />
illégale de l'Afrique du Sud en Namibie, transfert au peuple du pouvoir<br />
par le jeu d'élections libres sous les auspices de l'ONU, etc...
-367-<br />
nomique et social qui affectent les Bts.te de cette zone ne seront pas<br />
réglés comme par enchantement et il restera toujours à définir un tvoe de<br />
...-...<br />
relations entre le géant sud-africain et ses voisins mais ce préalab.l.e.<br />
est néanmoins nécessaire" (1). L'éventualité d'une solution radicale est<br />
ici exclue. Ce qui implique la prise en compte des intérêts réCiproques en<br />
vue d'une négociation. le Parti socialiste met l'accent de nouveau sur<br />
l'inefficacité des sanctions et appuie l'expérience tentée par le "groupe<br />
des sages" du Commonwealth en 1986. Il s'agit d'ouvrir des négociations<br />
entre les autorités sud-africaines et multiraciales. Les gouvernements<br />
occidentaux devraient agir dans ce sens face à la crise sud-africaine.<br />
Cette nouvelle lecture n'est pas dénuée d'ambiguïtés tant au niveau de la<br />
perception de la situation que de la méthode envisageable en vue de<br />
conjurer la crise sud-africaine. Car, selon le premier secrétaire du Parti,<br />
la question sud-africaine ne se pose pas en terme de "résurgence<br />
d'émancipation nationale" mais bien en terme de colonisation (2),<br />
La question centrale des droits de l'homme reste posée. en<br />
Afrique du Sud. Les "réformes marginales" entreprises par le système<br />
raciste de Pretoria n'ont en rien modifié la structure de l'apartheid. La<br />
majorité de la population sud-africaine reste en dehors de la politique<br />
sud-africaine. Ainsi le6 conditions d'une négociation pouvant changer le<br />
caractère raciste du régime restent à déterminer. Le système ct 'apartheid<br />
est-il adaptable ?<br />
(1) Louis LE PENSEC (dir) - op. cit. <strong>L'A</strong>frique australe - page 169<br />
C'est nous qui soulignons<br />
(2) "Il Y a indiscutablement la résurgence d 'émancipation nationale qui<br />
étaient au coeur du thème que vous traitez. On peut, en réalité, dire qu 'il<br />
n y li pas résurgence, mais simplement permanence quand subsistent des<br />
situations de colonisation, comme c 'est vrai pOLIr l'Afrique australe qui<br />
- doit être au coeur de nos préoccupations" Lionel JOSPIN<br />
In Louis LE PENSEC - op. cit. page 261
-368-<br />
La réponse n'apparaît pas clairement (l). Il n'y a pas ici<br />
convergence absolue entre la lecture des Socialistes français et celle de<br />
l'Internationale Socialiste sur la situation en Afrique australe. .!-'exercice<br />
du pouvoir politique et la défense de l'intérêt national ne sont pas sans<br />
conséquences sur la politique sud-africaine des socialistes français. Ce<br />
qui n'est pas syn0l:!yme de conservatisme en la matière, et ceci à la<br />
différence d'autres forces politiques.<br />
(1) La prudence des Socialistes serait liée à l'expérience 1981-1986. Car,<br />
selon Jean-François BAYART : "En Afrique australe, une fois passés les<br />
effusions et les discours,' les limites du nouveau cours se faisaient<br />
sentir. Le coût économique d'une rupture avec la République sud-africaine<br />
effrayait. Imperturbable, le poste d'expansion économique de l'Ambassade<br />
de France à Pretoria continuait d'inciter les entreprises françaises à<br />
répondre aux besoins du marché, et au sein du gouvernement des voix<br />
en vi eegeaieni: Ie .livraison d'un deuxième réacteur à la centrale nucléaire<br />
de Koeberg" - op. cit. page 32
-369-<br />
CONCLUSION GENERALE
A.C.C.T<br />
A.D.E.A.C.<br />
A. F. V. P.<br />
A. 1. D.<br />
A.N.C.<br />
A. P. D.<br />
A.S.E.C.N.A.<br />
A.U.D.E.C.A.M.<br />
A.Z. A. P.O.<br />
B.C.E.O.M.<br />
B.D. P.A.<br />
B. E. I.<br />
B.L.A.C.T.<br />
B. L. P.<br />
B. R. G. M.<br />
C. C. C. E.<br />
C.C.F.O.M.<br />
C. C. P.<br />
C. E. E.<br />
C.E.R.E.S.<br />
C. F. D. T.<br />
C.F. T.C.<br />
C. G. T.<br />
C.H. E.A.M<br />
C. I. E. S.<br />
C. 1. R.<br />
C.N.U.C.E.D.<br />
CONFEMEN<br />
F. A. C.<br />
-375-<br />
Agence de Coopération Culturelle et Technique<br />
Association pour le Développement des echanges<br />
Artistiques et Culturels<br />
Association Française des Volontaires de Progrès<br />
Association Internationale pour le Développement<br />
African National Congress<br />
Aide Publique au Développement<br />
'Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne<br />
en Afrique et à Madagascar<br />
Association Universitaire pour le Développement de<br />
l'Enseignement et de<br />
Madagascdr<br />
la Culture en Afrique et à<br />
Azanian People Organization<br />
Bureau Centra 1 d'Etudes pour<br />
d'Outre-Mer<br />
les Equ i peIllents<br />
Bureau pour' le Développement de la Production<br />
Agricole<br />
Banque Européenne d'Investissement<br />
Bureau des Liaisons des Agents de<br />
Technique<br />
British Labour Party<br />
Coopération<br />
Bureau de Recherches Géologiques et Minières<br />
Caisse Centrale de Coopération Economique<br />
Caisse Centrale de la France d'Outre-mer<br />
Convention People's Party<br />
Communauté Economique Européenne<br />
Centre d'Etudes,<br />
Socialiste<br />
de Recherches et d'Education<br />
Confédération Française Démocratique du travail<br />
Confédération Française des Travai l leurs, Chrétiens<br />
Confédération Génèrale du Travail<br />
Centres des Hautes Etudes sur l'Afrique et l'Asie<br />
Modernes<br />
Centre International des Etudiants et Stagiaires<br />
Convention des Institutions Républicaines<br />
Conférence des Nations Unies pour le Commerce et<br />
le Développement<br />
Conférence des Ministres de<br />
Francophone<br />
l'Education Nationale<br />
Fonds d'Aide et de Coopération
F. A. O.<br />
F. E. D.<br />
F.G. D.S.<br />
F.LD.A.<br />
F.l.D.E.S.<br />
F. M. 1.<br />
<strong>FR</strong>EL l MD<br />
G.A.T.T.<br />
G. E. R.D. A.T<br />
l.E.D.E.S.<br />
l.E.MV.T.<br />
1. F. C C.<br />
I.I.AP.<br />
I.I.H.S.<br />
i. O. S.<br />
I.R.A.T.<br />
I.R.CA.<br />
I.R.e.T.<br />
l.R.F.A.<br />
r. S.<br />
K. A. N. U.<br />
M. L. P.<br />
M.N.R.<br />
M.P.L.A.<br />
M.R.G.<br />
M. S. A.<br />
O. C. A. U.<br />
O.F.E.R.M.A.T.<br />
-376-<br />
Organisation des Nattons Unies pour l'Alimentation<br />
et l'Agriculture<br />
Fonds Européen de Développement<br />
Fédération de la Gauche démocratique et Socialiste<br />
Fonds International de Développement Agricole<br />
Fonds d'Investissement pour le Développement Ecomique<br />
et Social des Territoires d'Outre-mer<br />
Fonds Monétaire International<br />
Front de Libération du Mozambique<br />
Accord Général sur les tarifs douaniers et le<br />
Commerce<br />
Groupement d'Etudes et de Recherches pour le<br />
Développement de l'Agronomie Tropicale<br />
Institut d'Etudes du Développement Economique et<br />
Social<br />
Insti.tut d'Elevage et de Hédecirie Vétèrina1r
-377-<br />
O.N.G. Organisations Non Gouvernementales<br />
O.R.S.T.O.M. Office de la Recherche Scientique et Technique<br />
d'Outre-mer<br />
O.U.A. Organisation de l'Unité Africaine<br />
P.A.C. Pan Africanist Congress of Azania<br />
P.C.F. Parti Communiste Français<br />
P.M.A. Pays les Moins Avancés<br />
P. N.B. Produit National Brut<br />
P. N. U. D. Programme des Nations-1Jnies pour le Développement<br />
P.O.B. Parti Ouvrier Belge<br />
P. R. A, Parti de Regroupement Africain<br />
P.S.A. Parti Socialiste Autonome<br />
P,S.1. Parti Socialiste Italien<br />
P.S.U. Parti Sooialiste Unifié<br />
P.V.D.A. Parti du Travail Néerlandais<br />
R, D, A. Rassemblement Dèmocraique Africain<br />
S.A. Socialist Affairs<br />
S.A.LP, Parti Travailliste d'Afrique du Sud<br />
S.A.T.E,C, Société d'Aide technique et de Coopération<br />
S,C,E,T. Société Centrale pour l'Equipement du Terrttoire<br />
S.E.D,E.S, Société d'Etudes pour le Développement Economique<br />
et Social<br />
S.F. [, Société Financière Internationale<br />
S.F, [.0. Section Française de l'Internationale Ouvrière<br />
. S, 1. l . Socialist International Information<br />
S.M.V,H.Secrétariat des Missions Urbaines et Habitat<br />
S.O.D.E.T.R,A.F. SOciété pour le DEveloppement des TRansports<br />
Aériens en AFrique<br />
S.O. F. R, E. A. V, r . A. SOciété <strong>FR</strong>ançaise d'Etudes (,t de Réalisations<br />
d'Equipements Aéronautiques<br />
S.O.F.R,E.C.O,M. SOciété <strong>FR</strong>ançaise d'Etudes et de réalisations<br />
d'EquipemeDts de Télécommunications<br />
S. P. D, Parti Social-Démocrate allemand<br />
STABEX Système de stabilisation des recettes<br />
d'exportation des produits agricoles<br />
S.W.A.P.O, SoutbWest Africa People's Organization<br />
T.A.N.V. Tanganyika African National union<br />
V, A. M. Vni0I! Africaine et Malgache<br />
V. D.F. United Democratie Front
U. D.S.R.<br />
U. F. D.<br />
U. G. D. S.<br />
U. M. O. A.<br />
U.lI.I.T.A<br />
U.P.S.<br />
Union Démocratique et Sociale de la Résistance<br />
Front Démocratique Uni<br />
Union de la Gauche socialiste et démocrate<br />
Union monétaire Ouest-Africaine<br />
Union Nationale pour l'Indépendance de l'Angola<br />
Union Progressiste Sénégalaise
BIBLIOGRAPHIE<br />
GENERALE
GRIMAL Henri<br />
GROSSER Alfred<br />
HERNU Charles<br />
JAURES Jean<br />
JOUVE Edmond<br />
KOLN S.C.<br />
KRIEGEL Annie<br />
MANCERON Claude et<br />
PINGAUD Bernard<br />
-381-<br />
La décolonisation 1919-1963<br />
Armand Colin - Paris - 1963 - 408 pages<br />
Affaires extérieures La politique de la<br />
France 1944/1984<br />
Ed. Flammarion - Paris - 1984 - 346 pages<br />
Soldat-Citoyen essai sur la défense et la<br />
sécurité de la France<br />
Flammarion - Paris - 1975 - 258 pages<br />
Pages choisies<br />
Editions Rieder - 1922<br />
L'Organisation de l'Unité Africaine<br />
PUF - Paris - 1984 - 284 pages<br />
Solutions socialistes à propos de la transition<br />
socialiste<br />
Ramsey - Paris - 1978 - 495 pages<br />
Libéralisme et Socialisme<br />
Guy Authier - Paris - 1977 - 438 pages<br />
François Mitterrand l'homme, les idées,<br />
le programme<br />
Flammarion - Paris - 1981<br />
MERLE Marcel Sociologie des Relations internationales<br />
Dalloz (3e éd.) - Paris - 1982 - 527 pages<br />
MESSINE Philippe Nord-Sud: la Gauche An l - Critique de<br />
l'économie politique<br />
Maspero - Paris - 1982<br />
MIC<strong>HA</strong>LET Charles-Albert Le défi du développement indépendant<br />
Editions Rochevignes - Paris - 1983<br />
MITTERRAND François Ma part de vérité<br />
Fayard - Paris - 1969<br />
Le Socialisme du possible<br />
Ed. Seuil - Paris - 1970 - 125 pages<br />
La paille et le grain<br />
Gallimard - Paris - 1975 - 301 pages<br />
Réflexions sur la politique extérieure de la<br />
France - Introduction à vingt-cinq discours<br />
1981 - 1985<br />
Editions Fayard - Paris - 1985 - 441 pages<br />
NANIA. Guy Un parti de la gauche : le PSU<br />
Librairie Gédalgue - 1966
NAY Catherine<br />
PISANI Edgar<br />
PORTELLI Hugues ,<br />
PORTELLI Hugues (Dir.)<br />
PORTELLI Hugues et<br />
<strong>HA</strong>NLEY David (Dir.)<br />
SEDILLOT Robert<br />
SURET-CANALE Jean<br />
TOUC<strong>HA</strong>RD Jean<br />
ZIEGLER Jean<br />
-382-<br />
Le noir et le rouge ou l'histoire d'une<br />
ambition<br />
Ed. Grasset et Fasquelle - Paris - 1984<br />
380 pages<br />
La main et l'outil: le développement du<br />
Tiers-monde et l'Europe<br />
Robert Laffont - Paris - 1984 - 241 pages<br />
La politique en France sous la Ve République<br />
Ed. Grasset - Paris - 1988 - 341 pages<br />
L'internationale socialiste<br />
Ed. ouvrières - Paris - 1983 - 188 pages<br />
Social-Démocratie et défense en Europe<br />
Institut de Politique Internationale et<br />
Européenne - université de Paris X Nanterre<br />
1985 - 345 pages<br />
Histoire du Socialisme<br />
Guy Authier - Paris - 1978 - 495 pages<br />
<strong>L'A</strong>frique noire: de la colonisation aux<br />
indépendances 1945-1960<br />
Ed. Sociales - Paris - 1977<br />
La Gauche en France depuis 1900<br />
Editions du Seuil - Paris - 1977 - 412 pages<br />
Vive le Pouvoir ! ou les délices de la raison<br />
d'Etat<br />
Seuil - Paris -1985
BELOTEAU Jacques<br />
MASQUET Brigitte<br />
N· 24 - Mars 1947<br />
N" 30 - 1948<br />
N· 51 - 1950<br />
Février 1949<br />
N· 112 - Juin 1959<br />
MARC<strong>HA</strong>IS Georges<br />
ROCHET Waldeck<br />
THOREZ Maurice<br />
Juin-Juillet 1962<br />
Juin-Juillet 1971<br />
-383-<br />
II - LES REVUES<br />
A<strong>FR</strong>IQUE CONTEMPORAINE<br />
Les 21 PMA d'Afrique noire<br />
N· 119 - Janv.-Fév. 1982 - Pages 1-9<br />
France-Afrique : dépasser les contradictions<br />
N' 119 - Janv.-Fév. 1982<br />
BULLETIN INTERIEUR PS-SFIO<br />
Le Conseil national de la SFIO<br />
Le Parti et l'Union française - Pages 16-17<br />
Rapport d'Oreste Rosenfeld - page 53<br />
Résolution portant programme d'action du PS<br />
dans les Territoires d'Outre-Mer<br />
51e congrès SFIO<br />
CAHIERS DU COMMUNISME (LES)<br />
Rapport à la Conférence nationale du PCF<br />
Gennevilliers - 2-3 février 1963<br />
Supplément aux cahiers du Communisme<br />
N' Janv.-Fév. 1963<br />
Extrait du rapport présenté au Comité central<br />
d'Ivry - Mai 1963<br />
Juin 1963 - Page 152<br />
Cinquante ans après le tournant décisif<br />
d'octobre 1917<br />
Oct.-Nov. 1967 - Page 20<br />
Rapport au Comité central<br />
Kai 1956 - page 25<br />
COURRIER DU PSU (LE)<br />
Motion adoptée au Conseil national<br />
CRITIQUE SOCIALISTE -PSU<br />
BRIDIER Manuel : Pour un débat sur la stratégie<br />
internationale --page 69<br />
.'.
PLANTEY Ala in<br />
N' 143 - 1962<br />
N· 7 - 1977<br />
Ii· li - <strong>1958</strong><br />
If' 25 - Mai-Juin 1980<br />
BARBE R.<br />
HINCKER M.<br />
MEYNARD Jean-Paul<br />
et PREJEAN A.<br />
ROCARD Kichel<br />
22/12/1982<br />
Septembre 1968<br />
ROUS Jean<br />
-3.'34-'<br />
DEFENSE NATIONALE<br />
Diplomatie et armement<br />
MARS 1984 - Pages 31--50<br />
DOCU1(ENTAIION SOCIAL131E<br />
Les pays sous-développés<br />
DOSSIERS DE L'HISTOIRE<br />
AYACHE Georges<br />
Pages 1-35<br />
ECONOMIE ET POLITIQUE<br />
Le temps du silence<br />
Problèmes de l' orientati.on du développement<br />
économique en Afrique noire<br />
Janv.-Juin 1962 - Pages 179-197<br />
Indépendance politique et développement<br />
économique en Afrique<br />
Juillet-Déc. 1960 - Pages 15-·35<br />
Marché commun et néo-colonialisme en Afrique<br />
Janv.-Juin 1962 - Pages 47-64<br />
Nord-Sud, l' ambi tian socialiste<br />
Décembre 1980 - Pages 17-21<br />
JEUNE A<strong>FR</strong>IQUE<br />
Départ de Cot : les Africains y gagnent-i 1s<br />
NOUVELLE rRITIQUE<br />
Déclaration du bureau politique du PCF<br />
5 août 1968 - Page 18<br />
NOUVELLE REVUE SOCIALISTE<br />
L'anticolonialisme chez Jaurès et les perspeet<br />
ives socialistes en Afr i qu a. _<br />
t'T' 6 - 1974
AKSELLE Jean-Loup<br />
BU lJTENHUIJS R.<br />
LUCK<strong>HA</strong>M R.<br />
MOURIC N.<br />
OTAYEK Robert<br />
HUNTZINGER Jacques<br />
CHEYSSON Claude<br />
Numéro spécial<br />
AVRIL Pierre<br />
COHEN Samy<br />
DU<strong>HA</strong>MEL Olivier<br />
GIRARDET Raoul<br />
-:.,·85-<br />
POLIIIl)UE A<strong>FR</strong>IC.AliŒ<br />
La politique de la Banque mondiale au sud<br />
du Sahara<br />
N" 10 - Juin 1983 - Pages 113-118<br />
L'art de ménager la chévre et le chou - la<br />
politique tchadienne de François Mitterrand<br />
N· 16 - Décembre 1984 - Pages 102-117<br />
Le militarisme français en Afrique<br />
N· 6 - Mai 1982 - Pages 45-71<br />
La politique tchadienne de la France sous<br />
Valéry Giscard d'Estaing<br />
N" 16 - Décembre 1984 - Pages 86-101<br />
La Libye face à la France au Tchad :<br />
Qui perd gagne ?<br />
N" 16 - Décembre 1984 - Pages 66-85<br />
POLITIQUE ETRANGERE<br />
La politique étrangère du parti socialiste<br />
N· 2 - 1975 - Pages 177-179<br />
POL IIl QUE l NTERNATlillf.A1.E.<br />
L'Europe face au désordre économique mondial<br />
N" 3 - 1979<br />
POUVOIRS<br />
81 La Gauche au pouvoir<br />
N' 20 - 1982<br />
Chaque institution à sa place<br />
le parti et le groupe<br />
N· 20 - 1982 - Pages 115-126<br />
Les hommes de l'Elysèe<br />
N" 20 - 1982 - Pages 87-100<br />
le Président,<br />
1981 : la Ve achevée (Sllt- dix caractéristiques<br />
du rôgime)<br />
N" 20 - 1982 - Pages 127-135<br />
Autour de la notion de tradition politiqu8<br />
Essai et problématique<br />
N" 42 - 1987 - Pages 5-14
Programme commun de gouyernement<br />
du Parti cOmmuniste<br />
et du Parti socialiste<br />
-390-<br />
Rapport de Georges MARC<strong>HA</strong>IS Secrétaire<br />
Général du PCF - XXlle congrès du PCF<br />
Réunion du 4 au 8 février 1976<br />
PCF - Paris<br />
KANAPA Jean : Le mouvement comuuniste<br />
international hier et aujourd'hui<br />
PCF - Paris - 1977 - 29 pages<br />
L'impérialisme français aujourd'hui<br />
Journées d'études de la Section de polItique<br />
extérieure du Comité central du<br />
PCF - 22-23 mai 1976<br />
Ed. Sociales - Paris - 1977 - 191 pages<br />
27 juin 1972<br />
Editions Sociales - Paris - 1972<br />
192 pages
A N N E X E S
1 - Discours de François MITTERRAND<br />
Président de la République française<br />
Conférence sur les Pays les Moins Avancés
PRE S IDE NeE<br />
DEL A<br />
R E PUB L 1 QUE<br />
SERVICE DE PRESSE<br />
DISCOURS<br />
DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE<br />
PRONONCE LORS DE LA SEANCE INAUGURALE<br />
DE LA CONFERENCE DE PARIS<br />
SUR LES PAYS LES MOINS AVANCES<br />
Cler SEPTEMBRE 1951)
-396-<br />
Conférence devront être menés et nous savons, Monsieur le<br />
Directeur Général, à quel point vous tiennent à cOÇur les<br />
idéaux qui justifient l'aci:ion de l'UNESCO. J'exprime éga::'e<br />
ment notre gratitude,pour la tâche déjà accomplie en vue de<br />
cette Conférencè et celle qui reste à faire, envers tous les<br />
fonctionnaires des Nations Unies qui se sont dévoués àsa<br />
réalisation et au premier rang, ceux de la CNUCED que àiri<br />
ge avec distinction et compétence M. Gamani COREA.<br />
De notre côté, croyez bien que vous mettrons tout<br />
en oeuvre pour que votre séjour dans notre capitale soit<br />
le plus agréable possible. Et aussi, et surtout, pour que<br />
cette Conférence de Paris reste dans .Les rn êmoi r e s comme<br />
un progrès' important de la coopération du Nord et du Sud,<br />
des pays déjà développés avec les pays en développement, des<br />
plus riches avec les plus ·démunis.<br />
.2.<br />
.r.
-403-<br />
La France entend faire porte r son action dans cinq domaine s pr i nc i pa u:<br />
- Premièrement, elle souhaite que dans les r2.ppOlï:5<br />
Nord-Sud un esprit de re s po n s abilité partagée remplace la rnèfi ance<br />
et l'indifférence. 'Une volonté nouvelle de se comprendre et d'agir doit<br />
se manifester. Les conversations au niveau des Che f s d'Etal qui se<br />
tie ndro nt en octobre à Cane un contribue l'ont à forge r ce tte vo lont é.<br />
L'engagement de négociations globales lui permettra de se traduire<br />
par des actions concrètes correspondant à des intérêts mutuels.<br />
Avec ses partenaires, la France fera son possible pour que cette<br />
volonté se manifeste à brève échéance.<br />
- Deuxièmement, la France souligne l'importance d'ai<br />
der concrètement les pays du Sud à surmonter les difficultés aiguës<br />
provoquées par l'alourdissement de leur facture énergétique. Elle<br />
a proposé à Nairobi l'établissement d'un inventaire économique des<br />
énergies nouveEes et renouvelables. Elle apporte son soutien entier<br />
au projet de création d'une "filiale énergie" de la Banque Mondiale<br />
qui associerait, à responsabilités égales, les Pays du Nord e-t les<br />
Pays du Suu au développement énergétique du Tiers-Monde.<br />
s .<br />
- T'r-oi s i èrne rne nt, la France r-e c orma ît que tout<br />
processus de développement, surtout si son rythme est rapide,<br />
réclame dl importante s disponibilités financière s. Le s engage me nts<br />
pris par la Cornrnunaut é inte rnationale n'ont pas été te nus pe ndant<br />
... / ...
- 404.--<br />
.10.<br />
les années de forte croissance et de pr o s pé r it é • Il faudra pour t a n:<br />
les atteindre alors que les circonstances S(I.1t moins Iavoiable s . Le<br />
France a décidé de rattraper son propre r e t ar-d et de parvenir d:c:<br />
à 1988, dans le cadre de son prochain plan de développement écono<br />
mique, à l'objectif de 0,7% du PNB d'aide publique adopté par les<br />
Nations Unie s.<br />
A cet égard, la situation des pays les moins avancés<br />
appelle un effort particulier. L'idée de réserver aux pays les moins<br />
a vancé s une part non négligeable du montant global de l'aide publique,<br />
nous paraft tout à fait appropriée.<br />
- Comme quatrième volet de notre action, il nous<br />
paraft indispensable d'apporter aux pays en développement dans<br />
leur ensemble et, notamment aux pays les moins avancés, plus de<br />
stabilité et de continuité dans leurs recettes. L'équilibre de<br />
nombreuses économies dépend des recettes d'exportation d'un seul<br />
produit. Po u vo i r prévoir. ces recettes telle est la condition s ina qua<br />
non du développement.<br />
La France se montre favorable à la stabilisation de s<br />
recettes provenant de l'exportation des mat iè r e s premières du Ticrs<br />
Munde. il s'agit d'une part, des accords de produits et nous p r ofiions<br />
de cette occasion pour saluer les efforts de la CNUCED en ce do rn a i ne<br />
... / ...