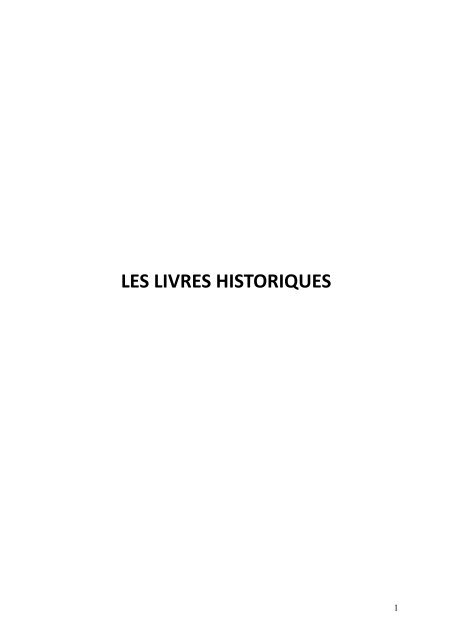Poly - Introduction aux Livres Historiques - Dogmatique.net
Poly - Introduction aux Livres Historiques - Dogmatique.net
Poly - Introduction aux Livres Historiques - Dogmatique.net
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
LES LIVRES HISTORIQUES<br />
1
1. LE PENTATEUQUE<br />
1.1 <strong>Introduction</strong> au Pentateuque<br />
1.1.1 Le nom<br />
Signifie en tant que tel « le (livre) en 5 parties ». Cela vient de la LXX. C’est une référence <strong>aux</strong><br />
5 morce<strong>aux</strong> de peau qui entouraient le livre en forme d’un gant. Ce mot est passé à la<br />
Vulgate puis à nous.<br />
Le canon hébraïque nomme les livres par les premières paroles :<br />
Genèse : Bereshit = Commencement<br />
Exode : Semot = Les noms<br />
Lévitique : Wayyiqra = Et il appela<br />
Nombre : Bamidbar = Dans le désert<br />
Deutéronome : Dbarim = Des paroles (discours d’adieu de Moïse).<br />
La tradition juive appelle ces livres la Torah.<br />
- La Torah est le Pentateuque ;<br />
- Les Néviim sont les prophètes antérieurs (tradition Deutéronomiste) et les prophètes<br />
postérieurs (livres prophétiques) ;<br />
- Les Kétoubim sont les récits poétiques et sapienti<strong>aux</strong>.<br />
Ces trois éléments de Torah, Néviim et Kétoubim sont le TaNaK.<br />
Le Pentateuque commence avec le récit de la création et s’achève <strong>aux</strong> dernières paroles de<br />
Moïse en Moab. C’est donc une structure historiographique.<br />
1.1.2 L’auteur<br />
Pour la tradition juive, c’est Moïse qui est l’auteur, sauf pour le chapitre 34 du Deutéronome<br />
qui raconte sa mort. Quoi que certains aient affirmé qu’étant prophète c’est lui qui l’aurait<br />
écrit.<br />
Les commentateurs juifs du Moyen Age posent des problèmes. Surtout Ibn-Ezra qui au 12 ème<br />
siècle montre des incongruités d’expression.<br />
Ainsi il relève :<br />
2
Gn 36,31 : « Voici les rois qui régnèrent au pays d'Edom avant que ne régnât un roi des Israélites. »<br />
Or, au temps de Moïse, les juifs n’ont pas de roi.<br />
Gn 13,7 : « Il y eut une dispute entre les pâtres des troupe<strong>aux</strong> d'Abram et ceux des troupe<strong>aux</strong> de Lot<br />
(les Cananéens et les Perizzites habitaient alors le pays). »<br />
Moïse n’a pas pu dire cela par rapport <strong>aux</strong> cananéens car au moment où le texte est<br />
écrit il sous-entend que désormais les Cananéens et le Perizzites n’y habitent plus.<br />
Gn 50,10 : « Etant parvenus jusqu'à Gorèn-ha-Atad, - c'est au-delà du Jourdain, - ils y firent une<br />
grande et solennelle lamentation, et Joseph célébra pour son père un deuil de sept jours. ».<br />
Or, celui qui parle est en Canaan et Moïse n’est jamais entré en Canaan.<br />
On ne remet cependant pas en cause Moïse comme auteur avant le 16 ème siècle. Vient<br />
ensuite l’idée en milieu juif avec Baruch Spinoza.<br />
1.1.3 Origine de la théorie documentaire classique :<br />
De la fin du 18 ème siècle à maintenant c’est la patronne de l’interprétation sur les auteurs du<br />
Pentateuque. Elle est :<br />
à la base de l’exégèse,<br />
la plus en vogue,<br />
on la trouve dans les manuels classiques<br />
mais Paximadi ne la partage pas.<br />
cependant il est impératif de la connaître.<br />
La théorie de Jean Astruc (mi 18 ème , protestant).<br />
Il remarque que quelques parties du Pentateuque utilisent le tétragramme sacré pour le<br />
nom de Dieu et que d’autres utilisent Elohim. Aussi, le Pentateuque serait une fusion de<br />
textes antiques mis en une seule œuvre. C’est pour cela que souvent on voit une histoire en<br />
2 récits. Il s’agit de deux œuvres différentes qui sont unies.<br />
J. G. Eichhorn s’unit à Astruc et les deux donnent une exposition autoritaire.<br />
Le document originaire contenant le tétragramme est le « document Yahviste », l’autre qui<br />
contient Elohim est le « document Elohiste ».<br />
3
En 1798, un autre exégète, K. D. Ilgen fait une autre observation en se fixant sur le<br />
document Elohiste. Il montre que ce n’est pas une seule œuvre. Il y a des caractéristiques<br />
théologiques, stylistiques, littéraires… Il y aurait le 1 er Elohiste qui serait le document ou code<br />
ou œuvre Sacerdotale, et le 2 ème Elohiste.<br />
Nous avons là le squelette de la théorie documentaire. Le Pentateuque est comme une<br />
fusion de documents complets en tant que tel.<br />
Selon l’hypothèse fragmentaire, il ne s’agit pas d’œuvres entières, mais de fragment mis<br />
ensemble par le dernier rédacteur. Ceci n’a eu que peu de succès.<br />
Le Deutéronome était à part.<br />
Il y aurait donc 4 sources :<br />
1. Yahviste : J<br />
2. 1 er Elohiste : E1 ou P (Priester codex) = code Sacerdotal<br />
3. 2 ème Elohiste : E2<br />
4. Deutéronome : D<br />
En 1865 Karl Heinrich Graf (1815-1869) publie une œuvre où l’on accepte cette répartition.<br />
Jusque là on pensait que le Sacerdotal était le plus ancien. Mais lui pense que c’est le<br />
Sacerdotal le plus récent. Il démontre que les lois sacerdotales contenues dans le<br />
Pentateuque (prescriptions liturgiques, lois de pureté, législation sur le sacerdoce, etc.) sont<br />
inconnues du Deutéronome, des Prophètes antérieurs à l’exil et des livres historiques, qui ne<br />
les citent jamais. Il en conclut que l’ensemble des lois sacerdotales et leur cadre narratif sont<br />
postérieurs à ces livres et n’ont pu $être rédigés qu’après l’exil. Ce serait la base sur laquelle<br />
on a inséré les autres sources que l’on a distribué selon la structure du code Sacerdotal. Le<br />
cadre de base du Pentateuque est donc Sacerdotal. Il y a donc un changement de datation et<br />
de cadre.<br />
Abraham Kuenen (1828-1891), à la suite de Graf, reconstitue l’ensemble de la source P du<br />
Pentateuque (récits + lois Sacerdotales), qui se trouvaient correspondre exactement au<br />
4
document E1. Ainsi, ce que l’on pensait être un écrit très ancien, apparaissait désormais<br />
comme la couche la plus récente du Pentateuque.<br />
Graf et Kuenen disent que d’abord vient le Yahviste puis l’Elohiste et enfin le Deutéronome<br />
qui aurait été rédigé peu avant la réforme de Josias en 622 comme manifeste de la réforme<br />
religieuse. Le code Sacerdotal aurait donc été écrit après l’Exil et promulgué par Esdras.<br />
L’ordre est donc J. E. D. P. La source P aurait fournit le cadre conceptuel de base du<br />
Pentateuque.<br />
Julius Wellhausen (1844-1918) est celui qui rend systématique la pensée de Graf en 2<br />
œuvres :<br />
1. Prolegomena zur Geschichte Israels, Berlin 1883. C’est son chef-d’oeuvre.<br />
2. Die Composition des Hexateuchs und des historischen Bücher des Alten Testaments,<br />
Berlin, 1876. On peut voir Hexateuch in T. K. Cheyne – S. Black, Encyclopedia Biblica,<br />
II, Londres 1901.<br />
A l’époque à Berlin, c’est l’idéalisme allemand de Hegel et tout ce qui s’en suit. Il y a une<br />
théorie évolutionniste du phénomène religieux :<br />
Thèse : L’origine serait une religion naturaliste.<br />
Antithèse : L’évolution serait venue par les prophètes : religiosité spirituelle. Ceci donne le<br />
monothéisme éthique fondé par le prophétisme.<br />
Synthèse : Après l’exil, la religion cultuelle légale du code Sacerdotale.<br />
Or, eriger le prophétisme est anti-historique car le prophétisme est une partie du culte et du peuple.<br />
Le but de Wellhausen est de reconstruire l’histoire d’Israël. Le post-exil est vu négativement.<br />
(Influence anti-sémite). Le sommet est pour lui le prophétisme.<br />
Ensuite, la synthèse devient thèse, l’antithèse sera le christianisme et la synthèse sera<br />
l’Esprit Absolu. On retrouve donc l’être protestant et hégélien de Wellhausen.<br />
Sa méthode :<br />
Pour évaluer les successions des différentes couches, il part des lois sacrales (qui sont<br />
conservatrices car une fois le précepte donné il n’y a aucune raison qu’il change et donc c’est<br />
un acquis) et regarde leur évolution. La loi la plus ancienne sur les lieux saints se trouve dans<br />
5
l’Elohiste et le Yahviste. Il y a une absence d’unicité de lieux d’adoration, il y a des usages de<br />
stèles et d’autres représentations, il y a une diversité de lieux de cultes autorisés par une<br />
manifestation divine. (Ex. de Béthel, Penuel).<br />
Ceci est très différent du code Sacerdotal et Deutéronomiste :<br />
Le Deutéronomiste réagit polémiquement et affirme en Deut 12 un seul lieu de culte<br />
qui est à Jérusalem. C’est le manifeste de la réforme du roi Josias en 622.<br />
Le Sacerdotal est tranquille et l’unicité du lieu est présupposée, à cette époque, le<br />
problème ne se pose plus. Le Sacerdotal projette cette unicité à l’épisode du désert<br />
où l’on voit la tente (Ex 25) qui serait le Temple de Jérusalem dans le Désert.<br />
D’un prêtre dans chaque sanctuaire (Silo, Béthel) on passe à un phénomène où les<br />
prêtres vont à Jérusalem laissant les sanctuaires périphériques (est-ce la naissance<br />
des lévites ?). Il est post-exilique.<br />
L’étiologie : ce sont des légendes qui veulent expliquer une origine. Le Sacerdotal insère tout<br />
dans une généalogie qui est l’instrument prince du Sacerdotal.<br />
Aussi, les textes de J et E sont de pures légendes, et les textes de P sont des légendes<br />
narratives dans le but d’une systématisation pour rendre définitive la doctrine.<br />
On en arrive donc à un rigide évolutionnisme religieux et à l’exclusion de toute possibilité<br />
d’intervention surnaturelle. C’est évident.<br />
1.1.4 Exposition systématique de Graf et Wellhausen.<br />
On la partage ou on ne la partage pas, mais il faut la savoir. La Vulgate a influencé<br />
pratiquement toute la littérature successive. Il y a plusieurs points :<br />
1. Premier moment : en plusieurs étapes :<br />
a. Peut-être à l’époque de Moïse, en tout cas en époque pré-monarchique, il y a<br />
l’élaboration de traditions autour de 2 noy<strong>aux</strong> princip<strong>aux</strong> qui sont un peu comme des<br />
catalyseurs et qui sont les sanctuaires et les traditions étiologiques des groupes<br />
trib<strong>aux</strong>.<br />
6
L’étiologie est l’histoire des origines d’une chose particulière comme un sanctuaire, un lieu,<br />
un nom, une personne… des héros éponymes. (L’éponyme donne son nom à quelque chose).<br />
Dans notre cas, il s’agit d’étiologie liée à des lieux, comme par exemple le cas du sanctuaire de<br />
Béthel où Jacob a vu monter et descendre des anges du ciel et il s’est dit que c’était la maison<br />
de Dieu d’où le nom de Béthel qui en est la traduction. Mais l’étiologie peut aussi concerner<br />
des héros éponymes qui sont à l’origine des races ou lignées.<br />
b. Durant la monarchie unitaire (règne de Saül, David et Salomon), ces traditions<br />
prennent forme en récits poétiques ; le Livre du Juste (Josué 10,12) ; le Livre des<br />
guerres de Jahvé (Nb 21,14).<br />
c. Après le schisme (925) ces traditions continuent à exister en un mélange de<br />
particularisme loc<strong>aux</strong> et de fidélité à l’idée de base d’une providence divine envers<br />
Israël.<br />
2. Le deuxième moment : le Yahviste<br />
Il vient après le schisme religieux et politique (925) ; ces traditions continuent d’exister. Il y a<br />
des idées particulières locales comme par exemple l’élection d’Israël et la providence de<br />
Dieu pour Israël.<br />
C’est alors que nous voyons la formation du Yahviste. Le Yahviste est la tradition propre du<br />
sud. Ce n’est pas une œuvre unitaire, il y aurait 3 couches :<br />
1. Le 1 er Yahviste qui contient Caïn : l’histoire primitive Yahviste sans<br />
le déluge ;<br />
2. vers la moitié du 9 ème siècle, le 2 ème Yahviste<br />
3. plus tard le 3 ème Yahviste.<br />
Le terminus post quem pour attribuer cette date est Gn 27,40 : la libération d’Esaü du joug<br />
du frère est l’affranchissement d’Edom de la tutelle de Juda, qui advient sous le règne de<br />
Joram (853 ?-841). Cf. 2Rois 8,20.<br />
Nous savons que Esaü est le 2 ème héro éponyme des Edomites. (Le 2 ème nom d’Esaü est Edom). Les<br />
édomites ont longtemps été sous la tutelle de Juda. L’affranchissement à lieu sous le règne de Joram<br />
(853-841) cf. 2Roi 8,20. Le Yahviste aurait été formé après cela. C’est le terminus post quem.<br />
7
Les caractéristiques de J sont un langage vivace et tendant à l’anthropomorphisme<br />
(humaniser le divin), la simplicité, le coloris, la finesse psychologique et la profondeur<br />
religieuse, une vision théologique créative souvent basée sur la dialectique<br />
promesse/accomplissement.<br />
3. La troisième étape : l’Elohiste.<br />
C’est la tradition du règne du Nord, très influencée par la « religion morale » des prophètes<br />
typique du Nord. Il y a :<br />
1. E1 qui contient les oracles de Balaam en Nb 23. Ce serait un texte du début du<br />
8 ème siècle.<br />
2. E2 qui intègre E1 et il serait postérieur au règne de Jéroboam II (vers 770), qui<br />
repousse Moab au sud de l’Arnon (cf. Nb 21,13 1 ), mais antérieur à la chute de<br />
Samarie en 721.<br />
La caractéristique de E est la majeure attention à la dimension éthique et un soulignement<br />
de la réponse d’Israël à l’initiative de Dieu en terme de Foi et de Crainte. De style plus sobre<br />
que le Yahviste, ses récits sont aussi plus épisodiques, le plan général de l’œuvre est moins<br />
<strong>net</strong>tement dessiné. Il se préoccupe plus de l’aspect moral et il se plaît à souligner les<br />
interventions divines qui se produisent souvent dans un songe la nuit et très rarement en<br />
anthropomorphismes.<br />
En Ex 20,24 à 23,19 nous voyons le code de l’alliance qui par soi ne fait pas partie des<br />
sources et dont la datation est très discutée. Il est intégré au Pentateuque après le E2.<br />
En 721 il y a la chute de Samarie, et l’Élohiste qui est déjà conclu émigre au sud à Jérusalem.<br />
4. La quatrième étape : la Fusion<br />
A Jérusalem, après la chute de Samarie, l’Elohiste et le Yahviste sont fusionnés et<br />
harmonisés, soit après 721, mais avant 622 qui est la réforme religieuse de Josias et la<br />
publication du Deutéronome.<br />
5. La cinquième étape : le Deutéronome.<br />
1 (« Ils partirent de là et campèrent au-delà de l'Arnon. Ce torrent sortait, dans le désert, du pays des Amorites. Car l'Arnon<br />
était à la frontière de Moab, entre les Moabites et les Amorites. »). Ce passage nous éclaire pour la datation de E2. Jéroboam<br />
fait en sorte que le fleuve Arnon soit une frontière entre les Moabites et les Amorites. Ceci est le terminus post quem pour la<br />
rédaction de E2. Mais E2 ne connaît pas la chute de Samarie en 721 qui est le terminus ante quem.<br />
8
Le Deutéronome est publié la 18 ème année du règne de Josias, soit en 622 qui est l’année de<br />
la réforme (2Roi 22,3ss).<br />
Selon la théorie de Graf et Wellhausen, le Deutéronome est une « pia fraus ». Le clergé de<br />
Jérusalem aurait rédigé le Deutéronome pour fonder sa suprématie sur les autres<br />
sanctuaires et l’aurait caché à temps pour que les commissaires du roi le retrouvent. Ceci<br />
correspondrait à l’idéologie de centralisation du temple de Josias. Le Dt « retrouvé » sous<br />
Josias (D1) fut ensuite intégré en diverses reprises (D2a, D2b, D2c) jusqu’à ce qu’un<br />
rédacteur l’unisse à JE, en harmonisant ce dernier en donnant ainsi origine à JED.<br />
Le Deutéronome a un style que l’on ne peut pas confondre : il aime les répétitions en style<br />
homilétique, la parénétique, l’exhortatif. Sa forme littéraire est celle d’une suite de<br />
discours ; la pensée s’y développe en périodes d’une ampleur inégalée, soutenue par un<br />
souffle puissant et une émotion religieuse profonde. L’amour et la sollicitude de Dieu pour<br />
son peuple éclairent d’une lumière nouvelle le rappel des évènements survenus depuis<br />
l’Horeb. C’est une préoccupation morale. Israël doit montrer sa crainte par l’obéissance <strong>aux</strong><br />
commandements divins. Typique de D est la théologie de la rétribution : à l’obéissance<br />
correspond la récompense et la désobéissance est punie par un châtiment, longuement<br />
menacé et décrit dans sa réalisation.<br />
La centralité du culte a une importance fondamentale. Elle est accompagnée d’une théologie<br />
typique qui pense le Temple comme le lieu où Dieu fait habiter son Nom et non pas lui-<br />
même. Il écoute les prières à son nom qui y réside.<br />
Le culte en D est important, mais pas il n’y a pas d’intérêt de type technico-liturgique.<br />
6. La sixième étape : le document Sacerdotal P<br />
1. Pendant et peut-être après l’exil, peut-être sous l’influence d’Ezéchiel, divers<br />
documents d’origine sacerdotale sont unis et harmonisé. Le plus antique semble<br />
être la Loi de sainteté (Lv 17-26, appelée Ph, de l’allemand Heiligkeit), qui semble<br />
avoir des points de contact avec le Dt. Ces documents sont intégrés en un écrit<br />
fondamental (Pg, Grundschrift), qui part de la création, suit en exposant les<br />
généalogie des Patriarches et les épisodes de leur vie qui fondent une loi rituelle<br />
(par ex. Gn 17 : Abraham et la circoncision), culmine avec la construction du<br />
Tabernacle (Ex 25-31 ; 35-40), poursuit avec la mort de Moïse et l’installation des<br />
9
israélites en Canaan. Aussi, le texte comprend une partie de Josué. Pg est publié<br />
après l’exil comme œuvre d’Esdras (444 ?).<br />
2. Ensuite, Pg est intégré par de nombreux suppléments (Ps) sacerdot<strong>aux</strong> qui<br />
regardent des lois cultuelles de genre varié : les sacrifices (Lev 1-7) ; la pureté (Lev<br />
11-15) et diverses lois en Nb.<br />
Aussi, Ph + Pg + Ps1 + Ps2 + Ps….. = P<br />
Du point de vue du style, celui de P ne peut pas être confondu. Il n’y a pas le pathétique du<br />
Deutéronome. P aime les répétitions formulaires et les technicismes lég<strong>aux</strong>. Il a un style sec,<br />
<strong>net</strong> et précis et monotone, abondant de terme techniques. P a une vraie passion pour les<br />
généalogies et les chiffres, pour les sentences brèves qui reviennent comme un refrain. P<br />
bannit les anthropomorphismes et met en relief la transcendance de Dieu : Yahvé habite au<br />
milieu de son peuple, mais de façon invisible et dans la Tente de la Rencontre, dont ne<br />
s’approchent que les prêtres et les lévites consacrés à son service. Le culte est décrit dans<br />
ses aspects technico-liturgiques les plus minutieux sans qu’apparemment en soit donnée<br />
une explicite justification théologique. La présence de Dieu dans le Temple est pensée en<br />
terme d’habitation de la gloire-nuée Kavod.<br />
En parallèle avec le Yahviste et l’élohiste dans le livre de l’Exode, il s’intéresse à la naissance<br />
du peuple, à la vocation de Moïse, au rôle de Moïse et d’Aaron dans les plaines, à la Pâque<br />
dont il recueille toutes les prescriptions rituelles,…. C’est au Sinaï que ce document situe ses<br />
plus abondantes législations.<br />
Vers 400, un rédacteur sacerdotal prend J E et D qui sont déjà unifiés, il les fragmente et les<br />
insère dans les lieux appropriés de P (Pg + Ps) en harmonisant.<br />
Vers 330, sous Alexandre le grand, le Pentateuque est l’ensemble canonique que l’on<br />
connaît.<br />
1.1.5 Evaluation de la théorie fragmentaire<br />
Wellhausen et Graf n’ont jamais eu le consensus de tous. Mais sa capacité de synthèse est<br />
devenu la colonne vertébrale.<br />
10
- Il y a le problème des précompréhensions théologiques et philosophiques sur<br />
l’évolution du phénomène religieux. Il n’y a pas de surnaturel, la religion spirituelle<br />
vaut mieux que celle de la loi.<br />
- Wellhausen ne connaît rien du monde antique au Moyen Orient. L’idée serait que le<br />
culte et la loi viennent après la religion morale qui vient après la religion naturelle. La<br />
loi a sclérosé le tout.<br />
Dans le Moyen Orient, cette idée ne tient pas. Des parallèles de culte se trouvent au<br />
2 ème et 3 ème millénaire dans le bassin méditerranéen comme par exemple la tente de<br />
l’exode.<br />
L’archéologie et l’histoire du Moyen Orient sont beaucoup plus tardives. Ainsi, les<br />
recherches de Pierre Emile Botta et de S. H. Lagard commence en 1840 en<br />
Mésopotamie. Le déchiffrage des normes akkadiennes sont faites en 1849 lorsque<br />
l’on découvre à Bisitum une inscription.<br />
G. Smith publie l’épopée de Gilgamesh retrouvée à Ninive en 1876.<br />
L’archéologie en Palestine commence encore plus tard. C’est Sir F. Petrie qui<br />
commence en 1890.<br />
Aussi, à l’époque de Wellhausen, on étudie surtout sur la Bible.<br />
- On peut aussi noter le naufrage de l’historicité des textes. Les textes sont vus<br />
uniquement comme de pure légendes.<br />
- L’explosion des subdivisions ultérieures que les critiques retinrent de devoir<br />
introduire. On en est ainsi arrivé à une situation de consensus de base sur l’existence<br />
de traditions reconductibles à ce qui a été émis comme hypothèses par la théorie<br />
documentaire, mais on est loin d’un accord sur le particulier. En exagérant, on peut<br />
dire que chaque exégète s’est occupé de ces textes en proposant une reconstruction<br />
personnelle.<br />
- L’impossibilité de mieux définir les caractéristiques de la source E, au point<br />
qu’aujourd’hui on préfère ne pas distinguer explicitement un Elohiste. Les passages<br />
attribués auparavant à cette source sont désormais vus comme des interpolations de<br />
différentes provenances.<br />
Bien qu’aujourd’hui on ne puisse plus accueillir la théorie fragmentaire dans sa forme<br />
classique, la grande majorité des scientifiques n’ose pas la remettre totalement en crise.<br />
Cependant beaucoup de voix se lèvent pour la réviser dans un sens ou un autre. De façon<br />
particulière on tend toujours davantage à ne plus concevoir J E P D comme « sources »<br />
dotées de leur autonomie littéraire originaire, mais plutôt comme des traditions (orales ou<br />
11
écrites) assumées et utilisées en divers modes au niveau rédactionnel. Quelques juifs ont<br />
revendiqué P à une époque préexilique (J. Milgrom et M. Haran) par des arguments<br />
historico-archéologiques ou linguistiques.<br />
Une chose claire est que l’on ne peut pas retourner à l’époque précédant la théorie<br />
documentaire, mais le consensus qu’elle avait créé a été cassé sans que personne ait été<br />
capable de produire une synthèse. Il en reste tout de même que quelques affirmations de la<br />
théorie documentaire comme la présence de différentes traditions remontant à des époques<br />
diverses, les caractéristiques de D et de P, l’existence de J sont des acquisitions acceptées<br />
par la grande majorité des chercheurs. On a aussi réévalué les informations historiques<br />
contenues dans les différentes sources.<br />
Von Rad affirme qu’au moins le souvenir d’un évènement fondateur au Sinaï, d’une<br />
expérience de salut à la mer des Rose<strong>aux</strong> et d’une permanence dans le désert liée à l’Oasis<br />
de Cadès, doivent être reconduit à des souvenirs historiques très anciens, même si les<br />
circonstances concrètes de tels évènements ne peuvent plus être reconstruits. Aussi l’idée<br />
d’un lien originaire avec les Madianites (grand nomades du Désert) et donc d’une origine<br />
nomadique de la religion d’Israël secoue quelques faveurs, vue la présentation positive que<br />
le Pentateuque fait de Jéthro, le beau-père de Moïse Madianite, qui est montré dans l’acte<br />
d’adorer le vrai Dieu (Ex 18,12). Il parait difficile ensuite de chasser définitivement dans la<br />
sphère du légendaire la figure et le rôle de Moïse.<br />
1.1.6 Possibilité de proposition différente : la proposition de R. Rendtorff<br />
Dans son volume Das überlieferungsgeschichtliche Problem des Pentateuch R. Rendtorff<br />
soumet à une critique serrée la théorie des sources : il affirme que l’incertitude à déterminer<br />
à quelle source doit être attribuée un certain texte et la prolifération de textes qui dans le<br />
doute sont classés comme « glose » (ou texte dont l’attribution à des sources spécifiques est<br />
impossible) , a porté à une prolifération incontrôlée de divisions et subdivisions à l’intérieur<br />
des diverses sources car il faut aussi y ajouter la toujours plus grande difficulté à établir les<br />
frontières entre les sources singulières<br />
Rendtorff retient que le présupposé méthodologique lui-même est erroné et doit être<br />
changé : il faut distinguer un moment rédactionnel Deutéronomiste exilique et un moment<br />
rédactionnel Sacerdotal postexilique. Mais il affirme que le matériel sur lequel travaillèrent<br />
12
ces rédacteurs était des grands cycles narratifs d’histoires centrés sur différents<br />
personnages : Abraham, les patriarches, Moïse, etc.…, qui arrivèrent à l’exil de façon<br />
substantiellement indépendante et furent ensuite unis. Il faut noter que Rendtorff accepte<br />
tout de même l’idée d’un Sacerdotal totalement postexilique (au moins comme rédaction).<br />
1.1.7 Une révolution copernicienne : les méthodes synchroniques<br />
Une position totalement différente du problème non seulement du Pentateuque mais de la<br />
totalité de l’interprétation biblique est donnée les chercheurs qui retiennent important de<br />
partir non de reconstructions plus ou moins probables d’un texte « originaire », mais de la<br />
considération que l’objet de notre interprétation, et particulièrement de l’interprétation<br />
théologique, est le texte que nous lisons et qui nous arrive canonisé par la communauté de<br />
foi dans laquelle nous vivons.<br />
La prise en charge de l’unité canonique est la ligne discriminante entre deux modes assez<br />
différents de s’approcher de la Sainte Ecriture : deux modes qui proviennent de questions et<br />
préoccupations entre elles étrangères.<br />
P. Beauchamp : « il y a une différence idéologique qui sépare deux exégèses, l’une qui<br />
s’estime récompensée quand elle a pu conjecturer le premier état d’un texte, et l’autre qui se<br />
laisse prendre par les raisons et convaincre par les forces qui sortent d’un texte ».<br />
L’exégèse moderne appelle ce type de lecture « approche synchronique », en l’opposant à<br />
« l’approche diachronique », de type historico-critique. On pourrait dire que la lecture<br />
patristique de la Sainte Ecriture a toujours eu une approche plus synchronique que<br />
diachronique. On pourrait même dire exclusivement synchronique, dans le sens que les<br />
Pères de l’Eglise étaient beaucoup plus préoccupés d’individuer dans leur lecture la<br />
cohérence globale du texte biblique et surtout d’observer comment les singulières parties<br />
trouvent leur achèvement et illumination dans le mystère du Christ.<br />
Il n’est cependant pas bon d’aplatir l’exégèse synchronique sur la lecture biblique que<br />
faisaient les Pères de l’Eglise, parce que la lecture synchronique, même d’un point de vue<br />
chronologique, vient après les résultats et les considérations émergées de l’exégèse<br />
historico-critique et donc elle ne peut pas faire abstraction de ses apports. C’est une richesse<br />
pour donner à sa lecture une perspective que les anciens ne connaissaient pas.<br />
Cette perspective synchronique porte avec soi l’exigence de prendre en considération l’unité<br />
des deux testaments, et des deux Instrumenta qui en sont le document écrit (les deux<br />
13
moments de l’histoire du salut ; et les deux sections du texte biblique qui pour souligner<br />
cette distinction sont appelés Instrumenta). C’est une exigence qui vient du fait même qu’ils<br />
font partie de la même textualité qui est structurée autour de la narration de la rencontre<br />
entre Dieu et l’homme, qui se spécifie dans la rencontre entre Dieu et son peuple et rejoint<br />
son extrême concrétude dans l’évènement de Jésus Christ. Scinder le Novum Instrumentum<br />
du Vetus Instrumentum signifie ne pas reconnaître l’unité des deux Testaments, c'est-à-dire<br />
l’unité du projet divin sur l’histoire et sur le cosmos, et se situer ainsi hors de la perspective<br />
canonique et aussi de cet évènement qui structure tant la Sainte Ecriture que la<br />
communauté croyante.<br />
Un tel point de vue demande nécessairement d’assumer quelques présupposés.<br />
Le premier est admettre la possibilité d’un tel évènement, ou bien l’existence d’une<br />
dimension surnaturelle et la possibilité pour une telle dimension surnaturelle de faire<br />
effectivement irruption dans l’histoire de l’homme en la modifiant.<br />
Un autre présupposé indispensable à une telle approche est l’affirmation que<br />
derrière l’autorité du texte biblique il y a une autre réalité qui la précède : la<br />
communauté croyante précède l’écriture. L’écriture se présente ainsi comme le<br />
témoignage écrit d’un événement qui la précède et de la réflexion que de tel<br />
évènement la communauté a fait en étant le protagoniste. Tout naturellement sous<br />
la conduite de l’Esprit Saint.<br />
La communauté précède l’Ecriture sous un certain point de vue, dans le sens qu’elle se met à<br />
l’écoute de cette parole qui est à la base de son existence. Pour reprendre l’analogie de<br />
l’Eucharistie on peut dire que l’Ecriture fait l’Eglise et l’Eglise fait l’Ecriture.<br />
Ce type d’approche canonique prend en premier lieu la considération de l’état des textes<br />
comme ils nous sont consignés par la tradition normative de la communauté croyante,<br />
toutefois l’analyse historico-critique, avec ses découvertes inégalables, malgré les évidentes<br />
limites théologiques et méthodologiques, ne peut pas être simplement refusé, sous peine de<br />
tomber en une forme d’anti-historicisme. Mais on réagira à la tentation de voir dans la<br />
forme la plus antique du texte la forme la plus originaire et de considérer les interprétations<br />
postérieures comme des trahisons conditionnées par des dialectiques sociopolitiques qui ont<br />
pollué la pureté originaire de la parole de Dieu. Les relectures font partie de<br />
l’approfondissement de sens de l’histoire. Ceci en révèle la réalité profonde.<br />
14
Les diverses formes de lecture synchronique de l’écriture peuvent cependant tomber dans<br />
un risque grave, celui de tomber dans une méfiance dans la possibilité d’une reconstruction<br />
historique et de limiter ainsi la propre interprétation d’une lecture intra-textuelle. Une telle<br />
méfiance dérive d’une position qui dévalue la possibilité de lire l’implication de Dieu avec<br />
l’homme comme un évènement historique.<br />
Il vaut donc la peine d’écouter ces paroles de B. Childs : « L’objet de la réflexion théologique<br />
ne sont pas les évènements historiques ou les expériences subjacentes au texte ou<br />
considérées de façon séparée de l’interprétation scripturaire donnée par une vive<br />
communauté de foi. D’autre part, vue que le texte témoigne ponctuellement des évènements<br />
et des réactions dans la vie d’Israël, la littérature ne peut pas être isolée de ses évidentes<br />
références ».<br />
15
1.2 LA GENESE<br />
1.2.1 Structure du livre<br />
La forme actuelle du livre est structurée par le recours à une formule généalogique répétée :<br />
« Telles sont les toledot de … » qui apparaît avec des variations en 2,4a ; 5,1 ; 6,9 ; 10,1 ; 11,<br />
10, etc.… Le mot n’a pas une signification universellement partagée, mais il dérive tout de<br />
même du verbe ‘alud qui signifie générer. On le traduit donc par génération ou<br />
descendance. Cette formule peut être suivie par une généalogie ou par un récit narratif.<br />
On peut diviser le texte sur des bases de contenu : les chapitre 1-11,26 (histoire de<br />
l’humanité jusqu’à Abraham), se distinguent des chapitre 11,27-50 (histoire d’Abraham et de<br />
sa descendance). Le toledot permettent d’identifier les divisions suivantes (l’astérisque<br />
indique une des toledot) :<br />
1. Le récit des nations (1,1-11,26) :<br />
a. La création du monde (1,1-2,3)<br />
b. La création de l’homme et de la femme et leur descendance (2,4*-4,26)<br />
c. Les générations antédiluviennes (5,1*-6,8)<br />
d. Le déluge (6,9*-9,29)<br />
e. Les descendants de Noé et Babel (10,1*-11,0)<br />
f. Récit : la généalogie de Shem à Térach (11,10*-26)<br />
2. Le récit des ancêtres d’Israël (11,27*-50,26)<br />
a. L’histoire d’Abraham (11,27*-25,11)<br />
[La branche secondaire : les descendants d’Ismaël (25,12*-18)]<br />
b. L’histoire d’Isaac et de Jacob (25,19*-35,29)<br />
[La branche secondaire : les descendants d’Esaü à Canaan (36,1*-8) et en<br />
Edom (36,9*-43)]<br />
c. L’histoire de Joseph et de ses frères (37,1-50,26)<br />
Selon Von Rad qui est accueilli par Childs, les chapitres 1-11 qui sont prémisses des histoires<br />
patriarcales, doivent être vus comme une préparation à l’histoire du salut qui commence<br />
avec Abraham. Il s’agit d’une histoire où est racontée la croissante aliénation de l’humanité.<br />
Tout commence ave l’expulsion du jardin d’Eden ; le péché se répand et croît : l’homicide<br />
d’Abel, le péché des anges, le déluge et le sommet dans la tour de Babel, le retour au chaos.<br />
16
La réponse de Dieu au péché de l’homme est l’élection d’Israël qui n’est pas seulement donc<br />
l’histoire d’un peuple particulier, mais est liée à l’histoire de l’humanité et de ses rapports<br />
avec le créateur. Ces chapitres affirment la priorité de la création. La relation de Dieu avec le<br />
monde dérive du projet initial pour l’univers et pas seulement pour Israël, mais le rôle<br />
rédempteur d’Israël dans la réconciliation des nations est présent depuis le début.<br />
1.2.2 Lecture de Genèse 1,1-2,4a. :<br />
[1] Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre.<br />
[2] Or la terre était vide et vague, les ténèbres couvraient l'abîme, un vent de Dieu tournoyait sur les e<strong>aux</strong>.<br />
[3] Dieu dit : "Que la lumière soit" et la lumière fut.<br />
[4] Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière et les ténèbres.<br />
[5] Dieu appela la lumière "jour" et les ténèbres "nuit." Il y eut un soir et il y eut un matin : premier jour.<br />
[6] Dieu dit : "Qu'il y ait un firmament au milieu des e<strong>aux</strong> et qu'il sépare les e<strong>aux</strong> d'avec les e<strong>aux</strong>" et il en fut ainsi.<br />
[7] Dieu fit le firmament, qui sépara les e<strong>aux</strong> qui sont sous le firmament d'avec les e<strong>aux</strong> qui sont au-dessus du<br />
firmament,<br />
[8] et Dieu appela le firmament "ciel." Il y eut un soir et il y eut un matin : deuxième jour.<br />
[9] Dieu dit : "Que les e<strong>aux</strong> qui sont sous le ciel s'amassent en une seule masse et qu'apparaisse le continent" et il<br />
en fut ainsi.<br />
[10] Dieu appela le continent "terre" et la masse des e<strong>aux</strong> "mers", et Dieu vit que cela était bon.<br />
[11] Dieu dit : "Que la terre verdisse de verdure : des herbes portant semence et des arbres fruitiers donnant sur<br />
la terre selon leur espèce des fruits contenant leur semence" et il en fut ainsi.<br />
[12] La terre produisit de la verdure : des herbes portant semence selon leur espèce, des arbres donnant selon<br />
leur espèce des fruits contenant leur semence, et Dieu vit que cela était bon.<br />
[13] Il y eut un soir et il y eut un matin : troisième jour.<br />
[14] Dieu dit : "Qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour et la nuit ; qu'ils servent de<br />
signes, tant pour les fêtes que pour les jours et les années ;<br />
[15] qu'ils soient des luminaires au firmament du ciel pour éclairer la terre" et il en fut ainsi.<br />
[16] Dieu fit les deux luminaires majeurs : le grand luminaire comme puissance du jour et le petit luminaire<br />
comme puissance de la nuit, et les étoiles.<br />
[17] Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre,<br />
[18] pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière et les ténèbres, et Dieu vit que cela était bon.<br />
[19] Il y eut un soir et il y eut un matin : quatrième jour.<br />
[20] Dieu dit : "Que les e<strong>aux</strong> grouillent d'un grouillement d'êtres vivants et que des oise<strong>aux</strong> volent au-dessus de la<br />
terre contre le firmament du ciel" et il en fut ainsi.<br />
[21] Dieu créa les grands serpents de mer et tous les êtres vivants qui glissent et qui grouillent dans les e<strong>aux</strong> selon<br />
leur espèce, et toute la gent ailée selon son espèce, et Dieu vit que cela était bon.<br />
[22] Dieu les bénit et dit : "Soyez féconds, multipliez, emplissez l'eau des mers, et que les oise<strong>aux</strong> multiplient sur<br />
la terre."<br />
[23] Il y eut un soir et il y eut un matin : cinquième jour.<br />
[24] Dieu dit : "Que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce : besti<strong>aux</strong>, bestioles, bêtes sauvages selon<br />
leur espèce" et il en fut ainsi.<br />
[25] Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les besti<strong>aux</strong> selon leur espèce et toutes les bestioles du sol<br />
selon leur espèce, et Dieu vit que cela était bon.<br />
[26] Dieu dit : "Faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance, et qu'ils dominent sur les poissons de<br />
la mer, les oise<strong>aux</strong> du ciel, les besti<strong>aux</strong>, toutes les bêtes sauvages et toutes les bestioles qui rampent sur la terre."<br />
[27] Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, homme et femme il les créa.<br />
[28] Dieu les bénit et leur dit : "Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la ; dominez sur les<br />
poissons de la mer, les oise<strong>aux</strong> du ciel et tous les anim<strong>aux</strong> qui rampent sur la terre."<br />
[29] Dieu dit : "Je vous donne toutes les herbes portant semence, qui sont sur toute la surface de la terre, et tous<br />
les arbres qui ont des fruits portant semence : ce sera votre nourriture.<br />
[30] A toutes les bêtes sauvages, à tous les oise<strong>aux</strong> du ciel, à tout ce qui rampe sur la terre et qui est animé de vie,<br />
je donne pour nourriture toute la verdure des plantes" et il en fut ainsi.<br />
[31] Dieu vit tout ce qu'il avait fait : cela était très bon. Il y eut un soir et il y eut un matin : sixième jour.<br />
2 [1] Ainsi furent achevés le ciel et la terre, avec toute leur armée.<br />
[2] Dieu conclut au septième jour l'ouvrage qu'il avait fait et, au septième jour, il chôma, après tout l'ouvrage qu'il<br />
avait fait.<br />
[3] Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, car il avait chômé après tout son ouvrage de création.<br />
17
[4] Telle fut l'histoire du ciel et de la terre, quand ils furent créés.<br />
Ce passage qui ouvre la Bible fait partie de la source Sacerdotale. Il est possible de<br />
l’accepter. Le langage est clair, les liens avec la tradition Sacerdotale s’imposent.<br />
Mais d’habitude, la source Sacerdotale s’interrompt en 2,4a et reprend en 5,1 avec la<br />
généalogie d’Adam.<br />
De 2,4b à 4,26 ce serait la source Yahviste. On le voit en 2,4b « Au temps où Yahvé Dieu fit la<br />
terre et le ciel (…) »<br />
4,26 : « alors on commença à invoquer le nom de Jahvé ».<br />
Le nom du Seigneur est connu depuis le neveu d’Adam qui l’invoque en premier. Donc avant<br />
le déluge. Dans nos traductions nous avons YHWH = le Seigneur et Elohim = Dieu. Alors que<br />
l’Elohiste n’utilise pas avant l’exode 3,14. Le Yahviste dit que c’est quelque chose de connu<br />
depuis le début de l’humanité. C’est la théorie des sources classique.<br />
Mais cette affirmation de passer de 2,4a à 5,1 rencontre des problèmes : jusqu’à 2,4a le mot<br />
Adam est utilisé dans une signification générique = homme (ish). Alors que si nous allons en<br />
5,1 Adam est un nom propre. Ce serait une source où l’on passe d’un nom commun à un<br />
nom propre en quelques versets, ce qui est étrange.<br />
Comment se fait ce passage au nom propre ? Avec les chapitres 2, 3 et 4 qui sont Yahvistes.<br />
En juxtaposant les chapitres, le rédacteur a fait en sorte qu’il y ait une cohérence, une<br />
transition qui permette de passer au chapitre 5. On ne peut pas tailler les chapitres Yahvistes<br />
pour soi-disant retrouver le Sacerdotal dans son état pur. Ici le texte a été réélaboré.<br />
Autre exemple : en 1, il y a une refrain : « Dieu vit que cela était bon » à la fin il dit « c’est chose très<br />
bonne ».<br />
Dans le chapitre 2 on trouve au verset 8 « il n’est pas bon que l’homme soit seul ». C’est donc une<br />
reprise du refrain du chapitre 1. Ceci se rencontre sur le fait que selon la théorie ces deux sources ne<br />
se connaissent pas.<br />
Aussi le rédacteur a travaillé pour faire une harmonisation en donnant une homogénéité.<br />
Donc, il n’est pas possible herméneutiquement de lire un texte comme si un texte n’existait<br />
18
pas. On ne peut pas parler d’un premier et d’un deuxième récit de la création. Il y a un livre<br />
avec du matériel réélaboré pour une compréhension.<br />
La réélaboration a donc été très profonde et il est désormais impossible de redécomposer le<br />
texte pour soi-disant l’interpréter dans sa pureté originelle. C’est similaire dans le Nouveau<br />
Testament lorsque l’on veut reconstruire la théologie de la source Q : c’est une hypothèse,<br />
elle n’existe pas en tant que telle. On peut l’utiliser comme hypothèse, mais pas comme<br />
moyen herméneutique et scientifique.<br />
L’auteur qui a recomposer les textes était insatisfait des deux textes et les a réharmonisés<br />
selon sa théologie et les deux ne sont plus qu’un.<br />
Nous avons donc une recomposition profonde du texte. Ce texte veut être programmatique.<br />
Il est d’une tradition très longue et en même temps il présente une élaboration et une<br />
concentration théologique très forte.<br />
Nous pouvons noter un fait très important : ce texte qui semble être mythologique pour<br />
nous ne l’est pas. C’est un des premier – sinon le premier – texte scientifique qui cherche à<br />
avoir une description claire du monde et précise. Ce n’est plus notre conception du monde<br />
par rapport à la description physique. Mais pour la description ça l’est beaucoup plus d’un<br />
point de vue de l’impression de l’œil humain. C’est la description objective de l’œil humain.<br />
On ne voit pas que la terre est ronde, mais ce n’est pas immédiat.<br />
Cette vision du monde finit par être scientifique, objective de l’univers, on le voit en<br />
comparaison avec les autres textes qui circulaient à l’époque. Les textes qui circulaient<br />
étaient des cosmogonies et des théogonies (histoires divines de la terre et des cieux) ; les<br />
dieux du ciel ont le mieux sur ceux de la terre.<br />
Enuma elis : « comment en haut ». C’est un poème trouvé en akkadique de la bibliothèque<br />
de Ninive qui glorifie Mardouk (dans la Bible c’est Beel). Ce n’est pas lui le dieu primordial et<br />
ordinateur du monde.<br />
Il introduit deux personnages : Apsu le dieu masculin et dieu des e<strong>aux</strong> profondes douces.<br />
Tiamat est un dieu féminin monstre des abysses marin. Dans le delta des deux fleuves Tigre<br />
et Euphrate s’unissent avec la mer. Cela donne le marais, là où les mondes ne sont pas<br />
distinguables, une sorte d’entre deux. Par leur union, ils génèrent quelque chose qui devient<br />
une génération de divinité. Apsu et Tiamat sont les premiers et après viennent les autres.<br />
19
Dans la genèse, on ne cherche pas à expliquer qui est Dieu, d’où il vient, comment il est…<br />
Dieu est un donné à priori.<br />
Des divinités naissent encore et un problème naît entre Apsu et le dieu Ea qui est le dieu des<br />
e<strong>aux</strong> canalisés, le dieu agricole (soumise au régime de l’homme). Ce dieu Ea se rebelle<br />
contre le Père Apsu et le tue et prend sa place. Tiamat n’est pas contente de la chose et<br />
prépare sa vengeance. Il ne faut pas oublier que c’est le monstre marin (TmT de Thm téom =<br />
chaos originaire). Tiamat réunit ses alliés et met Kingu à sa tête et l’épouse. Ea qui est<br />
devenu le roi des dieux convoque le conseil des dieux et met sur le tapis le problème de la<br />
défense de ce dieu Kingu et de sa mère Tiamat. On propose le dieu Mardouk dieu de la ville<br />
de Babylone (nous somme avant la création du monde et des hommes). Ils acceptent la<br />
proposition de mettre Mardouk sur le trône si il vainc l’ennemi. Il vainc Tiamat et devant le<br />
cri de la reine il lui vient l’idée de faire quelque chose avec le corps de Tiamat : le monde.<br />
Mardouk met les astres, dispose les montagnes sur l’autre moitié de dessous. Il utilise les<br />
yeux pour faire deux fleuves, le Tigre et l’Euphrate.<br />
A un moment les dieux ont une autre idée : ce serait mieux qu’un autre travaille pour eux.<br />
Les anim<strong>aux</strong> sont trop bêtes, Mardouk crée donc un être à moitié avec le sang de Kingu qu’il<br />
tue et la terre : il crée les hommes.<br />
Dans ce deuxième récit il y a dieu qui crée l’homme de la poussière de la terre. Mais ici c’est<br />
l’explication de pourquoi l’homme est mortel alors que dans la Bible, c’est l’explication de la<br />
dignité de l’homme. La création est une évolution divine.<br />
En Egypte le dieu primordial Atum crée un monde qui auto-évolue. Il est aussi appelé le<br />
masturbateur car il crée le monde en se masturbant. Parfois c’est son éclaboussure qui crée.<br />
C’est le dieu qui s’autoféconde. C’est l’évolution de la réalité qu’est le pays. Pour les<br />
Egyptien c’est l’Egypte, les Assyriens c’est l’Assyrie…<br />
Dans la cosmologie antique, l’univers est divisé en trois parties : une zone abyssale, d’eau de<br />
mort. Au centre de cet océan abyssale la terre ferme : une grande île appuyée sur des<br />
colonne qui la soutiennent. A l’extrémité de l’océan des montagnes mystérieuses sur<br />
lesquelles s’appuie la voûte du firmament. Sur celui-ci les e<strong>aux</strong> supérieures que Dieu peut<br />
laisser tomber du ciel en ouvrant les cataractes. Suspendues au firmament les étoiles, le<br />
soleil et la lune.<br />
Dans le texte de la création c’est un seul qui prend l’initiative. On ne sait pas qui il est, ni son<br />
identité, en tout cas il est présupposé qu’il existe.<br />
20
Le verbe Bara est un verbe qui signifie créer. Dans le texte massorétique, il n’y a que Dieu<br />
qui bara. Sinon on utilise un autre verbe.<br />
Le rédacteur Sacerdotal fait tout pour éloigner la mythologie. C’est un texte anti-<br />
mythologique.<br />
Si on prend le psaume 104 (103) de la création, on trouve un langage qui frise à la<br />
mythologie : la lumière est le manteau de Dieu ; construit sur les e<strong>aux</strong> tes demeures (c’est<br />
l’océan supérieur) alors que dans le récit de la création, Dieu ne se construit pas une maison,<br />
encore moins dans sa création. On ne sait pas où il habite. Tu marches sur les ailes du vent.<br />
Psaume 68,5 : « Chantez à Dieu, jouez pour son nom, frayez la route au Chevaucheur des nuées, jubilez<br />
en Yahvé, dansez devant sa face. »<br />
Le chevaucheur des nuées est Baal. A la fin du psaume il y a une montagne de Dieu.<br />
Donc dans la genèse on cherche à épurer au maximum ce qui peut avoir un aspect<br />
mythologique.<br />
Le passage de Genèse : 7 unités en sept jours de la création.<br />
La liberté, la spontanéité de la création. Il donne origine au ciel et à la terre. C’est un<br />
mérisme (figure rhétorique typique sémitique qui consiste à nommer les extrêmes pour<br />
parler de tout ce qu’il y a entre : père et mère = la famille ; ciel et terre = univers ; bon et<br />
méchant = tous les hommes). Il n’y a donc pas d’obligation en Dieu. Il ne travaille pas comme<br />
Mardouk qui construit l’univers à partir de Tiamat.<br />
Ce premier chapitre montre un Dieu qui crée et qui a un rapport avec sa créature.<br />
Ce texte montre t-il la création ex nihilo ?<br />
2Maccabée 7,28 : « Je t'en conjure, mon enfant, regarde le ciel et la terre et vois tout ce qui est en eux,<br />
et sache que Dieu les a faits de rien et que la race des hommes est faite de la même manière. »<br />
On ne dit pas que Dieu créa de quelque chose le monde. Il faut savoir qu’en Hébreu, le verbe<br />
être signifie « da sein ; exister ». Notre réflexion sur l’être vient du grec qui permet de<br />
l’exprimer de façon adéquate. Il n’y a pas de façon adéquate en hébreu pour parler de l’être<br />
et du non-être.<br />
Le verset 2 se présente comme une digression théologique.<br />
Comment se traduit le rapport entre le verset 1 et le 2 ? Il y a deux possibilités, celle de<br />
mettre un point à la fin du verset 1, ou de dire : « v.1 au principe où Dieu créa le ciel et la<br />
terre, v.2 la terre était informe… ». Dans un cas c’est mis côte à côte. Dans le deuxième cas<br />
c’est une subordonnée. Donc, selon la traduction la différence est importance. Dans un cas,<br />
21
c’est une sorte de titre donné par le verset 1. Dans l’autre le chaos est description de ce que<br />
Dieu crée. Dans le premier il y a une introduction et on voit le départ qui est le chaos. Dans<br />
le deuxième cas, c’est Dieu qui crée le chaos.<br />
P. Paximadi soutient que ce sont deux propositions indépendantes. La première est une<br />
introduction et la deuxième est le point de départ.<br />
Le v.1 est un compendium, et le v.2 est la description de l’abysse du chaos qui est la<br />
description du rien, du nihil. Comme c’est inintelligible on dit que ce n’est pas.<br />
Il y a toujours le risque que cette création retourne dans cet état informe si elle n’est pas<br />
soutenue par Dieu. C’est non seulement un nul, mais un nul qui peut engloutir. Il faut Dieu<br />
qui soutient. Dieu maintient sa création.<br />
Problème de l’Esprit de Dieu qui plane sur les e<strong>aux</strong> : 2 solutions<br />
1. Von Rad pense que cet esprit de dieu fait encore partie du chaos et doit se traduire<br />
en vent (rouah) c’est un superlatif, un vent très fort. Le vent très fort serait un<br />
élément de désordre qui fait partie du chaos. Ceci pourquoi ? Parce que ce vent de<br />
Dieu apparaît ici et disparaît complètement sans aucune incidence sur le texte.<br />
2. Le verbe est intéressant merahefet exprime le geste de la couveuse, de l’oiseau qui<br />
couve en tenant sous les ailes les oisillons. Rouah en hébreu est féminin. Certaines<br />
mythologies égyptiennes voient l’oiseau primordial poser l’œuf primordial dans le<br />
marais, le couver et en sort le monde. C’est déjà l’action de Dieu qui agit. Quelque<br />
chose fait penser à l’idée que l’oiseau primordial est l’oiseau du déluge qui tourne sur<br />
les e<strong>aux</strong> et donne le signal du monde qui recommence. Du déluge le monde ressort<br />
renouvelé. Le fait de Noé peut faire penser à l’esprit de Dieu en ordre à l’esprit de<br />
dieu comme un ordre de la création. Ce vent est donc déjà un moment d’ordre.<br />
Au verset 3 on voit la lumière qui apparaît et qui semble indépendante des astres qui n’en<br />
sont pas la source. La première chose que fait le Seigneur est de mettre l’intelligibilité dans<br />
ce chaos, de mettre la lumière. C’est encore une fois une polémique anti-mythologique. Une<br />
telle lumière vient par le moyen de la parole.<br />
Dans la suite on voit Dieu à l’œuvre : v.7 ; v.16 Dieu fit ; v.17 Dieu pose.<br />
22
Mais surtout on voit que Dieu opère par la parole. Mais ceci a des antécédents dans la<br />
mythologie. Mardouk opère aussi par la parole, mais elle arrive par de formules magiques.<br />
Par là il peut opérer par la parole. Pour nous, l’œuvre de Dieu par la parole sert à souligner le<br />
détachement entre le monde créé et Dieu. Le monde crée n’est pas une émanation de Dieu,<br />
ce n’est pas le fruit de son évolution à la différence des poèmes babyloniens. Le seul rapport<br />
entre Dieu et sa création est la parole qui en plus n’est pas magique.<br />
Premier jour. Par la lumière il sépare le jour de la nuit. Le verbe hébreu est habdîl qui signifie<br />
séparer, distinguer. Dans la théologie Sacerdotale il est connoté par une signification<br />
Sacerdotale. Le prêtre distingue, détermine, sépare, organise. C'est-à-dire qu’il individu la<br />
structure de la réalité. C’est donc très fort. Lorsque le prêtre distingue le pur de l’impur, il<br />
fait une opération semblable à celle de Dieu qui distingue le chaos. Nous sommes donc en<br />
pleine théologie Sacerdotale.<br />
Deuxième jour. La seconde opération de Dieu est de nommer, appeler : ce qui est distingué<br />
est intelligible. Par le nom on donne l’être, la réalité. Il s’agit d’un passage à l’être. Donner le<br />
nom est donner, constituer la réalité. C’est donc une opération fondamentale. C’est un vrai<br />
texte de théologie.<br />
Etre nommé signifie être destiné à une existence. Le chaos est d’être destiné au nul, au rien.<br />
Les v.6 à 10 mettent les bases du monde. Le firmament est à entendre au sens<br />
étymologique, comme quelque chose de fixe comme une chape, quelque chose de solide. Ce<br />
firmament « sépare » (habdil) encore une fois c’est la distinction des e<strong>aux</strong> supérieures des<br />
e<strong>aux</strong> inférieures.<br />
Les e<strong>aux</strong> profondes de la partie intérieure (inférieure) sont le symbole par excellence du<br />
chaos. (cf. le schéma). Pour les juifs, la mer est signe de la stérilité et le mont est le signe de<br />
la fécondité, de la positivité, de la fertilité. La mer est toujours très négative. Dans le monde<br />
européen c’est différent.<br />
L’abysse demeure, mais sous le contrôle de Dieu, soumis à sa volonté. On peut conforter ce<br />
texte avec le psaume 104, 7-9 : « A ta menace, elles prennent la fuite, à la voix de ton<br />
tonnerre, elles s'échappent ; [8] elles sautent les montagnes, elles descendent les vallées vers<br />
le lieu que tu leur as assigné ; [9] tu mets une limite à ne pas franchir, qu'elles ne reviennent<br />
couvrir la terre. » L’abysse est comme personnifié.<br />
23
Le troisième jour arrivent les plantes. Au v.12 on peut noter une sorte de médiation : Dieu<br />
ordonne à la terre de produire les plantes. Les plantes sont comme produites par la terre qui<br />
est la médiatrice maternelle. A la fin du troisième jour on voit que Dieu vit que c’était une<br />
bonne chose. Cette création de la structure de base du monde : terre, plante. La création de<br />
cette structure contient donc aussi les plantes.<br />
Le 4 ème jour, v. 14-19. Dieu fait les lampadaires. Il les pose dans le firmament et Dieu voit que<br />
c’est une chose bonne. On peut noter que la lune, le soleil et les étoiles ne sont pas<br />
nommées : pourquoi, parce que ce sont des divinités, des objets de culte. On parle donc de<br />
lampadaire majeure et de lampadaire mineur. Ils servent à réguler, c’est un but de service<br />
pour scander le temps. Comme une grande horloge dans le temps pour réguler le temps.<br />
C’est comme si Dieu prépare l’arrivée de l’homme car pour l’instant tout cela ne sert à rien.<br />
Le 5 ème jour marque une étape : l’arrivée de la vie. Les plantes ne sont pas la vie car la vie<br />
bouge et pas les plantes. Les anim<strong>aux</strong> sont présentés comme ceux qui bougent, qui<br />
gesticulent. La vie est quelque chose de nouveau. Son apparition est quelque chose de<br />
nouveau.<br />
Au verset 21 on voit que Dieu crée encore. C’est donc une nouveauté. La succession des<br />
anim<strong>aux</strong> : d’abord les monstres marins (des petites Tiamat) qui sont dans leur abysse et<br />
n’approchent pas la terre. Ils ont leur place dans le plan de Dieu. D’abord, donc les lointains<br />
de l’abysse. Viennent ensuite les poissons puis les oise<strong>aux</strong>. Ils sont créés par Dieu<br />
directement car ils sont étranges et ont besoin que ce soit Dieu. Les poissons vivent dans<br />
l’eau : de quoi vivent-ils si la mer est le règne du chaos ? C’est la puissance de la vie de Dieu<br />
qui doit les assister personnellement. Les oise<strong>aux</strong> sont étranges car ils sont plus lourd que<br />
l’air mais volent dans l’air. Ils sont donc eux aussi dans la main directe de Dieu. Ils peuvent<br />
dépasser les limites. Il y a une assistance majeure de Dieu. De ces anim<strong>aux</strong> anorm<strong>aux</strong> on dit<br />
qu’ils sont bons et sont bénis. Il n’y a pas d’éléments négatifs qui doivent être combattus.<br />
Tout fait partie de ce plan qui est bon.<br />
La première œuvre du 6 ème jour est aussi vue comme liée à la terre au verset 24. L’eau de la<br />
mer ne peut pas participer de cette production car l’eau ne peut pas avoir cette fonction de<br />
24
donner la vie. La création des anim<strong>aux</strong> ne reçoit pas la bénédiction. On voit que c’est une<br />
chose bonne, mais Dieu ne bénit pas les anim<strong>aux</strong> terrestres alors que les poissons et les<br />
oise<strong>aux</strong> sont bénis. Au seuil de la création de l’homme pour montrer la distance entre les<br />
anim<strong>aux</strong> et l’homme.<br />
Au verset 26 nous avons la création de l’homme. Elle se distingue en mode significatif de<br />
celle des anim<strong>aux</strong>. Il y a une décision divine qui caractéristiquement est exprimée au pluriel.<br />
Pourquoi ? Il y a eu beaucoup de recherches. Ce pluriel avec beaucoup de probabilités, se<br />
réfère à l’assemblée des dieux. D’habitude les dieux prennent une décision ensemble. Par<br />
exemple en 1Roi 22,19s on voit cette notion d’assemblée des dieux où c’est plutôt une<br />
assemblée de ministres, une cour du roi. En Job 2,1 on voit aussi les Fils de Dieu qui se<br />
présentent devant le trône. Peut-être qu’il s’agit des débuts d’une angélologie ? En Isaïe 6 on<br />
en voit une autre qui est beaucoup plus autocrate, un souverain plus autoritaire. Cette idée<br />
est très présente : d’un côté c’est comme si Dieu promulguait son désir de créer l’homme.<br />
Ce pluriel nous fait comprendre l’idée de l’assemblée des dieux. On utilise un langage<br />
mythologique là où personne ne participe à cette décision. C’est fait pour solenniser le geste<br />
de Dieu. C’est un consistoire qui ne décide pas mais applaudit les décisions du souverain qui<br />
viennent promulguées.<br />
L’image et la ressemblance. Il y a encore une référence mythologique. Dans le poème<br />
Mardouk fait aussi à partir de la terre une création. C’est une idée présente dans la<br />
mythologie qui montre que l’homme est moins que Dieu, un sous-produit. Dans notre<br />
conteste anti-mythologique on veut montrer la splendeur de l’homme qui est fait à l’image<br />
et ressemblance de l’assemblée divine. C’est peut-être lié avec le psaume 8,6 « tu l’as fait un<br />
peut moindre que les dieux ». Il est clair que l’on est dans un milieu monothéiste et que ce<br />
mot signifie être céleste.<br />
Ici nous avons un homme qui est fait à l’image d’une réalité divine. En ce sens on peut<br />
expliquer comment est introduite cette idée de l’assemblée divine. Donc faisons à l’image de<br />
l’assemblée divine (notre image) pour montrer que l’homme a une dignité supérieure <strong>aux</strong><br />
autres anim<strong>aux</strong>, mais il n’y a pas de connaturalité entre Dieu et l’homme.<br />
En Gn 3,22 revient ce pluriel curieux « l’homme est devenu comme nous… » : C’est encore<br />
l’image de l’assemblée qui est en dessous de Dieu et à laquelle l’homme ressemble. La<br />
distance est encore marquée. Il y a tout de même une ambiguïté ; si il est clair que le texte<br />
25
ne veut pas référer à Dieu cette chose, on sait que c’est à l’image de Dieu que l’homme est<br />
crée. Il y a le désir de montrer une distance et de montrer la vraie présence de la dignité, de<br />
la réalité divine.<br />
L’image de l’hypostase est très tardive et regarde la période sapientiale. C’est très<br />
postérieur. On ne peut pas le faire entrer ici en jeu.<br />
Il y a donc une image de Dieu et aussi une distance. De ce projet originaire fait partie<br />
l’opposition sexuelle qui n’est pas compris comme différenciation secondaire. Le 2 ème<br />
chapitre réfléchira là-dessus. Cela fait partie de cet aspect. Cette différenciation n’est pas<br />
attachée à l’aspect génératif. C’est ensuite que Dieu les béni et leur dit d’être féconds. La<br />
fécondité est due à une autre bénédiction de Dieu. On ne veut pas sexualiser Dieu. Là n’est<br />
pas l’image de Dieu. Le risque est d’introduire la fécondité sexuelle en Dieu et par là on<br />
aurait fait entrer les rites cananéens avec la prostitution sacrée… Dieu n’est pas fécond par<br />
voie de génération sexuelle. La fécondité en l’homme est distingué : la fin unitive est<br />
distincte de la fin procréative. La fin n’est pas seulement la fécondité. Du premier couple<br />
c’est une réalité relationnelle qui est image de Dieu ; vient ensuite la fécondité.<br />
Dieu ne produit pas par l’union sexuelle. Cette idée de la distinction sexuelle comme image<br />
divine de la possibilité de relation.<br />
Dans le verset 28 Dieu les béni et leur dit. C’est la première fois que Dieu s’adresse à une de<br />
ses créatures. Avant il avait parlé à la troisième personne : qu’il y ait… Ici il crée l’homme, le<br />
béni et lui donne la fécondité en s’adressant à lui.<br />
Au verset 29-30, l’homme reçoit la seigneurie sur la création, mais pas pour manger les<br />
anim<strong>aux</strong>. Le verset 31 Dieu voit que ce qu’il a fait était très bon. Le vertige de la création est<br />
le shabbat où Dieu se repose. C’est un moment de mystère inaccessible qui est réservé à<br />
Dieu. C’est le plan d’un langage mythologique. Lorsque Mardouk crée l’homme, les dieux lui<br />
offrent un palais, un festin et un repos des dieux. Ce repos a cette caractéristique de<br />
déborder sur la création.<br />
Le 7 ème jour fait partie de la création, mais le repos de Dieu consacre ce jour et la création.<br />
Dieu agit le shabbat, que fait-il ? Le shabbat. C’est une partie de la création qui est la<br />
possibilité pour l’homme d’accéder au monde divin ; c’est une réalité créée qui est<br />
constituée, bénie et consacrée. Dans le code Sacerdotal la bénédiction est très importante.<br />
Ce 7 ème jour est consacré et il est médiateur entre le monde et Dieu. Il y a une possibilité<br />
26
salvifique pour l’homme d’entrer en ce repos de Dieu. Les rabbins disent que Dieu continue<br />
d’agir le shabbat : donner la vie (car les enfants naissent aussi à shabbat), enlever la vie (car<br />
les hommes meurent aussi le shabbat), et si les hommes meurent, il juge. Ce sont donc trois<br />
gestes propres de Dieu ce jour-là. On peut donc parler d’une sacramentalité du shabbat. On<br />
le voit bien dans la théologie Sacerdotale. Ici c’est une médiation entre l’homme et Dieu. Le<br />
tabernacle sera l’autre grande médiation entre le monde de Dieu et les hommes. Le shabbat<br />
est cité en Ex 25-31 les instructions de Dieu à Moise ; 35-40 : les exécutions des ordres de<br />
Dieu à Moïse. La référence sur le shabbat arrive à la fin des instructions de Dieu à Moïse en<br />
31,12-17, et au début des exécutions en 35,1-3. L’homme reconnaît une priorité de l’agir de<br />
Dieu et on respecte le shabbat en premier. De plus Dieu bénit ce jour, et il manque la<br />
formule « il y eut un soir, il y eut un matin… », donc le shabbat n’a pas de fin, il s’étend sur<br />
toute la création.<br />
Il n’y a pas de textes très anciens qui parlent d’un shabbat hebdomadaire avant l’exil. C’était<br />
peut-être une fête de la lune pleine et de la nouvelle lune. L’emphase sur le shabbat serait<br />
restée alors que les sacrifices n’étaient plus possibles. Pour Paximadi c’est une institution<br />
préexilique, mais qui connaît son expansion durant l’exil où le culte et les fêtes sont limitées<br />
voire impossibles. Ce serait donc un croître dans la conscience de cet aspect. Il est difficile de<br />
penser que tout soit de l’exil.<br />
Le destinataire du shabbat est le monde entier alors que le tabernacle est pour le peuple juif.<br />
Le but pour le Sacerdotal est que Dieu habite dans le temple, mais il faut un peuple pour<br />
cela. Ce sont deux ordres différents.<br />
27
1.2.3 Lecture de Gn 2,4-25<br />
[4] Telle fut l'histoire du ciel et de la terre, quand ils furent créés. Au temps où Yahvé Dieu fit la terre et le ciel,<br />
[5] il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre et aucune herbe des champs n'avait encore poussé,<br />
car Yahvé Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol.<br />
[6] Toutefois, un flot montait de terre et arrosait toute la surface du sol.<br />
[7] Alors Yahvé Dieu modela l'homme avec la glaise du sol, il insuffla dans ses narines une haleine de vie et<br />
l'homme devint un être vivant.<br />
[8] Yahvé Dieu planta un jardin en Eden, à l'orient, et il y mit l'homme qu'il avait modelé.<br />
[9] Yahvé Dieu fit pousser du sol toute espèce d'arbres séduisants à voir et bons à manger, et l'arbre de vie au<br />
milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal.<br />
[10] Un fleuve sortait d'Eden pour arroser le jardin et de là il se divisait pour former quatre bras.<br />
[11] Le premier s'appelle le Pishôn : il contourne tout le pays de Havila, où il y a l'or ;<br />
[12] l'or de ce pays est pur et là se trouvent le bdellium et la pierre de cornaline.<br />
[13] Le deuxième fleuve s'appelle le Gihôn : il contourne tout le pays de Kush.<br />
[14] Le troisième fleuve s'appelle le Tigre : il coule à l'orient d'Assur. Le quatrième fleuve est l'Euphrate.<br />
[15] Yahvé Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Eden pour le cultiver et le garder.<br />
[16] Et Yahvé Dieu fit à l'homme ce commandement : "Tu peux manger de tous les arbres du jardin.<br />
[17] Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal tu ne mangeras pas, car, le jour où tu en mangeras, tu<br />
deviendras passible de mort."<br />
[18] Yahvé Dieu dit : "Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je lui fasse une aide qui lui soit assortie."<br />
[19] Yahvé Dieu modela encore du sol toutes les bêtes sauvages et tous les oise<strong>aux</strong> du ciel, et il les amena à<br />
l'homme pour voir comment celui-ci les appellerait : chacun devait porter le nom que l'homme lui aurait donné.<br />
[20] L'homme donna des noms à tous les besti<strong>aux</strong>, <strong>aux</strong> oise<strong>aux</strong> du ciel et à toutes les bêtes sauvages, mais, pour<br />
un homme, il ne trouva pas l'aide qui lui fût assortie.<br />
[21] Alors Yahvé Dieu fit tomber une torpeur sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la<br />
chair à sa place.<br />
[22] Puis, de la côte qu'il avait tirée de l'homme, Yahvé Dieu façonna une femme et l'amena à l'homme.<br />
[23] Alors celui-ci s'écria : "Pour le coup, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair ! Celle-ci sera appelée<br />
"femme", car elle fut tirée de l'homme, celle-ci !"<br />
[24] C'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme, et ils deviennent une seule chair.<br />
[25] Or tous deux étaient nus, l'homme et sa femme, et ils n'avaient pas honte l'un devant l'autre.<br />
Avec Gn 2,4b nous entrons dans la tradition Yahviste. Attention à ne pas absolutiser ces<br />
données. Le rédacteur les a aussi profondément réélaborées. Ce texte voit aussi en lui la<br />
présence d’autres traditions ; les fleuves par exemple sont comme cela au milieu.<br />
Le problème de notre justification doit expliquer non pas ce qu’il y avait comme texte, mais<br />
ce qu’il y a.<br />
Verset 4a : ceci sont les origines et ce serait la conclusion de ce qui précède. Les tolédot sont<br />
ce qui a une saveur Sacerdotale ; donc la conclusion selon la tradition Sacerdotale de la<br />
création. En réalité, il faut se rendre compte que bien que la formule soit Sacerdotale, elle a<br />
une fonction de titre. Elle ne ferme pas ce qui précède, mais ouvre ce qui suit ; on ne peut<br />
donc encore pas couper au couteau les deux textes. Ce verset typiquement Sacerdotale est<br />
utilisé pour introduire un texte Yahviste ;<br />
Nous voyons une différence de vocabulaire entre les deux chapitres. Dans le 1 er chapitre,<br />
nous voyons Dieu qui crée par la parole ; Asah signifie faire, sans spécifier comment cela se<br />
fait.<br />
28
Ici au contraire, nous avons un Dieu qui forme, donc il a des mains, il souffle, donc il a une<br />
bouche, il se promène, donc il a des jambes et des pieds pour se rafraîchir le soir. Alors que<br />
le 1 er chapitre cherchait à éviter tout anthropomorphisme ce 2 ème est tranquillement<br />
anthropomorphique ; au 3 ème nous verrons un animal qui parle (ce n’est pas un miracle !) ; la<br />
fable est une communication importante. En tout cas, nous avons ces caractéristiques très<br />
différentes, mais nous sommes loin d’un récit primitif. Le texte Sacerdotal a une<br />
préoccupation plus abstraite, une terminologie plus étroite. Ici nous sommes dans le<br />
domaine de la métaphore littéraire. Il y a ensuite une différence d’intérêt.<br />
Le récit Sacerdotal veut faire un panorama de la création.<br />
Le récit Yahviste est préoccupé plus par la narration sur les rapports entre l’homme et Dieu.<br />
On a vu que dans le conteste Sacerdotal il y a aussi cette préoccupation, mais ici c’est au<br />
premier plan.<br />
Si nous le voulons, le récit Yahviste est comme une sorte d’objection au récit Sacerdotal qui<br />
montrait la bonté de la création (très bonne).<br />
Ici on constate le mal, d’où vient-il si la création est très bonne ? Donc le récit Yahviste est<br />
une étiologie qui cherche à expliquer l’origine de cette contradiction. Comment cela surgit-<br />
il ?<br />
Von Rad : comme l’histoire Sacerdotale décrit la création du monde par Dieu depuis le<br />
chaos, ainsi l’histoire Yahviste veut montrer en quel mode, de la création bonne on est arrivé<br />
au chaos, au mal que l’on constate. Les deux parties sont donc en dialogue entre-elles ; c’est<br />
un discours théologique uniforme. Contrairement à ce qui a été dit avant, l’homme est la<br />
première créature et non la dernière. Le concept est toujours le même. Le mode de<br />
l’exprimer est différent ; dans le récit Sacerdotal, des réalités vivantes l’homme est le<br />
sommet ; dans le Yahviste, l’homme est l’archétype.<br />
Verset 7 : description de la création de l’homme.<br />
C’est important de noter les deux éléments anthropologiques de cette action divine. Dieu<br />
modèle l’homme avec la poussière du sol. Il le forme avec des actions de potier, la matière<br />
n’est pas l’argile mais est la poussière de la terre, du sol. Adam et Adama (‘adam et adamah)<br />
(homme et terre rouge) ont une racine très proche. Ici c’est la poussière du sol. L’homme a<br />
un rapport privilégié avec le sol : il est fait de ce qu’il cultive. L’idée du Dieu potier est très<br />
29
présente dans les mythologies antiques. Le dieu Khnum avec une tête de bélier fait des<br />
vases. Dans le texte nous cueillons un effort de démythologisation, on ne parle pas de potier.<br />
Un premier élément anthropologique est celui-là ; contrairement à d’autre mythe de la<br />
création, l’homme n’est pas crée pour la subsistance des dieux. En effet, à un moment les<br />
dieux sont vus comme des classe inférieurs : il y a les dieux supérieurs les igigi et les dieux<br />
inférieurs les anunnaki (surtout à Babylone) ; les dieux inférieurs travaillent pour les dieux<br />
supérieurs, mais ils se rebellent et cessent le travail ; donc ils créent l’homme qui ne peut<br />
pas se rebeller. Par les sacrifices ils sont nourris ; l’homme est là pour nourrir les dieux. Cet<br />
aspect n’existe pas dans notre texte. Ce n’est pas Dieu qui a besoin de l’homme, mais<br />
l’homme est mis dans le jardin et exprime dans le travail sa dépendance par rapport à Dieu<br />
qui est providence.<br />
Le travail exprime donc la réalité humaine.<br />
La seconde action de Dieu est d’insuffler dans les narines l’air vital. La Nephesh (nepes)<br />
signifie souffle et ensuite devient quelque chose de relatif au souffle vital qui va et vient et<br />
prend ensuite la signification de la force, de la valeur de l’homme. Nephesh (LXX psyché)<br />
peut signifie le ‘moi’, le centre de la personne. L’aspect sentimental est réservé <strong>aux</strong> rahamim<br />
que sont les viscères, c’est le siège de la haine et de l’amour. Dieu prend la nephesh et la<br />
souffle et l’homme devient un être vivant qui respire. Dieu est le possesseur de l’élément<br />
vital. La psyché est la force vitale de l’homme et des anim<strong>aux</strong> que Dieu possède. Dieu la<br />
donne <strong>aux</strong> anim<strong>aux</strong> et <strong>aux</strong> hommes et peut ensuite la retirer.<br />
Le psaume 104, 29-30 en parle : « Tu caches ta face, ils s'épouvantent, tu retires leur souffle, ils<br />
expirent, à leur poussière ils retournent. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, tu renouvelles la face de<br />
la terre ». C’est donc là le signe de dépendance à Dieu de l’homme.<br />
Is 30,33 : « Car depuis longtemps est préparé Tophèt, - il sera aussi pour le roi - profond et large son<br />
bûcher, feu et bois y abondent ; le souffle de Yahvé, comme un torrent de soufre, va y mettre le feu ».<br />
Is 42,5 : « Ainsi parle Dieu, Yahvé, qui a créé les cieux et les a déployés, qui a affermi la terre et ce<br />
qu'elle produit, qui a donné le souffle au peuple qui l'habite, et l'esprit à ceux qui la parcourent ».<br />
Job 9,4 : « Parmi les plus sages et les plus robustes qui donc lui tiendrait tête impunément ? »<br />
La traduction ne le laisse pas voir.<br />
30
Cette nephesh n’est pas l’âme de Dieu, ce n’est pas une étincelle divine mise en l’homme, l’homme ne<br />
participe pas de la vie de Dieu. C’est encore une différence d’avec les mythologies.<br />
Après la description de la création.<br />
Nous avons dans le chapitre 2 un ‘il n’est pas bon’, l’homme n’est pas fait pour être seul, il<br />
est fait pour la relation ; c’est un thème sapiential.<br />
Qo 4,9-12 : « Mieux vaut être deux que seul, car ainsi le travail donne bon profit. En cas de chute, l'un<br />
relève l'autre ; mais qu'en est-il de celui qui tombe sans personne pour le relever ? Et si l'on couche à<br />
deux, on se réchauffe, mais seul, comment avoir chaud ? Là où un homme seul est renversé, deux<br />
résistent, et le fil triple ne rompt pas facilement ».<br />
Dieu veut faire une aide à l’homme. L’expression est « un secours ». Cette aide n’est pas<br />
trouvée chez les anim<strong>aux</strong>. Ils sont subordonnés à l’homme qui détermine son rapport avec<br />
eux en les nommant. Dieu amène les anim<strong>aux</strong> à l’homme pour qu’il donne leur être. Il y a<br />
une nouvelle initiative de Dieu qui crée la femme.<br />
L’homme n’assiste pas à cette création, il dort. Tardemah signifie la stupeur qui envahi<br />
l’homme lorsque Dieu ou un de ces envoyés lui parle en direct, c’est comme un<br />
obscurcissement des facultés humaines.<br />
Par exemple Gn 15,12 : « Comme le soleil allait se coucher, une torpeur tomba sur Abram et<br />
voici qu'un grand effroi le saisit. »<br />
Job 9,4 : « Parmi les plus sages et les plus robustes qui donc lui tiendrait tête impunément ? »<br />
Il y a donc une stupeur mystérieuse. Adam ne voit pas la femme au moment de sa création ;<br />
l’attitude d’Adam indique cette nouveauté absolue. Par rapport <strong>aux</strong> anim<strong>aux</strong>, Adam lui<br />
donne le nom, mais la signification est différente : il reconnaît que la femme a son nom qui<br />
est le même que l’homme (‘is et ‘issah), c’est la chair de sa chair.<br />
Cette origine forme la raison v24 de l’attraction de l’homme et de la femme. Là aussi nous<br />
voyons une narration à fond étiologique : justifier la réalité par un évènement passé. Le<br />
texte nous fait comprendre l’origine de la situation actuelle de l’homme. L’étiologie part<br />
d’un donné de fait existant, donc pas de quelque chose de paradisiaque, et qui est perdu.<br />
Arrêter la création à l’exemple de l’homme n’est pas bon, car c’est l’état de solitude. Mais<br />
l’homme n’est pas un androgyne.<br />
31
Dans le Banquet Platon raconte le mythe des hommes ronds en trois genres : les masculins,<br />
les féminins et les bi. Mais les dieux ont rompu cette réalité ; on cherche donc sa moitié. Seul<br />
les androgynes cherchent le sexe opposé car c’est leur moitié perdue.<br />
Pour le mythe biblique, cette solitude est un inachevé à assainir. Dès l’origine, l’homme est<br />
fait pour un rapport, avec Dieu et avec la femme. L’homme peut se découvrir dans la femme<br />
et la femme peut se découvrir dans l’homme. Ils sont nus et n’en éprouvent pas de honte, il<br />
y a la conscience de la complétude que l’on trouve dans l’autre.<br />
32
1.2.4 Lecture de Gn 3<br />
[1] Le serpent était le plus rusé de tous les anim<strong>aux</strong> des champs que Yahvé Dieu avait faits. Il dit à la femme :<br />
"Alors, Dieu a dit : Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?"<br />
[2] La femme répondit au serpent : "Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin.<br />
[3] Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas,<br />
sous peine de mort."<br />
[4] Le serpent répliqua à la femme : "Pas du tout ! Vous ne mourrez pas !<br />
[5] Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, qui<br />
connaissent le bien et le mal."<br />
[6] La femme vit que l'arbre était bon à manger et séduisant à voir, et qu'il était, cet arbre, désirable pour acquérir<br />
le discernement. Elle prit de son fruit et mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il mangea.<br />
[7] Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus ; ils cousirent des feuilles de figuier<br />
et se firent des pagnes.<br />
[8] Ils entendirent le pas de Yahvé Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour, et l'homme et sa femme<br />
se cachèrent devant Yahvé Dieu parmi les arbres du jardin.<br />
[9] Yahvé Dieu appela l'homme : "Où es-tu ?" Dit-il.<br />
[10] "J'ai entendu ton pas dans le jardin, répondit l'homme ; j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché."<br />
[11] Il reprit : "Et qui t'a appris que tu étais nu ? Tu as donc mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger !"<br />
[12] L'homme répondit : "C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre, et j'ai mangé !"<br />
[13] Yahvé Dieu dit à la femme : "Qu'as-tu fait là ?" Et la femme répondit : "C'est le serpent qui m'a séduite, et j'ai<br />
mangé."<br />
[14] Alors Yahvé Dieu dit au serpent : "Parce que tu as fait cela, maudit sois-tu entre tous les besti<strong>aux</strong> et toutes les<br />
bêtes sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la terre tous les jours de ta vie.<br />
[15] Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien. Il t'écrasera la tête et tu l'atteindras<br />
au talon."<br />
[16] A la femme, il dit : "Je multiplierai les peines de tes grossesses, dans la peine tu enfanteras des fils. Ta<br />
convoitise te poussera vers ton mari et lui dominera sur toi."<br />
[17] A l'homme, il dit : "Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais<br />
interdit de manger, maudit soit le sol à cause de toi ! A force de peines tu en tireras subsistance tous les jours de<br />
ta vie.<br />
[18] Il produira pour toi épines et chardons et tu mangeras l'herbe des champs.<br />
[19] A la sueur de ton visage tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes au sol, puisque tu en fus tiré. Car<br />
tu es glaise et tu retourneras à la glaise."<br />
[20] L'homme appela sa femme "Eve", parce qu'elle fut la mère de tous les vivants.<br />
[21] Yahvé Dieu fit à l'homme et à sa femme des tuniques de peau et les en vêtit.<br />
[22] Puis Yahvé Dieu dit : "Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous, pour connaître le bien et le mal !<br />
Qu'il n'étende pas maintenant la main, ne cueille aussi de l'arbre de vie, n'en mange et ne vive pour toujours !"<br />
[23] Et Yahvé Dieu le renvoya du jardin d'Eden pour cultiver le sol d'où il avait été tiré.<br />
[24] Il bannit l'homme et il posta devant le jardin d'Eden les chérubins et la flamme du glaive fulgurant pour<br />
garder le chemin de l'arbre de vie.<br />
Ce chapitre est la deuxième face de ce texte Yahviste. C’est une étiologie du mal. Nous avons<br />
de grands problèmes interprétatifs. Pour comprendre les autres chapitres, le contexte<br />
méditerranéen nous a aidé. Mais là nous n’avons aucun texte antique qui nous raconte un<br />
tel récit. C’est donc isolé dans le contexte culturel du temps : maso hiératique.<br />
Ez 28,13s il y a une allusion à ce texte, mais en sens figuré : « tu étais en Eden, au jardin de Dieu.<br />
Toutes sortes de pierres précieuses formaient ton manteau : sardoine, topaze, diamant, chrysolithe,<br />
onyx, jaspe, saphir, escarboucle, émeraude, d'or étaient travaillées tes pendeloques et tes paillettes ;<br />
tout cela fut préparé au jour de ta création. »<br />
33
Sg 2,23s : « Oui, Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité, il en a fait une image de sa propre nature ;<br />
c'est par l'envie du diable que la mort est entrée dans le monde : ils en font l'expérience, ceux qui lui<br />
appartiennent ! »<br />
Sir 25,24 : « C'est par la femme que le péché a commencé et c'est à cause d'elle que tous nous<br />
mourons. »<br />
Soit tous des textes tardifs. Nous trouvons des choses semblables au péché originel dans les<br />
apocryphes : Apocalypse de Moïse, Esdras 4…<br />
Le fondement de la doctrine ecclésiale du péché originel n’est pas Gn 3, mais la relecture de<br />
Ro 5,12s ! Le cœur de notre doctrine : la solidarité de tous les hommes en Adam ; cette<br />
perspective est absente en Gn 3. Paul part de la rédemption de tous les hommes en Christ.<br />
[Pour compléter : les cours de Paul et de <strong>Dogmatique</strong>. Commentaire à la lettre <strong>aux</strong> Romains de H.<br />
Schlier <strong>aux</strong> p 110-113 ; Catéchisme de l'Eglise Catholique n°402-403.]<br />
Le péché originel est purement une conception chrétienne car ceci est fondé par la<br />
rédemption en Christ. Nous trouvons des conceptions dans les intertestamentaires.<br />
Le problème du texte : quel est l’origine du mal ? Il convient de voir la psychologie de<br />
l’auteur.<br />
Le serpent n’est pas le diable. Le texte se situe dans une époque où l’angélologie et la<br />
démonologie sont peu développées. (Daniel, intertestamentaires). Donc identifier le serpent<br />
avec le diable ne doit pas être fait très rapidement. Le fait est que nous nous trouvons<br />
devant un être perfide et insaisissable. Nous sommes dans un contexte de fable : Le serpent,<br />
comme on aurait dit « le loup ». C’est une façon typique de la fable de présenter les choses.<br />
On ne pense pas qu’il y ait un rapport avec le serpent des Madianites qui était une réalité<br />
positive. On a proposé une relation avec l’histoire de Gilgamesh, mais c’est très faible, car<br />
Gilgamesh n’a pas une relation personnelle avec le serpent. Il est vrai qu’il y a l’algue de la<br />
vie qui est dérobée.<br />
Le fait que l’animal parle est propre à la fable. Ici on veut éviter de détacher la responsabilité<br />
de l’homme. Le serpent est la manifestation du dialogue intérieur de l’homme qu’il a avec<br />
lui-même. Le ton de fable permet à chaque interlocuteur de se mettre, de s’identifier avec la<br />
narration. Tout le monde doit pouvoir s’identifier. Le dialogue entre le serpent et Eve nous<br />
fait voir le processus intérieur de la tentation.<br />
34
Le serpent commence en insinuant un doute sur l’essence du plan de Dieu : « est-ce vrai<br />
que…? ». C’est un mensonge évident. Il dit cela pour entrer en discussion. La femme tombe<br />
dans le piège, elle corrige le serpent, mais elle ajoute quelque chose que le Seigneur n’a pas<br />
dit. Elle veut se donner loi elle-même. C’est un commandement qu’elle s’est donnée.<br />
« "Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. [3] Mais du fruit de l'arbre qui est au<br />
milieu du jardin, Dieu a dit : Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sous peine de<br />
mort." ».<br />
Elle a peur de transgresser et se pose un autre commandement : ne pas toucher.<br />
Dieu n’a rien dit du genre. Elle répond à un commandement qu’elle s’est donnée. Elle<br />
manifeste une peur et une insécurité ; en trouvant le point faible, le serpent attaque. Dieu<br />
aurait des intentions sur l’homme. Ainsi elle est posée face à un choix. Elle est encore<br />
indépendante. Là il n’y a pas de transgression. Il y a la possibilité de choix entre la confiance<br />
à la parole de Dieu ou sa compréhension à elle.<br />
Pourquoi l’homme après avoir mangé connaît-il le bien et le mal ? Parce qu’il a posé son<br />
jugement sur la chose, c’est une prise d’autonomie de jugement. La décision de la femme<br />
provient de l’insinuation du serpent que Dieu agit contre l’homme. Elle accepte donc ce<br />
jugement.<br />
La nudité reconnue révèle la fracture profonde dans l’homme et la femme. Avant c’était le<br />
signe de leur rapport réciproque. Maintenant c’est la possibilité que ce rapport devienne<br />
violent. Le cœur même de l’homme qui est capacité de relation est abîmé. Le cœur de la<br />
théologie biblique est cela. En observant que la nudité de l’homme et la femme exprime<br />
cette absence de liberté, de réciproque donation, l’auteur biblique veut montrer que c’est le<br />
cœur qui est touché par la faute. C’est la réalité la plus profonde.<br />
Pourquoi le serpent n’a pas de pattes ? C’est le seul qui avance sans jambes. L’étiologie<br />
explique la forme étrange de cet animal et la naturelle antipathie de l’homme par une<br />
condamnation. L’activité tentatrice du serpent perdure durant toute l’existence de l’homme.<br />
Contrairement au serpent, l’homme et la femme ne sont pas condamnés. Mais il y a des<br />
fractures dans leurs activités. Ils sont nus et en ont honte. Ensuite les activités<br />
caractéristiques : la génération douloureuse, les rapports entre les deux ne sont plus<br />
35
transparents ; l’homme est assujettit à la fatigue dans son travail (v. 17-18). [Ne pas oublier<br />
que c’est la description de l’époque de la situation des rapports homme/femme…].<br />
L’immortalité est à éloigner du texte. Dieu donne la Nephesh et c’est donc provisoire. A<br />
l’origine l’homme n’est pas immortel. L’immortalité est vue comme une condamnation, un<br />
défi par rapport à un désir d’auto-décision. Lorsque Dieu dit si vous mangez vous mourrez,<br />
ceci ne signifie pas que l’homme ne mourrait pas.<br />
Annexe au point 1.2.4 Reprise de la question sur comment interpréter ces<br />
textes qui sont très important en tant que fondement du dogme du péché originel ?<br />
Le Catéchisme de l'Eglise Catholique donne quelques lignes d’interprétation :<br />
Le péché originel – une vérité essentielle de la foi<br />
388 : Avec la progression de la Révélation est éclairée aussi la réalité du péché. Bien que le Peuple de<br />
Dieu de l’Ancien Testament ait connu d’une certaine manière la condition humaine à la lumière de<br />
l’histoire de la chute narrée dans la Genèse, il ne pouvait pas atteindre la signification ultime de cette<br />
histoire, qui se manifeste seulement à la lumière de la Mort et de la Résurrection de Jésus-Christ (cf.<br />
Ro 5, 12-21). Il faut connaître le Christ comme source de la grâce pour connaître Adam comme source<br />
du péché. C’est l’Esprit-Paraclet, envoyé par le Christ ressuscité, qui est venu “ confondre le monde en<br />
matière de péché ” (Jn 16, 8) en révélant Celui qui en est le Rédempteur.<br />
389 : La doctrine du péché originel est pour ainsi dire “ le revers ” de la Bonne Nouvelle que Jésus est<br />
le Sauveur de tous les hommes, que tous ont besoin du salut et que le salut est offert à tous grâce au<br />
Christ. L’Église qui a le sens du Christ (cf. 1 Co 2, 16) sait bien qu’on ne peut pas toucher à la révélation<br />
du péché originel sans porter atteinte au mystère du Christ.<br />
Pour lire le récit de la chute<br />
390 : Le récit de la chute (Gn 3) utilise un langage imagé, mais il affirme un événement primordial, un<br />
fait qui a eu lieu au commencement de l’histoire de l’homme (cf. GS 13, § 1). La Révélation nous donne<br />
la certitude de foi que toute l’histoire humaine est marquée par la faute originelle librement commise<br />
par nos premiers parents (cf. Cc. Trente : DS 1513 ; Pie XII : DS 3897 ; Paul VI, discours 11 juillet 1966).<br />
Ce texte n’a pas toujours été interprété pareillement, mais cela fait partie du processus de la<br />
révélation. C’est le Christ comme sujet de la grâce qui nous révèle Adam comme sujet du<br />
péché. La rédemption en Christ révèle l’action du Christ ; sans le Christ on ne comprend pas<br />
la profondeur du péché.<br />
36
Mais, comment lire le texte de la chute, car nous savons que c’est une « fable » pour<br />
expliquer l’origine du péché ? Mais lisant Ro 5 et la littérature du Nouveau Testament, Christ<br />
n’est pas une métaphore ! Y a-t-il un Adam de l’histoire comme il y a un Christ de l’histoire ?<br />
Ce qui est sûr c’est qu’il y a la factualité du péché. Actuellement on ne peut pas montrer<br />
avec certitude l’existence d’Adam. Aussi, le Catéchisme de l'Eglise Catholique explique en<br />
390 comment lire. Il parle d’évènement primordial. Il n’utilise pas l’évènement historique<br />
(historique = dans le sens que la science historique peut le confirmer). Il faut tenir le concept<br />
d’historique et de métahistorique.<br />
Le récit de la chute n’est pas historique, la chute est un évènement. Du récit de la chute nous<br />
ne pouvons pas trouver quoi que ce soit du particulier de cet évènement primordial. Le récit<br />
de Genèse en tant que tel est relu par Ro 5. Dans notre texte, le mal semble préexistant à<br />
l’homme.<br />
Nous sautons le problème des 12 chapitres du début de la Genèse. Nous allons au chapitre<br />
12 avec une introduction à l’histoire patriarcale.<br />
37
1.2.5 <strong>Introduction</strong> <strong>aux</strong> Histoires Patriarcales<br />
Nous sommes partis du fait que la religion d’Israël est une religion historique par les faits qui<br />
sont historiques. Tout est historique. Nous avons vu la différence entre le mythe et l’histoire.<br />
De fait dans les peuples à côté, on n’arrivait pas à concevoir une histoire à cause des<br />
influences mythologiques. Dans notre cas, Abraham est un homme ; en Egypte, le pharaon<br />
est un dieu, lorsqu’il meurt, c’est une apparente victoire du chaos, mais un nouveau surgit.<br />
Dans la Bible ce sont des évènements historiques. Les histoires patriarcales sont encadrées<br />
dans un contexte historique d’une certaine objectivité. Les faits ont été retravaillés,<br />
embellis…<br />
La première ébauche de l’histoire peut être retrouvé dans ces phénomènes ; c’est commun<br />
avec la civilisation classique grecque qui parle un langage très semblable au langage de la<br />
Bible. Mais l’histoire biblique se construit à partir de l’aventure avec Dieu. Dans l’histoire<br />
classique, c’est construit contre la propre religion.<br />
Il faut aussi rappeler le caractère religieux de ces populations du 2 ème millénaire. C’est une<br />
reconstruction difficile, mais nous pouvons dire une chose : (Cf. Alt, Le Dieu des Pères) est<br />
typique de ces cultures non pas la vénération d’une divinité liée à un lieu précis, mais la<br />
reconnaissance d’un dieu qui a des relations particulières avec le clan, avec la tribu par le<br />
chef. D’où la notion de Dieu des pères. Ces rapports : une manifestation originaire où le dieu<br />
promettait au clan une certaine fécondité et une possession de terre. C’est une aspiration<br />
pour ces nomades de posséder une terre. (Cf. la différence entre les Grands et petits<br />
nomades).<br />
Nous savons que ce thème du Dieu du Père revient souvent : « le Dieu d’Abraham » voir Gn<br />
26,24 ; 28,13 ; 32,10. Nous trouvons en Gn 31,53 « le Dieu d’Abraham et le Dieu de Nahor ».<br />
Gn 31,45 : « la terreur d’Isaac ».<br />
Gn 49,24 : « les mains du Puissant de Jacob, par le Nom de la Pierre d'Israël, [25] par le Dieu<br />
de ton père, qui te secourt, par El Shaddaï qui te bénit… »<br />
La divinité se réfère à un père, le dieu protecteur d’un clan. Ce dieu n’est pas totalement<br />
détaché d’un culte local. Mais le culte local est le dieu protecteur des points de référence<br />
38
comme les puits dans le désert. Dieu assure la marche dans le désert en assurant les puits.<br />
Cf. Ps 18, 3.32.37. Deut 32,4.<br />
Chaque clan se réfère à un fondateur auquel étaient adressées les promesses divines.<br />
Derrière ces fondateurs il y a des rappels historiques qui nous empêchent d’en faire des<br />
personnages totalement légendaires. Ce n’est donc pas de la mythologie, mais des récits très<br />
anciens. Ce que l’on ne peut pas prendre sont les généalogies ; ce sont des manières à<br />
posteriori de reconnaître l’unité du peuple. Il faut penser <strong>aux</strong> patriarches comme étant les<br />
ancêtres de beaucoup de clans. Ensuite on se réunit en un seul groupe familial. Ces<br />
généalogies veulent montrer une unité qui dépassait les divisions internes. La conscience de<br />
cette unité n’est pas fausse car ces clans font partie d’une même racine ethnique. La<br />
situation historique de ces migrations peut être située en une époque que l’on connaît : celle<br />
des grands mouvements migratoire araméens du 19-18 ème siècle. La tradition biblique<br />
concorde avec ces traditions sur les mouvements, le style de vie de ses populations. Les<br />
généalogies sont donc à entendre en ce sens. Ces chefs de clans entrent en relation avec les<br />
sanctuaires cananéens et donc avec le Dieu ‘El. C’est la divinité principale, mais pas la plus<br />
adorée. A ce contact, ils identifient le dieu des pères avec le dieu cananéen ‘El.<br />
A l’époque, le Dieu est attaché à un lieu, si je change d’endroit, je change de Dieu (Cf. David<br />
et Saül). C’est seulement avec Ezéchiel que cela changera avec la vision du char divin qui suit<br />
son peuple et qui donc peut être adoré partout.<br />
Cette opération de reconnaissance se fait en attribuant <strong>aux</strong> pères l’histoire des sanctuaires<br />
qui pourtant étaient pré-historiques. Pourquoi le dieu de mon père Jacob est adoré à<br />
Béthel ? Parce c’est lui qui l’a fondé en Gn 28,10.<br />
Israël fonde Sichem, Gn 33,18-20, qui est originairement distinct de Jacob :<br />
« Puis Jacob arriva sain et sauf à la ville de Sichem, au pays de Canaan, lorsqu'il revint de<br />
Paddân-Aram, et il campa en face de la ville. [19] Il acheta <strong>aux</strong> fils de Hamor, le père de<br />
Sichem, pour cent pièces d'argent, la parcelle de champ où il avait dressé sa tente [20] et il y<br />
érigea un autel, qu'il nomma "El, Dieu d'Israël." »<br />
• Jacob fonde Béthel, où est adoré le dieu ‘El.<br />
• Israël est distinct de Jacob et fonde Sichem, du dieu ‘El bérit, le dieu créateur.<br />
39
‘El est le dieu céleste. Il est vénéré en ces sanctuaires. Ces sanctuaires sont au centre<br />
Nord du pays.<br />
• Le patriarche Isaac est lié à Bersabée, à l’extrême sud du Pays, la dernière ville<br />
d’Israël, où le dieu est ‘El-olam.<br />
• Abraham est attaché à Mambré. La tradition l’identifie avec Hébron. Mais c’est très<br />
postérieur. Ce n’est pas vrai, mais c’est cette zone des montagnes au sud et<br />
Bethlehem. On y adore ‘El-Shaddaï qui se traduit avec « tout puissant ». En réalité ça<br />
n’a rien à voir. On ne sait pas ce que cela signifie. Quelqu’un pense à « ‘El des<br />
montagnes ».<br />
Ensuite ces personnes furent mises en un seul clan. On parlera du dieu des pères. On a<br />
ensuite donné une autre généalogie de patriarches, mais à un niveau historique différents :<br />
ce sont les douze patriarches des douze tribus (2 ème moitié du 2 ème millénaire).Ce sont les<br />
ancêtres éponymes.Traces de l’originaire indépendance de ces clans est l’attention entre les<br />
fils des différentes matriarches : les fils de Rachel et les autres tribus.<br />
Généalogie :<br />
Térah enfante 3 fils : Nahor, Abraham et Harân.<br />
Nahor épouse Milka la fille d’Harân enfante Bétuel et 8 autres ; Bétuel enfante Rébecca<br />
(future femme de Isaac) et Laban. Laban enfante Léa et Rachel qui seront les deux épouses<br />
de Jacob.<br />
Abraham d’Agar enfante Ismaël et de Sarah enfante Isaac. Il a une troisième concubine<br />
Qetura qui donnera origine <strong>aux</strong> madianites, <strong>aux</strong> Sabéens et <strong>aux</strong> Dedanites les habitants de<br />
Dedân (cf. Is 21,13).<br />
Isaac épouse Rebecca et enfante Esaü dit aussi Edom qui donnera les édomites ; et Jacob<br />
d’où viendront les 12 tribus d’Israël.<br />
Harân enfante Milka qui épouse Nahor ; et Lot. Lot donnera Moab et Amon.<br />
40
Laban<br />
Bétuel<br />
Léa Rachel<br />
Edomites<br />
Ruben<br />
Siméon<br />
1.2.5.1 Arbre des origines des patriarches<br />
Térah<br />
Nahor Harân<br />
Rebecca<br />
+ 8 autres<br />
(Gn 22,21s)<br />
Esaü/Edom<br />
Agar<br />
Ismaël<br />
Abraham<br />
12 patriarches<br />
Isaac<br />
Jacob<br />
Lévi Juda Dan Nephtali Gad Asher<br />
Milka Lot<br />
Issachar<br />
Moab Amon<br />
Benjamin<br />
Zabulon<br />
Joseph<br />
Ephraïm Manassé<br />
Il y a deux systèmes de tribu : une avec Joseph et Lévi ; un autre qui met à<br />
part Lévi et insère Ephraïm et Manassé à la place de Lévi et Joseph.<br />
Sara<br />
Qetura<br />
Madianites<br />
Sabéens<br />
Dedanites<br />
41
Jacob a quatre femmes de qui il aura 12 fils et une Fille :<br />
- Ruben de Léa<br />
- Siméon de Léa<br />
- Lévi de Léa<br />
- Juda de Léa<br />
- Dan de Bila<br />
- Nephtali de Bila<br />
- Gad de Zilpa<br />
- Asher de Zilpa<br />
- Issachar de Léa<br />
- Zabulon de Léa<br />
- Dina (fille) de Léa<br />
- Joseph de Rachel Ephraïm et Manassé de Joseph<br />
- Benjamin de Rachel<br />
Benjamin a fait le pont entre le Nord et le Sud en Israël comme frère direct de Joseph.<br />
Joseph a deux fils : Ephraïm et Manassé qui sont insérés comme fils de Jacob. Ils sont<br />
importants car ils sont adoptés par Jacob et font un saut générationnel. Il y a deux systèmes<br />
de tribu : une avec Lévi et la maison de Joseph, et une qui exclue Lévi qui est prêtre ainsi que<br />
Joseph et insère les deux autres d’Ephraïm et Manassé. Joseph et Benjamin sont fils de la<br />
même mère. Ces deux tribus d’Ephraïm et Manassé ont toujours eu des bonnes relations<br />
avec Benjamin qui est au nord.<br />
De par les mères, il y a des relations plus intimes entre les tribus. Ces généalogies ne sont<br />
pas vraies, mais elles montrent ces relations.<br />
Le Dieu des pères a aussi un autre nom, celui du tétragramme sacré ; YHWH. Ce nom peut<br />
venir de la tradition madianite : un clan qui a immigré plus au sud, et a fini en Egypte.<br />
Certains pensent sous le règne de Ixos (dynastie d’origine sémitique) où des peuples<br />
envahissent le sud, et c’est peut-être là que des clans entrent dans le delta. En 1400 environ,<br />
lors de la 18 ème dynastie, on a une régression de ces nomades qui sont mis en esclaves. Nous<br />
en avons des nouvelles au temps de Ramsès qui règne de 1290-1224.<br />
Merneptah (1224-1204) est le fils de Ramsès qui régna peu à cause de la durée du règne de<br />
son père.<br />
Ramsès fonde une nouvelle capitale ‘Pyrames’ qui a une vie éphémère et ne dure pas. Or, au<br />
moment où l’écrivain écrit exode 22, cette ville n’existe plus, il l’a donc appris par des notes<br />
historiques. Ramsès a des ouvriers forcés, les Hapirû qui seraient peut-être les juifs parce<br />
42
que les consonnes sont semblables, les racines des mots se ressemblent. Or, ce n’est pas<br />
évident. Il s’agissait de certains travailleurs d’une certaine classe sociale. Ces Hapirû sont une<br />
population mal définie, attestée par les documents mésopotamiens, cananéens et égyptiens<br />
entre le 19 ème et le 13 ème siècle a.C. dans tous les documents du 2ème millénaire, ce terme<br />
désigne une population instable et mal contrôlée, vivant souvent de razzia, ou en<br />
s’engageant au service du plus offrant, soit comme main d’œuvre, soit comme mercenaire.<br />
Sur une stèle découverte à Thèbes en 1896 qui décrit les victoires de ce pharaon sur les<br />
libyens et les peuples d’Asie (à A<strong>net</strong>), figure Israël alors que c’est un peuple nomade 2 . C’est<br />
le seul témoignage extrabiblique d’Israël en Egypte.<br />
Ex 1,11 : « On imposa donc à Israël des chefs de corvée pour lui rendre la vie dure par les<br />
trav<strong>aux</strong> qu'ils exigeraient. C'est ainsi qu'il bâtit pour Pharaon les villes-entrepôts de Pitom et<br />
de Ramsès ».<br />
Lorsque les textes sont écris, la ville n’existe plus.<br />
La mer des rose<strong>aux</strong>, une chose au Sinaï particulière, un personnage, Moïse auquel est lié le<br />
groupe. Lien avec les araméens en Palestine. Arrive dans la terre de ses pères ces groupes.<br />
Les araméens ont identifié le dieu ‘El comme dieu, le groupe de Moïse a aussi ce nom : donc<br />
ils sont parents parce qu’ils ont le même dieu. Si le dieu de ton père est le même que celui<br />
de mon père, alors nous sommes cousins et notre dieu est le même. C’est la fusion.<br />
Il y a des indices qui permettent d’avancer cette hypothèse que Jahvé était lié à ces peuples<br />
qui revendiquait un territoire sur le golfe d’Akaba. Ils entrent en Palestine en ayant identifié<br />
le dieu de leur père avec ce Jahvé et conclu un pacte avec le clan d’Israël à Sichem où est<br />
vénéré le Dieu de l’alliance témoigné en Josué 24. Ainsi l’histoire de la libération devint<br />
patrimoine commun au fur et à mesure qu’il avançait en notoriété. C’est sans doute un nom<br />
madianite.<br />
L’hypothèse madianite : Le groupe des Qénites qui est un sous clan des madianites d’où<br />
vient l’associé de Moïse Jg 1,16 et 4,11. Ex 3,1s le beau père est dit madianite.<br />
Ex 18,1s, Jéthro reçoit le titre de prêtre de Madian qui offre des sacrifices <strong>aux</strong>quels<br />
participent Moïse et Aaron, donc le sacrifice est au dieu juste. Donc Moïse a eut des<br />
2 Stèle de Merneptah, (ca. 1200 av. J.-C. lignes 26-27) : « les princes sont prosternés, disant ‘Paix !’ Pas un des<br />
Neuf Arcs ne lève la tête. Téhénu (la Libye) est dévasté, le Hatti (le royaume hittite) est en paix. Canaan est<br />
dépouillé de toute sa malfaisance : Ashqelôn a été déporté, on s’est emparé de Gézer, Yeno‘am a été anéanti,<br />
Israël est dévasté, il n’y a plus de semence. Le Haru est la veuve du Pays bien aimé. Tous les pays ensemble<br />
sont pacifiés. »<br />
43
elations avec les madianites. C’est Jéthro qui conseille à Moïse d’organiser le groupe en<br />
clan, c’est madianite.<br />
Découverte de Timna<br />
A Timna dans le désert du Néguev on a retrouvé un lieu d’extraction de cuivre qui<br />
appartenait à l’Egypte du 4 ème millénaire. On y a trouvé un petit temple à Hator (qui est<br />
représenté par une vache) destiné au culte pour les mineurs. Après Ramsès viennent les<br />
madianites qui adaptent leur culte, enlèvent le toit et mettent à la place une toile ornée que<br />
l’on a retrouvée sur le lieu grâce à la bonne conservation dans le désert. On a retrouvé<br />
l’image d’un serpent de bronze avec la tête dorée qui ressemble à celui d’Exode 22 avec<br />
Nehushtân. De plus, sur le côté de l’autel du temple Yahviste de Beér-Sheba un serpent est<br />
sculpté. Donc le serpent est fortement attaché à ce culte.<br />
(Là où il y a des os de chame<strong>aux</strong>, c’est madianite. Ils ont apprivoisé le chameau.)<br />
Le mont Sinaï est souvent lié à la terre de Madian et Orar. L’actuel Sinaï où l’on va en<br />
pèlerinage n’a rien à voir. Le culte du Gebel Mussah est liée au corps d’une sainte très<br />
vénérée en Orient : Catherine d’Alexandrie. C’est donc une tradition chrétienne.<br />
Plus à l’intérieur des terres il y a le Gebel Serbal où on a trouvé une importante quantité<br />
d’inscription, les protosinaïtiques qui témoignent d’un culte très ancien qui est maintenu<br />
ensuite après le passage de Moïse.<br />
1.2.6 Lecture théologique des histoires patriarcales<br />
De la théologie propre des traditions singulières, la tradition canonique nous donne une<br />
relecture de tout cela. Elle amplifie, réfléchie… mais c’est enraciné dans le fond le plus<br />
ancien de ces traditions qui sont historiques. Quel est le thème développé de façon<br />
profonde : celui de la promesse. La promesse <strong>aux</strong> patriarches qui est le point nœudal de la<br />
foi des pères est développée en deux lignes :<br />
1. Le critère de lecture, même là où ce n’est pas présent. Tout est lu sous cet angle ;<br />
2. Une dilatation temporelle du thème de la promesse. Ceci est important.<br />
Le thème prophétique y est lié, le thème dialectique entre la prophétie et son<br />
accomplissement. Ceci n’a en soi rien à voir avec la promesse à l’origine.<br />
44
Relu par la tradition prophétique, ceci se dilate. On n’a plus une promesse pour le présent,<br />
mais elle se dilate ; le père ne voit plus la promesse, il vit dans la foi. On voit donc une<br />
relecture radicale ou l’élément religieux montre une tendance permanente de Dieu avec son<br />
peuple. Dieu promet une terre limitée, mais il la dilate toujours davantage avec les<br />
descendants.<br />
La religion d’Israël est historique, c’est un élément archaïque de la religion d’Israël.<br />
45
1.2.6.1 Lecture de Gn 12,1-9 :<br />
[1] Yahvé dit à Abram : "Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, pour le pays que je<br />
t'indiquerai.<br />
[2] Je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai, je magnifierai ton nom ; sois une bénédiction !<br />
[3] Je bénirai ceux qui te béniront, je réprouverai ceux qui te maudiront. Par toi se béniront tous les<br />
clans de la terre."<br />
[4] Abram partit, comme lui avait dit Yahvé, et Lot partit avec lui. Abram avait 75 ans lorsqu'il quitta<br />
Harân.<br />
[5] Abram prit sa femme Saraï, son neveu Lot, tout l'avoir qu'ils avaient amassé et le personnel qu'ils<br />
avaient acquis à Harân ; ils se mirent en route pour le pays de Canaan et ils y arrivèrent.<br />
[6] Abram traversa le pays jusqu'au lieu saint de Sichem, au Chêne de Moré. Les Cananéens étaient<br />
alors dans le pays.<br />
[7] Yahvé apparut à Abram et dit : "C'est à ta postérité que je donnerai ce pays." Et là, Abram bâtit un<br />
autel à Yahvé qui lui était apparu.<br />
[8] Il passa de là dans la montagne, à l'orient de Béthel, et il dressa sa tente, ayant Béthel à l'ouest et<br />
Aï à l'est. Là, il bâtit un autel à Yahvé et il invoqua son nom.<br />
[9] Puis, de campement en campement, Abram alla au Négeb.<br />
Ici nous sommes face à un exemple paradigmatique de la promesse faite au patriarche.<br />
Bénédiction et malédiction ne sont plus liées. La bénédiction assume une caractéristique<br />
plus ample. C’est l’intervention gratuite de Dieu. Elle est immanente à l’histoire d’Abraham.<br />
Nous sommes dans la tradition Yahviste. Elle nous présente le récit le contexte des<br />
araméens. Ce que l’auteur Yahviste avait sous les yeux était une tradition qui racontait<br />
l’histoire des voyages d’Abraham. C’est donc schématique ; normalement dans les histoires<br />
patriarcales : celle de la descendance et de la terre sont unies comme les deux faces d’une<br />
médaille. Ici c’est disjoint. La promesse de la terre devient une preuve posée à la foi<br />
d’Abraham. Lui vient soustrait quelque chose de clair : l’appartenance à son clan, à sa tribu.<br />
L’appartenance à la tribu et la vie physique coïncide pour un antique. Ici c’est ce qui est<br />
demandé à Abraham.<br />
Pour ce contexte, sortir de la terre implique la renonciation totale à tout en vue d’une<br />
promesse d’une terre qui n’est pas donnée comme ça. La terre en second temps. D’abord il<br />
part et ensuite il reçoit la promesse de la terre.<br />
C’est donc en lien avec sa foi. Nous avons la première irruption du personnage d’Abraham<br />
dans l’histoire. Ce moment a été précédé par une sorte d’histoire universelle sur le péché.<br />
Les 11 premiers chapitres montre la décadence de l’humanité. Avec le chapitre 12 nous<br />
avons un retournement d’Abraham qui se détache du péché et part. On voit la foi<br />
d’Abraham. L’auteur veut nous dire : comme Abraham a donné une réponse de foi, ainsi<br />
tout homme.<br />
46
Aussi dans des moments où Abraham est introduit dans le pays, c’est tout autre que la<br />
promesse. On voit encore sa foi.<br />
Il va a Sichem, il construit un autel, descend au sud, plante encore une tente et un autel. Il<br />
construit donc un autel au Nord (ville du nord Sichem) [Béthel est le centre du pays] et il en<br />
fait un au sud.<br />
Il traverse donc le pays occupé par les cananéens et peut seulement construire 2 autels. Il ne<br />
se passe rien, tout est dans le grand silence.<br />
La promesse de la descendance ne trouve pas tout de suite son accomplissement.<br />
11,30 : Sarah est stérile. Contraste entre l’énormité de la promesse et ce voyage pauvre en<br />
évènement et la rencontre préoccupante avec les cananéens et leurs sanctuaires idolâtres<br />
de Sichem et Béthel. Ils font partie d’une vision négative.<br />
Par ce contraste on voit la foi d’Abraham qui se fie en la parole de Dieu. Ce fil rouge parcourt<br />
toute l’histoire d’Abraham jusqu’au chapitre 22 ;<br />
Selon Cassuto, le cycle d Abraham peut être construit autour de 10 épreuves. Chacune est<br />
suivie d’une consolation de Dieu.<br />
1. Chapitre 12, 1-4 : l’émigration du pays, vient la promesse d’un terre.<br />
2. Chapitre 12,10-13,1 : le voyage en Egypte dangereux avec l’histoire de Sarah<br />
qu’Abraham fait passer pour sa sœur. Peut-être est-ce amorite : chez les amorites<br />
nobles, les femmes n’avaient aucun droit. Pour ne pas être traité ainsi, le père du<br />
mari adoptait comme fille la femme de son mari. Ainsi elle avait des droits. Peut-être<br />
qu’à l’origine de cette narration il y a un usage de l’époque que le rédacteur n’aurait<br />
pas compris mais conservé. C’est une hypothèse. La consolation est au v.2 et 3 : le<br />
bétail, le culte.<br />
3. Chapitre 13,2-18 : le conflit avec Lot. Abraham laisse le choix de la terre à Lot qui<br />
prend la meilleure. De v.14-18, le Seigneur montre le pays qu’il va donner. Soit une<br />
renouvellement de la promesse.<br />
4. Chapitres 14 et 15 : la guerre des 4 rois. Cette histoire d’origine incertaine qui est<br />
insérée dans notre narration par le verset 12 : la capture de Lot. Abraham intervient.<br />
Il y a un grand renouvellement de la promesse au chapitre 15 qui est le centre.<br />
5. Chapitre 16 : le danger d’Ismaël. Agar et Sarah ont un litige. Agar est chassée.<br />
Abraham est consolé par la promesse qu’aussi à travers Ismaël naîtra une<br />
descendance.<br />
47
6. Chapitre 17 : la circoncision et le renouvellement de l’alliance qui suit. En vertu de<br />
cette alliance naîtra un fils à Sarah (Chap. 21).<br />
7. Chapitre 18-19,29 : Sodome. Lot est en danger là-bas et Abraham discute avec Dieu.<br />
La consolation est le salut de Lot jusqu’au v. 29. histoire sur l’origine<br />
8. Chapitre 20 : quelque chose sur l’histoire de l’Egypte : Abraham et Abimélek. Il<br />
présente à Abimélek sa femme qui la prend comme concubine, mais le Seigneur<br />
l’avertit. Abraham est intercesseur. Le problème est au niveau sexuel. La consolation<br />
est la naissance d’Isaac.<br />
9. Chapitre 21,8-34 : l’histoire de l’expulsion d’Ismaël qui se conclu au v.21. il y a<br />
ensuite la possibilité d’avoir une alliance ave Abimélek. V. 33-34 finissent par une<br />
invocation à Dieu.<br />
10. Chapitre 22 : le sacrifice d’Isaac. Après il y a le renouvellement de la promesse avec<br />
les versets 15-18.<br />
1.2.6.2 Lecture de Genèse 22, 1-19 :<br />
[1] Après ces événements, il arriva que Dieu éprouva Abraham et lui dit : "Abraham ! Abraham !" Il<br />
répondit : "Me voici !"<br />
[2] Dieu dit : "Prends ton fils, ton unique, que tu chéris, Isaac, et va-t'en au pays de Moriyya, et là tu<br />
l'offriras en holocauste sur une montagne que je t'indiquerai."<br />
[3] Abraham se leva tôt, sella son âne et prit avec lui deux de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois<br />
de l'holocauste et se mit en route pour l'endroit que Dieu lui avait dit.<br />
[4] Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin.<br />
[5] Abraham dit à ses serviteurs : "Demeurez ici avec l'âne. Moi et l'enfant nous irons jusque là-bas, nous<br />
adorerons et nous reviendrons vers vous."<br />
[6] Abraham prit le bois de l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac, lui-même prit en mains le feu et le<br />
couteau et ils s'en allèrent tous deux ensemble.<br />
[7] Isaac s'adressa à son père Abraham et dit : "Mon père !" Il répondit : "Oui, mon fils" - "Eh bien, reprit-il,<br />
voilà le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?"<br />
[8] Abraham répondit : "C'est Dieu qui pourvoira à l'agneau pour l'holocauste, mon fils", et ils s'en allèrent<br />
tous deux ensemble.<br />
[9] Quand ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y éleva l'autel et disposa le bois,<br />
puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois.<br />
[10] Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils.<br />
[11] Mais l'Ange de Yahvé l'appela du ciel et dit : "Abraham ! Abraham !" Il répondit : "Me voici !"<br />
[12] L'Ange dit : "N'étends pas la main contre l'enfant ! Ne lui fais aucun mal ! Je sais maintenant que tu<br />
crains Dieu : tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique."<br />
[13] Abraham leva les yeux et vit un bélier, qui s'était pris par les cornes dans un buisson, et Abraham alla<br />
prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils.<br />
[14] A ce lieu, Abraham donna le nom de "Yahvé pourvoit", en sorte qu'on dit aujourd'hui : "Sur la<br />
montagne, Yahvé pourvoit."<br />
[15] L'Ange de Yahvé appela une seconde fois Abraham du ciel<br />
[16] et dit : "Je jure par moi-même, parole de Yahvé : parce que tu as fait cela, que tu ne m'as pas refusé<br />
ton fils, ton unique,<br />
48
[17] je te comblerai de bénédictions, je rendrai ta postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que<br />
le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité conquerra la porte de ses ennemis.<br />
[18] Par ta postérité se béniront toutes les nations de la terre, parce que tu m'as obéi."<br />
[19] Abraham revint vers ses serviteurs et ils se mirent en route ensemble pour Bersabée. Abraham résida<br />
à Bersabée.<br />
[20] Après ces événements, on annonça à Abraham que Milka elle aussi avait enfanté des fils à son frère<br />
Nahor :<br />
[21] son premier-né Uç, Buz, le frère de celui-ci, Qemuel, père d'Aram,<br />
[22] Késed, Hazo, Pildash, Yidlaph, Bétuel<br />
[23] [et Bétuel engendra Rébecca]. Ce sont les huit enfants que Milka donna à Nahor, le frère d'Abraham.<br />
[24] Il avait une concubine, nommée Réuma, qui eut aussi des enfants : Tébah, Gaham, Tahash et Maaka.<br />
Le principe de la relecture est ici très présent.<br />
Il y avait des cultes de sacrifices humains dans des sanctuaires. Le narrateur en fait un<br />
morceau de bravoure littéraire. Il est aussi attentif <strong>aux</strong> notations qui pourraient permettre<br />
d’identifier le sanctuaire dont on est entrain de parle. Le toponyme échappe à toute<br />
reconnaissance. 2Chro 3,1 identifie Moriyya avec le mont du Temple de Jérusalem. Notre<br />
texte ne connaît pas cela. C’est beaucoup plus tardif. Ici le narrateur veut éliminer tout ce<br />
qui peut faire reconnaître. L’endroit est générique.<br />
Abraham est mis dans ce récit.<br />
Il est bon de lire le sage de Auerbach sur le réalisme dans la littérature ; il fait une analyse<br />
très précise de ce texte en le mettant en parallèle à des textes de la même époque dont<br />
l’Odyssée. Il montre que le narrateur biblique est parvenu à nous donner un effet de vrai et<br />
propre réalisme. Il nous décrit le personnage.<br />
Il n’y a pas d’éléments secondaires. On ne nous décrit que les faits avec les seuls éléments<br />
essentiels : âne, serviteurs. Les adjectifs sont pour Isaac : ton fils, celui que tu aimes…<br />
On ne nous dis rien sur le voyage : Abraham lève les yeux et voit le lieu. On ne sait rien<br />
d’autre. Rien ne nous est dit sur l’état d’âme d’Abraham. C’est Isaac le plus jeune qui porte<br />
le poids, mais pas le feu et le couteau qu’Abraham porte.<br />
Lorsque les deux quittent les serviteurs, le temps se ralenti. Il y a des questions, des<br />
réponses, des silences. Arrivé au sommet la clef narrative change : tout est raconté : la<br />
construction de l’autel, le bois, les liens du fils qui est déposé sur le bois. On veut donner un<br />
rythme angoissant à l’issue du texte. Le narrateur utilise les verbes graphiques. Il faut dire<br />
avec quoi on accomplit une action : prendre le couteau = tendre la main et … ; parler = ouvrir<br />
la bouche et… Nous avons l’usage de ce participe graphique pour nous montrer l’hésitation<br />
d’Abraham avec le couteau. L’écrivain est un vrai artiste.<br />
49
L’arrivée de l’ange donne la clef de lecture : Dieu l’a éprouvé.<br />
V. 14 le narrateur a fini de nous raconter l’antique légende cultuelle. Le bouc a été offert. On<br />
peut s’interroger sur la valeur des sacrifices humains. Il y a un courant qui a une position plus<br />
positive sur ces sacrifices humains vus comme valide (Fille de Jephté, roi de Moab…).<br />
Substantiellement on voit que la position de ce narrateur est de considérer les sacrifices<br />
humains comme impossible car la vie du fils n’est pas à sa disposition. Mais Abraham a offert<br />
son fils, le sacrifice est accompli. C’est la disponibilité ou non de la victime : la vie humaine<br />
n’est pas dans la vie d’Abraham et l’animal est offert en substitution de la vie humaine. Le<br />
rituel est différent du sacrifice lévitique : le prêtre n’intervient que pour approcher la victime<br />
de l’autel et l’offrir. La mort en tant que telle est une préparation faite avant.<br />
C’est une réflexion du code Sacerdotal qui veut éloigner l’idée que la mort de l’animal<br />
représente la mort de l’homme. Ici nous avons le rituel d’un sacrifice Kelîl où la victime était<br />
tuée sur l’autel et brûlée là où elle est tuée. [Les cornes de l’autel servaient sans doute pour<br />
lier la victime].<br />
Mizbéah est du verbe zgh et signifie abattoir.<br />
Le déplacement de l’immolation de la victime du centre de l’autel au côté de l’autel, est pour<br />
enlever tout ambiguïté. Dans notre texte on substitue l’animal à l’homme parce que la vie de<br />
l’homme n’appartient pas à l’offrande.<br />
Abraham est qualifié comme quelqu’un qui craint Dieu. Il a sacrifié son fils, même si il n’est<br />
pas mort.<br />
L’étiologie s’arrêt là avec un proverbe ; dans la fondation de Sichem en 28,10 l’étiologie vient<br />
à la fin, Jacob a commenté la chose et met la pierre en l’appelant Béthel. En 32,23 pour<br />
Pémuel où on voit Jacob appeler ce lieu ainsi parce qu’il a vu Dieu face à face.<br />
Ici nous n’avons pas le nom. Nous n’avons que l’explication étymologique ; l’auteur veut<br />
empêcher d’identifier ce lieu. De plus le narrateur n’est pas satisfait et continu avec l’ange<br />
qui appelle Abraham pour la deuxième fois.<br />
La descendance d’Abraham est décrite avec des superlatifs très fort dans cette pauvre<br />
langue. Dieu jure par lui-même et conclu avec un refrain « oracle du Seigneur ». [ne’ûm<br />
YHWH] est la phrase des prophètes pour un oracle du Seigneur.<br />
Ce qui surprend en ce texte est l’absolu : du vouloir de Dieu, de l’obéissance d’Abraham, de<br />
la gratuité de la vie faite à Isaac, de la promesse faite à Abraham. Le vouloir divin face auquel<br />
l’homme ne peut rien faire. C’est comme le sceau final : le don total de Dieu : Par ta<br />
50
postérité se béniront toutes les nations de la terre, parce que tu m'as obéi. Figure de l’absolu<br />
du don de l’homme à Dieu et de Dieu à l’homme est Abraham.<br />
Fin de l’histoire d’Abraham.<br />
51
1.2.7 Un cycle narratif à part dans les histoires patriarcales : l’histoire de Joseph<br />
Chapitre 37s<br />
Avec les histoires de Joseph, nous changeons de style. Abraham est une histoire composite<br />
autour de la figure du patriarche. Ici nous avons une figure unitaire. La narration de Joseph<br />
est cohérente.<br />
Quant au genre littéraire nous ne sommes pas face à des légendes. C’est un récit de<br />
didascalie en style sapiential ; alors que les sagas patriarcales nous permettent de rejoindre<br />
la base historique, l’histoire de Joseph rend difficile de rejoindre le fond historique de<br />
l’histoire. Aussi, Abraham est plus facilement reconductible à l’histoire que Joseph.<br />
Nous sommes donc en présence d’un processus littéraire qui rend difficile à retrouver le<br />
matériel historique. Nous sommes dans une cathédrale baroque où l’on ne distingue plus les<br />
différentes origines.<br />
La narration est plus compacte. Aucun passage n’a pu avoir une existence en soi. Nous<br />
sommes dans une rédaction sapientiale de l’histoire des patriarches.<br />
Il y a des théories de deux histoires de Joseph mises ensemble. Westermann démonte cela.<br />
On pense que le chapitre 38 est une insertion postérieure. Mais ce chapitre 38 fait partie de<br />
la narration. L’histoire de Judas et Tamar introduit le thème de la menace de l’intégrité de la<br />
race que l’on voit dès le début de la Genèse. C’est donc un lien entre l’histoire de Joseph et<br />
les autres patriarches.<br />
A partir de là il est donc difficile de distinguer ce qui est historique et ce qui et romanesque.<br />
En tout cas, nous avons à nous occuper d’un texte qui a été inséré dans l’histoire des<br />
patriarches.<br />
Le salut de la race et le don de la terre sont présent : Joseph est le sauveur de la race car il se<br />
charge de sauver ses frères bien que déjà mis en difficulté dans sa propre vie. Mais il les<br />
sauve de la famine. Ce passage de la genèse se rattache donc <strong>aux</strong> grandes promesses<br />
patriarcales. C’est comme un prologue de l’Exode.<br />
Nous y voyons diverses conceptions de Dieu et de son action dans l’Histoire. En 46,1-7 3 :<br />
Dieu intervient non pour bouger les choses, mais pour donner une légitimation de l’histoire.<br />
3 « Israël partit avec tout ce qu'il possédait. Arrivé à Bersabée, il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac et Dieu dit à Israël dans une<br />
vision nocturne : "Jacob ! Jacob !" et il répondit : "Me voici." Dieu reprit : "Je suis El, le Dieu de ton père. N'aie pas peur de descendre en<br />
52
Ce n’est pas la théophanie qui fait intervenir les choses. Dans les histoires patriarcales, Dieu<br />
se manifeste et fait. Ici Dieu ne semble pas guider l’histoire de la même manière. L’action de<br />
Dieu reste inhérente à l’histoire de l’homme.<br />
Les histoires davidiques ressemblent un peu à cela : l’action de Dieu intervient par la liberté<br />
de l’homme. Le Deutéronomiste accepte cela.<br />
Le pharaon est présenté comme habitant de Basse Egypte (soit le Nord, bas en altitude). Or<br />
la capitale est à Thèbes en Haute Egypte et ce jusqu’en l’époque de Ramsès, donc après le<br />
moment supposé de l’histoire de Joseph, étant donné que le pharaon de l’oppression<br />
d’Israël serait Ramsès II ou son fils Merneptah. Il n’est pas certain qu’Israël soit entrée lors<br />
des Hyksos.<br />
1.2.7.1 Lecture de Genèse 37 :<br />
[Genèse 37]<br />
[1] Mais Jacob demeura dans le pays où son père avait séjourné, dans le pays de Canaan.<br />
[2] Voici l'histoire de Jacob. Joseph avait dix-sept ans. Il gardait le petit bétail avec ses frères, - il était<br />
jeune, - avec les fils de Bilha et les fils de Zilpa, femmes de son père, et Joseph rapporta à leur père le<br />
mal qu'on disait d'eux.<br />
[3] Israël aimait Joseph plus que tous ses autres enfants, car il était le fils de sa vieillesse, et il lui fit<br />
faire une tunique ornée.<br />
[4] Ses frères virent que son père l'aimait plus que tous ses autres fils et ils le prirent en haine, devenus<br />
incapables de lui parler amicalement.<br />
[5] Or Joseph eut un songe et il en fit part à ses frères qui le haïrent encore plus.<br />
[6] Il leur dit : "Ecoutez le rêve que j'ai fait :<br />
[7] il me paraissait que nous étions à lier des gerbes dans les champs, et voici que ma gerbe se dressa<br />
et qu'elle se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et elles se prosternèrent devant ma gerbe."<br />
[8] Ses frères lui répondirent : "Voudrais-tu donc régner sur nous en roi ou bien dominer en maître ?"<br />
Et ils le haïrent encore plus, à cause de ses rêves et de ses propos.<br />
[9] Il eut encore un autre songe, qu'il raconta à ses frères. Il dit : "J'ai encore fait un rêve : il me<br />
paraissait que le soleil, la lune et onze étoiles se prosternaient devant moi."<br />
[10] Il raconta cela à son père et à ses frères, mais son père le gronda et lui dit : "En voilà un rêve que<br />
tu as fait ! Allons-nous donc, moi, ta mère et tes frères, venir nous prosterner à terre devant toi ?"<br />
[11] Ses frères furent jaloux de lui, mais son père gardait la chose dans sa mémoire.<br />
[12] Ses frères allèrent paître le petit bétail de leur père à Sichem.<br />
[13] Israël dit à Joseph : "Tes frères ne sont-ils pas au pâturage à Sichem ? Viens, je vais t'envoyer vers<br />
eux" et il répondit : "Je suis prêt."<br />
[14] Il lui dit : "Va donc voir comment se portent tes frères et le bétail, et rapporte-moi des nouvelles."<br />
Il l'envoya de la vallée d'Hébron et Joseph arriva à Sichem.<br />
[15] Un homme le rencontra errant dans la campagne et cet homme lui demanda : "Que cherches-tu<br />
?"<br />
[16] Il répondit : "Je cherche mes frères. Indique-moi, je te prie, où ils paissent leurs troupe<strong>aux</strong>."<br />
[17] L'homme dit : "Ils ont décampé d'ici, je les ai entendus qui disaient : Allons à Dotân" ; Joseph<br />
partit en quête de ses frères et il les trouva à Dotân.<br />
Egypte, car là-bas je ferai de toi une grande nation. C'est moi qui descendrai avec toi en Egypte, c'est moi aussi qui t'en ferai remonter, et<br />
Joseph te fermera les yeux." Jacob partit de Bersabée, et les fils d'Israël firent monter leur père Jacob, leurs petits enfants et leurs femmes sur<br />
les chariots que Pharaon avait envoyés pour le prendre. Ils emmenèrent leurs troupe<strong>aux</strong> et tout ce qu'ils avaient acquis au pays de Canaan et<br />
ils vinrent en Egypte, Jacob et tous ses descendants avec lui : ses fils et les fils de ses fils, ses filles et les filles de ses fils, bref tous ses<br />
descendants, il les emmena avec lui en Egypte ».<br />
53
[18] Ils l'aperçurent de loin et, avant qu'il n'arrivât près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir.<br />
[19] Ils se dirent entre eux : "Voilà l'homme <strong>aux</strong> songes qui arrive !<br />
[20] Maintenant, venez, tuons-le et jetons-le dans n'importe quelle citerne ; nous dirons qu'une bête<br />
féroce l'a dévoré. Nous allons voir ce qu'il adviendra de ses songes !"<br />
[21] Mais Ruben entendit et il le sauva de leurs mains. Il dit : "N'attentons pas à sa vie !"<br />
[22] Ruben leur dit : "Ne répandez pas le sang ! Jetez-le dans cette citerne du désert, mais ne portez<br />
pas la main sur lui !" C'était pour le sauver de leurs mains et le ramener à son père.<br />
[23] Donc, lorsque Joseph arriva près de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, la tunique ornée<br />
qu'il portait.<br />
[24] Ils se saisirent de lui et le jetèrent dans la citerne ; c'était une citerne vide, où il n'y avait pas<br />
d'eau.<br />
[25] Puis ils s'assirent pour manger. Comme ils levaient les yeux, voici qu'ils aperçurent une caravane<br />
d'Ismaélites qui venait de Galaad. Leurs chame<strong>aux</strong> étaient chargés de gomme adragante, de baume et<br />
de ladanum, qu'ils allaient livrer en Egypte.<br />
[26] Alors Juda dit à ses frères : "Quel profit y aurait-il à tuer notre frère et couvrir son sang ?<br />
[27] Venez, vendons-le <strong>aux</strong> Ismaélites, mais ne portons pas la main sur lui : il est notre frère, de la<br />
même chair que nous." Et ses frères l'écoutèrent.<br />
[28] Or des gens passèrent, des marchands madianites, et ils retirèrent Joseph de la citerne. Ils<br />
vendirent Joseph <strong>aux</strong> Ismaélites pour vingt sicles d'argent et ceux-ci le conduisirent en Egypte.<br />
[29] Lorsque Ruben retourna à la citerne, voilà que Joseph n'y était plus ! Il déchira ses vêtements<br />
[30] et, revenant vers ses frères, il dit : "L'enfant n'est plus là ! Et moi, où vais-je aller ?"<br />
[31] Ils prirent la tunique de Joseph et, ayant égorgé un bouc, ils trempèrent la tunique dans le sang.<br />
[32] Ils envoyèrent la tunique ornée, ils la firent porter à leur père avec ces mots : "Voilà ce que nous<br />
avons trouvé ! Regarde si ce ne serait pas la tunique de ton fils."<br />
[33] Celui-ci regarda et dit : "C'est la tunique de mon fils ! Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis<br />
en pièces !"<br />
[34] Jacob déchira son vêtement, il mit un sac sur ses reins et fit le deuil de son fils pendant longtemps.<br />
[35] Tous ses fils et ses filles vinrent pour le consoler, mais il refusa toute consolation et dit : "Non,<br />
c'est en deuil que je veux descendre au shéol auprès de mon fils." Et son père le pleura.<br />
[36] Cependant, les Madianites l'avaient vendu en Egypte à Potiphar, eunuque de Pharaon et<br />
commandant des gardes.<br />
On peut remarquer que 37,2 (Voici l'histoire de Jacob) est la ptolédote où Joseph est mis au<br />
rang des autres patriarches. Mais il ne partage pas avec les autres l’honneur d’être direct<br />
porteur de la promesse.<br />
Alonso Schökel a beaucoup étudié ce sujet.<br />
Le drame naît d’une prédilection humaine et non divine, le texte explique que c’est du père.<br />
Il lui fait un habit à manches longues et décorées. Ce n’est donc pas un habit de travail. Ceci<br />
indique un signe distinctif d’une personne qui ne travaille pas manuellement. Les nobles ne<br />
travaillent pas. Joseph est donc mis sur un plan de domination par rapport à ses frères ; il n’a<br />
pas besoin de travailler pour vivre. 2S 13,18 [Elle portait une tunique de luxe qui était<br />
autrefois le vêtement des filles qui n'étaient pas mariées.] montre un habit semblable<br />
princier. Thamar endosse un habit. Ici, l’antipathie des frères augmente encore avec ce que<br />
Joseph raconte à son père des histoires ou commérages (v.2). Le sommet de l’antipathie<br />
advient lorsqu’il raconte ses songes.<br />
54
C’est donc bien l’histoire de la conversion des frères qui reconnaissent leurs erreurs ; mais il<br />
y a aussi une évolution de Joseph. Le texte nous montre l’évolution spirituelle de tous les<br />
personnages. Jacob aussi a une évolution personnelle. Le personnage de Joseph n’est pas<br />
présenté positivement par le texte, mais il deviendra le grand homme que l’on verra en fin<br />
de texte, capable de pardonner et même de s’engager personnellement pour sauver les<br />
siens. Cette antipathie augmente lorsque Joseph raconte de façon imprudente son songe.<br />
La réaction est caractérisée par des veines anti-monarchiques. Jusqu’à la fin la monarchie eut<br />
des critiques en tant qu’institution. Le texte a donc peut-être été écrit en époque où le sujet<br />
était chaud.<br />
En tout cas Joseph n’est pas pris à la légère, les frères ont peur de la réalisation de ce songe.<br />
Le v.19 le montre bien. Au délit de crime s’ajoute l’autre délit des frères qui racontent la<br />
mort de Joseph. Jacob est trompé par la veste de Joseph. C’est comme lors de la bénédiction<br />
que Jacob reçoit à la place d’Esaü où il avait trompé son père par le vêtement.<br />
Il y a donc une tragédie : le délit contre la fraternité blesse le père.<br />
Deux des frères se sont détachés : Ruben et Juda.<br />
1.2.7.2 Lecture de Genèse 44 :<br />
[1] Puis Joseph dit à son intendant : "Remplis les sacs de ces gens avec autant de vivres qu'ils peuvent<br />
porter et mets l'argent de chacun à l'entrée de son sac.<br />
[2] Ma coupe, celle d'argent, tu la mettras à l'entrée du sac du plus jeune, avec le prix de son grain." Et<br />
il fit comme Joseph avait dit.<br />
[3] Lorsque le matin parut, on renvoya nos gens avec leurs ânes.<br />
[4] Ils étaient à peine sortis de la ville et n'étaient pas bien loin que Joseph dit à son intendant :<br />
"Debout ! Cours après ces hommes, rattrape-les et dis-leur : Pourquoi avez-vous rendu le mal pour le<br />
bien ?<br />
[5] N'est-ce pas ce qui sert à mon maître pour boire et aussi pour lire les présages ? C'est mal ce que<br />
vous avez fait !"<br />
[6] Il les attrapa donc et leur redit ces paroles.<br />
[7] Mais ils répondirent : "Pourquoi Monseigneur parle-t-il ainsi ? Loin de tes serviteurs de faire une<br />
chose pareille !<br />
[8] Vois donc : l'argent que nous avions trouvé à l'entrée de nos sacs à blé, nous te l'avons rapporté du<br />
pays de Canaan, comment aurions-nous volé de la maison de ton maître argent ou or ?<br />
[9] Celui de tes serviteurs avec qui on trouvera l'objet sera mis à mort et nous-mêmes deviendrons<br />
esclaves de Monseigneur."<br />
[10] Il reprit : "Eh bien ! Qu'il en soit comme vous avez dit : celui avec qui on trouvera l'objet sera mon<br />
esclave, mais vous autres vous serez quittes."<br />
[11] Vite, chacun descendit à terre son sac à blé et chacun l'ouvrit.<br />
[12] Il les fouilla en commençant par l'aîné et en finissant par le plus jeune, et la coupe fut trouvée<br />
dans le sac de Benjamin !<br />
[13] Alors, ils déchirèrent leurs vêtements, rechargèrent chacun son âne et revinrent à la ville.<br />
[14] Lorsque Juda et ses frères entrèrent dans la maison de Joseph, celui-ci s'y trouvait encore, et ils<br />
tombèrent à terre devant lui.<br />
[15] Joseph leur demanda : "Quelle est cette action que vous avez commise ? Ne saviez-vous pas qu'un<br />
homme comme moi sait deviner ?"<br />
55
[16] Et Juda répondit : "Que dirons-nous à Monseigneur, comment parler et comment nous justifier ?<br />
C'est Dieu qui a mis en évidence la faute de tes serviteurs. Nous voici donc les esclaves de<br />
Monseigneur, aussi bien nous autres que celui <strong>aux</strong> mains duquel on a trouvé la coupe."<br />
[17] Mais il reprit : "Loin de moi d'agir ainsi ! L'homme <strong>aux</strong> mains duquel la coupe a été trouvée sera<br />
mon esclave, mais vous, retournez en paix chez votre père."<br />
[18] Alors Juda s'approcha de lui et dit : "S'il te plaît, Monseigneur, permets que ton serviteur fasse<br />
entendre un mot <strong>aux</strong> oreilles de Monseigneur, sans que ta colère s'enflamme contre ton serviteur, car<br />
tu es vraiment comme Pharaon !<br />
[19] Monseigneur avait posé cette question à ses serviteurs : Avez-vous encore un père ou un frère ?<br />
[20] Et nous avons répondu à Monseigneur : Nous avons un vieux père et un cadet, qui lui est né dans<br />
sa vieillesse ; le frère de celui-ci est mort, il reste le seul enfant de sa mère et notre père l'aime !<br />
[21] Alors tu as dit à tes serviteurs : Amenez-le moi, que mon regard se pose sur lui.<br />
[22] Nous avons répondu à Monseigneur : L'enfant ne peut pas quitter son père ; s'il quitte son père,<br />
celui-ci en mourra.<br />
[23] Mais tu as insisté auprès de tes serviteurs : Si votre plus jeune frère ne descend pas avec vous,<br />
vous ne serez plus admis en ma présence.<br />
[24] Donc, lorsque nous sommes remontés chez ton serviteur, mon père, nous lui avons apporté les<br />
paroles de Monseigneur.<br />
[25] Et lorsque notre père a dit : Retournez pour nous acheter un peu de vivres,<br />
[26] nous avons répondu : Nous ne pouvons pas descendre. Nous ne descendrons que si notre jeune<br />
frère est avec nous, car il n'est pas possible que nous soyons admis en présence de cet homme sans<br />
que notre plus jeune frère soit avec nous.<br />
[27] Alors ton serviteur, mon père, nous a dit : Vous savez bien que ma femme ne m'a donné que deux<br />
enfants :<br />
[28] l'un m'a quitté et j'ai dit : il a été mis en pièces ! et je ne l'ai plus revu jusqu'à présent.<br />
[29] Que vous preniez encore celui-ci d'auprès de moi et qu'il lui arrive malheur et vous feriez<br />
descendre dans la peine mes cheveux blancs au shéol.<br />
[30] Maintenant, si j'arrive chez ton serviteur, mon père, sans que soit avec nous l'enfant à l'âme<br />
duquel son âme est liée,<br />
[31] dès qu'il verra que l'enfant n'est pas avec nous, il mourra, et tes serviteurs auront fait descendre<br />
dans l'affliction les cheveux blancs de ton serviteur, notre père, au shéol.<br />
[32] Et ton serviteur s'est porté garant de l'enfant auprès de mon père, en ces termes : Si je ne te le<br />
ramène pas, j'en serai coupable envers mon père toute ma vie.<br />
[33] Maintenant, que ton serviteur reste comme esclave de Monseigneur à la place de l'enfant et que<br />
celui-ci remonte avec ses frères.<br />
[34] Comment, en effet, pourrais-je remonter chez mon père sans que l'enfant soit avec moi ? Je ne<br />
veux pas voir le malheur qui frapperait mon père."<br />
Le péché de Benjamin serait d’avoir volé la coupe oraculaire. En effet, cette coupe servait à<br />
lire les présages. En volant cette coupe, c’est la sécurité même de l’état qui est mise en<br />
cause. C’est un crime national car la sécurité est menacée.<br />
La vraie sanction exigeait que le coupable soit tué et que les autres deviennent esclaves.<br />
Mais Joseph est « miséricordieux » et veut prendre Benjamin en esclave et laisser les autres<br />
partir.<br />
Par là Joseph teste ses frères pour voir si ils sont attachés au plus jeune. C’est Juda qui parle<br />
et fait une affirmation importante étant sûr que Joseph ne comprend pas. « Dieu a découvert<br />
la faute de tes serviteurs ».<br />
56
Soit deux possibilités : Dieu a découvert la faute d’un vol ; ou Dieu punit pour le délit<br />
de ce qu’ils ont fait au jeune frère (Joseph) il y a longtemps.<br />
Autrefois, les frères n’ont pas hésité à sacrifier Joseph et à donner de la douleur à leur Père.<br />
Ici ils ne veulent pas donner de douleur au Père. C’est donc le signe de la conversion. Joseph<br />
peut donc se faire reconnaître. C’est le chapitre suivant. Les frères ont donc expié la faute.<br />
Joseph parlera en araméen alors qu’il utilisait un interprète. Si ce fut vraiment au temps des<br />
Hyksos, il n’y aurait pas eu ce problème.<br />
Le message théologique : la menace de la fécondité de la race n’est pas externe, mais<br />
interne : la jalousie et l’envie entre frères ! Les frères ne reconnaissent pas l’élection de<br />
Joseph. Désormais cela vient de Dieu.<br />
C’est donc une thématique liée au Pentateuque : l’élection. Ici elle est mise en question par<br />
des facteurs internes : le fait de ne pas reconnaître la préférence de Dieu.<br />
1.3 L’EXODE ET LES LIVRES SUCCESSIFS<br />
1.3.1 Structure du livre de l’Exode<br />
En sortant de la Genèse nous trouvons l’Exode.<br />
Exode, Lévitique et Deutéronome ont une unité narrative. Il convient donc de les considérer<br />
ensemble.<br />
Entrons dans l’Exode. Il y a deux sections interdépendantes mais connexes.<br />
1. 1-15,21 : la libération des hébreux du Pharaon en Egypte<br />
2. 12,37-40,38 : le voyage de l’Egypte au Sinaï<br />
La marche advient en 12 étapes chacune marquée par « ils levèrent le camp de X et<br />
arrivèrent à Y ».<br />
Il y a une superposition des deux parties avec les chapitres charnières de la libération :<br />
12,37-15,31.<br />
1. Chapitre 12 : la pâque et ses prescriptions<br />
2. Chapitre 13 : les premiers-nés et la dernière plaie<br />
3. Chapitre 14 : la traversée de la mer<br />
4. Chapitre 15 : le cantique de Myriam<br />
57
Ces étapes font un raccord.<br />
16 à 19,1 : 7 étapes du voyage.<br />
En 19,1 est la dernière étape qui finira en Nombre 10,11. Elle comprend toute la deuxième<br />
partie, tout le Lévitique et les premiers chapitres des Nombres.<br />
Après la sortie d’Egypte à pâque, 3 mois après ils arrivent au Sinaï pour 1 an. Ensuite<br />
recommence le chemin du désert.<br />
La division entre Exode et Nombre, et entre Nombre et Lévitique n’est pas dû à l’auteur mais<br />
au besoin de livres standard … il fallait changer de rouleau de papier parce que le premier<br />
est terminé. Donc c’est involontaire. C’est une division extrinsèque. Le rouleau ne pouvait<br />
pas être trop gros, ils avaient des mesures standard.<br />
De Exode 19,2 à Nb 10,10, le peuple est formé au Sinaï. Ils reçoivent un chef Moïse, la loi<br />
(Torah), un temple (le tabernacle), et une terre comme possession et non comme promesse.<br />
1.3.2 Lecture de Exode 3 : la vocation de Moïse et la révélation du Nom<br />
[1] Moïse faisait paître le petit bétail de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madiân ; il l'emmena pardelà<br />
le désert et parvint à la montagne de Dieu, l'Horeb.<br />
[2] L'Ange de Yahvé lui apparut, dans une flamme de feu, du milieu d'un buisson. Moïse regarda : le<br />
buisson était embrasé mais le buisson ne se consumait pas.<br />
[3] Moïse dit : "Je vais faire un détour pour voir cet étrange spectacle, et pourquoi le buisson ne se<br />
consume pas."<br />
[4] Yahvé vit qu'il faisait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. "Moïse, Moïse",<br />
dit-il, et il répondit : "Me voici."<br />
[5] Il dit : "N'approche pas d'ici, retire tes sandales de tes pieds car le lieu où tu te tiens est une terre<br />
sainte."<br />
[6] Et il dit : "Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob." Alors<br />
Moïse se voila la face, car il craignait de fixer son regard sur Dieu.<br />
[7] Yahvé dit : "J'ai vu, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Egypte. J'ai entendu son cri devant<br />
ses oppresseurs ; oui, je connais ses angoisses.<br />
[8] Je suis descendu pour le délivrer de la main des Egyptiens et le faire monter de cette terre vers une<br />
terre plantureuse et vaste, vers une terre qui ruisselle de lait et de miel, vers la demeure des<br />
Cananéens, des Hittites, des Amorites, des Perizzites, des Hivvites, et des Jébuséens.<br />
[9] Maintenant, le cri des Israélites est venu jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que font peser sur eux<br />
les Egyptiens.<br />
[10] Maintenant va, je t'envoie auprès de Pharaon, fais sortir d'Egypte mon peuple, les Israélites."<br />
[11] Moïse dit à Dieu : "Qui suis-je pour aller trouver Pharaon et faire sortir d'Egypte les Israélites ?"<br />
[12] Dieu dit : "Je serai avec toi, et voici le signe qui te montrera que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand<br />
tu feras sortir le peuple d'Egypte, vous servirez Dieu sur cette montagne."<br />
[13] Moïse dit à Dieu : "Voici, je vais trouver les Israélites et je leur dis : Le Dieu de vos pères m'a<br />
envoyé vers vous. Mais s'ils me disent : Quel est son nom ?, que leur dirai-je ?"<br />
58
[14] Dieu dit à Moïse : "Je suis celui qui est." Et il dit : "Voici ce que tu diras <strong>aux</strong> Israélites : Je suis m'a<br />
envoyé vers vous."<br />
[15] Dieu dit encore à Moïse : "Tu parleras ainsi <strong>aux</strong> Israélites : Yahvé, le Dieu de vos pères, le Dieu<br />
d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. C'est mon nom pour toujours,<br />
c'est ainsi que l'on m'invoquera de génération en génération.<br />
[16] "Va, réunis les anciens d'Israël et dis-leur : Yahvé, le Dieu de vos pères, m'est apparu - le Dieu<br />
d'Abraham, d'Isaac et de Jacob - et il m'a dit : Je vous ai visités et j'ai vu ce qu'on vous fait en Egypte,<br />
[17] alors j'ai dit : Je vous ferai monter de l'affliction d'Egypte vers la terre des Cananéens, des Hittites,<br />
des Amorites, des Perizzites, des Hivvites et des Jébuséens, vers une terre qui ruisselle de lait et de<br />
miel.<br />
[18] Ils écouteront ta voix et vous irez, toi et les anciens d'Israël, trouver le roi d'Egypte et vous lui<br />
direz : Yahvé, le Dieu des Hébreux, est venu à notre rencontre. Toi, permets-nous d'aller à trois jours<br />
de marche dans le désert pour sacrifier Yahvé notre Dieu.<br />
[19] Je sais bien que le roi d'Egypte ne vous laissera aller que s'il y est contraint par une main forte.<br />
[20] Aussi j'étendrai la main et je frapperai l'Egypte par les merveilles de toute sorte que j'accomplirai<br />
au milieu d'elle ; après quoi, il vous laissera partir.<br />
[21] "Je ferai gagner à ce peuple la faveur des Egyptiens, et quand vous partirez, vous ne partirez pas<br />
les mains vides.<br />
[22] La femme demandera à sa voisine et à celle qui séjourne dans sa maison des objets d'argent, des<br />
objets d'or et des vêtements. Vous les ferez porter à vos fils et à vos filles et vous en dépouillerez les<br />
Egyptiens."<br />
Par rapport à la distinction des sources, on considère qu’il s’agit d’une composition du<br />
Yahviste et de l’Elohiste. On pense que le cœur du texte soit l’Elohiste où l’on prononce le<br />
nom de Dieu. Attention à ces hypothèses qui restent des hypothèses, surtout que l’Elohiste<br />
est toujours plus remis en cause.<br />
La théophanie faite à Moïse est semblable à celle des patriarches, mais il y a aussi d’autres<br />
choses interprétatives.<br />
Moïse reçoit cette théophanie dans un lieu spécial : on parle de lieu sacré, d’arbre sacré (qui<br />
ne peut pas manquer dans ces zones). Seneh ne parait que deux fois dans la Bible. On ne sait<br />
donc pas ce que c’est. SOneh, l’arbre sacré ne peut pas manquer et nous en trouvons dans la<br />
Bible :<br />
Gn 18,1 : « Yahvé lui apparut au Chêne de Mambré, tandis qu'il était assis à l'entrée de la tente, au plus<br />
chaud du jour. »<br />
Gn 21,33s : « Abraham planta un tamaris à Bersabée et il y invoqua le nom de Yahvé, Dieu d'Eternité. »<br />
Il y a une différence substantielle. Les manifestations divines <strong>aux</strong> patriarches ont avec elles<br />
une promesse : race et terre. Pour Moïse, ce n’est pas pour une terre, mais pour une<br />
mission. Dans le cas de Moïse, cette promesse est déjà présente. Le spécifique de Moïse : il<br />
lui est confié la commission de transmettre un message à d’autres ; c’est une configuration<br />
de type prophétique, un élément nouveau qui entre à faire partie des traditions patriarcales.<br />
Ici il n’y a pas la fondation d’un sanctuaire comme il advenait pourtant chez les patriarches.<br />
59
Donc nous avons la révélation d’une théophanie prophétique, qui ne fonde pas un culte et<br />
qui prépare le message le plus fort du passage : la révélation du nom de Dieu, versets 13-15.<br />
La révélation du Nom de YHWH :<br />
[13] Moïse dit à Dieu : "Voici, je vais trouver les Israélites et je leur dis : Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers<br />
vous. Mais s'ils me disent : Quel est son nom ? que leur dirai-je ?"<br />
[14] Dieu dit à Moïse : "Je suis celui qui est." Et il dit : "Voici ce que tu diras <strong>aux</strong> Israélites : Je suis m'a envoyé vers<br />
vous."<br />
[15] Dieu dit encore à Moïse : "Tu parleras ainsi <strong>aux</strong> Israélites : Yahvé, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le<br />
Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. C'est mon nom pour toujours, c'est ainsi que l'on<br />
m'invoquera de génération en génération.<br />
En translittération :<br />
[13] waY%Amer m%veh Ael-h!Ael%h$m hiN#h A!n%k$ b!A Ael-BOn#y<br />
yixOr!A#l wOA!marOT$ l!hem Ael%h#y Aabot#ykem vOl!fan$ Aal#ykem wOA!mOr&-l$ mah-VOmo m!h A%mar Aal#hem<br />
[14] waY%Amer Ael%h$m Ael-m%veh AehOyeh Aaver AehOyeh waY%Amer K%h t%Amar libOn#y yixOr!A#l AehOyeh<br />
vOl!fan$ Aal#ykem<br />
[15] waY%Amer Eod Ael%h$m Ael-m%veh K%h-t%Amar Ael-BOn#y yixOr!A#l yOhw!h Ael%h#y Aab%t#ykem Ael%h#y<br />
AabOr!h!m Ael%h#y yicOf!q w#Al%h#y yaEaq%b vOl!fan$ Aal#ykem zeh-VOm$ lOE%l!m wOzeh zikOr$ lOd%r D%r<br />
Quelle est la signification étymologique du nom divin ?<br />
Il s’agit probablement d’un nom pré-israélien, peut-être madianite, assumé par les israéliens<br />
pour désigner le Dieu national.<br />
Le nom fut lié au verbe être qui se dit HYH ou haya.<br />
Comment traduire la phrase du verset 14 ?<br />
L’interprétation de la LXX est : evgw, eivmi o` w;n que l’on peut traduire : je suis celui qui est.<br />
Or, l’hébreu n’utilise jamais le verbe être. Ceci ne traduit pas le verbe du verset 14. Cette<br />
interprétation est donc à écarter.<br />
En hébreu ce serait : « je suis celui qui je suis ».<br />
Une autre interprétation fondée : le refus de se donner un nom et Dieu dirait : en quelque<br />
sorte « cela ne te regarde pas ». Mais cette interprétation force contre le verset suivant où<br />
Dieu se donne un nom : au verset 14-15 : d’abord il dit « je suis m’a envoyé à vous » puis il<br />
dit Jahvé.<br />
Soit d’abord on a « Je suis » m’a envoyé à vous puis « YHWH … le Dieu des pères » m’a<br />
envoyé à vous.<br />
Quel est ce nom : ‘éhyeh ou YHWH ou le Dieu des pères ? C’est difficile à savoir. Dans le<br />
canon biblique on trouve YHWH en Gn 4,26.<br />
60
Par rapport à ‘éhyeh ne revient pas d’autres fois dans le texte massorétique, si ce n’est une<br />
allusion en Is 42,8 : « Je suis Yahvé, tel est mon nom ! Ma gloire, je ne la donnerai pas à un<br />
autre, ni mon honneur <strong>aux</strong> idoles ».<br />
Ex 48,2 : « Car ils tirent leur nom de la ville sainte, ils s'appuient sur le Dieu d'Israël, Yahvé<br />
Sabaot est son nom ».<br />
Comment traduire la phrase ?<br />
Il faut observer que Dieu se donne plusieurs noms. D’abord il utilise le « Je suis » pour se<br />
nommer, puis le tétragramme et enfin « le Dieu des pères ».<br />
Les deux seconds noms sont des noms traditionnels ; le nom de YHWH n’est pas traditionnel.<br />
Le nom nouveau que Dieu se donne est plutôt ‘éhyeh et non les deux autres. Or c’est une<br />
voie verbale qui signifie je suis. C’est la première personne singulière du verbe être à<br />
l’impératif. En hébreu le verbe être indique une continuité dans le temps.<br />
Pourquoi Dieu change t-il de nom comme cela? Pourquoi fait-il cette affirmation ? Pourquoi<br />
Dieu s’applique t-il le verbe être ?<br />
Attention à ne pas confondre ‘éhyeh avec le tétragramme sacré !<br />
Ex 3,6 : « "Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de<br />
Jacob." ». En fait le français ne fait pas voir cette feinte de langage entre la voie verbale et le<br />
tétragramme.<br />
Le nom des pères est déjà une chose convaincante de la part de Dieu. Il est donc le Dieu de<br />
son père Abraham.<br />
Lorsque l’on est en présence d’une divinité il faut demander son nom parce qu’elle doit être<br />
objet de culte dans le lieu. Mais on ne peut pas l’adorer comme il faut si on ne connaît pas<br />
son nom. Le risque serait aussi de ne pas adorer le dieu présent et d’adorer un autre ce qui<br />
entraînerait la colère du Dieu. Ici Moïse veut une précision pour rendre le juste culte. C’est<br />
une mentalité commune à tout le bassin méditerranéen.<br />
On le voit à Athènes avec l’autel au dieu inconnu.<br />
Les romains faisaient des longues litanies de dieux et finissait avec une formule générale qui<br />
permette de les englober tous.<br />
La deuxième conséquence pour Moïse est que cela lui donne une supériorité. Moïse a donc<br />
deux préoccupations : une de culte et une diplomatique…<br />
61
Le Dieu qui apparaît à Moïse ne semble pas vouloir révéler son nom à Moïse. D’un côté le<br />
rédacteur a de quoi faire avec une tradition qui voit le tétragramme sacré comme la pseudo-<br />
éthymologie de je suis.<br />
Mais le nom divin n’est pas nouveau. Cette apparition ne serait donc pas une révélation du<br />
nom divin, mais la révélation de la signification du nom de Dieu.<br />
Le rédacteur utilise deux choses :<br />
1. Signification ambiguë de la phrase je suis qui je suis.<br />
2. Par cette phrase, le rédacteur établie une relation de pseudo-étymologie<br />
entre le nom de Dieu et le tétragramme sacré. Que signifie t-il donc ?<br />
Moïse veut le nom de la divinité pour l’adorer, Dieu la fait demander comme une<br />
signification de ce nom en jouant sur ce « je suis ».<br />
La phrase est donc une réponse à la question de Moïse vue du côté de Dieu comme<br />
explication de son nom. En hébreu le verbe être n’est jamais la copule. Notre concept<br />
philosophique grec d’être naît de la copule. Beaucoup de langues ont des difficultés à<br />
traduire être.<br />
Ainsi la phrase « je suis qui je suis » peut être un refus de donner le nom. Mais peut aussi<br />
être « je suis celui que je suis » « je suis celui qui est présent ».<br />
Dieu comme signification de nom dit « je suis celui qui est présent ». Si Dieu dit « je suis celui<br />
qui est présent », les juifs disent de leur Dieu : « il est celui qui est présent » car ils parlent de<br />
lui à la troisième personne. Or cette formulation est la pseudo-éthymologie de YHWH.<br />
Quelle est la signification théologique du texte ?<br />
Ce texte démythise l’importance du nom du dieu. Ce n’est pas en soi important. YHWH, je<br />
suis là.<br />
Le monothéisme ne naît pas sur une spéculation sur les dieux qui en fait ne sont que la<br />
manifestation d’un seul Dieu. Aménophis IV n’était pas monothéiste car il se considérait<br />
comme un dieu ainsi que sa femme ; le monothéisme biblique naît comme expérience.<br />
1.3.3 Lecture d’Exode 14, le passage de la mer<br />
[1] Yahvé parla à Moïse et lui dit :<br />
[2] "Dis <strong>aux</strong> Israélites de rebrousser chemin et de camper devant Pi-Hahirot, entre Migdol et la mer,<br />
devant Baal-Cephôn ; vous camperez face à ce lieu, au bord de la mer.<br />
[3] Pharaon dira des Israélites : Les voilà qui errent dans le pays, le désert s'est refermé sur eux.<br />
[4] J'endurcirai le cœur de Pharaon et il se lancera à leur poursuite. Je me glorifierai <strong>aux</strong> dépens de<br />
Pharaon et de toute son armée, et les Egyptiens sauront que je suis Yahvé." C'est ce qu'ils firent.<br />
62
[5] Lorsqu'on annonça au roi d'Egypte que le peuple avait fui, le cœur de Pharaon et de ses serviteurs<br />
changea à l'égard du peuple. Ils dirent : "Qu'avons-nous fait là, de laisser Israël quitter notre service !"<br />
[6] Pharaon fit atteler son char et emmena son armée.<br />
[7] Il prit 600 des meilleurs chars et tous les chars d'Egypte, chacun d'eux monté par des officiers.<br />
[8] Yahvé endurcit le cœur de Pharaon, le roi d'Egypte, qui se lança à la poursuite des Israélites sortant<br />
la main haute.<br />
[9] Les Egyptiens se lancèrent à leur poursuite et les rejoignirent alors qu'ils campaient au bord de la<br />
mer - tous les chev<strong>aux</strong> de Pharaon, ses chars, ses cavaliers et son armée - près de Pi-Hahirot, devant<br />
Baal-Cephôn.<br />
[10] Comme Pharaon approchait, les Israélites levèrent les yeux, et voici que les Egyptiens les<br />
poursuivaient. Les Israélites eurent grand-peur et crièrent vers Yahvé.<br />
[11] Ils dirent à Moïse : "Manquait-il de tombe<strong>aux</strong> en Egypte, que tu nous aies menés mourir dans le<br />
désert ? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Egypte ?<br />
[12] Ne te disions-nous pas en Egypte : Laisse-nous servir les Egyptiens, car mieux vaut pour nous<br />
servir les Egyptiens que de mourir dans le désert ?"<br />
[13] Moïse dit au peuple : "Ne craignez pas ! Tenez ferme et vous verrez ce que Yahvé va faire pour<br />
vous sauver aujourd'hui, car les Egyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus<br />
jamais.<br />
[14] Yahvé combattra pour vous ; vous, vous n'aurez qu'à rester tranquilles."<br />
[15] Yahvé dit à Moïse : "Pourquoi cries-tu vers moi ? Dis <strong>aux</strong> Israélites de repartir.<br />
[16] Toi, lève ton bâton, étends ta main sur la mer et fends-la, que les Israélites puissent pénétrer à<br />
pied sec au milieu de la mer.<br />
[17] Moi, j'endurcirai le cœur des Egyptiens, ils pénétreront à leur suite et je me glorifierai <strong>aux</strong> dépens<br />
de Pharaon, de toute son armée, de ses chars et de ses cavaliers.<br />
[18] Les Egyptiens sauront que je suis Yahvé quand je me serai glorifié <strong>aux</strong> dépens de Pharaon, de ses<br />
chars et de ses cavaliers."<br />
[19] L'Ange de Dieu qui marchait en avant du camp d'Israël se déplaça et marcha derrière eux, et la<br />
colonne de nuée se déplaça de devant eux et se tint derrière eux.<br />
[20] Elle vint entre le camp des Egyptiens et le camp d'Israël. La nuée était ténébreuse et la nuit<br />
s'écoula sans que l'un puisse s'approcher de l'autre de toute la nuit.<br />
[21] Moïse étendit la main sur la mer, et Yahvé refoula la mer toute la nuit par un fort vent d'est ; il la<br />
mit à sec et toutes les e<strong>aux</strong> se fendirent.<br />
[22] Les Israélites pénétrèrent à pied sec au milieu de la mer, et les e<strong>aux</strong> leur formaient une muraille à<br />
droite et à gauche.<br />
[23] Les Egyptiens les poursuivirent, et tous les chev<strong>aux</strong> de Pharaon, ses chars et ses cavaliers<br />
pénétrèrent à leur suite au milieu de la mer.<br />
[24] A la veille du matin, Yahvé regarda de la colonne de feu et de nuée vers le camp des Egyptiens, et<br />
jeta la confusion dans le camp des Egyptiens.<br />
[25] Il enraya les roues de leurs chars qui n'avançaient plus qu'à grand-peine. Les Egyptiens dirent :<br />
"Fuyons devant Israël car Yahvé combat avec eux contre les Egyptiens !"<br />
[26] Yahvé dit à Moïse : "Etends ta main sur la mer, que les e<strong>aux</strong> refluent sur les Egyptiens, sur leurs<br />
chars et sur leurs cavaliers."<br />
[27] Moïse étendit la main sur la mer et, au point du jour, la mer rentra dans son lit. Les Egyptiens en<br />
fuyant la rencontrèrent, et Yahvé culbuta les Egyptiens au milieu de la mer.<br />
[28] Les e<strong>aux</strong> refluèrent et recouvrirent les chars et les cavaliers de toute l'armée de Pharaon, qui<br />
avaient pénétré derrière eux dans la mer. Il n'en resta pas un seul.<br />
[29] Les Israélites, eux, marchèrent à pied sec au milieu de la mer, et les e<strong>aux</strong> leur formèrent une<br />
muraille à droite et à gauche.<br />
[30] Ce jour-là, Yahvé sauva Israël des mains des Egyptiens, et Israël vit les Egyptiens morts au bord de<br />
la mer.<br />
[31] Israël vit la prouesse accomplie par Yahvé contre les Egyptiens. Le peuple craignit Yahvé, il crut en<br />
Yahvé et en Moïse son serviteur.<br />
63
Ce texte est celui où est le mieux visible la présence de plusieurs sources. De façon<br />
particulière dans des passages où l’on voit des tensions entre les morce<strong>aux</strong>. Le miracle de la<br />
mer est décrit de deux façons différentes.<br />
Verset 16 : « Toi, lève ton bâton, étends ta main sur la mer et fends-la, que les<br />
Israélites puissent pénétrer à pied sec au milieu de la mer ».<br />
V. 21 : « Moïse étendit la main sur la mer, et Yahvé refoula la mer toute la nuit par un<br />
fort vent d'est ; il la mit à sec et toutes les e<strong>aux</strong> se fendirent ».<br />
Il étend la main sur la mer, Dieu sèche la mer. Le début se poursuit à la fin du verset ; le<br />
centre est une autre source.<br />
Chapitre 13, 17 : Lorsque Pharaon eut laissé partir le peuple, Dieu ne lui fit pas prendre la route du pays des<br />
Philistins, bien qu'elle fût plus proche, car Dieu s'était dit qu'à la vue des combats le peuple pourrait se repentir et<br />
retourner en Egypte.<br />
Le pharaon laissa partir le peuple.<br />
Chapitre 14,5 : Lorsqu'on annonça au roi d'Egypte que le peuple avait fui, le cœur de Pharaon et de ses<br />
serviteurs changea à l'égard du peuple. Ils dirent : "Qu'avons-nous fait là, de laisser Israël quitter notre service !"<br />
Le peuple s’enfuit.<br />
Le but que Dieu donne au plan est de montrer sa gloire (14,4). Le pharaon se présente<br />
comme une espèce d’anti-dieu envers les hébreux par l’esclavage, le projet infanticide. Au<br />
milieu de cela il y a Israël qui n’est pas conscient et se plaint à Moïse. La fonction de Moïse<br />
est d’encourager les hébreux à s’enfiler dans le plan de Dieu (v.13).<br />
Le verset 15 créé une tension et le Seigneur demande « pourquoi cries tu vers moi ? » C’est<br />
une autre tension qui sans doute vient à l’origine des autres sources.<br />
Au verset 13 c’est le peuple qui crie vers Dieu et au verset 15 Dieu reproche à Moïse d’avoir<br />
crié vers lui. Le midrash note cela et se dit que Moïse aurait fait une prière qui n’est pas<br />
reporté dans le texte.<br />
Ici on voit comment travaille notre narrateur qui ne cherche pas à soigner les incongruités<br />
du texte. Il veut se fixer sur les différents personnages du texte.<br />
Moïse a confiance en Dieu, il ne connaît pas encore son plan et Dieu s’adressa à Moïse pour<br />
conforter les hébreux. Ensuite il donne à Moïse des éléments de son plan au verset 18. Dans<br />
64
ce verset apparaît le mot gloire qui est la marque d’identité du Sacerdotal. Le rédacteur a<br />
fait cette rédaction dans l’optique du Sacerdotal. Dieu veut faire sa gloire.<br />
Jusqu’au verset 18, le point focal est le contraste entre le plan de Dieu et celui du pharaon.<br />
Ce sont deux plans différents : le naturel et le surnaturel.<br />
D’un côté le plan de Dieu est annoncé à Moïse et exécuté par lui ; il est médiateur<br />
prophétique du plan de Dieu. D’autre part cependant l’autre manière est Dieu qui intervient<br />
directement sans la main de Moïse (le vent qui souffle toute la nuit), sans sa médiation. Ainsi<br />
l’auteur insère des parties plus anciennes dans la narration Sacerdotale.<br />
Soit Sacerdotal/Yahviste/Sacerdotal.<br />
Le point fort est lorsque les Egyptiens reconnaissent au verset 25 : Il enraya les roues de leurs<br />
chars qui n'avançaient plus qu'à grand-peine. Les Egyptiens dirent : "Fuyons devant Israël car<br />
Yahvé combat avec eux contre les Egyptiens !"<br />
Les versets 13 et 30 vont ensemble selon le schéma promesse/achèvement. Dieu promet<br />
quelque chose et à la fin on constate la promesse faite par Dieu.<br />
D’un côté il résulte donc que le texte est composite de diverses sources, mais l’état actuel du<br />
texte a son intégrité et n’est pas une simple récolte de fragments.<br />
La pensée de l’auteur du 18 ème 19 ème siècle :<br />
Certaines pensées modernes ont pensé à un phénomène de marée basse dans une région<br />
marécageuse. Ceci en extrapolant le Yahviste. « Le Seigneur souffla un fort vent … » et verset 25 « les<br />
roues s’enrayent…. ». C’est donc une simple marée. On peut penser au ramzin.<br />
L’autre texte est l’Elohiste réélaboré par le Sacerdotal qui introduit l’élément surnaturel : la mer taillée<br />
en deux comme une tarte à la crème (dixit le prof !).<br />
On a donc une interprétation selon laquelle l’aspect surnaturel est une intervention de Dieu ou bien<br />
c’est un phénomène naturel exagéré.<br />
Le problème : on divise le texte en deux. De plus le texte ne permet pas de faire cette<br />
lecture. Le Yahviste est lui-même loin de voir un évènement naturel. Les deux traditions. Les<br />
éléments extraordinaires sont fait par Moïse et les éléments ordinaires sont fait par Dieu.<br />
Diviser les deux textes est contraire à la tradition. Si il était vrai que le rédacteur voulait<br />
construire un récit transfigurant la tradition surnaturelle il aurait éliminé tout ce qui n’est<br />
pas naturel. Or il conserve les deux éléments en équilibre.<br />
65
Ici on a à faire avec des problèmes là où l’écriture témoigne d’irruption directe de Dieu dans<br />
l’histoire, on a des phénomènes d’incohérence scripturaire. Le texte est le témoignage<br />
historique que le transcendant entre dans le domaine historique.<br />
1.3.4 Ex 19-20 : Israël au Sinaï – Notes sur le code de l’alliance<br />
1.3.4.1 Lecture d’Exode 19<br />
[1] Le troisième mois après leur sortie du pays d'Egypte, ce jour-là, les Israélites atteignirent le désert<br />
du Sinaï.<br />
[2] Ils partirent de Rephidim et atteignirent le désert du Sinaï, et ils campèrent dans le désert ; Israël<br />
campa là, en face de la montagne.<br />
[3] Moïse alors monta vers Dieu. Yahvé l'appela de la montagne et lui dit : "Tu parleras ainsi à la<br />
maison de Jacob, tu déclareras <strong>aux</strong> Israélites :<br />
[4] Vous avez vu vous-mêmes ce que j'ai fait <strong>aux</strong> Egyptiens, et comment je vous ai emportés sur des<br />
ailes d'aigles et amenés vers moi.<br />
[5] Maintenant, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, je vous tiendrai pour mon bien propre<br />
parmi tous les peuples, car toute la terre est à moi.<br />
[6] Je vous tiendrai pour un royaume de prêtres, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras <strong>aux</strong><br />
Israélites."<br />
[7] Moïse alla et convoqua les anciens du peuple et leur exposa tout ce que Yahvé lui avait ordonné,<br />
[8] et le peuple entier, d'un commun accord, répondit : "Tout ce que Yahvé a dit, nous le ferons."<br />
Moïse rapporta à Yahvé les paroles du peuple.<br />
[9] Yahvé dit à Moïse : "Je vais venir à toi dans l'épaisseur de la nuée, afin que le peuple entende<br />
quand je parlerai avec toi et croie en toi pour toujours." Et Moïse rapporta à Yahvé les paroles du<br />
peuple.<br />
[10] Yahvé dit à Moïse : "Va trouver le peuple et fais-le se sanctifier aujourd'hui et demain ; qu'ils<br />
lavent leurs vêtements<br />
[11] et se tiennent prêts pour après-demain, car après-demain Yahvé descendra <strong>aux</strong> yeux de tout le<br />
peuple sur la montagne du Sinaï.<br />
[12] Puis délimite le pourtour de la montagne et dis : Gardez-vous de gravir la montagne et même d'en<br />
toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera mis à mort.<br />
[13] Personne ne portera la main sur lui ; il sera lapidé ou percé de flèches, homme ou bête, il ne vivra<br />
pas. Quand la corne de bélier mugira, eux graviront la montagne."<br />
[14] Moïse descendit de la montagne et vint trouver le peuple qu'il fit se sanctifier, et ils lavèrent leurs<br />
vêtements.<br />
[15] Puis il dit au peuple : "Tenez-vous prêts pour après-demain, ne vous approchez pas de la femme.<br />
[16] Or le surlendemain, dès le matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée<br />
sur la montagne, ainsi qu'un très puissant son de trompe et, dans le camp, tout le peuple trembla.<br />
[17] Moïse fit sortir le peuple du camp, à la rencontre de Dieu, et ils se tinrent au bas de la montagne.<br />
[18] Or la montagne du Sinaï était toute fumante, parce que Yahvé y était descendu dans le feu ; la<br />
fumée s'en élevait comme d'une fournaise et toute la montagne tremblait violemment.<br />
[19] Le son de trompe allait en s'amplifiant ; Moïse parlait et Dieu lui répondait dans le tonnerre.<br />
[20] Yahvé descendit sur la montagne du Sinaï, au sommet de la montagne. Yahvé appela Moïse au<br />
sommet de la montagne et Moïse monta.<br />
[21] Yahvé dit à Moïse : "Descends et avertis le peuple de ne pas franchir les limites pour venir voir<br />
Yahvé, car beaucoup d'entre eux périraient.<br />
[22] Même les prêtres qui approchent Yahvé doivent se sanctifier de peur que Yahvé ne se déchaîne<br />
contre eux."<br />
[23] Moïse dit à Yahvé : "Le peuple ne peut pas gravir la montagne du Sinaï puisque toi-même tu nous<br />
as avertis : délimite la montagne et déclare-la sacrée."<br />
[24] Yahvé reprit : "Allons, descends et remontez, toi et Aaron. Mais que les prêtres et le peuple ne<br />
franchissent pas les limites pour monter vers Yahvé, de peur qu'il ne se déchaîne contre eux."<br />
[25] Moïse descendit alors vers le peuple et lui dit...<br />
66
Ce texte a donné beaucoup de problèmes parce que l’on y voit beaucoup d’incongruités :<br />
Aux versets 10 à 19 Moïse est avec le peuple alors que de 20 à 25 il est seul.<br />
Au verset 18 on nous dit que Dieu est déjà descendu sur le Sinaï et au verset 20 on nous dit<br />
que le Seigneur descend sur le mont Sinaï. Tout ce va et vient de Moïse sur ce mont semble<br />
peu clair. Il semble que dans certains cas Dieu habite sur le mont : v.3. Or c’est en<br />
contradiction avec ce qui est dit ensuite qu’il descend : v. 20.<br />
Les phénomènes de la théophanie :<br />
Verset 16 : la théophanie semble être un orage de montagne (Elohiste) ; alors qu’au verset<br />
18 ce serait plutôt une irruption volcanique (Yahviste).<br />
Si c’était effectivement une irruption, ce ne peut pas être là qu’à eu lieu la théophanie, mais<br />
en Arabie où se trouve une zone volcanique. L’identification du Sinaï est en plus douteuse<br />
donc ceci ne fait qu’en rajouter. Or ici nous sommes dans la description d’un phénomène<br />
extraordinaire qu’il est difficile de décrire. La description par des phénomènes naturels est<br />
purement rationaliste.<br />
Verset 12 à 21 : Dieu dit deux fois que le peuple ne doit pas s’hasarder à monter sur la<br />
montagne. Le rôle et la fonction de Moïse ne sont pas totalement identiques. En Exode<br />
20,18-20 (Elohiste), l’office de médiation de Moïse provient de la peur du peuple alors que la<br />
théophanie originaire est adressée à tous. Ainsi au verset 19 le peuple préfère envoyer<br />
Moïse en avant parce qu’ils ont peur de Dieu. Alors qu’en Exode 19,9 (Jahviste) nous avons<br />
une idée différente : l’idée que le peuple entende la parole donnée à Moïse, c’est Dieu qui<br />
veut qu’ils écoutent afin qu’ils sache que Moïse est le médiateur. Ainsi dans un cas c’est Dieu<br />
qui établie Moïse comme médiateur, dans l’autre cas, c’est la peur qui pousse le peuple à<br />
mettre Moïse en avant.<br />
La première conception du peuple qui met en avant Moïse est Elohiste et la deuxième serait<br />
Yahviste. Mais ici encore on voit que les deux traditions sont très proches l’une de l’autre.<br />
On pense donc à une tradition orale qui a uni deux récits originairement indépendants bien<br />
avant une fixation écrite. On voit deux sources différentes, mais le texte n’en est pas<br />
contradictoire pour autant. Il est facile de suivre et de comprendre. A la fin le résultat est là :<br />
le peuple a entendu la voix et met Moïse en avant.<br />
67
Sur l’origine de ses deux traditions, la première (peut-être) de caractère plus prophétique et<br />
l’autre avec des caractères plus Sacerdotales (non pas pourtant dans le sens d’une majeure<br />
affinité à P), en tout cas ce qui est sûr c’est que les deux sont d’origine cultuelle et qu’elles<br />
sont très antiques.<br />
Peut-être est-ce encore un schéma promesse/parole.<br />
La première a plus une image prophétique où Moïse est le médiateur entre Dieu et le<br />
peuple et fait connaître les désirs de Dieu.<br />
Dans le deuxième cas c’est plus Sacerdotal : Moïse est le médiateur qui connaît la<br />
technique pour s’approcher du sacré sans provoquer des désastres. Le prêtre connaît<br />
la technique de médiation adéquate pour passer la frontière entre le sacré et le<br />
profane et les faire se rencontrer sans danger.<br />
Cependant il n’y a aucune doctrine de pureté et donc on ne pense pas à une influence<br />
Sacerdotale. De plus, le culte n’est pas opposé, le prophétisme est un élément du culte.<br />
Nous sommes donc dans le cas de textes nés pour la réactualisation de cet évènement. Le<br />
Deutéronome présente aussi ces deux traditions en divers contenus.<br />
Trois points :<br />
Deut 5,4-5 : « [4] Sur la montagne, au milieu du feu, Yahvé vous a parlé face à face, [5] et moi je me tenais<br />
alors entre Yahvé et vous pour vous faire connaître la parole de Yahvé ; car, craignant le feu, vous n'étiez pas<br />
montés sur la montagne ».<br />
1. La sainteté d’Israël,<br />
2. Le rôle médiateur de Moïse<br />
3. Les terrifiantes conséquences de la rencontre indiscrète entre L’homme et Dieu : là<br />
où Dieu se trouve il ne peut pas y avoir l’homme et vice versa.<br />
Structure des versets 9-25 en deux unités littéraires 9-19 et 20-25<br />
(Monseigneur Enrico Galbiati publie une structuration ante litteram. Son livre : La struttura letteraria<br />
dell’Esodo, Alba 1956, pp. 176-185)<br />
V.9-19 :<br />
A. 9a : annonce de la prochaine venue du Seigneur dans la nuée.<br />
B. 9b : information de Moïse qui réfère la parole du peuple.<br />
C. 10-11 : ordre de préparer le peuple à la théophanie du 3 ème jour.<br />
Centre 12-13 : les dispositions pour tenir éloigné le peuple du mont.<br />
C’. 14-16 : exécution de l’ordre : description de la théophanie.<br />
B’ 17 : information, Moïse conduit le peuple vers le mont.<br />
A’ 18-19 : la vérification de ce qui a été révélé au verset 9a.<br />
68
V.20-25 :<br />
A. 20 : information, Dieu appelle Moïse à monter sur le mont.<br />
B. 21-22 : ordre de descendre pour entretenir le peuple.<br />
Centre 23 : objection de Moïse.<br />
B’ 24 : Dieu ordonne de descendre et entretenir le peuple.<br />
A’ 25 : information, Moïse descend du mont.<br />
Les deux passages sont bien liés entre eux et il y a un lien entre les deux centres où les<br />
dispositions sont données et où il y a une objection.<br />
Les v 22 et 24 sont les développements des menaces du passage précédant.<br />
Au verset 13 c’est une peine de mort par main humaine alors qu’en v 24-25 la peine vient de<br />
Dieu lui-même.<br />
Les versets 20 à 25 ont souvent été considérés comme secondaire en tant que répétition<br />
inutile de ce qui a été dit auparavant. L’ordre de Dieu à Moïse étonne tout le monde dont<br />
Moïse lui-même et Dieu répète ses ordres. Il en est contraint parce que ni Moïse ni le peuple<br />
n’ont une expérience aussi concrète de Dieu.<br />
1.3.4.2 Lecture d’Exode 20 : le Décalogue<br />
[1] Dieu prononça toutes ces paroles, et dit :<br />
[2] "Je suis Yahvé, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Egypte, de la maison de servitude.<br />
[3] Tu n'auras pas d'autres dieux devant moi.<br />
[4] Tu ne te feras aucune image sculptée, rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux, là-haut, ou sur<br />
la terre, ici-bas, ou dans les e<strong>aux</strong>, au-dessous de la terre.<br />
[5] Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux et tu ne les serviras pas, car moi Yahvé, ton Dieu, je suis<br />
un Dieu jaloux qui punis la faute des pères sur les enfants, les petits-enfants et les arrière-petitsenfants<br />
pour ceux qui me haïssent,<br />
[6] mais qui fais grâce à des milliers pour ceux qui m'aiment et gardent mes commandements.<br />
[7] Tu ne prononceras pas le nom de Yahvé ton Dieu à f<strong>aux</strong>, car Yahvé ne laisse pas impuni celui qui<br />
prononce son nom à f<strong>aux</strong>.<br />
[8] Tu te souviendras du jour du sabbat pour le sanctifier.<br />
[9] Pendant six jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage ;<br />
[10] mais le septième jour est un sabbat pour Yahvé ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, toi, ni ton<br />
fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes.<br />
[11] Car en six jours Yahvé a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, mais il s'est reposé<br />
le septième jour, c'est pourquoi Yahvé a béni le jour du sabbat et l'a consacré.<br />
[12] Honore ton père et ta mère, afin que se prolongent tes jours sur la terre que te donne Yahvé ton<br />
Dieu.<br />
[13] Tu ne tueras pas.<br />
[14] Tu ne commettras pas d'adultère.<br />
[15] Tu ne voleras pas.<br />
[16] Tu ne porteras pas de témoignage mensonger contre ton prochain.<br />
[17] Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain,<br />
ni son serviteur, ni sa servante, ni son boeuf, ni son âne, rien de ce qui est à ton prochain."<br />
Telles sont les paroles de Dieu présentées de façon très solennelle.<br />
Dans l’Exode on parle de table de Pierre.<br />
69
On les appelle les 10 Paroles en Deut 4,13 et 9,9. Ce sont des communications immédiates<br />
de Dieu et non pas des affirmations arbitraire de Dieu. C’est la directe parole de Dieu, celle<br />
qui génère de la terreur. C’est le document pas excellence entre Dieu et son peuple. Ces<br />
paroles sont un unicum. 19,25 Moïse descend et parle et Dieu<br />
Exode 20,2-17 : le décalogue est l’ensemble des paroles directement adressée par Dieu.<br />
C’est le premier code législatif. Ainsi le décalogue forme le cadre de compréhension des lois<br />
du Pentateuque.<br />
La proclamation du décalogue : théophanie du Sinaï et lors de la proclamation par Moïse<br />
dans les steppes de Moab avant le passage du Jourdain et avant l’entrée en terre promise.<br />
Le décalogue ouvre l’Exode et le ferme.<br />
Voici la version du Deutéronome :<br />
Deut 5,6-21 :<br />
[6] "Je suis Yahvé ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Egypte, de la maison de servitude.<br />
[7] "Tu n'auras pas d'autres dieux devant moi.<br />
[8] "Tu ne te feras aucune image sculptée de rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux là-haut, ou<br />
sur la terre ici-bas, ou dans les e<strong>aux</strong> au-dessous de la terre.<br />
[9] Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux ni ne les serviras. Car moi, Yahvé, ton Dieu, je suis un<br />
Dieu jaloux, qui punis la faute des pères sur les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants,<br />
pour ceux qui me haïssent,<br />
[10] mais qui fais grâce à des milliers, pour ceux qui m'aiment et gardent mes commandements.<br />
[11] "Tu ne prononceras pas le nom de Yahvé ton Dieu à f<strong>aux</strong>, car Yahvé ne laisse pas impuni celui qui<br />
prononce son nom à f<strong>aux</strong>.<br />
[12] "Observe le jour du sabbat pour le sanctifier, comme te l'a commandé Yahvé, ton Dieu.<br />
[13] Pendant six jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage,<br />
[14] mais le septième jour est un sabbat pour Yahvé ton Dieu. Tu n'y feras aucun ouvrage, toi, ni ton<br />
fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton boeuf, ni ton âne ni aucune de tes bêtes, ni<br />
l'étranger qui est dans tes portes. Ainsi comme toi-même, ton serviteur et ta servante pourront se<br />
reposer.<br />
[15] Tu te souviendras que tu as été en servitude au pays d'Egypte et que Yahvé ton Dieu t'en a fait<br />
sortir d'une main forte et d'un bras étendu ; c'est pourquoi Yahvé ton Dieu t'a commandé de garder le<br />
jour du sabbat.<br />
[16] "Honore ton père et ta mère, comme te l'a commandé Yahvé ton Dieu, afin que se prolongent tes<br />
jours et que tu sois heureux sur la terre que Yahvé ton Dieu te donne.<br />
[17] "Tu ne tueras pas.<br />
[18] "Tu ne commettras pas l'adultère.<br />
[19] "Tu ne voleras pas.<br />
[20] "Tu ne porteras pas de f<strong>aux</strong> témoignage contre ton prochain.<br />
[21] "Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu ne désireras ni sa maison, ni son champ, ni<br />
son serviteur ou sa servante, ni son boeuf ou son âne : rien de ce qui est à ton prochain."<br />
Le décalogue n’est pas l’unique liste de lois dans la torah. Mais c’est la seule de 10 lois.<br />
Ex 34,14-26 : série de 10 commandements.<br />
70
Pourquoi le décalogue s’appelle t-il ainsi ?<br />
Quelle est la systématique ?<br />
Combien sont-ils ? Plus de 10 en tout cas.<br />
Dans la tradition catholique :<br />
1. Monothéisme<br />
2. Nom de Dieu<br />
3. Jour du Seigneur<br />
4. Amour du prochain<br />
5. Ne pas tuer<br />
6. Ne pas avoir de désir impur<br />
7. Ne pas voler<br />
8. Ne pas porter de f<strong>aux</strong> témoignages<br />
9. Ne pas désirer la femme d’autrui<br />
10. Ne pas désirer le bien d’autrui<br />
Dans la tradition juive :<br />
1. Monothéisme<br />
2. Exclusion des images<br />
3. Le respect du nom de Dieu<br />
4. le shabbat<br />
5. honorer père et mère<br />
6. ne pas tuer<br />
7. ne pas commettre adultère<br />
8. ne pas voler<br />
9. ne pas dire de f<strong>aux</strong> témoignage<br />
10. ne pas désirer la femme et le bien<br />
d’autrui<br />
Comment concilier cette idée des 10 paroles avec ces 10 paroles ? On peut penser que 10<br />
indique la totalité et donc que c’est un symbole. L’expression des 10 paroles n’est pas le seul<br />
titre. La Bible témoigne d’un autre titre en Ex 18,38 : les deux tables.<br />
Y a-t-il 5 paroles sur chaque table ? Selon notre tradition il y en aurait 3 et 7 : 3 sur l’amour<br />
du Seigneur et les autres sur l’amour du prochain. Mais c’est une théorie. Le problème en<br />
réalité est que ce document est imaginé comme légal et donc il est copié en deux fois et une<br />
copie est posée <strong>aux</strong> pieds de chaque contracteur. Dans l’antiquité on écrivait avec une table<br />
scripturaire de pierre petite, blanchie à la ch<strong>aux</strong> et on écrivait avec une plume chauffée. On<br />
écrivait deux fois ce document.<br />
Le problème de la date du décalogue.<br />
Il y a eu beaucoup de réponses sur l’époque de rédaction : de l’époque antique à la période<br />
exilique et postexilique. Il est difficile dire quel est le lien entre le texte et la personne de<br />
Moïse. D’un point de vue étroitement historique on ne peut pas préciser le lien avec Moïse<br />
parce qu’il y a des siècles entre Moïse et la rédaction du texte. Dans les derniers temps on a<br />
71
pensé à une date ancienne. Ce consensus est basé sur divers facteurs. La manière avec<br />
laquelle s’exprime le décalogue rappelle les formes de loi les plus anciennes du bassin<br />
méditerranéen. En tout cas le décalogue devait avoir à l’origine un contexte cultuel ; une<br />
bonne partie de lui se pose sur un fond d’homogénéité.<br />
La question par rapport à une forme originaire du Décalogue reste inconclue. En tout cas on<br />
parle d’une longue histoire rédactionnelle ; peut-être que l’hypothèse de ce qui est bref est<br />
plus ancien s’avère vrai et donc les formules brèves du cœur seraient plus proches des textes<br />
anciens.<br />
Selon la tradition exégétique (à laquelle ne croit pas Paximadi), la formulation de Exode 20<br />
est Sacerdotale parce que plus récente, et le Sacerdotal est plus récent.<br />
Mais d’où vient-il avant étant donné qu’il subsiste en deux traditions ? La tradition sinaïtique<br />
est plus importante dans la tradition religieuse du nord que dans le sud. Ainsi vu que la<br />
tradition du nord est l’Elohiste.<br />
La seule chose que l’on peut dire : le décalogue dérive d’une source plus ancienne dans<br />
laquelle on a inséré du matériel du Deutéronome.<br />
La deuxième chose est que cette source plus ancienne avait un sitz im leben plus cultuel.<br />
Möwinckel (de la première moitié du dernier siècle) pense à une fête d’intronisation du<br />
Seigneur comme renouvellement de l’alliance. Cette théorie eut du succès puis non puis<br />
encore….<br />
Structure du passage selon Mey<strong>net</strong> :<br />
A : 2-7 : 6 verbes négatifs ; ton dieu – maison – en vain<br />
B : 8-11 : rappelle-toi – YHWH ton Dieu – jour<br />
Parce que<br />
B’ : v 12 : honore – le Seigneur ton Dieu – jour<br />
Parce que<br />
A’ : 13-17 : 6 verbes négatifs ; ton prochain – maison – faussement<br />
On peut donc voir que la structure est une sorte de miroir. Entre les verbes négatifs, il y a<br />
deux verbes positifs qui concernent le shabbat et les parents. On peut remarquer une<br />
différence par rapport à la promulgation de la loi en fonction des livres:<br />
Ex 20 : le shabbat et un rappel de la création<br />
72
Deut 5 : le shabbat rappelle l’Exode.<br />
Dans le premier cas, l’Exode est à peine vécue. Sur le Sinaï Moïse recevra comment doit être<br />
construit le tabernacle. Le centre de ce livre est le tabernacle. Le tabernacle est un peu<br />
comme le sommet de la création. C’est un peu comme un micro-cosmos une création en<br />
petit.<br />
En Deut 5 : c’est le début du discours de Moïse dans les steppes de Moab. Les discours<br />
d’adieu dans les steppes. Ils ont passé 40 ans dans ses steppes, une génération est morte et<br />
Moïse répète le décalogue avant l’entrée en terre promise pour renouveler l’alliance.<br />
Le décalogue est donc vécu d’abord lorsque les juifs ont tout juste passé la mer rouge, et<br />
après les juifs vont passer le Jourdain, d’où ce choix du rédacteur.<br />
La centralité du shabbat est importante. C’est un peu le moment, l’espace de temps<br />
consacré dans lequel l’homme ne peut pas agir parce qu’un autre agit, Dieu. Il agit dans la<br />
création et dans l’histoire d’Israël. Pour la théologie Sacerdotale, le shabbat est la médiation<br />
entre Dieu et le monde, c’est quelque chose qui précède. C’est un aspect de la création<br />
autonome. Le calendrier est venu avec la création du monde et le shabbat tout<br />
particulièrement. Par là on reconnaît l’action unique de Dieu dans le monde. C’est donc un<br />
entrer en communion avec cette action, c’est une possibilité d’entrer en communication<br />
avec l’origine.<br />
De façon analogue, parmi tous les liens famili<strong>aux</strong>, les liens avec les parents sont un lien<br />
unique avec l’origine. Il n’y a qu’un père et qu’un mère. L’unicité du père et de la mère.<br />
Quelle est la conséquence que le texte tire du commandement sur le shabbat ? Le<br />
commandement s’adresse au Père de famille en le chargeant d’une œuvre de libération :<br />
libération du travail pour lui-même et y compris pour l’esclave et les anim<strong>aux</strong>. Ensuite pour<br />
les parents, le commandement s’adresse <strong>aux</strong> enfants. Le tout est enraciné dans la mémoire<br />
de l’Exode.<br />
L’accent est celui de l’origine qui œuvre pour la libération : le père libère du travail et les<br />
enfants reconnaissent cela. De cette liberté dérive une responsabilité. Il est nécessaire<br />
d’honorer Dieu et son prochain. On honore Dieu, en respectant, en honorant son nom, on<br />
respecte le prochain en évitant le mensonge (le blasphème est un mensonge et un sacrilège)<br />
souvent le mensonge est un f<strong>aux</strong> jurement et donc j’instrumentalise le prochain et j’insulte<br />
le nom de Dieu. À ceci ensuite le mensonge et le nom de Dieu sont liés. Israël a reçu le nom<br />
de Dieu.<br />
73
Dans le deuxième versant du texte, l’homme doit respecter la vie et liberté de l’autre.<br />
Au commandement sur l’exclusion de l’adultère ou l’idolâtrie. L’adultère est l’expression de<br />
l’idolâtrie.<br />
Il faut aussi noter que le décalogue contient des préceptes qui regardent le complexe de la<br />
vie humaine. Ceci est caractéristique. Ces commandements sont donnés au moment où<br />
Israël devient la communauté sainte, c'est-à-dire au moment où Dieu fait d’Israël son<br />
peuple, sa nation, celle qu’il se choisit. En ce moment Israël ne reçoit pas une loi qui le<br />
limite, qui en marque le limites, mais qui montre les bases de la caractéristique humaine.<br />
Les lois sacrales délimiteront Israël comme peuple saint. Mais ici il n’y a pas de lois sacrales,<br />
les 10 commandements qui ne sont pas des lois sacrales, sont humaines, mais pas pour<br />
autant naturelles parce que le décalogue est le document de l’alliance du fait que le peuple<br />
entre en contact avec Dieu. C’est le document écris de l’alliance. « Je suis le seigneur ton<br />
Dieu ». Le but est de montrer quels sont les rapports salvifique entre Dieu et son Peuple. Le<br />
décalogue est comme mettre la balle dans le camps d’Israël : maintenant tu dois<br />
correspondre au rapport avec moi pour continuer avec moi.<br />
Il ne faut pas se prosterner devant d’autres dieux est parce que Dieu est jaloux : c’est un<br />
unicum dans l’histoire des religions, aucun autre dieu ne se présente comme intolérant.<br />
C’est la route vers le monothéisme ; le décalogue est donc l’expression de cette intolérance<br />
de Dieu. C’est une déclaration d’amour fougueuse.<br />
.<br />
Ex 20,22 à Ex 23,36 : le texte législatif donné à Moïse de l’alliance.<br />
Ex 24,7 il est appelé livre de l’alliance : il est lu par Moïse devant le peule au moment<br />
du sacrifice de l’alliance.<br />
Comment est structuré ce code ?<br />
Il y a une subdivision de Ex 21,1 qui fini en Ex 22,17 c’est la section des Mispatim en effet en<br />
Ex 21,1 on trouve : « Voici les lois [mispatim] que tu leur donneras » ; ce sont des normes. Le<br />
style de cette section est casuistique.<br />
On peut reconnaître la différence entre des lois casuistiques et des lois apodictiques. Les lois<br />
casuistiques se présentent comme solution d’un cas concret. Les lois apodictiques au<br />
contraire se trouvent dans le bassin oriental, surtout dans les document d’alliance : elles<br />
sont plus générales et regardent le droit sacré.<br />
74
La partie de Ex 20,3-23.33 est caractéristique par les malédictions et bénédictions. C’est en<br />
parallèle avec la fin du Deutéronome. Les lois apodictiques réclament un sitz im leben de<br />
type cultuel caractérisé par un type de l’alliance.<br />
Ex 20,24 : « Tu me feras un autel de terre sur quoi immoler tes holocaustes et tes sacrifices de<br />
communion, ton petit et ton gros bétail. En tout lieu où je rappellerai mon nom, je viendrai à<br />
toi et je te bénirai ».<br />
On souligne le lieu où il faut se souvenir de son nom. Mais il n’y a pas encore une<br />
centralisation du lieu de culte. Ces lois cultuelles apodictiques interdisent la profanation du<br />
nom de Dieu, la licence sexuelle (20,26 : « Et tu ne monteras pas à mon autel par des<br />
marches pour n'y pas laisser voir ta nudité »), l’idolâtrie. Par rapport à l’époque de ces textes<br />
on ne peut pas dire grand-chose. En tout cas cela regarde une population qui n’est plus<br />
nomade. Ce n’est plus l’Israël de kadèsh barmé. On ne peut pas exclure en ces textes du<br />
matériel antique.<br />
On ne voit jamais de ville, ce n’est pas une population urbaine. Le premier sujet est l’homme<br />
(ish), quelques fois on parle de baal ou patron, le chef de famille. Il s’agit d’une législation<br />
patriarcale. L’état est le clan, le père de famille. Voilà les choses que l’on peut dire par<br />
rapport à l’époque. Ceci a été fait avant le code Deutéronomiste. Le matériel a été fusionné<br />
par le rédacteur : sans doute il y avait d’abord une narration de l’évènement du Sinaï dans<br />
lesquelles étaient inséré les lois apodictiques. Ensuite, des mispatim ont pu être insérées<br />
lorsque l’on désirait présenter les antiques collections de façon plus adéquate avec la<br />
théologie de l’alliance. Ces collections ont été recollées au Sinaï parce que Israël n’a pas de<br />
législateur et on insère ces lois dans le Sinaï pour donner un lien. L’autorité est donnée à<br />
Dieu. Lorsque cette opération a été faite, c’était peut-être l’époque des tribus du livre des<br />
juges. Ce n’était pas encore un état.<br />
Les mispatim ne sont pas un droit cultuel sacral. Il ne faut pas considérer le code de l’alliance<br />
hors de cela.<br />
Décalogue puis ces lois apodictiques. Les mispatim sont insérés en un deuxième moment. La<br />
vie d’Israël provient toujours de l’alliance. Il n’y a pas d’ordre logique.<br />
Les 9 sections :<br />
1. 20,22-26 : lois sur l’autel<br />
2. 21,1-11 : la loi sur l’esclavage (on entre en 21,1 dans les mispatim)<br />
3. 21,12-17 : lois sur les délits capit<strong>aux</strong><br />
75
4. 21,18-36 : lois avec les lésions personnelles<br />
5. 21,37-22,16 : lois sur les dommages à la propriété.<br />
6. 22,17-30 : dispositions cultuelles et morales<br />
7. 23,1-9 : procédures judiciaires<br />
8. 23,10-19 : calendrier cultuel<br />
9. 23,20-33 : exhortatif parénétique avec les bénédictions et malédictions.<br />
Du point de vue de la disposition, ce n’est pas totalement au hasard.<br />
La loi sur l’autel et le calendrier sont des corniches de sections.<br />
De 21,1 à 22,16 : série de mispatim sur les rapports interpersonnels<br />
22,17-23,9 : lois apodictiques et les sanctions ne sont pas nommées de façon<br />
systématiques. Elles regardent l’attitude face à Dieu ; elles regardent le for interne si<br />
on veut. Le pouvoir public ne peut pas imposer une moralité.<br />
Le code de l’alliance montre une familiarité avec les traditions légales du moyen orient.<br />
Le plus grand cas est celui du bœuf qui encorne. Nous trouvons cela dans le code<br />
d’Amourapi au § 250-252 et Ex 21,28-31. C’est un délit de sang.<br />
Le code d’Amourapi parle de rendre sous forme pécuniaire.<br />
Mais c’est la même formulation que le code. Ces observations font faire l’hypothèse qu’il y<br />
ait des gens dédiés <strong>aux</strong> études légales. Cette tradition légale est observée. Ce qui change<br />
c’est le cadre. La théologie de l’alliance et les décrets des rois<br />
1.3.5 Le code Sacerdotal (Ex ; Lv ; Nb)<br />
L’autre grand texte est le code Sacerdotal. Mais tout affronter dans les détails serait long.<br />
Avec les chapitres 25 à 31 de l’Exode nous entrons dans le cœur du Sacerdotal.<br />
Lorsque Moïse monte sur le mont il reçoit les indications pour le tabernacle dont le cœur<br />
sera l’arche de l’alliance qui conservera les tables de l’alliance qui rapportent le décalogue.<br />
Au chapitre 25 de l’Exode il reçoit des indications sur les 4 objets :<br />
1. Arche de l’alliance,<br />
2. son Propitiatoire (kapporet qui signifie couvrir, couvercle, mais c’est aussi le lieu où<br />
se déroule le rite de la propitiation d’où le nom de propitiatoire selon la LXX qui<br />
l’appelle ),<br />
76
3. la Ménorah<br />
4. la Table des pains d’offrande.<br />
Au verset 22 : « C'est là que je te rencontrerai. C'est de sur le propitiatoire, d'entre les deux chérubins qui<br />
sont sur l'arche du Témoignage, que je te donnerai mes ordres pour les Israélites »<br />
Parallèle en 29,45 : « Je demeurerai au milieu des Israélites et je serai leur Dieu »<br />
Le tabernacle :<br />
La Torah interdit de porter des vêtements composés de deux matéri<strong>aux</strong> pace que c’est<br />
sacré ; or le seul tissu que l’on peut tisser est la laine. Aussi, ce que l’on appelle la pourpre<br />
est le lin.<br />
Il y a une première tente de lin et une deuxième à l’intérieur de la première. La tente du<br />
centre est divisée en deux parties non égales : dans la première partie se trouve la table des<br />
pains d’offrande, la Ménorah et l’autel des encens ; dans la deuxième partie se trouve le<br />
Saint des Saints qui contient l’arche de l’alliance. Dans l’espace entre la première tente et la<br />
deuxième se trouvent l’autel des sacrifices et la vasque des ablutions pour les prêtres.<br />
Les deux Chérubins sont deux sphinx et non pas des anges comme on peut le penser. Ils<br />
protègent la partie centrale. Au dehors il y a la vasque d’eau de purification et l’autel de<br />
bronze des holocaustes.<br />
On voit donc une ressemblance entre les cultes d’Israël et les peuples d’autours.<br />
77
1.3.5.1 Lecture de Exode 25<br />
[1] Yahvé parla à Moïse et lui dit :<br />
[2] "Dis <strong>aux</strong> Israélites de prélever pour moi une contribution. Vous prendrez la contribution de tous ceux<br />
que leur cœur incite.<br />
[3] Et voici la contribution que vous accepterez d'eux : de l'or, de l'argent et du bronze ;<br />
[4] de la pourpre violette et écarlate, du cramoisi, du lin fin et du poil de chèvre ;<br />
[5] des pe<strong>aux</strong> de béliers teintes en rouge, du cuir fin et du bois d'acacia ;<br />
[6] de l'huile pour le luminaire, des aromates pour l'huile d'onction et l'encens aromatique ;<br />
[7] des pierres de cornaline et des pierres à enchâsser dans l'éphod et le pectoral.<br />
[8] Fais-moi un sanctuaire, que je puisse résider parmi eux.<br />
[9] Tu feras tout selon le modèle de la Demeure et le modèle de son mobilier que je vais te montrer.<br />
[10] "Tu feras en bois d'acacia une arche longue de deux coudées et demie, large d'une coudée et demie et<br />
haute d'une coudée et demie.<br />
[11] Tu la plaqueras d'or pur, au-dedans et au-dehors, et tu feras sur elle une moulure d'or, tout autour.<br />
[12] Tu fondras pour elle quatre anne<strong>aux</strong> d'or, et tu les mettras à ses quatre pieds : deux anne<strong>aux</strong> d'un<br />
côté et deux anne<strong>aux</strong> de l'autre.<br />
[13] Tu feras aussi des barres en bois d'acacia ; tu les plaqueras d'or,<br />
[14] et tu engageras dans les anne<strong>aux</strong> fixés sur les côtés de l'arche les barres qui serviront à la porter.<br />
[15] Les barres resteront dans les anne<strong>aux</strong> de l'arche et n'en seront pas ôtées.<br />
[16] Tu mettras dans l'arche le Témoignage que je te donnerai.<br />
[17] Tu feras aussi un propitiatoire d'or pur, de deux coudées et demie de long et d'une coudée et demie<br />
de large.<br />
[18] Tu feras deux chérubins d'or repoussé, tu les feras <strong>aux</strong> deux extrémités du propitiatoire.<br />
[19] Fais l'un des chérubins à une extrémité et l'autre chérubin à l'autre extrémité : tu feras les chérubins<br />
faisant corps avec le propitiatoire, à ses deux extrémités.<br />
[20] Les chérubins auront les ailes déployées vers le haut et protégeront le propitiatoire de leurs ailes en se<br />
faisant face. Les faces des chérubins seront tournées vers le propitiatoire.<br />
[21] Tu mettras le propitiatoire sur le dessus de l'arche, et tu mettras dans l'arche le Témoignage que je te<br />
donnerai.<br />
[22] C'est là que je te rencontrerai. C'est de sur le propitiatoire, d'entre les deux chérubins qui sont sur<br />
l'arche du Témoignage, que je te donnerai mes ordres pour les Israélites.<br />
[23] "Tu feras une table en bois d'acacia, longue de deux coudées, large d'une coudée et haute d'une<br />
coudée et demie.<br />
[24] Tu la plaqueras d'or pur, et tu lui feras tout autour une moulure d'or.<br />
[25] Tout autour, tu lui feras des entretoises larges d'une palme, et tu feras autour des entretoises une<br />
moulure d'or.<br />
[26] Tu lui feras quatre anne<strong>aux</strong> d'or, et tu mettras les anne<strong>aux</strong> <strong>aux</strong> quatre angles formés par les quatre<br />
pieds.<br />
[27] Les anne<strong>aux</strong> seront placés près des entretoises pour loger les barres qui serviront à porter la table.<br />
[28] Tu feras les barres en bois d'acacia et tu les plaqueras d'or ; elles serviront à porter la table.<br />
[29] Tu feras ses plats, ses coupes, ses aiguières ainsi que ses bols pour les libations ; c'est d'or pur que tu<br />
les feras,<br />
[30] et tu placeras toujours sur la table, devant moi, les pains d'oblation.<br />
[31] Tu feras un candélabre d'or pur ; le candélabre, sa base et son fût seront repoussés ; ses calices,<br />
boutons et fleurs feront corps avec lui.<br />
[32] Six branches s'en détacheront sur les côtés : trois branches du candélabre d'un côté, trois branches du<br />
candélabre de l'autre côté.<br />
[33] La première branche portera trois calices en forme de fleur d'amandier, avec bouton et fleur ; la<br />
deuxième branche portera aussi trois calices en forme de fleur d'amandier, avec bouton et fleur ; il en sera<br />
ainsi pour les six branches partant du candélabre.<br />
[34] Le candélabre lui-même portera quatre calices en forme de fleur d'amandier, avec bouton et fleur :<br />
[35] un bouton sous les deux premières branches partant du candélabre, un bouton sous les deux<br />
branches suivantes et un bouton sous les deux dernières branches - donc <strong>aux</strong> six branches se détachant du<br />
candélabre.<br />
78
[36] Les boutons et les branches feront corps avec le candélabre et le tout sera fait d'un bloc d'or pur<br />
repoussé.<br />
[37] Puis tu feras ses sept lampes. On montera les lampes de telle sorte qu'elles éclairent en avant de lui.<br />
[38] Ses mouchettes et ses cendriers seront d'or pur.<br />
[39] Tu le feras, avec tous ses accessoires, d'un talent d'or pur.<br />
[40] Regarde et exécute selon le modèle qui t'est montré sur la montagne.<br />
La Ménorah est d’or, il y avait des amandes et une forme de petit arbre. Le reste est une<br />
pure devi<strong>net</strong>te. Si il est précisé les formes en amande, cela signifie que c’est un arbre sacré.<br />
Et l’arbre sacré est la chose la plus commune du bassin du moyen orient. Cette<br />
représentation se trouve en plus dans des centaines de sce<strong>aux</strong> de l’époque.<br />
Les chérubins sont des espèces de sphinx que l’on retrouve aussi ailleurs avec une fonction<br />
de protection. La table vient de la conception que le culte est la maison de la divinité : table,<br />
siège ou trône. Il manque le lit or « il ne dort ni ne sommeille le gardien d’Israël ».<br />
Cette conception du culte est profondément enracinée dans le style du moyen Orient à<br />
l’époque. En Egypte la statue du Dieu est réveillée : on enlève les sce<strong>aux</strong>, on la réveille, on la<br />
lave, la parfume, l’habille, la maquille, on lui donne le petit déjeuner et on referme les<br />
portes. En Assyrie et Mésopotamie est aussi particulièrement développé l’aspect du banquet<br />
(trois fois par jours) où on lui offre des viandes de toute sorte, des gâte<strong>aux</strong>, du vin, de la<br />
bière ; ensuite on met un voile pour la divinité mange en paix, puis on débarrasse. (Il ne faut<br />
pas oublier que les dieux babyloniens créent les hommes pour les servir). On a d’ailleurs<br />
découvert tout un complexe de cuisine auprès de ces temples.<br />
Le sanctuaire est donc semblable. L’arche d’alliance est le conteneur du document d’alliance<br />
entre Dieu et son peuple. Les autres peuples portaient aussi leurs contrats devant la divinité.<br />
D’un côté nous sommes vraiment dans le milieu cultuel de l’époque, mais d’un autre côté le<br />
rédacteur réinterprète et confesse le Dieu d’Israël en certains aspects du culte. La Ménorah<br />
comme arbre sacré doit-elle recevoir un culte au moins comme image de la divinité ? Ici, elle<br />
est déplacé du centre et mis de côté. Souvent on voyait à l’époque des chérubins qui<br />
adoraient et protégeaient l’arbre sacré. Ici ce n’est plus qu’une lampe et cet objet n’est plus<br />
vénéré.<br />
Ici, les pains sont changés une fois par semaine et ce n’est pas un banquet 3 fois par jour.<br />
Pour éviter que Dieu mange et se nourrisse, il est interdit de faire entrer de la nourriture<br />
dans le Saint.<br />
79
Le tabernacle d’Exode a existé à un moment dans l’histoire d’Israël. Mais le tabernacle de<br />
l’époque de Moïse devait être autre, déplaçable. Celui-ci ressemble plus <strong>aux</strong> tabernacles<br />
cananéens. Sinon, où trouver ce matériel précieux ? De plus, pour déplacer le tabernacle il<br />
faut des chars à bœufs, or le bœuf ne survit pas dans le désert. La chèvre est l’animal le<br />
mieux pour cela, mais chèvres et vaches ne peuvent pas vivre ensemble : la vache ne va pas<br />
là où est allée la chèvre ; le chameau est l’animal des madianites par excellence et il n’y en a<br />
pas en Israël. L’âne aussi est la bête de somme par excellence. Tout cela pour dire que c’est<br />
peu probable que ce tabernacle soit celui de l’époque de Moïse. Selon Wellhausen, le<br />
tabernacle est une réduction du temple de Salomon. Mais ce n’est pas vrai, le tabernacle est<br />
plutôt comme ceux des religions d’autour.<br />
Nous avons donc toute une réinterprétation du culte. Le sanctuaire est conçu en clef de la<br />
théologie Sacerdotale. Le tabernacle est un Sinaï, une épiphanie portable. La gloire de Dieu<br />
se manifeste et brûle les offrandes : Lv 9,23s. Dans la signification du tabernacle, il y a la<br />
double mention du shabbat (Ex 35,1). Le shabbat a la même fonction que cet espace vide au<br />
dessus des chérubins : l’homme n’intervient pas avec son œuvre pour permettre à Dieu<br />
d’intervenir et d’entrer en contact avec l’homme. C’est une vision typiquement Yahviste,<br />
Sacerdotale.<br />
Comment s’articule le reste du code Sacerdotal ?<br />
Problème de datation. Pour Wellhausen c’est le dernier à surgir. Mais il y a des doutes et on<br />
pense désormais beaucoup qu’il soit bien plus ancien, voire préexilique, ce qui est un<br />
renversement des propositions.<br />
Le code Sacerdotal peut être réparti comme il suit :<br />
Ex 25-31 et Ex 35-40, tout le Lévitique avec l’exception des chapitres 17-26 qui sont la<br />
source H ou code de sainteté ; Nombre 1,1 à 10,10 ; Nb 15 ; Nb 18-19 ; Nb 26-30 ; Nb<br />
33-36. Ceci n’est pas la totalité du Sacerdotal. Ici nous parlons du code Sacerdotal, ce<br />
qui est loi.<br />
Ce code contient une série disparate de lois que l’on réparti en 19 points :<br />
1. Exode 25-31 et 35-40 : la réalisation du tabernacle<br />
2. Lévitique 1-7 : matériel et lois sur les sacrifices, manuel des sacrifices,<br />
3. Lévitique 8-11 : rituel de la consécration des prêtres et le lois connexes au sacerdoce,<br />
80
4. Lévitique 11-16 : loi de pureté :<br />
a. 11 : animal pur et impur,<br />
b. 12 : loi sur l’accouchée,<br />
c. 13 : loi sur la lèpre de l’homme et des vêtements,<br />
d. 14 : le rite de purification et appendice sur la lèpre de la maison,<br />
(En fait ce n’est pas la lèpre que nous appelons comme telle mais plutôt un<br />
psoriasis ; la lèpre est arrivée avec l’armée de Alexandre le grand au 3 ème<br />
siècle).<br />
e. 15 : impureté sexuelle de l’homme et la femme,<br />
f. 16 : le rite de Yom Kippour qui expie et purifie tout cela,<br />
Lévitique 17-26 : la source H,<br />
5. Lévitique 27 : les tarifs et les rachats,<br />
6. Nombres 1-5 : Normes sur les lévites et les dispositions du camp,<br />
7. Nombre 6 : complément sur les normes de pureté,<br />
8. Nombre 7 et 8 : les offrandes de la dédicace du temple et la consécration des lévites,<br />
9. Nombre 9 : lois sur la pâque et la description de la nuée,<br />
10. Nombre 10,1-10 : lois sur les Trompettes,<br />
Partie narrative,<br />
11. Nombre 15 : les lois sur les tsitsits ou franges,<br />
12. Nombre 18 : lois sur les fonctions des prêtres et les tarifs (quelle part prendre…),<br />
13. Nombre 19 : histoire de la vache rousse (pour la purification du contact avec des<br />
morts par l’eau lustrale dans laquelle on a mis les cendres de la vache rousse ; celle-ci<br />
doit avoir moins de 3 poils blanc pour être rousse),<br />
14. Nombre 26,1-27,11 : recensement et femme héritière,<br />
15. Nombre 28-29 : les sacrifices selon l’année liturgique,<br />
16. Nombre 30 : les vœux,<br />
17. Nombre 33,50-34,29 : lois sur la répartition du pays,<br />
18. Nombre 35 : la part des lévites dans le pays et les villes de refuge,<br />
19. Nombre 36 : ultérieures dispositions pour le mariage des héritières : seulement dans<br />
la tribu.<br />
Nous voyons un processus législatif en acte ; le cas se trouve d’abord en Nb 27 (principe) et<br />
la réponse vient ensuite en Nb 36 (objection et réponse), donc il y a une évolution.<br />
81
C’est un ensemble cohérent. L’homogénéité se recherche du point de vue théologique et par<br />
le style Sacerdotale : précision terminologique qui nous sont opaques, répétitions, formules,<br />
donc un style purement législatif. Le tabernacle est au centre du camp. Les lois décrivent le<br />
culte dans ses rites dans ses temps, lieux et personnel ; la deuxième fonctions de ces lois est<br />
de purifier et de structurer le peuple pour ne pas mettre en danger la présence du Seigneur<br />
dans le camp et que la subsistance du peuple ne soit pas non plus mise en cause par un<br />
mauvais contact entre le sacré et le profane.<br />
Au centre du culte il y a donc le Seigneur. Le deuxième but est de purifier et structurer le<br />
peuple. Sa subsistance n’est ainsi pas remise en cause par un contact avec la divinité.<br />
1.3.5.2 La conception Sacerdotale :<br />
On passe de l’impur au pur et au sacré par une gradation ascendante. On pourrait imaginer<br />
un cercle au centre duquel se trouve Dieu ; on avance donc depuis les limites du cercle vers<br />
le très saint ; à l’extérieur du cercle c’est le profane (le pur) qui constitue le deuxième cercle.<br />
Enfin il y a un troisième cercle que est celui de l’impur. C’est grave ; par exemple le cadavre<br />
est impur et passe indépendamment du contact. Il y a la fameuse lèpre. Les questions<br />
sexuelles.<br />
Est possible un passage du pur au sacré. Par contre ce qui est impossible pour le Sacerdotal<br />
est le contact direct entre l’impur et le sacré. Si cela arrive c’est un désastre. Le code donc<br />
sert à structurer le peuple d’Israël dans son rapport avec le Seigneur. Le médiateur entre la<br />
sphère du sacré et de l’impur est toujours un homme. Ce n’est pas le cadavre qui contamine<br />
le temple, mais l’homme qui est au contact du cadavre : si il y a un cadavre, l’homme doit<br />
s’éloigner pour ne pas contaminer ensuite le temple. C’est très anthropocentrique. Le<br />
problème est l’aspect volontaire ou involontaire de l’acte. L’impureté n’est pas le péché,<br />
n’est pas morale. Un pécheur grave comme un menteur n’est pas impur. Et au contraire, une<br />
personne vertueuse peut être impure. Il y a donc une grande séparation entre la sphère du<br />
péché et celle de l’impureté.<br />
Ce qui est en jeu c’est la connaissance de l’homme. Dans ce cas il se purifie ou non. Ce qui<br />
est grave c’est l’homme qui connaît son impureté et ne fait pas la purification. Dans ce cas<br />
c’est la mort parce que c’est un péché volontaire : le péché porte à la mort, pas l’impureté.<br />
Le code fait des exceptions : des sacrifices. Certains péchés peuvent être réduits à l’état<br />
d’impureté par une confession d’admission ; c’est le cas de certains parjures … il faut enlever<br />
82
notre catégorie morale. Il n’y a pas de sacrifice pour un péché, mais certains péchés peuvent<br />
être réduits à l’impureté. Le code Sacerdotale est juridique et liturgique.<br />
Mais alors qu’arrive t-il pour toutes les impuretés des attitudes involontaires et<br />
inconscientes de l’homme ? Parce que la relation entre Dieu et l’homme sera mise en crise<br />
mais le coupable ne le sait pas. Donc Lévitique 16 : Yom Kippour. Eliminer toutes les<br />
impuretés inconscientes et d’éliminer les impuretés conscientes non purifiées qui font<br />
mettre en contact le sacré et le divin. Cette fête expie aussi pour celui impur qui a été mis à<br />
mort impur. C’est un jour de pardon dans le sens qu’il répare les oublis qui créent des<br />
relations difficiles avec Dieu, voire dangereuses.<br />
Aujourd’hui on ne peut plus se purifier de la mort parce qu’il n’y pas plus le sacrifice de la<br />
vache rousse : plus de vache rousse (moins de 3 poils blancs) et plus de temple.<br />
Sur les conséquences désastreuses d’un mauvais rapport avec Dieu nous avons une<br />
illustration en Lv 10,1-3 :<br />
[1] Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun leur encensoir. Ils y mirent du feu sur lequel ils<br />
posèrent de l'encens, et ils présentèrent devant Yahvé un feu irrégulier qu'il ne leur avait pas prescrit.<br />
[2] De devant Yahvé jaillit alors une flamme qui les dévora, et ils périrent en présence de Yahvé. [3]<br />
Moïse dit alors à Aaron : "C'est là ce que Yahvé avait déclaré par ces mots : En mes proches je montre<br />
ma sainteté, et devant tout le peuple je montre ma gloire." Aaron resta muet.<br />
Le peuple dans la zone du pur à une structure qui concerne les rapports interpersonnel et<br />
soci<strong>aux</strong>, les dispositions des tribus sur la terre, la disposition du peuple dans le camp. Le pur<br />
est ce qui est correct.<br />
Le code cherche à interpréter la présence de Dieu dans le temple qui implique la vie du<br />
peuple, la vie sociale. C’est une vision totalisante de la réalité.<br />
1.3.5.3 Le code de sainteté dans le Lévitique chapitre 17-26.<br />
On l’abrège avec la lettre H qui signifie Heiligkeitsgesetz. A partir de K Lostermann, on pense<br />
que ce soit une source indépendante et précédante au code Sacerdotal. Selon Paximadi,les<br />
racine du Sacerdotale vont très en arrière, voire préexilique ; la première forme du<br />
Sacerdotal serait cet source H qui serait post exilique et incorporé à P. Milgrom.<br />
Cette loi de sainteté vient de ce refrain que l’on ne trouve que là « soyez saints parce que<br />
moi je suis saint ».<br />
Lv 11,44 :<br />
La transition entre la première partie du Lévitique et le code Sacerdotal est le chapitre 16<br />
avec le rite de Yom Kippour.<br />
83
Le contenu du code de sainteté peut se décrire<br />
1. Chapitres 17-18 : loi sur la boucherie rituelle et les questions sur l’interdiction du<br />
sang ; dans le chapitre 17 on trouve l’affirmation que le sang purifie et chapitre 18 les<br />
relations sexuelles interdites.<br />
2. Chapitres 19-20 : prescriptions sur les questions éthiques et peines correspondantes.<br />
3. Chapitres 21-22 : lois sur les prêtres<br />
4. Chapitres 23-25 : lois sur le culte et particulièrement 25,23-55 : l’appendice sur le<br />
rachat.<br />
5. Chapitre 26 : conclusion homilétique avec bénédictions et malédictions<br />
Ces conclusions homilétiques rappellent la conclusion du code de l’alliance.<br />
84
1.4 LE DEUTERONOME<br />
1.4.1 Structure du livre<br />
La structure est constituée de 3 discours de Moïse qui encadrent le corps législatif du livre.<br />
Tout le livre se présente comme le discours d’adieu de Moïse tenu dans les steppes de Moab<br />
immédiatement avant sa mort :<br />
1. Premier discours, Dt 1,1à 4,49 : la narration de l’histoire du peuple de l’Horeb à<br />
Moab.<br />
2. Deuxième discours, Dt 5,1 à 11,32 : le décalogue et l’introduction au livre de la loi en<br />
homilétique.<br />
Dt 12,1 à 26,15 : il y a le livre de la loi qui est le corpus fondamental du Deutéronome,<br />
c’est le code législatif proprement dit.<br />
Dt 26,16-19 : conclusion.<br />
3. Troisième discours, Dt 27,1-28,69 : les bénédictions et les malédictions.<br />
Dt 29,1- 30,20 : les deux voies.<br />
Dt 31,1- 32,12 : le chant de Moïse, les bénédictions <strong>aux</strong> tribus et la mort de Moïse.<br />
Le code de la loi est inséré dans le discours de Moïse.<br />
1.4.2 Origine du livre.<br />
On le relie à ce qui est écrit dans les chapitre 22 et 23 de 2Roi où l’on découvre le livre de la<br />
loi avec le prêtre et cela donne origine à la réforme du roi Josias ; ce fait est signalé pour l’an<br />
622, 18 ème année du règne de Josias. On en a beaucoup discuté, mais les preuves contraires<br />
ne sont pas très significatives. L’histoire rédactionnelle est longue et complexe, mais c’est<br />
unitaire comme histoire religieuse. Dans le Deutéronome nous ne trouvons pas des<br />
éléments du Pentateuque et vice et versa.<br />
Dans un premier moment il y a le Code Deutéronomique et 12,1-26,15 : les normes reprises<br />
dans le code de l’alliance (Ex 21-23).<br />
La caractéristique du code du Deutéronome est de relire les normes du code de l’Alliance sur<br />
la base d’un développement social concret : monarchie, le développement de la complexité<br />
sociale… En ce texte chapitre 12,26 on peut voir l’influence de courant sapiential et de<br />
courant prophétique surtout ; évidement prophétie = Nord d’Israël à partir du 7 ème siècle.<br />
85
Les chapitres 5-11 et 27-28 particulièrement seraient un code législatif avec une introduction<br />
et une conclusion. La caractéristique du Deutéronome est son ensemble de prédication, une<br />
vraie mosaïque. C’est une anthologie de florilège qui devait avoir son centre dans le<br />
sanctuaire de Sichem (Nord) où l’on vénère ‘El berit avec un rite de renouvellement de<br />
l’alliance. Les protagonistes étaient sûrement les lévites. C’est semblable à d’autres choses<br />
dans le Ancien Testament ; les Rékabites par exemple conservent le jéhovisme dans un état<br />
parfait, originaire. Ici nous sommes peut-être dans le même cas, durant la fête de<br />
renouvellement de l’alliance à Sichem. (Cf. Mowinkel). C’est la première étape du<br />
Deutéronome.<br />
La deuxième étape de la rédaction se produit après la chute de Samarie (722) : le premier<br />
texte passa à Jérusalem sous le règne d’Ezéchias (716-687) et il est ensuite oublié sous le<br />
Règne de Manassé et Amon et redécouvert en 622 sous Josias (640-609) qui en fait un peu<br />
comme la constitution du règne.<br />
La troisième étape est la déportation de Jérusalem (587). C’est en cette phase que le<br />
Deutéronome reçoit une prémisse ,1-4, et une conclusion, 29-34.<br />
1.4.3 Concepts fondament<strong>aux</strong> du Deutéronome :<br />
L’idée fondamentale est la dialectique entre élection, alliance et loi. Le Deutéronome est un<br />
livre de loi, c’est un livre légal. Le Deutéronome a cependant une approche différente de<br />
celle de saint Paul dans le sens de loi.<br />
Il faut dire que tous les commandements du Deutéronome sont d’aimer le Seigneur et de ne<br />
rester fidèle qu’à lui.<br />
Cette exhortation assume la forme littéraire d’un traité entre le seigneur et son vassal,<br />
comme c’était commun dans le Moyen Orient.<br />
Une partie dispositive ici le code (12-26).<br />
Une partie de bénédictions et malédiction, ici aussi (27-28).<br />
Ceci sert à exprimer le concept de base que le Seigneur, bien que le Seigneur du ciel et de la<br />
terre, s’est lié par amour à la race du peuple d’Abraham. On peut donc l’appeler le Seigneur,<br />
le Dieu d’Israël. La Seigneurie cosmique se fait dans le choix du peuple d’Israël<br />
86
Deutéronome 7,7-9 :<br />
[7] Si Yahvé s'est attaché à vous et vous a choisis, ce n'est pas que vous soyez le plus nombreux de<br />
tous les peuples : car vous êtes le moins nombreux d'entre tous les peuples. [8] Mais c'est par amour<br />
pour vous et pour garder le serment juré à vos pères, que Yahvé vous a fait sortir à main forte et t'a<br />
délivré de la maison de servitude, du pouvoir de Pharaon, roi d'Egypte. [9] Tu sauras donc que Yahvé<br />
ton Dieu est le vrai Dieu, le Dieu fidèle qui garde son alliance et son amour pour mille générations à<br />
ceux qui l'aiment et gardent ses commandements.<br />
A la base il y a une gratuité de l’amour de Dieu. L’idée fondamentale est la dialectique entre<br />
élection, alliance et loi. La loi n’est pas entendue dans le sens de saint Paul, ici tous les<br />
commandements illustrent la fidélité à Dieu et l’amour envers lui.<br />
La forme est celle d’un traité entre le Seigneur et son vassal. La loi est la condition de la<br />
sainteté, c'est-à-dire de l’élection et elle doit être pratiquée par toute la personne. Dieu ne<br />
demande pas de prestations, aussi le culte est une reconnaissance de la part d’Israël que<br />
tout vient de Dieu et que tout est don gratuit. Même la loi est conçue comme un don gratuit<br />
de Dieu. La loi fonde le peuple au dessus des autres et confère la sagesse au peuple.<br />
Deutéronome 4,6-8 :<br />
[6] Gardez-les et mettez-les en pratique, ainsi serez-vous sages et avisés <strong>aux</strong> yeux des peuples. Quand ceux-ci auront<br />
connaissance de toutes ces lois, ils s'écrieront : "Il n'y a qu'un peuple sage et avisé, c'est cette grande nation !"<br />
[7] Quelle est en effet la grande nation dont les dieux se fassent aussi proches que Yahvé notre Dieu l'est pour nous<br />
chaque fois que nous l'invoquons ?<br />
[8] Et quelle est la grande nation dont les lois et coutumes soient aussi justes que toute cette Loi que je vous prescris<br />
aujourd'hui ?<br />
L’idée centrale est aussi la centralité du Culte qui est la pierre de vérification de la fidélité.<br />
Nous sommes dans une culture où la pluralité de culte implique la pluralité des divinités.<br />
Baal Hadad était le dieu de la tempête. L’unicité du lieu de culte montre l’unicité de Dieu. Le<br />
Deutéronome veut un Dieu, un sanctuaire, un peuple, une Torah, une loi : Deut 6.<br />
1.4.4 Lecture de Deut 6, 1-9 :<br />
[1] Tels sont les commandements, les lois et les coutumes que Yahvé votre Dieu a ordonné de vous<br />
enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession.<br />
[2] Ainsi, si tu crains Yahvé ton Dieu tous les jours de ta vie, si tu observes toutes ses lois et ses<br />
commandements que je t'ordonne aujourd'hui, tu auras longue vie, toi, ton fils et le fils de ton fils.<br />
[3] Puisses-tu écouter, Israël, garder et pratiquer ce qui te rendra heureux et te multipliera, ainsi que<br />
te l'a dit Yahvé, le Dieu de tes pères, en te donnant une terre qui ruisselle de lait et de miel !<br />
87
[4] Ecoute, Israël : Yahvé notre Dieu est le seul Yahvé.<br />
[5] Tu aimeras Yahvé ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir.<br />
[6] Que ces paroles que je te dicte aujourd'hui restent dans ton cœur !<br />
[7] Tu les répéteras à tes fils, tu les leur diras aussi bien assis dans ta maison que marchant sur la<br />
route, couché aussi bien que debout ;<br />
[8] tu les attacheras à ta main comme un signe, sur ton front comme un bandeau ;<br />
[9] tu les écriras sur les pote<strong>aux</strong> de ta maison et sur tes portes.<br />
Ce texte est un peu le cœur de la théologie Deutéronomiste, comme l’est le Pater pour nous.<br />
Le Shema. Il part d’une invitation à l’écoute. Par là est mis en lumière le lien avec la tradition<br />
sapientiale. C’est l’invitation à l’écoute dans un rapport éducatif entre Père/fils ou<br />
Maître/disciple, supérieur/inférieur. La caractéristique de ces textes est donc le caractère<br />
d’instruction.<br />
Dans le Deutéronome, cette tradition sapientiale réapparaît donc. Sauf que c’est Dieu lui-<br />
même qui adresse son message à Israël : rapport de filialité et de discipulance. C’est là la<br />
nouveauté : ce nouveau rapport. Il n’existe pas un peuple auquel est adressé un message<br />
semblable ; ce rapport personnel avec la divinité est d’habitude réservé à quelques<br />
personnes. Ici c’est tout le peuple. C’est donc innovateur.<br />
V. 4 : le Seigneur est le seul Seigneur. Ce n’est pas une affirmation de monothéisme. Cette<br />
conscience d’un monothéisme théorique n’est pas encore présente à cette époque. Ici c’est<br />
une opposition entre les phénomènes de baalisation du Dieu d’Israël et le Dieu lui-même.<br />
Les lieux différents de culte avaient fragmenté la vision du Dieu d’Israël et il prenait des<br />
traits de baal. L’idée d’alliance est mise en crise par cette fragmentation ; le Seigneur est<br />
l’unique Seigneur et il est épuré de la fragmentation qui l’assimilait avec d’autres divinités.<br />
Il est Un, il s’adresse à son peuple comme un père à son fils, comme un maître à son disciple.<br />
L’attitude correcte d’Israël sera donc un amour qui embrase tout : tout ton cœur, de toute<br />
ton âme et de tout ton pouvoir : littéralement les viscères, le cœur, l’âme. L’âme néphesh est<br />
la vie de l’homme comme respirant (les êtres vivants respirent tous donc ils ont une âme :<br />
anim<strong>aux</strong>, hommes… mais pas les plantes car elle ne respirent pas), pour nous ce serait la vie,<br />
mais pas ce que nous entendons en disant que l’âme est la forme substantielle du corps. On<br />
voit donc la totalité de la personne dans sa disponibilité économique et sociale qui doit être<br />
prise par l’amour de Dieu. Amour ‘ahab est un concept à deux valeurs : un pour décrire les<br />
affections de la famille (relation parents/enfants), mais c’est aussi le rapport entre le<br />
88
seigneur et son vassal, une sorte d’amour imposé. Dans ce cas c’est une obéissance, une<br />
fidélité…<br />
V. 6 : le plan de l’observation des préceptes. La sphère de l’intériorité n’est pas<br />
abandonnée : cœur. C’est donc maintenir les paroles du Seigneur (décalogue et toute la loi)<br />
avec le cœur. Il faut maintenir les paroles avec le cœur ; on peut noter le aujourd’hui : c’est<br />
dans l’instant présent que l’on maintient le rapport avec Dieu. Le midrash dit que tout juif<br />
doit obéir de la même manière que si en ce moment il se trouvait au Sinaï à recevoir cette<br />
parole. L’évènement du Sinaï s’étend à tout le temps par l’obéissance du juif en ce moment.<br />
C’est le concept de la mémoire. Le verbe zahar le manifeste ; l’évènement historique se<br />
manifeste dans l’action présente. C’est l’expérience d’aujourd’hui. En accomplissant la<br />
mitzva le juif rend Dieu présent. Le juif doit la répéter toujours et partout. Il doit le mettre<br />
sur les montants des portes. Ceci donnera l’usage de la mezuzah. Pour toute l’antiquité la<br />
porte est un lieu dangereux car c’est le lieu de communication entre deux lieux : le lieu du<br />
pur et de l’impur ; du bien et du mal… C’est pour cela que la porte a toujours eu des<br />
attentions particulières dans les cultes (même chez les romains ou ailleurs). La porte devient<br />
ici le symbole qu’il n’y a pas de différence entre l’intérieur et l’extérieur pour observer la loi.<br />
La loi doit être observée partout et toujours. Il y a une permanence dans le temps. Ceci se<br />
fait par l’enseignement que le juif en fait <strong>aux</strong> nouvelles générations : la transmettre et<br />
l’enseigner. Cette loi est le point unificateur de la vie du juif. La vie du juif est unifiée par<br />
l’observation de la loi.<br />
Là se trouve le cœur du Deutéronomiste.<br />
Le devoir de l’amour de Dieu est une nécessité de moyen : si l’homme n’aime pas Dieu il<br />
n’existe pas comme homme orienté vers sa fin. La liberté pour saint Thomas est d’adhérer à<br />
la fin. L’homme n’est pas libre si il se détache de Dieu. Adhérer à Dieu est un devoir :<br />
l’homme ne peut pas ne pas aimer Dieu.<br />
2. L’HISTOIRE DEUTERONOMISTE<br />
Les prophètes antérieurs selon le canon hébreu : Josué, Juges, 1Samuel, 2Samuel, 1Roi et<br />
2Roi. Ceci ne correspond pas à nos livres historiques. (+Tobie, Judith et Esther).<br />
Les postérieurs : Isaïe, Ezéchiel et Jérémie + les douze petits Prophètes.<br />
89
Ces prophètes antérieurs ont des rapports complexes avec les livres qui les précèdent, plus<br />
que l’on pourrait le voir.<br />
2.1 Exateuque ou Tétrateuque ?<br />
Proposition de Otto Eissfeldt :<br />
Même le livre de Josué aurait la même division en source que le reste du Pentateuque : on<br />
peut trouver l’Elohiste, le Sacerdotal et le Deutéronomiste. Josué serait la vraie conclusion<br />
du Pentateuque qui serait l’histoire d’Israël depuis la création du monde jusqu'à l’installation<br />
en terre promise. Le Pentateuque serait donc un Hexateuque. Même Josué est donc soumis<br />
à la division des sources. C’est une théorie présente depuis longtemps, mais de fait elle ne<br />
fut jamais totalement acceptée. En premier lieu le postulat d’Eissfeldt qu’il y ait des sources<br />
différentes repose sur l’idée déjà hypothétique en soi des sources elles-mêmes qui sont déjà<br />
discutées et plus ou moins acceptées. Le problème est la division en sources en Josué.<br />
L’hypothèse d’étendre cette théorie des sources à Josué est donc difficile. En second lieu il y<br />
a un problème rédactionnel. Nous avons Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome<br />
et Josué. Or, Deutéronome est un peu la clef de lecture pour tout ce qui suit. De plus de<br />
Genèse à Nombre il n’y a aucune influence de la théologie Deutéronomiste, mais plutôt de la<br />
théologie Sacerdotale. A partir du Deutéronome, nous avons la disparition du Sacerdotal,<br />
mais nous avons l’influence du Deutéronomiste qui influence Josué et encore les livres qui<br />
suivent (Roi…). Cette théorie d’Eissfeldt est donc bancale.<br />
Théorie de Martin Noth<br />
Pour suppléer à ce problème sur la fonction du Deutéronome dans ce corpus, Martin Noth a<br />
proposer une théorie plutôt rare : elle est universellement acceptée !<br />
Cette théorie dit que le Deutéronome ne serait pas le dernier livre du Pentateuque, mais le<br />
prologue d’une œuvre qui s’étend du Deutéronome à 2Roi et qu’il appelle Histoire<br />
Deutéronomiste. Les premiers livres de la Bible seraient donc un Tétrateuque.<br />
Selon Martin Noth, l’auteur aurait uni différentes sources. L’idée est en résumé que les bons<br />
sont ceux qui sacrifient dans le Temple les mauvais ceux qui sacrifient ailleurs. Tout cela est<br />
dû à la clef de lecture de l’auteur Deutéronomiste ; il n’est pas possible de trouver des<br />
strates continues de tradition. Ce matériel est donc unifié dans cette œuvre. C’est un<br />
rédacteur d’une école Deutéronomiste qui considère le Deutéronome comme fondamental,<br />
mais il en restreint la portée. C’est un peu une scholastique du Deutéronome.<br />
90
Selon cette vision aujourd’hui prévalente, cette œuvre serait du temps de Josias qui englobe<br />
du matériel plus antique comme l’histoire de l’accès au trône de David qui serait d’un auteur<br />
contemporain de l’évènement au 8 ème siècle et qui est inséré ; le cycle d’Elie ; elle serait<br />
revue durant l’exil à la lumière des évènements de la chute de Juda ; un terminus post-quem<br />
qui est l’emprisonnement de Joiaqim, avant dernier roi (2Roi 25,27). Cet évènement est<br />
environ en 560. L’histoire ignore l’édit de Cyrus en 538 car il n’en parle pas. Donc il est<br />
impossible que l’auteur l’ait connu. Le terminus ante quem est donc 538. C’est donc une<br />
œuvre exilique, pas post exilique, comme dernière rédaction. Soit rédaction au 7 ème siècle<br />
sous Josias et qui est revu après l’incarcération de Joiaqim et avant l’édit de Cyrus. On parle<br />
de la rédaction et non des sources qui sont plus anciennes. Nous avons donc la montée de<br />
David, le cycle d’Elie, des récits populaires, des éléments d’archives : 1Roi 4, 7-19<br />
[7] Salomon avait douze préfets sur tout Israël, qui approvisionnaient le roi et sa maison ; il revenait à<br />
chacun d'y pourvoir un mois par an.<br />
[8] Voici leurs noms : Fils de Hur, dans la montagne d'Ephraïm.<br />
[9] Fils de Déqer, à Mahaç, Shaalbim, Bet-Shémesh, Ayyalôn, Bet-Hanân.<br />
[10] Fils de Hésed, à Arubbot ; il avait Soko et tout le pays de Héphèr.<br />
[11] Fils d'Abinadab : tous les cote<strong>aux</strong> de Dor. Tabaat, fille de Salomon, fut sa femme.<br />
[12] Baana fils d'Ahilud, à Tanak et Megiddo jusqu'au-delà de Yoqméam, et tout Bet-Shéân au-dessous<br />
de Yizréel, depuis Bet-Shéân jusqu'à Abel-Mehola, qui est vers Cartân.<br />
[13] Fils de Géber, à Ramot de Galaad ; il avait les Douars de Yaïr, fils de Manassé, qui sont en Galaad ;<br />
il avait le territoire d'Argob qui est en Bashân, 60 villes fortes, emmurées et verrouillées de bronze.<br />
[14] Ahinadab fils d'Iddo, à Mahanayim.<br />
[15] Ahimaaç, en Nephtali ; lui aussi épousa une fille de Salomon, Basmat.<br />
[16] Baana fils de Hushaï, dans Asher et <strong>aux</strong> falaises.<br />
[17] Yehoshaphat fils de Paruah, en Issachar.<br />
[18] Shiméï fils d'Ela, en Benjamin.<br />
[19] Géber fils d'Uri, au pays de Gad, le pays de Sihôn roi des Amorites et d'Og roi du Bashân. En plus, il<br />
y avait un préfet qui était dans le pays.<br />
A partir du v12 reviennent les noms annoncés au début : le texte était sur deux colonnes et<br />
une colonne était détruite donc il manque des noms.<br />
En Roi on cite les Actes de Salomon, les <strong>Livres</strong> des Chroniques des Rois d’Israël et le Livre des<br />
Chroniques des Rois de Juda ; ces livres existait à l’époque, surtout qu’après la chute de<br />
Samarie les archives sont transportées en Juda, ce qui donne un matériel intéressant à notre<br />
auteur.<br />
Cette hypothèse de Noth a été massivement acceptée, avec quelques nuances. C’est un fait<br />
rare que les exégètes soient d’accord.<br />
Par contre sur le problème du Tétrateuque, Noth n’a pas eu l’unanimité : si on sépare<br />
Nombres de Deutéronome, la fin n’est pas excellente : les filles de Zélophcad.<br />
91
La queue aurait été éliminée : c’est ce que soutient Noth. Un Tétrateuque avec une finale<br />
que nous n’avons plus. Puis une histoire Deutéronomiste indépendante. Plus tard le<br />
Tétrateuque aurait été uni, mais comme il y a avait deux histoires de siège, on a coupé le<br />
texte pour les unir et les filles de Zélophcad sont la fin. Telle est la pensée de Noth. Mais<br />
c’est peu crédible vu qu’à l’époque il n’y a pas de canon. D’un point de vu canonique le<br />
Deutéronome détermine tout ce qui suit, mais il est aussi lié quand même avec ce qui<br />
précède d’un point de vue cohérence. Donc que doit-on penser ? On pense à une seule<br />
œuvre littéraire dans laquelle le Deutéronome fait charnière. Non pas un Tétrateuque, mais<br />
une seule œuvre, de la Genèse à 2Roi et le Deutéronome serait la charnière, le point<br />
d’équilibre de cette œuvre en deux volumes. L’histoire Deutéronomiste commencerait donc<br />
à la Genèse, le Deutéronome conclu une première période.<br />
[Pour Paximadi : le Sacerdotal est préexilique et non post exilique ; l’exil n’a duré que 50 ans<br />
et tout n’a pas pu être fait durant cette époque]. Il y a une histoire de la création et à<br />
l’intérieur le Pentateuque en tant que tel a sa fonction particulière.<br />
2.2 La Théologie de l’histoire ; le but de cette vision Deutéronomiste<br />
A cette grande thèse de fond : narrer l’histoire pour montrer comment le peuple est arrivé à<br />
cette expérience de l’exil. Tant Israël que Juda furent coupable de faute cultuelle tellement<br />
nombreuses qu’il fallait cette punition de l’exil. La faute des souverains qui a déchaîné la<br />
colère de Dieu. Or on ne peut pas parler de centralité du culte à Jérusalem avant Josias. Je<br />
pêche contre la centralité du lieu de culte, je pêche contre Dieu. C’est la base du jugement<br />
contre les rois. Quelques personnages sont le paradigme de la fidélité. Le premier est Josué<br />
qui est le chef adapté pour Israël, il est successeur de Moïse et continuateur de sa mission<br />
mais à un autre degré. On recommande son exemple pour l’application de la loi : Jos 1,8 :<br />
« Que le livre de cette Loi soit toujours sur tes lèvres : médite-le jour et nuit afin de veiller à<br />
agir selon tout ce qui y est écrit. C'est alors que tu seras heureux dans tes entreprises et<br />
réussiras ».<br />
Josué est intransigeant dans les lois de la guerre sainte Jos 6,17-21 :<br />
[17] "La ville sera dévouée par anathème à Yahvé, avec tout ce qui s'y trouve. Seule Rahab, la prostituée, aura la<br />
vie sauve ainsi que tous ceux qui sont avec elle dans sa maison, parce qu'elle a caché les émissaires que nous<br />
avions envoyés.<br />
[18] Mais vous, prenez bien garde à l'anathème, de peur que, poussés par la convoitise, vous ne preniez quelque<br />
chose de ce qui est anathème, car ce serait rendre anathème le camp d'Israël et lui porter malheur.<br />
92
[19] Tout l'argent et tout l'or, tous les objets de bronze et de fer seront consacrés à Yahvé, ils entreront dans son<br />
trésor."<br />
[20] Le peuple poussa le cri de guerre et l'on sonna de la trompe. Quand il entendit le son de la trompe, le peuple<br />
poussa un grand cri de guerre, et le rempart s'écroula sur place. Aussitôt le peuple monta vers la ville, chacun<br />
devant soi, et ils s'emparèrent de la ville.<br />
[21] Ils dévouèrent à l'anathème tout ce qui se trouvait dans la ville, hommes et femmes, jeunes et vieux,<br />
jusqu'<strong>aux</strong> taure<strong>aux</strong>, <strong>aux</strong> moutons et <strong>aux</strong> ânes, les passant au fil de l'épée.<br />
La transgression de cette loi impliquera la répudiation de la maison de Saül qui est le premier<br />
souverain. La loi de Herem : tout est consacré à Dieu. Beaucoup de traits de Josué<br />
ressemblent à Moïse. La Blitzkrieg de Josué est une image contrastée par ce que dit Juges.<br />
Suite à la situation peccamineuse il y a une punition : la défaite d’Israël.<br />
Jg 13,1 : « Les Israélites recommencèrent à faire ce qui est mal <strong>aux</strong> yeux de Yahvé, et<br />
Yahvé les livra <strong>aux</strong> mains des Philistins pendant 40 ans »<br />
Grâce au retour vers le Seigneur vient le Sauveur.<br />
Les livres de Samuel et des Rois passe en revue les différents rois et en donne un jugement.<br />
Les seuls acceptés de façon inconditionnée sont Ezéchias et Josias. Mais David est le fidèle,<br />
l’obéissant (le Deutéronomiste ne parle pas de la morale de David, mais distingue). A partir<br />
de Salomon, les rois ne réussissent pas à suivre la voie de David. Jéroboam I est le paradigme<br />
des rois de Juda. Son péché sera un exemple d’horreur pour les suites.<br />
Que sont les prophètes : les voix de Dieu pour le peuple afin qu’il reprenne la juste voie.<br />
Il n’est pas exclu que le Deutéronomiste ait utilisé des sources qui fussent déjà unifiées ou<br />
élaborées par des auteurs de petites écoles.<br />
L’auteur encadre les sources dans son schéma, les interprète, mais les respecte. C’est<br />
intéressant. La sortie de cela est une œuvre qui est mémoire du passé dans laquelle Dieu<br />
s’est fait proche de son peuple. Il y a un jugement en fonction de cette situation ; 29,28.<br />
2.3 La théologie de l’histoire à l’œuvre<br />
2.3.1 Lecture de Juges 2,6-23 ; le jugement sur la période des juges<br />
[6] Alors Josué congédia le peuple et les Israélites se rendirent chacun dans son héritage pour occuper<br />
le pays.<br />
[7] Le peuple servit Yahvé pendant toute la vie de Josué et toute la vie des anciens qui survécurent à<br />
Josué et qui avaient connu toutes les grandes œuvres que Yahvé avait opérées en faveur d'Israël.<br />
[8] Josué, fils de Nûn, serviteur de Yahvé, mourut à l'âge de 110 ans.<br />
[9] On l'ensevelit dans le domaine qu'il avait reçu en héritage à Timnat-Hérès, dans la montagne<br />
d'Ephraïm, au nord du mont Gaash.<br />
93
[10] Et quand cette génération à son tour fut réunie à ses pères, une autre génération lui succéda qui<br />
ne connaissait point Yahvé ni ce qu'il avait fait pour Israël.<br />
[11] Alors les enfants d'Israël firent ce qui est mal <strong>aux</strong> yeux de Yahvé et ils servirent les Baals.<br />
[12] Ils délaissèrent Yahvé, le Dieu de leurs pères, qui les avait fait sortir du pays d'Egypte, et ils<br />
suivirent d'autres dieux parmi ceux des peuples d'alentour. Ils se prosternèrent devant eux, ils<br />
irritèrent Yahvé,<br />
[13] ils délaissèrent Yahvé pour servir le Baal et les Astartés.<br />
[14] Alors la colère de Yahvé s'enflamma contre Israël. Il les abandonna à des pillards qui les<br />
dépouillèrent, il les livra <strong>aux</strong> ennemis qui les entouraient et ils ne purent plus tenir devant leurs<br />
ennemis.<br />
[15] Dans toutes leurs expéditions la main de Yahvé intervenait contre eux pour leur faire du mal,<br />
comme Yahvé le leur avait dit et comme Yahvé le leur avait juré. Leur détresse était extrême.<br />
[16] Alors Yahvé leur suscita des juges qui les sauvèrent de la main de ceux qui les pillaient.<br />
[17] Mais même leurs juges, ils ne les écoutaient pas, ils se prostituèrent à d'autres dieux, et ils se<br />
prosternèrent devant eux. Bien vite ils se sont détournés du chemin qu'avaient suivi leurs pères,<br />
dociles <strong>aux</strong> commandements de Yahvé ; ils ne les ont point imités.<br />
[18] Lorsque Yahvé leur suscitait des juges, Yahvé était avec le juge et il les sauvait de la main de leurs<br />
ennemis tant que vivait le juge, car Yahvé se laissait émouvoir par leurs gémissements devant leurs<br />
persécuteurs et leurs oppresseurs.<br />
[19] Mais le juge mort, ils recommençaient à se pervertir encore plus que leurs pères. Ils suivaient<br />
d'autres dieux, les servaient et se prosternaient devant eux, ne renonçant en rien <strong>aux</strong> pratiques et à la<br />
conduite endurcie de leurs pères.<br />
[20] La colère de Yahvé s'enflamma alors contre Israël et il dit : "Puisque ce peuple a transgressé<br />
l'alliance que j'avais prescrite à ses pères et qu'il n'a pas écouté ma voix,<br />
[21] désormais je ne chasserai plus devant lui aucune des nations que Josué a laissé subsister quand il<br />
est mort",<br />
[22] afin de mettre par elles Israël à l'épreuve, pour voir s'il suivra ou non les chemins de Yahvé<br />
comme les ont suivi ses pères.<br />
[23] C'est pourquoi Yahvé a laissé subsister ces nations, il ne s'est point hâté de les chasser et ne les a<br />
pas livrées <strong>aux</strong> mains de Josué.<br />
La mort de Josué ouvre un problème grave. Le peuple n’est pas capable d’être fidèle au<br />
Seigneur. Israël oublie et n’écoute pas (shamor ve zaror) ; le bon chef est celui qui maintient<br />
Israël dans l’alliance et le souvenir de son Dieu ; la défaite n’est que la conséquence de<br />
l’apostasie de la trahison. Le rôle de Moïse est non substituable. Il est la conscience<br />
populaire. Josué meurt et la chute dans l’idolâtrie est inévitable et Dieu punit certainement :<br />
la rétribution est très forte. Le don des chefs charismatiques est présenté comme une libre<br />
initiative de Dieu envers un peuple ingrat et aveugle. Dieu est décris comme un Père qui<br />
punit, qui reproche un fils rebelle qui reste tout de même son fils. Nous voyons quand même<br />
un unilatéralisme de l’alliance, ce qui offre la possibilité de transcender la catastrophe<br />
historique. Le v. 19 // 4,1 ; 6,1 ; 8,33 etc… C’est le fil conducteur Deutéronomiste qui permet<br />
de donner une lecture théologique.<br />
2.3.2 Lecture de 1Sam 8-9 : le débat sur la monarchie<br />
[1] Lorsque Samuel fut devenu vieux, il établit ses fils comme juges en Israël.<br />
[2] Son fils aîné s'appelait Yoël et son cadet Abiyya ; ils étaient juges à Bersabée.<br />
94
[3] Mais ses fils ne suivirent pas son exemple : ils furent attirés par le gain, acceptèrent des présents et<br />
firent fléchir le droit.<br />
[4] Tous les anciens d'Israël se réunirent et vinrent trouver Samuel à Rama.<br />
[5] Ils lui dirent : "Tu es devenu vieux et tes fils ne suivent pas ton exemple. Eh bien ! établis-nous un<br />
roi pour qu'il nous juge, comme toutes les nations."<br />
[6] Cela déplut à Samuel qu'ils aient dit : "Donne-nous un roi, pour qu'il nous juge", et il invoqua<br />
Yahvé.<br />
[7] Mais Yahvé dit à Samuel : "Satisfais à tout ce que te dit le peuple, car ce n'est pas toi qu'ils ont<br />
rejeté, c'est moi qu'ils ont rejeté, ne voulant plus que je règne sur eux.<br />
[8] Tout ce qu'ils m'ont fait depuis le jour où je les ai fait monter d'Egypte jusqu'à maintenant - ils<br />
m'ont abandonné et ont servi des dieux étrangers - ils te le font aussi.<br />
[9] Eh bien, satisfais à leur demande. Seulement, tu les avertiras solennellement et tu leur apprendras<br />
le droit du roi qui va régner sur eux."<br />
[10] Samuel répéta toutes les paroles de Yahvé au peuple qui lui demandait un roi.<br />
[11] Il dit : "Voici le droit du roi qui va régner sur vous. Il prendra vos fils et les affectera à sa charrerie<br />
et à ses chev<strong>aux</strong> et ils courront devant son char.<br />
[12] Il les emploiera comme chefs de mille et comme chefs de 50 ; il leur fera labourer son labour,<br />
moissonner sa moisson, fabriquer ses armes de guerre et les harnais de ses chars.<br />
[13] Il prendra vos filles comme parfumeuses, cuisinières et boulangères.<br />
[14] Il prendra vos champs, vos vignes et vos oliveraies les meilleures et les donnera à ses officiers.<br />
[15] Sur vos cultures et vos vignes, il prélèvera la dîme et la donnera à ses eunuques et à ses officiers.<br />
[16] Les meilleurs de vos serviteurs, de vos servantes et de vos boeufs, et vos ânes, il les prendra et les<br />
fera travailler pour lui.<br />
[17] Il prélèvera la dîme sur vos troupe<strong>aux</strong> et vous-mêmes deviendrez ses esclaves.<br />
[18] Ce jour-là, vous pousserez des cris à cause du roi que vous vous serez choisi, mais Yahvé ne vous<br />
répondra pas, ce jour-là !"<br />
[19] Le peuple refusa d'écouter Samuel et dit : "Non ! Nous aurons un roi<br />
[20] et nous serons, nous aussi, comme toutes les nations : notre roi nous jugera, il sortira à notre tête<br />
et combattra nos combats."<br />
[21] Samuel entendit toutes les paroles du peuple et les redit à l'oreille de Yahvé.<br />
[22] Mais Yahvé lui dit : "Satisfais à leur demande et intronise-leur un roi." Alors Samuel dit <strong>aux</strong><br />
hommes d'Israël : "Retournez chacun dans sa ville."<br />
[I Samuel 9]<br />
[1] Il y avait, parmi les Benjaminites, un homme qui s'appelait Qish, fils d'Abiel, fils de Ceror, fils de<br />
Bekorat, fils d'Aphiah ; c'était un Benjaminite, homme de condition.<br />
[2] Il avait un fils nommé Saül, qui était dans la fleur de l'âge et beau. Nul parmi les Israélites n'était<br />
plus beau que lui : de l'épaule et au-dessus, il dépassait tout le monde.<br />
[3] Les ânesses appartenant à Qish, père de Saül, s'étant égarées, Qish dit à son fils Saül : "Prends avec<br />
toi l'un des serviteurs et va, pars à la recherche des ânesses."<br />
[4] Ils traversèrent la montagne d'Ephraïm, ils traversèrent le pays de Shalisha sans rien trouver ; ils<br />
traversèrent le pays de Shaalim : elles n'y étaient pas ; ils traversèrent le pays de Benjamin sans rien<br />
trouver.<br />
[5] Lorsqu'ils furent arrivés au pays de Cuph, Saül dit au serviteur qui l'accompagnait : "Allons !<br />
Retournons, de peur que mon père ne laisse les ânesses pour s'inquiéter de nous."<br />
[6] Mais celui-ci lui répondit : "Voici qu'un homme de Dieu habite cette ville-là. C'est un homme réputé<br />
: tout ce qu'il dit arrive sûrement. Allons-y donc, peut-être nous éclairera-t-il sur le voyage que nous<br />
avons entrepris."<br />
[7] Saül dit à son serviteur : "A supposer que nous y allions, qu'offrirons-nous à l'homme ? Le pain a<br />
disparu de nos sacs et nous n'avons pas de rétribution à offrir à l'homme de Dieu. Qu'avons-nous<br />
d'autre ?"<br />
[8] Le serviteur reprit la parole et dit à Saül : "Il se trouve que j'ai en main un quart de sicle d'argent, je<br />
le donnerai à l'homme de Dieu et il nous éclairera sur notre voyage."<br />
[9] Autrefois en Israël, voici ce qu'on disait en allant consulter Dieu : "Allons donc chez le voyant", car<br />
au lieu de "prophète" comme aujourd'hui on disait autrefois "voyant."<br />
[10] Saül dit à son serviteur : "Tu as bien parlé, allons donc !" Et ils allèrent à la ville où se trouvait<br />
l'homme de Dieu.<br />
95
[11] Comme ils gravissaient la montée de la ville, ils rencontrèrent des jeunes filles qui sortaient pour<br />
puiser l'eau et ils leur demandèrent : "Le voyant est-il là ?"<br />
[12] Elles leur répondirent en ces termes : "Il est là, il t'a juste précédé. Hâte-toi maintenant : il est<br />
venu aujourd'hui en ville, car il y a aujourd'hui un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu.<br />
[13] Dès que vous entrerez en ville, vous le trouverez avant qu'il ne monte au haut lieu pour le repas.<br />
Le peuple ne mangera pas avant son arrivée, car c'est lui qui doit bénir le sacrifice ; après quoi, les<br />
invités mangeront. Maintenant, montez : vous le trouverez sur l'heure."<br />
[14] Ils montèrent donc à la ville. Comme ils entraient dans la porte, Samuel sortait à leur rencontre<br />
pour monter au haut lieu.<br />
[15] Or, un jour avant que Saül ne vînt, Yahvé avait fait cette révélation à Samuel :<br />
[16] "Demain à pareille heure, avait-il dit, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, tu lui donneras<br />
l'onction comme chef de mon peuple Israël, et il délivrera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai<br />
vu la misère de mon peuple et son cri est venu jusqu'à moi."<br />
[17] Et quand Samuel aperçut Saül, Yahvé lui signifia : "Voilà l'homme dont je t'ai dit : C'est lui qui<br />
jugera mon peuple."<br />
[18] Saül aborda Samuel au milieu de la porte et dit : "Indique-moi, je te prie, où est la maison du<br />
voyant."<br />
[19] Samuel répondit à Saül : "Je suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu. Vous mangerez<br />
aujourd'hui avec moi. Je te dirai adieu demain matin et je t'expliquerai tout ce qui occupe ton cœur.<br />
[20] Quant <strong>aux</strong> ânesses que tu as perdues il y a trois jours, ne t'en inquiète pas : elles sont retrouvées.<br />
D'ailleurs, à qui revient toute la richesse d'Israël ? N'est-ce pas à toi et à toute la maison de ton père ?"<br />
[21] Saül répondit ainsi : "Ne suis-je pas un Benjaminite, la plus petite des tribus d'Israël, et ma famille<br />
n'est-elle pas la moindre de toutes celles de la tribu de Benjamin ? Pourquoi me dire de telles paroles<br />
?"<br />
[22] Samuel emmena Saül et son serviteur. Il les introduisit dans la salle et leur donna une place en<br />
tête des invités, qui étaient une trentaine.<br />
[23] Puis Samuel dit au cuisinier : "Sers la part que je t'ai donnée en te disant de la mettre de côté."<br />
[24] Le cuisinier préleva le gigot et la queue, qu'il mit devant Saül, et il dit : "Voilà posé devant toi ce<br />
qu'on a laissé. Mange ! ..." Ce jour-là, Saül mangea avec Samuel.<br />
[25] Ils descendirent du haut lieu à la ville. On prépara un lit sur la terrasse pour Saül<br />
[26] et il se coucha. Dès que parut l'aurore, Samuel appela Saül sur la terrasse : "Lève-toi, dit-il, je vais<br />
te dire adieu." Saül se leva, et Samuel et lui sortirent tous deux au-dehors.<br />
[27] Ils étaient descendus à la limite de la ville quand Samuel dit à Saül : "Ordonne au serviteur qu'il<br />
passe devant nous, mais toi, reste maintenant, que je te fasse entendre la parole de Dieu." -<br />
La succession des juges qui conduit Israël à une infidélité porte le débat ailleurs par le<br />
personnage de Samuel. Il marque un point de passage entre deux époques différentes : celle<br />
où le peuple est jugé par les juges et celle d’un véritable état national. Samuel participe des<br />
caractéristiques des deux époques.<br />
En 1Sam 7,15 il libère et gouverne le peuple ; en 3,20 il est prophète et le Seigneur lui confie<br />
des messages pour le peuple ; au chapitre 8 on voit le problème de la succession de Samuel :<br />
ses fils ne sont pas adaptés : le peuple propose d’élire un roi. Samuel est donc celui qui est<br />
chargé de manifester la décision de Dieu : choisir un roi.<br />
Ce récit par rapport à l’institution de la monarchie est donc entre le chapitre 8 et 9 des Rois.<br />
La majorité des exégètes note un détachement entre le chapitre 8 et le chapitre 9 : aspect<br />
théologique et contexte historique ; le matériel le plus antique est sans doute dans le<br />
chapitre 9. Le mot de roi n’est pas utilisé ; on parle de nagîd qui est plus modeste. On le voit<br />
96
mis dans la bouche de Dieu par rapport à ceux qui exercent : 1Sam 10,1 ; 13,14 ; 25,30 ;<br />
2Sam 5,2 ; 6,12 ; 7,8 etc…<br />
Saül est investit par l’Esprit du Seigneur et se retrouve dans l’euphorie propre du<br />
prophétisme antique. Il va chercher les ânesses de son père, à Rama (Ramhallah) il consulte<br />
le voyant (Samuel). Le mot voyant est un usage archaïque du terme. Au verset 9 le rédacteur<br />
insère une glose pour expliquer cette parole qui à cette époque n‘est plus comprise. Durant<br />
le banquet sacrificiel Samuel accomplie une sorte de rite d’intronisation en attribuant à Saül<br />
la portion qui revient à celui qui préside : il l’élève face à ceux qui sont présent (V23). C’est<br />
donc une narration archaïque.<br />
Le chapitre 8 au contraire contient un matériel plus récent qui tient présent le<br />
développement successif de la monarchie en Israël ; le départ est une sorte de péché<br />
originel : le peuple demande un roi, un melek. En 8,5, les anciens demandent à Samuel<br />
d’être comme tous les goïms, soit une renonciation à l’alliance, à être le peuple élu… Dieu<br />
répudie donc son peuple. Au v.8, Dieu l’individu dans l’idolâtrie. L’abandon de Dieu est une<br />
idolâtrie. Samuel annonce au peuple les droits d’un roi quel qu’il soit : oppression du peuple.<br />
Dans ces deux chapitres il y a une tension : un regard positif sur la royauté, mais c’est aussi<br />
vu comme une trahison de l’alliance. Dans le Deutéronome la monarchie a une place<br />
relative.<br />
Deut 17, 14-20 : les lois pour les rois ; des limitations mises à la capacité décisionnelle du roi<br />
et en limitent l’action ; pensons à Osée (7,7) qui critique le roi. (13,11).<br />
Il y a aussi donc une position critique par rapport à la monarchie. Dans les psaumes roy<strong>aux</strong><br />
au contraire le roi est exalté (Ps 2 : il jouit d’un rapport de filialité avec Dieu ; 110 il exalte le<br />
roi en disant que son pouvoir vient de l’intronisation de Dieu lui-même). Le roi n’est jamais<br />
proclamé comme fils charnel de la divinité (Egypte), son origine n’est pas divine (Assyrie), sa<br />
filialité est adoptive. Les origines de la monarchie en Israël sont rigoureusement historiques.<br />
L’histoire de la succession montre l’aspect politique. On le voit entre David et Saül avec<br />
Jonathan. C’est une histoire où rien n’est mythologisé. C’est très différent de Babylone.<br />
Cette conception laïque veut dire que le vrai roi d’Israël est Dieu qui guide son peuple par<br />
son oint. Cette élection n’est pas dissemblable du pouvoir charismatique des juges. Le texte<br />
plus exprimant ce concept d’élection est la prophétie de Nathan en 2Sam 7,1-17.<br />
97
2.4 L’historiographie en Israël : l’histoire de la succession de David<br />
2.4.1 Israël et l’histoire ; lecture de 2Sam 7,1-17<br />
[1] Quand le roi habita sa maison et que Yahvé l'eut débarrassé de tous les ennemis qui l'entouraient,<br />
[2] le roi dit au prophète Natân : "Vois donc ! J'habite une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite<br />
sous la tente !"<br />
[3] Natân répondit au roi : "Va et fais tout ce qui te tient à cœur, car Yahvé est avec toi."<br />
[4] Mais, cette même nuit, la parole de Yahvé fut adressée à Natân en ces termes :<br />
[5] "Va dire à mon serviteur David : Ainsi parle Yahvé. Est-ce toi qui me construiras une maison pour<br />
que j'y habite ?<br />
[6] Je n'ai jamais habité de maison depuis le jour où j'ai fait monter d'Egypte les Israélites<br />
jusqu'aujourd'hui, mais j'étais en camp volant sous une tente et un abri.<br />
[7] Pendant tout le temps où j'ai voyagé avec tous les Israélites, ai-je dit à un seul des juges d'Israël,<br />
que j'avais institués comme pasteurs de mon peuple Israël : Pourquoi ne me bâtissez-vous pas une<br />
maison de cèdre ? (8) Voici maintenant ce que tu diras à mon serviteur David : Ainsi parle Yahvé<br />
Sabaot. C'est moi qui t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour être chef de mon peuple Israël.<br />
[9] J'ai été avec toi partout où tu allais ; j'ai supprimé devant toi tous tes ennemis. Je te donnerai un<br />
grand nom comme le nom des plus grands de la terre.<br />
[10] Je fixerai un lieu à mon peuple Israël, je l'y planterai, il demeurera en cette place, il ne sera plus<br />
ballotté et les méchants ne continueront pas à l'opprimer comme auparavant,<br />
[11] depuis le temps où j'instituais des juges sur mon peuple Israël ; je te débarrasserai de tous tes<br />
ennemis. Yahvé t'annonce qu'il te fera une maison.<br />
[12] Et quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je maintiendrai après<br />
toi le lignage issu de tes entrailles (et j'affermirai sa royauté.<br />
[13] C'est lui qui construira une maison pour mon Nom) et j'affermirai pour toujours son trône royal.<br />
[14] Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils : s'il commet le mal, je le châtierai avec une<br />
verge d'homme et par les coups que donnent les humains.<br />
[15] Mais ma faveur ne lui sera pas retirée comme je l'ai retirée à Saül, que j'ai écarté de devant toi.<br />
[16] Ta maison et ta royauté subsisteront à jamais devant moi, ton trône sera affermi à jamais."<br />
[17] Natân communiqua à David toutes ces paroles et toute cette révélation.<br />
Le rédacteur Deutéronomiste concilie ces deux sources ; il n’a pas peur face <strong>aux</strong> opposés. Il<br />
les met ensemble. Au fond ces prétextes sont unifiés par la même conception : le vrai<br />
détenteur du pouvoir en Israël est Dieu. Ceci est clair au chapitre 9. Ce charisme (11,1-11)<br />
conduit au couronnement. Dieu gouverne à travers son oint. Les prophètes dénonceront<br />
toujours le fait que les alliances conduisent à l’idolâtrie et donc à la trahison….. Is 30,1 ; Jr<br />
2 … le texte biblique est le résultat d’une opération du rédacteur il a fusé du matériel en<br />
donnant au texte une unité très claire ; dans le texte que l’on lit, l’antimonarchisme a la<br />
prédominance. L’histoire du couronnement de Saül s’ouvre avec la rébellion, mais au<br />
chapitre 12, la conclusion est un discours très dur de Samuel (12,16-19). La pluie hors saison<br />
montre la faute du peuple. Dans le chapitre suivant le peuple se repent et le prophète le<br />
console et l’exhorte à rester fidèle à Dieu. Samuel, proprement à cause de ce qui a été dit,<br />
que le roi est l’oint…, dit que c’est Dieu qui a constitué un roi sur eux. Malgré la trahison,<br />
Dieu n’abandonne pas le peuple et la monarchie est légitime. Le rédacteur Deutéronomiste<br />
98
exprime que la monarchie ne fait pas partie du plan originaire de Dieu par rapport à Israël.<br />
Mais suite au péché du peuple, Dieu assume la monarchie et la fait devenir instrument de la<br />
providence pour le peuple. Celui-ci a l’obligation de se conduire selon la loi de Dieu. Israël<br />
sera toujours tenté de se conduire comme tous les peuples. Le rapport au Dieu d’Israël ne<br />
peut pas se limiter au culte ; il est là c’est sûr, mais le culte est expression de la conscience<br />
de l’homme plutôt que du désir de biens. Au moment où Israël est retiré des conceptions<br />
mytologico-sacrales, cela ne correspond pas à un éloignement de Dieu, mais au contraire<br />
Dieu est très présent. Le peuple dépend encore plus de Dieu. La dimension sacrée du peuple<br />
n’est plus limitée au culte, mais toute l’expérience quotidienne, toute la vie politique par<br />
laquelle Dieu s’adéquat au peuple est sacrée.<br />
Cet aspect ne se trouve qu’une fois dans le bassin méditerranéen. Dans le Bible et les grands<br />
classiques, avec une différence substantielle Hérodote et Tucidite. Hérodote limite l’action<br />
de Dieu à quelques actions merveilleuse. Pour le Deutéronomiste c’est différent ; il est<br />
conscient que le protagoniste de l’histoire est Dieu : raconter une histoire humaine est<br />
raconter une histoire ou Dieu s’engage avec l’homme.<br />
L’image de l’intervention de Dieu dans l’histoire est importante et distingue Israël des<br />
peuples qui entourent. C’est dans l’histoire qu’Israël fait l’expérience de son Dieu. Une<br />
institution est accueillie par Dieu est devient une catégorie storico-salvifique.<br />
2.4.1.1 Le document que l’on appelle « Histoire de la succession au trône de David »<br />
Il se termine en 1Roi 2, mais il est difficile de savoir où il commence. Probablement en 2Sam<br />
6 ; soit de 2Sam 6 à 1Roi 2. C’est une grande source de connaissance. Le grand problème<br />
politique est celui de la succession de David au Trône. Dans le monde antique c’est un<br />
problème fondamental.<br />
Quand a-t-il été écris ? Beaucoup d’hypothèses. On pense que l’auteur serait très proche des<br />
évènements qu’il raconte. Nous sommes dans un moment où l’on arrive à recueillir des<br />
témoignages directs. Peut-être même que l’auteur lui-même est un auteur direct ; en tout<br />
cas on ne peut pas aller au-delà de Salomon.<br />
Qui est-ce ? Aucune hypothèse n’a plus de vraisemblance que les autres ; en tout cas il est<br />
fonctionnaire de cour, parfaitement au courant des intrigues qui se déroulaient et du<br />
fonctionnement.<br />
99
Il est convaincu de la fonction sacrée du roi d’Israël et il lui est totalement soumis. On pense<br />
à un fidèle de David lui-même. Il est doué d’un réalisme profond. Ce qui d’un point de vue<br />
littéraire touche est que l’on est face à un texte narratif vrai et proprement réaliste. Nous<br />
sommes face à l’exemple le plus fort de prose hébraïque ; ce qui touche aussi est une<br />
structuration idéale. Nous nous trouvons face à une œuvre historique véritable. Il faut se<br />
rendre compte que l’on se trouve dans le 8 ème siècle du Moyen-Orient antique. C’est la<br />
première œuvre ; nous n’aurons de parallèles que dans la littérature grecque. C’est donc une<br />
nouveauté, quelqu’un a eu la capacité d’être historien. Faire l’histoire, l’écrire est chercher à<br />
décrire une succession d’évènements politiques dans leurs causes immédiates. La majorité<br />
des peuples de l’antiquité n’est jamais parvenu à ce genre de pensée : l’histoire n’est que le<br />
refaire surface d’évènements mythologiques : le cycle éternel. L’Egypte par exemple n’a<br />
jamais composé une histoire d’elle-même. Il n’existe pas un devenir historique. Ce n’est pas<br />
vraiment un devenir ; le pharaon n’est que la réactualisation du lever et coucher du soleil.<br />
Les textes mésopotamiens nous disent que la monarchie vient du ciel.<br />
Ici la monarchie est humaine. Elle ne vient pas du ciel. Israël a toujours eu une notion<br />
historique. Nous n’avons pas d’autres peuples de l’antiquité qui aient une idée aussi claire<br />
de son histoire. Nous avons à faire avec une clarté de connaissance vérifiable ; c’est une<br />
grandeur totalement différente. Notre approximation est due au manque d’information,<br />
mais il ne s’agit pas de mythologie. Il n’y a qu’un seul parallèle qui est l’historiographie<br />
grecque classique qui naît autour de deux noms : Hérodote et Thucydide. Dans le cas du<br />
premier historien il y a encore une place pour le divin, mais il est confiné dans le cas du<br />
curieux ou du merveilleux. Il parle de miracle, mais ceci n’a pas de fonction dans sa<br />
narration.<br />
Thucydide exclue le divin et le dit clairement. Il ne le nie pas, mais il dit que l’aspect divin ne<br />
fait pas partie de ce qu’il veut raconter. Ce sont les causes humaines qui ont conduit à<br />
certaines situations. Le discours divin n’est pas important pour le discours historique. La<br />
conception de l’histoire voit donc l’exclusion (pas la négation) du divin. Israël n’a pas connu<br />
son Dieu dans la mythologie, mais dans l’histoire. Ce que l’on peut dire du Dieu d’Israël est<br />
qu’il intervient dans l’histoire. La seule chose qu’Israël a pu dire de son Dieu est cela : il<br />
existe et il intervient. Les autres dieux des peuples n’ont pas un domaine d’action qui soit<br />
historique. D’ailleurs le Dieu d’Israël n’est pas un Dieu de la fécondité. L’histoire est le<br />
domaine de l’agir divin. Raconter l’histoire est faire un acte de foi dans le propre Dieu.<br />
100
On est passé d’une conception de l’histoire où toute intervention est liée à une intervention<br />
de Dieu (Juges) à une narration où est caractéristique qu’il n’y a pas ou peu de références à<br />
Dieu ; et pourtant cette histoire est un véritable acte de foi dans l’intervention de Dieu.<br />
Cette intervention est de l’intérieur.<br />
L’histoire grecque a vécu un peu la même chose. Homère n’est pas capable de décrire le<br />
processus : l’argumentation qu’Achille aurait pu faire dans sa tête, c’est la déesse qui la fait :<br />
c’est le contraire de la historiographie réaliste ; la grécité classique dépasse cela. Cette<br />
apparition est en fait un processus intérieur de l’homme.<br />
2.4.2 Lecture de 2Sam 11 David et Bethsabée<br />
[1] Au retour de l'année, au temps où les rois se mettent en campagne, David envoya Joab et avec lui<br />
sa garde et tout Israël : ils massacrèrent les Ammonites et mirent le siège devant Rabba. Cependant<br />
David restait à Jérusalem.<br />
[2] Il arriva que, vers le soir, David, s'étant levé de sa couche et se promenant sur la terrasse du palais,<br />
aperçut, de la terrasse, une femme qui se baignait. Cette femme était très belle.<br />
[3] David fit prendre des informations sur cette femme, et on répondit : "Mais c'est Bethsabée, fille<br />
d'Eliam et femme d'Urie le Hittite !"<br />
[4] Alors David envoya des émissaires et la fit chercher. Elle vint chez lui et il coucha avec elle, alors<br />
qu'elle venait de se purifier de ses règles. Puis elle retourna dans sa maison.<br />
[5] La femme conçut et elle envoya dire à David : "Je suis enceinte !"<br />
[6] Alors David expédia un message à Joab : "Envoie-moi Urie le Hittite", et Joab envoya Urie à David.<br />
[7] Lorsqu'Urie fut arrivé auprès de lui, David demanda comment allaient Joab et l'armée et la guerre.<br />
[8] Puis David dit à Urie : "Descends à ta maison et lave-toi les pieds." Urie sortit du palais, suivi d'un<br />
présent de la table royale.<br />
[9] Mais Urie coucha à la porte du palais avec tous les gardes de son maître et ne descendit pas à sa<br />
maison.<br />
[10] On en informa David : "Urie, lui dit-on, n'est pas descendu à sa maison." David demanda à Urie :<br />
"N'arrives-tu pas de voyage ? Pourquoi n'es-tu pas descendu à ta maison ?"<br />
[11] Urie répondit à David : "L'arche, Israël et Juda logent sous les huttes, mon maître Joab et la garde<br />
de Monseigneur campent en rase campagne, et moi j'irais à ma maison pour manger et boire et<br />
coucher avec ma femme ! Aussi vrai que Yahvé est vivant et que tu vis toi-même, je ne ferai pas une<br />
chose pareille !"<br />
[12] Alors David dit à Urie : "Reste encore aujourd'hui ici, et demain je te donnerai congé." Urie resta<br />
donc à Jérusalem ce jour-là. Le lendemain,<br />
[13] David l'invita à manger et à boire en sa présence et il l'enivra. Le soir Urie sortit et s'étendit sur sa<br />
couche avec les gardes de son maître, mais il ne descendit pas à sa maison.<br />
[14] Le matin suivant, David écrivit une lettre à Joab et la fit porter par Urie.<br />
[15] Il écrivait dans la lettre : "Mettez Urie au plus fort de la mêlée et reculez derrière lui : qu'il soit<br />
frappé et qu'il meure."<br />
[16] Joab, qui bloquait la ville, plaça Urie à l'endroit où il savait que se trouvaient de vaillants guerriers.<br />
[17] Les gens de la ville firent une sortie et attaquèrent Joab. Il y eut des tués dans l'armée, parmi les<br />
gardes de David, et Urie le Hittite mourut aussi.<br />
[18] Joab envoya à David un compte-rendu de tous les détails du combat.<br />
[19] Il donna cet ordre au messager : "Quand tu auras fini de raconter au roi tous les détails du<br />
combat,<br />
[20] si la colère du roi s'élève et qu'il te dise : Pourquoi vous êtes-vous approchés de la ville pour livrer<br />
bataille ? Ne saviez-vous pas qu'on tire du haut des remparts ?<br />
[21] Qui a tué Abimélek, le fils de Yerubbaal ? N'est-ce pas une femme, qui a lancé une meule sur lui,<br />
du haut du rempart, et il est mort à Tébèç ? Pourquoi vous êtes-vous approchés du rempart ?, tu diras<br />
: Ton serviteur Urie le Hittite est mort lui aussi."<br />
101
[22] Le messager partit et, à son arrivée, il rapporta à David tout le message dont Joab l'avait chargé.<br />
David s'emporta contre Joab et dit au messager : "Pourquoi vous êtes-vous approchés du rempart de<br />
la ville pour livrer bataille ? Ne saviez-vous pas qu'on tire du haut des remparts ? Qui a tué Abimélek,<br />
le fils de Yerubbaal ? N'est-ce pas une femme qui a jeté une meule sur lui du haut du rempart, et il est<br />
mort à Tébèç ? Pourquoi vous êtes-vous approchés du rempart ?"<br />
[23] Le messager répondit à David : "C'est que ces gens l'avaient emporté sur nous et étaient sortis<br />
vers nous en rase campagne, nous les avons refoulés jusqu'à l'entrée de la porte<br />
[24] mais les archers ont tiré sur tes gardes du haut des remparts, certains des gardes du roi ont péri et<br />
ton serviteur Urie le Hittite est mort lui aussi."<br />
[25] Alors David dit au messager : "Voici ce que tu diras à Joab : Que cette affaire ne t'affecte pas :<br />
l'épée dévore tantôt celui-ci et tantôt celui-là. Force ton attaque contre la ville et détruis-là. Ainsi tu lui<br />
rendras courage."<br />
[26] Lorsque la femme d'Urie apprit que son époux, Urie, était mort, elle fit le deuil pour son mari.<br />
[27] Quand le deuil fut achevé, David l'envoya chercher et la recueillit chez lui, et elle devint sa femme.<br />
Elle lui enfanta un fils. Mais l'action que David avait commise avait déplut à Yahvé.<br />
David sait que cette femme a fait un bain de purification et donc qu’elle est féconde. Il pêche<br />
en sachant ce qu’il fait. David propose à Urie de violer la règle de guerre qui voulait<br />
l’abstinence sexuelle. Pour cela Urie refuse d’aller chez lui. Brave David qui prend soin de la<br />
veuve… !<br />
Cette histoire a toujours rencontré la stupeur des exégètes. David est parfaitement<br />
conscient de ce qu’il fait. Il connaît le risque, il connaît le danger de trahison lorsqu’il fait sa<br />
proposition à Urie. Urie est le type de l’innocent trahit. Bethsabée ne fait non plus bonne<br />
figure. Elle ne dit rien. Lorsque le texte est écrit, Bethsabée est encore vivante vu que c’est la<br />
reine-mère. Mais il n’y a pas une critique.<br />
David est âgé, et il ne conduit pas lui-même la bataille. Il la confit à Joab. Ceci ne l’empêche<br />
pas d’avoir ses désirs. Lorsque Joab envoie son messager, il prévoit parfaitement la réplique<br />
du roi. Il le connaît donc parfaitement et il met dans la bouche du messager la parole qui<br />
faut pour calmer le roi : Urie est mort. En cette complicité, les deux sont liés et David ne peut<br />
pas le tuer lui-même, son fils le fera.<br />
Les hittites étaient d’Asie mineure. A l’époque de David ils n’existent plus. Mais certaines<br />
familles conservaient des rappels des origines Hittites.<br />
David est au sommet de la ville depuis son palais. Il voit donc le bain de cette femme<br />
lorsqu’il se promène. David se promène parce qu’il fait bon le soir. Est-ce que c’est la faute<br />
de Bethsabée ou de David qui a l’œil long… ? L’auteur ne le dit pas. En tout cas lorsque dans<br />
la suite Bethsabée est envoyée cherchée, elle ne dit rien, et plus tard elle ne fera que dire<br />
qu’elle est enceinte. De plus, lorsqu’une femme est violentée en ville, elle doit crier pour<br />
qu’on l’aide ; ici elle ne crie pas. Bethsabée n’est pas une esclave ou autre.<br />
102
On voit donc l’impudeur de Bethsabée, l’envie de David, la fierté de Urie… Le narrateur nous<br />
fait comprendre exactement la dynamique de la chose.<br />
Cette histoire a une grande importance : le problème est celui de la succession de David.<br />
Au chapitre 12 il y a l’histoire de la brebis et la mort du fils de Bethsabée.<br />
Au chapitre 13 il y a une autre histoire : la violence charnelle du premier fils de David par<br />
rapport à Thamar : colère de Absalom qui tue Amnon et se met en révolte contre son Père<br />
en tentant un coup d’état et David doit fuir de Jérusalem. On voit la faiblesse de David par<br />
rapport à ses fils.<br />
Avant de nous décrire tout cela, l’auteur introduit le personnage de la futur reine-mère et<br />
prépare une solution au dilemme qui se prépare. C’est donc le prologue. Le devoir de<br />
Bethsabée d’expliciter la question ; elle formulera la question au roi.<br />
1Roi 1,20 : Bethsabée demande au roi un descendant. Elle fait avancer la question et met les<br />
prémisses de la solution.<br />
Le problème politique de David n’est pas tant d’être un bon roi, mais une faiblesse coupable<br />
par rapport à ses fils. Continuellement mis en crise par rapport à ses fils, il ne pourra pas dire<br />
quelque chose. C’est donc un discours politique que nous avons : la succession au trône. Si le<br />
système n’est pas clair, ceci portera au krach de l’état.<br />
Au verset 27 de ce chapitre 11 de 2Sam, l’écrivain montre que ce que David a fait est mal.<br />
Ceci contraste avec la tendance opposée de l’auteur Deutéronomiste. Ici l’auteur est<br />
caractérisé par une grande sobriété de jugement. D’habitude l’auteur Deutéronomiste<br />
présente l’histoire avec des jugements. Ici la sobriété est absolue. On voit une pénétration<br />
de la complexité des personnages.<br />
On voit d’autres jugement en 2Sam 12,25 lorsqu’il est dit que le Seigneur aima Salomon ; et<br />
en 2Sam 17,14 : « Yahvé avait décidé de faire échouer le plan habile d'Ahitophel, afin<br />
d'amener le malheur sur Absalom ». Nous trouvons un débat de type stratégique et on<br />
retient de devoir garder une idée. De ce conseil retenu, l’auteur voit la main de Dieu ; c’est<br />
pourtant le choix du roi et de son conseil, rien ne nous dit que le roi ait été aveuglé ou autre.<br />
Ici nous sommes conduit dans une conception où l’histoire entière est le domaine de l’action<br />
de Dieu, mais la différence est que dans ce cas, ce ne sont plus seulement les évènements<br />
extraordinaires qui guident l’histoire, mais le normal est déjà action divine. Dieu bouge<br />
103
l’histoire de son intérieur. L’histoire est mue de l’intérieur. C’est d’ailleurs exactement notre<br />
conception : ce qui advient advient par divine providence. Ce n’est pas la voie extraordinaire<br />
de la vision, de la motion ou autre ; dans la grande majorité des cas, la manière normale<br />
pour la communication dans l’histoire est le vivre habituel. D’ailleurs la tradition<br />
carmélitaine demande de se méfier de ceux qui ont trop de manifestations extraordinaires.<br />
Dans l’histoire des juges nous avons comme une présentation conventionnelle : les juges se<br />
ressemblent tous. Ici ce n’est pas conventionnel. Dieu est le seul patron d’une histoire qui de<br />
toute manière est humaine. Dieu collabore avec la liberté humaine pour conduire à effet ses<br />
décisions ; c’est une démythisation radicale, or nous sommes à la moitié du 10 ème siècle<br />
avant Jésus Christ. C’est un approchement du Dieu de l’histoire à la différence de la grécité<br />
qui a éloigné dieu.<br />
2.5 Histoire de Salomon le grand, ascension et décadence<br />
On voit une dualité entre Samuel et Rois. L’auteur organise comme un diptyque<br />
1. 1Sam et 2Sam : débat sur la monarchie avec au centre la succession au trône de<br />
David.<br />
2. 1 et 2Roi : la chute de la monarchie davidique : Salomon avec le sommet dans le<br />
Temple et se termine avec la destruction du même temple lors d’une suite<br />
d’infidélités à Dieu.<br />
Pour l’auteur Deutéronomiste, la prophétie de Nathan est fondamentale : signe d’espérance<br />
à l’intérieur des renversements causés par les infidélités. Le temple, Jérusalem ... étaient<br />
considérés comme des évènements presque fondateurs (pas comme l’Exode et le Sinaï). Le<br />
temple en sera un objet de profession de foi ; mais l’élection de David, de Jérusalem et du<br />
Temple étaient vu comme le mode en lequel était vue la fidélité de Dieu éternelle pour son<br />
peuple. Aussi, lorsque la monarchie tombe, comment est la fidélité de Dieu, tombe t-elle<br />
avec ? L’auteur répond que la catastrophe ne compromet pas la prophétie de Nathan qui<br />
doit être comprise sur un autre niveau. C’est par là que naîtront les messianismes. La<br />
fonction Deutéronomiste est de poser la base pour les conceptions prophétiques. Attention<br />
à la notion de messianisme, il n’y en a pas qu’un ! et ce n’est pas Jésus Christ. Le<br />
messianisme est un discours complexe, mais qui se fonde sur ces bases : les promesses qui<br />
ne se sont pas réalisées sont encore valables et il faut les relire et les réinterpréter. L’auteur<br />
n’explique pas comment interpréter, mais il finit son œuvre avec 2Roi 25,27-30 qui s’achève<br />
104
avec la libération du dernier davidien ; c’est donc une fin ouverte vers l’espérance. Si<br />
l’auteur avait entendu parler de Zorobabel il en aurait parlé, ce qui montre que son œuvre<br />
est bouclée avant 538.<br />
L’ambiguïté de la monarchie qui est critiquée dans son institution revient avec David puis<br />
avec Salomon.<br />
105
2.5.1 Lecture de 1Roi 3,1-15 et 1Roi 11,1-13<br />
[I Rois 3,1-15]<br />
[1] Salomon devint le gendre de Pharaon, le roi d'Egypte ; il<br />
prit pour femme la fille de Pharaon et l'introduisit dans la<br />
Cité de David, en attendant d'avoir achevé de construire son<br />
palais, le Temple de Yahvé et le rempart de Jérusalem.<br />
[2] Le peuple sacrifiait sur les hauts lieux, car on n'avait pas<br />
encore bâti en ce temps-là une maison pour le Nom de<br />
Yahvé.<br />
[3] Salomon aima Yahvé : il se conduisait selon les préceptes<br />
de son père David ; seulement il offrait des sacrifices et de<br />
l'encens sur les hauts lieux.<br />
[4] Le roi alla à Gabaôn pour y sacrifier, car le plus grand haut<br />
lieu se trouvait là - Salomon a offert mille holocaustes sur cet<br />
autel.<br />
[5] A Gabaôn, Yahvé apparut la nuit en songe à Salomon.<br />
Dieu dit : "Demande ce que je dois te donner."<br />
[6] Salomon répondit : "Tu as témoigné une grande<br />
bienveillance à ton serviteur David, mon père, et celui-ci a<br />
marché devant toi dans la fidélité, la justice et la droiture du<br />
cœur ; tu lui as gardé cette grande bienveillance et tu as<br />
permis qu'un de ses fils soit aujourd'hui assis sur son trône.<br />
[7] Maintenant, Yahvé mon Dieu, tu as établi roi ton serviteur<br />
à la place de mon père David, et moi, je suis un tout jeune<br />
homme, je ne sais pas agir en chef.<br />
[8] Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as élu, un<br />
peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut le compter ni<br />
le recenser.<br />
[9] Donne à ton serviteur un cœur plein de jugement pour<br />
gouverner ton peuple, pour discerner entre le bien et le mal,<br />
car qui pourrait gouverner ton peuple, qui est si grand ?"<br />
[10] Il plut au regard du Seigneur que Salomon ait fait cette<br />
demande ;<br />
[11] et Dieu lui dit : "Parce que tu as demandé cela, que tu<br />
n'as pas demandé pour toi de longs jours, ni la richesse, ni la<br />
vie de tes ennemis, mais que tu as demandé pour toi le<br />
discernement du jugement,<br />
[12] voici que je fais ce que tu as dit : je te donne un cœur<br />
sage et intelligent comme personne ne l'a eu avant toi et<br />
comme personne ne l'aura après toi.<br />
[13] Et même ce que tu n'as pas demandé, je te le donne<br />
aussi : une richesse et une gloire comme à personne parmi<br />
les rois.<br />
[14] Et si tu suis mes voies, gardant mes lois et mes<br />
commandements comme a fait ton père David, je<br />
t'accorderai une longue vie."<br />
[15] Salomon s'éveilla et voilà que c'était un songe. Il rentra à<br />
Jérusalem et se tint devant l'arche de l'alliance du Seigneur ;<br />
il offrit des holocaustes et des sacrifices de communion et<br />
donna un banquet à tous ses serviteurs.<br />
Nous avons donc le début et la fin du règne de Salomon.<br />
[I Rois 11,1-13]<br />
[1] Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères -<br />
outre la fille de Pharaon - : des Moabites, des Ammonites, des<br />
Edomites, des Sidoniennes, des Hittites,<br />
[2] de ces peuples dont Yahvé avait dit <strong>aux</strong> Israélites : "Vous<br />
n'irez pas chez eux et ils ne viendront pas chez vous ; sûrement<br />
ils détourneraient vos cœurs vers leurs dieux." Mais Salomon<br />
s'attacha à elles par amour ;<br />
[3] il eut 700 épouses de rang princier et 300 concubines.<br />
[4] Quand Salomon fut vieux, ses femmes détournèrent son<br />
cœur vers d'autres dieux et son cœur ne fut plus tout entier à<br />
Yahvé son Dieu comme avait été celui de son père David.<br />
[5] Salomon suivit Astarté, la divinité des Sidoniens, et Milkom,<br />
l'abomination des Ammonites.<br />
[6] Il fit ce qui déplaît à Yahvé et il ne lui obéit pas parfaitement<br />
comme son père David.<br />
[7] C'est alors que Salomon construisit un sanctuaire à Kemosh,<br />
l'abomination de Moab, sur la montagne à l'orient de<br />
Jérusalem, et à Milkom, l'abomination des Ammonites.<br />
[8] Il en fit autant pour toutes ses femmes étrangères, qui<br />
offraient de l'encens et des sacrifices à leurs dieux.<br />
[9] Yahvé s'irrita contre Salomon parce que son cœur s'était<br />
détourné de Yahvé, Dieu d'Israël, qui lui était apparu deux fois<br />
[10] et qui lui avait défendu à cette occasion de suivre d'autres<br />
dieux, mais il n'observa pas cet ordre.<br />
[11] Alors Yahvé dit à Salomon : "Parce que tu t'es comporté<br />
ainsi et que tu n'as pas observé mon alliance et les prescriptions<br />
que je t'avais faites, je vais sûrement t'arracher le royaume et le<br />
donner à l'un de tes serviteurs.<br />
[12] Seulement je ne ferai pas cela durant ta vie, en<br />
considération de ton père David ; c'est de la main de ton fils que<br />
je l'arracherai.<br />
[13] Encore ne lui arracherai-je pas tout le royaume : je laisserai<br />
une tribu à ton fils, en considération de mon serviteur David et<br />
de Jérusalem que j'ai choisie.<br />
La clef de lecture est la fidélité au Seigneur selon l’exemple du Père ; nous avons une note<br />
sur la politique matrimoniale de Salomon. La fille de Pharaon est une fille secondaire et non<br />
celle directe ; elle était mi femme mi déesse : soit le prix est assez cher…<br />
Le mariage avec la princesse égyptienne est seulement pour des motifs politiques. Il est<br />
précisé que Salomon aime le Seigneur et rien n’est dit en ce qui concerne la princesse. On<br />
brûle de l’encens sur les hauteurs car il n’y a pas encore de temple, mais Salomon s’en<br />
occupe.<br />
106
Salomon épouse d’autres femmes d’autres peuples, qui sont donc ennemis, mais celles-là ils<br />
les aime et elles emportent son cœur loin du Seigneur. Le numéro exorbitant des femmes<br />
n’est pas très gonflé : un harem de ce genre était normal. Le problème est que le texte<br />
souligne (Deut 17,17 : le roi ne devra pas avoir trop de femme pour ne pas que son cœur<br />
disparaisse) que le roi a trop de femmes. La polygamie est habituelle dans le Moyen-Orient.<br />
Le harem royal est signe de pouvoir et c’est héréditaire : le nouveau roi reçoit le harem de<br />
son père. Ici Salomon est critiqué pour le nombre de ces femmes. Il continu de brûler de<br />
l’encens sur les hauteurs, mais pour d’autres dieux.<br />
Le dialogue entre Dieu et Salomon est un exemple de théologie royale : le roi d’Israël est le<br />
Seigneur avant tout ; l’oint est choisi par le peuple, mais ne peut gouverner sans le Seigneur.<br />
Pour cela il faut qu’il soit fidèle. Donc l’infidélité porte des fruits inévitables : le schisme mais<br />
pas la destruction du règne.<br />
Il y a toujours un reste, Dieu n’annule pas tout. A la schismatique monarchie davidique n’a<br />
pas le même traitement. Ce reste a une fonction d’espérance, c’est la possibilité pour<br />
l’auteur Deutéronomiste d’insérer un élément de gratuité qui permet à l’histoire de Dieu<br />
avec son peuple d’aller de l’avant.<br />
Dans le cœur de l’histoire de Salomon nous avons le 1Roi 8,12-53.<br />
2.5.2 Lecture de 1Roi 8,12-53. La dédicace du Temple<br />
[12] Alors Salomon dit : "Yahvé a décidé d'habiter la nuée obscure.<br />
[13] Oui, je t'ai construit une demeure princière, une résidence où tu habites à jamais."<br />
[14] Puis le roi se retourna et bénit toute l'assemblée d'Israël, et toute l'assemblée d'Israël se tenait debout.<br />
[15] Il dit : "Béni soit Yahvé, Dieu d'Israël, qui a accompli de sa main ce qu'il avait promis de sa bouche à mon père David<br />
en ces termes :<br />
[16] Depuis le jour où j'ai fait sortir d'Egypte mon peuple Israël, je n'ai pas choisi de ville, dans toutes les tribus d'Israël,<br />
pour qu'on y bâtît une maison où serait mon Nom, mais j'ai choisi David pour qu'il commandât à mon peuple Israël.<br />
[17] Mon père David eut dans l'esprit de bâtir une maison pour le Nom de Yahvé, Dieu d'Israël,<br />
[18] mais Yahvé dit à mon père David : Tu as eu dans l'esprit de bâtir une maison pour mon Nom, et tu as bien fait.<br />
[19] Seulement, ce n'est pas toi qui bâtiras cette maison, c'est ton fils, issu de tes reins, qui bâtira la maison pour mon<br />
Nom.<br />
[20] Yahvé a réalisé la parole qu'il avait dite : j'ai succédé à mon père David et je me suis assis sur le trône d'Israël comme<br />
avait dit Yahvé, j'ai construit la maison pour le Nom de Yahvé, Dieu d'Israël,<br />
[21] et j'y ai fixé un emplacement pour l'arche, où est l'alliance que Yahvé a conclue avec nos pères lorsqu'il les fit sortir<br />
du pays d'Egypte."<br />
[22] Puis Salomon se tint devant l'autel de Yahvé, en présence de toute l'assemblée d'Israël ; il étendit les mains vers le<br />
ciel<br />
[23] et dit : "Yahvé, Dieu d'Israël ! il n'y a aucun Dieu pareil à toi là-haut dans les cieux ni ici-bas sur la terre, toi qui es<br />
fidèle à l'alliance et gardes la bienveillance à l'égard de tes serviteurs, quand ils marchent de tout leur cœur devant toi.<br />
[24] Tu as tenu à ton serviteur David, mon père, la promesse que tu lui avais faite, et ce que tu avais dit de ta bouche, tu<br />
l'as accompli aujourd'hui de ta main.<br />
[25] Et maintenant, Yahvé, Dieu d'Israël, tiens à ton serviteur David, mon père, la promesse que tu lui as faite, quand tu<br />
as dit : Tu ne seras jamais dépourvu d'un descendant qui soit devant moi, assis sur le trône d'Israël, à condition que tes<br />
fils veillent à leur conduite et marchent devant moi comme tu as marché toi-même devant moi.<br />
[26] Maintenant donc, Dieu d'Israël, que se vérifie la parole que tu as dite à ton serviteur David, mon père !<br />
107
[27] Mais Dieu habiterait-il vraiment avec les hommes sur la terre ? Voici que les cieux et les cieux des cieux ne le<br />
peuvent contenir, moins encore cette maison que j'ai construite !<br />
[28] Sois attentif à la prière et à la supplication de ton serviteur, Yahvé, mon Dieu, écoute l'appel et la prière que ton<br />
serviteur fait aujourd'hui devant toi !<br />
[29] Que tes yeux soient ouverts jour et nuit sur cette maison, sur ce lieu dont tu as dit : Mon Nom sera là, écoute la<br />
prière que ton serviteur fera en ce lieu.<br />
[30] "Ecoute la supplication de ton serviteur et de ton peuple Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Toi, écoute du lieu où tu<br />
résides, au ciel, écoute et pardonne.<br />
[31] "Supposé qu'un homme pèche contre son prochain et que celui-ci prononce sur lui un serment imprécatoire et le<br />
fasse jurer devant ton autel dans ce Temple,<br />
[32] toi, écoute au ciel et agis ; juge entre tes serviteurs : déclare coupable le méchant en faisant retomber sa conduite<br />
sur sa tête, et justifie l'innocent en lui rendant selon sa justice.<br />
[33] "Quand ton peuple Israël sera battu devant l'ennemi, parce qu'il aura péché contre toi, s'il revient à toi, loue ton<br />
Nom, prie et supplie vers toi dans ce Temple,<br />
[34] toi, écoute au ciel, pardonne le péché de ton peuple Israël et ramène-le dans le pays que tu as donné à ses pères.<br />
[35] "Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura pas de pluie parce qu'ils auront péché contre toi, s'ils prient en ce lieu,<br />
louent ton Nom et se repentent de leur péché, parce que tu les auras humiliés,<br />
[36] toi, écoute au ciel, pardonne le péché de ton serviteur et de ton peuple Israël - tu leur indiqueras la bonne voie qu'ils<br />
doivent suivre - et arrose de pluie ta terre, que tu as donnée en héritage à ton peuple.<br />
[37] "Quand le pays subira la famine, la peste, la rouille ou la nielle, quand surviendront les sauterelles ou les criquets,<br />
quand l'ennemi de ce peuple assiégera l'une de ses portes, quand il y aura n'importe quel fléau ou épidémie,<br />
[38] quelle que soit la prière ou la supplication de quiconque, éprouve le remords de sa propre conscience, s'il étend les<br />
mains vers ce Temple,<br />
[39] toi, écoute au ciel, où tu résides, pardonne et agis ; rends à chaque homme selon sa conduite, puisque tu connais<br />
son cœur - tu es le seul à connaître le cœur de tous - ,<br />
[40] en sorte qu'ils te craignent tous les jours qu'ils vivront sur la terre que tu as donnée à nos pères.<br />
[41] "Même l'étranger qui n'est pas d'Israël ton peuple, s'il vient d'un pays lointain à cause de ton Nom -<br />
[42] car on entendra parler de ton grand Nom, de ta main forte et de ton bras étendu - , s'il vient et prie en ce Temple,<br />
[43] toi, écoute-le au ciel, où tu résides, exauce toutes les demandes de l'étranger afin que tous les peuples de la terre<br />
reconnaissent ton Nom et te craignent comme fait ton peuple Israël, et qu'ils sachent que ce Temple que j'ai bâti porte<br />
ton nom.<br />
[44] "Si ton peuple part en guerre contre ses ennemis par le chemin où tu l'auras envoyé et s'il prie Yahvé, tourné vers la<br />
ville que tu as choisie et vers le Temple que j'ai construit pour ton Nom,<br />
[45] écoute au ciel sa prière et sa supplication et fais-lui justice.<br />
[46] "Quand ils pécheront contre toi - car il n'y a aucun homme qui ne pèche - , quand tu seras irrité contre eux, que tu<br />
les livreras à l'ennemi et que leurs conquérants les emmèneront captifs dans un pays ennemi, lointain ou proche,<br />
[47] s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils auront été déportés, s'ils se repentent et te supplient dans le pays de<br />
leurs conquérants en disant : Nous avons péché, nous avons mal agi, nous nous sommes pervertis,<br />
[48] s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme dans le pays des ennemis qui les auront déportés, et s'ils<br />
te prient tournés vers le pays que tu as donné à leurs pères, vers la ville que tu as choisie et le Temple que j'ai bâti pour<br />
ton Nom,<br />
[49] écoute au ciel où tu résides,<br />
[50] pardonne à ton peuple les péchés qu'il a commis envers toi et toutes les rébellions dont ils furent coupables, faisleur<br />
trouver grâce devant leurs conquérants, que ceux-ci aient pitié d'eux ;<br />
[51] car ils sont ton peuple et ton héritage, ceux que tu as fait sortir d'Egypte, cette fournaise pour le fer.<br />
[52] "Que tes yeux soient ouverts sur la supplication de ton serviteur et de ton peuple Israël, pour écouter tous les appels<br />
qu'ils lanceront vers toi.<br />
[53] Car c'est toi qui les as mis à part comme ton héritage, parmi tous les peuples de la terre, ainsi que tu l'as déclaré par<br />
le ministère de ton serviteur Moïse, quand tu as fait sortir nos pères d'Egypte, Seigneur Yahvé !"<br />
Un phénomène caractéristique est celui d’excentricité : on affirme une chose et juste après<br />
on veut la limiter. L’importance du Temple est diminuée au moment même de la dédicace :<br />
Dieu n’habite pas dans le Temple, mais au ciel. La fonction du Temple est une station de<br />
liaison où le peuple fait entendre ses prières. Dieu cependant habite ailleurs ; le temple est<br />
central, mais… c’est un peu une fonction sacramentelle du temple. Les sacrements ne<br />
servent pas à Dieu, mais à l’homme, ils existent pour l’homme. Le culte sert à l’homme avec<br />
une fonction réelle et salvifique.<br />
108
Le Deutéronomiste et le Sacerdotal sont donc complètement d’accord. Cependant pour le<br />
Sacerdotal il y a une médiation : la Gloire qui habite dans le Temple.<br />
Salomon ne parle pas de sacrifices, mais uniquement de prières. L’auteur Deutéronomiste<br />
n’est pas intéressé à développer la théologie des sacrifices. Une idée forte de théologie<br />
universaliste : le choix d’un lieu, d’un peuple … est pour y inclure tous les peuples et tous les<br />
lieux. Cette irruption universaliste est en accord avec la théologie Sacerdotale des premières<br />
pages de la Bible : avant de narrer l’histoire d’Abraham, on dessine une table de tous les<br />
peuples où Israël n’existe pas encore. Pour les égyptiens, le monde est l’Egypte ; Thèbes est<br />
le lieu de la fondation du monde.<br />
2.6 Le schisme Lecture de 1Roi 12<br />
[1] Roboam se rendit à Sichem, car c'est à Sichem que tout Israël était venu pour le proclamer roi.<br />
[2] (Dès que Jéroboam, fils de Nebat, fut informé - il était encore en Egypte, où il avait fui le roi Salomon - , il<br />
revint d'Egypte.<br />
[3] On fit appeler Jéroboam et il vint, lui et toute l'assemblée d'Israël.) Ils parlèrent ainsi à Roboam :<br />
[4] "Ton père a rendu pénible notre joug, allège maintenant le dur servage de ton père, la lourdeur du joug qu'il<br />
nous imposa, et nous te servirons !"<br />
[5] Il leur dit : "Retirez-vous pour trois jours, puis revenez vers moi", et le peuple s'en alla.<br />
[6] Le roi Roboam prit conseil des anciens, qui avaient assisté son père Salomon pendant qu'il vivait, et demanda :<br />
"Quelle réponse conseillez-vous de faire à ce peuple ?"<br />
[7] Ils lui répondirent : "Si tu te fais aujourd'hui serviteur de ces gens, si tu te soumets et leur donnes de bonnes<br />
paroles, alors ils seront toujours tes serviteurs."<br />
[8] Mais il repoussa le conseil que les anciens avaient donné et consulta des jeunes gens qui l'assistaient, ses<br />
compagnons d'enfance.<br />
[9] Il leur demanda : "Que conseillez-vous que nous répondions à ce peuple qui m'a parlé ainsi : Allège le joug que<br />
ton père nous a imposé ?"<br />
[10] Les jeunes gens, ses compagnons d'enfance, lui répondirent : "Voici ce que tu diras à ce peuple qui t'a dit :<br />
Ton père a rendu pesant notre joug, mais toi allège notre charge, voici ce que tu leur répondras : Mon petit doigt<br />
est plus gros que les reins de mon père !<br />
[11] Ainsi, mon père vous a fait porter un joug pesant, moi j'ajouterai encore à votre joug ; mon père vous a<br />
châtiés avec des lanières, moi je vous châtierai avec des fouets à pointes de fer !"<br />
[12] Jéroboam avec tout le peuple vint à Roboam le troisième jour, selon cet ordre qu'il avait donné : "Revenez<br />
vers moi le troisième jour."<br />
[13] Le roi fit au peuple une dure réponse, il rejeta le conseil que les anciens avaient donné<br />
[14] et, suivant le conseil des jeunes, il leur parla ainsi : "Mon père a rendu pesant votre joug, moi j'ajouterai<br />
encore à votre joug ; mon père vous a châtiés avec des lanières, moi je vous châtierai avec des fouets à pointes de<br />
fer."<br />
[15] Le roi n'écouta donc pas le peuple : c'était une intervention de Yahvé, pour accomplir la parole qu'il avait dite<br />
à Jéroboam fils de Nebat par le ministère d'Ahiyya de Silo.<br />
[16] Quand les Israélites virent que le roi ne les écoutait pas, ils lui répliquèrent : "Quelle part avons-nous sur<br />
David ? Nous n'avons pas d'héritage sur le fils de Jessé. A tes tentes, Israël ! Et maintenant, pourvois à ta maison,<br />
David." Et Israël s'en fut à ses tentes.<br />
[17] Quant <strong>aux</strong> Israélites qui habitaient les villes de Juda, Roboam régna sur eux.<br />
[18] Le roi Roboam dépêcha Adoram, le chef de la corvée, mais tout Israël le lapida et il mourut ; alors le roi<br />
Roboam se vit contraint de monter sur son char pour fuir vers Jérusalem.<br />
[19] Et Israël fut séparé de la maison de David, jusqu'à ce jour.<br />
[20] Lorsque tout Israël apprit que Jéroboam était revenu, ils l'appelèrent à l'assemblée et ils le firent roi sur tout<br />
Israël ; il n'y eut pour se rallier à la maison de David que la seule tribu de Juda.<br />
[21] Roboam se rendit à Jérusalem ; il convoqua toute la maison de Juda et la tribu de Benjamin, soit 180.000<br />
guerriers d'élite, pour combattre la maison d'Israël et rendre le royaume à Roboam fils de Salomon.<br />
[22] Mais la parole de Dieu fut adressée à Shemaya l'homme de Dieu en ces termes :<br />
[23] "Dis ceci à Roboam fils de Salomon, roi de Juda, à toute la maison de Juda, à Benjamin et au reste du peuple :<br />
109
[24] Ainsi parle Yahvé. N'allez pas vous battre contre vos frères, les enfants d'Israël ; que chacun retourne chez<br />
soi, car cet événement vient de moi." Ils écoutèrent la parole de Yahvé et prirent le chemin du retour comme<br />
avait dit Yahvé.<br />
[25] Jéroboam fortifia Sichem dans la montagne d'Ephraïm et y séjourna. Puis il sortit de là et fortifia Penuel.<br />
[26] Jéroboam se dit en lui-même : "Comme sont les choses, le royaume va retourner à la maison de David.<br />
[27] Si ce peuple continue de monter au Temple de Yahvé à Jérusalem pour offrir des sacrifices, le cœur du peuple<br />
reviendra à son seigneur, Roboam, roi de Juda, et on me tuera."<br />
[28] Après avoir délibéré, il fit deux ve<strong>aux</strong> d'or et dit au peuple : "Assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem !<br />
Israël, voici ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Egypte."<br />
[29] Il dressa l'un à Béthel,<br />
[30] et le peuple alla en procession devant l'autre jusqu'à Dan.<br />
[31] Il établit le temple des hauts lieux et il institua des prêtres pris du commun, qui n'étaient pas fils de Lévi.<br />
[32] Jéroboam célébra une fête le huitième mois, le quinzième jour du mois, comme la fête qu'on célébrait en<br />
Juda, et il monta à l'autel. Voilà comme il a agi à Béthel, sacrifiant <strong>aux</strong> ve<strong>aux</strong> qu'il avait faits, et il établit à Béthel<br />
les prêtres des hauts lieux, qu'il avait institués.<br />
pour les Israélites et il monta à l'autel pour offrir le sacrifice.<br />
Nous avons ici la description de la division des deux règnes. Roboam monte se faire sacrer<br />
roi à Sichem. Le roi du nord avait besoin de la reconnaissance du peuple. Jéroboam qui avait<br />
tenté un coup d’état manqué et avait fuit en Egypte, revient. Le peuple demande une<br />
réduction des corvées, mais il ne s’agit pas trav<strong>aux</strong> forcés dans le sens d’une peine à laquelle<br />
on est condamné : il s’agit de taxes payées en nature de travail. Cet aspect était antipathique<br />
au peuple et Salomon l’a utilisé pour le Temple et le renforcement des murailles. Le peuple<br />
demande donc cela à Roboam au Nord. Le conseil de Roboam demande d’accepter, mais les<br />
jeunes disent de doubler les charges. La conséquence est le schisme aggravé par le fait que<br />
Roboam s’enfuit à Jérusalem et envoie en parlementaire le fonctionnaire des trav<strong>aux</strong> forcés<br />
qui est lynché : c’est la fin des relations entre le nord et le Sud. 2Sam 5,1-5 montre déjà un<br />
dualisme. Ici l’expression anciens est utilisé pour les personnages de la cour de Juda. Le texte<br />
nous présente Jéroboam. Attention à ne pas confondre : Roboam est le roi du Sud<br />
successeur de Salomon et Jéroboam est l’usurpateur du Nord. Jéroboam est présenté<br />
comme anti-David. Mais il reçoit un oracle prophétique qui fait écho à celle de nathan.<br />
Pour éviter les pèlerinages à Jérusalem, il revendique les sanctuaires du sud : Béthel (des<br />
patriarches) et du nord, Dan (cf. Juges 17-18). Le Dieu d’Israël est représenté par un jeune<br />
taureau. C’est un animal symbolique (au sud les chérubins et au nord le jeune taureau). Les<br />
chérubins ne sont pas un problème en soi, mais le jeune taureau est la représentation de<br />
baal ou hadad, dieu de la fécondité. Un symbolisme de ce genre ouvrait le passage à<br />
beaucoup de chose du paganisme.<br />
1Roi 12,28b : « Après avoir délibéré, il fit deux ve<strong>aux</strong> d'or et dit au peuple : "Assez longtemps<br />
vous êtes montés à Jérusalem ! Israël, voici ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Egypte." »<br />
C’est la phrase de Exode 32,4 dans la bouche de Jéroboam. La vrai traduction dans les deux<br />
110
cas serait voici tes dieux. Elohim peut être dieu ou bien le pluriel de ‘el. Dans ce cas les<br />
verbes sont au pluriel. C’est une profession de foi païenne.<br />
Le motif de ce schisme : la soif autocratique du jeune roi qui exaspère le peuple dans son<br />
mécontentement. Il y a comme un plan réel divin et c’est comme si le Seigneur déterminait<br />
la situation. L’oracle dit cela. Si on lit l’oracle de 1Roi 11,26s, Dieu veut punir la maison de<br />
David pour son infidélité. Le péché de Jéroboam devient (1Roi 13,34) cause du malheur du<br />
peuple. Les critiques prophétiques sont réduites à cette critique de type cultuelle.<br />
Le péché de la maison est un péché d’idolâtrie et d’avoir continué à accomplir des péchés<br />
d’idolâtrie dans la suite.<br />
Cette histoire du péché des rois d’Israël, dont Jéroboam, est le fil rouge de toute l’histoire du<br />
nord.<br />
2.7 La fin d’Israël, Lecture de 2Roi 17<br />
[1] En la douzième année d'Achaz, roi de Juda, Osée fils d'Ela devint roi sur Israël à Samarie ; il régna neuf ans.<br />
[2] Il fit ce qui déplaît à Yahvé, non pas pourtant comme les rois d'Israël ses prédécesseurs.<br />
[3] Salmanasar, roi d'Assyrie, monta contre Osée, qui se soumit à lui et lui paya tribut.<br />
[4] Mais le roi d'Assyrie découvrit qu'Osée le trahissait : celui-ci avait envoyé des messagers à Saïs, vers le roi<br />
d'Egypte, et il n'avait pas livré le tribut au roi d'Assyrie, comme chaque année. Alors le roi d'Assyrie le fit mettre<br />
en prison, chargé de chaînes.<br />
[5] Le roi d'Assyrie envahit tout le pays et vint assiéger Samarie, pendant trois ans.<br />
[6] En la neuvième année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et déporta les Israélites en Assyrie. Il les établit à<br />
Halah et sur le Habor, fleuve de Gozân, et dans les villes des Mèdes.<br />
[7] Cela arriva parce que les Israélites avaient péché contre Yahvé leur Dieu, qui les avait fait monter du pays<br />
d'Egypte, les soustrayant à l'emprise de Pharaon, roi d'Egypte. Ils adorèrent d'autres dieux,<br />
[8] ils suivirent les coutumes des nations que Yahvé avait chassées devant eux.<br />
[9] Les Israélites proférèrent des paroles inconvenantes contre Yahvé leur Dieu, ils se construisirent des hauts<br />
lieux partout où ils habitaient, depuis les tours de garde jusqu'<strong>aux</strong> villes fortes.<br />
[10] Ils se dressèrent des stèles et des pieux sacrés sur toute colline élevée et sous tout arbre verdoyant.<br />
[11] Ils sacrifièrent sur tous les hauts lieux à la manière des nations que Yahvé avait expulsées devant eux et ils y<br />
commirent de mauvaises actions, provoquant la colère de Yahvé.<br />
[12] Ils rendirent un culte <strong>aux</strong> idoles, alors que Yahvé leur avait dit : "Vous ne ferez pas cette chose-là."<br />
[13] Pourtant, Yahvé avait fait cette injonction à Israël et à Juda, par le ministère de tous les prophètes et de tous<br />
les voyants : "Convertissez-vous de votre mauvaise conduite, avait-il dit, et observez mes commandements et mes<br />
lois, selon toute la Loi que j'ai prescrite à vos pères et que je leur ai communiquée par le ministère de mes<br />
serviteurs les prophètes."<br />
[14] Mais ils n'obéirent pas et raidirent leur nuque plus que n'avaient fait leurs pères, qui n'avaient pas cru en<br />
Yahvé leur Dieu.<br />
[15] Ils méprisèrent ses lois, ainsi que l'alliance qu'il avait conclue avec leurs pères et les ordres formels qu'il leur<br />
avait intimés. A la poursuite de la Vanité, ils sont devenus vanité, à l'imitation des nations d'alentour, bien que<br />
Yahvé leur eût commandé de ne pas faire comme elles.<br />
[16] Ils rejetèrent tous les commandements de Yahvé leur Dieu, et se firent des idoles fondues, les deux ve<strong>aux</strong>, ils<br />
se firent un pieu sacré, ils se prosternèrent devant toute l'armée du ciel et rendirent un culte à Baal.<br />
[17] Ils firent passer leurs fils et leurs filles par le feu, ils pratiquèrent la divination et la sorcellerie, ils se vendirent<br />
pour faire le mal au regard de Yahvé, provoquant sa colère.<br />
[18] Alors Yahvé fut profondément irrité contre Israël et l'écarta de devant sa face. Il ne resta que la seule tribu de<br />
Juda.<br />
[19] Juda non plus n'observa pas les commandements de Yahvé son Dieu, et suivit les coutumes qu'Israël avait<br />
établies.<br />
[20] Et Yahvé repoussa toute la race d'Israël, il l'humilia et la livra <strong>aux</strong> pillards, tant qu'enfin il la rejeta loin de sa<br />
face.<br />
111
[21] Il avait, en effet, détaché Israël de la maison de David, et Israël avait proclamé roi Jéroboam fils de Nebat ;<br />
Jéroboam avait détourné Israël de Yahvé et l'avait entraîné dans un grand péché.<br />
[22] Les Israélites imitèrent le péché que Jéroboam avait commis, ils ne s'en détournèrent pas,<br />
[23] tant qu'enfin Yahvé écarta Israël de sa face, comme il l'avait annoncé par le ministère de ses serviteurs, les<br />
prophètes ; il déporta les Israélites loin de leur pays en Assyrie, où ils sont encore aujourd'hui.<br />
[24] Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Kuta, de Avva, de Hamat et de Sepharvayim et les établit<br />
dans les villes de la Samarie à la place des Israélites ; ils prirent possession de la Samarie et demeurèrent dans ses<br />
villes.<br />
[25] Au début de leur installation dans le pays, ils ne révéraient pas Yahvé et celui-ci envoya contre eux des lions,<br />
qui en firent un massacre.<br />
[26] Ils dirent au roi d'Assyrie : "Les nations que tu as déportées pour les établir dans les villes de la Samarie ne<br />
connaissent pas le rite du dieu du pays, et il a envoyé contre elles des lions. Ceux-ci les font mourir parce qu'elles<br />
ne connaissent pas le rite du dieu du pays."<br />
[27] Alors le roi d'Assyrie donna cet ordre : "Qu'on fasse partir là-bas l'un des prêtres que j'en ai déportés, qu'il<br />
aille s'y établir et qu'il leur enseigne le rite du dieu du pays."<br />
[28] Alors vint l'un des prêtres qu'on avait déportés de Samarie et il s'installa à Béthel ; il leur enseignait comment<br />
ils devaient révérer Yahvé.<br />
[29] Chaque nation se fit ses dieux et les mit dans les temples des hauts lieux, qu'avaient faits les Samaritains ;<br />
chaque nation agit ainsi dans les villes qu'elle habitait.<br />
[30] Les gens de Babylone avaient fait un Sukkot-Benot, les gens de Kuta un Nergal, les gens de Hamat un Ashima,<br />
[31] les Avvites un Nibhaz et un Tartaq, et les gens de Sepharvayim brûlaient leurs enfants au feu en l'honneur<br />
d'Adrammélek et d'Anammélek, dieux de Sepharvayim.<br />
[32] Ils révéraient aussi Yahvé et ils se firent, en les prenant parmi eux, des prêtres des hauts lieux, qui officiaient<br />
pour eux dans les temples des hauts lieux.<br />
[33] Ils révéraient Yahvé et ils servaient leurs dieux, selon le rite des nations d'où ils avaient été déportés.<br />
[34] Encore aujourd'hui, ils suivent leurs anciens rites. Ils ne révéraient pas Yahvé et ils ne se conformaient pas à<br />
ses règles et à ses rites, à la loi et <strong>aux</strong> commandements que Yahvé avait prescrits <strong>aux</strong> enfants de Jacob, à qui il<br />
avait imposé le nom d'Israël.<br />
[35] Yahvé avait conclu avec eux une alliance et il leur avait fait cette prescription : "Vous ne révérerez pas les<br />
dieux étrangers, vous ne vous prosternerez pas devant eux, vous ne leur rendrez pas de culte et vous ne leur<br />
offrirez pas de sacrifices.<br />
[36] C'est seulement à Yahvé, qui vous a fait monter du pays d'Egypte par la grande puissance de son bras étendu,<br />
qu'iront votre révérence, votre adoration et vos sacrifices.<br />
[37] Vous observerez les règles et les rites, la loi et les commandements qu'il vous a donnés par écrit pour vous y<br />
conformer toujours, et vous ne révérerez pas de dieux étrangers.<br />
[38] N'oubliez pas l'alliance que j'ai conclue avec vous et ne révérez pas de dieux étrangers,<br />
[39] révérez seulement Yahvé, votre Dieu, et il vous délivrera de la main de tous vos ennemis."<br />
[40] Mais ils n'obéirent pas, et ils continuent de suivre leur ancien rite.<br />
[41] Donc ces nations révéraient Yahvé et rendaient un culte à leurs idoles ; leurs enfants et les enfants de leurs<br />
enfants continuent de faire aujourd'hui comme avaient fait leurs pères.<br />
La chute du règne du nord est la synthèse de cette problématique. Vers le verset 7, l’auteur<br />
fait une synthèse de jugement sur la situation. Le roi fait ce qui est mal <strong>aux</strong> yeux du<br />
Seigneur, mais pas comme tous les autres, et en cette situation arrive Salmanasar.<br />
La chute est narrée de façon étroite : peu claires sont les circonstances historiques. Du<br />
verset 7-23 on voit comme un texte d’accusation.<br />
A partir du verset 21, Jéroboam est mis en avant. Israël dans sa totalité a accompli un<br />
nombre incroyable de fautes cultuelles. Il résulte que la marque interprétative du<br />
Deutéronome ressemble à Amos 5,26 : le culte de Samarie est veiné d’idolâtrie. Ce prophète<br />
prêche a Béthel : 4,1-3 ; 6,1-7 // Is 5,24 ; 31,1-3 ; Jr 2. Les dénonciations regardent<br />
exclusivement les fautes cultuelles.<br />
112
Cette théologie de la parole de Dieu est particulière. Une fois donné le nom de Dieu, tout est<br />
annoncé et déterminé. Le prophète voit quelque chose et le cause, le fait être. L’histoire<br />
d’Israël est une histoire de révolte. L’infidélité est infidélité à la loi. Ceci annonce de graves<br />
catastrophes qui s’avéreront. Les prophètes ont la fonction de se faire porteurs de ces<br />
annonces de mésaventure. On voit le schéma : prédiction/accomplissement. Pour l’auteur<br />
Deutéronomiste, la vraie histoire est la parole de Dieu qui ne laisse pas tomber sa parole.<br />
Ainsi il peut se donner que la parole s’avère sous le règne d’un roi qui n’est pas pire que les<br />
autres. Cette parole prononcée tombe et s’avère. Il y a une espèce de déterminisme de la<br />
parole de Dieu pour le Deutéronomiste (le mot est fort !). Une fois mise en œuvre, la parole<br />
de Dieu détermine les évènements. L’homme peut éloigner la réalisation de la parole de<br />
Dieu, mais pas l’éviter. Au péché succède la catastrophe. La conversion n’a pas d’espace<br />
sinon en tant qu’elle peut retarder la catastrophe jusqu’à ce qu’elle surgisse.<br />
Voilà pour l’histoire Deutéronomiste.<br />
Les autres deux grands livres historiques : Les Chroniques et les Maccabées<br />
3. LES CHRONIQUES<br />
3.1 Le genre littéraire :<br />
La définition est contenu dans le nom lui-même que la traditions nous enseigne : Chronique<br />
qui en hébreu donne dibrê hayyamîm c'est-à-dire les paroles ou choses des jours. Cette<br />
expression se trouve en 1Roi 14,19 ; 1Roi 14,29.<br />
Dans la LXX, les livres ont pris le nom de , c'est-à-dire des évènements<br />
historiques.<br />
Dans le canon juif, ils sont mis dans les kétoubim et à la dernière place dans l’ordre<br />
canonique.<br />
Pour la LXX c’est dans les livres historiques. Ceci semble être témoigné par le Nouveau<br />
Testament. En Mt 23,35 et Lc 11,51, on parle des délits de sang témoigné dans l’histoire<br />
sacrée : l’assassinat d’Abel et l’assassinat du prêtre Zacharie entre le temple et l’autel (2Chr<br />
24,20-22) qui n’est pas présent dans le livre des rois. L’ordre canonique serait donc le même<br />
que celui que l’on connaît. La division du livre en deux n’est pas originaire. Elle n’apparaît<br />
pas avant le 15 ème siècle, c’est de type éditorial.<br />
113
3.2 Auteur et époque :<br />
Jusqu’à des temps proches on a pensé que 1 et 2 Ch, Néhémie et Esdras serait du même<br />
auteur. Cette idée à une forme plus traditionnelle qui l’identifie avec Esdras et on le trouve<br />
aussi dans la tradition juive. Cette idée de la paternité d’Esdras est celle qui a le plus résistée<br />
et qui est encore évaluée.<br />
Mais il y a un problème : il est difficile d’attribuer à la même main tout le complexe d’Esdras<br />
et Néhémie qui semble venir de mains différentes. Cette parenté a une forme plus moderne<br />
qui dit qu’il y aurait un auteur des chroniques qui aurait rédigé l’ensemble de ces livres avec<br />
des sources le précédant et en synoptique avec les Histoires Deutéronomistes. A la fin des<br />
années 60 du siècle dernier cette théorie fut mise en discussion par Sarah Japhet qui dans<br />
son commentaire Old Testament Library conteste cette idée. C’est la première qui dit de ne<br />
pas mettre ensemble tout cela : Chronique et Esdras/Néhémie n’ont pas le même auteur. Il y<br />
a des différences linguistiques, stylistiques, etc.… et des différences théologiques entre les<br />
deux. En particulier elle souligne le fait que Esdras et Néhémie se présentent comme une<br />
tentative de rénover l’histoire biblique tout en partant de l’histoire Deutéronomiste. (Esdras<br />
et Néhémie sont un seul livre eux aussi). Ils veulent innover de façon formelle et<br />
chronologique. Chronique est plus conforme au vieux style. Esdras et Néhémie sont plus<br />
modernes.<br />
Les observations de Sarah sont vraies et pleine de sens. Mais Esdras se présente comme la<br />
continuation de Chronique et souligne le lien avec Chronique en reprenant :<br />
2Ch 36, 23 : « "Ainsi parle Cyrus, roi de Perse: Yahvé, le Dieu du ciel, m'a remis tous les royaumes de la<br />
terre; c'est lui qui m'a chargé de lui bâtir un Temple à Jérusalem, en Juda. Quiconque, parmi vous, fait<br />
partie de tout son peuple, que son Dieu soit avec lui et qu'il monte!" »<br />
Esdras 1,1 : « Or la première année de Cyrus, roi de Perse, pour accomplir la parole de Yahvé<br />
prononcée par Jérémie, Yahvé éveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit proclamer - et même<br />
afficher - dans tout son royaume : [2] "Ainsi parle Cyrus, roi de Perse : Yahvé, le Dieu du ciel, m'a remis<br />
tous les royaumes de la terre, c'est lui qui m'a chargé de lui bâtir un Temple à Jérusalem, en Juda. [3]<br />
Quiconque, parmi vous, fait partie de tout son peuple, que son Dieu soit avec lui ! Qu'il monte à<br />
Jérusalem, en Juda, et bâtisse le Temple de Yahvé, le Dieu d'Israël - c'est le Dieu qui est à Jérusalem ».<br />
114
Esdras est donc un continuateur et on ne peut pas parler de textes opposés ou<br />
indépendants. Il y a une unité entre Esdras, Néhémie et Chronique. On peut donc parler<br />
encore de l’œuvre du chroniqueur. Le rédacteur a voulu donner à son oeuvre une continuité.<br />
Des critiques allemands ont parlé d’éléments secondaires et primaires : les chroniques<br />
seraient composées sur le modèle du Pentateuque avec des documents retaillés. Cette école<br />
sur la ligne des idées de rédaction du Pentateuque a proposé des théories semblables pour<br />
les Chroniques.<br />
Martin Noth soutient plutôt une première composition ensuite enrichie et développée.<br />
Aucune de ces propositions ne se présente de façon satisfaisante : le chroniqueur utilise des<br />
sources qui nous sont connues : le Deutéronomiste. C’est une opération de relecture<br />
Deutéronomiste. Donc les allemands lisent le chroniqueur sans ce qu’il y a avant. La<br />
discontinuité existe, mais c’est plus un phénomène de rédaction.<br />
Il faut écarter l’hypothèse traditionnelle qui attribue Chronique à Esdras (2 ème moitié du 6 ème<br />
siècle ou début du 5 ème ). Les années de la reconstruction du temple sont environ en 520-515.<br />
Si Esdras avait écrit ce texte on ne pourrait pas penser à une forme de culte aussi<br />
développée comme dans les Chroniques.<br />
En certains points le texte se détache du Deutéronomiste et montre une langue tardive et<br />
qui n’est plus le classique. Mais il ne montre aucun signe d’influence hellénique, ni<br />
linguistique, ni théologique. On peut proposer une date autour du 4 ème siècle.<br />
3.3 Perspective théologique de l’histoire du chroniqueur<br />
Le but est de donner une nouvelle interprétation théologique.<br />
Le fait que cette interprétation s’explicite dans la narration historique, est de la plus grande<br />
importance.<br />
Nous sommes dans un point où faire de l’histoire résulte insuffisant et demande une<br />
nouvelle interprétation. Tant l’auteur Deutéronomiste que le chroniqueur partent du fait<br />
que l’histoire est le lieu privilégiée de la relation entre Israël et son Dieu. Dans la vision<br />
classique l’histoire de Dieu avec son peuple est une succession d’alliance ; pour le<br />
chroniqueur, la succession des alliances est moins importante. Le rapport entre Dieu et son<br />
peuple est une relation absolue, cosmique, celle qui lie le créateur et la créature. Il y a une<br />
emphase sur l’alliance, pour passer au fait que le rapport de Dieu avec son peuple est<br />
115
comme le reflet d’une relation cosmique, créaturale. Pour le chroniqueur, l’élection de David<br />
est le moment fondamental de l’histoire d’Israël. Tout ce qui est précédent est narré par des<br />
généalogies de façon succincte (9 premiers chapitres) ; en ces généalogies, Abraham est<br />
nommé non comme le premier destinataire de l’alliance, mais comme le premier Père<br />
d’Israël. On ne parle pas de Moise ni du Sinaï ; David est le sommet de l’histoire d’Israël. Tout<br />
culmine dans la tribu de Juda et du clan davidique. Or à cette époque la monarchie n’existe<br />
plus et le clan de David n’a plus de relevance.<br />
La situation politique du chroniqueur est plus tranquille que celle du Deutéronomiste qui est<br />
catastrophique. Ici nous sommes dans une situation de stagnation. Les rapports<br />
économiques sont garantis, les taxes sont payées, la bureaucratie… on ne peut pas dire<br />
qu’Israël ait une force. L’empire perse ne tombera pas comme cela. Il tombe par<br />
l’intervention de Alexandre le grand.<br />
Au chroniqueur il n’intéresse pas d’expliquer une catastrophe par le péché, c’est trop loin<br />
dans le temps. Il veut se soulever à contempler à travers l’histoire le destin de sa nation sous<br />
un point de vue transcendant, métahistorique et toutes les alliances ne l’intéressent pas.<br />
Tout n’est pas idéalisé. Le péché du peuple et de qui le guide est bien présent. Il est clair que<br />
le péché ne peut pas porter à la rupture de l’alliance. Reste une théorie de la rétribution.<br />
Tout roi est jugé par sa fidélité à l’alliance. La punition est la manifestation de la justice<br />
infaillible de Dieu qui l’applique au pécheur de façon étroite. Mais le fait qu’il punit le<br />
pécheur montre qu’il est le roi d’Israël. Ce rapport ne se rompt pas. Tombe ce déterminisme<br />
de la parole de Dieu. Il y a une possibilité de pardon inconditionné et rien ne peut rompre ce<br />
rapport avec Dieu qui s’incarne en David et a en Israël toute son explication.<br />
David devient un saint, il n’y a plus de Bethsabée. C’est comme les images du 18 ème avec les<br />
enfants qui veulent être sœur dès le sein maternel.<br />
Mais du point de vue théologique on avance énormément : l’idée de la grâce : le rapport<br />
d’Israël avec son Dieu ne peut pas être réduit au problème de l’observation de la loi et donc<br />
aussi la punition est une image de la miséricorde. A cette époque la prophétie est morte,<br />
donc on ne peut pas faire un lien avec Ezéchiel.<br />
Nous avons donc une revisitation de la figure de David qui devient le dépositaire de l’alliance<br />
au prix d’une déshumanisation de sa personne.<br />
Ce que le chroniqueur développe d’une façon forte est la thématique du culte qui<br />
représente la partie humaine de la relation entre Dieu et son peuple. Le peuple est en<br />
116
elation avec Dieu par le culte. Le chroniqueur part de la vision Deutéronomiste et la vision<br />
du culte est importante. Nous avons vu que l’histoire Deutéronomiste est une vision laïque.<br />
Les sacrifices ne sont pas thématisés.<br />
Le chant est un aspect du culte. Peut-être que l’écrivain est un lévite chanteur. Ce<br />
témoignage de l’importance du culte dans le temple. Dans le code Sacerdotal on n’en parle<br />
jamais. La liturgie serait substantiellement muette. On décrit ce qui doit être fait. Mais on ne<br />
parle pas des formules ou du chant.<br />
Le Deutéronome développe l’aspect du culte comme louange à Dieu. Dieu élit son peuple et<br />
le peuple loue son Dieu avec le chant. C’est une perspective propre de l’auteur.<br />
David est comme un personnage collectif qui englobe tout Israël qui chante. David est celui<br />
qui met en ordre l’organisation du chant liturgique, et le chant n’est pas moins important<br />
que l’aspect sacrificiel. Le culte culmine dans le chant de louange. Le culte est de tout<br />
l’homme qui reflète son comportement moral. La justice est une partie intégrante du culte. Il<br />
n’y a pas de culte sans justice. L’expression la plus adéquate du culte est la justice : la<br />
confiance, la crainte de Dieu… L’acte du culte est inaccompli si il n’est pas fait par toute la<br />
personne. D’un point de vue de la valeur spirituelle du texte, le Deutéronomiste est un peu<br />
déprimant : l’histoire d’une tragédie historique qui finit mal. L’histoire du chroniqueur a un<br />
regard plus positif de l’histoire : l’espérance est comme développée et manifeste la joie,<br />
dans le culte.<br />
4. LES LIVRES DES MACCABEES<br />
4.1 Situation littéraire<br />
Ce sont des deutérocanoniques. Ils nous transportent dans une époque historique toute<br />
différente : la mort d’Alexandre le grand et le morcellement de son règne.<br />
Alexandre III de Macédoine meurt à Babylone le 23 juin 323 laissant un immense empire<br />
offert à la convoitise et à la concurrence de ses compagnons d’armes et successeurs, les<br />
Diadoques (successeurs) qui se le disputeront durant 40 ans avant d’établir un partage en 4<br />
royaumes qui seront constamment en guerre entre eux. C’est le temps des royautés<br />
hellénistiques.<br />
Les plus avisé d’entre eux, Ptolémée, fils de Lagos, macédonien, renonça le premier à régner<br />
sur la totalité de cet empire démesuré et se contenta de l’Egypte où il établit pour 250 ans la<br />
117
dynastie Lagide. Il fit d’Alexandrie la nouvelle capitale de l’Egypte, et elle devint la métropole<br />
commerciale et culturelle de l’Orient méditerranéen.<br />
Séleucos s’était octroyé la Babylonie et combattit plusieurs années pour obtenir l’hégémonie<br />
sur les satrapies du nord de la Mésopotamie et de l’Iran. A l’issue de vingt ans de guerres (en<br />
301), la dynastie séleucide règne sur toute la partie orientale de l’empire d’Alexandre, du<br />
Taurus à l’Indus, avec sa capitale à Antioche.<br />
La Judée, épuisée par cette guerre syrienne accepta d’abord favorablement ce changement<br />
de maître, Antiochos III ayant su se montrer magnanime. Mais ses successeurs Séleucos IV et<br />
Antiochos IV, en proie à de graves difficultés financières, accentuèrent la pression fiscale et<br />
le second tenta d’imposer par la violence le processus d’hellénisation de la société juive.<br />
C’est ce qui provoqua en 167 la révolte nationaliste juive sous la conduite des Maccabées.<br />
Ceux-ci seront assez habiles pour se concilier l’appui des romains qui voyaient en eux d’utiles<br />
alliés contre les royaumes hellénistiques d’Orient à bout de souffle. Le royaume juif<br />
asmonéen issu de cette révolte se maintint avec succès grâce à cet équilibre jusqu’à<br />
l’avènement d’Alexandre Jannée (104-76). Celui-ci renoua avec une politique anti-romaine,<br />
faisant alliance avec différents royaumes orient<strong>aux</strong> qui tentaient de résister à Rome : le<br />
royaume du Pont avec Mithridate, le royaume d’Arménie avec Tigrane, le puissant Parthe.<br />
Cette politique entraîna l’intervention militaire de Rome et c’est Pompée qui établit la<br />
domination romaine sur la Syro-palestine en 64-63.<br />
L’histoire des règnes des Diadoques est donc très compliquée. Il suffit de fixer que en Egypte<br />
émerge la dynastie Lagide dont le chef est Ptolémée I Lago. Tous ces successeurs prendront<br />
le nom de Ptolémée et il y a un deuxième nom qui est de couronnement, ainsi nous avons<br />
par exemple Ptolémée I Lago Sôter.<br />
En Syrie-Babylone nous avons les Séleucides avec comme fondateur le général Séleucus I<br />
Nicator. La politique lagide tend au respect des traditions, au contraire la monarchie<br />
Séleucide était un mélange de peuples et ils retournent à la tradition syro-babylonienne.<br />
Cesse donc la politique religieuse de Cyrus le Grand et le roi est divinisé de façon hellénique<br />
et il y a une adoption des coutumes grecque. L’hellénisme devient l’élément unificateur. La<br />
Judée reste sous domination Lagide jusqu’en 200. Ensuite elle est conquise par Antioche III<br />
le Grand et son fils Antioche IV Epiphane (= le dieu manifeste) introduit cette hellénisation<br />
forcée qui donne la révolte.<br />
118
Le livre des Maccabées parle de cette révolte qui commence en 167 avec le prêtre<br />
Mattathias et se poursuit avec le fils de ce prêtre qui est Judas Maccabée. Ceci portera à une<br />
certaine indépendance avec la dynastie des asmonéens. Elle s’éteint lorsque Hérode le<br />
Grand épouse la dernière reine Mariamne II. Le maître de justice de Qumran serait un de ces<br />
rois prêtres asmonéens ?<br />
Les livres partent de l’accession au trône de Antiochus Epiphane 165 jusqu’à la mort de<br />
Simon Maccabées en 134 ; le second livre commence un peu avant avec la fin du règne de<br />
Séleucus IV Philopator qui est le frère et prédécesseur de Antiochus Epiphane. Ce livre<br />
s’arrête aussi avant : avant la mort de Judas Maccabée.<br />
Ce sont deux œuvres profondément différentes entre elles : pas le même auteur ni la même<br />
perspective théologique.<br />
4.2 Caractéristiques littéraires<br />
Le 1 er Maccabées serait la traduction grecque d’un original sémitique perdu. Le second est<br />
une vraie œuvre de historiographie hellénique. C’est l’épitomé d’un certain Jason de Cyrène,<br />
soit le résumé d’une œuvre plus vaste. Cette œuvre ne nous est pas arrivée et nous n’avons<br />
pas de nouvelle de ce personnage. Nous ne savons pas qui a résumé en un seul livre l’œuvre<br />
en 5 livres de Jason. Ces deux livres sont caractérisés de façon différente.<br />
La première est une imitation de l’histoire Deutéronomiste et des classiques. Il dérive d’un<br />
judaïsme palestinien. La deuxième œuvre est un texte qui reflète la préoccupation d’un<br />
judaïsme d’une culture et langue totalement différentes.<br />
Le 1 er est écrit avant la conquête de Jérusalem par Pompé en 63 car il donne une vision<br />
positive des Romains (ce qui ne serait pas arrivé si l’auteur avait su que Pompé avait conquis<br />
la ville en 166 et était entré dans le Saint des saints). C’est le terminus post quem. Le<br />
terminus ante quem est que le livre connaît le monument funèbre des asmonéens qui date<br />
de 143. Soit entre 166-143. Soit vers la fin du deuxième siècle. Probablement dans la<br />
dernière partie du règne de Jean Hyrcan I qui règne de 134 à 104.<br />
Le deuxième livre est plus antique. Il est écrit en Egypte à Alexandrie et était fini avant 144<br />
parce que c’est la date des deux lettres qui ouvrent le texte. Jason de Cyrène aurait écrit ces<br />
livres vers 160.<br />
119
4.3 Perspectives théologiques<br />
Les livres sont donc différents.<br />
Le premier est un souteneur de la mission providentielle des asmonéens. Les Maccabées<br />
sont ceux qui ont finalement rapporté l’indépendance du peuple. L’auteur du premier livre<br />
est sceptique sur les valeurs héroïques personnelles et le martyr, la résurrection, la vie dans<br />
l’au-delà, des miracles, de la prophétie qu’il considère finie, 1M 9,27. Nationalisme politique<br />
presque extrémiste. Bref tout cela concorde avec le peu que l’on sait de la tradition<br />
saducéenne.<br />
Le deuxième ne perd pas occasion pour affirmer ces doctrines. Résurrection au chapitre 7,<br />
intercession 2M 12,38-45, les miracles et l’intervention divine : 3,24-40. Du point de vue<br />
politique on voit d’autres figures que Judas Maccabées qu pourtant il respecte : Le prêtre<br />
Onias III. Les frères de Judas n’ont pas d’importance (différente dans le premier livre).<br />
Il ne faut pas cependant sous-évaluer le lien entre les deux livres : ce qui caractérise le<br />
peuple d’Israël est la fidélité à la loi (1M 1,56s) qui est la Torah. Cette fidélité s’exprime dans<br />
le refus des pratiques idolâtriques, la circoncision, les normes de la kascher et l’observation<br />
du shabbat. La mort est préférable à la violation de ces normes. Nous sommes dans le plein<br />
judaïsme. Le martyr assume de l’importance même si il est évalué différemment : dans le<br />
premier c’est généreux mais peu réaliste. Dans le deuxième c’est fort. Ce qui compte en tout<br />
cas est la fidélité à la Torah.<br />
4.4 Lecture de 2Maccabées 7<br />
[1] Il arriva aussi que sept frères ayant été arrêtés avec leur mère, le roi voulut les contraindre, en leur infligeant les<br />
fouets et les nerfs de boeuf, à toucher à la viande de porc (interdite par la loi).<br />
[2] L'un d'eux se faisant leur porte-parole : "Que vas-tu, dit-il, demander et apprendre de nous ? Nous sommes prêts à<br />
mourir plutôt que d'enfreindre les lois de nos pères."<br />
[3] Le roi, hors de lui, fit mettre sur le feu des poêles et des chaudrons.<br />
[4] Sitôt qu'ils furent brûlants, il ordonna de couper la langue à celui qui avait été leur porte-parole, de lui enlever la peau<br />
de la tête et de lui trancher les extrémités, sous les yeux de ses autres frères et de sa mère.<br />
[5] Lorsqu'il fut complètement impotent, il commanda de l'approcher du feu, respirant encore, et de le faire passer à la<br />
poêle. Tandis que la vapeur de la poêle se répandait au loin, les autres s'exhortaient mutuellement avec leur mère à<br />
mourir avec vaillance.<br />
[6] "Le Seigneur Dieu voit, disaient-ils, et il a en vérité cette compassion de nous selon que Moïse l'a annoncé par le<br />
cantique qui proteste ouvertement en ces termes : Et il aura pitié de ses serviteurs."<br />
[7] Lorsque le premier eut quitté la vie de cette manière, on amena le second pour le supplice. Après lui avoir arraché la<br />
peau de la tête avec les cheveux, on lui demandait : "Veux-tu manger du porc, avant que ton corps soit torturé membre<br />
par membre ?"<br />
[8] Il répondit dans la langue de ses pères : "Non !" C'est pourquoi lui aussi fut à son tour soumis <strong>aux</strong> tourments.<br />
[9] Au moment de rendre le dernier soupir : "Scélérat que tu es, dit-il, tu nous exclus de cette vie présente, mais le Roi du<br />
monde nous ressuscitera pour une vie éternelle, nous qui mourons pour ses lois."<br />
[10] Après lui on châtia le troisième. Il présenta aussitôt sa langue comme on le lui demandait et tendit ses mains avec<br />
intrépidité ;<br />
120
[11] il déclara courageusement : "C'est du Ciel que je tiens ces membres, mais à cause de ses lois je les méprise et c'est<br />
de lui que j'espère les recouvrer de nouveau.)"<br />
[12] Le roi lui-même et son escorte furent frappés du courage de ce jeune homme qui comptait les souffrances pour rien.<br />
[13] Ce dernier une fois mort, on soumit le quatrième <strong>aux</strong> mêmes tourments et tortures.<br />
[14] Sur le point d'expirer il s'exprima de la sorte : "Mieux vaut mourir de la main des hommes en tenant de Dieu l'espoir<br />
d'être ressuscité par lui, car pour toi il n'y aura pas de résurrection à la vie."<br />
[15] On amena ensuite le cinquième et on le tortura.<br />
[16] Mais lui, fixant les yeux sur le roi, lui disait : "Tu as, quoique corruptible, autorité sur les hommes, tu fais ce que tu<br />
veux. Ne pense pas cependant que notre race soit abandonnée de Dieu.<br />
[17] Pour toi, prends patience et tu verras sa grande puissance, comme il te tourmentera toi et ta race."<br />
[18] Après celui-là ils amenèrent le sixième, qui dit, sur le point de mourir : "Ne te fais pas de vaine illusion, c'est à cause<br />
de nous-mêmes que nous souffrons cela, ayant péché envers notre propre Dieu (aussi nous est-il arrivé des choses<br />
étonnantes).<br />
[19] Mais toi, ne t'imagine pas que tu seras impuni après avoir entrepris de faire la guerre à Dieu."<br />
[20] Eminemment admirable et digne d'une illustre mémoire fut la mère qui, voyant mourir ses sept fils dans l'espace<br />
d'un seul jour, le supporta courageusement en vertu des espérances qu'elle plaçait dans le Seigneur.<br />
[21] Elle exhortait chacun d'eux, dans la langue de ses pères, et, remplie de nobles sentiments, elle animait d'un mâle<br />
courage son raisonnement de femme :<br />
[22] "Je ne sais comment vous avez apparu dans mes entrailles ; ce n'est pas moi qui vous ai gratifiés de l'esprit et de la<br />
vie ; ce n'est pas moi qui ai organisé les éléments qui composent chacun de vous.<br />
[23] Aussi bien le Créateur du monde, qui a formé le genre humain et qui est à l'origine de toute chose, vous rendra-t-il,<br />
dans sa miséricorde, et l'esprit et la vie, parce que vous vous méprisez maintenant vous-mêmes pour l'amour de ses lois."<br />
[24] Antiochus se crut vilipendé et soupçonna un outrage dans ces paroles. Comme le plus jeune était encore en vie, non<br />
seulement il l'exhortait par des paroles, mais il lui donnait par des serments l'assurance de le rendre à la fois riche et très<br />
heureux, s'il abandonnait les traditions ancestrales, d'en faire son ami et de lui confier de hauts emplois.<br />
[25] Le jeune homme ne prêtant à cela aucune attention, le roi fit approcher la mère et l'engagea à donner à l'adolescent<br />
des conseils pour sauver sa vie.<br />
[26] Lorsqu'il l'eut longuement exhortée, elle consentit à persuader son fils.<br />
[27] Elle se pencha donc vers lui et, mystifiant le tyran cruel, elle s'exprima de la sorte dans la langue de ses pères : "Mon<br />
fils, aie pitié de moi qui t'ai porté neuf mois dans mon sein, qui t'ai allaité trois ans, qui t'ai nourri et élevé jusqu'â l'âge où<br />
tu es (et pourvu à ton entretien).<br />
[28] Je t'en conjure, mon enfant, regarde le ciel et la terre et vois tout ce qui est en eux, et sache que Dieu les a faits de<br />
rien et que la race des hommes est faite de la même manière.<br />
[29] Ne crains pas ce bourreau, mais, te montrant digne de tes frères, accepte la mort, afin que je te retrouve avec eux<br />
dans la miséricorde."<br />
[30] A peine achevait-elle de parler que le jeune homme dit : "Qu'attendez-vous ? Je n'obéis pas <strong>aux</strong> ordres du roi, j'obéis<br />
<strong>aux</strong> ordres de la Loi qui a été donnée à nos pères par Moïse.<br />
[31] Et toi, qui t'es fait l'inventeur de toute la calamité qui fond sur les Hébreux, tu n'échapperas pas <strong>aux</strong> mains de Dieu.<br />
[32] (Nous autres, nous souffrons à cause de nos propres péchés.)<br />
[33] Si, pour notre châtiment et notre correction, notre Seigneur qui est vivant s'est courroucé un moment contre nous, il<br />
se réconciliera de nouveau avec ses serviteurs.<br />
[34] Mais toi, ô impie et le plus infect de tous les hommes, ne t'élève pas sans raison, te berçant de vains espoirs et<br />
levant la main contre ses serviteurs,<br />
[35] car tu n'as pas encore échappé au jugement de Dieu qui peut tout et qui voit tout.<br />
[36] Quant à nos frères, après avoir supporté une douleur passagère, en vue d'une vie intarissable, ils sont tombés pour<br />
l'alliance de Dieu, tandis que toi, par le jugement de Dieu, tu porteras le juste châtiment de ton orgueil.<br />
[37] Pour moi, je livre comme mes frères mon corps et ma vie pour les lois de mes pères, suppliant Dieu d'être bientôt<br />
favorable à notre nation et de t'amener par les épreuves et les flé<strong>aux</strong> à confesser qu'il est le seul Dieu.<br />
[38] Puisse enfin s'arrêter sur moi et sur mes frères la colère du Tout-Puissant justement déchaînée sur toute notre race<br />
!"<br />
[39] Le roi, hors de lui, sévit contre ce dernier encore plus cruellement que contre les autres, le sarcasme lui étant<br />
particulièrement amer.<br />
[40] Ainsi trépassa le jeune homme, sans s'être souillé, et avec une parfaite confiance dans le Seigneur.<br />
[41] Enfin la mère mourut la dernière, après ses fils.<br />
[42] Mais en voilà assez sur la question des repas rituels et des tortures monstrueuses.<br />
Ce texte est très connu et fut souvent utilisé. Nous voyons comment est caractéristique :<br />
• Les martyrs acceptent avec joie leur issue pour les choses que le monde considère<br />
comme folles.<br />
• Les dialogues entre les condamnés.<br />
121
• Les descriptions des tortures.<br />
• L’admiration des païens sous les souffrances.<br />
D’un point de vue théologique il faut souligner l’espérance dans la résurrection et<br />
l’espérance sur le pouvoir rédempteur du martyr. Le martyr obtient les grâces de Dieu pour<br />
soi et la nation.<br />
Seuls les martyrs avec leur souffrances causent l’intervention de Dieu. C’est un outil pour<br />
susciter l’action de Dieu pour l’innocent frappé. Ce qui est innovateur dans ce texte est<br />
d’appliquer cette idée au martyr. La Lettre <strong>aux</strong> Hébreux fait référence à ce texte 11,35.<br />
La tentation est la viande de porc et le péché d’idolâtrie. Il est difficile de douter de la<br />
souffrance des tortures. Le premier frère énonce la prémisse. Le deuxième explicite et le<br />
troisième ajoute qu’ils retrouveront les membres, le quatrième dit qu’Antiochus n’aura pas<br />
de part, le cinquième dit qu’Israël sera vengé et le sixième dit que. Tout se conclu avec le<br />
septième frère et sa mère.<br />
Nous voyons l’aspiration la plus profonde de tout Israël. L’homme peut-il être fidèle<br />
jusqu’au bout à Dieu et à la Torah ? Le Nouveau Testament donnera une réponse.<br />
122
LES LIVRES HISTORIQUES............................................................................................................ 1<br />
1. LE PENTATEUQUE........................................................................................................... 2<br />
1.1 <strong>Introduction</strong> au Pentateuque................................................................................. 2<br />
1.1.1 Le nom........................................................................................................ 2<br />
1.1.2 L’auteur ...................................................................................................... 2<br />
1.1.3 Origine de la théorie documentaire classique : ......................................... 3<br />
1.1.4 Exposition systématique de Graf et Wellhausen. ...................................... 6<br />
1.1.5 Evaluation de la théorie fragmentaire ..................................................... 10<br />
1.1.6 Possibilité de proposition différente : la proposition de R. Rendtorff..... 12<br />
1.1.7 Une révolution copernicienne : les méthodes synchroniques ................ 13<br />
1.2 LA GENESE ............................................................................................................ 16<br />
1.2.1 Structure du livre...................................................................................... 16<br />
1.2.2 Lecture de Genèse 1,1-2,4a. :................................................................... 17<br />
1.2.3 Lecture de Gn 2,4-25................................................................................ 28<br />
1.2.4 Lecture de Gn 3 ........................................................................................ 33<br />
Annexe au point 1.2.4 Reprise de la question sur comment interpréter ces textes<br />
qui sont très important en tant que fondement du dogme du péché originel ? .... 36<br />
1.2.5 <strong>Introduction</strong> <strong>aux</strong> Histoires Patriarcales.................................................... 38<br />
1.2.5.1 Arbre des origines des patriarches.................................................... 41<br />
1.2.6 Lecture théologique des histoires patriarcales........................................ 44<br />
1.2.6.1 Lecture de Gn 12,1-9 :....................................................................... 46<br />
1.2.6.2 Lecture de Genèse 22, 1-19 :............................................................. 48<br />
1.2.7 Un cycle narratif à part dans les histoires patriarcales : l’histoire de<br />
Joseph Chapitre 37s ................................................................................................. 52<br />
1.2.7.1 Lecture de Genèse 37 :...................................................................... 53<br />
1.2.7.2 Lecture de Genèse 44 :...................................................................... 55<br />
1.3 L’EXODE ET LES LIVRES SUCCESSIFS ..................................................................... 57<br />
1.3.1 Structure du livre de l’Exode.................................................................... 57<br />
1.3.2 Lecture de Exode 3 : la vocation de Moïse et la révélation du Nom ....... 58<br />
1.3.3 Lecture d’Exode 14, le passage de la mer................................................ 62<br />
1.3.4 Ex 19-20 : Israël au Sinaï – Notes sur le code de l’alliance....................... 66<br />
123
1.3.4.1 Lecture d’Exode 19............................................................................ 66<br />
1.3.4.2 Lecture d’Exode 20 : le Décalogue .................................................... 69<br />
1.3.5 Le code Sacerdotal (Ex ; Lv ; Nb) .............................................................. 76<br />
1.3.5.1 Lecture de Exode 25.......................................................................... 78<br />
1.3.5.2 La conception Sacerdotale : .............................................................. 82<br />
1.3.5.3 Le code de sainteté dans le Lévitique chapitre 17-26....................... 83<br />
1.4 LE DEUTERONOME ............................................................................................... 85<br />
1.4.1 Structure du livre...................................................................................... 85<br />
1.4.2 Origine du livre......................................................................................... 85<br />
1.4.3 Concepts fondament<strong>aux</strong> du Deutéronome : ........................................... 86<br />
1.4.4 Lecture de Deut 6, 1-9 :............................................................................ 87<br />
2. L’HISTOIRE DEUTERONOMISTE .................................................................................... 89<br />
2.1 Exateuque ou Tétrateuque ?................................................................................ 90<br />
2.2 La Théologie de l’histoire ; le but de cette vision Deutéronomiste..................... 92<br />
2.3 La théologie de l’histoire à l’œuvre...................................................................... 93<br />
2.3.1 Lecture de Juges 2,6-23 ; le jugement sur la période des juges .............. 93<br />
2.3.2 Lecture de 1Sam 8-9 : le débat sur la monarchie .................................... 94<br />
2.4 L’historiographie en Israël : l’histoire de la succession de David......................... 98<br />
2.4.1 Israël et l’histoire ; lecture de 2Sam 7,1-17 ............................................. 98<br />
2.4.1.1 Le document que l’on appelle « Histoire de la succession au trône de<br />
David » 99<br />
2.4.2 Lecture de 2Sam 11 David et Bethsabée ............................................... 101<br />
2.5 Histoire de Salomon le grand, ascension et décadence .................................... 104<br />
2.5.1 Lecture de 1Roi 3,1-15 et 1Roi 11,1-13.................................................. 106<br />
2.5.2 Lecture de 1Roi 8,12-53. La dédicace du Temple .................................. 107<br />
2.6 Le schisme Lecture de 1Roi 12 ........................................................................... 109<br />
2.7 La fin d’Israël, Lecture de 2Roi 17 ...................................................................... 111<br />
3. LES CHRONIQUES ....................................................................................................... 113<br />
3.1 Le genre littéraire :............................................................................................. 113<br />
3.2 Auteur et époque : ............................................................................................. 114<br />
3.3 Perspective théologique de l’histoire du chroniqueur ...................................... 115<br />
4. LES LIVRES DES MACCABEES ...................................................................................... 117<br />
124
4.1 Situation littéraire .............................................................................................. 117<br />
4.2 Caractéristiques littéraires ................................................................................. 119<br />
4.3 Perspectives théologiques ................................................................................. 120<br />
4.4 Lecture de 2Maccabées 7................................................................................... 120<br />
125