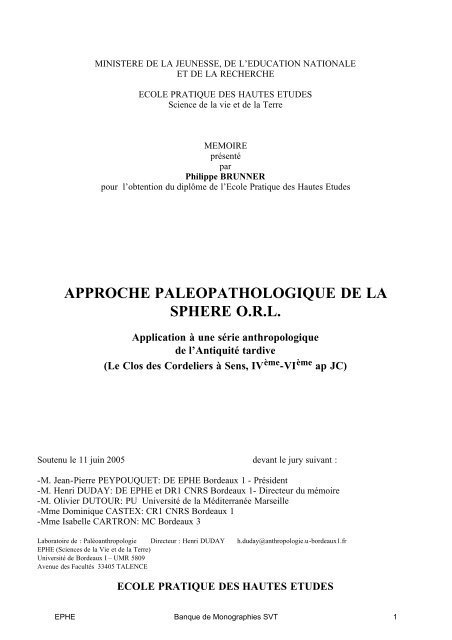Philippe BRUNNER - EPHE
Philippe BRUNNER - EPHE
Philippe BRUNNER - EPHE
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE L’EDUCATION NATIONALE<br />
ET DE LA RECHERCHE<br />
ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES<br />
Science de la vie et de la Terre<br />
MEMOIRE<br />
présenté<br />
par<br />
<strong>Philippe</strong> <strong>BRUNNER</strong><br />
pour l’obtention du diplôme de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes<br />
APPROCHE PALEOPATHOLOGIQUE DE LA<br />
SPHERE O.R.L.<br />
Application à une série anthropologique<br />
de l’Antiquité tardive<br />
(Le Clos des Cordeliers à Sens, IV ème -VI ème ap JC)<br />
Soutenu le 11 juin 2005 devant le jury suivant :<br />
-M. Jean-Pierre PEYPOUQUET: DE <strong>EPHE</strong> Bordeaux 1 - Président<br />
-M. Henri DUDAY: DE <strong>EPHE</strong> et DR1 CNRS Bordeaux 1- Directeur du mémoire<br />
-M. Olivier DUTOUR: PU Université de la Méditerranée Marseille<br />
-Mme Dominique CASTEX: CR1 CNRS Bordeaux 1<br />
-Mme Isabelle CARTRON: MC Bordeaux 3<br />
Laboratoire de : Paléoanthropologie Directeur : Henri DUDAY h.duday@anthropologie.u-bordeaux1.fr<br />
<strong>EPHE</strong> (Sciences de la Vie et de la Terre)<br />
Université de Bordeaux I – UMR 5809<br />
Avenue des Facultés 33405 TALENCE<br />
ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES<br />
<strong>EPHE</strong> Banque de Monographies SVT 1
RÉSUMÉ :<br />
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE<br />
APPROCHE PALEOPATHOLOGIQUE<br />
DE LA SPHERE O.R.L.<br />
Application à une série anthropologique<br />
De l’Antiquité tardive<br />
(Le Clos des Cordeliers à Sens, IV ème -VI ème ap JC)<br />
<strong>Philippe</strong> <strong>BRUNNER</strong><br />
11 juin 2005<br />
La pathologie O.R.L. n’a pratiquement jamais été abordée de façon globale et systématique<br />
dans la recherche sur des séries de squelettes anciens provenant de fouilles archéologiques.<br />
Certaines de ses affections ont donné lieu à publications, alors que pour d’autres tout reste à<br />
faire.<br />
Nous avons développé un protocole d’examen simple, et facile à mettre en œuvre quelle que<br />
soit la série anthropologique étudiée, et qui permette de passer au crible toutes les pathologies<br />
pouvant laisser des traces au niveau de l’os, pathologies que nous avons décrites et répertoriées dans<br />
les rappels cliniques.<br />
Une série de tableaux sur lequels sont colligés tous les résultats, permet in fine de visualiser<br />
un état de santé global de la population étudiée. Ils pourront être utilisés dans l’avenir pour une<br />
analyse statistique.<br />
Notre série d’étude, particulièrement homogène, puisqu’il s’agit d’une sépulture de catastrophe<br />
liée à une crise de mortalité due à la plus ancienne épidémie de peste authentifiée par les analyses<br />
paléobactériologiques, se situe entre les IVème et VIème siècles (datation radiocarbone ; Ly-8001),<br />
elle comprend 36 blocs crânio-faciaux.<br />
Nous avons découvert un important panel de pathologies, de malformations, et de variations<br />
anatomiques, au sein duquel prédominent les problèmes maxillo-dentaires.<br />
Nous décrivons ensuite des infections otologiques, et plusieurs cas d’hyperostose poreuse<br />
venant confirmer un état sanitaire d’ensemble plutôt médiocre. Nous rapportons ensuite de<br />
nombreuses anomalies restant à interpréter, et qui vont constituer l’ébauche d’une base de données.<br />
Un cas très intéressant de malformation mandibulaire à type d’agénésie condylienne<br />
unilatérale est décrit. Il s’inscrit dans le cadre actuel des microsomies hémifaciales ; deux cas<br />
seulement sont publiés dans la littérature paléopathologique.<br />
MOTS-CLES :<br />
Paléopathologie, O.R.L., oto-rhino-laryngologie, agénésie condylienne mandibulaire, microsomie<br />
hémifaciale, Sens (Yonne, France), mastoïdite, sinusite, otite, abcès dentaire, fistule buccosinusienne,<br />
déviation septale, osselets, Concha bullosa, Cribra orbitalia, Meatus acusticus internus.<br />
TABLE DES MATIÈRES<br />
Table des tableaux p 8<br />
<strong>EPHE</strong> Banque de Monographies SVT 2
Table des figures (dessins, photos et radiographies) p 9<br />
INTRODUCTION p 11<br />
CHAPITRE I = Rappels anatomiques et pathologiques p 15<br />
I Rappels anatomiques, embryologiques, et organogénétiques. p16<br />
A Organogénèse du splanchnocrâne p 16<br />
1 Organogénèse de la pneumatisation crânio-faciale humaine p 16<br />
(Intérêt d’une chronologie).<br />
2 Organogénèse de l’appareil manducateur. p 17<br />
3 Organogénèse de l’os temporal. p 17<br />
B Rappels anatomiques p 18<br />
1 Fosses nasales et sinus. p 18<br />
2 L’os temporal. p 19<br />
II Panorama de la pathologie p 20<br />
A Les maladies osseuses constitutionnelles p 20<br />
1 Maladies osseuses constitutionnelles sans pathogènie connue p 20<br />
a Ostéochondrodysplasies<br />
b Dysostoses avec atteinte du crâne et de la face<br />
2 Maladies osseuses constitutionnelles d’étiopathogénie connue p 22<br />
a Aberrations chromosomiques<br />
b Anomalies secondaires<br />
B Pathologie des fosses nasales et des sinus p 23<br />
1 Pathologie des fosses nasales p 23<br />
a Altérations structurales<br />
b Pathologie spéciale<br />
2 Pathologie des sinus p 26<br />
a Pathologies infectieuses : les sinusites<br />
b Mucocèles<br />
c Pneumosinus dilatans<br />
d Pathologies tumorales<br />
C Pathologie de l’oreille p 28<br />
<strong>EPHE</strong> Banque de Monographies SVT 3
1 Pathologies de l’oreille externe p 28<br />
2 Pathologies de l’oreille moyenne p 28<br />
a Otites aiguës<br />
b Otites chroniques<br />
c Pathologie ossiculaire<br />
d Tumeurs de l’oreille<br />
3 Pathologie de l’oreille interne p 30<br />
D Pathologie traumatique p 31<br />
III Bases du diagnostic en paléopathologie. p 32<br />
A Bases anatomo-pathologiques du diagnostic<br />
des infections squelettiques p 32<br />
1 Anatomo-pathologie des infections squelettiques p 32<br />
a Infections à pyogènes<br />
b Infections d’emblée chroniques<br />
2 Paléopathologie des infections squelettiques p 33<br />
B Bases anatomo-pathologiques du diagnostic des tumeurs p 33<br />
CHAPITRE II = Matériel et méthodes p 35<br />
I Matériel p 36<br />
A Matériel biologique : la série (DEA) p 36<br />
1 Situation de la série étudiée p 36<br />
2 Description de la population inhumée p 37<br />
a Estimation du sexe<br />
b Estimation de l’age<br />
c Résultats<br />
d Interprétation<br />
B Matériel physique p 39<br />
II Méthodes p 40<br />
A Etude paléopathologique de chaque spécimen p 40<br />
B Analyse globale de la population étudiée p 41<br />
1 Appréciation de l’état de conservation de la série p 41<br />
<strong>EPHE</strong> Banque de Monographies SVT 4
a Conservation des pièces osseuses I<br />
b Conservation des pièces osseuses II<br />
c Conservation des osselets<br />
d Inventaire dentaire<br />
2 Appréciation de l’état sanitaire de la population concernée p 42<br />
a Etat dentaire<br />
b Mensuration des conduits auditifs internes<br />
c Pathologies constatées<br />
CHAPITRE III = Résultats p 44<br />
Préambule. p 45<br />
I Les données individuelles p 46<br />
A groupe I p 46<br />
B groupe II p 51<br />
C groupe III p 52<br />
D groupe IV p 54<br />
II Les données globalisées p 56<br />
A Les tableaux de conservation p 56<br />
1 Conservation des pièces osseuses I p 56<br />
2 Conservation des pièces osseuses II p 56<br />
3 Conservation des osselets p 56<br />
4 Inventaire dentaire p 56<br />
B Les tableaux de constatations p 57<br />
1 Etat dentaire p 57<br />
2 Mensurations des conduits auditifs internes p 57<br />
3 Pathologies constatées p 57<br />
CHAPITRE IV = Discussion p 59<br />
I De l’aspect méthodologique p 60<br />
A Sur le choix de la série p 60<br />
B Sur la méthode de travail p 60<br />
C Sur le recueil des résultats p 61<br />
D Sur l’analyse des résultats p 61<br />
II De l’aspect paléopathologique p 64<br />
<strong>EPHE</strong> Banque de Monographies SVT 5
A A partir de chaque anomalie rencontrée p 64<br />
1 Pathologie par pathologie p 64<br />
a Pathologie de l’oreille<br />
-pathologie infectieuse<br />
-pathologie de l’oreille interne<br />
-pathologie de l’oreille externe<br />
-autres pathologies de la littérature<br />
b Pathologie des fosses nasales et des sinus<br />
-pathologie malformative et traumatique<br />
-pathologie tumorale<br />
-pathologie infectieuse<br />
*infections non spécifiques<br />
*infections spécifiques<br />
*parasitoses<br />
c Pathologie d’origine dentaire<br />
d Pathologie mandibulaire<br />
2 Les diagnostics différentiels, variations, et originalités p 74<br />
a Le problème des osselets<br />
b Les variations anatomiques<br />
-Concha bullosa<br />
-Variations de taille des sinus<br />
-Rapports du sinus latéral<br />
-Déhiscence du canal de tensor tympani<br />
-Problème du kyste congénital médian alvéolaire<br />
-Déhiscence des tympanaux<br />
c Les surprises<br />
B Approche d’un état sanitaire global p 77<br />
CONCLUSION p 79<br />
BIBLIOGRAPHIE p 84<br />
ANNEXES p 91<br />
RÉSUMÉ ET MOTS CLÉS p 131<br />
<strong>EPHE</strong> Banque de Monographies SVT 6
INTRODUCTION<br />
Si en paléopathologie de très nombreux travaux, et une multitude de publications ont été consacrés à<br />
tout ce qui touche à la pathologie ostéo-articulaire, et à la traumatologie, il semble que la pathologie<br />
ORL ait peu intéressé les chercheurs, surtout dans son approche globale.<br />
Notre spécialité, l’oto-rhino-laryngologie, nez-gorge-oreille disait-on autrefois, doit être démantelée<br />
au préalable, car pour ces patients particuliers que sont ces hommes, ces femmes, ou ces enfants<br />
d’anciennes époques, voire ces Hommes Fossiles, nous n’examinerons, sauf cas très particulier, que<br />
des crânes secs, ou souvent plutôt des fragments de crânes secs ! Sur ce type de pièce anatomique,<br />
l’otologiste et le rhinologiste pourront intervenir. Par contre le laryngologiste restera au chômage, tout<br />
son domaine se trouvant dans des tissus mous dont nous n’aurons pas conservé la trace, exception<br />
faite de quelques cartilages calcifiés, et du cas particulier des momies. Le larynx de l’Homme<br />
préhistorique reste un grand inconnu, bien que de nombreux chercheurs et linguistes se posent de<br />
passionnantes questions sur l’origine du langage et sur le moment possible de son apparition.<br />
L’homme de Neandertal ne fumait pas ; il s’enfumait certainement un peu dans ses abris sous roche,<br />
mais une laryngoscopie ne s’imposait pas. Nous verrons, plus sérieusement, que ce facteur fumée des<br />
foyers domestiques, à des époques où la cheminée n’existait pas, surtout dans les habitats des basses<br />
classes sociales, est à même d’induire des pathologies inflammatoires chronique de la muqueuse de la<br />
sphère ORL, au même titre que la pollution industrielle déjà très présente en zone urbaine au moyen<br />
age !<br />
La paléopathologie ORL peut être abordée dans deux optiques :<br />
-D’abord sous la forme d’une étude ciblée sur tel problème, telle maladie, avec des vues<br />
descriptives ou épidémiologiques, et cela pour des pathologies courantes, comme l’otite<br />
chronique par exemple, ou plus rares comme la lèpre, la syphilis.<br />
-Ensuite, avec une approche anthropologique et historique, en étudiant là, des séquelles de<br />
pathologies moins spectaculaires, otites, sinusites, anémies, problèmes dentaires, mais qui nous<br />
<strong>EPHE</strong> Banque de Monographies SVT 7
permettront plus sûrement d’apprécier un état sanitaire global pour une population donnée.<br />
Notre travail s’est d’abord attaché à faire un point aussi exhaustif que possible des connaissances<br />
actuelles associant oto-rhino-laryngologie et paléopathologie. Nous verrons que certaines pathologies<br />
ont donné lieu à de multiples publications : l’exemple type, qui nous a frappé dès nos premières<br />
recherches sur Internet, est celui des exostoses du conduit auditif externe, alors que d’autres ne sont<br />
pratiquement jamais abordées, comme le neurinome de l’acoustique !<br />
Cette sélection peut s’expliquer à notre avis, par la facilité de l’observation visuelle de certaines<br />
pièces, qui de plus se conservent bien et en grand nombre, comme dans notre premier exemple. A<br />
l’inverse sur ce même os temporal, dans le cas du second exemple, pour le même matériel d’étude,<br />
l’examen du conduit auditif interne s’avère impossible sur des crânes entiers en dehors de techniques<br />
tomodensitométriques onéreuses !<br />
Voici donc déjà deux facteurs déterminants les possibilités d’études et de publications :<br />
-En premier lieu une bonne conservation de l’os qui sera étudié, ce qui permettra de présenter une<br />
série significative ; ceci nous a amené à prévoir dans notre protocole, un tableau de conservation<br />
des constituants ostéologiques les uns par rapport aux autres (Tableaux I et II). Il est évident<br />
qu’un os temporal se conserve mieux qu’un ethmoïde ! Nous verrons grâce à ces tableaux, la<br />
gradation de conservation qui est elle moins évidente, des différents sinus de la face.<br />
-Puis la facilité de l’observation : facilité technique pour un conduit auditif externe qui s’examine<br />
à l’œil nu, opposée à la difficulté d’origine économique, liée à l’utilisation d’un matériel<br />
radiologique sophistiqué, pour mesurer des conduits auditifs internes.<br />
L’espoir de découverte d’une pathologie rare, comme une malformation mandibulaire, pour laquelle<br />
nous n’avons recensé que deux publications paléopathologiques, constitue un facteur supplémentaire<br />
d’intérêt pour l’étude d’une série donnée.<br />
L’objectif premier de cette étude était de mettre au point une méthodologie de travail pour une étude<br />
synthétique de pathologie ORL sur une série anthropologique. Nous avons donc réfléchi à partir de<br />
nos connaissances cliniques, confrontées à la revue de la littérature que nous avons rassemblée, pour<br />
développer une grille de recherche.<br />
L’objet de l’étude est un crâne, ou fragment de crâne.<br />
Ce crâne doit appartenir à une série archéologique ou paléontologique ; c’est à dire qu’il doit faire<br />
partie d’un groupe homogène, soit d’individus collectés lors d’une fouille en un lieu précis, dans une<br />
stratigraphie déterminée, soit sur plusieurs sites correspondant à des habitats d’une même période.<br />
Enfin cette série doit être quantitativement suffisante pour pouvoir espérer y trouver quelque chose et<br />
éventuellement réaliser une analyse statistique.<br />
Quelles sont les pathologies ORL susceptibles d’être observées sur ces crânes ?<br />
Il s’agit en effet uniquement de séquelles, de traces : il nous a fallu réfléchir organe par organe aux<br />
maladies possibles, à leurs complications connues actuellement et à leur expression au niveau de l’os.<br />
Globalement deux grands cadres se présentent à nous avec les pathologies infectieuses et tumorales ;<br />
plus accessoirement il doit être possible de retrouver des maladies de système.<br />
<strong>EPHE</strong> Banque de Monographies SVT 8
Notre sujet est limité à la pathologie, mais nous avons profité de l’étude pour noter tout ce qui peut<br />
se rapporter à de la traumatologie, ou à des maladies de voisinage (neurologie, ophtalmologie ou<br />
stomatologie par exemple).<br />
Sur le plan pratique l’examen est essentiellement macroscopique et visuel, simplement amélioré par<br />
notre matériel de consultation (otoscope, fibroscope).<br />
A l’angoisse du début concernant la recherche d’une série, venait s’ajouter celle de n’y trouver<br />
aucune pathologie ! Un développement méthodologique pur et dur n’aurait pas été passionnant ;<br />
heureusement nos observations ont été nombreuses et intéressantes.<br />
La construction méthodologique, bien sur toujours améliorable, servira de base à des études futures,<br />
qui pourront alors être validées par des analyses statistiques, et surtout être le point de départ pour des<br />
approches d’états sanitaires des populations.<br />
Sur le plan purement médical et descriptif, de nombreuses pathologies ont été détectées : elles vont<br />
entre autres, des problèmes dentaires très nombreux et souvent gravement compliqués, à une rare<br />
malformation congénitale de la mandibule, en passant par des déviations du septum nasal, et des<br />
mastoïdites fistulisées.<br />
Chaque cas a été discuté au regard de nos connaissances cliniques et de la littérature que nous avions<br />
trouvée le concernant.<br />
Nous avons ensuite plus globalement pour chaque chapitre de la pathologie, réalisé une synthèse de<br />
notre collecte bibliographique, pour y situer nos observations.<br />
Une lecture globale des différents résultats permet enfin d’un peu mieux appréhender le quotidien de<br />
cette population urbaine de l’Antiquité Tardive du Clos des Cordeliers à Sens, population marquée<br />
par les vicissitudes des maladies ordinaires qui nous frappent tous, et qui de plus a été décimée<br />
soudainement par une épidémie entre les IV ème et VI ème siècles, réunissant enfants, adultes, et<br />
vieillards dans les fosses communes d’une sépulture de catastrophe.<br />
<strong>EPHE</strong> Banque de Monographies SVT 9
I De l’aspect méthodologique<br />
A Sur le choix de la série<br />
B Sur la méthode de travail<br />
C Sur le recueil des résultats<br />
D Sur l’analyse des résultats<br />
C’est la finalité de l’étude.<br />
CHAPITRE IV<br />
DISCUSSION<br />
<strong>EPHE</strong> Banque de Monographies SVT 10
1 Le travail d’analyse et d’interprétation s’exerce d’abord sur chaque spécimen ; il s’agit d’une<br />
démarche médicale, de la confrontation du médecin avec son patient, avec ses évidences, et avec<br />
ses limites.<br />
L’expérience est un facteur de qualité pour le diagnostic, et de nouvelles séries, de nouvelles<br />
études pourront nous permettre de progresser dans cette démarche.<br />
2 L’analyse porte ensuite sur l’état sanitaire de la population prise dans son ensemble.<br />
Nous avons déjà parlé des critères de choix initiaux de la série étudiée, et nous voulons évoquer<br />
ici les facteurs susceptibles de fausser l’analyse globale et l’interprétation des résultats :<br />
a Conservation des différentes pièces osseuses<br />
Nous travaillons à partir de dépôts de fouilles, où les sujets ont été rangés dans des sacs<br />
étiquetés, avec les petits éléments, comme les dents par exemple, rassemblés dans des boites ;<br />
les sujets sont ensuite regroupés dans des cartons.<br />
Il faut avoir en tête que la présence ou l’absence de tel ou tel élément, peut être liée à une<br />
destruction in situ, avant la fouille, ou à une destruction volontaire et intentionnelle comme nous<br />
l’avons déjà signalé, pour les quatre mandibules d’immatures utilisées pour une recherche<br />
d’ADN bactérien dont nous verrons l’intérêt dans les conclusions ; mais il peut aussi s’agir<br />
d’une perte lors de manipulations.<br />
En effet chaque spécimen peut être utilisé successivement pour plusieurs études, et il sera donc<br />
sorti de son sac puis rangé chaque fois, avec un risque à chaque manipulation.<br />
Nous pensons en particulier à la conservation des osselets de l’oreille, que nous avons souvent<br />
trouvés en tamisant la poussière du fond d’un sac, ou que parfois nous avons vu tomber de la<br />
caisse du tympan lorsque nous manipulions un crâne.<br />
Tout examen et toute manipulation de pièce ostéologique doit donc obligatoirement s’effectuer<br />
sur et au dessus d’un plateau ou d’un bac de type photographique.<br />
b Mélange possible d’ossements de deux individus<br />
C’est un facteur d’erreur spécifique aux sépultures collectives.<br />
Il faudra donc tout en faisant confiance à l’équipe de fouilles, s’assurer du bon appariement des<br />
pièces osseuses entre elles.<br />
Plus les pièces seront petites, plus le risque sera grand (par exemple pour les dents, les osselets,<br />
l’os hyoïde).<br />
c Difficulté rencontrée dans la mesure des conduits auditifs internes<br />
Nous avons vu que globalement l’os pétreux se conservait bien, et que donc les conduits<br />
auditifs internes pouvaient donner lieu à une analyse biométrique.<br />
Cette analyse qui paraît simple sur le plan de la réalisation pratique, est limitée par le fait que le<br />
conduit auditif interne n’est pas accessible sur un crâne entier ! Les mesures ne peuvent être<br />
faites que sur les rochers isolés.<br />
Pour une étude systématique, il faudrait radiographier tous les crânes entiers, pour pouvoir<br />
obtenir une dimension mesurée sur le négatif.<br />
Nous pourrions aussi imaginer un protocole utilisant une micro réglette introduite au contact de<br />
porus, associée à une lecture à l’aide de notre endoscope souple introduit par le foramen<br />
magnum.<br />
Nous avons mesuré uniquement la hauteur et la largeur des porus.<br />
<strong>EPHE</strong> Banque de Monographies SVT 11
Il s’avère que la seule valeur fiable est la hauteur, puisque la largeur est limitée par un bord<br />
médial mousse difficile à situer. Nous avons à posteriori, retrouvé la même technique de mesure<br />
sur une autre étude (SPOOR et al., 1998)<br />
Dans notre série pour 36 sujets, nous avions 63 conduits auditifs internes (63/72), et nous<br />
n’avons pu mesurer que 24 pièces (6 matures et 18 immatures). Notons que les crânes<br />
immatures sont plus souvent fragmentés et donc mesurables (Tableau VI).<br />
Notre tableau n’a de valeur que méthodologique compte tenu du faible échantillon, et de<br />
l’encore plus faible nombre de mesures, mais ce travail mériterait d’être développé, comme<br />
nous le disait le professeur D. CAMPILLO, car très peu d’études portent sur la paléopathologie<br />
du neurinome de l’acoustique, qui est de nos jours une des préoccupations principales de<br />
l’otologiste (CAMPILLO et al., 1997). Cette tumeur bénigne est suspectée de façon<br />
systématique devant toute symptomatologie unilatérale (surdité, vertige, acouphènes) ; le<br />
diagnostic positif, orienté par les tests neurophysiologiques, est affirmé par une mesure<br />
comparative des conduits auditifs internes sur un scanner ou une IRM.<br />
La tomodensitométrie a été utilisée en paléopathologie (HOMØE et al., 1992) : elle permet une<br />
mesure précise des conduits auditifs interne.<br />
II De l’aspect paléopathologique<br />
A A partir de chaque anomalie rencontrée<br />
1 Pathologie par pathologie<br />
Nous nous reportons au tableau des pathologies constatées (Tableau VII), pour en dégager<br />
plusieurs groupes que nous discuterons au regard des publications que nous avons rassemblées :<br />
-pathologie de l’oreille, avec surtout les otites et mastoïdites, puis les problèmes d’oreille<br />
interne, et les éventuelles anomalies congénitales.<br />
-pathologie du nez et des sinus, pour laquelle nous avons constaté peu de chose (deux<br />
déviations septales).<br />
-pathologie d’origine dentaire, fortement représentée.<br />
-anomalies congénitales des maxillaires.<br />
a Pathologie de l’oreille<br />
- La pathologie infectieuse.<br />
Nous avons deux cas de mastoïdites : I/7 et I/11.<br />
* Le diagnostic s’appuie sur la constatation d’une cavité mastoïdienne avec une ou plusieurs<br />
fistulisations au travers de la corticale externe, et surtout une condensation osseuse<br />
périphérique des orifices, l’infection chronique entraînant une éburnation de l’os.<br />
* Le diagnostic différentiel doit s’attacher à ce caractère pour éliminer de simples érosions<br />
(voir III/35), ou des variations à type de grandes cellules ressemblant à un abcès (IV/46,<br />
photo). Le diagnostic de tumeurs posera en général moins de problèmes : tumeurs bénignes, à<br />
type de dysplasie fibreuse comme pour le spécimen n° 13 dans (LOVELAND et al, 1990), et<br />
le sujet n°5 dans (SCHULTZ, 1992). Enfin une pathologie générale, comme le scorbut,<br />
pourrait se caractériser par des hématomes sous périostés de la corticale mastoïdienne, cas des<br />
<strong>EPHE</strong> Banque de Monographies SVT 12
spécimens 17 et 18 dans (LOVELAND et al, op.cit.), provenant de Crow Creek site.<br />
* La littérature est abondante sur ces problèmes otologiques, d’autant plus que nous savons<br />
que, sans remonter très loin dans le temps, avant l’ère des antibiotiques, la mastoïdite était<br />
fréquente, et que nos maîtres en ont opérées beaucoup. D’autre part le temporal se conservant<br />
bien (os pétreux = petrosus = pierreux), nous en avons de belles séries à examiner. GREGG<br />
propose même d’utiliser cet os résistant pour des comptages de populations ; son étude sur le<br />
massacre de Crow Creek, où ont été décimées des populations du Dakota au XIV éme siècle,<br />
porte sur 963 temporaux, tous radiographiés, parmi lesquels seulement 61% apparaissent<br />
normaux, les autres présentant des atteintes à des degrés divers de type infectieux ; deux cas<br />
seulement de cholestéatomes y sont évoqués (GREGG et al., 1981).<br />
LOVELAND, dans une métanalyse portant sur 18 sujets en décrit plusieurs cas, évoquant les<br />
formes évolutives classiques que sont le cholestéatome pour le spécimen n°8, et les<br />
complications endocrâniennes fatales : thrombophlébite du sinus caverneux et méningite pour<br />
le spécimen n°9 (LOVELAND et al, op.cit.).<br />
Curieusement DASTUGUE, dans « Paléopathologie du squelette humain » constate p.96<br />
que « les cas de séquelles mastoïdiennes infectieuses publiées en paléopathologie sont d’une<br />
insigne rareté. » (DASTUGUE, 1992).<br />
GRMEK rapporte quant à lui, que la mastoïdite est fréquente en Egypte pharaonique et en<br />
Amérique précolombienne ; il rapporte aussi le cas d’un enfant de Lerne mort à l’age de 3 ans<br />
d’une mastoïdite aigue compliquée d’une thrombose du sinus caverneux (GRMEK, op .cit.).<br />
A l’inverse McKENZIE, in (GUERRIER, 1980) après l’examen de 10000 crânes ne trouva<br />
que six cas probants !<br />
ANGEL, à partir des squelettes exhumés lors des fouilles de l’Agora d’Athènes, squelettes<br />
d’habitants de l’Attique, depuis le néolithique jusqu’à l’époque médiévale, signale un seul cas<br />
de mastoïdite (sujet 72 A.K., 930-650 B.C.) (ANGEL, 1945).<br />
Une étude scanographique de 56 os temporaux d’anciens Inuits (côte ouest du Groenland,<br />
1800-1900 A.D.), met en évidence 6 cas pathologiques (HOMØE, op.cit.).<br />
Si nous passons au Danemark à l’époque médiévale, une importante étude portant sur 659<br />
individus (QVIST et al., 2001), étude cette fois clinique au microscope opératoire, qui<br />
s’intéresse à la fois à la mastoïde et aux osselets, rapporte une fréquence de 1 à 7% de<br />
pathologies infectieuses chroniques de l’oreille.<br />
Sur des périodes similaires, SCHULTZ à partir de l’étude de populations Mérovingiennes, et<br />
Pré Colombiennes (examen direct et radiographies), constate 6 cas pathologiques pour 70<br />
sujets et 109 temporaux, dans les premières, dont un cholestéatome calcifié, et seulement 2 cas<br />
pour 86 sujets et 129 temporaux dans les populations indiennes (SCHULTZ, 1979).<br />
Il faut préciser que pour cette étude, la radiographie a été systématique dans la première série,<br />
et seulement complémentaire dans la seconde, en fonction du résultat de l’examen visuel.<br />
Evoquons enfin le cas particulier des momies, ou éventuellement de sujets conservés dans la<br />
glace ou la tourbe, sur lesquels de très belles observations d’infections otitiques sont attestées<br />
en plus des lésions osseuses radiographiques, par des perforations de la membrane<br />
tympanique documentées histologiquement (LYNN et BENITEZ, 1974, HORNE et al., 1976,<br />
et BENITEZ, 1988).<br />
Les difficultés du diagnostic sont évidentes si on évoque le cas du crâne de Broken Hill (homo<br />
rhodesiensis, entre -250 et -130000 ans), où de magnifiques lésions de la mastoïde et de<br />
l’écaille du temporal étaient considérées comme d’origine ORL à l’évidence depuis<br />
longtemps ; des travaux plus récents, grâce au scanner, infirment ces diagnostics pour proposer<br />
un traumatisme post-mortem, et un granulome à éosinophile (MONTGOMERY et al., 1994).<br />
En conclusion, nous constatons que 3 types d’études sont utilisés :<br />
-Etudes cliniques, macroscopiques.<br />
-Etudes radiologiques, voire tomodensitométriques.<br />
<strong>EPHE</strong> Banque de Monographies SVT 13
-Etudes mixtes, où la radiologie est utilisée après une présélection clinique des cas.<br />
Nous avons beaucoup plus de dépistages avec les secondes, qui représenteront donc un outil<br />
de choix pour apprécier un état de santé global d’une population, car elles vont prendre en<br />
compte tous les degrés d’atteinte ; la méthode macroscopique n’enregistrant que les cas<br />
évidents de pathologies très démonstratives, éventuellement documentée radiologiquement,<br />
est parfaite pour l’iconographie, mais sans intérêt pour la statistique !<br />
Quoi qu’il en soit nous constatons des distorsions énormes :<br />
-39% de temporaux anormaux à Crow Creek,<br />
-6 cas pathologiques pour 10000 chez MC KENZIE,<br />
-1 cas pour ANGEL à Athènes !<br />
Faut-il affiner les méthodologies ?<br />
De toutes façon ne seront comparables que les études relevant de l’une ou l’autre des<br />
méthodes.<br />
La variabilité des résultats constatée dans la littérature paraît donc difficile à interpréter, et à<br />
relier à des facteurs écologiques, géographiques, ou sociologiques.<br />
- La pathologie de l’oreille interne.<br />
Nous avons une anomalie congénitale possible du conduit auditif interne : I/71.<br />
Le diamètre vertical de ce conduit de sujet immature est le plus grand de notre série, et la<br />
disposition des fossettes qui en constituent le fond ne nous paraît pas conforme à nos<br />
connaissances anatomiques ; la dilatation de la fossette unguéale par contre se rencontre<br />
fréquemment chez les immatures.<br />
Sur ce type d’anomalies nous n’avons rien trouvé comme documentation, par contre la<br />
paléopathologie de l’oreille interne semble être un sujet très peu exploré.<br />
Nous avons seulement deux articles :<br />
CAMPILLO passe en revue une centaine de crânes qu’il a étudiés en 30 ans, pour constater 4<br />
cas possibles de neurinomes (étude mixte, clinique puis scanner) (CAMPILLO et al., 1997).<br />
SPOOR qui a étudié le crâne de Singa au Soudan, constate sur l’étude tomodensitométrique<br />
une absence des structures du labyrinthe osseux du temporal droit. L’ossification du labyrinthe<br />
peut être due soit à un processus infectieux, soit à une ischémie, et la cause possible de ce<br />
problème micro circulatoire peut être liée à la présence d’un neurinome qui comprime<br />
progressivement l’artère auditive interne. Cette éventualité semble confirmée par la<br />
constatation d’un conduit beaucoup plus large du côté droit.<br />
De plus cet article collige une série d’études plus anciennes, regroupant 686 paires de<br />
temporaux, et donnant les écarts de taille des diamètres verticaux entre<br />
côtés droits et côtés gauches. Cette série pourrait constituer une bonne base de données de<br />
départ pour une étude ultérieure (SPOOR et al., 1998).<br />
- La pathologie de l’oreille externe.<br />
Nous avons une déhiscence centrale symétrique des deux tympanaux : III/44.<br />
Il s’agit visiblement d’un problème congénital chez ce sujet immature ; nous n’avons trouvé<br />
aucune documentation sur ce type d’anomalie. Une sténose congénitale du conduit auditif<br />
externe, avec anomalies ossiculaires est le seul élément de notre bibliographie (McGREW et<br />
<strong>EPHE</strong> Banque de Monographies SVT 14
GREGG, 1971 in LOVELAND et al., 1990) .<br />
Par contre nous n’avons trouvé dans notre série ni ostéomes, ni exostoses. Ces petites tumeurs<br />
osseuses situées dans ou à l’entrée du conduit auditif externe osseux semblent avoir été<br />
jusqu’à présent le sujet de prédilection des paléopathologistes ORL ! Il est vrai que la<br />
constatation d’exostoses permet une approche environnementale des sujets observés, qui ont<br />
classiquement une activité aquatique en eau froide (pêche, récolte de coquillages etc.).<br />
Les publications sont très nombreuses, nous n’en retenons que quelques unes : (GREGG et<br />
BASS, 1970, GREGG et al., 1981, MANZI et al., 1991, DASTUGUE et al., 1992,<br />
STANDEN et al., 1997, HUTCHINSON et al., 1997, PEREZ et al., 1997, GERSZTEN et al.,<br />
1998, VELASCO-VAZQUEZ et al., 2000, ARNAY-DE-LA-ROSA et al., 2001.).<br />
Notons que GERSZTEN et PEREZ évoquent une origine infectieuse pour ces exostoses,<br />
secondaire à l’exposition à l’eau.<br />
- Les autres pathologies de la littérature.<br />
Nous évoquerons ici seulement l’otospongiose, sujet qui intéresse toujours l’oto-rhinolaryngologiste,<br />
puisqu’il s’agit de la seule surdité qui soit curable chirurgicalement. Il s’agit<br />
d’une fixation progressive du stapes dans la fossa ovata.<br />
Le diagnostic de cette maladie nous pose le problème de la visualisation de ce très petit et très<br />
fragile osselet, in situ ! Nous n’en avons trouvé que 2 pour nos 36 sujets.<br />
Notons à ce sujet la magnifique préparation histologique d’une fosse ovale normale chez une<br />
momie égyptienne, (BENITEZ, 1988), à comparer au seul cas pathologique (à notre<br />
connaissance), documenté macroscopiquement, histologiquement, et radiologiquement à<br />
Campos Santos Cemetery (A.D. 1776) (BIRKBY et GREGG, 1975).<br />
Pour ce qui est des autres osselets, à notre avis ils se conservent bien ; il faut simplement<br />
prendre le temps de les chercher et éviter de les perdre (CZIGANY, 1996, CZIGANY, 1998).<br />
Leur examen ne nous a pas permis d’y constater de modifications d’ordre pathologique ; les<br />
érosions y sont par contre fréquentes : longue apophyse de l’incus, et manche du malleus.<br />
QVIST et GRØNTVED se sont basés en partie sur l’examen de ces os, pour poser des<br />
diagnostics d’otites chroniques : leur série est importante, regroupant 659 individus, 921<br />
temporaux, et 1309 osselets, parmi lesquels 245 stapes (QVIST et GRØNTVED, 2001)!<br />
b Pathologie des fosses nasales et des sinus.<br />
- La pathologie malformative et traumatique.<br />
Nous n’avons trouvé que 2 déviations septales : I/70 et I/72.<br />
Aucune pathologie sinusienne, ni otitique n’y était associée.<br />
La cloison osseuse constituée de la lame perpendiculaire de l’ethmoïde et du vomer est une<br />
pièce fragile (13 fosses nasales sont seulement interprétables sur 72).<br />
La déformation que nous constatons devait s’accompagner d’une déviation secondaire du<br />
cartilage septal, troisième constituant du septum ; en fonction de son importance, le sujet<br />
devait être plus ou moins gêné pour respirer, et certainement fragililisé vis-à-vis des infections<br />
de la sphère ORL.<br />
GREGG constate 13 cas de déformations septales à Crow Creek, sans préciser leur fréquence<br />
(GREGG, op.cit.)<br />
La déviation a pu aussi se manifester extérieurement sur le plan purement esthétique.<br />
Ces déformations ont été traduites sur le plan artistique par des céramistes Péruviens durant la<br />
période Moche (200-700 A.D.) sur des pièces de vaisselle anthropomorphes représentant des<br />
hypoplasies alaires unilatérales, ou des aplasies bilatérales secondaires à des traumatismes de<br />
<strong>EPHE</strong> Banque de Monographies SVT 15
l’enfance ou de la vie intra-utérine (PIRSIG, 1989).<br />
Pour rester sur la pyramide nasale, région exposée s’il en est, plusieurs cas de traumatismes<br />
sont rapportés dans la littérature (MAFART, 1983, GREGG, op.cit., GARLOWSKA, 2001).<br />
- La pathologie tumorale.<br />
Nous n’avons diagnostiqué aucun cas.<br />
Nous savons que globalement elles sont plus rares pour le paléopathologiste que les séquelles<br />
de traumatismes, d’arthrose, ou d’infections. Sur le plan ORL nous avons trouvé dans la<br />
littérature surtout des descriptions de tumeurs bénignes. SCHULTZ qui étudie des populations<br />
mérovingiennes d’Allemagne du sud (endoscopie et radiologie), sur une série de 81 cas<br />
exploitables, décrit 3 tumeurs sinusiennes : une tumeur bénigne du sinus maxillaire chez un<br />
enfant, une tumeur supposée maligne de l’ethmoïde ayant évoluée vers l’orbite chez un<br />
homme de 35-40 ans, et une tumeur bénigne du sinus frontal chez une femme de 30-40 ans.<br />
L’auteur évoque les mauvaises conditions environnementales pour ces classes pauvres de la<br />
population, en particulier l’enfumage permanent des habitations sans cheminée, qui génèrerait<br />
une inflammation chronique des muqueuses, à l’origine d’infections puis de tumeurs<br />
(SCHULTZ, 1978, SCHULTZ,1992).<br />
DASTUGUE, quant à lui, décrit une tumeur maligne ossifiante du sinus maxillaire chez un<br />
sujet du XII ème siècle à Caen, dont l’intérêt réside dans la constatation de deux tentatives de<br />
traitement successives : d’abord extraction des dents sinusiennes, puis trépanation de l’os<br />
zygomatique (DASTUGUE, op.cit.).<br />
Les ostéomes semblent par contre assez fréquents : petit ostéome en regard d’une première<br />
prémolaire dans le sinus maxillaire associé à une sévère parodontopathie pour une momie<br />
sicilienne du XVIII ème siècle pour 50 sujets (CIRANNI et al., 1999), deux ostéomes frontaux<br />
sur le toit de l’orbite sur une série de 33 individus fossiles en Espagne datés entre 200 et<br />
300000 ans (PEREZ et al., 1996).<br />
L’hyperostose frontale interne, épaississement mamelonné progressif de la table interne du<br />
frontal, paraît être une pathologie des temps modernes, de prévalence féminine, après 60 ans,<br />
liée à la stimulation oestrogénique (HERSHKOVITZ et al., 1999) ; un cas est cependant décrit<br />
chez une femme Nubienne de 40 ans (300 A.D.)(ARMELAGOS et CHRISMAN, 1988).<br />
Pour conclure ce chapitre des tumeurs, nous pouvons remarquer que suivant les séries elles<br />
vont être représentées de façon très variable : de grosses séries n’en observent aucune<br />
(GREGG op.cit.), et visiblement la constatation de tumeur malignes reste très rare.<br />
Nous trouvons enfin toute une série de publications portant sur l’étude ORL soit de<br />
l’ « homme des glaces », soit de momies égyptiennes, selon des procédures type bloc<br />
opératoire : explorations clinique, endoscopique avec biopsies, recoupées par la<br />
tomodensitométrie. Ces études intéressantes s’appliquent cependant à un nombre de spécimens<br />
réduit. Il faut noter que les embaumeurs égyptiens utilisaient, pour vider le crâne de la matière<br />
cérébrale, la voie d’abord nasale classique de l’hypophyse, qui remonte le long du septum, et<br />
passe au travers du corps du sphénoïde pour aborder la selle turcique (GUNKEL et al., 1997,<br />
THUMFART et al., 1997, YARDLEY et RUTKA, 1997, MOTAMED et al., 1998, GAAFAR<br />
et al., 1999).<br />
- La pathologie infectieuse.<br />
* Infections non spécifiques :<br />
Des études sur des séries importantes d’époque médiévale, ont récemment permis une<br />
systématisation dans la description des lésions à rechercher :<br />
Notons en particulier celle de BOOCOCK, qui étudiant 133 sujets (XII ème au XVII ème<br />
siècle), constate, en utilisant sa méthodologie, 54,9% de modifications osseuses sinusiennes.<br />
Il ne trouve pas de prévalence selon l’age ou le sexe, ou le fait que les sujets soient ou non<br />
<strong>EPHE</strong> Banque de Monographies SVT 16
lépreux ; il compare ce résultat à celui d’un autre échantillon médiéval Anglais qui ne<br />
diagnostique que 3,6% de lésions sinusiennes (WELLS, 1977, BOOCOCK et al., 1995). Ces<br />
écarts très importants sont rattachés par les auteurs à des facteurs environnementaux.<br />
Une autre étude comparative à partir de 663 ruraux et 1042 urbains dans l’Angleterre de la<br />
fin du moyen age, montre que la sinusite est beaucoup plus fréquente en ville (54% pour<br />
39% à la campagne). Cette différence est expliquée par les facteurs de pollution<br />
atmosphérique liés à une importante activité industrielle (tannerie, fours à chaux, fonderie)<br />
présente depuis le<br />
XV ème siècle (LEWIS et al., 1995).<br />
Pour les classiques les infections du sinus maxillaire sont fréquentes au néolithique (PALES,<br />
1930), et celle du sinus frontal à toutes les époques (DASTUGUE, 1992) ; ce dernier<br />
rapporte des exemples de trépanation de cette cavité. Une infection purulente du maxillaire<br />
dans une sépulture royale de Mycènes (59 myc.) est décrite par ANGEL, dans (GRMEK,<br />
1983).<br />
Il semble que même les Hommes Fossiles n’aient pas été à l’abri de ces pathologies : ainsi<br />
pour le début du Pléistocène (1,15 M.A.), l’Homme de Lantian laisse voir au dessus du torus<br />
supra orbitaire deux dépressions interprétées, soit comme des blessures cicatrisées, soit<br />
comme des fistulisations d’abcès sinusiens (CASPARI, 1997). Au Pléistocène moyen (300 à<br />
200 K.A.), à Sima de los Huesos, le crâne 5 montre une ostéite extensive du maxillaire<br />
(PEREZ, op.cit.).<br />
* Infections spécifiques :<br />
Deux infections suscitent l’intérêt et animent des débats passionnés chez les<br />
paléopathologistes : la lèpre et la syphilis.<br />
Pour la première, la lèpre, dont nous ne retrouvons les premiers cas bien argumentés que<br />
vers le VI ème siècle (Europe, Afrique), les débats vont porter sur la diffusion de cette<br />
maladie qui va constituer un fléau au Moyen Age. Il faut saluer les travaux de MÖLLER-<br />
CHRISTENSEN, portant sur la systématisation des descriptions des formes cliniques, avec<br />
comparaison de séries anciennes et contemporaines. L’étude de cette maladie peut<br />
rapidement se déplacer vers une approche globale de l’état sanitaire d’une population : la<br />
forme lépromateuse, liée à une déficience immunitaire, se complique toujours d’infections<br />
naso-sinusiennes progressivement mutilantes, une cribra orbitalia est souvent associée.<br />
Une étude comparative entre une série médiévale Danoise (107 crânes), et l’examen de 333<br />
patients d’une léproserie actuelle, montre des lésions identiques, mais des degrés d’atteintes<br />
différents : le syndrome de Bergen II apparaissant plus fréquent au Moyen Age (MÖLLER-<br />
CHRISTENSEN, 1974). Nous pouvons penser que la médecine moderne y est peut être pour<br />
quelque chose !<br />
Une autre étude, toujours pour le Moyen Age en Angleterre, retrouve ces syndromes rhinomaxillaires,<br />
considérés comme pathognomoniques de la forme lépromateuse, mais en<br />
comparant sujets lépreux et non lépreux, constate que la prévalence des signes de sinusite<br />
maxillaire est la même dans les deux populations. Les facteurs environnementaux, et socioéconomiques<br />
sont avancés (BOOCOCK et al., 1995).<br />
Pour la seconde de ces infections, la syphilis, les débats sont encore plus vifs sur la présence<br />
de treponema pallidum dans l’ancien Monde avant les voyages de Christophe COLOMB<br />
dont six des marins furent traités pour une nouvelle maladie à leur retour à Barcelone.<br />
La syphilis tertiaire est attestée au Nouveau Monde par de nombreux cas bien étudiés ; ainsi<br />
sur une série de 700 crânes datant de 8000 ans (région sud Pérou, nord Chili), plusieurs cas<br />
de perturbations osseuses associant périostite, osteïte, et ostéomyélite du crâne et des os<br />
long, en particulier des tibias, évoquent fortement cette maladie. Certains de ces sujets ont<br />
été traités par des trépanations (GERSZTEN et al, 1998). Notons que ces auteurs affirment<br />
<strong>EPHE</strong> Banque de Monographies SVT 17
qu’aucune lésion de type syphilitique n’a été détectée sur des squelettes Européens,<br />
Egyptiens et Asiatiques datant d’avant la découverte de l’Amérique.<br />
Pour remonter vers l’Amérique du Nord, à Crow Creek(1350 A.D.), quelques réactions<br />
périostées sont notées sur des os longs, mais aucune sur des crânes (GREGG, op.cit.)<br />
En Europe lorsque la datation archéologique ne pose pas de problème, comme pour le cas<br />
d’une sépulture Hongroise du XVII ème siècle, la discussion n’a pas lieu d’être ; ce sujet<br />
permet une description clinique et radiologique démonstrative (MOLNAR et al., 1998). Ces<br />
auteurs à l’inverse des précédents sont convaincus de la présence de la maladie dans<br />
l’Ancien Monde avant la fin du XV ème siècle.<br />
Une autre étude est démonstrative des difficultés rencontrées et de la prudence nécessaire<br />
pour l’analyse de chaque cas : le « crâne Romain d’Arles » des collections du Musée Calvet<br />
était considéré comme datant de l’antiquité tardive ou du haut Moyen age. Une étude<br />
récente avec datation Carbone 14, le situe entre 1480 et 1663, avec un pic de probabilité<br />
maximale entre 1518 et 1588 ; nous nous trouvons sur la période de l’extension majeure de<br />
la syphilis en Europe. Les auteurs le considèrent comme le plus ancien cas européen de<br />
syphilis, et ne tranchent pas entre une importation du microbe depuis le Nouveau Monde et<br />
une modification de la pathogénicité d’un tréponème autochtone (MAFART et al., 1998).<br />
* Parasitoses :<br />
Nous avons noté la description d’un cas de leishmaniose, décrit chez une femme d’age<br />
moyen (700 A.D.) dans la série Andine évoquée ci-dessus, montrant des destructions<br />
importantes autour de la fosse nasale et de l’orbite droite. Nous savons que cette maladie est<br />
endémique en région Andine de nos jours, liée à leismania brasiliensis. Dans les sépultures<br />
étudiées des chiens sont souvent associés ; animaux de compagnie et de consommation à<br />
cette époque, nous savons qu’ils constituent, avec le singe et l’agouti, le réservoir de virus<br />
de la maladie (GERSZTEN, op.cit.).<br />
c Pathologies d’origine dentaire<br />
Nous ne détaillerons pas l’aspect purement odontologique : les multiples caries, l’état d’usure,<br />
les malformations dentaires sont du ressort du spécialiste, et pourraient donner lieu à une étude<br />
spécifique. Nos tableaux « Inventaire, et Etat dentaire » seront plutôt destinés à l’approche<br />
globale de l’état sanitaire de cette petite population de l’antiquité tardive.<br />
Nous avons privilégié les complications ayant laissé une trace au niveau de l’os ; elles sont très<br />
nombreuses à type d’abcès et granulomes (I/68, II/19, II/24, III/35, III/37).<br />
Elles siègent aussi bien sur le maxillaire que sur la mandibule.<br />
Le sujet II/19 montre un aspect assez effrayant de ces complications, qui nous laisse imaginer ce<br />
que pouvait être la qualité de vie de cette femme, et quel a pu être le retentissement sur son<br />
alimentation et son état de santé ! Nous nous sommes même posé la question devant l’énorme<br />
abcès en regard de la 12, d’un diagnostic différentiel avec une fente palatine.<br />
Dans 2 cas ces infections se sont compliquées de fistules bucco-dentaires (I/77, III/35).<br />
Si nous avons trouvé beaucoup de lésions d’origine dentaire, nous constatons qu’elles sont aussi<br />
très nombreuses dans la littérature ; nous n’en citerons que quelques exemples.<br />
L’étude d’une momie Sicilienne du XVIII ème siècle à Comiso, dont l’intérêt principal était la<br />
présence d’un goitre thyroïdien, constatait par ailleurs une sévère maladie périodontale, associée<br />
à un petit ostéome au niveau de la première prémolaire du maxillaire (CIRANNI et al., 1999).<br />
Une ostéomyélite massive du corps de la mandibule (Arikana A.D. 1750-85) affectant une<br />
femme de 20 ans est associée à une infection mastoïdienne fistulisée ayant visiblement entraîné<br />
la mort (LOVELAND, op.cit.).<br />
A Crow Creek, l’étude de 136 pièces comportant plus de 3 dents en place, montre de<br />
nombreuses caries, ainsi qu’une usure pouvant exposer la pulpe ; 17 abcès dentaires sont<br />
<strong>EPHE</strong> Banque de Monographies SVT 18
dénombrés, ainsi que 4 fistules bucco-dentaires, et 11 cas d’anomalies dentaires diverses<br />
(GREGG, op.cit.).<br />
A l’époque classique, de nombreux cas sont cités, tel celui de cet aristocrate de Mycènes (59<br />
Myc.), qui montre une formation kystique au regard d’une deuxième molaire qui s’est propagée<br />
sous forme d’abcès au sinus maxillaire, dont les lésions inflammatoires attestent d’une longue<br />
évolution, ou celui de ce citoyen Athénien (65 AK.) décédé vers 450 avant J.C., porteur d’une<br />
pyorrhée alvéolaire avec un large abcès de la mâchoire (ANGEL, op.cit.).<br />
L’étude portant sur une population Néolithique de 92 individus en Pologne centrale (4300-4000<br />
B.C.) constate des problèmes infectieux, et dégénératifs (caries, résorption alvéolaire et pertes<br />
de dents), ainsi que des anomalies du développement (hypoplasies de l’émail). 30,1% des<br />
individus présentent des caries, 52% des adultes, des zones de résorbions alvéolaires, et 34,5%<br />
des pertes dentaires. Les hypoplasies de l’émail, témoins de stress sévères, alimentaires ou<br />
pathologiques sont observées dans 67,8% des cas, ainsi que quelques anomalies du<br />
développement ou malformations d’ordre génétique (GARLOWSKA, 2001).<br />
Parmi les crânes fossiles du Pléistocène moyen (300 – 200000 B.P.) de Sima de los Huesos, le n<br />
°5 montre une ostéite étendue du processus alvéolaire du maxillaire gauche, allant de l’incisive<br />
latérale à la première molaire ; la mandibule du même individu présente aussi un vaste abcès<br />
dentaire en regard de l’apex de la deuxième incisive gauche, avec visiblement la perte des deux<br />
incisives adjacentes ante mortem (PEREZ et al.,1997).<br />
Une pyorrhée alvéolaire avait déjà été diagnostiquée sur la mandibule d’un Hominidé, le<br />
Sinanthrope de Lantian (450000 B.C.)(WOO, 1964 in GRMEK, op.cit.).<br />
d Pathologie mandibulaire<br />
Nous avons une anomalie mandibulaire congénitale : IV/46. Il s’agit d’une malformation de la<br />
partie droite de la mandibule, dont la composante fonctionnelle principale est une agénésie<br />
condylienne.<br />
Ce problème est évoqué dans deux articles de paléopathologie :<br />
-dans l’importante série de Crow Creek datée du XIV ème siècle, deux anomalies<br />
mandibulaires sont décrites sur des sujets mâles adultes, malheureusement sur des mandibules<br />
dépourvues de leur crânes. Sur la première, le condyle gauche était plus haut de 2.5 cm que le<br />
droit, alors que la dentition, les surfaces articulaires, et le reste de l’os étaient normaux. Sur la<br />
seconde, le côté gauche montrait une hypoplasie congénitale de l’angle et du bord postérieur<br />
de la branche montante, et le condyle était peu développé, alors que le droit était normal. Une<br />
usure symétrique des dents suggérait une mastication normale. Les auteurs évoquent donc<br />
une microsomie hémifaciale de grade I selon la classification de CALDARELLI,<br />
(CALDARELLI et al., 1980) ; selon cette classification ce sujet avait 86% de probabilité<br />
d’une malformation ossiculaire associée, et 90.7% d’une malformation de l’oreille externe<br />
(GREGG, op.cit.).<br />
-une aplasie bilatérale est décrite par NAGAR et ARENSBURG, sur une mandibule vieille de<br />
1400 ans, pour laquelle le diagnostic de microsomie hémifaciale est aussi posé. La pièce<br />
montre une absence de condyles, un corps très ramassé et raccourci mais de largeur normale,<br />
des processus coronoïdiens très développés ; l’insertion creusée du muscle masséter et la<br />
présence d’un tubercule de muscle ptérygoïdien médial, évoquent une hypertrophie des<br />
muscles de l’occlusion. Ce large tubercule d’insertion musculaire est considéré comme une<br />
autapomorphie Néandertalienne. L’étude de l’usure des quelques dents restantes montrait une<br />
mandibule fonctionnelle, dont le travail principal s’effectuait sur les dents les plus postérieures<br />
<strong>EPHE</strong> Banque de Monographies SVT 19
(NAGAR et ARENSBURG, 2000).<br />
Des références sont disponibles sur ce sujet dans la littérature médicale actuelle :<br />
Parmi celles–ci, un article Japonais essaie d’évaluer les conséquences fonctionnelle d’une<br />
microsomie hémifaciale chez une petite fille de 9 ans, hospitalisée pour protrusion et<br />
déformation de la mandibule. Elle présentait une atrophie du condyle mandibulaire droit, à<br />
laquelle était associée un hypo développement du processus alvéolaire du maxillaire du même<br />
côté. Comme dans les cas précédents, la tomodensitométrie des muscles masticateurs, mettait en<br />
évidence une hypertrophie du ptérygoïdien médial, dont le but est d’essayer de maintenir un<br />
centrage mandibulaire lors de la fonction masticatoire. Le condyle du côté sain, doublement<br />
sollicité, présentait quant à lui un hyper développement (NAKATA et al., 1995).<br />
Dans les banques de données concernant les maladies rares, comme ORPHANET, les anomalies<br />
radiales de la microsomie hémifaciale sont classées par fréquence : sont donnés comme signes<br />
très fréquents, l’asymétrie faciale, l’hypoplasie ou l’absence partielle de mandibule, et le<br />
caractère autosomique dominant, et comme signes fréquents, les surdités, les microties ou<br />
anoties, les appendices pré auriculaires, les absences ou atrésie du conduit auditif externe, les<br />
fistules pré auriculaires, les micromélies rhizoméliques, les polydactylies pré axiales du membre<br />
supérieur, la triphalangie du pouce, et la scoliose ; d’autres signes sont classés comme<br />
occasionnels, nous ne les citons pas.<br />
Il existe donc une grande hétérogénéité des morphotypes malformatifs, expliquée en partie par<br />
l’embryogénèse complexe de la région, des deux premiers arcs branchiaux (mandibulaire et<br />
hyoïdien), séparés par la première poche endoblastique à l’origine de l’oreille moyenne, et le<br />
premier sillon ectoblastique pour le conduit auditif externe.<br />
Les fréquentes malformations oto-mandibulaires, dysostoses oto-mandibulaires, ou microsomie<br />
hémifaciale consistent le plus souvent en l’association d’une branche montante courte, avec une<br />
microtie.<br />
Les syndromes poly malformatifs familiaux sont d’origine génétique :<br />
-syndrome de Franceschetti et Teacher Collins : dysostose mandibulo-faciale.<br />
-syndrome de Goldenhar : oculo-auriculo-vertébral.<br />
-syndrome branchio-oto-rénal : surdité de perception, aplasie d’oreille, fistule branchiale<br />
cervico-faciale, anomalie rénale.<br />
En dehors de ces problèmes malformatifs et fonctionnels, de nombreux articles décrivent des<br />
pathologies beaucoup plus banales, telles que les arthropathies (GREGG, op.cit., HODGES,<br />
1991, PEREZ et al., 1997), des tumeurs telles que l’ostéome mandibulaire étudié par SCHULTZ<br />
(SCHULTZ, op.cit.), et des lésions ostéïtiques (LOVELAND, op.cit., PEREZ op.cit., ANGEL,<br />
op.cit., WOO, 1964).<br />
2 Les diagnostics différentiels, variations, et originalités<br />
a Les osselets<br />
Nous avons vu qu’ils se conservaient bien, tout au moins le malleus et l’incus ; par contre le<br />
stapes est très fragile, et la possibilité de le trouver in situ très faible.<br />
Le diagnostic d’otospongiose sera donc toujours difficile à évoquer en paléopathologie ; nous<br />
avons déjà parlé de la seule description que nous ayons trouvée (BIRKBY, op.cit.).<br />
La latéralisation de ces petits osselets, pose par contre problème, car leurs extrémités, ou leurs<br />
surfaces articulaires ont souvent été érodées.<br />
Ces réflexions valent surtout pour l’étude la plus fréquente qui est celle de squelettes, car dans<br />
<strong>EPHE</strong> Banque de Monographies SVT 20
le cas de momies, comme nous l’avons déjà dit, la conservation et même l’observation in situ<br />
sera souvent possible dans de très bonnes conditions.<br />
Dans le cadre d’une étude précise, en particulier grâce au microscope opératoire, les osselets<br />
peuvent même servir de marqueurs de l’otite chronique, comme dans l’étude portant sur deux<br />
populations médiévales au Danemark :<br />
Populations : Nordby Tirup<br />
Nombre<br />
sujets :<br />
de 169 490<br />
Malleus 52 486<br />
Incus 68 458<br />
Stapes 27 218<br />
Osselets total 147 1162<br />
Nous sommes étonnés du nombre de stapes observés.<br />
Le pourcentage d’anomalies ossiculaires constatées dans la première série est de 0.7%, et de<br />
1.1% dans la seconde, alors que pour les lésions macroscopiquement visibles sur les temporaux<br />
les taux sont respectivement de 1.4 et 6.0%(QVIST et GRØNTVED, op.cit.).<br />
L’étude des osselets peut donc être utilisée dans un but de dépistage des lésions otologiques ;<br />
elle nous semble cependant difficile à mettre en œuvre, et sa fiabilité devrait être testée sur<br />
d’autres séries, séries comportant des osselets ce qui n’est pas toujours le cas !<br />
b Les variations anatomiques<br />
- Concha bullosa :<br />
Nous en avons observé un cas (I/66), mais ce n’est pas un phénomène rare.<br />
Il s’agit d’une pneumatisation d’importance variable du cornet moyen pouvant se compliquer<br />
d’une gêne respiratoire liée à l’obstruction mécanique de la fosse nasale.<br />
Une étude récente portant sur 309 sujets (Broumov Ossuary, du XIII ème au XVIII ème siècle),<br />
retrouve cette variation sur 160 crânes (51.77%) (POSPIŠILOVA, et al., 2001).<br />
- Rapport de proximité entre racine dentaire et fond du sinus maxillaire :<br />
Nous en avons observé deux cas (II/30 et IV/46).<br />
C’est une constatation fréquente que nous recherchons sur une radiographie panoramique des<br />
maxillaires, quand se pose à nous le problème d’une sinusite maxillaire unilatérale.<br />
- Variations de taille des sinus :<br />
Ceci est particulièrement fréquent pour les sinus frontaux et sphénoïdaux.<br />
Pour les premiers, la variation est presque la normalité.<br />
Pour les seconds par contre, nous avons observé deux cas (I/7 et II/19).<br />
Si l’asymétrie est très importante pour le II/19, pour le I/7 se pose la question d’une agénésie :<br />
le sinus droit se présentant comme une très grande cavité, soufflée vers la gauche, cloisonnée de<br />
spicules osseux, alors que la cavité gauche est quasi virtuelle avec un ostium paraissant oblitéré.<br />
Un examen du crâne de l’homo erectus de Ceprano (Pléistocène moyen ancien), montre<br />
justement une variation du sinus sphénoïdal gauche qui pénètre profondément dans l’épaisseur<br />
de la grande aile jusqu’à la suture sphéno-temporale (ASCENZI et al., 1997).<br />
Nous pouvons revenir un instant sur la taille et le développement des sinus des sujets immatures,<br />
qui pourraient, à notre avis, venir, dans certains cas, préciser une détermination de l’age au<br />
<strong>EPHE</strong> Banque de Monographies SVT 21
décès.<br />
- Rapport du sinus latéral avec les cavités mastoïdiennes :<br />
Il s’agit du sujet I/81, dont nous avons parlé au chapitre des résultats.<br />
L’empreinte de la portion sigmoïde du sinus est verticalisée et impactée en avant ; une lame<br />
d’os papyracé sépare la gouttière veineuse de l’extérieur, sans interposition de cellules<br />
mastoïdiennes. Dans notre cas cette fine lame avait même disparu, certainement du fait d’une<br />
érosion, formant une solution de continuité entre la cavité crânienne et l’extérieur. Nous avons<br />
évoqué le risque chirurgical lors d’une mastoïdectomie, pensons aussi au risque traumatique par<br />
lequel une blessure de la région retro-auriculaire, même modeste, peut se compliquer d’une<br />
hémorragie veineuse massive et rapidement mortelle.<br />
- Déhiscence du canal du muscle tensor tympani dans la fosse cérébrale moyenne : Nous<br />
n’avons trouvé aucune documentation sur cette variation constatée sur le sujet I/9.<br />
Il est possible que le muscle ait été simplement recouvert par la dure mère crânienne à ce<br />
niveau.<br />
Dans cette même région, et dans le même ordre d’idée, les variations de taille du trou déchiré,<br />
fermé par une lame de dure-mère sont importantes, l’os et la méninge se complétant.<br />
- Kyste congénital médian alvéolaire :<br />
Nous avons noté une dilatation ampullaire au niveau du trou incisif, sortie du canal palatin<br />
antérieur, pour les sujets I/7, I/77, II/17, II/30, et III/44.<br />
A partir de quelle taille peut-on suspecter la présence d’un kyste congénital ? Le<br />
problème reste posé, d’autant que nous n’avons pas trouvé pour l’instant de renseignement dans<br />
notre revue de la littérature.<br />
- Déhiscence congénitale des tympanaux :<br />
Nous avons constaté cette particularité sur le sujet immature III/44.<br />
Anomalie parfaitement symétrique correspondant visiblement à un défaut de l’ossification.<br />
Aucune conséquence fonctionnelle n’est envisagée, les condyles mandibulaires en regard sont<br />
normaux. Là aussi, nous n’avons aucune référence dans la littérature.<br />
Notons que nous avons de plus enregistré chez ce sujet, un kyste ayant pour point de départ le<br />
germe d’une canine définitive sur le rebord inférieur de la mandibule (Figure 34 photo).<br />
La dentition presque parfaite de cet enfant, dont l’age estimé était de 5 à 9 ans, nous a permis de<br />
réaliser une iconographie détaillée, dans l’optique d’un usage ultérieur comme référentiel d’une<br />
anatomie pour une fois parfaitement normale !<br />
c Les surprises<br />
Dans la boite dentaire du sujet I/9 nous avons trouvé une dent qui a attiré notre attention, par des<br />
cuspides déchiquetées, ressemblant beaucoup à des anomalies rencontrées lors de syphilis<br />
congénitales, en principe sur des incisives. Nous avions par contre deux racines, mais une fusion<br />
aurait pu être envisagée, et la découverte d’une syphilis de l’antiquité tardive était quelque chose<br />
d’excitant !<br />
Les spécialistes du quaternaire ont rapidement fait tomber les spéculations en reconnaissant une<br />
seconde prémolaire inférieure de cochon ou de sanglier !<br />
B Approche d’un état sanitaire global.<br />
Nous manquons malheureusement de renseignements sur la population que nous avons étudiée :<br />
<strong>EPHE</strong> Banque de Monographies SVT 22
aucun document historique n’avait été trouvé lors de précédentes études.<br />
Nous n’avons pas non plus de données climatiques précises sur cette période allant du IV ème au<br />
VI ème siècles.<br />
Toutes ces personnes mortes en même temps, nous montrent un tableau classique de crise de<br />
mortalité de type épidémique. Les récentes analyses d’ADN bactérien ont confirmé le diagnostic<br />
évoqué de peste (DRANCOURT et al., 2004), et nous savons que la première pandémie de cette<br />
maladie a fait le tour du bassin méditerranéen au VI ème siècle ; son point de départ évoqué était<br />
l’Egypte, où la maladie aurait sévi depuis plus de deux mille ans. La puce du rat d’Egypte porteur<br />
sain, se serait ensuite adaptée au rat noir venu d’Asie, qui s’est ensuite répandu progressivement<br />
vers l’Europe en propageant la maladie surtout dans les zones urbaines. Les auteurs ont alors parlé<br />
de peste Justinienne (PANAGIOTAKOPULU, 2004).<br />
Notre population est bien une population urbaine de l’antiquité tardive, et nous pouvons imaginer<br />
qu’il s’agit plutôt de personnes modestes, d’artisans.<br />
Les seuls marqueurs de santé utilisables que nous ayons pour cette population prise dans son<br />
ensemble sont d’une part l’état dentaire, et d’autre part les signes de carence martiale : l’état<br />
dentaire est très mauvais, et nous observons trois cas de cribra orbitalia pour nos 36 sujets !<br />
La prévalence de pathologies infectieuses (oreilles et sinus), qui a aussi pu être utilisée comme<br />
marqueur, nécessite l’étude de séries beaucoup plus importantes.<br />
Nous n’avons trouvé que peu de chose sur cette approche type Santé Publique, qui nous paraît<br />
passionnante.<br />
Nous avons déjà parlé de l’étude d’une population néolithique de Pologne centrale de 92 individus<br />
(4300-4000 B.C.) ; un inventaire dentaire complet y est réalisé par l’auteur à la recherche de caries,<br />
résorptions alvéolaires, pertes de dents, et hypoplasies de l’émail.<br />
Des caries sont observées chez 30.1% des individus, caries localisées essentiellement sur les<br />
surfaces mésiodistales et buccales des molaires, à l’exception d’un cas sur une seconde prémolaire,<br />
et d’une seule carie de la surface occlusale. Ce type de localisation est généralement rapporté à un<br />
manque d’hygiène de la cavité buccale. Aucune implication quant à l’alimentation n’est évoquée.<br />
La résorption alvéolaire est notée dans 52% des cas chez les adultes, surtout chez les hommes, et les<br />
pertes de dents dans 34.5% des cas.<br />
Les hypoplasies de l’émail, bien connues comme marqueurs de stress, surtout dans le cas de<br />
carences alimentaires, sont notées dans 67.8% des cas ! La fréquence des hypoplasies semble plus<br />
importante pour les hommes.<br />
En parallèle une fréquence importante de cribra orbitalia était observée : 34.9%. L’importance de<br />
cette pathologie peut être associée à une période d’intensification de l’agriculture, avec modification<br />
de l’équilibre alimentaire ; période où par ailleurs les populations se regroupent de plus en plus en<br />
communautés, avec une occupation permanente des villages, en promiscuité avec des animaux<br />
domestiques, une hygiène précaire, facteurs favorisants pour le développement des virus, bactéries<br />
et champignons pathogènes (GARLOWSKA, op.cit.).<br />
Une autre étude qui prend comme indicateur les séquelles d’otites chroniques, dans deux<br />
populations ayant vécu dans une même région du Danemark, à deux époques médiévales<br />
différentes, XI ème et XIV ème siècles, constate un accroissement net des pathologies pour l’époque<br />
la plus récente (de 1% à 7%). Les auteurs concluent à une détérioration des conditions de vie, ce<br />
que confirment leurs recherches sur le plan démographique et historique.<br />
Ils développent par ailleurs la théorie d’un « ostéological paradox » (WOOD et al., 1992), qui<br />
consiste à dire que les individus présentant des séquelles importantes sont en fait ceux qui sont en<br />
meilleure santé, puisqu’ils ont réussi à survivre à leur maladie (QVISTet GRØNTVED, op.cit.) !<br />
Dans le même ordre d’idée l’étude de cimetières de classes sociales différentes à l’époque<br />
Mérovingienne, constate une prévalence de pathologies infectieuses otitiques dans celui dévolu aux<br />
classes pauvres, par rapport à celui des princes (SCHULTZ, op.cit.).<br />
A l’évidence, de bonnes conditions de vie, tant du point de vue de l’habitat, que de la nourriture,<br />
<strong>EPHE</strong> Banque de Monographies SVT 23
permettent d’une part d’être moins exposé aux agents pathogènes, et aux facteurs irritants (fumée<br />
dans les maisons), et d’autre part d’avoir un système immunitaire en parfait état de fonctionnement.<br />
Ce même auteur propose aussi une approche environnementale dans son article sur les tumeurs<br />
osseuses : il relie le nombre important de tumeurs des sinus para-nasaux, à une inflammation<br />
chronique des voies respiratoires supérieures liée aux mauvaises conditions de vie dans les habitats<br />
populaires Mérovingiens privés de cheminées.<br />
Ces constatations restent valables de nos jours, quand nous voyons par exemple la recrudescence de<br />
la tuberculose dans notre « quart monde », ou les milieux de l’immigration.<br />
L’interprétation sociale de la paléopathologie est très intéressante ; il faut cependant rester prudent<br />
dans les analyses, car ces hypothèses sont souvent avancées à partir de l’étude de petites séries !<br />
<strong>EPHE</strong> Banque de Monographies SVT 24
BIBLIOGRAPHIE<br />
1 ANDERSON, T., Medieval example of cleft lip and palate from St. Gregory's Priory, Canterbury. Cleft Palate<br />
Craniofac J., 1994. 31(6): p. 466-72.<br />
2 ANGEL, J.L., Skeletal material from Attica. Hesperia, 1945. 14: p. 279-363.<br />
3 ARMELAGOS, G.J. et CHRISMAN, O.D., Hyperostosis frontalis interna: a Nubian case. Am J Phys Anthropol.,<br />
1988. 76(1): p. 25-8.<br />
4 ARNAY-DE-LA-ROSA, M., et al., Auricular exostoses among the prehistoric population of different islands of the<br />
Canary Archipelago. Ann Otol Rhinol Laryngol., 2001. 110: p. 1080-1083.<br />
5 ASCENZI, A., BENVENUTI, A., et SEGRE A.G., On the paleopathologic findings exhibited by the late Homo erectus<br />
of Ceprano, Italy. HUM-EVOL., 1997. 12(3): p. 189-196.<br />
6 BALLESTER, M., Pathologie ORL et loisirs. OPA pratique, 2003(170): p. 1-5.<br />
7 BENITEZ, J.T., Otopathology of Egyptian mummy Pum II: final report. J Laryngol Otol., 1988. 102(6): p. 485-90.<br />
8 BIRKBY, W.H. et GREEG, J.B., Otosclerotic stapedial footplate fixation in an 18th. century burial. Am J Phys<br />
Anthropol, 1975. 42: p. 81-4.<br />
9 BOOCOCK, P., ROBERTS, C., et MANCHESTER, K., Maxillary sinusitis in Medieval Chichester, England. Am J<br />
Phys Anthropol., 1995. 98(4): p. 483-95.<br />
10 BOOCOCK, P.A., ROBERTS, C.A., et MANCHESTER, K., Prevalence of maxillary sinusitis in leprous individuals<br />
from a medieval leprosy hospital. Int J Lepr Other Mycobact Dis., 1995. 63(2): p. 265-8.<br />
11 CALDARELLI, D.D., et al., A comparison of microtia and temporal bone anomalies in hemifacial microsomia and<br />
mandibulofacial dysostosis. Cleft Palate Craniofac J., 1980(17): p. 103-115.<br />
12 CAMPILLO, D., CARVAJAL, A., et PRIM, J., Acoustic neuromas in paleopathology. Journal of Paleopathology,<br />
1997. 9(1): p. 23-36.<br />
13 CASPARI, R., Brief communication: evidence of pathology on the frontal bone from Gongwangling. Am J Phys<br />
Anthropol., 1997. 102(4): p. 565-8.<br />
14 CASTEX, D., Mortalité, morbidité, et gestion de l'espace funéraire au cours du haut Moyen-Age .Contribution<br />
spécifique de l'anthropologie biologique. 1994, Bordeaux I. p. 330 p. (n.p.).<br />
15 CASTEX, D., Les Fédons. 1996, Service Régional de l'Archéologie de P.A.C.A.<br />
16 CHARPY, J.J., BELLIER, C., et CATTELAIN, P., "Au temps de Clovis" Les Mérovingiens en Champagne et en<br />
Ardenne. L'Archéologue, 2003(69): p. 19-31.<br />
17 CIRRANI, R., CASTAGNA, M., et FORNACIARI, G., Goiter in an eighteenth-century Sicilian mummy. Am J Phys<br />
Anthropol., 1999. 108(4): p. 427-32.<br />
18. CZIGANY, J., Hallocsontmaradvanyok masfel ezer ev tavlatabol (Is it unusual to find auditory ossicles among<br />
medieval fossils?). Orv. Hetil., 1996. 137: p. 1430-1431.<br />
19 CZIGANY, J., [Paleopathology of the hearing organ]. Orv Hetil., 1998. 139(16): p. 967-8.<br />
20 DASTUGUE, J. et GERVAIS, V., Paléopathologie du squelette humain. L'Homme et ses origines. 1992, Boubée,<br />
Paris. 253.<br />
<strong>EPHE</strong> Banque de Monographies SVT 25
21 DRANCOURT, M., et al., Genotyping, Orientalis-like yersinia pestis, and Plague Pendemics. Emerging Infectious<br />
diseases, 2004. 10(9): p. 1585-1592.<br />
22 GAAFAR, H., ABDEL-MONEM, M., et ELSHEIKH, S., Nasal endoscopy and CT study of Pharaonic and Roman<br />
mummies. Acta Otolaryngol., 1999. 119(2): p. 257-60.<br />
23 GARLOWSKA, E., Disease in the neolithic population of the Lengyel culture (4300-4000 B.C.) from the Kujawy<br />
region in north-central Poland. Z Morphol Anthropol., 2001. 83(1): p. 43-57.<br />
24 GERSZTEN, P., GERSZTEN E., et ALLISON M., Diseases of the skull in pre-Columbian South American mummies.<br />
Neurosurgery., 1998. 42(5): p. 1145-51; discussion 1151-2.<br />
25 GREGG, J.B. et BASS W.M., Exostoses in the external auditory canals. Ann Otol Rhinol Laryngol., 1970. 79(4): p.<br />
834-9.<br />
26 GREGG, J.B., et al., Otolaryngic osteopathology in 14th century mid-america. The crow creek massacre. Ann Otol<br />
Rhinol Laryngol., 1981. 90(3 Pt 1): p. 288-93.<br />
27 GRMEK, M., Les maladies à l'aube de la civilisation occidentale, 1994, Payot et Rivages., Paris. 532.<br />
28 GUERRIER, Y. et MOUNIER-KHUN, P., Histoire des Maladies de l'Oreille du Nez et de la Gorge 1980, Roger<br />
Dacosta, Paris. 492.<br />
29 GUIGNIER, M., Les sépultures multiples du Clos des Cordeliers à Sens (Yonne). IVe-VIe siècles. Approches<br />
archéologique, biologique, et historique, Diplôme d’Etudes Approfondies, 1997, Université de Bordeaux I. 60<br />
30 GUNKEL, A.R., et al., Otorhinolaryngologic computer-assisted biopsies of the Iceman. Arch Otolaryngol Head Neck<br />
Surg., 1997. 123(3): p. 253-6.<br />
31 HERSHKOVITZ, I., et al., Hyperostosis frontalis interna: an anthropological perspective. Am J Phys Anthropol.,<br />
1999. 109(3): p. 303-25.<br />
32 HODGES, D.C., Temporomandibular joint osteoarthritis in a British skeletal population. Am J Phys Anthropol.,<br />
1991. 85(4): p. 367-77.<br />
33 HOMOE, P., LYNNERUP, N., et VIDEBAEK, H., CT-scanning of ancient Greenlandic Inuit temporal bones. Acta<br />
Otolaryngol., 1992. 112(4): p. 674-9.<br />
34 HORNE, P.D., et al., Histologic processing and examination of a 4,000-year-old human temporal bone. Arch<br />
Otolaryngol, 1976. 102(12): p. 713-5.<br />
35 HUTCHINSON, D.L., et al., A reevaluation of the cold water etiology of external auditory exostoses. Am J Phys<br />
Anthropol., 1997. 103(3): p. 417-22.<br />
36 LAGIER, R., Bases anatomopathologiques du diagnostic d'infection squelettique en paléopathologie. Bull. et Mém.<br />
de la Société d'Anthropologie de Paris, n.s., 1998. 10(1-2): p. 5-16.<br />
37 LEDERMANN, S., Nouvelles tables de mortalité. 1969, I.N.E.D.: Paris.<br />
38 LEWIS, M.E., ROBERTS, C.A, et MANCHESTER, K., Comparative study of the prevalence of maxillary sinusitis in<br />
later Medieval urban and rural populations in northern England. Am J Phys Anthropol., 1995. 98(4): p. 497-506.<br />
39 LOVELAND, C.J., PIERCE, L.C., et GREGG, J.B, Ancient temporal bone osteopathology. Ann Otol Rhinol<br />
Laryngol., 1990. 99(2 Pt 1): p. 146-54.<br />
40 LYNN, G.E. et BENITEZ, J.T., Temporal bone preservation in a 2600-year-old Egyptian mummy. Science., 1974.<br />
183(121): p. 200-2.<br />
<strong>EPHE</strong> Banque de Monographies SVT 26
41 MAFART, B.Y., PATHOLOGIE OSSEUSE AU MOYEN AGE EN PROVENCE. PALEOECOLOGIE DE L'HOMME<br />
FOSSILE. Vol. 4. 1983, Paris: Editions du C.N.R.S. 266.<br />
42 MAFART, B.Y., et al., Le crâne Romain d'Arles: une syphilis naso-frontale post-colombienne, apport des nouvelles<br />
méthodes de datation C 14 en paléopathologie. Bull. et Mém. de la Société d'anthropologie de Paris, 1998. 10(3-4):<br />
p. 333-334.<br />
43 MANZI, G., SPERDUTI, A., et PASSARELLO, P., Behavior-induced auditory exostoses in imperial Roman society:<br />
evidence from coeval urban and rural communities near Rome. Am J Phys Anthropol., 1991. 85(3): p. 253-60.<br />
44 MOLLER-CHRISTENSEN, V., Changes in the anterior nasal spine and the alveolar process of the macillae in<br />
leprosy : a clinical examination. Int J Lepr Other Mycobact Dis., 1974. 42(4): p. 431-5.<br />
45 MOLLER-CHRISTENSEN, V., Bone Changes in Leprosy. 1961, Munksgaard, Copenhagen. 51.<br />
46 MOLNAR, E., DUTOUR, O., et PALFI, G., Diagnostic paléopathologique des tréponématoses: à propos d'un cas<br />
bien conservé. Bull. et Mém. de la Société d'Anthropologie de Paris, n.s., 1998. 10(1-2): p. 17-28.<br />
47 MOLNAR, S., Human tooth wear, tooth function, and cultural variability. Am J Phys Anthropol, 1971(24): p. 175-<br />
190.<br />
48 MONTGOMERY, P.Q., et al., An assessment of the temporal bone lesions of the Broken Hill cranium. Journal of<br />
Archaeological Science, 1994. 21: p. 331-337.<br />
49 MOTAMED, M., et al., ENT aspects of the mummification of the head in ancient Egypt: an imaging study. Rev<br />
Laryngol Otol Rhinol (Bord)., 1998. 119(5): p. 337-9.<br />
50 NAGAR, Y. et ARENSBURG, B., Brief communication: bilateral aplasia of the condyles in a 1,400-year-old<br />
mandible from Israel. Am J Phys Anthropol., 2000. 111(1): p. 135-9.<br />
51 NAKATA, S., et al., Functional masticatory evaluation of hemifacial microsomia. European Journal of Orthodontics,<br />
1995(17): p. 273-280.<br />
52 PALES, L., Paléopathologie et Pathologie Comparative. 1930, Paris: Masson. 352.<br />
53 PANAGIOTAKOPULU, E., Pharaonic Egypt and the origins of plague. Journal of Biogeography, 2004(31): p. 269.<br />
54 PEREZ, P.J., et al., Paleopathological evidence of the cranial remains from the Sima de los Huesos Middle<br />
Pleistocene site (Sierra de Atapuerca, Spain). Description and preliminary inferences. J Hum Evol, 1997. 33(2-3):<br />
p. 409-21.<br />
55 PERROT, R., MOREL, P., et BERARD, G., Un cas intéressant de trépanation mégalithique (dolmen de roque-d'aille,<br />
Lorgues, Var) associée à une imitation auriculaire. Cahiers Médicaux Lyonnais, 1972. 48(26): p. 2871-2880.<br />
56 PIRSIG, W., Diseases of the nasal region on ceramics of the Moche-culture in ancient Peru. Rhinol Suppl., 1989. 9:<br />
p. 27-36.<br />
57 PIRSIG, W., [Aplasia and hypoplasia of the side of the nose in the Mocha Period and today]. Auris Nasus Larynx.,<br />
1989. 16(Suppl 1): p. S47-52.<br />
58 POSPISILOVA, B., et al., Findings of massive pneumatization of the middle nasal turbinate in a collection of skulls<br />
from the 13th-18th centuries. Acta Medica (Hradec Kralove) Suppl.Czech., 2001. 44(2): p. 53-8.<br />
59 QVIST, M. et GRONTVED, A.M., Chronic otitis media sequelae in skeletal material from medieval Denmark.<br />
Laryngoscope., 2001. 111(1): p. 114-8.<br />
60 SCHULTZ, M., [An osseus tumor in the skull of a precolumbian indian from Peru (author's transl)]. Virchows Arch<br />
<strong>EPHE</strong> Banque de Monographies SVT 27
A Pathol Anat Histol., 1978. 378(2): p. 121-32.<br />
61 SCHULTZ, M., Diseases in the ear region in early and prehistoric populations. J Hum Evol, 1979(8): p. 575-580.<br />
62 SCHULTZ, M., Nature and Frequency of Bony Tumors in Prehistoric and Historic Populations. IN VIVO (Athens),<br />
1992(6): p. 439-442.<br />
63 SPITERY, E., LA PALEONTOLOGIE DES MALADIES OSSEUSES CONSTITUTIONNELLES. PALEOECOLOGIE<br />
DE L'HOMME FOSSILE. Vol. 6. 1983, Marseille: Editions du C.N.R.S. 130.<br />
64 SPOOR, F., STRINGER, C., et ZONNEVELD, F., Rare temporal bone pathology of the Singa calvaria from Sudan.<br />
Am J Phys Anthropol., 1998. 107(1): p. 41-50.<br />
65 STANDEN, V.G., ARRIAZA, B.T., et SANTORO, C.M., External auditory exostosis in prehistoric Chilean<br />
populations: a test of the cold water hypothesis. Am J Phys Anthropol., 1997. 103(1): p. 119-29.<br />
66 THUMFART, W.F., et al., 3D image-guided surgery on the example of the 5,300-year-old Innsbruck Iceman. Acta<br />
Otolaryngol., 1997. 117(2): p. 131-4.<br />
67 VELASCO-VAZQUEZ, J., et al., Auricular exostoses among the prehistoric population of Gran Canaria. Am J Phys<br />
Anthropol, 2000. 112: p. 49-55.<br />
68 WELLS, C., Disease of the maxillary sinus in antiquity. Med Biol Illus., 1977. 27(4): p. 173-8.<br />
69 WOO, J.K., Mandible of Sinanthropus Lantianensis. Curr. Anthrop., 1964(5): p. 98-101.<br />
70 WOOD, J.W., MILNER, G.R., HARPENDING, H.C., WEISS, K.M., The osteological paradox. Current<br />
Anthropology, 1992 (4) : p. 343-370.<br />
71 YARDLEY, M., et RUTKA, J., Rescued from the sands of time: interesting otologic and rhinologic findings in two<br />
ancient Egyptian mummies from the Royal Ontario Museum. J Otolaryngol., 1997. 26(6): p. 379-83.<br />
Bibliographie complémentaire :<br />
Articles et Ouvrages non cités dans le texte.<br />
1. AARON, J.E., ROGERS, J., et KANIS, J.A., Paleohistology of Paget's disease in two medieval skeletons. Am J Phys<br />
Anthropol., 1992. 89(3): p. 325-31.<br />
2. ARENSBURG, B., GOLDSTEIN, M., et RAY, Y., Observations on the pathology of the Jewish population in Israel<br />
(100 B.C. to 600 C.E.). Korot., 1985. 9(1-2): p. 73-83.<br />
3. BARTHELEMY, I., et al., [Stomatologic and maxillofacial pathology in a medieval population (10th-12th centuries)<br />
of southwestern France]. Rev Stomatol Chir Maxillofac., 1999. 100(3): p. 133-9.<br />
4. CAMPILLO, D., Paleopatologia - Los primeros vestigios de la enfermedad. Coleccion Historica de Ciencias de la<br />
Salud, ed. F.U. 1838. Vol. 4. 1993, Barcelona. 167.<br />
5. CAMPILLO, D., Paleopatologia - Los primeros vestigios de la enfermedad. Coleccion Historica de Ciencias de la<br />
Salud, ed. F.U.-À. 1838. Vol. 5. 1994, Barcelona. 123.<br />
6. CAMPILLO, D., Afecciones otorrhinolaringologicas en la prehistoria. ORL-DIPS, s.d. (6): p. 363-372.<br />
7. CASTEX, D. et FRIESS, M., Pein und plagen. Aspekte einer Historischen Epidemiologie. Archaea Epidemiologie.<br />
1998, Francfort: Kernkes-Grottenthaller A. Henke W.<br />
<strong>EPHE</strong> Banque de Monographies SVT 28
8. COPPENS, Y. et PICQ, P., Aux Origines de l'Humanité. De l'apparition de la vie à l'homme moderne.<br />
Vol. 1. 2002, Fayard, Paris. 649.<br />
9. DASTUGUE, J., Pathology of French paleolithic man. Paleopathol Newsl., 1974. 7: p. 9-14.<br />
10. DUDAY, H. Anthropologie "de terrain", archéologie de la mort. dans La Mort, passé, présent, conditionnel:<br />
colloque du groupe Vendéen d'Etudes Préhistoriques. 1995. La Roche-sur-Yon: G.V.E.P.<br />
11. EUFINGER, H., et al., Descriptive and metric classification of jaw atrophy. An evaluation of 104 mandibles and 96<br />
maxillae of dried skulls. Int J Oral Maxillofac Surg., 1997. 26(1): p. 23-8.<br />
12. GOSSEREZ, M., CHASSAGNE, J.F., et GOSSEREZ, O., Kystes du maxillaire supérieur, E.M.C. O.R.L. [20482 A<br />
10], 1982, E.M.Chir., Paris. 10.<br />
13. HIOCO, D.J. La Maladie de Paget - Symposium International. 1973: Laboratoires Armour Montagu, Paris. 321.<br />
14. KENNEDY, G.E., The relationship between auditory exostoses and cold water: a latitudinal analysis. Am J Phys<br />
Anthropol, 1986. 71(4): p. 401-15.<br />
15. PAHOR, A.L., Ear, nose and throat in ancient Egypt. Part III. J Laryngol Otol., 1992. 106(10): p. 863-73.<br />
16. PARK, A.W. et YAACOB, H.B., The ancient origins of oral pathology. J Nihon Univ Sch Dent., 1991. 33(4): p. 211-<br />
43.<br />
17. PICQ, P. et COPPENS, Y., Aux origines de l'humanité. Le propre de l'homme. Vol. 2. 2002, Fayard, Paris. 569.<br />
18. PIGEAUD, R., Du rififi chez les hommes préhistoriques. La Recherche, 2002(357): p. 18-19.<br />
19. PORTMANN, G., Les Mastoïdites. 1945, Masson, Paris. 504.<br />
20. RATHBUN, T.A. et MALLIN, R., Middle ear disease in a prehistoric Iranian population. Bull N Y Acad Med.,<br />
1977. 53(10): p. 901-5.<br />
21. REYBEYROL, Y., Lucy et les siens - Chroniques préhistoriques. 1988, La Découverte et Journal "Le Monde", Paris.<br />
324.<br />
22. ROTHSCHILD, B.M. et THILLAUD, P.L., Oldest bone disease. Nature., 1991. 349(6307): p. 288.<br />
23. ROUVIERE, H., Anatomie Humaine. Tome I, Fasc I et II, 5 ème éd., 1943, Masson, Paris. 1156.<br />
24. SIGNOLI, M., CHAUSSERIE-LAPREE, J., et DUTOUR, O., Etude anthropologique d'un charnier de peste de<br />
1720-1721 à Martigues. Préhistoire Méditerranéenne, 1995. 4: p. 173-189.<br />
25. TAGUE, R.G., Bone resorption of the pubis and preauricular area in humans and nonhuman mammals. Am J Phys<br />
Anthropol., 1988. 76(2): p. 251-67.<br />
26. TERRACOL, J., Les Maladies des Fosses Nasales. 1953, Masson, Paris. 838.<br />
27. TESTUT, L., Traité d'Anatomie Humaine. Vol. 1 et 2, 3 éme éd., 1896, Octave Doin, Paris. 1188.<br />
28. TILLIER, A.M., et al., Brief communication: An early case of hydrocephalus: the Middle Paleolithic Qafzeh 12 child<br />
(Israel). Am J Phys Anthropol., 2001. 114(2): p. 166-70.<br />
29. TORINO, M., [Diseases of ancient Egyptian mummies]. Arch Stomatol (Napoli)., 1990. 31(3): p. 653-63.<br />
30. VEYRET, C. and e. al., Radiologie de la sinusite chronique. Bayer ed. 1995: Agence V.L.C. - 95560 Maffliers. 72.<br />
31. WELLS, C. and C. DALLAS, Romano-British pathology. Antiquity., 1976. 50: p. 53-5.<br />
<strong>EPHE</strong> Banque de Monographies SVT 29
32. ZINK, A., et al., Malignant tumors in an ancient Egyptian population. Anticancer Res., 1999. 19(5B): p. 4273-7.<br />
<strong>EPHE</strong> Banque de Monographies SVT 30