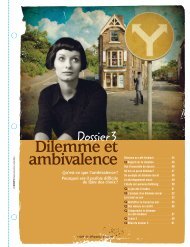Les maladies infectieuses du système respiratoire - Erpi
Les maladies infectieuses du système respiratoire - Erpi
Les maladies infectieuses du système respiratoire - Erpi
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Chapitre 24 <strong>Les</strong> <strong>maladies</strong> <strong>infectieuses</strong><br />
<strong>du</strong> <strong>système</strong> <strong>respiratoire</strong><br />
Pneumocystis carinii.<br />
Ce mycète provoque une<br />
pneumonie chez les personnes<br />
immunodéprimées.<br />
La structure et les fonctions<br />
<strong>du</strong> <strong>système</strong> <strong>respiratoire</strong><br />
Objectif d’apprentissage<br />
Àchaque inspiration, on inhale plusieurs<br />
microorganismes présents dans des<br />
gouttelettes d’aérosol ou dans des sécrétions<br />
contaminées ; les voies <strong>respiratoire</strong>s supérieures<br />
constituent donc une porte d’entrée majeure<br />
pour les agents pathogènes. En fait, les infections<br />
<strong>du</strong> <strong>système</strong> <strong>respiratoire</strong> sont le type<br />
d’infection le plus courant, et elles comptent<br />
parmi les plus graves. L’ingestion d’aliments<br />
ou d’eau contaminés peut également con<strong>du</strong>ire<br />
■ Décrire les mécanismes qui s’opposent à l’entrée des microorganismes<br />
dans le <strong>système</strong> <strong>respiratoire</strong>.<br />
Pour des raisons pratiques, on divise le <strong>système</strong> <strong>respiratoire</strong><br />
en deux grandes parties: les voies <strong>respiratoire</strong>s supérieures et<br />
les voies <strong>respiratoire</strong>s inférieures. <strong>Les</strong> voies <strong>respiratoire</strong>s<br />
supérieures sont constituées <strong>du</strong> nez, <strong>du</strong> pharynx comprenant<br />
le nasopharynx, l’oropharynx et la laryngopharynx, et des<br />
structures associées, qui comprennent l’oreille moyenne et la<br />
à des infections <strong>respiratoire</strong>s. Par ailleurs,<br />
certains des agents pathogènes qui pénètrent<br />
dans le corps par les voies <strong>respiratoire</strong>s infectent<br />
d’autres parties <strong>du</strong> corps ; c’est le cas des<br />
microorganismes responsables de la rougeole,<br />
des oreillons et de la rubéole. Un Tableau<br />
résumé dresse une liste des différentes<br />
<strong>maladies</strong> <strong>infectieuses</strong> <strong>du</strong> <strong>système</strong> <strong>respiratoire</strong><br />
à la fin <strong>du</strong> chapitre.<br />
trompe auditive (figure 24.1). <strong>Les</strong> con<strong>du</strong>its partant des sinus<br />
et les con<strong>du</strong>its lacrymo-nasaux de l’appareil lacrymal (qui<br />
pro<strong>du</strong>it les larmes) débouchent sur la cavité nasale (figure 16.3).<br />
La trompe auditive, ou trompe d’Eustache, s’ouvre sur la<br />
partie supérieure <strong>du</strong> pharynx ou nasopharynx.<br />
Sur le plan anatomique, les voies <strong>respiratoire</strong>s supérieures<br />
sont dotées de plusieurs mécanismes de défense contre les<br />
agents pathogènes aéroportés. <strong>Les</strong> poils rugueux <strong>du</strong> nez<br />
filtrent les grosses particules de poussière contenues dans l’air.<br />
De plus, la muqueuse qui tapisse le nez et le nasopharynx<br />
comporte de nombreuses cellules ciliées et des cellules sécrétant<br />
<strong>du</strong> mucus.Le mucus humidifie l’air inhalé et emprisonne<br />
les poussières et les microorganismes, en particulier les particules<br />
dont le diamètre dépasse 4 ou 5 m. <strong>Les</strong> cellules ciliées
2 QUATRIÈME PARTIE <strong>Les</strong> microorganismes et les <strong>maladies</strong> humaines<br />
Sinus frontal<br />
Cavité nasale<br />
Amygdale pharyngienne<br />
Cavité buccale<br />
Amygdales palatine et linguale<br />
Langue<br />
Épiglotte<br />
Larynx<br />
Trachée<br />
FIGURE 24.1 Structures des voies <strong>respiratoire</strong>s supérieures.<br />
■ Nommer les mécanismes de défense des voies <strong>respiratoire</strong>s supérieures<br />
contre les agents pathogènes.<br />
jouent un rôle dans l’élimination de ces particules; le mouvement<br />
de leurs cils les refoule vers la bouche.<br />
À la jonction entre le nez et l’oropharynx, communément<br />
appelé gorge, se trouvent les amygdales, formées de<br />
tissu lymphoïde, qui participent à la lutte contre certaines<br />
infections. Il arrive cependant que les amygdales s’infectent<br />
et contribuent à la dissémination de l’agent pathogène jusqu’à<br />
l’oreille par l’intermédiaire de la trompe auditive. Étant<br />
donné que le nez et la gorge sont reliés aux sinus, à l’appareil<br />
lacrymo-nasal et à l’oreille moyenne, il n’est pas rare qu’une<br />
infection se propage d’une de ces régions à une autre.<br />
<strong>Les</strong> voies <strong>respiratoire</strong>s inférieures comprennent le<br />
larynx, la trachée, les bronches et les alvéoles pulmonaires<br />
(figure 24.2). Deux ou plusieurs alvéoles sont regroupées<br />
en sacs alvéolaires, qui constituent le tissu pulmonaire; c’est<br />
à l’intérieur de ces sacs que s’effectuent les échanges gazeux<br />
entre les poumons et le sang. <strong>Les</strong> poumons humains comportent<br />
plus de 300 millions d’alvéoles, de sorte que la surface<br />
de tissu où ont lieu les échanges gazeux mesure au<br />
moins 70 m 2 . La membrane à deux feuillets qui entoure les<br />
poumons est la plèvre.<br />
La muqueuse ciliée tapissant les voies <strong>respiratoire</strong>s inférieures<br />
<strong>du</strong> larynx jusqu’aux bronchioles s’oppose également<br />
à l’entrée des microorganismes dans les poumons. <strong>Les</strong> particules<br />
emprisonnées sont repoussées vers la gorge par l’activité<br />
Sinus sphénoïdal<br />
Oreille moyenne<br />
Trompe auditive<br />
Orifice de la trompe auditive<br />
Pharynx<br />
Colonne vertébrale<br />
Œsophage<br />
combinée des cils et <strong>du</strong> mucus; ce mécanisme s’appelle escalier<br />
mucociliaire (figure 16.4). Le lysozyme, une enzyme présente<br />
dans tous les liquides biologiques tels les sécrétions<br />
nasales et le mucus des voies <strong>respiratoire</strong>s, concourt à la<br />
destruction des bactéries inhalées. Dans l’épaisseur de la<br />
muqueuse bronchique se trouvent de petits follicules lymphatiques<br />
composés de macrophagocytes, de lymphocytes B<br />
(secrètent des IgA) et T. L’activité immunitaire de ces<br />
différentes cellules contribue à la protection des bronches.<br />
En général, si des microorganismes atteignent néanmoins<br />
les alvéoles pulmonaires, des macrophagocytes (macrophages)<br />
alvéolaires les localisent, puis les ingèrent et les détruisent.<br />
À cette action non spécifique s’ajoute l’action spécifique<br />
des anticorps de type IgA contenus dans certaines sécrétions<br />
tels le mucus des voies <strong>respiratoire</strong>s, la salive et les larmes<br />
(tableau 17.1);les anticorps IgA jouent un rôle dans la protection<br />
des muqueuses contre de nombreux agents pathogènes.<br />
Ainsi, le corps est doté de divers mécanismes de défense<br />
qui participent à l’élimination des agents pathogènes responsables<br />
des infections <strong>respiratoire</strong>s:défense non spécifique d’une<br />
part, de nature tant mécanique que chimique et cellulaire, et<br />
défense spécifique d’autre part, associée à la présence d’anticorps<br />
IgA dans les sécrétions. Ces mécanismes contribuent<br />
au maintien de l’homéostasie de l’organisme humain en le<br />
protégeant contre l’action des microbes.
Pharynx<br />
(gorge)<br />
Larynx<br />
Trachée<br />
Poumon droit<br />
Bronche<br />
Bronchiole<br />
Plèvre<br />
Diaphragme<br />
(muscle de<br />
la respiration)<br />
La flore normale<br />
<strong>du</strong> <strong>système</strong> <strong>respiratoire</strong><br />
Objectif d’apprentissage<br />
■ Décrire les caractéristiques et le rôle de la flore normale des<br />
voies <strong>respiratoire</strong>s supérieures et inférieures.<br />
La flore normale <strong>du</strong> <strong>système</strong> <strong>respiratoire</strong> colonise la muqueuse<br />
des cavités nasales et <strong>du</strong> pharynx. Staphylococcus aureus,<br />
Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pneumoniæ et les diphtéroïdes<br />
sont majoritaires dans le nez et le nasopharynx,alors<br />
que les streptocoques <strong>du</strong> groupe viridans sont plus nombreux<br />
dans la cavité buccale et l’oropharynx. Un certain<br />
nombre de microorganismes potentiellement pathogènes<br />
Objectif d’apprentissage<br />
■ Faire la distinction entre pharyngite, laryngite, amygdalite,<br />
sinusite et épiglottite.<br />
CHAPITRE 24 <strong>Les</strong> <strong>maladies</strong> <strong>infectieuses</strong> <strong>du</strong> <strong>système</strong> <strong>respiratoire</strong> 3<br />
Cœur<br />
FIGURE 24.2 Structures des voies <strong>respiratoire</strong>s inférieures.<br />
Poumon gauche<br />
■ Nommer les mécanismes de défense des voies <strong>respiratoire</strong>s inférieures<br />
contre les agents pathogènes.<br />
Bronchiole<br />
Veinule<br />
pulmonaire<br />
LES MALADIES INFECTIEUSES<br />
DES VOIES RESPIRATOIRES SUPÉRIEURES<br />
Artériole<br />
pulmonaire<br />
Capillaires<br />
Alvéoles<br />
font partie de la flore normale des voies <strong>respiratoire</strong>s supérieures.<br />
En général, ils ne provoquent pas de maladie parce<br />
que les microorganismes prédominants de la flore normale<br />
font obstacle à leur croissance en s’appropriant les nutriments<br />
et en pro<strong>du</strong>isant des substances inhibitrices; il s’agit de<br />
l’antagonisme microbien ou effet barrière dont nous avons<br />
parlé au chapitre 14. Par exemple, les streptocoques <strong>du</strong><br />
groupe viridans présents dans la bouche exercent un effet<br />
barrière sur Streptococcus pyogenes.<br />
Par contre, les voies <strong>respiratoire</strong>s inférieures sont normalement<br />
presque stériles – bien que la trachée puisse abriter<br />
quelques bactéries – grâce à l’efficacité de l’escalier mucociliaire<br />
dans les bronches et à l’activité phagocytaire.<br />
Chacun sait par expérience que plusieurs affections courantes<br />
touchent les voies <strong>respiratoire</strong>s. Nous traiterons sous<br />
peu de la pharyngite, inflammation des muqueuses de la
4 QUATRIÈME PARTIE <strong>Les</strong> microorganismes et les <strong>maladies</strong> humaines<br />
gorge aussi appelée angine. Si l’infection touche le larynx, le<br />
sujet souffre d’une laryngite, qui ré<strong>du</strong>it sa capacité de parler.<br />
Cette dernière affection est causée par une bactérie,telle que<br />
Streptococcus pneumoniæ ou S. pyogenes, ou par un virus,<br />
et souvent par des microorganismes des deux types. <strong>Les</strong><br />
microbes responsables de la pharyngite peuvent aussi provoquer<br />
une inflammation des amygdales, l’amygdalite.<br />
<strong>Les</strong> sinus paranasaux sont des cavités situées dans certains<br />
os crâniens; ils s’ouvrent sur la cavité nasale. <strong>Les</strong> muqueuses<br />
tapissant les sinus et la cavité nasale forment une membrane<br />
continue. L’infection d’un sinus par un microorganisme tel<br />
que S. pneumoniæ ou Hæmophilus influenzæ se tra<strong>du</strong>it par une<br />
inflammation des muqueuses, d’où un abondant écoulement<br />
nasal de liquide muqueux. On appelle cet état sinusite.<br />
Si l’orifice qui permet au mucus de s’échapper <strong>du</strong> sinus<br />
s’obstrue, la pression interne qui en résulte occasionne de la<br />
douleur. Ces <strong>maladies</strong> sont presque toujours spontanément<br />
résolutives, c’est-à-dire que la guérison se pro<strong>du</strong>it généralement<br />
sans intervention médicale. Toutefois, des antibiotiques<br />
sont fréquemment prescrits lorsque l’infection est<br />
d’origine bactérienne.<br />
La maladie infectieuse des voies <strong>respiratoire</strong>s supérieures<br />
la plus dangereuse est l’épiglottite, soit l’inflammation de<br />
l’épiglotte. L’épiglotte est une structure cartilagineuse, dont<br />
la forme évoque une feuille, qui empêche les matières ingérées<br />
d’entrer dans le larynx (figure 24.1). L’épiglottite est une<br />
maladie à évolution rapide susceptible d’entraîner la mort en<br />
quelques heures. Elle est <strong>du</strong>e à un agent pathogène, le plus<br />
souvent H. influenzæ type b. L’administration <strong>du</strong> nouveau<br />
vaccin Hib, élaboré surtout pour lutter contre la méningite,<br />
a ré<strong>du</strong>it de façon considérable l’incidence de l’épiglottite<br />
chez les personnes immunisées.<br />
<strong>Les</strong> bactérioses des voies<br />
<strong>respiratoire</strong>s supérieures<br />
Objectifs d’apprentissage<br />
■ Décrire l’épidémiologie des bactérioses suivantes, et notamment<br />
la virulence des agents pathogènes en cause, leurs<br />
réservoirs, leurs modes de transmission ainsi que les facteurs<br />
prédisposants de l’hôte réceptif: pharyngite streptococcique,<br />
scarlatine, diphtérie, diphtérie cutanée et otite moyenne.<br />
■ Relier, pour les mêmes <strong>maladies</strong>, les dommages<br />
physiopathologiques et les symptômes de l’infection<br />
au pouvoir pathogène des bactéries en cause.<br />
■ Relier ces infections aux épreuves de diagnostic, au type<br />
de thérapeutique et aux mesures de prévention utilisées<br />
pour contrer leur transmission.<br />
<strong>Les</strong> agents pathogènes aéroportés entrent d’abord en contact<br />
avec les muqueuses lorsqu’ils pénètrent dans le corps par les<br />
voies <strong>respiratoire</strong>s supérieures. C’est dans cette partie de<br />
l’organisme que de nombreuses <strong>maladies</strong> <strong>respiratoire</strong>s ou<br />
systémiques déclenchent une infection.<br />
La pharyngite streptococcique<br />
La pharyngite streptococcique, ou angine streptococcique,<br />
est une infection des voies <strong>respiratoire</strong>s supérieures<br />
<strong>du</strong>e à des streptocoques -hémolytiques <strong>du</strong> groupe A. Ces<br />
bactéries à Gram positif appartiennent toutes à l’espèce<br />
Streptococcus pyogenes, qui est également responsable de plusieurs<br />
infections de la peau et des tissus mous, telles que<br />
l’impétigo, l’érysipèle et l’endocardite bactérienne aiguë.<br />
La pathogénicité des streptocoques -hémolytiques <strong>du</strong><br />
groupe A vient en partie de leur résistance à la phagocytose.<br />
Par ailleurs, ces bactéries pro<strong>du</strong>isent des enzymes spécifiques:<br />
les streptokinases, qui lysent les caillots de fibrine, et les streptolysines,<br />
qui sont cytotoxiques pour les cellules des tissus, les<br />
érythrocytes et les leucocytes.<br />
Sans analyse de laboratoire, il est impossible de distinguer<br />
une pharyngite streptococcique d’une pharyngite <strong>du</strong>e à une<br />
autre bactérie ou à un virus. Il est probable que la moitié<br />
seulement des angines qualifiées de streptococciques sont<br />
véritablement causées par des streptocoques.Autrefois,le diagnostic<br />
d’une pharyngite streptococcique reposait sur<br />
la culture de bactéries provenant d’un prélèvement de gorge. Il<br />
fallait attendre au lendemain, ou même plus longtemps, pour<br />
obtenir les résultats, de sorte que le test a été remplacé presque<br />
partout par des tests reposant sur une réaction d’agglutination<br />
indirecte effectuée au moyen de particules de latex<br />
microscopiques, enrobées d’anticorps contre les streptocoques<br />
<strong>du</strong> groupe A. Plusieurs de ces tests peuvent être effectués<br />
en 10 minutes seulement,et ils permettent de vérifier de<br />
façon précise la présence ou l’absence de streptocoques <strong>du</strong><br />
groupe A. Cependant, on peut déceler la présence de S. pyogenes<br />
dans la gorge de nombreux porteurs asymptomatiques.<br />
Un résultat positif n’indique donc pas nécessairement que les<br />
symptômes sont <strong>du</strong>s aux streptocoques décelés. L’augmentation<br />
<strong>du</strong> titre des anticorps IgM est le meilleur indice qu’une<br />
angine est vraiment d’origine streptococcique, mais on ne<br />
mesure généralement pas ce paramètre parce qu’il faudrait<br />
trop de temps et que le procédé serait trop coûteux. Lorsque<br />
les résultats des tests sont négatifs, on devrait les vérifier au<br />
moyen d’une culture d’un prélèvement de gorge.<br />
La pharyngite streptococcique est caractérisée par une<br />
inflammation locale et une fièvre supérieure à 38 o C<br />
(figure 24.3). Notez que d’habitude cette pharyngite bactérienne<br />
n’entraîne pas de toux. Elle est souvent accompagnée<br />
d’une amygdalite – qui peut entraîner de la difficulté à avaler<br />
–, et les nœuds (ou ganglions) lymphatiques cervicaux<br />
gonflent et deviennent douloureux. Elle se complique fréquemment<br />
d’une infection de l’oreille moyenne, appelée<br />
otite moyenne. La pénicilline constitue toujours le médicament<br />
d’élection pour le traitement des infections à streptocoques<br />
<strong>du</strong> groupe A.<br />
Plus de 80 sérotypes de streptocoques <strong>du</strong> groupe A sont<br />
responsables d’une douzaine au moins de <strong>maladies</strong> différentes.<br />
Comme l’immunité aux <strong>maladies</strong> streptococciques est spécifique<br />
<strong>du</strong> sérotype <strong>du</strong> streptocoque,une personne s’étant remise<br />
d’une infection causée par un sérotype donné n’est pas immunisée<br />
contre une infection provoquée par un autre sérotype.
FIGURE 24.3 Pharyngite streptococcique.<br />
■ Quelles sont les complications possibles d’une<br />
pharyngite streptococcique ?<br />
<strong>Les</strong> enfants de 5 à 15 ans forment le groupe cible de la<br />
pharyngite streptococcique. Au cours des dernières années,<br />
l’augmentation de la fréquentation des garderies s’est accompagnée<br />
d’une hausse de la fréquence de l’infection chez les<br />
plus jeunes enfants. À l’heure actuelle, la pharyngite streptococcique<br />
se transmet principalement par contact direct<br />
avec les sécrétions <strong>respiratoire</strong>s d’une personne infectée ;<br />
le contact avec des porteurs asymptomatiques augmente les<br />
risques de contagion. Autrefois, elle donnait souvent lieu à<br />
des épidémies dont la source était le lait non pasteurisé.<br />
Comme pour toute infection <strong>respiratoire</strong>, le moyen le plus<br />
efficace de prévenir la pharyngite est de se laver souvent les<br />
mains après s’être mouché, avoir éternué ou toussé, et après<br />
avoir manipulé des mouchoirs ou des objets contaminés par<br />
des sécrétions.<br />
La scarlatine<br />
Si la souche de S. pyogenes responsable de la pharyngite<br />
streptococcique élabore une toxine érythrogène (provoquant<br />
des rougeurs), elle cause une infection appelée scarlatine.<br />
C’est ce qui se pro<strong>du</strong>it lorsque le streptocoque est infecté<br />
par un bactériophage au cours <strong>du</strong> processus de lysogénie<br />
(figure 13.12). Nous avons vu que l’information génétique<br />
<strong>du</strong> phage (virus) est alors intégrée dans le chromosome de la<br />
bactérie, et que les caractéristiques de cette dernière en sont<br />
modifiées.<br />
La toxine érythrogène altère la résistance <strong>du</strong> corps à<br />
l’infection en diminuant la phagocytose et la pro<strong>du</strong>ction<br />
d’anticorps. Elle provoque une forte fièvre et un érythème<br />
cutané rouge rosé, probablement dû à une réaction d’hypersensibilité<br />
de la peau à la toxine en circulation dans le sang<br />
(figure 24.4). La langue prend un aspect dit framboisé<br />
(papilles enflammées saillantes) et devient rouge écarlate et<br />
enflée lorsque la membrane superficielle se détache. Au fur<br />
et à mesure que la maladie évolue, on observe souvent une<br />
CHAPITRE 24 <strong>Les</strong> <strong>maladies</strong> <strong>infectieuses</strong> <strong>du</strong> <strong>système</strong> <strong>respiratoire</strong> 5<br />
FIGURE 24.4 Érythème cutané rouge rosé, caractéristique de la<br />
scarlatine. L’éruption s’étend à presque toute la surface <strong>du</strong> corps,<br />
à l’exception de la paume des mains et de la plante des pieds.<br />
■ Un phage lysogène, à l’intérieur de S. pyogenes,<br />
porte le gène de la toxine érythrogène qui cause<br />
la scarlatine.<br />
desquamation de la peau affectée, comme après un coup de<br />
soleil, ce qui évoque le syndrome de Ritter-Lyell causé par<br />
Staphylococcus aureus (figure 21.4).<br />
La gravité et la fréquence de la scarlatine semblent varier<br />
en fonction <strong>du</strong> temps et des endroits où la maladie se<br />
déclare, mais en général elles ont diminué au cours des dernières<br />
années. Il s’agit d’une maladie transmissible, qui se<br />
propage principalement par l’inhalation de gouttelettes<br />
<strong>infectieuses</strong> provenant d’une personne infectée. On pensait<br />
autrefois que la scarlatine était associée à la pharyngite streptococcique,<br />
mais on sait maintenant qu’elle peut aussi accompagner<br />
une infection cutanée streptococcique.<br />
La diphtérie<br />
La diphtérie est également une infection bactérienne des<br />
voies <strong>respiratoire</strong>s supérieures; elle fait partie des <strong>maladies</strong> à<br />
déclaration obligatoire. Jusqu’en 1935, c’était la maladie<br />
infectieuse responsable <strong>du</strong> plus grand nombre de décès chez<br />
les enfants de moins de 10 ans en Amérique <strong>du</strong> Nord. La<br />
diphtérie débute par des maux de gorge et de la fièvre, suivis<br />
le plus souvent d’un malaise général et d’un œdème <strong>du</strong> cou.<br />
Le microorganisme responsable est Corynebacterium diphteriæ,<br />
un bacille à Gram positif, non pro<strong>du</strong>cteur d’endospores, dont<br />
la morphologie pléomorphe évoque fréquemment une griffe<br />
et dont la coloration n’est pas uniforme (figure 24.5).<br />
Dans les pays in<strong>du</strong>strialisés, le vaccin DCT fait partie <strong>du</strong><br />
programme normal d’immunisation des très jeunes enfants;<br />
il est suivi d’une dose de rappel au cours de l’enfance. La lettre<br />
D désigne l’anatoxine diphtérique, une toxine inactivée qui<br />
déclenche la pro<strong>du</strong>ction d’anticorps contre la toxine diphtérique.Au<br />
Canada, très peu de cas de diphtérie ont été signalés<br />
depuis les années 1980, et aucune déclaration n’a été faite<br />
en 1998.
6 QUATRIÈME PARTIE <strong>Les</strong> microorganismes et les <strong>maladies</strong> humaines<br />
Cellules en<br />
forme de griffe<br />
Arrangement<br />
en palissade<br />
MO<br />
FIGURE 24.5 Corynebacterium diphteriæ, agent causal de la<br />
diphtérie. La coloration de Gram représentée ici met en évidence<br />
la morphologie en forme de griffe de la bactérie ; les cellules en<br />
train de se diviser se replient fréquemment les unes sur les autres<br />
de manière à former un V ou un Y. Notez aussi l’arrangement<br />
en palissade des cellules bactériennes juxtaposées.<br />
■ Un phage lysogène, à l’intérieur de C. diphteriæ,<br />
porte le gène de la toxine diphtérique.<br />
5 mm<br />
C. diphteriæ s’est adapté à une population en majorité<br />
immunisée ; on en trouve des souches relativement non<br />
virulentes dans la gorge de nombreux porteurs sains. La bactérie<br />
se prête bien à la transmission par voie aérienne parce<br />
qu’elle est très résistante à la sécheresse;elle se transmet aussi<br />
par contact direct entre les personnes.<br />
La diphtérie (d’un mot grec signifiant «cuir») est caractérisée<br />
par la formation d’une membrane grisâtre résistante<br />
dans la gorge, en réaction à l’infection de la muqueuse<br />
(figure 24.6). Cette membrane contient de la fibrine, des tissus<br />
morts ainsi que des bactéries et des phagocytes, et elle peut<br />
obstruer totalement le passage de l’air vers les poumons; elle<br />
est alors à même de provoquer une suffocation, appelée croup.<br />
La gravité de la diphtérie est associée à la présence d’un<br />
phage dans la bactérie infectante. Même si elles n’envahissent<br />
pas les tissus, les bactéries qui ont été infectées par un phage<br />
lysogène spécifique sont susceptibles de pro<strong>du</strong>ire une exotoxine<br />
puissante (la diphtérie est en fait la première maladie<br />
dont on ait attribué la cause à une toxine). Lorsqu’elle circule<br />
dans le sang, la toxine pénètre dans les cellules et inhibe<br />
la synthèse des protéines, entraînant rapidement la mort cellulaire<br />
(figure 15.4). Seulement 0,01 mg de cette toxine très<br />
virulente suffit pour tuer une personne de 90 kg. Donc,<br />
pour être efficace, l’administration d’antitoxine – immunisation<br />
passive avec des immunoglobulines spécifiques – doit se<br />
faire avant que la toxine pénètre dans les cellules des différents<br />
tissus. Le myocarde (tissu musculaire cardiaque), les reins<br />
et les nerfs en sont les principaux tissus cibles. Lorsqu’elle<br />
atteint les nerfs, la toxine peut provoquer une paralysie partielle.<br />
Lorsqu’elle touche le cœur et les reins, elle risque de<br />
FIGURE 24.6 Membrane caractéristique de la diphtérie. Chez<br />
les jeunes enfants, la présence de la membrane, dont l’aspect<br />
évoque le cuir, et l’inflammation de la muqueuse des voies<br />
<strong>respiratoire</strong>s supérieures risque de bloquer les con<strong>du</strong>its aériens<br />
et d’interrompre l’approvisionnement en air.<br />
■ Qu’est-ce que la diphtérie cutanée ?<br />
causer la mort rapidement, avant même que la réaction<br />
immunitaire ait pu organiser la défense de l’organisme.<br />
Le diagnostic de laboratoire par la détermination de<br />
l’agent bactérien présente des difficultés, car il exige l’utilisation<br />
de plusieurs milieux sélectifs et différentiels. La nécessité<br />
de distinguer les isolats pro<strong>du</strong>cteurs de toxine et les<br />
souches non toxinogènes complique encore l’identification,<br />
car on peut rencontrer les deux types chez un même patient.<br />
Bien que certains antibiotiques tels que la pénicilline et<br />
l’érythromycine inhibent la croissance de la bactérie, ils ne<br />
neutralisent pas la toxine diphtérique. Il faut donc les<br />
employer en association avec une antitoxine.<br />
La diphtérie est-elle une maladie en voie de disparition?<br />
Aux États-Unis, on dénombre au plus cinq cas de diphtérie<br />
par année, mais le taux de décès consécutifs à la forme <strong>respiratoire</strong><br />
se situe encore entre 5 et 10% des patients, la maladie<br />
étant surtout mortelle chez les personnes très âgées ou très<br />
jeunes. Chez les jeunes enfants, elle touche principalement<br />
ceux qui n’ont pas été vaccinés pour des raisons religieuses<br />
ou autres. Lorsque la diphtérie était plus courante, les nombreux<br />
contacts avec des souches toxinogènes renforçaient<br />
l’immunité, qui s’affaiblit avec le temps. À l’heure actuelle,<br />
de nombreux a<strong>du</strong>ltes ne sont pas immunisés parce que tous<br />
n’ont pas eu accès à la vaccination systématique lorsqu’ils<br />
étaient enfants. Des enquêtes ont montré que, en Amérique<br />
<strong>du</strong> Nord, 20% seulement de la population a<strong>du</strong>lte possède<br />
une immunité efficace. La situation en Russie illustre bien<br />
ce qui pourrait se passer si on abandonnait les programmes<br />
de vaccination systématique; récemment en effet, la baisse<br />
de l’immunité des populations de presque tous les pays de<br />
l’ex-URSS a déclenché une épidémie.<br />
C. diphteriæ peut aussi provoquer une diphtérie cutanée.<br />
Dans ce cas, la bactérie infecte la peau, le plus souvent
dans une blessure ou une lésion, et la circulation de la toxine<br />
dans l’organisme est minimale. Dans les infections cutanées,<br />
la bactérie cause des ulcères recouverts d’une membrane<br />
grisâtre et lents à guérir.<br />
La diphtérie cutanée est fréquente dans les pays tropicaux.Aux<br />
États-Unis, elle touche surtout les autochtones et<br />
les a<strong>du</strong>ltes des classes socioéconomiques défavorisées. Cette<br />
forme de la maladie constitue la majorité des cas de diphtérie<br />
déclarés chez les a<strong>du</strong>ltes de plus de 30 ans.<br />
Autrefois, la diphtérie se transmettait surtout à des porteurs<br />
sains par l’intermédiaire de gouttelettes. On a observé<br />
des cas de la forme <strong>respiratoire</strong> provoqués par contact avec<br />
une personne atteinte de diphtérie cutanée.<br />
L’otite moyenne<br />
L’infection de l’oreille moyenne, appelée otite moyenne<br />
ou «mal à l’oreille» par les enfants, est l’une des complications<br />
les plus gênantes <strong>du</strong> rhume ou de toute autre infection<br />
<strong>du</strong> nez ou de la gorge (telle que l’amygdalite). <strong>Les</strong> agents<br />
pathogènes provoquent la formation de pus dont la présence<br />
accroît la pression sur la membrane <strong>du</strong> tympan, qui<br />
s’enflamme et devient douloureuse (figure 24.7). Cette affection<br />
est particulièrement fréquente chez les jeunes enfants,<br />
probablement parce que, étant plus petite, la trompe auditive<br />
– qui relie l’oreille moyenne à la gorge – s’obstrue plus facilement<br />
(figure 24.1). La pénétration de microorganismes<br />
peut aussi se faire directement par le biais d’une petite lésion<br />
<strong>du</strong> tympan; les baignades en piscine où la tête est plongée<br />
sous l’eau sont parfois mises en cause dans la transmission de<br />
la maladie.<br />
Diverses bactéries sont susceptibles d’occasionner une<br />
otite moyenne. L’agent pathogène le plus souvent isolé est<br />
S. pneumoniæ (dans environ 35% des cas); cette bactérie est<br />
communément présente chez des porteurs sains. Parmi les<br />
Bombement<br />
de la membrane<br />
<strong>du</strong> tympan<br />
FIGURE 24.7 Otite moyenne aiguë accompagnée d’un bombement<br />
de la membrane <strong>du</strong> tympan.<br />
■ S. pneumoniæ est la cause la plus fréquente des<br />
infections de l’oreille moyenne.<br />
CHAPITRE 24 <strong>Les</strong> <strong>maladies</strong> <strong>infectieuses</strong> <strong>du</strong> <strong>système</strong> <strong>respiratoire</strong> 7<br />
autres bactéries souvent responsables, on note les souches<br />
non encapsulées de H. influenzæ (de 20 à 30%), Moraxella<br />
catarrhalis (de 10 à 15%), S. pyogenes (de 8 à 10%) et S. aureus<br />
(de 1 à 2%).Dans 3 à 5% des cas environ,on ne décèle aucune<br />
bactérie. Il peut alors s’agir d’infections virales, et les isolats<br />
les plus courants sont des virus <strong>respiratoire</strong>s syncytiaux (p. 19).<br />
L’otite moyenne touche 85% des enfants de moins de<br />
3 ans, et elle est la cause de près de la moitié des consultations<br />
en pédiatrie.Bien qu’elle puisse être d’origine virale,on<br />
suppose toujours, pour prescrire un traitement, que l’otite<br />
moyenne est <strong>du</strong>e à une bactérie. <strong>Les</strong> pénicillines à large<br />
spectre telles que l’amoxicilline sont les médicaments d’élection<br />
pour les enfants. De nos jours, beaucoup de médecins<br />
remettent en question l’utilisation d’antibiotiques, car ils ne<br />
sont pas certains qu’elle permette de ré<strong>du</strong>ire la <strong>du</strong>rée de la<br />
maladie. <strong>Les</strong> chercheurs sont en train d’élaborer des vaccins<br />
contre les trois bactéries pathogènes les plus communes. Un<br />
vaccin conjugé contre S. pneumoniæ (p. XXX) ne semble pas<br />
avoir beaucoup d’effet sur l’incidence de l’otite moyenne.<br />
<strong>Les</strong> viroses des voies <strong>respiratoire</strong>s<br />
supérieures<br />
Objectifs d’apprentissage<br />
■ Décrire l’épidémiologie <strong>du</strong> rhume et notamment la<br />
virulence des agents pathogènes en cause, leurs réservoirs,<br />
leurs modes de transmission, et les facteurs prédisposants<br />
de l’hôte réceptif.<br />
■ Décrire, pour la même maladie, les symptômes de<br />
l’infection et les particularités de la réponse immunitaire,<br />
ainsi que les moyens de prévention.<br />
La maladie probablement la plus fréquente chez les humains,<br />
<strong>du</strong> moins dans les zones tempérées, est une infection virale,<br />
ou virose, des voies <strong>respiratoire</strong>s supérieures: le rhume.<br />
Le rhume<br />
Un certain nombre de virus jouent un rôle dans la cause <strong>du</strong><br />
rhume. Environ 50% des cas sont <strong>du</strong>s à des Rhinovirus;<br />
les Coronavirus sont sans doute responsables de 15 à 20% des<br />
cas; divers autres virus sont responsables d’environ 10 %<br />
des cas; enfin, dans 40% des cas, on ne peut déterminer<br />
aucun agent infectieux.<br />
Au cours de leur vie, les humains ont tendance à accumuler<br />
différentes immunités contre les virus <strong>du</strong> rhume, ce<br />
qui expliquerait qu’en vieillissant ils aient en général moins<br />
souvent le rhume; les jeunes enfants ont 3 ou 4 rhumes par<br />
année, tandis que les a<strong>du</strong>ltes de 60 ans ont en moyenne<br />
moins de 1 rhume par année. L’immunité repose sur le rapport<br />
d’anticorps IgA et de sérotypes donnés, et elle n’est<br />
réellement efficace que pendant un court laps de temps.<br />
Certaines populations isolées acquièrent une immunité collective,<br />
de sorte qu’elles n’attrapent plus le rhume jusqu’à ce
8 QUATRIÈME PARTIE <strong>Les</strong> microorganismes et les <strong>maladies</strong> humaines<br />
que de nouveaux virus soient intro<strong>du</strong>its dans la communauté.<br />
On estime que plus de 200 agents pathogènes sont<br />
susceptibles de provoquer un rhume. De ce nombre, au<br />
moins 113 sont des sérotypes de Rhinovirus, si bien qu’il<br />
semble impossible d’élaborer un vaccin efficace contre<br />
autant d’agents pathogènes.<br />
Chacun connaît bien les symptômes <strong>du</strong> rhume, qui<br />
comprennent des éternuements, des sécrétions nasales abondantes<br />
et de la congestion. (Selon une école de médecine de<br />
l’Antiquité, l’écoulement nasal était constitué de déchets<br />
provenant <strong>du</strong> cerveau, d’où l’expression «avoir un rhume<br />
de cerveau ».) L’infection s’étend facilement de la gorge<br />
aux sinus, aux voies <strong>respiratoire</strong>s inférieures et à l’oreille<br />
moyenne, et peut donc s’accompagner de complications telles<br />
qu’une laryngite ou une otite moyenne. En l’absence de<br />
complication, le rhume ne cause généralement pas de fièvre.<br />
La température optimale de réplication des Rhinovirus est<br />
légèrement inférieure à la température corporelle normale,et<br />
correspond approximativement à la température dans les voies<br />
<strong>respiratoire</strong>s supérieures, qui sont ouvertes sur l’air ambiant.<br />
On ne sait pas pourquoi le nombre de cas de rhume est beaucoup<br />
plus élevé <strong>du</strong>rant la saison froide dans les zones tempérées.<br />
Il reste à démontrer si les contacts résultant de la vie à<br />
l’intérieur favorisent une transmission de type épidémique,<br />
ou si la sécheresse de l’air est en cause,ou encore si des changements<br />
physiologiques rendent les indivi<strong>du</strong>s plus sensibles.<br />
Un seul Rhinovirus déposé sur la muqueuse nasale suffit<br />
souvent à provoquer un rhume. Cependant, il n’y a pas<br />
consensus sur le mode de transmission <strong>du</strong> virus <strong>du</strong> rhume<br />
qui pénètre dans le nez. Selon une approche expérimentale,<br />
les personnes enrhumées déposeraient des virus sur les poignées<br />
de porte, les téléphones et d’autres surfaces, où les<br />
virus persistent pendant des heures. Des personnes saines<br />
LES MALADIES INFECTIEUSES<br />
DES VOIES RESPIRATOIRES INFÉRIEURES<br />
Beaucoup des bactéries et virus pathogènes qui infectent<br />
les voies <strong>respiratoire</strong>s supérieures peuvent aussi infecter les<br />
voies <strong>respiratoire</strong>s inférieures. Si les bronches sont atteintes, il<br />
se pro<strong>du</strong>it une bronchite ou une bronchiolite (figure 24.2).<br />
La pneumonie est une complication grave de la bronchite,<br />
qui touche les alvéoles pulmonaires.<br />
<strong>Les</strong> bactérioses des voies<br />
<strong>respiratoire</strong>s inférieures<br />
Objectifs d’apprentissage<br />
■ Décrire l’épidémiologie de la coqueluche et de la tuberculose,<br />
et notamment la virulence des agents pathogènes en cause,<br />
leurs réservoirs, leurs modes de transmission, ainsi que<br />
les facteurs prédisposants de l’hôte réceptif.<br />
feraient ainsi passer ces virus de leurs mains à leurs voies<br />
nasales. Cette théorie a été étayée par une expérience dans<br />
laquelle on a observé que, chez des personnes saines qui<br />
s’en<strong>du</strong>isent les mains d’une solution virocide d’iode, l’incidence<br />
<strong>du</strong> rhume est beaucoup plus faible que la normale.<br />
On a effectué une série d’expériences avec un groupe de<br />
joueurs de cartes, dont la moitié avait le rhume tandis que<br />
l’autre moitié ne l’avait pas, et on a abouti à une conclusion<br />
différente. Des contraintes imposées à la moitié des joueurs<br />
sains ne leur permettaient pas de transférer à leur nez les virus<br />
qui seraient passés des cartes à leurs mains;ces contraintes ne<br />
s’appliquaient pas à l’autre moitié des joueurs sains. On n’a<br />
observé aucune différence quant à la fréquence <strong>du</strong> rhume<br />
chez les deux sous-groupes de joueurs sains – ce qui viendrait<br />
étayer l’hypothèse de la transmission par voie aérienne. Par<br />
ailleurs, on a placé des sujets sains dans une pièce où aucune<br />
des personnes présentes ne souffrait <strong>du</strong> rhume,et on a pris des<br />
précautions pour qu’ils n’entrent pas en contact avec des aérosols<br />
de sécrétions, mais on les a fait jouer avec des cartes qui<br />
étaient littéralement imbibées de sécrétions nasales; aucun<br />
participant n’a contracté le rhume. Au cours d’une autre série<br />
d’expériences, peut-être moins désagréables, les chercheurs<br />
ont demandé à des volontaires sains d’embrasser des personnes<br />
souffrant <strong>du</strong> rhume pendant 60 à 90 secondes; seulement 8%<br />
des volontaires ont contracté l’infection. <strong>Les</strong> autres personnes<br />
étaient-elles immunisées ou protégées grâce à une résistance<br />
particulière? On ne connaît toujours pas la réponse.<br />
Comme le rhume est causé par des virus, l’antibiothérapie<br />
est inutile. L’évolution d’un rhume mène généralement<br />
à la guérison en une semaine. <strong>Les</strong> médicaments ven<strong>du</strong>s sans<br />
ordonnance, actuellement offerts sur le marché, n’ont aucun<br />
effet sur le temps de récupération, mais ils peuvent alléger<br />
certains signes et symptômes.<br />
■ Relier, pour les mêmes <strong>maladies</strong>, les dommages physiopathologiques<br />
et les symptômes de l’infection au pouvoir<br />
pathogène des bactéries en cause.<br />
■ Relier ces infections aux épreuves de diagnostic, au type de<br />
thérapeutique et aux mesures de prévention utilisées pour<br />
contrer leur transmission.<br />
<strong>Les</strong> bactérioses des voies <strong>respiratoire</strong>s inférieures comprennent<br />
la coqueluche, la tuberculose et plusieurs types de pneumonies<br />
bactériennes, ainsi que des <strong>maladies</strong> moins connues<br />
telles que la psittacose et la fièvre Q.<br />
La coqueluche<br />
L’infection par la bactérie Bordetella pertussis provoque la<br />
coqueluche. B. pertussis est un petit coccobacille à Gram<br />
négatif, aérobie obligatoire, dont les souches virulentes sont
dotées d’une capsule. La bactérie se fixe à des cellules ciliées<br />
spécifiques de la trachée, ce qui entrave d’abord leur action,<br />
puis les détruit gra<strong>du</strong>ellement (figure 24.8).L’activité de l’escalier<br />
mucociliaire (figure 16.4) est ainsi inhibée, et le mucus<br />
n’est plus expulsé. B. pertussis pro<strong>du</strong>it plusieurs toxines. La<br />
cytotoxine trachéale (une endotoxine), qui est une fraction fixe<br />
de la paroi cellulaire de la bactérie, est responsable des dommages<br />
causés aux cellules ciliées, tandis que la toxine coquelucheuse,<br />
qui pénètre dans la circulation sanguine, est associée<br />
aux symptômes systémiques de la maladie.<br />
La coqueluche est avant tout une maladie d’enfance et<br />
peut être très grave; elle se manifeste tout au long de l’année<br />
et dans tous les pays <strong>du</strong> monde. Elle se transmet par contact<br />
direct ou par inhalation des sécrétions (écoulements et gouttelettes)<br />
provenant <strong>du</strong> nez ou de la gorge d’une personne<br />
infectée. Le premier stade, appelé stade catarrhal, ressemble à<br />
un rhume avec apparition d’une fièvre et d’un écoulement<br />
nasal. De longues quintes de toux caractérisent le deuxième<br />
stade, appelé stade paroxystique. (Le nom pertussis est formé<br />
des éléments latins per- en abondance et tussis = toux.)<br />
Lorsque l’activité mucociliaire est perturbée, le mucus<br />
s’accumule et la personne infectée fait des efforts désespérés<br />
pour le rejeter en toussant. Chez les jeunes enfants, la violence<br />
de la toux peut entraîner une fracture des côtes. L’inspiration<br />
prolongée entre les quintes de toux pro<strong>du</strong>it un<br />
sifflement aigu évoquant le chant <strong>du</strong> coq, d’où le nom de la<br />
maladie. On observe des accès de toux convulsive plusieurs<br />
fois par jour, pendant 1 à 6 semaines; ces quintes de toux<br />
épuisantes sont souvent suivies de vomissements. Le troisième<br />
stade, appelé phase de convalescence, peut <strong>du</strong>rer des mois.<br />
Comme les nourrissons ont plus de difficulté à tousser de<br />
MEB<br />
2 mm<br />
FIGURE 24.8 Cellules ciliées des voies <strong>respiratoire</strong>s infectées<br />
par Bordetella pertussis. La photo représente des cellules<br />
de B. pertussis en croissance sur les cellules ciliées ; elles finiront<br />
par entraîner la destruction de ces cellules.<br />
■ B. pertussis est l’agent causal de la coqueluche.<br />
CHAPITRE 24 <strong>Les</strong> <strong>maladies</strong> <strong>infectieuses</strong> <strong>du</strong> <strong>système</strong> <strong>respiratoire</strong> 9<br />
manière à conserver une voie aérienne adéquate, la coqueluche<br />
provoque parfois chez eux des épisodes d’apnée et de<br />
cyanose entraînant des altérations cérébrales irréversibles, et<br />
le taux de mortalité est relativement élevé dans cette classe<br />
d’âge. Chez les a<strong>du</strong>ltes, la maladie s’exprime d’habitude par<br />
une simple toux persistante et on la confond fréquemment<br />
avec une bronchite.<br />
Le diagnostic de la coqueluche repose principalement<br />
sur les signes et symptômes cliniques. On peut faire croître<br />
l’agent pathogène à partir d’un prélèvement de gorge,<br />
obtenu en insérant par le nez un écouvillon que l’on maintient<br />
dans la gorge <strong>du</strong> patient pendant qu’il tousse. On peut<br />
aussi avoir recours à une culture sur un milieu spécifique,<br />
mais les tests sérologiques et l’amplification en chaîne par<br />
polymérase (ACP) effectués directement sur le prélèvement<br />
de gorge sont plus rapides. On traite les cas graves de coqueluche<br />
avec l’érythromycine. Bien qu’ils ne procurent pas<br />
nécessairement une amélioration rapide de l’état <strong>du</strong> patient,<br />
les antibiotiques rendent ce dernier non infectieux au bout<br />
de 5 jours de traitement. En l’absence d’antibiothérapie, la<br />
période de contagion s’étend jusqu’à 3 semaines à partir de<br />
la phase catharrale.<br />
Après la guérison, le patient possède une bonne immunité;<strong>du</strong><br />
moins, une deuxième infection ne provoque que de<br />
légers symptômes. Depuis son avènement en 1943, la vaccination<br />
a entraîné une ré<strong>du</strong>ction de la fréquence de la<br />
maladie de près de 90% au Canada. Aux États-Unis, on ne<br />
dénombre généralement pas plus de 10 décès <strong>du</strong>s à cette<br />
maladie par an. L’efficacité de la vaccination des enfants tend<br />
à diminuer au bout d’une douzaine d’années, si bien que de<br />
nombreux enfants vaccinés deviennent à nouveau réceptifs<br />
à la coqueluche à l’adolescence ou à l’âge a<strong>du</strong>lte.<br />
On a remis en question la sécurité <strong>du</strong> vaccin anticoquelucheux,<br />
qui contient des bactéries tuées par la chaleur. Étant<br />
donné qu’il renferme une plus grande quantité d’endotoxines<br />
que tout autre vaccin, il provoque souvent de la fièvre et on<br />
pense même qu’il pourrait être la cause de troubles neurologiques.<br />
Au Japon, en Suède et en Angleterre, la mauvaise<br />
presse dont le vaccin a fait l’objet a entraîné un refus massif<br />
de la vaccination active, qui a eu comme conséquence une<br />
augmentation <strong>du</strong> nombre de cas de coqueluche. De nouveaux<br />
vaccins acellulaires, contenant des fragments de cellules<br />
mortes de B. pertussis et ayant peu d’effets secondaires, sont<br />
en train de remplacer l’ancien vaccin. Au Canada, un<br />
nouveau vaccin acellulaire combiné contre la coqueluche, la<br />
diphtérie et le tétanos (ADACEL MC ) a été homologué. Ce<br />
vaccin a été approuvé pour être administré aux adolescents<br />
et aux a<strong>du</strong>ltes comme dose de rappel.<br />
La tuberculose<br />
La tuberculose (TB) est une maladie infectieuse causée par<br />
Mycobacterium tuberculosis,un mince bacille aérobie obligatoire.<br />
Cette bactérie – aussi appelée bacille de Koch, <strong>du</strong> nom <strong>du</strong><br />
médecin qui l’a découverte – se développe lentement (son<br />
temps de génération est de 20 heures ou plus);elle forme parfois<br />
des filaments et a tendance à croître en amas (figure 24.9).
10 QUATRIÈME PARTIE <strong>Les</strong> microorganismes et les <strong>maladies</strong> humaines<br />
Arrangement<br />
funiforme<br />
5 mm<br />
FIGURE 24.9 Mycobacterium tuberculosis. L’agent pathogène<br />
doit son nom au fait qu’en se développant il pro<strong>du</strong>it des filaments<br />
évoquant un mycète ; ces filaments prennent une couleur rouge<br />
à la coloration, dans le frottis de tissu pulmonaire illustré ici. Dans<br />
d’autres conditions, la bactérie pro<strong>du</strong>it en se développant de minces<br />
bacilles isolés. Une composante cireuse de la cellule est responsable<br />
de l’arrangement funiforme, et si on injecte cette composante, elle<br />
cause des effets pathogènes identiques à ceux <strong>du</strong> bacille tuberculeux.<br />
Sur la surface d’un milieu de culture liquide, sa croissance<br />
évoque la formation de moisissures, d’où le nom de genre<br />
Mycobacterium (myco- = mycète).<br />
M. tuberculosis est relativement résistant aux méthodes<br />
simples de coloration. <strong>Les</strong> cellules imprégnées d’un colorant<br />
rouge, la fuchsine basique, ne sont pas décolorées par un<br />
mélange d’acide et d’alcool et elles sont dites acido-alcoolorésistantes<br />
(chapitre 3, p. 77). Cette caractéristique reflète la<br />
composition inhabituelle de la paroi cellulaire des mycobactéries,<br />
riche en lipides. Ces lipides sont peut-être également<br />
responsables de la résistance des mycobactéries aux contraintes<br />
<strong>du</strong> milieu, telles que la sécheresse. En fait, les mycobactéries<br />
peuvent survivre pendant des semaines dans des crachats<br />
séchés et elles sont très résistantes aux substances antimicrobiennes<br />
utilisées comme antiseptiques ou désinfectants.<br />
La tuberculose illustre bien l’équilibre écologique qui<br />
s’établit entre un parasite et son hôte au cours d’une maladie<br />
infectieuse. L’hôte ne se rend pas nécessairement compte<br />
que des agents pathogènes envahissent son organisme et que<br />
ce dernier les combat. Cependant, si le <strong>système</strong> immunitaire<br />
n’arrive pas à détruire les microorganismes, l’hôte devient parfaitement<br />
conscient de la maladie qui en résulte. Plusieurs<br />
facteurs prédisposants influent sur la résistance de l’hôte, soit<br />
la présence d’une autre maladie – par exemple un diabète<br />
non contrôlé – et des facteurs physiologiques ou environnementaux<br />
– tels que la malnutrition, l’immunodéficience, la<br />
surpopulation et le stress. Le fait que la résistance varie d’un<br />
indivi<strong>du</strong> à un autre a été illustré de façon spectaculaire en<br />
1926 à Lübeck, en Allemagne. On avait inoculé par erreur<br />
MO<br />
■ On identifie M. tuberculosis à l’aide d’un colorant<br />
acido-alcoolo-résistant.<br />
des bactéries de la tuberculose, virulentes, à 249 bébés au<br />
lieu <strong>du</strong> vaccin contenant une souche atténuée. Bien que tous<br />
les nourrissons eussent reçu le même inoculum, seulement 76<br />
en moururent, et les autres ne furent pas gravement malades.<br />
La tuberculose se transmet principalement par inhalation<br />
d’aérosols contenant l’agent pathogène. Seules de très fines<br />
particules contenant de 1 à 3 bacilles parviennent jusqu’aux<br />
poumons, où un macrophagocyte situé dans les alvéoles les<br />
capture le plus souvent. Chez un indivi<strong>du</strong> sain les macrophagocytes<br />
sont activés par la présence des bacilles, et ils réussissent<br />
habituellement à détruire ces derniers de telle sorte<br />
qu’ils combattent avec succès une infection potentielle, surtout<br />
si la quantité de bactéries est faible. L’homéostasie est<br />
aussi maintenue.<br />
La pathogénie de la tuberculose<br />
La figure 24.10 décrit la pathogénie de la tuberculose. Elle<br />
représente le cas où les mécanismes de défense de l’organisme<br />
ne réussissent pas à détruire les bacilles, de sorte que<br />
la maladie évolue vers la mort.<br />
1 2 Si l’infection progresse,les macrophagocytes alvéolaires<br />
ne parviennent pas à détruire les bacilles qu’ils ont<br />
ingérés; la bactérie empêcherait la formation <strong>du</strong> phagolysosome.<br />
Notez que M. tuberculosis ne pro<strong>du</strong>it ni enzyme ni<br />
toxine susceptible de causer des lésions tissulaires. Il semble<br />
que la virulence de cet agent pathogène soit liée à la composition<br />
de sa paroi cellulaire, riche en lipides. Ces lipides exerceraient<br />
un effet chimiotactique sur les macrophagocytes et<br />
sur d’autres cellules immunitaires à médiation cellulaire.Toutes<br />
ces cellules de défense s’accumulent et se regroupent en formation<br />
arrondie, isolant les bactéries pathogènes vivantes dans<br />
un granulome appelé tubercule – d’où le nom de la maladie.<br />
3 Si on arrive à arrêter l’infection à ce stade, les granulomes<br />
guérissent lentement et ils se calcifient ; ils sont alors visibles<br />
sur une radiographie. 4 5 Si les mécanismes de défense ne<br />
réussissent pas à vaincre l’agent pathogène à ce stade, le processus<br />
infectieux se poursuit;les tubercules matures – qui renferment<br />
maintenant plusieurs bactéries – se rompent et<br />
libèrent dans les voies aériennes des poumons des bacilles<br />
virulents, qui se répandent ensuite dans les <strong>système</strong>s cardiovasculaire<br />
et lymphatique.<br />
Après la dissémination, l’infection est appelée tuberculose<br />
miliaire (parce que les nombreux tubercules qui se forment<br />
dans les tissus infectés ont la taille d’un grain de millet). Le<br />
<strong>système</strong> immunitaire, affaibli, est vaincu et le patient souffre<br />
d’une perte de poids, de toux (les expectorations contiennent<br />
souvent <strong>du</strong> sang) et d’atonie générale.Autrefois, la tuberculose<br />
était communément appelée consomption.<br />
FIGURE 24.10 La pathogénie de la tuberculose. La figure représente<br />
l’évolution de la maladie lorsque les défenses de l’organisme<br />
n’arrivent pas à lutter victorieusement contre le bacille. Chez la<br />
majorité des indivi<strong>du</strong>s sains, l’infection disparaît avant d’évoluer<br />
vers une maladie mortelle.<br />
■ M. tuberculosis résiste à la digestion<br />
par les macrophagocytes.
Capillaire<br />
Parois<br />
de l’alvéole<br />
Bacille<br />
tuberculeux<br />
phagocyté<br />
Macrophagocyte<br />
alvéolaire<br />
Bronchiole<br />
Macrophagocyte<br />
infiltrant<br />
(non activé)<br />
Tubercule initial<br />
Bacilles<br />
tuberculeux<br />
Lésion caséeuse<br />
Macrophagocytes<br />
activés<br />
Lymphocyte<br />
Couche externe<br />
d’un tubercule<br />
mature<br />
Caverne<br />
tuberculeuse<br />
Bacilles<br />
tuberculeux<br />
Rupture de<br />
la paroi de<br />
la bronchiole<br />
Intérieur de<br />
l’alvéole<br />
CHAPITRE 24 <strong>Les</strong> <strong>maladies</strong> <strong>infectieuses</strong> <strong>du</strong> <strong>système</strong> <strong>respiratoire</strong> 11<br />
Intérieur de l’alvéole<br />
1 <strong>Les</strong> bacilles tuberculeux qui<br />
atteignent les alvéoles pulmonaires<br />
sont ingérés par des macrophagocytes,<br />
mais en général plusieurs survivent<br />
et deviennent des parasites<br />
intracellulaires.<br />
2<br />
<strong>Les</strong> bacilles tuberculeux qui se multiplient<br />
dans les macrophagocytes déclenchent une<br />
réaction chimiotactique, ce qui attire encore<br />
des macrophagocytes et d’autres cellules<br />
défensives dans la zone infectée. <strong>Les</strong> cellules<br />
de défense forment une couche enveloppante,<br />
puis un premier tubercule (ou granulome).<br />
La majorité des macrophagocytes enveloppants<br />
ne réussissent pas à détruire les bactéries,<br />
mais ils libèrent des enzymes et des cytokines<br />
qui provoquent une inflammation locale<br />
dommageable pour les poumons.<br />
3 Au bout de quelques semaines, beaucoup<br />
de macrophagocytes meurent, ce qui entraîne<br />
la formation d’une zone de nécrose (caséum)<br />
appelée lésion caséeuse au centre <strong>du</strong> tubercule.<br />
(Le terme caséum signifie « semblable à<br />
<strong>du</strong> fromage mou et friable».) <strong>Les</strong> macrophagocytes<br />
morts libèrent alors les bacilles tuberculeux.<br />
Étant donné qu’ils sont aérobies, les<br />
bacilles tuberculeux ne se développent pas<br />
bien à cet endroit. Cependant, plusieurs restent<br />
à l’état de dormance et servent de base lors<br />
d’une réactivation de la maladie. Parfois, la<br />
maladie prend fin à ce stade, et les lésions<br />
se calcifient.<br />
4 Chez certains indivi<strong>du</strong>s, il se forme un tubercule<br />
mature. La maladie évolue lorsque la lésion<br />
caséeuse s’agrandit, par un processus appelé<br />
liquéfaction. La lésion caséeuse se transforme<br />
alors en caverne tuberculeuse, remplie<br />
d’air, où les bacilles aérobies se multiplient,<br />
à l’extérieur des macrophagocytes.<br />
5 La liquéfaction se poursuit jusqu’à ce que<br />
le tubercule se rompe, ce qui permet aux<br />
bacilles de se disperser dans une bronchiole<br />
(figure 24.2) et de se répandre ainsi dans<br />
toutes les parties des poumons, puis dans<br />
les <strong>système</strong>s sanguin et lymphatique.
12 QUATRIÈME PARTIE <strong>Les</strong> microorganismes et les <strong>maladies</strong> humaines<br />
Le diagnostic et le traitement de la tuberculose<br />
Le premier antibiotique efficace pour traiter la tuberculose a<br />
été la streptomycine. À l’heure actuelle, on administre au<br />
patient plusieurs médicaments tels que l’isoniazide, la rifampicine<br />
et la pyrazinamide. S’il se pro<strong>du</strong>it une résistance aux<br />
médicaments ou tout autre problème, on peut administrer<br />
en outre des agents antimycobactériens, tels que l’éthambutol<br />
ou la streptomycine. La chimiothérapie n’est efficace que si<br />
elle <strong>du</strong>re plusieurs mois. Un traitement prolongé est indispensable,<br />
notamment parce que les bacilles tuberculeux se<br />
développent très lentement et que beaucoup d’antibiotiques<br />
ne peuvent agir que contre les bactéries en croissance. De<br />
plus, les bacilles peuvent rester longtemps à l’abri à l’intérieur<br />
de macrophagocytes ou dans un autre endroit où les<br />
antibiotiques ont de la difficulté à les atteindre.<br />
Le traitement de la tuberculose se heurte à un problème<br />
pratique majeur, soit le manque de coopération <strong>du</strong> patient<br />
qui doit prendre des médicaments sur une longue période.<br />
Ce comportement a largement contribué à l’apparition de<br />
souches pharmacorésistantes <strong>du</strong> bacille tuberculeux (voir<br />
l’encadré <strong>du</strong> chapitre 15, p. XXX).<br />
<strong>Les</strong> personnes infectées par le bacille de Koch présentent<br />
une réaction d’immunité à médiation cellulaire contre ce<br />
bacille. C’est ce type de l’immunité qui entre en jeu plutôt<br />
que l’immunité humorale parce que l’agent pathogène est<br />
localisé principalement dans les macrophagocytes. L’immunité<br />
à médiation cellulaire repose sur l’action des lymphocytes<br />
T sensibilisés et elle est à la base <strong>du</strong> test cutané (ou cutiréaction)<br />
à la tuberculine (figure 24.11). Ce dernier<br />
consiste à intro<strong>du</strong>ire dans l’organisme, par scarification,<br />
l’antigène – soit une fraction protéique purifiée <strong>du</strong> bacille<br />
tuberculeux, préparée par précipitation d’un bouillon de<br />
culture. Si le receveur a déjà été infecté par la mycobactérie,<br />
les lymphocytes T sensibilisés réagissent aux protéines, et<br />
l’on observe une réaction d’hypersensibilité retardée environ<br />
48 heures plus tard. Cette réaction se tra<strong>du</strong>it par l’in<strong>du</strong>ration<br />
(<strong>du</strong>rcissement) et le rougissement de la zone entourant<br />
le point d’injection. Le test à la tuberculine le plus précis est<br />
FIGURE 24.11 Test cutané (cutiréaction) à la tuberculine sur<br />
un bras.<br />
■ Qu’indique un test cutané à la tuberculine positif ?<br />
probablement l’épreuve de Mantoux, qui consiste à injecter<br />
dans le derme une solution de 0,1 mL d’antigène,puis à mesurer<br />
le diamètre de la peau qui présente ces manifestations.<br />
Un test à la tuberculine positif chez un très jeune enfant<br />
indique qu’il s’agit probablement d’un cas de tuberculose<br />
actif. Chez un indivi<strong>du</strong> plus âgé, il peut indiquer simplement<br />
une hypersensibilité résultant d’une infection antérieure<br />
guérie ou d’une vaccination. Il est néanmoins recommandé<br />
d’effectuer des examens plus poussés tels qu’une radiographie<br />
pulmonaire pour déceler une lésion et des essais pour isoler<br />
la bactérie.<br />
La première étape <strong>du</strong> diagnostic de laboratoire consiste à<br />
examiner au microscope des frottis, notamment de crachats.<br />
On peut utiliser une coloration acido-alcoolo-résistante ou<br />
une technique microscopique d’immunofluorescence, plus<br />
précise. Il est difficile de confirmer un diagnostic de tuberculose<br />
en isolant la bactérie, car la croissance de celle-ci est<br />
très lente. La formation d’une colonie peut prendre de 3 à<br />
6 semaines, et il faut attendre encore 3 à 6 semaines pour<br />
obtenir des résultats fiables des épreuves de détermination.<br />
On a cependant fait d’énormes progrès dans l’élaboration de<br />
tests diagnostiques rapides. On dispose maintenant de sondes<br />
d’ADN pour identifier des isolats cultivés (figure 10.15), et<br />
de tests fondés sur l’amplification en chaîne par polymérase,<br />
qui permettent de déceler directement M. tuberculosis dans<br />
les crachats ou dans un autre type de spécimen (p. XXX).<br />
Plusieurs de ces nouvelles épreuves exigent que l’on ait<br />
recours aux services de grands laboratoires spécialisés.<br />
L’espèce Mycobacterium bovis, qui est aussi un agent<br />
pathogène, touche surtout les bovins. Elle cause la tuberculose<br />
bovine, qui se transmet aux humains par l’intermédiaire<br />
de lait ou d’aliments contaminés. Cette forme bovine<br />
est rarement transmise d’une personne à une autre mais,<br />
avant la pasteurisation <strong>du</strong> lait et l’élaboration de méthodes<br />
de contrôle, telles que les tests à la tuberculine effectués sur<br />
les troupeaux de bovins,elle était fréquente chez les humains.<br />
<strong>Les</strong> infections à M. bovis sont responsables d’une tuberculose<br />
qui atteint surtout les os et le <strong>système</strong> lymphatique.Autrefois,<br />
cette maladie se manifestait souvent par une déformation de<br />
la colonne vertébrale (bosse dorsale) appelée gibbosité.<br />
D’autres <strong>maladies</strong> mycobactériennes touchent les personnes<br />
souffrant de SIDA à un stade avancé. La majorité des<br />
isolats appartiennent à un groupe apparenté de microorganismes<br />
appelé complexe M. avium-intracellulare. <strong>Les</strong> infections<br />
<strong>du</strong>es aux agents pathogènes de ce groupe sont rares<br />
dans l’ensemble de la population.<br />
Le vaccin BCG est une culture vivante de M. bovis ren<strong>du</strong>e<br />
avirulente par une longue série de cultures sur des<br />
milieux artificiels. (<strong>Les</strong> lettres BCG sont le sigle de bacille de<br />
Calmette-Guérin, <strong>du</strong> nom des deux chercheurs qui ont été<br />
les premiers à isoler la souche pathogène.) Relativement<br />
efficace pour prévenir la tuberculose, ce vaccin est utilisé<br />
depuis les années 1920. À l’échelle mondiale, c’est l’un des<br />
vaccins les plus fréquemment administrés.On estime que 70%<br />
des enfants d’âge scolaire de la planète l’ont reçu en 1990.<br />
Cependant, le vaccin BCG n’est pas très employé au Canada
et aux États-Unis, où l’on n’en recommande l’administration<br />
qu’aux enfants à risque élevé pour lesquels le test cutané<br />
est négatif. <strong>Les</strong> personnes qui ont reçu le vaccin présentent<br />
une réaction positive aux tests cutanés à la tuberculine. La<br />
difficulté d’interpréter le test après la vaccination est l’un des<br />
arguments évoqués depuis longtemps par les opposants à<br />
l’administration <strong>du</strong> vaccin à grande échelle dans ces pays.<br />
<strong>Les</strong> efforts pour lutter contre la maladie comprennent l’augmentation<br />
de la surveillance des nouveaux cas, le suivi des<br />
patients sous antibiothérapie et l’amélioration des conditions<br />
sociales et environnementales qui favorisent la propagation<br />
de la maladie.<br />
Depuis la création d’antibiotiques efficaces dans les<br />
années 1950,l’incidence de la tuberculose a diminué régulièrement;<br />
toutefois, l’antibiorésistance de certaines souches de<br />
M. tuberculosis est devenue un problème ces dernières années.<br />
Au Canada, 1 464 nouveaux cas de la maladie ont été signalés<br />
en 2000. <strong>Les</strong> provinces <strong>du</strong> Québec, de l’Ontario et de la<br />
Colombie-Britannique sont les plus touchées (figure 24.12a).<br />
En fait, certaines souches sont maintenant résistantes à la<br />
plupart des médicaments antituberculeux offerts, y compris<br />
l’isoniazide (INH) et la rifampine (RMP); le pourcentage<br />
d’isolats qui affichent une résistance aux antituberculeux est<br />
de 11,2% et la proportion des isolats considérés comme multirésistants<br />
est de 1% (figure 24.12b). La médecine s’avère<br />
tout aussi impuissante face à ces cas qu’elle l’était il y a un<br />
siècle face à l’ensemble des personnes atteintes de tuberculose,<br />
et on peut dire en ce sens qu’elle est revenue à l’ère<br />
préantibiotique. La maladie sévit avec plus de virulence chez<br />
les autochtones, chez les immigrants en provenance de pays<br />
où la maladie est endémique (Haïti, Inde, pays africains), chez<br />
les sans-abri et dans les collectivités défavorisées des centresvilles.<br />
L’Ontario, dont les grandes villes accueillent beaucoup<br />
d’immigrants, est la province <strong>du</strong> Canada où le nombre<br />
de cas de tuberculose est le plus élevé (figure 24.12c). Aux<br />
États-Unis, on dénombre actuellement environ 20 000 nouveaux<br />
cas par année; cependant, le taux de mortalité, qui est<br />
de près de 2 000 cas par année, décroît continuellement.<br />
Environ un tiers des nouveaux cas de tuberculose touche<br />
des immigrants, notamment ceux qui arrivent <strong>du</strong> Mexique,<br />
des Philippines et <strong>du</strong> Viêtnam. En outre, certains groupes<br />
ethniques sont particulièrement ciblés: les Afro-Américains,<br />
les autochtones, les Asiatiques et les Hispaniques constituent<br />
les deux tiers des cas (figure 24.13). Chez les Américains de<br />
race blanche, ce sont en majorité les personnes très âgées qui<br />
sont atteintes par la maladie.<br />
On estime qu’un tiers de la population mondiale est<br />
infectée par le bacille tuberculeux. Au moins 3 millions de<br />
personnes meurent chaque année des suites de la tuberculose,<br />
FIGURE 24.12 La résistance des isolats de Mycobacterium tuberculosis<br />
aux antituberculeux au Canada en 2000. [SOURCE: Système<br />
canadien de surveillance des laboratoires de tuberculose, 2000.]<br />
■ <strong>Les</strong> personnes atteintes de tuberculose doivent<br />
s’astreindre à la prise de grandes quantités d’antibiotiques<br />
sur une longue période.<br />
CHAPITRE 24 <strong>Les</strong> <strong>maladies</strong> <strong>infectieuses</strong> <strong>du</strong> <strong>système</strong> <strong>respiratoire</strong> 13<br />
a) Résistance aux antituberculeux déclarée au Canada<br />
par province/territoire en 2000 (n = 1 464 isolats).<br />
Résistance (%) aux médicaments<br />
Isolats déclarés<br />
14<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
11,2<br />
Résistance<br />
à un ou<br />
plusieurs<br />
médicaments<br />
8,1<br />
Résistance<br />
à un seul<br />
médicament<br />
Type de résistance<br />
1,0<br />
TB-MR<br />
(on appelle<br />
multirésistance<br />
la résistance<br />
à l’INH et au<br />
RMP au moins)<br />
Multirésistance<br />
Résistance<br />
à un ou plusieurs<br />
médicaments<br />
Tous sensibles<br />
b) Profil général de résistance aux antituberculeux déclarée<br />
au Canada en 2000.<br />
700<br />
600<br />
500<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
0<br />
Alb.<br />
C.-B.<br />
Man.<br />
N.-B.<br />
T.-N.<br />
N.-É.<br />
T.N.-O.<br />
Nun.<br />
Ont.<br />
Î.-P.-É.<br />
Province/territoire<br />
c) Isolats de M. tuberculosis déclarés au Canada par<br />
province/territoire en 2000 (n = 1464 isolats).<br />
Qc<br />
2,1<br />
Autres<br />
profils de<br />
résistance<br />
Sask.<br />
Yn
14 QUATRIÈME PARTIE <strong>Les</strong> microorganismes et les <strong>maladies</strong> humaines<br />
Noirs non hispaniques<br />
5 831 (31,8 %)<br />
Hispaniques<br />
4 099 (22,3 %)<br />
qui est encore aujourd’hui la maladie infectieuse provoquant<br />
le plus grand nombre de décès dans le monde.<br />
Notez que, dans certains groupes, le VIH fait progresser<br />
la maladie plus rapidement qu’on ne l’aurait cru possible.Par<br />
ailleurs, comme nous l’avons mentionné, les voyages internationaux,<br />
les échanges commerciaux, l’immigration sont<br />
autant de facteurs qui favorisent la propagation de la tuberculose<br />
hors des frontières des pays touchés. La tuberculose<br />
est en passe de devenir un problème de santé mondial.<br />
<strong>Les</strong> pneumonies bactériennes<br />
Objectifs d’apprentissage<br />
Blancs non<br />
hispaniques<br />
4 495 (24,5 %)<br />
Inconnus<br />
60 (0,3 %)<br />
Asiatiques ou en<br />
provenance des îles<br />
<strong>du</strong> Pacifique<br />
3 623 (19,7 %)<br />
Autochtones<br />
252 (1,4 %)<br />
FIGURE 24.13 Distribution des cas de tuberculose aux<br />
États-Unis. Pourcentage des cas selon la race ou l’origine<br />
ethnique. [SOURCE : Morbidity and Mortality Weekly Report<br />
(MMWR), vol. 47, n o 53, 31 décembre 1999.]<br />
■ Le VIH favorise la progression de la tuberculose.<br />
■ Décrire les similitudes et les différences entre les sept types<br />
de pneumonies bactériennes décrites dans le présent chapitre.<br />
■ Décrire l’épidémiologie de la légionellose, de la psittacose<br />
et de la fièvre Q, et notamment la virulence des agents<br />
pathogènes en cause, leurs réservoirs, leurs modes de transmission,<br />
ainsi que les facteurs prédisposants de l’hôte réceptif.<br />
■ Relier les dommages physiopathologiques et les symptômes<br />
de la pneumonie à pneumocoques au pouvoir pathogène<br />
des microorganismes en cause.<br />
■ Relier ces infections pulmonaires aux épreuves de<br />
diagnostic, au type de thérapeutique et aux mesures<br />
de prévention utilisées pour contrer leur transmission.<br />
Le terme pneumonie désigne de nombreuses infections<br />
pulmonaires dont la majorité sont d’origine bactérienne. La<br />
pneumonie provoquée par Streptococcus pneumoniæ est la plus<br />
fréquente, d’où l’appellation pneumonie typique (voir l’encadré<br />
de la page XXX). <strong>Les</strong> pneumonies causées par d’autres<br />
bactéries ou par des mycètes, des protozoaires ou des virus<br />
sont appelées pneumonies atypiques. Cependant, cette distinction<br />
est de moins en moins nette en pratique.<br />
On distingue aussi les pneumonies en fonction de la partie<br />
des voies <strong>respiratoire</strong>s inférieures qui est atteinte. Par<br />
exemple, si les lobes des poumons sont infectés, on parle de<br />
pneumonie lobaire;les pneumonies provoquées par S.pneumoniæ<br />
sont généralement de ce type. Le terme bronchopneumonie<br />
indique que les alvéoles pulmonaires adjacentes aux bronches<br />
sont infectées. La pleurésie est une complication fréquente de<br />
diverses pneumonies;elle est caractérisée par une inflammation<br />
douloureuse des membranes pleurales. <strong>Les</strong> symptômes<br />
classiques d’une pneumonie comprennent une fièvre élevée,<br />
des difficultés <strong>respiratoire</strong>s et des douleurs thoraciques.<br />
La pneumonie à pneumocoques<br />
On appelle pneumonie à pneumocoques la pneumonie<br />
provoquée par S. pneumoniæ. Cette bactérie fait partie de la<br />
flore normale des voies <strong>respiratoire</strong>s, mais elle peut devenir<br />
pathogène ; elle est aussi une cause fréquente de l’otite<br />
moyenne,de la méningite et de la septicémie.S.pneumoniæ est<br />
une bactérie sphérique (coccus) à Gram positif (figure 24.14).<br />
Comme les cocci sont généralement regroupés par paires, le<br />
genre a d’abord été nommé Diplococcus pneumoniæ. <strong>Les</strong> paires<br />
de bactéries sont entourées d’une capsule dense qui les rend<br />
résistantes à la phagocytose; les pneumocoques encapsulés<br />
peuvent alors se multiplier et envahir les tissus pulmonaires.<br />
<strong>Les</strong> capsules ont servi de base à la différenciation sérologique<br />
des pneumocoques en quelque 83 sérotypes.Avant l’avènement<br />
de l’antibiothérapie, on traitait la maladie à l’aide<br />
d’immunsérums dirigés contre ces antigènes capsulaires.<br />
La pneumonie à pneumocoques atteint à la fois les<br />
bronches et les alvéoles pulmonaires (figure 24.2).<strong>Les</strong> symptômes<br />
apparaissent brutalement – fièvre élevée, difficulté à<br />
respirer et douleurs thoraciques. (L’évolution initiale des<br />
pneumonies atypiques est généralement plus lente; la fièvre<br />
est moins élevée et les douleurs thoraciques sont moins<br />
intenses.) <strong>Les</strong> poumons ont un aspect rougeâtre à cause de la<br />
dilatation des vaisseaux sanguins. En réaction à l’infection,<br />
les alvéoles se remplissent d’érythrocytes, de granulocytes<br />
neutrophiles (tableau 16.1) et de liquide provenant des tissus<br />
adjacents; l’altération des alvéoles ré<strong>du</strong>it les échanges<br />
gazeux, ce qui peut entraîner une détresse <strong>respiratoire</strong>.<br />
<strong>Les</strong> crachats sont fréquemment de couleur rouille, car ils<br />
contiennent <strong>du</strong> sang expulsé des poumons. <strong>Les</strong> pneumocoques<br />
peuvent s’intro<strong>du</strong>ire dans la circulation sanguine,<br />
dans la cavité pleurale entourant les poumons et, parfois,<br />
dans les méninges. On ne connaît aucune relation nette<br />
entre une exotoxine ou une endotoxine bactérienne et la<br />
pathogénicité <strong>du</strong> microorganisme.<br />
On établit un diagnostic de présomption en isolant des<br />
pneumocoques de la gorge, des crachats ou d’autres liquides.<br />
On peut distinguer les pneumocoques des autres streptocoques<br />
-hémolytiques en observant l’inhibition de la<br />
croissance autour d’un disque d’optochine (chlorhydrate<br />
d’éthylhydrocupréine) ou en effectuant un test de solubilité
Capsule<br />
Cocci appariés<br />
(diplocoque)<br />
FIGURE 24.14 Streptococcus pneumoniae, agent causal le plus<br />
courant de la pneumonie à pneumocoques. Notez le regroupement<br />
des cellules par paires. On a ren<strong>du</strong> la capsule plus apparente en<br />
la faisant réagir avec un antisérum pneumococcique spécifique,<br />
qui la fait paraître enflée.<br />
■ La capsule de S. pneumoniæ fait obstacle<br />
à la phagocytose.<br />
MO<br />
de la bile.On peut aussi les différencier sur le plan sérologique.<br />
<strong>Les</strong> cas reconnus d’infections envahissantes à S. pneumoniæ<br />
doivent faire l’objet d’une déclaration auprès des services de<br />
santé publique.<br />
De nombreux indivi<strong>du</strong>s sains sont porteurs de pneumocoques;<br />
95% des enfants de moins de 2 ans le sont à un<br />
moment donné. La transmission se fait de personne à personne<br />
par des gouttelettes infectées et par contact indirect<br />
avec des objets fraîchement contaminés. La virulence de la<br />
bactérie semble dépendre principalement de la résistance<br />
de l’hôte, qui peut être affaiblie par le stress. Beaucoup de<br />
<strong>maladies</strong> touchant les personnes âgées évoluent vers une<br />
pneumonie pneumococcique.<br />
La réapparition d’une pneumonie pneumococcique<br />
n’est pas rare, mais en général l’agent infectieux est sérologiquement<br />
différent.Avant l’avènement de la chimiothérapie,<br />
le taux de mortalité atteignait 25%. Il ne dépasse pas 1%<br />
maintenant chez les jeunes patients traités dès le début de la<br />
maladie mais, chez les patients âgés hospitalisés, il est encore<br />
de près de 20%. Le médicament d’élection est la pénicilline,<br />
mais on a observé des souches de pneumocoques résistantes<br />
à cet antibiotique. Ce problème, qui va en s’aggravant, porte<br />
sur au moins 25 % des isolats dans certaines régions des<br />
États-Unis. On a élaboré un vaccin à partir de la substance<br />
capsulaire purifiée des 23 types de pneumocoques responsables<br />
d’au moins 90% des cas de pneumonie à pneumocoques.<br />
Ce vaccin est administré aux groupes les plus<br />
susceptibles d’être infectés, soit les personnes âgées et les indivi<strong>du</strong>s<br />
immunodéprimés.Par ailleurs,on a mis au point récemment<br />
un vaccin antipneumococcique conjugué (p. XXX).<br />
CHAPITRE 24 <strong>Les</strong> <strong>maladies</strong> <strong>infectieuses</strong> <strong>du</strong> <strong>système</strong> <strong>respiratoire</strong> 15<br />
2 mm<br />
La pneumonie à Hæmophilus influenzæ<br />
<strong>Les</strong> pneumonies à Hæmophilus influenzæ sont fréquentes<br />
chez les patients atteints d’alcoolisme, de malnutrition, d’un<br />
cancer ou <strong>du</strong> diabète.Hæmophilus influenzæ est un coccobacille<br />
à Gram négatif que l’on trouve dans la flore normale des voies<br />
<strong>respiratoire</strong>s de porteurs sains.Une coloration de Gram de crachats<br />
permet de distinguer une pneumonie causée par cet<br />
organisme d’une pneumonie à pneumocoques. <strong>Les</strong> céphalosporines<br />
de deuxième génération ne sont pas inactivées<br />
par les -lactamases pro<strong>du</strong>ites par de nombreuses souches de<br />
H. influenzæ; par conséquent, ces antibiotiques sont le plus<br />
souvent le médicament d’élection.<br />
La pneumonie à mycoplasmes<br />
<strong>Les</strong> mycoplasmes, qui sont dépourvus de paroi cellulaire, ne<br />
se développent pas dans les conditions de culture prévalant<br />
en général lors de l’isolement de la plupart des bactéries<br />
pathogènes. C’est pourquoi on confond souvent la pneumonie<br />
à mycoplasmes avec une pneumonie virale.<br />
L’agent responsable de la pneumonie à mycoplasmes<br />
est la bactérie Mycoplasma pneumoniæ. On a découvert cette<br />
forme de pneumonie en constatant que des infections atypiques<br />
réagissaient aux tétracyclines, ce qui révélait un agent<br />
pathogène non viral. La pneumonie à mycoplasmes est fréquente<br />
chez les jeunes a<strong>du</strong>ltes et les enfants; elle constitue<br />
environ 20% de tous les cas de pneumonie, mais sa déclaration<br />
n’est pas obligatoire. La transmission se fait par contact<br />
avec les sécrétions d’une personne infectée. <strong>Les</strong> symptômes,<br />
qui <strong>du</strong>rent au moins 3 semaines, comprennent une faible<br />
fièvre, de la toux et des maux de tête. Ils sont parfois assez<br />
graves pour nécessiter l’hospitalisation <strong>du</strong> patient. L’immunité<br />
acquise ne semble pas permanente. La pneumonie à mycoplasmes<br />
est aussi appelée pneumonie atypique et maladie d’Eaton.<br />
En croissant sur un milieu contenant <strong>du</strong> sérum de cheval<br />
ou un extrait de levure, les isolats provenant de frottis de<br />
la gorge ou de crachats constituent des colonies qui ont<br />
un aspect caractéristique d’«œuf frit» (figure 24.15), trop<br />
petites pour être visibles à l’œil nu. Comme ils n’ont pas de<br />
paroi cellulaire, les mycoplasmes présentent des formes très<br />
diversifiées (figure 11.17). Grâce à leur flexibilité, ils passent<br />
à travers les filtres dont les pores n’ont pas plus de 0,2 m de<br />
diamètre et qui retiennent la majorité des autres bactéries.<br />
Le diagnostic fondé sur l’isolement de l’agent pathogène<br />
n’est pas nécessairement utile pour déterminer le traitement<br />
puisque le microorganisme, à croissance lente, prend parfois<br />
jusqu’à 2 semaines pour se développer. Cependant, on a<br />
grandement amélioré les épreuves diagnostiques au cours de<br />
ces dernières années. Elles comprennent maintenant l’amplification<br />
en chaîne par polymérase et des tests sérologiques<br />
permettant de déceler les anticorps IgM contre M. pneumoniæ.<br />
La légionellose<br />
La légionellose, ou maladie <strong>du</strong> légionnaire, a attiré<br />
pour la première fois l’attention <strong>du</strong> public en 1976,<br />
lorsqu’une série de décès se sont pro<strong>du</strong>its parmi les membres
16 QUATRIÈME PARTIE <strong>Les</strong> microorganismes et les <strong>maladies</strong> humaines<br />
MO<br />
1 mm<br />
FIGURE 24.15 Colonies de Mycoplasma pneumoniæ, agent<br />
causal de la pneumonie à mycoplasmes.<br />
■ <strong>Les</strong> colonies de Mycoplasma pneumoniæ sont tellement<br />
petites que leur observation nécessite un agrandissement<br />
de 50 à 100.<br />
de l’American Legion qui avaient assisté à un congrès à<br />
Philadelphie. En tout, 182 personnes avaient apparemment<br />
contracté une maladie pulmonaire lors de cette réunion, et<br />
29 en moururent. Comme on n’arrivait pas à déterminer une<br />
cause bactérienne, les décès furent attribués à une pneumonie<br />
virale. Des recherches plus poussées, principalement à l’aide<br />
de techniques visant à localiser un présumé agent à rickettsies,<br />
ont permis de déterminer une bactérie jusque-là inconnue,<br />
soit un bacille aérobie à Gram négatif qui a été appelé<br />
Legionella pneumophila. On connaît maintenant 39 espèces<br />
<strong>du</strong> genre Legionella, mais elles ne sont pas toutes pathogènes.<br />
La maladie <strong>du</strong> légionnaire est caractérisée par une fièvre<br />
atteignant 40,5 °C, de la toux et les symptômes généraux de<br />
la pneumonie. Elle ne semble pas être transmissible de personne<br />
à personne. Des études récentes ont montré qu’il est<br />
facile d’isoler la bactérie des eaux naturelles. De plus, la bactérie<br />
peut croître dans l’eau de condensation des <strong>système</strong>s de<br />
climatisation, de sorte que des épidémies observées dans des<br />
hôtels, des centres d’affaires et des hôpitaux ont peut-être<br />
été causées par une transmission aérienne de la bactérie. On<br />
sait que des poussées récentes avaient comme origine des<br />
baignoires à remous, des humidificateurs, des chauffe-eau,<br />
des douches et des fontaines décoratives.<br />
On a en outre démontré que L. pneumophila réside dans<br />
les con<strong>du</strong>ites d’eau de nombreux hôpitaux. La majorité des<br />
établissements de ce type maintiennent, par mesure de sécurité,<br />
une température relativement basse (de 43 à 55 °C)<br />
dans les con<strong>du</strong>ites d’eau chaude, si bien que dans les zones<br />
les plus froides <strong>du</strong> <strong>système</strong> la température est favorable à la<br />
croissance de Legionella. Ce microorganisme est beaucoup<br />
plus résistant au chlore que la majorité des bactéries, et il<br />
peut survivre <strong>du</strong>rant de longues périodes dans une eau faiblement<br />
chlorée. La résistance de Legionella au chlore et à la<br />
chaleur s’explique peut-être par une association avec des<br />
amibes présentes dans l’eau. <strong>Les</strong> bactéries sont ingérées par les<br />
amibes, mais continuent de proliférer et survivent même à<br />
l’intérieur d’amibes enkystées. De plus, elles sont résistantes<br />
à la phagocytose.<br />
On pense maintenant que la maladie <strong>du</strong> légionnaire a<br />
toujours été relativement courante, bien que non connue.<br />
Le nombre de cas déclarés est de plus de 1 000 par année,<br />
mais on estime que l’incidence s’élève en fait à plus de<br />
25 000 cas par année aux États-Unis; on observe quelques<br />
centaines de cas par année en France, mais bien moins au<br />
Canada. Ce sont les hommes de plus de 50 ans qui risquent<br />
le plus de contracter la légionellose, en particulier ceux qui<br />
font un usage abusif de tabac ou d’alcool, et ceux qui<br />
souffrent d’une affection chronique.<br />
L. pneumophila est également responsable de la fièvre de<br />
Pontiac, dont les symptômes comprennent de la fièvre, des<br />
douleurs musculaires et, en général, de la toux. Il s’agit d’une<br />
maladie bénigne et spontanément résolutive.<br />
La meilleure méthode diagnostique est la culture sur un<br />
milieu sélectif à base de gélose d’extrait de levure de charbon.<br />
L’analyse des spécimens <strong>respiratoire</strong>s se fait à l’aide<br />
de techniques d’immunofluorescence et il existe un test à la<br />
sonde d’ADN. <strong>Les</strong> médicaments préférés sont l’érythromycine<br />
et d’autres antibiotiques de la famille des macrolides,<br />
tels que l’azithromycine.<br />
La psittacose (ornithose)<br />
Le terme psittacose vient de l’association de cette maladie<br />
avec les oiseaux de la famille des psittacidés, tels que les<br />
perruches et les perroquets. Par la suite, on a découvert que<br />
plusieurs autres types d’oiseaux peuvent transmettre cette<br />
affection, par exemple les pigeons, les poulets, les canards<br />
et les dindes. On a maintenant recours à l’appellation ornithose,<br />
plus générale.<br />
L’agent responsable de la psittacose est Chlamydia psittaci,<br />
une bactérie intracellulaire obligatoire, à Gram négatif.<br />
<strong>Les</strong> chlamydias diffèrent des rickettsies, qui sont aussi des<br />
bactéries intracellulaires obligatoires, notamment par le fait<br />
qu’elles forment de minuscules corps élémentaires à un<br />
stade de leur cycle de vie (figure 11.14). Ces derniers,<br />
contrairement à la majorité des rickettsies,sont résistants aux<br />
contraintes <strong>du</strong> milieu et se transmettent donc par voie<br />
aérienne; il n’est pas nécessaire qu’il y ait morsure pour que<br />
l’agent infectieux passe directement d’un hôte à un autre.<br />
La psittacose est une forme de pneumonie qui cause<br />
généralement de la fièvre, des maux de tête et des frissons. Il<br />
s’agit souvent d’une infection subclinique et le stress semble<br />
augmenter la sensibilité à la maladie. Une perte <strong>du</strong> sens de<br />
l’orientation, ou même <strong>du</strong> délire dans certains cas, indique<br />
une atteinte <strong>du</strong> <strong>système</strong> nerveux.<br />
La maladie se transmet rarement d’une personne à une<br />
autre;elle se contracte la plupart <strong>du</strong> temps par contact avec de<br />
la fiente ou d’autres exsudats d’oiseaux. L’un des modes de
R É S O L U T I O N D E C A S C L I N I Q U E S<br />
Une infection des voies <strong>respiratoire</strong>s<br />
La description <strong>du</strong> problème comporte<br />
des questions que le médecin de premier<br />
recours et l’épidémiologiste <strong>du</strong> service de<br />
santé publique se posent lorsqu’ils tentent<br />
de résoudre un problème clinique.<br />
Essayez de répondre à chaque question<br />
avant de poursuivre votre lecture.<br />
1. Une femme de 39 ans se présente au<br />
service des urgences; depuis 4 jours,<br />
elle fait de la fièvre, a des frissons,<br />
ressent de la fatigue, tousse et souffre<br />
de douleurs dans la partie supérieure<br />
gauche <strong>du</strong> dos. L’examen physique<br />
révèle un murmure vésiculaire<br />
diminué, une température de 39 °C<br />
et un rythme accéléré des pulsations<br />
cardiaques. La patiente présente une<br />
infection chronique des sinus pour<br />
laquelle elle a reçu trois traitements<br />
aux antibiotiques au cours de<br />
l’année. Une radiographie des poumons<br />
met en évidence des infiltrats<br />
dans le lobe pulmonaire gauche.<br />
De quelles informations supplémentaires<br />
avez-vous besoin?<br />
2. <strong>Les</strong> résultats de la coloration de Gram<br />
de crachats et d’un lavage des bronches<br />
sont représentés dans la figure a.<br />
On a aussi prélevé un échantillon<br />
de sang pour la mise en culture.<br />
De quelle maladie peut-il s’agir? Quel<br />
serait le traitement le plus approprié?<br />
transmission les plus courants est l’inhalation de particules<br />
d’excréments séchés. Quant aux oiseaux, ils ont habituellement<br />
la diarrhée, le plumage ébouriffé, des troubles <strong>respiratoire</strong>s<br />
et un port mou. <strong>Les</strong> perruches et les perroquets ven<strong>du</strong>s<br />
3. <strong>Les</strong> symptômes de la patiente et la<br />
présence de cocci à Gram positif<br />
sont compatibles avec un diagnostic<br />
de pneumonie. Un traitement de<br />
7 jours à la pénicilline est donc<br />
indiqué.Toutefois, les symptômes<br />
de la patiente continuent de se<br />
manifester pendant les jours<br />
suivants. Quelles analyses supplémentaires<br />
devrait-on effectuer?<br />
4. On inocule une gélose au sang avec<br />
l’échantillon de sang de la patiente;<br />
les résultats sont illustrés dans la<br />
figure b. La figure c représente les<br />
résultats de tests de sensibilité aux<br />
antibiotiques effectués sur l’isolat<br />
(dans le sens des aiguilles d’une<br />
montre, en partant de la droite).<br />
On teste la sensibilité de l’agent<br />
pathogène aux antibiotiques suivants:<br />
la vancomycine (V), la pénicilline<br />
(P), la tétracycline (T), la streptomycine<br />
(S) et l’érythromycine (E).<br />
Qu’indiquent les résultats?<br />
5. La souche isolée provoque une<br />
hémolyse de type alpha sur la gélose<br />
au sang (figure b); la souche est<br />
résistante à la pénicilline (figure c).<br />
On détermine au moyen d’une<br />
réaction d’agglutination par les<br />
anticorps que les colonies de bactéries<br />
-hémolytiques appartiennent<br />
a) b) c)<br />
CHAPITRE 24 <strong>Les</strong> <strong>maladies</strong> <strong>infectieuses</strong> <strong>du</strong> <strong>système</strong> <strong>respiratoire</strong> 17<br />
à l’espèce Streptococcus pneumoniæ.<br />
Il est donc possible que la pénicilline<br />
prescrite n’ait pas éliminé l’infection,<br />
car l’isolat de S. pneumoniæ est<br />
résistant à cet antibiotique.<br />
Quel(s) médicament(s) est (sont)<br />
efficace(s) contre la souche isolée?<br />
6. La souche isolée est sensible à la<br />
vancomycine et à l’érythromycine.<br />
Partout dans le monde, on rencontre de<br />
plus en plus fréquemment des souches<br />
pharmacorésistantes de S. pneumoniæ.<br />
Dans certaines régions, on a constaté<br />
que jusqu’à 35% des isolats pneumococciques<br />
ont une résistance relative<br />
à la pénicilline. Bon nombre des pneumocoques<br />
résistants à la pénicilline<br />
le sont aussi à d’autres antibiotiques.<br />
Ce phénomène complique en général<br />
le traitement d’une infection pneumococcique.<br />
Il faut alors employer des<br />
agents antimicrobiens plus coûteux, et<br />
cela entraîne souvent une augmentation<br />
de la <strong>du</strong>rée de l’hospitalisation et des frais<br />
médicaux. L’émergence de la résistance<br />
aux antimicrobiens met en évidence<br />
l’importance de prévenir les infections<br />
streptococciques par la vaccination.<br />
SOURCE: Informations sur les médicaments<br />
tirées de MMWR, vol. 46 (RR-08),<br />
4 avril 1997.<br />
E V<br />
dans les animaleries sont le plus souvent (mais pas toujours)<br />
exempts de la maladie. Beaucoup d’oiseaux sont porteurs de<br />
l’agent pathogène dans la rate, sans présenter de symptômes;<br />
ils ne deviennent malades que s’ils sont soumis à un stress.<br />
S<br />
T<br />
P
18 QUATRIÈME PARTIE <strong>Les</strong> microorganismes et les <strong>maladies</strong> humaines<br />
<strong>Les</strong> employés des animaleries et les éleveurs de dindes sont les<br />
personnes qui risquent le plus de contracter une ornithose.<br />
Le diagnostic repose sur l’isolement de la bactérie dans des<br />
œufs embryonnés ou sur une culture cellulaire. Des tests sérologiques<br />
permettent d’identifier l’organisme isolé. Il n’existe<br />
pas de vaccin, mais les tétracyclines sont des antibiotiques<br />
efficaces pour le traitement de la maladie chez les humains<br />
et les animaux. La guérison ne confère pas une immunité<br />
efficace, même si le titre d’anticorps dans le sérum est élevé.<br />
Le nombre de cas d’ornithose est généralement faible et<br />
les décès sont rares. Le fait que la maladie tarde à être diagnostiquée<br />
constitue le principal danger.Avant l’avènement<br />
de l’antibiothérapie, le taux de mortalité était d’environ<br />
20% en Amérique <strong>du</strong> Nord.<br />
La pneumonie à Chlamydia<br />
On a découvert que des épidémies d’une maladie <strong>respiratoire</strong><br />
étaient <strong>du</strong>es à un organisme <strong>du</strong> genre Chlamydia. On a<br />
d’abord cru qu’il s’agissait d’une souche de C. psittaci, mais<br />
on a nommé l’agent pathogène Chlamydia pneumoniæ et la<br />
maladie porte le nom de pneumonie à Chlamydia. Cette<br />
affection ressemble cliniquement à la pneumonie à mycoplasmes.<br />
(Il se pourrait qu’il existe une association entre<br />
C. pneumoniæ et l’athérosclérose – c’est-à-dire l’obstruction<br />
d’artères par des dépôts de matières grasses.)<br />
La pneumonie à Chlamydia se transmet apparemment de<br />
personne à personne, probablement par voie <strong>respiratoire</strong>,<br />
mais pas aussi facilement que des infections comme la grippe.<br />
Cette forme de pneumonie est assez courante en Amérique<br />
<strong>du</strong> Nord puisque près de un indivi<strong>du</strong> sur deux possède des<br />
anticorps contre C. pneumoniæ. Il existe plusieurs tests sérologiques<br />
servant au diagnostic, mais les résultats sont difficiles<br />
à interpréter à cause de la variation antigénique.<br />
L’antibiotique le plus efficace est la tétracycline.<br />
La fièvre Q<br />
Une maladie est apparue en Australie <strong>du</strong>rant les années<br />
1930. Elle était caractérisée par une fièvre persistant de 1 à<br />
2 semaines, des frissons, des douleurs thoraciques, des maux<br />
de tête intenses et d’autres signes et symptômes propres à une<br />
infection de type pulmonaire; elle était rarement mortelle.<br />
Étant donné qu’il n’y avait pas de cause évidente,on a nommé<br />
l’affection fièvre Q (query signifiant «point d’interrogation»),<br />
un peu comme on dirait fièvre X. On a par la suite découvert<br />
que l’agent responsable était Coxiella burnetii, une bactérie<br />
intracellulaire, parasite obligatoire (figure 24. 16a). Cette<br />
bactérie vit à l’intérieur <strong>du</strong> macrophagocyte qui l’a capturé<br />
et peut s’y multiplier grâce aux conditions acides <strong>du</strong> phagolysosome;<br />
la bactérie contourne ainsi le moyen de défense<br />
habituellement efficace de la phagocytose. La majorité des<br />
bactéries intracellulaires, telles que les rickettsies (famille à<br />
laquelle appartient Coxiella), ne sont pas assez résistantes<br />
pour se transmettre par voie aérienne, mais C. burnetii fait<br />
exception grâce à sa grande résistance à la dessiccation.<br />
La complication la plus grave de la fièvre Q est l’endocardite,<br />
que l’on observe dans 10% des cas, généralement de<br />
5 à 10 ans après l’infection initiale. Il semble que pendant<br />
ce laps de temps l’agent pathogène réside dans le foie, où il<br />
risque de provoquer une forme d’hépatite.<br />
C. burnetii est un parasite de plusieurs arthropodes, en<br />
particulier de la tique <strong>du</strong> bétail, et il se transmet d’un animal<br />
à un autre par la morsure de tique. Chez les animaux,<br />
l’infection est habituellement subclinique. La tique <strong>du</strong> bétail<br />
propage d’abord la maladie chez les bovins laitiers, et le<br />
microbe est libéré dans les fèces, le lait et l’urine des bêtes<br />
infectées. Lorsque la maladie atteint un troupeau, elle s’y<br />
maintient par transmission par aérosol. Elle se transmet aux<br />
humains par l’ingestion de lait non pasteurisé et par l’inhalation<br />
d’aérosols des microbes pro<strong>du</strong>its dans les étables à<br />
vaches laitières et provenant principalement de débris placentaires<br />
pendant la saison de vêlage. L’inhalation d’un seul<br />
agent pathogène suffit à provoquer l’infection, de sorte que<br />
de nombreux travailleurs de l’in<strong>du</strong>strie laitière contractent<br />
au moins une infection subclinique. Le risque est également<br />
élevé pour les employés des usines de transformation de la<br />
viande ou de préparation des peaux. La température de pasteurisation<br />
<strong>du</strong> lait, d’abord fixée de manière à détruire le<br />
bacille tuberculeux, a été augmentée en 1956 de manière à<br />
garantir l’élimination de C.burnetii. En 1981,on a découvert<br />
un élément ressemblant à une endospore dont la présence<br />
explique peut-être la résistance à la chaleur de la bactérie<br />
(figure 24.16b).<br />
On identifie l’agent pathogène par isolement, par culture<br />
dans un embryon de poulet ou un œuf et par culture<br />
cellulaire. <strong>Les</strong> employés de laboratoire se servent de tests sérologiques<br />
pour vérifier la présence d’anticorps spécifiques de<br />
Coxiella dans le sérum d’un patient.<br />
La majorité des cas de fièvre Q surviennent dans l’ouest<br />
canadien et américain. La maladie est endémique dans les<br />
États de Californie, d’Arizona, d’Oregon et de Washington.<br />
Il existe un vaccin pour les employés de laboratoire et les<br />
autres travailleurs exposés. La tétracycline constitue un traitement<br />
très efficace.<br />
Autres pneumonies bactériennes<br />
On découvre de plus en plus de bactéries responsables de<br />
pneumonies; les plus importantes sont Staphylococcus aureus,<br />
Moraxella catarrhalis, Streptococcus pyogenes et des anaérobies<br />
résidant dans la cavité buccale. Des bacilles à Gram négatif,<br />
tels que les espèces de Pseudomonas et Klebsiella pneumoniæ, provoquent<br />
aussi parfois des pneumonies bactériennes. La pneumonie<br />
à Klebsiella touche principalement les personnes âgées<br />
dont la résistance est affaiblie,en particulier celles qui sont hospitalisées,<br />
qui ont une déficience immunitaire ou qui souffrent<br />
d’alcoolisme. La pneumonie à Pseudomonas, bactérie qui fait<br />
partie de la flore normale intestinale, est fréquente en milieu<br />
hospitalier.Présentes sur de la literie souillée,les bactéries sont<br />
projetées dans l’air au cours des manœuvres de la réfection des<br />
lits. Pseudomonas résiste à de nombreux désinfectants et persiste<br />
même sur les feuilles des plantes. <strong>Les</strong> personnes affaiblies<br />
qui respirent l’air ambiant d’un hôpital sont particulièrement<br />
susceptibles de contracter une pneumonie de cette nature.
a) Notez la croissance intracellulaire<br />
de Coxiella burnetii, dans les vacuoles<br />
de la cellule hôte.<br />
<strong>Les</strong> viroses des voies<br />
<strong>respiratoire</strong>s inférieures<br />
Objectifs d’apprentissage<br />
■ Énumérer les agents responsables de la pneumonie virale.<br />
■ Décrire l’épidémiologie de l’infection au VRS et de la<br />
grippe, et notamment la virulence des agents pathogènes<br />
en cause, leurs réservoirs, leurs modes de transmission,<br />
ainsi que les facteurs prédisposants de l’hôte réceptif.<br />
■ Décrire, pour l’infection au VRS et la grippe, les dommages<br />
physiopathologiques et les symptômes de l’infection et<br />
les particularités de la réponse immunitaire, ainsi que<br />
les moyens de prévention et de traitement.<br />
■ Décrire les difficultés associées à la prévention et à la<br />
thérapie de ces deux infections virales.<br />
Un virus doit vaincre plusieurs défenses de l’hôte qui visent<br />
à le piéger et à le détruire avant qu’il atteigne les voies <strong>respiratoire</strong>s<br />
inférieures et y déclenche une maladie.<br />
La pneumonie virale<br />
Coxiella burnetii dans une vacuole<br />
MET<br />
La pneumonie virale est une complication potentielle de<br />
la grippe, de la rougeole et même de la varicelle. Un certain<br />
nombre d’Enterovirus et d’autres virus sont responsables de<br />
pneumonies virales, mais on isole et on détermine l’agent<br />
responsable dans seulement 1% des cas d’infections ressemblant<br />
à une pneumonie, car peu de laboratoires ont l’équipement<br />
requis pour analyser de façon adéquate des échantillons<br />
cliniques susceptibles de contenir un virus. Lorsque la cause<br />
CHAPITRE 24 <strong>Les</strong> <strong>maladies</strong> <strong>infectieuses</strong> <strong>du</strong> <strong>système</strong> <strong>respiratoire</strong> 19<br />
5 mm<br />
FIGURE 24.16 Coxiella burnetii, l’agent causal de la fièvre Q.<br />
■ Quels sont les deux modes de transmission de la fièvre Q ?<br />
b) La cellule illustrée ici vient tout juste de se diviser<br />
; l’élément ressemblant à une endospore (E)<br />
est probablement responsable de la résistance<br />
relative <strong>du</strong> microorganisme.<br />
MET<br />
d’une pneumonie est indéterminée, on suppose fréquemment<br />
que l’affection est d’origine virale si on peut éliminer la possibilité<br />
d’une pneumonie à mycoplasmes.<br />
Le virus <strong>respiratoire</strong> syncytial<br />
L’infection au virus <strong>respiratoire</strong> syncytial (VRS) est probablement<br />
la principale cause de maladie <strong>respiratoire</strong> virale<br />
chez les jeunes enfants de 2 à 6 mois. <strong>Les</strong> symptômes communs<br />
sont la toux creuse avec sécrétions abondantes, des<br />
frissons, de la dyspnée, des sibilances et des douleurs thoraciques;<br />
les bronchioles sont souvent atteintes, ce qui entraîne<br />
une bronchiolite marquée par une détresse <strong>respiratoire</strong> grave.<br />
La transmission se fait par contact direct avec les sécrétions,<br />
par inhalation de gouttelettes et par contact avec des objets<br />
fraîchement contaminés. Le virus persiste près de 8 heures<br />
sur les objets et une demi-heure sur les mains. Le VRS peut<br />
aussi provoquer une pneumonie potentiellement mortelle<br />
chez les personnes âgées. <strong>Les</strong> épidémies ont lieu l’hiver et au<br />
début <strong>du</strong> printemps. Presque tous les enfants sont infectés<br />
avant l’âge de 2 ans. Nous avons déjà mentionné que le VRS<br />
est aussi responsable de cas d’otite moyenne. Il doit son nom<br />
à l’une de ses caractéristiques;il provoque en effet l’hybridation<br />
somatique, ou syncytium, lorsqu’on le met en culture<br />
cellulaire. Il existe maintenant plusieurs tests sérologiques<br />
rapides, portant sur des échantillons de sécrétions des voies<br />
<strong>respiratoire</strong>s, qui permettent de déceler à la fois le virus et<br />
ses anticorps.<br />
L’immunité naturelle acquise est pratiquement nulle.On a<br />
approuvé l’emploi d’un pro<strong>du</strong>it d’immunoglobuline pour la<br />
protection des jeunes enfants ayant des troubles <strong>respiratoire</strong>s,<br />
tels que l’asthme, qui mettent leur vie en danger. Un vaccin<br />
E<br />
0,5 mm
20 QUATRIÈME PARTIE <strong>Les</strong> microorganismes et les <strong>maladies</strong> humaines<br />
est actuellement soumis à des essais cliniques. On administre<br />
de la ribavirine (un médicament antiviral) en aérosol aux<br />
patients gravement atteints. Ce traitement diminue sensiblement<br />
l’intensité des symptômes.<br />
La grippe<br />
Dans les pays in<strong>du</strong>strialisés, la maladie la mieux connue est<br />
sans doute la grippe, si on fait exception <strong>du</strong> rhume. Cette<br />
affection est caractérisée par des frissons,de la fièvre (39 o C),<br />
des maux de tête et de gorge, des douleurs musculaires<br />
et de la fatigue. La guérison survient habituellement après<br />
quelques jours, et des symptômes semblables au rhume<br />
apparaissent lorsque la fièvre tombe. La diarrhée n’est pas un<br />
symptôme normal de la maladie ; les malaises intestinaux<br />
attribués à la «grippe intestinale» sont probablement <strong>du</strong>s à<br />
une autre cause.<br />
Le virus grippal<br />
Le génome des virus <strong>du</strong> genre Influenzavirus est formé<br />
de huit segments monocaténaires d’ARN, de longueurs différentes;<br />
les fragments d’ARN sont entourés d’une capside<br />
(enveloppe protéinique) et d’une membrane externe lipidique<br />
(figures 13.3b et 24.17). De nombreuses excroissances,<br />
caractéristiques <strong>du</strong> virus, sont insérées dans la membrane<br />
lipidique; elles sont de deux types: les spicules d’hémagglutinine<br />
(H) et les spicules de neuraminidase (N).<br />
<strong>Les</strong> spicules H – au nombre de 500 environ sur chaque<br />
virus – permettent au virus de reconnaître les cellules hôtes<br />
et d’y adhérer, avant de les infecter. <strong>Les</strong> anticorps contre le<br />
virus grippal s’attaquent principalement à ces spicules. Le<br />
terme hémagglutinine évoque l’agglutination des globules<br />
rouges (ou hémagglutination) qui se pro<strong>du</strong>it lorsque ceuxci<br />
se mélangent à des virus. Cette réaction joue un rôle<br />
essentiel dans des tests sérologiques tels que la réaction<br />
d’inhibition de l’hémagglutination virale, souvent utilisée<br />
pour identifier le virus grippal et d’autres virus.<br />
<strong>Les</strong> spicules N – au nombre de 100 environ par virus –<br />
diffèrent des spicules H par leur aspect et leur fonction. Sur<br />
le plan enzymatique, ils aident apparemment le virus à se<br />
séparer de la cellule infectée après la réplication intracellulaire.<br />
Le virus est relâché par bourgeonnement à partir de<br />
la membrane cytoplasmique de la cellule hôte de sorte que,<br />
au bout de quelques cycles de réplication, la cellule hôte<br />
meurt; l’effet est donc cytocide. <strong>Les</strong> spicules N stimulent<br />
également la formation d’anticorps, mais ces derniers ne<br />
sont pas aussi cruciaux pour la résistance de l’organisme à la<br />
maladie que les anticorps pro<strong>du</strong>its en réaction aux spicules H.<br />
On détermine les souches virales à l’aide de la variation<br />
des antigènes H et N. On désigne les différents types d’antigènes<br />
au moyen d’indices, par exemple H1,H2,H3,N1 et<br />
N2. Chacun de ces symboles représente une souche virale<br />
qui diffère sensiblement des autres par la composition protéinique<br />
des spicules. Ces variations, appelées mutations<br />
antigéniques, sont assez décisives pour rendre inefficace<br />
Spicule N<br />
Capside<br />
(Enveloppe<br />
protéinique)<br />
Spicule H<br />
Membrane<br />
lipidique<br />
2 à 8 segments<br />
d’ARN<br />
50 nm<br />
FIGURE 24.17 Structure détaillée <strong>du</strong> virus de la grippe. La<br />
capside (enveloppe protéinique) est recouverte d’une membrane<br />
lipidique et de deux types de spicules. Il y a huit segments d’ARN<br />
à l’intérieur de la capside. Dans certaines conditions ambiantes,<br />
le virus de la grippe adopte une morphologie filamenteuse.<br />
l’immunité acquise contre un type spécifique d’antigène.<br />
Cette capacité de changement est responsable des épidémies,<br />
y compris les pandémies de 1918, 1957 et 1968, décrites<br />
dans le tableau 24.1. Notez que l’on a isolé un virus grippal<br />
pour la première fois en 1933; jusque-là, on déterminait la<br />
composition des antigènes des virus grippaux responsables<br />
d’épidémies par l’analyse des anticorps prélevés chez des<br />
personnes infectées.<br />
<strong>Les</strong> mutations antigéniques sont probablement <strong>du</strong>es à une<br />
recombinaison génétique majeure. Étant donné que l’ARN<br />
<strong>du</strong> virus grippal comporte huit segments, il s’est probablement<br />
pro<strong>du</strong>it une recombinaison dans le cas des infections<br />
provoquées par plus d’une souche. Il est aussi possible qu’il y<br />
ait recombinaison de l’ARN de souches virales animales<br />
(présentes chez les porcs, les chevaux et les oiseaux par<br />
exemple) et de l’ARN de souches virales humaines. On<br />
pense que les porcs, les canards et les poulets (mais surtout les<br />
porcs, qui peuvent être infectés à la fois par des souches virales<br />
humaines et par des souches virales aviaires) élevés dans des<br />
collectivités agricoles <strong>du</strong> sud de la Chine joueraient un rôle<br />
particulièrement important dans les mutations génétiques –<br />
d’où l’appellation «réservoir de mélange» donnée à ces animaux.<br />
<strong>Les</strong> canards sauvages et d’autres oiseaux migrateurs<br />
deviennent ainsi des porteurs asymptomatiques qui disséminent<br />
le virus dans des régions géographiques éten<strong>du</strong>es.<br />
L’épidémiologie de la grippe<br />
Entre deux grandes mutations antigéniques, il se pro<strong>du</strong>it de<br />
petits changements annuels dans la composition de l’antigène,
Tableau 24.1 Virus grippaux humains*<br />
Sous-type Importance<br />
Type antigénique Année de la maladie<br />
A<br />
B<br />
C<br />
H 3N 2 (la première pandémie<br />
« moderne », qui a débuté<br />
dans le sud de la Chine)<br />
H 1N 1 (Espagne)<br />
H 2N 2 (Asie)<br />
H 3N 2 (Hong-Kong)<br />
Aucun<br />
Aucun<br />
1889<br />
1918<br />
1957<br />
1968<br />
1940<br />
1947<br />
* Il semble acquis que les souches H 1, H 2 et H 3 sont <strong>infectieuses</strong><br />
pour les humains ; H 4 et H 5 infectent les animaux ;<br />
cependant, c’est chez le porc que l’on trouve à la fois H 4<br />
et H 5. En 1997, il y a eu une épidémie causée par H 5N 1 dans<br />
la population de poulets de Hong-Kong. On n’a observé que<br />
quelques cas mortels chez les humains, mais par mesure de<br />
prévention tous les poulets de Hong-Kong ont été détruits.<br />
SOURCE : Adapté de C. Mims et coll., Medical Microbiology,<br />
2 e éd., London, Mosby International, 1998.<br />
appelés dérives antigéniques. Par exemple, même si on<br />
désigne toujours un virus par H 3N 2, des souches reflétant de<br />
petites variations des antigènes, à l’intérieur <strong>du</strong> groupe<br />
antigénique, font leur apparition. On assigne parfois à ces<br />
souches virales un nom relié au lieu où elles ont été découvertes.<br />
En général, elles présentent uniquement une altération<br />
d’un seul acide aminé de la composition protéinique<br />
des spicules H ou N. Une mutation simple, mineure, de ce<br />
type constitue probablement une réaction à une pression<br />
sélective exercée par les anticorps (habituellement des anticorps<br />
IgA localisés dans les muqueuses), qui neutralisent<br />
tous les virus sauf ceux qui présentent la dernière mutation.<br />
On peut s’attendre à ce qu’une dérive antigénique survienne<br />
lors de une multiplication <strong>du</strong> virus sur un million. Un taux<br />
élevé de mutations est une caractéristique des virus à ARN,<br />
qui n’ont pas la même capacité de «correction d’épreuve»<br />
que les virus à ADN.<br />
Lorsqu’une dérive antigénique a lieu, un vaccin efficace<br />
par exemple contre H 3 sera désormais moins efficace contre<br />
les isolats de cette souche en circulation 10 ans après la variation.<br />
Le changement aura alors été assez important pour que<br />
le virus échappe en grande partie à l’action des anticorps<br />
pro<strong>du</strong>its en réaction à la souche originale.<br />
On classe également les virus grippaux en trois grands<br />
groupes, A, B et (parfois) C, selon les antigènes contenus<br />
dans leur capside. <strong>Les</strong> virus <strong>du</strong> type A, les plus virulents, sont<br />
responsables de la majorité des principales pandémies; les<br />
virus <strong>du</strong> type B sont aussi en circulation et ils subissent des<br />
mutations, mais ils provoquent généralement des infections<br />
moins éten<strong>du</strong>es sur le plan géographique et plus légères.<br />
CHAPITRE 24 <strong>Les</strong> <strong>maladies</strong> <strong>infectieuses</strong> <strong>du</strong> <strong>système</strong> <strong>respiratoire</strong> 21<br />
Moyenne<br />
Grave<br />
Grave<br />
Moyenne<br />
Moyenne<br />
Très faible<br />
On n’a pas encore réussi à élaborer un vaccin antigrippal<br />
qui procure une immunité <strong>du</strong>rable à l’ensemble de la population.<br />
Il est facile de mettre au point un vaccin contre une<br />
souche antigénique donnée <strong>du</strong> virus, mais chaque nouvelle<br />
souche qui entre en circulation doit être déterminée rapidement,<br />
soit vers le mois de février, pour qu’on soit en mesure<br />
de créer et de distribuer un vaccin avant la fin de l’année.Des<br />
représentants des CDC ont enseigné à des travailleurs médicaux<br />
de Chine continentale les techniques servant à détecter<br />
les variations antigéniques <strong>du</strong> virus grippal. En recueillant<br />
des informations en Chine, au Japon et à Taïwan, on se rend<br />
compte plus rapidement de l’apparition d’un nouveau type<br />
de virus. Cela accroît généralement les chances d’élaborer<br />
un vaccin annuel qui s’attaque aux types antigéniques les<br />
plus courants. À moins qu’il n’existe une souche particulièrement<br />
virulente, on n’administre habituellement le vaccin<br />
qu’aux personnes âgées, au personnel hospitalier et à d’autres<br />
groupes à risque élevé. La majorité des vaccins sont polyvalents,<br />
c’est-à-dire qu’ils peuvent combattre plusieurs souches<br />
en circulation au même moment. À l’heure actuelle, les<br />
virus grippaux utilisés pour la fabrication de vaccins sont<br />
cultivés dans des œufs embryonnés. L’efficacité des vaccins<br />
est en général de 70 à 90 %, mais la protection ne <strong>du</strong>re<br />
probablement pas plus de 3 ans pour les souches visées. On<br />
élabore en ce moment de nouveaux types de vaccins antigrippaux;<br />
on devrait bientôt approuver l’emploi d’un vaccin,<br />
administré sous forme d’aérosol nasal. On effectue également<br />
des essais avec des vaccins dont les virus sont obtenus<br />
dans des cultures cellulaires. L’approbation de ces vaccins<br />
mettrait fin à l’engorgement de la pro<strong>du</strong>ction et éliminerait<br />
le risque de réaction allergique associé aux virus cultivés<br />
dans des œufs.<br />
Presque chaque année, notamment aux mois de novembre<br />
et mars, des épidémies de grippe s’étendent rapidement à<br />
des populations de grande taille. La maladie se transmet par<br />
contact direct avec des gouttelettes projetées dans l’air<br />
lors d’éternuements ou de toux ; à partir d’objets contaminés;<br />
et par autocontamination par des mains contaminées.<br />
Le virus peut survivre près de 48 heures sur les objets<br />
inanimés, quelques heures dans des sécrétions séchées et<br />
quelques minutes sur la peau. Ainsi, la transmission est si<br />
facile que des épidémies se pro<strong>du</strong>isent dès l’apparition d’une<br />
souche modifiée. Le taux de mortalité n’est pas élevé –<br />
généralement moins de 1% – et les décès surviennent le plus<br />
souvent chez les très jeunes enfants ou les personnes très<br />
âgées. Cependant, le nombre de personnes infectées lors<br />
d’une grande épidémie est tellement important que le<br />
nombre total de décès est souvent considérable. Habituellement,<br />
la cause des décès n’est pas la grippe elle-même,<br />
mais une surinfection bactérienne. La bactérie H. influenzæ<br />
doit son nom au fait qu’on a cru à tort qu’elle était le<br />
principal agent causal de la grippe, et non un germe responsable<br />
d’une infection secondaire. S. aureus et S. pneumoniæ<br />
sont deux autres germes d’infections secondaires<br />
importants.
22 QUATRIÈME PARTIE <strong>Les</strong> microorganismes et les <strong>maladies</strong> humaines<br />
Lorsqu’il est question de la grippe, on ne peut passer<br />
sous silence la grande pandémie de 1918-1919 * ,qui a entraîné<br />
la mort de plus de 20 millions de personnes à l’échelle mondiale.<br />
On ne sait pas exactement pourquoi le nombre de<br />
décès a été aussi élevé.Aujourd’hui, la majorité des victimes<br />
sont de très jeunes enfants ou des personnes très âgées mais,<br />
en 1918-1919, le taux de mortalité a été particulièrement<br />
élevé chez les jeunes a<strong>du</strong>ltes, qui mouraient souvent en quelques<br />
heures. L’infection, qui se limite d’ordinaire aux voies<br />
<strong>respiratoire</strong>s supérieures,envahissait les poumons et causait une<br />
pneumonie virale, en raison d’une modification particulière<br />
de la virulence.<br />
Des données indiquent que le virus infectait aussi des<br />
cellules de divers organes <strong>du</strong> corps. Aujourd’hui encore, on<br />
tente de déterminer les particularités génétiques <strong>du</strong> virus<br />
responsable qui expliqueraient sa pathogénicité. On a ainsi<br />
effectué des analyses à l’aide de l’amplification en chaîne par<br />
polymérase sur des tissus prélevés sur des victimes de 1918,<br />
et même sur des cadavres exhumés de tombes situées dans<br />
des zones de l’Arctique où le sol est gelé en permanence.<br />
La grippe s’accompagne fréquemment de complications<br />
bactériennes qui, avant l’avènement des antibiotiques, étaient<br />
souvent mortelles. La souche virale de 1918 est apparemment<br />
devenue endémique chez une population de porcs aux<br />
États-Unis, où elle avait peut-être pris naissance. La grippe<br />
se propage encore parfois aux humains à partir de ce type de<br />
réservoir, mais elle ne s’est jamais disséminée autant que<br />
l’infection virulente de 1918.<br />
Deux médicaments antiviraux, l’amantadine et la rimantadine,ré<strong>du</strong>isent<br />
sensiblement les symptômes de la grippe de<br />
type A s’ils sont administrés rapidement. Deux autres médicaments,<br />
mis sur le marché récemment, sont des inhibiteurs<br />
de la neuraminidase, que le virus utilise pour se séparer de la<br />
cellule hôte après la repro<strong>du</strong>ction. Ce sont le zanamivir<br />
(Relenza MD ), qui doit être inhalé, et le phosphate d’oseltamivir<br />
(Tamiflu MD ), administré oralement. Si on prend ces<br />
médicaments moins de 30 heures après le début de la grippe,<br />
les symptômes <strong>du</strong>rent moins longtemps,mais ni l’un ni l’autre<br />
ne peut remplacer le vaccin. <strong>Les</strong> complications bactériennes<br />
de la grippe peuvent faire l’objet d’une antibiothérapie.<br />
L’identification sérologique complète d’isolats de virus<br />
grippaux est généralement effectuée par les grands laboratoires.<br />
On élabore à l’heure actuelle des tests diagnostiques<br />
* Il est probable que l’on ne pourra jamais déterminer de façon certaine<br />
l’origine de cette célèbre pandémie; cependant, selon les données les<br />
plus fiables, les premiers cas bien documentés auraient été observés<br />
parmi les recrues des forces armées américaines de Camp Funston, au<br />
Kansas, en mars 1918. L’infection se serait ensuite répan<strong>du</strong>e rapidement<br />
chez les militaires, jusque sur le front occidental en France, où des<br />
troupes avaient été dépêchées. La censure militaire a interdit la révélation<br />
<strong>du</strong> fait que les troupes, de part et d’autre <strong>du</strong> front, étaient dans<br />
l’incapacité de combattre; les premières descriptions de la situation<br />
parurent dans les journaux lorsque l’épidémie avait déjà atteint<br />
l’Espagne, d’où l’appellation de «grippe espagnole » fréquemment<br />
utilisée pour désigner la pandémie.<br />
dont les résultats devraient être disponibles en moins d’une<br />
heure, dans le cabinet même <strong>du</strong> médecin.<br />
<strong>Les</strong> mycoses des voies<br />
<strong>respiratoire</strong>s inférieures<br />
Objectifs d’apprentissage<br />
■ Décrire l’épidémiologie de trois mycoses <strong>du</strong> <strong>système</strong><br />
<strong>respiratoire</strong>, et notamment la virulence des agents pathogènes<br />
en cause, leurs réservoirs, leurs modes de transmission,<br />
ainsi que les facteurs prédisposants de l’hôte réceptif.<br />
■ Relier pour la coccidioidomycose et la pneumonie à<br />
Pneumocystis les dommages physiopathologiques et les<br />
symptômes de l’infection au pouvoir pathogène des mycètes<br />
en cause.<br />
De nombreux mycètes pro<strong>du</strong>isent des spores qui se disséminent<br />
dans l’air. Il n’est donc pas étonnant que plusieurs<br />
mycoses graves touchent les voies <strong>respiratoire</strong>s inférieures.<br />
Le taux des infections fongiques a augmenté au cours des<br />
dernières années. <strong>Les</strong> mycètes opportunistes sont capables<br />
de se développer chez les personnes immunodéprimées,<br />
dont le nombre s’est considérablement accru depuis l’apparition<br />
<strong>du</strong> SIDA et la mise sur le marché d’anticancéreux et<br />
de médicaments destinés aux receveurs d’une greffe.<br />
L’histoplasmose<br />
L’histoplasmose ressemble à première vue à la tuberculose.<br />
En fait, on a découvert que cette maladie était plus fréquente<br />
qu’on ne le croyait lorsque des séries de radiographies<br />
pulmonaires ont révélé la présence de lésions chez bon<br />
nombre de personnes dont les tests à la tuberculine étaient<br />
négatifs.<br />
La maladie est fréquemment asymptomatique. S’il y a<br />
des symptômes, ils sont généralement mal définis et souvent<br />
subcliniques, de sorte que la maladie est prise pour une<br />
infection bénigne des voies <strong>respiratoire</strong>s. Toutefois, cette<br />
primo-infection entraîne une hypersensibilité chez la personne<br />
qui peut être mise en évidence par un test d’intradermoréaction<br />
à l’histoplasmine. Dans quelques cas, variant de<br />
5 à 0,1% selon les régions, l’histoplasmose évolue vers une<br />
maladie systémique grave. Le plus souvent, l’infection atteint<br />
d’abord les poumons, puis les agents pathogènes peuvent se<br />
répandre dans le sang et la lymphe, et causer ainsi des lésions<br />
dans presque tous les organes <strong>du</strong> corps. Cela se pro<strong>du</strong>it<br />
lorsque l’inoculum est exceptionnellement important ou<br />
lors de la réactivation de l’infection, chez un sujet dont le<br />
<strong>système</strong> immunitaire est affaibli (par le SIDA, par exemple)<br />
ou chez un sujet présentant une anomalie structurale ou<br />
fonctionnelle de son <strong>système</strong> <strong>respiratoire</strong>. Dans ces deux<br />
derniers cas, l’infection est opportuniste.
L’agent responsable, Histoplasma capsulatum, est un mycète<br />
dimorphe, c’est-à-dire qu’il présente une morphologie levuriforme<br />
lorsqu’il se développe dans les tissus (figure 24.18a),<br />
tandis que dans le sol ou sur un milieu de culture artificiel<br />
il pro<strong>du</strong>it un mycélium filamenteux porteur de conidies<br />
repro<strong>du</strong>ctrices (figure 24.18b). Dans l’organisme humain,<br />
l’agent levuriforme réside dans des macrophagocytes, où il<br />
survit et se repro<strong>du</strong>it.<br />
Bien que l’histoplasmose soit répan<strong>du</strong>e à l’échelle mondiale,<br />
on l’observe, en Amérique <strong>du</strong> Nord, en particulier dans<br />
une région bien délimitée des États-Unis (figure 24.19). En<br />
général,elle est présente dans les États riverains <strong>du</strong> Mississippi<br />
et de la rivière Ohio. Plus de 75% de la population de certains<br />
de ces États possède des anticorps contre l’infection,<br />
alors qu’ailleurs, par exemple dans le nord-est, il est rare<br />
qu’un test soit positif. Dans l’ensemble des États-Unis, on<br />
dénombre annuellement une cinquantaine de décès <strong>du</strong>s à<br />
H. capsulatum<br />
levuriforme<br />
a) Morphologie levuriforme caractéristique<br />
de la croissance dans un tissu, à 37 °C. Notez<br />
la présence d’une cellule bourgeonnante<br />
à proximité <strong>du</strong> centre.<br />
b) Forme filamenteuse, pro<strong>du</strong>ctrice de spores,<br />
présente dans le sol à des températures inférieures<br />
à 35 °C ; les particules <strong>infectieuses</strong><br />
sont généralement des spores.<br />
FIGURE 24.18 Histoplasma capsulatum, mycète dimorphe<br />
responsable de l’histoplasmose.<br />
■ Que signifie le terme dimorphe ?<br />
MO<br />
MO<br />
CHAPITRE 24 <strong>Les</strong> <strong>maladies</strong> <strong>infectieuses</strong> <strong>du</strong> <strong>système</strong> <strong>respiratoire</strong> 23<br />
5 mm<br />
50 mm<br />
FIGURE 24.19 Distribution des cas d’histoplasmose aux États-<br />
Unis. <strong>Les</strong> régions en jaune sont celles où la maladie est présente.<br />
■ L’histoplasmose est une mycose systémique.<br />
l’histoplasmose. Au Québec, on a signalé quelques cas dans<br />
la région de Montréal et dans la vallée <strong>du</strong> Saint-Laurent.<br />
<strong>Les</strong> humains contractent la maladie en inhalant des<br />
poussières riches en spores, pro<strong>du</strong>ites dans des conditions<br />
propices d’humidité et de pH, qu’on rencontre principalement<br />
dans les endroits riches en accumulations d’excréments<br />
d’oiseaux ou de chauves-souris, tels que les fermes et<br />
les grottes. <strong>Les</strong> oiseaux ne sont pas eux-mêmes porteurs de<br />
la maladie parce que leur température corporelle est relativement<br />
élevée, mais les fientes contiennent des nutriments<br />
et constituent notamment une source d’azote pour le mycète.<br />
La température des chauves-souris est plus faible que celle<br />
des oiseaux, et ces animaux sont porteurs <strong>du</strong> mycète, qu’ils<br />
excrètent dans leurs fèces, contaminant ainsi de nouvelles<br />
portions de sol.<br />
<strong>Les</strong> signes cliniques et les antécédents <strong>du</strong> patient, des<br />
tests sérologiques, des sondes d’ADN et, surtout, l’isolement<br />
de l’agent pathogène ou son identification dans des prélèvements<br />
tissulaires sont indispensables pour établir un diagnostic<br />
exact.La chimiothérapie la plus efficace à l’heure actuelle est<br />
l’administration d’amphotéricine B ou d’itraconazole.<br />
La coccidioïdomycose<br />
La coccidioïdomycose est aussi une mycose pulmonaire,<br />
mais sa distribution est relativement limitée. L’agent causal,<br />
Coccidioides immitis, est un mycète dimorphe. On rencontre<br />
des conidies (spores) dans les régions semi-désertiques telles<br />
que les sols alcalins secs <strong>du</strong> sud-ouest des États-Unis (Texas,<br />
Californie et Arizona) et dans des sols <strong>du</strong> même type<br />
<strong>du</strong> nord <strong>du</strong> Mexique et d’Amérique centrale ou <strong>du</strong> Sud.<br />
Étant donné que la maladie est fréquente dans la vallée <strong>du</strong><br />
San Joaquin, en Californie, elle est parfois appelée fièvre <strong>du</strong><br />
désert ou fièvre de San Joaquin. Dans les tissus, le microorganisme<br />
forme des granulomes à paroi épaisse, remplis de<br />
spores, appelés sphérules ou sporanges (figure 24.20). Dans le
24 QUATRIÈME PARTIE <strong>Les</strong> microorganismes et les <strong>maladies</strong> humaines<br />
sol, il pro<strong>du</strong>it des filaments qui se repro<strong>du</strong>isent par la formation<br />
d’arthroconidies qui, transportées par le vent, transmettent<br />
l’infection. Il existe souvent une telle abondance<br />
d’arthroconidies qu’une personne peut contracter la maladie<br />
simplement en con<strong>du</strong>isant son véhicule dans une région<br />
endémique, surtout s’il y a des tourbillons de poussière.<br />
Ainsi, on a observé une augmentation de l’incidence de la<br />
maladie après un tremblement de terre.<br />
La majorité des infections ne sont pas apparentes, et<br />
presque toutes les victimes guérissent en quelques semaines,<br />
même si elles ne sont pas traitées. <strong>Les</strong> symptômes de la coccidioïdomycose<br />
comprennent des douleurs musculaires et<br />
parfois de la fièvre, de la toux, des infiltrats pulmonaires et<br />
une perte de poids. Dans moins de 1% des cas, une maladie<br />
évolutive semblable à la tuberculose s’étend à tout l’organisme<br />
humain. Dans cette forme plus sévère de la maladie, il<br />
apparaît des no<strong>du</strong>les dans les poumons et parfois,dans d’autres<br />
organes; ces no<strong>du</strong>les sont souvent confon<strong>du</strong>s avec des cancers<br />
pulmonaires. Chez une bonne proportion des a<strong>du</strong>ltes<br />
habitant depuis longtemps dans une zone où l’infection est<br />
endémique, le test cutané démontre l’existence d’une infection<br />
à C. immitis antérieure.<br />
La coccidioïdomycose ressemble tellement à la tuberculose<br />
qu’il est nécessaire d’isoler l’agent pathogène pour établir<br />
un diagnostic exact. La méthode la plus fiable consiste<br />
à déterminer la présence de sphérules dans des tissus ou des<br />
liquides. On peut mettre en culture le mycète prélevé dans<br />
un liquide ou une lésion, mais les employés de laboratoire<br />
doivent prendre bien soin de ne pas inhaler d’aérosols infectieux.<br />
Il existe plusieurs tests sérologiques et sondes d’ADN<br />
permettant d’identifier les isolats. Un test cutané à la tuberculine<br />
sert à éliminer la possibilité d’un cas de tuberculose.<br />
L’infection atteint particulièrement les hommes a<strong>du</strong>ltes;<br />
des facteurs hormonaux seraient en cause. L’incidence de la<br />
coccidioïdomycose a augmenté récemment en Californie et<br />
FIGURE 24.20 Le cycle de vie<br />
de Coccidioides immitis, agent<br />
causal de la coccidioïdomycose.<br />
■ <strong>Les</strong> arthroconidies se<br />
trouvent dans le sol et<br />
la poussière des régions<br />
semi-désertiques.<br />
2<br />
<strong>Les</strong> arthroconidies<br />
se séparent de<br />
l’hyphe.<br />
L’hyphe<br />
commence à<br />
se segmenter<br />
en arthroconidies.<br />
Hyphe<br />
tubulaire<br />
3<br />
Des arthroconidies<br />
se propagent<br />
dans l’air.<br />
1<br />
en Arizona. <strong>Les</strong> facteurs favorisants comprennent la croissance<br />
<strong>du</strong> nombre de résidents âgés et de personnes porteuses<br />
<strong>du</strong> VIH ou atteintes <strong>du</strong> SIDA, de même que la période de<br />
grande sécheresse, qui a facilité la transmission par les poussières.Aux<br />
États-Unis, on estime que le nombre d’infections<br />
est de 100 000 par année et on dénombre annuellement de<br />
50 à 100 décès <strong>du</strong>s à la maladie.<br />
On utilise l’amphotéricine B pour traiter les cas graves.<br />
Cependant, des médicaments imidazolés moins toxiques,<br />
dont le kétoconazole et l’itraconazole, sont des substances<br />
de remplacement utiles.<br />
La pneumonie à Pneumocystis<br />
La pneumonie à Pneumocystis est causée par Pneumocystis<br />
carinii (figure 24.21). La classification taxinomique de ce<br />
microbe prête à controverse depuis sa découverte en 1909.<br />
On a d’abord pensé qu’il s’agissait d’un trypanosome à un<br />
stade non mature, mais on n’est jamais arrivé à déterminer<br />
de façon certaine s’il est un protozoaire ou un mycète, car il<br />
présente des caractéristiques des deux types de microorganismes.<br />
Des analyses récentes de l’ARN et d’autres propriétés<br />
structurales indiquent qu’il est étroitement apparenté à<br />
certaines levures.<br />
La pneumonie à Pneumocystis sévit dans toutes les<br />
régions <strong>du</strong> globe, et elle est parfois endémique en milieu<br />
hospitalier. L’agent pathogène est normalement présent dans<br />
les poumons d’a<strong>du</strong>ltes sains, mais il déclenche une infection<br />
opportuniste chez les patients immunodéprimés. Ce groupe<br />
comprend les personnes qui reçoivent des médicaments<br />
immunodépresseurs, destinés à ré<strong>du</strong>ire au minimum le risque<br />
de rejet de tissus greffés, et celles dont le <strong>système</strong> immunitaire<br />
est affaibli par le cancer. <strong>Les</strong> patients atteints <strong>du</strong> SIDA<br />
sont également très sensibles à P. carinii, sans doute à cause de<br />
la réactivation d’une infection asymptomatique.<br />
Une arthroconidie aéroportée<br />
est inhalée.<br />
Une partie des<br />
arthroconidies<br />
retournent<br />
dans le sol<br />
<strong>Les</strong> endospores<br />
libérées se<br />
disséminent<br />
dans le tissu<br />
et chacune<br />
se transforme<br />
en une<br />
nouvelle<br />
sphérule<br />
Sol Humain<br />
Une arthroconidie (d’environ 5 mm de<br />
longueur) germe dans un hyphe tubulaire.<br />
4<br />
L’ arthroconidie inhalée grossit<br />
et commence à se transformer<br />
en sphérule.<br />
6<br />
Sphérule (diamètre<br />
d’environ 30 mm)<br />
dans un tissu<br />
5<br />
<strong>Les</strong> endospores<br />
se développent<br />
dans la sphérule.<br />
La sphérule libère<br />
des endospores.
5<br />
Chaque trophozoïte se<br />
transforme en kyste mature.<br />
Avant le début de l’épidémie de SIDA, la pneumonie à<br />
Pneumocystis était une maladie rare; on en dénombrait peutêtre<br />
une centaine de cas par année. En 1993, la maladie a été<br />
un indicateur <strong>du</strong> SIDA dans plus de 20 000 cas.<br />
Dans les poumons d’un humain, les mycètes résident<br />
principalement dans la paroi des alvéoles. Ils y forment un<br />
kyste à paroi épaisse, dans lequel des corps intrakystiques<br />
sphériques se divisent successivement <strong>du</strong>rant le cycle de repro<strong>du</strong>ction<br />
sexuée (figure 24.21). 1 Le kyste mature contient<br />
huit corps intrakystiques, 2 qu’il finit par libérer en se rompant.<br />
3 Chaque corps intrakystique se transforme alors en<br />
trophozoïte. 4 – 5 <strong>Les</strong> cellules trophozoïtes peuvent se<br />
repro<strong>du</strong>ire de façon asexuée,par scissiparité,mais elles peuvent<br />
aussi passer au stade sexué à l’intérieur <strong>du</strong> kyste (figure 24.22).<br />
La repro<strong>du</strong>ction de P. carinii entraîne donc des lésions tissulaires<br />
qui perturbent le fonctionnement des poumons.<br />
À l’heure actuelle,le médicament de choix est un composé<br />
de deux antibiotiques agissant en synergie, le triméthoprimesulfaméthoxazole<br />
(Bactrim MD ), mais on le remplace souvent<br />
par l’iséthionate de pentamidine.<br />
La blastomycose (nord-américaine)<br />
La blastomycose est une maladie surtout nord-américaine<br />
qui sévit notamment aux États-Unis dans la vallée <strong>du</strong> Mississippi<br />
et de l’Ohio; au Canada, on la retrouve dans le sud de<br />
l’Ontario et de l’Alberta ainsi que dans la vallée <strong>du</strong> Saint-<br />
Laurent au Québec. Le microorganisme se développe probablement<br />
dans le sol lorsque ce dernier est riche en matières<br />
organiques. La maladie est provoquée par Blastomyces dermatitidis,<br />
un mycète dimorphe existant sous forme de levure<br />
dans les tissus des êtres humains et animaux à sang chaud et<br />
1<br />
4 <strong>Les</strong> trophozoïtes<br />
se divisent.<br />
CHAPITRE 24 <strong>Les</strong> <strong>maladies</strong> <strong>infectieuses</strong> <strong>du</strong> <strong>système</strong> <strong>respiratoire</strong> 25<br />
Le kyste mature contient huit corps<br />
intrakystiques.<br />
Corps<br />
intrakystiques<br />
3<br />
Kyste<br />
<strong>Les</strong> corps intrakystiques<br />
se transforment en trophozoïtes.<br />
2 En se rompant,<br />
le kyste libère les<br />
corps qu’il contient.<br />
Trophozoïte<br />
FIGURE 24.21 Le cycle<br />
de vie de Pneumocystis<br />
carinii, agent causal<br />
de la pneumonie à<br />
Pneumocystis. Longtemps<br />
classé parmi les protozoaires,<br />
Pneumocystis carinii<br />
est maintenant considéré<br />
le plus souvent comme<br />
un mycète, mais il possède<br />
des caractéristiques des<br />
deux types de microorganismes.<br />
■ Pneumocystis<br />
carinii est un<br />
agent opportuniste<br />
qui affecte<br />
particulièrement<br />
les personnes<br />
atteintes <strong>du</strong> SIDA.<br />
Kystes<br />
MEB<br />
FIGURE 24.22 Pneumocystis carinii. P. carinii au stade kystique,<br />
dans une alvéole d’un poumon de singe.<br />
5 mm<br />
sous forme filamenteuse dans le sol ; il survit aussi sous<br />
forme de conidies dans le sol. On dénombre annuellement<br />
aux États-Unis de 30 à 60 décès consécutifs à une infection<br />
disséminée, mais la majorité des cas sont asymptomatiques.<br />
La transmission se fait par inhalation <strong>du</strong> mycète ou par<br />
son intro<strong>du</strong>ction dans le corps à la suite d’un traumatisme<br />
cutané. L’infection, qui touche d’abord les poumons, peut se<br />
répandre rapidement et entraîner des lésions secondaires.<br />
On observe fréquemment des ulcères cutanés, la formation<br />
d’abcès éten<strong>du</strong>s et la destruction de tissus. L’atteinte cutanée
26 QUATRIÈME PARTIE <strong>Les</strong> microorganismes et les <strong>maladies</strong> humaines<br />
peut aussi être l’unique manifestation de la maladie en<br />
particulier chez les indivi<strong>du</strong>s dont le <strong>système</strong> immunitaire<br />
est affaibli par un diabète ou le SIDA. L’agent pathogène<br />
peut être isolé d’un échantillon de pus ou d’un prélèvement<br />
par biopsie. L’amphotéricine B constitue généralement un<br />
traitement efficace.<br />
Autres mycètes associés<br />
à des <strong>maladies</strong> <strong>respiratoire</strong>s<br />
Plusieurs autres mycètes opportunistes sont susceptibles<br />
de causer des <strong>maladies</strong> <strong>respiratoire</strong>s, en particulier chez les<br />
personnes immunodéprimées ou atteintes de <strong>maladies</strong> chroniques<br />
(cancer, diabète par exemple) ou en contact avec un<br />
nombre considérable de spores. L’aspergillose est une infection<br />
importante de ce type, qui se transmet par les spores<br />
d’Aspergillus fumigatus et d’autres espèces <strong>du</strong> genre Aspergillus<br />
souvent présentes dans la végétation en putréfaction.Asper-<br />
Tableau 24.2 Maladies <strong>infectieuses</strong> <strong>du</strong> <strong>système</strong> <strong>respiratoire</strong><br />
Maladie Agents pathogènes Remarques<br />
Bactérioses des voies <strong>respiratoire</strong>s supérieures<br />
Pharyngite (ou<br />
angine) streptococcique<br />
Scarlatine<br />
Diphtérie<br />
Otite moyenne<br />
Viroses des voies <strong>respiratoire</strong>s supérieures<br />
Rhume<br />
Coronavirus et Rhinovirus<br />
Bactérioses des voies <strong>respiratoire</strong>s inférieures<br />
Coqueluche<br />
Bordetella pertussis<br />
Tuberculose<br />
Pneumonie à<br />
pneumocoques<br />
Pneumonie à<br />
Hæmophilus influenzæ<br />
Pneumonie<br />
à mycoplasmes<br />
Streptocoques, en particulier<br />
Streptococcus pyogenes<br />
Souches de Streptococcus pyogenes<br />
pro<strong>du</strong>ctrices d’une toxine érythrogène<br />
Corynebacterium diphteriæ<br />
Diverses bactéries, en particulier<br />
Staphylococcus aureus, Streptococcus<br />
pneumoniæ et Hæmophilus influenzæ<br />
Mycobacterium tuberculosis<br />
Mycobacterium bovis<br />
Streptococcus pneumoniæ<br />
Hæmophilus influenzæ<br />
sérotype b<br />
Mycoplasma pneumoniæ<br />
gillus flavus,une moisissure des céréales,des arachides,secrète<br />
une aflatoxine qui a des effets mutagènes (chapitre 8, p. 251).<br />
Le compost constitue un milieu propice à la croissance de<br />
ces mycètes, de sorte que les agriculteurs et les jardiniers<br />
sont fréquemment en contact avec une quantité infectieuse<br />
de ce type de spores.<br />
Des personnes contractent des infections pulmonaires<br />
similaires lorsqu’elles sont exposées à des spores de moisissures<br />
de genres différents, tels que Rhizopus et Mucor. Certaines<br />
de ces <strong>maladies</strong> sont très dangereuses, en particulier les aspergilloses<br />
pulmonaires envahissantes. <strong>Les</strong> facteurs prédisposants<br />
comprennent un affaiblissement <strong>du</strong> <strong>système</strong> immunitaire, le<br />
cancer et le diabète. Comme pour la majorité des infections<br />
fongiques systémiques, il existe peu d’agents antifongiques<br />
efficaces; il semble que l’amphotéricine B soit le plus utile.<br />
* * *<br />
Le tableau 24.2 présente une récapitulation des <strong>maladies</strong><br />
<strong>respiratoire</strong>s <strong>infectieuses</strong> décrites dans le présent chapitre.<br />
Inflammation des muqueuses de la gorge.<br />
L’exotoxine streptococcique provoque des rougeurs sur la peau<br />
et la langue, et la desquamation de la peau touchée.<br />
L’exotoxine bactérienne perturbe la synthèse des protéines et<br />
cause des dommages au cœur, aux reins et à d’autres organes ;<br />
formation d’une membrane dans la gorge ; il existe une forme<br />
cutanée de la maladie.<br />
L’accumulation de pus dans l’oreille moyenne se tra<strong>du</strong>it par<br />
une pression accrue sur la membrane <strong>du</strong> tympan, qui cause des<br />
douleurs.<br />
Symptômes familiers : toux, éternuements et écoulement nasal.<br />
<strong>Les</strong> cils des voies <strong>respiratoire</strong>s supérieures sont inactivés ; le<br />
mucus s’accumule et les tentatives pour l’expulser provoquent<br />
une forte toux spasmodique.<br />
<strong>Les</strong> bacilles tuberculeux qui entrent dans les poumons survivent<br />
à la phagocytose et se repro<strong>du</strong>isent dans des macrophagocytes ;<br />
formation de tubercules visant à isoler les agents pathogènes ;<br />
les défenses finissent par être vaincues et l’infection devient<br />
systémique.<br />
<strong>Les</strong> alvéoles pulmonaires infectées se remplissent de liquide, ce<br />
qui perturbe les échanges gazeux.<br />
Symptômes ressemblant à ceux de la pneumonie à<br />
pneumocoques.<br />
Symptômes <strong>respiratoire</strong>s légers mais <strong>du</strong>rables ; fièvre peu élevée,<br />
toux et maux de tête.
Tableau 24.2 (suite)<br />
Maladie Agents pathogènes Remarques<br />
Légionellose<br />
Psittacose (ornithose)<br />
Pneumonie à Chlamydia<br />
Fièvre Q<br />
Viroses des voies <strong>respiratoire</strong>s inférieures<br />
Maladie à virus respi- Virus <strong>respiratoire</strong> syncytial<br />
ratoire syncytial (VRS)<br />
Grippe<br />
Mycoses des voies <strong>respiratoire</strong>s inférieures<br />
Histoplasmose<br />
Histoplasma capsulatum<br />
Coccidioïdomycose<br />
Pneumonie<br />
à Pneumocystis<br />
Blastomycose<br />
Legionella pneumophila<br />
Chlamydia psittaci<br />
Chlamydia pneumoniæ<br />
Coxiella burnetii<br />
Influenzavirus ; plusieurs sérotypes<br />
Coccidioides immitis<br />
Pneumocystis carinii<br />
Blastomyces dermatitidis<br />
INTRODUCTION (p. XXX)<br />
1. <strong>Les</strong> infections des voies <strong>respiratoire</strong>s supérieures sont le type<br />
d’infection le plus courant.<br />
2. <strong>Les</strong> agents pathogènes qui pénètrent dans le <strong>système</strong> <strong>respiratoire</strong><br />
sont susceptibles d’infecter d’autres parties <strong>du</strong> corps.<br />
LA STRUCTURE ET LES FONCTIONS<br />
DU SYSTÈME RESPIRATOIRE (p. XXX- XXX)<br />
1. <strong>Les</strong> voies <strong>respiratoire</strong>s supérieures comprennent le nez,<br />
le pharynx et les structures associées, telles que l’oreille<br />
moyenne et la trompe auditive.<br />
CHAPITRE 24 <strong>Les</strong> <strong>maladies</strong> <strong>infectieuses</strong> <strong>du</strong> <strong>système</strong> <strong>respiratoire</strong> 27<br />
Pneumonie potentiellement mortelle touchant particulièrement<br />
les hommes âgés qui font un usage abusif de l’alcool ou <strong>du</strong><br />
tabac. L’agent pathogène se développe notamment dans l’eau<br />
des tours de refroidissement des conditionneurs d’air.<br />
<strong>Les</strong> symptômes, s’ils sont présents, comprennent de la fièvre,<br />
des maux de tête et des frissons. Le mode de transmission<br />
le plus fréquent est le contact avec des excréments d’oiseaux.<br />
Maladie <strong>respiratoire</strong> bénigne, fréquente chez les jeunes; ressemble<br />
à la pneumonie à mycoplasmes.<br />
Maladie <strong>respiratoire</strong> bénigne qui <strong>du</strong>re de 1 à 2 semaines ;<br />
accompagnée parfois de complications telles que l’endocardite.<br />
Maladie <strong>respiratoire</strong> grave touchant les jeunes enfants.<br />
Maladie caractérisée par des frissons, de la fièvre, des maux<br />
de tête et des douleurs musculaires. Le virus change rapidement<br />
de caractéristiques antigéniques, de sorte que la guérison<br />
ne confère qu’une immunité restreinte.<br />
L’agent pathogène se développe dans le sol, en particulier<br />
dans les endroits contaminés par des excréments d’oiseaux.<br />
La maladie est très répan<strong>du</strong>e dans les vallées de l’Ohio et <strong>du</strong><br />
Mississippi ; parfois mortelle.<br />
L’agent pathogène se développe dans les sols arides <strong>du</strong> sudouest<br />
des États-Unis. L’infection, très répan<strong>du</strong>e dans cette<br />
région, est parfois mortelle.<br />
Complication fréquente et grave <strong>du</strong> SIDA ; asymptomatique<br />
chez les personnes immunocompétentes.<br />
Mycose rare mais très grave, présente dans la vallée <strong>du</strong><br />
Mississippi, où l’agent pathogène se développe dans le sol.<br />
2. <strong>Les</strong> poils rugueux <strong>du</strong> nez filtrent les grosses particules<br />
contenues dans l’air qui pénètre dans les voies <strong>respiratoire</strong>s.<br />
3. La muqueuse ciliée <strong>du</strong> nez et <strong>du</strong> pharynx emprisonne<br />
les particules dans le mucus et le mouvement des cils<br />
les élimine <strong>du</strong> corps.<br />
4. <strong>Les</strong> amygdales, qui sont composées de tissu lymphoïde,<br />
assurent l’immunité contre certaines infections.<br />
5. <strong>Les</strong> voies <strong>respiratoire</strong>s inférieures comprennent le larynx,<br />
la trachée, les bronches et les alvéoles pulmonaires.<br />
6. L’escalier mucociliaire des voies <strong>respiratoire</strong>s inférieures<br />
contribue à empêcher les microorganismes de se rendre<br />
dans les poumons.<br />
7. Le lysozyme, une enzyme présente dans les sécrétions,<br />
détruit les bactéries inhalées.<br />
8. <strong>Les</strong> microbes qui pénètrent dans les poumons peuvent<br />
être digérés par les macrophagocytes alvéolaires.<br />
9. Le mucus des voies <strong>respiratoire</strong>s contient des anticorps IgA.
28 QUATRIÈME PARTIE <strong>Les</strong> microorganismes et les <strong>maladies</strong> humaines<br />
LA FLORE NORMALE DU SYSTÈME<br />
RESPIRATOIRE (p. XXX)<br />
1. La flore normale de la cavité nasale et <strong>du</strong> pharynx exerce<br />
un effet barrière contre l’implantation de microorganismes<br />
pathogènes; toutefois, la flore transitoire est susceptible de<br />
comprendre des microorganismes pathogènes.<br />
2. <strong>Les</strong> voies <strong>respiratoire</strong>s inférieures sont habituellement stériles,<br />
grâce à l’efficacité de l’escalier mucociliaire et des anticorps<br />
de type Ig A.<br />
LES MALADIES INFECTIEUSES DES VOIES<br />
RESPIRATOIRES SUPÉRIEURES (p. XXX- XXX)<br />
1. Des zones données des voies <strong>respiratoire</strong>s supérieures sont<br />
susceptibles d’être infectées, provoquant ainsi, selon le cas,<br />
une pharyngite, une laryngite, une amygdalite, une sinusite<br />
ou une épiglottite.<br />
2. <strong>Les</strong> infections des voies <strong>respiratoire</strong>s supérieures peuvent<br />
être causées par diverses bactéries et par divers virus ou,<br />
fréquemment, par une association de ces agents pathogènes.<br />
3. La majorité des infections des voies <strong>respiratoire</strong>s supérieures<br />
sont spontanément résolutives.<br />
4. H. influenzæ type b peut provoquer une épiglottite.<br />
LES BACTÉRIOSES DES VOIES<br />
RESPIRATOIRES SUPÉRIEURES (p. XXX- XXX)<br />
La pharyngite streptococcique (p. XXX)<br />
1. La pharyngite (ou angine) streptococcique est <strong>du</strong>e à des<br />
streptocoques -hémolytiques <strong>du</strong> groupe A; ces bactéries<br />
font toutes partie de l’espèce Streptococcus pyogenes capables de<br />
résister à la phagocytose.<br />
2. <strong>Les</strong> symptômes comprennent l’inflammation des muqueuses,<br />
le gonflement des nœuds lymphatiques et de la fièvre;<br />
l’amygdalite ou l’otite moyenne constituent des complications<br />
potentielles.<br />
3. Des réactions d’agglutination indirecte permettent de poser<br />
rapidement un diagnostic préliminaire, mais seule l’observation<br />
de l’augmentation des anticorps IgM autorise l’établissement<br />
d’un diagnostic formel.<br />
4. Le médicament de choix est la pénicilline.<br />
5. L’immunité contre les infections streptococciques est spécifique<br />
<strong>du</strong> sérotype.<br />
6. La pharyngite streptococcique se transmet généralement<br />
par des gouttelettes; elle était autrefois associée à la consommation<br />
de lait non pasteurisé.<br />
La scarlatine (p. XXX- XXX)<br />
1. Si la bactérie S. pyogenes responsable de la pharyngite<br />
streptococcique élabore une toxine érythrogène, la maladie<br />
est susceptible d’évoluer vers la scarlatine.<br />
2. S. pyogenes pro<strong>du</strong>it une toxine érythrogène lorsqu’il est<br />
infecté par un phage lysogène; ce dernier intro<strong>du</strong>it alors<br />
le gène de la toxine dans la bactérie.<br />
3. La toxine érythrogène inhibe la phagocytose et la pro<strong>du</strong>ction<br />
des anticorps, affaiblissant ainsi la défense immunitaire de<br />
l’organisme.<br />
4. <strong>Les</strong> symptômes comprennent un érythème rouge rosé,<br />
une fièvre élevée et une langue dite framboisée (papilles<br />
enflammées saillantes sur un en<strong>du</strong>it rouge écarlate).<br />
La diphtérie (p. XXX- XXX)<br />
1. La diphtérie est provoquée par Corynebacterium diphteriæ,<br />
une bactérie pro<strong>du</strong>ctrice d’exotoxine.<br />
2. C. diphteriæ pro<strong>du</strong>it une exotoxine lorsqu’il est infecté<br />
par un phage lysogène; ce dernier intro<strong>du</strong>it alors le gène<br />
de la toxine dans la bactérie.<br />
3. Il se forme dans la gorge une membrane, contenant de<br />
la fibrine et des cellules humaines et bactériennes mortes,<br />
qui risque de faire obstacle au passage de l’air.<br />
4. L’exotoxine inhibe la synthèse des protéines et entraîne<br />
la mort cellulaire; il peut en résulter des dommages au cœur,<br />
aux reins et aux nerfs.<br />
5. Le diagnostic de laboratoire repose sur l’isolement de la bactérie<br />
et sur la culture sur des milieux différentiels et sélectifs.<br />
6. Il faut administrer une antitoxine pour neutraliser la toxine;<br />
les antibiotiques inhibent la croissance des bactéries.<br />
7. En Amérique <strong>du</strong> Nord, le programme de vaccination<br />
comprend le vaccin DCT qui contient l’anatoxine diphtérique.<br />
8. La diphtérie cutanée est caractérisée par l’apparition d’ulcères<br />
à cicatrisation lente.<br />
9. Dans la diphtérie cutanée, l’exotoxine est faiblement disséminée<br />
dans la circulation sanguine.<br />
L’otite moyenne (p. XXX)<br />
1. L’otite moyenne est une complication potentielle des infections<br />
<strong>du</strong> nez et <strong>du</strong> pharynx.<br />
2. L’accumulation de pus entraîne une augmentation<br />
de la pression sur la membrane <strong>du</strong> tympan.<br />
3. <strong>Les</strong> agents pathogènes bactériens comprennent Streptococcus<br />
pneumoniæ, Hæmophilus influenzæ non encapsulé, Moraxella<br />
catarrhalis, Streptococcus pyogenes et Staphylococcus aureus.<br />
LES VIROSES DES VOIES RESPIRATOIRES<br />
SUPÉRIEURES (p. XXX)<br />
Le rhume (p. XXX)<br />
1. On connaît près de 200 virus différents susceptibles de<br />
causer le rhume; les Rhinovirus sont responsables d’environ<br />
50% des cas.<br />
2. <strong>Les</strong> symptômes comprennent des éternuements,<br />
un écoulement nasal et de la congestion.<br />
3. La sinusite, les infections des voies <strong>respiratoire</strong>s inférieures,<br />
la laryngite et l’otite moyenne sont des complications potentielles<br />
<strong>du</strong> rhume.<br />
4. Le rhume se transmet par contact indirect, par contact direct<br />
et par voie aérienne.<br />
5. La température optimale de réplication des Rhinovirus est<br />
légèrement inférieure à la température <strong>du</strong> corps, d’où leur<br />
préférence pour les voies <strong>respiratoire</strong>s supérieures.<br />
6. L’incidence <strong>du</strong> rhume augmente par temps froid, peut-être<br />
parce que les gens passent davantage de temps à l’intérieur<br />
des bâtisses et s’y côtoient davantage, peut-être parce<br />
que l’air environnant est plus sec à cause <strong>du</strong> chauffage,
peut-être encore à cause de changements physiologiques<br />
chez l’humain.<br />
7. Il y a pro<strong>du</strong>ction d’anticorps spécifiques des virus responsables.<br />
8. Le rhume est une infection courante à tout âge,<br />
particulièrement chez les jeunes enfants.<br />
LES MALADIES INFECTIEUSES DES VOIES<br />
RESPIRATOIRES INFÉRIEURES (P. XXX)<br />
1. Beaucoup des microorganismes qui infectent les voies<br />
<strong>respiratoire</strong>s supérieures infectent aussi les voies <strong>respiratoire</strong>s<br />
inférieures.<br />
2. <strong>Les</strong> infections des voies <strong>respiratoire</strong>s inférieures comprennent<br />
la bronchite et la pneumonie.<br />
LES BACTÉRIOSES DES VOIES<br />
RESPIRATOIRES INFÉRIEURES (p. XXX- XXX)<br />
La coqueluche (p. XXX)<br />
1. La coqueluche est causée par la bactérie Bordetella pertussis.<br />
Cette maladie touche surtout les enfants.<br />
2. B. pertussis pro<strong>du</strong>it plusieurs toxines, dont la cytotoxine<br />
trachéale, qui est responsable des dommages causés aux<br />
cellules ciliées, et la toxine coquelucheuse, qui est associée<br />
aux symptômes systémiques de la maladie.<br />
3. Le stade initial de la coqueluche ressemble à un rhume;<br />
on l’appelle stade catarrhal.<br />
4. L’accumulation de mucus dans la trachée et les bronches et la<br />
destruction des cellules ciliées provoquent une toux profonde,<br />
caractéristique <strong>du</strong> stade paroxystique (le deuxième stade).<br />
5. La phase de convalescence (le troisième stade) peut <strong>du</strong>rer<br />
plusieurs mois.<br />
6. Le diagnostic de laboratoire repose sur l’isolement des<br />
bactéries sur des milieux sélectifs, suivi de tests sérologiques.<br />
7. L’incidence de la coqueluche a diminué grâce à la vaccination<br />
systématique des enfants.<br />
La tuberculose (p. XXX- XXX)<br />
1. La tuberculose est causée par Mycobacterium tuberculosis.<br />
2. La résistance de l’agent pathogène aux acides et à l’alcool,<br />
de même qu’à la sécheresse et aux désinfectants, est <strong>du</strong>e<br />
au fait que sa paroi cellulaire est riche en lipides.<br />
3. M. tuberculosis peut être ingéré par des macrophagocytes alvéolaires,<br />
dans lesquels il se repro<strong>du</strong>it s’il n’est pas détruit.<br />
4. <strong>Les</strong> lésions formées par M. tuberculosis sont appelées tubercules.<br />
Des bactéries et des macrophagocytes morts composent la<br />
lésion caséeuse qui, si elle se calcifie, devient visible sur une<br />
radiographie pulmonaire.<br />
5. La liquéfaction de la lésion caséeuse pro<strong>du</strong>it une caverne<br />
tuberculeuse, dans laquelle M. tuberculosis est capable<br />
de croître.<br />
6. La rupture d’une lésion caséeuse libère des bactéries dans<br />
les vaisseaux sanguins et lymphatiques, et peut ainsi entraîner<br />
la formation de nouveaux foyers d’infection; cet état s’appelle<br />
tuberculose miliaire.<br />
CHAPITRE 24 <strong>Les</strong> <strong>maladies</strong> <strong>infectieuses</strong> <strong>du</strong> <strong>système</strong> <strong>respiratoire</strong> 29<br />
7. La tuberculose miliaire est caractérisée par une perte<br />
de poids, de la toux et de l’atonie <strong>du</strong>e aux multiples<br />
lésions organiques.<br />
8. La chimiothérapie consiste habituellement à administrer<br />
deux médicaments pendant 1 à 2 ans; M. tuberculosis est<br />
de plus en plus fréquemment résistant aux antibiotiques.<br />
9. Un résultat positif à un test cutané à la tuberculine indique<br />
soit une tuberculose active, soit une infection antérieure,<br />
ou simplement le fait que la personne a été vaccinée<br />
et qu’elle est immunisée contre la maladie.<br />
10. Le diagnostic de laboratoire repose sur la présence de bacilles<br />
acido-alcoolo-résistants et sur l’isolement de la bactérie,<br />
laquelle requiert jusqu’à huit semaines d’incubation.<br />
11. Mycobacterium bovis est responsable de la tuberculose bovine<br />
et se transmet aux humains par l’intermédiaire de lait non<br />
pasteurisé.<br />
12. <strong>Les</strong> infections à M. bovis touchent généralement les os<br />
et le <strong>système</strong> lymphatique.<br />
13. Le vaccin antituberculeux BCG est constitué d’une culture<br />
vivante avirulente de M. bovis.<br />
14. Le complexe M. avium-intracellulare infecte les personnes<br />
atteintes <strong>du</strong> SIDA à un stade avancé.<br />
<strong>Les</strong> pneumonies bactériennes (p. XXX- XXX)<br />
1. La pneumonie typique est causée par S. pneumoniæ.<br />
2. <strong>Les</strong> pneumonies atypiques sont <strong>du</strong>es à d’autres<br />
microorganismes.<br />
La pneumonie à pneumocoques (p. XXX- XXX)<br />
1. La pneumonie à pneumocoques est <strong>du</strong>e à Streptococcus<br />
pneumoniæ encapsulé qui résiste à la phagocytose.<br />
2. <strong>Les</strong> symptômes comprennent de la fièvre, de la difficulté<br />
à respirer, des douleurs thoraciques et des crachats couleur<br />
rouille.<br />
3. L’identification des bactéries se fait au moyen de la pro<strong>du</strong>ction<br />
d’-hémolysines, de l’inhibition par l’optochine, de<br />
la solubilité de la bile et de tests sérologiques.<br />
4. Il existe un vaccin constitué de substance capsulaire purifiée<br />
provenant de 23 sérotypes différents de S. pneumoniæ.<br />
La pneumonie à Hæmophilus influenzæ (p. XXX)<br />
1. L’alcoolisme, la malnutrition, le cancer et le diabète sont<br />
des facteurs prédisposants à la pneumonie à H. influenzæ.<br />
2. H. influenzæ est un coccobacille à Gram négatif.<br />
La pneumonie à mycoplasmes (p. XXX)<br />
1. La pneumonie à mycoplasmes, <strong>du</strong>e à Mycoplasma pneumoniæ,<br />
est une maladie endémique. Elle est responsable de 20% des<br />
cas de pneumonie, et est généralement traitée à la tétracycline.<br />
2. M. pneumoniæ pro<strong>du</strong>it des colonies ayant un aspect «d’œuf<br />
frit» après une incubation de deux semaines sur un milieu<br />
de culture enrichi contenant <strong>du</strong> sérum de cheval et un extrait<br />
de levure.<br />
3. Un des tests utilisés pour diagnostiquer la maladie repose<br />
sur l’augmentation <strong>du</strong> titre des anticorps IgM.
30 QUATRIÈME PARTIE <strong>Les</strong> microorganismes et les <strong>maladies</strong> humaines<br />
La légionellose (p. XXX- XXX)<br />
1. La légionellose est causée par un bacille aérobie à Gram<br />
négatif, Legionella pneumophila.<br />
2. L’agent pathogène peut croître dans l’eau, par exemple dans<br />
les <strong>système</strong>s de climatisation, les humidificateurs, les baignoires<br />
à remous, et être ensuite disséminé dans l’air (transmission<br />
aérienne).<br />
3. Cette forme de pneumonie ne semble pas être transmissible<br />
de personne à personne.<br />
4. Le diagnostic de laboratoire se fait au moyen d’une culture<br />
bactérienne, par détection par les anticorps fluorescents (AF)<br />
et par des sondes d’ADN.<br />
La psittacose (ornithose) (p. XXX)<br />
1. Chlamydia psittaci se transmet par contact avec de la fiente<br />
ou des exsudats d’oiseaux contaminés.<br />
2. <strong>Les</strong> corps élémentaires permettent à l’agent pathogène de<br />
la psittacose (ou ornithose) de survivre à l’extérieur de l’hôte.<br />
3. <strong>Les</strong> personnes qui manipulent des oiseaux dans le cadre de<br />
leur travail sont les plus susceptibles de contracter la maladie.<br />
4. On isole l’agent pathogène dans des œufs embryonnés,<br />
des souris ou des cultures cellulaires; la détermination<br />
de la bactérie repose sur des tests sérologiques.<br />
La pneumonie à Chlamydia (p. XXX- XXX)<br />
1. Chlamydia pneumoniæ provoque une forme de pneumonie<br />
qui se transmet de personne à personne.<br />
2. Le diagnostic de laboratoire repose sur un test de l’absorption<br />
fluorescente des anticorps.<br />
La fièvre Q (p. XXX)<br />
1. La fièvre Q est <strong>du</strong>e à Coxiella burnetii, un parasite intracellulaire<br />
obligatoire.<br />
2. La maladie se transmet généralement aux humains par l’intermédiaire<br />
de lait non pasteurisé ou par l’inhalation d’aérosols<br />
présents dans les étables à vaches laitières.<br />
3. Le diagnostic de laboratoire repose sur la culture de la bactérie<br />
dans des œufs embryonnés ou sur une culture cellulaire.<br />
Autres pneumonies bactériennes (p. XXX)<br />
1. <strong>Les</strong> bactéries à Gram positif susceptibles de provoquer une<br />
pneumonie comprennent S. aureus et S. pyogenes.<br />
2. <strong>Les</strong> bactéries à Gram négatif responsables de pneumonies<br />
comprennent M. catarrhalis, K. pneumoniæ et les espèces<br />
de Pseudomonas.<br />
LES VIROSES DES VOIES RESPIRATOIRES<br />
INFÉRIEURES (p. XXX- XXX)<br />
La pneumonie virale (p. XXX)<br />
1. Un certain nombre de virus sont susceptibles de provoquer<br />
une pneumonie en tant que complication d’une infection<br />
telle que la grippe.<br />
2. La cause des pneumonies virales n’est généralement<br />
pas déterminée par les laboratoires cliniques parce que<br />
l’isolement et l’identification des virus posent des difficultés.<br />
Le virus <strong>respiratoire</strong> syncytial (p. XXX)<br />
Le virus <strong>respiratoire</strong> syncytial (VRS) est la cause la plus fréquente<br />
de pneumonie chez les jeunes enfants.<br />
La grippe (p. XXX- XXX)<br />
1. La grippe est <strong>du</strong>e à Influenzavirus; elle est caractérisée<br />
par des frissons, de la fièvre, des maux de tête et des douleurs<br />
musculaires.<br />
2. La membrane lipidique externe <strong>du</strong> virus porte des<br />
excroissances d’hémagglutinine (H) et de neuraminidase (N),<br />
appelées spicules.<br />
3. On détermine les souches <strong>du</strong> virus grâce aux différences<br />
antigéniques des spicules H et N; on classe également les<br />
diverses souches en fonction des différences antigéniques des<br />
capsides (A, B et C).<br />
4. On détermine les isolats viraux à l’aide de la réaction<br />
d’inhibition d’hémagglutination virale et de réactions<br />
d’immunofluorescence sur des anticorps monoclonaux.<br />
5. <strong>Les</strong> mutations antigéniques qui modifient la nature antigénique<br />
des spicules H et N ré<strong>du</strong>isent l’efficacité de l’immunité naturelle<br />
et de la vaccination. <strong>Les</strong> dérives antigéniques provoquent<br />
de légères variations antigéniques.<br />
6. <strong>Les</strong> décès associés à des épidémies de grippe sont généralement<br />
<strong>du</strong>s à des infections bactériennes secondaires.<br />
7. Il existe des vaccins polyvalents pour les personnes âgées<br />
et d’autres groupes à risque élevé.<br />
8. L’amantadine et la rimantadine sont des médicaments<br />
efficaces pour prévenir et traiter les infections<br />
à Influenzavirus A.<br />
LES MYCOSES DES VOIES RESPIRATOIRES<br />
INFÉRIEURES (p. XXX- XXX)<br />
1. <strong>Les</strong> spores fongiques sont facilement inhalées; elles sont<br />
susceptibles de germer dans les voies <strong>respiratoire</strong>s inférieures.<br />
2. L’incidence des mycoses a augmenté au cours des dernières<br />
années; les mycoses sont des infections opportunistes.<br />
3. L’amphotéricine B sert à traiter les mycoses décrites<br />
ci-dessous.<br />
L’histoplasmose (p. XXX- XXX)<br />
1. Histoplasma capsulatum provoque une infection pulmonaire<br />
subclinique qui évolue parfois vers une maladie systémique<br />
grave.<br />
2. L’histoplasmose se contracte par inhalation de conidies<br />
présentes dans l’air.<br />
3. L’isolement <strong>du</strong> mycète ou son identification dans des<br />
échantillons de tissus est essentiel pour poser un diagnostic.<br />
La coccidioïdomycose (p. XXX- XXX)<br />
1. L’inhalation d’arthroconidies de Coccidioides immitis risque<br />
de provoquer une coccidioïdomycose.
2. La majorité des cas sont subcliniques mais, en présence de<br />
facteurs prédisposants tels que la fatigue et la malnutrition,<br />
l’infection peut évoluer vers une maladie ressemblant<br />
à la tuberculose.<br />
La pneumonie à Pneumocystis (p. XXX- XXX)<br />
1. On trouve Pneumocystis carinii dans les poumons de personnes<br />
saines.<br />
2. Pneumocystis carinii provoque des infections opportunistes<br />
chez les personnes immunodéprimées.<br />
3. On utilise actuellement <strong>du</strong> triméthoprime ou de la pentamidine<br />
pour traiter la pneumonie à Pneumocystis.<br />
La blastomycose (nord-américaine) (p. XXX)<br />
1. Blastomyces dermatitidis est l’agent causal de la blastomycose.<br />
2. L’infection débute dans les poumons et peut par la suite<br />
provoquer des abcès éten<strong>du</strong>s dans d’autres parties <strong>du</strong> corps.<br />
Des abcès cutanés peuvent apparaître au niveau d’une lésion.<br />
Autres mycètes associés à des <strong>maladies</strong><br />
<strong>respiratoire</strong>s (p. XXX)<br />
1. Divers mycètes opportunistes sont susceptibles de provoquer<br />
des <strong>maladies</strong> <strong>respiratoire</strong>s chez un hôte immunodéprimé,<br />
surtout si la quantité de spores inhalée est importante.<br />
2. Aspergillus, Rhizopus et Mucor font partie de ces mycètes<br />
opportunistes.<br />
RÉVISION<br />
1. <strong>Les</strong> <strong>maladies</strong> des voies <strong>respiratoire</strong>s se transmettent généralement<br />
par .<br />
2. Décrivez les mécanismes qui font obstacle à la pénétration<br />
des microorganismes dans les voies <strong>respiratoire</strong>s supérieures,<br />
et à l’infection des voies <strong>respiratoire</strong>s inférieures.<br />
3. En quoi la flore normale <strong>du</strong> <strong>système</strong> <strong>respiratoire</strong> participet-elle<br />
à la protection de l’organisme contre l’infection?<br />
4. Décrivez les différences et les ressemblances entre<br />
la pneumonie à mycoplasmes et la pneumonie virale.<br />
5. Comment contracte-t-on une otite moyenne? Quels sont<br />
les microorganismes fréquemment responsables de l’otite<br />
moyenne? Pourquoi est-il question d’otite moyenne dans<br />
un chapitre portant sur les <strong>maladies</strong> <strong>du</strong> <strong>système</strong> <strong>respiratoire</strong>?<br />
6. Donnez les informations suivantes au sujet de la coqueluche:<br />
l’agent causal et ses caractéristiques de virulence, le réservoir,<br />
CHAPITRE 24 <strong>Les</strong> <strong>maladies</strong> <strong>infectieuses</strong> <strong>du</strong> <strong>système</strong> <strong>respiratoire</strong> 31<br />
le mode de transmission, les symptômes, le traitement, la<br />
prévention et les populations à risque.<br />
7. Nommez l’agent causal, les symptômes et le traitement de<br />
quatre viroses <strong>du</strong> <strong>système</strong> <strong>respiratoire</strong>, et indiquez si chacune<br />
atteint les voies <strong>respiratoire</strong>s supérieures ou les voies <strong>respiratoire</strong>s<br />
inférieures.<br />
8. Donnez les informations suivantes au sujet de la tuberculose:<br />
l’agent causal et ses caractéristiques de virulence, le réservoir,<br />
le mode de transmission, les symptômes, le traitement, la<br />
prévention et les populations à risque.<br />
9. Dans quelles conditions les mycètes Aspergillus et Rhizopus<br />
sont-ils susceptibles de causer des infections?<br />
10. Est-il suffisant de poser un diagnostic de pneumonie pour<br />
entreprendre un traitement avec un agent antimicrobien?<br />
Justifiez brièvement votre réponse.<br />
11. Nommez l’agent causal, le mode de transmission et les<br />
régions endémiques des <strong>maladies</strong> suivantes: l’histoplasmose,<br />
la coccidioïdomycose, la blastomycose et la pneumonie<br />
à Pneumocystis. Pourquoi ces infections sont-elles souvent<br />
dites «opportunistes»?<br />
12. Décrivez brièvement le procédé et les résultats positifs d’un<br />
test à la tuberculine, et indiquez ce que signifie un test positif.<br />
13. Expliquez l’augmentation de l’incidence <strong>du</strong> rhume par temps<br />
froid.<br />
QUESTIONS À CHOIX MULTIPLE<br />
1. Un patient fait de la fièvre et il a de la difficulté à respirer ; il<br />
se plaint de douleurs thoraciques, et ses alvéoles pulmonaires<br />
sont remplies de liquide. On a isolé des cocci à Gram positif<br />
dans ses crachats couleur rouille. Le patient, traité aux<br />
antibiotiques, souffre:<br />
a) d’une pneumonie à mycoplasmes.<br />
b) de la tuberculose.<br />
c) d’un rhume.<br />
d) d’une pneumonie à pneumocoques.<br />
e) de la grippe.<br />
2. On n’a pas réussi à isoler d’agent pathogène des crachats d’un<br />
patient souffrant de pneumonie, et l’antibiothérapie n’a<br />
donné aucun résultat. On devrait:<br />
a) faire une culture pour Mycobacterium tuberculosis.<br />
b) faire une culture pour Streptococcus pneumoniæ.<br />
c) faire une culture pour des mycètes.<br />
d) modifier l’antibiothérapie.<br />
e) On ne peut rien faire d’autre<br />
Associez les choix suivants aux descriptions de cultures données<br />
dans les questions 3 à 5.<br />
a) Chlamydia d) Mycobacterium<br />
b) Coccidioides e) Mycoplasma<br />
c) Histoplasma
32 QUATRIÈME PARTIE <strong>Les</strong> microorganismes et les <strong>maladies</strong> humaines<br />
3. Une culture d’un prélèvement provenant d’un patient atteint<br />
de pneumonie ne semble pas se développer. Cependant, des<br />
colonies en forme d’œufs frits sont visibles si on examine la<br />
boîte de Petri avec un grossissement de 100.<br />
4. La détermination de la cause de cette forme de pneumonie<br />
requiert une culture cellulaire.<br />
5. L’examen microscopique d’une biopsie pulmonaire révèle<br />
la présence de sphérules.<br />
6. À San Francisco, 10 techniciens en hygiène vétérinaire présentent<br />
les premiers symptômes d’une pneumonie 2 semaines<br />
après qu’on a installé 130 chèvres dans l’abri où ils travaillent.<br />
La maladie est causée par Coxiella burnetii. Lequel des énoncés<br />
suivants est faux ?<br />
a) Le diagnostic devrait reposer sur une culture de crachats<br />
sur gélose au sang.<br />
b) Il s’agit d’un parasite intracellulaire obligatoire.<br />
c) La maladie est la fièvre Q.<br />
d) La maladie est transmise par des aérosols.<br />
e) L’inhalation de quelques agents pathogènes, voire d’un<br />
seul, suffit à provoquer l’infection.<br />
7. Lequel des phénomènes suivants entraîne tous les autres lors<br />
d’une coqueluche?<br />
a) Le stade catarrhal d) L’accumulation de mucus<br />
b) La toux e) Une cytotoxine trachéale<br />
c) La mort des cellules ciliées<br />
Associez les choix suivants aux énoncés des questions 8 à 10.<br />
a) Bordetella pertussis<br />
b) Corynebacterium diphteriæ<br />
c) Legionella pneumophila<br />
d) Mycobacterium tuberculosis<br />
e) Aucun des choix précédents<br />
8. Microorganisme transmis par l’eau des climatiseurs<br />
et des humidificateurs.<br />
9. Microorganisme responsable de la formation d’une membrane<br />
obstruant la gorge.<br />
10. Microorganisme résistant à la destruction par des<br />
macrophagocytes.<br />
QUESTIONS À COURT DÉVELOPPEMENT<br />
1. Faites la distinction entre S. pyogenes responsable de l’angine<br />
streptococcique et S. pyogenes responsable de la scarlatine.<br />
2. Pourquoi le vaccin contre la grippe n’est-il pas toujours aussi<br />
efficace que les autres vaccins?<br />
3. Expliquez pourquoi il n’est pas utile d’inclure des vaccins<br />
contre le rhume ou la grippe dans la vaccination de routine<br />
des enfants.<br />
APPLICATIONS CLINIQUES<br />
N.B. Certaines de ces questions nécessitent que vous cherchiez des<br />
réponses dans les différents chapitres <strong>du</strong> livre.<br />
1. Vous finissez votre stage en pédiatrie. Votre professeur vous<br />
soumet le cas d’un enfant de 4 ans atteint d’asthme sévère et<br />
hospitalisé parce qu’il présente depuis quatre jours une toux<br />
évolutive accompagnée, dans les deux derniers jours, d’accès<br />
de fièvre. On a obtenu une culture de cocci à Gram positif<br />
assemblés par paires à partir d’un échantillon de sang. Le<br />
diagnostic est une pneumonie à pneumocoques causée par<br />
Streptococcus pneumoniæ.<br />
<strong>Les</strong> parents de l’enfant sont inquiets car il s’agit de la<br />
troisième pneumonie en un an et demi; ils se demandent s’ils<br />
ne devraient pas retirer l’enfant de la nouvelle garderie dans<br />
laquelle ils l’avaient placé. Vous devez leur expliquer pourquoi<br />
l’enfant est sensible à l’infection, leur dire s’ils doivent<br />
laisser l’enfant dans la garderie ou l’en retirer, et leur expliquer<br />
pourquoi ils doivent être vigilants en regard de l’évolution<br />
de la pneumonie.<br />
Vous devez également faire un compte ren<strong>du</strong> aux autres<br />
stagiaires sur les liens entre les caractéristiques de la virulence<br />
<strong>du</strong> microbe, les dommages physiologiques causés par la<br />
bactérie et le dysfonctionnement <strong>respiratoire</strong> de l’enfant.<br />
Vous devez aussi expliquer pourquoi une personne peut<br />
contracter plus d’une fois une telle pneumonie (Indice: voir<br />
le chapitre 15).<br />
2. Janie est une fillette de 3 ans qui fréquente la même garderie<br />
familiale que votre enfant <strong>du</strong>rant la journée. Elle vient d’être<br />
admise au service de pédiatrie et on a diagnostiqué une<br />
coqueluche. Ses parents avaient d’abord cru à un mauvais<br />
rhume, mais les quintes de toux creuse et profonde de Janie,<br />
suivies de vomissements, les avaient inquiétés. <strong>Les</strong> services<br />
sociaux ont averti le personnel de la garderie. Vous craignez<br />
que votre enfant n’ait attrapé le microbe et le transmette<br />
à vos autres enfants, et vous décidez de vous informer sur<br />
la virulence de la bactérie et sur sa contagiosité.<br />
Décrivez les liens qui existent entre les caractéristiques<br />
de la virulence de la bactérie, les dommages physiologiques<br />
qu’elle cause et le dysfonctionnement <strong>respiratoire</strong> de l’enfant<br />
(Indice: voir les chapitres 15 et 16).<br />
Expliquez pourquoi la garderie doit être avisée <strong>du</strong> cas de<br />
coqueluche.Avez-vous lieu de vous inquiéter si vos enfants<br />
ont reçu le vaccin DCT? Justifiez votre réponse. (Indice: voir<br />
le chapitre 14)<br />
3. Au cours d’un stage de prévention des infections, on vous<br />
soumet la situation épidémiologique suivante. Sur une<br />
période de 6 mois, 72 membres <strong>du</strong> personnel d’une clinique<br />
présentent des résultats positifs à un test cutané à la tuberculine.<br />
On effectue une étude cas-témoin pour déterminer la<br />
(ou les) source(s) probable(s) de l’infection à M. tuberculosis<br />
dont souffrent les membres <strong>du</strong> personnel. On compare en<br />
tout 16 cas de la maladie et 34 cas-témoins dont le test à la<br />
tuberculine est négatif. <strong>Les</strong> résultats sont notés dans le tableau<br />
suivant. On vous demande de déterminer les sources les plus<br />
probables de l’infection. Que peut signifier un test cutané à la<br />
tuberculine positif? Pourquoi ne vaccine-t-on pas systématiquement<br />
toute la population contre la tuberculose? Si<br />
l’iséthionate de pentamidine n’est pas utilisée dans ce cas-ci<br />
pour traiter la tuberculose, quelle maladie cherchait-on probablement<br />
à combattre en administrant ce médicament?<br />
(Indice: voir les chapitres 18 et 24)
Cas ( %) Cas-témoins ( %)<br />
■ A travaillé au moins<br />
40 heures par semaine 100 62<br />
■ A été en contact avec des patients 94 94<br />
■ Mangeait dans la salle<br />
de repos <strong>du</strong> personnel 38 35<br />
■ Réside à Montréal 75 65<br />
■ De sexe féminin 81 77<br />
■ Fumeur 6 15<br />
■ A été en contact avec une<br />
infirmière atteinte de tuberculose 15 12<br />
■ Était présent dans la pièce<br />
non ventilée où on a prélevé des<br />
échantillons de crachats dont<br />
l’analyse a révélé qu’ils étaient<br />
positifs pour la tuberculose 13 8<br />
■ Était présent dans la pièce<br />
où on a administré un traitement<br />
d’iséthionate de pentamidine<br />
en aérosol à des patients<br />
atteints de tuberculose 31 3<br />
4. Votre grand-mère habite dans une résidence pour personnes<br />
âgées. Elle se plaint qu’elle est souvent enrhumée depuis son<br />
arrivée. <strong>Les</strong> avis varient sur les causes de ces rhumes. Pour<br />
certains résidents, c’est parce qu’elle joue régulièrement aux<br />
cartes. Pour d’autres, c’est parce qu’elle est maintenant plus<br />
âgée et plus fragile. Pour d’autres encore, c’est parce que<br />
le chauffage est trop élevé dans la bâtisse. Votre grand-mère<br />
se demande si la vaccination contre la grippe la protégerait<br />
contre le rhume ou si la prise d’antibiotiques serait efficace.<br />
Vous décidez de lui rendre visite. Vous devez répondre aux<br />
questions qu’elle se pose quant aux modes de transmission<br />
<strong>du</strong> rhume et l’informer sur la façon de se soigner contre le<br />
rhume ou la grippe (Indice: voir le chapitre 14).<br />
5. Au mois de mars, six membres d’une même famille ont présenté<br />
de la fièvre, de l’anorexie, des maux de gorge, de la<br />
toux, des maux de tête, des vomissements et des douleurs<br />
musculaires. Deux d’entre eux ont été hospitalisés, et l’état des<br />
six personnes s’est amélioré après une thérapie à la tétracycline.<br />
<strong>Les</strong> titres des anticorps d’échantillons de sérum prélevés<br />
en phase de convalescence ont été de 64 et de 32. La famille<br />
avait acheté une calopsitte élégante à la mi-février, et s’était<br />
ren<strong>du</strong> compte que la perruche était irritable. On a euthanasié<br />
l’oiseau en avril. La maladie dont souffrent les six membres<br />
de la famille est la psittacose. Décrivez dans l’ordre les différents<br />
CHAPITRE 24 <strong>Les</strong> <strong>maladies</strong> <strong>infectieuses</strong> <strong>du</strong> <strong>système</strong> <strong>respiratoire</strong> 33<br />
éléments de la chaîne épidémiologique de cette maladie.<br />
Expliquez pourquoi les titres d’anticorps peuvent servir au<br />
diagnostic de la maladie. Recherchez des éléments d’information<br />
quant aux moyens de prévention qui peuvent être<br />
utiles pour protéger la santé de la population (Indice: voir le<br />
chapitre 18).<br />
6. Au mois d’août, Christophe, un jeune sans-abri de 24 ans,<br />
revient d’un séjour en Californie où il a traversé à pied des<br />
régions arides et poussiéreuses.Au mois de septembre, il se<br />
sent fatigué et courbaturé et constate qu’il a per<strong>du</strong> <strong>du</strong> poids;<br />
il tousse et a de la difficulté à respirer. Lors de sa première<br />
évaluation médicale, le médecin observe des infiltrats au<br />
niveau des deux lobes pulmonaires; il pense qu’il peut s’agir<br />
d’une pneumonie typique et prescrit à Christophe des antibiotiques<br />
pour une période de 15 jours; cependant, il n’a pas<br />
atten<strong>du</strong> d’avoir confirmation de son diagnostic à partir<br />
de cultures pour bactéries. En décembre, les symptômes de<br />
Christophe se sont aggravés; le médecin décèle une masse<br />
laryngée et évoque la possibilité d’un cancer <strong>du</strong> larynx,<br />
mais un traitement aux stéroïdes ne donne aucun résultat.<br />
Finalement, au mois de janvier, une biopsie pulmonaire et<br />
une laryngoscopie révèlent la présence de tissu granuleux<br />
diffus. On administre de l’amphotéricine B à Christophe,<br />
qui quitte l’hôpital 5 jours plus tard. Il souffrait de coccidioïdomycose.<br />
Énumérez les causes qui ont entraîné les retards<br />
dans le bon diagnostic. Pour quelle raison les antibiotiques<br />
n’ont-ils pas agi contre le microbe responsable? En quoi<br />
les informations sur le voyage en Californie auraient-elles<br />
été utiles pour poser le diagnostic? (Indice: voir le<br />
chapitre 12)<br />
7. Lors d’une formation sur les soins à donner aux patients<br />
ayant subi une greffe, on vous soumet un article tiré d’une<br />
revue médicale. Il y est mentionné que, moins d’un an après<br />
avoir subi une greffe de rein réalisée avec un organe provenant<br />
d’un même donneur, les deux receveurs ont présenté<br />
une histoplasmose. <strong>Les</strong> receveurs n’ont jamais été en contact<br />
l’un avec l’autre et ne se sont jamais ren<strong>du</strong>s dans la région où<br />
l’histoplasmose est endémique. Le typage moléculaire révèle<br />
que les isolats de Histoplasma capsulatum sont les mêmes chez<br />
les deux receveurs. (Source: New England Journal of Medicine,<br />
vol. 343, n o 16, 19 octobre 2000.)<br />
Rassemblez les données qui permettent d’établir un lien<br />
entre la maladie, la greffe d’organe et la possibilité que les<br />
personnes atteintes se soient trouvées dans une situation<br />
favorisant l’infection.<br />
Si le donneur est un zoologiste s’occupant de chauvessouris,<br />
son emploi peut-il être la cause de la maladie?<br />
Justifiez votre réponse.