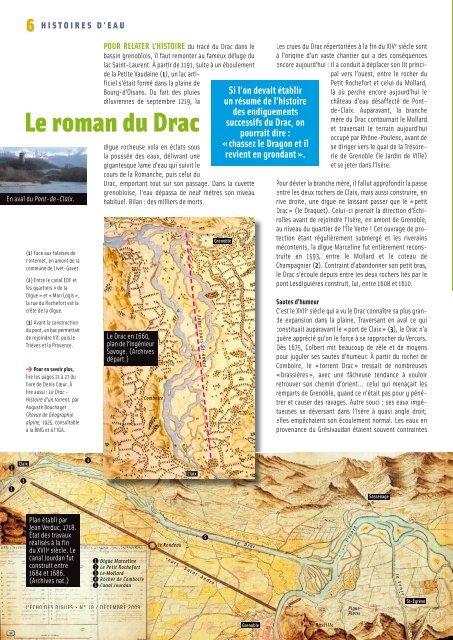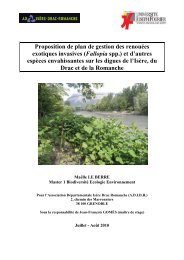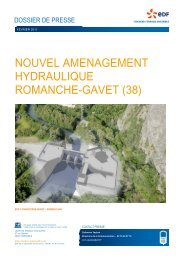La digue du Drac sécurisée - AD Isère Drac Romanche
La digue du Drac sécurisée - AD Isère Drac Romanche
La digue du Drac sécurisée - AD Isère Drac Romanche
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
6<br />
L’ÉCHO DES DIGUES • N° 10 / DÉCEMBRE 2009<br />
POUR RELATER L’HISTOIRE <strong>du</strong> tracé <strong>du</strong> <strong>Drac</strong> dans le<br />
bassin grenoblois, il faut remonter au fameux déluge <strong>du</strong><br />
lac Saint-<strong>La</strong>urent. À partir de 1191, suite à un éboulement<br />
de la Petite Vaudaine (1), un lac arti-<br />
ficiel s’était formé dans la plaine de<br />
Bourg-d’Oisans. Du fait des pluies<br />
diluviennes de septembre 1219, la<br />
Le roman <strong>du</strong> <strong>Drac</strong><br />
En aval <strong>du</strong> Pont-de-Claix.<br />
2<br />
1<br />
Claix<br />
3<br />
HISTOIRES D’EAU<br />
(1) Face aux falaises de<br />
l’Infernet, en amont de la<br />
commune de Livet-Gavet.<br />
(2) Entre le canal EDF et<br />
les quartiers « de la<br />
Digue » et « Mon Logis »,<br />
la rue <strong>du</strong> Rochefort est la<br />
crête de la <strong>digue</strong>.<br />
(3) Avant la construction<br />
<strong>du</strong> pont, un bac permettait<br />
de rejoindre Vif, puis le<br />
Trièves et la Provence.<br />
Pour en savoir plus,<br />
lire les pages 21 à 27 <strong>du</strong><br />
livre de Denis Cœur. À<br />
lire aussi : Le <strong>Drac</strong> -<br />
Histoire d'un torrent, par<br />
Auguste Bouchayer<br />
(Revue de Géographie<br />
alpine, 1925, consultable<br />
à la BMG et à l’IGA.<br />
Plan établi par<br />
Jean Ver<strong>du</strong>c, 1718.<br />
État des travaux<br />
réalisés à la fin<br />
<strong>du</strong> XVII e siècle. Le<br />
canal Jourdan fut<br />
construit entre<br />
1684 et 1686.<br />
(Archives nat.)<br />
4<br />
<strong>digue</strong> rocheuse vola en éclats sous<br />
la poussée des eaux, délivrant une<br />
gigantesque lame d’eau qui suivit le<br />
cours de la <strong>Romanche</strong>, puis celui <strong>du</strong><br />
<strong>Drac</strong>, emportant tout sur son passage. Dans la cuvette<br />
grenobloise, l’eau dépassa de neuf mètres son niveau<br />
habituel. Bilan : des milliers de morts.<br />
Le <strong>Drac</strong> en 1660,<br />
plan de l’ingénieur<br />
Savoye. (Archives<br />
départ.)<br />
1 Digue Marceline<br />
2 Le Petit Rochefort<br />
3 Le Mollard<br />
4 Rocher de Comboire<br />
5 Canal Jourdan<br />
Comboire<br />
le Rondeau<br />
Claix<br />
futur cours St-André<br />
cours Saint-André<br />
5<br />
Si l’on devait établir<br />
un résumé de l’histoire<br />
des en<strong>digue</strong>ments<br />
successifs <strong>du</strong> <strong>Drac</strong>, on<br />
pourrait dire :<br />
« chassez le Dragon et il<br />
revient en grondant ».<br />
Grenoble<br />
le <strong>Drac</strong><br />
Grenoble<br />
Les crues <strong>du</strong> <strong>Drac</strong> répertoriées à la fin <strong>du</strong> XIV e siècle sont<br />
à l’origine d’un vaste chantier qui a des conséquences<br />
encore aujourd’hui : il a con<strong>du</strong>it à déplacer son lit principal<br />
vers l’ouest, entre le rocher <strong>du</strong><br />
Petit Rochefort et celui <strong>du</strong> Mollard,<br />
là où perche encore aujourd’hui le<br />
château d’eau désaffecté de Pontde-Claix.<br />
Auparavant, la branche<br />
mère <strong>du</strong> <strong>Drac</strong> contournait le Mollard<br />
et traversait le terrain aujourd’hui<br />
occupé par Rhône-Poulenc, avant de<br />
se diriger vers le quai de la Trésorerie<br />
de Grenoble (le Jardin de Ville)<br />
et se jeter dans l’<strong>Isère</strong>.<br />
Pour dévier la branche mère, il fallut approfondir la passe<br />
entre les deux rochers de Claix, mais aussi construire, en<br />
rive droite, une <strong>digue</strong> ne laissant passer que le « petit<br />
<strong>Drac</strong> » (le Draquet). Celui-ci prenait la direction d’Échirolles<br />
avant de rejoindre l’<strong>Isère</strong>, en amont de Grenoble,<br />
au niveau <strong>du</strong> quartier de l’Île Verte ! Cet ouvrage de protection<br />
étant régulièrement submergé et les riverains<br />
mécontents, la <strong>digue</strong> Marceline fut entièrement reconstruite<br />
en 1593, entre le Mollard et le coteau de<br />
Champagnier (2). Contraint d’abandonner son petit bras,<br />
le <strong>Drac</strong> s’écoule depuis entre les deux rochers liés par le<br />
pont Lesdiguières construit, lui, entre 1608 et 1610.<br />
Sautes d’humeur<br />
C’est le XVII e siècle qui a vu le <strong>Drac</strong> connaître sa plus grande<br />
expansion dans la plaine. Traversant en aval ce qui<br />
constituait auparavant le « port de Claix » (3), le <strong>Drac</strong> n’a<br />
guère apprécié qu’on le force à se rapprocher <strong>du</strong> Vercors.<br />
Dès 1675, Colbert mit beaucoup de zèle et de moyens<br />
pour juguler ses sautes d’humeur. À partir <strong>du</strong> rocher de<br />
Comboire, le « torrent <strong>Drac</strong> » tressait de nombreuses<br />
« brassières », avec une fâcheuse tendance à vouloir<br />
retrouver son chemin d’orient… celui qui menaçait les<br />
remparts de Grenoble, quand ce n’était pas pour y pénétrer<br />
et causer des ravages. Autre souci : ses eaux impétueuses<br />
se déversant dans l’<strong>Isère</strong> à quasi angle droit,<br />
elles empêchaient son écoulement normal. Les eaux en<br />
provenance <strong>du</strong> Grésivaudan étaient souvent contraintes<br />
la Bastille<br />
l’<strong>Isère</strong><br />
Pique-<br />
Pierre<br />
Sassenage<br />
la Vence<br />
St-Égrève<br />
COURS & DIGUE<br />
L’aménagement progressif <strong>du</strong><br />
<strong>Drac</strong> a aussi permis, non loin de<br />
son lit, celui que certains<br />
considéraient à l’époque comme<br />
étant « le plus beau cours de<br />
France ». Long de 8 km et portant<br />
le nom de son concepteur, le<br />
cours Saint-André (4) a été<br />
construit entre 1660 et 1684, sur<br />
demande de François de Bonne,<br />
<strong>du</strong>c de Lesdiguières. Destiné à<br />
mieux circuler vers le sud, cet<br />
ouvrage qui file droit dans les<br />
anciennes « brassières » <strong>du</strong> <strong>Drac</strong><br />
était aussi une « œuvre contre le<br />
<strong>Drac</strong> » ! En effet, il était longé<br />
par quatre fossés drainant les<br />
eaux de la vallée et « soutenu<br />
par des murs ». Par là, il faut<br />
entendre des rangées de pierres<br />
ou d’enrochements, ce qui<br />
permet de dire que le cours avait<br />
aussi une fonction de protection<br />
arrière, de <strong>digue</strong> reculée.<br />
d’y retourner, inondant Grenoble au<br />
passage.<br />
<strong>La</strong> solution : creuser un chenal rectiligne<br />
bordé de <strong>digue</strong>s pour le <strong>Drac</strong>.<br />
Avec le canal Jourdan construit entre<br />
1684 et 1686, on tenta — pour la<br />
seconde fois — de déplacer le torrent<br />
vers l’ouest, mais le gros œuvre ne<br />
fut pas terminé ! Suite à plusieurs<br />
alertes, le <strong>Drac</strong> bouscula ses <strong>digue</strong>s<br />
en 1733, provoquant — par reflux de<br />
l’<strong>Isère</strong> — l’une des trois plus grosses<br />
inondations que Grenoble ait jamais<br />
connu. Après de nouveaux et longs<br />
atermoiements, et surtout le déluge<br />
de la Saint-Crépin (1778) dû à l’<strong>Isère</strong>,<br />
le canal Jourdan fut enfin achevé, et<br />
les deux <strong>digue</strong>s continues — celles<br />
qui contiennent le <strong>Drac</strong> encore au-<br />
jourd’hui — érigées en lieu et place<br />
d’inefficaces alignements interrompus.<br />
Restait à régler le problème de<br />
la confluence <strong>Drac</strong>-<strong>Isère</strong>. En 1782,<br />
elle est une première fois déplacée<br />
vers l’aval, en face de Pique-Pierre.<br />
Il faudra attendre 1821 pour que la<br />
<strong>digue</strong> gauche <strong>du</strong> <strong>Drac</strong> soit prolongée<br />
jusqu’à Sassenage et que la con-<br />
fluence soit définitivement calée<br />
face à Saint-Egrève.<br />
Espaces et<br />
temps de<br />
l’inondation<br />
À la jonction de l’information<br />
historique et des sciences de<br />
l’environnement, entretien<br />
avec Denis Cœur, docteur en<br />
histoire, spécialiste de<br />
l’aménagement <strong>du</strong> territoire<br />
et des risques naturels.<br />
Vous êtes un historien averti<br />
en matière d’hydrologie. Comment<br />
concilier ces deux domaines ?<br />
En tant qu’historien, mon interrogation<br />
s’est portée très tôt sur la<br />
genèse <strong>du</strong> territoire, en particulier<br />
son rapport avec les événements<br />
naturels dommageables, notamment<br />
l’inondation. A priori, je suis<br />
plutôt versé dans les sciences<br />
humaines. Dès mes premiers sujets<br />
de recherche, j’ai rencontré des<br />
spécialistes des sciences de la nature,<br />
en particulier des hydrologues.<br />
C’est pour cette raison que mon travail<br />
d’expertise se situe aujourd’hui<br />
à la frontière de ces deux disciplines,<br />
mais avec d’autres aussi<br />
comme la nivologie ou la géologie.<br />
Comment les ingénieurs perçoivent–<br />
ils votre intervention ?<br />
Toute l’histoire de l’aménagement<br />
<strong>du</strong> territoire montre le rôle fondamental<br />
qu’ont joué les ingénieurs.<br />
Un territoire se manifeste par un<br />
certain nombre d’objets techniques<br />
qui l’ont investi dans le passé. C’est<br />
le cas pour les <strong>digue</strong>s : elles ont été<br />
érigées pour juguler les torrents,<br />
canaliser les cours d’eau. L’histoire<br />
générale est autant humaine que<br />
technique. Le registre technique conditionne<br />
en partie l’aménagement<br />
<strong>du</strong> territoire : il participe à la construction<br />
matérielle de l’espace. Habituellement,<br />
la posture de l’historien<br />
est plutôt d’être en décalage<br />
avec le présent. Pour ma part, j’ai<br />
choisi d’aller sur le terrain, de voir<br />
comment aujourd’hui l’information<br />
historique permettait de comprendre<br />
certaines situations, comment<br />
elle pouvait contribuer à rechercher<br />
des solutions techniques ou à améliorer<br />
la prise de décisions.<br />
Cette approche est encore peu<br />
courante en France ?<br />
Oui, mais les mentalités évoluent,<br />
sans doute parce que, <strong>du</strong> fait de<br />
l’urbanisation, les enjeux sont maintenant<br />
plus forts qu’ils ne l’étaient il<br />
y a cinquante ans. Derrière tout<br />
projet d'aménagement, il y a des<br />
problématiques politiques, sociales<br />
et culturelles. Devant un événement<br />
de type inondation, un territoire est<br />
vulnérable et, souvent, avant même<br />
d’élaborer un diagnostic, il faut comprendre<br />
comment on en est arrivé<br />
là, quelles sont les raisons qui ont<br />
con<strong>du</strong>it à cet état des lieux, quand<br />
et comment les décisions ont été<br />
prises, dans quel contexte politique<br />
ou technique... Même pour modéliser<br />
certains phénomènes de façon<br />
scientifique, il n’est plus rare de faire<br />
appel à des données historiques.<br />
Revisiter le passé pour mieux<br />
comprendre le présent…<br />
Il faudrait mettre tout projet d’aménagement<br />
<strong>du</strong> territoire dans une<br />
perspective historique et géographique.<br />
L’un des enjeux majeurs<br />
auquel notre société se trouve<br />
confrontée réside là : il faut s’interroger<br />
à la fois sur l’espace et sur le<br />
temps qu’on habite. Tout territoire a<br />
une histoire. En tant qu’historienconseil,<br />
ce qu’on me demande c’est<br />
de prendre <strong>du</strong> recul, de réinvestir le<br />
passé, de le mettre en lumière ou en<br />
musique par rapport aux questions<br />
qui se posent aujourd’hui, par rapport<br />
aux enjeux auxquels un territoire<br />
donné est confronté.<br />
HISTOIRES D’EAU 7<br />
Denis Cœur, historienconseil<br />
au sein <strong>du</strong> cabinet<br />
Acthys.<br />
(4) À Pont-de-Claix, il<br />
porte encore ce nom.<br />
Plus au nord, c'est le<br />
cours Jean-Jaurès, cours<br />
de la Libération, avenue<br />
<strong>du</strong> Général de Gaulle….<br />
GÉNÈSE D’UNE POLITIQUE PUBLIQUE<br />
L’ouvrage de Denis Cœur titré <strong>La</strong> Plaine de Grenoble face aux<br />
inondations : genèse d'une politique publique <strong>du</strong> XVIIe au XXe au XXe au XX<br />
siècle est paru en 2008 aux éditions Quae. À travers la chronique<br />
des crues <strong>du</strong> <strong>Drac</strong> et de l’<strong>Isère</strong>, l’auteur s’attache à décrire<br />
l’engagement des autorités pour mettre en œuvre des<br />
techniques d’en<strong>digue</strong>ment, des dispositifs de prévention et<br />
de secours. En annexe, des documents d’archives : photos,<br />
cartes, dessins, plans. Bien plus qu’un livre destiné aux<br />
techniciens ou aux décideurs, cet ouvrage permet à chacun<br />
d’ouvrir des pans entiers d’une mémoire enfouie sous les<br />
eaux. À la lumière des projets d’aménagement contemporains,<br />
cette plongée dans un passé récent est essentielle.<br />
L’ÉCHO DES DIGUES • N° 10 / DÉCEMBRE 2009