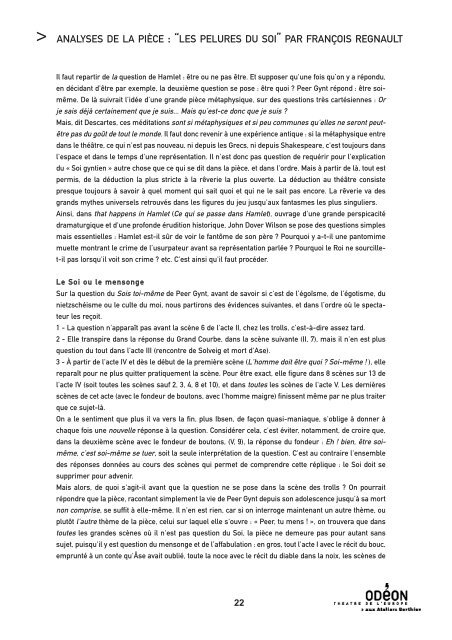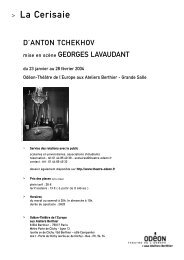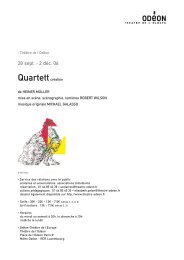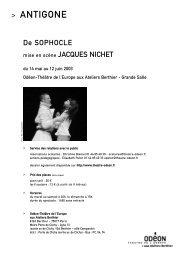You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
ANALYSES DE LA PIÈCE : “LES PELURES DU SOI” PAR FRANÇOIS REGNAULT<br />
Il faut repartir <strong>de</strong> la question <strong>de</strong> Hamlet : être ou ne pas être. Et supposer qu'une fois qu’on y a répondu,<br />
en décidant d'être par exemple, la <strong>de</strong>uxième question se pose : être quoi ? <strong>Peer</strong> <strong>Gynt</strong> répond : être soimême.<br />
De là suivrait l'idée d’une gran<strong>de</strong> pièce métaphysique, sur <strong>de</strong>s questions très cartésiennes : Or<br />
je sais déjà certainement que je suis... Mais qu’est-ce donc que je suis ?<br />
Mais, dit Descartes, ces méditations sont si métaphysiques et si peu communes qu'elles ne seront peutêtre<br />
pas du goût <strong>de</strong> tout le mon<strong>de</strong>. Il faut donc revenir à une expérience antique : si la métaphysique entre<br />
dans le théâtre, ce qui n'est pas nouveau, ni <strong>de</strong>puis les Grecs, ni <strong>de</strong>puis Shakespeare, c'est toujours dans<br />
l'espace et dans le temps d'une représentation. Il n'est donc pas question <strong>de</strong> requérir pour l'explication<br />
du « Soi gyntien » autre chose que ce qui se dit dans la pièce, et dans l'ordre. Mais à partir <strong>de</strong> là, tout est<br />
permis, <strong>de</strong> la déduction la plus stricte à la rêverie la plus ouverte. La déduction au théâtre consiste<br />
presque toujours à savoir à quel moment qui sait quoi et qui ne le sait pas encore. La rêverie va <strong>de</strong>s<br />
grands mythes universels retrouvés dans les figures du jeu jusqu'aux fantasmes les plus singuliers.<br />
Ainsi, dans that happens in Hamlet (Ce qui se passe dans Hamlet), ouvrage d'une gran<strong>de</strong> perspicacité<br />
dramaturgique et d'une profon<strong>de</strong> érudition historique, John Dover Wilson se pose <strong>de</strong>s questions simples<br />
mais essentielles : Hamlet est-il sûr <strong>de</strong> voir le fantôme <strong>de</strong> son père ? Pourquoi y a-t-il une pantomime<br />
muette montrant le crime <strong>de</strong> l’usurpateur avant sa représentation parlée ? Pourquoi le Roi ne sourcillet-il<br />
pas lorsqu'il voit son crime ? etc. C'est ainsi qu'il faut procé<strong>de</strong>r.<br />
Le Soi ou le mensonge<br />
Sur la question du Sois toi-même <strong>de</strong> <strong>Peer</strong> <strong>Gynt</strong>, avant <strong>de</strong> savoir si c'est <strong>de</strong> l’égoïsme, <strong>de</strong> l'égotisme, du<br />
nietzschéisme ou le culte du moi, nous partirons <strong>de</strong>s évi<strong>de</strong>nces suivantes, et dans l’ordre où le spectateur<br />
les reçoit.<br />
1 - La question n'apparaît pas avant la scène 6 <strong>de</strong> l'acte II, chez les trolls, c’est-à-dire assez tard.<br />
2 - Elle transpire dans la réponse du Grand Courbe, dans la scène suivante (II, 7), mais il n'en est plus<br />
question du tout dans l'acte III (rencontre <strong>de</strong> Solveig et mort d'Ase).<br />
3 - À partir <strong>de</strong> l'acte IV et dès le début <strong>de</strong> la première scène (L'homme doit être quoi ? Soi-même ! ), elle<br />
reparaît pour ne plus quitter pratiquement la scène. Pour être exact, elle figure dans 8 scènes sur 13 <strong>de</strong><br />
l'acte IV (soit toutes les scènes sauf 2, 3, 4, 8 et 10), et dans toutes les scènes <strong>de</strong> l'acte V. Les <strong>de</strong>rnières<br />
scènes <strong>de</strong> cet acte (avec le fon<strong>de</strong>ur <strong>de</strong> boutons, avec l'homme maigre) finissent même par ne plus traiter<br />
que ce sujet-là.<br />
On a le sentiment que plus il va vers la fin, plus Ibsen, <strong>de</strong> façon quasi-maniaque, s'oblige à donner à<br />
chaque fois une nouvelle réponse à la question. Considérer cela, c'est éviter, notamment, <strong>de</strong> croire que,<br />
dans la <strong>de</strong>uxième scène avec le fon<strong>de</strong>ur <strong>de</strong> boutons, (V, 9), la réponse du fon<strong>de</strong>ur : Eh ! bien, être soimême,<br />
c’est soi-même se tuer, soit la seule interprétation <strong>de</strong> la question. C'est au contraire l'ensemble<br />
<strong>de</strong>s réponses données au cours <strong>de</strong>s scènes qui permet <strong>de</strong> comprendre cette réplique : le Soi doit se<br />
supprimer pour advenir.<br />
Mais alors, <strong>de</strong> quoi s'agit-il avant que la question ne se pose dans la scène <strong>de</strong>s trolls ? On pourrait<br />
répondre que la pièce, racontant simplement la vie <strong>de</strong> <strong>Peer</strong> <strong>Gynt</strong> <strong>de</strong>puis son adolescence jusqu'à sa mort<br />
non comprise, se suffit à elle-même. Il n'en est rien, car si on interroge maintenant un autre thème, ou<br />
plutôt l'autre thème <strong>de</strong> la pièce, celui sur laquel elle s'ouvre : « <strong>Peer</strong>, tu mens ! », on trouvera que dans<br />
toutes les gran<strong>de</strong>s scènes où il n'est pas question du Soi, la pièce ne <strong>de</strong>meure pas pour autant sans<br />
sujet, puisqu'il y est question du mensonge et <strong>de</strong> l’affabulation : en gros, tout l'acte I avec le récit du bouc,<br />
emprunté à un conte qu'Âse avait oublié, toute la noce avec le récit du diable dans la noix, les scènes <strong>de</strong><br />
22