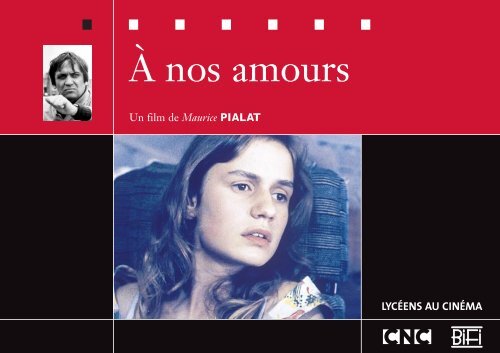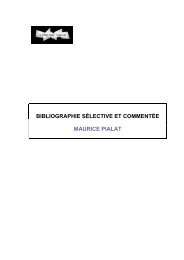A NOS AMOURS
A NOS AMOURS
A NOS AMOURS
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■<br />
À nos amours<br />
Un film de Maurice PIALAT<br />
LYCÉENS AU CINÉMA
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■<br />
Sommaire<br />
2<br />
3<br />
4<br />
6<br />
8<br />
10<br />
12<br />
GÉNÉRIQUE / SYNOPSIS<br />
ÉDITORIAL<br />
RÉALISATEUR /FILMOGRAPHIE<br />
DÉCOUPAGE ET ANALYSE DU RÉCIT<br />
L’intrigue résumée, planifiée et commentée,<br />
étape par étape.<br />
QUESTIONS DE MÉTHODE<br />
Les moyens artististiques et économiques mis<br />
en œuvre pour la réalisation du film, le travail<br />
du metteur en scène avec les comédiens et les<br />
techniciens, les partis pris et les ambitions de<br />
sa démarche.<br />
PERSONNAGES<br />
ET ACTEURS PRINCIPAUX<br />
MISES EN SCÈNE<br />
Un choix de scènes, ou de plans, mettant en<br />
valeur les procédés de mise en scène les plus<br />
importants, les marques les plus distinctives<br />
du style du réalisateur.<br />
16<br />
18<br />
19<br />
20<br />
21<br />
22<br />
23<br />
LE LANGAGE DU FILM<br />
Les outils de la grammaire cinématographique<br />
choisis par le réalisateur, et l’usage spécifique<br />
qu’il en a fait.<br />
UNE LECTURE DU FILM<br />
L’auteur du dossier donne un point de vue<br />
personnel sur le film étudié, ou en commente<br />
un aspect essentiel à ses yeux.<br />
EXPLORATIONS<br />
Les questions que soulève le propos du film,<br />
les perspectives qui s’en dégagent.<br />
DANS LA PRESSE, DANS LES SALLES<br />
L’accueil public et critique du film.<br />
L’AFFICHE<br />
AUTOUR DU FILM<br />
Le film replacé dans un contexte historique,<br />
artistique, ou dans un genre cinématographique.<br />
BIBLIOGRAPHIE<br />
LYCÉENS AU CINÉMA<br />
Avec le soutien du Ministère de la culture et de la communication<br />
(Centre national de la cinématographie, Direction régionale des affaires culturelles)<br />
et des Régions participantes.<br />
et le concours des salles de cinéma participant à l’opération
2<br />
■ GÉNÉRIQUE<br />
France, 1983<br />
Benjamin Baltimore<br />
Réalisation Maurice Pialat<br />
Scénario Arlette Langmann et Maurice Pialat<br />
■ Auteur du dossier Joël Magny<br />
Image Jacques Loiseleux, Pierre Novion, Patrice Guillou, Christian Fournier<br />
Décors Jean-Paul Camail, Arlette Langmann Costumes Valérie Schlumberger, Martha de Villalonga<br />
Montage Yann Dedet, Sophie Coussein, Valérie Condroyer, Corinne Lazare, Jean Gargonne, Nathalie<br />
Letrosne, Catherine Legault Son Jean Umansky, François de Morant, Julien Cloquet,<br />
Thierry Jeandroz Mixage Dominique Hennequin Scriptes Marie-Florence Roncatolo, Martine Rapin<br />
Assistants réalisateurs Florence Quentin, Cyril Collard, Christian Argentino Musique Henry Purcell,<br />
What power art thou, extrait de King Arthur, interprété par Klaus Nomi<br />
Interprétation<br />
Suzanne Sandrine Bonnaire, Robert, le frère Dominique Besnehard, Roger, le père Maurice Pialat,<br />
Betty, la mère Evelyne Kerr, Anne Anne-Sophie Maillé, Michel, “ celui qui a un grand nez ”<br />
Christophe Odent, Luc Cyr Boitard, Martine Maïté Maillé, Bernard Pierre-Loup Rajot, Jean-<br />
Pierre, le mari de Suzanne Cyril Collard, Nathalie Nathalie Gureghian, le moniteur Guénolé Pascal,<br />
Charline Caroline Cibot, Jacques, le beau-frère de Robert Jacques Fieschi, Marie-France, l’épouse de<br />
Robert Valérie Schlumberger, l’Américain Tom Stevens, Fanny Tsilka Theodorou, Claude Vanghel<br />
Theodorou, Solange Isabelle Prades, Freddy Hervé Austen, Alex Alexandre de Dardel, Richard<br />
Alexis Quentin, Adrien Pierre Novion, Henri Eric Viellard, la mère de Jean-Pierre Anne-Marie<br />
Nivelle, Angelo Jean-Paul Camail, Géraldine Caroline Legendre, le premier matelot Loïc Ermel,<br />
le second matelot Claude Bachowiak, le directeur Paul Lugagne<br />
Les dossiers pédagogiques et les fiches-élèves de l'opération lycéens au cinéma ont été<br />
édités par la Bibliothèque du film (BIFI) avec le soutien du Ministère de la culture et de<br />
la communication (Centre national de la cinématographie).<br />
Rédacteur en chef Frédéric Strauss.<br />
Production les Films du Livradois, Gaumont<br />
Producteur exécutif Micheline Pialat<br />
Distribution Gaumont<br />
Durée 1h42<br />
Sortie à Paris 16 novembre 1983<br />
■ SYNOPSIS<br />
Suzanne, quinze ans, répète On ne badine pas avec l’amour dans une colonie de vacances. Elle aime Luc,<br />
mais ne veut pas coucher avec lui alors qu’elle ne cesse de le faire avec des inconnus. Dans sa famille,<br />
Suzanne n’est pas à l’aise entre un père, Roger, fourreur juif d’origine polonaise, qu’elle aime beaucoup<br />
mais qui la traite parfois durement, une mère, Betty, agressive, névrosée et jalouse de sa jeunesse, et un<br />
frère, Robert, aux grandes ambitions littéraires et qui éprouve à l’égard de sa sœur comme de sa mère des<br />
sentiments possessifs et plutôt troubles.<br />
Lorsque le père quitte la famille, les disputes deviennent constantes et violentes entre Suzanne, sa mère et<br />
son frère, qui ne supportent pas sa « liberté ». La situation est intolérable pour Suzanne, qui décide de partir<br />
en pension.<br />
Roger reparaît un soir au beau milieu d’un repas de famille. Suzanne a épousé Jean-Pierre, mais s’intéresse<br />
déjà à Michel, tandis que Robert, devenu auteur à succès, a épousé Marie-France, la sœur de Jacques,<br />
célèbre critique littéraire. Roger règle ses comptes et reproche surtout à son fils d’avoir trahi sa vocation<br />
littéraire pour l’argent et le succès, trouve tous ces gens « tristes », se demande quelle est la position de<br />
Suzanne… Betty le chasse, au grand soulagement de chacun.<br />
Plus tard, Roger accompagne Suzanne à l’aéroport. Elle part pour San Diego avec Michel. Une grande<br />
tendresse et une grande complicité unissent le père et la fille. Dans le bus qui le ramène à Paris, Roger est<br />
songeur, tandis que dans l’avion, Suzanne semble elle aussi pleine d’incertitude.<br />
Dossier A nos amours © BIFI<br />
Maquette Public Image Factory Iconographie photogrammes © Gaumont /<br />
Portrait de Maurice Pialat (couverture et page 4) D.R.<br />
Bibliothèque du film (BIFI)<br />
100, rue du Faubourg Saint-Antoine - 75012 PARIS<br />
Tél : 01 53 02 22 30 - Fax : 01 53 02 22 39<br />
Site Internet : www.bifi.fr
■ ÉDITORIAL<br />
L'élan heurté de l'adolescence sous le regard<br />
d'un grand cinéaste<br />
A nos amours nous ouvre une des œuvres les plus passionnantes du cinéma français, une des<br />
plus singulières aussi : l'œuvre de Maurice Pialat. Metteur en scène des tensions, des crises,<br />
des commotions et des émotions qui rendent la vie intense, et parfois invivable, Maurice<br />
Pialat a fait de A nos amours un film lumineux, même dans la dureté et la folie de la famille<br />
qu'il y met en scène. Il campe lui-même le père, personnage ombrageux, fuyant, qui se<br />
confie peu, et seulement à sa fille, Suzanne, enjôleuse mais farouche, insaisissable elle aussi.<br />
C'est de cette adolescente que A nos amours trace le portrait sensible, contrasté : sensuelle<br />
et libre, Suzanne cherche dans l'élan charnel, le don de son corps, une perspective de vie,<br />
un épanouissement qui se dérobent à elle. De ces émois cahotants, Pialat n'a pas fait une<br />
charmante chronique de l'âge tendre, mais une forme de rapport romanesque sur une existence<br />
traversée, tout à la fois, par la grâce et par le sentiment du tragique, de l'irréparable.<br />
La force de frappe et de vérité de la mise en scène s'accompagne en effet toujours ici d'une<br />
ambition formelle et d'un regard sur les personnages qui transcendent la notion de réalisme.<br />
Dans ces entrelacs de la « méthode » Pialat, les acteurs ont une place de choix entre réalité<br />
et fiction, à l'instar de Sandrine Bonnaire, qui fut la révélation de A nos amours, éblouissante<br />
dans le rôle de Suzanne, où se reflète un peu de son tempérament, de sa jeunesse.<br />
Aussi subtil qu'il est direct, aussi secret qu'il est à vif, le film de Maurice Pialat nous invite<br />
à un dialogue vivant avec une grande idée du cinéma.<br />
3<br />
La Bibliothèque du film
4<br />
Les acteurs non<br />
professionnels de<br />
Passe ton bac<br />
d’abord (ci-contre),<br />
et les acteurs<br />
vedettes de Sous le<br />
soleil de Satan,<br />
Depardieu et<br />
Bonnaire<br />
(page suivante).<br />
■ LE RÉALISATEUR<br />
Pialat, la cicatrice intérieure<br />
« Je dis qu’on peut faire des entrées avec des bons films. La preuve a été faite. Il y a Pagnol, par exemple,<br />
seulement il est auteur. C’est ça ! Il n’est pas nécessaire de faire des films moins bons pour faire des entrées. Alors<br />
que tous ces gens qui tiennent le haut du pavé et qui imposent leurs produits dans le cinéma, en particulier en<br />
France depuis plus d’une décennie maintenant ! Pratiquement depuis la Nouvelle Vague. Ce sont ces gens qui<br />
prétendent que les films qui marchent sont des films faciles, qui font un tas de concessions. [...] C’est quand<br />
même pas par hasard que je cite Pagnol à tout bout de champ, et même à l’intérieur des films, parce que je ne<br />
rêve que de ça, de faire des films qui aient le succès qu’il a eu ». Maurice Pialat, au moment de la sortie de A nos amours.<br />
> Regarder en face<br />
On se souvient de la palme d’or attribuée sous les sifflets à Maurice Pialat,<br />
en 1987 à Cannes, pour Sous le soleil de Satan, et de cette phrase : « Vous ne m’aimez<br />
pas… Eh bien, je ne vous aime pas non plus ! » Ce n’est pas sous le signe de<br />
l’esthétique, de la morale ou de la métaphysique que Pialat place alors son<br />
triomphe, mais sur le plan affectif. La vie, l’amour, la mort, comme chez<br />
Lelouch, mais chaque plan de Pialat rappelle que le cinéma n’a pas été inventé<br />
pour fermer les yeux ou se boucher les oreilles, adoucir la vie ou anesthésier les<br />
consciences. « Le soleil ni la mort ne se peuvent regarder fixement », lit le Roi Soleil<br />
à la fin du merveilleux film de Roberto<br />
Rossellini, La Prise de pouvoir par Louis XIV,<br />
citant La Rochefoucauld (maxime n°26).<br />
Pialat en fait la matière même de son cinéma :<br />
regarder en face – et fixement, longuement–<br />
ce que, d’habitude, le cinéma nous permet<br />
d’éluder.<br />
Si cette exigence peut expliquer en partie la<br />
carrière difficile et chaotique de Maurice<br />
Pialat – dix longs métrages pour le cinéma en<br />
trente ans –, il faut ajouter que son parcours<br />
même ne ressemble à aucun autre dans le<br />
cinéma français. Maurice Pialat est né le 21<br />
© Gaumont<br />
août 1925 à Cunlhat, dans le Puy-de-Dôme. Son père, commerçant en « tout »,<br />
fait faillite alors que le petit Maurice a deux ans. Il sera élevé dans un milieu<br />
populaire à Courbevoie et à Montreuil. Comme tous les enfants, il aime le cinéma<br />
de l’époque, qu’il découvre surtout au patronage (Chaplin, Laurel et Hardy,<br />
Carné, La Bête humaine, Les Trois Lanciers du Bengale…), mais son intérêt pour la<br />
pratique du cinéma sera tardif. Il s’oriente d’abord vers d’autres arts. Après les<br />
Arts Décoratifs et les Beaux-Arts, où il est l’élève de Brianchon, Oudot et<br />
Desnoyer, il envisage un temps l’architecture, qu’il trouve trop technique, avant<br />
de se tourner vers la peinture. Il expose en 1945, 46 et 47 au Salon des moins de<br />
trente ans. Cet intérêt pour la peinture, qui le rapproche d’un homme tel que<br />
Bresson, un des rares cinéastes dont il reconnaisse l’influence, demeure essentiel<br />
pour comprendre son œuvre de cinéaste 1 . Parallèlement, Pialat fait du<br />
théâtre en amateur, écrit et monte des pièces et des spectacles burlesques.<br />
> L’irrémédiable<br />
C’est Pierre Braunberger, producteur de nombreux courts métrages de la<br />
Nouvelle Vague, qui lui permet de réaliser en 1960 L’Amour existe, un documentaire<br />
remarqué qui reçoit le Prix Louis Lumière et le Lion du court métrage<br />
au festival de Venise, et qu’on peut considérer comme la matrice de toute<br />
l’œuvre de Pialat. Apparaît déjà la veine autobiographique, puisque le film est<br />
nourri de visions et de souvenirs d’enfance et de jeunesse, Courbevoie,<br />
Montreuil… Ce documentaire est d’abord le constat douloureux de ce que le<br />
1. À l’époque d’À nos amours, il confie à Positif :« J’ai longtemps été paralysé par le fait d’avoir abandonné la peinture, parce que pour moi, il n’y a pas de comparaison, non seulement entre la peinture et le cinéma,<br />
mais entre la peinture et la littérature » (voir « Bibliographie », p. 23).
philosophe Clément Rosset appelle le « caractère<br />
insignifiant et éphémère de toute chose au monde » 2 ,<br />
Pialat y évoquant la guerre, la spéculation immobilière,<br />
« le temps des casernes civiles », le sort des<br />
vieux travailleurs, les bidonvilles… Mais le film<br />
tire sa force d’une douleur sourde et lancinante,<br />
qui constate une dégradation irrémédiable dans le<br />
même temps où elle fait sentir la beauté de ce qui<br />
a été. C’est lorsqu’il disparaît que l’on sent le plus<br />
que « l’amour existe ».<br />
Pialat doit attendre près de dix ans – peuplés de<br />
travaux de commande – pour passer au long<br />
métrage de fiction. Il en gardera une certaine<br />
amertume contre la Nouvelle Vague qui s’installe.<br />
C’est pourtant avec l’aide de François Truffaut et<br />
de Claude Berri, entre autres, qu’il peut tourner<br />
L’Enfance nue, histoire d’un enfant recueilli temporairement<br />
dans des familles d’accueil auprès<br />
desquelles il ne cesse de se rendre odieux. Le<br />
parallèle avec Les Quatre Cents Coups de Truffaut<br />
s’impose au spectateur, mais il ne faut pas longtemps<br />
pour saisir une différence radicale : les difficultés<br />
familiales du jeune Doinel, posées dès le<br />
départ, serviront toujours à justifier en arrière<br />
plan l’engrenage de la délinquance. Rien, au<br />
contraire, ne vient expliquer, « excuser », le comportement<br />
opaque de François, le jeune héros de<br />
Pialat. Comme rien ne viendra cautériser une<br />
cicatrice intérieure invisible. Dès le début du film,<br />
« le mal est fait », écrit Jean Narboni 3 .<br />
> Coups de gueule<br />
et prise de risque<br />
Après le succès d’estime de L’Enfance nue,<br />
Pialat va obtenir un des ses plus grands succès<br />
publics avec Nous ne vieillirons pas ensemble (1972),<br />
où le couple formé par Jean Yanne et Marlène<br />
Jobert se déchire et se détruit. Pialat reconnaît la<br />
part très largement autobiographique de ce film,<br />
qui apparaît plus nette encore dans le roman<br />
publié en même temps, rédigé à la première per-<br />
sonne 4 . De ce film naît la légende de « Pialat<br />
l’emmerdeur », l’homme des coups de gueule et<br />
des plateaux orageux. Pialat déclare le film raté,<br />
Yanne se gausse de son Prix d’interprétation à<br />
Cannes, affirmant que Pialat ne l’a jamais « dirigé<br />
» !<br />
Au lieu de profiter des avantages acquis, Pialat se<br />
lance dans le projet le plus risqué de sa carrière,<br />
La Gueule ouverte (1973) : un film sur la mort<br />
d’une mère. Non seulement il s’agit de montrer<br />
l’irreprésentable, mais de montrer dans le même<br />
temps à quel point cette mort, la douleur de<br />
l’autre, gêne. La Gueule ouverte paraît illustrer<br />
cette autre remarque de Clément Rosset :<br />
« L’homme est la seule créature connue à avoir<br />
conscience de sa propre mort (comme la mort promise à<br />
toute chose), mais aussi la seule à rejeter sans appel<br />
l’idée de la mort. Il sait qu’il vit, mais ne sait pas comment<br />
il fait pour vivre ; il sait qu’il doit mourir, mais<br />
il ne sait pas comment il fera pour mourir ». Le film<br />
– sans doute son plus beau – est radicalement rejeté<br />
par le public.<br />
> Faire un cinéma populaire<br />
à succès...<br />
Une autre légende s’attache alors à Pialat,<br />
celle du cinéaste « naturaliste », voire « sordide »,<br />
que pourrait confirmer Passe ton bac d’abord<br />
(1979), décrivant le désenchantement d’adolescents<br />
lensois et réalisé avec un très faible budget,<br />
mais bien accueilli par le public. Pourtant Pialat<br />
ne se veut ni réaliste, ni cinéaste de la pauvreté, il<br />
aspire plutôt à un vrai cinéma populaire et au succès.<br />
Dans la période qui suit, il obtient des<br />
moyens importants (même s’il les juge toujours<br />
insuffisants), en particulier grâce aux acteurs de<br />
premier plan auxquels il n’avait plus recours<br />
depuis Nous ne vieillirons pas ensemble. Les<br />
méthodes de travail de Pialat n’en demeurent pas<br />
moins identiques à elles-mêmes (avec difficultés et<br />
rumeurs) et son propos tout aussi net, qu’il s’agis-<br />
2. Dans Le Principe de cruauté, Minuit, 1988. Ce titre pourrait parfaitement s’appliquer à l’ensemble de l’œuvre de Pialat, comme cet autre, Logique du pire,PUF,1971.<br />
3. « Le mal est fait », Cahiers du cinéma, n°304, octobre 1979.<br />
4. Nous ne vieillirons pas en semble, par Maurice Pialat, « Bibliothèque de l’amour contemporain », Galliera, 1972.<br />
se d’évoquer la fascination d’une bourgeoise en rupture<br />
de classe sociale (Isabelle Huppert) pour un<br />
Loulou interprété par Gérard Depardieu ; qu’il<br />
s’agisse du policier Mangin (Depardieu) traitant son<br />
« amie » (Sophie Marceau) comme les suspects<br />
maghrébins qu’il interroge dans Police, ou de l’abbé<br />
Donissan (Depardieu) pris entre doute et fougue<br />
dans Sous le soleil de Satan (adapté de Bernanos), jusqu’à<br />
provoquer le suicide de la jeune Mouchette,<br />
incarnée par Sandrine Bonnaire, la révélation de À<br />
nos amours.<br />
Puis c’est la consécration de Van Gogh (1991), avec<br />
Jacques Dutronc dans le rôle-titre. Un grand sujet<br />
traité à la façon de Pialat, dans lequel la souffrance<br />
et la « tristesse » du peintre d’Auvers sont dégagées<br />
de tout mysticisme légendaire, de toute idéalisation,<br />
de toute religiosité, et aussi un succès public non<br />
négligeable. Interviewé alors par Paris-Match, Pialat<br />
déclare que son ambition est de « faire, une fois, un<br />
vrai succès ». Il ajoute qu’il n’envisage pas de faire<br />
tourner son fils Antoine, né en 1991 : « Il est déconseillé<br />
d’utiliser des enfants au cinéma, mais il n’y a pas de<br />
règles ». Antoine jouera finalement, en 1995, dans<br />
Le Garçu, aux cotés de Gérard Depardieu. Un film<br />
très personnel, mêlant autobiographie et biographie<br />
imaginaire (le « Garçu », c’était le père dans La<br />
Gueule ouverte), qui déroute spectateurs et critiques.<br />
Effectivement, « il n’y a pas de règles », du moins le<br />
cinéma de Pialat ne cesse-t-il de les déborder,<br />
comme le cadre de ses films n’arrive jamais à établir<br />
une frontière étanche entre la fiction et la vie.<br />
Sous le soleil de Satan<br />
© Gaumont<br />
Filmographie<br />
1951 / 1958<br />
Courts métrages<br />
en 16 mm<br />
1960 L’Amour existe (court<br />
métrage documentaire)<br />
1961 Janine (court métrage sur<br />
un scénario et des<br />
dialogues de Claude Berri)<br />
1965 / 1966<br />
Chroniques d’en France<br />
(courts métrages<br />
documentaires Pathé<br />
pour les télévisions<br />
francophones)<br />
1969 L’Enfance nue<br />
1970 / 1971<br />
La Maison des bois<br />
(feuilleton télévisé<br />
en sept épisodes<br />
pour l’ORTF)<br />
1972 Nous ne vieillirons<br />
pas ensemble<br />
1973 La Gueule ouverte<br />
1979 Passe ton bac d’abord<br />
1980 Loulou<br />
1983 A nos amours<br />
1985 Police<br />
1987 Sous le soleil de Satan<br />
1991 Van Gogh<br />
1995 Le Garçu<br />
5
6<br />
■ DÉCOUPAGE ET ANALYSE DU RÉCIT<br />
Entre-temps, la vie<br />
Criblé d’ellipses spatiales et temporelles, le récit ouvre, dans A nos amours,<br />
sur un art des lacunes, une pratique audacieuse et inédite de l’évocation, par-delà<br />
la continuité et la logique des faits.<br />
> 1.<br />
Suzanne apprend le rôle de Camille dans On ne badine pas<br />
avec l’amour. Son frère Robert vient la chercher pour faire du<br />
bateau avec des amis. Elle joue sur scène avec son amie<br />
Anne, dans le rôle de Perdican.<br />
> 2.<br />
Suzanne retrouve Luc, très amoureux d’elle, qui campe près<br />
d’une autoroute et se plaint de ne plus la voir assez.<br />
> 3.<br />
Dans un café, de nuit, Suzanne danse parmi des matelots<br />
puis couche avec un Américain sur la plage. Elle retrouve au<br />
dortoir Anne, à qui elle confie dans une rage douloureuse :<br />
« J’en ai marre ». Le lendemain, elle aperçoit l’Américain, qui<br />
l’ignore.<br />
> 4.<br />
Dans un appartement parisien, Suzanne est au lit avec un<br />
autre amant, Henri.<br />
ANALYSE Dans ces quatre premières scènes, Pialat présente Suzanne et<br />
son problème principal : la contradiction entre l’amour-affection et une<br />
attirance sensuelle insatiable. Le choix des phrases de Musset éclaire ce<br />
dilemme : « Vous devez mépriser les femmes, qui vous prennent tel que vous<br />
êtes et qui chassent leur dernier amant pour vous attirer dans leurs bras, avec<br />
les baisers d’un autre sur les lèvres… »<br />
Cette ouverture est typique du cinéma de Pialat, qui attaque les scènes,<br />
y compris au tout début, lorsque leur déroulement logique et chronologique<br />
est déjà largement entamé. La relation entre Suzanne et Luc est<br />
déjà sur la pente descendante. Les causes et les origines des événements<br />
nous échappent. Les scènes sont des blocs qui se succèdent de façon<br />
purement chronologique, mais sans enchaînement, laissant des béances<br />
dans la narration, des ellipses indéfinissables. Où se situe la séquence 1<br />
par rapport à la 2 ? Il ne s’agit probablement pas du même lieu, même<br />
si ce n’est pas absolument exclu. Si les séquences 2 et 3 se succèdent sans<br />
hiatus, combien de temps sépare les séquences 1 et 2, 3 et 4, dans l’appartement<br />
?<br />
Les personnages sont livrés sans la moindre précision, sinon pour<br />
Suzanne, Luc, Robert… Les autres sont anonymes, mais leur fonction est<br />
variable : on ne reverra pas les marins et l’Américain ; quant aux amis de<br />
Robert, à peine entrevus sur le bateau, il est impossible d’imaginer qu’ils<br />
joueront un rôle dans la suite du film, comme Marie-France et Michel.<br />
> 5.<br />
Tandis que Suzanne dort, sa copine Martine (sœur d’Anne) la<br />
rejoint au lit pour se reposer après les cours du matin. Roger,<br />
le père de Suzanne, s’étonne et trouve que ce n’est pas très<br />
sérieux.<br />
> 6.<br />
Dans l’atelier de fourrure attenant à l’appartement, Roger<br />
confie à Robert qu’il apprécie les « trucs » qu’il écrit…<br />
> 7.<br />
Suzanne rejoint Luc dans un atelier d’une académie de dessin.<br />
Dehors, il lui dit avec tristesse qu’il pense que c’est fini.<br />
Elle le laisse s’éloigner.<br />
> 8.<br />
Suzanne rentre chez elle. Sa mère (Betty) lui demande d’où<br />
elle vient… Suzanne montre à Michel un livre sur Bonnard<br />
puis, après le départ des visiteurs, demande la permission<br />
d’aller au cinéma avec Solange (nièce de Roger) et deux garçons…<br />
Le père gifle soudainement sa fille. Elle passe la nuit<br />
avec Bernard, qui va bientôt partir au service militaire.<br />
> 9.<br />
Suzanne rentre avec précaution la nuit. Son père, qui travaille,<br />
lui reproche son retard sans agressivité. Il lui annonce<br />
qu’il va partir. Une complicité s’établit autour de la disparition<br />
d’une des fossettes de Suzanne…<br />
ANALYSE Cette seconde partie apparaît moins lacunaire que la première,<br />
puisque les scènes s’enchaînent sans laisser le spectateur dans l’incertitude<br />
temporelle ou logique. Elle est centrée sur le père et ses relations<br />
avec son entourage familial, faites d’une certaine douceur et de<br />
compréhension : attitude aimablement critique et amusée face aux<br />
deux filles et à la provocation de Suzanne (« Elle te trouve mignon,<br />
Martine… »), compliments à Robert, confidences à Suzanne sur son<br />
départ... Mais cette attitude n’exclut pas la violence soudaine, lorsque<br />
claque la gifle.<br />
> 10.<br />
Après avoir rencontré Michel à la terrasse d’un café, Suzanne<br />
rentre tard et sa mère lui annonce : « Papa nous a quittés ».<br />
Le matin, elle lui reproche de dormir nue.<br />
> 11.<br />
Dans un café avec d’autres lycéens (dont Anne, Martine et<br />
Solange), Suzanne est surprise de voir Luc, qui voudrait l’embrasser.<br />
Elle refuse.<br />
> 12.<br />
Au lit après l’amour, Suzanne confie à Bernard qu’elle a peur<br />
d’avoir le cœur sec.
13.<br />
Matin. Suzanne constate que sa mère a fouillé dans ses affaires,<br />
jeté une robe, déchiré des lettres de Bernard. Elles se battent.<br />
Robert tente de les séparer, frappe sa sœur, calme la mère…<br />
> 14.<br />
Soir. Betty annonce que Robert ne rentre pas manger.<br />
Suzanne décide de partir, elle aussi.<br />
> 15.<br />
Dans un appartement, Suzanne, Solange, Anne, Bernard,<br />
Martine et quelques autres préparent à manger, puis, dans la<br />
nuit, Suzanne laisse Martine discuter avec Angelo pour<br />
rejoindre Bernard avec lequel elle parle des « conneries »<br />
qu’elle a faites avec Luc.<br />
> 16.<br />
Suzanne rentre chez elle.Sa mère l’attend et appelle immédiatement<br />
Robert, qui la frappe et veut la forcer à demander<br />
pardon à la mère. Suzanne se défend, la mère pleure en<br />
demandant pourquoi sa fille ne l’aime pas. « Fallait pas me<br />
chier ! », lance Suzanne.<br />
> 17.<br />
Après un nouvel échange fielleux entre mère et fille, Suzanne<br />
annonce à Robert qu’elle ne peut plus vivre comme ça et va<br />
entrer en pension.<br />
> 18.<br />
Suzanne rencontre Anne, qui est avec Luc, dans un magasin<br />
d’habillement. Elle passe un moment seule sous la pluie,<br />
sous un Abribus.<br />
> 20.<br />
Au retour, Robert l’accueille en la frappant. Ils s’écroulent sur<br />
le lit de la mère et se battent tous les trois.<br />
ANALYSE Désormais, ce sont les relations de Suzanne avec sa mère (et<br />
Robert) qui prennent le devant, dans une alternance implacable de<br />
scènes assez courtes qui illustrent parfaitement la construction générale<br />
du film, en constant balancement : Suzanne à l’extérieur, en compagnie<br />
de ses amants successifs, partagée entre le plaisir et le désespoir (relations<br />
avec Luc et plans de l’Abribus).<br />
> 22.<br />
Suzanne, la nuit, dans la rue, demande à Jean-Pierre de ne<br />
pas la quitter. Celui-ci va voir Robert et lui reproche de battre<br />
Suzanne. Il rétorque qu’elle est volage et qu’il protégera toujours<br />
sa mère.<br />
> 23.<br />
Suzanne et Jean-Pierre cherchent un hôtel pour la nuit.<br />
> 24.<br />
Suzanne essaie une robe sous le regard apaisé de sa mère, de<br />
Jean-Pierre et de la mère de celui-ci. Luc téléphone et<br />
Suzanne accepte de le voir dans un café. Il l’aime. Elle ne veut<br />
pas faire de mal à Jean-Pierre et puis, elle a changé.<br />
ANALYSE Ces trois scènes constituent la seule articulation logique et traditionnelle<br />
dans la construction du film : la violence familiale ayant<br />
atteint son comble dans le segment précédent, Suzanne se raccroche à<br />
Jean-Pierre, l’épouse, repousse une dernière fois Luc. La situation familiale<br />
est apaisée mais la souffrance intérieure de Suzanne est toujours<br />
présente.<br />
> 25.<br />
Une fête dans l’appartement. Robert présente Jean-Pierre,<br />
marié depuis six mois avec Suzanne, à Jacques, son beaufrère.<br />
Des remarques troubles sont échangées sur les rapports<br />
entre frères et sœurs. Robert se félicite de sa réussite,<br />
vante son épouse Marie-France auprès de sa mère. Soudain<br />
débarque le père, qui s’installe à table, reproche à Robert<br />
d’épouser Marie-France pour sa carrière. Citant Van Gogh,<br />
il conclut : « La tristesse durera toujours… » Betty le force à<br />
partir.<br />
> 26.<br />
Roger accompagne sa fille en bus à l’aéroport, d’où elle part<br />
pour San Diego avec Michel. Il lui dit gentiment qu’elle croit<br />
aimer mais qu’elle attend seulement qu’on l’aime, évoque la<br />
fossette… Lui en bus, elle en avion, ils partent dubitatifs et un<br />
peu tristes…<br />
ANALYSE Ces deux dernières scènes concluent le film dans le même principe<br />
: deux blocs indépendants (voire contradictoires), sans continuité<br />
logique avec ce qui précède. Une phrase nous apprend, dans la séquence<br />
25, que Suzanne est mariée depuis six mois. Dans la 26, elle a quitté<br />
Jean-Pierre. Depuis combien de temps ? Surtout, la grande scène du<br />
dîner (25) est un petit film à l’intérieur du film, comme tombé là arbitrairement<br />
(ce qui est d’ailleurs le cas, voir « Questions de méthode »,<br />
p. 8-9). Cette construction et cette fin ouverte qui ne conclut rien (le<br />
film pourrait parfaitement continuer) produisent cet effet très particulier<br />
à Pialat : le sentiment de voir vivre des personnages comme dans la vie<br />
et non dans une construction et une épaisseur romanesque. Les événements<br />
arrivent sans raison apparente, d’autres nous restent cachés. Le<br />
monde de Pialat vit et existe en dehors de ce qui nous est montré.<br />
7
8<br />
■ QUESTIONS DE MÉTHODE<br />
Par à-coups<br />
De l’écriture au montage, A nos amours a suivi un parcours sinueux qui dessine la matière, chaotique<br />
et créative, de la « méthode Pialat ».<br />
> « Work in progress »<br />
Ecrit par Arlette Langmann, A nos amours trouve son origine<br />
dans un autre scénario de cette collaboratrice de Pialat, Les<br />
Filles du faubourg. Arlette Langmann, qui est née en 1947 dans<br />
une famille de Juifs polonais, s’y inspirait des souvenirs de sa<br />
propre adolescence, dans les années 60 : « Il y a une base autobiographique<br />
dans le personnage de Suzanne : la fille qui a des aventures<br />
mais qui n’arrive pas à s’attacher ; marquée par l’image du<br />
père ; qui n’aime que son père, surtout lorsqu’il est absent… ; ses rapports<br />
avec sa mère (pitié - répulsion). La fille qui ne supporte pas le<br />
chagrin de sa mère, et se fait dure pour ne pas succomber elle-même au<br />
chagrin… ». Ce scénario, écrit sous la forme d’une longue nouvelle<br />
qui tresse le destin de six filles, permet à Pialat d’obtenir,<br />
en 1976, l’Avance sur recettes 1 et un accord de coproduction<br />
Les propos d’Arlette Langmann sont extraits du livre consacré au scénario de A nos amours (voir bibliographie).<br />
1. Aide remboursable attribuée par une commission du Centre National de la Cinématographie.<br />
2. Selon Pialat, l’action se situe toujours dans les années 60, ce qui explique un aspect quelque peu désuet.<br />
3. Ce terme, aujourd’hui répandu, reprend le titre d’un ouvrage de James Joyce de 1923, soit Travail en cours, qui deviendra Finnegans Wake.<br />
avec FR3. Mais Pialat ne trouve pas le financement complémentaire,<br />
s’attaque à un autre projet (Les Meurtrières), puis utilise des<br />
éléments des Filles du faubourg pour tourner Passe ton bac d’abord.<br />
Après avoir écrit Loulou, Arlette Langmann redéveloppe Les<br />
Filles du faubourg, à la demande de Pialat, sous forme d’une adaptation<br />
de trois heures. Puis, recentré sur une des adolescentes, le<br />
scénario devient Suzanne, mais se voit refuser l’Avance sur<br />
recettes, officiellement déjà obtenue sur le même sujet. Le projet<br />
est alors remanié, raccourci et transposé de nos jours 2 pour<br />
faciliter le tournage en extérieur et réduire les coûts. Selon<br />
Pialat, « ce qui reste, et ce qui est le plus important du scénario des<br />
Filles du faubourg, c’est l’adolescence d’Arlette Langmann. Il reste<br />
beaucoup plus de la partie familiale que celle de ses relations avec ses<br />
amis, ses flirts ».<br />
Au tournage, de nouvelles modifications sont apportées.<br />
Notamment dans le langage de Sandrine Bonnaire, plus populaire<br />
qu’à l’origine, précise Arlette Langmann. Mais surtout, le<br />
père ne meurt plus, contrairement à ce qui était écrit, comme<br />
en témoigne encore une réplique de Suzanne sur ses yeux<br />
jaunes, dans la scène de la fossette. Après avoir reculé sans cesse<br />
le tournage de la mort de son personnage (en partie par superstition,<br />
suggère Arlette Langmann), Pialat décida de le faire<br />
simplement partir, puis soudainement revenir. Cette séquence<br />
du retour fut donc entièrement ajoutée par le réalisateur, et<br />
improvisée au tournage.<br />
Le cheminement chaotique du scénario imprime déjà au film<br />
une forme particulière. C’est dans la méthode de travail de<br />
Pialat que sa formation et son passé de peintre sont présents,<br />
alors que ses images sont rarement affectées d’une tendance au<br />
picturalisme. Il conçoit en effet, à la manière de nombreux<br />
peintres et de certains écrivains, ses films comme des works in<br />
progress 3 , des travaux que l’on peut abandonner, reprendre,<br />
retravailler, parfois recommencer totalement à zéro (comme le<br />
firent Chaplin, Kubrick ou Welles). « Un film ne doit pas être<br />
construit rigoureusement comme un plan d’architecte, il ne faut pas se<br />
priver de l’imprévisibilité d’un tournage. L’inspiration y vient de<br />
même qu’en peinture, par à-coups », dit-il.
La créativité fait autorité<br />
Plutôt que de reprendre les anecdotes de tournages qui alimentent<br />
les gazettes – acteurs aigris ou fâchés, techniciens, surtout<br />
opérateurs et monteurs, qui se succèdent, jusqu’à une dizaine<br />
par film 4 à chaque poste –, il est préférable de chercher à comprendre<br />
la méthode de Pialat sur le plateau. Les « psychodrames »<br />
de ses tournages ne sont rien d’autre qu’une forme de direction<br />
d’acteurs et aussi de techniciens. Jacques Loiseleux 5 est de ceux<br />
qui comprennent et explicitent le mieux la démarche du cinéaste :<br />
« Maurice est quelqu'un qui a envie de travailler de manière extrêmement<br />
précise. Il imagine très bien la façon dont il veut que les choses<br />
soient, il a du mal à le dire et ne dit jamais ce qu'il veut, parce qu'il<br />
considère qu'à partir du moment où il l'a dit, c'est déjà trop tard : les gens<br />
vont faire de la reproduction. Il veut donc susciter des choses chez les<br />
autres, à tous les niveaux. Le principe de Pialat, c’est de convaincre les<br />
comédiens sans leur dire ce qu’ils ont à faire, pour éviter le jeu classique<br />
et les amener, en interrogeant le personnage, en investissant les problèmes<br />
que pose la figure, à chercher<br />
les moyens de la faire apparaître.<br />
Alors, puisqu’il est<br />
pris dans un processus de<br />
recherche, l’acteur reste<br />
vivant. Entre le jeu classique<br />
de la récitation, qui reproduit<br />
quelque chose de déjà-là,<br />
de déjà pensé avant d’être<br />
exprimé, et ce type de direction<br />
d’acteur, les frontières<br />
parfois semblent délicates<br />
mais Pialat les trouve et elles<br />
tombent juste : c’est un travail<br />
de laboratoire ». Quant<br />
à l’opérateur, il en va de<br />
même : « Pialat me met en<br />
scène, au même titre que les<br />
autres acteurs, c’est-à-dire<br />
qu’il me faut être disponible<br />
pour capter l’attention en<br />
train d’advenir ». Chaque<br />
collaborateur doit participer<br />
à la création, être lui-même créateur, ce qui passe souvent par<br />
le négatif : « Il dit souvent : “Tu ne fais pas ça” et on doit en déduire<br />
ce qu’il faut faire ». Le technicien comme les acteurs sont sommés<br />
d’inventer leur personnage et leur parcours, comme dans cette<br />
séquence entre Suzanne, la mère et le frère : « On n’a évidemment<br />
pas répété, Maurice nous avait donné le champ d’action, c’est-à-dire tout<br />
l’appartement, et on est parti d’un seul coup… ».<br />
La caméra suit Besnehard jusqu’au lit de la mère. Lorsque<br />
Loiseleux ne supporte plus la vue de cette femme en colère (« ça<br />
ne fonctionnait pas »), il renvoie le chariot de travelling filmer<br />
Sandrine Bonnaire dans la pièce voisine. Voyant la caméra partie,<br />
Besnehard va de lui-même rechercher Bonnaire dans le couloir.<br />
« Tout cela n’a pu être possible que par cette mise en scène dans laquelle<br />
nous sommes tous impliqués ». Une telle méthode impose que chacun,<br />
acteur, opérateur, perchman, devienne metteur en scène en<br />
concurrence avec les autres et avec le réalisateur lui-même : c’est<br />
la source de conflits comme de déceptions pour ceux qui ne peu-<br />
vent ou ne veulent pas entrer dans ce jeu périlleux et éprouvant.<br />
Mais contrairement à ce que veut la légende, Pialat n’improvise<br />
que très rarement. La scène du retour du père fait donc exception,<br />
et de manière spectaculaire puisque seuls quelques techniciens,<br />
dont évidemment Jacques Loiseleux, avaient été avertis par Pialat<br />
de ce qu’il allait faire. La surprise et la déroute de chacun amènent<br />
à confondre personnages, mis en accusation par le père et sommés<br />
de choisir leur camp, et acteurs, placés devant un vide et un malaise<br />
total par le metteur en scène. Comme les grands moments du<br />
cinéma de Pialat, la scène atteint le point où les comédiens ne<br />
jouent plus, où la vie se confond totalement avec la fiction.<br />
> Retrouver l’évidence des choses<br />
Le tournage dans l’appartement s’étant éternisé, l’argent<br />
manquait pour les extérieurs, à peine commencés en été, et un<br />
second tournage eut lieu en hiver, raccordant difficilement avec<br />
les premiers extérieurs. Mais les difficultés n’étaient pas encore<br />
finies.Yann Dedet 6 reprit le montage après Sophie Coussein, qui<br />
reviendra plus tard. « Pendant trois semaines, nous repassions tous les<br />
deux jours en salle de projection, et nous avions à chaque fois un ordre<br />
différent. On a eu la colonie au milieu, des scènes disparaissaient,<br />
d’autres prenaient plus de place. Maurice a même voulu ramener le<br />
dîner final au milieu du film !… Brusquement, la décision de tout<br />
ramener autour du père est devenue évidente. Le retour du père, c’est la<br />
fin du film, ça ne peut être autre chose… Mais il a fallu neuf mois de<br />
montage pour tout essayer, tout remettre en cause ». Le montage, après<br />
le tournage, ne cesse de démantibuler la structure générale du scénario<br />
et du tournage, car il ne s’agit pas de monter selon les critères<br />
traditionnels, mais à l’émotion. Le but ultime de Pialat reste,<br />
selon Yann Dedet, « que les choses soient là, qu’elles soient évidentes,<br />
mais que ce soit comme si c’était arrivé par hasard. L’idée serait de se<br />
dire : “Comment est-il possible qu’il y ait eu une caméra à ce<br />
moment-là ?” ».<br />
4. C’est le chiffre donné par Pialat lui-même à propos d’A nos amours, pour les monteurs, alors que le générique n’en crédite que sept (Cinématographe, n°94, novembre 1983).<br />
5. Directeur de la photographie et cadreur, il a travaillé en particulier à partir de 1973 sur les films d’Yves Boisset, Joël Santoni, Patrick Grandperret, Jean-Luc Godard, Joris Ivens, Philippe Garrel.<br />
6. Yann Dedet a travaillé comme monteur sur Passe ton bac d’abord, Loulou, À nos amours, Sous le soleil de Satan et Van Gogh, ainsi qu’avec, entre autres, François Truffaut, Jean-François Stévenin, Patrick Grandperret, Catherine Breillat, Philippe Garrel, Claire Denis.<br />
9
10<br />
■ PERSONNAGES ET ACTEURS PRINCIPAUX<br />
Une grande famille<br />
Dans A nos amours, une histoire de famille est racontée par les comédiens,<br />
une autre l’est à travers eux : sous le propos apparent, circulent des affects<br />
personnels qui nourrissent indirectement le film et lui donnent une grande part<br />
de sa force émotionnelle.<br />
Cyril Collard, Jacques Fieschi et Dominique Besnehard.<br />
> Liens secrets à la lumière<br />
du cinéma<br />
On sait que le scénario de A nos amours a pour point de<br />
départ les souvenirs d’adolescence d’Arlette Langmann, qui fut<br />
pendant plusieurs années l’épouse de Maurice Pialat. Quant à<br />
Micheline Pialat, productrice exécutive du film, elle a partagé<br />
durant vingt ans la vie du réalisateur, et fondé avec lui la société<br />
de production Les Films du Livradois, qui apparaît au géné-<br />
rique de A nos amours. La régie générale du film est assurée par<br />
Sylvie Danton, qui deviendra la collaboratrice puis l’épouse de<br />
Pialat et la mère du petit Antoine, héros du Garçu. A nos amours<br />
se rattachant aux souvenirs d’Arlette Langmann, sœur de l’acteur,<br />
réalisateur et producteur Claude Berri, le personnage<br />
interprété par Dominique Besnehard, Robert, s’inspire donc<br />
de Berri lui-même, qui fut très lié à Pialat : le premier court<br />
métrage de fiction de Pialat, Janine, en 1962, est écrit, dialogué<br />
et interprété par Claude Berri, qui participa également à la<br />
production de L’Enfance nue. Pialat admirait le talent de<br />
conteur de Berri et les compliments que Roger adresse à son<br />
fils au début du film en sont le reflet : « Tu vois, les gens qui sont<br />
capables, comme ça, en quelques lignes, de camper des personnages,<br />
chapeau ! » (séquence 6). Il est difficile de ne pas mettre en<br />
relation les reproches qu’il adresse ensuite à Robert - avoir<br />
vendu un talent rare lui permettant d’être un nouveau Pagnol<br />
- avec l’évolution de son ancien ami, du cinéaste auteur au producteur-réalisateur<br />
d’œuvres calculées pour plaire au public le<br />
plus large, justement des adaptations de Pagnol, Jean de<br />
Florette et Manon des sources.<br />
Autre règlement de compte, lors de la même scène, lorsque le<br />
père reproche au « beau-frère », Jacques, d’avoir consacré un<br />
numéro spécial au travail de Robert, pour ensuite laisser passer,<br />
sous couvert d’interview, un « truc » où « il y avait une espèce<br />
de type » qui donnait « trois sur vingt » à Robert et, disait que<br />
1. Voir « Tourner avec Pialat », par Jacques Fieschi, Cinématographe, n°94. Jacques Fieschi a ensuite collaboré au scénario de Police et travaillé comme scénariste avec Cyril Collard, Claude Sautet, Olivier Assayas, Edouard Molinaro…<br />
2. Cahiers du cinéma, n°354.<br />
c’était un minable. L’interprète du beau-frère est Jacques<br />
Fieschi 1 , rédacteur en chef de la revue Cinématographe, qui, un<br />
an après avoir consacré un numéro spécial à Pialat, publia en<br />
1981 un entretien avec le chef-opérateur Pierre-William<br />
Glenn, qui venait d’être remplacé sur le tournage de A nos<br />
amours. Glenn donnait en effet « trois sur vingt » à Loulou et<br />
déniait un quelconque talent à Pialat !<br />
L’une des principales caractéristiques du film tient à l’utilisation<br />
d’acteurs peu connus, comme Pierre-Loup Rajot dans le<br />
rôle de Bernard, ou carrément amateurs.<br />
EVELYNE KER n’avait plus vu Pialat depuis Janine, quand il<br />
lui demanda de jouer le rôle de la mère. Elle donne à son personnage<br />
ce déséquilibre constant, au bord de la folie, mélange<br />
de rigidité puritaine et de jalousie indécente. Sur le tournage,<br />
selon Pialat, s’instaura une rivalité entre Evelyne Ker et<br />
Sandrine Bonnaire, Pialat ne s’intéressant qu’à sa jeune découverte.<br />
La jalousie inconsciente qui s’ensuivit permit de contrebalancer<br />
le jeu trop théâtral de l’actrice, la poussant à un incessant<br />
débordement dans le réel : « D'ailleurs, à un moment donné,<br />
elle dit : ça veut faire du cinéma ! Puis elle lui tombe dessus. On l'a<br />
coupé parce que ça faisait private joke » 2 .<br />
DOMINIQUE BESNEHARD est parfait dans le rôle du<br />
frère, Robert, dans la mollesse, la veulerie, l’autorité exercée<br />
sans vraie conviction à la place du père défaillant, et surtout<br />
dans les rapports troubles avec sa mère comme avec Suzanne,<br />
sans cesse à la limite du malaise. Aujourd’hui agent artistique<br />
renommé chez Artmédia, Dominique Besnehard commença sa<br />
carrière au cinéma en tant que directeur de casting, chargé de<br />
distribuer les rôles, notamment sur La Drôlesse, de Jacques<br />
Doillon, puis Passe ton bac d’abord de Pialat. S’il n’a pas découvert<br />
Sandrine Bonnaire, Dominique Besnehard a révélé<br />
Juliette Binoche, Pierre-Loup Rajot, Béatrice Dalle… Il gère<br />
ou a géré aussi les carrières de Nathalie Baye, Sophie Marceau,<br />
Valérie Kaprisky… De la part de Pialat, choisir un « décou-
vreur d’acteurs » pour jouer le frère de Sandrine Bonnaire<br />
n’est évidemment pas indifférent, puisque A nos amours repose<br />
sur la « découverte » de la débutante Sandrine Bonnaire. Mais,<br />
plus secrètement, ce choix renvoie au modèle du personnage<br />
de Robert, Claude Berri, qui a beaucoup aidé Dominique<br />
Besnehard à ses débuts et l’a orienté, alors qu’il était acteur<br />
débutant, vers le métier de directeur de casting. Sans négliger<br />
le fait que Dominique Besnehard est l’agent de Marlène<br />
Jobert, qui avait vécu avec Claude Berri, ce qui fait, dit-il, que<br />
« je savais tout de la famille » 3 .<br />
CYRIL COLLARD, futur réalisateur des Nuits fauves (1992),<br />
qui mourra du sida en 1993, joue le rôle de Jean-Pierre, le<br />
mari, un garçon très doux qui « calme » Suzanne, un gendre<br />
idéal pour Betty, effacé, dont se moquent aussi bien Jacques<br />
que Robert, Michel ou Bernard lors des fiançailles… La relation<br />
entre Pialat et Collard, principalement assistant-réalisateur<br />
sur le film, fut si intense que le jeune homme dut quitter<br />
le tournage pendant trois semaines, comme il le raconta dans<br />
Libération à la sortie de A nos amours : « Maurice n’a pas d’enfant.<br />
Parfois j’ai été cet enfant quelques secondes. Et puis plus rien,<br />
une pierre dans le torrent. Maurice m’avait fait peur ». Nul mieux<br />
que Collard n’explique, indirectement, la justesse de l’interprétation<br />
de Pialat lui-même, père du film en tant que metteur<br />
en scène, père dans la fiction, père spirituel de la jeune actrice,<br />
passant d’un instant à l’autre de la douceur à la cruauté : « Il<br />
suit une ligne inexorable, l’émotion. Là, il peut aller jusqu’à la<br />
méchanceté. Suzanne pleure parce qu’elle comprend que son amie<br />
Anne a profité de sa dispute avec Luc pour prendre sa place auprès de<br />
lui. L’instant d’avant, Maurice avait rappelé à Sandrine avec une<br />
violence incroyable sa vie avant le tournage dans sa famille de onze<br />
enfants, et le HLM de Grigny où il aurait mieux fait de la laisser<br />
croupir. Mais il a fait A nos amours pour elle. Par amour pour elle.<br />
La nostalgie d’un amour ».<br />
SANDRINE BONNAIRE est évidemment au centre du film.<br />
Née en 1967, elle avait seize ans quand elle fut découverte par<br />
Maurice Pialat, à la suite d’une petite annonce qu’il avait fait<br />
3. Studio, juillet-août 1998.<br />
paraître dans France-Soir, à<br />
laquelle elle répondit à la<br />
place de sa sœur aînée...<br />
Légende invérifiable, bien<br />
dans la mythologie de l’actrice<br />
inconnue, découverte<br />
et formée par son<br />
Pygmalion, à la manière de<br />
Garbo et Mauritz Stiller,<br />
Marlène Dietrich et Josef<br />
von Sternberg, Anna Karina<br />
et Jean-Luc Godard… Le<br />
fait est que Sandrine<br />
Bonnaire correspondait à ce<br />
qu’attendait Pialat, non<br />
comme illustration d’un<br />
personnage totalement défini,<br />
mais comme actrice de<br />
tempérament, pleinement<br />
capable, malgré son inexpérience,<br />
de participer au système<br />
créatif et exigeant du<br />
cinéaste (elle le montrera encore dans Police et surtout dans<br />
Sous le soleil de Satan). Le fait est que la comédienne en sera<br />
influencée pour la suite de sa carrière, loin de toute miévrerie,<br />
marquée par des personnages forts et des rencontres importantes,<br />
avec Agnès Varda (Sans toit ni loi, 1985), André Téchiné<br />
(Les Innocents, 1987), Jacques Rivette (Jeanne la Pucelle, 1994,<br />
et Secret défense, 1998) ou Claude Chabrol (La Cérémonie, 1995,<br />
Au cœur du mensonge, 1998). Ici encore, la coïncidence entre la<br />
situation réelle et celle du personnage est au cœur de la réussite<br />
du film et du rôle de Suzanne. Pas seulement par la relation<br />
père-fille qui s’établit entre le cinéaste et l’actrice, mais parce<br />
que la situation de Sandrine Bonnaire sur le plateau est semblable<br />
à celle de Suzanne dans le film. L’actrice débute dans le<br />
cinéma comme son personnage dans la vie amoureuse.<br />
Suzanne est en totale disponibilité mais en même temps soucieuse<br />
de ne pas se laisser imposer quoi que ce soit par les<br />
autres, amant de cœur comme Luc, père, mère, frère ou<br />
mari… Comme toute adolescente de quinze ans, mais plus<br />
encore dans ces années 80, Suzanne ne sait pas ce qu’elle veut,<br />
mais la liberté que lui accorde l’évolution des mœurs la laisse<br />
dans un grand vide affectif. Il n’y a presque plus d’interdits,<br />
puisque Suzanne se trouve seulement confrontée à des principes<br />
dénués de toute base (comme lorsque sa mère lui affirme<br />
qu’elle ne doit pas dormir nue parce que « ça ne se fait pas ! »),<br />
à un père qui gifle soudainement puis autorise ce qu’il refusait,<br />
avant de se mettre en touche… Où se poser et en vertu de<br />
quels principes s’opposer ? Même le jugement qu’elle attend<br />
de son père, ne serait ce que sur le choix de ses amants, ne<br />
viendra pas… La liberté est-elle aussi difficile à vivre que la<br />
contrainte ?<br />
11
12<br />
Le tourbillon<br />
page 13<br />
Un plan-séquence où les personnages de<br />
A nos amours cherchent leur place,<br />
comme des électrons dont les énergies et<br />
les trajectoires divergent.<br />
Destins en regards<br />
page 14<br />
Suzanne et Luc, deux adolescents dont<br />
Pialat soumet l’amourette à l’épreuve<br />
du tragique, de la séparation<br />
inéluctable et de la cruauté de l’amour.<br />
Esthétisme et<br />
blessure narcissique<br />
page 15<br />
Plans-tableaux signés par un cinéaste<br />
qui fut peintre, et qui sait aussi, parfois,<br />
faire des concessions pour flatter le<br />
« bon goût » des spectateurs.<br />
■ MISES EN SCÈNE<br />
Le choc et la chute des corps<br />
Libre, la mise en scène de Maurice Pialat ne se conforme à aucun projet esthétique repérable ;<br />
rigoureuse, elle impose ses règles aux corps et aux regards.<br />
Au même titre que le scénario, la mise en scène d’A nos amours est pour le<br />
moins chaotique et paraît ne pas procéder d’un projet élaboré. Tout particulièrement,<br />
les premières scènes du film mettent en évidence une hétérogénéité de<br />
styles. Plans du spectacle théâtral, tirés au cordeau, stylisation cinématographique<br />
très élaborée de l’image du générique, filmage assez hasardeux des<br />
scènes avec les marins puis avec l’Américain, rigueur des échanges de regards<br />
entre Suzanne et Luc, réalisation sobre et classique des scènes suivantes…<br />
Pialat ne se plie pas à un projet fictionnel ou stylistique précis. Sa caméra<br />
s’adapte à chaque situation, simplement soucieuse de saisir avec précision<br />
chaque détail. On pourrait parler de naturalisme, ce mot qui fait bondir Pialat,<br />
dans cette description quasi documentaire du comportement amoureux de<br />
Suzanne, d’autant que le film répond à deux des critères classiques du naturalisme,<br />
l’entrée dans la fiction in media res, sans nécessité de présenter les personnages,<br />
et la vision partielle, limitée à ce qu’en perçoit le personnage.<br />
Pourtant, chez Pialat, le détail réaliste, matériel, ne renvoie jamais à une métaphysique,<br />
à un classement sociologique ou psychologique prédéfini : comme le<br />
comportement du héros de l’Enfance nue, celui de Suzanne reste opaque et ne<br />
renvoie qu’à lui-même, ce que confirment les réflexions de Suzanne elle-même<br />
sur sa propre attitude à l’égard des garçons.<br />
Ce qui rapproche tout de même Pialat de l’idée naturaliste, c’est son aspect<br />
expérimental (mais non scientifique) : il filme des corps en action, réagissant les<br />
uns par rapport aux autres, s’attirant ou se repoussant avec une force variable<br />
selon les pôles (les personnages), celui constitué par Suzanne étant particulièrement<br />
chargé d’énergie, celui que représente Luc paraissant au contraire en<br />
« basse charge ». Une scène est particulièrement significative, celle où la mère<br />
vient réveiller sa fille, qui se redresse péniblement. Betty reproche à Suzanne<br />
de dormir nue, « c’est dégoûtant ». Sur le papier, on peut y voir aussi bien le<br />
conflit des générations que le puritanisme et la rivalité entre une mère et une<br />
fille sur le plan de la séduction amoureuse. Mais cette scène, Pialat la filme, par<br />
de subtils recadrages, sur le plan strictement physique : au début du planséquence,<br />
la stature verticale et digne de la mère domine le corps alangui de<br />
Sandrine Bonnaire. Une fois celle-ci dressée, son dos dénudé envahissant une<br />
grande part de l’écran, elle chasse littéralement Evelyne Ker vers la sortie, dans<br />
la profondeur de l’image.<br />
Mise en scène des corps et sujet du film se confondent : comment accepter que<br />
l’autre ait un corps ? Comment la mère, le père, le frère peuvent-ils accepter<br />
que Suzanne ait un corps séparé d’eux et en dispose à sa guise ?<br />
Pialat filme le choc et la chute des corps. Sa mise en scène lance la caméra à la<br />
poursuite des acteurs, mais elle obéit à des règles strictes : l’organisation spatiale<br />
de l’appartement-atelier, qui limite les déplacements dans l’horizontalité<br />
comme dans la profondeur et distribue à chacun une place à laquelle il ne cesse<br />
d’échapper ; les regards qui, comme les corps, se cherchent et s’évitent. La<br />
caméra traque les personnages pour leur faire rendre, sinon l’âme, du moins la,<br />
leur vérité. La longueur des plans ou des scènes est le résultat de ces corps à<br />
corps où la violence est là sans qu’on l’ait vue arriver, et perdure jusqu’à épuisement<br />
des combattants.
■ MISES EN SCÈNE<br />
Le tourbillon<br />
Un plan-séquence où les personnages de A nos amours cherchent leur place, comme des électrons dont les énergies<br />
et les trajectoires divergent.<br />
1a 1b 1c<br />
1d 1e<br />
Ce plan-séquence de 41 secondes constitue<br />
le début de la séquence 8 de notre découpage<br />
séquentiel. Il ne s’y passe rien de capital,<br />
sinon que la mère, Betty, apparaît pour la première<br />
fois et amorce ses reproches à Suzanne,<br />
que l’on fait la connaissance de Michel,<br />
accompagné d’une jeune femme (Géraldine),<br />
et que celui-ci ne prête qu’une attention gênée<br />
à Suzanne, qui tente en vain de le charmer en<br />
lui montrant une reproduction de Bonnard…<br />
Simple transition ? Non, puisque la scène «<br />
fait le point » sur la place des différents personnages<br />
et leurs relations, après quoi tout va<br />
basculer : gifle, première bagarre, départ du<br />
père…<br />
C’est moins le contenu qui importe, le dialogue<br />
étant extrêmement pauvre, que la façon<br />
dont Pialat a choisi de filmer cette scène, dans<br />
un mouvement incessant et complexe qui suit,<br />
relie, quitte les personnages pour les retrouver.<br />
S’il ne s’agissait que de décrire les faits et<br />
de suivre les gestes, une série de champscontrechamps<br />
était aussi efficace et plus rapide<br />
à réaliser. Ici, l’opérateur doit installer un<br />
travelling, marquer les arrêts de la caméra,<br />
effectuer dans le même temps un panoramique<br />
à 360° pour suivre les personnages et<br />
cadrer avec précision les poses.<br />
Le début de ce plan-séquence prend Suzanne<br />
au moment où celle-ci arrive en haut de l’escalier,<br />
sur le palier. La caméra entre en travelling-arrière<br />
dans l’appartement, laissant entrer<br />
à sa suite Suzanne et la mère, qui ferme la<br />
porte (1a). Le mouvement d’appareil suit<br />
ensuite celui de la mère, qui entre dans la cuisine<br />
(1b), puis bifurque pour retrouver<br />
Suzanne qui, hors-champ, sort de la chambre<br />
de Robert, que Michel et Géraldine s’apprêtent<br />
à quitter (1c). La caméra accompagne<br />
Michel, qui rejoint Betty – que l’on a vue passer<br />
un instant avant en premier plan portant<br />
un plat – à l’entrée de la salle à manger, suivi<br />
de sa compagne (1d). On suit maintenant<br />
Michel seul, qui se dirige vers la porte d’entrée,<br />
regardant avec inquiétude en arrière si<br />
Géraldine quitte Betty, comme pour éviter la<br />
rencontre avec Suzanne qui arrive de sa<br />
chambre, au fond (1e)… Dans ce mouvement<br />
qui semble libre, chaque personnage a été assigné<br />
à une place particulière.<br />
Betty est d’abord hors-champ, sur le palier,<br />
comme déjà abandonnée, puis elle est définie<br />
par les lieux où elle se trouve (la cuisine, la<br />
salle à manger), et par son attitude (les politesses<br />
d’usage). Robert est avachi mollement<br />
dans le fauteuil de sa chambre. Michel est<br />
fuyant. En revanche, Suzanne traverse avec<br />
énergie toutes les pièces, disparaissant à droite<br />
du champ en premier plan pour reparaître à<br />
gauche, au fond. Le mouvement incessant des<br />
personnages, dont aucun ne reste en place<br />
(sauf Robert), renforcé par la continuité de la<br />
prise de vue et la circularité du mouvement de<br />
la caméra, donne bien le sentiment d’un<br />
« tourbillon » – Serge Daney, dans Libération,<br />
parlait de « cyclone » – dans lequel des personnages-électrons<br />
s’attirent et se repoussent<br />
dans un trafic ininterrompu.<br />
Enfin, dans cette scène d’A nos amours comme<br />
dans bien d’autres, la caméra prend une sorte<br />
d’indépendance qui la fait évoluer du plan<br />
d’ensemble au plan très rapproché ou au plan<br />
américain, sans que cela corresponde à la<br />
teneur émotionnelle de l’instant, Jacques<br />
Loiseleux ayant inventé de lui-même cadrages<br />
et mouvements d’appareil en fonction du<br />
mouvement des acteurs voulu par Pialat.<br />
13
14<br />
■ MISES EN SCÈNE<br />
Destins en regards<br />
Suzanne et Luc, deux adolescents dont Pialat soumet l’amourette à l’épreuve du tragique,<br />
de la séparation inéluctable et de la cruauté de l’amour.<br />
1 2 3<br />
Ces trois photogrammes, issus de la fin de la séquence 2 de<br />
notre découpage séquentiel, illustrent une figure caractéristique<br />
du cinéma de Pialat : les regards qui se cherchent, s’évitent, se<br />
fuient. Elle a été étendue à la presque totalité d’un film, La Gueule<br />
ouverte, où chacun (le fils, le père, la belle-fille) évite de croiser<br />
aussi bien le regard de la mère mourante, que celui des deux<br />
autres, de peur d’y lire l’inavouable : le désir que cela finisse. Ici,<br />
l’enjeu est moins fort, mais, à l’âge des personnages, la sensibilité<br />
aussi à vif. L’amour de Suzanne pour Luc s’effrite peu à peu. Luc<br />
en ressent la disparition inéluctable et s’accroche maladroitement,<br />
tandis que Suzanne n’ose lui avouer et s’avouer à ellemême<br />
cette vérité.<br />
Ils viennent de se retrouver près de l’autoroute. On pense un instant<br />
qu’ils ont fait l’amour, mais la suite du film permet de croire<br />
que Suzanne s’est toujours refusée à Luc. Pour faire sentir plutôt<br />
qu’expliquer le caractère inévitable et déjà accompli de la séparation<br />
de leurs destins, Pialat a choisi l’autoroute, élément à la fois<br />
métaphorique et très concret. Dans chaque plan, la barrière de<br />
sécurité et la vitesse des automobiles renforcent cette idée de trajectoire<br />
implacable. Dans un premier temps, venant d’un paysage<br />
lumineux, Suzanne et Luc marchent côte à côte, dans la même<br />
direction. Luc offre un petit paquet à Suzanne (1), qui l’ouvre :<br />
« Elle est belle », dit-elle. Le trajet se poursuit un instant, comme<br />
si ce cadeau pouvait raviver la passion, mais la seconde phrase de<br />
Suzanne tombe : « Il va falloir que j’y aille ! » Déjà, les regards ne<br />
se croisent pas. Luc n’a pas vraiment levé les yeux vers Suzanne<br />
et lorsque celle-ci lui jette un bref coup d’œil, il détourne le<br />
regard.<br />
Le contrechamp marque la cassure. Ils sont encore tous deux présents<br />
dans le même plan, mais les directions vont s’opposer. Luc<br />
poursuit son chemin vers un fond plus sombre, barré par une<br />
courbe de l’autoroute, comme s’il lui fallait désormais changer de<br />
cap. De nouveau, les regards vont s’échanger sans pouvoir se<br />
croiser. Lorsque Luc se retourne vers Suzanne (2), celle-ci est<br />
déjà de trois-quarts dos, les yeux tournés dans une direction<br />
opposée, un peu dans le vide.<br />
Enfin, les deux plan suivants accomplissent la rupture : on voit<br />
d’abord Luc s’en aller, puis Suzanne repartir seule d’où ils sont<br />
arrivés. Rupture accomplie, Suzanne a-t-elle fait le deuil de son<br />
amour pour Luc ? Ce serait trop simple, trop net. Elle se retourne<br />
une dernière fois vers le garçon (3), mais nous devinons que lui<br />
ne se retourne pas, ayant pris son parti de l’échec de cette timide<br />
et douloureuse tentative. Pour Suzanne, tout n’est pas accompli et<br />
il restera quelque chose de son amour pour Luc. Elle refusera<br />
pourtant de renouer avec lui à la veille de son mariage, avec l’argument<br />
qu’elle ne veut pas faire souffrir Jean-Pierre. Mais demeurera<br />
toujours sa tristesse devant la douleur qu’elle a causée à Luc.<br />
En quelques images presque muettes, cette brève séquence met le<br />
doigt « là où ça fait mal » pour chacun des deux personnages, en<br />
même temps que sur les contradictions intimes et insolubles de<br />
Suzanne.
■ MISES EN SCÈNE<br />
Esthétisme et blessure narcissique<br />
Plans-tableaux signés par un cinéaste qui fut peintre, et qui sait aussi, parfois,<br />
faire des concessions pour flatter le « bon goût » des spectateurs.<br />
1 2 3<br />
Dans A nos amours, film en mouvement constant, les plans de<br />
pure immobilité sont exceptionnels. Tout particulièrement s’ils<br />
concernent Suzanne, dont l’énergie imprime au film sa respiration<br />
haletante. Trois plans, pourtant, un peu au-delà du milieu du film<br />
(fin de la séquence 18), marquent une sorte de pause avant un nouveau<br />
départ.<br />
Suzanne a choisi d’entrer en pension. De passage à Paris pour le<br />
week-end, elle vient de rencontrer par hasard Luc, qui vit manifestement<br />
une relation amoureuse avec Anne. Luc a commencé<br />
par éviter, une fois de plus, le regard de Suzanne, puis s’irrite<br />
auprès d’Anne de sa présence. Les deux filles quittent ensemble le<br />
magasin, tellement perturbées qu’elles veulent emprunter une sortie<br />
interdite.<br />
C’est alors que s’élève la musique de Purcell. Une musique lancinante<br />
qui martèle, avec de légères et progressives variations de ton,<br />
une même sonorité. On découvre alors Suzanne assise sur un banc,<br />
apparemment accablée (1). L’espace autour d’elle est pratiquement<br />
vide, tandis qu’au loin, en arrière-plan, passent de rares piétons et<br />
des voitures, en écho à celles qui passaient sur l’autoroute (voir<br />
page précédente), indifférentes au drame que vivaient alors Luc et<br />
Suzanne. L’image est grise, humide, seuls le blouson rouge et le<br />
jean bleuté apportent un semblant de couleur et de chaleur.<br />
Le plan suivant nous montre Suzanne derrière la vitre d’un<br />
Abribus, assise sur l’extrémité du banc, tandis que la pluie<br />
tombe (2). Les lignes géométriques formées par l’armature de<br />
l’Abribus, le plan de Paris à droite, les lignes de marquage au sol,<br />
la frontalité, le flou dû à l’atmosphère pluvieuse et au vitrage, la<br />
répartition des masses, l’écho entre le rouge-orangé du blouson et<br />
la couleur d’une voiture à l’arrière-plan, cet ensemble donne forme<br />
à une des rares images ouvertement picturales de l’œuvre de Pialat,<br />
ici abstraite et froide (façon Mondrian). Dans plusieurs entretiens,<br />
Pialat a considéré l’utilisation de la musique de Purcell dans l’interprétation<br />
de Klaus Nomi comme une concession pour flatter un<br />
certain public, concession nécessaire mais finalement sans gravité.<br />
Gageons qu’au-delà du plaisir de Pialat à pasticher une peinture<br />
facile à la Mondrian – comme il jugera plus tard facile celle de Van<br />
Gogh –, ce clin d’œil au « bon goût » culturel lui semble également<br />
de l’ordre d’une concession nécessaire et sans gravité. Mais<br />
15<br />
cette complaisance esthétisante ne renvoie-t-elle pas, à ce moment,<br />
à celle de l’héroïne elle-même ? Certes, la blessure de la rupture<br />
avec Luc ravivée, Suzanne ne peut s’empêcher d’être vexée de le<br />
voir dans une relation, même mièvre, avec une de ses amies et,<br />
ainsi, lui échapper, malgré ses dénégations en réponse aux questions<br />
d’Anne. Dans cette blessure narcissique, Suzanne s’attribue<br />
inconsciemment la perfection glacée et géométrique d’une peinture<br />
abstraite, d’une absolue maîtrise, même si assez vaine.<br />
Le troisième plan vient atténuer la froideur géométrique du précédent<br />
(3). Dans le même axe, nous voyons Suzanne en plan rapproché,<br />
une mèche de cheveux secouée par le vent, donnant à la<br />
fixité de l’image un élément de vie et de mouvement. La vie est de<br />
retour, la larme que Suzanne essuiera dans l’image suivante le<br />
confirme.<br />
Cette séquence est analysée par Jacques Loiseleux dans Le Cadre au cinéma,<br />
film vidéo de Jacques Petat et Jacques Loiseleux, 1991, Prod. Les Films de<br />
l’Estran, pour les Ministères de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des<br />
Sports et de la Culture, et le CNC.
16<br />
■ LE LANGAGE DU FILM<br />
Rejoindre le romanesque<br />
par l’anti-romanesque<br />
Pialat nous confronte à un matériau qui semble souvent brut : blocs temporels, improvisation des comédiens qui rendent réellement<br />
coup pour coup... Mais à l’intérieur de ce style « direct », c’est une idée du cinéma très réfléchie qui s’élabore subtilement.<br />
> Scènes de théâtre / scènes de ménage<br />
A nos amours s’ouvre sur Suzanne répétant une tirade de On ne badine pas avec l’amour,<br />
d’Alfred de Musset. Suit bientôt la représentation d’une scène, puis toute allusion à une quelconque<br />
activité théâtrale de Suzanne est abandonnée. Le théâtre revient pourtant sous une autre<br />
forme. Aux scènes de Musset succèdent en effet d’autres scènes, qui rendent fades et inopérantes<br />
les premières : des scènes de ménage. Au cours de l’une d’elles (séquence 13), Robert constate :<br />
« C’est mieux qu’au Théâtre de Poche ! » Le film joue ainsi entièrement sur cette notion de théâtre<br />
et de représentation par la façon dont la caméra occupe, lors des disputes et des crises d’hystérie<br />
entre Suzanne, sa mère et Robert, la place du quatrième côté face à une scène, constituée d’une<br />
première pièce (où travaillent le père et Robert, au début) et d’une seconde en arrière-plan (qui<br />
sert de salle à manger). Ce dispositif joue essentiellement sur le déplacement horizontal des personnages,<br />
plus rarement sur la profondeur : les déplacements des personnages sont ainsi limités<br />
aux bords du cadre ou par le décor. Parfois, un changement de plan recentre les personnages,<br />
parfois la caméra se lance à leur poursuite, comme si elle savait que dans ce décor sans horschamp,<br />
ils ne pouvaient lui échapper.<br />
Mais il n’y a pas, chez Pialat, le moindre souci de performance : il y a toujours au terme de la<br />
scène quelque chose de « déceptif » qui l’empêche de consister vraiment, de se transformer en<br />
morceau d’anthologie, à commencer par l’épuisement des personnages ou des acteurs. Parce que<br />
c’est précisément le propre de la scène hystérique de ne pas aboutir et parce que le cinéma de<br />
Pialat ne joue pas sur l’opposition traditionnelle apparence/réalité, théâtre/vie, acteur/personne,<br />
mensonge/vérité. Tout s’y joue sur le même plan, sans hiérarchie : le mensonge est un discours<br />
au même titre que l’aveu. La théâtralité de ces scènes de ménage, voire de ménagerie, ne révèle<br />
pas une vérité cachée, mais ouvre simplement le champ à la violence pure des pulsions instinctives,<br />
animales, brutes. Non seulement les coups portés sont de vrais coups, mais ils échappent<br />
généralement à la perception du spectateur : le temps qu’il en prenne conscience, le coup est déjà
porté et a déjà fait son effet, la bagarre est là presque sans<br />
avoir éclaté. Et elle ne s’achève pas sur la victoire de l’un ou<br />
l’autre, mais par l’arrêt, la suspension, en attendant de<br />
reprendre, comme si elle était à elle-même son propre but.<br />
> Un double non-écoulement<br />
du temps<br />
C’est dans ce sens que peut se comprendre l’étrange temporalité<br />
des films de Pialat et tout particulièrement de A nos<br />
amours. Nous avons déjà évoqué, à propos de la construction<br />
dramatique du film (cf. page 7), l’incertitude temporelle et<br />
logique de l’histoire. Sur quelle durée se déroule-t-elle ? Deux<br />
ans au moins, précise Pialat dans divers entretiens. Ce qui est<br />
vraisemblable pour justifier de voir passer Suzanne du lycée au<br />
mariage puis au départ pour San Diego, et Robert des premiers<br />
écrits à un succès favorisé par les relations. Mais la<br />
durée de la fiction, de la diégèse, est sans relation avec la<br />
durée vécue par le spectateur à la vision du film. D’abord pour<br />
les raisons que nous avons éclairées à propos du théâtre dans<br />
le film : la scène hystérique ne commence pas et ne finit pas,<br />
elle ne se situe pas dans une temporalité, une durée définie. Le<br />
spectateur ne peut que la vivre au présent. On a demandé à<br />
Pialat d’introduire des indications avec des dates pour faciliter<br />
le repérage du spectateur. Il a constaté, dit-il, que c’était<br />
impossible, « à cause d’une dualité indispensable, celle d’un double<br />
(non) écoulement du temps » . A nos amours oblige en effet à distinguer<br />
(au moins) l’écoulement du temps pour le père, qui<br />
disparaît dans une autre temporalité dont nous ne saurons à<br />
peu près rien, et celui qui concerne le reste de la famille, tout<br />
particulièrement Suzanne. Chacun vit sa propre durée, son<br />
propre rythme, avec peu de points de rencontre, sinon les<br />
visites de Suzanne à son père et le retour brutal et ponctuel de<br />
celui-ci au sein de la famille dont il constate l’évolution, mais<br />
dont il s’est exclu. Si Roger est sorti de la temporalité familiale<br />
et conjugale (voire professionnelle), ponctuée des moments<br />
de travail, de repas, de dispute, il ne nous paraît pas avoir<br />
bougé entre le début et la fin du film, fidèle à lui-même. Il<br />
précise fort justement dans la dernière scène, « Je suis pas encore<br />
fini ». C’est le même non-écoulement temporel qui marque<br />
Suzanne, malgré son évolution apparente à travers la pension<br />
(dont nous ne voyons rien non plus) puis le mariage : partant<br />
1. A nos amours, éditions Yellow Now, coll. “ Long Métrage ”, Bruxelles, 1987.<br />
avec Michel, elle a rompu avec Jean-<br />
Pierre comme elle l’avait fait au début<br />
du film avec Luc. De nouveau électron<br />
libre sans attache affective, rien<br />
ne permettant d’imaginer avec Michel<br />
autre chose qu’une halte agréable<br />
comme les précédentes : San Diego<br />
ou ailleurs, trois mois ou six mois…<br />
On comprend que dans ce perpétuel<br />
présent du film comme des personnages,<br />
l’époque comme le décor<br />
demeurent dans le flou, années 60 par<br />
certains côtés (la coupe des peaux à la<br />
main dans l’atelier), années 80 par la<br />
liberté sexuelle de Suzanne… A nos<br />
amours refuse la densité romanesque<br />
dans sa conception du temps, alors<br />
même que ses thèmes le sont éminemment,<br />
à commencer par la famille,<br />
les relations entre parents et<br />
enfants, la paternité et la filiation. Le<br />
film tire ainsi sa force de cette opposition<br />
constante entre durée romanesque impliquée par la fiction<br />
et durée objective du réalisme cinématographique.<br />
> Montage : une coulée narrative<br />
La conception du montage chez Pialat découle directement<br />
de cette attitude. Dans son livre sur le film 1 , Alain<br />
Philippon rapproche avec une grande justesse les propos de<br />
Yann Dedet, principal monteur du film, de la conception du<br />
naturalisme dans le cinéma de Stroheim (comme de Renoir ou<br />
Buñuel) selon André Bazin. « Ce que Maurice aimerait vraiment,<br />
c’est quelque chose qui coule totalement, sans que ça fasse scénario,<br />
sans que ça fasse plan-séquence, sans que ça fasse raccord :<br />
quelque chose qui coule tout seul… » De même, Bazin imagine<br />
« à la limite, un film de Stroheim composé d’un seul plan aussi long<br />
et aussi gros que l’on voudra ». « Regarder le monde d’assez près et<br />
avec assez d’insistance pour qu’il finisse par révéler sa cruauté et sa<br />
laideur » (Stroheim selon Bazin) est bien l’équivalent de la<br />
volonté de Pialat de regarder en face et fixement ce dont le<br />
cinéma, d’habitude, se détourne. Contrairement à ce que l’on<br />
pourrait penser, A nos amours n’est en rien un film heurté ou<br />
chaotique. S’il comporte, comme tout film de Pialat, sa dose<br />
de faux raccords, ils importent peu tant le film fonctionne sur<br />
ces juxtapositions de blocs, de scènes, déjà signalées. Bien<br />
plus, les hiatus temporels, les ellipses, réelles, ne se perçoivent<br />
jamais. Le spectateur a le sentiment d’une coulée narrative et<br />
ne perçoit qu’à retardement l’ellipse, le saut dans le temps,<br />
comme il ne perçoit qu’après coup la gifle qui vient de jaillir.<br />
Ou comment rejoindre le romanesque par les moyens les plus<br />
opposés au romanesque.<br />
17
18<br />
■ UNE LECTURE DU FILM<br />
Un Pialat optimiste ?<br />
La figure de Suzanne survole, presque intacte, un film où les réglements de compte<br />
et les vérités blessent.<br />
> Les « enfants humiliés »<br />
Sur les images du générique de A nos amours, Suzanne-<br />
Sandrine Bonnaire exhale la fraîcheur, la santé, le plaisir de l’instant.<br />
Les deux derniers plans du film montrent la double image<br />
de la jeune fille à peine mûrie (photo de couverture du dossier)<br />
et de son père, tous deux revenus de certaines illusions, dubitatifs<br />
face à un avenir incertain. A la sortie du film, la critique a<br />
insisté sur la « révélation » de Sandrine Bonnaire et sur les sempiternels<br />
attributs de réalisme, naturalisme et pessimisme, mais<br />
surtout sur le portrait d’une « jeune fille d’aujourd’hui ». C’était<br />
rester à la surface d’un film bien plus profond, bien plus ambi-<br />
gu, bien plus dérangeant qu’il n’y paraît. De<br />
même qu’Eric Rohmer a toujours nié faire un<br />
portrait de la jeunesse de notre époque à travers<br />
ses héroïnes, Pialat ne livre une description de<br />
la jeunesse que de surcroît. Son propos est<br />
d’abord, lui aussi, celui d’un moraliste, et tend,<br />
au-delà du figuratif, à l’abstraction, voire à la<br />
métaphysique. Le projet d’adapter Sous le soleil<br />
de Satan, qui a pris forme très tôt en lui, a<br />
d’ailleurs été tout particulièrement réactivé au<br />
moment de A nos amours. « J’ignore pour qui<br />
j’écris, mais je sais pourquoi j’écris. J’écris pour me<br />
justifier. – Aux yeux de qui ?… – Aux yeux de l’enfant<br />
que je fus », écrit Bernanos dans Les Enfants<br />
humiliés. Se justifier, n’est-ce pas également ce<br />
que font les personnages de Pialat, tout particulièrement<br />
dans A nos amours, comme ceux de<br />
Rohmer, même s’ils recourent moins au raisonnement<br />
? Mais se justifier de quoi ?<br />
> Préservez-moi d’être une fille<br />
dont on a honte<br />
Les sentiments de remords et de honte planent sur A nos<br />
amours. Honte de quelque Mal dont on ne sait s’il est déjà fait, à<br />
faire ou en train d’être fait. La grande scène du retour du père<br />
repose sur un principe unique, décliné sur divers modes et personnages.<br />
Roger s’installe face à la famille au grand complet et<br />
son discours n’a qu’un seul but : faire honte. Clairement, il fait<br />
honte à Robert de sacrifier son talent au succès. À Jacques, le<br />
À propos de Van Gogh, Serge Toubiana parle de remords (Cahiers du cinéma, n°449, novembre 1991), Francis Vanoye, de honte (« Honte et rage : Pialat avec Renoir »,<br />
L’Expression du sentiment au cinéma, revue La Licorne, N°37, UFR Langues Litterratures, Poitiers, 1996).<br />
beau-frère, de laisser traîner dans la boue celui qu’il prétend<br />
défendre. A Betty, « la mère tape-dur », de sa vulgarité, de sa<br />
prévisibilité, de son « cinéma »… A tous : « C’est vous qui êtes<br />
tristes, tout ce que vous faites, c’est triste »… D’ailleurs, dans leur<br />
accablement après son départ, le remords ne fait aucun doute,<br />
Roger a tapé juste, là où ça fait mal. Mais le remords, la honte<br />
sont aussi de l’autre camp : Roger a pris la fuite. Comme il l’explique<br />
à Suzanne : « Tu vois, un jour on en a assez… Il y en a marre,<br />
oui ! » D’emblée, elle met le doigt là où pour lui aussi, ça fait<br />
mal : « Et nous, qu’est-ce qu’on va faire, t’y penses ? », à quoi fera<br />
écho Robert : « T’as jamais téléphoné pour savoir comment on<br />
allait ».<br />
Reste Suzanne, qui n’échappe pas au remords. Honte face à une<br />
morale conventionnelle puritaine, quand sa mère lui reproche<br />
de dormir nue. Honte de relations troubles avec le père, qui<br />
affleure quand Roger vient trouver sa fille et sa copine Martine<br />
au lit, la main placée étrangement (sur son sexe, cf. photo<br />
page 7) pour maintenir sa blouse fermée tandis que Suzanne le<br />
provoque en lui disant que Martine le trouve « mignon »… Mais<br />
plus intéressante est la confidence de Suzanne à Bernard :<br />
« Quand je rencontre un type, je pense à mon père… Je me demande<br />
s’il trouverait que c’est un garçon bien… » On songe à cette lettre<br />
de Vincent Van Gogh à son frère Théo : « préservez-moi d’être un<br />
fils dont on a honte » (31 mai 1896). La question centrale du film,<br />
celle de la jouissance et du corps, est moins dans les relations<br />
entre garçons et filles qu’entre parents et enfants : comment,<br />
pour les parents, admettre le corps et la jouissance d’une fille<br />
devenant adulte, pour la fille les relations sexuelles des parents ?<br />
Comment accepter d’affirmer sa propre jouissance sans<br />
remords ? La remarque de Suzanne fait moins preuve d’un attachement<br />
malsain que de moralité profonde. À quoi fait écho<br />
l’interpellation de Roger, au milieu de son règlement de<br />
comptes : « N’est-ce pas, mademoiselle Suzanne ?… T’es comme<br />
eux ?… » L’ignominie de la scène n’avait qu’un seul but : lancer<br />
une perche à la seule qu’il aime encore, la seule qui fasse preuve<br />
de morale dans ce monde triste. D’ailleurs, elle part avec<br />
Bernard, qui avait répondu à sa confidence par cette remarque<br />
lucide : « Dans le fond, t’es une fille sérieuse… » Si Suzanne n’est<br />
pas encore « dans le bon lot », rien cependant n’est perdu…
■ EXPLORATIONS<br />
Suzanne, entre<br />
années 60 et an 2000…<br />
Suzanne est un personnage né des souvenirs d’une adolescente des années 60,<br />
transposé par Maurice Pialat au début des années 80, et que des lycéens vont découvrir<br />
en l'an 2000… Quelques repères pour situer cette figure de « jeune fille libre ».<br />
> « Petit animal à la splendeur sauvage »<br />
L'héroïne de A nos amours et son interprète, Sandrine<br />
Bonnaire, portent l'héritage des années 60, qui virent changer la<br />
situation des femmes et leur image, particulièrement au cinéma. La<br />
femme qui inspire les cinéastes est alors définitivement éloignée<br />
des déesses mythiques qu'incarnaient Greta Garbo ou Marlène<br />
Dietrich. Déjà, Marilyn Monroe, qui meurt tragiquement en 1962,<br />
revendiquait moins un pouvoir sexuel qu’une liberté d’épanouir<br />
une exubérance et un dynamisme naturels. En France, Brigitte<br />
Bardot incarne, à partir de Et Dieu créa la femme de Roger Vadim<br />
1. Robert Chazal, France-Soir, 16 novembre 1983.<br />
2. Le Quotidien de Paris, 18 novembre 1983.<br />
3. Christian Lasch, Le Complexe de Narcisse, Laffont, 1981 ; Gilles Lépidovsky, L’Ère du vide, Gallimard, 1983.<br />
(1956), une sensualité naturelle, une sexualité heureuse face aux<br />
tabous encore très puissants de la morale bourgeoise. Pas plus que<br />
Bardot débutante (« petit animal à la splendeur sauvage », Vadim),<br />
Bonnaire ne symbolise la femme inaccessible, au contraire :<br />
Suzanne, son premier rôle au cinéma, apparaît comme une fille<br />
« facile », c’est bien ce qu’on lui reproche, et qu’elle se reproche<br />
parfois à elle-même. Les rapports de Suzanne avec sa mère sont<br />
également marqués par un conflit de générations typique des<br />
années 60, notamment lorsque Betty est choquée que sa fille<br />
dorme sans chemise de nuit : s'opposent alors la fille aux mœurs «<br />
modernes » et la femme de moralité traditionnelle.<br />
« À quinze ans, elle est libre et d’une certaine manière embarrassée de cette<br />
liberté sexuelle qui a pourtant ses lois et engendre les désillusions […]<br />
Suzanne est une fille de maintenant à qui son appétit de tout connaître le<br />
plus vite et les plus fort possible enlève toute sensibilité et sentimentalité.<br />
Sans en être consciente, elle sent probablement qu’elle passe à côté de l’essentiel.<br />
Et c’est irrémédiable » 1 . Suzanne est une jeune fille de l’aprèsféminisme,<br />
elle n’agit pas « contre » (sa mère, Luc), mais ne cherche<br />
que son propre plaisir dans l’instant, sans justification, sans revendication<br />
et sans souci du lendemain. Mais, comme le constate<br />
Dominique Jamet, « Suzanne, de lit en lit, de garçon en garçon.<br />
Pourquoi pas, si elle trouvait la moindre satisfaction au plaisir qu'elle<br />
prend ? Longtemps, elle ne comprendra pas pourquoi elle n'est pas heureuse<br />
puisqu'elle est libre, avant de découvrir que le plaisir n'est rien – rien<br />
qu'un moment d'oubli, le gouffre d'un instant – si le cœur n'y est pas » 2 .<br />
> Destin individuel et destin collectif<br />
Par de nombreux aspects, Suzanne illustre ce que l’on a parfois<br />
nommé, dans les années 80, « un nouveau stade de l’individualisme<br />
» 3 , pour désigner la morale hédoniste et permissive de l’individu<br />
devenu indifférent au monde, indifférent aux grands projets<br />
révolutionnaires de naguère comme au contexte économique,<br />
celui de la crise renforçant même une stratégie de survie<br />
individuelle. Une petite phrase lancée à Suzanne par sa mère<br />
- « Je t'ai payé ton psychiatre, ça m'a coûté une fortune » - pointe<br />
significativement cette attention à « l'être » et au « mieux être »<br />
qui ont accompagné le nouvel individualisme des années 80. Mais<br />
cette réplique furtive suggère aussi des souffrances secrètes, une<br />
crise identitaire ou une difficulté à vivre, et Suzanne est d'ailleurs<br />
parfois en proie à de sourdes inquiétudes. La sensualité qu'elle<br />
revendique rend au sexe sa première place, mais l'expose aussi, la<br />
fragilise. D'autant qu'en nous donnant à ressentir l’angoisse qui<br />
accompagne la jouissance sans entraves, Pialat et son héroïne<br />
semblent anticiper un bouleversement alors tout proche : c'est en<br />
mai 1984 que sera identifié le virus du sida. A la charnière d’une<br />
époque, Suzanne nous offre ainsi de jeter un dernier regard sur<br />
une liberté sexuelle aujourd’hui régie par la prophylaxie, en<br />
même temps qu’elle nous montre la mélancolie qui naît des<br />
désaccords intemporels entre le désir, la chair, et les sentiments.<br />
C'est ce qui nous permet, à l’orée de l’an 2000, de rester sensibles<br />
à son aventure au-delà de tout regard sociologique distant.<br />
19
20<br />
■ DANS LA PRESSE, DANS LES SALLES<br />
Eloge d’un cinéaste<br />
A nos amours hisse définitivement Maurice Pialat au rang des « grands cinéastes français » et fait triompher la notion d’auteur :<br />
le regard, la personnalité, le style et l’œuvre de Pialat sont au centre des commentaires, avant même le sujet de son film.<br />
> Une sortie « serrée »<br />
Peu avant la sortie de A nos amours, le 16 novembre 1983,<br />
Maurice Pialat manifeste ses doutes quant à la distribution de<br />
son film, évoquant « ce drame des films à peine sortis dont on<br />
réduit déjà le nombre des salles la semaine suivante... J’espère que<br />
Gaumont fera l’effort » (Gaumont est le distributeur de A nos<br />
amours). Les inquiétudes du cinéaste ne sont pas sans<br />
fondement. Un mois plus tôt, les Cahiers du cinéma ont<br />
publié un dossier intitulé « Cinéma d’auteur : la cote<br />
d’alerte », avec une photo de Sandrine Bonnaire dans A<br />
nos amours en couverture. On s’y inquiète du « grand<br />
écart » entre le cinéma d’auteur, au public fléchissant,<br />
et les films distribués dans un maximum de salles quitte<br />
à devenir des « films-toboggans » (au nombre<br />
d’écrans en rapide diminution). Roger Diamantis, propriétaire<br />
des cinémas Saint-André-des-Arts à Paris, achète une page du<br />
journal Libération pour obtenir de Gaumont une copie du film<br />
de Pialat et pouvoir le montrer dans sa salle, en supplément de<br />
la seule choisie dans le Quartier Latin, en raison d’une sortie<br />
« serrée ». Le public sera pourtant au rendez-vous, et la reconnaissance<br />
officielle suivra : A nos amours obtiendra en 1984 le<br />
Prix Louis Delluc et le César du meilleur film.<br />
> « Un ouvrage subversif »<br />
En novembre 1983, dans Cinématographe (n°94), la revue<br />
dirigée par Jacques Fieschi (qui joue Jacques, le beau-frère de<br />
Robert, dans A nos amours), Maurice Pialat s’inquiète aussi de<br />
l’accueil critique de son film, des « malentendus qui subsistent…<br />
Si les jeunes vont voir le film, peut-être qu’ils se reconnaîtront dans<br />
les conflits familiaux que je montre, mais je ne sais pas ce qu’ils vont<br />
pouvoir penser de certains dialogues… » Il songe à la phrase de<br />
Van Gogh citée par le personnage du père, « la tristesse durera<br />
toujours ». Mais ses craintes pessimistes trouvent place dans un<br />
dossier copieux consacré à son film par Cinématographe. Les<br />
Cahiers du cinéma font de même le mois suivant (n°354), sous le<br />
titre « A nos amours, éloge de Maurice Pialat ». Positif se<br />
« Pialat ne se contente pas d’inventer<br />
des personnages et des péripéties (ce serait<br />
mesquin), il invente l’espace autour d’eux,<br />
entre eux », Serge Daney dans Libération.<br />
contentera d’un article très modéré de Paul Louis Thirard qui<br />
tient le « marginal » Pialat « comme l’un des grands cinéastes<br />
français », mais trouve bien faible « le croquis sociologique et son<br />
environnement idéologique expliqué ».<br />
Majoritairement, la presse accueille le film avec enthousiasme.<br />
Dans Le Figaro (15.11), Pierre Montaigne, parle « au bon sens<br />
du terme, d’un ouvrage subversif. Il secoue le spectateur et le force à<br />
écarquiller les yeux devant des personnages dont la détresse est tout<br />
aussi choquante qu’irrécusable ». Ce qui n’est guère éloigné de<br />
l’opinion du journal communiste Révolution (18.11), sous la<br />
plume de Noël Simsolo : « Nous sommes à des années-lumière des<br />
impostures sentimentales qui barbotent dans les Boum, les<br />
Compères et autres Branchés… Pialat échafaude un oratorio<br />
imparable qui désigne la réalité douloureuse et marginale d’une<br />
génération oppressée. Mais il refuse le témoignage moralisateur, tout<br />
autant que le naturalisme rassurant et partial ». Sociologique<br />
également, le point de vue de Michel Pérez, dans Le Matin, de<br />
sensibilité socialiste : « Pialat témoigne du désarroi d’une fraction<br />
de la moyenne ou de la petite bourgeoisie qui a allègrement sauté pardessus<br />
ses garde-fous familiers et rejeté son code d’hypocrisie pour<br />
atteindre à un épanouissement dont elle s’affole de ne pas ressentir<br />
immédiatement les bienfaits ». Au contraire, Claire Devarrieux,<br />
dans Le Monde (17.11.83), est plus relativiste. « Ce n’est pas un<br />
cinéma romanesque. Pas de sociologie non plus. Libre à chacun de<br />
s’identifier aux personnages, suivant les générations, mais le cinéaste<br />
ne rabote pas la réalité pour en tirer des lois générales ».<br />
Dans Libération (16.11), Serge Daney est dithyrambique « à<br />
cause de l’ampleur du geste (Pialat-peintre), de la liberté de ton<br />
(Pialat-dialoguiste), de l’allégresse dans le nihilisme (Pialat-musicien)…<br />
Pialat ne se contente pas d’inventer des personnages et des<br />
péripéties (ce serait mesquin), il invente l’espace autour d’eux, entre<br />
eux. Invisible, incertain, mais très réel. Dans l’espace d’A nos<br />
amours, perturbé s’il en fut, les personnages, accélérés comme des<br />
particules, tournent les uns autour des autres et perdent le Nord ».<br />
> « Un mélange explosif<br />
de tendresse et de cruauté »<br />
Si beaucoup apprécient la performance de Pialat luimême,<br />
le comparant à Jean Yanne, parfois celle de Jacques<br />
Fieschi, c’est évidemment à Sandrine Bonnaire que vont tous<br />
les suffrages, toutes tendances confondues. « Il faut voir comment<br />
elle ondule dans sa mini-jupe, le long d’une route, en faisant<br />
tournoyer son sac de la main. On n’a pas vu une telle démarche<br />
depuis Marilyn dans Bus Stop » (Gilles Le Morvan, L’Humanité,
16.11). « Pour son premier rôle, elle bouleverse toutes les règles, ridiculise toutes les<br />
écoles, disqualifie les meilleures professionnelles. On ne se demande pas si elle est jolie,<br />
si elle a du charme ou du chien » (Robert Chazal, France-Soir, 16.11). « bien<br />
mieux qu’Isabelle Huppert dans Loulou, elle donne au film une sorte d’évidence.<br />
Elle est Suzanne, avec une innocence perverse, un mélange explosif de tendresse et<br />
de cruauté, d’envie de vivre et de souffrance profonde » (Annie Coppermann, Les<br />
Échos, 18.11).<br />
> « C’est pauvre »<br />
Restent évidemment les déçus. Les politiques, d’abord, comme la Vie<br />
ouvrière (Serge Zeyons, 5.12) : « Comment comprendre que les questions d’argent<br />
n’interviennent jamais dans les relations (difficiles) de Suzanne avec ses parents »,<br />
ou Lutte ouvrière (Sylvie Friedman, 26.11) : « le pessimisme du film laisse perplexe.<br />
Suzanne est en fin de compte condamnée à la médiocrité et cela semble sans<br />
espoir. Alors Maurice Pialat a réalisé un film tout simple, certes, qui sonne juste, et<br />
c’est rare. Mais c’est pauvre, et quel en est l’intérêt ? » Regret semblable chez<br />
Marie-Françoise Leclère : « Quant au désarroi de Suzanne, le monde (son père ?)<br />
ne peut offrir en réponse qu’une grise mélancolie » (Le Point,14.11). Mais elle<br />
regrette aussi, sur un thème aussi fort, de ne pas être bouleversée, parce que<br />
« le film apparaît comme une juxtaposition de croquis plus ou moins réussis, parce<br />
que l’improvisation introduit parfois un flottement gênant, parce que la caricature<br />
(ah, cette mère !) affadit le propos ». Plus radicale est la critique hautaine de<br />
Louis Seguin dans la Quinzaine littéraire (15.12) : le film « flotte sur une épaisseur<br />
appréciable de consensus… Les gens, chez Pialat, sont ce qu’ils sont… Le risque<br />
est rare de voir ce vérisme simplifié s’égarer du côté du mélodrame ou du lyrisme.<br />
Le maître du film tient bien ses créatures en main : il ne leur permet aucun écart.<br />
Sa complicité et son mépris ne sont que les aspects complémentaires de son pouvoir »<br />
Pouvoir du cinéaste ou du critique ?<br />
■ L’AFFICHE<br />
Bonnaire,<br />
Bonnard peut-être<br />
Une jeune actrice prend la pose<br />
comme un modèle, et son regard<br />
nous interpelle.<br />
Pialat et Gaumont ont joué la sobriété : le titre, le nom du<br />
réalisateur et de l’actrice, un bandeau pour les éléments<br />
dits contractuels et la musique. Entre les deux, un plan<br />
rapproché pudique de Sandrine Bonnaire au lit… Le tout<br />
sur fond pratiquement noir, qui occupe plus de 50% de la<br />
surface. Deux éléments colorés, le visage, les bras et les<br />
épaules de Sandrine Bonnaire et le rouge du titre. Plus<br />
qu’une affiche classique, cette frontalité et cette absence de<br />
profondeur évoquent certaines toiles de Manet, Seurat ou<br />
même Bonnard, cité par Suzanne.<br />
La sobriété de cette affiche ne ment pas : malgré le titre et<br />
la jeunesse de l’actrice, montée en épingle par la publicité,<br />
A nos amours n’a rien à voir avec les films d’adolescence<br />
nostalgique et attendris tels que La Boum ou Diabolo<br />
Menthe. Si le portrait choisi ne joue pas sur la provocation<br />
sexuelle, mais sur la sensualité de l’actrice, il révèle immédiatement<br />
un aspect capital du personnage : le désarroi,<br />
une certaine inquiétude et, surtout, par le regard, l’adresse<br />
au spectateur, à qui l’actrice comme le réalisateur demandent<br />
sa participation. À travers Sandrine Bonnaire, c’est Pialat qui<br />
parle, comme l’indique l’échelle descendante des caractères<br />
et la triangulation qu’elle produit, entraînant notre regard<br />
vers le visage : encore inconnue, Sandrine Bonnaire n’existe<br />
qu’en tant que « modèle » du réalisateur (au sens pictural<br />
mais aussi bressonien), par son visage et son corps.<br />
Reste un mystère ; le point qui suit le titre. Il rappelle qu’il<br />
21<br />
ne faut pas entendre ici « A nos amours ! », comme lorsqu’on<br />
porte un toast dans un banquet, mais ce point donne<br />
le sentiment d’une ponctuation définitive, là où le film,<br />
justement, laisse la porte ouverte à tous les possibles…<br />
Benjamin Baltimore
22<br />
■ AUTOUR DU FILM<br />
Pialat entre Nouvelle Vague<br />
et vague nouvelle<br />
Figure solitaire et farouche du cinéma français, le metteur en scène de A nos amours n’a jamais prétendu montrer l’exemple,<br />
ni dicter des préceptes esthétiques. Plus que d’autres pourtant, Pialat fait école...<br />
> Affinités et ressentiment<br />
Né en 1925, Pialat appartient parfaitement, par son âge, à la<br />
génération de la Nouvelle Vague, qui apparaît à la fin des années<br />
50 : il trouve place entre les plus jeunes (Godard, Truffaut,<br />
Chabrol, Rivette, Demy), nés autour de 1930, et les plus anciens<br />
(Rohmer, Resnais), nés vers 1920. Les cinéastes que Pialat cite le<br />
plus souvent sont les mêmes que ceux de la Nouvelle Vague (à<br />
l’exception du cinéma hollywoodien) : Renoir surtout, Bresson,<br />
Tati, sans oublier Lumière. Dans la lignée directe de Renoir,<br />
Pialat se retrouve également de plain-pied avec la Nouvelle<br />
Vague dans le refus de la dictature du scénario comme du plan<br />
1. La Croix, 3 septembre 1987.<br />
2. Les Inrockuptibles, n°52, hiver 1994.<br />
3. Hors série « Nouvelle Vague, une légende en question », 1999.<br />
léché, le rejet du « glacis » au profit de l’image incertaine qui a<br />
pris au piège de la pellicule l’instant fugitif, l’impalpable, l’expression<br />
unique de l’acteur, la seconde où le personnage disparaît<br />
au profit de l’être humain. Pourtant, Pialat ne s’estime pas<br />
concerné par le combat de la Nouvelle Vague et des Cahiers du<br />
cinéma des années 50 contre la Tradition de la Qualité du cinéma<br />
français, représentée par les grands du cinéma d’avant-guerre,<br />
Marcel Carné, René Clair ou Julien Duvivier. « Ce sont des<br />
films qui m’ont tellement marqué quand j’étais jeune… Les Carné, La<br />
Bête humaine, je tourne autour de ça, enfin j’espère pour moi »,<br />
déclare Pialat, qui n’a jamais ménagé ses critiques à la Nouvelle<br />
Vague. Truffaut fut sa cible favorite : « La preuve que notre cinéma<br />
est médiocre, c’est que l’on met en avant le plus gentil d’entre nous :<br />
Truffaut… » 1 Selon lui, les cinéastes de la Nouvelle Vague<br />
« n’ont jamais eu la cruauté nécessaire à qui prétend être artiste » 2 .<br />
Cette position radicale explique sans doute l’influence de Pialat<br />
sur la jeune génération des cinéastes français, la vague nouvelle<br />
plutôt que la Nouvelle Vague.<br />
> Au-delà de la technique du cinéma<br />
Aujourd’hui, la majeure partie du jeune cinéma français ne<br />
se réclame pratiquement plus de Godard, encore un peu de<br />
Truffaut, un peu moins de Rohmer, mais de plus en plus de<br />
Pialat. Cette influence pourrait se mesurer à travers quelques<br />
thèmes qui distinguent ce jeune cinéma français, comme la noir-<br />
ceur et le désespoir, l’obsession de la mort, l’opacité des personnages,<br />
les relations affectives, familiales douloureuses et<br />
troubles, que ce soit chez Xavier Beauvois (Nord, N’oublie pas que<br />
tu vas mourir), Arnaud Desplechin (La Vie des morts, La<br />
Sentinelle), Pascale Ferran (Petits arrangements avec les morts),<br />
Laurence Ferreira-Barbosa (Les Gens normaux n’ont rien d’exceptionnel),<br />
Erick Zonca (La Vie rêvée des anges), Cédric Kahn (Bar<br />
des rails, L’Ennui), Noémie Lvovsky (Oublie-moi), Laetitia<br />
Masson (En avoir ou pas), ou encore dans les films de Claire<br />
Denis (Nénette et Boni)… Pialat n’y reconnaîtrait sans doute pas<br />
vraiment les siens. L’empreinte de son cinéma est pourtant perceptible<br />
dans les premiers films de Jean-Claude Brisseau (Un jeu<br />
brutal, De bruit et de fureur), dans Peaux de vaches (interprété par<br />
Sandrine Bonnaire) et Travolta et moi, de Patricia Mazuy, et La<br />
Promesse, des frères Dardenne, Belges, donc si proches de la<br />
France de Pialat. C’est plus qu’un simple hasard si plusieurs<br />
films de l’Auvergnat Pialat se situent dans le Nord de la France<br />
(L’Enfance nue, Passe ton bac d’abord …), région jugée longtemps<br />
dure et peu photogénique où les jeunes cinéastes tournent de<br />
plus en plus fréquemment.<br />
Mais au-delà de simples relations thématiques, c’est dans une<br />
certaine attitude à l’égard du cinéma et de la réalité que se joue<br />
l’affinité la plus profonde entre la vague nouvelle et l’auteur de<br />
A nos amours. Précisément, dans la volonté de redonner à l’expérience<br />
du tournage une place essentielle et décisive : confrontation<br />
avec les comédiens (et des comédiens entre eux), confronta-
tion avec la scène (souvent filmée caméra à l’épaule, ce qui fait<br />
intervenir une part « d’instinct »), tout va dans le sens d’une mise<br />
en danger de la mise en scène, dès lors que tourner ne consiste<br />
plus seulement à appliquer un scénario. C’est cette prise de<br />
risque, cette volonté de bousculer la rigueur (vaine) quitte à<br />
devoir « rentrer dans le choux du plan » (l’expression est de<br />
Pialat), qui fait lien entre le cinéaste et ses admirateurs de la<br />
vague nouvelle. Pas étonnant qu’une table ronde récemment<br />
publiée dans les Cahiers du cinéma 3 , réunissant Olivier Assayas,<br />
Claire Denis, Cédric Kahn et Noémie Lvovsky autour du thème<br />
de la Nouvelle Vague, se soit recentrée sur le « sujet » Pialat,<br />
notamment pour le comparer à Truffaut. « Les films de Pialat me<br />
bouleversaient, explique Noémie Lvovsky dans cet entretien à plusieurs<br />
voix, mais ne me faisaient pas aimer le cinéma. Alors que les<br />
films de Truffaut me faisaient aimer la lumière qui s’éteint, voir les<br />
choses bouger sur un écran. Autant les films de Truffaut peuvent avoir<br />
une valeur d’usage, autant ceux de Pialat, je m’en défie comme élève…<br />
Je ne peux être que spectatrice, être bouleversée… Je ne peux pas les<br />
étudier… ». Gageons que Pialat verrait là le plus beau des hommages<br />
! Puis Noémie Lvovsky cite Arnaud Desplechin, pour qui<br />
Pialat « veut vider les acteurs de leur métier d’acteur et de leurs personnages,<br />
les scénarios de leurs scénaristes ; et au bout du compte, il veut<br />
vider les films de lui-même. Du coup, je n’ai jamais autant eu l’impression<br />
de voir du désespoir, de l’amour ou de la haine, comme en bloc.<br />
Comme s’il pouvait vraiment toucher les sentiments que l’on peut<br />
connaître dans la vie ».<br />
Claire Denis, quant à elle, distingue deux camps du cinéma, celui<br />
de la fiction et celui des personnages. « A partir de la Nouvelle<br />
Vague, les personnages ne sont plus réduits au cours de la fiction, purs<br />
produits de la mécanisation du récit. Ils ont une existence indépendante,<br />
ils sont plus que la nécessité de fictionner ». Comparant le cinéma<br />
de Pialat à deux films de Renoir, La Bête humaine et La Chienne,<br />
elle conclut par un constat qui définit bien la spécificité du cinéma<br />
français tel que le rêvent et le défendent Pialat et les jeunes<br />
cinéastes français d’aujourd’hui : « On est devant une expérience de<br />
la vie, qui est au-delà de la technique du cinéma. Dans ces deux films<br />
de Renoir, j’ai vu quelque chose que j’ai vu dans les films de Pialat. La<br />
pulsion du suicide, du crime, de l’amour… ».<br />
Bibliographie sélective<br />
Quelques références autour de<br />
A nos amours…<br />
Livres et articles généraux sur Maurice Pialat<br />
Joël Magny, Maurice Pialat, Éditions de l’Étoile/<br />
Cahiers du cinéma, 1992.<br />
Sergio Toffetti, Aldo Tassone, Maurice Pialat, l’enfant sauvage,<br />
Muzeo Nazionale del Cinema, France Cinéma, Admiranda,<br />
Institut de l’image, Lindau s.r.l., Turin, 1992 (catalogue de<br />
la rétrospective Pialat du festival France Cinéma de Florence<br />
en 1992).<br />
Vincent Amiel, Maurice Pialat, les débordements du monde,<br />
Les Mille et une Nuits/Arte Éditions, 1997.<br />
Sur A nos amours<br />
Alain Philippon, A nos amours de Maurice Pialat, Crisnée<br />
(Belgique) : Yellow Now, 1989.<br />
Maurice Pialat, A nos amours, Paris : Lherminier, 1984<br />
(scénario du film et entretiens).<br />
Articles et entretiens<br />
Cahiers du cinéma, n°354, décembre 1983 (P. Bonitzer) ;<br />
« Le chaudron de la création », entretien avec Alain Bergala,<br />
Jean Narboni et Serge Toubiana.<br />
Cinématographe, n°94, novembre 1983 (Jean-Claude Bonnet,<br />
Gilles Gourdon, Alain Ménil) ; entretien avec<br />
Didier Goldschmith et Jérôme Tonnerre.<br />
Positif, n°275, janvier 1984 (Paul Louis Thirard) ;<br />
entretien avec Emmanuel Carrère et Michel Sineux.<br />
Autour du thème de la famille<br />
Sous la direction de Roger Odin, Le Film de famille usage privé,<br />
usage public, Paris : Méridiens Klincksieck, 1995.<br />
Sur l’histoire du cinéma français<br />
René Prédal, 50 ans de cinéma français (1945-1995), Paris :<br />
Nathan université, 1996.<br />
Pierre Billard, L'âge classique du cinéma français : du cinéma<br />
parlant à la Nouvelle vague, Paris : Flammarion, 1995.<br />
Jean-Michel Frodon, L'âge moderne du cinéma français :<br />
de la Nouvelle vague à nos jours, Paris : Flammarion, 1995.<br />
Quelques références pour en savoir<br />
plus sur l'histoire et les métiers<br />
du cinéma…<br />
Sous la direction de Michel Ciment, Jean-Claude Loiseau et<br />
Joël Magny, La petite encyclopédie du cinéma, Paris :<br />
Editions du Regard, 1998.<br />
Sous la direction de Jean-loup Passek, Dictionnaire du cinéma,<br />
Paris : Larousse-Bordas, 1998.<br />
Michel Chion, Le Cinéma et ses métiers, Paris : Bordas, 1990.<br />
Quelques références pour en savoir<br />
plus sur les méthodes d'analyse<br />
de film…<br />
Jean-Claude Fozza, Anne-Marie Garat, Françoise Parfait,<br />
Petite fabrique de l'image : parcours théorique et thématique,<br />
180 exercices, Paris : Magnard, 1989.<br />
Jacques Aumont, Michel Marie, L'Analyse des films, Paris :<br />
Nathan université, 1988.<br />
Vincent Pinel, Vocabulaire technique du cinéma, Paris :<br />
Nathan, 1996.<br />
Autour de l'opération Lycéens au cinéma<br />
: deux sites internet à consulter…<br />
Le site de la Bibliothèque du film www.bifi.fr<br />
Le site Image (CRAC de Valence, CNC)<br />
www.crac.asso.fr/image<br />
23