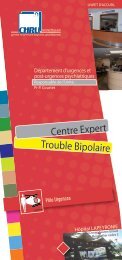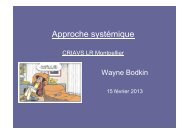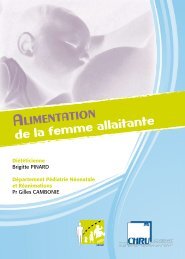Téléphone portable : Progrés ou danger - CHU Montpellier
Téléphone portable : Progrés ou danger - CHU Montpellier
Téléphone portable : Progrés ou danger - CHU Montpellier
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
INSTITUT DE FORMATION DE MANIPULATEURS<br />
EN ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE<br />
CHRU DE MONTPELLIER<br />
Directeur : Mr Georges BOURROUNET<br />
Conseiller scientifique : Dr Joseph PUJOL<br />
<strong>Téléphone</strong> <strong>portable</strong> : progrès <strong>ou</strong> <strong>danger</strong> ?<br />
Travail d’Intérêt Professionnel<br />
Promotion 2006 / 2009<br />
Mr Magurno Tèrence<br />
Mr Jeudy David<br />
Mr Clavel Alexandre
Remerciements<br />
N<strong>ou</strong>s tenons à remercier t<strong>ou</strong>tes les personnes qui ont bien v<strong>ou</strong>lu n<strong>ou</strong>s apporter leur aide<br />
p<strong>ou</strong>r ce travail :<br />
Mr R. Bacci, cadre formateur à l’IFMEM de <strong>Montpellier</strong><br />
Mr G. B<strong>ou</strong>rr<strong>ou</strong>net, notre cadre référent, directeur de l’IFE et de l’IFMEM<br />
Dr D. Mariano-G<strong>ou</strong>lart, en médecine nucléaire au <strong>CHU</strong> de <strong>Montpellier</strong>, qui n<strong>ou</strong>s a<br />
encadré dans la progression de notre travail.<br />
N<strong>ou</strong>s remercions t<strong>ou</strong>t spécialement Mr J.M. Danze, consultant en biophysique, licencié en<br />
sciences chimiques, ex-assistant à l’institut de pharmacie de l’Université de Liège dont<br />
l’aide a été indispensable.<br />
Enfin, n<strong>ou</strong>s remercions t<strong>ou</strong>tes les personnes qui n<strong>ou</strong>s ont eu la gentillesse de répondre à<br />
notre sondage ainsi qu’Andréa p<strong>ou</strong>r son traitement statistique des données et Annie p<strong>ou</strong>r<br />
sa contribution à la relecture.<br />
2
Table des matières<br />
Table des illustrations 5<br />
Lexique 6<br />
Abréviations et symboles 8<br />
Introduction 9<br />
I. Cadre théorique 10<br />
A. Notions d'électromagnétisme 10<br />
1. Définitions 10<br />
2. Rayonnements ionisants et non ionisants 11<br />
B. Description des OEM de la téléphonie mobile 12<br />
1. Présentation du réseau cellulaire 12<br />
2. Bandes et canaux de fréquence 13<br />
3. Le multiplexage temporel 14<br />
4. Production des OEM par le <strong>portable</strong> 15<br />
C. Unités de mesure 16<br />
1. Intensité des champs E et H 16<br />
2. Puissance rayonnée isotrope équivalente (PIRE) 16<br />
3. La densité de puissance D : 16<br />
4. Le Débit d'Absorption spécifique (DAS) : 16<br />
D. Cadre législatif 17<br />
1. Normes d’expositions en France 17<br />
2. Principe de précaution : 17<br />
E. Notion de cancérogenèse 18<br />
1. L’initiation 18<br />
2. La promotion 18<br />
3. La progression 19<br />
II. Etudes expérimentales et radiobiologie 20<br />
A. Des ondes non-ionisantes 20<br />
B. Effets sur la barrière hémato-encéphalique (BHE) 21<br />
1. Augmentation de la perméabilisation 21<br />
2. Conséquences de cette perméabilisation 22<br />
3. Mécanisme 23<br />
4. Conclusion 23<br />
C. Effets sur la biochimie cérébrale, les neurotransmetteurs et leurs récepteurs. 24<br />
1. Cas de l'acétylcholine 24<br />
2. Différentes études 24<br />
3. Discussion 25<br />
D. Effets génotoxiques 27<br />
E. Le stress cellulaire 28<br />
F. Effets sur le système immunitaire 29<br />
3
III. Epidémiologie et études d’observation 30<br />
A. Principe des études d’observation 30<br />
1. L’étude de cohorte 30<br />
2. L’étude cas-témoins 30<br />
3. L’étude écologique 31<br />
4. Intervalle de confiance 31<br />
5. Les biais 31<br />
B. Résultats et critique des études 32<br />
1. L’incertitude des débuts 32<br />
2. Les études récentes 33<br />
C. Discussion 34<br />
Conclusion 35<br />
Bibliographie 36<br />
Annexe 1<br />
Annexe 2<br />
4
Table des illustrations<br />
Représentation spatiale d’une onde électromagnétique (page8)<br />
Spectre des fréquence d’ondes électromagnétique (page 9)<br />
Antennes-relais et réseau cellulaire (page 10)<br />
Structure d'un onde porteuse modulée en intensité (page 10)<br />
Bandes de fréquence des liaisons montantes et descendantes (page11)<br />
Mesure d’une onde pulsée à 217 Hz (page 12)<br />
Antenne en f<strong>ou</strong>et à dipôles λ/4 et antenne hélicoïdale (page 13)<br />
Progression de la cancérisation (page 17)<br />
5
Lexique<br />
Bande de fréquence : Dans le cadre des ondes électromagnétiques de radiofréquence, elle<br />
représente une étendue de valeurs de fréquence, réservée à des systèmes de<br />
communication particuliers par l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR).<br />
Barrière hémato-encéphalique : Réseau de vaisseaux sanguins dont des cellules<br />
endothéliales possèdent des jonctions serrées empêchant les substances potentiellement<br />
<strong>danger</strong>euses de pénétrer dans le cerveau.<br />
Canaux de fréquence : Dans le domaine de la téléphonie mobile, c'est une bande de<br />
fréquence réduite, gérée par un opérateur, qui permet d'établir 8 communications<br />
simultanées.<br />
Cellule : Zone de territoire généralement hexagonale, c<strong>ou</strong>verte par le signal<br />
radioélectrique émis par un ensemble de stations de base.<br />
Epidémiologie analytique : L’épidémiologie est la science qui étudie la distribution et les<br />
déterminants des problèmes de santé dans une population dans un but de prévention. Par<br />
opposition à l’épidémiologie descriptive, l’épidémiologie analytique recherche les causes<br />
<strong>ou</strong> les facteurs de risques inconnus d’une pathologie.<br />
Facteur de risque : Elément associé à l’incidence accrue d’une maladie. Cela peut être une<br />
habitude de vie, un état physiologique <strong>ou</strong> pathologique.<br />
Incidence : En épidémiologie, c’est le nombre de n<strong>ou</strong>veaux cas d’une maladie dans une<br />
population, par rapport à une observation précédente. Cette grandeur représente donc la<br />
progression de la pathologie.<br />
Ipsilatéral : Synonyme de l’adjectif homolatéral. Exemple : quelqu’un en communication<br />
avec son <strong>portable</strong> collé contre son oreille droite sera irradié au niveau de l’oreille<br />
ipsilatérale (du même côté).<br />
Multiplexage temporel : Technologie permettant à une station de base déterminée,<br />
d'établir 8 communications simultanées sur le même canal de fréquence.<br />
Onde porteuse : Onde de haute fréquence dont la modulation porte une information de<br />
fréquence inférieure.<br />
Radiobiologie : Science des effets biologiques provoqués par des rayonnement sur un<br />
organisme vivant.<br />
Station de base (antenne-relais) : Antenne en liaison radioélectrique avec les terminaux<br />
mobiles. Elle permet de les relier à l'ensemble du réseau de télécommunication à la fois en<br />
émission et en réception.<br />
6
Terminal mobile (téléphone cellulaire) : Objet miniaturisé de télécommunication sans fil,<br />
en liaison avec l’ensemble réseau par l'intermédiaire de la station de base la plus proche.<br />
Il permet de recevoir et d'émettre simultanément des informations, notamment sonores,<br />
s<strong>ou</strong>s la forme d'OEM.<br />
Tumeur : Excroissance de tissus provoquée par la prolifération anormale de certaines<br />
cellules. Elle peut être bénigne <strong>ou</strong> maligne (cancer).<br />
7
3G : Troisième génération<br />
ACh : Acétylcholine<br />
ADN : Acide Désoxyribonucléique<br />
ANFR : Agence Nationale des Fréquences<br />
BHE : Barrière hémato-encéphalique<br />
DAS : Débit d'Absorption Spécifique<br />
DCS : Digital Communication System<br />
Abréviations et symboles<br />
ELF : Extremely Low Frequency (extrêmement basses fréquences)<br />
GSM : Global System Mobile communication<br />
HSP : Heat Shock Proteins (protéines de choc thermique)<br />
IC : Intervalle de confiance<br />
ICNIRP : International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection<br />
OEM : Ondes Electromagnétiques<br />
OR : Odds Ratio (<strong>ou</strong> RC)<br />
RC : Rapport de Cotes (<strong>ou</strong> OR)<br />
RR : Risque Relatif<br />
UMTS : Universal Mobile Telecommunications System<br />
8
Introduction<br />
« Sans cesse le progrès, r<strong>ou</strong>e au d<strong>ou</strong>ble engrenage,<br />
Fait marcher quelque chose en écrasant quelqu'un.<br />
Le mal peut être joie, et le poison parfum. »<br />
Extrait de Les Contemplations, Victor Hugo.<br />
Les progrès technologiques de ces dernières décennies ont permis de transformer<br />
beauc<strong>ou</strong>p de rêves dignes de la science-fiction, en réalité du quotidien. L'Homme du XXI e<br />
siècle peut désormais rester facilement en contact avec les siens, depuis n’importe quel<br />
endroit, grâce notamment au téléphone <strong>portable</strong>.<br />
En 1983, la firme Motorola a mis sur le marché le premier téléphone mobile de l’histoire.<br />
Cela n’a pas été considéré comme une invention au sens propre du terme car il existait<br />
déjà la radiotéléphonie de type talkie-walkie. Les concepteurs du téléphone <strong>portable</strong> ont<br />
eu l’idée d’adapter cette technologie à un système d’alimentation électrique miniaturisé,<br />
dans le but d’en faire un objet commercial de masse. Depuis, grâce des campagnes<br />
publicitaires intensives, cet <strong>ou</strong>til extraordinaire a réussi à s’imposer dans presque t<strong>ou</strong>s les<br />
foyers français. De 1995 à 2007 en France, les téléphones mobiles se sont multipliés<br />
comme des champignons, passant de 1,3 à plus de 55 millions.<br />
Cependant, t<strong>ou</strong>t comme il existe des champignons vénéneux, certains scientifiques se<br />
demandent si cet objet ne p<strong>ou</strong>rrait pas s’avérer <strong>danger</strong>eux p<strong>ou</strong>r la santé humaine. En effet,<br />
cela fait plusieurs dizaines d’années que les émetteurs de radiodiffusion <strong>ou</strong> de télévision,<br />
produisant des ondes électromagnétiques de forte puissance, sont suspectés d’être nocifs.<br />
A l’apparition des téléphones <strong>portable</strong>s, fonctionnant aussi grâce à ces ondes, les mêmes<br />
questions se sont donc posées.<br />
Une multitude d’études scientifiques ont été lancées p<strong>ou</strong>r tenter de répondre à ces<br />
interrogations. Mais à l’heure actuelle, les résultats restent tellement partagés que les<br />
médias, les politiques et l’opinion publique demeurent dans le fl<strong>ou</strong> le plus total. Seuls les<br />
experts des deux camps sont convaincus par leurs conclusions. Certains affirment qu’il<br />
n’y a aucun risque quant à l’utilisation d’un téléphone sans fil, d’autres établissent des<br />
liens avec des symptômes bien particuliers et même certaines pathologies graves comme<br />
le cancer.<br />
Alors qui croire dans cette affaire de santé publique ? C’est ce mystère qui n<strong>ou</strong>s a conduit<br />
à n<strong>ou</strong>s intéresser à notre sujet : l’utilisation intensive du téléphone <strong>portable</strong> est-elle à<br />
terme un facteur de risque de développement des tumeurs ? Doit-on appliquer le principe<br />
de précaution ?<br />
Afin de p<strong>ou</strong>voir répondre à t<strong>ou</strong>tes ces questions, n<strong>ou</strong>s allons, dans un premier temps,<br />
définir les notions indispensables p<strong>ou</strong>r aborder le sujet. Puis n<strong>ou</strong>s étudierons la<br />
radiobiologie des rayonnements de la téléphonie mobile, c'est-à-dire leurs effets<br />
biologiques sur l’organisme. Enfin, n<strong>ou</strong>s ferons le point sur les études épidémiologiques<br />
réalisées à ce j<strong>ou</strong>r.<br />
9
I. Cadre théorique<br />
A. Notions d'électromagnétisme<br />
P<strong>ou</strong>r p<strong>ou</strong>voir débattre des effets des rayonnements électromagnétiques sur l’organisme, il<br />
s’agit dans un premier temps d’en connaître les caractéristiques.<br />
1. Définitions<br />
L'électromagnétisme est une des quatre grandes forces physiques qui régit l'univers, mais<br />
c'est aussi le nom de la science qui l'étudie. Parmi les nombreux domaines que compte<br />
cette spécialité, n<strong>ou</strong>s allons n<strong>ou</strong>s intéresser plus particulièrement au phénomène de<br />
rayonnements électromagnétiques. Ces derniers transportent de l’énergie sans support<br />
matériel à la vitesse de la lumière et peuvent être considérés de deux façons différentes.<br />
En ce qui concerne la téléphonie mobile, les rayonnements peuvent être définis par un<br />
flux d’éléments énergétiques dép<strong>ou</strong>rvus de masse appelés photons, <strong>ou</strong> plus c<strong>ou</strong>ramment<br />
représentés s<strong>ou</strong>s la forme d’onde électromagnétique (OEM).<br />
Ces ondes transportent un champ électromagnétique variable qui possède deux<br />
composantes perpendiculaires oscillant en phase de manière sinusoïdale :<br />
champ électrique E<br />
champ magnétique B<br />
Les OEM et leurs caractéristiques :<br />
Célérité c nécessairement égale à la vitesse de la lumière soit 3.10 8 m.s -1<br />
Energie quantique E. Elle correspond à l’énergie portée par chaque photon et<br />
s’exprime en j<strong>ou</strong>les (J) <strong>ou</strong> en électron-volt (eV).<br />
La formule énoncée par Planck permet d’établir un lien entre ces différents<br />
paramètres grâce à la constante de Planck h = 6.626068 . 10 -34 J.s :<br />
E = h . ν =<br />
h . c<br />
λ<br />
10
2. Rayonnements ionisants et non ionisants<br />
A partir d’une certaine valeur E, les rayonnements électromagnétiques sont dits ionisants<br />
car chacun des photons dispose de suffisamment d’énergie p<strong>ou</strong>r arracher des électrons à la<br />
matière. Ce seuil théorique délimitant rayonnements ionisant et non-ionisant a été fixé à<br />
13.6 eV, ce qui correspond à l’énergie nécessaire p<strong>ou</strong>r ioniser un atome d’hydrogène.<br />
Parmi les rayonnements ionisants, on peut mentionner les rayons X et les rayons<br />
cosmiques. Ces derniers sont donc capables de provoquer une mutation au niveau de<br />
l’Acide Désoxyribonucléique (ADN).<br />
Les rayonnements non-ionisants sont incapables d’arracher des électrons à cause de la<br />
faible énergie de leurs photons. On peut notamment citer les ondes radio, celles de la<br />
télévision, des f<strong>ou</strong>rs micro-ondes, du téléphone mobile <strong>ou</strong> la lumière. Les ultra-violets,<br />
quant à eux, sont à la frontière de l’ionisation.<br />
11
B. Description des OEM de la téléphonie mobile<br />
1. Présentation du réseau cellulaire<br />
Le réseau de télécommunication qui n<strong>ou</strong>s permet d'utiliser la téléphonie sans fil<br />
fonctionne grâce à des stations de base, aussi appelées antennes-relais. Les stations sont<br />
reparties sur t<strong>ou</strong>t le territoire et permettent une c<strong>ou</strong>verture radio sur une surface<br />
déterminée appelée cellule. C’est de là que viennent les noms de réseau cellulaire et<br />
téléphone cellulaire. Une cellule peut gérer un nombre déterminé d’appels téléphoniques,<br />
c’est p<strong>ou</strong>rquoi dans les zones denses en population, leur taille a tendance à diminuer. Au<br />
centre de chaque cellule, on retr<strong>ou</strong>ve généralement un ensemble de trois antennes-relais<br />
émettant chacune avec un angle de rec<strong>ou</strong>vrement latéral de 120° et une légère inclinaison<br />
vers le bas.<br />
Antennes-relais Ensemble d’antennes vu de haut Réseau cellulaire<br />
Que ce soit dans les réseaux fixes <strong>ou</strong><br />
mobiles, lors d’une communication, le son<br />
de la voix est transformé en signal électrique<br />
par le microphone puis en signal numérique<br />
par un convertisseur. En ce qui concerne les<br />
<strong>portable</strong>s, ce signal sera porté par OEM<br />
hautes fréquences modulées en intensité : on<br />
parle d’onde porteuse.<br />
12
Les OEM porteuses ont des fréquences propres variables selon le type de réseau utilisé.<br />
Ce sont les bandes de fréquence. Voici les trois plus c<strong>ou</strong>rantes en France :<br />
Le GSM (Global System Mobile communication) est un système de 2 ème<br />
génération (2G). Contrairement à la première génération, il émet un signal<br />
digitalisé <strong>ou</strong> encore numérisé, et non plus un signal analogique. C’est actuellement<br />
le système le plus utilisé et il fonctionne sur une bande aut<strong>ou</strong>r d’une fréquence de<br />
900 MHz.<br />
Le DCS (Digital Communication System) est l’autre système 2G mais il<br />
fonctionne aut<strong>ou</strong>r de 1800 MHz<br />
L’UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) correspond à la 3 è<br />
génération communément appelée 3G, qui permet de transporter bien d’autres<br />
informations que du son : visiophonie, télévision numérique sur <strong>portable</strong>… Ce<br />
système fonctionne en principe aut<strong>ou</strong>r de 2100 MHz, même si des bandes de 900<br />
MHz viennent de lui être autorisées.<br />
2. Bandes et canaux de fréquence<br />
Quel que soit le type de station de base (GSM, DSC, UMTS…) il y a deux bandes de<br />
fréquences par antenne. L’une permet la transmission des liaisons descendantes : station<br />
vers terminal. L’autre fait de même p<strong>ou</strong>r les liaisons montantes terminaux vers station)<br />
comme le montre la figure ci-dess<strong>ou</strong>s. Ces deux bandes sont séparées d’une intervalle ce<br />
qui permet au téléphone <strong>portable</strong> de traiter les ondes qu’il émet différemment de celles<br />
qu’il envoie. Contrairement au talkie-walkie, qui n’utilise qu’une seule fréquence, on peut<br />
donc à la fois parler et éc<strong>ou</strong>ter.<br />
Même à l’intérieur d’une cellule, les<br />
communications entre une antenne-relais<br />
et les différents <strong>portable</strong>s se font sur des<br />
canaux de fréquences légèrement<br />
différentes ce qui permet à la station de<br />
base d’identifier chaque téléphone sans<br />
fil en appel. P<strong>ou</strong>r ne pas que les<br />
terminaux en communication se<br />
« gênent » au sein de la même cellule, on<br />
a besoin d’une largueur de canal de 200<br />
kHz p<strong>ou</strong>r éviter t<strong>ou</strong>te interférence. P<strong>ou</strong>r<br />
une antenne-relais classique de type<br />
GSM, la largeur de la bande étant de 35<br />
MHz, théoriquement, elle peut donc<br />
permettre des communications sur 175<br />
canaux simultanément (35 / 0.2 = 175).<br />
13
3. Le multiplexage temporel<br />
Très vite, avec l’augmentation du marché du mobile, ce chiffre de 175 canaux par antenne<br />
n’a pas suffit pas aux opérateurs. Ces derniers ne p<strong>ou</strong>vaient pas demander d’élargir la<br />
bande de fréquence car l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR) avait déjà t<strong>ou</strong>t<br />
déterminé. La solution était donc de renforcer le parc de stations de base mais cela aurait<br />
représenté un investissement colossal. De plus, sachant que les antenne-relais p<strong>ou</strong>vaient<br />
émettre jusqu’à des kilomètres, il aurait été dommage p<strong>ou</strong>r eux de réduire la taille des<br />
cellules. Des ingénieurs ont donc tr<strong>ou</strong>vé une solution p<strong>ou</strong>r faire en sorte que chaque<br />
antenne administre encore plus d’appels avec le même nombre de canaux : le<br />
multiplexage temporel.<br />
Ce système, utilisé par le réseau GSM, fait en sorte que chaque utilisateur n'utilise un<br />
canal de transmission que pendant 1/8 è du temps, et le reste du temps soit disponible p<strong>ou</strong>r<br />
d’autres utilisateurs. Huit appels peuvent par conséquent être transmis simultanément sur<br />
le canal. Ainsi, en communication, notre <strong>portable</strong> transmet notre voix par onde porteuse<br />
pendant une durée de 0.58 milliseconde t<strong>ou</strong>te les 4.64 millisecondes. Ce temps est<br />
tellement c<strong>ou</strong>rs que notre interlocuteur ne peut pas s’en rendre compte.<br />
L’onde émise par le téléphone GSM a donc une structure bien particulière, dite « pulsée »<br />
<strong>ou</strong> « en créneaux » comme le montre la figure ci-dessus. Cela a p<strong>ou</strong>r effet majeur de créer<br />
une extrêmement basse fréquence de 217 Hz (ELF : Extremely Low Frequency). Du fait<br />
de la technologie particulière utilisée en téléphonie mobile, <strong>ou</strong>tre cette fréquence de 217<br />
Hz, des fréquences de 2Hz et de 8Hz sont également présentes.<br />
14
4. Production des OEM par le <strong>portable</strong><br />
Les OEM issues d’un téléphone mobile sont générées par son antenne. Cet élément a la<br />
capacité de transformer un signal électrique en une onde électromagnétique durant<br />
l’émission <strong>ou</strong> l’inverse pendant la réception. L’antenne d’un <strong>portable</strong> peut servir<br />
simultanément à l’émission et à la réception.<br />
L’émission des OEM est basée sur le principe selon lequel t<strong>ou</strong>te charge électrique mise en<br />
m<strong>ou</strong>vement produit des champs électrique et magnétique. Un c<strong>ou</strong>rant est appliqué à un<br />
circuit électrique <strong>ou</strong>vert, il s’agit donc d’un simple fil métallique appelé le f<strong>ou</strong>et. Les deux<br />
extrémités de ce fil, appelées pôles, sont munies d’adaptateur d’impédance afin que<br />
l’énergie électrique puisse sortir du circuit et se propager dans l’air. L’intensité du champ<br />
magnétique formé est lié à l’intensité du c<strong>ou</strong>rant électrique circulant dans l’antenne, et<br />
l’intensité du champ électrique sera lié à la tension électrique appliquée à l’antenne. Il<br />
convient d’utiliser une longueur d’antenne égale au quart de la longueur d’onde λ du<br />
rayonnement (antenne de 8 cm environ p<strong>ou</strong>r le système GSM de 900 MHz). Une antenne<br />
n’émet donc qu’aut<strong>ou</strong>r d’une fréquence déterminée.<br />
Antenne en f<strong>ou</strong>et à dipôles λ/4 Antenne hélicoïdale<br />
Mais la miniaturisation de plus en plus p<strong>ou</strong>ssée des terminaux mobiles oblige à tr<strong>ou</strong>ver<br />
des solutions moins consommatrices d’espace. Ainsi, une n<strong>ou</strong>velle génération d’antennes<br />
hélicoïdales apparaît ce qui permet de descendre à une longueur d’antenne de 2 à 3 cm<br />
maximum. De plus, les fabricants s<strong>ou</strong>dent l’antenne au circuit imprimé ce qui permet de<br />
gagner encore de la place et de cacher complètement ce qui p<strong>ou</strong>rrait inquiéter à<br />
l’utilisateur. Cette quête du « t<strong>ou</strong>j<strong>ou</strong>rs plus petit » a un impact sur la qualité du signal et<br />
oblige l’antenne à compenser par plus de puissance délivrée.<br />
En fonction de la technologie d’antenne choisie, l’émission sera différente. Mais dans<br />
t<strong>ou</strong>s les cas elle ne sera pas isotrope. De ce simple constat, on peut s’apercevoir que la<br />
puissance de rayonnement reçue par l’utilisateur sera plus importante à certains endroits<br />
qu’à d’autres.<br />
La réception est basée sur le principe de l’induction électromagnétique. Le circuit<br />
électrique traversé par un rayonnement électromagnétique voit apparaître un c<strong>ou</strong>rant<br />
induit. Ce signal est recueilli et traité par un récepteur spécifique.<br />
15
C. Unités de mesure<br />
1. Intensité des champs E et H<br />
Le champ électrique E représente une des composantes des ondes électromagnétiques. En<br />
hautes fréquences émises par les téléphones mobiles, c'est la grandeur de référence p<strong>ou</strong>r<br />
évaluer l'intensité des ondes électromagnétiques. L'intensité du champ électrique se<br />
mesure en volt par unité de longueur (V/m). Le champ magnétique H, seconde<br />
composante de ce type d'ondes, se mesure en ampère par unité de longueur (A/m).<br />
2. Puissance rayonnée isotrope équivalente (PIRE)<br />
C’est la puissance totale qui se dégage à la s<strong>ou</strong>rce d’une antenne émettrice, quelque soit la<br />
directivité du faisceau de rayonnement. Elle se mesure en Watt (W) <strong>ou</strong> en j<strong>ou</strong>les par unité<br />
de temps (J.s -1 ). Elle correspond donc à une mesure du flux énergétique par unité de<br />
temps. En fonction des <strong>portable</strong>s et de la qualité du réseau, elle varie de 1 mW à 1 W p<strong>ou</strong>r<br />
les fréquences DCS et de 2 mW à 2 W p<strong>ou</strong>r les GSM.<br />
3. La densité de puissance D :<br />
Elle indique la puissance de radiation reçue par unité de surface. Cette grandeur,<br />
facilement mesurable en un endroit donné, permet un calcul (et non pas une mesure)<br />
rapide du dégagement de chaleur produit par l'onde électromagnétique sur un organisme :<br />
effet thermique. Elle s'exprime en Watt par unité de surface (W/m2). En ce qui concerne<br />
la téléphonie mobile, cette unité n’est pas utilisée car elle ne prend pas en compte un<br />
élément primordial p<strong>ou</strong>r la dosimétrie : la géométrie de l’antenne. En effet, selon sa<br />
forme, la répartition des OEM émises ne sera pas isotrope.<br />
4. Le Débit d'Absorption spécifique (DAS) :<br />
Il est aussi appelé Taux d'Absorption Spécifique TAS <strong>ou</strong> encore SAR en anglais<br />
(Specific Absorption Rate). Cette unité permet de mesurer (et non de calculer) la<br />
puissance de rayonnement réellement dissipée par masse de tissu biologique. Elle se<br />
mesure donc en W/kg. Cette grandeur ne tient pas compte de l'état de vie <strong>ou</strong> de mort du<br />
tissu mais uniquement de la manière dont il va absorber les ondes électromagnétiques,<br />
notamment grâce à l'eau qu'il contient. Le DAS permet aussi de mettre en évidence l'effet<br />
thermique. En revanche, il ne permet pas une évaluation pratique in vivo. P<strong>ou</strong>r le mesurer,<br />
on a rec<strong>ou</strong>rt à un protocole bien précis qui consiste à placer un capteurs de température<br />
dans un cube contenant 10 grammes d’un gel censé reproduire le tissu humain et on<br />
mesure le dégagement de chaleur après 6 minutes.<br />
La plupart des spécialistes admettent que p<strong>ou</strong>r des ondes du type de la téléphonie mobile,<br />
un DAS de 0.4 W/kg correspond à une densité de puissance de 1 mW/cm2. Mais il ne<br />
s'agit là que d'estimations.<br />
16
D. Cadre législatif<br />
1. Normes d’expositions en France<br />
• Le décret du 3 mai 2002 relatif aux valeurs limites d’exposition du public aux champs<br />
électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de<br />
télécommunication constitue une partie de la réglementation actuelle. Il fixe des<br />
intensité de champ électrique à ne pas dépasser en fonction des bandes de fréquences :<br />
41 V/m p<strong>ou</strong>r la fréquence GSM 900 MHz<br />
58 V/m p<strong>ou</strong>r la technologie DCS 1800 MHz<br />
61V/m p<strong>ou</strong>r le réseau UMTS 2100Mhz<br />
• Un autre décret, du 8 octobre 2003 définit des valeurs de DAS à ne pas dépasser en ce<br />
qui concerne les terminaux mobiles :<br />
Moyenne DAS p<strong>ou</strong>r l’ensemble du corps : 0.08 W/kg<br />
DAS localisé (tête et tronc) : 2 W/kg<br />
DAS localisé (membres) : 4 W/kg<br />
T<strong>ou</strong>tes ces normes reposent sur des recommandations de l’International Commission on<br />
Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) datant de 1998. Elles prennent en compte<br />
seulement deux effets des OEM. D’un part, ces valeurs n<strong>ou</strong>s protègent d’un effet<br />
thermique pathologique donc n<strong>ou</strong>s protègent de la cuisson. De l’autre elles veillent à ce<br />
que l’intensité des c<strong>ou</strong>rants induits dans notre organisme par les OEM des de basses<br />
fréquences soit plus faibles que les c<strong>ou</strong>rants électriques physiologiques.<br />
2. Principe de précaution :<br />
Depuis 2004, ce principe est inscrit dans la Charte de l’environnement de la Constitution<br />
française, c'est-à-dire au niveau le plus élevé des normes juridiques. Dans l’article 5, il est<br />
proposé une définition du principe de précaution : « Lorsque la réalisation d'un dommage,<br />
bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, p<strong>ou</strong>rrait affecter de manière<br />
grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du<br />
principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de<br />
procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et<br />
proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. »<br />
17
E. Notion de cancérogenèse<br />
Après avoir présenté les OEM et les lois qui régissent leur émission, avant d’aborder les<br />
preuves scientifiques, il est nécessaire d’approfondir la notion de tumeur. T<strong>ou</strong>t d’abord on<br />
peut la définir par l’apparition, dans un tissu vivant, d’un ensemble de cellules anormales,<br />
notamment au niveau de leur prolifération. Si cette prolifération est modérée, on parle de<br />
tumeur bénigne, mais si elle est anarchique, on parle de tumeur maligne <strong>ou</strong> encore de<br />
cancer. Afin de comprendre comment une telle pathologie peut survenir, n<strong>ou</strong>s allons<br />
étudier les différentes phases de son apparition : la cancérogenèse.<br />
1. L’initiation<br />
Ce premier évènement correspond aux mutations de gènes impliqués dans la prolifération<br />
cellulaire anarchique. Ces gènes sont appelés les oncogènes. Les agents connus p<strong>ou</strong>vant<br />
provoquer de cette mutation de l’ADN sont appelés des facteurs initiateurs :<br />
Tabac, amiante et autres toxiques chimiques<br />
Radiations ionisantes<br />
Beauc<strong>ou</strong>p de virus (Virus de l’Immunodéficience Humaine,<br />
hépatites…) et quelques autres agents infectieux<br />
Facteurs d’origine endogène : molécules issues de notre<br />
métabolisme<br />
Un déficit en substances physiologiques au p<strong>ou</strong>voir antioxydant<br />
(exemple de la mélatonine <strong>ou</strong> du tamoxifène).<br />
A cette étape, on ne parle pas de cancer. En effet, la plupart de ces mutations sont<br />
détectées puis réparées par des protéines spécifiques. Si elles ne sont pas réparées, la<br />
cellule atteinte va en principe se diriger spontanément vers une apoptose (mort cellulaire<br />
programmée) <strong>ou</strong> va devenir sénescente donc arrêter de se diviser. Dans le cas où la cellule<br />
ne détecte pas l’erreur sur l’ADN, <strong>ou</strong> que les processus normaux ne se dér<strong>ou</strong>lent pas, on<br />
ab<strong>ou</strong>tit à un état précancéreux et la seconde étape est désormais possible.<br />
2. La promotion<br />
Cette phase correspond à l’expression progressive des oncogènes t<strong>ou</strong>chés lors de l’étape<br />
précédente. Cela n’empêche en rien le fait que d’autres mutations puissent avoir lieu<br />
simultanément, d’autant plus que cette phase peut se dér<strong>ou</strong>ler plusieurs dizaines d’années.<br />
Les cellules acquièrent au fur et à mesure des caractéristiques cancéreuses : mitoses<br />
importantes effectuées sans contrôle du milieu, « immortalité » cellulaire (inhibition de<br />
l’apoptose) , capacité proliférative illimitée… Seules les cellules ayant l’état le plus<br />
avancé dans la maladie survivront à la compétition comme le montre la figure ci-après.<br />
18
A partir de ce stade, on peut parler de tumeur maligne <strong>ou</strong> bénigne suivant l’importance<br />
des altérations et en fonction de sa capacité proliférative. Là aussi on retr<strong>ou</strong>ve des facteurs<br />
promoteurs :<br />
Hormonaux : obésité, traitement hormonal de substitution…<br />
Facteurs de croissance cellulaires<br />
Etat inflammatoire chronique notamment à cause de la<br />
libération de cytokines : alcool, tabac, pathologies<br />
inflammatoires…<br />
Protéines de stress <strong>ou</strong> protéines HSP [1]<br />
3. La progression<br />
La progression débute par le stade de l’angiogenèse. Les cellules cancéreuses libèrent des<br />
substances favorisant la création de vaisseaux sanguins à proximité. C’est à ce moment là<br />
que commence le développement massif de la tumeur maligne, qui va même aller<br />
s’infiltrer dans les tissus adjacents.<br />
Par la suite, les cellules cancéreuses, continuant leur évolution, peuvent se transformer en<br />
des formes encore plus graves : les cellules métastatiques. Ces dernières ont des défauts<br />
d’adhésion cellulaire, vont par conséquent p<strong>ou</strong>voir être larguées dans la circulation<br />
lymphatique <strong>ou</strong> sanguine, p<strong>ou</strong>r aller coloniser un autre tissu.<br />
19
II. Etudes expérimentales et radiobiologie<br />
Maintenant que n<strong>ou</strong>s sommes armés p<strong>ou</strong>r comprendre les éléments mis en jeu dans cette<br />
histoire, entrons sans plus attendre dans le vif du sujet. Afin d’établir un éventuel lien<br />
entre OEM et cancer, commençons par n<strong>ou</strong>s intéresser aux mécanismes physiques<br />
d’interaction avec l’organisme. N<strong>ou</strong>s verrons ensuite si les effets biologiques tr<strong>ou</strong>vés<br />
peuvent induire des effets pathologiques de type tumorigène.<br />
A. Des ondes non-ionisantes<br />
Comme n<strong>ou</strong>s l’avons vu précédemment, l’origine des cancers réside dans la mutation<br />
d’un gène. A partir de la fréquence des OEM des téléphones <strong>portable</strong>s, n<strong>ou</strong>s allons<br />
calculer l’énergie quantique E. Ainsi n<strong>ou</strong>s allons vérifier si elle est assez importante p<strong>ou</strong>r<br />
provoquer des ionisations de la matière et donc léser l’ADN.<br />
Prenons comme référence la fréquence de 2.1 GHz correspondant au système UMTS<br />
(3G). En téléphonie mobile, c’est la bande de fréquence la plus grande utilisée, c’est donc<br />
celle qui a l’énergie quantique la plus élevée.<br />
E = h . ν<br />
E = 6.626068 . 10 -34 x 2.1 . 10 9<br />
E = 1.4 . 10 -24 J<br />
E = 8.7 . 10 -6 eV<br />
Or un rayonnement est ionisant si E > 13.6 Ev. On peut donc conclure que, d’après la<br />
théorie quantique, parmi les OEM étudiées, même les plus énergétiques sont largement<br />
trop faibles p<strong>ou</strong>r p<strong>ou</strong>voir provoquer une mutation génétique. De ce point de vue là, les<br />
ondes ne peuvent donc pas être des facteurs initiateurs de cancer.<br />
20
B. Effets sur la barrière hémato-encéphalique (BHE)<br />
Au niveau cérébral, la BHE est une membrane formée par un réseau de cellules<br />
vasculaires spécialisées, qui a p<strong>ou</strong>r but de protéger les neurones des substances du sang<br />
p<strong>ou</strong>vant être nocives. Elle a la particularité d’être imperméable à la quasi-totalité des<br />
molécules présentes dans le sang (sauf certaines molécules vitales comme l’eau, le<br />
glucose, l’O2…) Cette étanchéité est assurée par les jonctions serrées des cellules<br />
constituant les capillaires. Cette BHE a également un rôle de régulation dans la<br />
concentration de différents éléments tels les ions.<br />
1. Augmentation de la perméabilisation<br />
P<strong>ou</strong>r mettre en évidence une rupture de la BHE, certaines équipes dosent l’albumine dans<br />
le tissu cérébral après exposition aux OEM. Cette grosse molécule absente du cerveau en<br />
principe car trop grosse, traverse la BHE si elle devient perméable.<br />
Les publications sur les effets des OEM de la téléphonie mobile sur la BHE sont<br />
nombreuses et les doses d'exposition testées c<strong>ou</strong>vrent les valeurs susceptibles d'être reçues<br />
par les utilisateurs de téléphonie mobile.<br />
A des doses montrant un effet thermique important, donc au-delà des normes actuelles, la<br />
majorité des expériences [2] à [16] ont montré un effet ce qui fait d'ailleurs l'objet d'un<br />
consensus. Certaines équipes ne retr<strong>ou</strong>vent t<strong>ou</strong>tefois aucun effet, ni à dose thermique, ni à<br />
dose non thermique [17]. Il est donc logique d'invoquer un problème de sensibilité de<br />
détection de la fuite d'albumine au niveau de la BHE p<strong>ou</strong>r ces équipes comme le fait<br />
Persson [6]. Les travaux de Finnie et al. [17] en sont un bon exemple puisque leur<br />
conclusion est une perméabilisation faible, alors que les résultats eux-mêmes montrent<br />
une augmentation significative des fuites d'albumine sauf à 16 W/kg qui correspond à<br />
l’entrée de la fenêtre thermique.<br />
Dans la zone non thermique, correspondant aux doses reçues par un utilisateur de<br />
téléphone <strong>portable</strong> (0,3 W/kg à 5 W/kg) t<strong>ou</strong>tes les équipes utilisant l'albumine comme<br />
marqueur ([2] à [8] ; [10] ; [16] et [17]) retr<strong>ou</strong>vent des résultats équivalents, sauf Tsurita<br />
[19] qui ne valide pas la sensibilité de détection en zone thermique. D'autres équipes ne<br />
retr<strong>ou</strong>vent pas d'effets mais avec des marqueurs différents de l'albumine et sans valider<br />
leur détection en zone thermique [19] [20]. On ne sait donc pas si leur technique de<br />
marquage de l’<strong>ou</strong>verture de la BHE est fiable.<br />
Le marqueur utilisé est important puisque la BHE est un filtre sélectif et qu'une substance<br />
comme l’albumine, peut voir son transport modifié sans que ce soit le cas p<strong>ou</strong>r une autre<br />
substance (par exemple le sucrose).<br />
Aux alent<strong>ou</strong>rs de 0,1 W/kg à 0,3 W/kg, il y a discordance entre les travaux de Persson [6]<br />
[8] [18], de Fritze [5] et ceux de Tore. Mais cela n'est qu'apparent puisque avec une onde<br />
modulée à 217 Hz identique (type GSM) à Tore, Salford [4] <strong>ou</strong> Fritz [5] ne tr<strong>ou</strong>vent<br />
qu'une action faible, qui augmente dans les doses inférieures, contrairement à l'onde<br />
continue de radiofréquence [4] [6]. En dess<strong>ou</strong>s de 0,1 W/kg (cerveau) l'équipe de Persson<br />
confirme d'anciens travaux déjà réalisés dans les années 80.<br />
Les différents compte rendus de ces expériences montrent une action importante jusqu'à<br />
des DAS corps entier de 0,0016 W/kg soit environ 0,006 W/kg moyenne sur le cerveau,<br />
21
que ce soit en onde continue <strong>ou</strong> en onde modulée. Cela est très loin des valeurs<br />
réglementaires. L'exposition des rats se faisant à 24 µW/cm² (environ 3V/m à 7,7 V/m au<br />
niveau du cerveau des rats selon le mode de calcul – émission à 9,9v/m) ces doses sont de<br />
l'ordre de celles reçues par les riverains d'antennes relais <strong>ou</strong> lors d'une pollution passive<br />
d'une personne se situant à moins de 1,80m d'un utilisateur de téléphone<br />
.<br />
Il est donc évident qu'il n'y a pas de discordances entre les différents travaux<br />
contrairement à ce qu'on tr<strong>ou</strong>ve dans certains rapports français. Il est aussi évident que les<br />
doses de ces expériences sont de l'ordre de celles reçues par les utilisateurs de téléphones<br />
cellulaires.<br />
Ce qui est également très net c'est que l'on ne tr<strong>ou</strong>ve pas de relation dose/effet strictement<br />
linéaire mais en forme de creux de vague (d'onde) et dans une zone étroite, la relation<br />
dose/effet peut être inversée [4] [6] par rapport à ce qu'attendent certains physiciens.<br />
D'ailleurs cette notion de fenêtre a été constatée par d'autres effets et fait partie intégrante<br />
du mécanisme d'action des OEM.<br />
En ce qui concerne une éventuelle exposition répétée à des doses très faibles, une seule<br />
équipe a évoqué des travaux de ce type mais les résultats ne sont pas publiés. T<strong>ou</strong>tefois à<br />
ces doses, il a été montré que le temps d'exposition est aussi un facteur déterminant quant<br />
aux effets sur la BHE comme cela a été rapporté par d'autres effets des micro-ondes [24].<br />
2. Conséquences de cette perméabilisation<br />
Une altération de la BHE par une augmentation de sa perméabilité est susceptible de<br />
laisser passer au niveau des cellules nerveuses, des substances telle l'albumine, des ions,<br />
des substances chimiques, des virus [11]. Les expériences s'effectuent principalement sur<br />
le rat du fait de ses analogies de la structure de sa BHE avec celle de l'homme, c'est<br />
d'ailleurs le modèle de choix p<strong>ou</strong>r t<strong>ou</strong>tes les études concernant les conséquences d'une<br />
ischémie cérébrale <strong>ou</strong> celles concernant la maladie d'Alzheimer entre autre.<br />
Les conséquences à c<strong>ou</strong>rt terme sont la formation de micro-œdèmes d'inflammation de la<br />
dure-mère et donc apparition de migraines, de maux de tête. Les premières tentatives<br />
d'explications on fait appel au chauffage venant de la batterie du téléphone elle même<br />
mais cette explication ne tient plus avec les téléphones plus récents et la responsabilité<br />
directe des OEM est évoquée [27]. De plus, ces pathologies se retr<strong>ou</strong>vent dans les<br />
enquêtes épidémiologiques concernant les riverains d'antennes relais p<strong>ou</strong>r lesquels la<br />
notion de chauffage est bien sûr inexistante.<br />
Il n'y a pas eu d'études d'effets des OEM sur la barrière hémato-thymus alors qu'une<br />
perméabilisation de cette barrière p<strong>ou</strong>rrait être impliquée dans le développement de<br />
certaines tumeurs <strong>ou</strong> leucémies [30] et expliquerait la plus grande sensibilité des efforts<br />
(leucémies infantiles) aux OEM d'extrêmement basses fréquences de l'électricité (le<br />
thymus s’atrophie à l'adolescence).<br />
Quelques équipes notent la réversibilité de la perméabilisation de la BHE [5-6-7-8-9].<br />
Cette correction n'a malheureusement pas d'intérêt dans le cadre de l'utilisation répétée<br />
des téléphones <strong>portable</strong>s, de plus les conséquences secondaires de cette perméabilisation à<br />
plus long terme existent.<br />
22
Les sarcomes, astrocytomes, et plus généralement les tumeurs cérébrales dont le siège est<br />
au niveau des méninges, notamment lepto-méningée, ont une origine supposée<br />
inflammatoire. Si la dégénérescence des cellules nerveuses n'a t<strong>ou</strong>t d'abord été qu'une<br />
hypothèse [6] [30], elle a récemment été démontrée à très faible dose par Hassel :<br />
24µwatt/cm². Ce dernier confirme que la toxicité de l'albumine endogène en excès au<br />
niveau du parenchyme cerveau.<br />
3. Mécanisme<br />
Les travaux montrant que les radio fréquences sont un facteur de stress cellulaire sont très<br />
nombreux avec comme première conséquence visible les modifications de la synthèse des<br />
protéines de stress de type HSP (heat shock protein) qui sont des facteurs promoteur de<br />
cancer comme n<strong>ou</strong>s l’avons vu. Le transport actif au niveau de la BHE fait intervenir,<br />
dans les cellules endothéliales cérébrales, des phosphorylations-déphosphorylations par<br />
des enzymes, les SAP (kinases-stress activated protein) qui sont également activées par le<br />
stress cellulaire en entrainant une augmentation du trafic intracellulaire, la transcytose. La<br />
conséquence immédiate est la formation d'œdèmes et de nécrose hémorragiques<br />
cérébrales.<br />
Il faut noter au niveau de la BHE l'imbrication importante avec les neurones et qu'une<br />
atteinte des neurones est irréversible, puisqu'ils sont incapables de se multiplier.<br />
Ces neurones sont également sécréteurs de neurotransmetteurs p<strong>ou</strong>r lesquels la synthèse<br />
peut être affectée à plusieurs niveaux par la voie de stress cellulaire.<br />
T<strong>ou</strong>te atteinte chronique des différents systèmes de neurotransmetteurs, avec impossibilité<br />
de régulation à moyen terme du fait des variations d'exposition aux radiofréquences,<br />
entraine une dégénérescence des neurones et le risque des maladies neurodégénératives<br />
qui en sont les conséquences.<br />
4. Conclusion<br />
L'effet des champs électromagnétiques de radiofréquences en terme de perméabilisation<br />
de la BHE ne fait donc aucun d<strong>ou</strong>te ni à doses thermiques ni à doses non thermiques,<br />
comparables à celles reçues par les utilisateurs de téléphones mobiles et leurs voisins.<br />
Ceci justifie donc des mesures d'évitement qui doivent être très importantes du fait des<br />
conséquences prévisibles à long terme. Ces effets apparaissent, selon certaines équipes, à<br />
des doses très basses qui concernent la « téléphonie passive ». Il faut donc une baisse<br />
importante des doses de rayonnements reçus : la limite supérieure de 0,1 µwatt/cm² soit<br />
0,6v/m demandée par plusieurs associations est un facteur de sécurité en fonction des<br />
connaissances actuelles. La recherche doit absolument être accélérée en s'orientant vers<br />
l'étude des effets de rayonnements répétés à faible dose ainsi que la détermination de la<br />
valeur seuil d'apparition de ces effets.<br />
23
C. Effets sur la biochimie cérébrale, les neurotransmetteurs et leurs<br />
récepteurs.<br />
Des effets des micro ondes sur la biochimie cérébrale, les neurotransmetteurs et leurs<br />
récepteurs sont connus et rapportés depuis plusieurs années dans différentes études. Il a<br />
été mis en évidence des modifications des teneurs cérébrales en sérotonine dès 1976, une<br />
baisse de la noradrénaline et de la dopamine en 1977 par Merrit [30].<br />
Les travaux de Lai [31] [32] rapportent des effets des micro ondes sur les récepteurs<br />
muscariniques, benzodiazépines et opioïdes.<br />
1. Cas de l'acétylcholine<br />
L'acétylcholine (ACh) est un neurotransmetteur synthétisé par les neurones et servant à la<br />
transmission des signaux d'une cellule à l'autre. L'ACh est synthétisée dans les<br />
terminaisons axonales à partir de la choline et de l'acétylcoenzyme réaction catalysée par<br />
la choline acétyltransferase. L'ACh est transportée activement dans les vésicules<br />
synaptiques où elle est stockée. Lorsque la membrane de l'élément pré-synaptique est<br />
dépolarisée par l'arrivée d'un potentiel d'action, les canaux Ca 2+ sensible au voltage<br />
s'<strong>ou</strong>vrent, provoquant une entrée d'ions Ca 2+ et une augmentation de la concentration<br />
intracellulaire en Ca 2+ , facteur indispensable au déclenchement de l'exocytose. Lorsqu'un<br />
potentiel d'action arrive par l'axone au niveau de la terminaison nerveuse, il y a <strong>ou</strong>verture<br />
des canaux calciques dépendants du potentiel. Ces canaux sont situés à proximité des<br />
zones actives. Il y a alors une entrée importante d'ions Ca 2+ par un fort gradient de<br />
concentration. Au c<strong>ou</strong>rs de l'<strong>ou</strong>verture des canaux calciques, il y a augmentation brusque<br />
de la concentration qui fait changer la conformation de la protéine de liaison des vésicules<br />
aux sites actifs. Cette transformation faciliterait la fusion des 2 membranes et la libération<br />
de l'acétylcholine dans la fente synaptique par exocytose. Des protéines membranaires<br />
sont aussi importantes dans le phénomène d'exocytose des neuromédiateurs :<br />
• La synapsine est localisée à la face externe des membranes vésiculaires. Elle est<br />
calmoduline Ca 2+ dépendante.<br />
La synaptotagmine molécule transmembranaire des vésicules synaptiques : elle est<br />
calcium dépendante et gère la fusion avec la membrane pré-synaptique au niveau des<br />
pores de fusion.<br />
Une fois libérée, l'acétylcholine se fixe sur des récepteurs nicotiniques <strong>ou</strong> des récepteurs<br />
muscariniques. L'acétylcholine présente dans la fente synaptique est ensuite dégradée par<br />
l'acetylcholinesterase (AChE). L'AChE est une glycoprotéine synthétisée dans le corps<br />
cellulaire et apporté jusqu'aux terminaisons par le transport axonal rapide.<br />
Elle hydrolyse l'acétylcholine en choline et acide acétique. 50% de la choline ainsi libérée<br />
est recaptée par la terminaison pré-synaptique.<br />
2. Différentes études<br />
De nombreux travaux ont s<strong>ou</strong>ligné l'effet des CEM sur le calcium intracellulaire et il a été<br />
montré que le calcium était un élément important de l'action des CEM sur l'activité des<br />
neuromédiateurs [33] <strong>ou</strong> sur les protéines des canaux jonctionnels de la synapse électrique<br />
d'où une action sur les communications intracellulaire [34].<br />
Les travaux de Dutta et al. [35] ont d'abord porté sur l'influence OEM modulées en<br />
amplitude sur les flux cellulaires de calcium. Ils ont montré des variations significatives<br />
de ces flux de calcium aux valeurs de SAR de 0,05 et 0,005 w/kg.<br />
24
Ils ont montré ensuite [36] que ces mêmes doses entraînaient des modifications de<br />
l'activité de l'acetylcholinesterase (AChE). Il y a donc bien altération des fonctions<br />
cellulaires.<br />
Les nombreux travaux de Lai et al. [37 à 57] ont confirmé et étendu différents travaux en<br />
montrant l'action des OEM sur le taux d'acétylcholine. L’augmentation en 20 minutes de<br />
l'exposition aux ondes puis l'exposition pendant 45min ont diminué l'activité de<br />
l'acétylcholine dans diverses régions du cerveau du rat, en particulier dans le cortex<br />
frontal de l'hippocampe.<br />
Ces effets différents des OEM de la téléphonie mobile peuvent s'expliquer par les<br />
mécanismes :<br />
action rapide par l'intermédiaire du calcium <strong>ou</strong> des protéines Ca-dépendantes de la<br />
synapse.<br />
Effet lent par mise en jeu de l'AChe <strong>ou</strong> par l'incidence sur la synthèse elle-même après<br />
activation des HSP et de la voie des MAP Kinases.<br />
L'effet final est donc fonction du temps d'exposition.<br />
Lai et al. ont également montré l'action d'expositions répétées qui se traduisent par une<br />
modification du nombre de récepteurs à l'acétylcholine impliquant des perturbations nonphysiologiques<br />
du taux d'acétylcholine. Testyler et al [58] ont s<strong>ou</strong>ligné aussi l'influence<br />
de la dose d'exposition d'une part <strong>ou</strong> du temps d'exposition à dose fixe d'autre part.<br />
3. Discussion<br />
On connaît l 'implication de l'acétylcholine dans la régulation de l'humeur chez l'homme,<br />
et dans l’apprentissage. Dès 1998, Lai évoquait également des risques d'atteinte des<br />
fonctions de mémorisation. Dans le cadre des phénomènes cognitifs de la mémoire, le rôle<br />
de l'acétylcholine a été confirmé. Et il est donc pertinent de se demander si les<br />
modifications des taux d'Ach retr<strong>ou</strong>vés dans les expériences d’OEM peuvent avoir des<br />
répercussions sur la santé des personnes exposées aux téléphones <strong>portable</strong>s <strong>ou</strong> s'ils font<br />
partie du bruit physiologique.<br />
Différents travaux [61 à 66] ont montré que le taux d'Ach est en relation avec les phases<br />
du sommeil et que des variations très faibles du taux local d'Ach ont des répercussions:<br />
l'Ach est 30% supérieure durant les phases de sommeil paradoxal, par rapport aux autres<br />
phases <strong>ou</strong> l'éveil [66]. D'autre part une injection de glutamate augmente l'Ach locale ce<br />
qui a p<strong>ou</strong>r conséquence un racc<strong>ou</strong>rcissement de la latence avant le sommeil paradoxal,<br />
une augmentation du nombre de ce type de phase par heure de 10% ainsi qu'une<br />
augmentation du taux local d'Ach avec une relation dose-réponse.<br />
Les travaux de Lai et de Testylier s<strong>ou</strong>lignent que les OEM modulées de faible intensité<br />
peuvent entraîner des modifications encore plus importantes et donc bien supérieures au<br />
bruit physiologique. Les perturbations des neurotransmetteurs, dont l'acétylcholine, sont<br />
également suspectées d'être des facteurs importants de la genèse de certaines maladies<br />
neurodégénératives et des tr<strong>ou</strong>bles de la cognition tels des dyslexies, l'hyperactivité,<br />
l'autisme, la schizophrénie. Il est impossible d'affirmer auj<strong>ou</strong>rd'hui que la seule atteint de<br />
l'Ach par des OEM modulées puissent entraîner une tumeur, bien que cela soit<br />
envisageable: l'acétylcholine influençant les processus de prolifération et de<br />
différenciation neuronale au c<strong>ou</strong>rs du développement.<br />
25
De plus, ce type de perturbation des voies de communication nerveuse p<strong>ou</strong>rrait être à<br />
l’origine de plusieurs dérèglement, notamment la sécrétion de mélatonine par la glande<br />
pinéale. Or on connaît le rôle protecteur de cette molécule entre autre dans les cancers du<br />
sein. Beauc<strong>ou</strong>p d’études ont déjà fait le lien entre l’exposition aux champs<br />
électromagnétiques d’extrêmement basse fréquence (ELF) , la diminution de la<br />
mélatonine et l’apparition de tumeurs [99].<br />
Ce sujet est si controversé que des centaines d'études y ont été consacrées, ces dix<br />
dernières années. Cela ne facilite pas la tâche p<strong>ou</strong>r tr<strong>ou</strong>ver une vraie étude de référence,<br />
dans cet océan d'information qui dit t<strong>ou</strong>t et son contraire. Ceci dit, un rapport appelé<br />
rapport Bioinitiative est sorti il y a un peu plus d’un an. Ce rapport regr<strong>ou</strong>pe certaines<br />
études effectuées par une dizaine de chercheurs internationaux, des spécialistes dans leur<br />
domaine. Donc même si ces travaux n'ont pas encore été validés, n<strong>ou</strong>s avons pensé qu'il<br />
était intéressant de v<strong>ou</strong>s présenter les différents effets communs, mis en avant par ces<br />
études.<br />
26
D. Effets génotoxiques<br />
Le Dr Henry Lai a montré des cassures de chromosomes et des dommages sur l’ADN.<br />
Même si ces études sont remises en cause par certains, il l’a p<strong>ou</strong>rtant retr<strong>ou</strong>vé dans<br />
plusieurs de ses études. Certaines sont axées sur la masse relativement constante du<br />
cerveau qui est exposée à des rayonnements d'une intensité relativement haute (DAS entre<br />
4 et 8 W/kg ). La plupart ont montré des dégâts sur l'ADN à des DAS inférieures à 5<br />
w/kg.<br />
Sachant que des mutations génétiques dans une seule cellule suffisent à provoquer un<br />
cancer et qu'il y a des millions de cellules dans un gramme de tissu, il est inconcevable<br />
que la base de calcul du DAS soit « dix grammes » de tissus (unité de référence en<br />
vigueur en Europe). Des différents facteurs communs comme la fréquence, la durée<br />
d'exposition et le nombre de périodes d'exposition peuvent affecter la réponse de<br />
l'organisme. De plus ils interagissent les uns avec les autres et produire de nombreuses<br />
conséquences. P<strong>ou</strong>r bien les cerner, il faut comprendre si les effets sont cumulatifs, si<br />
l'organisme développe des réponses compensatrices, et à quel moment l'homéostasie se<br />
brise.<br />
Même si les OEM émises par le <strong>portable</strong> sont à priori non-ionisantes d’après la théorie<br />
quantique, il ne faut pas <strong>ou</strong>blier les diverses interactions des OEM avec l’organisme sont<br />
capables de générer de « faux messages » p<strong>ou</strong>rquoi pas ab<strong>ou</strong>tissant à l’autodestruction de<br />
l’ADN cellulaire s<strong>ou</strong>s l’effet des OEM activant des chaines protéiques comme les HSP.<br />
27
E. Le stress cellulaire<br />
Les seuils déclencheurs de stress dans les systèmes biologiques se situent p<strong>ou</strong>r les ELF à<br />
des niveaux ambiants de l'ordre de 0,5 à 1 µT.<br />
Les mécanismes moléculaires à très basse énergie sont des vecteurs plausibles de<br />
maladies (les effets du taux de transfert d'électrons liés au dommage oxydatif, l'activité de<br />
l'ADN lié à une mutation <strong>ou</strong> une biosynthèse aberrantes). Les cellules réagissent à une<br />
OEM comme potentiellement nocive malgré le fait que les électrons ne soit pas arrachés.<br />
De nombreuses pistes de recherche mettent désormais <strong>ou</strong>vertes prenant en compte les<br />
transferts d'électrons dans l'ADN comme un mécanisme plausible d'action résultant des<br />
ELF et des OEM de puissance non thermique.<br />
La même réponse biologique (production de protéines de stress) en présence d'OEM peut<br />
être obtenue avec différentes portions du spectre EM. Les interactions directes des ELF et<br />
des micro-ondes avec l'ADN sont connues. T<strong>ou</strong>s deux activent la synthèse des protéines<br />
de stress.<br />
28
F. Effets sur le système immunitaire<br />
Les études sur l'exposition à différentes sortes d'équipement moderne et s<strong>ou</strong>rces de ELF<br />
ont montré une réaction exacerbée du système immunitaire avec : des altérations des<br />
cellules immunitaires; un grossissement et une dégranulation des mastocytes chez les<br />
individus électrosensibles ; la présence des marqueurs biologiques de l'inflammation<br />
réagissant à des expositions CEM à des niveaux de puissance non thermique; des<br />
modifications de la viabilité des lymphocytes; un nombre réduits de cellules NK et un<br />
nombre réduit de lymphocytes T.<br />
Des individus déclarent s<strong>ou</strong>ffrir d'hypersensibilité électrique aux États Unis, en Suède, au<br />
Danemark , en Allemagne, en Suisse et dans de nombreux autres pays à travers le monde.<br />
Les estimations donnent entre 3 à 10% de la population t<strong>ou</strong>chée. Le développement de ce<br />
tr<strong>ou</strong>ble sanitaire, croissant, est synonyme de pertes de productivité et de j<strong>ou</strong>rnées de<br />
travail. Il est possible que des situations de « provocation chronique » due à l'exposition à<br />
des CEM puisse entraîner des dysfonctionnement du système immunitaire, des réponses<br />
allergiques chroniques, des réponses inflammatoires et une santé déficiente si ces<br />
situations surviennent continuellement. C'est un sujet important p<strong>ou</strong>r les recherches<br />
futures.<br />
Même si un état allergique est considéré comme étant protecteur contre le cancer, la suractivation<br />
du système immunitaire qu’il entraîne, peut ab<strong>ou</strong>tir chez un sujet fragile à une<br />
décompensation. C'est-à-dire que les défenses immunitaires débordées rendent les armes<br />
et le sujet est alors en état de dépression immunitaire plus <strong>ou</strong> moins prononcée. La<br />
promotion et la croissance tumorale n’est alors plus gênée par les défenses de<br />
l’organisme.<br />
D’après les données scientifiques actuelles, l’ensemble des mécanismes p<strong>ou</strong>vant ab<strong>ou</strong>tir à<br />
la formation de tumeur commencent t<strong>ou</strong>t juste à être mis en évidence. Mais cela démontre<br />
déjà que plusieurs explications sont possibles p<strong>ou</strong>r établir une association entre le cancer<br />
et l’exposition aux OEM du <strong>portable</strong>. Plus précisément, ce sont les ELF émises par la<br />
technologie propre au <strong>portable</strong> qui sont mises en cause car leur fréquence se rapproche de<br />
nos rythmes biologiques. Voyons maintenant ce que t<strong>ou</strong>s ces effets pathologiques peuvent<br />
provoquer au sein d’une population.<br />
29
III. Epidémiologie et études d’observation<br />
Après avoir vu les mécanismes qui p<strong>ou</strong>rrait l’expliquer, n<strong>ou</strong>s allons chercher s’il existe un<br />
lien statistique reliant l’exposition aux OEM d’un <strong>portable</strong> et l’apparition de tumeurs.<br />
A. Principe des études d’observation<br />
En termes épidémiologiques, le t<strong>ou</strong>t est de savoir si les ondes émises par les <strong>portable</strong>s<br />
sont des déterminants de tumeurs. P<strong>ou</strong>r répondre à cette question, il y a trois principaux<br />
types d’études d’observation réalisables.<br />
1. L’étude de cohorte<br />
Elle doit être réalisée au minimum sur deux gr<strong>ou</strong>pes d’individus, l’un exposé aux OEM<br />
du <strong>portable</strong> et l’autre non. On suit t<strong>ou</strong>tes ces personnes pendant quelques années, puis on<br />
compare le nombre de n<strong>ou</strong>veaux cas (incidence) de tumeurs entre les deux gr<strong>ou</strong>pes. Si<br />
l’incidence des tumeurs est plus important dans le gr<strong>ou</strong>pe exposé, on p<strong>ou</strong>rra conclure à un<br />
lien entre les OEM et cette pathologie, t<strong>ou</strong>t en p<strong>ou</strong>vant le mesurer.<br />
Cette mesure d’association est réalisée grâce au Risque Relatif (RR). Si RR = 1, il n’y a<br />
aucune corrélation possible entre les deux variable. Si RR < 1, les ondes constituent plutôt<br />
un facteur protecteur des cancers. Si RR > 1, on est d’avantage en présence d’un facteur<br />
de risque. Les sujets exposés ont alors un risque d’être malade RR fois plus élevé que les<br />
non-exposés.<br />
Ces études sont idéales p<strong>ou</strong>r obtenir des résultats fiables avec un mesure directe du RR.<br />
Le problème est qu’elles sont très difficiles à mettre en œuvre, prennent du temps et<br />
demandent un investissement financier important.<br />
2. L’étude cas-témoins<br />
A contrario, cette étude est assez simple à réaliser et n’exige pas beauc<strong>ou</strong>p de moyens.<br />
Elle doit comporter deux gr<strong>ou</strong>pes. L'un est constitué de sujets atteint de tumeur et on les<br />
appelle les "cas". L'autre ne doit contenir aucun sujet atteint de tumeur. Ces gr<strong>ou</strong>pes<br />
seront alors comparés en fonction de leur exposition antérieure. Si par exemple le gr<strong>ou</strong>pe<br />
des patients atteints de tumeurs a été exposé par le passé à significativement plus de<br />
rayonnement que l'autre gr<strong>ou</strong>pe, on p<strong>ou</strong>rra dire qu'il y a un lien entre ces deux<br />
évènements.<br />
Là aussi, une mesure de la corrélation p<strong>ou</strong>rra être effectuée mais cette fois-ci grâce au<br />
Rapport de Cotes RC (Odds Ratio OR en anglais). En ce qui concerne l’étude des cancers,<br />
la prévalence étant assez faible, les spécialistes admettent que le RC est une bonne<br />
approximation du RR. Mais cela reste moins précis qu’une étude de cohorte.<br />
30
3. L’étude écologique<br />
Plus rarement utilisée, elle étudie la corrélation entre la variation d'indicateurs collectifs<br />
d'exposition au rayonnement et de santé. Par exemple, dans une population, si le nombre<br />
de cancer cérébraux augmente à la même proportion que le nombre d’heures totales<br />
passées au téléphone par les abonnés, on p<strong>ou</strong>rra établir un rapprochement sans p<strong>ou</strong>voir le<br />
quantifier. De plus, on ne prend pas en compte le fait que d’autres facteurs puissent entrer<br />
en jeu. C’est donc un type d’étude ayant un p<strong>ou</strong>voir de démonstration très faible, par<br />
conséquent n<strong>ou</strong>s ne mentionnerons pas celles qui ont été réalisées sur le sujet.<br />
4. Intervalle de confiance<br />
Les RR et RC donnent un premier chiffre, simplement indicatif d’une tendance. Mais<br />
cette donnée seule n’est pas nécessairement significative. En effet, le hasard dans la<br />
sélection des personnes sondées est capable d’influencer le résultat. Ainsi, en reproduisant<br />
strictement les mêmes études sur des personnes différentes, on peut constater une légère<br />
fluctuation du risque, due au hasard.<br />
Afin d’éliminer ce d<strong>ou</strong>te, les épidémiologistes établissent un intervalle de confiance, IC<br />
en anglais, dans lequel le RC, <strong>ou</strong> le RR, a une très grande probabilité de se tr<strong>ou</strong>ver (95%<br />
est la valeur généralement utilisée). Plus le nombre d’individus présents dans l’étude est<br />
grand, plus l’intervalle est réduit, donnant une valeur de risque d’autant plus précise. On<br />
parle alors de la puissance d’une étude.<br />
5. Les biais<br />
En épidémiologie, un biais est un élément présent dans une étude p<strong>ou</strong>vant engendrer des<br />
erreurs dans les résultats. Ceux qui peuvent concerner les études dans le domaine de la<br />
téléphonie mobile sont de plusieurs types :<br />
Biais de sélection : La qualité de la sélection des individus est primordiale. Par<br />
exemple dans une étude de cohorte, il faut que le gr<strong>ou</strong>pe des personnes exposées<br />
et non-exposées aient les mêmes chances de développer un cancer dès le départ de<br />
l’enquête. P<strong>ou</strong>r cela il faut donc qu’ils aient les mêmes caractéristiques (âge, lieu<br />
de vie, profil socio-économique…)<br />
Biais d’information : Il concerne des erreurs commises dans le recueil des<br />
données. Il peut y avoir le biais de subjectivité quand l’enquêteur cherche avec<br />
plus d’acuité une exposition passée, chez une personne qu’il sait être malade.<br />
Enfin un biais de mémorisation peut survenir car les sujets atteint d’une pathologie<br />
ont tendance à davantage se s<strong>ou</strong>venir de leurs expositions passées que les sujets en<br />
bonne santé.<br />
31
B. Résultats et critique des études<br />
Dans cette partie, n<strong>ou</strong>s n<strong>ou</strong>s appuierons uniquement sur des études sérieuses publiées<br />
dans des revues scientifiques à comité de lecture et consultables dans la célèbre base de<br />
données Pubmed. Etant donné que l’exposition aux OEM émises par le <strong>portable</strong> concerne<br />
surt<strong>ou</strong>t la zone de la tête, n<strong>ou</strong>s n<strong>ou</strong>s concentrerons uniquement sur les études s’intéressant<br />
à l’apparition de tumeurs dans cette région anatomique.<br />
1. L’incertitude des débuts<br />
• La première étude épidémiologique de Hardell sur le sujet date de 1999 [66] et a<br />
été réalisé s<strong>ou</strong>s la forme cas-témoins. T<strong>ou</strong>s les types de tumeurs du cerveau sont<br />
pris en compte sur un total de 209 « cas ». Elle lance le début d’un âpre débat.<br />
Cette étude met en évidence seulement une augmentation non-significative du<br />
risque de développer une tumeur cérébrale ipsilatérale au coté contre lequel on a<br />
l’habitude de placer son téléphone <strong>portable</strong>. Coté droit : OR = 2.45 ; IC = 0.78-<br />
7.76. Coté gauche : OR = 2.40 ; IC = 0.52-10.9. Ce risque est non-significatif car<br />
de chaque coté, l’intervalle de confiance contient la valeur OR=1. L’auteur admet<br />
que son étude n’est pas assez puissante p<strong>ou</strong>r p<strong>ou</strong>voir tirer des conclusions hâtives,<br />
d’autant que le recul temporel n’est pas assez grand. Il suggère donc de p<strong>ou</strong>rsuivre<br />
les études.<br />
• Une autre étude de cas-témoins de Muscat, publiée en 2000 [67], comporte 469<br />
« cas » et étudie aussi les cancers cérébraux. Nécessairement, la durée<br />
d’exposition est très limitée car les sujets interrogés ont eu un diagnostic de leur<br />
cancer entre 1994 et 1998, très peu de temps après l’apparition du mobile. Cette<br />
étude n’apporte donc de résultats que sur une faible exposition aux OEM du<br />
<strong>portable</strong> (environ 3 ans p<strong>ou</strong>r la plupart des sujets). Cette étude ne montre aucun<br />
résultat significatif sauf en ce qui concerne les neuroépithéliomes (OR, 2.1 ; IC =<br />
0.9-4.7).<br />
La première étude de cohorte rétrospective est réalisée au Danemark en 2001 par<br />
Johansen [69] p<strong>ou</strong>r une période de 1982 à 1995. Elle prend en compte quelques 400<br />
000 usagers de téléphones mobiles dont les temps de commmunication ont été f<strong>ou</strong>rnis<br />
par un opérateur. Ces données rec<strong>ou</strong>pées avec les informations concernant divers<br />
types de cancers dans cet échantillon de personnes. Aucun lien n’est retr<strong>ou</strong>vé, ce qui a<br />
permis à t<strong>ou</strong>s les j<strong>ou</strong>rnaux de faire leur une sur l’affirmation de l’innocuité des<br />
mobiles p<strong>ou</strong>r la santé. Même si le nombre de personnes étudiées est impressionnant et<br />
la période longue, le suivi des usagers est trompeur. En effet, 70% des sujets de cette<br />
études sont abonnés depuis en moyenne 18 mois seulement ce qui est trop c<strong>ou</strong>rt p<strong>ou</strong>r<br />
réaliser une étude sérieuse dans le domaine du cancer. De plus, 200 000 usagers<br />
professionnels du même opérateur, qui représentent la majorité des temps de<br />
communication, n’ont pas été pris en compte p<strong>ou</strong>r des raisons techniques. Cela<br />
constitue un biais de sélection majeur.<br />
Presque même temps, Inskip [71] et Muscat [67] [75], dans des études de cas-témoins<br />
ne tr<strong>ou</strong>vent pas de risques significatifs de développer une tumeur en cas d’exposition<br />
aux OEM de <strong>portable</strong>s analogiques entre 1994 et 1999. Rappelons le faible recul<br />
32
temporel et la faible exposition des sujets, cette dernière étant considérée forte p<strong>ou</strong>r<br />
des temps de communication cumulés d’à peine quelques centaines d’heures.<br />
T<strong>ou</strong>j<strong>ou</strong>rs concernant les <strong>portable</strong>s analogiques, Auvinen établit un lien significatif<br />
avec les gliomes [74] mais pas avec d’autres types de tumeurs. Comme Johansen dans<br />
son étude de cohorte, Auvinen s’est procuré le détail des communications des usagers<br />
auprès des opérateurs. Cela supprime le biais de mémorisation contrairement à t<strong>ou</strong>tes<br />
les études précédentes. Seulement, cette méthode n’est pas forcément fiable car le<br />
s<strong>ou</strong>scripteur de l’abonnement n’est pas t<strong>ou</strong>j<strong>ou</strong>rs celui qui est s<strong>ou</strong>mis à l’exposition s’il<br />
prête son <strong>portable</strong> à quelqu’un. Il peut donc théoriquement avoir un biais de sélection<br />
concernant l’exposition.<br />
Hardell réalise une étude de cas-témoins sur des patients dont on a diagnostiqué des<br />
tumeurs cérébrales entre 1997 et 2000 [76]. Il retr<strong>ou</strong>ve un lien significatif entre<br />
l’exposition aux téléphones analogiques et l’apparition de tumeurs notamment du<br />
neurinome de l’ac<strong>ou</strong>stique (OR = 3.5 ; IC = 1.8-6.8). P<strong>ou</strong>r la première fois, on met<br />
aussi en évidence une présence accrue de tumeurs à l’exposition ipsilatérale et une<br />
relation dose-effet. Rien n’est démontré en ce qui concerne l’utilisation des téléphones<br />
digitaux car leur apparition étant encore récente.<br />
T<strong>ou</strong>tes ces études sont non-seulement contradictoires mais on leur reproche aussi de<br />
contenir des biais méthodologiques, sans d<strong>ou</strong>te impossibles à évaluer. De ce fait il n’est<br />
possible de rien conclure.<br />
2. Les études récentes<br />
Des études épidémiologiques récemment publiées comme les travaux d’Hardell [89]<br />
[92] recueillent les mêmes données cas-témoins, donc comprenant les mêmes biais.<br />
Mais elles portent sur des patients dont ont a diagnostiqué des tumeurs cérébrales à<br />
différentes périodes. Or ces études montrent que l’association est plus forte entre<br />
l’exposition et le cancer sur les patients dont on a déc<strong>ou</strong>vert le cancer plus tard. Cela<br />
montre donc clairement une relation dose-effet à priori sans biais. T<strong>ou</strong>tefois il est<br />
impossible de chiffrer ces données sans prendre en compte les biais de ses études.<br />
Parallèlement, à cela les premiers résultats d’une grande étude épidémiologique mondiale<br />
baptisée INTERPHONE commencent à être publiés. Cette étude demandée par les<br />
organismes officiels comme l’Organisation Mondiale de la Santé et d’autres à p<strong>ou</strong>r but de<br />
définitivement faire le point sur la <strong>danger</strong>osité <strong>ou</strong> non des OEM de la téléphonie mobile.<br />
Les conclusions officielles de ce rapport sont rassurantes mais des voix s’élèvent p<strong>ou</strong>r que<br />
l’on prennent en compte certaines études inquiétantes.<br />
33
C. Discussion<br />
Malgré les études épidémiologiques prises en compte [67 à 98], il est p<strong>ou</strong>r le moment<br />
difficile de faire la part des choses p<strong>ou</strong>r plusieurs raisons. Premièrement la technologie du<br />
téléphone <strong>portable</strong> changeant constamment, il est devenu extrêmement difficile voire<br />
impossible de réaliser une étude épidémiologique sans biais. En effet, il faudrait dans un<br />
grand gr<strong>ou</strong>pe de personnes, prendre en compte le temps de communication, mais aussi la<br />
puissance d’émission selon la qualité du réseau, la durée des appels (car le <strong>portable</strong> émet<br />
plus en début de communication), le DAS du <strong>portable</strong>, la répartition de l’émission de<br />
l’OEM émise par l’antenne (en général du coté batterie et moins du coté clavier), le type<br />
d’émission (GSM, UMTS…). T<strong>ou</strong>t cela est bien sur impossible à réaliser dans le cadre<br />
d’une étude rétrospective sans créer un biais de sélection.<br />
Deuxièmement, comparativement au développement exponentiel des technologies du<br />
<strong>portable</strong>, les études épidémiologiques n’ont jamais assez de recul p<strong>ou</strong>r signaler un <strong>danger</strong><br />
d’actualité.<br />
De plus, la politique de réduction des DAS rend difficile l’association du cancer avec<br />
l’exposition aux ondes de la téléphonie mobile, même si cela va dans le sens du principe<br />
de précaution.<br />
L’épidémiologie ne permet à l’heure actuelle de tirer aucune conclusion. Les études ne<br />
montrant pas de lien cancer / OEM ne p<strong>ou</strong>rront jamais avoir la puissance de pr<strong>ou</strong>ver<br />
l’absence de lien. En effet, elles reposent sur un risque de deuxième espèce de se tromper<br />
appelé risque bêta, mais ce dernier est théoriquement impossible à calculer. La seule<br />
preuve qu’il puisse exister un j<strong>ou</strong>r si c’est le cas, c’est de montrer un lien avec un risque<br />
de première espèce alpha de se tromper (en général alpha = 5% c’est p<strong>ou</strong>rquoi IC<br />
représente 95%). Mais devant la multiplicité des biais difficilement cont<strong>ou</strong>rnables, on<br />
peut d<strong>ou</strong>ter que le lien s’établisse formellement d’ici peu.<br />
34
Conclusion<br />
Comme n<strong>ou</strong>s venons de le voir, à l'heure actuelle, le monde scientifique demeure<br />
relativement partagé quant aux seuils de <strong>danger</strong>osité des OEM émises par le téléphone<br />
mobile. Malgré des années de recherche en bio-électromagnétisme, en études<br />
épidémiologiques et avec une somme colossale de travaux publiés, le débat fait t<strong>ou</strong>j<strong>ou</strong>rs<br />
rage. Cela peut s'expliquer du fait du très grand nombre des paramètres à prendre en<br />
compte simultanément lors de chaque expérience. De plus, les épidémiologistes estiment<br />
qu'il faut environ une vingtaine d'année de recul à partir de l'émergence du téléphone<br />
<strong>portable</strong> p<strong>ou</strong>r commencer à avoir des résultats probants sur les cancers et autres maladies<br />
au long c<strong>ou</strong>rt. Il faudra donc attendre encore quelques années avant d'avoir des certitudes.<br />
Néanmoins, après t<strong>ou</strong>s les documents que n<strong>ou</strong>s avons étudié sur le sujet, n<strong>ou</strong>s pensons<br />
qu'un risque réel existe. En effet, la grande majorité des études expérimentales prenant en<br />
compte le phénomène des ELF émises par le téléphone <strong>portable</strong> vont dans le sens de la<br />
formation de tumeurs. Cela fait plusieurs années que ces études sont sorties et p<strong>ou</strong>rtant les<br />
réactions des autorités se font t<strong>ou</strong>j<strong>ou</strong>rs attendre p<strong>ou</strong>r protéger la population.<br />
Il n<strong>ou</strong>s paraît évident que devant une telle situation, le principe de précaution s’impose.<br />
En effet, n<strong>ou</strong>s sommes bien plus que dans une « situation d’incertitude scientifique »<br />
comme le précise notre Constitution. Face à ses données, reconnaissant t<strong>ou</strong>t de même le<br />
problème, le ministère de la Santé recommande auj<strong>ou</strong>rd’hui l’approche de précaution,<br />
j<strong>ou</strong>ant ainsi sur les mots afin de rassurer la population. Mais parallèlement, cela fait<br />
passer l’idée que les données indiquent un risque de plus en plus accru.<br />
Mais peu à peu, n<strong>ou</strong>s constatons que part<strong>ou</strong>t, les autorités commencent à préparer<br />
psychologiquement la population à l’annonce prochaine d’un <strong>danger</strong>. On n<strong>ou</strong>s parle donc<br />
d’approche de précaution en France. Au niveau mondial, le CIRC (Centre International de<br />
Recherche sur le Cancer), chargé de classer t<strong>ou</strong>s les agents en fontion de leur propension<br />
à développer des tumeurs fait marche arrière en juin 2001. Les ELF, avant cette date<br />
classées comme agent non-cancérogène p<strong>ou</strong>r l’homme sans d<strong>ou</strong>te p<strong>ou</strong>r des raisons liées à<br />
l’économie, reviennent dans la catégorie dans la catégorie 2B au sein de la classification<br />
« preuves de cancérogénicité », établie par l’OMS, c’est-à-dire dans la catégorie « l’agent<br />
est peut-être cancérogène p<strong>ou</strong>r l’homme ». Part<strong>ou</strong>t dans le monde, des médecins et des<br />
chercheurs commencent à se faire entendre en signant des pétitions réclamant la<br />
diminution des seuils fixés par la loi. Car là résiderait l’application du véritable principe<br />
de précaution, et non simplement son approche. Des experts parlent de seuils notamment<br />
à 0.6 V/m. En attendant, même si beauc<strong>ou</strong>p de français ont conscience qu’un problème de<br />
santé publique est lié aux ondes du <strong>portable</strong>s, ils n’appliquent même pas l’approche de<br />
précaution recommandée par le ministère, et cela car cette posture leur semble sûrement<br />
contradictoire (sondage en annexe).<br />
En conclusion, n<strong>ou</strong>s retiendront que t<strong>ou</strong>tes les ondes électromagnétiques ne sont pas<br />
<strong>danger</strong>euses. Les radiofréquences des ondes porteuses de la téléphonie mobile ne<br />
constituent pas le problème, mais c’est bien les extrêmement basses fréquences émises du<br />
fait de la technologie mobile. N<strong>ou</strong>s p<strong>ou</strong>vons donc être rassuré sur les effets des<br />
radiofréquences employées en Imagerie par Résonance Magnétique, qui sont seulement<br />
thermiques.<br />
35
Ouvrages :<br />
Bibliographie<br />
FORGET, R. Le dossier noir du <strong>portable</strong>. Editions Pharos/Jacques-Marie Laffont Editeur,<br />
2006. 293p<br />
HUGO, V. Les contemplations. Paris : Lgf/Le Livre De Poche, 2002. 522p.<br />
LENTIN, J.P. Ces ondes qui tuent, ces ondes qui soignent. Paris : Albin Michel, 2001,<br />
340 p.<br />
SANTINI, R. et al. Votre GSM, votre santé : On v<strong>ou</strong>s ment ! 3 è édition. Liège : Editions<br />
Marco Pietteur, collection Résurgence, 2006, 208p.<br />
Publications scientifiques :<br />
[1] LARSEN, C.J., Quand des protéines de stress <strong>ou</strong> protéines HSP participent à la<br />
prolifération tumorale. Bulletin du Cancer, 2005, volume 92, n°5.<br />
[2] WILLIAMS, W.M. et al. Effect of 2450Mhz Microwave Energy on the Blood-Brain<br />
Barrier to Hydrophilic molécules. Brain Res, 1984, 319 : p. 165-212.<br />
[3] NEUBAUER, C. et al. Microwave Irradiation of Rats at 2.45Ghz Activates<br />
Pinocytotic-Like Uptake of Tracer by Capillary Endothelial Cells of the Cerebral Cortex.<br />
Bioelectromagnetics. 1990, 11 : p. 261-268.<br />
[4] SALFORD, L.G. et al. Perméabilité of the Blood-Brain Barrier Induced by 915Mhz<br />
Electromagnetic Radiation, contin<strong>ou</strong>s wave and modulated at 8, 16, 50 and 200Hz.<br />
Microsc Res Tech, 1994, 27 : p. 535-542.<br />
[5] FRITZE, K. et al. Effect of global system for mobile communication (GSM)<br />
microwave exposure on blood-brain barrier Permeability in rat. Acta Neuropathol.<br />
(Berl.) 1997, 94 : p. 465-470.<br />
[6] PERSSON, B.R. et al. Blood-brain barrier perméabilité in rats exposed to<br />
electromagnetic fields used in Wireless communication, Wireless Networks, 1997, p. 455-<br />
461.<br />
[7] SCHIRMACHER, A. et al. Electromagnetic Field (1.8Ghz) Increase the Permeability<br />
to Sucrose of the Blood Barrier. Bioelectromagnetics, 2000, 21 : p. 338-345.<br />
[8] PERSSON, B.R. et al. Histopathological Effects of short and long term microware<br />
exposure on the rat brain. BEMS Meeting. 2001. St Paul, Minnesota, USA. Abstract<br />
book. Page 14.<br />
[9] ALBERT, E.N et al. Reversible Microwave Effects on the Blood-Brain Barrier. Brain<br />
Res. 1981, 230 : 153-164.<br />
36
[10] OHMOTO, Y. et al. Sequential Changes in Cerebral Blood Flow, Early<br />
Neoropathological Consequences and Blood-Brain Barrier Disruption Following<br />
Radiofrequency-Induced Localized Hyperthemia in the Rat. Int J<strong>ou</strong>rnal Hyperthemia,<br />
1996, 12 : p. 321-334.<br />
[11] LANGE, D.G. Japonese Encephalitis Virus (JEV): Potentiation of Lethality in Mice<br />
by Microwave Radiation. Bioelectromagnetics. 1991, 12 : p. 335-348.<br />
[12] GOLDMAN, H. et al. Cerebrovascular Permeability to 86Rb in the rat After<br />
Exposure to Pulsed Microwaves. Bioelectromagnetics, 1984, 5 : p. 323-330.<br />
[13] MORIYAMA, E. Blood-Brain Barrier Alteration After Microwave-Induced<br />
Hyperthemia is Purely a Thermal Effect. Surg Neurol. 1991, 35 : p. 177-182.<br />
[14] OSCAR, K.J. et al. Microwace Alteration of tke Blood-Brain Barrier System of Rats.<br />
Exp. Neurol, 1982, 75 : p. 299-307.<br />
[15] BUCHARD, J.F. et al. Effects of electromagnetic fields on the levels of biogenic<br />
amine metabolites, quinolinic acid, and beta-endorphine in the cerebro-spinal fluid of<br />
dairy cows. Neurochem Res, 1998, 23 : p. 1527-1531.<br />
[16] HASSEL et al. "Neurotoxicity of Albumin in-vivo". Neuroscience Letters. 1994,<br />
167 : p. 29-32.<br />
[17] FINNIE, J.W. et al. Effects of long-terme mobile communication microwave<br />
exposure on vascular permeability in m<strong>ou</strong>se brain. Pathology, 2002, 34 : p. 344-7.<br />
[18] SALFORD, L.G. et al. Nerve Cell Damage in Mammalian Brain after Exposure to<br />
Microwaves from GSM Mobile Phones. Environ Health Perspect, 2003, 111 : p. 881-3.<br />
[19] TSURITA, G. et al. Biological and morphological effects on the brain after exposure<br />
of rats to a 1439Mhz TDMA field. Bioelectromagnetics, 2000, 21 : p. 364-371.<br />
[20] GRUENAU, S.P. Ansence of Microwaves Effects ON Blood-Brain Barrier<br />
Permeability to Sucrose in the Consci<strong>ou</strong>s Rat. Experimental Neurology, 1982, 75 : p. 299-<br />
307.<br />
[21] PRESTON, E. et al. Permeability of the Blood-Brain Barrier to Mannitol in the Rat<br />
Following 2450 Mhz Microwave Irradiation. Brain Res. 1979, 174 : 109-117.<br />
[22] GARBER, H. J. et al. MRI gradient fields increase brain mannitol space. Magn<br />
Reson Imaging, 1989, 7 : p. 605-610.<br />
[23] BINHI, V. N. et al. Molecular gyroscopes and biologicals effects of weak extremely<br />
low-frequency magnetic fields. Phys Rev E, 2002, 65 : 10 p.<br />
[24] DI CARLO, A. et al. Chronic electromagnetic field exposure decreases HSP70 levels<br />
and lowers cytoprotection. J Cell Biochem, 2002, 84 : p. 447-454.<br />
37
[25] OFTEDAL, G. et al. Symptoms experienced in connection with mobile phone use.<br />
Occup Med (Lond.) 2000, 50 : p. 237-245.<br />
[26] HOCKING, B. Perliminary Report: Symptoms Associed With Mobile Phone Use.<br />
Occup Med (Lond.) 1998, 48 : p. 357-360.<br />
[27] BORTKIEWICZ, A. A. Study on the biological effects of exposure to mobile phone<br />
frequency EMF. Med Pr, 2001, 52 : p. 101-6.<br />
[28] BUBANOVIC, I. V. Faillure of blood-thymus barrier as a mechanism of tumor and<br />
trophoblast escape. Medical Hypotheses, 2003, 60 : p. 315-320.<br />
[29] LESCYNSKI, D. et al. Non-thermal activation of the hsp27/p38MAPK stress<br />
pathway by mobile phone radiation in human endithelial cells: Molecular mechanism for<br />
cancer and blood-brain barrier-related effects. Differenciation, 2002, 70 : p. 120-9.<br />
[30] MERRIT, J. H. et al. Orientation effects on microwave inducted hyperthemia and<br />
neurochemical correlates. J. microwave Power, 1977,<br />
[31] LAI, H. et al. Naltrexone pretreatment blocks microwaces-induced changes in<br />
central cholinergic receptors. Bioelectromagnetics, 1992,<br />
[32] LAI, H. et al. Single vs repeated microwave exposure effects on benzodiazepine<br />
receptors in the brain of the rat. Bioelectromagnetics, 1992.<br />
[33] CALVO, A. C. et al. Synaptic neurone activity under applied 50hz alternating<br />
magnetic fields. Comp Biochem Physiol, 1999.<br />
[34] SHCHEGLOV, V. S. et al. Cell-to-cell communication in reponse of E. coli cells at<br />
different phases of growth to low-intensity microwaves. Biochim Biophys Acta, 2002.<br />
[35] DUTTA, S. K. et al. Radiofrequency radiation-induced calcium ion efflux<br />
enhancement from human and other neuroblastoma cells in culture. Bioelectromagnetics,<br />
1989.<br />
[36] DUTTA, S. K. et al. Dose dependance of acetylcholinesterase activity in<br />
neuroblastoma cells exposed to modulate radio-frequency electromagnetic radiation.<br />
Bioelectromagnetics, 1992.<br />
[37] LAI, H. Accute exposure to noise affects sodium-dependent high-affinity choline<br />
uptake in the central nerv<strong>ou</strong>s system of the rats. Pharmacol Biochem Behav, 1987.<br />
[38] LAI, H. Effects of repeated exposure to white noise on central cholinergic activity in<br />
the rat. Brain Research, 1988.<br />
[39] LAI, H. Research on the neurological effects of nonionzing radiation at the<br />
university of Washington. Bioelectromagnetics, 1992.<br />
[40] LAI, H. Neurological effects of microwave irradiation. Advances in electromagnetic<br />
field in living system, Vol.1, J.C. Lin (ed.), Plenum Press, New York. 1994, p. 27-80.<br />
38
[41] LAI, H. et al. Acute white noise exposure affects the concentration of benzodiazepine<br />
receptors in the brain of the rat. Pharmacol Biochem Behav, 1990.<br />
[42] LAI, H. et al. Effect of noise on High-affinity choline uptake in the frontal cortex and<br />
hippocampes of the rat are blocked by intracerebroventricular injection of a<br />
corticotropin-releasing factor antagonist. Brain Res, 1990.<br />
[43] LAI, H. et al. Opioid receptor subtypes mediating the noise-induced decreases in<br />
high-affinity choline uptake in the rat brain. Pharmacol Biochem Behav, 1992.<br />
[44] LAI, H. et al. 60 hz magnetic field and central cholinergic activity: effects of<br />
exposure Intensity and duration. Bioelectromagnetics, 1999.<br />
[45] LAI, H. et al. Psychoactive drug response is affected by acute low-level microwave<br />
irradiation. Bioelectromagnetics, 1983.<br />
[46] LAI, H. et al. Sodium-dependant High-affinity choline uptake in hippocampus and<br />
frontal cortex of the rat affected by acute restraint stress. Brain ressearch, 1986.<br />
[47] LAI, H. et al. A review of microwave irradiation and actions of psychoactive drugs.<br />
IEEE Eng Med Biol, 1987.<br />
[48] LAI, H. et al. Low-level microwave irradiation affects central cholinergic activity in<br />
the rat. J. Neurochem, 1987.<br />
[49] LAI, H. et al. Effects of low-level microwave irradiation of hippocampal and frontal<br />
cortical choline uptake are classically conditionable. Pharmacol. Biochem. Behav. 1987.<br />
[50] LAI, H. et al. Acute low-level microwave exposure and central cholinergic activity:<br />
studies on irradiation parameters. Bioelectromagnetics. 1988.<br />
[51] LAI, H. et al. Low-level microwave irradiation and central cholinergic systems.<br />
Pharmac. Biochem. Behav. 1989.<br />
[52] LAI, H. et al. Acute low-level microwave exposure and central cholinergic activity: a<br />
dose-response study. Bioelectromagnetics. 1989.<br />
[53] LAI, H. et al. Repeated noise exposure affects Muscarinic cholinergic receptors in<br />
the rat brain. Brain Res. 1989.<br />
[54] LAI, H. et al. Corticotropin-releasing factor antagonist blocks microwave-induced<br />
changes in central cholinergic activity in the rat. Brain Res. Bull. 1990.<br />
[55] LAI, H. et al. Opioid receptor subtypes that mediate a microwave-induced decrease<br />
in central cholinergic activity in the rat. Bioelectromagnetics. 1992.<br />
[56] LAI, H. et al. Microwave irradiation affects radial-arm maze performance in the rat.<br />
Bioelectromagnetics. 1994.<br />
39
[57] LAI, H. et al. Intraseptal funaltrexamine injection blocked microwave-induced<br />
decrease in hippocampal cholinergic activity in the rat.. Pharmacol Biochem Behav.<br />
1996.<br />
[58] TESTYLIER, G. et al. Effects of exposure to low level radiofréquence fields on<br />
acetylcholine release in hippocampes of freely moving rats. Bioelectromagnetics. 2002<br />
[59] EGO-STENGEL, V. et al. Acetylcholine-dépendent induction and expression of<br />
functional plasticity in the barrel cortex of the adult rat. J. Neurophysiol. 2001<br />
[60] KODAMA, T. et al. Enhancement of acetylcholine release during REM sleep in the<br />
caudomedial medulla as measured by in vivo microdialysis. Brain Res. 1992<br />
[61] KODAMA, T. et al. Brainstem Actylcholine Release and REM Sleep. Sleep<br />
Wakefulness, Eds Wiley Eastern, New Delhi. 1993, p. 51-56.<br />
[62] KODAMA, T. et al. Enhancement of acetylcholine release during paradoxical sleep<br />
in the dorsal tegmental field of the cat brain stem. Neuroscience Letters. 1990<br />
[63] LYDIC, R. et al. Microdialysis of cat pons reveals enhanced acetylcholine release<br />
during state-dépendent respiratory depression. Am J. Physiol. 1991<br />
[64] KAMETANI, H. et al. Alterations in acetylcholine release in the rat hippocampes<br />
during sleep-wakefulness detected by intracerebral dialysis. Life Sci. 1990<br />
[65] KAMETANI, H. et al. Circadian rythm of cortical acetylcholine release as measured<br />
by in vivo microdialysis in freely moving rate. Neuroscience Letters. 1991<br />
[66] HARDELL, L., et al. Use of cellular telephones and the risk for brain tum<strong>ou</strong>rs : a<br />
case-controle study. International J<strong>ou</strong>rnal of Oncology, 1999, 15(1) : p.113-6.<br />
[67] MUSCAT, J.E., et al. Handeld cellular telephone use and risk of brain cancer.<br />
J<strong>ou</strong>rnal of the American Medical Association, 2000, 284(23) : p. 3001-7.<br />
[68] HARDELL, L., et al. Case-control study on radiology work, medical x-ray<br />
investigations, and use of cellular telephones as risk factors for brain tumors. Medscape<br />
General Medicine, 2000, p. E2.<br />
[69] JOHANSEN, C., et al. Cellular telephones and cancer, a nationwide cohort study in<br />
Denmark. J<strong>ou</strong>rnal of the National Cancer Institute, 2001, 93(3) : p. 203-7.<br />
[70] HARDELL, L., et al. Ionizing radiation, cellular telephones and the risk for brain<br />
tum<strong>ou</strong>rs. European J<strong>ou</strong>rnal of Cancer Prevention, 2001, 10(6) : p. 523-9.<br />
[71] INSKIP, P.D., et al. Cellular-telephone use and brain tumors. New England J<strong>ou</strong>rnal<br />
of Medicine, 2001, 344(2) : p. 79-86.<br />
[72] STANG, A., et al. The possible role of radiofrequency radiation in the development<br />
of uveal melanoma. Epidemiology, 2001, 12(1) : p. 7-12.<br />
40
[73] HARDELL, L., et al. Cellular and cordless telephones and the risk for brain<br />
tum<strong>ou</strong>rs. European J<strong>ou</strong>rnal of Cancer Prevention, 2002, 11(4) : p. 377-386.<br />
[74] AUVINEN, A., et al. Brain tumors and salivary gland cancers among cellular<br />
telephone users. Epidemiology, 2002, 13(3) : p. 356-9.<br />
[75] MUSCAT, J.E., et al. Handheld cellular telephones and risk of ac<strong>ou</strong>stic neuroma.<br />
Neurology, 2002, 58(8) : p. 1304-6.<br />
[76] HARDELL, L., et al. Case-control study on the use of cellular and cordless phones<br />
and the risk of malignant brain tum<strong>ou</strong>rs. International J<strong>ou</strong>rnal of Radiation Biology,<br />
2002, 78(10) : p. 931-6.<br />
[77] HARDELL, L., et al. Further aspects on cellular and cordless telephones and brain<br />
tum<strong>ou</strong>rs. International J<strong>ou</strong>rnal of Oncology, 2003, 22(2) : p. 399-407.<br />
[78] HARDELL, L., et al. Vestibular schwannoma, tinnitus and cellular telephones.<br />
Neuroepidemiology, 2003, 116(1175) : U457.<br />
[79] WARREN, H.G., et al. Cellular telephone use and risk of intratemporal facial nerve<br />
tumor. Laryngoscope, 2003, 113(4) : p. 663-7.<br />
[80] LÖNN, S., et al. Mobile phone use and the risk of ac<strong>ou</strong>stic neuroma. Epidemiology,<br />
2004, 15(6) : p.653-9.<br />
[81] HARDELL, L., et al. No association between the use of cellular or cordless<br />
telephones and salivary gland tum<strong>ou</strong>rs. J<strong>ou</strong>rnal of Occupational and Environmental<br />
Medicine, 2004, 61(8) : p. 675-9.<br />
[82] CHRISTENSEN, H.C., et al. Cellular telephone use and risk of ac<strong>ou</strong>stic neuroma.<br />
American J<strong>ou</strong>rnal of Epidemiology, 2004, 159(3) : p. 277-283.<br />
[83] LÖNN, S., et al. Long-term mobile phone use and brain tumor risk. American<br />
J<strong>ou</strong>rnal of Epidemiology, 2005, 161(6) : p. 526-535.<br />
[84] CHRISTENSEN, H.C., et al. Cellular telephones and risk for brain tumors : a<br />
population-based, incident case-control study. Neurology, 2005, 64(7) : p. 1189-1195.<br />
[85] HARDELL, L., et al. Use of cellular telephones and brain tum<strong>ou</strong>r risk in urban and<br />
rural areas. J<strong>ou</strong>rnal of Occupational and Environmental Medicine, 2005, 62(6) : p. 390-4.<br />
[86] SCHOEMAKER, M.J., et al. Mobile phone use and risk of ac<strong>ou</strong>stic neuroma: results<br />
of the Interphone case-control study in five North European c<strong>ou</strong>ntries. British J<strong>ou</strong>rnal of<br />
Cancer, 2005, 93(7) : p. 842-8.<br />
[87] HARDELL, L., et al. Case-control study on cellular and cordless telephones and the<br />
risk for ac<strong>ou</strong>stic neuroma or meningioma in patients diagnosed 2000-2003.<br />
Neuroepidemiology, 2005, 25(3) : p. 120-8.<br />
41
[88] LÖNN, S., et al. Mobile phone use and risk of parotid gland tumor. American<br />
J<strong>ou</strong>rnal of Epidemiology, 2006, 164(7) : p. 637-43.<br />
[89] HARDELL, L., et al. Pooled analysis of two case-control studies on the use of<br />
cellular and cordless telephones and the risk of benign brain tum<strong>ou</strong>rs diagnosed during<br />
1997-2003. International J<strong>ou</strong>rnal of Oncology, 2006, 28(2) : p. 509-518.<br />
[90] HARDELL, L., et al. Tum<strong>ou</strong>r risk associated with use of cellular telephones or<br />
cordless desktop telephones. Worl J<strong>ou</strong>rnal of Surgical Oncology, 2006, 4 : p. 74.<br />
[91] HEPWORTH, S.J., et al. Mobile phone use and risk of glioma in adults: case-control<br />
study. British Medical J<strong>ou</strong>rnal, 2006, 332(7546) : p.883-7.<br />
[92] HARDELL, L., et al. Case-control study of the association between the use of<br />
cellular and cordless telephones and malignant brain tumors diagnosed during 2000-<br />
2003. Environment Research, 2006, 100(2) : p. 232-241.<br />
[93] LAHKOLA, A., et al. Mobile phone use and risk of glioma in 5 North European<br />
c<strong>ou</strong>ntries. International J<strong>ou</strong>rnal of Cancer, 2007, 120(8) : p. 1769-1775.<br />
[94] SCHÜZ, J., et al. Cellular telephone use and cancer risk: update of a nationwide<br />
Danish cohort. J<strong>ou</strong>rnal of National Cancer Institute, 2007, 99(8) : p. 665.<br />
[95] HOURS, M., et al. Cell phones and Risk of brain and ac<strong>ou</strong>stic nerve tum<strong>ou</strong>rs: the<br />
French INTERPHONE case-control study. Revue d'épidémiologie et de santé publique,<br />
2007, 55(5) : p. 321-332.<br />
[96] KLAEBOE, L., et al. Use of mobile phones in Norway and risk of intracranial<br />
tum<strong>ou</strong>rs. European J<strong>ou</strong>rnal of Cancer Prevention, 2007, 16(2) : p. 158-164.<br />
[97] LAHKOLA, A., et al. Meningioma and mobile phone use--a collaborative casecontrol<br />
study in five North European c<strong>ou</strong>ntries. International J<strong>ou</strong>rnal of Cancer, 2008,<br />
37(6) : p. 1304-1313.<br />
[98] SADETZKI, S., et al. Cellular phone use and risk of benign and malignant parotid<br />
gland tumors--a nationwide case-control study. American J<strong>ou</strong>rnal of Epidemiology, 2008,<br />
167(4) : p. 457-467.<br />
[99] LOSCHER, W. et al. Effects of weak alternating magnetic fields on noctural<br />
melatonin production and mammary carcinogenesis in rats. Oncology, 1994, 51 : p. 288-<br />
295.<br />
Thèse électronique :<br />
BERETTI, P., MORIN, H. et PACAUT, C. Réduction de l’exposition aux ondes<br />
électromagnétiques : cas de la téléphonie mobile [en ligne]. Thèse d’ingénieurs du génie<br />
sanitaire. Rennes : Ecole Nationale de la Santé Publique, , 2006, 97 p. Disponible sur :<br />
<br />
42
Sites Internet :<br />
AGENCE EUROPEENNE DE L’ENVIRONNEMENT. Radiation risk from everyday<br />
devices assessed [en ligne]. Disponible sur :<br />
<br />
AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES. Radiocommunication et santé [en ligne].<br />
Disponible sur : <br />
BIOINITIATIVE REPORT. A Rationale for a Biologically-based Public Exposure<br />
Standard for Electromagnetic Fields (ELF and RF) [en ligne].<br />
Disponible sur : <br />
INSTITUT NATIONAL DU CANCER. Cancer : prévention et risques [en ligne].<br />
Disponible sur : <br />
INSTITUT SCIENTIFIQUE DE SERVICE PUBLIC. PIRARD, W. Principes de<br />
fonctionnement des réseaux de téléphonie GSM [en ligne]. Disponible sur :<br />
<br />
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE. Les champs électromagnétiques,<br />
récapitulatif des effets sanitaires [en ligne]. Disponible sur :<br />
<br />
PUBMED. <br />
UNIVERSITE BORDEAUX 2, Institut de Santé Publique, d'Epidémiologie et de<br />
Développement. Fiches de synthèse concernant les effets sur la santé induits par les<br />
équipements de téléphonie mobile [en ligne]. Disponible sur :<br />
<br />
WIKIPEDIA, Ondes électromagnétiques [en ligne]. Disponible sur :<br />
<br />
WIKIPEDIA, Téléphonie mobile [en ligne]. Disponible sur :<br />
<br />
WIKIPEDIA, Cancer [en ligne].. Disponible sur :<br />
<br />
Documents législatifs :<br />
Décret n°2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l’article L. 32 du code des<br />
postes et télécommunications et relatif au valeurs limites d’exposition du public aux<br />
champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de<br />
43
télécommunication <strong>ou</strong> par les installations radioélectriques. (J<strong>ou</strong>rnal Officiel du 5 mai<br />
2002, p. 8624).<br />
Arrêté du 8 octobre 2003 fixant des spécifications techniques applicables aux<br />
équipements terminaux radioélectriques. (J<strong>ou</strong>rnal Officiel n°234 du 9 octobre 2003,<br />
p.17247)<br />
44
Annexe 1<br />
Notre étude porte sur un échantillon de 135 individus dont 74 femmes et 61 hommes.<br />
La moyenne d'âge des individus interrogés est de 33 ans et 7 mois.<br />
La personne la plus jeune a 13 ans et la plus âgée a 76 ans.<br />
Les questions posées étaient les suivantes :<br />
1) V<strong>ou</strong>s êtes un homme ? une femme ?<br />
2) Votre année de naissance ?<br />
3) Depuis quelle année avez v<strong>ou</strong>s un <strong>portable</strong> ?<br />
4) Pensez-v<strong>ou</strong>s être dépendant de votre <strong>portable</strong> ?<br />
5) Est-ce que v<strong>ou</strong>s laissez votre <strong>portable</strong> allumé la nuit ?<br />
6) Pensez v<strong>ou</strong>s que les ondes émises par le <strong>portable</strong> sont <strong>danger</strong>euses p<strong>ou</strong>r la santé ?<br />
Les lieux d’enquête sont :<br />
- le campus de Richter<br />
- l’université des sciences et des lettres de <strong>Montpellier</strong><br />
- le siège d’une grande entreprise<br />
- une école de danse<br />
- le centre ville de <strong>Montpellier</strong>.<br />
P<strong>ou</strong>r certaines questions, il n<strong>ou</strong>s a semblé pertinent de faire une différenciation entre<br />
hommes et femmes, notamment concernant la dépendance, car ceci révélateur de certaines<br />
pratiques.<br />
Dépendance des individus vis à vis du téléphone <strong>portable</strong><br />
44 %<br />
56 %<br />
Dépendance<br />
Indépendance<br />
On voit ici que 56% des personnes interrogées se disent dépendantes de leur téléphone<br />
<strong>portable</strong>. A noter que la plupart des individus sont équipés depuis l’an 2000.<br />
45
Dépendance au <strong>portable</strong> chez les hommes<br />
43 %<br />
35 %<br />
Dépendance au <strong>portable</strong> chez les<br />
femmes<br />
65 %<br />
57 %<br />
Dépendance<br />
Indépendance<br />
Dépendance<br />
Indépendance<br />
65 % des femmes interrogées, t<strong>ou</strong>t âge confondus, se déclarent dépendantes vis à vis de<br />
leur téléphone <strong>portable</strong> contre seulement 57 % chez les hommes.<br />
On peut rapprocher ce résultat d'une analyse sociologique de Pierre B<strong>ou</strong>rdieu (1930 -<br />
2002) qui estime que les femmes ont la responsabilité de développer et de maintenir les<br />
relations sociales (famille, amis ...). Cela peut donc en partie expliquer le fait qu'elles<br />
aient "besoin" de leur mobile car celui-ci leur permet de rester constamment en contact<br />
avec leurs proches.<br />
46
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
P<strong>ou</strong>r les femmes :<br />
Taux de dépendance chez les femmes en fonction de leur âge<br />
< 20 ans Entre 20 et<br />
25 ans<br />
Entre 25 et<br />
30 ans<br />
Entre 30 et<br />
45 ans<br />
Entre 45 et<br />
60 ans<br />
Plus de 60<br />
ans<br />
Ainsi, 75 % des moins de 20 ans s'estiment dépendantes de leur mobile. Cela concerne<br />
80% de la tranche 20-25 ans .<br />
Après 25 ans, on constate que globalement les femmes sont de moins en moins attachées<br />
à leur téléphone et ce au fur et à mesure que les années passent.<br />
On peut établir deux hypothèses à ce sujet :<br />
- La première est qu'elles ne sont pas de la "génération <strong>portable</strong>", elles ne<br />
voient pas ça comme un gadget à la mode, il ne constitue par p<strong>ou</strong>r elle un faire<br />
valoir.<br />
- La seconde est qu'il y a peut-être une certaine prise de conscience vis à vis des<br />
<strong>danger</strong>s qu'il peut représenter. On dit s<strong>ou</strong>vent que c'est avec le temps qu'apparaît la<br />
sagesse et la méfiance.<br />
non<br />
<strong>ou</strong>i<br />
47
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
P<strong>ou</strong>r les hommes :<br />
Taux de dépendance chez les hommes en fonction de leur âge<br />
< 20 ans Entre 20 et<br />
25 ans<br />
Entre 25 et<br />
30 ans<br />
Entre 30 et<br />
45 ans<br />
Entre 45 et<br />
60 ans<br />
Plus de 60<br />
ans<br />
Le taux de dépendance reste stable jusqu’à 25 ans puis il décroît considérablement jusqu’à<br />
atteindre 0% p<strong>ou</strong>r les plus de 60 ans. Ces derniers ont s<strong>ou</strong>vent un <strong>portable</strong> car ce sont<br />
leurs proches (enfants, petits enfants) qui leurs en ont offert un afin de p<strong>ou</strong>voir être de<br />
p<strong>ou</strong>voir appeler en cas de problèmes (notamment de santé).<br />
48
12 %<br />
7,5 %<br />
7,5 %<br />
Portable = Danger ?<br />
<strong>ou</strong>i<br />
non<br />
NSP<br />
Dépend de la durée<br />
Sur les 135 personnes interrogées 73 % considèrent que les ondes émises par le <strong>portable</strong><br />
représente un réel <strong>danger</strong> p<strong>ou</strong>r la santé.<br />
Cette inquiétude est sans d<strong>ou</strong>te due aux nombreux articles et reportages télévisés qui ont<br />
été diffusés ces dernières années.<br />
On note t<strong>ou</strong>t de même que 7,5 % attendent d'avoir de plus amples informations p<strong>ou</strong>r<br />
donner leur avis sur le sujet. Mais elles ont s<strong>ou</strong>vent précisé que, p<strong>ou</strong>r elles, t<strong>ou</strong>tes les<br />
ondes sont plus <strong>ou</strong> moins <strong>danger</strong>euses.<br />
C’est le même argument qu’ont avancé les 12 % qui ont dit non.<br />
Il y a quand même 7,5 % qui affirment que cela dépend de la durée d'utilisation mais elles<br />
n'ont pas pu définir une éventuelle durée limite.<br />
73 %<br />
49
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
Répartation par tranche d'âge des personnes p<strong>ou</strong>r qui<br />
<strong>portable</strong> = <strong>danger</strong>.<br />
Conseils relatifs à l’approche de précaution<br />
Annexe 2<br />
1. N’autorisez pas les enfants de moins de 12 ans à utiliser un téléphone <strong>portable</strong> sauf en<br />
cas d’urgence. En effet, les organes en développement (du fœtus <strong>ou</strong> de l’enfant) sont les<br />
plus sensibles à l’influence possible de l’exposition aux champs électromagnétiques.<br />
2. Lors de vos communications, essayez autant que possible de maintenir le téléphone à<br />
distance du corps (l’amplitude du champ baisse de quatre fois à 10 cm, et elle est<br />
cinquante fois inférieure à 1 m de distance). Dès que possible, utilisez le mode « hautparleur<br />
», <strong>ou</strong> un kit mains libres, <strong>ou</strong> une oreillette bluetooth (moins d’1/100e de<br />
l’émission électromagnétique du téléphone en moyenne).<br />
3. Restez à distance d’une personne en communication, et évitez d’utiliser votre téléphone<br />
<strong>portable</strong> dans des lieux publics comme le métro, le train <strong>ou</strong> le bus où v<strong>ou</strong>s exposez<br />
passivement vos voisins proches au champ électromagnétique de votre appareil.<br />
4. Evitez le plus possible de porter un téléphone mobile sur v<strong>ou</strong>s, même en veille. Ne pas<br />
le laisser à proximité de votre corps la nuit (s<strong>ou</strong>s l’oreiller <strong>ou</strong> sur la table de nuit) et<br />
particulièrement dans le cas des femmes enceintes – <strong>ou</strong> alors le mettre en mode « avion »<br />
<strong>ou</strong> « hors ligne/off line » qui a l’effet de c<strong>ou</strong>per les émissions électromagnétiques.<br />
5. Si v<strong>ou</strong>s devez le porter sur v<strong>ou</strong>s, assurez v<strong>ou</strong>s que la face « clavier » soit dirigée vers<br />
votre corps et la face « antenne » (puissance maximale du champ) vers l’extérieur.<br />
6. N’utilisez votre téléphone <strong>portable</strong> que p<strong>ou</strong>r établir le contact <strong>ou</strong> p<strong>ou</strong>r des<br />
conversations de quelques minutes seulement (les effets biologiques sont directement liés<br />
à la durée d’exposition). Il est préférable de rappeler ensuite d’un téléphone fixe filaire (et<br />
non d’un téléphone sans fil (DECT) qui utilise une technologie à micro-ondes apparentée<br />
à celle des <strong>portable</strong>s).<br />
7. Quand v<strong>ou</strong>s utilisez votre téléphone <strong>portable</strong>, changez de côté régulièrement, et avant<br />
de mettre le téléphone <strong>portable</strong> contre l’oreille, attendez que votre correspondant ait<br />
décroché (baisse de la puissance du champ électromagnétique émis).<br />
8. Evitez d’utiliser le <strong>portable</strong> lorsque la force du signal est faible <strong>ou</strong> lors de déplacements<br />
rapides comme en voiture <strong>ou</strong> en train (augmentation maximale et automatique de la<br />
puissance lors des tentatives de raccordement à une n<strong>ou</strong>velle antenne relais <strong>ou</strong> à une<br />
antenne distante)<br />
9. Communiquez par SMS plutôt que par téléphone (limite la durée d’exposition et la<br />
proximité du corps).<br />
10. Choisissez un appareil avec le DAS le plus bas possible par rapport à vos besoins (le<br />
« Débit d’Absorption Spécifique » mesure la puissance absorbée par le corps).<br />
52