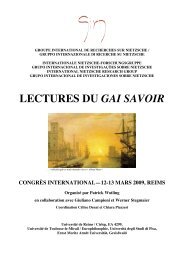L'agonistique des énoncés chez Foucault : pouvoir discursif et ...
L'agonistique des énoncés chez Foucault : pouvoir discursif et ...
L'agonistique des énoncés chez Foucault : pouvoir discursif et ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
L’agonistique <strong>des</strong> <strong>énoncés</strong> <strong>chez</strong> <strong>Foucault</strong> :<br />
<strong>pouvoir</strong> <strong>discursif</strong> <strong>et</strong> démocratie<br />
THIAGO MOTA<br />
Erasmus Mundus Europhilosophie<br />
Université de Toulouse II – Le Mirail<br />
thmotafs@gmail.com<br />
I<br />
Le suj<strong>et</strong> que je voudrais proposer à la discussion que nous sommes en trains de déployer<br />
autour de Heidegger <strong>et</strong> <strong>Foucault</strong> est celui de l’agonistique <strong>des</strong> <strong>énoncés</strong>. Ce mot-clé,<br />
agonistique <strong>des</strong> <strong>énoncés</strong>, je ne le trouve pas dans les textes de <strong>Foucault</strong>, mais je pense que<br />
l’on peut en profiter dans le cadre d’une lecture à double caractère. D’un côté, il faut dire que<br />
ce qui m’intéresse <strong>chez</strong> <strong>Foucault</strong> c’est tout d’abord son analyse de <strong>énoncés</strong>, <strong>des</strong> formations<br />
discursives <strong>et</strong>, de manière plus générale ce qu’il dit sur le langage. C’est alors l’analyse du<br />
langage, que l’on appellerait tout d’emblée une analyse agonistique, ou simplement une<br />
agonistique du langage que j’essaierais de comprendre ici. Mon exposé portera surtout sur le<br />
<strong>Foucault</strong> de l’Archéologie du savoir, ciblé sur ce qu’il nous raconte d’un accrochage à la<br />
question du langage <strong>et</strong> du discours mené de façon à révéler ou même à dénoncer ce que se<br />
passe au niveau plus basique de son articulation. L’agonistique <strong>des</strong> <strong>énoncés</strong> dont il est<br />
question ici est une approche du langage ou du discours qui se rapproche de la théorie du<br />
langage développée dans le monde Anglo-Germain sous la rubrique du pragmatisme<br />
linguistique. On verra alors, d’un côté, en quel sens l’Archéologie du savoir ressemble <strong>et</strong> se<br />
distingue de la philosophie pragmatique du langage, la pragmatische Sprachphilosophie.<br />
De l’autre côté, il faut dire que le motif d’une agonistique <strong>des</strong> <strong>énoncés</strong> <strong>chez</strong> <strong>Foucault</strong>, au-delà<br />
de son caractère disons linguistique, a aussi un caractère notamment politique, dans la mesure<br />
où il m<strong>et</strong> évidence la découverte archéologique que l’enchainement <strong>des</strong> <strong>énoncés</strong>, la liaison<br />
d’un énoncé à l’autre, ne va pas de soit, mais qu’il ne se laisse décrire à la rigueur qu’en<br />
termes de rapports de <strong>pouvoir</strong>. Ce précisément dans ce sens qu’il faut parler d’une agonistique<br />
<strong>des</strong> <strong>énoncés</strong>, <strong>des</strong> <strong>énoncés</strong> qui sont nés, modifiés <strong>et</strong> conditionnés par une logique <strong>des</strong> forces,<br />
par une agonistique. Evidement, il y est présupposé un élément politique qui, j’ai eu<br />
dernièrement le plaisir de découvrir, se trouve directement lié à une approche de la démocratie<br />
qui <strong>Foucault</strong> a développé au début <strong>des</strong> années 1980 <strong>et</strong> qui maintenant est connue du grande<br />
publique de par la publication <strong>des</strong> cours qu’il a donnée au Collège de France en 1983 sous le
THIAGO MOTA L’agonistique <strong>des</strong> <strong>énoncés</strong> <strong>chez</strong> <strong>Foucault</strong><br />
titre Le gouvernement de soi <strong>et</strong> <strong>des</strong> autres, paru <strong>chez</strong> Gallimard l’année dernier.<br />
II<br />
Je voudrais commencer en citant un passage que je trouve tout à fait décisif en ce qui<br />
concerne le rapport entre <strong>Foucault</strong> <strong>et</strong> la philosophie pragmatique du langage. C’est un passage<br />
auprès de la fin de la première conférence sur La vérité <strong>et</strong> les formes juridiques qu’il a<br />
présenté au Rio de Janeiro en 1973. Dans c<strong>et</strong>te conférence, <strong>Foucault</strong> affirme :<br />
« Le moment serait alors venu de considérer ces de discours non plus simplement sous leur aspect<br />
linguistique, mais d’une certaine façon – <strong>et</strong> ici je m’inspire <strong>des</strong> recherches réalisées par les Anglo-<br />
Américains –, comme <strong>des</strong> jeux, games, jeux stratégiques d’action <strong>et</strong> de réaction, de question <strong>et</strong> de<br />
réponse, de domination <strong>et</strong> d’esquive, ainsi que de lutte. Le discours est c<strong>et</strong> ensemble régulier de faits<br />
linguistiques à un certain niveau <strong>et</strong> de faits polémiques <strong>et</strong> stratégiques à un autre niveau. » (Dits <strong>et</strong><br />
écrits II, p. 538)<br />
<strong>Foucault</strong> dit qu’il faut considérer les discours comme jeux, en occurrence jeux de langage,<br />
Sprachspiele <strong>et</strong>, sans mentionner noms, fait référence aux recherches menées par les angloaméricains.<br />
Je pense qu’il suffit de citer le titre de la traduction française de Word and object<br />
(MIT Press, 1960) de Quine, à savoir Le mot <strong>et</strong> la chose (Flammarion, 1977), pour savoir dont<br />
<strong>Foucault</strong> parle. Bien sur que cela ne suffit pas pour dire que <strong>Foucault</strong> est un pragmatiste, mais<br />
c’est une piste qui peut nous aider à comprendre un <strong>des</strong> enjeux centraux de l’Archéologie du<br />
savoir. Pour cela, je voudrais relire quelques passages de l’Archéologie ayant égard à c<strong>et</strong>te<br />
question : est-ce que l’on pourrait appeler l’analyse archéologique <strong>des</strong> <strong>énoncés</strong> une<br />
pragmatique ? Dans quelle mesure sont-elles ressemblantes, dans quelle mesure sont-elles<br />
différentes ?<br />
Dans la définition d’un vocabulaire que lui perm<strong>et</strong>trait de saisir ce qui arrive au niveau<br />
proprement archéologique de l’analyse <strong>des</strong> <strong>énoncés</strong>, <strong>Foucault</strong> se sert librement de termes<br />
courants dans la philosophie analytique du langage, notamment dans le pragmatisme<br />
linguistique (Archéologie du savoir, Ch. 3). Ainsi, on le voit employer <strong>des</strong> termes comme acte<br />
performatif ou performance linguistique qui en principe caractériseraient mieux l’énoncé que<br />
le terme logique-sémantique de proposition ou le terme grammatical de phrase. Loin d’être un<br />
atome linguistique, l’énoncé serait une action <strong>et</strong> l’énonciation, une pratique. Alors, il aurait<br />
une sorte de matérialité du langage différente de la matérialité <strong>des</strong> signes imprimés sur une<br />
page ou prononcés dans un auditoire. C<strong>et</strong>te matérialité serait de l’ordre de l’action ou d’un<br />
ensemble d’actions énonciatives, <strong>des</strong> performances langagières <strong>et</strong> en tant que telles elles<br />
forment un discours. On parlerait alors de la matérialité de la pratique discursive.<br />
En outre, il serait possible de s’attaquer aux <strong>énoncés</strong> de manière à montrer comment-ils, en<br />
[2]
THIAGO MOTA L’agonistique <strong>des</strong> <strong>énoncés</strong> <strong>chez</strong> <strong>Foucault</strong><br />
tant qu’actions, peuvent être effectués ou interdits, se laissent répéter ou doivent être oubliés<br />
<strong>et</strong> même cachés. Ainsi, un énoncé ne serait pas la matérialisation d’une forme idéale éternelle<br />
identique à soi-même, mais il ne serait pas non plus l’occurrence d’un événement entièrement<br />
singulier, unique <strong>et</strong> irrépétable. On voit <strong>Foucault</strong> essayer de détacher l’analyse archéologique<br />
de la supposition d’une ontologie de l’événement-énoncé, de l’Aussage-Ereignis, pour<br />
employer le terme choisit par le traducteur allemand de l’Archéologie du savoir <strong>et</strong> que revoie<br />
tout du coup à une possible filiation du <strong>Foucault</strong> archéologue au dernier Heidegger. Je<br />
n’insisterai pas là-<strong>des</strong>sus. Plutôt, je voudrais accentuer l’idée d’un champ de stabilisation<br />
associé aux <strong>énoncés</strong>, d’un champ institutionnel définissant les possibilités de réinscription <strong>et</strong><br />
transcription <strong>des</strong> <strong>énoncés</strong> (Archéologie du savoir, p. 142). Par rapport à ce champ de<br />
stabilisation <strong>des</strong> <strong>énoncés</strong>, <strong>Foucault</strong> dit :<br />
« Au lieu d’être une chose dite une fois pour toutes […] l’énoncé, en même temps qu’il surgit dans sa<br />
matérialité, apparaît avec un statut, entre dans <strong>des</strong> réseaux, se place dans <strong>des</strong> champs d’utilisation,<br />
s’offre à <strong>des</strong> transferts <strong>et</strong> à <strong>des</strong> modifications possibles, s’intègre à <strong>des</strong> opérations <strong>et</strong> <strong>des</strong> stratégies où<br />
son identité se maintient ou s’efface. Ainsi l’énoncé circule, sert, se dérobe, perm<strong>et</strong> ou empêche de<br />
réaliser un désir, est docile ou rebelle à <strong>des</strong> intérêts, entre dans l’ordre <strong>des</strong> contestations <strong>et</strong> <strong>des</strong> luttes,<br />
devient thème d’appropriation ou de rivalité. » (Archéologie du savoir, p. 145)<br />
On voit alors que le champ de stabilisation <strong>des</strong> <strong>énoncés</strong> est le champ de son utilisation, que les<br />
facteurs déterminants de leur apparition, de leur matérialisation sont ramenés à l’usage, ce qui<br />
détermine aussi leur statut, s’ils sont autorisés ou pas. On parlerait tout simplement d’une<br />
pragmatique <strong>des</strong> <strong>énoncés</strong> dans l’Archéologie du savoir, si <strong>Foucault</strong> ne revoyait pas c<strong>et</strong> usage<br />
<strong>et</strong> le statut assumé par l’énoncé aux intérêts, aux stratégies, aux contestations, aux luttes <strong>et</strong><br />
aux rivalités qui sont impliqués dans son usage. Il y a tout un contenu disons politique de<br />
l’énonciation, de la performance langagière qu’une analyse linguistico-pragmatique n’arrive<br />
pas à saisir. Il y a le fait que le réseau qui conditionne <strong>et</strong> rend possible l’action discursive est à<br />
la fois un réseau langagier <strong>et</strong> un réseau de rapports de <strong>pouvoir</strong>, que la pragmatique aide à<br />
comprendre, mais dont elle ne parle pas, ou ne veut pas parler. Cela perm<strong>et</strong> déjà de distinguer<br />
l’analyse archéologique <strong>des</strong> <strong>énoncés</strong> de l’analyse pragmatique : l’effort de <strong>Foucault</strong> se<br />
caractérise comme une appropriation de l’appareillage conceptuel du pragmatisme en fonction<br />
d’un accrochage à la question du <strong>pouvoir</strong> implicite dans l’usage du langage. C’est cela qui<br />
définit le niveau à proprement dire archéologique de la <strong>des</strong>cription de l’<strong>énoncés</strong>.<br />
En fait, le fil conducteur offert par la question du <strong>pouvoir</strong> perm<strong>et</strong> à <strong>Foucault</strong> de parler d’une<br />
économie politique <strong>des</strong> discours, où la matérialité <strong>et</strong> la valeur d’un énoncé est considérée<br />
comme celle d’un bien, d’un produit, d’une marchandise rare <strong>et</strong> qui doit être administrée,<br />
sauvegardée, économisée. Je cite <strong>Foucault</strong> :<br />
[3]
THIAGO MOTA L’agonistique <strong>des</strong> <strong>énoncés</strong> <strong>chez</strong> <strong>Foucault</strong><br />
« il [l’énoncé] est un bien – fini, limité, désirable, utile – qui a ses règles d’apparition, mais aussi ses<br />
conditions d’appropriation <strong>et</strong> de mise en œuvre ; un bien qui pose par conséquent, dès son existence<br />
[…] la question du <strong>pouvoir</strong> ; un bien qui est, par nature, l’obj<strong>et</strong> d’une lutte, <strong>et</strong> d’une lutte politique. »<br />
(Archéologie du savoir, p. 166)<br />
Je pense que cela suffit pour dissuader la tendance trop schématique que l’on constate dans la<br />
littérature sur <strong>Foucault</strong> de diviser sa pensée dans une phase archéologique, centrée sur la<br />
question du savoir, <strong>et</strong> une phase généalogique, centrée sur la question du <strong>pouvoir</strong>, comme s’il<br />
n’y aurait pas de rapport entre les <strong>pouvoir</strong>s <strong>et</strong> les savoirs <strong>et</strong> comme si <strong>Foucault</strong> n’aurait pas été<br />
toujours le penseur du savoir-<strong>pouvoir</strong> par excellence.<br />
Il y a pourtant une autre question, plus compliquée, dont je voudrais parler rapidement : c’est<br />
la question de l’a priori historique. On vient de voir que l’analyse archéologique <strong>des</strong> <strong>énoncés</strong><br />
a un caractère <strong>des</strong>criptif, on pourrait dire anti-normativiste. <strong>Foucault</strong> disait même qu’il était<br />
un « positiviste heureux » (Archéologie du savoir, p. 172). En même temps, on le voit parler<br />
de règles, de conditions, <strong>des</strong> lois déterminant l’occurrence <strong>des</strong> <strong>énoncés</strong>. On pourrait dire que<br />
le champ de stabilisation ou d’utilisation <strong>des</strong> <strong>énoncés</strong> est un champ de lois de possibilité, dans<br />
ce sens où il est le champ qui conditionne <strong>et</strong> rend possible l’action discursive. Par conséquent,<br />
on pourrait soutenir que la méthode archéologique perm<strong>et</strong> de dégager les présupposés de la<br />
pratique discursive, en quelque sorte la transcendantalité que l’on trouve dans la couche plus<br />
profonde du langage <strong>et</strong> que donc l’arché en quête dans l’archéologie foucaldienne ne serait<br />
pas tellement différente de celle <strong>des</strong> philosophes qu’il insiste de critiquer.<br />
Par contre, on voit <strong>Foucault</strong> essayer de se libérer du thème historique-transcendantal. Il<br />
affirme l’extériorité totale du domaine énonciatif, sa superficialité, dans le sens où il serait<br />
présent tout entier à sa propre surface. L’énonciation ne présupposerait pas forcement un<br />
auteur, un agent <strong>discursif</strong>, un suj<strong>et</strong> parlant, dont l’intériorité serait le siège de ses<br />
conditionnements. Dans une prise de position par rapport à Heidegger, <strong>Foucault</strong> affirme la<br />
contingence de l’énonciation <strong>et</strong> la discontinuité <strong>des</strong> discours pour défendre la neutralité de<br />
l’archéologie par rapport à la question de la validation <strong>et</strong> l’idée que le champ de<br />
possibilitation serait un champ anonyme : le suj<strong>et</strong> de l’énonciation serait le on, das man, <strong>et</strong> la<br />
question heideggerienne du qui, du wer, n’aurait pas d’importance. Ainsi, nous le voyons<br />
définir explicitement l’a priori historique : « j’entends désigner par là [dit <strong>Foucault</strong>] un a<br />
priori qui serait non pas condition de validité pour <strong>des</strong> jugements, mais condition de réalité<br />
pour <strong>des</strong> <strong>énoncés</strong> » (Archéologie du savoir, p. 174).<br />
On dirait alors que les lois articulées par l’archéologie ne sont que <strong>des</strong> lois d’effectivité <strong>des</strong><br />
<strong>énoncés</strong>, mais cela n’est pas le dernier mot, car ces lois ont un caractère spécifique. En eff<strong>et</strong>,<br />
[4]
THIAGO MOTA L’agonistique <strong>des</strong> <strong>énoncés</strong> <strong>chez</strong> <strong>Foucault</strong><br />
<strong>Foucault</strong> ne le dit pas explicitement dans l’Archéologie du savoir, mais c’est encore la<br />
question du <strong>pouvoir</strong> qui offre la clé pour comprendre la spécificité de sa formulation de l’a<br />
priori historique, puisqu’en tant que condition d’effectivité c<strong>et</strong> a priori présuppose une réalité<br />
structuré comme rapports de forces. Il y aurait alors une logique agonistique immanente au<br />
discours que l’archéologie perm<strong>et</strong>trait de m<strong>et</strong>tre en évidence <strong>et</strong> par conséquent l’a priori<br />
historique serait la loi régissant la pratique discursive dans la mesure où il serait précisément<br />
une loi de <strong>pouvoir</strong> <strong>discursif</strong>, un machtdiskursives Ges<strong>et</strong>z.<br />
III<br />
Pour conclure, je voudrais entamer brièvement une évaluation de c<strong>et</strong>te conception discursive<br />
de <strong>pouvoir</strong> que, nous venons de le voir, se trouve implicite dans l’Archéologie du savoir. Je<br />
voudrais alors déplacer l’encadrement de mes considérations de la seule question <strong>des</strong> <strong>énoncés</strong><br />
vers la question institutionnelle qu’y découle directement, tout en reprenant une critique que<br />
par exemple Axel Honn<strong>et</strong>h faisait à <strong>Foucault</strong> déjà en 1986. Honn<strong>et</strong>h comprend qu’au but de la<br />
transition de <strong>Foucault</strong> de l’analyse du discours à la théorie du <strong>pouvoir</strong>, en fait au but de<br />
l’explicitation du contenu disons agonistique de la pratique discursive, <strong>Foucault</strong> n’aurait autre<br />
façon de s’accrocher aux institutions sociales qu’en les concevant comme <strong>des</strong> moyens<br />
d’exercice unilatéral de contraintes oppressifs ou répressifs, comme « bloße Mittel einseitiger<br />
Zwangsherrschaft» (Honn<strong>et</strong>h, Kritik der Macht, p. 194). <strong>Foucault</strong> aurait le mérite de nous<br />
avoir donné <strong>des</strong> instruments pour dénoncer comment les intérêts stratégiques se déguisent de<br />
manière subreptice derrière les discours apparemment auto-justifiés <strong>des</strong> épistémologies plus<br />
sophistiquées du XXème siècle, par exemple l’analyse structurelle <strong>et</strong> l’analyse pragmatique<br />
du langage. Cependant, au but de la critique foucaldienne, de toute c<strong>et</strong>te déconstruction <strong>et</strong><br />
dénonciation, il ne nous resterait que le constat amer de l’existence de rapports de <strong>pouvoir</strong><br />
traversant toutes les pratiques <strong>et</strong> toutes les institutions imaginables, le constat de<br />
l’impossibilité de la légitimation <strong>des</strong> discours en général. Dans ces termes, on a vraiment du<br />
mal à comprendre comment, selon <strong>Foucault</strong>, serait-il possible de fonder, au sens d’instituer,<br />
stiften, une pratique à caractère politique, comment serait-il possible de s’engager.<br />
A c<strong>et</strong> égard, je voudrais attirer notre attention aux cours de <strong>Foucault</strong> qui portent sur Le<br />
gouvernement de soi <strong>et</strong> <strong>des</strong> autres. Le cours de 1983 se déploie autour d’une notion, en fait un<br />
mot grec qui ne est pas du tout familier, au quel <strong>Foucault</strong> va attribuer un statut spécial : il<br />
s’agit de la parrêsia. Parrêsia signifie parler franchement, dire la vérité <strong>et</strong> que la vérité, dire<br />
toute la vérité. <strong>Foucault</strong> le traduit comme le « dire-vrai » en le reliant aux procédures de<br />
gouvernement <strong>et</strong> de constitution <strong>des</strong> subjectivités, aux rapports au soi <strong>et</strong> aux autres. De<br />
[5]
THIAGO MOTA L’agonistique <strong>des</strong> <strong>énoncés</strong> <strong>chez</strong> <strong>Foucault</strong><br />
manière générale, la parrêsia serait, selon <strong>Foucault</strong> : « une vertu, devoir <strong>et</strong> technique que l’on<br />
doit rencontrer <strong>chez</strong> celui qui dirige la conscience <strong>des</strong> autres <strong>et</strong> les aide à constituer leur<br />
rapport à soi » (Le gouvernement de soi <strong>et</strong> <strong>des</strong> autres, p. 43). C’est-à-dire que la parrêsia joue<br />
un rôle remarquable dans la constitution du soi, mais ce n’est pas un rôle simplement éthique<br />
qu’elle joue, il est aussi politique, car la parrêsia, le dire-vrai est constitutif du rapport à<br />
l’autre sans lequel il n’y a pas de rapport à soi.<br />
Si nous revenons alors à ce que je parlais tout à l’heure de l’agonistique <strong>des</strong> <strong>énoncés</strong>, il faut<br />
adm<strong>et</strong>tre que le rapport à soi <strong>et</strong> aux autres, l’être-en-soi-même <strong>et</strong> l’être-avec-les-autres<br />
présupposés par les procédures institutionnels r<strong>et</strong>ombe dans la logique du <strong>pouvoir</strong> <strong>discursif</strong> <strong>et</strong><br />
donc que l’énonciation de c<strong>et</strong>te vérité, le dire-vrai ne serait qu’une répercussion <strong>des</strong><br />
impositions du <strong>pouvoir</strong> disciplinaire. La parrêsia serait alors tout simplement un nouveau mot<br />
pour décrire le phénomène du <strong>pouvoir</strong> <strong>discursif</strong>. Pourtant, il me semble que <strong>Foucault</strong> a autre<br />
intention que celle de la simple dénonce dans ce r<strong>et</strong>our aux grecs. Il me semble qu’il veut<br />
faire le pari de la légitimité de son propre discours en tant que vrai-disant avec c<strong>et</strong>te notion de<br />
parrêsia, ce qui implique une nouvelle conception du <strong>pouvoir</strong>, que j’appellerais démocraticoagonistique,<br />
autrement que l’abandon de l’idée que la vérité a toujours un rapport avec le<br />
<strong>pouvoir</strong>.<br />
<strong>Foucault</strong> travaille explicitement le problème du rapport de la parrêsia à la démocratie. Il parle<br />
d’une circularité entre l’une <strong>et</strong> l’autre : il n’y aurait pas de démocratie sans parrêsia <strong>et</strong> il n’y<br />
aurait pas de parrêsia sans démocratie. La volonté derrière la parrêsia serait en fait la volonté<br />
d’avoir accès au « premier rang », de participer du group <strong>des</strong> citoyens qui exercent le <strong>pouvoir</strong>,<br />
qui gouvernent. L’appartenance à ce group ne serait pourtant pas caractérisée comme un<br />
statut, définit en fonction de la richesse ou de la nationalité, mais comme dunamis, comme<br />
exercice. Il serait c<strong>et</strong> exercice, ce qui rendrait à certains citoyens l’autorité ou, ce le terme de<br />
<strong>Foucault</strong>, une certaine « supériorité » face aux autres <strong>et</strong> qui perm<strong>et</strong>trait de diriger, de<br />
gouverner la cité. Mais c<strong>et</strong>te supériorité, c<strong>et</strong>te autorité, <strong>et</strong> cela est le plus intéressant, ne serait<br />
pas à confondre avec la tyrannie ou l’autoritarisme, car « c<strong>et</strong>te supériorité liée à la parrêsia est<br />
une supériorité que l’on partage avec d’autres […] sous la forme de la concurrence, de la<br />
rivalité, du conflit, de la joute. C’est une structure agonistique. » (Le gouvernement de soi <strong>et</strong><br />
<strong>des</strong> autres, p. 144).<br />
On r<strong>et</strong>rouve alors, maintenant explicitement employé par <strong>Foucault</strong>, le terme d’agonistique,<br />
qui décrit la structure conditionnant de l’énonciation de la vérité dans le contexte de la<br />
démocratie grecque. <strong>Foucault</strong> parle d’un champ agonistique rendant possible la parrêsia,<br />
[6]
THIAGO MOTA L’agonistique <strong>des</strong> <strong>énoncés</strong> <strong>chez</strong> <strong>Foucault</strong><br />
c’est-à-dire l’énonciation d’une vérité qui n’est point <strong>des</strong>tituée de <strong>pouvoir</strong>, mais bien au<br />
contraire fondante du <strong>pouvoir</strong> démocratique. Il est remarquable que le champ agonistique<br />
conditionnant l’exercice du <strong>pouvoir</strong>-vérité démocratique renvoie à un partage avec les autres,<br />
c’est-à-dire à un avec. On parlerait alors d’un avec agonistique. Mais le plus remarquable est<br />
pourtant le fait que c<strong>et</strong>te <strong>des</strong>cription de la démocratie n’a pas l’air de la dénonce, mais bien<br />
plutôt celui de la défense. <strong>Foucault</strong> dit :<br />
« la parrêsia est quelque chose qui va caractériser beaucoup moins un statut, une position statique, un<br />
caractère classificatoire de certains individus dans la cité, qu’une dynamique, un mouvement qui, audelà<br />
de l’appartenance pure <strong>et</strong> simple au corps <strong>des</strong> citoyens, m<strong>et</strong> l’individu dans une position de<br />
supériorité […] où il va <strong>pouvoir</strong> s’occuper de la cité dans la forme <strong>et</strong> par l’exercice du discours vrai. »<br />
(Le gouvernement de soi <strong>et</strong> <strong>des</strong> autres, p. 144).<br />
Il serait peut-être très tôt pour parler d’une réinscription de <strong>Foucault</strong> dans la modernité<br />
philosophique, comme on lit dans la quatrième couverture du bouquin, mais je pense que l’on<br />
peut parler déjà, avec <strong>Foucault</strong>, d’un engagement agonistique <strong>et</strong> même d’un r<strong>et</strong>our au<br />
normatif dans la théorie du <strong>pouvoir</strong> <strong>discursif</strong>.<br />
[7]