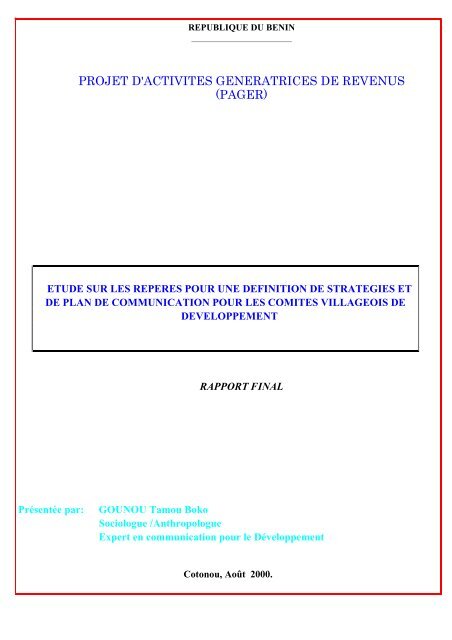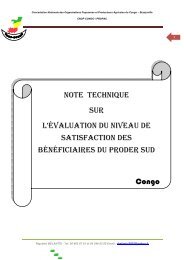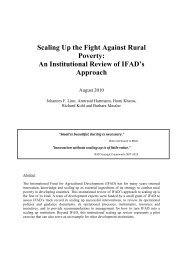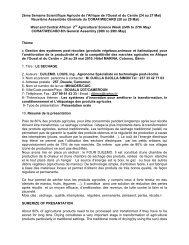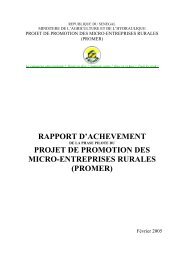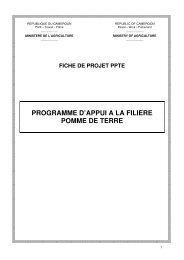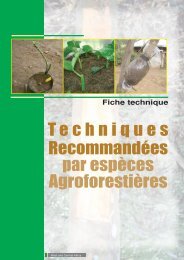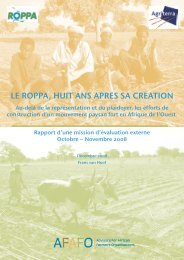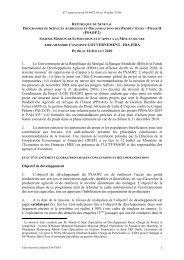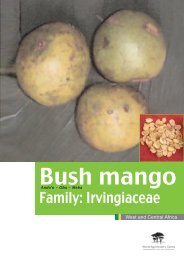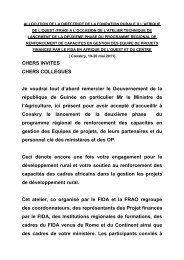Etude sur les repères pour une définition de stratégies ... - FIDAfrique
Etude sur les repères pour une définition de stratégies ... - FIDAfrique
Etude sur les repères pour une définition de stratégies ... - FIDAfrique
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
REPUBLIQUE DU BENIN<br />
———————————<br />
PROJET D'ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS<br />
(PAGER)<br />
ETUDE SUR LES REPERES POUR UNE DEFINITION DE STRATEGIES ET<br />
DE PLAN DE COMMUNICATION POUR LES COMITES VILLAGEOIS DE<br />
DEVELOPPEMENT<br />
RAPPORT FINAL<br />
Présentée par: GOUNOU Tamou Boko<br />
Sociologue /Anthropologue<br />
Expert en communication <strong>pour</strong> le Développement<br />
Cotonou, Août 2000.
1. Introduction<br />
Dans le cadre <strong>de</strong> ses activités, le Projet d’Activités Génératrices <strong>de</strong> Revenus<br />
(PAGER) a choisi <strong>de</strong> s’insérer dans <strong>une</strong> politique globale <strong>de</strong> lutte contre la<br />
pauvreté. Son objectif est d’augmenter <strong>les</strong> revenus et la sécurité alimentaire <strong>de</strong>s<br />
populations rura<strong>les</strong> et périurbaines <strong>de</strong>s départements <strong>de</strong> l’Atlantique, du Littoral,<br />
du Couffo, du Mono, du Plateau et du Zou.<br />
1.1.Contexte<br />
En visant <strong>les</strong> objectifs spécifiques que sont :<br />
- le développement <strong>de</strong>s activités génératrices <strong>de</strong> revenus,<br />
- la protection <strong>de</strong> l’environnement et<br />
- la création et/ou le renforcement <strong>de</strong>s institutions <strong>de</strong> base,<br />
le PAGER a mis en place <strong>de</strong>s Comités Villageois <strong>de</strong> Développement (CVD) qui<br />
sont <strong>de</strong>s structures villageoises chargées <strong>de</strong> promouvoir le développement local.<br />
Les CVD ont été créés dans <strong>une</strong> trentaine <strong>de</strong> villages encadrés dans le<br />
domaine <strong>de</strong>s activités génératrices <strong>de</strong> revenus par le PAGER ; la mise en place<br />
<strong>de</strong>s CVD est as<strong>sur</strong>ée directement par le PAGER à travers sa composante Appui<br />
aux Institutions <strong>de</strong> Base (AIB), qui est appuyée par <strong>les</strong> Cellu<strong>les</strong> Départementa<strong>les</strong><br />
Décentralisées (CDD) dudit Projet, et <strong>de</strong>s ONG partenaires.<br />
D’importantes attributions sont confiées aux CVD :<br />
- servir <strong>de</strong> courroie <strong>de</strong> transmission entre le village et l’ensemble <strong>de</strong>s<br />
partenaires au développement (services techniques, Organismes Non<br />
Gouvernementaux, organisations internationa<strong>les</strong>, collectivités loca<strong>les</strong> et<br />
autres) ;<br />
- animer et organiser le village <strong>pour</strong> la mobilisation sociale <strong>de</strong> la communauté<br />
en vue <strong>de</strong> sa participation active au développement local ;<br />
- ai<strong>de</strong>r <strong>les</strong> agences <strong>de</strong> développement intervenant dans le village, à<br />
l’i<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong>s problèmes <strong>de</strong> développement du milieu et à la recherche<br />
<strong>de</strong>s solutions idoines;<br />
- entreprendre et/ou encourager <strong>les</strong> activités visant la promotion du milieu par<br />
la mobilisation <strong>de</strong>s ressources humaines, matériel<strong>les</strong>, financières aussi bien<br />
loca<strong>les</strong> que cel<strong>les</strong> extérieures au village.<br />
A travers tout ce qui précè<strong>de</strong>, le PAGER vise un changement progressif,<br />
constant et irréversible d’attitu<strong>de</strong>s et <strong>de</strong> comportements <strong>de</strong>s différents groupes<br />
<strong>de</strong> la population, grâce à l’exercice d’<strong>une</strong> politique susceptible <strong>de</strong> rendre durable<br />
le CVD.<br />
2
Contrairement à ses attentes, le PAGER observe que <strong>les</strong> réflexes,<br />
attitu<strong>de</strong>s, et comportements qui cadrent avec <strong>les</strong> objectifs du développement<br />
durable ne sont pas encore ancrés dans <strong>les</strong> habitu<strong>de</strong>s socia<strong>les</strong> quotidiennes <strong>de</strong>s<br />
populations.<br />
Plus grave, <strong>les</strong> CVD, vecteurs <strong>de</strong> ce changement naviguent à vue, parce<br />
que n’ayant pas <strong>de</strong> plan <strong>de</strong>vant servir <strong>de</strong> gui<strong>de</strong>.<br />
C’est au vu <strong>de</strong> tout ce qui précè<strong>de</strong> que le PAGER a initié <strong>une</strong> étu<strong>de</strong> visant<br />
à terme à l’élaboration d’<strong>une</strong> approche participative et <strong>de</strong>s supports <strong>de</strong><br />
communication.<br />
1.2.Objectifs<br />
L’objectif principal <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong> est d’i<strong>de</strong>ntifier <strong>les</strong> canaux <strong>de</strong> communication<br />
pouvant ai<strong>de</strong>r <strong>les</strong> membres <strong>de</strong>s CVD à atteindre efficacement leurs objectifs.<br />
Cette étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>vra permettre entre autres <strong>de</strong> :<br />
1. évaluer la collaboration entre <strong>les</strong> CVD et <strong>les</strong> autorités loca<strong>les</strong> ;<br />
2. recenser <strong>les</strong> difficultés rencontrées par <strong>les</strong> CVD, <strong>les</strong> approches <strong>de</strong> solution et<br />
<strong>les</strong> besoins ;<br />
3. concevoir et proposer <strong>une</strong> approche participative et <strong>de</strong>s supports <strong>de</strong><br />
communication qui permettent aux membres <strong>de</strong>s CVD d’atteindre leurs<br />
objectifs ;<br />
4. faire <strong>de</strong>s recommandations dans le sens <strong>de</strong> l’amélioration du système<br />
d’information <strong>de</strong>s CVD.<br />
1.3.Méthodologie utilisée<br />
En raison <strong>de</strong> la nature <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>mandée, qui se fon<strong>de</strong> <strong>sur</strong> le paramètre<br />
<strong>de</strong> la communication sociale dans <strong>une</strong> zone d’intervention où s’expriment<br />
plusieurs ethnies, la dimension socio-culturelle a été largement prise en compte.<br />
La méthodologie utilisée a consisté en la division <strong>de</strong> la zone<br />
d’intervention du Projet en aires socio-culturel<strong>les</strong>; car la question <strong>de</strong> la<br />
communication a <strong>de</strong>s liens très étroits avec la langue (qui est le véhicule <strong>de</strong> la<br />
culture), et <strong>les</strong> habitu<strong>de</strong>s culturel<strong>les</strong> qui mettent en avant <strong>les</strong> valeurs cardina<strong>les</strong><br />
<strong>de</strong> chaque milieu culturel.<br />
Etant donné la nature <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong> qui considère <strong>les</strong> aires culturel<strong>les</strong> comme<br />
subdivisions <strong>de</strong> la zone d’intervention du Projet, six (06) aires ont paru<br />
prioritaires :<br />
- l’aire culturelle Fon/Aïzo ( Plateau d’Allada, Plateau d’Abomey)<br />
3
- l’aire culturelle Holli (Abadago, Ouinhi),<br />
- l’aire culturelle Wémê- Goun (Dêkin, Gbakpo, Sêdjè et environs),<br />
- l’aire culturelle Nagot ( Sakété, Pobè),<br />
- l’aire culturelle Adja (Mono Nord),<br />
- l’aire culturelle Saxwe (Mono Centre).<br />
C’est <strong>sur</strong> la base <strong>de</strong> cette subdivision que l’échantillonnage s’est effectué, à<br />
raison <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux (02) villages par aire socio-culturelle, soit au total, douze (12)<br />
villages.<br />
Il convient <strong>de</strong> préciser que <strong>les</strong> aires culturel<strong>les</strong> Goun et Nagot ont été<br />
couvertes par le même enquêteur, en raison <strong>de</strong> ses capacités réel<strong>les</strong> <strong>de</strong> maîtrise<br />
<strong>de</strong>s langues du milieu. Toutefois, <strong>pour</strong> <strong>de</strong>s raisons d’efficacité, il lui a été confié<br />
un village par aire culturelle, ce qui a ramené en définitive le nombre <strong>de</strong> villages<br />
à dix (10) :<br />
• Ougbègamey (Djidja) et Hlagba-Dénou <strong>pour</strong> l’aire culturelle Fon,<br />
• Avamê (Tori-Bossito) et Avakpa (Allada) <strong>pour</strong> l’aire culturelle Fon/Aïzo<br />
• Abadago (Adja Ouèrè) et Zoungbomé (Akpo-Misrété) <strong>pour</strong> <strong>les</strong> aires<br />
culturel<strong>les</strong> Wémê-Goun et Nagot,<br />
• Doko-Centre et Olouhoué <strong>pour</strong> l’aire culturelle Adja, et enfin<br />
• Lobogo et Dhodho <strong>pour</strong> l’aire culturelle Saxwè.<br />
1.5. Les cib<strong>les</strong><br />
Les cib<strong>les</strong> visées par la présente étu<strong>de</strong> ont été notamment :<br />
- Les membres <strong>de</strong>s CVD,<br />
- <strong>les</strong> membres <strong>de</strong>s groupements, <strong>les</strong> élus ASF,<br />
- <strong>les</strong> autorités loca<strong>les</strong> (chef village, maire, chef coutumier, autorités<br />
religieuses),<br />
- <strong>les</strong> institutionnels ( agents <strong>de</strong>s services décentralisés <strong>de</strong> l’Etat, responsab<strong>les</strong><br />
d’ONG),<br />
- <strong>les</strong> personnes ressources ( retraités, notab<strong>les</strong>, artistes célèbres du terroir).<br />
- Les responsab<strong>les</strong> <strong>de</strong>s groupes minoritaires.<br />
A chac<strong>une</strong> <strong>de</strong> ces cib<strong>les</strong>, il a été soumis un gui<strong>de</strong> d’entretien correspondant à<br />
la nature <strong>de</strong>s informations recherchées.<br />
Le consultant s’est chargé personnellement <strong>de</strong> recueillir <strong>de</strong>s données précises<br />
auprès du Directeur du PAGER et <strong>de</strong>s responsab<strong>les</strong> <strong>de</strong> volets du Projet : AIB,<br />
Suivi-Evaluation, et AGR (absent <strong>pour</strong> raison <strong>de</strong> congés).<br />
4
2. Synthèse <strong>de</strong>s résultats d’enquête<br />
2.1.Du niveau <strong>de</strong> collaboration entre <strong>les</strong> différentes instances du PAGER.<br />
2.2.1. Niveau <strong>de</strong> collaboration entre <strong>les</strong> cadres du PAGER et <strong>les</strong> différents<br />
répondants <strong>sur</strong> le terrain.<br />
Dans l’ensemble, la qualité <strong>de</strong>s rapports qu’entretiennent <strong>les</strong> cadres <strong>de</strong> l’Unité<br />
<strong>de</strong> Gestion du PAGER avec <strong>les</strong> répondants <strong>sur</strong> le terrain est bonne ; elle varie<br />
selon <strong>les</strong> relations fonctionnel<strong>les</strong> existant entre ces cadres et leurs répondants. Si<br />
la Direction entretient <strong>de</strong>s rapports cordiaux avec toutes <strong>les</strong> autres instances tout<br />
en <strong>de</strong>meurant <strong>sur</strong>tout administrative, il arrive qu’il n’existe aucun rapport entre<br />
certaines autorités villageoises et certains responsab<strong>les</strong> <strong>de</strong> composante qui<br />
déclarent <strong>les</strong> connaître très peu (cas du responsable AIB avec <strong>les</strong> maires et <strong>les</strong><br />
chefs coutumiers). Il précise que ses homologues <strong>de</strong>s cellu<strong>les</strong> Départementa<strong>les</strong>,<br />
entités <strong>de</strong> proximité, <strong>les</strong> connaissent bien.<br />
De même, le responsable <strong>de</strong> la cellule Suivi-Evaluation n’entretient aucun<br />
rapport particulier avec <strong>les</strong> maires, <strong>les</strong> chefs coutumiers et <strong>les</strong> chefs <strong>de</strong> villages.<br />
2.2.Du niveau <strong>de</strong> collaboration entre <strong>les</strong> CVD et <strong>les</strong> autorités loca<strong>les</strong>.<br />
L’appréciation du niveau <strong>de</strong> collaboration entre <strong>les</strong> CVD et <strong>les</strong> autorités loca<strong>les</strong><br />
s’est faite à travers l’énumération <strong>de</strong>s formations reçues par ces <strong>de</strong>rniers et<br />
l’usage qu’ils en ont fait.<br />
De nombreux thèmes <strong>de</strong> formation ont été cités dont <strong>les</strong> plus constants sont :<br />
- Les rô<strong>les</strong> individuels et collectifs ;<br />
- Comment conduire <strong>une</strong> réunion ;<br />
- Comment as<strong>sur</strong>er le développement local ;<br />
- Comment gérer la décentralisation ;<br />
- L’i<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong>s besoins ;<br />
- Les techniques <strong>de</strong> communication ;<br />
- Comment élaborer <strong>de</strong>s plans d’action ;<br />
Ces séances <strong>de</strong> formation leur ont appris très tôt à comprendre que le<br />
développement d’<strong>une</strong> localité implique toutes <strong>les</strong> composantes <strong>de</strong> la population,<br />
et qu’il est nécessaire, <strong>pour</strong> réussir, d’associer tout le mon<strong>de</strong> à la gestion <strong>de</strong> la<br />
chose publique. Ce qui justifie la qualité <strong>de</strong>s rapports <strong>de</strong> collaboration que <strong>les</strong><br />
CVD entretiennent avec <strong>les</strong> autorités loca<strong>les</strong> plus particulièrement, et grâce<br />
auxquel<strong>les</strong> ils parviennent à mobiliser <strong>les</strong> villageois <strong>pour</strong> participer aux réunions<br />
et aux travaux communautaires.<br />
5
Quant aux ASF, el<strong>les</strong> n’entretiennent <strong>de</strong>s rapports qu’avec leurs<br />
actionnaires.<br />
2.3. Du répertoire <strong>de</strong>s difficultés rencontrées par <strong>les</strong> différentes instances du<br />
PAGER dans l’exercice <strong>de</strong> leurs activités et <strong>les</strong> approches <strong>de</strong> solution.<br />
2.3.1. Difficultés rencontrées par <strong>les</strong> Cadres du PAGER dans l’exercice <strong>de</strong> leurs<br />
activités et <strong>les</strong> approches <strong>de</strong> solution.<br />
Ici aussi, <strong>les</strong> difficultés sont fonction <strong>de</strong>s préoccupations <strong>de</strong> chaque instance :<br />
ainsi, la Direction du PAGER est préoccupée par <strong>les</strong> difficultés liées à<br />
l’inadéquation existant entre l’objectif principal <strong>de</strong> son institution ( la lutte<br />
contre la pauvreté) et <strong>les</strong> principes cardinaux <strong>de</strong> certaines institutions comme la<br />
FECECAM qui se refuse à faire octroyer du crédit aux populations du Mono<br />
dont la pauvreté est telle qu’el<strong>les</strong> sont <strong>de</strong>s débitrices insolvab<strong>les</strong>. Si <strong>les</strong><br />
difficultés évoquées par le responsable <strong>de</strong> la composante AIB se rapprochent <strong>de</strong>s<br />
précé<strong>de</strong>ntes, parce qu’el<strong>les</strong> ont trait à la faible mobilisation <strong>de</strong> la contrepartie<br />
exigée <strong>de</strong>s bénéficiaires <strong>de</strong>s interventions du Projet, il s’y ajoute la différence <strong>de</strong><br />
compréhension <strong>de</strong> la gestion <strong>de</strong>s affaires publiques.<br />
Les approches <strong>de</strong> solution préconisées sont en adéquation avec <strong>les</strong> problèmes<br />
évoqués : la Direction mène <strong>de</strong>s négociations sans fin <strong>pour</strong> la recherche <strong>de</strong><br />
solutions alternatives, ce qui lui coûte un temps précieux eu égard à ses<br />
obligations <strong>de</strong> résultats, tandis que le responsable <strong>de</strong> la composante AIB propose<br />
qu’<strong>une</strong> formation <strong>de</strong>s agents <strong>de</strong>s CDD et <strong>de</strong>s ONG soit initiée <strong>pour</strong> faire face à<br />
la problématique <strong>de</strong> la mobilisation <strong>de</strong> la contrepartie.<br />
2.3.2. Difficultés rencontrées par <strong>les</strong> CVD dans l’exercice <strong>de</strong> leurs activités et<br />
approches <strong>de</strong> solution.<br />
Les difficultés rencontrées par <strong>les</strong> CVD ont trait :<br />
- à la mobilisation <strong>de</strong> la contrepartie villageoise <strong>pour</strong> <strong>les</strong> réalisations<br />
communautaires, et plus spécifiquement la contrepartie financière,<br />
- au recouvrement <strong>de</strong>s crédits octroyés par <strong>les</strong> ASF,<br />
- à la mobilisation <strong>de</strong>s populations <strong>pour</strong> prendre part aux réunions,<br />
- à la conduite <strong>de</strong>s réunions,<br />
- au manque <strong>de</strong> moyens <strong>pour</strong> faire face aux déplacements liés à leurs activités.<br />
2.3.3. Du répertoire <strong>de</strong>s besoins <strong>de</strong>s CVD.<br />
Bien que <strong>de</strong>s notions <strong>de</strong> base aient été acquises au cours <strong>de</strong>s formations sus<br />
citées, <strong>les</strong> CVD éprouvent <strong>de</strong>s difficultés à la mise en œuvre <strong>de</strong> certaines <strong>de</strong> ces<br />
notions, plus particulièrement cel<strong>les</strong> relatives à la planification <strong>de</strong>s activités <strong>de</strong><br />
6
développement <strong>de</strong> leurs localités respectives. Quoiqu’ils aient évoqué <strong>les</strong><br />
techniques <strong>de</strong> communication parmi <strong>les</strong> thèmes <strong>de</strong> formation dont ils ont<br />
bénéficié, <strong>les</strong> CVD manquent encore <strong>de</strong> ressources en matière d’animation.<br />
2.4. De l’attente <strong>de</strong>s acteurs en matière <strong>de</strong> communication.<br />
C’est à l’unanimité que <strong>les</strong> acteurs, toutes catégories confondues, se sont<br />
déclarés satisfaits <strong>de</strong>s informations qu’ils reçoivent du PAGER et <strong>de</strong> toutes ses<br />
instances à divers niveaux. Les informations qui leur parviennent sont cel<strong>les</strong><br />
relatives aux comptes rendus <strong>de</strong>s réunions <strong>de</strong>s CVD, aux conditions d’octroi et<br />
<strong>de</strong> remboursement <strong>de</strong>s crédits auprès <strong>de</strong>s ASF, à leur participation aux travaux<br />
<strong>de</strong> réalisation d’infrastructures communautaires. Ces informations concernent<br />
aussi <strong>les</strong> avis <strong>de</strong> réunion et <strong>de</strong> formation.<br />
La périodicité avec laquelle leur parviennent ces informations est variable selon<br />
l’instance dont émanent <strong>les</strong> informations : <strong>une</strong> à <strong>de</strong>ux semaines lorsque <strong>les</strong><br />
informations proviennent <strong>de</strong>s CDD, un mois à un trimestre lorsqu’el<strong>les</strong> émanent<br />
du siège du PAGER.<br />
Toutefois, <strong>pour</strong> pallier <strong>les</strong> longs silences, <strong>les</strong> acteurs souhaitent être tenus<br />
informés au moins <strong>une</strong> fois par mois <strong>de</strong>s activités <strong>de</strong>s CVD et <strong>de</strong>s CDD, hormis<br />
<strong>les</strong> cas d’urgence.<br />
2.5. De l’inventaire <strong>de</strong>s moyens <strong>de</strong> communication existants.<br />
Une partie essentielle <strong>de</strong> la planification <strong>de</strong> la communication consiste à établir<br />
un inventaire <strong>de</strong> toutes <strong>les</strong> ressources disponib<strong>les</strong> en communication dans le<br />
milieu, et ceci, du point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong> la quantité, <strong>de</strong> la qualité et <strong>de</strong> l’impact.<br />
Il se dégage <strong>une</strong> constante dans toutes <strong>les</strong> aires culturel<strong>les</strong> quant aux moyens <strong>de</strong><br />
communication utilisés :<br />
- le gong : sorte <strong>de</strong> cloche jumelée ou non, c’est un instrument dont joue le<br />
crieur public à travers <strong>les</strong> différentes concessions du village ou du quartier ;<br />
le timbre du gong attire l’attention. Le crieur public suspend la percussion<br />
<strong>pour</strong> annoncer l’avis qu’il est chargé d’adresser au public.<br />
En tant que moyen <strong>de</strong> communication, le gong ne peut servir à transmettre <strong>de</strong><br />
longs messages. Si l’usage du gong a l’avantage d’être à effet immédiat, la<br />
déformation du message par le crieur public est fréquente.<br />
- L’assemblée villageoise : <strong>les</strong> réunions <strong>de</strong> quartier ou <strong>de</strong> village sont <strong>de</strong>s<br />
moyens courants <strong>de</strong> communication <strong>de</strong>stinés au maximum <strong>de</strong>s habitants,<br />
mais qui, à la différence du gong, portent <strong>sur</strong> un ou <strong>de</strong>s sujets dont la<br />
transmission est longue et nécessite dialogue, discussions, débats <strong>pour</strong> la<br />
7
prise d’<strong>une</strong> résolution et l’engagement d’<strong>une</strong> action collective. La tenue <strong>de</strong>s<br />
assemblées villageoises est généralement précédée <strong>de</strong> l’appel du crieur public<br />
usant du gong.<br />
- Le « bouche à oreille » : il paraît le plus couramment utilisé, mais comporte<br />
un risque certain <strong>de</strong> déformation <strong>de</strong> l’information ou du message.<br />
- Le tam-tam : l’usage du tam-tam selon un rythme bien défini annonce<br />
généralement <strong>une</strong> mauvaise nouvelle (décès, sinistre) dans l’aire culturelle<br />
Fon.<br />
- La convocation ou le message écrit : il est utilisé le plus souvent par le<br />
siège et <strong>les</strong> CDD <strong>pour</strong> l’invitation à <strong>de</strong>s séances <strong>de</strong> travail ou <strong>pour</strong> prévenir<br />
<strong>les</strong> partenaires d’<strong>une</strong> visite imminente.<br />
Le téléphone : Cité par <strong>les</strong> responsab<strong>les</strong> du Siège, <strong>de</strong>s CDD et <strong>de</strong>s ASF, le<br />
téléphone est utilisé <strong>pour</strong> transmettre <strong>de</strong>s messages urgents en direction <strong>de</strong>s<br />
différentes instances.<br />
Selon <strong>les</strong> circonstances, d’autres canaux sont utilisés par <strong>les</strong> institutionnels dans<br />
le cadre <strong>de</strong> leurs activités :<br />
La vidéo : elle a été citée par certains acteurs qui en ont fait l’expérience lors <strong>de</strong><br />
la présentation d’un documentaire <strong>sur</strong> le PAGER.<br />
Le diapo-langage : consistant à la projection d’images diapositives que <strong>les</strong><br />
populations commentent, elle a été citée par le responsable AIB.<br />
- La musique traditionnelle : <strong>les</strong> chansons en langues loca<strong>les</strong> accompagnées<br />
d’instruments divers est un puissant moyen <strong>de</strong> communication. Les ve<strong>de</strong>ttes<br />
traditionnel<strong>les</strong> <strong>de</strong> la chanson véhiculent <strong>de</strong>s messages qui ont un impact<br />
certain <strong>sur</strong> <strong>les</strong> populations, car el<strong>les</strong> usent <strong>de</strong> préceptes, <strong>de</strong> proverbes et <strong>de</strong><br />
bien d’autres co<strong>de</strong>s propres au terroir, et qui ont <strong>de</strong>s effets mobilisateurs,<br />
instructifs, voire éducatifs. Dix (10) à quinze (15) rythmes variés se<br />
retrouvent à travers la zone d’intervention du PAGER. Leur manifestation a<br />
toujours été l’objet d’attroupements.<br />
- Les groupes sociaux constitués : Ce sont <strong>de</strong>s confessions religieuses, toutes<br />
tendances confondues : <strong>de</strong>s animistes aux religions révélées, ce sont aussi <strong>les</strong><br />
diverses associations loca<strong>les</strong> : amica<strong>les</strong>, organisation <strong>de</strong> femmes, <strong>de</strong> je<strong>une</strong>s,<br />
etc.<br />
8
- Les élus locaux et <strong>les</strong> lea<strong>de</strong>rs d’opinion : <strong>les</strong> premiers sont <strong>les</strong> maires, <strong>les</strong><br />
délégués (chefs <strong>de</strong> villages) ; <strong>les</strong> seconds sont en général <strong>les</strong> responsab<strong>les</strong> <strong>de</strong>s<br />
groupes sociaux constitués : vecteurs ou relais à l’information, se sont<br />
souvent <strong>de</strong>s partenaires efficaces <strong>pour</strong> faire accepter aux populations <strong>de</strong>s<br />
décisions ou <strong>de</strong>s choix qui ne garantissent pas d’avance l’adhésion <strong>de</strong> ces<br />
<strong>de</strong>rnières. Les ONG, <strong>les</strong> services d’Etat et d’autres partenaires au<br />
développement <strong>les</strong> utilisent souvent.<br />
- Les visites croisés entre CVD : <strong>les</strong> CVD apprécient hautement <strong>les</strong> visites<br />
qu’ils ont effectuées auprès <strong>de</strong> leurs homologues <strong>de</strong>s villages voisins ;<br />
l’i<strong>de</strong>ntité <strong>de</strong>s problèmes et <strong>les</strong> échanges d’expériences ont permis à nombre<br />
d’entre eux <strong>de</strong> se conforter <strong>de</strong> leurs réussites, et à d’autres <strong>de</strong> se sentir plus<br />
solidaires. Toutefois, <strong>les</strong> CVD n’ayant pas eu l’opportunité d’en visiter<br />
d’autres, souhaitent vivement le faire, alors que ceux qui en ont fait<br />
l’expérience souhaitent d’autres excursions <strong>pour</strong> enrichir leur expérience.<br />
Certaines institutions servent el<strong>les</strong>-mêmes <strong>de</strong> vecteurs d’information :<br />
- La radio locale : citée par <strong>les</strong> populations <strong>de</strong> Dhodho, <strong>de</strong> Djidja, <strong>de</strong> Lobogo,<br />
Zoungbomey et d’Abadago, il ne fait aucun doute que la prolifération <strong>de</strong> la radio<br />
<strong>de</strong> proximité est un canal privilégié <strong>pour</strong> toucher au même moment le plus grand<br />
nombre <strong>de</strong> personnes.<br />
- Le théâtre populaire : <strong>les</strong> sketches et autres pièces <strong>de</strong> théâtre en langues<br />
loca<strong>les</strong>, agrémentés <strong>de</strong> ballets ou du folklore du terroir sont très appréciés <strong>de</strong>s<br />
populations dont la quasi totalité <strong>de</strong>s villages abritent <strong>de</strong>s troupes <strong>de</strong> théâtre<br />
créées par <strong>de</strong>s religieux ou <strong>de</strong>s je<strong>une</strong>s, et qui sont mises à contribution par<br />
diverses institutions <strong>pour</strong> faire passer <strong>de</strong>s messages. A l’instar <strong>de</strong> la musique<br />
traditionnelle, le théâtre informe, éduque en même temps qu’il divertit.<br />
- Le matériel imprimé : <strong>les</strong> affiches, bulletins, dépliants ne sont pas d’un<br />
accès aisé <strong>pour</strong> <strong>de</strong>s populations en majorité analphabètes. Toutefois, <strong>les</strong><br />
affiches collées <strong>sur</strong> <strong>les</strong> murs ou clouées <strong>sur</strong> <strong>les</strong> troncs <strong>de</strong>s arbres <strong>de</strong>s places<br />
publiques suscitent la curiosité <strong>de</strong> ceux qui ne savent pas lire, même en leur<br />
propre langue, mais qui sollicitent <strong>les</strong> explications <strong>de</strong> ceux qui y ont accès.<br />
2.6. De la proposition <strong>de</strong>s moyens <strong>de</strong> communication <strong>les</strong> mieux adaptés.<br />
Des moyens <strong>de</strong> communication existant dans <strong>les</strong> localités d’intervention du<br />
PAGER, la préférence <strong>de</strong>s différents groupes interrogés s’est porté <strong>sur</strong> :<br />
- Le gong : son caractère pratique le situe en première position <strong>de</strong> tous <strong>les</strong><br />
moyens <strong>de</strong> communication utilisés dans toutes <strong>les</strong> aires culturel<strong>les</strong>.<br />
9
- L’assemblée villageoise : elle est reconnue comme l’un <strong>de</strong>s moyens <strong>les</strong><br />
plus efficaces <strong>de</strong> communication aussi bien par <strong>les</strong> autorités loca<strong>les</strong> que par<br />
<strong>les</strong> CVD, <strong>les</strong> ASF et <strong>les</strong> personnes ressources, et <strong>pour</strong> cause : elle permet le<br />
contact physique, donne l’occasion <strong>de</strong> discuter, <strong>de</strong> débattre et d’as<strong>sur</strong>er le<br />
feed back. Si l’efficacité <strong>de</strong> l’assemblée villageoise fait l’unanimité <strong>de</strong>s<br />
différents acteurs, ces <strong>de</strong>rniers n’en regrettent pas moins <strong>les</strong> contraintes qui<br />
lui sont parfois inhérentes : la mobilisation <strong>de</strong>s populations.<br />
- Le message porté : il est préféré plus par <strong>les</strong> membres <strong>de</strong>s CVD et <strong>de</strong>s<br />
autorités loca<strong>les</strong> <strong>pour</strong> diverses raisons : la précision du message est<br />
garantie, l’oubli évité, et le membre du CVD qui le reçoit éprouve <strong>de</strong> la<br />
fierté qu’un message écrit lui soit adressé.<br />
- Les visites croisées entre CVD : el<strong>les</strong> ont été très appréciées <strong>de</strong>s membres<br />
<strong>de</strong> CVD. Il serait souhaitable que <strong>de</strong> tel<strong>les</strong> initiatives soient <strong>pour</strong>suivies.<br />
- La radio locale : bien que n’existant pas dans <strong>les</strong> villages couverts par<br />
l’enquête, <strong>les</strong> radios <strong>de</strong> proximité qui émettent en langues loca<strong>les</strong> sont très<br />
écoutées <strong>de</strong>s populations et pratiquement plébiscitées par <strong>les</strong> populations<br />
<strong>pour</strong> leur capacité à porter <strong>les</strong> informations jusque dans <strong>les</strong> hameaux <strong>les</strong><br />
plus reculés.<br />
- Le théâtre populaire : Tel que présenté, il fait l’unanimité <strong>de</strong>s différentes<br />
catégories interviwées, bien que <strong>les</strong> institutionnels émettent <strong>de</strong>s réserves<br />
quant à la fréquence <strong>de</strong> son utilisation, en raison <strong>de</strong>s contraintes qui lui sont<br />
inhérentes (déplacement <strong>de</strong> la troupe là où il n’y en a pas, conception et mise<br />
en œuvre du scénario entre autres).<br />
- La cassette audio : la plupart <strong>de</strong>s ménages ruraux disposent <strong>de</strong> radiocassettes<br />
; l’écoute d’enregistrements <strong>de</strong> débats publics, <strong>de</strong> musique<br />
traditionnelle, <strong>de</strong> pièces <strong>de</strong> théâtre ou <strong>de</strong> sketches <strong>sur</strong> <strong>de</strong>s sujets touchant <strong>de</strong><br />
près <strong>les</strong> populations fait <strong>de</strong> la cassette audio un support <strong>de</strong> communication au<br />
nombre <strong>de</strong> ceux préférés en matière <strong>de</strong> média.<br />
10
3. Supports <strong>de</strong> communication et approche participative.<br />
3.1.Stratégie <strong>de</strong> mise en œuvre.<br />
Pour tirer le meilleur parti <strong>de</strong> tous <strong>les</strong> moyens <strong>de</strong> communication inventoriés, il<br />
convient d’envisager leur utilisation optimum à travers <strong>une</strong> stratégie.<br />
3.2.Stratégie globale<br />
La stratégie globale consiste à utiliser <strong>les</strong> divers moyens <strong>de</strong> communication <strong>de</strong><br />
façon à garantir la permanence <strong>de</strong> l’information dans la zone<br />
d’intervention du PAGER. Pour ce faire, il s’agira <strong>de</strong> créer <strong>une</strong> articulation<br />
entre <strong>les</strong> différents moyens <strong>de</strong> communication tout en diversifiant la forme ou le<br />
style <strong>de</strong> transmission du message.<br />
Pour <strong>les</strong> localités bénéficiant <strong>de</strong> l’utilisation <strong>de</strong> plusieurs canaux ou supports <strong>de</strong><br />
communication, il s’agira d’adapter le message aux canaux que l’on compte<br />
mettre à contribution : ainsi, <strong>une</strong> information thématique relative aux critères <strong>de</strong><br />
choix ou <strong>de</strong> localisation d’<strong>une</strong> infrastructure peut passer par un média <strong>de</strong> masse<br />
comme la radio.<br />
Toujours par ce même canal, <strong>une</strong> émission présentée sous forme <strong>de</strong> dialogue<br />
ou <strong>de</strong> joute oratoire (question/réponse) permettra <strong>de</strong> mieux saisir<br />
l’information.<br />
Présentée sous forme d’émission publique à partir d’un témoignage suivi d’un<br />
débat public, la transmission du message permettra d’en recueillir le feed<br />
back.<br />
Enregistrée <strong>sur</strong> cassette audio, elle <strong>pour</strong>rait être réécoutée, en attendant la<br />
préparation d’<strong>une</strong> autre émission.<br />
De même, la composition d’<strong>une</strong> chanson <strong>sur</strong> un thème et son enregistrement <strong>sur</strong><br />
cassette audio peut être jouée <strong>sur</strong> la place publique ou le jour du marché.<br />
La troupe théâtrale peut présenter le thème sous forme <strong>de</strong> sketches, dont la<br />
radio <strong>pour</strong>rait diffuser un extrait en introduction à <strong>une</strong> table ron<strong>de</strong> ou à un<br />
débat public.<br />
L’affiche peut schématiser le message sous forme d’appel à la solidarité ou <strong>de</strong><br />
mobilisation en faveur <strong>de</strong> la résolution d’un problème qui n’exclue personne, ni<br />
aucun village.<br />
La radio, avec <strong>les</strong> spots à son tour peut reprendre le contenu d’<strong>une</strong> affiche <strong>de</strong><br />
façon lapidaire.<br />
11
Cette stratégie globale peut se renouveler avec d’autres thèmes, sans compter<br />
que la rediffusion <strong>de</strong> certains messages n’est pas <strong>de</strong> trop, lorsqu’on s’aperçoit<br />
qu’après un certain temps, certaines situations l’exigent.<br />
3.3.Stratégies spécifiques<br />
Dans le cas spécifique <strong>de</strong>s localités ou <strong>de</strong>s aires culturel<strong>les</strong> hors <strong>de</strong> portée <strong>de</strong> la<br />
radio, la cassette audio peut remplacer la radio, bien que l’écoute publique<br />
soit limitée à un nombre plus restreint d’auditeurs.<br />
Au contraire <strong>de</strong> la radio, la réécoute du message permet <strong>de</strong> mieux le fixer.<br />
Aussi, prendra-t-on la précaution d’obtenir <strong>une</strong> cassette <strong>de</strong> chaque émission<br />
radiodiffusée à l’usage <strong>de</strong>s écoutes publiques.<br />
Le déplacement <strong>de</strong>s techniciens <strong>de</strong> la radio vers <strong>les</strong> populations <strong>pour</strong><br />
l’enregistrement d’émissions publiques écoutées par la suite <strong>sur</strong> cassette audio<br />
est à encourager.<br />
12
4. Plan <strong>de</strong> communication par catégories d’acteurs du développement<br />
local.<br />
Les plans <strong>de</strong> communication ci-après proposés sont élaborés en tenant aussi bien<br />
compte <strong>de</strong>s résultats <strong>de</strong>s enquêtes par aire culturelle que <strong>de</strong>s souhaits <strong>de</strong>s<br />
différents groupes d’acteurs. Le cadre <strong>de</strong> conception du plan <strong>de</strong> communication<br />
est constitué <strong>de</strong>s principaux éléments suivants :<br />
- Type <strong>de</strong> message : il s’agit <strong>de</strong> déterminer la nature <strong>de</strong>s messages qui sont<br />
susceptib<strong>les</strong> d’être transmis aux populations, selon <strong>les</strong> objectifs <strong>de</strong>s<br />
informations <strong>de</strong> mobilisation ou autres qui sont visés.<br />
- Média à utiliser : à la nature du message et à l’objectif visé, correspond le<br />
ou <strong>les</strong> médias à utiliser : média <strong>de</strong> masse ou média <strong>de</strong> proximité . Toujours<br />
est-il qu’aucun média ne se suffit à lui tout seul<br />
.<br />
- Canaux à utiliser : <strong>pour</strong> transmettre un message, un canal est nécessaire. Le<br />
canal est le support <strong>de</strong> communication. La radio et la télévision sont par<br />
exemple <strong>les</strong> canaux utilisés par <strong>les</strong> média <strong>de</strong> masse. Il existe <strong>de</strong>s canaux <strong>pour</strong><br />
<strong>les</strong> média <strong>de</strong> proximité, tels que la vidéo.<br />
- Pour mener à bien <strong>une</strong> activité <strong>de</strong> communication, il convient <strong>de</strong> savoir<br />
comment utiliser <strong>les</strong> canaux et à quel moment <strong>les</strong> utiliser.<br />
4.1.Plan <strong>de</strong> communication <strong>pour</strong> <strong>les</strong> membres <strong>de</strong>s CVD.<br />
En ce qui concerne <strong>les</strong> membres <strong>de</strong>s CVD :<br />
• <strong>les</strong> avis <strong>de</strong> réunion, d’invitation ou <strong>de</strong> visite <strong>pour</strong>ront emprunter <strong>les</strong><br />
messages écrits, le téléphone ou le « bouche à oreille », le téléphone étant<br />
comme d’habitu<strong>de</strong> réservé aux cas d’urgence.<br />
• Les formations et <strong>les</strong> besoins <strong>de</strong> concertation auront recours aux réunionsdiscussions,<br />
avec au besoin <strong>de</strong>s supports tels que <strong>les</strong> images diapositives,<br />
la vidéo, la boîte à images, bref, <strong>de</strong>s supports réservés <strong>pour</strong> <strong>les</strong> groupes<br />
restreints.<br />
Il conviendrait <strong>de</strong> souligner qu’il faut éviter autant que possible d’utiliser<br />
<strong>les</strong> média <strong>de</strong> masse <strong>pour</strong> s’adresser aux membres <strong>de</strong>s CVD qui <strong>de</strong>vraient<br />
avoir la primeur <strong>de</strong>s informations qui <strong>les</strong> intéressent en priorité.<br />
13
4.2. Plan <strong>de</strong> communication <strong>pour</strong> <strong>les</strong> populations.<br />
Les mass média et <strong>les</strong> média <strong>de</strong> proximité intéressent plus particulièrement <strong>les</strong><br />
populations.<br />
Le type <strong>de</strong> message à adresser aux populations concernera <strong>les</strong> informations<br />
généra<strong>les</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> activités que mène le PAGER dans sa zone d’intervention, <strong>les</strong><br />
informations thématiques, <strong>les</strong> témoignages, <strong>les</strong> opportunités qu’offre le PAGER,<br />
le mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong>s équipements et <strong>de</strong>s infrastructures communautaires.<br />
Les canaux à utiliser ici peuvent être la radio, la musique traditionnelle,<br />
l’assemblée villageoise, la cassette audio, le théâtre populaire.<br />
Le mo<strong>de</strong> d’utilisation peut être l’écoute publique, <strong>les</strong> interviews, l’exposition <strong>sur</strong><br />
<strong>les</strong> places publiques selon <strong>les</strong> cas.<br />
Les moments d’utilisation <strong>de</strong> ces moyens sont à choisir : <strong>de</strong> préférence <strong>les</strong> soirs,<br />
<strong>les</strong> jours <strong>de</strong> marché, <strong>les</strong> saisons mortes <strong>de</strong> campagne agricole, etc., en tout<br />
cas, <strong>les</strong> moments <strong>de</strong> grands rassemblements ou <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> écoute.<br />
14
5. Caractéristiques <strong>de</strong>s canaux et complémentarités<br />
L’utilisation <strong>de</strong> tel ou tel canal <strong>pour</strong> transmettre <strong>de</strong>s messages aux populations<br />
n’est pas innocente : elle est fonction <strong>de</strong> l’objectif visé, <strong>de</strong>s réactions<br />
attendues <strong>de</strong> la part <strong>de</strong>s promoteurs <strong>de</strong> la communication <strong>pour</strong> le<br />
développement.<br />
5.1.Caractéristiques <strong>de</strong>s canaux et dispositifs <strong>de</strong> communication.<br />
A chaque canal correspond un dispositif <strong>pour</strong> le rendre opérationnel.<br />
5.1.1. La radio.<br />
La radio est un canal excellent <strong>pour</strong> attirer l’attention <strong>sur</strong> <strong>les</strong> idées et <strong>les</strong><br />
techniques nouvel<strong>les</strong>.<br />
Avantages<br />
• ce canal a l’avantage <strong>de</strong> toucher à la fois un public plus nombreux en<br />
même temps et en tout lieu, selon la puissance <strong>de</strong> l’émetteur. Il couvre<br />
largement <strong>les</strong> zones rura<strong>les</strong> et est d’accès facile.<br />
• <strong>les</strong> stations <strong>de</strong> radio loca<strong>les</strong> facilitent l’information localisée.<br />
• la production et la réception sont peu coûteuses en rapport avec d’autres<br />
média <strong>de</strong> masse comme la télévision.<br />
• la production d’émissions est relativement simple, et peut être conçue<br />
selon le génie <strong>de</strong>s populations auxquel<strong>les</strong> il s’adapte aisément<br />
• <strong>les</strong> émissions <strong>de</strong> radio ont <strong>pour</strong> effet psychologique <strong>de</strong> valoriser <strong>les</strong><br />
populations.<br />
Inconvénients<br />
- ce canal se révèle faible <strong>pour</strong> la formation et l’éducation, car il est<br />
uniquement auditif.<br />
Dispositif <strong>de</strong> communication<br />
Le dispositif <strong>de</strong> communication par la radio dans le cadre <strong>de</strong>s activités du<br />
PAGER se présente comme suit :<br />
- Le Projet, ses CDD , ses ASF et ses CVD se rencontrent <strong>pour</strong> concevoir et<br />
programmer l’enregistrement <strong>de</strong>s thèmes choisis et leur diffusion.<br />
15
- La radio intervient techniquement <strong>sur</strong> le terrain ou en studio selon <strong>les</strong> cas.<br />
Des contraintes d’ordre techniques peuvent amener à <strong>de</strong>s modifications :<br />
contraintes <strong>de</strong> temps d’antenne ou <strong>de</strong> montage éventuellement.<br />
- Les représentants <strong>de</strong>s populations : relais à l’information, ce sont <strong>les</strong><br />
mobilisateurs et <strong>les</strong> animateurs <strong>de</strong>s acteurs villageois. Ils peuvent apporter<br />
<strong>une</strong> contribution considérable dans la mise en œuvre <strong>de</strong> la communication<br />
par la radio qui passionne également <strong>les</strong> populations<br />
- Les populations : <strong>de</strong>stinataires <strong>de</strong>s messages et <strong>de</strong>s informations, <strong>les</strong><br />
populations ont toujours été sensib<strong>les</strong> aux émissions radiodiffusées<br />
développant <strong>de</strong>s sujets <strong>les</strong> touchant <strong>de</strong> près, et davantage sensib<strong>les</strong><br />
lorsqu’el<strong>les</strong> reconnaissent <strong>les</strong> leurs qui interviennent, ou se reconnaissent<br />
à travers eux.<br />
Feed-back<br />
Schéma du dispositif <strong>de</strong> la communication par radio<br />
Projet<br />
Radio<br />
Populations<br />
AIB+CDD+ASF<br />
Conception<br />
Représentant <strong>de</strong>s populations<br />
La radio est en général un canal <strong>de</strong> transmission à sens unique <strong>de</strong>s messages.<br />
Toutefois, <strong>de</strong>s émissions enregistrant <strong>les</strong> opinions et <strong>les</strong> réactions <strong>de</strong>s<br />
populations peuvent servir <strong>de</strong> feed back.<br />
5.1.2. La vidéo<br />
La vidéo est <strong>de</strong>venue <strong>pour</strong> beaucoup le média par excellence. C’est en effet un<br />
média très efficace, mais qui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>une</strong> stratégie bien étudiée et <strong>de</strong>s<br />
producteurs qualifiés.<br />
Avantages<br />
C’est un média très persuasif, car il a l’avantage d’associer le son et l’image<br />
• L’enregistrement électronique image/son permet <strong>une</strong> réécoute immédiate,<br />
d’où <strong>une</strong> soup<strong>les</strong>se <strong>de</strong> production.<br />
16
• Il s’offre <strong>de</strong>s possibilités d’enregistrer <strong>de</strong>s commentaires en plusieurs<br />
langues <strong>sur</strong> <strong>une</strong> même ban<strong>de</strong>.<br />
• Les progrès constants <strong>de</strong> la technologie font baisser <strong>les</strong> coûts et<br />
améliorent la fiabilité du matériel.<br />
Inconvénients<br />
• La production <strong>de</strong> programmes <strong>pour</strong> le développement nécessite du talent,<br />
<strong>de</strong> l’expérience en la matière.<br />
• Les conditions <strong>de</strong> déplacement (transport) <strong>de</strong> l’équipement peuvent être<br />
diffici<strong>les</strong> en zones rura<strong>les</strong> enclavées.<br />
5.1.3. La musique traditionnelle.<br />
Schéma du dispositif <strong>de</strong> communication vidéo.<br />
Projet<br />
Techniciens<br />
Populations<br />
AIB+CDD+ASF<br />
Conception<br />
Mise en oeuvre<br />
Témoignages - réalisations<br />
C’est un moyen <strong>de</strong> communication traditionnel dont l’utilisation créative dans<br />
<strong>les</strong> localités où il est resté populaire et puissant constitue un canal subtile et<br />
efficace <strong>pour</strong> introduire <strong>de</strong>s idées et <strong>de</strong>s messages <strong>de</strong> développement.<br />
Ses avantages<br />
• la chanson traditionnelle divertit ;<br />
• elle véhicule <strong>de</strong>s messages instructifs, éducatifs ;<br />
• jouée en direct, elle rassemble <strong>les</strong> populations ;<br />
• enregistrée <strong>sur</strong> cassette audio, elle intègre <strong>les</strong> foyers. Réécoutée, elle est<br />
fredonnée, et la compréhension <strong>de</strong> son sens profond pousse à l’action<br />
ou au changement <strong>de</strong> comportement ;<br />
• diffusée à la radio, elle traverse <strong>les</strong> frontières du territoire et valorise<br />
son terroir <strong>de</strong> provenance ;<br />
• sa production est d’un coût peu élevé.<br />
17
Ses inconvénients<br />
Il faut souvent <strong>une</strong> gran<strong>de</strong> habileté <strong>pour</strong> intégrer <strong>les</strong> messages <strong>de</strong> développement<br />
à ce genre <strong>de</strong> média traditionnel. Toujours est-il qu’il faut savoir doser<br />
divertissement et développement avec adresse, afin que le second ne porte<br />
pas préjudice au premier.<br />
5.1.4. Le théâtre populaire.<br />
Dispositif <strong>de</strong> communication / musique traditionnelle<br />
Projet<br />
AIB+CDD+ASF<br />
Choix <strong>de</strong>s thèmes<br />
Ve<strong>de</strong>ttes <strong>de</strong> la chanson<br />
Enregistrements<br />
Duplication<br />
Radio<br />
Population<br />
Population<br />
Population<br />
(Production en série)<br />
Comme la chanson traditionnelle, le théâtre populaire est un moyen <strong>de</strong><br />
communication traditionnel dont l’utilisation créative dans <strong>les</strong> localités où il est<br />
resté populaire et puissant constitue un canal subtile et efficace <strong>pour</strong> introduire<br />
<strong>de</strong>s idées et <strong>de</strong>s messages <strong>de</strong> développement.<br />
18
Son utilisation<br />
Le théâtre, dans sa forme classique, est un canal <strong>de</strong> transmission aux fins <strong>de</strong><br />
développement impliquant <strong>les</strong> spectateurs qui interviennent <strong>pour</strong> donner<br />
leur point <strong>de</strong> vue, discuter d’un sujet à <strong>une</strong> étape <strong>de</strong> la présentation <strong>de</strong> la<br />
pièce. Ce qui nécessite un esprit d’à propos, sinon, c’est à la fin <strong>de</strong> la pièce que<br />
<strong>les</strong> spectateurs engagent <strong>les</strong> débats <strong>sur</strong> <strong>les</strong> thèmes abordés, ce qui constitue un<br />
feed back recueilli à chaud.<br />
Ses avantages :<br />
• le théâtre divertit en même temps qu’il instruit grâce aux messages<br />
présentés sous forme <strong>de</strong> fiction.<br />
• le nombre <strong>de</strong> personnes touchées à la fois est relativement important à<br />
l’échelle du village ; <strong>une</strong> estimation du public atteint peut s’effectuer dans<br />
le cadre du suivi <strong>de</strong>s activités <strong>de</strong> communication.<br />
• le moyen est aussi bien auditif que visuel, donc persuasif ;<br />
• le feed back peut être as<strong>sur</strong>é.<br />
Ses inconvénients :<br />
• Ici aussi, il faut <strong>une</strong> gran<strong>de</strong> adresse <strong>pour</strong> intégrer <strong>les</strong> messages <strong>de</strong><br />
développement à ce média traditionnel ;<br />
• il peut être difficile à organiser, et <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong>s relations <strong>de</strong> travail<br />
étroites entre la structure d’appui au développement et <strong>les</strong> artistes <strong>de</strong><br />
tradition populaire ;<br />
• il peut être aussi difficile <strong>de</strong> déplacer la troupe dans un certain nombre <strong>de</strong><br />
villages <strong>pour</strong> mieux véhiculer le message.<br />
Dispositif <strong>de</strong> communication <strong>pour</strong> théâtre populaire<br />
Feed-back<br />
Projet<br />
AIB+CDD+ASF<br />
Conception<br />
Troupe théâtrale<br />
Populations<br />
19
5.1.5. La cassette audio.<br />
Appelée encore « cassette sonore », la cassette audio est <strong>de</strong> nos jours d’un usage<br />
très courant dans <strong>les</strong> milieux ruraux .<br />
L’utilisation <strong>de</strong> la cassette audio comme canal d’information ou <strong>de</strong> transmission<br />
<strong>de</strong> messages présente plus d’avantages que d’inconvénients.<br />
Avantages<br />
• la production <strong>de</strong>s programmes est facile et peu coûteuse ;<br />
• <strong>les</strong> lecteurs <strong>de</strong> cassettes sont facilement disponib<strong>les</strong><br />
• la localisation <strong>de</strong> l’information est simple ;<br />
• elle favorise l’information <strong>de</strong> retour, car <strong>les</strong> ruraux peuvent enregistrer<br />
leurs questions/réaction ;<br />
• elle peut être utilisée en liaison avec la radio locale.<br />
Inconvénients<br />
C’est un moyen uniquement auditif, qui souffre <strong>de</strong>s mêmes faib<strong>les</strong>ses que la<br />
radio, bien qu’<strong>une</strong> écoute répétitive puisse y remédier.<br />
En somme, la cassette audio est un très bon moyen peu coûteux. Il est<br />
regrettable que son potentiel ne soit pas encore reconnu.<br />
Il est particulièrement utile en liaison avec la vulgarisation et la radio locale.<br />
Feed-back<br />
5.1.6. Les affiches.<br />
Dispositif <strong>de</strong> communication <strong>pour</strong> cassette audio<br />
Projet<br />
Population<br />
AIB+CDD+ASF<br />
Enregistrement<br />
Les affiches bien conçues et bien rédigées à l’intention <strong>de</strong>s populations rura<strong>les</strong><br />
peuvent constituer <strong>une</strong> source <strong>de</strong> référence essentielle et peu coûteuse <strong>pour</strong> <strong>les</strong><br />
animateurs et <strong>pour</strong> ceux qui savent lire et écrire dans <strong>les</strong> zones rura<strong>les</strong>.<br />
20
Avantages<br />
De production assez bon marché, elle est facile et simple à utiliser.<br />
Inconvénients<br />
Son utilisation est très limitée auprès <strong>de</strong>s ruraux analphabètes. Cependant, il<br />
faut penser au niveau d’alphabétisation villageoise ou familiale, et non à<br />
celui du paysan isolé.<br />
5.1.7. La réunion/discussion.<br />
Assez éprouvée, la réunion / discussion est entre agents et populations, ou entre<br />
représentants <strong>de</strong>s populations et ces <strong>de</strong>rnières, un <strong>de</strong>s moyens <strong>de</strong><br />
communication <strong>les</strong> plus efficaces en matière d’appui à l’autopromotion.<br />
Avantages<br />
• <strong>les</strong> réunions/discussions permettent un contact direct entre<br />
interlocuteurs ;<br />
• el<strong>les</strong> donnent la possibilité <strong>de</strong> recueillir le feed back ;<br />
• el<strong>les</strong> ouvrent <strong>les</strong> possibilités d’aboutir à un consensus ;<br />
• el<strong>les</strong> sont peu coûteuses : ne nécessitent que déplacement, et à la limite,<br />
la restauration.<br />
Inconvénients<br />
• En raison <strong>de</strong> la sollicitu<strong>de</strong> d’autres institutions qui opèrent <strong>sur</strong> le même<br />
territoire, la fréquence <strong>de</strong>s réunions finit par lasser <strong>les</strong> populations qui<br />
parfois s’y dérobent ;<br />
• La tenue <strong>de</strong> réunions/débats en pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> forte presse <strong>de</strong>s activités<br />
agrico<strong>les</strong> a peu <strong>de</strong> chances <strong>de</strong> trouver un écho favorable auprès <strong>de</strong>s<br />
populations rura<strong>les</strong>.<br />
21
Feed-back<br />
5.1.8. Le diapo-langage<br />
Dispositif <strong>de</strong> communication <strong>pour</strong> <strong>les</strong> réunions<br />
Projet<br />
AIB+CDD+ASF<br />
Représentants <strong>de</strong>s populations<br />
Populations<br />
Le diapo-langage est la projection <strong>de</strong> quelques diapositives commentées par <strong>les</strong><br />
ruraux eux-mêmes.<br />
Les diapositives sont réalisées dans le milieu habituel <strong>de</strong>s populations, et<br />
représentent <strong>de</strong>s situations riches en informations susceptib<strong>les</strong> <strong>de</strong><br />
provoquer <strong>de</strong>s débats pouvant aboutir à <strong>de</strong>s prises <strong>de</strong> décisions.<br />
Le nombre <strong>de</strong> diapositives est toujours limité à 5 ou 6.<br />
Dispositif <strong>de</strong> communication <strong>pour</strong> le diapo-langage<br />
Feed-back<br />
5.2.Complémentarité entre canaux<br />
Projet<br />
Populations<br />
AIB+CDD+ASF<br />
Aucun média n’est en soi meilleur que <strong>les</strong> autres à tous points <strong>de</strong> vue, au point<br />
<strong>de</strong> se suffire à lui tout seul. Une mise en œuvre efficace par l’utilisation<br />
optimum <strong>de</strong>s moyens <strong>de</strong> communication passés en revue s’obtiendra en tirant<br />
avantage <strong>de</strong> la complémentarité qui peut s’établir entre eux.<br />
22
5.2.1. La radio et la musique traditionnelle.<br />
Si <strong>les</strong> émissions <strong>de</strong> radio sont entrecoupées <strong>de</strong> pauses musica<strong>les</strong> <strong>pour</strong> rendre plus<br />
aisée le suivi <strong>de</strong>s informations, la musique traditionnelle passe par la radio<br />
<strong>pour</strong> se faire entendre hors <strong>de</strong>s frontières du village, selon <strong>une</strong> périodicité<br />
que ne peut soutenir le groupe musical.<br />
En termes <strong>de</strong> mise en œuvre d’activités <strong>de</strong> communication <strong>pour</strong> le<br />
développement, l’effet <strong>de</strong> l’utilisation <strong>de</strong> la musique traditionnelle <strong>pour</strong><br />
véhiculer <strong>les</strong> messages est décuplé lorsque la musique se sert <strong>de</strong> la radio<br />
comme véhicule.<br />
5.2.2. La radio et le théâtre populaire.<br />
S’il est reconnu que le théâtre populaire permet <strong>de</strong> transmettre <strong>de</strong>s messages à<br />
un public déterminé, l’enregistrement et la diffusion <strong>de</strong> la pièce ou du sketch<br />
démultipliera le public atteint, même si ce public y perd l‘image <strong>de</strong>s gestes et<br />
<strong>de</strong>s mimiques.<br />
5.2.3. La radio et la cassette audio<br />
Si la radiodiffusion d’<strong>une</strong> information touche à la fois un public nombreux, le<br />
message, <strong>une</strong> fois passé, est irrécupérable <strong>pour</strong> l’auditeur. La cassette audio<br />
y supplée en donnant la possibilité <strong>de</strong> répéter à volonté le message enregistré à<br />
la radio.<br />
5.2.4. Le théâtre populaire et la musique traditionnelle.<br />
Il est <strong>de</strong> plus en plus noté que <strong>les</strong> ve<strong>de</strong>ttes <strong>de</strong> la chanson traditionnelle<br />
introduisent <strong>les</strong> morceaux par un dialogue plus ou moins long. La leçon tirée du<br />
dialogue sert <strong>de</strong> prétexte ou d’introduction <strong>pour</strong> développer le ou <strong>les</strong><br />
thèmes véhiculés par la chanson.<br />
5.2.5. Le bulletin <strong>de</strong> liaison<br />
Le bulletin <strong>de</strong> liaison est un bimestriel ou un trimestriel d’information <strong>sur</strong> <strong>les</strong><br />
activités menées par le PAGER pendant la pério<strong>de</strong> correspondant au rythme <strong>de</strong><br />
parution du bulletin.<br />
Le bulletin <strong>de</strong> liaison, d’<strong>une</strong> vingtaine <strong>de</strong> pages <strong>pour</strong>rait, à titre indicatif,<br />
contenir <strong>les</strong> rubriques ci-après :<br />
23
- un éditorial analysant et commentant <strong>les</strong> activités menées et <strong>les</strong> faits<br />
marquants enregistrés <strong>sur</strong> <strong>les</strong> différentes zones d’intervention du PAGER.<br />
La réflexion, en rapport avec la philosophie, <strong>les</strong> principes, la démarche et <strong>les</strong><br />
objectifs du Généraux du PAGER ,<strong>pour</strong>rait servir d’introduction aux divers<br />
artic<strong>les</strong> <strong>de</strong>s numéraux.<br />
De la conception à la distribution du bulletin <strong>de</strong> liaison.<br />
Du fait que <strong>les</strong> enquêtes ont révélé le désintéressement <strong>de</strong>s populations par<br />
rapport à ce support comme moyen <strong>de</strong> communication, parce qu’analphabtes,<br />
el<strong>les</strong> n’y ont pas accès, le bulletin <strong>de</strong> liaison sera écrit en français.<br />
L’animation et <strong>les</strong> artic<strong>les</strong> seront proposés aussi bien par le personnel du<br />
PAGER que par <strong>les</strong> membres <strong>de</strong>s instances <strong>sur</strong> le terrain, voire par <strong>les</strong> divers<br />
partenaires du PAGER à différents niveaux.<br />
La sélection <strong>de</strong>s artic<strong>les</strong> sera effectuée par l’Unité <strong>de</strong> Gestion du PAGER<br />
(UGP).<br />
Le PAGER n’aura que l’embarras du choix quant la réalisation et multiplication<br />
(reproduction), <strong>de</strong>s maquettes , en raison <strong>de</strong> la multitu<strong>de</strong> d’institutions<br />
spécialisées en la matière.<br />
Quant à la distribution, <strong>les</strong> <strong>de</strong>stinataires du bulletin <strong>de</strong> liaison seront notamment:<br />
- <strong>les</strong> différentes instances du PAGER,<br />
- <strong>les</strong> services déconcentrés <strong>de</strong> l’Etat, <strong>les</strong> ONG et <strong>les</strong> projets partenaires <strong>sur</strong> la<br />
zone d’intervention du PAGER.<br />
Le nombre d’exemplaires sera fonction du nombre <strong>de</strong> partenaires dénombrés.<br />
Avantages<br />
- L’implication <strong>de</strong>s représentants <strong>de</strong>s populations au choix et à la rédaction <strong>de</strong><br />
certains artic<strong>les</strong> sont déjà un exercice à <strong>une</strong> meilleure animation <strong>sur</strong> tout ce<br />
qui se rapporte à leur partenariat avec le PAGER.<br />
- La distribution <strong>de</strong>s numéros aux différents partenaires <strong>sur</strong> l’ensemble <strong>de</strong> la<br />
zone d’intervention du PAGER marque sa présence.<br />
Inconvénients<br />
En raison du lectorat limité auquel il s’adresse, son coût peut paraître élevé la<br />
première année.<br />
24
Dispositif <strong>de</strong> communication <strong>pour</strong> le bulletin <strong>de</strong> liaison<br />
Feed-back<br />
Projet<br />
Impression<br />
Lectorat<br />
AIB+CDD+ASF<br />
Choix <strong>de</strong>s thèmes / rédaction <strong>de</strong>s artic<strong>les</strong><br />
25
6. Recommandations<br />
Il convient <strong>de</strong> faire noter au prime abord que la mise en œuvre d’un plan <strong>de</strong><br />
communication contribue à ce que la conception et le plan d’action du projet<br />
tiennent compte <strong>de</strong> la culture, <strong>de</strong>s mentalités, mais aussi <strong>de</strong>s capacités <strong>de</strong>s<br />
populations auxquel<strong>les</strong> le projet est <strong>de</strong>stiné.<br />
Par la mise en œuvre du plan <strong>de</strong> communication, le dialogue qui s’établit entre<br />
<strong>les</strong> partenaires <strong>de</strong>vient plus fécond, et permet d’engager <strong>de</strong>s actions plus<br />
durab<strong>les</strong>.<br />
Mais <strong>pour</strong> y parvenir, la formation à divers niveaux <strong>de</strong>vrait être effectuée :<br />
- Formation <strong>de</strong>s agents <strong>de</strong> terrain à l’utilisation du matériel, mais aussi<br />
aux techniques <strong>de</strong> communication interpersonnel : l’outil (le matériel)<br />
n’est pas neutre ; c’est la façon dont s’en sert qui est déterminante <strong>pour</strong><br />
atteindre le but visé (sensibilisation – mobilisation – action – évaluation, etc.)<br />
dans le contexte d’actions <strong>de</strong> développement utilisant la démarche<br />
participative.<br />
- Formation <strong>de</strong>s représentants <strong>de</strong>s populations aux techniques <strong>de</strong><br />
communication interpersonnelle, plus spécifiquement à l’animation <strong>de</strong><br />
réunions villageoises ou <strong>de</strong> quartiers.<br />
- Formation à la conception, la production et l’utilisation <strong>de</strong>s matériels <strong>de</strong><br />
communication.<br />
La réussite <strong>de</strong> la mise en œuvre <strong>de</strong>s activités <strong>de</strong> communication est avant tout<br />
conditionnée par la qualité du produit qui sera présenté, à savoir, la qualité du<br />
fond et <strong>de</strong> la forme <strong>de</strong>s messages que véhiculent <strong>les</strong> moyens mis en œuvre, et<br />
qui ont <strong>une</strong> inci<strong>de</strong>nce <strong>sur</strong> le caractère pédagogique qu’ils portent : <strong>de</strong>s tests<br />
préalab<strong>les</strong> <strong>de</strong>s produits seront faits <strong>sur</strong> <strong>de</strong> petits groupes avant diffusion.<br />
De ce fait, la production <strong>de</strong>s éléments audio visuels ou audio que ce soit à la<br />
radio ou <strong>sur</strong> cassettes audio ou vidéo voire <strong>sur</strong> affiche, <strong>pour</strong> en garantir la<br />
qualité, se doit <strong>de</strong> réunir <strong>les</strong> compétences nécessaires à leur conception et à<br />
leur réalisation.<br />
Une dynamique nouvelle <strong>de</strong> la circulation <strong>de</strong> l’information <strong>sur</strong> <strong>les</strong> objectifs et <strong>les</strong><br />
plans d’action du PAGER <strong>de</strong>vra voir le jour avec la mise en œuvre <strong>de</strong>s différents<br />
plans <strong>de</strong> communication. De ce fait, <strong>de</strong>s comités d’écoute constitués d’hommes,<br />
<strong>de</strong> femmes et <strong>de</strong> je<strong>une</strong>s choisis parmi <strong>les</strong> lea<strong>de</strong>rs et <strong>les</strong> élus locaux (3 à 5<br />
personnes) ai<strong>de</strong>ront <strong>les</strong> représentants villageois avec l’appui <strong>de</strong> l’Animateur à<br />
26
préparer et organiser <strong>les</strong> séances publiques d’écoute (radio, cassette) ou<br />
d’assistance aux représentations (théâtre).<br />
Faire en sorte que ce comité soit actif grâce à la permanence <strong>de</strong>s informations à<br />
faire passer. Pour y parvenir, <strong>une</strong> « banque d"éléments sonores ou visuels »<br />
<strong>de</strong>vra être constituée, qui sera alimentée au fur et à me<strong>sur</strong>e <strong>de</strong> l’évolution <strong>de</strong>s<br />
activités. Des échanges d’éléments d’information <strong>pour</strong>raient s’opérer entre CVD<br />
<strong>de</strong> localités différentes.<br />
Les réécoutes ou revues seront d’ailleurs réclamées <strong>de</strong>s populations, encore que<br />
<strong>les</strong> feed back <strong>de</strong>s séances d’écoute <strong>pour</strong>raient maintenir vivaces dans l’esprit<br />
<strong>de</strong>s populations <strong>les</strong> activités et <strong>les</strong> plans d’action du PAGER.<br />
Il convient <strong>de</strong> signaler <strong>pour</strong> terminer que <strong>les</strong> coûts <strong>de</strong>s émissions <strong>de</strong>s radio <strong>de</strong><br />
proximité citées sont d’<strong>une</strong> moyenne <strong>de</strong> soixante quinze mille francs (75000 F<br />
cfa) <strong>pour</strong> <strong>une</strong> durée <strong>de</strong> trente (30) minutes à cent vingt mille francs (120000 F<br />
cfa) <strong>pour</strong> <strong>une</strong> heure. L’expérience a prouvé que la création <strong>de</strong> rapports <strong>de</strong><br />
partenariat entre <strong>les</strong> Projets et <strong>les</strong> stations <strong>de</strong> radiodiffusion dans le cadre <strong>de</strong> la<br />
couverture radiophonique <strong>de</strong>s activités <strong>de</strong>s premiers <strong>sur</strong> <strong>de</strong>s pério<strong>de</strong>s <strong>de</strong> un à<br />
trois ans ramène ces coûts à <strong>de</strong>s proportions plus avantageuses.<br />
27
ANNEXES<br />
28
ANNEXE 1<br />
LA DEMARCHE PARTICIPATIVE<br />
ET LES SUPPORTS DE COMMUNICATION<br />
La démarche participative implique un intérêt direct <strong>de</strong>s ruraux aux actions<br />
qu’ils enten<strong>de</strong>nt mener dans le cadre du développement <strong>de</strong> leur communauté.<br />
Ces objectifs ne peuvent être atteints d’<strong>une</strong> manière durable que si <strong>les</strong> intéressés<br />
expriment clairement leurs besoins, après <strong>une</strong> analyse critique <strong>de</strong> leur situation.<br />
A la métho<strong>de</strong> participative, nous proposons un ensemble <strong>de</strong> supports didactiques<br />
qui viendront apporter un appui à l’expression et à la prise <strong>de</strong> décision <strong>de</strong>s<br />
ruraux.<br />
Pour chaque étape <strong>de</strong> l’approche participative, un ou plusieurs auxiliaires <strong>de</strong><br />
communication, souvent complémentaires, ont été proposés.<br />
Dans la mise en œuvre d’<strong>une</strong> stratégie d’appui à la communication, le PAGER<br />
agira avec <strong>les</strong> différentes structures partenaires, en prenant en compte <strong>les</strong> trois<br />
niveaux <strong>de</strong> communication multi-média :<br />
- La communication éducative, qui s’adresse à la personne ou aux petits<br />
groupes, dans <strong>une</strong> relation <strong>de</strong> dialogue éducatif.<br />
- La communication sociale, que nous appelons aussi « communication <strong>de</strong><br />
masse » ou communication MASS MEDIA. Elle englobe un large public, et<br />
propose le plus souvent <strong>de</strong> l’information <strong>pour</strong> sensibiliser <strong>sur</strong> <strong>les</strong> problèmes<br />
d’<strong>une</strong> zone à gran<strong>de</strong> échelle.<br />
- La communication institutionnelle : celle-ci s’adresse à l’ensemble <strong>de</strong>s<br />
institutions travaillant <strong>sur</strong> <strong>de</strong>s thèmes analogues ou complémentaires. La<br />
communication se fera entre ces structures, <strong>pour</strong> profiter <strong>de</strong>s initiatives et <strong>de</strong>s<br />
expériences <strong>de</strong>s uns et <strong>de</strong>s autres.<br />
La mise en oeuvre <strong>de</strong> cet appui par la communication multi-média aux<br />
différentes structures nécessite <strong>une</strong> organisation <strong>de</strong> l’ensemble du dispositif et<br />
<strong>une</strong> décentralisation <strong>de</strong>s responsabilités.<br />
29
La composante qui animera ce projet <strong>de</strong> communication multi-média <strong>de</strong>vra :<br />
• bien connaître <strong>les</strong> média, leurs spécificités, leur mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> production et<br />
leurs réseaux <strong>de</strong> diffusion ;<br />
• programmer certains supports et <strong>les</strong> réaliser <strong>pour</strong> <strong>les</strong> utiliser dans <strong>les</strong><br />
étapes <strong>de</strong> connaissance du milieu et <strong>de</strong> sensibilisation, conscientisation et<br />
i<strong>de</strong>ntification ;<br />
• utiliser le feed-back <strong>de</strong>s premières étapes <strong>de</strong> la démarche<br />
participative <strong>pour</strong> concevoir et réaliser rapi<strong>de</strong>ment <strong>les</strong> supports uti<strong>les</strong> à la<br />
formation – vulgarisation ;<br />
• rassembler régulièrement <strong>les</strong> personnes ressources <strong>de</strong> la communication<br />
sociale <strong>pour</strong> <strong>les</strong> informer du niveau d’avancement <strong>de</strong>s activités <strong>sur</strong> le<br />
terrain et solliciter leur participation aux moments clés <strong>de</strong>s grands thèmes<br />
<strong>de</strong> sensibilisation ;<br />
• planifier, en liaison étroite avec <strong>les</strong> structures partenaires <strong>sur</strong> le terrain,<br />
l’ensemble <strong>de</strong> la conception, <strong>de</strong> la réalisation et <strong>de</strong> la diffusion <strong>de</strong>s<br />
supports <strong>de</strong> communication ;<br />
• stimuler en permanence le feed-back <strong>pour</strong> chaque type <strong>de</strong> support, afin<br />
d’enrichir la dynamique créée par la circulation <strong>de</strong>s informations ;<br />
• évaluer périodiquement, aux niveaux départemental et <strong>de</strong> toute la zone<br />
d’intervention, l’impact <strong>de</strong>s supports <strong>de</strong> la communication éducative,<br />
sociale et institutionnelle.<br />
30
ANNEXE 2<br />
OUTILS DE COMMMUNICATION EDUCATIVE UTILISABLES POUR<br />
LES DIFFERENTES ETAPES DE LA DEMARCHE PARTICIPATIVE*<br />
* (à lire du bas vers le haut)<br />
Evaluation globale<br />
Niveau zone d’intervention<br />
AUTO-EVALUATION<br />
Niveau collectivité<br />
SUIVI-EVALUATION<br />
A <strong>de</strong>s pério<strong>de</strong>s clés <strong>de</strong>s réalisations<br />
VULGARISATION/FORMATION A<br />
LA BASE<br />
ETUDES DE FAISABILITE<br />
PROGRAMMATION<br />
ORGANISATION<br />
IDENTIFICATION<br />
CONSCIENTISATION<br />
SENSIBILISATION<br />
INFORMATION<br />
CONNAISSANCE DU MILIEU<br />
- radio<br />
- vidéo<br />
31<br />
- Rencontres inter-villages<br />
- Radio<br />
- Cassette audio (écoute <strong>de</strong> la cassette<br />
- Enregistrée à l’étape<br />
programmation)<br />
- Diapo-langage<br />
- Radio<br />
- Réunion/discussion<br />
- Affiches<br />
- Photographies <strong>de</strong>s réalisations<br />
- Diapositives<br />
- Blocs-notes géants (ou boîtes à<br />
images)<br />
- Affiches<br />
- Vidéo<br />
- Radio<br />
- Cassette audio<br />
- Réunion/discussion<br />
- Affiches<br />
- Théâtre<br />
- Diapo-langage + cassette audio<br />
- Rencontre intervillage où il y a <strong>de</strong>s<br />
réalisations<br />
- Réunion <strong>de</strong>s notab<strong>les</strong> d’un ensemble<br />
<strong>de</strong> villages<br />
- Diapositives<br />
- Cassette audio
ANNEXE 3<br />
DIAPO-LANGAGE ET APPROCHE PARTICIPATIVE<br />
32
ANNEXE 4<br />
LA VIDEO SUR LE TERRAIN<br />
33
ANNEXE 5<br />
LE DIAPO LANGAGE<br />
OU LA PUISSAN CE DES IMAGES<br />
34
ANNEXE 6<br />
LA RADIO RURALE ET LA COLLABORATION ENTRE<br />
INSTITUTIONS<br />
35
BIBLIOGRAPHIE<br />
La vidéo appliquée : gui<strong>de</strong> <strong>pour</strong> l’utilisation <strong>de</strong> la vidéo dans <strong>les</strong><br />
projets <strong>de</strong> terrain <strong>de</strong> la FAO (Rome, 1991).<br />
La puissance <strong>de</strong>s images : manuel <strong>de</strong> planification, <strong>de</strong> production<br />
et d’utilisation (FAO, Rome, 1991).<br />
L’école <strong>de</strong> la parole : gui<strong>de</strong> du formateur en radio rurale<br />
(UNICEF - FAO)<br />
36