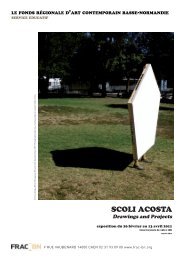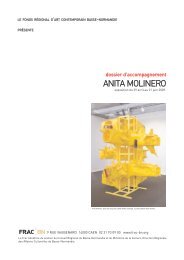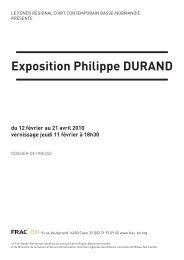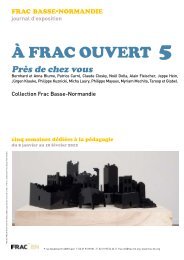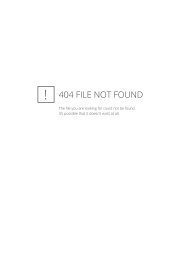SOUS L\'HORIZON.pdf - FRAC Basse-Normandie
SOUS L\'HORIZON.pdf - FRAC Basse-Normandie
SOUS L\'HORIZON.pdf - FRAC Basse-Normandie
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
sous l’horizon des mers<br />
Marcel Dinahet et Véronique Joumard<br />
Quelques références<br />
La mer<br />
La mer est un thème récurrent de la peinture occidentale. Elle a évolué au cours de l’histoire en même temps que se<br />
transformait la relation entre les hommes et l’océan. Si la «marine» a vu le jour au Pays-Bas du XVIIème siècle, le thème<br />
du paysage marin est réinvesti au XIXème par les futurs impressionnistes. Courbet observe une mer tourmentée,<br />
inquiétante encore emplie d’angoisse romantique, la mer est toujours un élément incontrôlable et un lieu dangereux.<br />
Monet, quant à lui fasciné par la mer, appartient déjà à un siècle qui apprivoise et analyse, étudie ses mouvements et<br />
variations lumineuses. Dans tous les cas la mer est tout à la fois l’immatériel et l’infini.<br />
Gustave Courbet (1819-1877)<br />
La mer orageuse dit aussi La vague, 1870<br />
Huile sur toile, 117 x 160,5 cm<br />
Collection Musée d’Orsay<br />
© RMN-Grand Palais (Musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski<br />
Éprouver le paysage ou le «sentiment océanique»<br />
Les deux vidéos Paysage frotté et Sur la baie de Marcel Dinahet créent un sentiment d’immersion dans le paysage.<br />
Le paysage Travelling de Véronique Joumard est à l’inverse marqué par une séparation, le bâtiment qui instaure une<br />
distance entre le spectateur et la mer qu’il contemple.<br />
La relation entre l’artiste et la nature n’est-elle pas toujours dans cette relation ambivalente de fusion et de séparation ?<br />
«On retrouve, au cœur de la relation entre art et nature, l’expérience existentielle fondamentale d’une oscillation constante entre la<br />
rêverie fusionnelle et la conscience de séparation. Sentiments contradictoires qui, on le sait, traversent aussi la littérature. «Ne faire<br />
qu’un avec toutes choses vivantes, retourner par un radieux oubli de soi dans le Tout de la Nature...» écrivait Hölderlin pour revenir<br />
ensuite, dans un mouvement de lucidité douloureuse, au constat de la séparation : «... j’ai parfaitement appris à me distinguer de<br />
ce qui m’entoure : et me voilà isolé dans la beauté du monde...». N’est-ce pas le désir de fusion qui habite Monet, quand il donne<br />
à certains de ses grands Nymphéas ce mouvement centrifuge qui dilate la peinture à l’intérieur de son cadre, ou encore lorsque, à<br />
l’Orangerie, tout près de la mort, il semble tendre vers l’unique, l’impossible tableau sans bord où s’engloutir - et peinture et nature,<br />
là, se superposent et se confondent ? Et c’est peut-être à l’inverse l’exclusion, le fait que toute forme de «sentiment océanique» nous<br />
soit désormais interdit, que vient signifier la mince barrière d’eau qui occupe le tout premier plan de bon ombre des toiles de Poussin,<br />
repoussant le paysage arcadien, inéluctablement, sur l’autre rive.»<br />
Colette Garraud, L’idée de nature dans l’art contemporain, édition Flammarion et CNAP, collection La Création contemporaine, Paris, 1994.