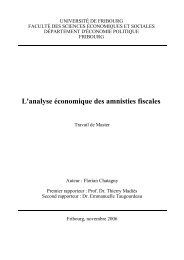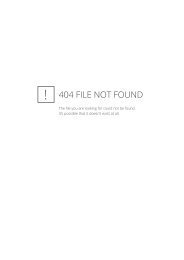La collaboration entre les acteurs publics et privés dans le ... - IDHEAP
La collaboration entre les acteurs publics et privés dans le ... - IDHEAP
La collaboration entre les acteurs publics et privés dans le ... - IDHEAP
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Étant donné qu’il considère conjointement <strong><strong>le</strong>s</strong> courants du NMP <strong>et</strong> du MR <strong>et</strong> <strong>le</strong>urs incidences sur<br />
la convergence <strong>entre</strong> <strong><strong>le</strong>s</strong> sphères publique <strong>et</strong> privée, ce modè<strong>le</strong> apporte une nouvel<strong>le</strong> contribution en<br />
la matière. En eff<strong>et</strong>, jusqu’à date, aucune recherche, à notre connaissance, n’a considéré ces courants<br />
conjointement. Bien que <strong><strong>le</strong>s</strong> PPP soient un terrain de recherche mixte (<strong>et</strong> bien sûr une pratique<br />
mixte), impliquant aussi bien des <strong>acteurs</strong> du secteur public que du secteur privé, <strong><strong>le</strong>s</strong> chercheurs s’en<br />
tiennent généra<strong>le</strong>ment aux courants de <strong>le</strong>ur champ (public ou privé) en négligeant <strong><strong>le</strong>s</strong> éclairages en la<br />
matière apportés par <strong>le</strong>urs homologues de l’autre champ. Un survol de littérature sur <strong><strong>le</strong>s</strong> PPP perm<strong>et</strong><br />
de découvrir un terrain de recherche très divisé, regroupant d’un côté <strong><strong>le</strong>s</strong> apports des chercheurs en<br />
administration publique exprimant essentiel<strong>le</strong>ment la fac<strong>et</strong>te publique du PPP <strong>et</strong> de l’autre côté, <strong><strong>le</strong>s</strong><br />
apports des chercheurs en sciences de la gestion m<strong>et</strong>tant l’accent sur la fac<strong>et</strong>te privée. Le modè<strong>le</strong><br />
proposé a ainsi <strong>le</strong> mérite de réunir ces champs en joignant <strong><strong>le</strong>s</strong> fac<strong>et</strong>tes publiques <strong>et</strong> privées pour<br />
dépeindre une vue plus complète des PPP. En outre, c<strong>et</strong>te étude aura éga<strong>le</strong>ment permis de m<strong>et</strong>tre<br />
l’emphase sur la convergence <strong>entre</strong> <strong><strong>le</strong>s</strong> mondes public <strong>et</strong> privé afférente à <strong>le</strong>urs interactions <strong>dans</strong> <strong>le</strong><br />
cadre de l’organisation PPP. Ainsi, <strong><strong>le</strong>s</strong> théories de l’ordre négocié apportent de nouveaux éclairages<br />
sur la problématique de la <strong>collaboration</strong> <strong>dans</strong> <strong><strong>le</strong>s</strong> alliances stratégiques dont <strong><strong>le</strong>s</strong> PPP.<br />
En eff<strong>et</strong>, plusieurs avenues de recherche sur la <strong>collaboration</strong> se dessinent <strong>dans</strong> une perspective de<br />
l’ordre négocié. De nouvel<strong><strong>le</strong>s</strong> études sur <strong><strong>le</strong>s</strong> alliances stratégiques impliquant des parties d’un même<br />
monde ou de mondes différents <strong>et</strong> ce, en se basant sur la perspective constructiviste pourraient être<br />
envisagées. Ces recherches perm<strong>et</strong>traient d’al<strong>le</strong>r au-delà des termes formels de la <strong>collaboration</strong> <strong>et</strong> d’y<br />
introduire des considérations d’ordre cognitif. Le modè<strong>le</strong> proposé pourrait ainsi servir de cadre<br />
d’investigation pour des recherches futures notamment des études de cas d’alliances <strong>et</strong> de PPP.<br />
En outre, <strong><strong>le</strong>s</strong> chercheurs pourraient envisager d’al<strong>le</strong>r plus loin en étudiant la <strong>collaboration</strong> <strong>dans</strong><br />
des alliances <strong>entre</strong> organisations marquées non seu<strong>le</strong>ment par des cultures corporatives, mais aussi<br />
par des cultures nationa<strong><strong>le</strong>s</strong> diverses; il s’agit notamment des PPP internationaux. En eff<strong>et</strong>, au-delà des<br />
caractéristiques propres aux secteurs, <strong><strong>le</strong>s</strong> cultures corporatives sont éga<strong>le</strong>ment fonction des cultures<br />
nationa<strong><strong>le</strong>s</strong>. Bien qu’appartenant au même secteur, deux organisations publiques de pays différents<br />
peuvent avoir des caractéristiques divergentes marquées <strong><strong>le</strong>s</strong> va<strong>le</strong>urs nationa<strong><strong>le</strong>s</strong> véhiculées par <strong><strong>le</strong>s</strong><br />
schèmes cognitifs de <strong>le</strong>urs membres <strong>et</strong> ayant un impact direct sur la construction des schèmes<br />
organisationnels. <strong>La</strong> comparaison des rô<strong><strong>le</strong>s</strong> assignés à l’État divergent fortement d’un pays à l’autre,<br />
dépendamment de la culture nationa<strong>le</strong> (qui est fonction du patrimoine historique) <strong>et</strong> de l’orientation<br />
politique qui en décou<strong>le</strong>. En France, la perception du rô<strong>le</strong> de l’État <strong>et</strong> des pouvoirs <strong>publics</strong> ainsi que<br />
<strong><strong>le</strong>s</strong> particularités de la bureaucratie française (Crozier, 1963) divergent <strong>dans</strong> une large mesure de<br />
cel<strong><strong>le</strong>s</strong> de mise <strong>dans</strong> d’autres pays, particulièrement <strong><strong>le</strong>s</strong> pays anglo-saxons tel que <strong><strong>le</strong>s</strong> Etats-Unis.<br />
23