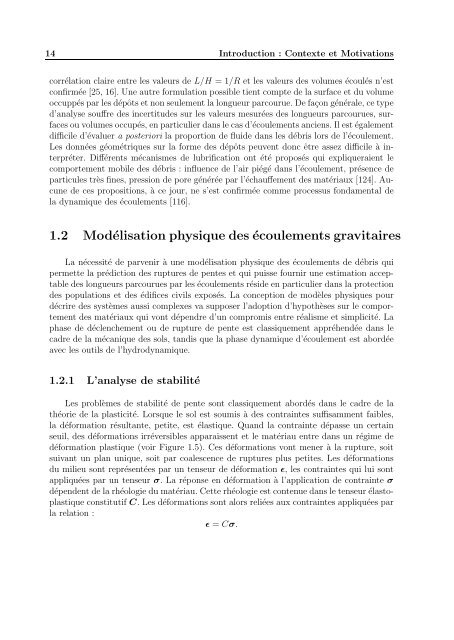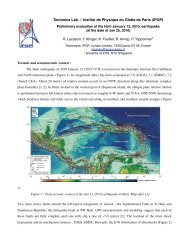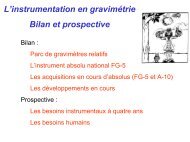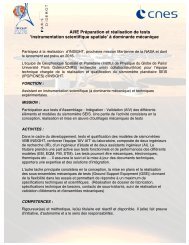Chapitre 1 Introduction : Contexte et Motivations
Chapitre 1 Introduction : Contexte et Motivations
Chapitre 1 Introduction : Contexte et Motivations
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
14 <strong>Introduction</strong> : <strong>Contexte</strong> <strong>et</strong> <strong>Motivations</strong><br />
corrélation claire entre les valeurs de L/H = 1/R <strong>et</strong> les valeurs des volumes écoulés n’est<br />
confirmée [25, 16]. Une autre formulation possible tient compte de la surface <strong>et</strong> du volume<br />
occuppés par les dépôts <strong>et</strong> non seulement la longueur parcourue. De façon générale, ce type<br />
d’analyse souffre des incertitudes sur les valeurs mesurées des longueurs parcourues, surfaces<br />
ou volumes occupés, en particulier dans le cas d’écoulements anciens. Il est également<br />
difficile d’évaluer a posteriori la proportion de fluide dans les débris lors de l’écoulement.<br />
Les données géométriques sur la forme des dépôts peuvent donc être assez difficile à interpréter.<br />
Différents mécanismes de lubrification ont été proposés qui expliqueraient le<br />
comportement mobile des débris : influence de l’air piégé dans l’écoulement, présence de<br />
particules très fines, pression de pore générée par l’échauffement des matériaux [124]. Aucune<br />
de ces propositions, à ce jour, ne s’est confirmée comme processus fondamental de<br />
la dynamique des écoulements [116].<br />
1.2 Modélisation physique des écoulements gravitaires<br />
La nécessité de parvenir à une modélisation physique des écoulements de débris qui<br />
perm<strong>et</strong>te la prédiction des ruptures de pentes <strong>et</strong> qui puisse fournir une estimation acceptable<br />
des longueurs parcourues par les écoulements réside en particulier dans la protection<br />
des populations <strong>et</strong> des édifices civils exposés. La conception de modèles physiques pour<br />
décrire des systèmes aussi complexes va supposer l’adoption d’hypothèses sur le comportement<br />
des matériaux qui vont dépendre d’un compromis entre réalisme <strong>et</strong> simplicité. La<br />
phase de déclenchement ou de rupture de pente est classiquement appréhendée dans le<br />
cadre de la mécanique des sols, tandis que la phase dynamique d’écoulement est abordée<br />
avec les outils de l’hydrodynamique.<br />
1.2.1 L’analyse de stabilité<br />
Les problèmes de stabilité de pente sont classiquement abordés dans le cadre de la<br />
théorie de la plasticité. Lorsque le sol est soumis à des contraintes suffisamment faibles,<br />
la déformation résultante, p<strong>et</strong>ite, est élastique. Quand la contrainte dépasse un certain<br />
seuil, des déformations irréversibles apparaissent <strong>et</strong> le matériau entre dans un régime de<br />
déformation plastique (voir Figure 1.5). Ces déformations vont mener à la rupture, soit<br />
suivant un plan unique, soit par coalescence de ruptures plus p<strong>et</strong>ites. Les déformations<br />
du milieu sont représentées par un tenseur de déformation ɛ, les contraintes qui lui sont<br />
appliquées par un tenseur σ. La réponse en déformation à l’application de contrainte σ<br />
dépendent de la rhéologie du matériau. C<strong>et</strong>te rhéologie est contenue dans le tenseur élastoplastique<br />
constitutif C. Les déformations sont alors reliées aux contraintes appliquées par<br />
la relation :<br />
ɛ = Cσ.