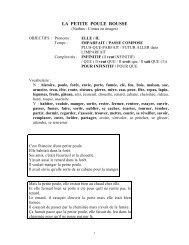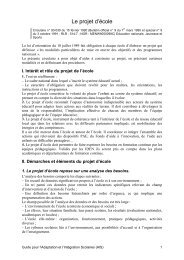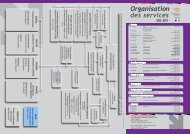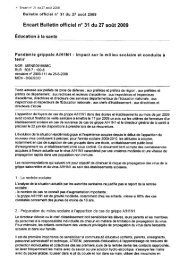9 effets de monsieur et madame Van Eyck
9 effets de monsieur et madame Van Eyck
9 effets de monsieur et madame Van Eyck
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
LE MUSEE ITINERANT<br />
Défi 2012-2013
Un défi est lancé !<br />
Proposer à sa classe <strong>de</strong> travailler à partir <strong>de</strong> l’œuvre <strong>de</strong> Christine Crozat,<br />
«Les neuf <strong>eff<strong>et</strong>s</strong> <strong>de</strong> M <strong>et</strong> Mme <strong>Van</strong> <strong>Eyck</strong>»<br />
Le déroulement du proj<strong>et</strong> se passe en 4 phases :<br />
Phase 1 : prêt <strong>de</strong> l'oeuvre <strong>de</strong> Christine Crozat dans l'école ;<br />
Phase 2 : travail <strong>de</strong>s élèves ; développer une pratique artistique en partant <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te œuvre. Vous<br />
trouverez en pièce jointe <strong>de</strong>s documents d'accompagnement ;<br />
Phase 3 : animation pédagogique (mercredi 13 mars, 9H00-12H00 à Quintin) qui perm<strong>et</strong>tra<br />
d'échanger sur les travaux <strong>de</strong>s élèves. Comment ai<strong>de</strong>r les élèves à faire évoluer leurs productions<br />
<strong>de</strong>stinées à être exposées ?<br />
Phase 4 : installation <strong>de</strong>s travaux d'élèves au collège Le Volozen <strong>de</strong> Quintin puis vernissage dans la<br />
matinée du mercredi 17 avril ;
«Les neuf <strong>eff<strong>et</strong>s</strong> <strong>de</strong> M <strong>et</strong> Mme <strong>Van</strong> <strong>Eyck</strong>» <strong>de</strong> Christine Crozat<br />
9 sérigraphies, 1994
Dans c<strong>et</strong> ensemble composé <strong>de</strong> 9 lithographies, l’artiste<br />
s’empare <strong>de</strong> 9 éléments figurant dans l’oeuvre <strong>de</strong> <strong>Van</strong> <strong>Eyck</strong> :<br />
la coiffe <strong>de</strong> la femme, ses chaussures droite <strong>et</strong> gauche, les<br />
socques droite <strong>et</strong> gauche <strong>de</strong> l’homme, le chapel<strong>et</strong> <strong>et</strong> la p<strong>et</strong>ite<br />
brosse entourant le miroir, la forme oblongue du lit à<br />
baldaquin <strong>et</strong> enfin les fruits posés près <strong>de</strong> la fenêtre.<br />
Les Epoux Arnolfini <strong>de</strong> Jan <strong>Van</strong> <strong>Eyck</strong><br />
(1434)
Réappropriations, emprunts, citations, parodies...<br />
l'art du détournement<br />
Comme en littérature, le recours à la citation, à la parodie, voire au pastiche, est, dans le domaine <strong>de</strong><br />
l'art pictural, aussi ancien que la peinture elle-même. Nombreux sont les exemples <strong>de</strong> réappropriation,<br />
<strong>de</strong> ré-interprétation ou <strong>de</strong> relecture d'un même thème, celui-ci pouvant se répercuter sur plusieurs<br />
siècles. Le cas <strong>de</strong> "La Jocon<strong>de</strong>" est à ce titre exemplaire : on ne compte plus les citations diverses <strong>de</strong><br />
ce chef-d'oeuvre <strong>de</strong> Léonard <strong>de</strong> Vinci : dès le XVIe siècle, Mona Lisa inspira <strong>de</strong> nombreux peintres, qui<br />
en firent <strong>de</strong>s copies <strong>et</strong> <strong>de</strong>s imitations plus ou moins fidèles. Corot, Robert Delaunay <strong>et</strong> Fernand Léger<br />
en ont tiré <strong>de</strong>s variations. Au XXe siècle les surréalistes, pour protester contre «l’art établi»<br />
détournèrent le tableau : Mona Lisa se vit affublée d’une moustache par Salvador Dali, <strong>et</strong> par Marcel<br />
Duchamp sous le titre « L.H.O.O.Q. », reçut une pipe dans la bouche, chevaucha une moto, fut<br />
déguisée en ange <strong>de</strong> la mort, en chien ou en sirène...<br />
L'esprit <strong>de</strong> désacralisation n'est pas toujours à l’œuvre dans l'usage <strong>de</strong> la citation <strong>et</strong> si l'artiste s'inscrit<br />
dans les pas <strong>de</strong> ses pairs, il peut aussi désirer lui rendre hommage: ainsi, lorsqu'il réalise "Le déjeuner<br />
sur l'herbe" en 1862, Édouard Man<strong>et</strong> propose une interprétation mo<strong>de</strong>rne du "Concert champêtre" du<br />
Titien (1508-1509), tableau lui-même inspiré d'une oeuvre antérieure <strong>de</strong> Giorgione. À son tour, le<br />
tableau <strong>de</strong> Man<strong>et</strong> sera <strong>de</strong> nombreuses fois détourné par d’autres peintres célèbres (Mon<strong>et</strong>, Picasso,<br />
Jacqu<strong>et</strong>...).
Les Epoux Arnolfini <strong>de</strong> Jan <strong>Van</strong> <strong>Eyck</strong> (1434)<br />
Jan <strong>Van</strong> <strong>Eyck</strong><br />
Né vers 1390 <strong>et</strong> mort à Bruges en 1441. <strong>Van</strong> <strong>Eyck</strong> est un peintre flamand célèbre pour ses portraits<br />
d’un réalisme minutieux. On sait qu’il effectuait quelques missions diplomatiques pour son protecteur,<br />
le Duc <strong>de</strong> Bourgogne, Philippe Le Bon, dont il fut le val<strong>et</strong> <strong>de</strong> chambre. Il se fixe à Bruges vers 1430.<br />
Ce tableau est l’un <strong>de</strong>s plus célèbres <strong>de</strong> l’artiste. Son oeuvre est surtout composée <strong>de</strong><br />
représentations <strong>de</strong> la Vierge Marie <strong>et</strong> <strong>de</strong> portraits. Il est considéré comme le fondateur du portrait<br />
occi<strong>de</strong>ntal. Le portrait <strong>de</strong>s époux Arnolfini ( conservé à la National Gallery <strong>de</strong> Londres) représente en<br />
pied, dans un intérieur flamand, un riche marchand établi à Bruges, Giovani Arnolfini, <strong>et</strong> son épouse,<br />
au moment <strong>de</strong> leurs noces.[…]<br />
L’apport technique <strong>de</strong> Jan <strong>Van</strong> <strong>Eyck</strong> à la peinture occi<strong>de</strong>ntale est capital (utilisation d’un liant à base<br />
d’huile siccative). Il a porté la technique <strong>de</strong> la peinture à l’huile <strong>et</strong> le réalisme <strong>de</strong>s détails à un niveau<br />
jamais atteint avant lui.<br />
Source Wikipédia
Les époux Arnolfini : 1434<br />
- détrempe à la résine sur bois - 82/60 cm - National Gallery-Londres<br />
Par sa <strong>de</strong>scription naturaliste d’un couple dans un intérieur bourgeois, fixé avec une gran<strong>de</strong> précision <strong>de</strong><br />
détails, le tableau marque le tournant <strong>de</strong> l’art sacré vers l’art profane. Vêtu d’habits somptueux, l’homme <strong>et</strong> la<br />
femme se tiennent <strong>de</strong>bout dans la chambre nuptiale pour conclure les liens du mariage. Devant eux, un p<strong>et</strong>it<br />
chien, symbole <strong>de</strong> la fidélité. Sur le lustre suspendu au-<strong>de</strong>ssus d’eux, brûle une unique bougie symbolisant la<br />
présence du Christ.<br />
Le peintre a fixé c<strong>et</strong>te cérémonie dans son tableau <strong>et</strong> sa signature en fait le témoin <strong>de</strong>s mariés : « Johannes<br />
<strong>Van</strong> <strong>Eyck</strong> hic fuit » (Jan <strong>Van</strong> <strong>Eyck</strong> fut présent), c’est l’inscription que l’on peut lire au <strong>de</strong>ssus du miroir, dans<br />
lequel on reconnaît les <strong>de</strong>ux témoins.<br />
3 La peinture flaman<strong>de</strong> », Renaissance <strong>et</strong> Maniérisme (p.27)<br />
Le thème profane <strong>et</strong> le caractère intime du portrait son certainement dus à la nationalité du commanditaire.<br />
Giovani Arnolfini était un très riche homme d’affaire italien qui dirigeait la filiale <strong>de</strong> Bruges <strong>de</strong> son père. Il<br />
connaissait la valeur qu’on attribuait dans son pays à l’individualité <strong>et</strong> l’habitu<strong>de</strong> qu’avaient les hommes<br />
importants <strong>de</strong> se faire portraiturer. […]<br />
Le nouveau procédé <strong>de</strong> la peinture à l’huile, par sa plus gran<strong>de</strong> fluidité, sa meilleure siccativité, perm<strong>et</strong>tait <strong>de</strong><br />
travailler avec plus <strong>de</strong> lenteur, par couches superposées <strong>et</strong> r<strong>et</strong>ouches. Elle perm<strong>et</strong>tait aussi les nuances<br />
colorées les plus fines. C<strong>et</strong>te technique flaman<strong>de</strong> fut bientôt diffusée <strong>et</strong> admirée hors <strong>de</strong>s Pays-Bas par<br />
l’intermédiaire <strong>de</strong>s peintres flamands appelés à travailler aux cours italiennes.<br />
« La peinture flaman<strong>de</strong> », Renaissance <strong>et</strong> Maniérisme (p.26-27)
Le tableau a été réalisé en 1434 à Bruges qui était alors la plus importante métropole commerciale <strong>de</strong><br />
l’Europe du Nord […] Le couple représenté par le peintre est riche. Ce sont leurs vêtements qui le montrent le<br />
mieux. Le riche surcot en étoffe <strong>de</strong> la dame est ourlé d’hermine ; une secon<strong>de</strong> personne <strong>de</strong>vait porter la<br />
traîne quand elle se déplaçait. L’homme est vêtu d’une somptueuse tunique <strong>de</strong> velours garnie <strong>de</strong> vison ou <strong>de</strong><br />
zibeline. Les patins <strong>de</strong> bois indiquent qu’il n’est pas issu <strong>de</strong> la noblesse : on les enfilait sur les chaussures pour<br />
les protéger <strong>de</strong> la boue. Les nobles se déplaçaient en litière ou à cheval <strong>et</strong> n’en avaient pas besoin.<br />
C<strong>et</strong> homme d’affaire vivait dans le luxe digne d’un aristocrate : tapis d’orient, lustre comme ceux que les<br />
ferronniers flamands fabriquaient à l’époque, miroir, fenêtres en partie vitrées, présence d’oranges, chères à<br />
l’époque. Néanmoins, la pièce est étroite comme celle d’une maison bourgeoise.<br />
A l’arrière-plan du tableau, sur l’axe central, est suspendu un miroir rond en verre au cadre décoré <strong>de</strong><br />
médaillons représentant <strong>de</strong>s scènes <strong>de</strong> la passion du Christ.<br />
Le p<strong>et</strong>it chien, aux pieds <strong>de</strong> l’épouse, symbolise la fidélité. Plusieurs obj<strong>et</strong>s évoquent la pur<strong>et</strong>é <strong>de</strong> la mariée :<br />
le miroir sans taches <strong>et</strong> le chapel<strong>et</strong> aux pierres transluci<strong>de</strong>s suspendu au mur. Ce que montre c<strong>et</strong>te image,<br />
c’est la condition <strong>de</strong>s femmes à c<strong>et</strong>te époque. On voit le regard bas <strong>de</strong> la femme, elle semble soumise. La<br />
question <strong>de</strong> la vertu, <strong>de</strong> la fidélité <strong>et</strong> du péché est au centre du tableau.<br />
Les mains <strong>de</strong> l’époux sont blanches <strong>et</strong> soignées comme celle <strong>de</strong> l’épouse ; ses épaules étroites <strong>et</strong> tombantes<br />
montrent qu’il n’a pas besoin <strong>de</strong> sa force physique pour s’imposer dans la société.<br />
Sur le lustre, on ne voit flamber qu’une bougie. La flamme unique représente le Christ qui voit tout, qui est<br />
témoin <strong>de</strong> la promesse solennelle. La figure en bois, sous le lustre, représente Sainte Marguerite triomphant<br />
du dragon, la sainte patronne <strong>de</strong>s futures mères.
Ce langage symbolique est né dans les églises médiévales car le peuple, ne sachant pas lire, avait besoin<br />
d’images pour méditer <strong>et</strong> s’instruire.<br />
Les pantoufles <strong>et</strong> les patins ont aussi une signification symbolique. Les contemporains du peintre y voyaient<br />
une allusion à l’Ancien Testament (Exo<strong>de</strong>, 3,6). Quand <strong>de</strong>ux personnes s’administraient le sacrement, un<br />
simple plancher <strong>de</strong>venait « une terre<br />
sainte ».<br />
Ce tableau illustre non seulement le passage du sacré au profane mais aussi l’avènement <strong>de</strong> la bourgeoisie, le<br />
passage <strong>de</strong> l’aristocratie à la bourgeoisie. Les riches bourgeois, à l’instar <strong>de</strong>s nobles, se font portraiturer.<br />
La signature du peintre est calligraphiée <strong>et</strong> mise en valeur entre le miroir <strong>et</strong> le lustre. Elle n’acquiert pas sa<br />
validité en tant que signature du peintre mais en tant que signature du témoin.<br />
La main droite <strong>de</strong> la jeune femme repose dans la main gauche <strong>de</strong> l’époux. Ce geste est placé au centre du<br />
tableau, ce qui lui donne une importance particulière. Les personnages ont une attitu<strong>de</strong> solennelle pour poser<br />
dans leur cadre quotidien : l’homme lève la main droite, comme pour prêter serment. Les mains qui se<br />
touchent <strong>et</strong> le geste solennel signifient que les personnages sont en train <strong>de</strong> se marier. Sans doute s’agit-il<br />
d’un mariage « <strong>de</strong> la main gauche », genre d’union contractée entre conjoints qui ne sont pas du même rang.<br />
(le plus souvent, la femme <strong>de</strong> condition inférieure <strong>de</strong>vait renoncer, pour elle <strong>et</strong> pour ses enfants, à la<br />
succession).<br />
La mariée porte un costume <strong>de</strong> cérémonie. Son ventre arrondi ne fait pas allusion à son état mais correspond,<br />
à l’instar <strong>de</strong> la poitrine menue <strong>et</strong> lacée haut, à l’idéal <strong>de</strong> beauté du style gothique flamboyant dont c’est<br />
l’époque. Le monstre sculpté qui orne le banc, à l’arrière-plan, évoque aussi l’époque gothique comme la pose<br />
<strong>de</strong> la femme.<br />
« La peinture flaman<strong>de</strong> », Renaissance <strong>et</strong> Maniérisme
Pistes pédagogiques<br />
- Réaliser une collection <strong>de</strong> chaussures ; trouver une façon <strong>de</strong> présenter la collection ; en gar<strong>de</strong>r une trace<br />
- Représenter les chaussures en expérimentant divers instruments <strong>et</strong> supports afin <strong>de</strong> rendre <strong>de</strong>s <strong>eff<strong>et</strong>s</strong> <strong>de</strong><br />
matières différents<br />
- Présenter les 9 tableaux <strong>de</strong> Christine Crozat d'une autre manière : les disposer dans <strong>de</strong>s boîtes, sur <strong>de</strong><br />
p<strong>et</strong>ites étagères, sous forme d'installation au sol...<br />
- Reproduire les 9 tableaux <strong>de</strong> Christine Crozat en utilisant une autre technique que la lithographie :<br />
peintures, encres, craies, fusain...<br />
- Composer <strong>de</strong> nouvelles images en mêlant <strong>de</strong>s éléments <strong>de</strong> l'oeuvre <strong>de</strong> Christine Crozat avec ceux du<br />
tableau <strong>de</strong> Jan <strong>Van</strong> <strong>Eyck</strong><br />
- Composer <strong>de</strong> nouvelles images en partant <strong>de</strong>s 9 tableaux <strong>de</strong> Christine Crozat ; continuer, comme l’artiste<br />
l'a fait avec l'oeuvre <strong>de</strong> Jan <strong>Van</strong> <strong>Eyck</strong>, à isoler un détail pour aboutir à <strong>de</strong>s gros plans ou très gros plans<br />
- Collecter <strong>de</strong>s obj<strong>et</strong>s personnels qui nous définissent ; photographier ou reproduire ces obj<strong>et</strong>s<br />
- Créer un roman photo qui expliquerait la présence <strong>de</strong> ces obj<strong>et</strong>s dans les <strong>de</strong>ux œuvres ; faire parler les<br />
personnages <strong>de</strong> Jan <strong>Van</strong> <strong>Eyck</strong> ; les amener à évoquer leurs obj<strong>et</strong>s intimes
Proj<strong>et</strong> <strong>de</strong> Frédéric Prouff<br />
Le Vieux Bourg<br />
« Donc, <strong>Van</strong> <strong>Eyck</strong>.<br />
Je vous avais dit au téléphone que c'était l'oeuvre <strong>de</strong> la collection qui me tentait le moins. Je la trouvais très<br />
difficile à travailler en classe, notamment avec <strong>de</strong>s p<strong>et</strong>its (j'ai une classe <strong>de</strong> p<strong>et</strong>ite <strong>et</strong> moyenne section).<br />
Finalement j'y suis allé dans un premier temps sans filtre, en jouant sur la curiosité <strong>de</strong>s enfants pour c<strong>et</strong><br />
obj<strong>et</strong>, c<strong>et</strong>te grosse "boîte" qu'ils voyaient dans la classe <strong>de</strong>puis <strong>de</strong>ux jours.<br />
C'était l'occasion avec <strong>de</strong>s p<strong>et</strong>its d'un premier travail sur la notion d'oeuvre: la malle m<strong>et</strong> en scène le<br />
caractère précieux, la valeur <strong>de</strong> c<strong>et</strong> obj<strong>et</strong>, la malle, le papier bulle, les précautions nécessaires pour<br />
manipuler.<br />
Ensuite nous avons travaillé sur la nature <strong>de</strong> ces obj<strong>et</strong>s: le cadre, le tableau, l'image...<br />
Puis sur les images elles-mêmes: que voyez vous ? (où l'on voit que la simplicité visuelle <strong>de</strong> chaque tableau<br />
le rend accessible pour <strong>de</strong>s p<strong>et</strong>its, ça correspond à leur rapport spontané à l'image.)<br />
Difficile d'aller beaucoup plus loin, une fois ce travail <strong>de</strong> défrichement accompli: l'oeuvre manque un peu <strong>de</strong><br />
séduction pour eux.
C'est là que la famille Arnolfini intervient. J'explique aux enfants, en lisant avec eux le titre <strong>de</strong> l'oeuvre,<br />
que grâce à intern<strong>et</strong> on peut se renseigner sur <strong>monsieur</strong> <strong>et</strong> <strong>madame</strong> <strong>Van</strong> <strong>Eyck</strong>. Nous tapons "<strong>monsieur</strong> <strong>et</strong><br />
<strong>madame</strong> van <strong>Eyck</strong>" dans Google image, <strong>et</strong> la troisième proposition c'est le tableau "Les époux Arnolfini".<br />
Du coup ces images <strong>de</strong>s tableaux <strong>de</strong> C. Crozat, une fois le mot "eff<strong>et</strong>" expliqué, ou en tout cas éclairci",<br />
prennent corps dans une histoire possible, celle <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux personnages. Ce sont leurs affaires, que l'on<br />
r<strong>et</strong>rouve dans le tableau <strong>de</strong> <strong>Van</strong> <strong>Eyck</strong>.<br />
On pourrait ici travailler sur le tableau <strong>de</strong> <strong>Van</strong> <strong>Eyck</strong>: plein <strong>de</strong> pistes s'ouvrent. Je ne l'ai pas fait, du moins<br />
pour l'instant.<br />
Nous avons basculé sur un r<strong>et</strong>our au travail <strong>de</strong> Crozat. Il nous est apparu qu'elle a extrait <strong>de</strong>s éléments du<br />
tableau <strong>de</strong> <strong>Van</strong> <strong>Eyck</strong> pour les m<strong>et</strong>tre en valeur dans un cadre. Et c'est sur ce travail d'extraction que nous<br />
avons décidé <strong>de</strong> travailler, en nous éloignant du couple Arnolfini, mais en nous concentrant sur le principe<br />
à l'oeuvre chez Crozat, <strong>et</strong> en le transposant dans l'école.<br />
Nous avons donc décidé <strong>de</strong> fabriquer <strong>de</strong>s cadres <strong>et</strong> <strong>de</strong> prélever <strong>de</strong>s éléments <strong>de</strong> l'école, travail<br />
déambulatoire <strong>et</strong> prospectif. Et comme nous sommes tout p<strong>et</strong>its, nous utiliserons une technique à notre<br />
portée pour reproduire ces éléments, la photographie numérique. Nous obtiendrons ainsi par citation une<br />
définition/un portrait <strong>de</strong> notre école. »
Photographies numériques, 4 tableaux<br />
« Vertical/Horizontal », MS<br />
« Lignes », MS
« Neuf p<strong>et</strong>its tableaux », PS<br />
« Intérieur », PS
Détails
Détail
Proj<strong>et</strong> <strong>de</strong> Sophie Martin-Buh<strong>et</strong><br />
Saint-Brandan<br />
- Collecter <strong>de</strong>s obj<strong>et</strong>s personnels qui nous définissent<br />
- Reproduire ces obj<strong>et</strong>s sur <strong>de</strong> p<strong>et</strong>its supports format carré (papiers différents), en utilisant le plus <strong>de</strong><br />
techniques possibles : <strong>de</strong>ssin au feutre, au pastel, au fusain, photocopie, photographie, peinture...<br />
Travailler sur l'aspect « reproductible » présent dans le travail <strong>de</strong> C. Crozat (technique <strong>de</strong><br />
la sérigraphie)<br />
- Tapisser un <strong>de</strong>s murs <strong>de</strong> la galerie<br />
- Installer les obj<strong>et</strong>s-référence dans une vitrine avec <strong>de</strong>s étiqu<strong>et</strong>tes explicatives : j'aime c<strong>et</strong> obj<strong>et</strong><br />
parce que..<br />
- Inciter les spectateurs à continuer le mur..
Crayon à papier, crayons <strong>de</strong> couleur, stylo-bille, feutres, gouache, encre,<br />
photographie, photocopie, craies grasses, pastels<br />
« Nos obj<strong>et</strong>s », CE1
Proj<strong>et</strong> <strong>de</strong> Philippe Legueut<br />
Saint-Brandan<br />
Phase 1<br />
« Au suj<strong>et</strong> du défi... je pensais avec ma classe opter pour la 6ème "piste péda" proposée, à savoir<br />
composer <strong>de</strong> nouvelles images en partant <strong>de</strong>s 9 tableaux <strong>de</strong> C. Crozat (...)<br />
Il y aura donc 2 carrés Canson noir <strong>de</strong> 80 cm, à l'intérieur <strong>de</strong>squels on trouvera 9 carrés <strong>de</strong> 21 cm. »<br />
Phase 2<br />
Découvrir les morceaux extraits en créant un eff<strong>et</strong> <strong>de</strong> surprise. On ne doit pas voir tout <strong>de</strong> suite le morceau<br />
extrait. Le spectateur doit faire quelque chose pour le voir.<br />
Exemples :<br />
regar<strong>de</strong>r à travers un tube, un tissu transparent...déplier, dérouler le papier...ouvrir...une boîte, une<br />
enveloppe, un étui, un sach<strong>et</strong>...soulever un cache...<br />
Deman<strong>de</strong>r d'apporter <strong>de</strong>s obj<strong>et</strong>s esthétiquement intéressants qui pourraient être utilisés pour c<strong>et</strong>te mise en<br />
scène.<br />
Phase 3<br />
Avec les obj<strong>et</strong>s à disposition, chaque élève crée sa mise en scène. »
27p<strong>et</strong>ites installations, GS/CP<br />
« Des tailles <strong>de</strong> détails », GS/CP
Détails
Détails
Détails
Détails
Détails
Détails
Détails
Dessin <strong>de</strong> reproduction au fusain (libre ou au vidéo projecteur)
Proj<strong>et</strong> <strong>de</strong> Sandrine Jacques<br />
Le Foeil<br />
- Se démarquer <strong>de</strong> la figure <strong>de</strong> Mme Arnolfini/Mme <strong>Van</strong> <strong>Eyck</strong> : femme soumise à son mari<br />
- Utiliser l'obj<strong>et</strong> chaussure pour montrer le contraste entre la femme du 15ème <strong>et</strong> la femme d'aujourd'hui.<br />
- Donner à voir la diversité <strong>de</strong> la femme d'aujourd'hui : elle peut porter <strong>de</strong>s chaussures <strong>de</strong> toutes le<br />
formes, <strong>de</strong> toutes les couleurs, <strong>de</strong> toutes les matières...<br />
- Mise en scène d'une paire <strong>de</strong> chaussures qui illustre c<strong>et</strong>te diversité<br />
- Photographies prises par les élèves<br />
- Installation <strong>de</strong>s photographies dans <strong>de</strong>s boîtes à chaussures<br />
- Assemblage <strong>de</strong> ces boîtes sur le mur (comme les 9 tableaux <strong>de</strong> C. Crozat)<br />
- Travail d'écriture : collecte <strong>de</strong> mots opposés écrits sur <strong>de</strong>s morceaux <strong>de</strong> papiers<br />
- Papiers mis dans une poch<strong>et</strong>te à chaussure, accrochée près <strong>de</strong>s boîtes
Photographies numériques installées dans <strong>de</strong>s boîtes à chaussures<br />
« Madame hésite, Madame choisit »<br />
CM1
Proj<strong>et</strong> <strong>de</strong> Sylvie Guillemot<br />
Mûr <strong>de</strong> Br<strong>et</strong>agne<br />
Travail arts visuels<br />
- Recherche documentaire : trouver <strong>de</strong>s représentations <strong>de</strong> chaussures dans <strong>de</strong>s peintures <strong>de</strong> maître<br />
- Les reproduire en plus grand au pastel<br />
- Les découper<br />
- Les utiliser pour les m<strong>et</strong>tre en scène : photo-montage<br />
Les élèves se m<strong>et</strong>tent par 2 : l'un se m<strong>et</strong> en scène <strong>de</strong>rrière le livre ; l'autre cadre la photo pour ne faire<br />
apparaître qu'un morceau <strong>de</strong> la jambe <strong>et</strong> le livre ouvert avec la chaussure collée.
Travail d'écriture<br />
Chercher <strong>de</strong>s idées originales à <strong>de</strong>s rubriques telles que :<br />
- collection (ex : « collection Renoir », « collection les Impressionnistes », <strong>et</strong>c)<br />
- couleurs (ex pour <strong>Van</strong> Gogh : « jaune comme les blés », <strong>et</strong>c)<br />
- pointure (ex pour Botero : « bottes <strong>de</strong> 7 lieues », <strong>et</strong>c)<br />
- matière (ex pour Botero : « en peau <strong>de</strong> bête », <strong>et</strong>c)<br />
- <strong>de</strong>scription (ex pour Cézanne : « souliers pour chanter en costume d'Arlequin <strong>et</strong> <strong>de</strong> Pierrot », <strong>et</strong>c)<br />
- prix (ex « valeur inestimable , Hors <strong>de</strong> prix » <strong>et</strong>c)<br />
Textes à enregistrer : utilisation du logiciel audacity<br />
Montage <strong>de</strong>s photos avec le son : utilisation du logiciel gratuit Movie Maker
Film d'animation (pixilation) / durée : 5'39<br />
Installation au sol <strong>de</strong> chaussures <strong>de</strong>ssinées<br />
« Le baz'art », CM1
Film à visionner