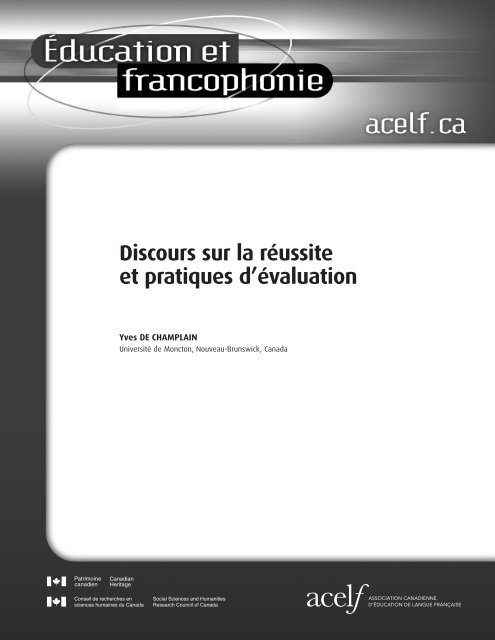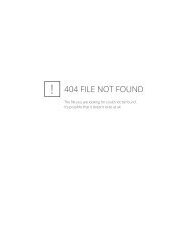Discours sur la réussite et pratiques d'évaluation - acelf
Discours sur la réussite et pratiques d'évaluation - acelf
Discours sur la réussite et pratiques d'évaluation - acelf
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Discours</strong> <strong>sur</strong> <strong>la</strong> réussite<br />
<strong>et</strong> <strong>pratiques</strong> d’évaluation<br />
Yves DE CHAMPLAIN<br />
Université de Moncton, Nouveau-Brunswick, Canada
VOLUME XXXIX:1 – PRINTEMPS 2011<br />
Revue scientifique virtuelle publiée par<br />
l’Association canadienne d’éducation<br />
de <strong>la</strong>ngue française dont <strong>la</strong> mission est<br />
d’offrir aux intervenants en éducation<br />
francophone une vision, du perfectionnement<br />
<strong>et</strong> des outils en construction<br />
identitaire.<br />
Directrice de <strong>la</strong> publication<br />
Chantal Lainey, ACELF<br />
Présidente du comité de rédaction<br />
Mari<strong>et</strong>te Théberge,<br />
Université d’Ottawa<br />
Comité de rédaction<br />
Sylvie B<strong>la</strong>in,<br />
Université de Moncton<br />
Lucie DeBlois,<br />
Université Laval<br />
Nadia Rousseau,<br />
Université du Québec à Trois-Rivières<br />
Paul Ruest,<br />
Collège universitaire de Saint-Boniface<br />
Mari<strong>et</strong>te Théberge,<br />
Université d’Ottawa<br />
Directeur général de l’ACELF<br />
Richard Lacombe<br />
Conception graphique <strong>et</strong> montage<br />
C<strong>la</strong>ude Bail<strong>la</strong>rgeon<br />
Responsable du site Intern<strong>et</strong><br />
Anne-Marie Bergeron<br />
Diffusion Érudit<br />
www.erudit.org<br />
Les textes signés n’engagent que<br />
<strong>la</strong> responsabilité de leurs auteures<br />
<strong>et</strong> auteurs, lesquels en assument<br />
également <strong>la</strong> révision linguistique.<br />
De plus, afin d’attester leur receva bi lité,<br />
au regard des exigences du milieu<br />
universitaire, tous les textes sont<br />
arbitrés, c’est-à-dire soumis à des pairs,<br />
selon une procédure déjà convenue.<br />
La revue Éducation <strong>et</strong> francophonie est<br />
publiée deux fois l’an grâce à<br />
l’appui financier du ministère du<br />
Patrimoine canadien <strong>et</strong> du Conseil<br />
de recherches en sciences humaines<br />
du Canada.<br />
268, rue Marie-de-l’Incarnation<br />
Québec (Québec) G1N 3G4<br />
Téléphone : 418 681-4661<br />
Télécopieur : 418 681-3389<br />
Courriel : info@<strong>acelf</strong>.ca<br />
Dépôt légal<br />
Bibliothèque <strong>et</strong> Archives nationales<br />
du Québec<br />
Bibliothèque <strong>et</strong> Archives du Canada<br />
ISSN 1916-8659 (En ligne)<br />
ISSN 0849-1089 (Imprimé)<br />
Regards critiques <strong>sur</strong><br />
les discours politiques<br />
<strong>et</strong> scientifiques à l’égard<br />
de <strong>la</strong> réussite sco<strong>la</strong>ire<br />
Rédactrices invitées :<br />
C<strong>la</strong>ire LAPOINTE <strong>et</strong> Pauline SIROIS<br />
Liminaire<br />
1 Regards critiques <strong>sur</strong> les discours politiques <strong>et</strong> scientifiques à l’égard de <strong>la</strong> réussite sco<strong>la</strong>ire<br />
C<strong>la</strong>ire LAPOINTE, Université Laval, Québec, Canada<br />
Pauline SIROIS, Université Laval, Québec, Canada<br />
7 Au premier p<strong>la</strong>n : les enfants ou les résultats<br />
Marianne CORMIER, Université de Moncton, Nouveau-Brunswick, Canada<br />
26 Développement discursif de l’enfant sourd : récit <strong>et</strong> morphosyntaxe<br />
Marie-Pierre BARON, Université Laval, Québec, Canada<br />
Hélène MAKDISSI, Université Laval, Québec, Canada<br />
Andrée BOISCLAIR, Université Laval, Québec, Canada<br />
54 La re<strong>la</strong>tivité historique de <strong>la</strong> réussite <strong>et</strong> de l’échec sco<strong>la</strong>ires<br />
Sabine KAHN, Université libre de Bruxelles, Belgique<br />
67 Les aides-enseignants (AE) : un service utile <strong>et</strong> controversé en adaptation sco<strong>la</strong>ire<br />
René LANGEVIN, Campus Saint-Jean, Alberta, Canada<br />
80 La réussite sco<strong>la</strong>ire des élèves d’origine immigrée : réflexions <strong>sur</strong> quelques enjeux à<br />
Montréal<br />
Fasal KANOUTÉ, Université de Montréal, Québec, Canada<br />
Gina LAFORTUNE, Université de Montréal, Québec, Canada<br />
93 Une analyse par quantiles de <strong>la</strong> résilience chez les élèves issus de milieux défavorisés<br />
Gabriel POWER, Université Laval, Québec, Canada<br />
Lucie DEBLOIS, Université Laval, Québec, Canada<br />
119 <strong>Discours</strong> <strong>sur</strong> <strong>la</strong> réussite <strong>et</strong> <strong>pratiques</strong> d’évaluation<br />
Yves de CHAMPLAIN, Université de Moncton, Nouveau-Brunswick, Canada<br />
133 Perceptions d’éducateurs à l’égard de parents en matière d’évaluation des apprentissages<br />
au primaire<br />
Rol<strong>la</strong>nde DESLANDES, Université du Québec à Trois-Rivières, Québec, Canada<br />
Marie-C<strong>la</strong>ude RIVARD, Université du Québec à Trois-Rivières, Québec, Canada<br />
156 L’étude de <strong>la</strong> réussite sco<strong>la</strong>ire au Québec : une analyse historicoculturelle de l’activité d’un<br />
centre de recherche, le CRIRES<br />
Thérèse LAFERRIÈRE, Université Laval, Québec, Canada<br />
Barbara BADER, Sylvie BARMA, C<strong>la</strong>ire BEAUMONT, Lucie DEBLOIS, Fernand GERVAIS, Hélène<br />
MAKDISSI, Chantal POULIOT, Denis SAVARD <strong>et</strong> Anabelle VIAU-GUAY, Université Laval, Québec,<br />
Canada<br />
Stéphane ALLAIRE, Université du Québec à Chicoutimi, Québec, Canada<br />
Geneviève THERRIAULT, Université du Québec à Rimouski, Québec, Canada<br />
Rol<strong>la</strong>nde DESLANDES <strong>et</strong> Marie-C<strong>la</strong>ude RIVARD, Université du Québec à Trois-Rivières, Québec,<br />
Canada<br />
Carole BOUDREAU, Sylvain BOURDON, Godelieve DEBEURME <strong>et</strong> Anne LESSARD, Université de<br />
Sherbrooke, Québec, Canada<br />
183 Points de vue d’étudiantes du collégial <strong>sur</strong> leurs expériences d’apprentissage de <strong>la</strong> physique<br />
<strong>et</strong> <strong>sur</strong> leur éventuelle pratique d’enseignement<br />
Audrey GROLEAU, Université Laval, Québec, Canada<br />
Chantal POULIOT, Université Laval, Québec, Canada<br />
201 La réussite sco<strong>la</strong>ire en contexte d’éducation des adultes<br />
Résultats <strong>et</strong> réflexions émergeant d’une recherche exploratoire<br />
Carine VILLEMAGNE, Université de Sherbrooke, Québec, Canada<br />
218 De <strong>la</strong> dramatique d’usage de soi à l’usage dramatique de soi : une approche ergologique de<br />
<strong>la</strong> réussite <strong>et</strong> de l’échec dans l’apprentissage au travers de <strong>la</strong> question du corps-soi<br />
Pierre USCLAT, Université Paul Valéry-Montpellier III, France
<strong>Discours</strong> <strong>sur</strong> <strong>la</strong> réussite<br />
<strong>et</strong> <strong>pratiques</strong> d’évaluation<br />
Yves DE CHAMPLAIN<br />
Université de Moncton, Nouveau-Brunswick, Canada<br />
RÉSUMÉ<br />
La réussite est intimement liée à l’évaluation parce que toute réussite est le<br />
résultat d’une évaluation. Mais lorsque le discours <strong>sur</strong> <strong>la</strong> réussite entre en contradiction<br />
avec les <strong>pratiques</strong> d’évaluation, comment ce<strong>la</strong> affecte-t-il les personnes concer -<br />
nées C<strong>et</strong> article analyse trois situations vécues par des enseignants au primaire,<br />
ainsi qu’une autre abordée du point de vue d’une élève de troisième secondaire.<br />
Chacune de ces situations touche <strong>la</strong> personne qui <strong>la</strong> vit d’une façon différente <strong>et</strong> à<br />
des niveaux divers, mais, dans chaque situation, on est témoin d’un bris de contrat<br />
qui éc<strong>la</strong>ire <strong>la</strong> nature de <strong>la</strong> contradiction entre le discours <strong>et</strong> <strong>la</strong> pratique. Ces bris de<br />
contrat s’appliquent au contrat d’embauche professionnel, à l’engagement personnel<br />
de l’enseignant <strong>et</strong> de l’élève, de même qu’au contrat social qui fonde le système<br />
d’éducation. Si le bris de contrat en contexte d’évaluation est perçu comme un ob -<br />
stacle par les enseignants <strong>et</strong> tend à faire s’effriter le sens que ceux-ci sont en me<strong>sur</strong>e<br />
de donner à leur travail, on y découvre également des pistes authentiques pour<br />
favoriser <strong>la</strong> réussite des élèves.<br />
volume XXXIX:1, printemps 2011<br />
119<br />
www.<strong>acelf</strong>.ca
<strong>Discours</strong> <strong>sur</strong> <strong>la</strong> réussite <strong>et</strong> <strong>pratiques</strong> d’évaluation<br />
ABSTRACT<br />
Views on success and assessment practices<br />
Yves DE CHAMPLAIN<br />
University of Moncton, New Brunswick, Canada<br />
Success is intimately re<strong>la</strong>ted to assessment, because all success is the result of<br />
an assessment. But how are those involved affected when the discourse on success<br />
contradicts assessment practices This article analyses three situations experienced<br />
by elementary school teachers, and another examines the point of view of a secondary<br />
three student. Each of these situations affects the person who experiences it differently<br />
and at different levels, but in each situation, we see a breach of contract that<br />
helps us understand the nature of the contradiction b<strong>et</strong>ween discourse and practice.<br />
These breaches of contract are linked to professional hiring contracts, the personal<br />
commitments of teachers and students, and the social contract behind the education<br />
system. Even if the breach of contract in the assessment context is seen as an obstacle<br />
by the teachers, and tends to erode the meaning that they are able to give to their<br />
work, we also see promising means of promoting student success.<br />
RESUMEN<br />
Discurso sobre el éxito y <strong>la</strong>s prácticas evaluativas<br />
Yves DE CHAMPLAIN<br />
Universidad de Moncton, Nuevo-Brunswick, Canadá<br />
El éxito está íntimamente ligado a <strong>la</strong> evaluación porque todo éxito es el resultado<br />
de una evaluación. Pero cuando el discurso sobre el éxito entre en contradicción<br />
con <strong>la</strong>s prácticas evaluativas, ¿cómo se afecta a <strong>la</strong>s personas implicadas Este artículo<br />
analiza tres situaciones vividas por maestros de primaria, así como otra que aborda<br />
el punto de vista de una alumna de tercero de secundaria. Cada una de esas situaciones<br />
afecta a <strong>la</strong> persona que <strong>la</strong> vive de manera diferente y a niveles diferentes, pera<br />
cada situación nos muestra <strong>la</strong> vio<strong>la</strong>ción de los contratos de empleo profesional, de<br />
compromiso del maestro y presenta <strong>la</strong> tendencia a pulverizar el sentido que los<br />
maestros pueden dar a su trabajo, y asimismo descubrimos pistas autenticas para<br />
favorecer el éxito de los alumnos.<br />
volume XXXIX:1, printemps 2011<br />
120<br />
www.<strong>acelf</strong>.ca
<strong>Discours</strong> <strong>sur</strong> <strong>la</strong> réussite <strong>et</strong> <strong>pratiques</strong> d’évaluation<br />
Introduction<br />
[…] le discours <strong>sur</strong><br />
<strong>la</strong> réussite instaure un<br />
contrat qui est souvent<br />
rompu par <strong>la</strong> pratique<br />
de l’évaluation.<br />
La réflexion proposée ici s’intéresse à <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tion qui peut exister entre le discours<br />
<strong>sur</strong> <strong>la</strong> réussite <strong>et</strong> les <strong>pratiques</strong> d’évaluation au sein du système sco<strong>la</strong>ire. Pour ce<br />
faire, quatre situations pédagogiques d’évaluation seront analysées : en première<br />
année, en sixième année, en secondaire trois, puis une autre dans le cadre d’un cours<br />
de musique au primaire. Il s’agit d’une réflexion se basant <strong>sur</strong> le point de vue subjectif<br />
des acteurs concernés, soit trois enseignants <strong>et</strong> une élève. En ce qui concerne les<br />
trois premières situations, <strong>la</strong> réflexion se base <strong>sur</strong> un fragment de discours recueilli<br />
en entrevue. Pour <strong>la</strong> quatrième situation, le matériel de base sera un fragment de<br />
mon journal de pratique en tant qu’enseignant de musique au primaire. Il s’agit donc<br />
de m<strong>et</strong>tre le discours <strong>sur</strong> <strong>la</strong> réussite à l’épreuve de situations <strong>pratiques</strong>, soit par le discours<br />
parlé ou écrit de différents acteurs du système sco<strong>la</strong>ire québécois.<br />
Le choix d’analyser le discours <strong>sur</strong> <strong>la</strong> réussite au moyen de situations d’évaluation<br />
s’est fait de façon progressive. Premièrement, il existe un lien insécable entre<br />
réussite <strong>et</strong> évaluation puisque toute réussite implique nécessairement une évaluation,<br />
même si c<strong>et</strong>te dernière n’est que subjective, voire non consciente (Vermersch,<br />
2003). La réussite sco<strong>la</strong>ire pour sa part implique un ensemble de normes, de politiques<br />
<strong>et</strong> de <strong>pratiques</strong> d’évaluation qui occupent une p<strong>la</strong>ce centrale dans tout le<br />
processus sco<strong>la</strong>ire depuis le tout premier « Est-ce que ça compte » jusqu’à <strong>la</strong> remise<br />
du diplôme.<br />
Deuxièmement, le lien entre <strong>la</strong> réussite <strong>et</strong> l’évaluation m’a été en quelque sorte<br />
donné par une élève en troisième secondaire. Par son expérience <strong>et</strong> son questionnement,<br />
elle m’a amené <strong>sur</strong> une piste qui s’est révélée porteuse d’une réflexion plus<br />
profonde : le discours <strong>sur</strong> <strong>la</strong> réussite instaure un contrat qui est souvent rompu par <strong>la</strong><br />
pratique de l’évaluation. Ainsi, le choix des quatre situations d’évaluation ne vise pas<br />
seulement à présenter le point de vue de personnes dans des contextes différents,<br />
mais <strong>sur</strong>tout à montrer quatre bris de contrat de natures très différentes.<br />
Contexte<br />
La réflexion proposée dans le présent texte n’est pas le résultat d’une étude en<br />
soi, mais constitue plutôt une extension de ma thèse de doctorat (de Champ<strong>la</strong>in,<br />
2008). J’avais alors entrepris de rem<strong>et</strong>tre en question les éléments de légitimation de<br />
ma pratique d’enseignant. Malgré <strong>la</strong> bonne volonté des enseignants en général, combien<br />
de fois les contraintes systémiques, même si elles sont souvent contradictoires,<br />
ne guident-elles pas l’action bien plus sûrement que nos nobles intentions Bien<br />
souvent, <strong>la</strong> sagesse conventionnelle véhiculée dans les milieux sco<strong>la</strong>ires constitue<br />
l’obstacle même qui empêche ses acteurs de mieux percevoir <strong>la</strong> réalité <strong>et</strong> de changer<br />
leurs façons de faire en conséquence (Royer, 2006). C<strong>et</strong> apparent paradoxe tient au<br />
fait que les fondements d’une légitimation de l’acte d’éduquer font appel à des systèmes<br />
de savoirs, de valeurs <strong>et</strong> de croyances dont je suis un héritier (Simard, 1999) <strong>et</strong><br />
qui prennent forme <strong>et</strong> sens au quotidien dans les gestes de ma pratique.<br />
volume XXXIX:1, printemps 2011<br />
121<br />
www.<strong>acelf</strong>.ca
<strong>Discours</strong> <strong>sur</strong> <strong>la</strong> réussite <strong>et</strong> <strong>pratiques</strong> d’évaluation<br />
Une réflexion <strong>sur</strong> les <strong>pratiques</strong><br />
La présente réflexion, si elle traite de discours, interroge aussi les limites du discours<br />
face à <strong>la</strong> pratique. Comme il a déjà été dit, les fragments de discours présentés<br />
dans ce texte n’ont pas été recueillis dans le cadre d’une étude <strong>sur</strong> les <strong>pratiques</strong> d’évaluation.<br />
Ils ont été d’abord choisis parce qu’ils m<strong>et</strong>tent en évidence des <strong>pratiques</strong><br />
sco<strong>la</strong>ires, point de départ de <strong>la</strong> réflexion. Ces fragments ont également été choisis<br />
parce que les commentaires autour des aspects <strong>pratiques</strong> m<strong>et</strong>tent en évidence des<br />
forces conflictuelles. C<strong>et</strong>te deuxième qualité perm<strong>et</strong> de passer du geste à <strong>la</strong> figure,<br />
soit une schématisation des forces en présence. En eff<strong>et</strong>, « le geste signifie, pour une<br />
majeure partie, en référence à des hiérarchies spécifiques de systèmes <strong>et</strong> de conventions<br />
symboliques » (Ferneyhough, 1987, p. 128). Ainsi, chaque fragment de pratique<br />
s’accompagne d’une tentative de donner du sens à ce moment, ce qui amène le praticien<br />
à définir le potentiel de <strong>la</strong> situation. Ensuite, les fragments de discours sont tous<br />
développés selon une perspective à <strong>la</strong> première personne. Dans chaque cas, <strong>la</strong> personne<br />
qui é<strong>la</strong>bore le discours se p<strong>la</strong>ce au centre de <strong>la</strong> situation. C<strong>et</strong>te condition est<br />
nécessaire pour perm<strong>et</strong>tre aux deux premières situations d’opérer réellement car, si<br />
elle ne peut le garantir à elle seule, elle favorise néanmoins un discours é<strong>la</strong>boré en<br />
rapport avec le vécu de l’action (Vermersch, 2003). Finalement, les fragments de discours<br />
sont choisis pour m<strong>et</strong>tre en évidence un certain type de bris de contrat.<br />
Fragments de discours<br />
Les trois premières situations sont examinées par le biais du discours tenu par<br />
des acteurs du système sco<strong>la</strong>ire, soit deux enseignantes <strong>et</strong> une élève. Ce qui est exa -<br />
miné, c’est donc d’abord un point de vue subjectif. Les noms sont fictifs.<br />
Pauline : Quand l’évaluation va à l’encontre de <strong>la</strong> réussite<br />
Parfois ça me fait tellement de peine quand je dois donner une mauvaise<br />
note à un élève alors qu’on est seulement en octobre. Il commence à peine <strong>et</strong><br />
je dois déjà lui donner une mauvaise note. Je trouve ça inhumain, mais je<br />
n’ai pas le choix, il y a le bull<strong>et</strong>in qui s’en vient. Il y a des élèves, ça les<br />
décourage. Après je dois passer tellement de temps à leur dire qu’ils sont<br />
capables. Eux, ce qu’ils comprennent, c’est qu’ils ne sont pas bons, pas intelligents.<br />
Pauline, enseignante de 1 re année<br />
Dans ce cas-ci, les exigences d’évaluation vont à l’encontre des exigences de<br />
réussite de l’élève. Pour Pauline, qui s’investit quotidiennement pour <strong>la</strong> réussite des<br />
élèves, c<strong>et</strong> acte « pédagogique » d’évaluation constitue un bris de contrat à deux<br />
niveaux. D’une part, ce<strong>la</strong> va à l’encontre de son intention au niveau personnel, de<br />
l’autre, ce<strong>la</strong> va à l’encontre de <strong>la</strong> raison même pour <strong>la</strong>quelle elle est engagée, donc de<br />
son intention au niveau institutionnel. C<strong>et</strong>te situation de ma<strong>la</strong>ise professionnel est<br />
volume XXXIX:1, printemps 2011<br />
122<br />
www.<strong>acelf</strong>.ca
<strong>Discours</strong> <strong>sur</strong> <strong>la</strong> réussite <strong>et</strong> <strong>pratiques</strong> d’évaluation<br />
amplifiée par le discours <strong>sur</strong> <strong>la</strong> réussite qui fait <strong>la</strong> promotion du respect des rythmes<br />
<strong>et</strong> des styles d’apprentissage. Le bon enseignant devrait être en me<strong>sur</strong>e de respecter<br />
les différences de chaque élève. D’ailleurs, on entend dans ce discours un mé<strong>la</strong>nge de<br />
honte <strong>et</strong> de culpabilité d’être personnellement responsable de <strong>la</strong> dévalorisation d’un<br />
enfant de 6 ans alors qu’on est chargé de sa réussite. L’exigence de produire une note<br />
pour le bull<strong>et</strong>in p<strong>la</strong>ce l’enseignante dans une situation où elle se sent obligée d’aller<br />
à l’encontre de son savoir professionnel. De plus, le choix des mots comme l’intensité<br />
dans l’expression de ce ma<strong>la</strong>ise indiquent que le bris de contrat affecte les<br />
niveaux des valeurs <strong>et</strong> des croyances de l’enseignante (Faingold, 2004). Ces « niveaux<br />
logiques » (Dilts, Hallbom <strong>et</strong> Smith, 1990) sont impliqués dans l’é<strong>la</strong>boration du sens.<br />
On est donc en me<strong>sur</strong>e de croire que de tels actes, en particulier parce qu’ils sont<br />
répétés, peuvent en venir à affecter profondément l’enseignante.<br />
Devant c<strong>et</strong>te situation, on est porté à se demander si une évaluation à c<strong>et</strong>te<br />
étape du parcours sco<strong>la</strong>ire a du sens. La me<strong>sur</strong>e, c’est le cas de le dire, semble drastique.<br />
Peut-on imaginer par exemple un poste qui exigerait de son nouveau titu<strong>la</strong>ire<br />
une évaluation après deux mois de travail <strong>et</strong> dont les résultats le suivraient pour des<br />
années à venir De plus, si l’on voit bien en quoi c<strong>et</strong>te pratique peut être néfaste pour<br />
certains élèves, on ne voit pas en revanche ce qu’elle pourrait avoir de bénéfique<br />
pour quiconque. Le discours <strong>sur</strong> <strong>la</strong> réussite m<strong>et</strong> souvent l’accent <strong>sur</strong> l’évaluation<br />
formative. Mais c<strong>et</strong>te précocité de l’évaluation sommative tend à invalider <strong>la</strong> première.<br />
Quelle crédibilité peut effectivement avoir l’évaluation formative si l’on<br />
impose l’évaluation sommative avant même que l’apprentissage soit réalisé<br />
À l’École, on évalue souvent, bien trop souvent, si souvent que l’on se sent<br />
évalué à chaque instant <strong>et</strong> que l’on n’hésite pas à se cen<strong>sur</strong>er par crainte de<br />
comm<strong>et</strong>tre une erreur ou une ma<strong>la</strong>dresse. [...] les efforts légitimes d’introduction<br />
d’une évaluation formative [...] sont, le plus souvent, réinterprétés<br />
par l’élève comme <strong>la</strong> me<strong>sur</strong>e d’un écart à <strong>la</strong> norme que détient toujours<br />
plus ou moins le maître, <strong>et</strong> dont on doit s’approcher le plus possible pour<br />
être bien jugé. [...] ce qui structure l’institution est, de toute évidence, l’évaluation<br />
normative, les <strong>pratiques</strong> qui tentent d’entrer en contradiction<br />
avec ce principe sont perçues comme des habil<strong>la</strong>ges démagogiques ou des<br />
expériences marginales <strong>et</strong> inutiles. Or c<strong>et</strong>te situation est dommageable au<br />
moins à deux égards : d’une part, elle m<strong>et</strong> l’école en contradiction avec sa<br />
vocation première, qui est d’être un lieu où l’on suspend le temps, l’exigence<br />
d’efficacité <strong>et</strong> <strong>la</strong> sanction sociale qui caractérisent l’univers de <strong>la</strong> production,<br />
pour prendre le temps d’apprendre. Il faut tâtonner <strong>et</strong> se tromper<br />
beaucoup à l’école [...] il faut y analyser ses erreurs – <strong>et</strong> donc pouvoir les<br />
comm<strong>et</strong>tre [...] Par ailleurs, <strong>la</strong> pression évaluative induit chez l’élève un<br />
comportement d’attente plus ou moins passive de <strong>la</strong> vérité corrective, de <strong>la</strong><br />
révé<strong>la</strong>tion par le maître de <strong>la</strong> « bonne solution » (Meirieu, 1992, p. 36-37).<br />
Ce qu’on peut r<strong>et</strong>enir de ce passage, c’est le constat que, même face à un discours<br />
appuyé théoriquement <strong>et</strong> même après plusieurs années, il est très difficile de<br />
changer les <strong>pratiques</strong> <strong>et</strong> les façons de faire. La stagnation de <strong>pratiques</strong> incohérentes<br />
volume XXXIX:1, printemps 2011<br />
123<br />
www.<strong>acelf</strong>.ca
<strong>Discours</strong> <strong>sur</strong> <strong>la</strong> réussite <strong>et</strong> <strong>pratiques</strong> d’évaluation<br />
ne peut être seulement attribuée à l’ignorance de ceux <strong>et</strong> celles qui les m<strong>et</strong>tent en<br />
œuvre ou bien au manque de fondements théoriques dans le domaine. Ce<strong>la</strong> est particulièrement<br />
vrai en ce qui concerne l’évaluation, celle-ci étant peut-être un des<br />
aspects les plus résistants au changement pour <strong>la</strong> raison qu’elle est indissociable du<br />
processus de validation du système sco<strong>la</strong>ire en entier.<br />
Le contrat comme triple engagement<br />
Ce qui ressort de ce premier fragment, c’est <strong>la</strong> polysémie de l’« engagement 1 » en<br />
contexte éducatif : d’une part, le contrat d’embauche professionnel qui lie l’ensei -<br />
gnant à <strong>la</strong> Loi <strong>sur</strong> l’instruction publique (Ministère de l’Éducation du Québec, 1993)<br />
<strong>et</strong>, d’autre part, un investissement personnel. Le bris de contrat se situe, au départ,<br />
purement <strong>sur</strong> le p<strong>la</strong>n professionnel. Les conditions de travail imposées par l’employeur<br />
empêchent l’enseignante de bien faire le travail pour lequel elle est em bau -<br />
chée. Ce bris de contrat semble provenir d’un autre niveau : le contrat social. Le système<br />
d’éducation doit nécessairement présenter à <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion les modalités d’évaluation<br />
qui lui perm<strong>et</strong>tent d’affirmer <strong>et</strong> de maintenir une validation de ce système.<br />
Nous voici donc en présence d’un triple contrat pédagogique constitué d’un<br />
engagement à <strong>la</strong> fois professionnel, social <strong>et</strong> personnel. Car le bris de contrat se ma -<br />
nifeste également au niveau de <strong>la</strong> personne. C’est que l’aspect personnel de l’engagement<br />
constitue un espace de création de sens. Se r<strong>et</strong>rouvant dans une double<br />
contrainte, l’enseignante vit des sentiments de honte <strong>et</strong> de culpabilité. Il n’est pas<br />
étonnant qu’un contexte où <strong>la</strong> validation externe l’emporte <strong>sur</strong> <strong>sur</strong> <strong>la</strong> cohérence<br />
interne entraîne <strong>la</strong> perte de sens chez <strong>la</strong> personne.<br />
Dans une civilisation technique, il est en fin de compte inévitable que ce ne<br />
soit pas tellement <strong>la</strong> créativité mais <strong>la</strong> capacité d’adaptation qui prime.<br />
Pour le dire d’une façon <strong>la</strong>pidaire : une société d’experts est en même<br />
temps une société de fonctionnaires. Car ce qui constitue le fonctionnaire,<br />
c’est qu’il se concentre lui-même <strong>sur</strong> l’administration de sa fonction. […]<br />
Même lorsque <strong>la</strong> dialectique de ce développement devient perceptible à<br />
chacun […] <strong>la</strong> société industrielle moderne demeure quand même<br />
soumise à une contrainte objective immanente. Ceci cependant conduit à<br />
<strong>la</strong> déchéance de <strong>la</strong> praxis [… <strong>et</strong>] à <strong>la</strong> déchéance dans <strong>la</strong> déraison sociale<br />
(Gadamer, 1976, p. 18-19).<br />
Ainsi, <strong>la</strong> culpabilité <strong>et</strong> <strong>la</strong> honte proviennent du fait que l’engagement pour <strong>la</strong><br />
réussite de l’élève est supp<strong>la</strong>nté par celui de faire fonctionner adéquatement les<br />
1. Le terme « contrat » est dérivé du <strong>la</strong>tin contrahere: « prendre engagement » (Rey, 2000, p. 874).2 Plusieurs<br />
informations à ce suj<strong>et</strong> ne font pas l’obj<strong>et</strong> de publications <strong>et</strong> ont été obtenues par l’entremise de madame<br />
Martine Cliche, présidente du Syndicat de l’enseignement de <strong>la</strong> région de La Mitis.3 Devant une souffrance de<br />
plus en plus manifeste des enseignants qui ne comprenaient plus les modalités d’application des droits aux<br />
services originalement garantis par <strong>la</strong> Loi <strong>sur</strong> l’instruction publique (MELS, 1993), les organisations syndicales<br />
qui en avaient les moyens ont commencé, aux alentours de 2008, à donner de l’information <strong>et</strong> de <strong>la</strong> formation<br />
à ce suj<strong>et</strong>. C<strong>et</strong>te prise en charge syndicale, d’ailleurs toujours en développement, des modalités d’octroi<br />
des services aux élèves indique que ce mode d’imp<strong>la</strong>ntation silencieuse n’était pas le fait de quelques directions<br />
d’école, mais était généralisé à de nombreuses commissions sco<strong>la</strong>ires.<br />
volume XXXIX:1, printemps 2011<br />
124<br />
www.<strong>acelf</strong>.ca
<strong>Discours</strong> <strong>sur</strong> <strong>la</strong> réussite <strong>et</strong> <strong>pratiques</strong> d’évaluation<br />
Ainsi, c’est<br />
effectivement l’élève<br />
capable de s’adapter<br />
aux conditions<br />
imposées par ces<br />
processus qui peut<br />
espérer atteindre<br />
<strong>la</strong> réussite.<br />
processus de validation du système. Ainsi, c’est effectivement l’élève capable de<br />
s’adapter aux conditions imposées par ces processus qui peut espérer atteindre <strong>la</strong><br />
réussite. Et le fait que c<strong>et</strong>te dialectique soit de plus en plus perceptible constitue un<br />
des facteurs qui autorisent les parents à critiquer l’école (B<strong>la</strong>is, Gauch<strong>et</strong> <strong>et</strong> Ottavi,<br />
2008) <strong>et</strong> qui minent son autorité (Benasayag <strong>et</strong> Schmit, 2006).<br />
Diane : Quand le jugement professionnel est remis en question<br />
C’est insultant! Quand je demande de l’aide pour un élève, c’est parce que<br />
je sais qu’il en a besoin. Mais là il faut se justifier <strong>et</strong> remplir de <strong>la</strong> paperasse.<br />
On passe des heures là-dessus <strong>et</strong> pour quoi en bout de ligne Pour se faire dire<br />
qu’il n’y a pas de ressources. Pour moi d’abord, c’est comme me faire dire que<br />
mon jugement ne vaut rien. Toute c<strong>et</strong>te paperasse qu’ils nous demandent<br />
c’est juste pour nous décourager de faire des demandes <strong>et</strong> cacher le fait qu’il<br />
n’y en a pas de services!<br />
Diane, enseignante de 6 e année<br />
Dans ce cas-ci, l’évaluation de l’enseignante – « c<strong>et</strong> élève a besoin d’aide » – fait<br />
elle-même l’obj<strong>et</strong> d’une évaluation : « Peux-tu me démontrer que tu as fait tout ce<br />
que tu pouvais faire avant de demander c<strong>et</strong>te aide si précieuse parce que limitée »<br />
Pour comprendre c<strong>et</strong>te situation, il faut d’abord c<strong>la</strong>rifier le contexte. La politique<br />
d’octroi de ressources d’aide aux élèves, orthopédagogie, psychoéducation ou autre,<br />
a changé. On demande aux enseignants de monter un dossier de leurs interventions<br />
<strong>et</strong> d’ainsi faire <strong>la</strong> preuve des besoins de l’élève. Mais ce qui pourrait être vu comme<br />
un acte professionnel de constitution d’un dossier pour mieux servir <strong>la</strong> réussite de<br />
l’élève est vu comme un affront par l’enseignante.<br />
C<strong>et</strong>te réaction mérite d’être rep<strong>la</strong>cée en contexte 2 , à savoir que c<strong>et</strong>te politique a<br />
été modifiée dans <strong>la</strong> foulée de <strong>la</strong> loi 142, loi spéciale pour imposer les conditions de<br />
travail dans le secteur public (Assemblée nationale, 2005), en spécifiant que <strong>la</strong> commission<br />
sco<strong>la</strong>ire devait fournir les services aux élèves en difficulté « dans <strong>la</strong> limite des<br />
ressources disponibles » (ibid.). Ce<strong>la</strong> a entraîné un resserrement inévitable dans l’octroi<br />
des services, mais qui fut appliqué de façon progressive, sans p<strong>la</strong>nification<br />
explicite de mise en p<strong>la</strong>ce <strong>et</strong> sans information de <strong>la</strong> part des commissions sco<strong>la</strong>ires 3 .<br />
Ainsi, <strong>la</strong> constitution d’un dossier qui devait, dans <strong>la</strong> Loi <strong>sur</strong> l’instruction publique<br />
(Ministère de l’Éducation du Québec, 1993), perm<strong>et</strong>tre d’évaluer les besoins de<br />
l’élève avant de l’intégrer en c<strong>la</strong>sse ordinaire devient bien trop souvent un constat<br />
des échecs de son intégration.<br />
2. Plusieurs informations à ce suj<strong>et</strong> ne font pas l’obj<strong>et</strong> de publications <strong>et</strong> ont été obtenues par l’entremise de<br />
madame Martine Cliche, présidente du Syndicat de l’enseignement de <strong>la</strong> région de La Mitis.<br />
3. Devant une souffrance de plus en plus manifeste des enseignants qui ne comprenaient plus les modalités<br />
d’application des droits aux services originalement garantis par <strong>la</strong> Loi <strong>sur</strong> l’instruction publique (MELS, 1993),<br />
les organisations syndicales qui en avaient les moyens ont commencé, aux alentours de 2008, à donner de<br />
l’information <strong>et</strong> de <strong>la</strong> formation à ce suj<strong>et</strong>. C<strong>et</strong>te prise en charge syndicale, d’ailleurs toujours en développement,<br />
des modalités d’octroi des services aux élèves indique que ce mode d’imp<strong>la</strong>ntation silencieuse n’était<br />
pas le fait de quelques directions d’école, mais était généralisé à de nombreuses commissions sco<strong>la</strong>ires.<br />
volume XXXIX:1, printemps 2011<br />
125<br />
www.<strong>acelf</strong>.ca
<strong>Discours</strong> <strong>sur</strong> <strong>la</strong> réussite <strong>et</strong> <strong>pratiques</strong> d’évaluation<br />
Tout discours qui nie<br />
l’aspect re<strong>la</strong>tionnel de<br />
l’enseignement risque<br />
fort d’être reçu comme<br />
une négation de l’identité<br />
de l’enseignant.<br />
Par ailleurs, il existe une réelle contradiction entre le fait d’attendre plus de travail<br />
des enseignants, d’abord en favorisant l’intégration, puis en leur demandant de<br />
tenir un dossier plus compl<strong>et</strong> de leurs interventions, tout en leur sortant continuellement<br />
<strong>la</strong> carte des ressources limitées. C<strong>et</strong>te contradiction se manifeste <strong>sur</strong> deux ni -<br />
veaux. D’un côté, les actes qu’un enseignant doit poser au quotidien sont très variés<br />
<strong>et</strong> plusieurs d’entre eux débordent de <strong>la</strong> compétence professionnelle proprement<br />
dite des enseignants. Par exemple, ils sont aux premières lignes pour dépister les<br />
troubles d’apprentissage, mais ne sont pas habil<strong>et</strong>és à poser un diagnostic. En même<br />
temps, ils doivent aussi se justifier en démontrant qu’ils ont essayé une panoplie de<br />
dispositifs pédagogiques, en plus du temps de préparation <strong>et</strong> de p<strong>la</strong>nification de ces<br />
dispositifs. D’une part, ils savent qu’il existe des experts formés pour répondre aux<br />
besoins de l’élève qui est assis devant eux; d’autre part, on leur demande de jouer à<br />
l’expert <strong>et</strong> de faire « tout ce qui peut être fait » (Jocelyne, directrice d’école). De là,<br />
pour l’enseignante, à sentir que le système sco<strong>la</strong>ire se déleste de sa responsabilité <strong>sur</strong><br />
elle, il n’y a qu’un pas.<br />
Mais c<strong>et</strong>te contradiction touche aussi un autre niveau. Ce discours d’efficacité<br />
autour de l’é<strong>la</strong>boration d’un dossier d’interventions auprès des élèves nie un aspect<br />
majeur du travail de l’enseignant : l’enseignement est un travail re<strong>la</strong>tionnel. Bien<br />
souvent, l’élève en difficulté n’a pas besoin d’être réparé comme une machine, à<br />
l’aide du bon outil pédagogique. Bien souvent, l’élève a besoin de faire <strong>la</strong> bonne rencontre<br />
qui lui perm<strong>et</strong>tra de se voir autrement <strong>et</strong> de construire un nouveau sens à son<br />
processus d’apprentissage. C’est d’ailleurs un des principaux messages que <strong>la</strong>nce<br />
Daniel Pennac (2007). Chez Pennac, c<strong>et</strong>te même exigence de réessayer sans cesse par<br />
tous les moyens n’a pas <strong>la</strong> même signification, puisque c’est de toucher l’élève qu’il<br />
est question. Tout discours qui nie l’aspect re<strong>la</strong>tionnel de l’enseignement risque fort<br />
d’être reçu comme une négation de l’identité de l’enseignant, déjà fragilisée (CSE,<br />
2004). Même si l’enseignant va protester qu’il y a là bris de contrat au niveau de <strong>la</strong><br />
reconnaissance de sa compétence professionnelle, le bris de contrat est plus profond.<br />
« Je suis celle qui passe ses journées avec c<strong>et</strong> élève, je le connais… » Mais c’est,<br />
encore une fois, aussi contre une certaine honte <strong>et</strong> une certaine culpabilité que l’enseignante<br />
proteste.<br />
Un contrat complexe au sein duquel s’é<strong>la</strong>bore l’identité professionnelle<br />
Ce qui ressort de ce second fragment est d’abord <strong>la</strong> complexité légis<strong>la</strong>tive <strong>et</strong><br />
administrative du triple contrat pédagogique <strong>et</strong> du rôle que peuvent y jouer les personnes,<br />
mais <strong>sur</strong>tout les organisations telles que le ministère, les syndicats <strong>et</strong> les<br />
commissions sco<strong>la</strong>ires. En y regardant de plus près, il s’y dessine un autre type de bris<br />
de contrat, créé par des modalités contractuelles silencieuses. On exige plus de transparence<br />
de <strong>la</strong> part de l’enseignante, sans pour autant dévoiler les modalités de c<strong>et</strong>te<br />
transparence. D’une part, l’enseignante ne comprend pas les raisons de c<strong>et</strong>te<br />
demande d’en dévoiler plus de son travail; de l’autre, on refuse de voir <strong>la</strong> nature fondamentalement<br />
re<strong>la</strong>tionnelle de celui-ci.<br />
Si, dans le fragment précédent, on voyait bien que l’aspect personnel de l’engagement<br />
constitue un lieu important de création de sens, on voit ici comment c<strong>et</strong>te<br />
volume XXXIX:1, printemps 2011<br />
126<br />
www.<strong>acelf</strong>.ca
<strong>Discours</strong> <strong>sur</strong> <strong>la</strong> réussite <strong>et</strong> <strong>pratiques</strong> d’évaluation<br />
création est liée au développement identitaire de l’enseignante. Ici, plutôt que d’intérioriser<br />
<strong>la</strong> contradiction <strong>et</strong> de faire d’un bris de contrat un bris d’identité, l’ensei -<br />
gnante <strong>la</strong> rej<strong>et</strong>te par le biais de <strong>la</strong> colère <strong>et</strong> de l’indignation. Si l’on ne peut <strong>la</strong><br />
reconnaître dans ce qu’elle est comme enseignante, alors c’est à elle qu’il revient de<br />
l’affirmer haut <strong>et</strong> fort.<br />
Marilou : Quand l’évaluation brise le contrat de réussite<br />
Pourquoi est-ce qu’un professeur, qui dit qu’il m<strong>et</strong> toute son énergie pour<br />
qu’on réussisse, va m<strong>et</strong>tre une question piège dans son examen Pourquoi,<br />
s’il travaille aussi fort qu’il le dit pour nous aider à réussir, après il s’arrange<br />
pour nous faire rater<br />
Marilou, élève de 3 e secondaire<br />
L’enseignant vient<br />
de révéler un second<br />
visage : il n’est plus là<br />
pour aider de son<br />
mieux, comme il l’a<br />
annoncé, mais aussi<br />
pour p<strong>la</strong>cer des<br />
embûches.<br />
Du point de vue de l’élève, le bris de contrat est manifeste. Le discours de l’enseignant<br />
à l’égard de <strong>la</strong> réussite vient d’être remis en question par un geste qui semble<br />
révéler une intention contradictoire. L’enseignant vient de révéler un second visage :<br />
il n’est plus là pour aider de son mieux, comme il l’a annoncé, mais aussi pour p<strong>la</strong>cer<br />
des embûches. À quoi peut bien servir une question piège À évaluer un autre aspect<br />
de <strong>la</strong> compréhension des élèves, à vérifier c<strong>et</strong>te compréhension plus en profondeur,<br />
à insérer un vol<strong>et</strong> plus compétitif, peut-être à en motiver quelques-uns à se dépasser<br />
ou à dépasser les autres Le point commun à ces questions est d’opérer une distinction<br />
supplémentaire entre les élèves. Ce qui dérange Marilou ici, c’est que l’évaluation<br />
s’éloigne de son mandat de valider <strong>la</strong> réussite pour occuper une fonction plus<br />
discriminante.<br />
Parce qu’en fait, au-delà de tous les discours <strong>sur</strong> <strong>la</strong> réussite, <strong>et</strong> plus particulièrement<br />
ceux qui visent <strong>et</strong> demandent <strong>la</strong> réussite de tous, l’évaluation discriminante<br />
n’est jamais réellement considérée. Si, comme le remarque Caou<strong>et</strong>te (1997), les en -<br />
sei gnants se dépassaient, que les ressources étaient au rendez-vous <strong>et</strong> que <strong>la</strong> réussite<br />
de tous advenait réellement, qu’en serait-il alors La réponse est simple : les exigences<br />
d’entrée aux cycles supérieurs, que ce soit au cégep, à l’université ou même<br />
<strong>sur</strong> le marché du travail, seraient simplement haussées. C’est d’ailleurs ce qui arrive<br />
c<strong>et</strong>te année même, alors que le nombre de demandes d’admission à l’université au<br />
Canada atteint un record (reportage présenté au Téléjournal de Radio-Canada le<br />
15 juin 2010). Alors, <strong>la</strong> réussite comme logique d’obtention d’un diplôme menée à<br />
son terme ne revient finalement qu’à repousser l’échec à un autre palier. En attendant,<br />
on entend des enseignants de tous les niveaux, y compris du présco<strong>la</strong>ire, se<br />
p<strong>la</strong>indre que les enfants, les élèves <strong>et</strong> les étudiants manquent de bases (Pennac,<br />
2007). Un autre constat troub<strong>la</strong>nt qui vient miner <strong>la</strong> réussite sco<strong>la</strong>ire comme obtention<br />
d’un diplôme est le taux dévastateur de suicide chez les jeunes Québécois, un<br />
des plus élevés au monde (Bouchard, 2002). Comment parler de réussite dans un tel<br />
contexte La réussite sco<strong>la</strong>ire doit être avant tout une réussite humaine, tant pour les<br />
élèves que pour les enseignants.<br />
volume XXXIX:1, printemps 2011<br />
127<br />
www.<strong>acelf</strong>.ca
<strong>Discours</strong> <strong>sur</strong> <strong>la</strong> réussite <strong>et</strong> <strong>pratiques</strong> d’évaluation<br />
Un contrat réciproque<br />
Ce troisième fragment <strong>la</strong>isse supposer qu’il s’é<strong>la</strong>bore entre l’enseignant <strong>et</strong><br />
l’élève un contrat d’aide mutuelle. L’enseignant s’engage explicitement à aider les<br />
élèves, ces derniers s’engagent à coopérer, à aider en quelque sorte l’enseignant à les<br />
aider. Ce contrat implique un respect réciproque, un non-jugement de part <strong>et</strong><br />
d’autre, un climat de confiance. C’est ce non-jugement qui est brisé. La question<br />
piège est source de discrimination, ce qui implique un jugement. L’élève va donc, à<br />
son tour, juger l’enseignant. La réciprocité est maintenue, mais le contrat d’aide<br />
mutuelle est rompu, sinon fragilisé. Encore une fois, <strong>la</strong> fonction de validation fait mal<br />
à <strong>la</strong> personne. Le processus de création de soi propre à l’apprenant est remp<strong>la</strong>cé par<br />
celui d’adaptation à des règles incompréhensibles, donc perçues comme arbitraires<br />
<strong>et</strong> dont on doit se méfier.<br />
Fragment de pratique<br />
C<strong>et</strong>te quatrième situation, bien qu’elle constitue encore un bris de contrat, va<br />
dans une direction différente, puisqu’il s’agit maintenant d’une piste de solution<br />
dans c<strong>et</strong>te articu<strong>la</strong>tion réussite-évaluation. La situation est tirée de mon journal de<br />
pratique en tant qu’enseignant de musique. Le nom de l’élève est fictif.<br />
Nico<strong>la</strong>s : Quand l’évaluation ratée ouvre <strong>la</strong> voie à <strong>la</strong> réussite<br />
C<strong>et</strong>te année, j’ai décidé d’instaurer des règles particulières pour les examens<br />
de flûte. La première est que chacun peut tenter de passer son examen autant<br />
de fois qu’il le désire, au moment qui lui convient, <strong>et</strong> que je ne conserve que<br />
<strong>la</strong> dernière note. Comme ces examens se déroulent en solo devant toute <strong>la</strong><br />
c<strong>la</strong>sse, j’ai pris le temps d’expliquer que, lors d’un examen, chacun peut venir<br />
en aide à <strong>la</strong> personne qui passe l’examen, d’abord par une attitude de respect<br />
<strong>et</strong> d’écoute. De plus, pour avoir le droit de formuler un commentaire, il faut<br />
obligatoirement avoir au moins autant de points positifs à nommer que de<br />
points négatifs. Tout commentaire doit être constructif, c’est-à-dire qu’il doit<br />
perm<strong>et</strong>tre à l’autre de s’améliorer. Finalement, les élèves proposent une note<br />
<strong>et</strong> nous discutons ensemble pour en arriver à un accord.<br />
Les examens de flûte de Nico<strong>la</strong>s, maintenant en cinquième année, ont<br />
tendance à se dérouler ainsi : Nico<strong>la</strong>s tremble, esquisse une note <strong>et</strong> se m<strong>et</strong> à<br />
pleurer. Bref, ce n’est pas ce qu’il y a de plus convaincant. Alors, quand<br />
Nico<strong>la</strong>s va commencer, je lui dis qu’on a tout notre temps <strong>et</strong> qu’on va tous<br />
l’aider. Il trouve ça très dur, a les <strong>la</strong>rmes aux yeux, mais je ne le lâche pas, l’accompagnant<br />
de <strong>la</strong> sorte : « Prends ton temps, moins vite, plus lentement,<br />
encore plus lentement, prends ton temps de bien faire sonner ta première<br />
note... » Puis, je demande aux élèves s’ils ont des trucs qu’ils pourraient<br />
partager avec Nico<strong>la</strong>s. J’ai peur que le fait de trop insister puisse lui faire<br />
vivre son échec de façon encore plus cruelle, alors je ne veux pas que les<br />
autres élèves demeurent seulement spectateurs, je veux qu’ils se sentent<br />
volume XXXIX:1, printemps 2011<br />
128<br />
www.<strong>acelf</strong>.ca
<strong>Discours</strong> <strong>sur</strong> <strong>la</strong> réussite <strong>et</strong> <strong>pratiques</strong> d’évaluation<br />
impliqués. Plusieurs élèves y vont de leur conseil. Finalement, quand Nico<strong>la</strong>s<br />
a réussi à enfiler quelques notes <strong>et</strong> arrête, je lui dis que c’est très bon, qu’il est<br />
capable <strong>et</strong> qu’il n’a qu’à pratiquer avec ces nouveaux trucs <strong>et</strong> revenir <strong>la</strong><br />
semaine prochaine. Juste ce qu’il vient de faire me semble vraiment énorme.<br />
La semaine suivante, il s’exécute, il joue <strong>la</strong> pièce du début à <strong>la</strong> fin, lentement<br />
<strong>et</strong> calmement. À <strong>la</strong> fin, tous les élèves explosent en app<strong>la</strong>udissements, d’une<br />
manière très chaleureuse <strong>et</strong> très sincère. C’est moi qui ai maintenant les<br />
<strong>la</strong>rmes aux yeux.<br />
Janvier 2005<br />
Dans c<strong>et</strong> exemple, le bris de contrat s’effectue entre ma manière d’évaluer <strong>et</strong> les<br />
exigences propres à l’évaluation. Il serait même aisé de dire qu’il ne s’agit pas là d’une<br />
évaluation, tellement l’élève est aidé <strong>et</strong> <strong>sur</strong>tout parce que je ne tiens aucunement<br />
compte de ses difficultés mais uniquement de ses efforts <strong>et</strong> de son progrès. Or, le contexte<br />
de l’évaluation est ici très important. L’impact de c<strong>et</strong> apprentissage n’aurait<br />
jamais pu être aussi grand s’il n’avait été question d’évaluation. Autrement dit, l’éva -<br />
luation est une mise en scène qui consiste effectivement à donner un rôle à chaque<br />
élève lors d’un examen qui est pourtant individuel. D’abord, les élèves doivent<br />
apprendre à écouter de manière à identifier ce qui est bien joué, alors que tous n’identifient<br />
spontanément que ce qui est raté. Ils doivent fournir un lieu accueil<strong>la</strong>nt par<br />
leur silence qui est en soi le signe d’une écoute attentive. Ils doivent être en me<strong>sur</strong>e<br />
de donner des conseils qui perm<strong>et</strong>tent à chacun de dépasser ses limites. L’élève qui<br />
doit jouer sa pièce joue sa pièce, bien sûr, mais doit aussi apprendre à ressentir le<br />
respect qui émane de l’écoute pour pouvoir y prendre appui. Il doit aussi apprendre<br />
à recevoir les conseils des autres. L’évaluation est donc détournée de sa fonction discriminatoire<br />
pour devenir un outil de réussite. La note obtenue par Nico<strong>la</strong>s de 10 <strong>sur</strong><br />
10 ne veut plus rien dire du point de vue objectivant généralement associé à l’évaluation<br />
sommative. D’autres ont fait mieux, plus rapidement <strong>et</strong> de façon plus autonome<br />
aussi, mais personne n’a pensé lui donner une autre note. Le poids significatif de<br />
l’exa men donne un sens aux apprentissages qui sont réalisés dans ce contexte.<br />
Contrat professionnel vs savoir professionnel<br />
Mon action telle que décrite consiste à ignorer les politiques qui gèrent mon<br />
engagement professionnel pour m<strong>et</strong>tre en application des savoirs <strong>pratiques</strong>, par<br />
lesquels je suis en me<strong>sur</strong>e de me considérer comme professionnel. Ce qui se dégage<br />
pour moi de c<strong>et</strong>te action est un sentiment de grande satisfaction <strong>et</strong> de compétence<br />
professionnelle, un indéniable sentiment de réussite. Pourtant, ce geste d’ignorer les<br />
directives qui encadrent mon travail me fragilise au sein de l’institution qui me perm<strong>et</strong><br />
de me définir comme professionnel.<br />
Mais le bris de contrat se situe réellement dans mon choix de favoriser une opinion<br />
personnelle plutôt que de fonder mon action <strong>sur</strong> des savoirs théoriquement établis.<br />
C’est, pourrait-on dire, l’ouverture au règne de l’arbitraire <strong>et</strong> de l’amateu risme. C’est<br />
également <strong>la</strong> base d’un profond questionnement <strong>sur</strong> <strong>la</strong> légitimité effective de mon<br />
action professionnelle.<br />
volume XXXIX:1, printemps 2011<br />
129<br />
www.<strong>acelf</strong>.ca
<strong>Discours</strong> <strong>sur</strong> <strong>la</strong> réussite <strong>et</strong> <strong>pratiques</strong> d’évaluation<br />
Conclusion<br />
Ce qui ressort d’abord de ces quatre situations, c’est qu’il y a des contradictions<br />
difficilement contournables entre le discours <strong>sur</strong> <strong>la</strong> réussite sco<strong>la</strong>ire <strong>et</strong> les <strong>pratiques</strong><br />
d’évaluation visant à valider c<strong>et</strong>te réussite. Mais on ne peut considérer qu’il s’agit là<br />
seulement de <strong>pratiques</strong> désuètes, puisque les exigences liées aux politiques d’évalua -<br />
tion soutiennent, voire imposent activement ces <strong>pratiques</strong>. Ce qui rend c<strong>et</strong> état contradictoire<br />
difficile est que le discours est, de manière générale, conforme aux valeurs<br />
<strong>et</strong> aux croyances des enseignants <strong>et</strong> des élèves. En même temps, ils ne peuvent<br />
adhérer à ce discours, puisque, face à <strong>la</strong> réalité des <strong>pratiques</strong>, ce discours est cons -<br />
tamment invalidé. De plus, <strong>la</strong> conséquence de demeurer à cheval entre « le dire <strong>et</strong> le<br />
faire » (Meirieu, 1995) pose des problèmes jusqu’au niveau de l’identité des personnes<br />
concernées. À ce suj<strong>et</strong>, on constate que le récent avis <strong>sur</strong> « L’évaluation au service des<br />
apprentissages <strong>et</strong> de <strong>la</strong> réussite de l’élève » (CSE, 2010) ne considère aucunement ces<br />
aspects du problème.<br />
Par ailleurs, si le discours dominant est en accord avec nos valeurs, nos croyances<br />
<strong>et</strong> nos aspirations en tant qu’enseignants, pourquoi alors ne nous appuyons-nous<br />
pas <strong>sur</strong> ce discours pour créer de nouvelles <strong>pratiques</strong> conformes à ce que nous<br />
voulons Pourquoi est-ce si souvent <strong>et</strong> si facilement <strong>la</strong> pratique contradictoire qui<br />
prend le dessus C<strong>et</strong>te question est complexe. D’abord, <strong>la</strong> pratique est toujours<br />
partiel lement conscientisée (Vermersch, 2003). Or, plus l’action est pressante, par<br />
exemple dans le monde de l’éducation, plus les réflexes sont mis en avant <strong>et</strong> moins<br />
<strong>la</strong> réflexion peut opérer. Mais ce qui complique davantage les choses, c’est que,<br />
comme on l’a constaté, plusieurs niveaux logiques (Dilts, Hallbom <strong>et</strong> Smith, 1990)<br />
sont en cause. Les politiques traitent généralement des structures <strong>et</strong> les formations<br />
en éducation traitent généralement seulement du niveau des stratégies <strong>et</strong> parfois<br />
aussi du niveau du contexte. Mais le discours est aussi porteur de valeurs <strong>et</strong> il touche<br />
également aux croyances <strong>et</strong> à l’identité. Dans une situation où il y a contradiction<br />
entre ces différents niveaux, il y a deux issues possibles : <strong>la</strong> perte de sens à plus ou<br />
moins long terme ou l’innovation.<br />
Mais l’innovation implique des risques <strong>et</strong> <strong>la</strong> personne fragilisée <strong>sur</strong> le p<strong>la</strong>n de<br />
ses valeurs ou de son identité n’est pas en position pour assumer ces risques. Alors <strong>la</strong><br />
contradiction va en s’amplifiant. C<strong>et</strong>te dynamique ne s’applique pas seulement à<br />
l’individu, mais également à <strong>la</strong> dynamique de l’équipe de travail. Selon mon expé -<br />
rience, pour plusieurs enseignants qui désirent innover <strong>la</strong> principale difficulté ne<br />
vient pas du système en p<strong>la</strong>ce, mais d’une recherche du statu quo au sein de<br />
l’équipe-école.<br />
Pour conclure, peut-être notre époque postmoderne est-elle réellement marquée<br />
par <strong>la</strong> fin des grands récits (Lyotard, 1979). Selon Meirieu (1993), le discours<br />
pédagogique aurait pour fonction d’inspirer l’action <strong>et</strong> ne pourrait être compris que<br />
comme « discours de <strong>la</strong> contradiction éducative » (Meirieu, 1993, p. 20). On peut ainsi<br />
en déduire que c’est en vou<strong>la</strong>nt ignorer les inévitables contradictions avec <strong>la</strong> pratique<br />
que les discours <strong>sur</strong> <strong>la</strong> réussite en viennent à être tellement enrageants pour les<br />
enseignants, quand ils ne sont pas carrément reçus comme des aveux d’impuissance<br />
volume XXXIX:1, printemps 2011<br />
130<br />
www.<strong>acelf</strong>.ca
<strong>Discours</strong> <strong>sur</strong> <strong>la</strong> réussite <strong>et</strong> <strong>pratiques</strong> d’évaluation<br />
(Decobert, 1998). Mais je ne connais aucun enseignant qui n’a pas besoin de créer du<br />
sens au travers de sa pratique. C’est là à mon avis <strong>la</strong> seule voix prom<strong>et</strong>teuse. Être en<br />
me<strong>sur</strong>e pour l’enseignant <strong>et</strong> aussi pour l’élève de créer un discours sensé qui soit issu<br />
d’une pratique cohérente <strong>et</strong> qui soit en même temps le germe d’une pratique créative,<br />
aussi créative en fait que les élèves peuvent le demander. Dans c<strong>et</strong>te perspective,<br />
le seul discours possible <strong>sur</strong> <strong>la</strong> réussite en est un qui tient d’abord compte des difficultés<br />
<strong>et</strong> des échecs comme conditions premières de tout apprentissage. J’ai le sentiment<br />
qu’on en est encore loin (CSE, 2010).<br />
Références bibliographiques<br />
ASSEMBLÉE NATIONALE (2005). Proj<strong>et</strong> de loi no 142 : Loi concernant les conditions<br />
de travail dans le secteur public. Éditeur officiel du Québec. [En ligne].<br />
[http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/<br />
telecharge.phptype=5&file=2005C43F.PDF[<br />
BENASAYAG, M. <strong>et</strong> SCHMIT, G. (2006). Les passions tristes : souffrance psychique <strong>et</strong><br />
crise sociale. Paris : La Découverte.<br />
BLAIS, M.-C., GAUCHET, M. <strong>et</strong> OTTAVI, D. (2008). Les conditions de l’éducation.<br />
Paris : Stock.<br />
BOUCHARD, J. (2002). Pourquoi le suicide Radio-Canada – Bas-Saint-Laurent.<br />
Rimouski : CJBR. Émission de radio.<br />
CAOUETTE, Ch. E. (1997). Éduquer. Pour <strong>la</strong> vie! Montréal : Écosociété.<br />
CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION (CSE) (2004). Un nouveau souffle pour <strong>la</strong><br />
profession enseignante. Avis au ministre de l’Éducation. Québec :<br />
Gouvernement du Québec.<br />
CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION (CSE) (2010). Pour une évaluation au<br />
service des apprentissages <strong>et</strong> de <strong>la</strong> réussite des élèves. Avis au ministre de<br />
l’Éducation. Québec : Gouvernement du Québec.<br />
DE CHAMPLAIN, Y. (2008). Le sentiment d’éduquer : une approche acousmatique de<br />
conscientisation du geste pédagogique d’un enseignant en musique au primaire.<br />
Thèse de doctorat en psychopédagogie. Québec : Université Laval.<br />
DECOBERT, N. (1998). L<strong>et</strong>tre à Franca (Journal d’une enseignante). Brossard :<br />
Humanitas.<br />
DILTS, R., HALLBOM, T. <strong>et</strong> SMITH, S. (1990). Beliefs: Pathways to Health &<br />
Well-Being. Port<strong>la</strong>nd, OR : M<strong>et</strong>amorphous Press.<br />
volume XXXIX:1, printemps 2011<br />
131<br />
www.<strong>acelf</strong>.ca
<strong>Discours</strong> <strong>sur</strong> <strong>la</strong> réussite <strong>et</strong> <strong>pratiques</strong> d’évaluation<br />
FAINGOLD, N. (1998). De l’explicitation des <strong>pratiques</strong> à <strong>la</strong> problématique de<br />
l’identité professionnelle : décrypter les messages structurants. Expliciter, 26,<br />
17-20.<br />
FAINGOLD, N. (2004). Explicitation, décryptage du sens, enjeux identitaires.<br />
Éducation permanente, 160, 81-99.<br />
FERNEYHOUGH, B. (1987). Le temps de <strong>la</strong> figure. Entr<strong>et</strong>emps, 3, 127-136.<br />
GADAMER, H.-G. (1976). Qu’est-ce que <strong>la</strong> praxis Les conditions de <strong>la</strong> raison<br />
sociale. Dans F. Couturier <strong>et</strong> al. (dir.), Herméneutique : traduire-interpréter-agir<br />
(p. 13-34). Montréal : Fides.<br />
LYOTARD, J.-F. (1979). La condition postmoderne. Paris : Minuit.<br />
MEIRIEU, Ph. (1992). Enseigner, scénario pour un nouveau métier. Paris : ESF.<br />
MEIRIEU, Ph. (1993). Le statut de <strong>la</strong> pédagogie dans <strong>la</strong> réflexion éducative<br />
contemporaine ou « À quelles conditions <strong>la</strong> pédagogie peut-elle encore espérer<br />
changer l’École ». Allocution présentée à <strong>la</strong> Société suisse de recherche en<br />
éducation. [En ligne]. [http://www.meirieu.com/ARTICLES/locarno93.pdf].<br />
MEIRIEU, Ph. (1995). La pédagogie entre le dire <strong>et</strong> le faire : le courage des<br />
commencements. Paris : ESF.<br />
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION (1993). Loi <strong>sur</strong> l’instruction publique (à jour au<br />
1 er février 2011). Éditeur officiel du Québec. [En ligne].<br />
[http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.<br />
phptype=2&file=/I_13_3/I13_3.html].<br />
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT (2007). La valeur<br />
accordée au jugement professionnel des enseignants : questions <strong>et</strong> éléments de<br />
réponse. Principales références dans les encadrements ministériels. Québec :<br />
MELS.<br />
PENNAC, D. (2007). Chagrin d’école. Paris : Gallimard.<br />
PERRENOUD, Ph. (1996). Enseigner : agir dans l’urgence, décider dans l’incertitude.<br />
Savoirs <strong>et</strong> compétences dans un métier complexe. Paris : ESF.<br />
REY, A. (dir.) (2000). Le Robert historique de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue française. Paris : Dictionnaires<br />
Le Robert.<br />
ROYER, É. (2006). Le chuchotement de Galilée : perm<strong>et</strong>tre aux jeunes difficiles de<br />
réussir à l’école. Québec : École <strong>et</strong> comportement.<br />
SIMARD, D. (1999). Postmodernité, herméneutique <strong>et</strong> culture : les défis culturels de <strong>la</strong><br />
pédagogie. Thèse de doctorat. Québec : Université Laval.<br />
VERMERSCH, P. (2003). L’entr<strong>et</strong>ien d’explicitation (4 e édition enrichie d’un<br />
glossaire). Paris : ESF.<br />
volume XXXIX:1, printemps 2011<br />
132<br />
www.<strong>acelf</strong>.ca