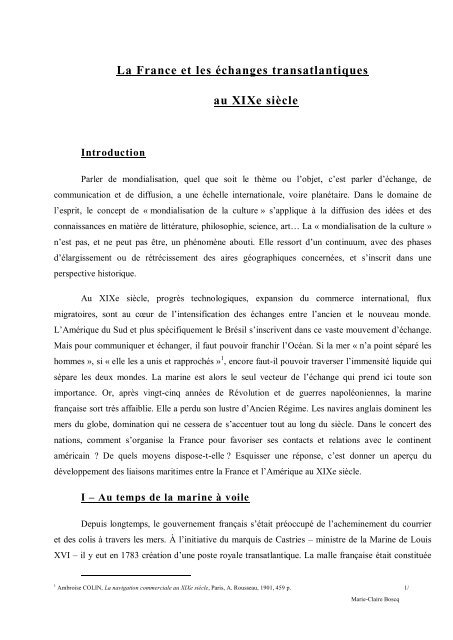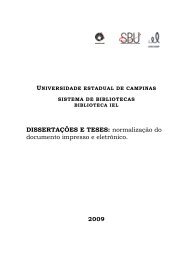La France et les échanges transatlantiques au XIXe siècle - IEL
La France et les échanges transatlantiques au XIXe siècle - IEL
La France et les échanges transatlantiques au XIXe siècle - IEL
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>La</strong> <strong>France</strong> <strong>et</strong> <strong>les</strong> échanges <strong>transatlantiques</strong><br />
<strong>au</strong> <strong>XIXe</strong> siècle<br />
Introduction<br />
Parler de mondialisation, quel que soit le thème ou l’obj<strong>et</strong>, c’est parler d’échange, de<br />
communication <strong>et</strong> de diffusion, a une échelle internationale, voire planétaire. Dans le domaine de<br />
l’esprit, le concept de « mondialisation de la culture » s’applique à la diffusion des idées <strong>et</strong> des<br />
connaissances en matière de littérature, philosophie, science, art… <strong>La</strong> « mondialisation de la culture »<br />
n’est pas, <strong>et</strong> ne peut pas être, un phénomène abouti. Elle ressort d’un continuum, avec des phases<br />
d’élargissement ou de rétrécissement des aires géographiques concernées, <strong>et</strong> s’inscrit dans une<br />
perspective historique.<br />
Au <strong>XIXe</strong> siècle, progrès technologiques, expansion du commerce international, flux<br />
migratoires, sont <strong>au</strong> cœur de l’intensification des échanges entre l’ancien <strong>et</strong> le nouve<strong>au</strong> monde.<br />
L’Amérique du Sud <strong>et</strong> plus spécifiquement le Brésil s’inscrivent dans ce vaste mouvement d’échange.<br />
Mais pour communiquer <strong>et</strong> échanger, il f<strong>au</strong>t pouvoir franchir l’Océan. Si la mer « n’a point séparé <strong>les</strong><br />
hommes », si « elle <strong>les</strong> a unis <strong>et</strong> rapprochés » 1 , encore f<strong>au</strong>t-il pouvoir traverser l’immensité liquide qui<br />
sépare <strong>les</strong> deux mondes. <strong>La</strong> marine est alors le seul vecteur de l’échange qui prend ici toute son<br />
importance. Or, après vingt-cinq années de Révolution <strong>et</strong> de guerres napoléoniennes, la marine<br />
française sort très affaiblie. Elle a perdu son lustre d’Ancien Régime. Les navires anglais dominent <strong>les</strong><br />
mers du globe, domination qui ne cessera de s’accentuer tout <strong>au</strong> long du siècle. Dans le concert des<br />
nations, comment s’organise la <strong>France</strong> pour favoriser ses contacts <strong>et</strong> relations avec le continent<br />
américain De quels moyens dispose-t-elle Esquisser une réponse, c’est donner un aperçu du<br />
développement des liaisons maritimes entre la <strong>France</strong> <strong>et</strong> l’Amérique <strong>au</strong> <strong>XIXe</strong> siècle.<br />
I – Au temps de la marine à voile<br />
Depuis longtemps, le gouvernement français s’était préoccupé de l’acheminement du courrier<br />
<strong>et</strong> des colis à travers <strong>les</strong> mers. À l’initiative du marquis de Castries – ministre de la Marine de Louis<br />
XVI – il y eut en 1783 création d’une poste royale transatlantique. <strong>La</strong> malle française était constituée<br />
1 Ambroise COLIN, <strong>La</strong> navigation commerciale <strong>au</strong> <strong>XIXe</strong> siècle, Paris, A. Rousse<strong>au</strong>, 1901, 459 p. 1/<br />
Marie-Claire Boscq
de navires appareillant de Port-Louis, en face de Lorient, à destination de New-York, tous <strong>les</strong><br />
troisièmes mardis du mois. Si la navigation à voi<strong>les</strong> ne perm<strong>et</strong>tait pas d’assurer à date fixe l’arrivée des<br />
navires, <strong>au</strong> moins pouvait-elle planifier <strong>les</strong> départs. En 1786, d’<strong>au</strong>tres lignes furent créées. <strong>La</strong> <strong>France</strong><br />
fut ainsi mise en rapport avec ses colonies <strong>et</strong> <strong>les</strong> Etats-Unis d’Amérique. Les premiers « paquebots » 2<br />
embarquaient, outre la malle royale <strong>et</strong> le fr<strong>et</strong>, quelques passagers. Mais <strong>les</strong> frais occasionnés par<br />
l’exploitation de ces lignes amenèrent leur suppression peu après leur création. Le 5 juill<strong>et</strong> 1788, un<br />
arrêté porta suppression des paquebots de la poste royale. Dès lors, l’état continua d’assurer le<br />
transport des correspondances par mer, en enjoignant <strong>au</strong>x capitaines de navires marchands de<br />
transporter <strong>les</strong> dépêches 3 , comme cela se faisait <strong>au</strong>paravant pour <strong>les</strong> colonies outre-Atlantique 4 . Les<br />
traversées s’effectuaient alors <strong>au</strong> gré des navires en partance. Les ports d’où l’on pouvait s’embarquer<br />
étaient <strong>au</strong> nombre de trente 5 . C’est à partir de Saint-Malo que, le 8 avril 1791, Chate<strong>au</strong>briand<br />
s’embarqua pour l’Amérique sur un brigantin 6 en partance pour Terre-Neuve. A son bord, il y avait 17<br />
passagers, dont 4 prêtres qui fuyaient la Révolution 7 . Comme le dit A. Colin, « A la fin du XVIIIe <strong>et</strong> <strong>au</strong><br />
commencement du <strong>XIXe</strong> siècle, la marine marchande [française], à be<strong>au</strong>coup d’égards, était une industrie dans l’enfance.<br />
Elle ne différait pas énormément de ce qu’elle avait été à l’époque de Louis XIV » 8 .<br />
Ce sont <strong>les</strong> Américains qui établirent dès 1816 une première ligne régulière de paquebots<br />
<strong>transatlantiques</strong> à partir du Havre 9 , basée sur la mise en service de « clippers » 10 . Ils furent très vite<br />
concurrencés par des compagnies anglaises qui organisèrent des services périodiques de voiliers à<br />
travers l’Océan Atlantique à destination de New-York. <strong>La</strong> première de ces compagnies fut la Black<br />
Ball (1820) qui établit une ligne entre Liverpool <strong>et</strong> New-York. Elle fut suivit peu après par d’<strong>au</strong>tres<br />
2 Le mot français « paquebot » vient de l’anglais : « pack<strong>et</strong>-boat », bate<strong>au</strong> pour <strong>les</strong> transports des colis <strong>et</strong> du courrier. Le nom de « paquebot » fut donné à<br />
la fin du XVIIIème siècle <strong>au</strong> p<strong>et</strong>it vaisse<strong>au</strong> qui faisait le service de la poste <strong>et</strong> des voyageurs entre Calais <strong>et</strong> Douvres. On continua de désigner sous le nom<br />
de « paquebots » <strong>les</strong> navires faisant des voyages réguliers pour le transport des passagers, par opposition <strong>au</strong>x « cargo-boats », navires réservés <strong>au</strong> transport<br />
des marchandises.<br />
3 BOURSELET V, MARECHAL G., FRANCOIS L., GILBERT G., <strong>La</strong> Poste maritime. Les Paquebots français <strong>et</strong> leurs cach<strong>et</strong>s, 1780-1935, Paris,<br />
Editions du Graouli, 1936, p. 3.<br />
4 Cf. l’ordonnance de Louis XVI du 4 juill<strong>et</strong> 1780. « Article 2 – Les capitaines des navires, seront tenus de recevoir <strong>les</strong> sacs ou coffres qui leur seront<br />
remis par <strong>les</strong> préposés des bure<strong>au</strong>x, avant leur départ… » ; « Article 4 – Les capitaines des navires en useront dans <strong>les</strong> ports des colonies, pour la réception<br />
des sacs ou coffres qui contiendront des l<strong>et</strong>tres pour la <strong>France</strong>… » ; « Article 5 – Lesdits sacs ou coffres seront placés dans le lieu le plus sûr des navires,<br />
<strong>et</strong>, <strong>au</strong>tant que faire se pourra, dans la chambre du capitaine ».<br />
5 Ports où <strong>les</strong> navires se trouvaient en partance. Sur <strong>les</strong> côtes Atlantique ou la Manche : Bayonne, Borde<strong>au</strong>x, Boulogne, Brest, Calais, Cherbourg, Dieppe,<br />
Dunkerque, Fécamp, Granville, Honfleur, <strong>La</strong> Rochelle, Le Havre, Port Louis, Lorient, Nantes, Noirmoutiers, Quimper, Rochefort, Saint-Brieux, Saint-<br />
Malo, Saint-Valéry (Seine Maritime), Saint-Valéry (Somme). Sur la Méditerranée : Antibes, C<strong>et</strong>te, Marseille <strong>et</strong> Toulon.<br />
6 Le brigantin est un p<strong>et</strong>it navire à deux mâts.<br />
7 Marie-Hélène VIVIANI, « Le voyage de Chate<strong>au</strong>briand en Amérique », Conférence de l'Association Budé d'Orléans, 2010.<br />
8 Ambroise COLIN, op. cit., p. 153.<br />
9 Ibidem, p. 32.<br />
10 Les clippers sont des voiliers de commerce de tonnage moyen construits de façon à privilégier la vitesse. Cf. Louis BRINDEAU, Les anciens paquebots<br />
entre Le Havre <strong>et</strong> New-York, artic<strong>les</strong> publiés dans Le Journal du Havre du 22 octobre <strong>au</strong> 14 novembre 1900, Le Havre, Imprimerie du Journal Le Havre,<br />
1900, L'<strong>au</strong>teur explique, en p. 8 de son livre, que « Les clippers grand modèle, à la fois fins, longs <strong>et</strong> d’une grand capacité, doués en même temps d’une<br />
robustesse leur perm<strong>et</strong>tant d’affronter l’Atlantique par <strong>les</strong> plus gros temps, devaient transporter à la fois des passagers de cabines, des émigrants, des<br />
marchandises encombrantes (ex. coton) <strong>et</strong> des marchandises riches ».<br />
Marie-Claire Boscq<br />
2/
compagnies anglaises 11 . En 1822, la <strong>France</strong> entra dans la compétition. Un premier service régulier de<br />
paquebots fut organisé entre Le Havre <strong>et</strong> New-York. Les départs furent fixés <strong>au</strong> 20 du mois, un mois<br />
sur deux (janviers, mars, <strong>et</strong>c.) 12 . D’<strong>au</strong>tres services, partant d’Angl<strong>et</strong>erre ou de <strong>France</strong> à destination de<br />
New-York, furent également créés dans <strong>les</strong> années suivantes. Toutes ces entreprises s’appuyaient sur<br />
<strong>les</strong> améliorations apportées à la marine à voile : utilisation plus rationnelle des courants <strong>et</strong> emploi de<br />
clippers à grande voilure. Le voyage durait environ 40 jours à l’aller <strong>et</strong> 20 à 30 jours <strong>au</strong> r<strong>et</strong>our 13 .<br />
L’Administration des Postes françaises fit de nouvel<strong>les</strong> tentatives de création de services<br />
réguliers à travers l’Atlantique, tant en direction de l’Amérique du Nord que de l’Amérique du Sud.<br />
Elle conclut en 1827 avec un Sr. G<strong>au</strong>tier un contrat de service de paquebots entre Borde<strong>au</strong>x <strong>et</strong> Vera-<br />
Cruz <strong>au</strong> Mexique. En 1829, elle mit en adjudication un service entre Le Havre, le Brésil <strong>et</strong> Buenos-<br />
Aires. Mais ces contrats ne furent pas renouvelés. Les subventions d’un montant trop faible ne<br />
perm<strong>et</strong>taient pas <strong>au</strong>x adjudicataires d’investir pour modifier leurs bate<strong>au</strong>x dont l’<strong>au</strong>gmentation des<br />
performances était rendue nécessaire par la perspective du développement de la navigation à vapeur. Il<br />
f<strong>au</strong>t en eff<strong>et</strong> souligner que c’est avec le début de la marine à vapeur que la marine à voile fut amenée à<br />
faire de grands progrès pour rester concurrentielle. Au somm<strong>et</strong> de ses capacités, la voile accomplissait<br />
<strong>les</strong> plus longs traj<strong>et</strong>s à des vitesses moyennes de 7 à 9 nœuds 14 .<br />
II – Au temps de la vapeur<br />
Prémices :<br />
Les premiers essais de bate<strong>au</strong>x à vapeur eurent d’abord lieu sur des fleuves 15 . En 1829-1830,<br />
un service de bate<strong>au</strong>x à vapeur à destination de l’Egypte <strong>et</strong> des Echel<strong>les</strong> du Levant 16 fut inst<strong>au</strong>ré en<br />
Méditerranée. En fait, <strong>les</strong> bate<strong>au</strong>x à vapeur se cantonnaient <strong>au</strong> grand ou p<strong>et</strong>it cabotage. Affronter<br />
l’Océan Atlantique était une toute <strong>au</strong>tre entreprise ! Il fallait pouvoir adapter le navire à vapeur <strong>au</strong>x<br />
longues traversées océaniques. C’est l’exploit que réussit à accomplir en 1838 un navire irlandais<br />
entièrement mu par la vapeur 17 . Peu après, un deuxième navire anglais reliait Bristol à New-York en<br />
11 Compagnies Red Star Line, Swallow Tail Line <strong>et</strong> Dramatic Line. Cf. Ambroise COLIN, op. cit., p. 32.<br />
12 Louis BRINDEAU, op. cit. p. 12.<br />
13 <strong>La</strong> traversée du Havre à New-York était be<strong>au</strong>coup plus longue à c<strong>au</strong>se des différences de route. En eff<strong>et</strong>, pour venir d’Amérique en Europe, <strong>les</strong> navires<br />
à voi<strong>les</strong> profitent du courant du Gulf-Stream <strong>et</strong> des vents favorab<strong>les</strong>, tandis que pour aller d’Europe en Amérique, <strong>les</strong> navires doivent descendre plus <strong>au</strong><br />
sud pour saisir <strong>les</strong> courants <strong>et</strong> vents favorab<strong>les</strong> dans ce sens.<br />
14 Le nœud marin est l’unité de vitesse qui correspond à 1 mille à l’heure, le mille marin étant l’unité de longueur qui équiv<strong>au</strong>t à 1 852 mètres.<br />
15 En <strong>France</strong>, ce fut sur la Loire en 1803.<br />
16 « Echel<strong>les</strong> du Levant », nom donné <strong>au</strong>x ports marchands de la Méditerranée soumis à la domination turque, tels que Constantinople, Salonique,<br />
Beyrouth, Smyrne, Alep, Alexandrie, Tripoli, <strong>et</strong>c.<br />
17 Marthe BARBANCE, Histoire de la Compagnie générale transatlantique, un siècle d’exploitation maritime, Paris, Arts <strong>et</strong> Métiers graphiques, 1955, p.<br />
28. : « Parti de la rade de Cork, le bate<strong>au</strong> irlandais rentrait dans le port de New-York le 22 avril 1838 ».<br />
3/<br />
Marie-Claire Boscq
19 jours. Il fit ensuite plusieurs voyages d’aller-r<strong>et</strong>our avec des temps réduits à 13 jours à l’aller <strong>et</strong> 12<br />
<strong>au</strong> r<strong>et</strong>our. C’est à partir de ces résultats que <strong>les</strong> Anglais décidèrent de construire d’<strong>au</strong>tres paquebots,<br />
plus grands <strong>et</strong> plus rapides 18 .<br />
Dès la fin de 1838, le gouvernement anglais se mit en mesure d’établir entre <strong>les</strong> Etats-Unis <strong>et</strong><br />
l’Angl<strong>et</strong>erre une communication régulière. Il conclut avec M. Cunard un contrat en vertu duquel le<br />
concessionnaire s’engageait à desservir deux fois par mois la ligne de Liverpool à Halifax, moyennant<br />
une subvention annuelle de 45 000 livres sterling. Le service fut in<strong>au</strong>guré en 1840. <strong>La</strong> même année,<br />
l’amir<strong>au</strong>té signa un contrat avec la Royal West India Mail Steam Pack<strong>et</strong> Company pour la<br />
correspondance <strong>au</strong>x Antil<strong>les</strong>, à la Côte-Ferme 19 <strong>et</strong> <strong>au</strong> Brésil 20 . Ainsi, dès <strong>les</strong> années 1840, l’Angl<strong>et</strong>erre<br />
disposait de plusieurs compagnies à vapeur 21 . Dans <strong>les</strong> mêmes années, d’<strong>au</strong>tres compagnies<br />
européennes furent également créées 22 .<br />
<strong>La</strong> <strong>France</strong> n’avait pas encore pris place dans c<strong>et</strong>te course à la vapeur. <strong>La</strong> Revue des Deux<br />
Mondes alertait l’amour-propre national en écrivant en 1840 : « Depuis dix-huit mois, <strong>les</strong> Anglais sillonnent<br />
l’Atlantique de leurs moteurs à feu, nous sommes à nous demander si la <strong>France</strong> <strong>les</strong> y suivra » 23 . Sous l’impulsion de<br />
Thiers, alors Président du Conseil <strong>et</strong> ministre des Affaires étrangères 24 , une loi fut votée le 16 juill<strong>et</strong><br />
1840 portant création de trois lignes <strong>transatlantiques</strong> : Le Havre/New-York ; Saint-Nazaire/Rio-de-<br />
Janeiro ; <strong>et</strong> Marseille <strong>et</strong> Borde<strong>au</strong>x en direction des Antil<strong>les</strong>. Mais <strong>les</strong> préoccupations d’ordre<br />
continental du moment empêchèrent l’application de la loi 25 . Réexaminé quelque temps plus tard, le<br />
proj<strong>et</strong> parut trop coûteux <strong>et</strong> fut abandonné. « Les passions à nouve<strong>au</strong> se déchaînèrent, attisées par <strong>les</strong> partisans de la<br />
voile qui refusaient de mourir […]. À l’affrontement voile contre vapeur, ports contre ports, lignes d’Etat contre lignes<br />
privées, se superposaient des problèmes techniques complexes : roues à <strong>au</strong>be, ou hélice Coques de bois, ou de fer […]<br />
Des années s’écoulèrent <strong>et</strong> <strong>les</strong> Français, de plus en plus nombreux, qui voulaient aller en Amérique étaient contraints de<br />
passer un mois en mer à bord d’un voilier de fr<strong>et</strong>, ou d’aller en Angl<strong>et</strong>erre prendre le pack<strong>et</strong> 26 de M. Cunard » 27 .<br />
18 Louis BRINDEAU, op. cit. p. 18.<br />
19 « Côte-Ferme » est le nom donné par <strong>les</strong> premiers explorateurs <strong>au</strong> littoral de l’Amérique du Sud allant du golfe d’Uruba à l’embouchure de l’Orénoque.<br />
20 C. LAVOLLEE, « Des Voies Maritimes, Les paquebots <strong>transatlantiques</strong> », Revue des Deux Mondes, janvier 1853, p. 714.<br />
21 Royal Mail sur l’Atlantique sud ; Cunard sur l’Atlantique nord ; Peninsular and Oriental Company en Méditerranée <strong>et</strong> en Extrême Orient.<br />
22 Marie-Françoise BERNERON-COUVENHES, Les Messageries Maritimes : l’essor d’une grande compagnie de navigation française. 1851-1894,<br />
Paris, PUPS (Presses Universitaires Paris Sorbonne), 2007, p. 31, cite <strong>les</strong> compagnies suivantes : Lloyd <strong>au</strong>trichien, fondée en 1836 <strong>et</strong> Hamburg Amerika<br />
Linie, fondée en 1847.<br />
23 Cité par Marthe BARBANCE, op. cit., p. 30.<br />
24 Adolphe Thiers fut Président du Conseil <strong>et</strong> ministre des Affaires étrangères du 22 février <strong>au</strong> 6 septembre 1836 <strong>et</strong> du 1 er mars <strong>au</strong> 29 octobre 1840, outre<br />
<strong>les</strong> <strong>au</strong>tres ministères qu’il occupa sous la monarchie de Juill<strong>et</strong>.<br />
25 Il s’agit de la Question d’Orient qui oppose le pacha d’Egypte, Mehem<strong>et</strong> Ali, <strong>au</strong> sultan de l’empire Ottoman... Par le jeu des alliances, c’est la<br />
suprématie occidentale qui est en jeu, notamment en Méditerranée. Ces questions provoquent l’isolement diplomatique de la <strong>France</strong>. THIERS n’exclut pas<br />
le risque d’une nouvelle guerre continentale. Durant l’été 1840, soutenue par l’opinion publique, la <strong>France</strong> décide de réarmer : des crédits extraordinaires<br />
sont votés <strong>et</strong> la décision d’entourer Paris de fortifications est prise...<br />
26 Pack<strong>et</strong> ou « pack<strong>et</strong>-boat », c’est-à-dire le paquebot.<br />
Marie-Claire Boscq
Début 1847, deux armateurs du Havre, Hérout <strong>et</strong> de Handel, constituèrent la Compagnie<br />
Générale des paquebots <strong>transatlantiques</strong> pour assurer deux liaisons Cherbourg/New-York <strong>et</strong> Saint-<br />
Nazaire/Amérique Centrale. Malheureusement, leurs bate<strong>au</strong>x, des frégates 28 trop lourdes <strong>et</strong> trop lentes,<br />
n’étaient pas adaptées <strong>au</strong> service demandé <strong>et</strong> « l’Etat ne lui accordant <strong>au</strong>cune subvention, elle dut suspendre son<br />
exploitation, le dernier départ eut lieu le 23 décembre 1847 » 29 . Dans ces mêmes années, d’<strong>au</strong>tres p<strong>et</strong>ites<br />
compagnies françaises de voiliers d’armateurs-négociants, tentèrent également de passer à la vapeur.<br />
Mais nombre disparurent f<strong>au</strong>te de capit<strong>au</strong>x privés suffisants pour soutenir la compétition avec ce<br />
nouve<strong>au</strong> mode de propulsion 30 .<br />
Ainsi, <strong>au</strong> milieu du siècle, <strong>les</strong> liaisons <strong>transatlantiques</strong> françaises restaient inexistantes. Ce n’est<br />
que dans la deuxième moitié du <strong>XIXe</strong> siècle que furent élaborés de nouve<strong>au</strong>x proj<strong>et</strong>s. Entre-temps, <strong>les</strong><br />
traversées furent assumées exclusivement par <strong>les</strong> Etats-Unis <strong>et</strong> la Grande-Br<strong>et</strong>agne. Dans son numéro<br />
de janvier 1853, la Revue des Deux Mondes se fit à nouve<strong>au</strong> le chantre de la nécessité de développer<br />
des lignes régulières de paquebots <strong>transatlantiques</strong>. « <strong>La</strong> <strong>France</strong> a jusqu’ici abandonné l’exploitation de ces<br />
vastes domaines, <strong>et</strong> <strong>les</strong> roues de ses paquebots ne connaissent encore que <strong>les</strong> flots de la Méditerranée […]. Notre intérêt <strong>et</strong><br />
notre honneur exigent que la solution ne se fasse plus attendre » 31 .<br />
Exploitation commerciale :<br />
Après <strong>les</strong> tâtonnements initi<strong>au</strong>x, la <strong>France</strong> allait enfin s’ouvrir à l’exploitation commerciale de<br />
la navigation à vapeur transatlantique. Les « chemins de fer de l’Océan » allaient devenir une réalité<br />
française. En une vingtaine d’années, de 1850 <strong>au</strong> début des années 1870, plusieurs compagnies<br />
maritimes furent créées. Toutes s’inscrivent dans le sillage de la grande banque <strong>et</strong> de la grande<br />
industrie. Ce n’est qu’à partir de ces compagnies nouvel<strong>les</strong> que furent établies des liaisons régulières<br />
avec <strong>les</strong> trois Amériques : Nord, Centre <strong>et</strong> Sud. Cf. l’annexe 1 qui présente de façon sommaire <strong>les</strong><br />
principa<strong>les</strong> compagnies françaises créées de 1850 <strong>au</strong> début du XXe siècle.<br />
Monopole des services post<strong>au</strong>x<br />
27 Jean-Jacques ANTIER, Au temps des premiers paquebos à vapeur, Paris, Editions <strong>France</strong>-Empire, 1982, p. 171. 4/<br />
28 <strong>La</strong> frégate était un bâtiment à voi<strong>les</strong> de la marine de guerre, à trois mâts. Les premiers bate<strong>au</strong>x à vapeur étaient des bate<strong>au</strong>x mixtes où <strong>les</strong> voi<strong>les</strong> étaient<br />
conservées avec la machine à vapeur. Cela devait perm<strong>et</strong>tre, en cas d’avarie, de pouvoir continuer à naviguer.<br />
29 Marthe BARBANCE, op. cit., p. 31.<br />
30 Jean RANDIER, Histoire de la marine marchande française : des premiers vapeurs à nos jours, Paris, Editions maritimes <strong>et</strong> d’outre-mer, 1980, p.<br />
264.<br />
31 C. LAVOLLEE, op. cit., pp. 708-709.<br />
Marie-Claire Boscq<br />
5/
<strong>La</strong> loi du 17 juin 1857 <strong>au</strong>torisa la concession de liaisons posta<strong>les</strong> <strong>transatlantiques</strong>. Toutefois,<br />
devant l’impossibilité financière de n’avoir qu’une seule compagnie, le ministre des Finances, Achille<br />
Fould, décida de scinder le service transatlantique en trois lots destinés <strong>au</strong>x lignes principa<strong>les</strong> : New-<br />
York, Mexique <strong>et</strong> Brésil 32 . Les deux premières lignes, Etats-Unis <strong>et</strong> Amérique Centrale, furent<br />
concédées par décr<strong>et</strong> du 20 février 1858 à la Compagnie Marziou, dite Union Maritime. Les<br />
Messageries Impéria<strong>les</strong> obtinrent la concession de la ligne postale du Brésil <strong>et</strong> de <strong>La</strong> Plata.<br />
<strong>La</strong> Compagnie Générale Transatlantique des frères Pereire n’obtint rien. Toutefois, la Compagnie<br />
Marziou, ne parvenant pas à constituer son capital, se désista en leur faveur le 6 octobre 1860. Les<br />
frères Pereire devinrent alors définitivement concessionnaires des lignes de New-York, du Mexique <strong>et</strong><br />
des Antil<strong>les</strong>.<br />
Les Messageries Impéria<strong>les</strong> signèrent le 16 septembre 1857 la convention de la concession<br />
obtenue pour <strong>les</strong> services post<strong>au</strong>x à destination de l’Amérique du Sud. Celle-ci devait durer 20 ans à<br />
partir de l’in<strong>au</strong>guration qui eut lieu le 25 mai 1860. El<strong>les</strong> s’engageaient à exécuter le parcours jusqu’à<br />
Rio-de-Janeiro en alternant tous <strong>les</strong> quinze jours <strong>les</strong> départs depuis Borde<strong>au</strong>x <strong>et</strong> Marseille 33 . S’ajoutait<br />
le service de <strong>La</strong> Plata, de Rio-de-Janeiro à Montevideo <strong>et</strong> Buenos-Aires. Pour de tel<strong>les</strong> traversées, le<br />
problème essentiel résidait dans l’approvisionnement en charbon. Les distances importantes<br />
impliquaient de charger <strong>les</strong> quantités de charbon nécessaires à la combustion des machines d’un port à<br />
l’<strong>au</strong>tre. Un peu plus de 4 000 mil<strong>les</strong> 34 séparent Pernambouc de Borde<strong>au</strong>x, plus de 5 000 pour Rio <strong>et</strong><br />
6200 pour Buenos-Aires. Il était donc impératif de faire le plein de charbon avant d’affronter la pleine<br />
mer.<br />
Intensification des échanges<br />
De 1860 à 1867, <strong>les</strong> Messageries Impéria<strong>les</strong> furent la seule compagnie française sur c<strong>et</strong>te route<br />
de l’Océan. À partir de 1867, la Société Générale de Transports Maritimes créa une ligne vers le<br />
Brésil <strong>et</strong> <strong>La</strong> Plata. Sept compagnies européennes desservaient alors le Brésil <strong>et</strong> l’Amérique du Sud 35 .<br />
En 1873, une troisième compagnie française, la Compagnie des Chargeurs Réunis, s’invita dans la<br />
compétition. Elle mit en service une ligne desservant Bahia, Rio-de-Janeiro, Montevideo, Buenos-<br />
Aires <strong>et</strong>, avec transbordement, Rosario.<br />
32 Marie-Françoise BERNERON-COUVENHES, op. cit., p. 129.<br />
33 <strong>La</strong> desserte à partir de Marseille était due <strong>au</strong> fait que <strong>les</strong> Messageries Impéria<strong>les</strong> avaient dû s’associer à Compagnie de Navigation Mixe, dirigée par J.B.<br />
Pastré, alors Président de la Chambre de Commerce <strong>et</strong> d’Industrie de Marseille, pour obtenir la concession des services post<strong>au</strong>x de l’Atlantique. (Archives<br />
de l’Association French Line – 1997-002-5199 : AG du 5 septembre 1857).<br />
34 Environ 7 500 kms.<br />
35 2 allemandes (Hamburg Amerika <strong>et</strong> Norddeutscher Lloyd) ; 3 anglaises (Royal Mail ; Red Cross Line <strong>et</strong> Booth Line) <strong>et</strong> 2 françaises (Messageries<br />
Impéria<strong>les</strong> <strong>et</strong> Société Générale de Transports Maritimes).<br />
Marie-Claire Boscq<br />
6/
Dans le dernier tiers du <strong>XIXe</strong> siècle, <strong>les</strong> échanges <strong>France</strong>-Brésil <strong>et</strong> Amérique du Sud<br />
s’intensifièrent. Au-delà des services post<strong>au</strong>x, il fallait assurer le transport des passagers <strong>et</strong> du fr<strong>et</strong>. <strong>La</strong><br />
navigation à vapeur devenait synonyme de rapidité <strong>et</strong> régularité. Départs comme arrivées pouvaient<br />
être planifiés, sur des traj<strong>et</strong>s fixes, avec des rotations fréquentes, <strong>et</strong> des temps de traversée raccourcis.<br />
Les hommes d’affaires traversaient de plus en plus souvent l’Océan <strong>et</strong> l’émigration apportait un flot<br />
continu <strong>et</strong> massif d’Européens aspirant <strong>au</strong> nouve<strong>au</strong> monde. Le trafic des marchandises pris de<br />
l’ampleur avec <strong>les</strong> progrès de l’industrialisation : exportations de produits manufacturés <strong>et</strong><br />
importations de matières premières (coton ; riz ; maïs ; viande de bœuf ; caoutchouc…). Ainsi, la<br />
construction des chemins de fer argentins qui nécessitait l’acheminement d’un matériel lourd, amena<br />
<strong>les</strong> Chargeurs Réunis à affréter <strong>et</strong> à construire de nouve<strong>au</strong>x navires. Deux des bate<strong>au</strong>x construits en<br />
1877 pour son compte devaient pouvoir contenir 44 cabines de premières classes, 16 à 20 cabines de<br />
seconde classe <strong>et</strong> 300 émigrants ainsi que 2 100 tonnes de port en lourd 36 37 .<br />
Itinéraires, temps de parcours <strong>et</strong> aperçu des prix de passage<br />
Les itinéraires suivis varient peu d’une compagnie à l’<strong>au</strong>tre. Pour <strong>les</strong> Messageries Impéria<strong>les</strong>,<br />
la route à partir de Borde<strong>au</strong>x est la suivante : Lisbonne, I<strong>les</strong> Canaries, Saint-Vincent du Cap Vert<br />
(escale charbonnière), Pernambouc, Bahia, Rio-de-Janeiro. En 1866, l’escale charbonnière de Saint-<br />
Vincent est remplacée par celle de Gorée. Une ligne annexe prolonge la principale à partir de Rio-de-<br />
Janeiro en direction de Montevideo <strong>et</strong> Buenos-Aires.<br />
Dans <strong>les</strong> années 1870-80, <strong>les</strong> Messageries Maritimes 38 assurent un départ tous <strong>les</strong> quinze jours<br />
à partir de Borde<strong>au</strong>x. Il f<strong>au</strong>t 20 jours pour atteindre Rio-de-Janeiro, <strong>et</strong> 5 à 6 jours supplémentaires pour<br />
Buenos Aires. Quand Pernambouc <strong>et</strong> Bahia se rajoutent à la route, il f<strong>au</strong>t 2 jours de plus pour atteindre<br />
Rio. En 1896, de Borde<strong>au</strong>x à Rio, il ne f<strong>au</strong>t plus que 16 jours, puis 13 en 1914 39 . Ces gains de temps<br />
de la traversée témoignent des progrès techniques accomplis en moins de trente ans par la marine à<br />
vapeur.<br />
D’après <strong>les</strong> quelques tarifs consultés, il semble que ceux-ci ne soient pas très différents d’une<br />
compagnie à l’<strong>au</strong>tre. Ils sont à peu près stab<strong>les</strong> de 1870 à la veille de 1914, <strong>et</strong> s’échelonnent d’environ<br />
800 francs pour une cabine de 1 ère classe à 200 francs pour un tarif émigrant. Toutefois, à ces tarifs de<br />
36 Jean BEAUGE <strong>et</strong> René-Pierre COGAN, Histoire maritime des Chargeurs Réunis <strong>et</strong> de leurs filia<strong>les</strong>, Paris, Barré-Dayez, 1984, p. 27.<br />
37 Le port en lourd d’un navire représente le chargement maximum qu’il peut emporter.<br />
38 Les Messageries Impéria<strong>les</strong> deviennent en 1871 <strong>les</strong> Messageries Maritimes.<br />
39 Au début du XXe s. la vitesse des bate<strong>au</strong>x à vapeur de 20 nœuds devient courante, contre 7 à 9 pour <strong>les</strong> voiliers <strong>les</strong> plus performants.<br />
7/<br />
Marie-Claire Boscq
ase s’ajoutent des prix spéci<strong>au</strong>x <strong>et</strong> suppléments qui peuvent multiplier par dix <strong>et</strong> plus le prix de la<br />
traversée. Ainsi, pour des appartements de luxe ou de grand luxe qui comprennent, par exemple,<br />
chambre, salon, salle à manger, bain, W.-C., salle de bagages, y compris le passage d’un domestique.<br />
Parmi <strong>les</strong> différentes options proposées, il y a la transformation de cabines en bure<strong>au</strong> de travail, salle<br />
de bains, <strong>et</strong>c., tous aménagements redevab<strong>les</strong> de tarifs spéci<strong>au</strong>x.<br />
Conclusion<br />
Dans le dernier tiers du <strong>XIXe</strong> siècle, la <strong>France</strong> tente de combler le r<strong>et</strong>ard qu’elle a accumulé<br />
depuis <strong>les</strong> années 1830-1840 par rapport <strong>au</strong>x armements anglais, allemands <strong>et</strong> <strong>au</strong>tres. Plusieurs<br />
compagnies maritimes françaises nouvel<strong>les</strong> inst<strong>au</strong>rent des liaisons régulières avec le Brésil <strong>et</strong> plus<br />
généralement avec l’Amérique du Sud. <strong>La</strong> grande banque <strong>et</strong> la grande industrie investissent dans ces<br />
nouvel<strong>les</strong> compagnies qu’el<strong>les</strong> impulsent, certaines d’entre-el<strong>les</strong> bénéficiant de surcroît de subventions<br />
posta<strong>les</strong>. Ce sont ces compagnies qui assurent le développement <strong>et</strong> le succès de ces « chemins de fer de<br />
l’Océan », tant attendus depuis 1840. Les améliorations techniques permanentes diminuent <strong>les</strong> temps<br />
de traj<strong>et</strong> 40 , tant <strong>et</strong> si bien qu’à la veille de la première guerre mondiale, il ne f<strong>au</strong>t plus qu’environ treize<br />
jours, partant de <strong>France</strong>, pour rejoindre Rio-de-Janeiro. Au-delà de l’honneur <strong>et</strong> de l’amour propre<br />
français, ce sont <strong>les</strong> intérêts commerci<strong>au</strong>x qui sont en jeu. Comme le rappelle A. Colin, <strong>les</strong> transports<br />
maritimes ne peuvent être actifs <strong>et</strong> rémunérateurs que lorsqu’ils aboutissent à des pays prospères <strong>et</strong><br />
riches, ayant de grandes quantités de marchandises à exporter 41 . Ce sont <strong>les</strong> débouchés qui créent la<br />
ligne, <strong>et</strong>, eff<strong>et</strong> de r<strong>et</strong>our, comme le dit l’adage marin « la marchandise suit le pavillon ».<br />
En 1834, dans l’Annuaire du commerce maritime, L. Maise<strong>au</strong> prédisait : « <strong>La</strong> librairie française<br />
deviendra d’une grande importance par suite du développement que prend l’usage de notre langue <strong>au</strong> Brésil » 42 . Encore<br />
fallait-il acheminer la « marchandise culturelle », livres, revues <strong>et</strong> journ<strong>au</strong>x. Comme toute <strong>au</strong>tre<br />
marchandise, la librairie va profiter de l’extraordinaire développement des « nob<strong>les</strong> <strong>et</strong> fraternels navires,<br />
instruments de civilisation, de commerce <strong>et</strong> de paix » 43 qui caractérise le passage de la marine à voile à la<br />
marine à vapeur <strong>au</strong> <strong>XIXe</strong> siècle.<br />
40 Louis BRINDEAU, op. cit., p. 94, compare des temps de traj<strong>et</strong> entre Le Havre <strong>et</strong> New-York de 1815 à 1891 avec des voiliers <strong>et</strong> des bate<strong>au</strong>x à vapeur.<br />
Ainsi, du Havre à New-York, en 1822 à la voile, il fallait de 40 à 45 à l’aller <strong>et</strong> de 35 à 30 jours <strong>au</strong> r<strong>et</strong>our. En 1891, avec un bate<strong>au</strong> à vapeur, il ne f<strong>au</strong>t plus<br />
que 7 jours ½, à l’aller comme <strong>au</strong> r<strong>et</strong>our.<br />
41 Ambroise COLIN, op. cit., p. 192.<br />
42 Louis, Raymond-Balthasard MAISEAU, Annuaire du commerce maritime. Manuel du négociant, de l’armateur <strong>et</strong> du capitaine, Paris, Mme Char<strong>les</strong><br />
Béch<strong>et</strong>, 1834, p. 414.<br />
43 C. LAVOLLEE, op. cit., p. 730.<br />
Marie-Claire Boscq<br />
8/
Annexe 1<br />
Présentation sommaire des compagnies <strong>transatlantiques</strong> françaises <strong>au</strong> <strong>XIXe</strong> siècle.<br />
Compagnie de Navigation mixte. Créée en 1850, la Société Louis Arn<strong>au</strong>d, Touache frères <strong>et</strong> Cie fut la toute première compagnie de navigation à<br />
in<strong>au</strong>gurer un service transatlantique à destination du Brésil en 1853. Partant de Marseille le 25 novembre, le bate<strong>au</strong> à vapeur « L’Avenir » fit route<br />
sur Pernambouc <strong>et</strong> Rio-de-Janeiro, en touchant en Espagne, à Lisbonne, <strong>au</strong>x Canaries <strong>et</strong> à Gorée. Mais <strong>les</strong> événements de 1855 la détournèrent de<br />
c<strong>et</strong>te exploitation. Elle fut appelée à donner tous ses soins <strong>au</strong>x transports des troupes pour la guerre de Crimée. À l’issue de celle-ci, elle reprit ses<br />
liaisons avec le Brésil. En 1858, elle prit le nom de Compagnie de Navigation Mixte.<br />
Messageries Maritimes. C’est également à Marseille que fut créée en 1851 la Compagnie des Services Maritimes des Messageries Nationa<strong>les</strong>.<br />
Depuis une cinquantaine d’années, <strong>les</strong> Messageries Nationa<strong>les</strong> bénéficiaient du monopole du roulage sur <strong>les</strong> routes de <strong>France</strong>. Leur activité se<br />
trouvant dès lors menacée par le développement des chemins de fer, el<strong>les</strong> décidèrent de changer d’obj<strong>et</strong> social <strong>et</strong> de se tourner désormais vers le<br />
transport maritime. Pendant le Second Empire, el<strong>les</strong> deviennent <strong>les</strong> Messageries Impéria<strong>les</strong>, pour acquérir leur dénomination définitive en 1871 :<br />
Messageries Maritimes. Dès l’origine, la compagnie souhaitait « [réunir] à la navigation de la Méditerranée, l’exploitation de la navigation entre<br />
l’Europe <strong>et</strong> l’Amérique » 44 .<br />
Compagnie Générale Transatlantique. Les frères Pereire, Emile <strong>et</strong> Isaac, saint-simoniens convaincus de la nécessité des progrès industriels <strong>et</strong> de<br />
leur bienfait, précédemment investis dans <strong>les</strong> chemins de fer 45 , fondateurs de la banque d’affaires du Crédit Mobilier 46 , fondèrent en 1854 la<br />
Compagnie Générale Maritime. Napoléon III confirma c<strong>et</strong>te fondation en l’<strong>au</strong>torisant par décr<strong>et</strong> du 2 mai 1855. <strong>La</strong> compagnie se proposait<br />
l’établissement de services post<strong>au</strong>x de paquebots à vapeur entre la <strong>France</strong> <strong>et</strong> le continent américain 47 . Elle prit quelque temps plus tard le nom de<br />
Compagnie Générale Transatlantique.<br />
Union Maritime. Un armateur havrais, Louis Victor Marziou, voulant investir sur des liaisons maritimes à vapeur entre Le Havre <strong>et</strong> <strong>les</strong> Etats-Unis,<br />
fonda l’Union Maritime. En 1857, le groupe financier de Rotschild, avec François Bartholony de la Compagnie des chemins de fer de Paris à<br />
Orléans, afin de contrecarrer <strong>les</strong> proj<strong>et</strong>s des frères Pereire, soutinrent Marziou <strong>et</strong> l’Union Maritime.<br />
G<strong>au</strong>thier Frères <strong>et</strong> Compagnie. Une <strong>au</strong>tre compagnie avait également tenté l’aventure. Il s’agit de G<strong>au</strong>thier Frères <strong>et</strong> Compagnie, compagnie<br />
lyonnaise, qui, à partir de 1856, voulut assurer <strong>les</strong> liaisons du Havre à destination de New-York <strong>et</strong> du Brésil. Elle arma huit grands voiliers de<br />
1 600 à 2 000 tonne<strong>au</strong>x 48 , dotés de machines à vapeur <strong>au</strong>xiliaires. Mais la compagnie ne put soutenir la lutte contre <strong>les</strong> lignes étrangères<br />
subventionnées, <strong>et</strong> la perte d’un de ses bâtiments « Le Lyonnais », dès 1856, précipita sa chute.<br />
Société Générale des Transports Maritimes à Vapeur (SGTM). <strong>La</strong> société fut fondée en 1865 par P<strong>au</strong>lin Talabot, fondateur du Chemin de fer<br />
Paris-Lyon-Méditerranée, <strong>et</strong> fondateur de la banque Société Générale. Dès 1867, elle offrait un service mensuel <strong>France</strong>-Amérique du Sud. Sa<br />
progression fut rapide <strong>et</strong>, en quelques années, elle posséda plusieurs bate<strong>au</strong>x desservant c<strong>et</strong>te ligne.<br />
Compagnie des Chargeurs Réunis. C’est dans la période de redressement qui suit la guerre de 1870 que se rattache la création de la Compagnie des<br />
Chargeurs Réunis. S’appuyant sur un armateur havrais, la maison Quesnel frères, Ju<strong>les</strong> Vignal, de la banque Blacque, Vignal <strong>et</strong> Compagnie, eut<br />
l’idée d’établir une nouvelle ligne de navigation. Le but initial affiché de c<strong>et</strong>te compagnie était d’assurer une liaison <strong>France</strong>-Amérique du Sud,<br />
« dispensant <strong>les</strong> exportateurs français de confier à des navires étrangers le soin de leurs expéditions de marchandises, à destination du Brésil <strong>et</strong> de<br />
44 Marie-Françoise BERNERON-COUVENHES, op. cit., p. 129.<br />
45 Leur première réalisation avait été, en 1835, la création du chemin de fer « Paris-Saint-Germain ». Ils poursuivirent par la création des lignes « Paris-<br />
Rennes » <strong>et</strong> « Paris-Lyon ».<br />
46 1852 : création du Crédit Mobilier.<br />
47 Marthe BARBANCE, op. cit., p. 27.<br />
48 Le tonne<strong>au</strong> est une unité de volume <strong>et</strong> de poids équivalent à 1 000 kilos ou 2 000 livres.<br />
Marie-Claire Boscq
<strong>La</strong> Plata ». À partir du 12 février 1872, date de constitution de la société, tout alla très vite. De 1872 à 1873, six navires destinés à c<strong>et</strong>te route<br />
étaient construits.<br />
Compagnie Française de Navigation à Vapeur, connue en Amérique sous le nom de Fabre Line <strong>et</strong> en Europe sous celui de Compagnie Cyprien<br />
Fabre. <strong>La</strong> compagnie fut fondée en 1881 à partir de p<strong>et</strong>ites compagnies de bate<strong>au</strong>x de pêche <strong>et</strong> de bate<strong>au</strong>x de commerce. Parmi <strong>les</strong> différentes<br />
lignes qu’elle déservit, cel<strong>les</strong> du Brésil <strong>et</strong> de l’Argentine participèrent de 1882 à 1905 <strong>au</strong> transport des émigrés Portugais <strong>et</strong> Italiens.<br />
Compagnie de Navigation Sud Atlantique. Fut fondée en 1910 sous le nom initial de Société d’Etudes de Navigation. Parmi ses fondateurs se<br />
trouvaient de grands banquiers <strong>et</strong> armateurs, tels Cyprien Fabre <strong>et</strong> Alfred Fraissin<strong>et</strong>. Elle in<strong>au</strong>gura ses services en septembre 1912. Deux de ses<br />
bate<strong>au</strong>x <strong>les</strong> plus modernes, Gallia <strong>et</strong> Lut<strong>et</strong>ia, desservirent <strong>les</strong> lignes posta<strong>les</strong> à grande vitesse de Borde<strong>au</strong>x à Rio-de-Janeiro, Montevideo <strong>et</strong><br />
Buenos-Aires.<br />
Quelques <strong>au</strong>tres grandes sociétés de navigation à vapeur furent également mises en service <strong>au</strong> <strong>XIXe</strong> ou <strong>au</strong> début du XXe siècle, tel<strong>les</strong> la<br />
Compagnie Fraissin<strong>et</strong>, la Compagnie Louis Dreyfus ou la Compagnie de Navigation d’Orbigny. Mais à c<strong>et</strong>te époque el<strong>les</strong> ne desservaient pas le<br />
continent américain, leurs routes étant dirigées vers d’<strong>au</strong>tres destinations.<br />
Marie-Claire Boscq
Annexe 2<br />
Compagnie de Navigation Sud-Atlantique – Ligne Amérique du Sud - 1914<br />
Archives de l’Association French Lines :<br />
Compagnie Générale Transatlantique – Ligne Amérique du Sud – Guide du passager<br />
Livr<strong>et</strong> relié, 1914 - cote 1997-004-9693.<br />
Marie-Claire Boscq
Annexe 3<br />
Affiche des « Chargeurs Réunis » - 1887 – (Gallica.bnf.fr)<br />
Marie-Claire Boscq