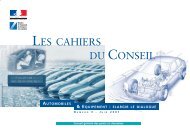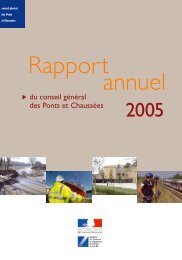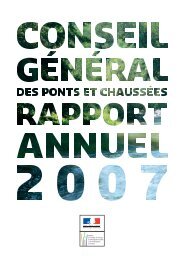Lettre de cadrage - cgedd
Lettre de cadrage - cgedd
Lettre de cadrage - cgedd
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
titre que l’autogestion, la décentralisation apparaît comme un mot d’ordre suffisamment largepour fédérer <strong>de</strong>s conceptions pourtant fort différentes. La gauche s’y convertit en ordredispersé, renouvelant son attachement ancien pour le socialisme municipal 61 .En second lieu, les premières années <strong>de</strong> la Ve République donnent un coupd’accélérateur décisif à la régionalisation, en souhaitant associer réforme territoriale etréforme administrative. En créant en 1964 la fonction <strong>de</strong> préfet <strong>de</strong> région coordonnateur, legouvernement Pompidou retrouve les accents du décret <strong>de</strong> 1852 et la croyance en l’efficacitédu moteur unique 62 . Les formules d’assemblées régionales, mises en place en 1964(Commissions <strong>de</strong> développement économique régional) et renouvelées en 1972(Etablissements publics régionaux) ne permettent guère qu’une participation <strong>de</strong> faça<strong>de</strong>. Enligne <strong>de</strong> mire cependant, c’est la survie <strong>de</strong>s départements qui est posée, même si le débat n’estpas tranché, du fait <strong>de</strong>s hésitations à la tête même <strong>de</strong> l’Etat. Le régime gaulliste s’interrogeégalement sur l’avenir <strong>de</strong>s communes. Il tente <strong>de</strong> promouvoir le regroupement communal, quece soit à travers l’expérimentation <strong>de</strong> la mise en œuvre <strong>de</strong>s villes nouvelles (1965-1968), lacoercition <strong>de</strong>s communautés urbaines (1966) ou l’incitation à la fusion (1971). Peine perdue,mais débat ouvert, qui traverse encore le septennat giscardien et nourrit les rapports Guichard(1976) et Aubert (1977) et le dépôt <strong>de</strong> la loi Bonnet (1980), ces matrices indiscutables <strong>de</strong> laloi Defferre. D’une certaine manière cependant, les gran<strong>de</strong>s lois <strong>de</strong>s années 1980 marquent lafin du cycle ouvert par l’avènement <strong>de</strong> la Ve République. En renforçant le pouvoir <strong>de</strong>s maireset <strong>de</strong> prési<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> conseils généraux, le premier magistrat <strong>de</strong> Marseille offre aux projetsrégionaux et intercommunaux gaullistes un enterrement <strong>de</strong> première classe.Cette lecture politique et administrative centrée sur la Ve République apparaîtcependant comme insuffisante pour éclairer et les enjeux généraux <strong>de</strong> la décentralisation <strong>de</strong>sannées 1980 et ses enjeux particuliers pour l’Equipement. Si la décentralisation est un thèmerécurrent <strong>de</strong> l’histoire politique <strong>de</strong> la France contemporaine, elle n’est pas pour autant unthème continu. Les pouvoirs centraux la réactivent périodiquement, à la fois pour contournerl’inertie présumée <strong>de</strong>s pouvoirs locaux et pour leur imposer les priorités du moment. Cespriorités sont connues pour ce qui concerne le second XXe siècle : urbanisme opérationnel<strong>de</strong>s ZUP et <strong>de</strong>s villes nouvelles, politique du cadre <strong>de</strong> vie, Equipement autoroutier,construction <strong>de</strong>s voies <strong>de</strong> TGV, Equipement universitaire et hospitalier, décentralisation puisreconversion industrielle et portuaire. Le ministère <strong>de</strong> l’Equipement (1966) est naturellementau cœur <strong>de</strong> ses politiques, qui se déploient sur la durée, mais qui toujours s’articulent avec <strong>de</strong>sterritoires politiques locaux. La difficulté <strong>de</strong> l’analyse historique consiste à croiser ici ce quirelève d’une histoire <strong>de</strong> moyenne durée sur l’ensemble du XXe siècle et ce qui relève d’unehistoire <strong>de</strong> courte durée, qu’on pourrait borner aux trente premières années <strong>de</strong> la VeRépublique. Il s’agit ici <strong>de</strong> croiser l’histoire économique et l’histoire politique, en s’appuyantsur le modèle <strong>de</strong>ssiné par Richard Kuysel 63 . En l’état actuel <strong>de</strong> l’historiographie, on ne peutque segmenter l’approche.Le domaine <strong>de</strong>s transports constitue un premier élément d’appréciation <strong>de</strong>s modalitéset <strong>de</strong>s limites du dirigisme. Terrain <strong>de</strong> prédilection <strong>de</strong> l’intervention économique <strong>de</strong> l’Etat<strong>de</strong>puis le XIXe siècle, le rail, la route et les voies navigables entrent à compter du premierXXe siècle dans l’ère <strong>de</strong> la coordination. La nationalisation du secteur est cependant trèsprogressive. Entre la loi Freycinet (1878) et la création <strong>de</strong> la SNCF (1937), ce sont <strong>de</strong>sOffices régionaux <strong>de</strong> transports, issus <strong>de</strong>s chambres <strong>de</strong> commerce, qui règlent la politique <strong>de</strong>s61GIRAULT, Jacques et BELLANGER, Emmanuel (dir), Villes <strong>de</strong> banlieue : Personnel communal, élus locauxet politiques urbaines en banlieue parisienne au XXe siècle, Paris, Créaphis, 200862 VADELORGE, Loïc, « « Mythe et réalité <strong>de</strong> la décentralisation en Normandie <strong>de</strong> 1951 à 1972 », Etu<strong>de</strong>snorman<strong>de</strong>s, 4, 2006, p. 27-4263KUYSEL, Richard, Le capitalisme et l’Etat en France. Mo<strong>de</strong>rnisation et dirigisme au XXe siècle, Paris,Gallimard, Bibliothèque <strong>de</strong>s Histoires, 198410