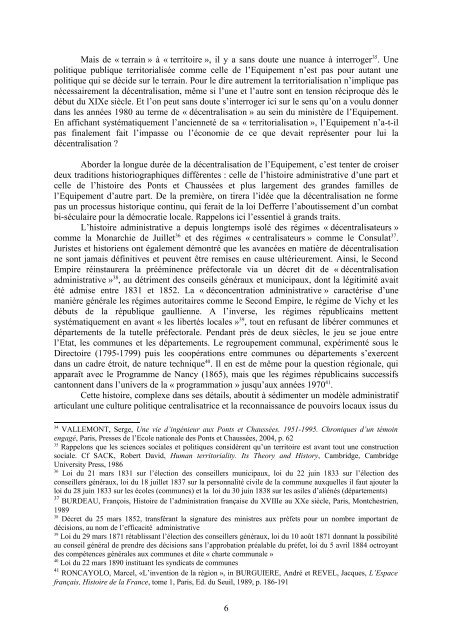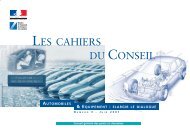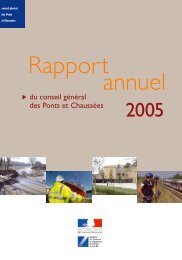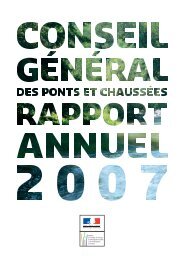Lettre de cadrage - cgedd
Lettre de cadrage - cgedd
Lettre de cadrage - cgedd
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Mais <strong>de</strong> « terrain » à « territoire », il y a sans doute une nuance à interroger 35 . Unepolitique publique territorialisée comme celle <strong>de</strong> l’Equipement n’est pas pour autant unepolitique qui se déci<strong>de</strong> sur le terrain. Pour le dire autrement la territorialisation n’implique pasnécessairement la décentralisation, même si l’une et l’autre sont en tension réciproque dès ledébut du XIXe siècle. Et l’on peut sans doute s’interroger ici sur le sens qu’on a voulu donnerdans les années 1980 au terme <strong>de</strong> « décentralisation » au sein du ministère <strong>de</strong> l’Equipement.En affichant systématiquement l’ancienneté <strong>de</strong> sa « territorialisation », l’Equipement n’a-t-ilpas finalement fait l’impasse ou l’économie <strong>de</strong> ce que <strong>de</strong>vait représenter pour lui ladécentralisation ?Abor<strong>de</strong>r la longue durée <strong>de</strong> la décentralisation <strong>de</strong> l’Equipement, c’est tenter <strong>de</strong> croiser<strong>de</strong>ux traditions historiographiques différentes : celle <strong>de</strong> l’histoire administrative d’une part etcelle <strong>de</strong> l’histoire <strong>de</strong>s Ponts et Chaussées et plus largement <strong>de</strong>s gran<strong>de</strong>s familles <strong>de</strong>l’Equipement d’autre part. De la première, on tirera l’idée que la décentralisation ne formepas un processus historique continu, qui ferait <strong>de</strong> la loi Defferre l’aboutissement d’un combatbi-séculaire pour la démocratie locale. Rappelons ici l’essentiel à grands traits.L’histoire administrative a <strong>de</strong>puis longtemps isolé <strong>de</strong>s régimes « décentralisateurs »comme la Monarchie <strong>de</strong> Juillet 36 et <strong>de</strong>s régimes « centralisateurs » comme le Consulat 37 .Juristes et historiens ont également démontré que les avancées en matière <strong>de</strong> décentralisationne sont jamais définitives et peuvent être remises en cause ultérieurement. Ainsi, le SecondEmpire réinstaurera la prééminence préfectorale via un décret dit <strong>de</strong> « décentralisationadministrative » 38 , au détriment <strong>de</strong>s conseils généraux et municipaux, dont la légitimité avaitété admise entre 1831 et 1852. La « déconcentration administrative » caractérise d’unemanière générale les régimes autoritaires comme le Second Empire, le régime <strong>de</strong> Vichy et lesdébuts <strong>de</strong> la république gaullienne. A l’inverse, les régimes républicains mettentsystématiquement en avant « les libertés locales » 39 , tout en refusant <strong>de</strong> libérer communes etdépartements <strong>de</strong> la tutelle préfectorale. Pendant près <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux siècles, le jeu se joue entrel’Etat, les communes et les départements. Le regroupement communal, expérimenté sous leDirectoire (1795-1799) puis les coopérations entre communes ou départements s’exercentdans un cadre étroit, <strong>de</strong> nature technique 40 . Il en est <strong>de</strong> même pour la question régionale, quiapparaît avec le Programme <strong>de</strong> Nancy (1865), mais que les régimes républicains successifscantonnent dans l’univers <strong>de</strong> la « programmation » jusqu’aux années 1970 41 .Cette histoire, complexe dans ses détails, aboutit à sédimenter un modèle administratifarticulant une culture politique centralisatrice et la reconnaissance <strong>de</strong> pouvoirs locaux issus du34VALLEMONT, Serge, Une vie d’ingénieur aux Ponts et Chaussées. 1951-1995. Chroniques d’un témoinengagé, Paris, Presses <strong>de</strong> l’Ecole nationale <strong>de</strong>s Ponts et Chaussées, 2004, p. 6235Rappelons que les sciences sociales et politiques considèrent qu’un territoire est avant tout une constructionsociale. Cf SACK, Robert David, Human territoriality. Its Theory and History, Cambridge, CambridgeUniversity Press, 198636Loi du 21 mars 1831 sur l’élection <strong>de</strong>s conseillers municipaux, loi du 22 juin 1833 sur l’élection <strong>de</strong>sconseillers généraux, loi du 18 juillet 1837 sur la personnalité civile <strong>de</strong> la commune auxquelles il faut ajouter laloi du 28 juin 1833 sur les écoles (communes) et la loi du 30 juin 1838 sur les asiles d’aliénés (départements)37 BURDEAU, François, Histoire <strong>de</strong> l’administration française du XVIIIe au XXe siècle, Paris, Montchestrien,198938Décret du 25 mars 1852, transférant la signature <strong>de</strong>s ministres aux préfets pour un nombre important <strong>de</strong>décisions, au nom <strong>de</strong> l’efficacité administrative39Loi du 29 mars 1871 rétablissant l’élection <strong>de</strong>s conseillers généraux, loi du 10 août 1871 donnant la possibilitéau conseil général <strong>de</strong> prendre <strong>de</strong>s décisions sans l’approbation préalable du préfet, loi du 5 avril 1884 octroyant<strong>de</strong>s compétences générales aux communes et dite « charte communale »40Loi du 22 mars 1890 instituant les syndicats <strong>de</strong> communes41 RONCAYOLO, Marcel, «L’invention <strong>de</strong> la région », in BURGUIERE, André et REVEL, Jacques, L’Espacefrançais, Histoire <strong>de</strong> la France, tome 1, Paris, Ed. du Seuil, 1989, p. 186-1916