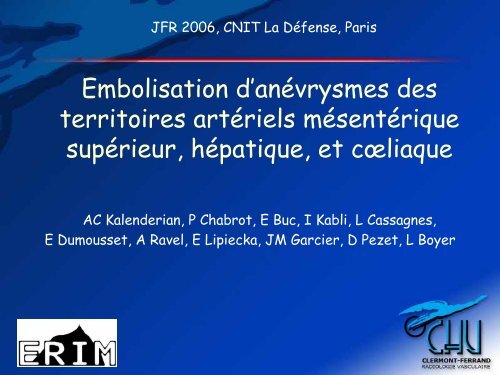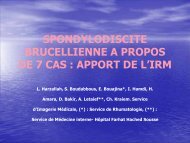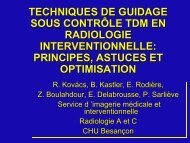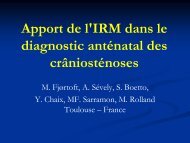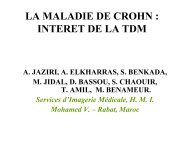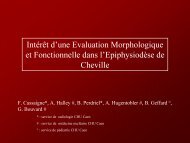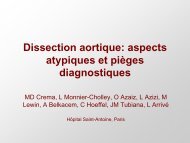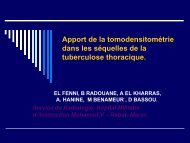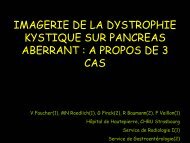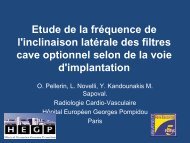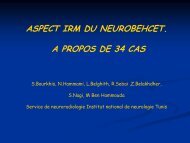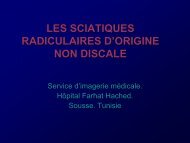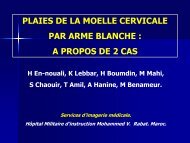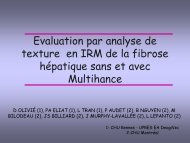7 patients étaient porteurs d'un anévrysme hépatique
7 patients étaient porteurs d'un anévrysme hépatique
7 patients étaient porteurs d'un anévrysme hépatique
- No tags were found...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
JFR 2006, CNIT La Défense, ParisEmbolisation d’anévrysmes desterritoires artériels mésentériquesupérieur, hépatique, et cœliaqueAC Kalenderian, P Chabrot, E Buc, I Kabli, L Cassagnes,E Dumousset, A Ravel, E Lipiecka, JM Garcier, D Pezet, L Boyer
RésuméObjectifs : Evaluer nos résultats techniques et cliniques après embolisation percutanée desanévrysmes portés par une artère viscérale abdominale (à l'exclusion de l'artère splénique).Matériels et méthodes : De 1996 à 2005, nous avons chez 12 <strong>patients</strong> traité 7 anévrysmes ou fauxanévrysmes artériels hépatiques, 2 cœliaques, 3 mésentériques supérieurs. Ces lésions étaientprises en charge en urgence devant des tableaux aigus pour 4 <strong>patients</strong>. Pour les 8 autres leslésions avaient été diagnostiquées pour 3 en échographie, pour 5 en TDM.Résultats : Toutes les lésions ont pu être traitées par coïls chez 8 <strong>patients</strong>, par stent chez 3<strong>patients</strong>. Aucune chirurgie secondaire n'était nécessaire. Nous ne déplorons aucune complicationimmédiate ou décès dans les trente jours. Après un suivi de 39 mois (1-108) ces <strong>patients</strong>restaient asymptomatiques sans procédure complémentaire. Nous ne déplorons aucunecomplication du vaisseau porteur ou des territoires d'aval.Conclusion : Les anévrysmes ou faux anévrysmes portés par le tronc coeliaque, l'artère hépatique etl'artère mésentérique supérieure, moins fréquents que les anévrysmes spléniques, bénéficientcomme eux des techniques thérapeutiques endovasculaires. Leur diagnostic repose sur l'imagerienon invasive. L'artériographie, immédiatement pré-thérapeutique, permet de déterminer lafaisabilité de cette exclusion.
Introduction▪ Avec un risque de rupture élevé et des taux de mortalité de 20 à 80%en cas de rupture, les anévrysmes des territoires artériels digestifspeuvent engager le pronostic vital [1, 2].▪ La problématique du diagnostic et de la prise en charge des anévrysmesde l’artère splénique est bien connue, eu égard à leur relative fréquence[3].▪ Les anévrysmes du tronc cœliaque, des artères mésentérique supérieureet hépatique, sont plus rares (environ 30% des anévrismes digestifs) [4].
Introduction 2Une prise en charge active est donc nécessaire:Réalisée à titre préventifClassiquement par une chirurgie programmée.L’artériographie diagnostique préalable à touteindication, suivie d’une embolisation, peutconstituer une alternative thérapeutique.
I Matériel & méthodePopulationCirconstances de découvertesDescriptif lésionnelModalités thérapeutiques
Matériel et Méthodes (1)PopulationA partir d’une étude rétrospective de janvier 1996 à décembre 2005, nous avonsrecensé 11 <strong>patients</strong>, âgés en moyenne de 52 ans (27-85), <strong>porteurs</strong> d’anévrysmesartériels digestifs justifiant d’un traitement préventif de rupture.En dehors des anévrysmes spléniques, nous avons dénombré: 2 anévrysmes coeliaques 7 anévrysmes hépatiques: 1 AH commune, 3 AH propre, 1 AH droite, 2 AH gauche 1 anévrysme gastro-duodénal 1 anévrysme pancréatico-duodénal 1 anévrysme gastrique gauche 3 anévrysmes mésentérique supérieur8 <strong>patients</strong> étaient <strong>porteurs</strong> d’un anévrysme unique2 <strong>patients</strong> présentaient 2 anévrysmes1 patient présentait 3 anévrysmes
Matériel et Méthodes (2)Circonstances de découvertesLe diagnostic initial de l’anévrysme était réalisé: Par échographie pour 2 <strong>patients</strong> Par TDM pour 9 <strong>patients</strong>3 étaient documentés en urgence: Pancréatite aiguë Hémorragie digestive (syndrome de Mallory Weiss) Traumatisme abdominal8 lors d’une exploration programmée: 6 dans un contexte athéromateux Un dans un contexte post-traumatique récent (J20) Un dans un contexte de maladie de Rendu-Osler
Matériel et Méthodes (3)Anévrysme du tronc cœliaque2 <strong>patients</strong> étaient <strong>porteurs</strong> d’un anévrysme coeliaque (20 et 25 mm)Juxta ostiauxSans extension aux artères hépatique ou mésentérique supérieure1 cas naissant d’une dissection de l’aorte abdominale
Matériel et Méthodes (4)Anévrysme mésentérique supérieure2 <strong>patients</strong> étaient <strong>porteurs</strong> d’un anévrysme mésentérique supérieure (20 et25 mm), rompu dans un faux kyste pancréatique pour l’un d’entre euxTous 2 proches de l’ostium
Matériel et Méthodes (5)Anévrysme hépatique7 <strong>patients</strong> étaient <strong>porteurs</strong> d’un anévrysme hépatique: 1 Hépatique commune 3 H. propre 1 H. droite 2 H. gauche Diamètre moyen 35 mm (10-50)
Matériel et Méthodes (6)Traitement par embolisationLe matériel utilisé dépendait de l’accessibilité, de lamorphologie de anévrysme et des nécessités depréserver le parenchyme d’aval, et d’exclure une voie deréalimentation.Les anévrysmes intra-parenchymateux ou portés par uneartère dont l’exclusion peut être envisagée ont étéembolisé par par coïls +/- gélatineDans les portions tronculaires: Collet large sur une artère à préserver: stent graft Collet large sans risque parenchymateux: « Sandwich » parcoïls d’amont et aval Collet étroit: packing respectant l’artère porteuse
Matériel et Méthodes (7)Traitement par embolisation: stent graft3 stents couverts ont été implantés: 2 cœliaques 1 hépatique communeAnévrysme sacciforme à colletlarge développé à la facesupérieure du TCOpacification sélective cœliaque avantpuis après stent graft: respect de labifurcation
Matériel et Méthodes (8)Traitement par embolisation: coïls8 <strong>patients</strong> étaient traités par coïls: 4 packing 2 exclusion du vaisseau porteur 2 pour exclure une réalimentation complétant un stentgraftDans 4 procédures, de la gélatine résorbable étaitutilisée pour accélérer la thrombose ou ralentir le flux.
Matériel et Méthodes (9)PackingTraitement par embolisation: coïlsAnévrysme mésentériquesupérieur à collet étroitOpacification sélective mésentérique avant puis aprèsembolisation par coïls: respect du vaisseau porteur
Matériel et Méthodes (10)Traitement par embolisation: coïlsExclusion du vaisseau porteur:Volumineux anévrysmehépatique gaucheOpacification sélective hépatique avant puis aprèsembolisation par coïls
Matériel et Méthodes (11)Traitement par embolisation: coïlsExclusion du vaisseau porteur:Opacification sélective hépatique avant puis aprèsembolisation par coïlsAnévrysme segmentairemédiale hépatique gauche
Matériel et Méthodes (12)Analyse des donnéesUn succès technique était défini par: Une exclusion de l’anévrysme Respectant le vaisseau porteur en cas de packingExprimé en intention de traiter.Les complications et le suivi morphologique effectuéavec un recul moyen de 39 mois (12- 108) ont étécollectés. Le suivi morphologique préconisé aprèsembolisation comportait un scanner de contrôle (LightSpeed) à J4, M1, M6, et sur point d’appel clinique oubiologique
II RésultatsSuccès techniqueTaux de complicationSuivi à long terme
Résultats (1)Succès immédiat Succès Technique = 9 /11 cas, soit 82 %:2 cas récusés pour traitement endovasculaire, aprèsangiographie diagnostique: 1 anévrysme de la terminaison du TC englobant l’hépatique,la gastrique gauche et la splénique, en aval d’une sténoseserrée du TC. 1 anévrysme fusiforme hépatique propre inaccessible à unstent graft: pas de solution endovasculaire ne risquant demettre en péril la vascularisation hépatique=> prise en charge chirurgicale réglée
Résultats (2)Incidents et complicationsLe suivi clinique était marqué par: Un syndrome post-embolisation régressif en 48 heures aprèsembolisation d’un faux-anévrysme hépatique post-traumatique.Le suivi biologique objectivait des modifications précoces et transitoires: 1 cytolyse hépatique à J 8 (< 2 UI) (AH gauche), 1 pancréatite biologique asymptomatique (AH gauche par coïl +gélatine), 1 insuffisance rénale totalement régressive en quelques jours (AH).Le suivi morphologique objectivait: 1 effet de masse sur la voie biliaire principale après packing d’unanévrysme hépatique et occlusion d’une arcade duodéno-pancréatiquesans cholestase biologique (TDM de contrôle à M1)
Résultats (3)Suivi à long termeAprès un recul de 39 mois (12-108) nous ne déplorons:pas de croissance ou rupture des anévrysmes excluspas de thrombose des stent graftLa perméabilité du vaisseau porteur d’un packingL’absence de signe clinique, biologique ou morphologiqued’ischémie parenchymateuse d’aval
DiscussionIndication d’embolisationChoix de la modalité thérapeutiqueSuccès immédiats endovasculaires et chirurgicauxComplications et suivi
Discussion (1)IndicationsLe traitement d’un anévrysme viscéral symptomatique est la règle.Le traitement d’un anévrysme asymptomatique est requis devant:- un diamètre supérieur à 2 ou 3 cm [5, 6],- ou supérieur à 3 ou 4 fois le diamètre du vaisseau porteur [7],- ou de croissance rapide.Toutefois l’absence de prédictibilité de l’évolution font retenir pour la plupart desauteurs le chiffre de 2 cm, excepté les anévrysmes affectant les artères:pancréatico-duodénale,gastro-duodénaleou mésentérique inférieureOu survenant chez une femme avec désir de grossessequi nécessite un traitement systématique [8, 9]Indépendamment, la migration du thrombus endoluminal responsable d’une ischémieparenchymateuse d’aval peut nécessiter une exclusion de l’anévrysme [10].
Discussion (2)Modalités thérapeutiquesEncore récemment la chirurgie représentait la solution thérapeutique deréférence: Par une ligature simple du lit artériel d’amont +/- aval (DeBakey 1953), Ou excision du sac anévrismal et reconstruction vasculaire décriteinitialement par Schumacker en 1958, réservée aux cas nécessité demaintenir un flux d’aval.Depuis peu le développement du matériel d’embolisation et de cathétérismepermet d’envisager des solutions percutanées variables: stent couvert [11,12] Exclusion ligature par coïls: technique du « sandwich » Packing intra saculaires {13].Le choix thérapeutique est évalué en fonction: des caractéristiques lésionnelles et du risque opératoire
Discussion (3)Choix thérapeutiques: caractéristique lésionnelleDiamètre anévrysmal: les volumineux anévrysmes seprêtent à une anévrismectomie chirurgicale, tandis qu’unpacking expose aux risques rupture et de compressionpar le matériel d’embolisation.Difficulté de cathétérismeParenchyme d’aval: le risque d’occlusion artériellereprésente la contre-indication principale: le traitement percutané d’un anévrysme coeliaque ouhépatique est pour certains une contre-indication s’ilexiste une occlusion mésentérique supérieure ou unethrombose porte [14] une pathologie parenchymateuse sous-jacente incite à laprudence (cirrhose hépatique).
Discussion (3)Choix thérapeutiques: risque opératoireLe risque opératoire varie en fonction:des circonstances de découverte: Pour Baggio [14], l’embolisation d’un anévrysme hépatiquerompu peut être conduit par voie endovasculaire si tant estque l’hémodynamique est maintenue Dans des conditions hémodynamiques précaires la chirurgies’impose le plus souvent De l’état général du patient et des ses antécédentschirurgicaux: les abdomens « hostiles » font préférer unealternative endovasculaire [15]
Discussion (4)Succès immédiats2 des 11 <strong>patients</strong> initialement explorés ne présentaientpas une disposition propice à un traitementendovasculaire.Pour les 9 autres le traitement mis en œuvre a pu êtreconduit permettant l’exclusion de l’anévrysme. Dans la littérature les résultats varient entre 50 à 100%de succès immédiats [14,16].Ces données résultent toutefois de séries limitées,n’excédant pas 10 <strong>patients</strong>.
Discussion (5)ComplicationsLe taux de complications mineures rapporté dans lalittérature varie entre 0 et 20% [5, 12], ici encore àpartir de séries d’effectif limité.Les complications graves résultent de la migration dumatériel d’embolisation, pouvant conduire à une ischémieengageant le pronostic vital. (décès au décours d’unepancréatite ischémique après migration d’un coïl [12])
Discussion (6)Suivi à long termeLe traitement endovasculaire expose à des complications propresliés au cathétérisme:dissection,reperméabilisation,migration du matériel,complication au point de ponctionqui s’ajoutent à l’histoire naturelle d’un anévrysme traité (récidiveet rupture)Des récidives après embolisation font l’objet de publicationsisolées, et apparaissent le plus souvent accessibles à un deuxièmetraitement percutané [12, 17].Nous n’avons pas déploré de complication grave, et n’avons pasobservé sur notre courte série de croissance anévrysmale oureperméabilisation.
ConclusionLes anévrysmes ou faux anévrysmes portés par le tronc coeliaque,l'artère hépatique et l'artère mésentérique supérieure, moinsfréquents que les anévrysmes spléniques, bénéficient comme euxdes techniques thérapeutiques endovasculaires.Leur diagnostic repose sur l'imagerie non invasive.L'artériographie, immédiatement pré-thérapeutique, permet dedéterminer la faisabilité de cette exclusion et la modalitéopératoire, variable en fonction de la morphologie lésionnelle et dela nécessité de respecter une perfusion d’aval.
Bibliographie 1. Deterling, R.A., Jr., Aneurysm of the visceral arteries. J Cardiovasc Surg (Torino), 1971. 12(4): p. 309-22. 2. Miani, S., et al., Splanchnic artery aneurysms. J Cardiovasc Surg (Torino), 1993. 34(3): p. 221-8.3. Guillon, R., et al., Management of splenic artery aneurysms and false aneurysms with endovascular treatment in 12<strong>patients</strong>. Cardiovasc Intervent Radiol, 2003. 26(3): p. 256-60.4. Berceli, S.A., Hepatic and splenic artery aneurysms. Semin Vasc Surg, 2005. 18(4): p. 196-201.5. Saltzberg, S.S., et al., Is endovascular therapy the preferred treatment for all visceral artery aneurysms? Ann VascSurg, 2005. 19(4): p. 507-15.6. Sessa, C., et al., Treatment of visceral artery aneurysms: description of a retrospective series of 42 aneurysms in 34<strong>patients</strong>. Ann Vasc Surg, 2004. 18(6): p. 695-703. 7. Brown, O.W., et al., Uncommon visceral artery aneurysms. South Med J, 1983. 76(8): p. 1000-1.8. Carmeci, C. and J. McClenathan, Visceral artery aneurysms as seen in a community hospital. Am J Surg, 2000. 179(6): p.486-9.9. Hossain, A., et al., Visceral artery aneurysms: experience in a tertiary-care center. Am Surg, 2001. 67(5): p. 432-7.10. Dorrler, J. and A. Wahba, [Diagnosis and treatment of visceral and renal embolisms]. Herz, 1991. 16(6): p. 425-33.11. Drescher, R., O. Koster, and T. von Rothenburg, Superior mesenteric artery aneurysm stent graft. Abdom Imaging,2006.12. Gabelmann, A., J. Gorich, and E.M. Merkle, Endovascular treatment of visceral artery aneurysms. J Endovasc Ther,2002. 9(1): p. 38-47.13. Thakker, R.V., et al., Embolisation of gastroduodenal artery aneurysm caused by chronic pancreatitis. Gut, 1983. 24(11):p. 1094-8.14. Baggio, E., et al., Treatment of six hepatic artery aneurysms. Ann Vasc Surg, 2004. 18(1): p. 93-9.15. Lipari, G., et al., [Treatment of celiac trunk aneurysms: personal experience and review of the literature]. J Mal Vasc,2006. 31(2): p. 72-5.16. Chiesa, R., et al., Visceral artery aneurysms. Ann Vasc Surg, 2005. 19(1): p. 42-8. 17. Grego, F.G., et al., Visceral artery aneurysms: a single center experience. Cardiovasc Surg, 2003. 11(1): p. 19-25.