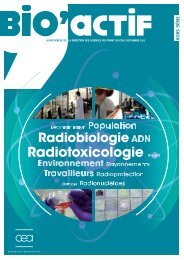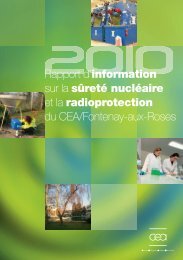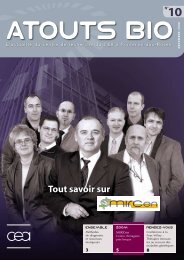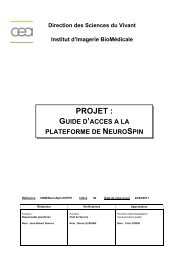Pour la Science - Direction des sciences du vivant - CEA
Pour la Science - Direction des sciences du vivant - CEA
Pour la Science - Direction des sciences du vivant - CEA
- No tags were found...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
particulier d’une longue nuit, qui ne re p r é-sente qu’un faible apport énerg é t i q u e ,s u ffit pour changer le comportement de<strong>la</strong> p<strong>la</strong>nte : par exemple, il empêche <strong>la</strong> floraisonchez une p<strong>la</strong>nte de jour court.Une fois de plus, c’est avec l’arabette<strong>des</strong> Dames et <strong>la</strong> méthode génétique quel’on a percé le mystère. A r a b i d o p s i s n ’ e s tpourtant pas un modèle idéal. C’est unep<strong>la</strong>nte de jours longs facultative : elle fleuritplus vite quand les jours sont longs (parexemple 16 heures de lumière ) : enviro nq u a t re semaines au lieu de huit ; mais ellen’a pas un besoin absolu de jours longs(elle peut fleurir quand les jours sontcourts). Or certains mutants d’arabette,dont le mutant constans (C O), ne perçoiventpas <strong>la</strong> photopériode et fleurissent avecre t a rd, même si les jours sont longs. Le gènec o n s t a n s, altéré chez le mutant C O, a étéidentifié, ce qui a permis d’analyser <strong>la</strong>répartition dans l’espace et dans le tempsde <strong>la</strong> quantité d’A R N messager et de <strong>la</strong> protéinecorre s p o n d a n t s .L’ARN et <strong>la</strong> protéine CO sont présentsdans les cellules de <strong>la</strong> feuille. Puisque lesmutants c o n s t a n s fleurissent tard i v e m e n t ,on peut en dé<strong>du</strong>ire que <strong>la</strong> protéine C Ostimule <strong>la</strong> floraison. Effectivement, <strong>des</strong>p<strong>la</strong>ntes où l’on provoque par génie génétiqueune forte synthèse de cette moléculefleurissent très vite. L’équipe de Georg eCoup<strong>la</strong>nd, de l’Institut Max P<strong>la</strong>nck deCologne, s’est donc penchée sur son moded’action. Elle a découvert deux pro p r i é t é sinatten<strong>du</strong>es. Tout d’abord, <strong>la</strong> quantité del ’A R N messager codant <strong>la</strong> protéine C O s u i tun rythme circ a d i e n : elle est élevée <strong>la</strong> nuit,baisse le matin et remonte en fin d’aprèsmidi.Ces oscil<strong>la</strong>tions sont quasiment lesmêmes que les jours soient courts ou longs.Elles se poursuivent pendant quelquesjours même dans l’obscurité totale : ellesne dépendent donc pas de <strong>la</strong> lumière, maisde l’horloge interne de <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nte.L’origine de<strong>la</strong> floraison : <strong>la</strong> feuilleÀ cette variation de concentration d’A R Nmessagers de C O, se superpose une régu<strong>la</strong>tionde <strong>la</strong> protéine C O elle-même par <strong>la</strong>l u m i è re. En effet, alors que certainesp rotéines restent stables <strong>du</strong>rant <strong>des</strong> heure sv o i re <strong>des</strong> jours dans les cellules, d’autre ssont dégradées (découpées puis re c y c l é e s )en quelques secon<strong>des</strong> par un complexeenzymatique, le protéasome. Or G. C o u-p<strong>la</strong>nd et ses collègues ont découvert que<strong>la</strong> protéine C O est stabilisée par <strong>la</strong> lumièreet dégradée par l’obscurité.Ainsi, <strong>du</strong>rant les pério<strong>des</strong> de jourscourts, l’A R N messager de C O n’est jamaisp ro<strong>du</strong>it en présence de lumière, ce quiempêche l’accumu<strong>la</strong>tion de <strong>la</strong> pro t é i n e ,et <strong>la</strong> floraison. Au contraire, quand les jourss’allongent, il existe un moment, en find’après-midi, où <strong>la</strong> quantité d’A R N m e s-sagers est suffisante et où <strong>la</strong> protéine C Op ro<strong>du</strong>ite est stabilisée par <strong>la</strong> lumière. Ellepeut alors s’accumuler et activer <strong>la</strong> floraison(voir l’encadré ci-<strong>des</strong>sous).C’est donc <strong>la</strong> coïncidence entre <strong>la</strong> synthèsede l’A R N messager de <strong>la</strong> protéine C Oet <strong>la</strong> stabilité de cette dernière qui expliquel ’ e ffet de <strong>la</strong> photopériode sur <strong>la</strong> floraison.L a p rotéine C O était-elle le florigènere c h e rc h é ? Migrait-elle jusqu’à <strong>la</strong> pointede <strong>la</strong> tige ? Non. En effet, une autre protéine,F T (Flowering locus T), était aussiun florigène potentiel. Elle avait été identifiéeen 1999 conjointement par l’équipede Detlef Weigel, à l’Institut Salk de SanDiego, et celle de Takashi Araki, de l’Universitéde Kyoto, en tant que stimu<strong>la</strong>teurde <strong>la</strong> floraison. Une p<strong>la</strong>nte qui enest privée fleurit tardivement. Si auL E R O L E D E L A P H O T O P É R I O D EMéristème apica<strong>la</strong>efProtéine FDConcentrationde l’ARN messagerde <strong>la</strong> protéine COProtéine CObTigeMigration de<strong>la</strong> protéine FTcGèneFTProtéine FTdTube criblé8] Biologie végétale © <strong>Pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Science</strong> - n° 381 - Juillet 2009