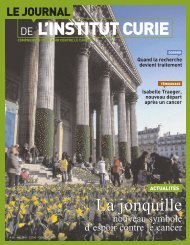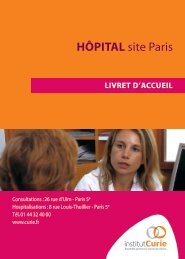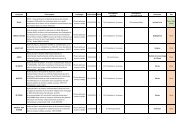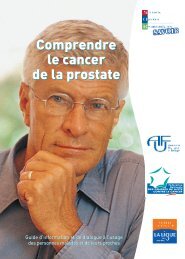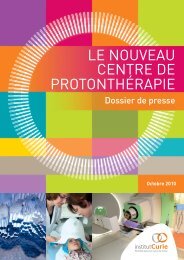ACTUALITÉSEN BREFLE JOURNAL DEL’INSTITUT CURIE06,GÉNÉRALESENVIRONNEMENTL’AMIANTE, TOUJOURSD’ACTUALITÉ«<strong>Le</strong> nombre <strong>de</strong> cancers induitspar l’amiante ne cesse d’augmenter,malgré son interdiction en France,en 1997», souligne le rapport 1 <strong>de</strong> laMission d’information <strong>de</strong> l’Assembléenationale sur les risques etles conséquences <strong>de</strong> l’expositionà l’amiante. <strong>Le</strong>s experts proposent<strong>de</strong>s recommandations sanitaires,médicales, techniques, juridiqueset économiques afin qu’une tellesituation ne se reproduise plus.<strong>Le</strong>s pouvoirs publics ont mis en placeplusieurs mesures parmi lesquellesle droit à un suivi médicalpersonnalisé pour les personnesayant été exposées à l’amianteet un renforcement <strong>de</strong>s contrôles<strong>de</strong>s bâtiments contenant <strong>de</strong>l’amiante. Enfin, en septembre 2005,les ministères chargés du Travail,<strong>de</strong> la Santé et <strong>de</strong> l’Écologie ontcréé l’Agence française <strong>de</strong> sécuritésanitaire <strong>de</strong> l’environnementet du travail (Afsset) pour notammentaméliorer la prévention <strong>de</strong>s risquesauxquels sont exposés lesprofessionnels qui interviennentsur l’amiante.1. Disponible sur www.sante.gouv.fr,ACCÈS À L’EMPRUNT,SOINS ESTHÉTIQUESSe réconcilieravec son corps,surtout à l’hôpitalSi la chimiothérapie et la radiothérapiesont <strong>de</strong>s traitements <strong>de</strong> plus enplus efficaces, leurs effets secondaires,comme la perte <strong>de</strong>s cheveux, <strong>de</strong>ssourcils ou <strong>de</strong>s cils, le changement<strong>de</strong> la qualité <strong>de</strong>s ongles ou <strong>de</strong> la texture<strong>de</strong> la peau, constituent un écueil difficileà surmonter, tant physiquement quemoralement.Afin <strong>de</strong> changer cette situation, quelquesétablissements <strong>de</strong> santé, dont l’Institut<strong>Curie</strong>, proposent <strong>de</strong>s soins esthétiquesou <strong>de</strong>s conseils. <strong>Le</strong>ur objectif est <strong>de</strong>réconcilier la personne avec son corps,les soins esthétiques <strong>de</strong>venant uncomplément précieux du traitementmédical. En effet, les mala<strong>de</strong>s expliquentque le temps d’un soin, ils se sentent <strong>de</strong>sfemmes ou <strong>de</strong>s hommes à part entière.Des spécialistes (esthéticiennes,coiffeurs…) prodiguent, à l’hôpital ouà l’extérieur, <strong>de</strong>s conseils pratiques surles techniques <strong>de</strong> maquillage adaptéesà la situation <strong>de</strong>s mala<strong>de</strong>s, mais aussisur les façons <strong>de</strong> nouer un turban, surUne association qui assureConstruire un projet, acheter unlogement, obtenir un prêt, autant<strong>de</strong> démarches dont sont trop souventdéboutées les personnes atteintes<strong>de</strong> cancer ou <strong>de</strong> pathologiesà risques aggravés. Depuis seize ans,cette exclusion sociale est combattuepar l’association Vivre avec. Créée par<strong>de</strong>s mala<strong>de</strong>s, elle propose désormaisun service d’information et <strong>de</strong> conseilpar téléphone qui facilite l’accès auxprêts et aux assurances. Lancée enRhône-Alpes, cette initiative baptisée« Pour une citoyenneté retrouvée »regroupe <strong>de</strong>s volontaires formés à cesquestions, <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins et <strong>de</strong>s courtiersd’assurance liés à l’association par unecharte éthique. <strong>Le</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur bénéficied’une expertise anonyme et gratuite<strong>de</strong> sa situation et d’un accompagnementdans toutes les phases <strong>de</strong> sa recherche.Plusieurs centaines <strong>de</strong> dossiers ont déjàhQuand la maladie malmène le corps, prendre soin<strong>de</strong> soi peut être un réconfort, loin d’être anecdotique.le choix d’une perruque ou d’uneprothèse mammaire.Ces initiatives, encore trop peunombreuses, sont, en majorité,le résultat <strong>de</strong> démarches individuelles,associatives ou <strong>de</strong> mécénat. <strong>Le</strong>urdéveloppement apparaît pourtantvraiment nécessaire et est réclamépar le Plan cancer <strong>de</strong>puis trois ans.J. L.h Quelques contacts utiles:• La liste <strong>de</strong>s douze centres <strong>de</strong> beauté Cew Franceimplantés dans <strong>de</strong>s hôpitaux: cew.asso.fr• <strong>Le</strong>s Espaces rencontres et information (Eri)<strong>de</strong> la Ligue contre le cancer organisent <strong>de</strong>s ateliers«beauté»: renseignements auprès <strong>de</strong>s Comitésdépartementaux <strong>de</strong> la Ligue.• L’Embellie, un magasin entièrement consacréaux femmes atteintes <strong>de</strong> cancer et à leur entourage,premier lieu du genre en France:29 bd Henri-IV, Paris 4 e . Tél.: 01 42 74 36 33.www.embellieboutique.comété traitées. Par ailleurs, signe que leschoses évoluent face aux revendications<strong>de</strong>s patients, <strong>de</strong>s spécialistes <strong>de</strong>la protection <strong>de</strong>s personnes commeSwissLife proposent <strong>de</strong>s produits conçusexclusivement pour les personnesayant eu un cancer 1 .J. L.1. Lire aussi <strong>Le</strong> <strong>Journal</strong> <strong>de</strong> l’Institut <strong>Curie</strong>, mars <strong>2006</strong>.h 0821 21 80 08 (0,12 euro TTC/min).S. Laure/Institut <strong>Curie</strong>L’informatisation du dossier médicalpersonnel (DMP), prévue d’ici 2007, viseà favoriser la coordination et la continuité<strong>de</strong>s soins et à améliorer, sous le contrôledu patient concerné, la communication<strong>de</strong>s informations médicales entre lesprofessionnels <strong>de</strong> santé qui le soignent.<strong>Le</strong> DMP, unique pour chaque personne,centralisera à terme l’ensemble <strong>de</strong>sdonnées médicales (comptes rendus <strong>de</strong>consultation ou d’opération, imageriemédicale…) et lui permettra, lorsqu’ellele souhaite, <strong>de</strong> consulter ses antécé<strong>de</strong>ntsmédicaux et d’y donner accèsaux mé<strong>de</strong>cins qu’elle consulte.<strong>Le</strong> DMP <strong>de</strong>vrait ainsi concourirà limiter les prescriptions redondantes,ai<strong>de</strong>r les mé<strong>de</strong>cins à éviterles interactions médicamenteuses…Aujourd’hui en cours d’expérimentation,le DMP doit encore surmonterquelques difficultés techniqueset financières. Une fois généralisé,il <strong>de</strong>vrait simplifier le parcours<strong>de</strong> soins du patient.Jérémy LavalayeFICHE PRATIQUEDOSSIER MÉDICALDossier médical personnel :le futur carnet <strong>de</strong> santé numérique<strong>Le</strong> dossier médical personnel (DMP)est accessible à l’hôpital.<strong>Le</strong> personnel médical et soignantpeut le consulter et le mettreà jour avec l’accord du patient.L’archivage informatisé <strong>de</strong>s informationsmédicales du patient est disponible sur Internet.Contrôle et sécurisation du DMP. Une procéduregarantit la confi<strong>de</strong>ntialité <strong>de</strong>s informationsmédicales <strong>de</strong> chacun, conformément aux droits<strong>de</strong>s patients dans le domaine <strong>de</strong>s donnéespersonnelles <strong>de</strong> santé.<strong>Le</strong> DMP est utilisablepar d’autres mé<strong>de</strong>cins.Lors d’une consultationchez un autre mé<strong>de</strong>cin (unspécialiste, par exemple)ou en cas d’urgencelors d’un déplacement,ce <strong>de</strong>rnier peut avoiraccès aux informationsmédicales et les mettre àjour, toujours sous réserve<strong>de</strong> l’autorisation du patient.1. D’ores et déjà, le patient peut avoir accès au dossier détenu par tout acteur <strong>de</strong> santé (établissement hospitalier, cabinet médical, etc.)après en avoir fait la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> écrite. <strong>Le</strong> délai <strong>de</strong> mise à disposition est limité par la loi à un mois maximum.L’Institut <strong>Curie</strong>,hôpital pilotePrintemps <strong>2006</strong> : début <strong>de</strong> la phased’expérimentation du dossier médicalpersonnel unique. L’Institut <strong>Curie</strong> yparticipe avec d’autres établissementset <strong>de</strong>s réseaux <strong>de</strong> soins, encollaboration avec un <strong>de</strong>s hébergeurshabilités. Son hôpital est fort d’uneexpérience <strong>de</strong> plusieurs années surla mise à disposition informatiséedu dossier d’établissement auprès<strong>de</strong> ses mé<strong>de</strong>cins correspondants.<strong>Le</strong> DMP est la propriété du patient. D’ici à fin2007, chacun <strong>de</strong>vrait pouvoir consulterson dossier informatisé 1 <strong>de</strong>puis tout ordinateurrelié à Internet (domicile, cybercafé, hôpital,etc.). À tout moment, le mala<strong>de</strong> a la liberté(et est le seul à l’avoir) <strong>de</strong> donner accèsà son dossier, <strong>de</strong> refuser ou <strong>de</strong> résilierce droit. Il peut le déléguer au mé<strong>de</strong>cinqui le suit régulièrement. Seuls <strong>de</strong>sprofessionnels <strong>de</strong> santé (mé<strong>de</strong>cins, soignants)peuvent être autorisés par le patientà accé<strong>de</strong>r à son DMP.Un mé<strong>de</strong>cin désigné parle patient peut intervenir dans leDMP. Lors <strong>de</strong> chaque consultation,le DMP est complété par lemé<strong>de</strong>cin traitant. Cela lui donneune vue d’ensemble actualisée duparcours médical <strong>de</strong> son patient.Philippe Rizand, directeur <strong>de</strong>s Systèmes d’information et <strong>de</strong> l’Informatique à l’Institut <strong>Curie</strong>.Illustrations : E. Lamoglia/Institut <strong>Curie</strong>LE JOURNAL DEL’INSTITUT CURIE ,07
DOSSIERDÉCOUVRIR ET SOIGNER,LA LOGIQUE DU TRANSFERTLE TRANSFERTh<strong>Le</strong>s chercheurs côtoyant régulièrement <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins sont naturellementamenés à «élargir leur horizon» vers les attentes <strong>de</strong>s patients.La recherche translationnelle est une passerelle entreles découvertes ou les inventions et les applicationsmédicales. Elle repose sur la concertation entre mé<strong>de</strong>cins,chercheurs, ingénieurs, techniciens… Quand tousces acteurs ont la chance <strong>de</strong> travailler dans un mêmeenvironnement, comme c’est le cas à l’Institut <strong>Curie</strong>, lesprogrès s’en trouvent accélérés, au bénéfice <strong>de</strong>s patients.«<strong>Le</strong> transfert, c’est le laboratoire qui setransporte dans le mon<strong>de</strong> réel <strong>de</strong>smala<strong>de</strong>s», résume le P r Thierry Philip,cancérologue et chercheur à Lyon 1 .Cependant, cette conversion n’est pasimmédiate: ainsi, treize ans séparent la découverte<strong>de</strong> la pénicilline (1928) <strong>de</strong> sa première application(1941). Et ce n’est qu’après plusieurs étapes <strong>de</strong>perfectionnement que la première greffe <strong>de</strong> moelleosseuse – en 1957, à l’Institut <strong>Curie</strong> – a donnénaissance à une véritable discipline désormaisappelée immunothérapie.Noak/<strong>Le</strong> bar Floréal/Institut <strong>Curie</strong>«<strong>Le</strong> transfert, c’est typiquement la mise au pointd’un test <strong>de</strong> routine à partir d’une découverte»,explique le P r Hervé Fridman 2 , artisan en 1993 dupremier laboratoire français <strong>de</strong> transfert en cancérologie,le laboratoire Garet, à l’Institut <strong>Curie</strong>. «Parexemple, grâce à <strong>de</strong>s techniques sophistiquées,nous venons d’i<strong>de</strong>ntifier une substance dans certainestumeurs du côlon et du rectum retirées à <strong>de</strong>spatients. Sa présence dans la tumeur est synonyme<strong>de</strong> bon pronostic pour le mala<strong>de</strong>. Il nous faut désormaismettre au point un test d’analyse simple pourla rechercher chez les patients. Il faudra ensuitedéterminer à partir <strong>de</strong> quelle quantité la présence<strong>de</strong> cette molécule est significative, s’assurer que letest est accessible et applicable par les mé<strong>de</strong>cins…L’avantage <strong>de</strong> l’Institut <strong>Curie</strong> dans cette étape estqu’il dispose sur place <strong>de</strong>s bio-informaticiens etautres ingénieurs capables d’exploiter la masse <strong>de</strong>données générée.» En effet, en France, peu <strong>de</strong> structurespeuvent faire le lien direct entre leurs chercheursdans leurs laboratoires et leurs mé<strong>de</strong>cins auchevet <strong>de</strong>s mala<strong>de</strong>s à l’hôpital.Mettre la scienceau service <strong>de</strong> l’hommeDe fait, la continuité <strong>de</strong> la recherche et du soin atoujours été à la base du fonctionnement <strong>de</strong> l’Institut<strong>Curie</strong>. Né sous ces doubles auspices (lire l’encadréci-contre), il a évolué en restant fidèle à sa mission,inscrite à l’article 1 <strong>de</strong> ses statuts : « Mettrela science au service <strong>de</strong> l’homme pour l’ai<strong>de</strong>r àlutter contre les maladies, et tout particulièrementle cancer. » Mieux encore, la pluridisciplinaritéjoue «dans l’intérêt <strong>de</strong> la science et <strong>de</strong>s mala<strong>de</strong>s».<strong>Le</strong> P r François Doz, pédiatre, le confirme: «Unanesthésiste-réanimateur orientera le chimiste et lephysicien vers la mise au point <strong>de</strong> cathéters bactérici<strong>de</strong>s[NDLR: pour limiter le risque <strong>de</strong> complicationsinfectieuses lors d’une opération]». Autreexemple, suggéré par Emmanuelle Deponge, chargéed’affaires à la Direction <strong>de</strong> la valorisation et <strong>de</strong>srelations industrielles: «Il nous arrive d’élargir laportée d’un brevet sur les travaux d’un chercheurgrâce à la participation d’un mé<strong>de</strong>cin dont l’horizonest orienté vers les patients.» «<strong>Le</strong> transfert ■ ■ ■1. Directeur du Centre régional <strong>de</strong> lutte contre le cancerLéon-Bérard (Lyon). Auteur <strong>de</strong> Vaincre son cancer, Éd. Milan.2. Directeur <strong>de</strong> laboratoire à l’université Paris-VIet chef du Département d’immunologie à l’Hôpitaleuropéen Georges-Pompidou (Paris).<strong>Le</strong> 5 e arrondissement <strong>de</strong> Paris,relais d’expérienceshSur les hauteurs <strong>de</strong> la montagne Sainte-Geneviève, le quartier «savant» <strong>de</strong>Paris, chercheurs et mé<strong>de</strong>cins échangent pour le plus grand bénéfice <strong>de</strong>s patients.Quand l’Université <strong>de</strong> Paris etl’Institut Pasteur déci<strong>de</strong>nt, en 1909,d’implanter l’Institut du radium 1au cœur <strong>de</strong> Paris, ils prévoient<strong>de</strong>ux laboratoires, l’un pour larecherche, l’autre pour l’applicationmédicale. <strong>Le</strong> premier sera dirigépar Marie <strong>Curie</strong>, prix Nobel<strong>de</strong> physique 1903, le second parle radiobiologiste Claudius Regaud.Entre les <strong>de</strong>ux, un jardin propiceaux échanges féconds. Cetétat d’esprit perdure, et c’estquotidiennement que chercheurset soignants continuent àse rencontrer à l’Institut <strong>Curie</strong>.Tout comme au sein <strong>de</strong> l’association<strong>de</strong> la Montagne-Sainte-Geneviève,fondée en 1993 avec les fleurons<strong>de</strong> ce quartier parisien, pépinière<strong>de</strong> prix Nobel : après les <strong>Curie</strong> etJoliot-<strong>Curie</strong>, Pierre-Gilles<strong>de</strong> Gennes, Georges Charpaket Clau<strong>de</strong> Cohen-Tannoudji.Physicochimiste à l’Écolesupérieure <strong>de</strong> physique et chimieindustrielle, Jean-Louis Viovyrejoint l’Institut <strong>Curie</strong> en 1995.« Je désirais mettre ma “boîteà outils” au service <strong>de</strong> la biologiemédicale », avoue-t-il avecmo<strong>de</strong>stie. Il y trouve matière,et un écho enthousiaste <strong>de</strong> la partdu D r Dominique Stoppa-Lyonnet,du Service <strong>de</strong> génétique oncologiqueà l’Institut <strong>Curie</strong>, confrontéeau diagnostic <strong>de</strong>s prédispositionshéréditaires au cancer du sein.Sans attendre, il met au point unoutil moins cher, plus accessible etsurtout cinq fois plus rapi<strong>de</strong> queles pratiques usuelles. Une société,Fluigent, accélérera le transfert<strong>de</strong> la métho<strong>de</strong>. Si la validation encours se confirme, la métho<strong>de</strong>pourra ainsi être utilisée en routineà l’hôpital dès 2007, réduisantle délai d’attente <strong>de</strong> réponse<strong>de</strong> <strong>de</strong>ux mois à… une semaine!Elle facilitera aussi la recherche<strong>de</strong> prédisposition à uncancer pédiatrique <strong>de</strong> l’œil,le rétinoblastome.M.-L. M.1. L’Institut <strong>Curie</strong> naîtra plus tard<strong>de</strong> la fusion <strong>de</strong> l’Institut du radiumet <strong>de</strong> la Fondation <strong>Curie</strong> créée en 1920.Noak/<strong>Le</strong> bar Floréal/Institut <strong>Curie</strong>LE JOURNAL DEL’INSTITUT CURIE08,LE JOURNAL DEL’INSTITUT CURIE , 09