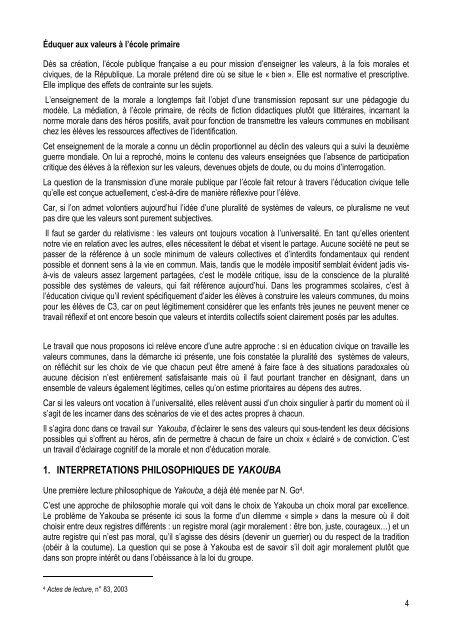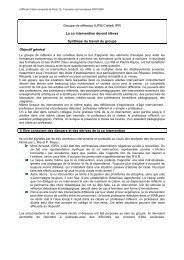"Yacouba " au cycle 3 - IUFM de l'Académie de Créteil
"Yacouba " au cycle 3 - IUFM de l'Académie de Créteil
"Yacouba " au cycle 3 - IUFM de l'Académie de Créteil
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Éduquer <strong>au</strong>x valeurs à l’école primaireDès sa création, l’école publique française a eu pour mission d’enseigner les valeurs, à la fois morales etciviques, <strong>de</strong> la République. La morale prétend dire où se situe le « bien ». Elle est normative et prescriptive.Elle implique <strong>de</strong>s effets <strong>de</strong> contrainte sur les sujets.L’enseignement <strong>de</strong> la morale a longtemps fait l’objet d’une transmission reposant sur une pédagogie dumodèle. La médiation, à l’école primaire, <strong>de</strong> récits <strong>de</strong> fiction didactiques plutôt que littéraires, incarnant lanorme morale dans <strong>de</strong>s héros positifs, avait pour fonction <strong>de</strong> transmettre les valeurs communes en mobilisantchez les élèves les ressources affectives <strong>de</strong> l’i<strong>de</strong>ntification.Cet enseignement <strong>de</strong> la morale a connu un déclin proportionnel <strong>au</strong> déclin <strong>de</strong>s valeurs qui a suivi la <strong>de</strong>uxièmeguerre mondiale. On lui a reproché, moins le contenu <strong>de</strong>s valeurs enseignées que l’absence <strong>de</strong> participationcritique <strong>de</strong>s élèves à la réflexion sur les valeurs, <strong>de</strong>venues objets <strong>de</strong> doute, ou du moins d’interrogation.La question <strong>de</strong> la transmission d’une morale publique par l’école fait retour à travers l’éducation civique tellequ’elle est conçue actuellement, c’est-à-dire <strong>de</strong> manière réflexive pour l’élève.Car, si l’on admet volontiers <strong>au</strong>jourd’hui l’idée d’une pluralité <strong>de</strong> systèmes <strong>de</strong> valeurs, ce pluralisme ne veutpas dire que les valeurs sont purement subjectives.Il f<strong>au</strong>t se gar<strong>de</strong>r du relativisme : les valeurs ont toujours vocation à l’universalité. En tant qu’elles oriententnotre vie en relation avec les <strong>au</strong>tres, elles nécessitent le débat et visent le partage. Aucune société ne peut sepasser <strong>de</strong> la référence à un socle minimum <strong>de</strong> valeurs collectives et d’interdits fondament<strong>au</strong>x qui ren<strong>de</strong>ntpossible et donnent sens à la vie en commun. Mais, tandis que le modèle impositif semblait évi<strong>de</strong>nt jadis visà-vis<strong>de</strong> valeurs assez largement partagées, c’est le modèle critique, issu <strong>de</strong> la conscience <strong>de</strong> la pluralitépossible <strong>de</strong>s systèmes <strong>de</strong> valeurs, qui fait référence <strong>au</strong>jourd’hui. Dans les programmes scolaires, c’est àl’éducation civique qu’il revient spécifiquement d’ai<strong>de</strong>r les élèves à construire les valeurs communes, du moinspour les élèves <strong>de</strong> C3, car on peut légitimement considérer que les enfants très jeunes ne peuvent mener cetravail réflexif et ont encore besoin que valeurs et interdits collectifs soient clairement posés par les adultes.Le travail que nous proposons ici relève encore d’une <strong>au</strong>tre approche : si en éducation civique on travaille lesvaleurs communes, dans la démarche ici présente, une fois constatée la pluralité <strong>de</strong>s systèmes <strong>de</strong> valeurs,on réfléchit sur les choix <strong>de</strong> vie que chacun peut être amené à faire face à <strong>de</strong>s situations paradoxales où<strong>au</strong>cune décision n’est entièrement satisfaisante mais où il f<strong>au</strong>t pourtant trancher en désignant, dans unensemble <strong>de</strong> valeurs également légitimes, celles qu’on estime prioritaires <strong>au</strong> dépens <strong>de</strong>s <strong>au</strong>tres.Car si les valeurs ont vocation à l’universalité, elles relèvent <strong>au</strong>ssi d’un choix singulier à partir du moment où ils’agit <strong>de</strong> les incarner dans <strong>de</strong>s scénarios <strong>de</strong> vie et <strong>de</strong>s actes propres à chacun.Il s’agira donc dans ce travail sur Yakouba, d’éclairer le sens <strong>de</strong>s valeurs qui sous-ten<strong>de</strong>nt les <strong>de</strong>ux décisionspossibles qui s’offrent <strong>au</strong> héros, afin <strong>de</strong> permettre à chacun <strong>de</strong> faire un choix « éclairé » <strong>de</strong> conviction. C’estun travail d’éclairage cognitif <strong>de</strong> la morale et non d’éducation morale.1. INTERPRETATIONS PHILOSOPHIQUES DE YAKOUBAUne première lecture philosophique <strong>de</strong> Yakouba a déjà été menée par N. Go 4 .C’est une approche <strong>de</strong> philosophie morale qui voit dans le choix <strong>de</strong> Yakouba un choix moral par excellence.Le problème <strong>de</strong> Yakouba se présente ici sous la forme d’un dilemme « simple » dans la mesure où il doitchoisir entre <strong>de</strong>ux registres différents : un registre moral (agir moralement : être bon, juste, courageux…) et un<strong>au</strong>tre registre qui n’est pas moral, qu’il s’agisse <strong>de</strong>s désirs (<strong>de</strong>venir un guerrier) ou du respect <strong>de</strong> la tradition(obéir à la coutume). La question qui se pose à Yakouba est <strong>de</strong> savoir s’il doit agir moralement plutôt quedans son propre intérêt ou dans l’obéissance à la loi du groupe.4 Actes <strong>de</strong> lecture, n° 83, 20034