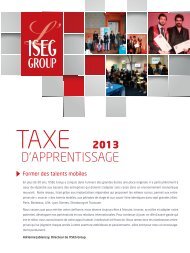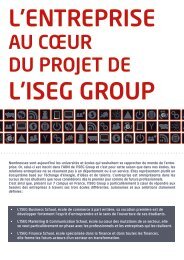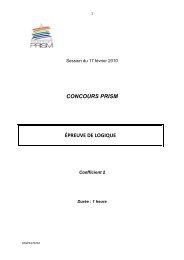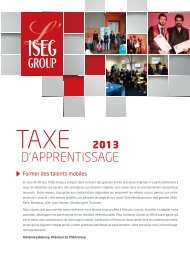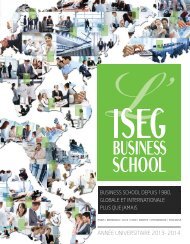Analyse du comportement de parasitisme dans la stratégie ...
Analyse du comportement de parasitisme dans la stratégie ...
Analyse du comportement de parasitisme dans la stratégie ...
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Analyse</strong> <strong>du</strong> <strong>comportement</strong> <strong>de</strong> <strong>parasitisme</strong> <strong>dans</strong> <strong>la</strong> stratégiemulticanale <strong>de</strong>s distributeurs : étu<strong>de</strong> empiriqueAnas FettahEnseignant-chercheur2012/1
<strong>Analyse</strong> <strong>du</strong> <strong>comportement</strong> <strong>de</strong> <strong>parasitisme</strong> <strong>dans</strong> <strong>la</strong> stratégiemulti-canale <strong>de</strong>s distributeurs : éu<strong>de</strong> empiriqueRésumé : La complémentarité entre site Internet et magasin n’est plus un sujet <strong>de</strong> division enrecherche sur <strong>la</strong> stratégie <strong>de</strong>s distributeurs. Notre recherche s’inscrit <strong>dans</strong> le prolongement <strong>de</strong>stravaux consacrés aux stratégies d’imp<strong>la</strong>ntations et <strong>de</strong> localisation commerciale, nous allonstenter <strong>de</strong> comprendre l’orientation stratégique <strong>de</strong>s distributeurs vers <strong>la</strong> formule électronique,sur <strong>la</strong> base d’une étu<strong>de</strong> empirique basée sur l’analyse <strong>de</strong> <strong>la</strong> répartition géographique <strong>de</strong> cinqgroupes <strong>de</strong> distribution français : Auchan, Carrefour, Cora, Intermarché, Leclerc.groupes <strong>de</strong>distribution alimentaire.Mots-clés : Parasitisme, concurrence, distribution, e-commerceAbstract : The complementarity between website and store is no longer a divisive issue inresearch on the strategy of distributors. Our research builds on the work on implementationstrategy and business location, we will try to un<strong>de</strong>rstand the strategic distributors to electronicform, on the basis of theoretical concepts and on the basis of study experimental analysis ofthe geographical distribution of five groups of French distribution: Auchan, Carrefour, Cora,Intermarché, Leclerc.Key Words : Parasitism , Competition, Retail, e-commerceIntro<strong>du</strong>ctionLes modèles d'analyse <strong>de</strong> l‘activité <strong>de</strong> distribution ont souvent examiné les lignes <strong>de</strong>force <strong>de</strong>s entreprises <strong>du</strong> secteur selon <strong>de</strong>s critères <strong>de</strong> performance. Sur le p<strong>la</strong>n financier, <strong>la</strong>mesure est basée sur les coûts et les marges. Les modèles intro<strong>du</strong>isant les variablesd'assortiment, <strong>de</strong> service et le <strong>comportement</strong> <strong>de</strong>s consommateurs permettent <strong>de</strong> mesurer <strong>la</strong>performance marketing sur <strong>la</strong> base d’une évaluation <strong>de</strong>s parts <strong>de</strong> clients, <strong>de</strong> fidélisation et <strong>de</strong>nombre <strong>de</strong> segments conquis ; Les modèles stratégiques ont souvent mesuré <strong>la</strong> performance<strong>de</strong> points <strong>de</strong> vue <strong>de</strong>s capacités <strong>de</strong>s firmes à réagir au développement <strong>de</strong> nouvelles formes <strong>de</strong>concurrence (Bensebaa, 2003 ; Roy, 2005 ; Marouseau, 2007)Depuis que <strong>la</strong> stratégie concerne l'avenir, le contexte stratégique d'une entreprise est<strong>de</strong>venu incertain, même si le <strong>de</strong>gré et les sources d'incertitu<strong>de</strong> peuvent être différents pour lesentreprises. La première décision pour une entreprise reste le choix <strong>du</strong> moment <strong>de</strong> réaction(Wernerfelt et Karnani, 1987). L'entreprise a le choix d'agir maintenant ou attendre jusqu'à ceque le niveau d’incertitu<strong>de</strong> soit atténué ; si l'entreprise déci<strong>de</strong> d’agir au moment où les1
incertitu<strong>de</strong>s sont nombreuses, elle doit concentrer ses ressources sur plusieurs scénarios enmaintenant <strong>la</strong> flexibilité. Pour analyser ces décisions, il convient d’analyser <strong>la</strong> nature <strong>de</strong>l’incertitu<strong>de</strong> et les caractéristiques <strong>de</strong> l’entreprise, ces analyses sont d’autant plus complexesen présence <strong>de</strong>s concurrents.Sur le p<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> distribution spatiale <strong>de</strong>s entreprises, <strong>la</strong> recherche académique a faitétat <strong>de</strong> nombreux travaux, qui visent à appréhen<strong>de</strong>r les dynamiques <strong>de</strong> formation et d’offre <strong>de</strong>ressources co-construites entre organisations, entreprises et territoires (Lauriol et al, 2008).Deux courants d’analyse sont distingués ; le premier abor<strong>de</strong> <strong>la</strong> stratégie <strong>de</strong> localisation à partir<strong>de</strong> <strong>la</strong> question <strong>de</strong> <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ce en considérant que les performances stratégiques <strong>dans</strong> une régionrésultent <strong>de</strong>s caractéristiques intrinsèques <strong>du</strong> territoire considéré (Sorenson et Baum, 2003) ;Le <strong>de</strong>uxième courant abor<strong>de</strong> <strong>la</strong> localisation <strong>du</strong> point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong> l’espace en intro<strong>du</strong>isant <strong>la</strong>dimension <strong>de</strong> répartition spatiale <strong>de</strong>s firmes à l’intérieur d’une in<strong>du</strong>strie ainsi qu’à <strong>la</strong>répartition <strong>de</strong>s actifs et <strong>de</strong>s ressources au sein <strong>de</strong>s firmes elles mêmes (E<strong>la</strong>ngo, 2004).Cet article se compose <strong>de</strong> trois partes. La première section abor<strong>de</strong> le paradigmed’interaction <strong>du</strong> point <strong>de</strong> vue théorique ainsi que le <strong>comportement</strong> <strong>de</strong> <strong>parasitisme</strong> mis en avant<strong>dans</strong> cette recherche ; <strong>dans</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>uxième section, nous étudions le <strong>comportement</strong> <strong>de</strong>distribution virtuelle <strong>de</strong> cinq enseignes <strong>de</strong> distribution présentant une formule <strong>de</strong> vente surInternet ; <strong>dans</strong> <strong>la</strong> troisième section, nous proposons <strong>de</strong> vérifier <strong>de</strong>ux hypothèses re<strong>la</strong>tives au<strong>comportement</strong> présumé <strong>de</strong> <strong>parasitisme</strong> <strong>dans</strong> le secteur <strong>de</strong> <strong>la</strong> distribution alimentaire.1 Revue <strong>de</strong> littérature1.1 Le choix <strong>de</strong> <strong>la</strong> localisation <strong>de</strong>s formules <strong>de</strong> vente : analyse selon <strong>la</strong> dynamiqueconcurrentielleLes modèles d'analyse <strong>de</strong> l‘activité <strong>de</strong> distribution ont souvent examiné les lignes <strong>de</strong>force <strong>du</strong> secteur selon <strong>de</strong>s critères <strong>de</strong> performance financière (Geyskens et al., 2002 ; Dupuis,2000) ; marketing (Vyt et Cliquet, 2002 ; Filser, 2004 ; Michaud-Trévinal et Cliquet, 2002 ;Dupuis et Fournioux, 2002) ; Stratégique en analysant les stratégies <strong>de</strong> croissance (Filser,2004 ; Dupuis, et Fournioux, 2002), <strong>de</strong> localisation par rapport aux concurrents (Rulence,2003 ; Bensebaa, 2003 ; Roy, 2005 ; Marouseau, 2007 ; Liarte, 2006 ; Fettah et Muller, 2008 )ou <strong>de</strong> renforcement <strong>de</strong> sa présence sur le marché (Roy, 2004). Le distributeur, sur son marchédomestique cherche à développer sa taille par croissance interne si l'environnementinstitutionnel lui permet <strong>de</strong> créer <strong>de</strong> nouveaux magasins. Dans le cas contraire, il va chercherle développement <strong>de</strong> sa taille via <strong>la</strong> stratégie <strong>de</strong> croissance externe. Néanmoins, toute stratégieadoptée par les distributeurs a pour effet <strong>de</strong> perturber l’équilibre <strong>de</strong>s entreprises présentes surle marché.2
Le choix <strong>de</strong> localisation relève <strong>de</strong> l’intention stratégique <strong>de</strong>s dirigeants, en recourant à<strong>de</strong>s hypothèses simples, les dirigeants ont souvent été amenés à arbitrer entre <strong>la</strong> stratégied’évitement et le <strong>parasitisme</strong>, alternant à <strong>la</strong> fois <strong>de</strong>s actions <strong>de</strong> coopération et <strong>de</strong> rivalité(Cliquet, 2002 ; Filser, 2004 ; Liarte, 2006). La stratégie d’évitement par extension <strong>du</strong> réseau<strong>dans</strong> les zones <strong>de</strong> marchés (Ghosh et Craig, 1983) s’apparente à <strong>la</strong> diffusion par contagiondécrite comme une conquête pas à pas sur un <strong>la</strong>rge front (Lau<strong>la</strong>jainen, 1987). Elle serapproche à <strong>la</strong> fois <strong>de</strong> <strong>la</strong> stratégie d’extension contiguë <strong>de</strong> Stampfl (1988), supposantl’ouverture <strong>de</strong> magasins proches <strong>de</strong>s anciens et <strong>la</strong> domination régionale dont l’objectif est <strong>de</strong>ré<strong>du</strong>ire les coûts <strong>de</strong> distribution et d’adapter l’offre aux besoins <strong>de</strong>s consommateurs locaux.La stratégie d’évitement consiste à ne pas provoquer ni initier une attaque frontale(Liarte, 2006). Opter pour un emp<strong>la</strong>cement différent <strong>de</strong>s concurrents peut paraître bénéfiquepour une entreprise lorsqu’elle cherche à se différencier, parfois, l’éloignement géographiquepeut s’avérer efficace pour verrouiller les préférences <strong>de</strong>s consommateurs.La stratégie d’agglomération, bien qu’elle puisse procurer <strong>de</strong>s avantages <strong>de</strong>s coûtslorsque les entreprises souhaitent bénéficier <strong>de</strong> l’attractivité crée par les entreprises déjàinstallées, elle contribue à intensifier <strong>la</strong> concurrence entre les acteurs et parfois même auphénomène <strong>de</strong> concentration. L’observation simple <strong>de</strong> <strong>la</strong> géographie économique con<strong>du</strong>itrapi<strong>de</strong>ment à percevoir l’agglomération <strong>de</strong>s activités <strong>de</strong> distribution <strong>dans</strong> l’espace (Crozet etMayer, 2002) créant les conditions <strong>de</strong> disparités <strong>dans</strong> <strong>la</strong> répartition <strong>de</strong>s surfaces <strong>de</strong> vente.Pour expliquer les inégalités observées <strong>de</strong> <strong>la</strong> répartition spatiale <strong>de</strong>s enseignes, nouspouvons citer les facteurs associés à l’attraction exercée par le lieu sur les entreprises, àl’intention stratégique <strong>de</strong>s distributeurs qui souhaitent perturber l’équilibre actuel <strong>de</strong>sconcurrents, et <strong>la</strong> volonté <strong>de</strong> ré<strong>du</strong>ire <strong>la</strong> domination <strong>de</strong>s enseignes rivales sur <strong>de</strong> zones <strong>de</strong>marché. Nous émettons l’hypothèse que l’orientation vers le commerce électronique permet<strong>de</strong> corriger l’absence <strong>de</strong>s distributeurs.En recourant à l’agglomération <strong>de</strong> l’activité Internet <strong>dans</strong> les zones <strong>de</strong> présencephysique <strong>de</strong>s concurrents, les distributeurs peuvent espérer ré<strong>du</strong>ire l’incertitu<strong>de</strong> re<strong>la</strong>tive à <strong>la</strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>du</strong> marché et préparer l’entrée <strong>de</strong> nouvelles formules. Par ailleurs, l’agglomérationautour d’entreprises concurrentes peut dépasser l’objectif <strong>de</strong> recherche <strong>de</strong>s effets positifsassociés à l’existence <strong>de</strong>s infrastructures nécessaires (entrepôts, transport par exemple) pouressayer <strong>de</strong> profiter <strong>de</strong> <strong>la</strong> dégradation d’une situation concurrentielle défavorables <strong>de</strong> sesrivaux (Liarte, 2006). Dans <strong>la</strong> première acception, <strong>la</strong> firme qui cherche <strong>de</strong>s effets positifs <strong>de</strong>l’agglomération peut adopter un <strong>comportement</strong> <strong>de</strong> passager c<strong>la</strong>n<strong>de</strong>stin sans avoir à supporter<strong>de</strong>s coûts supplémentaires. Pour le distributeur, il peut <strong>la</strong>isser d’autres enseignes s’installer3
<strong>dans</strong> une zone géographique déterminée et bénéficier <strong>de</strong>s effets positifs associés àl’infrastructure sans y avoir participé (Liarte, 2006) ; Dans <strong>la</strong> <strong>de</strong>uxième acception, <strong>la</strong> firme quia <strong>la</strong> meilleure maîtrise <strong>de</strong>s compétences pourraient éliminer celles qui ne l’ont pas, lescondamnant à disparaître ou à se focaliser sur un marché <strong>de</strong> niche. Cette stratégie, dite <strong>de</strong><strong>parasitisme</strong>, peut s’avérer dangereuse pour une entreprise qui intègre le marché avec peu <strong>de</strong>ressources ou sans avantage concurrentiel perceptible par les clients, car l’entreprise parasitéepeut riposter à cette situation en mettant en p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong>s actions agressives mettant fin à cespratiques et contraignant le parasite à quitter le marché (LeRoy, 2003).1.2 Étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> cas <strong>de</strong>s firmes <strong>de</strong> distribution alimentaireLa vision <strong>de</strong> marché global avec <strong>la</strong> diversification <strong>de</strong>s activités est l'un <strong>de</strong>s facteurs <strong>de</strong>compétitivité <strong>de</strong>s entreprises <strong>de</strong> distribution. Les formules <strong>de</strong> distribution ont réussi, pendantles cinq <strong>de</strong>rnières années, à maintenir leurs parts <strong>de</strong> marché malgré les retentissements récents<strong>de</strong> quelques groupes, comme Leclerc qui revendique <strong>la</strong> libéralisation <strong>du</strong> secteur, <strong>la</strong> levée <strong>de</strong>srestrictions réglementaires re<strong>la</strong>tives à l’imp<strong>la</strong>ntation (Loi Royer et ensuite <strong>la</strong> loi Raffarin) etles re<strong>la</strong>tions avec les fournisseurs (Loi Gal<strong>la</strong>nd).Le marché <strong>de</strong> l’alimentaire n’a pas connu d’innovation majeures en matières <strong>de</strong> formats<strong>de</strong> vente, <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tive stabilité que connaît ce marché ren<strong>de</strong>nt dominantes les formats <strong>de</strong>supermarché, <strong>de</strong> l’hypermarché et <strong>du</strong> hard discount, qui suscite l’interrogation <strong>de</strong>s praticienset <strong>de</strong>s chercheurs sur leurs perspectives d’évolution et sur l’avenir <strong>de</strong> développement <strong>de</strong>nouvelles formules innovantes capables <strong>de</strong> remettre en cause l’équilibre actuel (Filser etPaché, 2008).Le développement <strong>de</strong> <strong>la</strong> formule virtuelle <strong>de</strong> distribution paraît comme une opportunité pourles distributeurs qui souhaitent renforcer <strong>la</strong> présence <strong>de</strong> leur enseignes <strong>dans</strong> les zones <strong>de</strong>marché pour maintenir leurs parts <strong>de</strong> clients (Fettah et Muller, 2008) une tactique <strong>de</strong> prédationdont l’objectif est <strong>de</strong> combler <strong>la</strong> déficience d’une présence suffisante ou encore une stratégie<strong>de</strong> <strong>parasitisme</strong> vis-à-vis <strong>de</strong>s enseignes présentes à travers <strong>de</strong>s formules physiques <strong>de</strong>distribution.Notre recherche s’intéresse à l’utilisation <strong>de</strong> l’Internet <strong>dans</strong> l’interface avec lesconsommateurs (frontoffice), l’objectif est d’étudier les <strong>comportement</strong>s d’actions-réactions<strong>de</strong>s entreprises <strong>de</strong> distribution face à l’émergence <strong>du</strong> commerce électronique comme canalsupplémentaire <strong>de</strong> distribution. Nous justifions ce choix par <strong>de</strong>ux facteurs, tout d’abord, lessites Internet peuvent s’appuyer sur l’expertise et le volume d’achat <strong>du</strong> groupe auquel ils4
appartiennent pour être <strong>de</strong> plus en plus compétitifs ; le <strong>de</strong>uxième facteur émane <strong>du</strong>changement observé <strong>dans</strong> le <strong>comportement</strong> <strong>de</strong>s consommateurs, <strong>la</strong> tendance est à <strong>la</strong> collecte<strong>de</strong>s informations sur différents canaux pour arbitrer ensuite <strong>dans</strong> le choix <strong>de</strong> <strong>la</strong> formule <strong>de</strong>vente, ce phénomène <strong>la</strong>rgement étudie et mis e évi<strong>de</strong>nce <strong>dans</strong> <strong>la</strong> littérature académique avec le<strong>comportement</strong> <strong>de</strong> procrastination (Darpy, 1999).2 Stratégie d’agglomération et stratégie <strong>de</strong> distribution <strong>du</strong>aleLa stratégie <strong>de</strong> distribution <strong>du</strong>ale, dite click and mortar est une stratégie ambitieuse, avec<strong>la</strong>quelle l’entreprise souhaite ré<strong>du</strong>ire ses coûts et augmenter le niveau et <strong>la</strong> qualité <strong>de</strong> service(Gallouj, 2007 ; Poirel, 2008). Cependant, ces objectifs peuvent s’avérer difficiles à réaliserconjointement <strong>du</strong> point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> et <strong>de</strong> l’offre <strong>de</strong> pro<strong>du</strong>it (Geyskens et al., 2002 ;Poirel, 2008). L'Internet crée <strong>de</strong>s opportunités mais il n'est pas sans présenter <strong>de</strong>s risques, ilpeut améliorer les performances aussi facilement qu'il peut les détruire (Geyskens et al.,2002).2.1 Mesure <strong>de</strong> l’interaction spatiale et virtuelle <strong>de</strong>s distributeursLe territoire est une notion complexe et <strong>du</strong>ale qui offre <strong>de</strong>s opportunités aux entreprises<strong>de</strong> distribution pour être compétitives, son fon<strong>de</strong>ment basé sur trois composantes : le substrat<strong>de</strong>s actifs spécifiques que les acteurs extérieurs ne peuvent mobiliser avec <strong>la</strong> même efficience(Joffre et Koenig, 1992) ; <strong>la</strong> ré<strong>du</strong>ction <strong>de</strong>s coûts <strong>de</strong> transaction <strong>dans</strong> l’univers moins incertain<strong>de</strong> re<strong>la</strong>tions in<strong>du</strong>strielles plus conventionnelles que contractuelles ; le milieu favorable audéveloppement <strong>de</strong>s compétences indivi<strong>du</strong>elles spécialisées et spécifiques par le jeu <strong>de</strong> <strong>la</strong>stimu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> processus d’interaction et d’apprentissages collectifs (Saives et Lambert,1999). La notion d’interaction spatiale est excessivement difficile à définir bien qu’elle joueun rôle principal <strong>dans</strong> les définitions géomarketing. Elle a été liée, <strong>dans</strong> <strong>la</strong> littérature auphénomène <strong>de</strong> décroissance <strong>de</strong>s flux avec <strong>la</strong> distance. L’interaction spatiale se définit par lenombre <strong>de</strong> re<strong>la</strong>tions entre lieux spatialement proches (Cliquet, 1998).La notion d’occupation d’espace se dissout avec le commerce électronique, face au<strong>du</strong>rcissement <strong>de</strong> <strong>la</strong> légis<strong>la</strong>tion quant à l’imp<strong>la</strong>ntation <strong>de</strong>s surfaces <strong>de</strong> vente, les distributeurspeuvent cesser les manœuvres tactiques pour imp<strong>la</strong>nter leurs surfaces <strong>de</strong> vente, mobiliser <strong>de</strong>sressources nouvelles pour entrer en interaction virtuelle avec leurs concurrents. L’offrevirtuelle leur permet d’améliorer leur position qui n’est plus strictement limitée par le5
territoire. La stratégie d’agglomération suppose désormais pour le nouvel entrant <strong>de</strong> s’attaqueraux entreprises localement établies par l’ouverture d’une formule virtuelle <strong>de</strong> vente. Laréaction <strong>de</strong>s entreprises concurrencées (parasitées) peut s’orienter <strong>dans</strong> <strong>de</strong>ux directions,tolérer le <strong>parasitisme</strong> en considérant qu’il est préférable d’accepter l’arrivée d’un concurrentvirtuel même s’il pratique <strong>de</strong>s prix bas (Liarte, 2006), <strong>dans</strong> ce cas, l’entreprise seraitcontrainte <strong>de</strong> maintenir <strong>la</strong> cohérence spatiale <strong>de</strong> ses imp<strong>la</strong>ntations et <strong>de</strong> gar<strong>de</strong>r une certainehomogénéité au niveau <strong>de</strong>s prix ; <strong>la</strong> <strong>de</strong>uxième direction suppose <strong>de</strong> riposter au <strong>parasitisme</strong>considérant <strong>la</strong> manœuvre <strong>du</strong> nouvel entrant comme agressive, les distributeurs vont déployerd’autres ressources pour accroître le niveau <strong>de</strong> service <strong>de</strong> leur surfaces établies et ouvrir <strong>de</strong>nouvelles formules hybri<strong>de</strong>s combinant magasins et site Internet comme le Drive (Gallouj,2007)2.2 Formu<strong>la</strong>tions <strong>de</strong>s questions et <strong>de</strong>s hypothèses <strong>de</strong> rechercheÀ partir <strong>de</strong> cette revue <strong>de</strong> littérature qui se veut non-exhaustive <strong>de</strong>s stratégiesconcurrentielles, nous nous sommes interrogés sur le potentiel d’observation <strong>de</strong>s interactionsentre localisation <strong>de</strong>s surfaces <strong>de</strong> vente et sites <strong>de</strong> distribution électronique, existe-t-il unphénomène <strong>de</strong> <strong>parasitisme</strong> <strong>dans</strong> <strong>la</strong> stratégie <strong>de</strong> distribution <strong>du</strong>ale ?Question 1 : Y a-t-il une re<strong>la</strong>tion entre <strong>la</strong> répartition <strong>de</strong>s magasins et <strong>la</strong> distribution <strong>de</strong>sformules virtuelles compte tenu <strong>de</strong>s caractéristiques intrinsèques <strong>de</strong>s territoires considérés ?Question 2 : Les distributeurs ne disposant pas d’une forte cohérence spatiale seraient-ilsanimés par une stratégie <strong>de</strong> <strong>parasitisme</strong> ?2.3 Eléments <strong>de</strong> mesure <strong>de</strong> l’interaction spatiale et virtuelle <strong>de</strong>s groupes <strong>de</strong>distributionPour répondre à ces questions <strong>de</strong> <strong>la</strong> mesure <strong>du</strong> potentiel d’interaction spatiale etvirtuelle, nous proposons une méthodologie <strong>de</strong> recherche permettant <strong>de</strong> justifier le choix <strong>de</strong> <strong>la</strong>problématique et d’apporter <strong>de</strong>s éléments <strong>de</strong> réponses aux questions posées.2.4 MéthodologieChamp expérimentalLe champ expérimental comporte 5 enseignes <strong>de</strong> distribution généralistes, Auchan,Carrefour, Cora, Intermarché, Leclerc. La dominance alimentaire <strong>de</strong>s cinq enseignes nous6
amène à les considérer comme concurrentes. Le développement <strong>de</strong> ces enseignes sur tout leterritoire et l’extension vers <strong>de</strong>s formules <strong>de</strong> vente à distance ren<strong>de</strong>nt leurs stratégiescomparables.L’unité d’analyse est le département.L’échantillon est constitué <strong>de</strong>s 94 départements métropolitains pour <strong>de</strong>ux raisons : le respect<strong>de</strong> <strong>la</strong> continuité <strong>du</strong> territoire d’une part et d’autre part, l’existence <strong>dans</strong> chaque départementd’un siège <strong>de</strong> <strong>la</strong> Commission Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC).Le traitement <strong>de</strong> donnéesPour tous les groupes <strong>de</strong> distribution, on vérifie les liens qui existent entre les caractéristiques<strong>de</strong>s départements et le nombre <strong>de</strong> magasins. Pour chaque groupe <strong>de</strong> distribution, nouscomparons <strong>la</strong> couverture spatiale <strong>de</strong>s magasins par rapport à <strong>la</strong> couverture virtuelle.2.5 Validation <strong>de</strong>s hypothèses* Première question : y-t-il un lien entre <strong>la</strong> présence <strong>de</strong>s e-magasins, et caractéristiques<strong>de</strong>s territoires considérés?Autrement dit, l’hypothèse émise ici suppose que <strong>la</strong> couverture <strong>de</strong>s sites Internet estliée positivement aux caractéristiques intrinsèques <strong>de</strong>s territoires. L’action ou <strong>la</strong> réaction <strong>de</strong>sdistributeurs, vis-à-vis <strong>de</strong> <strong>la</strong> concurrence se manifeste par le déploiement spatial <strong>de</strong> formulesinteractives qui s’appuient davantage sur <strong>de</strong>s caractéristiques intrinsèques <strong>de</strong> <strong>la</strong> zonesélectionnée et <strong>la</strong> cohérence <strong>du</strong> réseau physique (figure 1),04RevAnnuel,17Nbretotalmage1,11,10 -,04 ,67,44TxPopAct,03Totalemagse2Mesures d’ajustement :Khi-carré = 1,189 n.d.l. = 1 p = 0,276RMSEA = 0,045 NFI = 0,980 CFI = 0,997RMR = 0,004 GFI = 0,994 AGFI = 0,937Modèle acceptable parce que les erreurs RMSEA et RMR < 0,10 et les indices d’ajustement NFI, CFI,GFI et AGFI ≥ 0,9.Figure 1: Les re<strong>la</strong>tions entre les caractéristiques <strong>de</strong>s territoires et <strong>la</strong> répartition <strong>de</strong>sformules <strong>de</strong> vente virtuelles7
L’analyse discriminante par <strong>la</strong> métho<strong>de</strong> <strong>de</strong>s pas entre le nombre <strong>de</strong> sites Internet <strong>de</strong>scinq groupes <strong>de</strong> distribution et les variables indépendantes : taux <strong>de</strong> présence <strong>de</strong> popu<strong>la</strong>tionactive, revenu annuel, , taux d’équipement en voitures, taux <strong>de</strong> popu<strong>la</strong>tions âgée, nombre <strong>de</strong>magasins, montre que seule cette <strong>de</strong>rnière variable discrimine significativement le nombre <strong>de</strong>e-magasins (Lambda <strong>de</strong> Wilks = 0,546 ; F (6 ;87,0) = 12,042 ; Signification = 0,000).La régression <strong>du</strong> nombre total <strong>de</strong> e-magasins sur le nombre total <strong>de</strong> magasinsphysiques, les revenus annuels et le taux <strong>de</strong> popu<strong>la</strong>tion active montre que ces variablesexpliquent 44 % <strong>de</strong> <strong>la</strong> variance <strong>du</strong> total <strong>de</strong>s e-magasin (r² = 0,44). Le nombre total <strong>de</strong>magasins physiques a un effet significatif positif sur le total <strong>de</strong> e-magasins ; p= 0,000). Le revenu annuel exerce un effet significatif positif sur le nombre total <strong>de</strong> magasins; p < 0,10). Le résultat présenté <strong>dans</strong> ce mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> calcul nous permet <strong>de</strong>vali<strong>de</strong>r l’hypothèse émise <strong>dans</strong> <strong>la</strong> question 1.* Deuxième question :Les distributeurs ne disposant pas d’une forte présence spatiale <strong>de</strong> leurs magasinsseraient-ils animés par une stratégie <strong>de</strong> <strong>parasitisme</strong> ?Autrement dit, l’hypothèse à ce sta<strong>de</strong> suppose que le développement <strong>de</strong> <strong>la</strong> formulevirtuelle <strong>de</strong> vente d’un groupe <strong>de</strong> distribution est lié négativement à <strong>la</strong> présence <strong>de</strong> ses points<strong>de</strong> vente. Nous opérons une distinction entre zone <strong>de</strong> présence qui concerne les zones <strong>de</strong>cha<strong>la</strong>ndise <strong>de</strong>s magasins physiques et zone <strong>de</strong> couverture qui correspond aux zones <strong>de</strong><strong>de</strong>sserte par les sites marchandsMesure <strong>de</strong> l’interaction entre présence physique et virtuelle <strong>de</strong>s distributeursPour vérifier l’hypothèse <strong>de</strong> déploiement <strong>de</strong> <strong>la</strong> ressource spatiale <strong>dans</strong> <strong>la</strong> stratégiemulti-canale, nous empruntons l’une <strong>de</strong>s techniques <strong>de</strong> mesure <strong>de</strong> <strong>la</strong> qualité <strong>de</strong> répartitiond’un réseau, l’entropie. Elle permet <strong>de</strong> mesurer le <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> désordre <strong>dans</strong> <strong>la</strong> répartition <strong>de</strong>spoints <strong>de</strong> vente sur un territoire défini (Cliquet et Rulence, 1998 ; Rulence, 2003). L’entropiepermet une analyse comparative <strong>de</strong> <strong>la</strong> cohérence spatiale entre firmes concurrentes.L’utilisation <strong>de</strong> l’entropie re<strong>la</strong>tive permet <strong>de</strong> simplifier l’analyse en comparant les valeurs<strong>dans</strong> un intervalle [0,1]. L’entropie est utilisée ici comme variable <strong>de</strong> contrôle, sa formule estexprimée par :8
E= -f i x log (f i ) ; i=1 à k Entropie re<strong>la</strong>tive = E/log kOù : E = entropie ; k = nombre <strong>de</strong> zones géographiques concernées ; f i = fréquence <strong>de</strong>s unités<strong>dans</strong> une zone (f i = n i / N) ; n i = nombre <strong>de</strong> magasins <strong>dans</strong> <strong>la</strong> zone i.N = nombre total <strong>de</strong> magasins.Métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> calculPour mesurer le <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> cohérence (vs désordre), Rulence (2003), Cliquet et Rulence(1998) ont utilisé <strong>de</strong>s coefficients d’auto-corré<strong>la</strong>tion permettant <strong>de</strong> délimiter l’espaced’analyse sur un territoire donné. Or, <strong>dans</strong> notre analyse, <strong>la</strong> notion d’espace se dissout pourmettre en évi<strong>de</strong>nce le <strong>comportement</strong> général <strong>de</strong> <strong>parasitisme</strong> sur un territoire éten<strong>du</strong> dont leslimites sont les frontières <strong>du</strong> pays. Nous utilisons une variable binaire [0,1] pour caractériserle phénomène <strong>de</strong> <strong>parasitisme</strong> d’un site Internet <strong>dans</strong> les départements. Ce phénomène estobservé à chaque fois que le site Internet <strong>du</strong> distributeur est présent <strong>dans</strong> le départementd’absence <strong>de</strong> ses magasins. La régression avec une variable binaire ne pourrait pas respecterle principe <strong>de</strong> <strong>la</strong> distribution normale, car toutes les valeurs se situent à 0 ou à 1. C’est <strong>la</strong>raison pour <strong>la</strong>quelle, nous avons choisi <strong>la</strong> métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> régression logistique.La régression pas à pas est utilisée comme solution aux problèmes <strong>de</strong> colinéarité enlimitant le nombre <strong>de</strong> variables explicatives suivant leurs coefficients <strong>de</strong> corré<strong>la</strong>tion partielleavec <strong>la</strong> variable expliquée (Foucart 2006). Cette métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> régression est parmi lesmétho<strong>de</strong>s les plus adaptées aux étu<strong>de</strong>s souffrant <strong>de</strong> multicolinéarité <strong>de</strong>s variables (Tenenhauset al.,1995).Dans notre étu<strong>de</strong>, l’interaction concurrentielles entre présence <strong>de</strong> magasin et couverture <strong>de</strong>sites marchands est étudiée selon ce même principe. En attribuant à chaque fois une valeur <strong>de</strong>1 à chaque unité <strong>de</strong> couverture <strong>du</strong> site marchand, <strong>la</strong> valeur 0 est attribué à l’unité qui n’est pascouverte par le site Internet.Le modèle général <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux régressions se présente ainsi :Y= e a X e b1(i) X e b2(j) X e b3(k) X e b4(h)Y correspond à <strong>la</strong> distribution <strong>de</strong> Houra et Expressmarché <strong>dans</strong> 64 et 61 départementsrespectivement.(i) représente le nombre <strong>de</strong> magasins Auchan ;(j) représente le nombre <strong>de</strong> magasins Carrefour ;(k) représente le nombre <strong>de</strong> magasins Leclerc ;(h) représente alternativement le nombre <strong>de</strong> magasins Cora <strong>dans</strong> les 61 départements oùIntermarché n’est pas présent, et le nombre <strong>de</strong> magasins <strong>de</strong> Intermarché <strong>dans</strong> les 64départements <strong>de</strong> non-présence <strong>de</strong> Cora.9
3 Comparaison <strong>de</strong> <strong>la</strong> couverture spatiale <strong>de</strong>s groupes <strong>de</strong> distributionLes groupes Auchan et Carrefour présentent une couverture assez homogène <strong>de</strong> leurssurfaces <strong>de</strong> vente. Cependant, leur cohérence spatiale <strong>dans</strong> le commerce électronique n’estque faiblement présentée. A l’inverse, Cora et Intermarché présentent une couverture spatialefaible (30 départements pour Cora et 33 pour Intermarché), leur cohérence spatiale estmoyenne, en revanche, leur présence sur Internet a été recensée <strong>de</strong>s plus fortes.Le groupe Leclerc, présente un cas particulier, il dispose <strong>de</strong> <strong>la</strong> plus forte présence sur leterritoire (Entropie re<strong>la</strong>tive = 0,94), mais ne dispose pas <strong>de</strong> site Internet dédié exclusivement àl’activité <strong>de</strong> vente en ligne. Ce groupe développe une formule hybri<strong>de</strong> <strong>de</strong> Drive <strong>dans</strong> 9départements <strong>de</strong> présence <strong>de</strong> ses magasins. Les sites <strong>de</strong>s enseignes, Auchan, Carrefour etLeclerc sont absents <strong>dans</strong> les zones <strong>de</strong> non-présence <strong>de</strong> magasins. Malgré l’absence <strong>de</strong> leursmagasins, les groupes Cora et Intermarché présentent une formule virtuelle (tableau 1)Le développement <strong>de</strong> e-magasins pour un groupe se base donc sur <strong>la</strong> présence <strong>de</strong> sesmagasins, <strong>dans</strong> une stratégie complémentaire <strong>de</strong> formules <strong>de</strong> vente, comme il peut s’appuyersur <strong>la</strong> présence <strong>de</strong>s concurrents, auquel cas, <strong>la</strong> stratégie concurrentielle est dite <strong>de</strong> <strong>parasitisme</strong>.Pour vérifier cette hypothèse, nous allons mesurer l’interaction <strong>de</strong>s sites <strong>de</strong> Houra etIntermarché <strong>dans</strong> respectivement 64 et 61 départements <strong>de</strong> non-présence <strong>de</strong> leurs magasinsphysiques. L’objectif est d’isoler le <strong>comportement</strong> <strong>de</strong> <strong>parasitisme</strong> qui peut viser un ouplusieurs concurrents présents sur le marché (tableau 2).10
3.1 Résultats et analysesNous avons retenu <strong>dans</strong> l’analyse <strong>de</strong>ux dimensions <strong>de</strong> <strong>la</strong> présence <strong>de</strong> Houra qui sontsignificatives et qui permettent <strong>de</strong> calculer <strong>la</strong> probabilité <strong>de</strong> <strong>parasitisme</strong> <strong>du</strong> groupe Cora : <strong>la</strong>présence <strong>de</strong>s magasins Auchan et Carrefour. Le Chi² est plus élevé après l’intro<strong>du</strong>ction <strong>de</strong>Auchan ce qui signifie que le modèle est amélioré par l’intro<strong>du</strong>ction <strong>de</strong> cette variable.EnseigneHouraEtape1(a)Etape2(b)Variables Nombre <strong>de</strong>significatives départementsCarrefourConstanteB Wald Signif Exp(B)R <strong>de</strong>ux <strong>de</strong> KhiNagelkerke <strong>de</strong>ux0,684 12,205 0,000 1,982 0,403 17,743-22,097 0,0003,4470,032Auchan 64 0,720 4,381 0,036 2,054 0,494 22,545Carrefour 0,496 5,037 0,025 1,642Constante-21,624 0,0003,9340,020a Variable(s) entrées à l'étape 1 : Carrefour.b Variable(s) entrées à l'étape 2 : Auchan.Tableau 1 : mesure <strong>du</strong> <strong>comportement</strong> <strong>de</strong> <strong>parasitisme</strong> <strong>du</strong> site HouraLa valeur <strong>de</strong> R² <strong>de</strong> Nagelkerke est une version ajustée <strong>du</strong> Cox et Snell et est donc plusprès <strong>de</strong> <strong>la</strong> réalité. Ainsi, 49,3% <strong>de</strong> <strong>la</strong> variation <strong>de</strong> <strong>la</strong> présence <strong>de</strong> Houra pourrait être expliquéepar <strong>la</strong> présence <strong>de</strong> Carrefour et Auchan <strong>dans</strong> les 64 départementsL’équation <strong>de</strong> régression <strong>de</strong> présence <strong>du</strong> site Houra peut s’écrire comme suit :(1)Y= e 0,2 x e 2,054(nb Mag Auchan) 1,642(nb Mag Carrefour)x e11
Enseigne VariablesExpressmarché significativesCarrefourEtape 1(a)ConstanteNombre <strong>de</strong>ExpB Wald Signifdépartements(B)R <strong>de</strong>ux <strong>de</strong> KhiNagelkerke <strong>de</strong>ux0,319 4,470 0,035 1,376 0,138 4,97461 -19,377 0,000 0,762,581a Variable(s) entrées à l'étape 1 : Carrefour.Tableau 2 : Mesure <strong>du</strong> <strong>comportement</strong> <strong>de</strong> <strong>parasitisme</strong> <strong>du</strong> site ExpressmarchéSeule <strong>la</strong> répartition <strong>de</strong>s magasins Carrefour permet d’expliquer <strong>la</strong> présence <strong>du</strong> siteExpressmarché. Nous pouvons affirmer que le groupe Intermarché souhaite parasiter <strong>la</strong>présence <strong>de</strong> l’enseigne Carrefour en proposant une formule virtuelle (tableau 4)L’équation <strong>de</strong> régression <strong>du</strong> site Expressmarché peut s’écrire :(2) Y= e 0,76 1,376(nb Mag Carrefour)x e3.2 Discussions, implication et limites <strong>de</strong> rechercheÀ travers cette étu<strong>de</strong> empirique <strong>de</strong> <strong>la</strong> répartition spatiale <strong>de</strong>s surfaces <strong>de</strong> vente et <strong>de</strong>ssites marchands, nous avons mis en évi<strong>de</strong>nce l’opportunité <strong>du</strong> web à procurer auxdistributeurs à faible couverture physique <strong>la</strong> possibilité <strong>de</strong> combler <strong>la</strong> défail<strong>la</strong>nce re<strong>la</strong>tive àl’insuffisance (désordre) <strong>de</strong> <strong>la</strong> répartition <strong>de</strong> leurs points <strong>de</strong> vente à travers le <strong>comportement</strong><strong>de</strong> <strong>parasitisme</strong> ; d’autre part, cette stratégie peut être sans intention préa<strong>la</strong>ble <strong>de</strong> nuire auxconcurrents, les distributeurs peuvent renforcer <strong>la</strong> présence <strong>de</strong> leurs magasins à traversl’élévation <strong>du</strong> niveau <strong>de</strong> service et l’exploitation <strong>de</strong> nouveau mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> médiation avec lesconsommateurs.L’étu<strong>de</strong> présentée <strong>dans</strong> cet article doit être complétée par <strong>de</strong>s entretiens <strong>de</strong>sdirigeants pour confirmer ou infirmer l’hypothèse d’intention stratégique <strong>du</strong><strong>comportement</strong> <strong>de</strong>s distributeurs.Du point <strong>de</strong> vue opérationnel, <strong>la</strong> métho<strong>de</strong> proposée pour caractériser le<strong>comportement</strong> <strong>de</strong> <strong>parasitisme</strong> <strong>de</strong>s distributeurs à travers <strong>la</strong> stratégie multicanale, <strong>de</strong>vraitêtre affinée pour tenir compte <strong>de</strong>s interactions au sein même <strong>de</strong>s zones <strong>de</strong> cha<strong>la</strong>ndise,<strong>dans</strong> ce cas, il convient <strong>de</strong> décrire <strong>de</strong>s zones <strong>de</strong> forte intensité concurrentielle et d’autreszones à faibles intensité avec une présence <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux concurrents au maximum. A terme,les groupes <strong>de</strong> distribution peuvent choisir les zones dont <strong>la</strong> profitabilité sera plusgran<strong>de</strong>.12
Références bibliographiquesBensebaa, F. (2003). La dynamique concurrentielle: défis analytiques et méthodologiques.Revue Finance, Contrôle, Stratégie. Vol 6. N° 1. pp. 5-39Cliquet, G. (1988). Les modèles gravitaires et leur évolution. Recherche et Applications enMarketing. Vol 3. N° 3/88. pp. 39-52Cliquet, G. Vyt, D (2003). Le géomerchandising <strong>dans</strong> <strong>la</strong> gran<strong>de</strong> distribution alimentairefrançaise : une approche exploratoire. Actes <strong>du</strong> 6 ème Colloque E.Thil. La RochelleCrozet, M. Mayer, T. (2002). Entre le global et le local, quelle localisation pour lesentreprises ? Les déterminants <strong>de</strong> <strong>la</strong> localisation <strong>de</strong>s firmes. Les nouvelles logiques <strong>de</strong>l'entreprise, Les Cahiers Français, N° 309E<strong>la</strong>ngo, B. (2004). Geographic Scope of Operations by Multinational Companies: AnExploratory Study of Regional and Global Strategies. European Management Journal,Vol. 22, n° 4.Fettah, A. Müller, J. (2008). Le paradigme d’interaction spatiale et virtuelle <strong>de</strong>s groupes <strong>de</strong>distribution alimentaire: approche empirique. Actes <strong>du</strong> 11 ème Colloque Etienne Thil.OctobreFilser, M. Paché, G. (2008). La dynamique <strong>de</strong>s canaux <strong>de</strong> distribution : Approches théoriqueset ruptures stratégiques. Revue Française <strong>de</strong> Gestion. Vol 182. pp. 109-133Filser, M. (2004). La stratégie <strong>de</strong> <strong>la</strong> distribution : <strong>de</strong>s interrogations managériales auxcontributions académiques. Revue Française <strong>de</strong> Marketing. N° 198. pp. 7-18Foucart, T. (2006). Colinéarité et régression linéaire. Mathématiques et Sciences humaines. n°173. pp. 5-25Gallouj, C. (2007). L’innovation <strong>dans</strong> le grand commerce : essai <strong>de</strong> construction d’uneapproche servicielle. Actes <strong>du</strong> 10 ème Colloque Etienne Thil. La Rochelle.Geyskens, I. Gielens, K. Dekimpe, M. (2002) Comment le marché évolue-t-il avec l'ajout d'uncanal? Recherche et application en Marketing. Vol 18. pp. 101-127Ghosh, A. et Craig C. S., (1983). Formu<strong>la</strong>ting Retail Location Strategy in a ChangingEnvironment. Journal of Marketing. N°47, 3, pp. 56-68.Joffre, P. Koenig, G (1985). Stratégie d’entreprise: antimanuel. Ed. Economica.Lau<strong>la</strong>jainen R. (1987), Spatial strategies in retailing, Dordrecht, Hol<strong>la</strong>nd : Rei<strong>de</strong>l.Lauriol, J. Perret, V. Tannery, F. (2008). Stratégies, espaces et territoires : Une intro<strong>du</strong>ctionsous un prisme géographique. Revue Française <strong>de</strong> Gestion. N°184. pp. 91-103LeRoy, F. (2003). Agresser un concurrent pour le sortir <strong>du</strong> marché: une étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> cas. RevueFinance, Contrôle, Stratégie. Vol 6. n°2. pp. . 179-202Le Roy, F. (2003). De <strong>la</strong> stratégie militaire au management stratégique <strong>de</strong>s entreprises : uneautre approche <strong>de</strong> <strong>la</strong> concurrence. Cahiers <strong>de</strong> l’ERFI. Vol 10. n°1Liarte, S. (2006). Mutualisme, prédation et <strong>parasitisme</strong> : <strong>la</strong> concurrence comme critère <strong>de</strong>choix <strong>de</strong> <strong>la</strong> zone d’imp<strong>la</strong>ntation. Actes <strong>de</strong> <strong>la</strong> conférence <strong>de</strong> l’AIMS. Juin.Liarte, S. (2006). Quelles stratégies d'imp<strong>la</strong>ntation vis-à-vis <strong>de</strong> <strong>la</strong> concurrence? RevueFrançaise <strong>de</strong> Gestion. Vol 32. N° 165. pp. . 139-159Marouseau, G. (2007). Les revirements stratégiques <strong>de</strong> <strong>la</strong> gran<strong>de</strong> distribution généraliste enmatière <strong>de</strong> commerce électronique. 6th international congress marketing trends. Janvier.Michaud-Trévinal, A. Cliquet, G. (2002). Localisation commerciale et mobilité <strong>du</strong>consommateur. Actes <strong>du</strong> 5 ème Colloque Etienne Thil. La Rochelle.Poirel, C. (2008). La stratégie <strong>de</strong> distribution multiple : <strong>de</strong>s ambitions et <strong>de</strong>s promesses. Etat<strong>de</strong> l’art. Actes <strong>de</strong> <strong>la</strong> conférence <strong>de</strong> l’AIMS.Poirel, C. Bonet Fernan<strong>de</strong>z, D. (2008). La stratégie <strong>de</strong> distribution multiple : À <strong>la</strong> recherche<strong>de</strong> synergies entre canal physique et canal virtuel. Revue Française <strong>de</strong> Gestion. Vol 34. N°182. pp. . 155-170Roy, P. (2005). Vertus <strong>de</strong> l'innovation stratégique pour les lea<strong>de</strong>rs <strong>de</strong> marché. RevueFrançaise <strong>de</strong> Gestion. Vol 31. N° 155. pp. . 97-116Rulence, D. (2003). Gestion <strong>de</strong>s réseaux <strong>de</strong> points <strong>de</strong> vente: l'importance <strong>de</strong> <strong>la</strong> dimensionspatiale. Recherche et Application en Marketing. Vol 18. N° 3. pp. . 65-81Saives A.L. Lambert A.(1999). Approche stratégique <strong>de</strong>s <strong>comportement</strong>s spatiaux <strong>de</strong>s firmes: quelles ressources stratégiques territoriales pour les In<strong>du</strong>stries Agroalimentaires? INRA.Sorenson O., Baum J.A.(2003). Geography and Strategy Editors’ Intro<strong>du</strong>ction. Advances inStrategic Management, vol. 20. pp. 1-1913
Tenenhaus, M. Gauchi, J-P. Ménardo, C.(1995). Régression PLS et applications. Revue <strong>de</strong>Statistique Appliquée. Tome 43. n°1.Wernerfelt, B. (1986). A Ressource-based View of the Firm. Strategic Management Journal.N° 5. pp. . 171-180.14
AuchaneAuchanCarrefourOoshopCoraHouraIntermarchéExpressmarchéLeclercExpressDriveAuchanAuchanDirectCarrefourOoshopCoraHouraIntermarchéExpressmarchéLeclercExpressDriveAnnexesEnseignes et sitesNombre <strong>de</strong> magasins 118 209 58 406 488Nb <strong>de</strong> départ <strong>de</strong> présence 54 73 30 33 89Nb <strong>de</strong> départ couverts par le siteInternet10 16 22 19 9Entropie re<strong>la</strong>tive magasins 0,835 0,883 0,695 0,72 0,948Entropie re<strong>la</strong>tive site 0,507 0,610 0,665 0,614 0,483(1) Différence moyenne t significatif à p = 0,000 ; (*) = signification p < 0,05 ; (**)signification p = 0,05 ; (ns) = non significatif.Tableau 3 : Comparaison <strong>de</strong> l'entropie re<strong>la</strong>tive <strong>de</strong>s groupes <strong>de</strong> distributionEnseignes et sitesNb <strong>de</strong> départ <strong>de</strong> nonprésence <strong>de</strong> magasins40 21 64 61 5Entropiemagasinsre<strong>la</strong>tive0 0 0 0 0Entropie re<strong>la</strong>tive site 0 0 0,5242 0,4751 0Tableau 4 : mesure <strong>de</strong> l’entropie re<strong>la</strong>tive <strong>de</strong>s e-magasins15