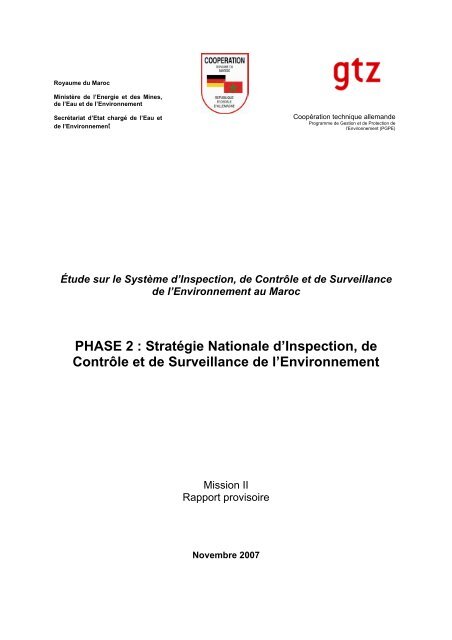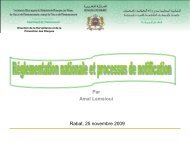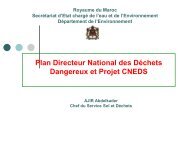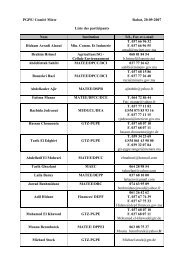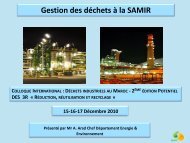PHASE 2 : Stratégie Nationale d'Inspection, de ... - GD MAROC
PHASE 2 : Stratégie Nationale d'Inspection, de ... - GD MAROC
PHASE 2 : Stratégie Nationale d'Inspection, de ... - GD MAROC
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Royaume du MarocMinistère <strong>de</strong> l’Energie et <strong>de</strong>s Mines,<strong>de</strong> l’Eau et <strong>de</strong> l’EnvironnementSecrétariat d’Etat chargé <strong>de</strong> l’Eau et<strong>de</strong> l’EnvironnementCoopération technique alleman<strong>de</strong>Programme <strong>de</strong> Gestion et <strong>de</strong> Protection <strong>de</strong>l’Environnement (PGPE)Étu<strong>de</strong> sur le Système d’Inspection, <strong>de</strong> Contrôle et <strong>de</strong> Surveillance<strong>de</strong> l’Environnement au Maroc<strong>PHASE</strong> 2 : Stratégie <strong>Nationale</strong> d’Inspection, <strong>de</strong>Contrôle et <strong>de</strong> Surveillance <strong>de</strong> l’EnvironnementMission IIRapport provisoireNovembre 2007
1. CHAPITRE I: CONTEXTE GENERAL1.1. PREAMBULE:La présente étu<strong>de</strong> « Etu<strong>de</strong> sur le Système D’inspection, <strong>de</strong> contrôle et <strong>de</strong>surveillance <strong>de</strong> l’Environnement » a été menée par le bureau d’étu<strong>de</strong> WAMAN enpartenariat avec le bureau d’étu<strong>de</strong> allemand A<strong>de</strong>phi Consult pour le compte <strong>de</strong>l’agence <strong>de</strong> la Coopération Technique Alleman<strong>de</strong> dans le cadre du Projet Gestionet Protection <strong>de</strong> l’Environnement GTZ/PGPE et la Direction <strong>de</strong> la Réglementationet du Contrôle du département <strong>de</strong> l’Environnement, Secrétariat d’Etat auprès duministère <strong>de</strong> l’énergie, <strong>de</strong>s mines, <strong>de</strong> l’eau et <strong>de</strong> l’environnement, charge <strong>de</strong> l’eauet <strong>de</strong> l’environnement (SEEE). L’opportunité <strong>de</strong> la réalisation d’une telle étu<strong>de</strong>rési<strong>de</strong> dans l’importance que revêt l’application effective <strong>de</strong>s dispositionsjuridiques contenues dans les lois environnementales et la vérification <strong>de</strong> leurrespect par les différentes populations cibles citées au niveau <strong>de</strong> ces mêmes lois.Le présent rapport constitue le rapport <strong>de</strong> mission II, Elaboration <strong>de</strong> la stratégie,et fait suite au rapport <strong>de</strong> Mission I <strong>de</strong> la présente étu<strong>de</strong> consacré au diagnosticdu système d’Inspection, <strong>de</strong> contrôle et <strong>de</strong> surveillance <strong>de</strong> l’environnement auMaroc, ainsi qu'au rapport du consultant international dans le cadre <strong>de</strong> la mêmemission I 1 .Le rapport fait suite aussi à un premier rapport sur les éléments <strong>de</strong> la stratégie 2qui a été transmis à la GTZ et suivi par le rapport <strong>de</strong> l'Expert international intitulé" Lignes directrices pour système efficace sur la base <strong>de</strong>s exigences du droit <strong>de</strong>l’Union européenne et <strong>de</strong>s expériences internationales 3 "Le présent rapport, arrive dans une conjoncture extrêmement favorable, quiconsiste dans le début du mandat du gouvernement actuel qui intègre dans lecadre du SEEE, l’eau et l’environnement. Ce qui permet <strong>de</strong> disposer <strong>de</strong> tout lemandat actuel pour garantir l’incubation et la mise en œuvre <strong>de</strong>s actionsprioritaires <strong>de</strong> la phase mise en œuvre <strong>de</strong> la stratégie nationale d’inspection, <strong>de</strong>contrôle et <strong>de</strong> surveillance <strong>de</strong> l’environnement. Il est évi<strong>de</strong>nt, comme cela a étéprécisé dans la mission I, que la présente stratégie fait partie intégrante <strong>de</strong> lastratégie nationale dans le domaine <strong>de</strong> l’environnement et s’inscrit dans leprocessus d’accélération <strong>de</strong>s mesures <strong>de</strong> protection <strong>de</strong> l’environnementenclenché par les pouvoirs publics notamment au travers du rythme soutenuqu’a connu le dispositif juridique et réglementaire (lois et textes d’application :Protection <strong>de</strong> l’environnement, Eau, air, déchets,……)1.2. POURQUOI UNE STATEGIE NATIONALE D’INSPECTION DE CONTROLE ETDE SURVEILLANCE ?1 AXEL KLAPHAKE/DENIS KALISCH, Etu<strong>de</strong> sur le système d’inspection, <strong>de</strong> contrôle et <strong>de</strong> surveillance <strong>de</strong>l’environnement au Marco. Expériences internationales et implications pour le Maroc, juin 20072 Waman Consulting "Etu<strong>de</strong> du système <strong>d'Inspection</strong> <strong>de</strong> contrôle et <strong>de</strong> surveillance <strong>de</strong> l'environnement: MissionII Elaboration <strong>de</strong> la stratégie nationale Premiers éléments Octobre 2007"3 A.Epiney " Lignes directrices pour système efficace sur la base <strong>de</strong>s exigences du droit <strong>de</strong> l’Union européenneet <strong>de</strong>s expériences internationales Novembre 2007"3
L’élaboration <strong>de</strong> la stratégie nationale en matière d’inspection, <strong>de</strong> contrôle et <strong>de</strong>surveillance <strong>de</strong> l’environnement ainsi que ses plans d’actions répond en gran<strong>de</strong>partie aux orientations et aux objectifs <strong>de</strong> la stratégie juridique du SEEE quiconsiste à mettre en place un cadre juridique national en matièred’environnement adéquat qui répond aux exigences et à la nécessité <strong>de</strong> procé<strong>de</strong>rà la vérification du respect <strong>de</strong>s dispositions juridiques et à la surveillance <strong>de</strong> laqualité <strong>de</strong> l’état <strong>de</strong> l’environnement. Cette stratégie juridique elle-même pren<strong>de</strong>n considération les objectifs <strong>de</strong> la stratégie nationale <strong>de</strong> protection <strong>de</strong>l’environnement et <strong>de</strong> développement durable qui vise à réduire les nuisancesqui affectent les différents milieux et d’en réduire le coût <strong>de</strong> leur dégradation quia atteint 4,6 du PIB national.Le diagnostic a montré que la stratégie nationale du SICSE constitue un atoutpour le gouvernement puisqu’elle offre les possibilités suivantes :Mettre en place <strong>de</strong>s systèmes flexibles orientés versl’amélioration continue et permettant <strong>de</strong> promouvoir la cohérenceentre les diverses mesures prises (politiques, stratégies,programmes sectoriels, etc.) ;Renforcement <strong>de</strong>s structures centralisées tout en permettantune évolution progressive vers <strong>de</strong>s systèmes décentralisésautorisant le partage <strong>de</strong>s enseignements <strong>de</strong> l’expérience et laconcertation;Passer d’une planification sectorielle à une planificationintégrée qui met en exergue les synergies d’action à exploiter;Optimiser l’usage <strong>de</strong>s moyens disponibles, en évitant lesdoubles emplois et en recherchant les synergies intersectorielles etinterrégionales;Favoriser la mobilisation <strong>de</strong>s financements en établissant uncadre cohérent et attractif pour les bailleurs <strong>de</strong> fonds tant au niveaunational qu’international;Mettre en place le système <strong>de</strong> suivi évaluation nécessaire àl’amélioration et l’apprentissage continus1.3. LA STRATEGIE NATIONALE : DEFINITIONSOn entend par stratégie nationale du SICSE un instrument <strong>de</strong> planificationcontraignant, qui définit <strong>de</strong>s objectifs mesurables et donc vérifiables, ainsi que<strong>de</strong>s indicateurs, pour les différents aspects <strong>de</strong> la conformité environnementale,et qui décrit le moyen <strong>de</strong> réaliser ces objectifs. Elle doit s'assurer que toutes lesréglementations et décisions politiques prennent en considération lesrépercussions qu'elles pourraient avoir sur l’environnement.Un <strong>de</strong>s principaux arguments en faveur d'une stratégie nationale rési<strong>de</strong>également dans son potentiel à mieux harmoniser les instruments actuels, àéviter les doubles emplois et à combler les lacunes subsistantes. La stratégieoffre par conséquent la possibilité d'organiser la pratique <strong>de</strong> la conformitéenvironnementale au Maroc d'une manière plus efficace et plus efficiente.la Stratégie nationale du SICSE (SNICSE) consiste en un processus <strong>de</strong>planification stratégique participatif et récurrent <strong>de</strong>stiné à atteindre, <strong>de</strong> manière4
équilibrée et intégrée à tous les niveaux, du niveau national au niveau local, <strong>de</strong>sobjectifs <strong>de</strong> contrôle et <strong>de</strong> surveillance <strong>de</strong> l’environnement.Une SNICSE fait partie intégrante <strong>de</strong> la stratégie juridique et s’applique enpriorité pour renforcer la politique gouvernementale en matière d’application <strong>de</strong>slois environnementales, mais elle doit aussi susciter la participation <strong>de</strong>l’ensemble <strong>de</strong>s acteurs économiques et sociaux. Elle est définie à l’ai<strong>de</strong> <strong>de</strong>squatre éléments suivants :Le processus stratégique, qui repose sur une série <strong>de</strong> principesd’inspection, contrôle, surveillance et <strong>de</strong> mécanismes <strong>de</strong> mise enoeuvre s’appliquant en priorité pour renforcer l’application <strong>de</strong>s loisenvironnementales et impliquant aussi l’ensemble <strong>de</strong>s acteurséconomiques et sociaux.Le contenu <strong>de</strong> la stratégie, qui est basé sur l’analyse <strong>de</strong> lasituation dans le pays et l’i<strong>de</strong>ntification d’une vision à moyen etlong terme propre au pays ; sur cette base, <strong>de</strong>s orientations et <strong>de</strong>saxes prioritaires sont définis, <strong>de</strong>s engagements sur <strong>de</strong>s objectifssont pris et l’intégration <strong>de</strong> politiques sectorielles est(progressivement) réalisée à l’ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> plans d’action d’inspection et<strong>de</strong> contrôle précis.Les résultats <strong>de</strong> la stratégie qui ont (déjà) été obtenus dans lepays au cours <strong>de</strong>s étapes précé<strong>de</strong>ntes qui ont amélioré la situation<strong>de</strong> certains secteurs dans le sens d’un système d’inspection,contrôle et surveillance <strong>de</strong> l’environnement. Ces différents élémentsont été décrits dans l’analyse SWOT( voir Mission I)Le suivi <strong>de</strong> la mise en oeuvre du plan stratégique etl’apprentissage, qui est opéré grâce à <strong>de</strong>s mécanismes <strong>de</strong> suiviévaluationet d’amélioration continue, en utilisant notamment <strong>de</strong>sindicateurs d’inspection, contrôle et surveillance.5
2. CHAPITRE II RAPPEL DES RESULTATS DE LAMISSION I2.1. DIAGNOSTIC DU SICSE ACTUELA notre sens, La SNICSE, <strong>de</strong>vra être conçue comme un processus à même <strong>de</strong>renforcer la cohérence <strong>de</strong>s processus stratégiques majeurs <strong>de</strong> la politiqueenvironnementale au Maroc, et <strong>de</strong>s stratégies nationales en général. Elle <strong>de</strong>vradéfinir et mettre en oeuvre <strong>de</strong>s synergies, <strong>de</strong> repérer <strong>de</strong>s lacunes, et mettre enplace un dispositif <strong>de</strong> suivi et d’évaluation unique. Elle ne doit donc en aucuncas apparaître comme une couche politique nouvelle qui s’imposerait auxautres politiques. Elle s’appuie sur la prise en compte <strong>de</strong>s principes directeursNoted’inspection, contrôle et surveillance (Cf Rapport Epiney3 ), assure lacoordination <strong>de</strong>s actions sectorielles et facilite la prise <strong>de</strong> décision par unmeilleur arbitrage <strong>de</strong>s enjeux intersectoriels.La SNICSE repose sur l’ensemble <strong>de</strong>s données et <strong>de</strong>s éléments ressortis dudiagnostic du SICSE actuel qui met en évi<strong>de</strong>nce un système <strong>de</strong> contrôlecomplexe issue <strong>de</strong> l’évolution historique du contexte juridique propre au Maroc,d’une part et <strong>de</strong>s résultats du Benchmarking qui a permis d’analyser lestendances et les expériences internationales en matière d’application <strong>de</strong>s loisenvironnementales.Le SICSE du Maroc reste insuffisamment adapté aux exigences mo<strong>de</strong>rnes <strong>de</strong>protection <strong>de</strong> l’environnement. Il est nettement en <strong>de</strong>ssous <strong>de</strong>s exigencesd’efficacité <strong>de</strong>s SICSE universels (critères minima) telle a été l’un <strong>de</strong>s constatsfaits lors <strong>de</strong>s 1ères assises <strong>de</strong> NECEMA 4 consacrées à l’évaluation <strong>de</strong>s systèmesd’inspection et <strong>de</strong> contrôle au niveau <strong>de</strong>s pays du Maghreb.Les 5 <strong>de</strong>rnières années ont connu une avancée considérable sur le plan législatifet réglementaire du domaine <strong>de</strong> l’environnement. En effet, d’importants textes<strong>de</strong> loi ont été publiés (loi n°11-03, loi n°12-03, loi n°13-03, et la loi n°28-00).Les dispositions juridiques applicables au contrôle <strong>de</strong> la pollution et <strong>de</strong> sesimpacts se trouvent dispersés dans ces textes. La réglementation se trouvecontenue dans les lois mais aussi dans les décrets et également dans les arrêtésinterministériels ou même émanant <strong>de</strong>s autorités locales. Une codificationspécifique du droit <strong>de</strong> l’environnement aurait pu rendre plus aisé l’accès à cetteréglementation. Cette codification est d’ailleurs réclamée par un ensembled’acteurs particulièrement les acteurs opérationnels et les partenaires.Les différents textes <strong>de</strong> loi prévoient, <strong>de</strong>s sanctions <strong>de</strong> différentes natures(sanctions pénales, civiles et administratives) selon la nature <strong>de</strong>s infractionsconstatées. Le constat réalisé sur le terrain met en évi<strong>de</strong>nce, cependant <strong>de</strong>sdifficultés importantes liées à la non explicitation <strong>de</strong>s conditions d’application <strong>de</strong>slois précitées (procédures) et à l’insuffisance <strong>de</strong>s moyens du constat et <strong>de</strong>verbalisation.Le système d’inspection et <strong>de</strong> contrôle <strong>de</strong> l’environnement s’inscrit dans uncontexte institutionnel complexe où les acteurs (départements ministériels, <strong>de</strong>stutelles exercées directement ou indirectement sur une <strong>de</strong> ses composantes)4 F Zyadi : 1érs assises NECEMA Présentation Powerpoint Nov 20056
trouvent <strong>de</strong>s difficultés à harmoniser leurs actions. L’analyse réalisée a permis <strong>de</strong>distinguer <strong>de</strong>ux niveaux <strong>de</strong> représentation institutionnelle:Le niveau fonctionnel qui décrit l’ensemble <strong>de</strong>s administrations concernéespar le SICSE. A ce niveau la principale avancée constatée rési<strong>de</strong> dansl’institutionnalisation du rôle du SEEE en tant que coordonateur etresponsable national <strong>de</strong> la politique environnementale tous secteursconfondus.Le niveau opérationnel dans lequel sont décrits les différents corps encharge du contrôle et <strong>de</strong> l’inspection environnementale. A ce niveau, il estimportant <strong>de</strong> noter les principaux points suivants :1. Le corps <strong>de</strong>s inspecteurs <strong>de</strong> l’environnement du SEEE. Cette nouvellepolice <strong>de</strong> l’environnement est encore embryonnaire, mais constituevéritablement la pierre angulaire du système eu égard à son rôleinstitutionnel et à la qualité <strong>de</strong> la formation <strong>de</strong> ses agents actuels..2. Certaines polices sectorielles sont très actives et témoignent d’unegran<strong>de</strong> efficacité lié à leur rôle historique et au pouvoir accordée par lelégislateur à ses agents ( police <strong>de</strong> la forêt , police <strong>de</strong> la chasse etc…3. La gendarmerie royale dispose d’un potentiel importantparticulièrement à travers les briga<strong>de</strong>s <strong>de</strong> l’environnement qui sontconstitués au niveau <strong>de</strong> toutes les régions conformément au découpagenational <strong>de</strong> la gendarmerie royale.4. Il est cependant important <strong>de</strong> noter une quasi absence <strong>de</strong> la police <strong>de</strong>l’eau malgré le recul <strong>de</strong> 10 ans <strong>de</strong> la loi 10/95.La réalisation <strong>de</strong>s différents activités d’inspection, <strong>de</strong> contrôle et <strong>de</strong>surveillance environnementales, passe par l’ensemble <strong>de</strong>s dispositifstechniques à travers : les réseaux <strong>de</strong> surveillance et les laboratoiresd’analyses : sur ce chapitre les principales constatations peuvent êtrerésumés comme suit :Une variété <strong>de</strong>s dispositifs ou réseaux <strong>de</strong> surveillance dont lesobjectifs et les opérateurs sont différents. En effet d’une part lesobjectifs peuvent concerner différents aspects (connaissance etsurveillance <strong>de</strong>s milieux, évaluation <strong>de</strong>s rejets polluants à <strong>de</strong>sfins réglementaires ou financières (re<strong>de</strong>vances..),caractérisation <strong>de</strong>s pollutions acci<strong>de</strong>ntelles. D’autre part, lesdifférents intervenants dans la protection <strong>de</strong> l’environnementdisposent <strong>de</strong> leurs réseaux propres <strong>de</strong> surveillance et <strong>de</strong>contrôle.L'existence <strong>de</strong> laboratoires au sein <strong>de</strong>s institutions et <strong>de</strong>sétablissements publics et privés (LNE, LPEE, ONEP, laboratoire<strong>de</strong> la Gendarmerie Royale CERPHOS, CNESTEN…..) dontl'activité est tournée vers la surveillance et le contrôle dans lecadre <strong>de</strong> leurs attributions respectives, mais aussi etaccessoirement vers la recherche et l'expertise,Le recours à la sous-traitance est un choix stratégique, qui aété fait par un grand nombre d'intervenants dans le SICSE ; dontles agences <strong>de</strong> bassins hydrauliques au travers <strong>de</strong>s conventionscadre. Cependant la sous traitance <strong>de</strong>vra se faire dans le respect<strong>de</strong>s règles <strong>de</strong> contrôle dans le cadre d'une prise en chargeeffective <strong>de</strong>s missions <strong>de</strong> contrôle et <strong>de</strong> surveillance7
En matière <strong>de</strong> ressources humaines nécessaires pour l’accomplissement <strong>de</strong>sactivités d’inspection et <strong>de</strong> contrôle environnemental, eu égard aux tâches quisont confiées au système d’inspection dans son ensemble et aux inspecteursen particulier, toute une série <strong>de</strong> compétences et d’aptitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> gestion,assez rares, en vérité, d’autant plus que l’exercice <strong>de</strong> la fonction <strong>de</strong>man<strong>de</strong>une capacité d’adaptation permanente à l’évolution constante <strong>de</strong>s objectifs .Les contacts entrepris auprès <strong>de</strong>s inspecteurs <strong>de</strong> l’EPA (Fès Avril 2007), ontpermis <strong>de</strong> disposer d’éléments <strong>de</strong> comparaison (référentiel) qui montrent leGAP à couvrir pour atteindre les standards internationaux. Ces standards (quitiennent compte du nombre d’installations, <strong>de</strong> la capacité <strong>de</strong>s inspecteurs, dutaux <strong>de</strong> non-conformité….) seront utilisés pour le dimensionnement du corps<strong>de</strong>s inspecteurs <strong>de</strong> l’environnement à la cible (Horizon <strong>de</strong> projet).Le renforcement <strong>de</strong>s capacités en particulier, la formation a toujours été uneactivité fortement prise en compte dans les programmes <strong>de</strong>s acteursinstitutionnels du SICSE, d'autant plus que ces activités sont largementsoutenue par les différents bailleurs <strong>de</strong> fonds et programmes <strong>de</strong> coopération.Le SEEE, en particulier a entrepris régulièrement <strong>de</strong>s actions <strong>de</strong> formation auprofit <strong>de</strong> ses cadres, en faisant systématiquement participer les autresacteurs aussi bien publics que privés.Notre conviction profon<strong>de</strong> tirée <strong>de</strong> l’analyse fonctionnelle est que le Maroc nedispose pas encore d’un système d’inspection, <strong>de</strong> contrôle et <strong>de</strong> surveillance <strong>de</strong>l’environnement intégré au sens fonctionnel, mais plutôt d’un ensemble d’objetslogiques nécessaires à sa construction à savoir :1. Les référentiels et les règles <strong>de</strong> gestion présents principalement dans laréglementation qui s’est suffisamment étoffée ces <strong>de</strong>rnières annéespour constituer une bonne assise au SICSE. Les futurs complémentsréglementaires (divers décrets et arrêtés) seront considérés par lesystème comme faisant partie <strong>de</strong> son système d’amélioration etmaintenance (suivi évaluation).2. Les acteurs (institutions et acteurs opérationnels) pour lesquels l’analysea montré <strong>de</strong>s difficultés dans la perception <strong>de</strong>s missions respectives enrelation avec les intérêts <strong>de</strong>s secteurs et les moyens humains <strong>de</strong>l’opérationnalisation <strong>de</strong> leur politique, à savoir :Le SEEE qui est au centre du SICSE et en assure le pilotagestratégique conformément à ses attributions (décret portantorganisation du département <strong>de</strong> l’environnement paru en 2000)Les institutions sectorielles responsables (DRPE et ABHs pourl’eau, eaux et forets, intérieur, Equipement, Transport…)Les régions et communes responsablesLes divers acteurs opérationnels responsables du contrôle (Corps<strong>de</strong>s inspecteurs, Police <strong>de</strong> l’eau, <strong>de</strong> la chasse, GendarmerieRoyale…)3. Les moyens Humains et matériels (Réseaux, laboratoires)),généralement suffisants pour le démarrage <strong>de</strong> l’activité mais loin <strong>de</strong>l’être en régime <strong>de</strong> croisière. Le point d’ordre à ce niveau concerne :8
a. La mise en place effective du corps <strong>de</strong>s inspecteurs <strong>de</strong>l’environnementb. La mise à niveau du laboratoire National <strong>de</strong> l’Environnement qui,<strong>de</strong>vrait faire un important saut qualitatif en termes <strong>de</strong> moyenshumains et matériels, compte tenu du rôle central qu’il <strong>de</strong>vraitjouer dans le SICSE à construire.Le diagnostic a été réalisé pour déceler les lacunes et les insuffisances actuellesdu système national <strong>de</strong> contrôle et <strong>de</strong> surveillance dans la perspective d’élaborerune stratégie nationale en la matière qui repose sur les bases légales,institutionnelles, organisationnelles, procédurales, humaine et financièresnécessaires au fonctionnement du SICSE et a pour objectifs :• Actualiser et mo<strong>de</strong>rniser les systèmes <strong>de</strong> contrôle sectorielsexistants• Rapprocher, harmoniser et établir <strong>de</strong>s passerelles <strong>de</strong> coordinationentre les systèmes existants• Rapprocher et renforcer les liens <strong>de</strong> coordination entre le SICE etla justice2.2. REVUE DES SYSTEMES D’ICE A L’INTERNATIONAL ( BENCHMARKING) :Les contenus et les implications essentielles du travail <strong>de</strong> l'IC international surles expériences internationales (France, Allemagne) concernant les stratégiesd’amélioration <strong>de</strong> la législation environnementale ont pu dégager une séried’éléments qui ont enrichi la réflexion développée sur la SNICSE dont l’économies’articule autour <strong>de</strong>s 10 recommandations essentielles:1. une importance <strong>de</strong> tout premier ordre en termes politiques et administratifs<strong>de</strong>vrait être accordée à la mise en oeuvre <strong>de</strong> la législation environnementale.2. la nécessité <strong>de</strong> développer la SNICSE sur un programme où lesprincipales mesures, y compris les délais impartis et les compétences,sont mentionnées sous forme <strong>de</strong> feuille <strong>de</strong> route.4. Un programme visant l’amélioration <strong>de</strong> la mise en oeuvre <strong>de</strong> lalégislation doit abor<strong>de</strong>r les différents aspects essentiels <strong>de</strong> cette mise enoeuvre. En règle générale, il y a lieu :• <strong>de</strong> vérifier l’applicabilité <strong>de</strong>s prescriptions légales et, le cas échéant,d’élaborer <strong>de</strong> nouvelles dispositions ou d’améliorer les dispositions déjàexistantes ;• <strong>de</strong> préciser les compétences administratives et, le cas échéant, <strong>de</strong> créer<strong>de</strong>s nouvelles unités officielles ;• <strong>de</strong> développer les capacités financières, spécialisées et en personnel <strong>de</strong>sautorités <strong>de</strong> mise en oeuvre ;• d’établir un contrôle efficace et un organisme d’inspections et, à cetégard, <strong>de</strong> fixer précisément par la loi les droits et les <strong>de</strong>voirs <strong>de</strong>s autoritésainsi que <strong>de</strong>s exploitants d’installations ;• d’analyser avec soin le groupe <strong>de</strong>s <strong>de</strong>stinataires <strong>de</strong>s dispositions (parexemple, les exploitants <strong>de</strong> certains établissements industriels) afin <strong>de</strong>9
comprendre les principales causes <strong>de</strong>s lacunes existantes jusqu’à présentdans le respect <strong>de</strong> la législation et <strong>de</strong> pouvoir adopter <strong>de</strong>s mesurescorrectives appropriées ;• d’élaborer <strong>de</strong>s programmes détaillés <strong>de</strong> contrôles et d’inspections ;• <strong>de</strong> combiner <strong>de</strong>s mesures visant à améliorer les instruments juridiqueset <strong>de</strong>s programmes favorisant le respect volontaire <strong>de</strong> la législation(campagnes d’informations, le cas échéant, incitations économiques) ;• dans certains secteurs industriels, <strong>de</strong>s renforcements juridiquespourraient s’accompagner d’une valorisation <strong>de</strong>s systèmes volontaires <strong>de</strong>certification et d’éco-audit.5. la définition d’exigences minimales concernant <strong>de</strong>s structuresefficaces <strong>de</strong> mise en oeuvre.6. La définition précise <strong>de</strong>s compétences administratives entrel’autorité concernée et les administrations spécialisées représente undéfi central.7. Il va <strong>de</strong> soi que la confiance accordée aux autorités <strong>de</strong> mise enoeuvre plutôt centralisées ou décentralisées dépend largement, dansles différents pays, du cadre général administratif et juridique et <strong>de</strong>spossibilités qui en découlent. Dans ce contexte, une approchedynamique <strong>de</strong> la réforme est parfaitement envisageable : danscertains pays, les expériences ont d’abord été collectées au niveaucentral et les expertises correspondantes réunies, et ce n’estqu’après que les compétences <strong>de</strong> mise en oeuvre ont été transférées<strong>de</strong> manière décentralisée. Toutefois, même dans ces cas, certainescompétences <strong>de</strong> surveillance ou <strong>de</strong>s responsabilités techniques (parexemple : <strong>de</strong>s laboratoires) sont généralement conservées auniveau central.8. Dans les domaines <strong>de</strong> la législation environnementale, dans lesquelsles impacts sur l’environnement présentent un intérêt national et/ou<strong>de</strong>s connaissances scientifiques, complexes, techniques et orientéessur le niveau <strong>de</strong> la recherche correspondant ainsi que <strong>de</strong>s analysesappropriées sont nécessaires, la mise en oeuvre est généralementréalisée au niveau central dans <strong>de</strong> nombreux pays.9. Outre le choix d’un système centralisé/décentralisé, il convient <strong>de</strong>résoudre la question <strong>de</strong>s structures <strong>de</strong> mise en oeuvre axées sur <strong>de</strong>sdomaines environnementaux et <strong>de</strong>s moyens spécifiques ou, aucontraire, <strong>de</strong>s approches administratives intégrées et utilisantdifférents moyens, la tendance penche clairement pour lesapproches intégrées qui peuvent cependant être très exigeantes auniveau <strong>de</strong> la coordination <strong>de</strong>s autorités et du management <strong>de</strong>l’information.10. Le public, y compris les groupes environnementaux et lespersonnes privées engagées, constitue <strong>de</strong>s partenaires importantspour renforcer l’application <strong>de</strong> la législation environnementale. C’estla raison pour laquelle il serait judicieux <strong>de</strong> les prendre enconsidération dans une stratégie visant à favoriser la mise enoeuvre <strong>de</strong> la législation.10
3. CHAPITRE III DEVELOPPEMENT DE LA STRATEGIE3.1. ELEMENTS CLES DE L’ELABORATION DE LA STRATEGIE NATIONALE ICSELa Stratégie <strong>Nationale</strong> d’Inspection, <strong>de</strong> Contrôle et <strong>de</strong> Surveillance <strong>de</strong>l’Environnement est élaborée pour répondre aux objectifs <strong>de</strong>s loisenvironnementales qui visent dans leur ensemble la mise en place d’un cadrejuridique et institutionnel qui répond aux exigences <strong>de</strong> protection, <strong>de</strong> préventionet <strong>de</strong> mise en valeur <strong>de</strong> l’environnement. La SNICSE <strong>de</strong>vra par ailleurs relever ledéfi <strong>de</strong> coordonner le SICSE avec les systèmes <strong>de</strong> contrôle existants tels celui<strong>de</strong> la forêt, <strong>de</strong> la chasse et la gendarmerie royale.En fait, il est temps pour le département <strong>de</strong> l’environnement <strong>de</strong> migrer vers unestratégie d’ICSE qui permet <strong>de</strong> relier ses budgets et moyens à une politiqueclaire avec <strong>de</strong>s objectifs Précis et <strong>de</strong>s résultats mesurables, avec commeprincipales thématiques :1. Développer une mission claire et intégrée avec un jeu d’objectifs et <strong>de</strong>principes Directeurs permettant <strong>de</strong> traduire ces objectifs en activitéset programmes.2. Assurer un lien entre les objectifs et désirs <strong>de</strong>s parties prenantes à longterme (institutions, société civile, acteurs économiques, Industriels, )3. Développer un nouveau système <strong>de</strong> gestion qui permettra au SICSE <strong>de</strong>gagner la confiance <strong>de</strong>s pouvoirs publics et <strong>de</strong>s citoyens pourpromouvoir son action et faciliter <strong>de</strong> nouvelles prises <strong>de</strong> décision enfaveur <strong>de</strong> la protection <strong>de</strong> l’environnement en général,4. Et enfin, mettre en place les moyens d’une protection efficace <strong>de</strong>l’environnement à un coût raisonnable,La stratégie nationale prendra en considération les structures et processusexistants et veillera à consoli<strong>de</strong>r les acquis dans le cadre <strong>de</strong> sa dynamique <strong>de</strong>mise en œuvre : Sachant que cet effort prendra quelques années, notreapproche est <strong>de</strong> réaliser un réel progrès dans les domaines prioritaires à courtterme en s’inscrivant toujours dans les objectifs à long termeLa stratégie SNICE est un document dynamique. Des changements <strong>de</strong> directionsont inévitables. Il est donc important <strong>de</strong> prévoir <strong>de</strong>s réajustements au fur et àmesure <strong>de</strong>s résultats du suivi évaluation. Dans tous les cas, une revue <strong>de</strong>stratégie <strong>de</strong>vra être réalisée durant les trois prochaines années3.2. MISSION ET OBJECTIFS DU SICSE:La stratégie nationale d’inspection contrôle et surveillance <strong>de</strong> l’environnement auMaroc, est un élément <strong>de</strong> la stratégie nationale <strong>de</strong> protection <strong>de</strong> l’environnementet <strong>de</strong>vra s’intégrer parfaitement dans les objectifs <strong>de</strong> la politique publique <strong>de</strong>l’environnement. L’application effective <strong>de</strong>s dispositions juridiques, la promotion<strong>de</strong> la conformité environnementale, ainsi que la coordination <strong>de</strong>s actions <strong>de</strong>l’inspection, <strong>de</strong> contrôle et <strong>de</strong> surveillance par la mise sur pied d’un corpsd’inspecteurs assermentés qui agissent aux niveaux national et régionalconstituent <strong>de</strong>s pistes importantes dans le cadre <strong>de</strong> la définition <strong>de</strong> la SNICSE,qui <strong>de</strong>vra bien entendu s’appuyer sur les nouvelles dispositions juridiques d’ordreopérationnel et fonctionnel contenues dans les nouvelles lois environnementales,sur les dispositions institutionnelles dont le regroupement au niveau d’une seuleautorité couvrant les domaines <strong>de</strong> l’eau et <strong>de</strong> l’environnement, et sur l’existence11
<strong>de</strong> systèmes sectoriels rodés <strong>de</strong>puis plus <strong>de</strong> 70 ans tels la police <strong>de</strong> la chasse, lapolice <strong>de</strong> la forêt, etc.3.3. LES PRINCIPES DIRECTEURS DU SICSE:Une large consultation <strong>de</strong>s acteurs et parties prenantes dans le cadre <strong>de</strong> laprésente mission a mis en évi<strong>de</strong>nce les domaines d’action prioritaires à intégrerpour la mise en place du système SICSE 5 . L’ensemble <strong>de</strong>s acteurs s’accor<strong>de</strong>nt àconstater que l’important travail <strong>de</strong> fond réalisé ces <strong>de</strong>rnières années rend laconjoncture extrêmement favorable au démarrage effectif du SICSE.Au préalable, il est admis que la stratégie nationale SICSE du SEEE est articuléeautour <strong>de</strong>s principes fondateurs suivants:1. Une concentration sur la mise en œuvre du droit <strong>de</strong> l’environnement (VoirLignes directrices pour système efficace sur la base <strong>de</strong>s exigences du droit<strong>de</strong> l’Union européenne et <strong>de</strong>s expériences internationales 62. Un domaine d’intervention (périmètre) clair et circonscrit, (à l’instar <strong>de</strong>l’EPA (USA) qui intervient dans la lutte contre les nuisances);3. Partage du SICSE par domaines environnementaux (Air, Eau, Sols etDéchets..) tout en maintenant un domaine d’activité transversal quiconcerne le pilotage du système et le domaine décisionnel et endomaines connexe comportant notamment (EIE, autorisations <strong>de</strong>sinstallations classées, risques majeurs et gestion <strong>de</strong>s crises)L’expérience internationale montre qu’il est possible <strong>de</strong> déterminer quelqueséléments-clés pour l’élaboration d ’ une stratégie nationale visant à améliorer lerespect du droit dans le domaine environnemental (IMPEL , INECE, OCDE ) :• Définition claire <strong>de</strong>s objectifs et applicabilité <strong>de</strong> la législation : le respect <strong>de</strong>sdispositions dépend en gran<strong>de</strong> partie <strong>de</strong> leur clarté, leur intelligibilité, leurmatérialisation, leur applicabilité pratique notamment par les autorités et,éventuellement, <strong>de</strong> leur souplesse.• Compétences et responsabilités dans la mise en œuvre <strong>de</strong> la législationenvironnementale : la mise en œuvre effective du droit implique unedéfinition claire <strong>de</strong>s rôles et <strong>de</strong>s compétences <strong>de</strong>s acteurs concernés(administrations, <strong>de</strong>stinataires <strong>de</strong>s dispositions, tribunaux, personnesprivées, etc.).• Ressources humaines et financières <strong>de</strong>s autoritésenvironnementales/autorités d’exécution : l’utilisation <strong>de</strong>s instruments <strong>de</strong>sautorités dans l’application du droit n’est possible qu ’ avec les ressourceshumaines et financières suffisantes.• Capacités <strong>de</strong>s autorités aux fins <strong>de</strong>s inspections et <strong>de</strong>s contrôles : enparticulier, il convient <strong>de</strong> garantir que les autorités puissent couvrir le respectpratique <strong>de</strong>s prescriptions environnementales <strong>de</strong> manière suffisante et donc<strong>de</strong> sanctionner les infractions.5 Rapport <strong>de</strong> Diagnostic Waman Consulting Septembre 20076 Rapprt Epiney Cf note 312
• Réactions appropriées <strong>de</strong>s autorités en cas d’infractions : il peut s’agird’instruments juridiques classiques (imposer <strong>de</strong>s prescriptions obligatoiresaux fins du respect <strong>de</strong> la législation, prescriptions <strong>de</strong> tests spécifiques et <strong>de</strong>présentation d’informations détaillées, fermeture temporaire ou permanente<strong>de</strong> l ’ établissement, ordres d’assainissement, etc.) ou encore <strong>de</strong> formules plussouples <strong>de</strong> l’application du droit (négociations, etc.).Le SICSE propose <strong>de</strong> prendre en considération les objectifs stratégiques, à longterme, à atteindre dans le cadre <strong>de</strong> la présente stratégie, dont certains sont liésaux différents domaines du périmètre tels qu’ils ont été i<strong>de</strong>ntifiés dans le cadredu diagnostic (cf Rapport Mission I 7 ). Les autres sont proprement liés à la miseen place et au renforcement <strong>de</strong>s structures et <strong>de</strong>s capacités <strong>de</strong> pilotage etopérationnelles du SICSE :Assurer une meilleure application <strong>de</strong>s lois environnementalesMettre en place <strong>de</strong>s standards <strong>de</strong> qualité et veiller a leur respectpour une meilleure efficacité environnementaleRéduire la pollution <strong>de</strong> l’air pour la protection <strong>de</strong> l’environnement et<strong>de</strong> la santé <strong>de</strong>s populationsProtéger les ressources en eau contre les pollutionsPrévenir les pollutions et réduire les risques pour les citoyens et lesécosystèmesAssurer une meilleure gestion <strong>de</strong>s déchetsAssurer une protection contre les risques <strong>de</strong> changementsclimatiquesMettre en place les moyens d’évaluation pour vérifier l’atteinte <strong>de</strong>sobjectifs spécifiquesLa mise en place <strong>de</strong> la stratégie nationale d’inspection <strong>de</strong> contrôle et <strong>de</strong>surveillance <strong>de</strong> l’environnement « SNICSE », <strong>de</strong>vra être mise en place sur unhorizon minimum <strong>de</strong> 5 ans, par le biais <strong>de</strong>s reconsidérations et aménagementsissus du système <strong>de</strong> suivi évaluation qui sera mis en place : Il estindispensable que l’adhésion du système décisionnel soit totale auprocessus proposé durant toute la pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> mise en œuvre(Sponsorship)7 Waman Consulting ( Etu<strong>de</strong> du système d’inspection <strong>de</strong> contrôle et <strong>de</strong> surveillance <strong>de</strong> l’environnementRapport <strong>de</strong> Mission I) Juin 200713
LES PRINCIPES DIRECTEURS DE LA SNICSEPrincipe 1 : Approche administrative intégréeLa mise en œuvre du SICSE <strong>de</strong>vrait s’effectuer par l’approche administrative intégrée,pilotée par une structure administrative centrale forte, regroupant <strong>de</strong>s ressources humaineset financières suffisantes avec une mise en œuvre effective au niveau <strong>de</strong>s régions : plusieursadministrations sectorielles dans les régions seront visés 8 .Ces mêmes administrationssectorielles <strong>de</strong>vraient assumer <strong>de</strong>s tâches <strong>de</strong> surveillance et <strong>de</strong>s tâches <strong>de</strong> contrôle <strong>de</strong> sortequ’il y ait une « concordance » <strong>de</strong>s différentes tâches <strong>de</strong> mise en œuvre du SICSE 9 . La miseen place dans le cadre <strong>de</strong> la SNICSE d’une plateforme <strong>de</strong> coordination et <strong>de</strong> concertationpour la surveillance <strong>de</strong> l’environnement est une priorité.Principe 2 :Laboratoire <strong>de</strong> référenceHisser le Laboratoire National <strong>de</strong> l’Environnement 10 en une structure reconnue commelaboratoire <strong>de</strong> référence en matière d’analyse et <strong>de</strong> mesurage .Le LNE est au service <strong>de</strong> lasurveillance et du contrôle environnemental.Principe3 : Système d’Information EnvironnementalLa mise en place du Système d’Information sur l’état <strong>de</strong> l’environnement qui gèrel’ensemble <strong>de</strong>s données et informations produites par la surveillance <strong>de</strong>s secteursenvironnementaux 11 .L’administration centrale responsable du contrôle environnemental <strong>de</strong>vrait publierrégulièrement <strong>de</strong>s rapports sur la mise en oeuvre <strong>de</strong>s lois environnementaux qui démontrenten détail les mesures prises et aussi les difficultés rencontrées 12 .Principe 4 :Clarification <strong>de</strong>s procéduresL’administration centrale <strong>de</strong>vra mettre en place un référentiel <strong>de</strong>s procédures claires traitantl’ensemble <strong>de</strong>s aspects <strong>de</strong> la surveillance et du contrôle13.Principe 5 :Assistance au respect volontaire du droit <strong>de</strong> l’environnementL’administration centrale responsable <strong>de</strong> la surveillance et du contrôle est amenée àassister les entreprises ou organisations à respecter volontairement les loisenvironnementales 14 .8 Principes 1, 5, 7 , 8 et 10 du document Epiney9 Principe 2 Epiney10 Principe 4 Epiney11 Principe 6 Epiney12 Principe 13 et 14 Epiney13 Principe 11 et 12 , document épiney14 Principe 17épiney14
Principe 6 : Le décentralisationAvec la nouvelle configuration du gouvernement, un dispositif du SICSE en région estencore ambigu et l’application du principe <strong>de</strong> décentralisation nécessitera une clarification<strong>de</strong>s missions et rôles <strong>de</strong>s entités décentralisées <strong>de</strong>s Ministères impliqués dans la mise enœuvre du droit <strong>de</strong> l’environnement. Nous proposons une décentralisation progressive avecune mise en œuvre du chantier <strong>de</strong> clarification <strong>de</strong>s attributions du SEEE et <strong>de</strong> ses partenairesinstitutionnels en région : Ce principe concerne aussi bien la surveillance que le contrôleL’accélération <strong>de</strong> la décentralisation pourra s’appuyer sur le levier du recours au secteurprivé (expertise, laboratoires, prélèvements ….).Principe 7 : Droit <strong>de</strong> RecoursLes particuliers et les ONG peuvent formuler <strong>de</strong>s plaintes auprès <strong>de</strong>s autorités centrales ourégionales évoquant un ou plusieurs déficits dans la mise en œuvre <strong>de</strong>s loisenvironnementaux 15 .Principe 8 : L’effectivité <strong>de</strong> la protection juridiqueLes particuliers et les ONG <strong>de</strong>vraient avoir un accès à la justice contre toute décision <strong>de</strong>l’administration centrale responsable <strong>de</strong> la surveillance et <strong>de</strong> contrôle 16 .3.3.1. LES OPTIONS INSTITUTIONNELLES DU SICSEPlusieurs options peuvent être, à priori examinées en fonction <strong>de</strong>s axesstratégiques :1. Organisation territoriale2. Niveau <strong>de</strong> rigueur dans l’application <strong>de</strong>s lois environnementales3. Budgets et moyens humains a mettre à disposition4. ….L’analyse réalisée dans le cadre du diagnostic (Mission I) et le rapprochementavec les expériences internationales, a permis <strong>de</strong> conclure, qu’il est plusjudicieux <strong>de</strong> proposer un système d’ICSE qui s’appuie sur les structuresactuelles, mais qui met en place une structure forte avec, in fine, uneéventuelle autonomisation <strong>de</strong> l’ensemble <strong>de</strong> l’activité <strong>de</strong> mise en œuvredu droit <strong>de</strong> l’environnement (Cf lignes directrices :rapport Epiney) quisoit :o En mesure <strong>de</strong> fédérer et <strong>de</strong> piloter l’ensemble <strong>de</strong>s systèmes actuels <strong>de</strong>contrôle et <strong>de</strong> surveillance <strong>de</strong> l’environnemento Dotée <strong>de</strong> moyen opérationnel lui permettant d’accomplir son action enrégiono Dotée <strong>de</strong>s pouvoirs <strong>de</strong> police nécessaireso Dotée <strong>de</strong>s moyens humains et matériels nécessairesAinsi le projet <strong>de</strong> mise en œuvre <strong>de</strong> la SNICE aura pour objet :15 Principe 16 épiney16 Principe 18, 19 et 20 Epiney15
1. Dans un premier temps le renforcement <strong>de</strong> la structure actuelledans les domaines <strong>de</strong> l’inspection du contrôle et <strong>de</strong> la surveillance<strong>de</strong> l’environnement, et d’opérer <strong>de</strong>s réaménagements aux niveauxopérationnels (surtout en région), en relation avec l’avancée dudispositif juridique et réglementaire.2. Une <strong>de</strong>uxième étape, sur base d’une évaluation du système (trois à5 ans en moyenne) permettra <strong>de</strong> vérifier le <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> maturité dusystème et d’envisager les options d’élargissement etd’autonomisation possibles (Création d’une structure plusautonome, extension du périmètre, Recherche d’efficacité, …)Dans tous les cas <strong>de</strong> figure le SICSE pourra s’appuyer sur les instrumentsfinanciers prévus par loi et notamment le Fond national pour la mise en valeur etla protection <strong>de</strong> l’environnement (Cf Loi 11/03 Art 60)Rappelons, enfin que ce dispositif tentera <strong>de</strong> couvrir les différents instruments <strong>de</strong>la mise en œuvre du droit environnemental (Cf Klaphake 17 )3.4. DEVELOPPEMENT DE LA STRATEGIE:Comme annoncé précé<strong>de</strong>mment le scénario <strong>de</strong> base prévoit un renforcement etune mise à niveau du système actuel, tant pour la surveillance que pourl’inspection et le contrôle, tout en mettant en valeur la relation structurelle entreces <strong>de</strong>ux éléments ; Le système, domicilié au niveau du département <strong>de</strong>l’environnement, est orienté vers la lutte contre la nuisance et le renforcement<strong>de</strong> la coordination avec les systèmes sectoriels ;Le schéma actuel récapitule l’ensemble <strong>de</strong>s dispositions à prendre en comptedans le scenario <strong>de</strong> base aussi bien pour la surveillance et le contrôle que pourles niveaux connexes et stratégies <strong>de</strong> décision. L’ensemble <strong>de</strong>sconsidérations ressortent obligatoirement du corpus législatif en vigueur(Lois environnementales)3.5. Stratégie <strong>de</strong> surveillance:La surveillance est un composant clé du système SICSE. Les objectifs sontd’élaborer une politique durable et intégrée, tant pour la protection etl’amélioration <strong>de</strong> la qualité <strong>de</strong> l’environnement que pour l’utilisation pru<strong>de</strong>nte etrationnelle <strong>de</strong>s ressources naturelles (eau, air littoral,…).L’approche recommandée consiste la recherche d’une cohérence qui répondraitaux besoins tant <strong>de</strong>s déci<strong>de</strong>urs que <strong>de</strong>s structures responsables <strong>de</strong> l’inspection etcontrôle, au sens large, qui inclut aussi les activités d’acceptabilitéenvironnementale dans le cadre <strong>de</strong>s lois en vigueur, en ce qui concerne laproduction d’une information pertinente sur l’état <strong>de</strong> l’environnement et sonévolution.Il s'agit entre autres <strong>de</strong> vérifier au travers <strong>de</strong> la surveillance si l'ensemble <strong>de</strong>smesures entreprises, dont le contrôle, contribue sensiblement à la réalisation<strong>de</strong>s objectifs <strong>de</strong> protection <strong>de</strong> l'environnement. Cette démarche analytiquepermet <strong>de</strong> reconsidérer, en termes <strong>de</strong> pertinence, les missions et dispositions <strong>de</strong>contrôle, la qualité <strong>de</strong>s restrictions, le durcissement <strong>de</strong>s normes, les moyensalloués sur la base <strong>de</strong>s observations et rapports <strong>de</strong> surveillance <strong>de</strong>s milieux…:17 Experiece internationale Klaphake Juin 0716
Le cadre <strong>de</strong> la loi 11/03 (Art 57), précise le rôle et prérogatives <strong>de</strong>s différentsréseaux <strong>de</strong> surveillance « l’administration met en place un observatoire national<strong>de</strong> l’environnement et <strong>de</strong>s réseaux régionaux d’observation, <strong>de</strong> contrôle et <strong>de</strong>suivi <strong>de</strong> la qualité <strong>de</strong> l’environnement, chacun dans son domaine. Ils peuventrequérir l’assistance <strong>de</strong>s centres <strong>de</strong> recherche, instituts scientifiques et autoritéslocales)La mission <strong>de</strong> la surveillance se base ainsi sur <strong>de</strong>s axes stratégiques majeurs :3.5.1. Régionalisation <strong>de</strong>s réseaux :L’efficacité <strong>de</strong>s réseaux <strong>de</strong> surveillance est intimement liée à la dimensiongéographique :et se prête mieux à une gestion décentralisée ; Cettesituation <strong>de</strong>vra cependant être nuancée en fonction du domaine <strong>de</strong>l’environnement et <strong>de</strong> l’état <strong>de</strong> sa prise en charge au niveau <strong>de</strong>s régionsconsidérées :Ainsi, par exemple: la prise en charge <strong>de</strong> la surveillance dans le domaine <strong>de</strong>l’eau est une responsabilité <strong>de</strong>s agences <strong>de</strong> bassin3.5.2. Le laboratoire <strong>de</strong> référence :La constitution d’une telle institution vise à assister les autorités publiques etles laboratoires d’analyses dans la réalisation et le suivi <strong>de</strong>s analyses dans lesdifférents secteurs. Elle doit aussi permettre au SEEE d’être mieux présentdans les commissions <strong>de</strong> normalisation.Compte tenu <strong>de</strong> l’existence <strong>de</strong> laboratoires spécialisés publics ou privés , laSNICSE considère qu’il convient <strong>de</strong> s’appuyer en priorité sur ces organismes,pour constituer une plate forme <strong>de</strong> coordination et <strong>de</strong> concertation dontla coordination serait assurée par la DSPR (Laboratoire National <strong>de</strong>l’Environnement). Il conviendrait dans tous les cas que le LNE soit engagédans une restructuration permettant d’élargir son champ d'action et sescompétences pour combler le manque <strong>de</strong> moyens actuels17
Ainsi, dans la cadre <strong>de</strong> la présente stratégie, il est proposé <strong>de</strong> renforcer lescapacités du LNE pour lui permettre d’assurer la coordination du Laboratoire<strong>de</strong> référence dont la fiche projet est proposée ci après :Actions <strong>de</strong> Renforcement du laboratoire National <strong>de</strong>l’EnvironnementLe renforcement du du LNE concerne les activités suivantes :• Surveiller la qualité <strong>de</strong> l’environnement en temps réel;• Contribuer au contrôle environnemental• I<strong>de</strong>ntifier, hiérarchiser et suivre les tendances <strong>de</strong>s indicateurs <strong>de</strong>pollution;• Promouvoir la recherche en collaboration avec les structures internes etexternes du SEEECe renforcement se décline en :Renforcement du rôle central du Laboratoire National <strong>de</strong> l’Environnement dans ledéveloppement <strong>de</strong>s outils analytiques pour une connaissance plus approfondie etconsistance <strong>de</strong>s différents paramètres environnementaux et <strong>de</strong> leur évolutionspatio-temporelle.Renforcement <strong>de</strong> ses missions pour la surveillance <strong>de</strong>s tendances <strong>de</strong>s différentesformes <strong>de</strong> pollution et <strong>de</strong> nuisance dans les principales composantes <strong>de</strong>l’environnement: l’eau, l’air et le sol.Figure 1: Fiche projet Renforcement du laboratoire national <strong>de</strong> l'environnement3.5.3. Le système d’information <strong>de</strong> l’état <strong>de</strong> l’environnementLe système d’information est une composante essentielle <strong>de</strong> la surveillance <strong>de</strong>l’état <strong>de</strong> l’environnement qui e i<strong>de</strong>ntifiée dans la stratégie nationale comme levierincontournable du SICSE ; La mise en place effective <strong>de</strong> l’observatoire national<strong>de</strong> l’environnement qui s’occupera <strong>de</strong> la gestion <strong>de</strong> la banque <strong>de</strong> données quiregroupe tous les rapports et informations produites par la surveillance <strong>de</strong>ssecteurs environnementaux, les secteurs système d’information <strong>de</strong>l’environnement.La Base d’informations est considérée comme une plateforme basée au sein <strong>de</strong> laDSPR qui sera enrichie par les éléments issus <strong>de</strong>s différents partenairessectoriels et les acteurs <strong>de</strong> la surveillance en général (Réseaux d’autosurveillance, Campagnes <strong>de</strong> contrôle et inspections Réseaux internationaux etrégionaux…)Le système d’Informations permettra, outre la gestion et le traitement <strong>de</strong>sinformations relatives à l’état <strong>de</strong> l »environnement, la mise à dispositiond’informations élaborées (synthèses, rapports, indicateurs…..) <strong>de</strong>stinées auxdifférentes catégories d »utilisateurs <strong>de</strong> l’information environnementale.18
Le défi à relever concerne la mise à jour permanente du système qui nécessiteune contribution <strong>de</strong> tous les partenaires sectoriels qui <strong>de</strong>vraient se retrouverdans ce partenariat dans une logique gagnant gagnant.3.5.4. La surveillance <strong>de</strong>s domaines environnementauxLes activités <strong>de</strong> surveillance se prêtent, à priori, a entreprendre une approchequi considère les domaines <strong>de</strong> l'environnement <strong>de</strong> manière indépendante pourpouvoir définir les stratégies par domaine d'activité stratégique, et ensuite <strong>de</strong>reprendre la configuration pour intégrer les dispositions horizontales ; Cetteapproche <strong>de</strong>vra respecter les principes <strong>de</strong> l’utilisation du potentiel <strong>de</strong>s institutionsactuelles et <strong>de</strong> la décentralisation. La stratégie proposée est articulée autourd’axes stratégiques répartis selon les différents domaines <strong>de</strong> l’environnement :3.5.4.1. Domaine Eau :Le dispositif actuel <strong>de</strong> surveillance mis en place dans le domaine eau disposed’atouts importants pour couvrir la mission qui lui est confiée. Cette mission, quidécoule <strong>de</strong> la loi 10 /95 principal référentiel dans le domaine, intègre la notion <strong>de</strong>l’unité géographique au niveau du bassin ABHs. Ce domaine nécessite unrenforcement <strong>de</strong> la coordination au niveau central pour optimiser les moyens. Lesystème <strong>de</strong>vra intégrer les informations issues du contrôle notamment opéré pard’autres partenaires (ONEP…)Le Développement <strong>de</strong> la stratégie au niveau du domaine eau est donné dans letableau ci après :Axe stratégiqueORIENTATION STRATEGIQUEObjectifsMettre en place la veille stratégique enmatiére <strong>de</strong> surveillance eauRenforcer les réseaux <strong>de</strong>s Agences <strong>de</strong>bassinMette en place un Laboratoire <strong>de</strong>référenceMise en place du système d'informationEauSURVEILLANCERENFORCER LA SURVEILLANCE DU SECTEUR EAUActions stratégiquesUne structure au sein du Ministère chargée <strong>de</strong> coordonner l'ensemble <strong>de</strong>s actions<strong>de</strong> la surveillance eauMettre en place le système d'évaluation <strong>de</strong> la performance du réseau pour chaqueagenceRenforcer les laboratoires <strong>de</strong>s ABHs et les moyens d'analyse in situ (unité mobile)Renforcer le cadre <strong>de</strong> sous traitance <strong>de</strong>s prestations <strong>de</strong> suivi <strong>de</strong>s réseaux pourchaque agenceMise a niveau du Laboratoire national dans le domaine Eau aux standardsinternationauxMise en place d'un groupe <strong>de</strong> travail sur la création du laboratoire national <strong>de</strong>référence (Ministère, ABHs, ONEP, Experts)Engager une réflexion sur le partage <strong>de</strong>s données et <strong>de</strong>s objectifs dans un soucid'optimisation <strong>de</strong>s moyens (comité a mettre en place)MoyensIndicateursBudgets;RHs; Comité <strong>de</strong> suiviRapports <strong>de</strong>s comités; rapports annuels <strong>de</strong>s ABHsTableau 1:Développement <strong>de</strong> la stratégie <strong>de</strong> surveillance du domaine EAU3.5.4.2. Domaine Air :La surveillance est assurée dans le cadre d’un référentiel qui est la loi surl’air. Le réseau actuel dont la supervision est assurée par le LNE permet19
d’établir un reporting régulier sur l’état <strong>de</strong> la qualité <strong>de</strong> l’air dans les villesconcernées ; Le dispositif nécessite un renforcement en moyens humains etmatériels .Le système <strong>de</strong>vra intégrer les informations issus du contrôlenotamment opéré par d’autres partenaires tels que la gendarmerie et la police ;ainsi que les rapports <strong>de</strong> l’autosurveillance opérée par les industrielsLe Développement <strong>de</strong> la stratégie au niveau du domaine eau est donné dans letableau ci après :Axe stratégiqueSURVEILLANCEORIENTATION STRATEGIQUEObjectifsMettre en place la veille stratégiqueen matière <strong>de</strong> surveillance AIRRENFORCER LA SURVEILLANCE DU SECTEUR AIRActions stratégiquesUne structure au sein du Ministère chargée <strong>de</strong> coordonner l'ensemble <strong>de</strong>s actions <strong>de</strong> lasurveillance AIR (LNE)Renforcer le réseau nationalHarmoniser et renforcer les actions<strong>de</strong>s partenairesMise en place du systèmed'information EauMettre en place le système d'évaluation <strong>de</strong> la performance du réseauEtendre et Renforcer le réseau <strong>de</strong> surveillance aux principales villes du RoyaumeRenforcer les moyens <strong>de</strong> supervision et <strong>de</strong> télégestion du réseauRenforcer le cadre <strong>de</strong> partenariat avec les opérateurs (Unités mobiles police etgendarmerie, Transports, collectivités et autres)Mise en place d'une démarche gagnant gagnant avec les opérateurs privés pour lasurveillance <strong>de</strong> la qualité <strong>de</strong> l'air (Autosurveillance)Mise en place <strong>de</strong> la plateforme du système d'information central <strong>de</strong> la qualité <strong>de</strong> l'airMoyens IndicateursBudgets;RHs; Comité <strong>de</strong> suivi; structure Rapports <strong>de</strong>s comités;Rapports annuelsprojetTableau 2: Dévelopement <strong>de</strong> la stratégie <strong>de</strong> sur veillance dans le doamine AIr3.5.4.3. Déchets :La surveillance Dans le domaine <strong>de</strong>s déchets s’inscrit dans le Référentiel loi28/00. Des précisions doivent être prévues dans le cadre <strong>de</strong>s décretsd’application. La surveillance dans le domaine <strong>de</strong>s déchets peut êtreappréhendée dans le cadre <strong>de</strong> la philosophie du contrôle prévu pour lesinstallations classées et <strong>de</strong> l’obligation du gestionnaire ou du délégataire duservice. La coordination au niveau central sera assurée par la DSPR encollaboration avec la DGCL du Ministère <strong>de</strong> l‘intérieur . La même approche peutêtre entreprise pour les déchets dangereux20
Le Développement <strong>de</strong> la stratégie au niveau du domaine eau est donné dans letableau ci après :Axe stratégiqueSURVEILLANCEORIENTATION STRATEGIQUERENFORCER LA SURVEILLANCE DU SECTEUR DECHETSObjectifsMettre en place la veille stratégique<strong>de</strong> surveillance du secteur déchetsMise en place du réseau national <strong>de</strong>surveillance <strong>de</strong>s déchargespubliquesHarmoniser et renforcer les actions<strong>de</strong>s partenairesMise en place du systèmed'information DéchetsActions stratégiquesLa surveillance dans le domaine <strong>de</strong>s déchets s’inscrit dans le Référentiel loi 28/00 : Etendreet Renforcer le réseau <strong>de</strong> surveillance aux principales agglomérations du RoyaumeMise en place du réseau <strong>de</strong> surveillance <strong>de</strong>s diffrérents décharges publiques <strong>de</strong>s gran<strong>de</strong>set moyennes agglomérationsMise en place <strong>de</strong> la surveillance <strong>de</strong>s déchets spéciaux dans le cadre du projet CNDESRenforcer le cadre <strong>de</strong> partenariat avec les opérateurs privés et les communesMise en place d'une démarche gagnant gagnant avec les opérateurs privés pour lasurveillance <strong>de</strong>s déchets (Autosurveillance)Mise en place <strong>de</strong> la plateforme du système d'information central <strong>de</strong>s déchetsMoyens IndicateursBudgets;RHs; Comité <strong>de</strong> suivi; structure Rapports <strong>de</strong>s comités;Rapports annuelsprojetTableau 3: Développement <strong>de</strong> la stratégie <strong>de</strong> surveillance du domaine déchets3.5.4.4. Forêts et biodiversitéCe domaine est pris en charge par le Ministère <strong>de</strong> l’agriculture etparticulièrement le Haut commissariat aux eaux et forets. Ce Domainenécessite <strong>de</strong> la part du département <strong>de</strong> l’environnement, une plus forteimplication dans la mise en place d’une plateforme <strong>de</strong> partage <strong>de</strong> l’informationafin <strong>de</strong> permettre la vision globale intégrée <strong>de</strong> l’environnement.Le Développement <strong>de</strong> la stratégie au niveau du domaine eau est donné dans letableau ci après :Axe stratégiqueORIENTATION STRATEGIQUEObjectifsRenforcer les actions <strong>de</strong>spartenairesSURVEILLANCELA SURVEILLANCE DU SECTEUR FORETS ETBIODIVERSITEActions stratégiquesRenforcer les actions <strong>de</strong> partenariat <strong>de</strong> surveillance dans le domaine<strong>de</strong> Forêts et SolsMise en place d'un groupe <strong>de</strong> travail entre les partenaires <strong>de</strong>surveillance <strong>de</strong>s Forets et sols (Ministère <strong>de</strong> l'agriculture et le Hautcommissariat <strong>de</strong>s Eaux et Forêts) pour la coordination avec lelaboratoire national <strong>de</strong> référenceMise en place du systèmed'information Forêts et SolsNécessite <strong>de</strong> mise en place d’une plateforme <strong>de</strong> partage <strong>de</strong>l’information compte tenu <strong>de</strong> l’interaction du domaine avec lesdomaines eau et accessoirement <strong>de</strong> l’airIndicateursRapports <strong>de</strong>s comités; Rapports annuels du Haut CommissariatMoyensBudgets;RHs; Comité <strong>de</strong> suiviTableau 4: Développement <strong>de</strong> la stratégie <strong>de</strong> surveillance Forets et biodiversité21
3.5.4.5. LittoralLe suivi <strong>de</strong> la qualité hygiénique <strong>de</strong>s eaux <strong>de</strong> baigna<strong>de</strong> est une activité <strong>de</strong>surveillance ancrée dans les attributions du SEEE et peut être considérée commel’une <strong>de</strong>s réussites du SEEE. Pilotée par la fondation Mohammed VI <strong>de</strong>l’Environnement et fait intervenir le Ministère <strong>de</strong> l’Equipement et du Transport, lasurveillance <strong>de</strong>s eaux <strong>de</strong> baigna<strong>de</strong> est un axe important <strong>de</strong> la SNICSE. Enprévision <strong>de</strong> l’application <strong>de</strong>s dispositions <strong>de</strong> la future loi sur le littoral, lasurveillance <strong>de</strong>vrait développer un programme <strong>de</strong> suivi <strong>de</strong> la qualité <strong>de</strong>s eauxmarines dans l’objectif <strong>de</strong> la mise en place d’aires marines protégées. Cet axemérite toute l’attention du SEEE et les partenaires institutionnels concernés.3.6. Stratégie <strong>de</strong> contrôle et inspection:Le terme contrôle sous entend l’inspection et contrôle et poursuit l’objectif <strong>de</strong> laconformité environnementale et le respect <strong>de</strong>s lois.Comme énoncé En mission I Les activités concernent aussi les domainesenvironnementaux en interaction avec les activités et installations polluantes. Lecontrôle interagit dans le sens ou l’état <strong>de</strong> l’environnement ; issu <strong>de</strong> lasurveillance influence les programmes <strong>de</strong> contrôle (renforcement ou allégementen fonction <strong>de</strong> l’état <strong>de</strong> dégradation). Et informe sur l’efficacité du système <strong>de</strong>contrôle mis en place.La mise en œuvre <strong>de</strong> la stratégie <strong>de</strong>vra être réalisée selon une planification <strong>de</strong>sdifférentes activités, en définissant l’ensemble <strong>de</strong>s moyens et mesures pourl’atteinte <strong>de</strong>s objectifs.3.6.1. Le renforcement du dispositif juridique et réglementaire :Si le corpus juridique s’est renforcé par la promulgation <strong>de</strong>s loisenvironnementales, la promulgation <strong>de</strong>s textes d’application (décrets, arrêtés)tar<strong>de</strong> à venir. Chaînon indispensable à l’application effective <strong>de</strong>s dispositionslégislatives contenues au niveau <strong>de</strong>s lois environnementales la promulgation <strong>de</strong>stextes d’application est un élément fondamental <strong>de</strong> la SNICSE.La mise en œuvre <strong>de</strong>s éléments <strong>de</strong> la présente stratégie est tributaire <strong>de</strong> lapromulgation <strong>de</strong>s textes d’application <strong>de</strong>s lois environnementales. La SNICSEpréconise <strong>de</strong> doubler d’efforts en matière <strong>de</strong> communication institutionnelleauprès <strong>de</strong>s responsables <strong>de</strong>s départements ministériels ainsi que ceux duSecrétariat Général du Gouvernement pour faire aboutir les textes d’application<strong>de</strong>s lois environnementales.3.6.2. Le Processus d’autorisation (Acceptabilité Environnementale) :Le cycle réglementaire montre l’enchaînement logique et les liens entre lesdifférentes étapes <strong>de</strong> la gestion <strong>de</strong> la conformité. Ainsi <strong>de</strong>s conditionsd’autorisation insuffisantes impactent automatiquement le contrôle et le travaild’inspection, et se répercute sur l’objectif global <strong>de</strong> protection <strong>de</strong>l’environnement. Le corpus législatif marocain en matière d’autorisation est aussiétoffé que cohérent avec la loi 12/03 sur les EIEs. Des dispositions sont prévuespour le renforcement du dispositif <strong>de</strong> mise en application <strong>de</strong> la loi sur les EIEs(voir résultat <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong> EDIC-Eauglobe ) .22
3.6.3. Renforcement <strong>de</strong>s structures <strong>de</strong> contrôle : Police <strong>de</strong> l’EnvironnementConformément à ses attributions, la Direction <strong>de</strong> la Réglementation et duContrôle est la structure responsable du contrôle environnemental au niveau dudépartement <strong>de</strong> l’environnement. Elle <strong>de</strong>vra jouer le rôle <strong>de</strong> coordonnateur <strong>de</strong>toute l’activité <strong>de</strong> contrôle ; Elle est au centre toute décision qui met en jeu <strong>de</strong>sengagements politique, technique ou financier.ROLE DE LA DRCLa promotion <strong>de</strong> la conformité environnementale, l’application effective <strong>de</strong>sdispositions juridiques ainsi que la coordination <strong>de</strong>s actions <strong>de</strong> l’inspection, <strong>de</strong>contrôle et <strong>de</strong> surveillance par la mise sur pied d’un corps d’inspecteursassermentés qui agissent aux niveaux national et régional constituent <strong>de</strong>s pistesimportantes dans le cadre <strong>de</strong> la définition <strong>de</strong> la SNICSE, qui <strong>de</strong>vra bien entendus’appuyer sur les nouvelles dispositions juridiques d’ordre opérationnel etfonctionnel contenues dans les nouvelles lois environnementales, sur lesdispositions institutionnelles dont le regroupement au niveau d’une seuleautorité les domaines <strong>de</strong> l’eau et <strong>de</strong> l’environnement , et sur l’existence <strong>de</strong>systèmes sectoriels rodés <strong>de</strong>puis plus <strong>de</strong> 70 ans tels la police <strong>de</strong> la chasse, lapolice <strong>de</strong> la forêt.La SNICE i<strong>de</strong>ntifie la Direction <strong>de</strong> la Réglementation et du Contrôle commeprincipale structure responsable du contrôle environnemental. (Voir Principe 1 18 )Figure 2: Role <strong>de</strong> la DRCPour assurer une meilleure prise en compte <strong>de</strong>s polices <strong>de</strong> l’environnement auniveau interministériel, la SNICSE estime que <strong>de</strong>s orientations <strong>de</strong> politiquegénérale pour la mise en œuvre <strong>de</strong>s polices <strong>de</strong> l’environnement pourraient êtredéfinies par le CNE conseil national <strong>de</strong> l’environnement, qui rassemble l’ensemble<strong>de</strong>s ministères.Cette politique nécessite la définition <strong>de</strong> programmes comportant <strong>de</strong>s prioritésnationales par grand domaine d’action. Ces programmes <strong>de</strong>vraient faire l’objet<strong>de</strong> déclinaisons régionales. La diffusion d’une circulaire fixant les objectifs etaccompagnée <strong>de</strong> lignes directrice est un signe fort <strong>de</strong> la traduction <strong>de</strong> la politique<strong>de</strong> contrôle sur le terrain.La nécessité d’élaborer un statut instituant un corps <strong>de</strong> police <strong>de</strong>l’environnement qui détermine leurs attributions est à notre avis un axe essentiel<strong>de</strong> la SNICSE. Le texte, décret en l’occurrence, a pour objet <strong>de</strong> définir lesattributions, l'organisation et le fonctionnement <strong>de</strong>s corps <strong>de</strong>s inspecteurschargés <strong>de</strong> la protection <strong>de</strong> l'environnement conformément aux dispositions <strong>de</strong>sarticles 77, 78 et 79 <strong>de</strong> la loi 11-03 relative à la protection et à la mise en valeur<strong>de</strong> l’environnement, <strong>de</strong>s articles 14 et 15 <strong>de</strong> la loi n°12-03 relative aux étu<strong>de</strong>sd’impact sur l’environnement, <strong>de</strong>s articles 9, 10 et 11 <strong>de</strong> la loi 13-03 relative àla lutte contre la pollution <strong>de</strong> l’air et les articles 61, 62, 63 et 64 <strong>de</strong> la loi 28-00relative à la gestion <strong>de</strong>s déchets et à leur élimination. La création du corps <strong>de</strong>police <strong>de</strong> l’environnement n’exclut pas les possibilités <strong>de</strong> coordination avec lescorps <strong>de</strong> police sectoriels (Eau, Chasse, Gendarmerie…..)..Corps <strong>de</strong>s inspecteurs <strong>de</strong> l’environnement18 Note N 1 : Epiney Nov 200723
L’évolution <strong>de</strong>s corps <strong>de</strong>s inspecteurs en une police <strong>de</strong> l’environnementreconnu sur le plan juridique et institutionnel est l’objectif fondamental<strong>de</strong> la SNICSEles missions <strong>de</strong>s inspecteurs <strong>de</strong> l’environnement peuvent être résuméescomme suit:• veiller à l'application <strong>de</strong> la législation et <strong>de</strong> la réglementation enmatière <strong>de</strong> protection <strong>de</strong> l’environnement qu’il soit terrestre,marin ou atmosphérique contre toutes les formes <strong>de</strong> dégradation,• veiller à la conformité avec la législation et la réglementation envigueur <strong>de</strong>s conditions <strong>de</strong> mise en place et d'exploitation <strong>de</strong>sinstallations classées, <strong>de</strong>s conditions <strong>de</strong> traitement etd'élimination <strong>de</strong>s rejets issus <strong>de</strong>s activités humaines,• veiller, en concertation avec les services concernés, à laconformité avec la législation et la réglementation en vigueur auxconditions d'utilisation, d'entreposage, <strong>de</strong> stockage, <strong>de</strong>manutention et <strong>de</strong> transport <strong>de</strong>s substances chimiques, <strong>de</strong>sdéchets toxiques ou dangereux et <strong>de</strong>s sources radioactives,• contrôler toutes les sources <strong>de</strong> pollution et <strong>de</strong> nuisances,• réaliser <strong>de</strong>s enquêtes visant à détecter les sources <strong>de</strong> pollution et<strong>de</strong> nuisances susceptibles <strong>de</strong> porter atteinte à la santé publique,aux ressources naturelles et à l'environnement,• veiller au respect <strong>de</strong> la législation et <strong>de</strong> la réglementation enmatière d'étu<strong>de</strong> d'impact sur l'environnement,• veiller au respect <strong>de</strong>s dispositions juridiques par les projets ayantbénéficié du fonds <strong>de</strong> dépollution industrielle ou le fonds national<strong>de</strong> l’environnement,• exécuter toute autre tâche dans le domaine <strong>de</strong> l’inspection <strong>de</strong>contrôle et <strong>de</strong> surveillance qui leur est confiée par le ministrechargé <strong>de</strong> l'environnement.Figure 3: Mise en place du Corps <strong>de</strong>s Inspecteurs <strong>de</strong> l'environnementLes inspecteurs chargés <strong>de</strong> l'environnement interviennent <strong>de</strong> manièreindépendante, sur la base d'un programme annuel d'inspection. Ils peuvent, enoutre, intervenir <strong>de</strong> manière inopinée à la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> du ministre chargé <strong>de</strong>l'environnement ou du wali concerné, pour effectuer toute mission d'enquêterendue nécessaire par une situation particulière. Ils établissent un bilan annuel<strong>de</strong> leurs activités. Le projet <strong>de</strong>vra prévoir une prise en charge progressive <strong>de</strong>sattributions en fonction <strong>de</strong> l’évolution du régime juridique et <strong>de</strong>s moyens mis enplace. L’ajustement <strong>de</strong>s ressources humaines sera opéré en conséquence.Le plan annuel <strong>de</strong>vra prévoir un dispositif d’assermentation <strong>de</strong>s agents enfonction <strong>de</strong>s besoins RHs selon l’approche empirique présentée dans la missionI . Il <strong>de</strong>vra par ailleurs prévoir le reporting nécessaire aux décisionsd’amélioration.24
Trois options organisationnelles sont examinées :Option 1 : Scénario actuel : <strong>de</strong>s inspecteurs <strong>de</strong> l’environnement agissantindividuellement et dépendant d’une structure hiérarchique au sein dudépartement <strong>de</strong> l’environnementOption 2 : Structure centrale regroupant les inspecteurs du corps <strong>de</strong>police <strong>de</strong> l’environnementOption 3 : Structures décentralisées (ABHs, Wilaya, Délégations), Le rôle<strong>de</strong>s IRATES reste assez à préciser compte tenu <strong>de</strong> nouvelle configurationgouvernementale et <strong>de</strong> son impact sur les structures décentraliséesLe choix organisationnel proposé est celui qui garantirait la durabilité du systèmeet qui consiste dans la mise en place d’une structure centrale appuyée par lesstructures décentralisées ;3.6.4. Renforcement <strong>de</strong> la normalisation environnementale :Aucune opération <strong>de</strong> contrôle ou <strong>de</strong> surveillance <strong>de</strong> l’état <strong>de</strong> l’environnement neprétend être fiable et utile en l’absence <strong>de</strong> normes <strong>de</strong> rejets liqui<strong>de</strong>s, gazeux ousoli<strong>de</strong>s, <strong>de</strong> prescriptions et techniques <strong>de</strong>s outils d’élimination <strong>de</strong>s nuisances ouencore en défaut <strong>de</strong> normes <strong>de</strong> qualité <strong>de</strong> l’environnement ambiant.La SNICSE prévoit à cet effet, l’élaboration d’un rapport sur l’état <strong>de</strong> respect <strong>de</strong>snormes nationales environnementales qui sera mis à la disposition <strong>de</strong>slégislateurs et <strong>de</strong>s déci<strong>de</strong>urs pour en évaluer la pertinence et partant lacontinuation <strong>de</strong> l’effort <strong>de</strong> normalisation.3.6.5. Elaboration <strong>de</strong>s manuels d’inspection et <strong>de</strong> contrôle:La SNICSE prévoit l’élaboration <strong>de</strong> manuels <strong>de</strong> conduite d’opérations d’inspectionet <strong>de</strong> contrôle environnemental. Le manuel en question inspiré <strong>de</strong>s modèles quiexistent au niveau international (IMPEL, EPA) est un gui<strong>de</strong> mis à la disposition<strong>de</strong>s inspecteurs assermentés du SEEE et aux autres agents <strong>de</strong>s autresdépartements ministériels chargés <strong>de</strong> constater les infractions en matièred’environnement.25
Le manuel national est <strong>de</strong>vrait être conçu comme un gui<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’inspectionenvironnementale permettant <strong>de</strong> mener à bien l’opération <strong>de</strong>puis la préparation<strong>de</strong> l’inspection jusqu’à la transmission du rapport aux autorités concernées.Ce manuel présentera toutes les métho<strong>de</strong>s d’inspection et <strong>de</strong> contrôle pour lavérification <strong>de</strong> la conformité environnementale dans les domaines <strong>de</strong> l’eau, l’air,les déchets, les pestici<strong>de</strong>s, les produits toxiques. Il décrit les activités et taches àrespecter par l’inspecteur mener à bien sa missionLe Développement <strong>de</strong> la stratégie institutionnelle du contrôle est donnée dans letableau ci aprèsAxe stratégiqueORIENTATION STRATEGIQUEObjectifsMettre en place la veilleréglementaire du domaine eauMise en place du corps <strong>de</strong> police <strong>de</strong>l'environnementMettre en place <strong>de</strong>s Procédures <strong>de</strong>contrôle1Mise en Œuvre <strong>de</strong> la stratégie du contrôleRenforcer le Cadre juridique, réglementaire et institutionnelActions stratégiquesUne structure au sein du Ministère chargée la veille réglementaire etnormativeActiver la promulgation <strong>de</strong>s arrêtés relatifs aux VLRsTexte juridique fixant les attributions et conditions <strong>de</strong> l'exercice <strong>de</strong> la police<strong>de</strong>s eaux (peut être commun avec le textes sur les inspecteurs <strong>de</strong>l'environnement)Procé<strong>de</strong>r à l'Assermentation <strong>de</strong>s agents <strong>de</strong> la police <strong>de</strong> l'e environnementRenforcement du pouvoir <strong>de</strong> police <strong>de</strong>s inspecteurs <strong>de</strong> l'environnement(Texte, moyens, statut, communication)Réalisation <strong>de</strong> l'étu<strong>de</strong> du référentiel <strong>de</strong>s procédures <strong>de</strong> contrôleMise à disposition du referentiel et formationMise en application du referentiel <strong>de</strong>s procéduresInformation <strong>de</strong>s parties prenantes (Large campagne <strong>de</strong> communication:Partenaires, Justice)Plateforme <strong>de</strong> coordination avec lesautres corps <strong>de</strong> policeMise en place d'un mécanisme <strong>de</strong> coordination au sein <strong>de</strong> la DRCRéalisation d'activités avec certains corps <strong>de</strong> policeElaboration <strong>de</strong>s indicateurs <strong>de</strong> suivi et <strong>de</strong> performanceSuivi EvaluationSuivi <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s et <strong>de</strong>s actions spécifiquesMoyensIndicateursBudget; RHs; Assistance technique Rapports d’avancement; Rapports annuels sur base <strong>de</strong>s indicateursTableau 5 :Renforcement du dispositif juridique, réglementaire et institutionnel du contrôleLe développement <strong>de</strong> la stratégie <strong>de</strong> contrôle est détaillé qui tient compte <strong>de</strong>s spécifités <strong>de</strong>ssecteurs Eau et air dans les tableaux ci après :26
Axe stratégiqueORIENTATION STRATEGIQUEObjectifsMettre en place la veilleréglementaire du domaine eau4 CONTRÔLERENFORCER LE CONTROLE DU SECTEUR EAUActions stratégiquesUne structure au sein du Ministére chargée la veille réglementaire etnormativeActiver la promulgation <strong>de</strong>s arretés realtifs aux VLRsOpérationnalisation <strong>de</strong> la police <strong>de</strong>seaux <strong>de</strong> manière progressive maisconsolidée et participative dans lerespect <strong>de</strong>s principes <strong>de</strong> la loi 10/95et <strong>de</strong>s lois environnementalesRéalisation <strong>de</strong>s programmes <strong>de</strong>contrôleSuivi EvaluationTexte juridique fixant les attributions et conditions <strong>de</strong> l'exercice <strong>de</strong> la police<strong>de</strong>s eaux (peut etre commun avec le textes sur les inspecteurs <strong>de</strong>l'environnement)Proce<strong>de</strong>r à l'Assermentation <strong>de</strong>s agents <strong>de</strong> la police <strong>de</strong>s eauxMise en place <strong>de</strong> la procédureInformation <strong>de</strong>s parties prenantes (Large campagne <strong>de</strong> communication:Partenaires, Justice)Elaboration <strong>de</strong>s programmes <strong>de</strong> contrôle par les ABHs dans le cadre ducontrat <strong>de</strong> gestionRéalisation <strong>de</strong>s campagnes <strong>de</strong> contrôle et actions d'inspection et rapportagea chaudEvaluation <strong>de</strong>s activités et élaboration du rapportsSuivi <strong>de</strong> la mise en place <strong>de</strong>s recommandationsMoyensIndicateursBudgets;RHs; Comité <strong>de</strong> suiviRapports <strong>de</strong>s comités;Rapports annuels <strong>de</strong>s ABHsTableau 6: Spécifités <strong>de</strong> la stratégie <strong>de</strong> contrôle dans le domaine EauAxe stratégique4 CONTRÔLEORIENTATION STRATEGIQUE 5RENFORCER Le contrôle DU SECTEUR AIRObjectifsActions stratégiquesMettre en place la veille stratégiqueen matiére <strong>de</strong> contrôle AIRRenforcer le réseau nationalHarmoniser et renforcer les actions<strong>de</strong>s partenairesMise en place du systémed'information EauUne structure au sein du Ministére chargée <strong>de</strong> coordonner l'ensemble <strong>de</strong>sactions <strong>de</strong> la surveillance AIR (LNE, DGMN)Mettre en place le systéme d'évaluation <strong>de</strong> la performance du réseauEtendre et Renforcer le réseau <strong>de</strong> surveillance aux principales villes duRoyaumeRenforcer les moyens <strong>de</strong> supervision et <strong>de</strong> télégestion du réseauRenforcer le cadre <strong>de</strong> partenariat avec les opérateurs (Unités mobilespolice et gendarmerie, Transports, collectivités et autres)Mise en place d'une démarche gagnant gagnant avec les opérateurs privéspour la surveillance <strong>de</strong> la qualité <strong>de</strong> l'air (Autosurveillance)Mise en place <strong>de</strong> la plateforme du systéme d'information central <strong>de</strong> laqualité <strong>de</strong> l'airMoyensIndicateursBudgets;RHs; Comité <strong>de</strong> suivi; Rapports <strong>de</strong>s comités;Rapports annuelsstructure projetTableau 7:Specificité <strong>de</strong> la stratégie <strong>de</strong> contrôle dans le domaine <strong>de</strong> l'air27
3.6.6. Planification <strong>de</strong>s opérations et programmes d’inspection :La SNICSE prévoit l’élaboration <strong>de</strong>s lignes directrices pour l’élaboration <strong>de</strong>sProgramme <strong>de</strong> contrôle et d’inspection environnementale. Les opérationsd'inspection environnementales seront planifiées à l'avance, en disposant enpermanence d'un ou <strong>de</strong> plusieurs programmes d'inspection couvrant l'ensembledu territoire et les installations réglementées qui s'y trouvent.Le Développement <strong>de</strong> la stratégie institutionnelle du contrôle est donnée dans letableau ci aprèsAxe stratégiqueORIENTATION STRATEGIQUEObjectifs3 CONTRÔLEElaboration et mise ne œuvre <strong>de</strong>s programmes d'inspection et <strong>de</strong> contrôleActions stratégiquesMise en oeuvre Des programmes<strong>de</strong> contrôle et d'inspectionElaboration <strong>de</strong>s projets par les entités <strong>de</strong> controles centrales et régionalesValidation <strong>de</strong>s programmes par la DRCPrise en charge <strong>de</strong> la programmation annuelle <strong>de</strong>s programmes validés parles entités opérationnelles <strong>de</strong> contrôleRéalisation <strong>de</strong>s programmes par les entités opérationnellesCoordination avec les autres corps<strong>de</strong> policeSuivi EvaluationAssociation <strong>de</strong>s polices sectorielles aux actions <strong>de</strong> contrôleMiseSuivi permanent selon systéme d'indicateursRapports annuels <strong>de</strong>s opérationnels et Elaboration du rapport annuelgénéral par la DRCMoyensIndicateursBudgets;RHs; Comité <strong>de</strong> suiviRapports d'avancement, Taux <strong>de</strong> réalisation Rapport annuelTableau 8: Mise en œuvre <strong>de</strong>s programmes d’inspection et contrôleCes programmes <strong>de</strong>vraient établis au niveau national, régional.Les programmes d'inspection environnementale <strong>de</strong>vraient être basés sur lesinformations suivantes :• les exigences juridiques à contrôler, normes, prescriptions• la liste <strong>de</strong>s installations autorisées concernées situées dans la zonecouverte par le programme;• un audit <strong>de</strong>s problèmes environnementaux dans la zone concernée par leprogramme;• les données <strong>de</strong>s inspections précé<strong>de</strong>ntes.Chaque programme d'inspection environnementale <strong>de</strong>vrait au minimum :• planifier les inspections environnementales régulières en tenant compte<strong>de</strong>s risques pour l'environnement ; cette planification <strong>de</strong>vrait indiquer, lecas échéant, la fréquence <strong>de</strong>s visites sur le terrain pour les différents typesd'installations ou pour <strong>de</strong>s installations réglementées déterminées ;28
• prévoir et décrire les procédures suivies pour les inspectionsenvironnementales ponctuelles, menées notamment à la suite d'uneplainte, d'un inci<strong>de</strong>nt, <strong>de</strong> manquements et aux fins d'octroyer uneautorisation ;• prévoir, une coordination entre les différentes autorités d'inspection.Les inspections sur le terrain <strong>de</strong>vraient menées <strong>de</strong> manière régulière par lesautorités d'inspection dans le cadre <strong>de</strong> leurs inspections environnementalesrégulières, et que ces visites sur le terrain respectent les critèressupplémentaires suivants :• examen <strong>de</strong> l'ensemble <strong>de</strong>s inci<strong>de</strong>nces pertinentes <strong>de</strong> l'installation surl'environnement, conformément aux exigences juridiques communautairesapplicables, aux programmes d'inspection environnementale et auxdispositions <strong>de</strong>s organismes d'inspection en matière d'organisation ;• promotion et approfondissement <strong>de</strong>s connaissances et <strong>de</strong> lacompréhension <strong>de</strong>s exploitants en ce qui concerne les exigences juridiquescommunautaires applicables et les sensibilités environnementales ainsique les inci<strong>de</strong>nces <strong>de</strong> leurs activités sur l'environnement ;• étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s risques et <strong>de</strong>s inci<strong>de</strong>nces en matière d'environnement liés àl'installation réglementée afin d'évaluer la pertinence <strong>de</strong>s exigencesapplicables en matière d'autorisation, <strong>de</strong> permis ou <strong>de</strong> licence, et <strong>de</strong>déterminer s'il est nécessaire d'améliorer ou <strong>de</strong> modifier ces exigences.Le SEEE <strong>de</strong>vrait également veiller à ce que <strong>de</strong>s visites sur le terrain soientmenées <strong>de</strong> manière ponctuelle dans les situations suivantes :• suite aux plaintes environnementales graves, et le plus rapi<strong>de</strong>mentpossible dès que les autorités, sont saisies <strong>de</strong> la plainte ;• suite aux acci<strong>de</strong>nts environnementaux graves, aux inci<strong>de</strong>nts et aux cas <strong>de</strong>manquement, et le plus rapi<strong>de</strong>ment possible dès qu'ils sont portés à laconnaissance <strong>de</strong>s autorités d'inspection compétentes ;• le cas échéant, dans le cadre <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s visant à déterminer l'opportunitéet les conclusions <strong>de</strong> l'octroi initial d'une autorisation pour une procédureou une activité prévue dans une installation réglementée ou sur le siteenvisagé à cette fin ou afin d'assurer le respect <strong>de</strong>s exigences <strong>de</strong>l'autorisation, du après que ceux-ci ont été octroyés et avant le démarrage<strong>de</strong> l'activité ;3.6.7. Intégration <strong>de</strong>s dispositions <strong>de</strong> la loi sur les EIEsLe processus d’autorisation est une partie intégrante du processus <strong>de</strong> mise enœuvre du droit <strong>de</strong> l’environnement.29
La Stratégie nationale en matière d’EIEs peut être approchée selon le tableausuivant :Axe stratégiqueORIENTATION STRATEGIQUEObjectifsVeille réglementaireOpérationnalisation <strong>de</strong>scommissions nationales etrégionales dans le respect <strong>de</strong>sprincipes <strong>de</strong> la loi 13/03 sur lesEIEsRéalisation <strong>de</strong>s programmes <strong>de</strong>scommissions nationale et régionaleSuivi Evaluation1Mise en œuvre <strong>de</strong> la loi sur les EIEsActions stratégiquesTextes d'applicationTexte juridique fixant les attributions et conditions <strong>de</strong> l'exerciceRedéfinir les structures régionales (Rôles et attributions : IRATEs….)Mise en place <strong>de</strong> la procédureInformation <strong>de</strong>s parties prenantes (Large campagne <strong>de</strong> communication:Autorités, CRIs; promoteurs, Institutionnels )Elaboration <strong>de</strong>s programmes en concertation avec les Autorités locales et CRIsRéalisation <strong>de</strong>s programmesEvaluation <strong>de</strong>s activités et élaboration <strong>de</strong>s rapportsMoyensIndicateursBudgets;RHs; Comité <strong>de</strong> suiviRapports <strong>de</strong>s commissions;Rapports annuelsTableau 9: Stratégie <strong>de</strong> contrôle dans le domaine <strong>de</strong>s EIEs3.6.8. Renforcement <strong>de</strong>s Actions d’inspection prioritaires:Certaines actions phares initiées par le département <strong>de</strong> l’environnement, et/oupourront servir <strong>de</strong> catalyseur et <strong>de</strong> support <strong>de</strong> communication <strong>de</strong> l’activité <strong>de</strong>contrôle ; Citons à ce propos :a) Inspection <strong>de</strong>s unités industrielles ayant bénéficie du FODEPCrée antérieurement à la promulgation <strong>de</strong>s lois environnementales, le FODEPayant pour référentiel juridique les projets <strong>de</strong> normes <strong>de</strong> rejets tels qu’ils ont étéproposés initialement au niveau <strong>de</strong> ces mêmes lois alors qu’elles n’étaient qu’austa<strong>de</strong> projet. Aujourd’hui la situation est différente, <strong>de</strong>s textes d’application et<strong>de</strong>s normes <strong>de</strong> qualité et <strong>de</strong> rejets en cours voire promulgués.Actuellement, la gestion technique du FODEP étant assurée par le département<strong>de</strong> l’environnement qui s’articule autour <strong>de</strong> l’évaluation <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s techniques<strong>de</strong>s projets <strong>de</strong> dépollution, la fixation <strong>de</strong>s montants éligibles, la notification <strong>de</strong>l’accord <strong>de</strong> financement et enfin le suivi et l’évaluation <strong>de</strong> la réalisation <strong>de</strong>sprojets.S’agissant du <strong>de</strong>rnier axe, et en vue d’une évaluation <strong>de</strong> la conformité au cahier<strong>de</strong>s charges qui fixe les mesures à prendre et l’engagement du respect <strong>de</strong>s projet<strong>de</strong> normes <strong>de</strong> rejet, la SNICSE préconise d’élaborer et <strong>de</strong> mettre en œuvre unprogramme pour vérifier cette conformité et l’application <strong>de</strong>s dispositions ducahier <strong>de</strong>s charges.Les résultats probants <strong>de</strong> la campagne <strong>de</strong> contrôle réalisée au cours <strong>de</strong> cetteannée montre que les projets ayant bénéficié du soutien du FODEP <strong>de</strong>vaient être30
concernés par un programme spécifique <strong>de</strong> contrôle vu la particularité du FODEPqui est un outil d’ai<strong>de</strong> à la conformité environnementaleb) Inspection <strong>de</strong>s unités industrielles ayant reçu l’acceptabilitéenvironnementale en vertu <strong>de</strong>s EIEsLe SEEE via le comité national <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s d’impact sur l’environnement dans unepremière étape et le walis via les comités régionaux après promulgation <strong>de</strong>stextes d’application <strong>de</strong> la loi 12-03 relative aux étu<strong>de</strong>s d’impact surl’environnement délivrent l’acceptabilité environnementale <strong>de</strong>s projets assujettis.La SNICSE procé<strong>de</strong>ra à l’établissement <strong>de</strong> programmes d’inspection et contrôlethématiques (huileries, carrières, assainissement, …) en vue d’évaluer laconformité environnementale <strong>de</strong>sdits projets.c) Elaboration d’un programme d’inspection <strong>de</strong>s établissements classés :L’inspection <strong>de</strong>s établissements classés a pour objet <strong>de</strong> vérifier la conformité <strong>de</strong>sprescriptions auxquelles les exploitations sont soumises. Il s’agit en effet d’unemission systématique <strong>de</strong> contrôle au cours du fonctionnement <strong>de</strong> l’établissement.Elle a pour objet <strong>de</strong> procé<strong>de</strong>r périodiquement à <strong>de</strong>s contrôles inopinés pours’assurer du bon fonctionnement <strong>de</strong> l’établissement sur <strong>de</strong>s aspects relatifs à lasécurité, l’hygiène et la salubrité publiques.L’inspection <strong>de</strong>s établissements classés est confiée en vertu du dahir du 25 août1914 toujours en vigueur à <strong>de</strong>s agents commissionnés à cet effet par le ministre<strong>de</strong> l’équipement. Les inspecteurs <strong>de</strong>s établissements classés précités exercentleurs fonctions concurremment avec les officiers <strong>de</strong> police judiciaire. Cependant,le contrôle <strong>de</strong> l’application <strong>de</strong>s prescriptions <strong>de</strong>s arrêtés concernant l’hygiène etla sécurité du personnel employé dans ces établissements relève exclusivement<strong>de</strong> la compétence <strong>de</strong>s inspecteurs du travail.D’autres corps d’inspecteurs interviennent indirectement dans le contrôle <strong>de</strong>sétablissements classés, dont notamment les agents du domaine publichydraulique. Ces <strong>de</strong>rniers veillent en effet au respect <strong>de</strong> l’interdiction <strong>de</strong>s rejetsdans les cours d’eau <strong>de</strong> matières nuisibles à l’hygiène publique et àl’alimentation <strong>de</strong>s animaux.Cependant, le contrôle prévu par ce texte n’existe pas en réalité et les aspectsenvironnementaux ne sont que partiellement considérés. Aucun rapport n’estpublié ni l’existence d’un corps d’agents chargés <strong>de</strong> cette mission n’est i<strong>de</strong>ntifiée.Pour pallier à cette situation et en attendant la refonte du cadre législatif etréglementaire relatif aux établissements classés la SNICSE préconise dans lecadre <strong>de</strong> la coopération avec le ministère <strong>de</strong> l ‘équipement et les autorités localesl’élaboration d’un programme d’inspection et <strong>de</strong> contrôle en vue d’inspecterl’ensemble du parc industriel national.Ce programme qui se déroulera sur 3 ans (2008-2009-2010) aura pour objetprincipal <strong>de</strong> dresser un inventaire du <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> conformité <strong>de</strong>s unités industrielles<strong>de</strong> première et <strong>de</strong> <strong>de</strong>uxième catégorie en activité.31
4. CHAPITRE 4 : LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT DE LASTRATEGIE DU SICSE4.1. Développement <strong>de</strong>s ressources humaines :L’analyse <strong>de</strong>s besoins en ressources humaines concernant l’inspection a montréla nécessité <strong>de</strong> procé<strong>de</strong>r au recrutement d’agents assermentés pour renforcerl’équipe actuelle <strong>de</strong> la DRC, avec un programme <strong>de</strong> formation (Certifiante) . Lesbesoins en région pourront être i<strong>de</strong>ntifiés en fonction <strong>de</strong>s réaménagements <strong>de</strong>sstructures régionales fonction <strong>de</strong> la configuration du gouvernement actuel (Rôle<strong>de</strong>s IRATES ; Etc) .De même l’activité surveillance <strong>de</strong>vra bénéficier <strong>de</strong> moyens humains appropriésdans les domaines d’intervention (Laboratoire, Réseaux et métiers supports)La stratégie RHs <strong>de</strong>vra mettre en place un système <strong>de</strong> promotion <strong>de</strong>scompétences basé en particulier sur la mise en valeur <strong>de</strong>s cadres à fort potentielLe Développement <strong>de</strong> la stratégie au niveau <strong>de</strong>s ressources humaines est donnédans le tableau ci après :Axe stratégique 1 Mise en place <strong>de</strong>s RHs nécessaires QUIORIENTATION STRATEGIQUE Satisfaction optimale <strong>de</strong>s besoins RHsOBJECTIFSActions stratégiquesDéfinition <strong>de</strong>s besoins RHsDSPRSurveillanceElaboration <strong>de</strong>s programmes <strong>de</strong> recrutement, redéploiementDBRHContrôleExpression <strong>de</strong>s besoins en formation (à traiter dans l'axe formation)Définition <strong>de</strong>s besoins RHsSupervision <strong>de</strong> la formation <strong>de</strong>s Inspecteurs (Responsabilité <strong>de</strong> lacertification au sein <strong>de</strong> la DRC)Pilotage <strong>de</strong> la politique RHs dans le cadre <strong>de</strong> la décentralisation(Recrutements et profils, formation et déploiement)DSPRDRCDRCExécution <strong>de</strong>s programmesRHsSuivi EvaluationRéalisation <strong>de</strong>s actions <strong>de</strong> Recrutement déploiement en central etrégionsEvaluation <strong>de</strong>s programmes RHs (Exécution <strong>de</strong>s lois cadre) s activitésselon indicateurs élaborées par la structure responsable <strong>de</strong>s RHs ausein du départementMoyens IndicateursBudgets;RHs; Comité <strong>de</strong> suivi Loi cadre, taux <strong>de</strong> satisfaction <strong>de</strong>s besoinsTableau 10: Stratégie <strong>de</strong> Mise en place <strong>de</strong>s RHs du SICSEDBRHDBRHLa formation dans le cadre <strong>de</strong> la stratégie nationale <strong>de</strong>vra être réalisée enarticulation avec les objectifs, fonction <strong>de</strong>s besoins <strong>de</strong>s utilisateurs internes etpilotée selon un plan <strong>de</strong> formation intégré et réalisableLe Développement <strong>de</strong> la stratégie au niveau <strong>de</strong> la formation est donné dans letableau ci après :32
Axe stratégiqueORIENTATION STRATEGIQUEOBJECTIFSElaboration du plan <strong>de</strong> formation dSICSE1 FORMATIONSatisfaction optimale <strong>de</strong>s besoins en formationActions stratégiquesDéfinition <strong>de</strong>s besoins en formation <strong>de</strong>s services du Département dans le domaine SICSEElaboration <strong>de</strong>s programmes en fonction <strong>de</strong>s prioritésElaboration du plan <strong>de</strong> formation intégré par la DBRHMise en œuvre du plan <strong>de</strong> formationResponsabilisation d'une structure i<strong>de</strong>ntifiéeMise en place <strong>de</strong>s moyens <strong>de</strong> formationRéalisation <strong>de</strong>s programmes <strong>de</strong> formation certifiantes (Inspecteurs, LNE….)Réalisation <strong>de</strong>s actions <strong>de</strong> formation prévues dans le programme, y compris séminaires etformation actions associant d'autres partenairesI<strong>de</strong>ntification et prise en charge <strong>de</strong>s cadres à fort potentielSuivi EvaluationEvaluation <strong>de</strong>s activités selon indicateurs élaborées par la structure responsable <strong>de</strong> laformationMoyens IndicateursTaux <strong>de</strong> réalisation <strong>de</strong>s actions <strong>de</strong> formation, Rapports d'évaluation <strong>de</strong>s sessions <strong>de</strong>Budgets; RHs; Comité <strong>de</strong> suiviformation, Rapports annuelsTableau 11: Stratégie <strong>de</strong> formation du SICSE4.2. Développement <strong>de</strong>s capacités <strong>de</strong>s partenaires du SICSE :Le renforcement <strong>de</strong>s capacités prévu par la SNICSE n’est pas limitéexclusivement aux cadres du département <strong>de</strong> l’environnement ; d’autres actionssont prévues dans ce cadre dont on peut citer :.• Accompagnement <strong>de</strong>s partenaires Justice (les prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong>s tribunauxcours les magistrats ISM) , GR, Police <strong>de</strong> l’Eau• Une attention particulière <strong>de</strong>vrait être donnée au corps <strong>de</strong> lamagistrature notamment les prési<strong>de</strong>nts <strong>de</strong>s tribunaux <strong>de</strong> premièreinstance et <strong>de</strong>s cours d’appel. Les activités enclenchées grâce à l’effort<strong>de</strong> rapprochement initié par la DRC dans le cadre du réseau NECEMA apermis <strong>de</strong> sensibiliser les prési<strong>de</strong>nts <strong>de</strong>s tribunaux aux loisenvironnementales. A travers l’Institut Supérieur <strong>de</strong> la Magistrature, lesfutures juges auront l’occasion <strong>de</strong> se familiariser avec les textesjuridique en matière d’environnement. A ce titre une session <strong>de</strong>formation est à assurer par les juristes et les contrôleurs assermentésainsi que les techniciens du SEEE régulièrement une fois par an.• La GR, la sûreté nationale, ayant déjà bénéficié notamment au niveaucentral <strong>de</strong> session <strong>de</strong> formation en ce qui concerne les procédés <strong>de</strong>contrôler les rejets <strong>de</strong>s gaz d’échappement <strong>de</strong>s véhicules, al SNCISEprévoit <strong>de</strong>s sessions <strong>de</strong> formation en matière <strong>de</strong> droit <strong>de</strong>l’environnement et <strong>de</strong>s techniques <strong>de</strong> réaliser une enquête etinvestigation e matière <strong>de</strong> pollution.33
• Contribution au renforcement <strong>de</strong>s capacités <strong>de</strong> l’ingénierie nationaledans les domaines d’activité et favoriser le développement du marché<strong>de</strong> l’expertise environnementaleLa justice constitue un chantier privilégié dans le cadre <strong>de</strong> cette stratégie, LeDéveloppement <strong>de</strong> la stratégie concernant cet aspect est donné dans le tableauci après :Axe stratégique 1ORIENTATION STRATEGIQUEOBJECTIFSMettre en place d'un programme <strong>de</strong>travail avec le ministère <strong>de</strong> la justiceRéalisation <strong>de</strong> programmes <strong>de</strong>formationRenforcement <strong>de</strong>s capacités <strong>de</strong> la justice dans le domaine <strong>de</strong>l'environnementMise à niveau du système judiciaireActions stratégiquesElaboration du programme et validation dans le cadre d'un protocole d'entente entre les <strong>de</strong>uxministresMise en œuvre du programme dans un cadre <strong>de</strong> projet (Financement àmettre en place)Intégration <strong>de</strong> l'environnement dans le cadre du cursus <strong>de</strong> formation <strong>de</strong>l'institut supérieur <strong>de</strong> la magistratureFormation <strong>de</strong>s juges et procureurs en exercice au droit <strong>de</strong> l'environnementCollaboration permanente avec lesinstances du Ministère <strong>de</strong> la justiceAssocier la Cour suprême a toutes les réflexions sur la mise en œuvre dudroit <strong>de</strong> l'environnement (Réferentiel)Elaboration du livre blanc sur le droit <strong>de</strong> l’environnementAssocier les tribunaux aux activités régionales <strong>de</strong> communication et <strong>de</strong> vulgarisationenvironnementaleMoyens IndicateursBudgets;RHs; Comité <strong>de</strong> suivi; structure Bilan <strong>de</strong>s réalisations pour les actions arrêtées ;Rapports thématiquesprojetTableau 12: Stratégie d'Appui au dispositif judiciaireTableau 13: Stratégie <strong>de</strong> formation du SICSE4.3. Mise en place <strong>de</strong>s moyens Financiers :La mise en œuvre <strong>de</strong> la stratégie nécessite une planification Ex anté <strong>de</strong> moyensfinanciers importants, en adéquation avec les ambitions du système cible. La nondisponibilité <strong>de</strong>s ressources financières constitue un facteur limitant et un risquemajeur pour la mise en œuvre du plan d’opération qui sera dégagé. Ainsi uneattention particulière <strong>de</strong>vra être accordée à la mobilisation <strong>de</strong>s ressourcesfinancières, mais aussi à la rationnalité et à l’efficience dans leur gestion.Le Développement <strong>de</strong> la stratégie au niveau <strong>de</strong> la formation est donné dans letableau ci après :Axe stratégique 1 Mise en place <strong>de</strong>s Moyens financiers QUIORIENTATION STRATEGIQUESatisfaire les besoins budgétaires34
ObjectifsActions stratégiquesDéfinition du budget <strong>de</strong> l'activité surveillance dans le cadre <strong>de</strong>s plans validés DSPRSurveillanceExécution <strong>de</strong>s budgets allouésDBRHReporting Comptable et budgétaire (tableaux <strong>de</strong> bord)DSPRDéfinition du budget <strong>de</strong> l'activité contrôleDRCContrôleExécution <strong>de</strong>s budgets allouésDRCReporting Comptable et budgétaire (tableaux <strong>de</strong> bord)DRCPilotage <strong>de</strong> l'élaboration du budget SICSE (Interne, Externe MF)DBRHPilotage <strong>de</strong> l'activitéOctroi <strong>de</strong>s budgets aux entités (surveillance, contrôle et support)DBRHSupervision <strong>de</strong> l'exécutionDBRHSuivi Evaluation Suivi budgétaire et tableaux <strong>de</strong> bord financiers DBRHMoyens IndicateursBudgets;RHs; Comité <strong>de</strong> suiviTaux <strong>de</strong> réalisation, Rapports financiers, tableaux <strong>de</strong> bordTableau 14: Développement <strong>de</strong> l'Axe financier e la SNICE4.4. Communication :Nous restons persuadés que le recours à l'information, à 1'éducation et àd'autres moyens est un outil efficace pour promouvoir et garantir l'observation<strong>de</strong> la loi. C’est pourquoi le SEEE doit prendre les mesures présentées dans cechapitre pour sensibiliser la population et favoriser l'échange <strong>de</strong> l'information.En outre, les fonctionnaires du Ministère rencontreront au besoin lesreprésentants d'autres ministères et organismes , provinciaux, territoriaux etautochtones, <strong>de</strong> l'industrie, <strong>de</strong> la société civile et d'autres parties intéressées,pour échanger <strong>de</strong> l'information et s'entretenir <strong>de</strong>s préoccupations concernant leslois environnementales et leur application.La stratégie <strong>de</strong> communication vise:Promouvoir l’engagement <strong>de</strong> tous les intervenants pour assurer leurcontribution dans le cadre du SCISEFournir à tous les partenaires, et au public en général, toute l’informationnécessaire à la promotion <strong>de</strong> la stratégie SICSERecueillir toute l’information permettant l’écoute et le suivi <strong>de</strong>s besoins etattentes <strong>de</strong>s groupes cibles, l’analyser et y donner suiteFavoriser le développement d’une image positive du SICSE et dudépartement <strong>de</strong> l’environnement en généralAssurer la cohérence et la cohésion <strong>de</strong> l’ensemble <strong>de</strong>s activités <strong>de</strong>communicationRenforcer l’adhésion du personnel aux objectifs <strong>de</strong> la stratégie nationaled’ICSELe développement <strong>de</strong> l’ensemble <strong>de</strong>s actions <strong>de</strong> la stratégie <strong>de</strong> communicationest récapitulé dans le tableau ci après :35
Axe stratégique 1 COMMUNICATION QUIORIENTATION STRATEGIQUEObjectifsElaboration <strong>de</strong> la STRATEGIE DECOMMUNICATIONActions stratégiquesMettre en place un plan <strong>de</strong> communication pluriannuel validé au plus haut niveau dudépartement <strong>de</strong> l'environnement comportant:Meise à niveau <strong>de</strong> la structure chargée <strong>de</strong> la communication pour la mise en œuvredu planMise en place <strong>de</strong>s budgets nécessairesDPCCDPCCCommunication avec les partenairesConduite du changementMettre en œuvre les actions <strong>de</strong> communication auprès <strong>de</strong>s partenaires institutionnelstant au niveau <strong>de</strong> la surveillance que le contrôle(Réunions, conférences; site web…)Réaliser <strong>de</strong>s actions <strong>de</strong> promotion <strong>de</strong> l'auto surveillanceAssurer une présence permanente dans les forums d'intérêt i<strong>de</strong>ntifiés par le plan <strong>de</strong>communicationRéaliser <strong>de</strong>s campagnes <strong>de</strong> sensibilisation Grand publicContribuer aux actions <strong>de</strong> lea<strong>de</strong>rshipe et communication interne permettant lapromotion du SICSE (Réunions internes; Intranet, Sponsorship,,,)DSPR/DRCSuivi EvaluationEvaluer les impacts et l'efficacité <strong>de</strong>s actions réalisées <strong>de</strong> facon périodique (annuelle)Budgets; RHs; Comité <strong>de</strong> pilotageMoyensIndicateursPlan <strong>de</strong> communication validé; Indicateurs <strong>de</strong> réalisation <strong>de</strong>s actions; EnquêtespériodiquesTableau 15: Stratégie <strong>de</strong> Communication et d'Accompagnement du SICSE4.5. Coopération :Ouverture du Système sur les autres systèmes maghrébins en l’occurrence(opportunités NECEMA, Impel, INECE )Depuis 2005, le SEEE à l’occasion <strong>de</strong> la tenue <strong>de</strong> la 7ème conférenceinternationale d’INECE a pris l’initiative <strong>de</strong> la création du réseau maghrébin surl’application et le respect <strong>de</strong>s lois environnementales NECEMA. Ledit réseau qui apour objet <strong>de</strong> promouvoir l’application <strong>de</strong>s lois environnementales au niveau <strong>de</strong>la région du Maghreb, a pu développer une dynamique régionale entre les pays.L’organisation d’une conférence régionale sur le rôle <strong>de</strong>s collectivités locales dansl’application <strong>de</strong>s lois environnementales ainsi que le thème consacré par sespremières assises sur la comparaison <strong>de</strong>s systèmes d’inspection et <strong>de</strong> contrôle <strong>de</strong>l’environnement ne peuvent que contribuer à la promotion <strong>de</strong> la conformitéenvironnementale.Le Développement <strong>de</strong> la stratégie au niveau <strong>de</strong> la formation est donné dans letableau ci après :Axe stratégiqueORIENTATION STRATEGIQUEObjectifs1 COOPERATIONActions stratégiques36
Partage et concertationAccroitre le rôle joué dans le cadre <strong>de</strong>s réseaux internationaux <strong>de</strong>la mise en œuvre du droit <strong>de</strong> l'environnement NECEMA IMPELINECEContribuer aux programmes régionaux et internationaux <strong>de</strong>protection <strong>de</strong> l'environnementBAILLEURS DE FONDS ETCOOPERATIONTECHNIQUERéalisation <strong>de</strong>sprogrammes <strong>de</strong>scommissions nationale etrégionaleSuivi EvaluationTraduire les composantes <strong>de</strong> la stratégie en lots <strong>de</strong> projetscohérents et faire appel a leur financementTrouver <strong>de</strong>s passerelles et <strong>de</strong>s opportunités sur les projets encours (PGPE, Protection <strong>de</strong>s ressources en eau)Promouvoir les actions <strong>de</strong> coopération technique et <strong>de</strong> transfert<strong>de</strong>s compétences (Ex EPA) et en faire <strong>de</strong>s leviers <strong>de</strong> coopérationElaboration <strong>de</strong>s programmes en concertation avec les Autoritéslocales et CRIsRéalisation <strong>de</strong>s programmesEvaluation <strong>de</strong>s activités et élaboration du rapportsMoyens IndicateursBudgets; RHs; Comité <strong>de</strong> suiviNombre et qualité <strong>de</strong>s conventions et contrats ;Taux <strong>de</strong> réalisation<strong>de</strong>s actions <strong>de</strong> coopération, Financements mobilisés,Tableau 16: Développement <strong>de</strong> l'Axe Coopération dans le cadre <strong>de</strong> la SNICSE4.6. Le système d’information globalL’évolution naturelle du mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> management du département <strong>de</strong>l’environnement va irrémédiablement vers l’adoption <strong>de</strong>s nouvelles technologies<strong>de</strong> l’information et <strong>de</strong> la communication. Le travail qui sera réalisé surl’observatoire <strong>de</strong> l’environnement (Surveillance) aura <strong>de</strong>s retombées positivessur les mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> gestion et l’on s’acheminera automatiquement vers un systèmed’information global du département qui intégrera les autres métiers(Planification, Support, Finances …..).4.7. LE SUIVI EVALUATION DE LA STRATEGIE :Un système <strong>de</strong> suivi/évaluation doit être mis en place pour suivre et évaluer leprocessus et le contenu <strong>de</strong> la stratégie, et rendre compte <strong>de</strong> l’état <strong>de</strong> mise enœuvredu plan/programme d’actions et du <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> réalisation <strong>de</strong>s objectifs <strong>de</strong> lastratégie nationale du contrôle et surveillance <strong>de</strong> l’environnement.Le suivi/évaluation doit en fait traiter les quatre points suivants :o La qualité <strong>de</strong> la participation et la prise en compte <strong>de</strong>s préoccupations <strong>de</strong>sparties prenantes ;o La qualité <strong>de</strong> la communication entre les parties prenantes (modalités,o fréquence et efficacité <strong>de</strong> la communication) ;o L’état <strong>de</strong> mise en œuvre <strong>de</strong>s actions envisagées ;o L’efficacité et la pertinence <strong>de</strong>s objectifs opérationnels.o Ce suivi/évaluation doit donner lieu à la production <strong>de</strong> rapportspériodiques annuels qui feront l’objet d’une large diffusion auprès <strong>de</strong>sacteurs concernés et du grand public.On peut considérer plusieurs types d’évaluation :37
L’évaluation interne, réalisée par la Direction <strong>de</strong> la Réglementation et duContrôle responsable <strong>de</strong> l’élaboration et <strong>de</strong> la mise en œuvre du SNICSE. Utilepoursuivre les progrès réalisés en regard <strong>de</strong>s objectifs opérationnels et <strong>de</strong>sindicateurs<strong>de</strong> performance. Sujette à la critique, puisque l’évaluateur est à la fois juge etpartie.L’évaluation externe, confiée à un organisme indépendant, non engagé dans leprocessus d’élaboration et <strong>de</strong> mise en œuvre du SNICSE permet d’évaluer lesrésultats sans complaisance.L’i<strong>de</strong>ntification et le suivi d’indicateurs, réalisés par le ministère <strong>de</strong>l’environnement et les organismes publics concernés par la mise en œuvre duSNICSE. DesIndicateurs <strong>de</strong> performance i<strong>de</strong>ntifiés pour chacune <strong>de</strong>s actions et chacun <strong>de</strong>sobjectifs <strong>de</strong> la SNICSE permettent d’évaluer le niveau d’avancement <strong>de</strong> la miseen œuvre du plan d’action et l’atteinte <strong>de</strong>s objectifs opérationnels. DesIndicateurs globaux <strong>de</strong> contrôle et surveillance environnemental doiventégalement être i<strong>de</strong>ntifiés à l’échelle nationale pour mesurer périodiquement lesprogrès en la matière.Ces différentes formes d’évaluation forment ensemble la base d’une nouvelleévaluation <strong>de</strong> la situation qui servira <strong>de</strong> référence au prochain cycle <strong>de</strong>planification.Dans le cadre <strong>de</strong>s références du prochain cycle, il est recommandé <strong>de</strong> procé<strong>de</strong>régalement à une actualisation <strong>de</strong>s travaux <strong>de</strong> prospective en fonction <strong>de</strong>snouvellesdonnées et analyses disponibles.Ce suivi/évaluation valorise l’apprentissage collectif que permet la SNICSE. Ilcontribue à l’amélioration <strong>de</strong>s actions en permettant une meilleure adéquation<strong>de</strong>s moyens aux objectifs, mais il change aussi le regard et la vision que lesacteursse font <strong>de</strong> la situation. C’est pourquoi il importe, dans le but <strong>de</strong> progresser, <strong>de</strong>faire part <strong>de</strong> ses succès et d’i<strong>de</strong>ntifier les difficultés éprouvées.L'évaluation <strong>de</strong>vra intervenir à trois étapes différentes du projet <strong>de</strong> mise enœuvre <strong>de</strong> la SNICSE:- L'évaluation ex-ante intervient dès la phase <strong>de</strong> conception <strong>de</strong> la SNICSE, avantsa mise en œuvre. Elle permet d'anticiper les effets prévisibles <strong>de</strong> la politique et<strong>de</strong> la corriger par <strong>de</strong>s dispositions organisationnelles voire par <strong>de</strong>scompensations. Dès cette étape, sans qu'il soit besoin d'attendre les résultats,peuvent être étudiées l’adéquation entre les besoins et les objectifs, c'est-à-direla pertinence du programme, ainsi que sa cohérence interne et externe. Cetteévaluation <strong>de</strong>vra être réalisée au moment du démarrage du projet <strong>de</strong> mise enœuvre <strong>de</strong> la SNICSE;- L'évaluation à mi-parcours qui permet d'apprécier les premières réalisationsphysiques du programme et l'utilisation <strong>de</strong>s ressources financières.- Enfin L'évaluation ex- post menée au terme <strong>de</strong> l'application <strong>de</strong> la SNICSE,permettra <strong>de</strong> mesurer son effet dans toutes ses dimensions. Elle pourraéventuellement servir à en corriger les inci<strong>de</strong>nces négatives non prévues. Cetteévaluation ex-post aura également pour objet <strong>de</strong> rendre compte <strong>de</strong> l'efficacité(adéquation entre objectifs et résultat) et <strong>de</strong> l'efficience du programme (résultatramené au coût du programme) ou encore <strong>de</strong> son utilité (adéquation <strong>de</strong>srésultats aux besoins).38
5. CONCLUSIONLe présent rapport représente l’aboutissement d’un long processus <strong>de</strong>réflexion qui met en place, pour la première fois au Maroc, lesfon<strong>de</strong>ments du système d’Inspection <strong>de</strong> contrôle et <strong>de</strong> surveillanceenvironnementale. Ce processus, est le résultat d’un engagement profond<strong>de</strong> la part du département <strong>de</strong> l’environnement, avec l’appui <strong>de</strong> la GTZ, etd’une participation active <strong>de</strong>s membres du comité <strong>de</strong> pilotage et <strong>de</strong>sdifférents acteurs et partenaires.La présente étu<strong>de</strong>, étape importante dans cette stratégie, constitue unpoint <strong>de</strong> départ et ne représente pas une fin en soi ; L’accélération duprocessus d’appropriation <strong>de</strong> la SNICSE, véritable projet d’entreprise, estune véritable dynamique participative à enclencher et qui <strong>de</strong>vraimpérativement bénéficier du support et <strong>de</strong> l’engagement du département<strong>de</strong> l’environnement au plus haut niveau. La stratégie nationale d’ICSEainsi validée <strong>de</strong>vient un élément incontournable dans la stratégie dudépartement, et <strong>de</strong>vra être prise en considération dans toute planificationet programme <strong>de</strong> celui-ci pour permettre la mutualisation <strong>de</strong>s efforts etl’intégration <strong>de</strong>s objectifs. Un mécanisme <strong>de</strong> veille <strong>de</strong>vra etre prévu dansle cadre du PROJET DE MISE EN ŒUVRE DU SICSELa conjoncture, très favorable, à plusieurs égards, permet d’appréhen<strong>de</strong>rfavorablement le projet <strong>de</strong> mise en œuvre <strong>de</strong> la stratégie nationale ;Cette mise en œuvre <strong>de</strong>vra être conduite, à notre sens dans le cadred’une approche programme, permettant <strong>de</strong> mettre en place uneplanification adaptée, <strong>de</strong>s structures et <strong>de</strong>s moyens dédiés, <strong>de</strong>sopportunités <strong>de</strong> financement avantageuses, et une gestion personnalisée.Ainsi, il est recommandé, <strong>de</strong> mettre en place un programme global issu <strong>de</strong>la stratégie nationale, qui répartit les activités en lots homogènes etintégrés, pour permettre <strong>de</strong> bénéficier l’ensemble <strong>de</strong>s opportunités <strong>de</strong>financement, et <strong>de</strong> mettre à contribution, éventuellement, <strong>de</strong>s lignes <strong>de</strong>crédit et programmes en cours ; pour la réalisation <strong>de</strong>s actions prioritaires39
ANNEXES40
Références bibliographiques1. Dahir n° 1- 95-154 du 10 août 1995 relatif à la loi n° 10-95 sur l'eau2. Dahir du 25 août 1914 portant réglementation <strong>de</strong>s établissements insalubres,incommo<strong>de</strong>s ou dangereux, B.O. n° 97, 7 septembre 1914, pp. 703-704, modifié parle Dahir du 13 octobre 1933, B.O. n" 1101 du 1 er décembre 1933, pp. 1187-1190.3. Dahir du 13 juillet 1926, modifie le 2 juillet 1947 portant réglementation du travaildans les établissements industriels, B.O., 11 octobre 1947.4. Dahir n° 1-95-154 du 10 août 1995 relatif à la loi n° 10-95 sur l'eau. Bulletin officieln° 4325 du 20 septembre 19955. Dahir n° 1-06-153 du 30 Chaoual 1427 (22 novembre 2006) portant promulgation <strong>de</strong> la loin° 28-00 relative à la gestion <strong>de</strong>s déchets et à leur élimination.(B.O. n° 5480 du Jeudi 7 Décembre 2006)6. Décret n°2-04-553 du 24 janvier 2005 relatif aux déversements, écoulements, rejets,dépôts directs ou indirects dans les eaux superficielles ou souterraines.7. Décret n° 2-97-414 du 4 février 1998 relatif aux modalités <strong>de</strong> fixation et <strong>de</strong>recouvrement <strong>de</strong> la re<strong>de</strong>vance pour utilisation <strong>de</strong> l’eau du domaine publichydraulique.8. Décret n° 2 - 97 – 487 du 4 février 1998 fixant la procédure d'octroi <strong>de</strong>sautorisations et <strong>de</strong>s concessions relatives au domaine public hydraulique.9. Décret n° 2-97-787 du 4 février 1998 relatif aux normes <strong>de</strong> qualité <strong>de</strong>s eaux et àl’inventaire du <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> pollution <strong>de</strong>s eaux.10. A.Epiney " Lignes directrices pour système efficace sur la base <strong>de</strong>s exigences dudroit <strong>de</strong> l’Union européenne et <strong>de</strong>s expériences internationales Novembre 2007"11. AXEL KLAPHAKE/DENIS KALISCH, Etu<strong>de</strong> sur le système d’inspection, <strong>de</strong>contrôle et <strong>de</strong> surveillance <strong>de</strong>l’environnement au Marco. Expériences internationaleset implications pour le Maroc, juin 200712. Loi n° 12-03 relative aux étu<strong>de</strong>s d'impact sur l'environnement (B.O., n° 5118, du 19-06-03, pp. 507-510)13. Loi n° 13-03 relative à la lutte contre la pollution <strong>de</strong> l'air(B.O., n° 5118, du 19-06-03, pp. 511-514)14. Loi n° 11-03 relative à la protection et à la mise en valeur <strong>de</strong> l'environnement (B.O.,n° 5118, du 19-06-03, pp. 500-507)15. Directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à laréduction intégrées <strong>de</strong> la pollution. Journal officiel n" L 257 du 10/10/1996 p. 0026– 004016. Etat <strong>de</strong> la qualité <strong>de</strong>s Ressources en eau au Maroc , Année 1995-1996 DRPE, Avril2003.17. Mekouar M.A. : Etu<strong>de</strong>s en Droit <strong>de</strong> l’Environnement, Editions OKAD, 198718. Rapport sur la mission d’accompagnement <strong>de</strong> la Direction <strong>de</strong> la Recherche et <strong>de</strong>Planification <strong>de</strong> l’Eau. ( <strong>MAROC</strong>) ; DRPE-GTZ ; Novembre 200619. OSBERHAUS et ELHAIBA : Evaluation du système <strong>de</strong> contrôle <strong>de</strong> l’état <strong>de</strong>l’environnement dans la ville <strong>de</strong> Mohammedia ; GTZ Octobre 2003 ;41
20. Rapport <strong>de</strong> l’atelier <strong>de</strong> sensibilisation et <strong>de</strong> préparation ( Fès, le 14 février 2006)PNUE-PAM-PAP-MATEE-PAC.<strong>MAROC</strong>21. Rapport Débat National sur l’eau, ABH Bou Regreg, Novembre 2006.22. Durand, F. ; Gaumand, C. ; Verrel, J.L : Propositions pour la constitution d'unlaboratoire <strong>de</strong> référence dans le domaine <strong>de</strong> l'eau et <strong>de</strong>s milieux aquatiques N°IGE/05/070 ,20 Juillet 2006, Ministère <strong>de</strong> l’écologie et développement durable.23. Gui<strong>de</strong> <strong>de</strong> planification <strong>de</strong> la prévention <strong>de</strong> la pollution. Edition d’EnvironnementCanada, 2001.24. SEE Novembre 2003 : Etat <strong>de</strong> la qualité <strong>de</strong>s ressources en eau au Maroc Année2000-200125. Projet REME, GTZ Juin 2006Mise à niveau environnementale au Maroc, Etat <strong>de</strong>slieux et opportunités26. Ministére <strong>de</strong> la Santé Service salubrité <strong>de</strong> l’environnement : Gui<strong>de</strong> sur les aspectssanitaires dans les étu<strong>de</strong>s d’impact sur l’environnement <strong>de</strong>s projets <strong>de</strong>développement, 2005.27. MEP-MATEE Surveillance <strong>de</strong> la qualité <strong>de</strong>s eaux <strong>de</strong> baigna<strong>de</strong> Rapport nationalSaison 2005-200628. Recommandation du Parlement Européen et du Conseil du 4 avril 2001 prévoyant<strong>de</strong>s critères minimaux applicables aux inspections environnementales dans les Etatsmembres. Directive Européen (331/2001/CE).29. Environmental Justice Fact Sheet, National Environmental Justice AdvisoryCouncil. United States Environmental Protection Agency. Enforcement andCompliance ( 2201 A). Septembre 2006.30. OECD Environmental Indicators : Development, Measurement, and Use ( 2003)31. Environmental Justice in The Permitting Process: A Report from the public meetingon environmental permitting convened by the National Environmental JusticeAdvisory Council, Arlington, Virginia November 30 – December 2, 199932. Regulations : A vital tool for protecting public health and the environment.Environmental Protection Agency, EPA100F-03-001, July 200333. Diagnostic et Proposition d’Action en Matière <strong>de</strong> Gestion <strong>de</strong>s Bases <strong>de</strong> Données et<strong>de</strong>s Systèmes d’Information Géographique sur l’Environnement, ONEM , MATEEJuin 2004 .34. Plan National <strong>de</strong> Mise en œuvre <strong>de</strong> la convention <strong>de</strong> Stockholm sur les polluantsorganiques persistants ( POP), MATEE, PNUD, Mai 200635. Evaluation du bilan <strong>de</strong>s réalisations dans le domaine <strong>de</strong> l’Environnement et duDéveloppement durable du Maroc, MATEE, 200442
Liste Des abréviationsABHAgences <strong>de</strong> Bassin HydrauliqueANPEAgence <strong>Nationale</strong> <strong>de</strong> Protection <strong>de</strong> l’Environnement TunisieCGEMConfédération Générale <strong>de</strong>s Entreprenueurs MarocainsCNEConseil National <strong>de</strong> l’EnvironnementCNEIE Commission nationale <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s d’impactCSECConseil Supérieur <strong>de</strong> l’eau et du ClimatDGMN Direction Générale <strong>de</strong> la Météo nationaleDGSN Direction Générale <strong>de</strong> la Sûreté <strong>Nationale</strong>DRCDirection <strong>de</strong> la Réglementation et du Contrôle (MATEE)DRHDirection régionale <strong>de</strong> l’HydrauliqueDRPEDirection <strong>de</strong> la recherché et <strong>de</strong> la planification <strong>de</strong> l’EauDSPR Direction <strong>de</strong> la Surveillance et <strong>de</strong> la Prévention <strong>de</strong>s Risques(MATEE)EPAEnvironnemental Protection Agency (USA)FMCIFédération marocaine du conseil et <strong>de</strong> l’IngénierieFODEP Fond <strong>de</strong> DépollutionGRGendarmerie RoyaleGTZAgence Alleman<strong>de</strong> <strong>de</strong> Coopération TechniqueHCEFLCD Haut commissariat aux eaux et forets et à la lutte contre la<strong>de</strong>sertificationIMPEL Réseau EuropéenINECE International Network for Environmental Compliance andEnforcementIRATE Inspection régionale <strong>de</strong> l’Aménagement du Territoire et <strong>de</strong>l’EnvironnementKfWAgence Alleman<strong>de</strong> <strong>de</strong> coopération financièreLNELaboratoire <strong>Nationale</strong> <strong>de</strong> l’Environnement (MATEE)LPEELaboratoire Public d’Etu<strong>de</strong>s et d’EssaisMADRPM Ministère <strong>de</strong> l’Agriculture et du développement ruralMEDPOL Réseau méditéranéenMEMMinistère <strong>de</strong> l’Energie et <strong>de</strong>s MinesMETMinistère <strong>de</strong> l’Equipement et du TransportMMEE Ministère <strong>de</strong>s mines, <strong>de</strong> l’eau et <strong>de</strong> l’environnementONEP Office <strong>Nationale</strong> <strong>de</strong> l’Eau PotableONGOrganisation non gouvernementaleORMVA Offices régionaux <strong>de</strong> mise en valeur agricolePANEPGPEProgramme <strong>de</strong> Gestion et <strong>de</strong> Protection <strong>de</strong> l’Environnement(GTZ)PNUEProgramme <strong>de</strong>s nations unies pour l’EnvironnementSEEESecrétariat d’état auprès du ministère <strong>de</strong>s mines, <strong>de</strong> l’eau et <strong>de</strong>l’environnement, chargée <strong>de</strong> l’eau et <strong>de</strong> l’environnement(département <strong>de</strong> l’environnement)SNICE Stratégie nationale d’Inspection, <strong>de</strong> contrôle et <strong>de</strong> surveillance<strong>de</strong> l’environnement43