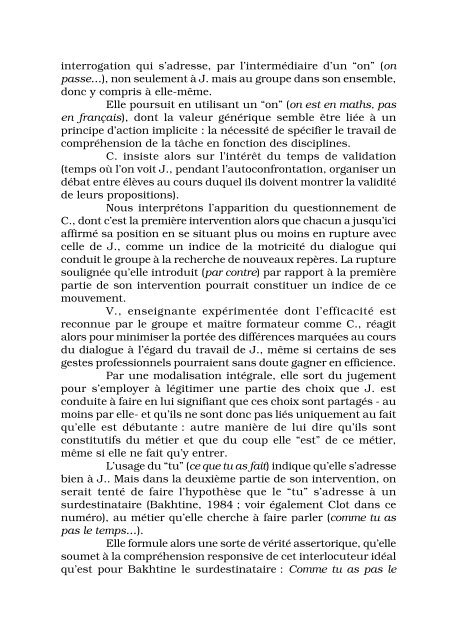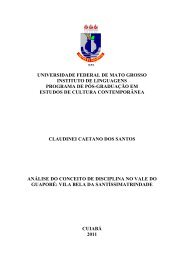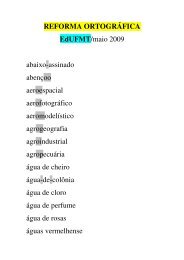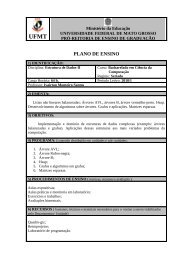spécificités de l'activité d'enseignants débutants et “genres ... - UFMT
spécificités de l'activité d'enseignants débutants et “genres ... - UFMT
spécificités de l'activité d'enseignants débutants et “genres ... - UFMT
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
interrogation qui s’adresse, par l’intermédiaire d’un “on” (onpasse…), non seulement à J. mais au groupe dans son ensemble,donc y compris à elle-même.Elle poursuit en utilisant un “on” (on est en maths, pasen français), dont la valeur générique semble être liée à unprincipe d’action implicite : la nécessité <strong>de</strong> spécifier le travail <strong>de</strong>compréhension <strong>de</strong> la tâche en fonction <strong>de</strong>s disciplines.C. insiste alors sur l’intérêt du temps <strong>de</strong> validation(temps où l’on voit J., pendant l’autoconfrontation, organiser undébat entre élèves au cours duquel ils doivent montrer la validité<strong>de</strong> leurs propositions).Nous interprétons l’apparition du questionnement <strong>de</strong>C., dont c’est la première intervention alors que chacun a jusqu’iciaffirmé sa position en se situant plus ou moins en rupture aveccelle <strong>de</strong> J., comme un indice <strong>de</strong> la motricité du dialogue quiconduit le groupe à la recherche <strong>de</strong> nouveaux repères. La rupturesoulignée qu’elle introduit (par contre) par rapport à la premièrepartie <strong>de</strong> son intervention pourrait constituer un indice <strong>de</strong> cemouvement.V., enseignante expérimentée dont l’efficacité estreconnue par le groupe <strong>et</strong> maître formateur comme C., réagitalors pour minimiser la portée <strong>de</strong>s différences marquées au coursdu dialogue à l’égard du travail <strong>de</strong> J., même si certains <strong>de</strong> sesgestes professionnels pourraient sans doute gagner en efficience.Par une modalisation intégrale, elle sort du jugementpour s’employer à légitimer une partie <strong>de</strong>s choix que J. estconduite à faire en lui signifiant que ces choix sont partagés - aumoins par elle- <strong>et</strong> qu’ils ne sont donc pas liés uniquement au faitqu’elle est débutante : autre manière <strong>de</strong> lui dire qu’ils sontconstitutifs du métier <strong>et</strong> que du coup elle “est” <strong>de</strong> ce métier,même si elle ne fait qu’y entrer.L’usage du “tu” (ce que tu as fait) indique qu’elle s’adressebien à J.. Mais dans la <strong>de</strong>uxième partie <strong>de</strong> son intervention, onserait tenté <strong>de</strong> faire l’hypothèse que le “tu” s’adresse à unsur<strong>de</strong>stinataire (Bakhtine, 1984 ; voir également Clot dans cenuméro), au métier qu’elle cherche à faire parler (comme tu aspas le temps…).Elle formule alors une sorte <strong>de</strong> vérité assertorique, qu’ellesoum<strong>et</strong> à la compréhension responsive <strong>de</strong> c<strong>et</strong> interlocuteur idéalqu’est pour Bakhtine le sur<strong>de</strong>stinataire : Comme tu as pas le