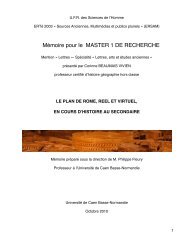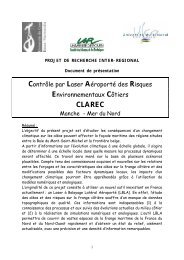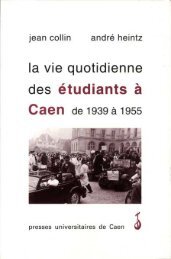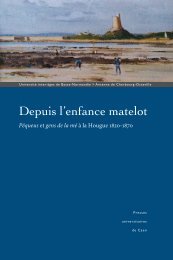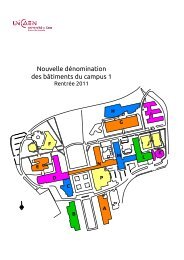« L'ours mal léché » : la reproduction de l'ours dans les sources ...
« L'ours mal léché » : la reproduction de l'ours dans les sources ...
« L'ours mal léché » : la reproduction de l'ours dans les sources ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Schedae, 2009<br />
Prépublication n° 20 Fascicule n° 2<br />
<strong>«</strong> L’ours <strong>mal</strong> <strong>léché</strong> <strong>»</strong> : <strong>la</strong> <strong>reproduction</strong> <strong>de</strong><br />
l’ours <strong>dans</strong> <strong>les</strong> <strong>sources</strong> antiques<br />
Jean Trinquier<br />
École nor<strong>mal</strong>e supérieure – Ulm<br />
Dans sa fable intitulée <strong>«</strong> L’ours et l’amateur <strong>de</strong> jardins <strong>»</strong>, La Fontaine évoque spirituellement<br />
un <strong>«</strong> ours à <strong>de</strong>mi <strong>léché</strong> <strong>»</strong> 1 . Dans le français d’aujourd’hui, on traite d’<strong>«</strong> ours <strong>mal</strong> <strong>léché</strong> <strong>»</strong><br />
un rustre, un personnage au comportement abrupt et grossier. L’expression ne s’est établie<br />
<strong>dans</strong> ce sens qu’au début du XVIII e siècle. Avant cette date, l’expression s’entendait au physique<br />
et se disait soit d’un <strong>«</strong> homme d’aspect grossier <strong>»</strong>, soit d’un <strong>«</strong> enfant <strong>mal</strong> venu <strong>»</strong>. On<br />
disait également, lorsqu’on préparait longuement une affaire, qu’il fal<strong>la</strong>it <strong>«</strong> lécher l’ours <strong>»</strong> 2 .<br />
Ces <strong>de</strong>ux expressions font référence à une croyance ancienne qui veut que l’ourse façonne<br />
ses petits à <strong>la</strong> naissance en <strong>les</strong> léchant avec soin 3 . Cette opinion erronée n’a été définitivement<br />
ba<strong>la</strong>yée qu’à <strong>la</strong> fin du XVIII e siècle, avant <strong>de</strong> poursuivre une existence posthume et<br />
fossilisée <strong>dans</strong> le trésor <strong>de</strong>s expressions popu<strong>la</strong>ires. La réalité qu’elle prétendait décrire<br />
était il est vrai difficilement observable, sauf peut-être en captivité ; vouloir surprendre <strong>les</strong><br />
premiers instants d’oursons nouveau-nés et saisir <strong>les</strong> gestes maternels <strong>de</strong> l’ourse conduit<br />
en effet à déranger au péril <strong>de</strong> sa vie le fauve <strong>dans</strong> sa tanière hivernale. La façon <strong>la</strong> plus<br />
sûre <strong>de</strong> réfuter cette opinion fautive est encore <strong>de</strong> tuer <strong>dans</strong> sa retraite hivernale 4 une<br />
femelle dont <strong>la</strong> gestation est bien avancée et d’examiner <strong>les</strong> fœtus que renferme sa matrice ;<br />
un examen même superficiel révèle alors que <strong>les</strong> oursons ne sont ni informes, ni inarticulés.<br />
1. La Fontaine, Fab<strong>les</strong>, VIII, 10, 1 ; voir aussi XI, 7, 13 (<strong>«</strong> Le paysan du Danube <strong>»</strong>).<br />
2. REY et CHANTREAU 1997, 662. L’expression existe aussi <strong>dans</strong> d’autres <strong>la</strong>ngues européennes : voir PASTOU-<br />
REAU 2007, 296-297.<br />
3. L’histoire <strong>de</strong> cette croyance a été écrite par ELZE 1913, suivi par Peck : ARISTOTE (Peck 1970), 376-377.<br />
4. Sur <strong>la</strong> pratique <strong>de</strong> <strong>la</strong> chasse à <strong>la</strong> tanière hivernale, voir COUTURIER 1954, 645-648. Il est possible qu’une telle<br />
chasse soit représentée à Pompéi <strong>dans</strong> le tablinum (10) <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>«</strong> Maison <strong>de</strong> <strong>la</strong> Chasse antique <strong>»</strong> (VII, 4, 48),<br />
sur une intéressante pré<strong>de</strong>lle, qui met en scène <strong>de</strong>s Amours chasseurs : l’ours bondit hors <strong>de</strong> sa tanière et<br />
se rue vers le premier chasseur, qui s’apprête à recevoir sa charge sur <strong>la</strong> pointe <strong>de</strong> son épieu (PPM, VII,<br />
p. 22, n° 24). Si cette interprétation est exacte, il s’agit <strong>de</strong> <strong>la</strong> seule attestation, pour l’Antiquité, <strong>de</strong> cette<br />
chasse dangereuse qui consiste à repérer l’emp<strong>la</strong>cement <strong>de</strong> <strong>la</strong> tanière où l’ours hiberne avant <strong>de</strong> l’en<br />
débusquer. Une telle chasse à <strong>la</strong> tanière hivernale est cependant présupposée par <strong>les</strong> observations<br />
recueillies par <strong>les</strong> naturalistes sur <strong>la</strong> conformation <strong>de</strong>s oursons nouveau-nés : voir Arist., HA, VI 30, 579 a<br />
18-30, cité infra. Aristote, on le sait, utilisait <strong>de</strong>s chasseurs comme informateurs : voir <strong>les</strong> références réunies<br />
par MANQUAT 1932, 59-61.<br />
Jean Trinquier<br />
<strong>«</strong>“L’ours <strong>mal</strong> <strong>léché</strong>” : <strong>la</strong> <strong>reproduction</strong> <strong>de</strong> l’ours <strong>dans</strong> <strong>les</strong> <strong>sources</strong> antiques <strong>»</strong><br />
Schedae, 2009, prépublication n°20, (fascicule n°2, p. 153-188).<br />
153
154<br />
C’est du reste ce que fit Matthioli, qui consigna le fait <strong>dans</strong> son influent commentaire au De<br />
materia medica <strong>de</strong> Dioscori<strong>de</strong>, paru en 1544 5 . Il fut suivi par Aldrovandi, puis par Ambrosinus<br />
6 . L’erreur n’en persista pas moins, si bien que <strong>la</strong> réfutation dut en être in<strong>la</strong>ssablement<br />
reprise 7 . Buffon, par exemple, prenait bien soin <strong>de</strong> rappeler, en 1760, <strong>dans</strong> le chapitre qu’il<br />
consacra à l’ours <strong>dans</strong> son Histoire naturelle, que <strong>les</strong> oursons ne naissent pas informes, mais<br />
sont au contraire parfaitement formés <strong>dans</strong> le sein <strong>de</strong> leur mère. Il émettait également <strong>de</strong>s<br />
doutes sur <strong>la</strong> durée <strong>de</strong> trente jours prêtée par <strong>les</strong> Anciens à <strong>la</strong> gestation <strong>de</strong> l’ours, en faisant<br />
valoir que <strong>la</strong> grosseur <strong>de</strong> l’ani<strong>mal</strong>, <strong>la</strong> lente croissance <strong>de</strong>s oursons, le petit nombre d’oursons<br />
par portée et <strong>la</strong> longévité <strong>de</strong> l’ani<strong>mal</strong> sont <strong>de</strong>s caractéristiques qui ne se trouvent réunies<br />
que chez <strong>de</strong>s animaux dont <strong>la</strong> gestation dure plusieurs mois 8 . Quelques décennies<br />
plus tard, Lacépè<strong>de</strong> se montrait plus affirmatif : <strong>«</strong> Cette femelle porte sept mois et non pas<br />
trente jours comme le croyait Aristote ; elle met bas <strong>dans</strong> sa retraite d’hiver, et fait <strong>de</strong>puis<br />
un jusqu’à trois petits […]. Elle dévore son arrière-faix, ce qui sert à <strong>la</strong> soutenir plus longtemps<br />
<strong>dans</strong> sa retraite : c’est sans doute pour l’avoir vue enlevant avec sa gueule cette<br />
enveloppe à ses petits, qu’on aura dit qu’elle ne met bas que <strong>de</strong>s masses d’une chair informe<br />
qu’elle façonne en <strong>les</strong> léchant 9 .<strong>»</strong><br />
La présente contribution est consacrée aux racines antiques <strong>de</strong> cette croyance 10 . Le<br />
motif <strong>de</strong> l’ourse léchant ses petits offre en effet un point <strong>de</strong> vue intéressant pour étudier<br />
<strong>les</strong> savoirs antiques sur l’ours. Il renvoie <strong>dans</strong> l’Antiquité à <strong>la</strong> question débattue <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>reproduction</strong><br />
<strong>de</strong> l’espèce ursine. La <strong>reproduction</strong> fait partie <strong>de</strong> ce qu’Aristote appelle <strong>les</strong> pravxei",<br />
c’est-à-dire <strong>les</strong> <strong>«</strong> fonctions vita<strong>les</strong> <strong>»</strong>. La discussion que le Stagirite consacre à <strong>la</strong> <strong>reproduction</strong><br />
<strong>de</strong> l’ours et plus <strong>la</strong>rgement à celle <strong>de</strong>s animaux multipares est exemp<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> l’effort du philosophe<br />
pour é<strong>la</strong>borer une biologie qui ren<strong>de</strong> compte <strong>de</strong>s complexités du vivant et qui<br />
s’attache à en déceler <strong>les</strong> causes. Le motif <strong>de</strong> l’ourse léchant ses petits permettra d’étudier<br />
<strong>la</strong> postérité <strong>de</strong> cette zoologie artistotélicienne <strong>de</strong>s fonctions vita<strong>les</strong> chez <strong>les</strong> auteurs postérieurs,<br />
vivant à l’époque hellénistique ou sous l’Empire, qui ont coutume <strong>de</strong> se référer à<br />
l’œuvre zoologique d’Aristote comme à une autorité. Il s’agira <strong>de</strong> cerner <strong>les</strong> orientations<br />
nouvel<strong>les</strong> suivies, par-<strong>de</strong>là <strong>la</strong> fidélité affichée à l’enseignement d’Aristote, par <strong>les</strong> discours<br />
antiques sur l’ani<strong>mal</strong>. Après avoir discuté <strong>les</strong> vues d’Aristote sur <strong>la</strong> <strong>reproduction</strong> <strong>de</strong> l’ours,<br />
je m’intéresserai à leur postérité antique, avant <strong>de</strong> m’interroger plus précisément sur le<br />
succès rencontré par le motif <strong>de</strong> l’ourse façonnant ses petits.<br />
Aristote et <strong>la</strong> <strong>reproduction</strong> <strong>de</strong> l’ours<br />
Aristote consacre un important développement à <strong>la</strong> <strong>reproduction</strong> <strong>de</strong> l’ours ; il passe en<br />
revue tous <strong>les</strong> aspects <strong>de</strong> <strong>la</strong> question, <strong>de</strong>puis l’accouplement jusqu’aux soins prodigués aux<br />
oursons nouveau-nés 11 :<br />
5. MATTHIOLI 1554, 183. Les premières critiques adressées à cette croyance remontent à Albert le Grand, qui<br />
ne croit pas que l’ourse, en le léchant, donne vie au nouveau-né et le façonne : Albert le Grand, De ani<strong>mal</strong>ibus,<br />
VII, 3, 3, 159, I (ALBERT LE GRAND (Stadler 1916), 564). Dans un autre livre du De ani<strong>mal</strong>ibus (XXII, 2,<br />
1, 107, II, ibid., 1406), il s’emploie à déterminer <strong>la</strong> cause <strong>de</strong> ce qui constitue à ses yeux une croyance erronée :<br />
in partu membra ui<strong>de</strong>ntur incompleta propter humoris superhabundantiam, propter quod ursa foetum<br />
diu <strong>la</strong>mbit et fouet.<br />
6. ALDROVANDI 1637, I, 124 ; ALDROVANDI et AMBROSINUS 1642, 140, cités par ELZE 1913.<br />
7. L’opinion traditionnelle fut reprise, par exemple, par Conrad Gesner : GESNER 1551, 1069, cité par ELZE<br />
1913. Voir aussi JONSTON 1652, 126-127, qui expose <strong>les</strong> <strong>de</strong>ux thèses en présence sans prendre parti.<br />
8. BUFFON 1760, 255-257. Sur le chapitre consacré à l’ours <strong>dans</strong> l’Histoire naturelle <strong>de</strong> Buffon, voir PASTOUREAU<br />
2007, 306-308.<br />
9. LACÉPÈDE et al. 1804, cité par VAN-PRAËT 1988, 26-27.<br />
10. La question n’est que brièvement abordée par Keller <strong>dans</strong> ses <strong>de</strong>ux ouvrages c<strong>la</strong>ssiques sur <strong>les</strong> animaux<br />
<strong>dans</strong> l’Antiquité : KELLER 1887, 122-123 et 1909, 180 ; voir aussi ELZE 1913.<br />
11. Arist., HA, VI 30, 579 a 18-30 (ARISTOTE (Louis 1968).<br />
Schedae, 2009, prépublication n°20, (fascicule n°2, p. 153-188).<br />
http://www.unicaen.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint0202009.pdf
AiJ <strong>de</strong>; a[rktoi th;n ojceivan poiou'ntai, w{sper ei[rhtai provteron, oujk ajnabado;n ajl<strong>la</strong>; katakeklimevnai<br />
ejpi; th'" gh'". Kuvei d j a[rkto" triavkonta hJmevrai". Tivktei <strong>de</strong>; kai; e}n kai; duvo, ta; <strong>de</strong>; plei'sta<br />
pevnte. ΔE<strong>la</strong>vciston <strong>de</strong>; tivktei to; e[mbruon tw'/<br />
megevqei wJ" kata; to; sw'ma to; aujth'" : e[<strong>la</strong>tton me;n ga;r<br />
galh'" tivktei, mei'zon <strong>de</strong>; muo;", kai; yilo;n kai; tuflovn, kai; ; scedo;n ajdiavrqrwta ta; skevlh kai; ta;<br />
plei'sta tw'n morivwn. Th;n d j ojceivan poiei'tai tou' mhno;" ΔE<strong>la</strong>fhboliw'no", tivktei <strong>de</strong>; peri; th;n<br />
w{ran th;n tou' fwlei'n. Givgnontai me;n ou\n peri; to;n crovnon tou'ton kai; hJ qhvleia kai; oJ a[rrhn<br />
piovtato" : o{tan <strong>de</strong>; ejkqrevyh/ trivtw/ mhni; ejkfaivnousin h[dh tou' e[aro". Kai; hJ u{strix <strong>de</strong>; fwleuvei<br />
kai; kuvei i[sa" hJmevra", kai; ta; a[l<strong>la</strong> wJsauvtw" th'/<br />
a[rktw/. Kuvousan d j a[rkton e[rgon ejsti; <strong>la</strong>bei'n.<br />
Les ourses s’accouplent, nous l’avons dit plus haut, non pas en <strong>la</strong>issant le mâle monter sur<br />
el<strong>les</strong>, mais en se couchant par terre. L’ourse porte trente jours. Elle met bas un ou <strong>de</strong>ux petits,<br />
cinq au maximum. L’ours naissant est tout petit proportionnellement au corps <strong>de</strong> sa mère : en<br />
effet, il est plus petit qu’une belette, plus gros qu’une souris ; il est sans poil et aveugle, et ses<br />
membres sont presque indistincts, comme <strong>la</strong> plupart <strong>de</strong> ses parties. L’accouplement a lieu pendant<br />
le mois d’É<strong>la</strong>phébolion, et <strong>la</strong> femelle met bas <strong>dans</strong> <strong>la</strong> saison où <strong>les</strong> ours restent cachés.<br />
Pendant cette pério<strong>de</strong>, <strong>la</strong> femelle et le mâle <strong>de</strong>viennent très gras. Quand <strong>la</strong> femelle a élevé ses<br />
petits, au troisième mois, ils font leur apparition alors que c’est déjà le printemps.<br />
La femelle du porc-épic reste elle aussi cachée ; elle porte le même nombre <strong>de</strong> jours et pour<br />
le reste se comporte comme l’ourse.<br />
Une ourse pleine est difficile à prendre.<br />
Ce qui intéresse Aristote <strong>dans</strong> le cas <strong>de</strong> l’ours, c’est que <strong>la</strong> femelle met au mon<strong>de</strong> <strong>de</strong>s<br />
petits manifestement inachevés au terme d’une gestation particulièrement brève. Les informations<br />
qu’il fournit sont cependant entachées d’une contradiction patente. Aristote affirme<br />
en effet premièrement que l’accouplement a lieu vers le mois d’É<strong>la</strong>phèbolion, qui correspond<br />
<strong>dans</strong> notre calendrier à <strong>la</strong> secon<strong>de</strong> moitié du mois <strong>de</strong> mars et à <strong>la</strong> première quinzaine<br />
du mois d’avril, <strong>de</strong>uxièmement que <strong>la</strong> mise bas se produit pendant l’hibernation, et troisièmement<br />
que <strong>la</strong> gestation dure trente jours. La contradiction entre ces informations est évi<strong>de</strong>nte<br />
et n’a pas manqué <strong>de</strong> frapper <strong>les</strong> lecteurs d’Aristote. Comme il se doit, <strong>les</strong> éditeurs<br />
<strong>de</strong> l’Histoire <strong>de</strong>s animaux se sont employés à réduire <strong>la</strong> contradiction en corrigeant le<br />
texte. Pour rendre le passage cohérent, il faut modifier soit <strong>la</strong> date <strong>de</strong> l’accouplement, soit<br />
<strong>la</strong> durée <strong>de</strong> <strong>la</strong> gestation. La date <strong>de</strong> <strong>la</strong> mise bas, pour sa part, est plus <strong>mal</strong>aisément modifiable,<br />
car il s’agit du point le mieux établi : on savait parfaitement que l’ourse mettait bas<br />
<strong>dans</strong> sa tanière pendant l’hiver 12 , alors que le moment <strong>de</strong> l’accouplement semble avoir<br />
donné lieu à beaucoup plus d’hésitations. Il n’y a rien là d’étonnant, car il n’est pas toujours<br />
facile <strong>de</strong> prendre <strong>la</strong> nature sur le fait, d’autant plus que <strong>les</strong> ours, paraît-il, font preuve <strong>de</strong><br />
discrétion en <strong>la</strong> matière 13 . D’autre part, <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’accouplement s’étale pour l’ours<br />
sur plusieurs mois, ce qui est rendu possible par le phénomène <strong>de</strong> l’ovu<strong>la</strong>tion induite 14 .<br />
Pour rendre le texte cohérent, <strong>la</strong> première solution consiste donc à modifier <strong>la</strong> date <strong>de</strong><br />
l’accouplement. Dittmeyer, à qui l’on doit l’édition Teubner <strong>de</strong> 1907 <strong>de</strong> l’Histoire <strong>de</strong>s animaux,<br />
a ainsi été amené à supposer l’existence d’une <strong>la</strong>cune <strong>dans</strong> le texte 15 . Selon lui, il ne<br />
faudrait pas lire <strong>«</strong> s’accouple pendant le mois d’É<strong>la</strong>phèbolion <strong>»</strong>, mais <strong>«</strong> s’accouple pendant<br />
le mois <strong>de</strong> Poséidéôn [c’est-à-dire décembre] et hiberne jusqu’au mois d’É<strong>la</strong>phèbolion <strong>»</strong>,<br />
ce qui revient à insérer <strong>dans</strong> le texte <strong>les</strong> mots suivants, [Posei<strong>de</strong>w'no" kai; fwleuvei mevcri tou'<br />
mhno;" tou'], qui auraient été omis à <strong>la</strong> suite d’un saut du même au même, d’un nom <strong>de</strong><br />
12. L’information est reprise au livre VII, <strong>dans</strong> le développement consacré à l’hibernation (VII-VIII, 17, 600 b 1).<br />
13. COUTURIER 1954, 458-459. PARDE et CAMARRA 1992, 9-10, se contentent <strong>de</strong> noter sobrement que l’on manque<br />
d’observations à ce sujet.<br />
14. L’ovu<strong>la</strong>tion induite est l’ovu<strong>la</strong>tion qui est provoquée par <strong>la</strong> copu<strong>la</strong>tion, un mécanisme physiologique qui<br />
est particulièrement adapté aux situations <strong>de</strong> basses <strong>de</strong>nsités et aux faib<strong>les</strong> probabilités <strong>de</strong> rencontre<br />
d’un partenaire : voir PARDE et CAMARRA 1992, 9.<br />
15. ARISTOTE (Dittmeyer 1907), 267.<br />
Schedae, 2009, prépublication n°20, (fascicule n°2, p.153-188).<br />
http://www.unicaen.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint0202009.pdf<br />
155
156<br />
mois à l’autre. De fait, <strong>les</strong> ours quittent leur tanière hivernale vers le mois <strong>de</strong> mars et selon<br />
certains auteurs, ce serait précisément à cause <strong>de</strong> ce réveil printanier <strong>de</strong> l’ours que le mois<br />
<strong>de</strong> mars aurait été consacré à Artémis É<strong>la</strong>phèbolos <strong>dans</strong> le calendrier athénien 16 . La correction<br />
proposée par Dittmeyer ne s’appuie cependant pas sur <strong>de</strong>s critères d’ordre paléographique<br />
et elle établit une séquence qui n’est pas chronologiquement cohérente,<br />
puisque <strong>la</strong> mention anticipée <strong>de</strong> <strong>la</strong> date à <strong>la</strong>quelle prend fin l’hibernation vient interrompre<br />
<strong>la</strong> séquence logique qui conduit <strong>de</strong> l’accouplement à <strong>la</strong> mise bas <strong>dans</strong> <strong>la</strong> tanière hivernale,<br />
avant donc le mois d’É<strong>la</strong>phèbolion.<br />
L’autre solution consiste à modifier <strong>la</strong> durée <strong>de</strong> <strong>la</strong> gestation. En faveur <strong>de</strong> cette solution,<br />
on notera que l’indication re<strong>la</strong>tive à <strong>la</strong> durée <strong>de</strong> <strong>la</strong> gestation <strong>de</strong> l’ours constitue une<br />
ano<strong>mal</strong>ie manifeste. Si l’on se rapporte au tableau dressé par S. Byl, où sont mis en regard<br />
<strong>les</strong> indications fournies par Aristote sur <strong>la</strong> durée <strong>de</strong> <strong>la</strong> gestation <strong>de</strong>s différents animaux et<br />
<strong>les</strong> chiffres que donnent <strong>les</strong> biologistes contemporains, on constate que l’information re<strong>la</strong>tive<br />
à <strong>la</strong> durée <strong>de</strong> <strong>la</strong> gestation <strong>de</strong> l’ours constitue <strong>la</strong> seule erreur d’importance, alors que <strong>les</strong><br />
autres indications s’accor<strong>de</strong>nt en général avec <strong>les</strong> observations <strong>de</strong> <strong>la</strong> science mo<strong>de</strong>rne 17 .<br />
Pour l’ourse, <strong>la</strong> différence est à peu près <strong>de</strong> un à huit : trente jours <strong>de</strong> gestation pour Aris-<br />
tote, <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux cent dix à <strong>de</strong>ux cent cinquante jours selon <strong>les</strong> observations mo<strong>de</strong>rnes. Aubert<br />
et Wimmer ont donc proposé, <strong>dans</strong> leur édition <strong>de</strong> 1868, <strong>de</strong> remp<strong>la</strong>cer hJmevra" par eJptavda"<br />
18 . La gestation, dès lors, n’est plus comptée en jours, mais en semaines. Cette correc-<br />
tion est économique, et l’idée est ingénieuse, car le compte tombe juste, puisque l’on<br />
arrive à une durée <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux cent dix jours. En outre, comme l’a montré S. Byl à <strong>la</strong> suite du<br />
travail pionnier <strong>de</strong> Roscher, l’œuvre biologique d’Aristote porte encore trace <strong>de</strong>s théories<br />
septénaires é<strong>la</strong>borées par <strong>les</strong> <strong>«</strong> physiciens <strong>»</strong> et <strong>les</strong> mé<strong>de</strong>cins du siècle précé<strong>de</strong>nt 19 . Ces<br />
spécu<strong>la</strong>tions arithmologiques ont été développées <strong>dans</strong> <strong>de</strong>ux domaines privilégiés :<br />
l’embryologie et <strong>les</strong> étapes <strong>de</strong> <strong>la</strong> croissance humaine d’une part, <strong>la</strong> périodisation <strong>de</strong>s <strong>mal</strong>adies<br />
<strong>de</strong> l’autre. El<strong>les</strong> ont accrédité l’idée que nombre <strong>de</strong> phénomènes <strong>de</strong> <strong>la</strong> vie organique<br />
se conformaient à un rythme septénaire. C’est ainsi qu’Aristote fixe à trois semaines <strong>la</strong><br />
durée du développement <strong>de</strong>s <strong>la</strong>rves d’insectes, à quatre semaines celle <strong>de</strong>s insectes<br />
ovipares ; cette <strong>de</strong>rnière durée est encore divisée suivant le nombre sept, puisque <strong>la</strong> formation<br />
<strong>de</strong> l’œuf se fait <strong>dans</strong> <strong>les</strong> sept jours qui suivent l’accouplement et que <strong>les</strong> œufs ainsi<br />
formés sont encore couvés pendant trois semaines avant <strong>de</strong> parvenir à éclosion 20 . De<br />
même, si <strong>la</strong> gestation <strong>de</strong>s poissons est d’une longueur variable suivant <strong>les</strong> espèces, sans<br />
toutefois excé<strong>de</strong>r trente jours, <strong>«</strong> chez tous, elle correspond à une pério<strong>de</strong> divisible par<br />
sept <strong>»</strong>, pavnte" d v ejn crovnoi" diairoumevnoi" eij" to;n tw'n eJbdomavdwn ajriqmo;n 21 . Cette valori-<br />
sation <strong>de</strong> l’hebdoma<strong>de</strong> <strong>dans</strong> l’œuvre biologique d’Aristote p<strong>la</strong>i<strong>de</strong> donc en faveur <strong>de</strong> <strong>la</strong> correction<br />
introduite par Aubert et Wimmer.<br />
Cette <strong>de</strong>rnière ne m’en semble pas moins <strong>de</strong>voir être rejetée. Aristote, d’une part,<br />
n’utilise l’unité <strong>de</strong> l’hepta<strong>de</strong> que pour <strong>de</strong>s durées inférieures ou éga<strong>les</strong> à un mois, jamais<br />
16. BRULÉ 1990, 17-18. Sur <strong>les</strong> liens entre Artémis et l’ours, voir en particulier JOST 1985, 405-410; BRULÉ 1987, 214-<br />
217; BRULÉ 1990; GIUMAN 1999, 119-125; PASTOUREAU 2007, 43-47. On ne reprendra pas ici le dossier <strong>de</strong> Brauron;<br />
parmi une abondante bibliographie, voir BRULÉ 1987 et 1990, GIUMAN 1999 et GENTILI et PERUSINO 2002.<br />
17. BYL 1980, 258.<br />
18. ARISTOTE (Aubert et Wimmer 1868), 101, en note. Aubert et Wimmer ont été suivis sur ce point par<br />
M. Vegetti : ARISTOTE (Lanza et Vegetti 1971), 393, note 115. Voir aussi, <strong>dans</strong> le même sens, WENSKUS 1990, 142.<br />
19. ROSCHER 1906, 90-98 ; BYL 1980, 252-263. Voir en particulier Alcméon <strong>de</strong> Crotone (24 A 15 D.-K., ap. Arist.,<br />
HA, IX / VII, 1, 581 a 9-17), Empédocle (31 B 153a D.-K., ap. Theo Sm., p. 104, 1 Hiller) et Hippon <strong>de</strong> Samos (38<br />
A 16 D.-K., ap. Cens., VII, 2). Pour <strong>la</strong> Collection hippocratique, on se reportera aux traités <strong>de</strong>s Chairs et du<br />
Fœtus <strong>de</strong> huit mois, ainsi qu’au traité pseudohippocratique <strong>de</strong>s Semaines : voir JOUANNA 1992, 104, 377,<br />
382, 398 et 475-480.<br />
20. Arist., HA, V, 20, 553 a 2-9.<br />
21. Ibid., VI, 17, 570 a 30-31.<br />
Schedae, 2009, prépublication n°20, (fascicule n°2, p. 153-188).<br />
http://www.unicaen.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint0202009.pdf
pour <strong>de</strong>s durées <strong>de</strong> plusieurs mois 22 . Si l’hebdoma<strong>de</strong> est valorisée, le mois n’en reste pas<br />
moins l’unité fondamentale fixant <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> à <strong>la</strong>quelle se plient en général <strong>les</strong> rythmes <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> vie, et notamment <strong>de</strong> <strong>la</strong> gestation et <strong>de</strong> <strong>la</strong> génération ; c’est que le mois, comme l’explique<br />
Aristote à <strong>la</strong> fin du livre IV <strong>de</strong> <strong>la</strong> Génération <strong>de</strong>s animaux, est une pério<strong>de</strong> commune à<br />
<strong>la</strong> fois à <strong>la</strong> lune et au soleil, dont <strong>les</strong> révolutions fixent justement <strong>les</strong> rythmes du vivant 23 . D’autre<br />
part, aucun <strong>de</strong>s textes postérieurs d’ascendance péripatéticienne ne corrobore cette correction<br />
24 . La correction d’Aubert et Wimmer n’a pas au <strong>de</strong>meurant recueilli l’adhésion <strong>de</strong><br />
tous <strong>les</strong> éditeurs d’Aristote. Si elle a été reprise par M. Vegetti, elle n’a pas en revanche été<br />
retenue <strong>dans</strong> l’édition <strong>de</strong> P. Louis ni <strong>dans</strong> l’editio maior <strong>de</strong> D. Balme 25 .<br />
En fait, <strong>la</strong> contradiction entre <strong>les</strong> informations réunies par Aristote ne s’explique pas<br />
par un problème textuel, mais dissimule une difficulté qui appartient en propre au domaine<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> biologie. Si l’on se rapporte au passage incriminé, on voit en effet qu’Aristote enregistre<br />
<strong>de</strong>s données qui sont globalement exactes et dont <strong>la</strong> contradiction n’est qu’apparente.<br />
La date <strong>de</strong> l’accouplement, quoique un peu précoce, est acceptable, car l’ours s’accouple<br />
<strong>de</strong> fait au printemps ou au début <strong>de</strong> l’été 26 . Il est exact que <strong>les</strong> nouveau-nés sont encore<br />
informes et particulièrement petits eu égard à <strong>la</strong> taille <strong>de</strong> l’ani<strong>mal</strong> adulte. Enfin, Aristote a<br />
bien noté qu’on ne prend que très rarement une femelle pleine 27 . Aristote déduit du caractère<br />
<strong>mal</strong> ébauché <strong>de</strong>s oursons nouveau-nés que <strong>la</strong> durée <strong>de</strong> <strong>la</strong> gestation doit être particulièrement<br />
brève. Cette déduction est confirmée par le fait que l’on ne prend que très rarement<br />
une femelle pleine, ce qui ne peut s’expliquer que par une gestation brève, se dérou<strong>la</strong>nt<br />
<strong>dans</strong> sa plus gran<strong>de</strong> partie pendant <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> hivernale où <strong>les</strong> ours sont cachés 28 . Cet<br />
ensemble <strong>de</strong> déductions, cependant, n’est pas compatible avec l’observation re<strong>la</strong>tive à <strong>la</strong><br />
date d’accouplement. Aristote n’a tout simplement pas eu le loisir <strong>de</strong> pousser plus loin ses<br />
investigations et d’harmoniser <strong>de</strong>s données contradictoires. On peut ajouter qu’il n’avait<br />
pas <strong>les</strong> moyens <strong>de</strong> le faire. La solution à ce problème n’a en effet été donnée que par <strong>la</strong><br />
science mo<strong>de</strong>rne, grâce à <strong>de</strong>s investigations menées à l’échelle microscopique, qui étaient<br />
hors <strong>de</strong> portée <strong>de</strong> <strong>la</strong> science antique. Pour résoudre <strong>la</strong> contradiction, il faut faire intervenir<br />
<strong>les</strong> notions <strong>de</strong> gestation à nidation différée et <strong>de</strong> diapose embryonnaire : chez l’ourse comme<br />
chez d’autres animaux, le phénomène <strong>de</strong> segmentation <strong>de</strong> l’œuf s’interrompt <strong>de</strong>ux à trois<br />
jours après <strong>la</strong> fécondation, pour ne reprendre que plusieurs mois plus tard, après l’entrée<br />
en hibernation 29 . L’ourse s’accouple bien au printemps, mais l’imp<strong>la</strong>ntation <strong>de</strong> l’œuf <strong>dans</strong><br />
<strong>la</strong> paroi utérine est différée, ce qui fait que <strong>la</strong> grossesse <strong>de</strong> l’ani<strong>mal</strong> ne peut être décelée<br />
pendant longtemps. Aussi une femelle fécondée ne <strong>de</strong>vait-elle pas donner l’impression d’être<br />
pleine lorsqu’elle était tuée à <strong>la</strong> chasse et qu’elle était ouverte pour être vidée 30 . L’Histoire<br />
<strong>de</strong>s animaux propose une première mise en ordre, inaboutie, <strong>de</strong>s données disponib<strong>les</strong> sur<br />
22. Rappelons à ce propos que l’hepta<strong>de</strong>, ou durée <strong>de</strong> sept jours, n’est pas d’un emploi aussi courant, en Grèce<br />
ancienne, que notre mo<strong>de</strong>rne semaine. Les mois sont en effet divisés non en semaines, mais en déca<strong>de</strong>s :<br />
voir, pour le calendrier athénien, SAMUEL 1972, 17-18 et 59-61. L’utilisation <strong>de</strong> l’hepta<strong>de</strong> s’inscrit pour sa<br />
part <strong>dans</strong> le cadre d’une théorie arithmologique. Sur l’origine <strong>de</strong> <strong>la</strong> semaine, voir ZERUBAVEL 1985, 5-26.<br />
23. GA, IV, 10, 777 b 17-778 a 9. Voir LEFEBVRE 1993, 274.<br />
24. Cf. Ar. Byz., Epit., II, 329-331 (LAMBROS 1885, 102) et Plin., nat., VIII, 126. Si l’on s’en tient à <strong>la</strong> solution proposée<br />
par Aubert et Wimmer, il faut alors supposer que <strong>la</strong> mention d’une gestation durant seulement<br />
trente jours résulte d’une corruption précoce, antérieure à Aristophane <strong>de</strong> Byzance, du texte d’Aristote.<br />
25. ARISTOTE (Louis 1968), 126 ; ARISTOTE (Balme 2002), 324.<br />
26. COUTURIER 1954, 458-459. PARDE et CAMARRA 1992, 9-10.<br />
27. L’information est reprise au livre VII, <strong>dans</strong> le développement re<strong>la</strong>tif à l’hibernation (HA, VII/VIII, 17, 600 b 6-7).<br />
28. Aristote est plus explicite à propos <strong>de</strong> <strong>la</strong> renar<strong>de</strong> (HA, VI 34, 580 a 7) : {Otan <strong>de</strong>; mevllh/tivktein, ejktopivzei<br />
ou{tw" w{ste spavnion eij~nai<br />
to; lhfqh`nai kuvousan, <strong>«</strong> Lorsqu’elle est sur le point <strong>de</strong> mettre bas, elle se<br />
cache, si bien qu’il est rare d’en prendre une qui soit pleine <strong>»</strong> (ARISTOTE, Louis 1968).<br />
29. PARDE et CAMARRA 1992, 9.<br />
30. Ici comme ailleurs <strong>dans</strong> l’Histoire <strong>de</strong>s animaux, Aristote a manifestement utilisé <strong>de</strong>s chasseurs comme<br />
informateurs. Sur ce point, voir supra, note 4.<br />
Schedae, 2009, prépublication n°20, (fascicule n°2, p.153-188).<br />
http://www.unicaen.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint0202009.pdf<br />
157
158<br />
ce sujet. La réflexion sur <strong>la</strong> <strong>reproduction</strong> <strong>de</strong>s ours est poursuivie <strong>dans</strong> le traité De <strong>la</strong> génération<br />
<strong>de</strong>s animaux.<br />
Aristote, <strong>dans</strong> ce traité, n’envisage pas le cas <strong>de</strong> l’ours séparément. L’ours, en effet,<br />
n’est pas le seul ani<strong>mal</strong> à mettre au mon<strong>de</strong> <strong>de</strong>s petits à peine formés ; c’est une caractéristique<br />
qu’il partage avec <strong>la</strong> plupart <strong>de</strong>s fissipè<strong>de</strong>s, en particulier avec le lion, le renard, <strong>la</strong><br />
belette, le chien, le chacal et le loup 31 . Aristote distingue plus précisément <strong>de</strong>ux <strong>de</strong>grés<br />
d’inachèvement : le premier, qui concerne <strong>«</strong> presque tous <strong>»</strong> <strong>les</strong> fissipè<strong>de</strong>s, y compris le chien,<br />
le loup et le chacal, est caractérisé par <strong>la</strong> cécité néonatale, le second, qui ne se retrouve<br />
plus que chez <strong>«</strong> certains <strong>»</strong>, à savoir <strong>«</strong> le renard, l’ours, le lion, et quelques autres <strong>»</strong>, se marque<br />
<strong>dans</strong> l’indifférenciation re<strong>la</strong>tive <strong>de</strong>s membres <strong>de</strong>s petits nouveau-nés, qui sont qualifiés<br />
par Aristote d’ajdiavrqrwta scedovn 32 . Il s’agit <strong>dans</strong> <strong>les</strong> <strong>de</strong>ux cas d’un inachèvement selon <strong>la</strong><br />
qualité, et non selon <strong>la</strong> quantité 33 . Tout nouveau-né est en effet inachevé selon <strong>la</strong> quantité.<br />
L’inachèvement selon <strong>la</strong> qualité renvoie pour sa part à un état où <strong>les</strong> parties <strong>de</strong> l’embryon<br />
ne se sont pas encore totalement différenciées. Aristote soutient ainsi que <strong>la</strong> cécité néonatale<br />
<strong>de</strong> nombreux fissipè<strong>de</strong>s s’explique par le fait que leurs yeux sont recouverts par une<br />
paupière unique, <strong>la</strong>quelle ne s’est pas encore scindée en <strong>de</strong>ux 34 . Aristote, cependant, ne<br />
s’arrête pas à ce constat, mais s’enquiert <strong>de</strong> <strong>la</strong> cause du phénomène, qui semble contredire<br />
l’assertion selon <strong>la</strong>quelle le <strong>de</strong>gré d’achèvement <strong>de</strong>s petits à <strong>la</strong> naisssance est proportionné<br />
au <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> perfection <strong>de</strong>s parents 35 . Or <strong>les</strong> fissipè<strong>de</strong>s occupent avec <strong>les</strong> autres animaux<br />
sanguins et vivipares le sommet <strong>de</strong> l’échelle <strong>de</strong> perfection zoologique qu’Aristote est amené<br />
à postuler <strong>dans</strong> ses recherches biologiques 36 . Et pourtant, <strong>les</strong> fissipè<strong>de</strong>s mettent au mon<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>s petits inachevés. Pour expliquer cet inachèvement, Aristote pose qu’il est le résultat<br />
d’une gestation prématurément interrompue, qui ne s’est pas poursuivie jusqu’à son terme.<br />
La cause <strong>de</strong> cette interruption prématurée <strong>de</strong> <strong>la</strong> gestation est à ses yeux <strong>la</strong> multiparité <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> plupart <strong>de</strong>s fissipè<strong>de</strong>s 37 . La multiparité entraîne en effet une mise bas précoce à <strong>la</strong> fois<br />
par manque <strong>de</strong> p<strong>la</strong>ce et par manque <strong>de</strong> nourriture. D’une part, <strong>«</strong> … <strong>la</strong> multiplicité [<strong>de</strong>s<br />
petits] empêche leur achèvement par une gêne mutuelle, et fait obstacle aux mouvements<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> génération <strong>»</strong> 38 . Cette gêne mutuelle explique à <strong>la</strong> fois l’inachèvement <strong>de</strong>s nouveaunés<br />
et <strong>la</strong> fréquence élevée <strong>de</strong>s cas tératologiques parmi <strong>les</strong> multipares. D’autre part, à <strong>la</strong><br />
seule exception <strong>de</strong> <strong>la</strong> truie, dont le corps florissant est capable, comme une terre grasse,<br />
d’amener à terme une nombreuse portée, <strong>les</strong> femel<strong>les</strong> multipares ne peuvent nourrir jusqu’à<br />
leur plein achèvement <strong>les</strong> embryons qu’el<strong>les</strong> portent 39 . Or, pour tous <strong>les</strong> animaux vivipares,<br />
<strong>la</strong> venue au mon<strong>de</strong> intervient précisément au moment où <strong>la</strong> nourriture provenant du cordon<br />
ombilical ne suffit plus au fœtus 40 . Chez <strong>les</strong> multipares, <strong>la</strong> nourriture venant précocément<br />
31. GA, IV, 6, 774 b 13-16 ; cf. ibid., II, 6, 742 a 8-10. Aristote ne fait que reprendre ici <strong>de</strong>s informations déjà<br />
présentes <strong>dans</strong> l’Histoire <strong>de</strong>s animaux : voir HA, VI, 20, 574 a 23-30 ; 30, 579 a 21-25 ; 31, 579 b 7-8 ; 34, 580<br />
a 6-10 ; 35, 580 a 12-13, 26-28.<br />
32. GA, IV, 6, 774 b 13-16 ; cf. ibid., II, 6, 742 a 8-10.<br />
33. Ibid., II, 1, 733 b 2-3.<br />
34. Ibid., II, 6, 742 a 8-10.<br />
35. Ibid., II, 1, 733 a 1-3 et b 1-4.<br />
36. Sur <strong>la</strong> perspective axiologique qui ordonne <strong>la</strong> biologie d’Aristote et sur <strong>les</strong> différents critères qui prési<strong>de</strong>nt<br />
à l’établissement <strong>de</strong> cette hiérarchie zoologique, voir LLOYD 1961, 76-78 ; LLOYD 1983, 26-43 ; ZUCKER<br />
2005b, 144-168.<br />
37. GA, IV, 4, 771 a 17-772 b 12 et IV, 6, 774 b 5-26.<br />
38. Ibid., IV, 4, 770 b 24-27 : … dia; to; th;n polutokivan ejmpodivzein ta;" teleiwvsei" ajllhvlwn kai; ta;" kinhvsei"<br />
ta;" gennhtikav" (ARISTOTE, Louis 1961). L’argument <strong>de</strong> <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ce se retrouve à propos <strong>de</strong>s poissons ovipares<br />
(GA, III, 4, 755 a 24-30). Si leurs œufs ne continuent pas à se développer à l’intérieur <strong>de</strong> l’utérus <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
femelle, comme c’est le cas pour <strong>les</strong> poissons ovovivipares, dont <strong>la</strong> ponte est interne, leur permettant<br />
ainsi <strong>de</strong> mettre au mon<strong>de</strong> <strong>de</strong>s petits bien vivants, c’est que ces poissons très prolifiques pon<strong>de</strong>nt un si<br />
grand nombre d’œufs que l’utérus est trop petit pour <strong>les</strong> contenir bien longtemps.<br />
39. Ibid., IV, 6, 774 b 19-26 (cas <strong>de</strong> <strong>la</strong> truie) ; ibid., IV, 6, 774 b 10-13.<br />
40. Ibid., IV, 777 a 22-27.<br />
Schedae, 2009, prépublication n°20, (fascicule n°2, p. 153-188).<br />
http://www.unicaen.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint0202009.pdf
à manquer, <strong>la</strong> mise bas se produit donc avant terme. C’est parce qu’ils sont <strong>de</strong> grands prématurés<br />
que <strong>les</strong> petits <strong>de</strong>s fissipè<strong>de</strong>s, dont l’ours, naissent inachevés. Aussi Aristote com-<br />
pare-t-il <strong>les</strong> fissipè<strong>de</strong>s mutipares aux <strong>«</strong> animaux producteurs <strong>de</strong> <strong>la</strong>rves <strong>»</strong>, ta; skwlhkotovka 41 .<br />
Pour comprendre cette comparaison, qui dit <strong>de</strong> façon hyperbolique l’inachèvement <strong>de</strong>s<br />
nouveau-nés, il faut gar<strong>de</strong>r en mémoire <strong>la</strong> définition aristotélicienne <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>la</strong>rve, qui est un<br />
embryon inachevé selon <strong>la</strong> qualité, qui poursuit son développement par lui-même, sans le<br />
secours d’aucun point d’attache 42 . La comparaison reste cependant imparfaite, <strong>dans</strong> <strong>la</strong><br />
mesure où l’ourson nouveau-né est al<strong>la</strong>ité par sa mère, tandis que <strong>la</strong> <strong>la</strong>rve tire sa nourriture<br />
d’elle-même, un peu à <strong>la</strong> façon <strong>de</strong> l’œuf, avec cette différence que <strong>la</strong> nourriture forme <strong>dans</strong><br />
l’œuf une partie séparée, alors que <strong>la</strong> <strong>la</strong>rve tire sa nourriture <strong>de</strong> l’ensemble du produit.<br />
La discussion sur <strong>les</strong> mécanismes <strong>de</strong> <strong>la</strong> multiparité est précédée, <strong>dans</strong> le traité De <strong>la</strong><br />
génération <strong>de</strong>s animaux, par un examen plus <strong>la</strong>rge <strong>de</strong> <strong>la</strong> question. Aristote cherche en effet<br />
à expliquer <strong>dans</strong> un premier temps pour quel<strong>les</strong> raisons certaines espèces sont multipares,<br />
alors que d’autres sont unipares ou paucipares. Il commence par remarquer que <strong>les</strong> grands<br />
animaux, <strong>de</strong> façon en apparence paradoxale, sont unipares ou paucipares, alors que <strong>les</strong><br />
animaux plus petits sont le plus souvent multipares 43 . Fort <strong>de</strong> cette observation contestable<br />
<strong>dans</strong> sa généralité, Aristote s’efforce d’établir un lien entre <strong>la</strong> taille <strong>de</strong>s animaux et le nombre<br />
<strong>de</strong> petits par portée. Si <strong>les</strong> animaux <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> taille ne sont pas multipares, c’est à ses<br />
yeux parce que <strong>la</strong> nourriture passe chez eux à l’accroissement <strong>de</strong> leur corps, et non à <strong>la</strong><br />
production <strong>de</strong> sperme, celui-ci étant défini par Aristote comme un résidu <strong>de</strong> <strong>la</strong> nourriture<br />
à son <strong>de</strong>rnier <strong>de</strong>gré d’é<strong>la</strong>boration 44 . La différence intervient ici d’un genre à un autre genre,<br />
et non à l’intérieur d’un même genre, d’un individu à l’autre, comme <strong>dans</strong> <strong>les</strong> considérations<br />
développées au livre I, où Aristote soutenait que <strong>les</strong> hommes qui se chargent <strong>de</strong> graisse<br />
émettent moins <strong>de</strong> sperme et ont moins <strong>de</strong> besoins sexuels que <strong>les</strong> autres, <strong>dans</strong> <strong>la</strong> mesure<br />
où <strong>la</strong> nourriture, une fois sa coction opérée, forme chez eux un résidu graisseux, et non un<br />
résidu séminal 45 . Aristote avance aussi, <strong>de</strong> façon moins c<strong>la</strong>ire, que le sperme générateur<br />
ayant nécessairement plus <strong>de</strong> volume chez <strong>les</strong> animaux plus grands, l’imp<strong>la</strong>ntation <strong>de</strong> plusieurs<br />
embryons au même endroit en <strong>de</strong>vient plus difficile 46 . La chaleur et l’humidité <strong>de</strong> l’organisme<br />
jouent également un rôle, puisque <strong>les</strong> animaux au corps chaud et humi<strong>de</strong> produisent<br />
plus <strong>de</strong> sperme que <strong>les</strong> autres, <strong>la</strong> nature du sperme étant elle aussi chau<strong>de</strong> et humi<strong>de</strong> 47 .<br />
Pour résumer, on peut dire que selon Aristote, <strong>les</strong> animaux sanguins <strong>de</strong> taille mo<strong>de</strong>ste<br />
et qui sont particulièrement chauds et humi<strong>de</strong>s seront volontiers multipares, car ils produisent<br />
du sperme en abondance, lequel, en se divisant, permet <strong>la</strong> formation <strong>de</strong> plusieurs<br />
embryons 48 . Il se trouve que ces animaux multipares sont pour <strong>la</strong> plupart <strong>de</strong>s fissipè<strong>de</strong>s 49 .<br />
41. Ibid., IV, 6, 774 b 10-13.<br />
42. Ibid., II, 1, 732 a 31-32 ; cf. III, 3, 755 a 16-17.<br />
43. Ibid., IV, 4, 771 a 17-23.<br />
44. Ibid., IV, 4, 771 a 26-31. Une bonne partie du livre I <strong>de</strong> <strong>la</strong> Génération <strong>de</strong>s animaux est consacrée à l’étu<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> nature du sperme : ibid., I, 17-19, 721 a 31-726 b 30.<br />
45. Ibid., I, 18, 725 b 25-726 a 6.<br />
46. Ibid., IV, 4, 771 a 31-35.<br />
47. Ibid., IV, 4, 772 b 3-5.<br />
48. Sur le processus <strong>de</strong> division du sperme, voir ibid., IV, 4, 771 b 14-772 a 37. Aristote entend montrer que ce<br />
n’est pas <strong>la</strong> forme <strong>de</strong> l’utérus, sa division en régions ou replis bien distincts, qui est responsable <strong>de</strong> <strong>la</strong> multiparité,<br />
mais bien le sperme émis par le mâle. D’autre part, il cherche à établir que l’abondance du sperme,<br />
<strong>la</strong>quelle se traduit par un surcroît <strong>de</strong> puissance, a pour conséquence non un accroissement <strong>de</strong> <strong>la</strong> taille <strong>de</strong><br />
l’embryon, mais une augmentation du nombre d’embryons, à condition bien sûr que <strong>la</strong> femelle fournisse<br />
suffisamment <strong>de</strong> matière.<br />
49. Aristote précise bien que c’est <strong>la</strong> taille du corps qui est <strong>la</strong> cause du nombre <strong>de</strong> petits par portée, et non<br />
le fait d’être solipè<strong>de</strong>, fissipè<strong>de</strong> ou à pieds fourchus ; il se trouve seulement que <strong>la</strong> plupart du temps, ces<br />
<strong>de</strong>rnières différences correspon<strong>de</strong>nt aussi à <strong>de</strong>s différences <strong>de</strong> taille (ibid., IV, 4, 771 b 1-10). Pour l’absence<br />
<strong>de</strong> corré<strong>la</strong>tion systématique entre le critère <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>reproduction</strong> et celui <strong>de</strong> <strong>la</strong> locomotion, voir aussi ibid.,<br />
II, 1, 732 b 15-30, avec l’analyse qu’en donne ZUCKER 2005b, 154-156.<br />
Schedae, 2009, prépublication n°20, (fascicule n°2, p.153-188).<br />
http://www.unicaen.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint0202009.pdf<br />
159
160<br />
Cette multiparité a pour conséquence <strong>de</strong> raccourcir <strong>la</strong> durée <strong>de</strong> <strong>la</strong> gestation, si bien que<br />
<strong>les</strong> petits mis au mon<strong>de</strong> sont inachevés. Aristote propose ainsi une théorie d’ensemble <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> multiparité, qui ne porte pas spécifiquement sur l’ours, mais sur tous <strong>les</strong> animaux multipares.<br />
L’ours n’apparaît que comme élément d’une énumération qui l’englobe et le dépasse,<br />
sans que son cas particulier fasse l’objet d’investigations particulières. On peut même dire<br />
que l’ours s’inscrit plutôt <strong>mal</strong> <strong>dans</strong> le cadre ainsi <strong>de</strong>ssiné. Sans pouvoir rivaliser avec l’éléphant<br />
ou le chameau, l’ours n’en jouit pas moins d’une taille respectable, qui pourrait suffire<br />
à lui valoir une p<strong>la</strong>ce parmi <strong>les</strong> animaux <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> taille ; on pourrait donc penser que<br />
chez lui comme chez <strong>les</strong> animaux <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> taille, <strong>la</strong> nourriture passe surtout à l’accroissement<br />
du corps, d’autant plus qu’il a une nette tendance à se charger <strong>de</strong> graisse et qu’il ne<br />
prend pas <strong>de</strong> nourriture pendant l’hiver, toutes conditions qui ne sont guère favorab<strong>les</strong>,<br />
<strong>dans</strong> le cadre <strong>de</strong> <strong>la</strong> théorie aristotélicienne <strong>de</strong> <strong>la</strong> génération, à <strong>la</strong> production <strong>de</strong> ce résidu<br />
ultime <strong>de</strong> <strong>la</strong> nourriture que constitue le sperme 50 . D’autre part, comme le note Aristote<br />
<strong>dans</strong> l’Histoire <strong>de</strong>s Animaux, l’ours n’est pas toujours multipare, mais peut être aussi bien<br />
unipare ou paucipare 51 . Si l’ours, <strong>mal</strong>gré sa gran<strong>de</strong> taille et sa multiparité seulement occasionnelle,<br />
est intégré <strong>dans</strong> <strong>la</strong> série <strong>de</strong>s animaux multipares, c’est parce que <strong>la</strong> multiparité<br />
est <strong>la</strong> seule explication dont dispose Aristote pour rendre compte du caractère inachevé<br />
<strong>de</strong>s oursons nouveau-nés. L’ours constitue donc bien un problème pour <strong>la</strong> théorie embryologique<br />
aristotélicienne, mais c’est un problème dont Aristote ne s’est pas avisé ou qu’il<br />
n’a pas eu le loisir <strong>de</strong> traiter.<br />
Il reste à expliquer comment l’ourson nouveau-né achève son développement. Aristote<br />
indique que l’ourse lèche son petit à <strong>la</strong> naissance, comme le fait en particulier <strong>la</strong> chienne.<br />
En revenant sur ce léchage post partum à propos <strong>de</strong> <strong>la</strong> renar<strong>de</strong>, il apporte quelques éc<strong>la</strong>ircissements<br />
sur <strong>la</strong> fonction <strong>de</strong> l’opération : o{tan d v ejktevkh/, th'/<br />
glwvtth/ leivcousa ejkqermaivnei<br />
kai; sumpevttei, <strong>«</strong> après <strong>la</strong> mise bas, [<strong>la</strong> renar<strong>de</strong>], en <strong>les</strong> léchant avec sa <strong>la</strong>ngue, apporte <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> chaleur [à ses petits] et contribue à leur coction <strong>»</strong> 52 . Le motif du nouveau-né <strong>léché</strong> par sa<br />
mère n’est donc pas absent <strong>de</strong> l’œuvre biologique d’Aristote, mais il faut noter <strong>de</strong>ux différences<br />
essentiel<strong>les</strong> par rapport à <strong>la</strong> tradition postérieure. Le motif ne s’est pas fixé <strong>de</strong> manière<br />
privilégiée sur l’ours, mais concerne tout autant <strong>la</strong> renar<strong>de</strong> ou <strong>la</strong> chienne, cette <strong>de</strong>rnière<br />
étant <strong>de</strong> loin <strong>la</strong> plus facile à observer. En second lieu, et c’est le point capital, <strong>la</strong> mère ne<br />
façonne pas son petit. Il pourrait sembler que cette coction opérée par l’entremise <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
<strong>la</strong>ngue soit très proche d’une activité formative, mais ce n’est pas le cas et du reste, Aristote<br />
ne dit jamais que l’ourse ou une autre femelle multipare façonnent le corps <strong>de</strong>s nouveau-nés.<br />
Pour bien saisir <strong>la</strong> différence, il convient <strong>de</strong> se reporter à <strong>la</strong> théorie aristotélicienne <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> génération du vivant et au rôle qui y est dévolu à <strong>la</strong> chaleur 53 . Dans <strong>la</strong> <strong>reproduction</strong><br />
sexuée, <strong>la</strong> femelle apporte <strong>la</strong> matière, tandis que <strong>la</strong> semence du mâle est responsable <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> forme. Pour décrire l’action <strong>de</strong> <strong>la</strong> semence du mâle sur <strong>la</strong> matière fournie par <strong>la</strong> femelle,<br />
Aristote recourt à <strong>de</strong>s analogies empruntées au domaine <strong>de</strong>s différents arts humains 54 . La<br />
comparaison entre le processus <strong>de</strong> <strong>la</strong> génération et l’art du charpentier ou du potier lui<br />
permet ainsi <strong>de</strong> préciser que <strong>la</strong> semence du mâle, en donnant forme à <strong>la</strong> matière féminine,<br />
tient <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ce à <strong>la</strong> fois <strong>de</strong> l’outil du charpentier et <strong>de</strong> l’artisan qui le manie 55 . La métallurgie fournit<br />
un <strong>de</strong>uxième paradigme, qui permet d’expliciter le rôle <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaleur. Aristote utilise en<br />
50. Voir supra, note 44.<br />
51. HA, VI, 30, 579 a 20-21.<br />
52. Ibid., VI, 34, 580 a 9-10.<br />
53. Pour un exposé d’ensemble <strong>de</strong> <strong>la</strong> théorie d’Aristote sur <strong>la</strong> <strong>reproduction</strong> <strong>de</strong>s vivants, voir LESKY 1951, 1344-<br />
1417 ; NEEDHAM 1959, 37-60 ; voir aussi SISSA 1983. Sur le rôle <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaleur <strong>dans</strong> l’embryogenèse, voir<br />
LESKY 1951, 1362-1363 ; ALTHOFF 1992a ; 1992b, 175-256 ; BESNIER 1997.<br />
54. Sur ces analogies empruntées aux techniques humaines, voir BYL 1980, 149 et 199-200.<br />
55. GA, I, 21, 729 b 14-18 et surtout 22, 730 b 5-24.<br />
Schedae, 2009, prépublication n°20, (fascicule n°2, p. 153-188).<br />
http://www.unicaen.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint0202009.pdf
effet l’exemple <strong>de</strong> <strong>la</strong> fabrication d’une épée pour rappeler que l’épée n’est pas faite seulement<br />
par le feu et que le chaud et le froid ne suffisent pas comme causes : <strong>«</strong> le froid et le<br />
chaud font <strong>la</strong> dureté ou <strong>la</strong> mol<strong>les</strong>se du fer, mais ce qui fait une épée, c’est le mouvement<br />
<strong>de</strong>s outils employés <strong>»</strong>, sklhro;n me;n ga;r kai; <strong>mal</strong>ako;n to;n sivdhron poiei' to; qermo;n kai; to;<br />
yucro;n, ajl<strong>la</strong>; xivfo" hJ kivnhsi" hJ tw'n ojrgavnwn. De <strong>la</strong> même façon, ce qui fait pour Aristote<br />
<strong>les</strong> parties du corps, c’est <strong>«</strong> le mouvement <strong>la</strong>ncé par le géniteur mâle, qui est en acte ce à<br />
partir <strong>de</strong> quoi le petit est fait est en puissance <strong>»</strong>, hJ kivnhsi" hJ ajpo; tou' gennhvsanto" tou' ejnteleceiva/<br />
o[nto" o{ ejsti dunavmei tov ejx ou| givnetai 56 . C’est le mouvement <strong>la</strong>ncé par le géniteur<br />
mâle qui façonne l’embryon ; il ne saurait donc être question, pour Aristote, d’un façonnage<br />
post partum. Le petit ourson, à sa naissance, continue son développement en vertu<br />
du mouvement qui lui a été imprimé au début par le géniteur mâle. De même que ce n’est<br />
pas le feu qui fait l’épée, <strong>de</strong> <strong>la</strong> même façon ce n’est pas <strong>la</strong> chaleur communiquée par <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue<br />
<strong>de</strong> l’ourse qui façonne l’ourson.<br />
Il reste à préciser le rôle exact <strong>de</strong> cette chaleur, qui contribue à l’achèvement <strong>de</strong> l’ourson<br />
nouveau-né. Pour le comprendre, il faut se reporter aux analyses qu’Aristote consacre<br />
au mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> génération <strong>de</strong>s animaux ovipares. En effet, <strong>les</strong> développements re<strong>la</strong>tifs aux<br />
animaux vivipares passent complètement sous silence <strong>la</strong> chaleur du corps maternel et ne<br />
lui attribuent aucun rôle. La mère se borne à fournir <strong>la</strong> matière et <strong>la</strong> nourriture <strong>de</strong> l’embryon,<br />
tandis que <strong>la</strong> chaleur est apportée par <strong>la</strong> semence du mâle. C’est parce que <strong>la</strong> mère se<br />
borne à apporter <strong>la</strong> nourriture qu’Aristote peut écrire, à propos <strong>de</strong>s embryons <strong>de</strong>s ovipares,<br />
que <strong>«</strong> <strong>la</strong> mère est, pour ainsi dire, à l’intérieur <strong>de</strong> l’utérus <strong>»</strong>, w{sper a]n ei[ ti" ei[poi th;n<br />
mhtevra ejn th'/<br />
uJstevra/ ei\nai, en ce sens que <strong>la</strong> nourriture et l’embryon sont p<strong>la</strong>cés sous <strong>la</strong><br />
même enveloppe ; il y a donc équivalence entre <strong>la</strong> mère et <strong>la</strong> nourriture <strong>de</strong> l’embryon 57 . Le<br />
cas <strong>de</strong>s animaux ovipares conduit cependant Aristote à s’interroger sur le phénomène <strong>de</strong><br />
l’incubation et à examiner le rôle que joue <strong>la</strong> chaleur fournie <strong>de</strong> l’extérieur par <strong>la</strong> mère <strong>dans</strong><br />
<strong>la</strong> maturation et <strong>dans</strong> l’éclosion <strong>de</strong>s œufs. Si l’œuf a besoin d’une chaleur venue <strong>de</strong> l’extérieur<br />
pour poursuivre son développement, c’est que <strong>la</strong> chaleur est nécessaire au durcissement<br />
du b<strong>la</strong>nc, à partir duquel est formé l’embryon, et à <strong>la</strong> liquéfaction du jaune, lequel lui<br />
sert <strong>de</strong> nourriture. Cette chaleur, au <strong>de</strong>meurant, n’est pas forcément apportée à l’embryon<br />
par <strong>la</strong> mère, puisque <strong>la</strong> chaleur contenue <strong>dans</strong> le sol ou apportée par <strong>la</strong> saison peut remplir<br />
<strong>la</strong> même fonction 58 . Cette chaleur extérieure <strong>«</strong> contribue à <strong>la</strong> coction <strong>»</strong>, sumpevttei, <strong>de</strong><br />
l’embryon, <strong>de</strong> <strong>la</strong> même façon que <strong>les</strong> vigoureux coups <strong>de</strong> <strong>la</strong>ngue <strong>de</strong> <strong>la</strong> femelle multipare<br />
contribuent à <strong>la</strong> coction <strong>de</strong>s nouveau-nés encore inachevés 59 . En employant le verbe sum-<br />
pevttein, Aristote circonscrit étroitement le rôle joué par <strong>la</strong> chaleur extérieure <strong>dans</strong> l’embryogenèse.<br />
Cette chaleur ne saurait assurer à elle-seule <strong>la</strong> coction <strong>de</strong> l’embryon, encore moins<br />
gouverner l’ensemble du processus. En d’autres termes, elle n’est pas <strong>la</strong> cause motrice <strong>de</strong><br />
l’embryon, celle-ci étant, selon le point <strong>de</strong> vue auquel on se p<strong>la</strong>ce, soit le père, soit <strong>la</strong> semence<br />
du père. Un passage du livre II permet <strong>de</strong> mieux comprendre le rôle dévolu à <strong>la</strong> chaleur 60 :<br />
{Wsper <strong>de</strong>; ta; uJpo; th'" tevcnh" ginovmena givnetai dia; tw'n ojrgavnwn, e[sti d v ajlhqevsteron eijpei'n dia;<br />
th'" kinhvsew" aujtw'n, au{th d v ejsti;n hJ ejnevrgeia th'" tevcnh", hJ <strong>de</strong>; tevcnh morfh; tw'n ginomevnwn ejn<br />
a[llw/, ou{tw" hJ th'" qreptikh'" yuch'" duvnami", w{sper kai; ejn aujtoi'" toi'" zwv/oi"<br />
kai; toi'" futoi'"<br />
56. Ibid., II, 1, 734 b 19-735 a 4. Voir aussi <strong>la</strong> célèbre analogie <strong>de</strong> l’automate (ibid., II, 1, 734 b 9-19), qui permet<br />
<strong>de</strong> préciser <strong>la</strong> façon dont le mouvement <strong>la</strong>ncé par le géniteur mâle gouverne <strong>dans</strong> sa totalité le processus<br />
<strong>de</strong> formation <strong>de</strong> l’embryon.<br />
57. Ibid., III, 2, 753 b 30-754 a 9.<br />
58. Ibid., III, 2, 752 b 15-753 a 21.<br />
59. Ibid., III, 2, 752 b 17, 33 et 753 a 19 pour l’emploi du verbe sumpevttein.<br />
60. Ibid., II, 4, 740 b 25-34 (ARISTOTE (Louis 1961) modifiée sur un point) ; cf. <strong>de</strong> An. II, 4, 416 a 9-18 ; Resp., 8,<br />
474 a 25-b 14 ; PA, II, 7, 652 b 7-16. Sur ce texte, voir ALTHOFF 1992a, 190-192 ; 1992b, 206-208.<br />
Schedae, 2009, prépublication n°20, (fascicule n°2, p.153-188).<br />
http://www.unicaen.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint0202009.pdf<br />
161
162<br />
u{steron ejk th'" trofh'" poiei' th;n au[xhsin, crwmevnh oi|on ojrgavnoi" qermovthti kai; yucrovthti<br />
(ejn ga;r touvtoi" hJ kivnhsi" ejkeivnh", kai; lovgw/ tini; e{kaston givnetai), ou{tw kai; ejx ajrch'" sunivsthsi<br />
to; fuvsei ginovmenon.<br />
De même que <strong>les</strong> produits <strong>de</strong> l’art sont formés au moyen <strong>de</strong>s instruments ou, plus exactement,<br />
du mouvement <strong>de</strong> ces instruments, ce mouvement étant l’acte <strong>de</strong> l’art, et l’art étant <strong>la</strong> forme<br />
<strong>de</strong> ce qui est produit <strong>dans</strong> un autre objet, ainsi en est-il <strong>de</strong> <strong>la</strong> puissance <strong>de</strong> l’âme nutritive : <strong>de</strong><br />
même que plus tard, <strong>dans</strong> <strong>les</strong> animaux et <strong>les</strong> végétaux individualisés, cette âme produit <strong>la</strong> croissance<br />
à l’ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> nourriture, en utilisant comme instruments le chaud et le froid (car c’est en<br />
eux que se manifeste son mouvement, et chaque être se forme suivant une certaine proportion),<br />
<strong>de</strong> même aussi cette âme, dès le principe, réalise <strong>la</strong> formation <strong>de</strong> l’être qui naît suivant<br />
<strong>la</strong> nature.<br />
L’âme nutritive est celle que l’embryon possè<strong>de</strong> en premier, par l’intermédiaire du pneu'ma<br />
contenu <strong>dans</strong> le sperme 61 . L’âme nutritive prend en quelque sorte le re<strong>la</strong>is <strong>de</strong> <strong>la</strong> semence<br />
et gouverne <strong>la</strong> suite du processus <strong>de</strong> formation <strong>de</strong> l’embryon 62 . C’est elle en particulier qui<br />
détermine <strong>la</strong> juste proportion – lovgo" – <strong>de</strong> chaud et <strong>de</strong> froid permettant <strong>la</strong> constitution <strong>de</strong>s<br />
différentes parties <strong>de</strong> l’embryon 63 . L’analogie avec <strong>les</strong> techniques humaines permet <strong>de</strong><br />
reconnaître au chaud et au froid le statut d’instrument, d’outil, to; ojrgavnon. La chaleur<br />
apportée par le léchage post partum <strong>de</strong> l’ourson peut donc être décrite, par analogie,<br />
comme un instrument entre <strong>les</strong> mains <strong>de</strong> l’âme nutritive ; comme tout instrument, <strong>la</strong> chaleur<br />
ne constitue ici qu’une cause intermédiaire 64 . Il n’est donc pas question, pour Aristote, <strong>de</strong><br />
considérer l’ourse ou <strong>les</strong> autres femel<strong>les</strong> multipares comme <strong>la</strong> cause motrice <strong>de</strong> l’achèvement<br />
du nouveau-né, ni <strong>de</strong> considérer leur <strong>la</strong>ngue comme l’instrument d’un façonnement<br />
post partum. L’analogie avec <strong>les</strong> arts humains joue, comme nous l’avons vu, à un autre<br />
niveau : c’est <strong>la</strong> chaleur résultant <strong>de</strong> ce léchage post partum qui constitue l’instrument, et<br />
l’agent est l’âme nutritive <strong>de</strong> l’embryon ou le pneu`ma contenu <strong>dans</strong> le sperme masculin.<br />
Conformément au cadre fermement phallocratique <strong>de</strong> <strong>la</strong> théorie aristotélicienne <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
génération <strong>de</strong>s êtres vivants, le rôle d’agent est refusé, ici comme ailleurs, à <strong>la</strong> femelle 65 .<br />
La <strong>reproduction</strong> <strong>de</strong> l’ours <strong>dans</strong> le discours zoologique<br />
d’époque hellénistique et romaine<br />
Si <strong>les</strong> informations fournies par Aristote sur <strong>la</strong> <strong>reproduction</strong> <strong>de</strong> l’ours ont été soigneusement<br />
reprises <strong>dans</strong> <strong>les</strong> ouvrages postérieurs, <strong>la</strong> perspective biologique et physiologique<br />
61. Arist., <strong>de</strong> An., II, 3, 414 a 31-415 a 13; GA, II, 3, 736 a 24-737 a 34. Voir à ce sujet LESKY 1951, 1365-1369; MORAUX<br />
1955, 262-263 ; ALTHOFF 1992a ; FREUDENTHAL 1995, 22-29 et 114-115 ; BESNIER 1997, 46-47 et 53. Il est vrai<br />
que <strong>dans</strong> certains cas, <strong>la</strong> femelle est capable <strong>de</strong> fournir l’âme végétative en puissance, celle que comportent,<br />
par exemple, <strong>les</strong> œufs b<strong>la</strong>ncs non fécondés ; il reviendra alors au mâle <strong>de</strong> fournir l’âme sensitive : II,<br />
5, 741 a 6-b 7. On <strong>la</strong>issera <strong>de</strong> côté, <strong>dans</strong> le cadre restreint <strong>de</strong> cette contribution, <strong>les</strong> problèmes extraordinairement<br />
complexes posés par l’apparition <strong>de</strong>s facultés <strong>de</strong> l’âme et par leur rôle <strong>dans</strong> l’embryogénèse :<br />
voir à ce sujet MORAUX 1955.<br />
62. Ce principe <strong>de</strong> <strong>la</strong> croissance est contenu <strong>dans</strong> le cœur – ou son analogue –, partie qui apparaît <strong>la</strong> première<br />
et qui gouverne <strong>la</strong> suite <strong>de</strong> <strong>la</strong> croissance : voir GA, II, 1, 735 a 4-26. On notera cependant que l’embryon<br />
ne possè<strong>de</strong> l’âme nutritive qu’en puissance, <strong>dans</strong> <strong>la</strong> mesure où l’embryon n’a pas besoin <strong>de</strong> transformer<br />
<strong>la</strong> nourriture qu’il reçoit pour en faire un aliment adéquat, puisqu’il s’agit déjà <strong>de</strong> sang ; <strong>«</strong> ce<strong>la</strong> entraîne <strong>»</strong>,<br />
comme l’écrit BESNIER 1997, 47, <strong>«</strong> que, tout au moins au début <strong>de</strong> <strong>la</strong> vie embryonnaire, le pneu`ma qui était<br />
<strong>dans</strong> le sperme masculin reste un moteur qui agit comme un agent extérieur à l’embryon <strong>»</strong>.<br />
63. Voir à ce sujet BESNIER 1997, qui critique <strong>les</strong> positions <strong>de</strong> FREUDENTHAL 1995.<br />
64. Sur <strong>la</strong> position intermédiaire, entre le moteur et <strong>la</strong> fin, <strong>de</strong>s instruments, voir Ph., II, 3, 195 a 1-3 ; sur <strong>la</strong> chaleur<br />
comme sunaivtion, cf. <strong>de</strong> An., 416 a 15. Sur <strong>la</strong> chaleur vitale comme instrument à <strong>la</strong> fois <strong>de</strong> l’âme végétative<br />
et <strong>de</strong> l’âme sensitive, voir BESNIER 1997, 48-49.<br />
65. Cf. GA, II, 6, 741 b 37-38 : le souffle qui opère <strong>la</strong> différenciation <strong>de</strong>s parties ne saurait être celui <strong>de</strong> <strong>la</strong> mère.<br />
Schedae, 2009, prépublication n°20, (fascicule n°2, p. 153-188).<br />
http://www.unicaen.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint0202009.pdf
qui était celle d’Aristote n’a pas trouvé le même écho. À <strong>la</strong> différence <strong>de</strong> Théophraste, le<br />
successeur immédiat d’Aristote à <strong>la</strong> tête du Lycée, <strong>les</strong> penseurs <strong>de</strong> l’époque hellénistique<br />
n’ont pas montré beaucoup d’empressement à reprendre <strong>les</strong> principes et <strong>les</strong> métho<strong>de</strong>s du<br />
Stagirite pour poursuivre ses recherches <strong>dans</strong> le domaine <strong>de</strong> <strong>la</strong> zoologie et <strong>de</strong> <strong>la</strong> biologie.<br />
Conçue à l’origine comme une enquête systématique sur le vivant, l’historia s’est transformée,<br />
à l’époque hellénistique, en un travail d’appropriation, <strong>de</strong> mise en forme et <strong>de</strong> récriture<br />
du corpus zoologique aristotélicien, désormais considéré comme une somme inimitable<br />
et achevée. L’effort principal a dès lors porté sur l’exploitation et <strong>la</strong> réorganisation <strong>de</strong> l’abondante<br />
information contenue <strong>dans</strong> <strong>les</strong> œuvres zoologiques d’Aristote 66 . On s’est plus particulièrement<br />
attaché à regrouper <strong>les</strong> informations re<strong>la</strong>tives aux différentes espèces, qui<br />
apparaissaient dispersées <strong>dans</strong> l’œuvre d’Aristote 67 . On a pu constater cette dispersion à<br />
propos <strong>de</strong> l’ours, puisque <strong>les</strong> informations re<strong>la</strong>tives à cet ani<strong>mal</strong> sont disséminées <strong>dans</strong> <strong>les</strong><br />
livres II, V, VI, VII / VIII et VIII / IX <strong>de</strong> l’Histoire <strong>de</strong>s animaux, pour ne rien dire <strong>de</strong>s traités sur<br />
<strong>les</strong> Parties <strong>de</strong>s animaux et sur <strong>la</strong> Génération <strong>de</strong>s animaux. Cette orientation monographique<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> zoologie hellénistique, qui choisit <strong>les</strong> espèces comme objet ultime <strong>de</strong> ses investigations,<br />
organise en particulier <strong>de</strong>ux œuvres qui ont joué un rôle capital <strong>dans</strong> <strong>la</strong> transmission<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> zoologie aristotélicienne, <strong>les</strong> Zwi>ka pseudo-aristotéliciens et l’Épitomé d’Aristophane<br />
<strong>de</strong> Byzance 68 . Si <strong>les</strong> Zwi>ka sont presque entièrement perdus, il n’en va pas <strong>de</strong> même pour<br />
l’Épitomé d’Aristophane <strong>de</strong> Byzance, dont <strong>de</strong> <strong>la</strong>rges extraits ont été compilés à l’époque<br />
byzantine à l’instigation <strong>de</strong> Constantin Porphyrogénète 69 . Le livre I <strong>de</strong> l’Épitomé est consa-<br />
cré à <strong>la</strong> question <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>reproduction</strong> ; il a été conservé <strong>dans</strong> son intégralité <strong>dans</strong> un manuscrit<br />
parisien du XIV e siècle (Paris. Suppl. Gr. 495), qui contient le premier livre <strong>de</strong> <strong>la</strong> Sulloghv<br />
byzantine. Ce n’est que <strong>dans</strong> <strong>les</strong> trois livres suivants qu’Aristophane adoptait un ordre<br />
d’exposition monographique, en traitant d’abord <strong>de</strong>s vivipares, puis <strong>de</strong>s ovipares. Le livre II,<br />
re<strong>la</strong>tif aux vivipares, est le seul dont <strong>de</strong> <strong>la</strong>rges extraits nous soient parvenus par l’intermédiaire<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Sulloghv byzantine, dont le <strong>de</strong>uxième livre n’est connu que par un unique manus-<br />
crit du Mont Athos (Athous 3714 Lambros = Dionysiou 180), lui aussi du XIV e siècle ; <strong>les</strong><br />
passages d’Aristophane <strong>de</strong> Byzance sont suivis et complétés, pour chaque ani<strong>mal</strong>, par <strong>de</strong>s<br />
informations tirées d’auteurs variés. Les livres suivants <strong>de</strong> <strong>la</strong> Sulloghv byzantine ont entraîné<br />
<strong>dans</strong> leur naufrage le reste <strong>de</strong> l’Épitomé d’Aristophane 70 .<br />
Successeur d’Ératosthène à <strong>la</strong> tête <strong>de</strong> <strong>la</strong> prestigieuse Bibliothèque d’Alexandrie <strong>dans</strong><br />
<strong>les</strong> <strong>de</strong>rnières années du III e siècle avant notre ère, grand érudit, Aristophane <strong>de</strong> Byzance<br />
est plus connu pour son œuvre <strong>de</strong> philologue et <strong>de</strong> grammairien que pour sa contribution<br />
66. Voir à ce sujet <strong>les</strong> analyses nuancées <strong>de</strong> ZUCKER 2005a, 301-311 et 322-323.<br />
67. ZUCKER 2005a, 310-311.<br />
68. La nature exacte <strong>de</strong>s rapports qui unissent ces <strong>de</strong>ux œuvres est très discutée. La thèse <strong>de</strong> l’i<strong>de</strong>ntité entre<br />
<strong>les</strong> <strong>de</strong>ux œuvres, soutenue notamment par ROSE (1863, 276-285), par DE STEFANI (1904, 433-434) et par<br />
WELLMANN (1891a, 487, note 1 et surtout 1916, 8), a été révoquée en doute par SUSEMIHL (1891, I, 443,<br />
note 50) et par KROLL (1940, 28-30). KROLL (1940) propose <strong>de</strong> voir <strong>dans</strong> l’Épitomé d’Aristophane <strong>de</strong><br />
Byzance un abrégé <strong>de</strong>s Zwi>ka ; il a été suivi sur ce point par DÜRING 1966, 513. Sur cette question, on se<br />
reportera à <strong>la</strong> mise au point pru<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> KULLMANN 1998, 128-129.<br />
69. L’édition <strong>de</strong> référence <strong>de</strong> <strong>la</strong> Sulloghv byzantine est celle <strong>de</strong> Lambros, parue en 1885 <strong>dans</strong> le Supplementum<br />
Aristotelicum. Sur cette œuvre, voir LEMERLE 1971, 296-297. Sur <strong>les</strong> sullogaiv byzantines <strong>de</strong> l’époque<br />
<strong>de</strong> Constantin VII Porphyrogénète, voir aussi ODORICO 1990, qui critique certaines positions défendues<br />
<strong>dans</strong> l’ouvrage c<strong>la</strong>ssique <strong>de</strong> LEMERLE 1971. Inconnus <strong>de</strong> NAUCK 1848, <strong>les</strong> fragments <strong>de</strong> l’Épitomé d’Aristophane<br />
<strong>de</strong> Byzance n’ont pas été repris par W. J. S<strong>la</strong>ter <strong>dans</strong> l’édition qu’il a donnée en 1986 <strong>de</strong>s Fragments<br />
d’Aristophane <strong>de</strong> Byzance ; W. J. S<strong>la</strong>ter se contente sur ce point <strong>de</strong> renvoyer à l’édition <strong>de</strong> Lambros.<br />
70. Sur <strong>la</strong> tradition manuscrite médiévale <strong>de</strong> l’Épitomé d’Aristophane <strong>de</strong> Byzance, qui n’est connu que par un<br />
petit nombre <strong>de</strong> manuscrits et sous une forme mutilée, voir LAMBROS 1885, IX-XVII, à compléter par DE<br />
STEFANI 1904 pour un manuscrit <strong>de</strong> <strong>la</strong> Laurentiana (Laur. gr. 86, 8, ff. 322 v -324 r = 323 v -325 r ), qui contient <strong>de</strong><br />
très brefs extraits <strong>de</strong>s livres I et II. À <strong>la</strong> tradition manuscrite médiévale, il convient d’ajouter un unique<br />
témoignage papyrologique, le P. Lit. Lond. 164 (Brit. Libr. inv. 2242, ed. pr. Milne 1922, ed. post. Roselli<br />
1979), qui contient un fragment re<strong>la</strong>tif aux chiens <strong>de</strong> Molossie.<br />
Schedae, 2009, prépublication n°20, (fascicule n°2, p.153-188).<br />
http://www.unicaen.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint0202009.pdf<br />
163
164<br />
au domaine <strong>de</strong>s sciences naturel<strong>les</strong> 71 . En rédigeant un épitomé <strong>de</strong> l’œuvre zoologique<br />
d’Aristote qui en modifie radicalement l’agencement, Aristophane ne fait qu’appliquer à<br />
une autre sphère <strong>les</strong> principes qui ont présidé à <strong>la</strong> pinacographie, cette vaste entreprise<br />
d’inventaire méthodique et <strong>de</strong> c<strong>la</strong>ssement <strong>de</strong>s livres innombrab<strong>les</strong> accumulés <strong>dans</strong> <strong>la</strong><br />
Bibliothèque d’Alexandrie 72 . C’est à Callimaque que l’on doit <strong>les</strong> monumenta<strong>les</strong> Tab<strong>les</strong><br />
(Pivnake") <strong>de</strong>s auteurs qui se sont illustrés <strong>dans</strong> tout secteur <strong>de</strong> <strong>la</strong> culture et <strong>de</strong>s œuvres<br />
qu’ils ont écrites, qui ne comptaient pas moins <strong>de</strong> cent vingt livres et qui furent complétées,<br />
cinquante ans plus tard, par Aristophane <strong>de</strong> Byzance 73 . En fournissant d’emblée <strong>de</strong>s<br />
bibliographies sectoriel<strong>les</strong>, <strong>les</strong> Tab<strong>les</strong> <strong>de</strong> Callimaque et d’Aristophane fournissaient plus<br />
qu’un simple catalogue <strong>de</strong>s livres <strong>de</strong> <strong>la</strong> Bibliothèque ; el<strong>les</strong> constituent une entreprise inédite<br />
d’inventaire et <strong>de</strong> mise en ordre <strong>de</strong> <strong>la</strong> mémoire écrite <strong>de</strong> l’humanité, qui conduit au<br />
démembrement <strong>de</strong> <strong>la</strong> tradition et à sa réorganisation en fonction <strong>de</strong> champs disciplinaires<br />
préa<strong>la</strong>blement définis 74 . Démembrement et réorganisation, telle est bien <strong>la</strong> double opération<br />
qui prési<strong>de</strong> à <strong>la</strong> composition <strong>de</strong> l’Épitomé d’Aristophane, dont le but avoué est <strong>de</strong> permettre<br />
<strong>de</strong> maîtriser plus facilement <strong>les</strong> connaissances zoologiques réunies <strong>dans</strong> <strong>les</strong> œuvres<br />
biologiques d’Aristote. Il n’est que <strong>de</strong> relire, pour s’en convaincre, le début du livre II <strong>de</strong><br />
l’Épitomé : <strong>«</strong> je vais présenter à votre intention, pour chaque ani<strong>mal</strong> en particulier, <strong>les</strong> fonctions,<br />
<strong>les</strong> mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> vie, et aussi <strong>les</strong> habitu<strong>de</strong>s et le nombre d’années que peut vivre chacun<br />
d’eux, car j’estime qu’il vaut <strong>la</strong> peine d’en faire le compte rendu écrit. Dans cette partie, qui<br />
est <strong>la</strong> <strong>de</strong>uxième, je vais entreprendre, en indiquant en tête le nom <strong>de</strong> l’ani<strong>mal</strong> dont je traite,<br />
d’indiquer <strong>dans</strong> l’ordre et à <strong>la</strong> suite toutes <strong>les</strong> parties anatomiques que possè<strong>de</strong> l’ani<strong>mal</strong> en<br />
question, puis son mo<strong>de</strong> d’accouplement, le nombre <strong>de</strong> mois que dure <strong>la</strong> gestation, et sur<br />
le chapitre <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>reproduction</strong>, comment et combien <strong>de</strong> petits <strong>la</strong> femelle est capable d’enfanter.<br />
Et après ces aspects, le mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> vie <strong>de</strong> l’ani<strong>mal</strong> en question, son tempérament et sa<br />
longévité. J’ai entrepris cette tâche pour vous permettre d’accé<strong>de</strong>r à l’ensemble <strong>de</strong><br />
l’œuvre zoologique d’Aristote, qui est disséminée <strong>dans</strong> plusieurs livres, et mettre à votre<br />
disposition, regroupées au même endroit, toutes <strong>les</strong> connaissances acquises sur chaque<br />
ani<strong>mal</strong>, l’un après l’autre <strong>»</strong> 75 .<br />
La notice consacrée à l’ours respecte parfaitement ce programme 76 . Je n’en citerai que<br />
ce qui concerne l’accouplement, <strong>la</strong> gestation et <strong>la</strong> mise bas 77 :<br />
ΔOrga'/<br />
<strong>de</strong>; hJ a[rkto" a[llote a[llw" : kairo;" <strong>de</strong>; th'" kuhvsew" aujth'/<br />
oujk e[stin eJstwv". ΔOceuvousi <strong>de</strong>;<br />
parakeklimevnoi oiJ a[rrene" pro;" ta; ojpivsqia tw'n qhlei'wn. Kuvei <strong>de</strong>; pavsa" ta;" hJmevra"<br />
tria;konta : tivktei <strong>de</strong>; e}n o{ e[sti tw'/<br />
megevqei e[<strong>la</strong>tton me;n galh'", mei'zwn <strong>de</strong>; muov", a[narqron kai;<br />
tuflovn. Qerapeuvei <strong>de</strong>; to; skumnivon kaqavper kai; hJ kuvwn.<br />
71. Sur Aristophane <strong>de</strong> Byzance, voir SUSEMIHL 1892, I, 428-448 ; COHN 1895 ; PFEIFFER 1968, 171-209 ; GOULET<br />
1989.<br />
72. Pour une analyse simi<strong>la</strong>ire à propos <strong>de</strong> l’œuvre paradoxographique <strong>de</strong> Callimaque, voir FRASER 1972, I,<br />
454.<br />
73. Call., fr. 429-453 PFEIFFER ; Ar. Byz., fr. 368-369, SLATER 1986.<br />
74. Sur <strong>la</strong> pinacographie, voir PFEIFFER 1968, 126-134 ; BLUM 1977 ; BLUM 1983, col. 19-28 ; VEGETTI 1992, 596 ;<br />
JACOB 1992, 102-103 ; MESSINA 1994 ; JACOB 1998, 25-27.<br />
75. Ar. Byz., Epit., II, 1 (LAMBROS 1885, 35-36) : ΔEn th/ `<strong>de</strong> th/ `suntavxei, to;n ajriqmo;n ou[sh/<strong>de</strong>utevra/, peiravsomai,<br />
progravfwn peri; ouJ~<br />
ejstin oJ lovgo" zw/ vou o{noma, prosupotavssein touvtw/o{sa to; protacqe;n zw/ òn movria<br />
kevkthtai, eij~ta<br />
peri; th`" ojceiva" aujtou` kai; povsou" kuvein duvnatai mh`na", periv te th`" ejktevxew" poià kai;<br />
povsa uJpomevnei tivktein brevfh: ejpi; pa`si <strong>de</strong>; tiv" oJ bivo" tou` prografevnto" zw/ vou kai; poiòn to; hj~qo"<br />
kai; povsa<br />
duvnatai zh`n e[th. Tou`to <strong>de</strong>; ejpeiravsqhn poih`sai, i{na mhvdih/ rhmevnhn ejn polloi`" th;n uJpo; ΔAristotevlou"<br />
peri; zw/ vwn pragmateivan ejpiporeuvh/, sunhgmevnhn <strong>de</strong>; oJmou` pa`san th;n ejf v eJni; eJkavstw/zwv/w/iJstorivan e[ch/"<br />
(ZUCKER 2005a, 308-309).<br />
76. Ar. Byz., Epit., II, 326-336 (LAMBROS 1885, 101-102).<br />
77. Ar. Byz., Epit., 329-331 (ibid., 102).<br />
Schedae, 2009, prépublication n°20, (fascicule n°2, p. 153-188).<br />
http://www.unicaen.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint0202009.pdf
L’ourse ne désire pas l’accouplement à une date déterminée, et le moment favorable à <strong>la</strong> grossesse<br />
n’est pas fixe. Les mâ<strong>les</strong> s’accouplent en se couchant contre l’arrière-train <strong>de</strong>s femel<strong>les</strong>.<br />
La gestation dure en tout trente jours. L’ourse met bas un seul petit, d’une taille inférieure à<br />
celle d’une belette, mais supérieure à celle d’une souris, dépourvu d’articu<strong>la</strong>tions et aveugle.<br />
Elle s’occupe <strong>de</strong> son petit <strong>de</strong> <strong>la</strong> même façon que <strong>la</strong> chienne.<br />
En ce qui concerne l’accouplement et <strong>la</strong> gestation <strong>de</strong> l’ourse, Aristophane supprime<br />
l’incohérence présente <strong>dans</strong> le texte d’Aristote. S’il conserve <strong>la</strong> durée <strong>de</strong> <strong>la</strong> gestation donnée<br />
par Aristote, il ne fixe plus l’accouplement au mois <strong>de</strong> mars, mais préfère lui assigner<br />
une date variable, et il ne dit rien <strong>de</strong> <strong>la</strong> mise bas pendant l’hibernation. Ce silence ne tient<br />
pas seulement à <strong>la</strong> nature du texte d’Aristophane, qui opère une sélection <strong>dans</strong> <strong>les</strong> données<br />
aristotéliciennes, mais s’explique surtout par l’assignation d’une date variable à l’accouplement.<br />
Si l’accouplement peut intervenir à différents moments <strong>de</strong> l’année et si <strong>la</strong> gestation<br />
dure trente jours, il s’ensuit que <strong>la</strong> date <strong>de</strong> <strong>la</strong> mise bas est elle aussi variable. En adoptant<br />
cette solution au problème posé par le texte d’Aristote, Aristophane <strong>de</strong> Byzance tombe<br />
<strong>dans</strong> une autre difficulté, puisque <strong>la</strong> mise bas <strong>de</strong> l’ourse n’intervient plus forcément pendant<br />
l’hibernation, ce qui est contredit par l’expérience. Cette difficulté est cependant dissimulée<br />
par l’absence <strong>de</strong> toute précision re<strong>la</strong>tive à <strong>la</strong> date <strong>de</strong> mise bas. Pour le reste,<br />
Aristophane reprend fidèlement <strong>les</strong> indications d’Aristote, sauf en ce qui concerne le nombre<br />
<strong>de</strong> petits par portée, dont il ne retient que l’estimation inférieure. Cette simplification<br />
a pour conséquence involontaire <strong>de</strong> ruiner l’explication aristotélicienne <strong>de</strong> l’inachèvement<br />
<strong>de</strong> l’ourson nouveau-né par <strong>la</strong> multiparité. En ce qui concerne <strong>les</strong> soins prodigués aux oursons,<br />
Aristophane se contente <strong>de</strong> dire que l’ourse s’occupe <strong>de</strong> ses petits comme <strong>la</strong> chienne,<br />
ce qui renvoie implicitement au motif du léchage post partum.<br />
Aristophane <strong>de</strong> Byzance, on le voit, n’apporte rien <strong>de</strong> nouveau sur <strong>la</strong> question <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
<strong>reproduction</strong> <strong>de</strong> l’ours, et telle n’était pas, au <strong>de</strong>meurant, l’ambition d’un ouvrage qui se<br />
présentait comme un simple épitomé <strong>de</strong> l’œuvre zoologique foisonnante d’Aristote. Il ne<br />
s’en montre pas moins attentif, en critique averti, habitué à éditer <strong>les</strong> gran<strong>de</strong>s œuvres en<br />
en éliminant <strong>les</strong> incohérences manifestes, aux difficultés posées par le texte d’Aristote. Son<br />
épitomé constitue en outre un jalon important <strong>dans</strong> <strong>la</strong> transmission du savoir zoologique<br />
péripatéticien 78 . Il permet en particulier <strong>de</strong> comprendre <strong>la</strong> forme que revêt l’exposé zoologique<br />
<strong>dans</strong> l’Histoire naturelle <strong>de</strong> Pline.<br />
Dans le livre VIII <strong>de</strong> l’Histoire naturelle, qui est consacré aux animaux terrestres, Pline<br />
adopte en effet le mo<strong>de</strong> d’exposition monographique, ani<strong>mal</strong> par ani<strong>mal</strong>, qui est celui <strong>de</strong>s<br />
compi<strong>la</strong>tions hellénistiques 79 . Les développements qu’il consacre aux différents animaux<br />
sont eux aussi organisés par un certain nombre <strong>de</strong> rubriques récurrentes, quoiqu’avec<br />
beaucoup plus <strong>de</strong> soup<strong>les</strong>se que <strong>dans</strong> l’Épitomé d’Aristophane <strong>de</strong> Byzance 80 . En ce qui<br />
concerne l’ours, Pline s’intéresse d’abord à <strong>la</strong> <strong>reproduction</strong> <strong>de</strong> l’espèce, avant d’en venir à<br />
l’hibernation. Les <strong>de</strong>ux questions, qui relèvent <strong>de</strong> ce qu’Aristote appe<strong>la</strong>it <strong>les</strong> pravxei",<br />
apparaissent au <strong>de</strong>meurant comme liées, puisque <strong>la</strong> mise bas <strong>de</strong> l’ourse intervient pendant<br />
l’hibernation et que Pline revient sur <strong>les</strong> soins prodigués aux petits en par<strong>la</strong>nt <strong>de</strong> l’hibernation.<br />
Les considérations re<strong>la</strong>tives à <strong>la</strong> <strong>reproduction</strong> et à l’hibernation occupent à el<strong>les</strong> seu<strong>les</strong> <strong>les</strong><br />
78. L’Épitomé d’Aristophane était en particulier connu d’Artémidore <strong>de</strong> Daldis (Artem., II, 14 = Ar. Byz., Epit.,<br />
fr. 377, 2, SLATER 1986) et <strong>de</strong> Jean le Lydien (De magistr., III, 63 = Ar. Byz., Epit., fr. 377, 1 SLATER 1986). Des<br />
extraits <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux premiers livres avaient été sélectionnés par Sopatros d’Apamée pour ses Extraits variés<br />
(Phot., Bibl., 161, 104 b 33, II, p. 128 Henry).<br />
79. Sur <strong>les</strong> <strong>sources</strong> péripatéticiennes <strong>de</strong> Pline <strong>dans</strong> <strong>les</strong> livres zoologiques <strong>de</strong> l’Histoire naturelle, on se reportera<br />
à l’étu<strong>de</strong> c<strong>la</strong>ssique <strong>de</strong> KROLL 1940. Voir aussi KROLL 1951, col. 309-310. BONA 1991 n’est en revanche<br />
d’aucun secours sur ce point.<br />
80. Sur <strong>les</strong> rubriques qui organisent <strong>les</strong> développements pliniens, voir BODSON 1997.<br />
Schedae, 2009, prépublication n°20, (fascicule n°2, p.153-188).<br />
http://www.unicaen.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint0202009.pdf<br />
165
166<br />
<strong>de</strong>ux tiers <strong>de</strong> <strong>la</strong> notice. Pline note ensuite rapi<strong>de</strong>ment quelques particu<strong>la</strong>rités re<strong>la</strong>tives à <strong>la</strong><br />
conformation <strong>de</strong> l’ours – faib<strong>les</strong>se <strong>de</strong> sa tête –, à son mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> locomotion – bipédie occasionnelle,<br />
façon <strong>de</strong> grimper aux arbres –, à ses techniques <strong>de</strong> prédation, pour finir, comme<br />
il le fait souvent, par le rôle joué par l’ani<strong>mal</strong> <strong>dans</strong> <strong>les</strong> uenationes <strong>de</strong> Rome 81 . Seul le début<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> notice nous retiendra ici 82 :<br />
Eorum coitus hiemis initio nec uulgari quadripedum more, sed ambobus cubantibus<br />
conplexisque ; <strong>de</strong>in secessus in specus separatim, in quibus pariunt XXX die plurimum quinos.<br />
Hi sunt candida informisque caro, paulo muribus maior, sine oculis, sine pilo ; ungues tantum<br />
prominent. Hanc <strong>la</strong>mbendo pau<strong>la</strong>tim figurant. Nec quicquam rarius quam parientem ui<strong>de</strong>re<br />
ursam. I<strong>de</strong>o mares quadragenis diebus <strong>la</strong>tent, feminae quaternis mensibus. […] Fetus rigentes<br />
adprimendo pectori fouent non alio incubitu quam ad oua uolucres.<br />
Les ours s’accouplent au commencement <strong>de</strong> l’hiver, non pas à <strong>la</strong> façon ordinaire <strong>de</strong>s quadrupè<strong>de</strong>s,<br />
mais tous <strong>de</strong>ux couchés et s’embrassant ; puis ils se séparent et se retirent chacun <strong>dans</strong><br />
<strong>de</strong>s cavernes, où <strong>la</strong> femelle met bas au bout <strong>de</strong> trente jours le plus souvent cinq petits. Ce sont<br />
<strong>de</strong>s masses <strong>de</strong> chair b<strong>la</strong>nches et informes, un peu plus grosses que <strong>de</strong>s rats, sans yeux, sans<br />
poil ; seuls <strong>les</strong> ong<strong>les</strong> dépassent. En léchant cette masse, <strong>les</strong> mères lui donnent forme peu à<br />
peu. Rien n’est plus rare que <strong>de</strong> voir une ourse mettre bas. Aussi tandis que <strong>les</strong> mâ<strong>les</strong> restent<br />
cachés seulement quarante jours, <strong>les</strong> femel<strong>les</strong> le <strong>de</strong>meurent pendant quatre mois. […] Ils<br />
réchauffent leurs petits g<strong>la</strong>cés <strong>de</strong> froid en <strong>les</strong> serrant contre leur poitrine, <strong>les</strong> couvant comme<br />
<strong>les</strong> vo<strong>la</strong>ti<strong>les</strong> font <strong>de</strong> leurs œufs.<br />
Ce que dit Pline <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>reproduction</strong> <strong>de</strong> l’ours est globalement conforme à l’enseignement<br />
d’Aristote, <strong>mal</strong>gré <strong>de</strong>s inadvertances et quelques différences significatives. La première<br />
concerne l’accouplement. Pour Aristote, l’ours s’accouple comme <strong>la</strong> plupart <strong>de</strong>s quadrupè<strong>de</strong>s :<br />
le mâle monte sur <strong>la</strong> femelle, ventre contre croupe 83 ; <strong>la</strong> seule particu<strong>la</strong>rité <strong>de</strong>s ours <strong>dans</strong><br />
ce domaine est que <strong>la</strong> femelle, au lieu <strong>de</strong> rester campée sur ses quatre pattes, peut s’allonger<br />
sur le sol, mais toujours <strong>dans</strong> <strong>la</strong> même position 84 . Cette <strong>de</strong>rnière précision a été <strong>mal</strong><br />
comprise par Pline, qui imagine que <strong>les</strong> <strong>de</strong>ux partenaires sont allongés l’un contre l’autre,<br />
ventre contre ventre, et non plus ventre contre croupe. Cette légère erreur a pour effet<br />
d’humaniser l’ours et <strong>de</strong> rapprocher <strong>les</strong> ébats <strong>de</strong> cette espèce <strong>de</strong> ceux d’un couple humain.<br />
Pline le dit plus explicitement encore <strong>dans</strong> le livre X : <strong>les</strong> ours s’accouplent <strong>«</strong> allongés comme<br />
<strong>les</strong> hommes <strong>»</strong>, humanitus strati 85 . La secon<strong>de</strong> inadvertance porte sur <strong>la</strong> traduction du participe<br />
grec kuvousa, qui est rendu par le <strong>la</strong>tin pariens ; <strong>dans</strong> le développement <strong>de</strong> Pline, il<br />
n’est plus question <strong>de</strong> capturer une ourse pleine – ce qui était une confirmation <strong>de</strong> <strong>la</strong> brièveté<br />
<strong>de</strong> sa gestation –, mais seulement d’observer, ui<strong>de</strong>re, une ourse au moment <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
mise bas, ce qui n’est guère étonnant, étant donné que l’ourse met bas <strong>dans</strong> sa tanière<br />
hivernale. Il existe d’autres différences mineures entre <strong>les</strong> informations fournies par l’Histoire<br />
<strong>de</strong>s animaux et le texte <strong>de</strong> Pline. Du nombre <strong>de</strong> petits indiqués par Aristote, Pline ne retient<br />
ainsi que l’estimation supérieure. Il mentionne, toujours à <strong>la</strong> suite d’Aristote, le caractère<br />
inachevé <strong>de</strong>s oursons nouveau-nés, tout en ajoutant que <strong>les</strong> ong<strong>les</strong> sont déjà formés, ce<br />
qui est exact 86 .<br />
81. Plin., nat., VIII, 126-131. Sur ce passage, voir BONA 1991, 165-174.<br />
82. Plin., nat., VIII, 126-127 (A. Ernout (trad.), Paris, Les Bel<strong>les</strong> Lettres (CUF), 1952).<br />
83. Voir Arist., HA, V, 3, 540 a 27-28 ; cf. PA, IV, 10, 689 a 32.<br />
84. Arist., HA, V, 2, 539 b 33-540 a 3 ; VI 30, 579 a 18-19.<br />
85. Plin., nat., X, 174. Sur l’opposition entre <strong>la</strong> position caractéristique <strong>de</strong> l’homme et celle qui caractérise au<br />
contraire <strong>les</strong> quadrupè<strong>de</strong>s, voir aussi Lucr., IV, 1265-1267, qui soutient que <strong>la</strong> position ferarum quadrupedumque<br />
ritu est plus propice à <strong>la</strong> conception.<br />
86. COUTURIER 1954, 467-468 ; PARDE et CAMARRA 1992, 10.<br />
Schedae, 2009, prépublication n°20, (fascicule n°2, p. 153-188).<br />
http://www.unicaen.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint0202009.pdf
La principale divergence du passage <strong>de</strong> Pline avec l’Histoire <strong>de</strong>s animaux porte sur <strong>la</strong><br />
date <strong>de</strong> l’accouplement, que Pline – ou sa source – p<strong>la</strong>ce au début <strong>de</strong> l’hiver. Il supprime<br />
ainsi <strong>la</strong> contradiction présente <strong>dans</strong> le développement d’Aristote et propose une séquence<br />
cohérente : l’ours s’accouple au début <strong>de</strong> l’hiver et <strong>la</strong> femelle met bas trente jours plus tard,<br />
<strong>dans</strong> sa tanière hivernale. On remarquera que <strong>la</strong> solution retenue par Pline n’est pas celle<br />
adoptée par Aristophane <strong>de</strong> Byzance, ce qui confirme, comme l’a bien vu Kroll, que l’Épitomé<br />
d’Aristophane <strong>de</strong> Byzance n’est pas <strong>«</strong> l’Aristote <strong>de</strong> Pline <strong>»</strong> 87 . Il existe une autre différence<br />
importante entre l’exposé d’Aristote et celui <strong>de</strong> Pline, qui touche au traitement <strong>de</strong>s<br />
petits. Ce que Pline dit <strong>de</strong> l’ourse réchauffant ses petits est certes parfaitement conforme<br />
à l’enseignement d’Aristote, <strong>de</strong> même que <strong>la</strong> comparaison avec l’incubation. Pline, en<br />
revanche, s’écarte notablement d’Aristote lorsqu’il écrit que <strong>les</strong> ourses <strong>«</strong> donnent forme <strong>»</strong>,<br />
figurant, à leurs petits en léchant. L’ourse qui donne forme à ses petits constitue en effet,<br />
comme nous l’avons vu, une interprétation non aristotélicienne du léchage <strong>de</strong>s petits par<br />
leur mère. La différence rési<strong>de</strong> <strong>dans</strong> le fait que <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue <strong>de</strong> <strong>la</strong> mère façonne <strong>les</strong> petits,<br />
jouant le rôle d’un outil, comme le dit très explicitement Plutarque <strong>dans</strong> son petit traité Sur<br />
l’amour maternel 88 :<br />
ÔH d j a[rkto", ajgriwvtaton kai; skuqrwpovtaton qhrivon, a[morfa kai; a[narqra tivktei, th'/<br />
<strong>de</strong>;<br />
glwvtth/ kaqavper ejrgaleivw/ diatupou'sa tou;" uJmevna" ouj dokei' genna'n movnon, ajl<strong>la</strong>; kai;<br />
dhmiourgei'n to; tevknon.<br />
L’ourse, une bête <strong>de</strong>s plus sauvages et <strong>de</strong>s plus farouches, met bas <strong>de</strong>s êtres difformes et<br />
désarticulés, mais avec sa <strong>la</strong>ngue, comme avec un outil, elle donne forme à leurs membranes,<br />
<strong>de</strong> sorte que, croit-on, elle ne se contente pas d’enfanter son ourson, mais qu’elle le façonne.<br />
Cette interprétation du léchage <strong>de</strong>s petits n’est pas une innovation <strong>de</strong> Pline. Elle se<br />
rencontre en effet antérieurement <strong>dans</strong> <strong>la</strong> littérature <strong>la</strong>tine. Si l’on en croit une tradition fermement<br />
établie qui remonte peut-être à Varius Rufus, l’ami et exécuteur testamentaire <strong>de</strong><br />
Virgile 89 , et dont Suétone s’est fait l’écho, Virgile aurait p<strong>la</strong>isamment utilisé l’exemple <strong>de</strong><br />
l’ourse pour expliquer sa manière <strong>de</strong> composer <strong>les</strong> Géorgiques. Selon cette tradition, le<br />
poète dictait le matin un grand nombre <strong>de</strong> vers, qu’il passait <strong>la</strong> journée à retravailler et à<br />
corriger, pour arriver le soir à un tout petit nombre <strong>de</strong> vers d’une facture achevée ; Virgile<br />
se serait comparé à une ourse léchant ses petits et leur donnant forme peu à peu 90 . L’ourse<br />
qui donne forme à ses petits réapparaît <strong>dans</strong> <strong>les</strong> Métamorphoses d’Ovi<strong>de</strong>, au livre XV. Les<br />
petits <strong>de</strong> l’ours sont en effet l’un <strong>de</strong>s exemp<strong>les</strong> pris par Pythagore, <strong>dans</strong> son long discours,<br />
pour illustrer le caractère instable et transitoire <strong>de</strong> toute forme 91 :<br />
Nec catulus, partu quem reddidit ursa recenti,<br />
sed <strong>mal</strong>e uiua caro est ; <strong>la</strong>mbendo mater in artus<br />
fingit et in formam, quantam capit ipsa, reducit.<br />
87. KROLL 1940, 29-30.<br />
88. Plu., De l’amour <strong>de</strong> <strong>la</strong> progéniture = Mor. 494 c (J. Dumortier et J. Defradas (trad.), Paris, Les Bel<strong>les</strong> Lettres<br />
(CUF), 1975).<br />
89. DEGL’INNOCENTI PIERINI 2006, 212.<br />
90. Suet., vita Verg., 22 Rolfe, ap. Hieronymi excerpta ex vita Vergilii quae libro C. Suetonii Tranquilli <strong>de</strong> poetis<br />
continebatur, X (In Gal. 3, 1, praef. ML 26, 427 C) et XI (In Zach. 3, 11, praef.), p. 7, 19-22 et 8, 2-6 B.-St. ;<br />
Don., vita Verg., 22, p. 28, 4-8 B.-St. ; cf. Vita Phi<strong>la</strong>rgyriana I, p. 175, 6-9 B.-St. Sur <strong>les</strong> rapports entre <strong>la</strong> Vie<br />
<strong>de</strong> Virgile transmise sous le nom d’Aelius Donat et le De poetis <strong>de</strong> Suétone, voir un bon état <strong>de</strong> <strong>la</strong> question<br />
<strong>dans</strong> SALLMANN 2000, 34-36. L’anecdote est reprise par Aulu-Gelle (XVII, 10, 2-3), qui <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ce <strong>dans</strong> <strong>la</strong><br />
bouche <strong>de</strong> Favorinus. Sur cette comparaison, voir DEGL’INNOCENTI PIERINI 2006.<br />
91. Ov., met., XV, 379-381.<br />
Schedae, 2009, prépublication n°20, (fascicule n°2, p.153-188).<br />
http://www.unicaen.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint0202009.pdf<br />
167
168<br />
Le petit que l’ourse a récemment mis bas n’est encore qu’une chair à peine vivante ; en le<br />
léchant, sa mère le façonne <strong>de</strong> manière à faire apparaître ses membres et elle lui donne forme<br />
semb<strong>la</strong>ble à <strong>la</strong> sienne, pour autant qu’elle possè<strong>de</strong> une forme achevée 92 .<br />
Il ne semble pas que le motif apparaisse <strong>dans</strong> <strong>la</strong> littérature <strong>la</strong>tine avant Virgile. C’est à<br />
tort que Morel propose d’attribuer à Ennius un vers cité sans nom d’auteur par Isidore <strong>de</strong><br />
Séville <strong>dans</strong> <strong>la</strong> notice qu’il consacre à l’ours <strong>dans</strong> ses Étymologies 93 :<br />
Sic format lingua fetum cum protulit ursa<br />
L’ourse façonne ainsi <strong>de</strong> sa <strong>la</strong>ngue le petit qu’elle mit au mon<strong>de</strong>.<br />
Ce vers se retrouve en effet <strong>dans</strong> un poème transmis par un manuscrit <strong>de</strong> Beauvais,<br />
aujourd’hui perdu, publié en 1579 par C<strong>la</strong>u<strong>de</strong> Binet 94 ; or le premier distique <strong>de</strong> ce poème<br />
est cité sous le nom <strong>de</strong> Pétrone par Fulgence le Mythographe 95 .<br />
L’origine du motif n’est pas autrement connue. Peut-être s’agit-il déjà d’un tour proverbial,<br />
cristallisant une interprétation popu<strong>la</strong>ire du léchage <strong>de</strong>s oursons. Le motif du façonnement<br />
post partum <strong>de</strong>s oursons s’inscrit cependant tout aussi bien <strong>dans</strong> <strong>la</strong> culture savante,<br />
<strong>dans</strong> <strong>la</strong> postérité directe <strong>de</strong> <strong>la</strong> zoologie aristotélicienne. Il est en effet facile <strong>de</strong> gauchir <strong>la</strong><br />
pensée d’Aristote et <strong>de</strong> comprendre que <strong>la</strong> femelle, en léchant ses petits, contribue non<br />
seulement à achever leur coction, mais encore à <strong>les</strong> façonner. Le glissement est d’autant<br />
plus aisé que <strong>les</strong> verbes grecs pevssein – Aristote emploie le composé sumpevssein – et<br />
p<strong>la</strong>vssein, qui signifie <strong>«</strong> façonner <strong>»</strong>, <strong>«</strong> mo<strong>de</strong>ler <strong>»</strong>, sont <strong>dans</strong> un rapport <strong>de</strong> quasi paronomase.<br />
Un passage du livre X <strong>de</strong> l’Histoire naturelle montre bien à quel point le glissement est aisé 96 :<br />
Quae solidas habent ungu<strong>la</strong>s, singulos ; quae bisulcas, et geminos pariunt ; quorum in digitos<br />
pedum fissura diuisa est, et numerosiora in fetu. Sed superiora omnia perfectos edunt partus,<br />
haec inchoatos, in quo sunt genere leaenae, ursae ; et uulpes informe etiam magis quam supra<br />
dicta parit, rarumque est ui<strong>de</strong>re parientem. Postea <strong>la</strong>mbendo calefaciunt fetus omnia ea et<br />
figurant ; pariunt plurimum quatenos. Caecos autem gignunt canes, lupi, pantherae, thoes.<br />
Les solipè<strong>de</strong>s font un seul petit ; <strong>les</strong> animaux à pied fourchu, jusqu’à <strong>de</strong>ux ; ceux dont le pied se<br />
divise en doigts ont une portée encore plus nombreuse. Mais <strong>les</strong> premiers mettent tous bas leurs<br />
petits bien conformés ; ceux-ci, ébauchés ; <strong>de</strong> ce nombre sont <strong>les</strong> lionnes, <strong>les</strong> ourses ; le renard<br />
met bas <strong>de</strong>s petits encore plus informes que <strong>les</strong> précé<strong>de</strong>nts, et il est rare <strong>de</strong> le voir mettre bas.<br />
Par <strong>la</strong> suite, tous ces animaux, en lèchant leurs petits, <strong>les</strong> échauffent et <strong>les</strong> façonnent ; ils en font<br />
quatre au plus. Les petits <strong>de</strong>s chiens, <strong>de</strong>s loups, <strong>de</strong>s panthères, <strong>de</strong>s chacals naissent aveug<strong>les</strong>.<br />
92. La proposition quantam capit ipsa a donné lieu à <strong>de</strong>s interprétations divergentes : voir DEGL’INNOCENTI<br />
PIERINI 2006, 215, note 21. BÖMER 1986, 352-353, a bien vu le sens <strong>de</strong> capit, qui signifie ici <strong>«</strong> avoir en soi <strong>»</strong>,<br />
au sens <strong>de</strong> <strong>«</strong> possé<strong>de</strong>r <strong>»</strong>. Je ne partage pas l’interprétation <strong>de</strong> Degl’Innocenti Pierini (2006), qui ne souscrit<br />
qu’en apparence à l’interprétation <strong>de</strong> Bömer, puisque <strong>la</strong> forma que l’ourse a en elle est à ses yeux une<br />
image mentale, qui lui sert <strong>de</strong> modèle pour façonner l’ourson nouveau-né. Cette interprétation ne rend<br />
pas compte <strong>de</strong> quantam, et ce renvoi à <strong>la</strong> théorie idéaliste <strong>de</strong> <strong>la</strong> création artistique ne me paraît pas ici<br />
pertinent. Il convient plutôt <strong>de</strong> se rappeler que l’ours est un ani<strong>mal</strong> plutôt informe (voir infra, p. 172), un trait<br />
que Virgile avait relevé <strong>dans</strong> ses Géorgiques (III, 247). À mon sens, c’est à ce vers <strong>de</strong>s Géorgiques qu’Ovi<strong>de</strong><br />
fait ici allusion, en jouant sur l’oxymoron paradoxal d’une forme informe : l’ourse donne à ses oursons<br />
toute <strong>la</strong> forme dont elle est elle-même capable. Cette interprétation permet d’expliquer le quantam :<br />
l’ourse donne à ses oursons autant <strong>de</strong> forme qu’elle en possè<strong>de</strong> elle-même, c’est-à-dire aussi peu.<br />
93. Isid., orig., XII, 2, 22 = FPL, incert., 2, p. 171 Morel.<br />
94. PLM, 90 Baehrens = Anth., 690 Riese = Petron., fr. 26 Bücheler = Poems 17 Heseltine & Warmington = fr.<br />
44 Müller.<br />
95. Fulg., myth., I, 13, p. 24 H. Comme <strong>les</strong> suivantes, cette pièce est attribuée par Binet à Pétrone, sans que<br />
l’on sache si cette attribution figurait sur le co<strong>de</strong>x ou s’il s’agit d’une conjecture <strong>de</strong> Binet. L’attribution à<br />
Pétrone est acceptée par COURTNEY 1991, 7 et 66.<br />
96. Plin., nat., X, 176 (Saint-Denis (trad.), Paris, Les Bel<strong>les</strong> Lettres (CUF), 1961).<br />
Schedae, 2009, prépublication n°20, (fascicule n°2, p. 153-188).<br />
http://www.unicaen.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint0202009.pdf
Même si <strong>la</strong> corré<strong>la</strong>tion entre <strong>la</strong> façon dont le pied est ou non divisé et le nombre <strong>de</strong> petits<br />
que compte une portée n’est aristotélicienne qu’en apparence 97 , ce passage est beaucoup<br />
plus proche à <strong>la</strong> fois <strong>de</strong> l’esprit et <strong>de</strong> <strong>la</strong> lettre <strong>de</strong> l’enseignement zoologique d’Aristote que<br />
<strong>les</strong> développements correspondants du livre VIII. Loin d’adopter l’approche monographique<br />
qui est celle du livre VIII, Pline rep<strong>la</strong>ce l’ours <strong>dans</strong> une série plus <strong>la</strong>rge, et surtout il<br />
reprend à son compte l’explication aristotélicienne <strong>de</strong> l’inachèvement <strong>de</strong>s nouveau-nés<br />
par <strong>la</strong> multiparité. Il traduit presque littéralement ce qu’Aristote disait <strong>de</strong> <strong>la</strong> renar<strong>de</strong>. La<br />
phrase d’Aristote, o{tan d v ejktevkh/, th' / glwvtth/ leivcousa ejkqermaivnei kai; sumpevttei, <strong>de</strong>vient<br />
en <strong>la</strong>tin postea <strong>la</strong>mbendo calefaciunt fetus omnia ea et figurant 98 . Si le verbe ejkqermaivnein<br />
a été fidèlement traduit par le <strong>la</strong>tin calefacere, le verbe ejkqermaivnein a été rendu par le<br />
<strong>la</strong>tin figurare, qui ne signifie pas <strong>«</strong> cuire <strong>»</strong>, mais <strong>«</strong> donner forme <strong>»</strong>. Il est tout à fait imaginable<br />
que Pline ait eu sous <strong>les</strong> yeux un texte grec où le verbe sumpevttein ait été remp<strong>la</strong>cé par<br />
un autre verbe, par exemple p<strong>la</strong>vssein. Cette substitution, qui introduit une analogie frappante<br />
avec l’art du sculpteur et qui rend le fait à <strong>la</strong> fois plus saisissant et plus étonnant,<br />
serait bien <strong>dans</strong> le goût <strong>de</strong> <strong>la</strong> littérature zoologique d’époque hellénistique, dont l’inflexion<br />
paradoxographique est connue 99 . On peut imaginer qu’elle soit intervenue, entre l’époque<br />
d’Aristophane <strong>de</strong> Byzance et celle <strong>de</strong> Virgile, <strong>dans</strong> un ouvrage sur <strong>les</strong> animaux d’ascendance<br />
péripatéticienne 100 . Une autre possibilité, peut-être moins probable, est que ce<br />
glissement soit l’œuvre d’auteurs <strong>la</strong>tins ayant librement traduit le grec d’Aristote.<br />
Pour conclure sur le texte <strong>de</strong> Pline, on peut dire que Pline reste globalement fidèle à<br />
<strong>la</strong> zoologie péripatéticienne, dont il partage l’intérêt pour <strong>les</strong> pravxei", c’est-à-dire <strong>les</strong> fonctions<br />
physiologiques, et pour le mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> vie. S’il reste fidèle à ces orientations <strong>de</strong> <strong>la</strong> zoologie<br />
péripatéticienne, s’il emprunte aux épitomés hellénistiques leur mo<strong>de</strong> d’exposition<br />
et une partie <strong>de</strong> leurs rubriques, Pline n’en introduit pas moins <strong>dans</strong> ce cadre péripatéticien<br />
<strong>de</strong>s éléments qui lui sont étrangers. En ce qui concerne <strong>la</strong> <strong>reproduction</strong>, cet élément étranger<br />
est le motif <strong>de</strong> l’ourse qui donne forme à ses petits 101 .<br />
À l’époque impériale, le façonnement post partum <strong>de</strong>s oursons est <strong>de</strong>venu un motif<br />
obligé <strong>de</strong> toute évocation <strong>de</strong> l’ani<strong>mal</strong>. C’est par lui que Pollux commence <strong>la</strong> notice qu’il<br />
consacre à l’ani<strong>mal</strong> <strong>dans</strong> le livre V <strong>de</strong> son Onomastikon 102 . Élien <strong>de</strong> Préneste n’a gar<strong>de</strong><br />
pour sa part <strong>de</strong> l’omettre <strong>dans</strong> son vaste ouvrage sur La Personnalité <strong>de</strong>s animaux. Plus<br />
encore que ses prédécesseurs, il lie intimement <strong>les</strong> informations re<strong>la</strong>tives à l’hibernation <strong>de</strong><br />
97. Aristote dit, en effet, expressément le contraire <strong>dans</strong> GA, IV, 4, 771 b 1-10. Voir supra, note 49.<br />
98. HA, VI, 34, 580 a 9-10.<br />
99. Voir à ce sujet SCHNEIDER 1969, II, 378-380 ; FRASER 1972, I, 454-455 et 770-774 ; BOUFFARTIGUE 2003, 140 ;<br />
ZUCKER 2005a, 311-322.<br />
100. On peut citer, à titre d’hypothèse, le nom <strong>de</strong> Sostratos, un mé<strong>de</strong>cin et iologue alexandrin, qui vécut sans<br />
doute <strong>dans</strong> l’entourage <strong>de</strong> Cléopâtre VII et qui aurait <strong>la</strong>issé un récit <strong>de</strong> <strong>la</strong> mort <strong>de</strong> cette <strong>de</strong>rnière : voir<br />
WELLMANN 1891b ; MARASCO 1995, 319 et 1998, 49. Il fut en particulier l’auteur d’un peri; zw/ vwn (ou peri; fuvsew"<br />
zw/ vwn), dont le peri; a[rktwn mentionné par une scholie aux Idyl<strong>les</strong> <strong>de</strong> Théocrite faisait sans doute<br />
partie (fr. 11 WELLMANN, ap. Scholia Theoc., I, 115, p. 67 Wen<strong>de</strong>l). Si <strong>la</strong> scholie ne fait état que <strong>de</strong> l’hibernation<br />
<strong>de</strong> l’ours et <strong>de</strong> <strong>la</strong> mise bas <strong>de</strong> <strong>la</strong> femelle pendant cette pério<strong>de</strong>, <strong>dans</strong> le but d’expliquer le qualificatif<br />
fw<strong>la</strong>v<strong>de</strong>" employé par Théocrite, il n’est pas exclu que Sostratos ait également traité du façonnement<br />
post partum <strong>de</strong> l’ourson nouveau-né. Sur Sostratos, dont l’œuvre zoologique peut être aussi bien postérieure<br />
qu’antérieure aux années <strong>de</strong> rédaction <strong>de</strong>s Géorgiques (37-30 av. J.-C.), voir WELLMANN 1891b ;<br />
SUSEMIHL 1892, II, 444-445 ; GOSSEN 1927 ; MICHLER 1968, 106-108 ; SCHNEIDER 1969, 380 ; FRASER 1972, I, 363<br />
et II, 537, note 231 ; MARASCO 1998, 43. Les maigres fragments du peri; zw/ vwn qui sont parvenus jusqu’à<br />
nous ne suffisent pas à accréditer le jugement <strong>de</strong> Gossen et <strong>de</strong> Schnei<strong>de</strong>r, qui veulent reconnaître <strong>dans</strong><br />
Sostratos le plus grand zoologiste <strong>de</strong> l’époque hellénistique.<br />
101. On pourrait montrer, <strong>de</strong> <strong>la</strong> même façon, comment le motif <strong>de</strong> l’ours qui lèche ses pattes pour se nourrir<br />
pendant <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> d’hibernation est complètement étranger à <strong>la</strong> réflexion aristotélicienne et vient contredire<br />
<strong>les</strong> indications sur <strong>la</strong> graisse <strong>de</strong> l’ours, qui portent, el<strong>les</strong>, <strong>la</strong> marque <strong>de</strong>s recherches d’Aristote et <strong>de</strong><br />
Théophraste. Je me propose <strong>de</strong> revenir sur ce point <strong>dans</strong> une autre étu<strong>de</strong>.<br />
102. Poll., V, 80, I, p. 283 Bethe : ÔH d v a[rkto" tivktei me;n savrka, p<strong>la</strong>vttei <strong>de</strong>; kai; ajrqroi` to; gevnnhma tw/ ` stovmati,<br />
kai; pro;" eij~do"<br />
zw/ vou ta; mevlh tupoi`.<br />
Schedae, 2009, prépublication n°20, (fascicule n°2, p.153-188).<br />
http://www.unicaen.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint0202009.pdf<br />
169
170<br />
l’ani<strong>mal</strong> et cel<strong>les</strong> re<strong>la</strong>tives à <strong>la</strong> gestation <strong>de</strong> <strong>la</strong> femelle 103 . L’hibernation <strong>de</strong> l’ourse <strong>dans</strong> sa<br />
tanière donne un relief particulier à son activité <strong>de</strong> mère, car elle lui confère à <strong>la</strong> fois une<br />
unité <strong>de</strong> temps et une unité <strong>de</strong> lieu. Pendant l’hibernation, l’ourse n’est que mère, puisque<br />
l’hibernation coïnci<strong>de</strong> pour elle avec le temps <strong>de</strong> <strong>la</strong> gestation, <strong>de</strong> <strong>la</strong> mise bas et <strong>de</strong>s soins<br />
prodigués avec sollicitu<strong>de</strong> aux oursons nouveau-nés.<br />
Dans <strong>la</strong> culture impériale, le façonnement post partum <strong>de</strong> l’ours fait désormais partie<br />
<strong>de</strong> ces mirabilia <strong>de</strong> <strong>la</strong> nature <strong>dans</strong> <strong>les</strong>quels <strong>les</strong> auteurs en quête <strong>de</strong> faits curieux, d’exemp<strong>les</strong><br />
frappants, d’arguments ou seulement <strong>de</strong> métaphores peuvent librement puiser. Promue au<br />
rang <strong>de</strong> modèle éthique, l’ourse léchant ses petits a ainsi pris p<strong>la</strong>ce <strong>dans</strong> l’arsenal d’exemp<strong>les</strong><br />
utilisés pour dénoncer le dévoiement du sentiment maternel <strong>dans</strong> <strong>la</strong> société impériale 104 .<br />
D’autres auteurs ont préféré mettre en avant le caractère paradoxal <strong>de</strong> cette embryogenèse<br />
qui prend p<strong>la</strong>ce après l’accouchement et qui a pour agent non <strong>la</strong> semence, mais <strong>la</strong><br />
<strong>la</strong>ngue <strong>de</strong> <strong>la</strong> mère. Le motif du façonnement post partum est ainsi rapproché par Galien<br />
d’un autre phénomène stupéfiant, le façonnement <strong>de</strong> <strong>la</strong> semence par <strong>la</strong> vue au moment <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> conception. Dans <strong>la</strong> Thériaque à Pison, Galien rapporte après d’autres l’histoire d’un<br />
homme contrefait qui <strong>de</strong>mandait à sa femme, au moment <strong>de</strong> s’unir à elle, <strong>de</strong> gar<strong>de</strong>r <strong>les</strong><br />
yeux fixés sur un tableau représentant un corps bien fait ; grâce à ce subterfuge, il lui fut<br />
donné d’avoir un bel enfant 105 . Les tenants <strong>de</strong> l’atomisme expliquaient cette étrange imprégnation<br />
par le regard en invoquant le rôle joué par <strong>les</strong> simu<strong>la</strong>cres, ces agrégats d’atomes<br />
subtils et ténus émis par le tableau, qui étaient censés pénétrer par <strong>les</strong> yeux <strong>dans</strong> le corps<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> femme. C’est pour réfuter cette explication corpuscu<strong>la</strong>ire que Galien invoque l’exemple<br />
du façonnement post partum <strong>de</strong>s oursons nouveau-nés 106 :<br />
ΔApotivktei me;n ga;r hJ a[rkto" a{pasi toi'" gennwmevnoi" oJmoivw" zwv/oi".<br />
“Esti <strong>de</strong>; sa;rx movnh gennwmevnh<br />
a[p<strong>la</strong>stov" te kai; ajdiavrqrwto", morfh;n me;n ouj<strong>de</strong>mivan e[cousa, eujqu;" <strong>de</strong>; uJpo; th'" gennwvsh"<br />
th'/<br />
fusikh'/<br />
tevcnh/ diatupoumevnh. Th'/<br />
ga;r glwvtth/ w{sper ceiriv tini crwmevnh hJ tekou'sa ou{tw<br />
memorfwmevnon zw'/on<br />
to; tecqe;n ajpotelei'n<br />
L’ourse, en effet, met bas <strong>de</strong> <strong>la</strong> même manière que tous <strong>les</strong> animaux qui enfantent. Le produit<br />
<strong>de</strong> l’enfantement n’est qu’une masse <strong>de</strong> chair indistincte et inarticulée ; privée <strong>de</strong> toute forme,<br />
elle est aussitôt façonnée par <strong>la</strong> parturiente en vertu d’un art naturel. Elle se sert en effet <strong>de</strong> sa<br />
<strong>la</strong>ngue comme d’une main pour faire du produit <strong>de</strong> son enfantement un être vivant parfaitement<br />
formé.<br />
Le rapport entre <strong>les</strong> <strong>de</strong>ux phénomènes est en fait assez lâche. Le point commun rési<strong>de</strong><br />
<strong>dans</strong> l’intervention, <strong>dans</strong> l’embryogenèse, d’organes ou <strong>de</strong> facultés qui lui sont ordinairement<br />
étrangers, <strong>la</strong> vue <strong>dans</strong> le premier cas, <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue <strong>dans</strong> le second. L’action <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue<br />
est censée éc<strong>la</strong>irer le mo<strong>de</strong> d’action, assurément plus obscur, <strong>de</strong> <strong>la</strong> vue. Les <strong>de</strong>ux phéno-<br />
mènes sont référés sans plus <strong>de</strong> précision par Galien à l’<strong>«</strong> art <strong>de</strong> <strong>la</strong> nature <strong>»</strong>, fusikh; tevcnh,<br />
cet art que <strong>les</strong> philosophes atomistes s’acharnaient justement à nier, en attribuant au hasard<br />
<strong>la</strong> configuration <strong>de</strong>s différents corps visib<strong>les</strong> 107 .<br />
103. Ael., NA, VI, 3 ; voir aussi II, 19.<br />
104. Voir Plu., De l’amour <strong>de</strong> <strong>la</strong> progéniture = Mor. 494 c, cité supra ; Philostr., VA, V, 14. Voir aussi, en un autre<br />
sens, Horap., II, 83, THISSEN 2001, 68 ; selon THISSEN 2001, XVI, il s’agirait d’un ajout postérieur au texte<br />
d’Horapollon, peut-être à l’initiative d’un Philippos, mentionné <strong>dans</strong> le titre <strong>de</strong> l’œuvre, qui l’aurait remaniée<br />
et complétée <strong>dans</strong> le courant du V e siècle <strong>de</strong> notre ère.<br />
105. Sur cette anecdote et sur l’influence embryologique qui est ici reconnue à <strong>la</strong> vue, voir GOUREVITCH 1987 et<br />
MAIRE 2004.<br />
106. Gal., Thériaque à Pison, XI = XIV, p. 254-255 Kühn.<br />
107. Sur <strong>la</strong> polémique <strong>de</strong> Galien contre <strong>les</strong> atomistes et sur l’importance <strong>de</strong> <strong>la</strong> notion d’<strong>«</strong> art <strong>de</strong> <strong>la</strong> nature <strong>»</strong> <strong>dans</strong><br />
son œuvre, voir BOUDON 2001 et 2003.<br />
Schedae, 2009, prépublication n°20, (fascicule n°2, p. 153-188).<br />
http://www.unicaen.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint0202009.pdf
Dans l’ensemble <strong>de</strong> ces témoignages, le rôle <strong>de</strong> <strong>la</strong> mère se borne à donner forme à ses<br />
petits, qui naissent inachevés. En revanche, il n’est pas dit explicitement que l’ourse met<br />
au mon<strong>de</strong> <strong>de</strong>s petits mort-nés, même si certaines formu<strong>la</strong>tions sont pour le moins ambiguës.<br />
Ovi<strong>de</strong>, par exemple, qualifie <strong>les</strong> oursons nouveau-nés <strong>de</strong> <strong>mal</strong>e uiua caro, <strong>«</strong> chair à peine<br />
vivante <strong>»</strong>, en employant un tour – <strong>mal</strong>e suivi d’un adjectif – qui équivaut à une quasi-négation<br />
108 . Et que dire du substantif caro utilisé aussi bien par Ovi<strong>de</strong> que par Pline, qui semble<br />
plus désigner une môle inerte qu’un petit vivant ? Des auteurs postérieurs seront plus<br />
explicites et assureront que l’ourse non seulement façonne <strong>les</strong> oursons nouveau-nés, mais<br />
encore leur donne vie. Solin écrit ainsi, <strong>dans</strong> le courant du III e siècle <strong>de</strong> notre ère, à moins<br />
que ce ne soit <strong>dans</strong> <strong>la</strong> première moitié du siècle suivant 109 , que <strong>les</strong> ourses <strong>«</strong> donnent peu à<br />
peu forme à [leurs petits] en <strong>les</strong> léchant et ce faisant el<strong>les</strong> <strong>les</strong> tiennent au chaud, bien serrés<br />
contre leur poitrine, si bien que ces <strong>de</strong>rniers, couvés et réchauffés sans discontinuer, se<br />
mettent à vivre et à respirer <strong>»</strong>, has <strong>la</strong>mbendo sensim figurant et interdum adpectoratas<br />
fouent, ut assiduo incubitu calefactae ani<strong>mal</strong>em trahant spiritum 110 . Solin rapproche <strong>les</strong><br />
<strong>de</strong>ux gestes maternels mentionnés par Pline, celui <strong>de</strong> lécher <strong>les</strong> nouveau-nés et celui <strong>de</strong><br />
<strong>les</strong> serrer contre soi afin <strong>de</strong> <strong>les</strong> réchauffer, en leur attribuant une finalité différente : le premier<br />
geste donne forme aux oursons nouveau-nés, le second <strong>les</strong> réchauffe et leur donne<br />
vie. Ce faisant, il pousse jusqu’à ses ultimes conséquences <strong>la</strong> réinterprétation <strong>de</strong>s vues<br />
d’Aristote opérée par <strong>la</strong> tradition postérieure. Pour Aristote, comme nous l’avons vu, <strong>la</strong> femelle<br />
lèche <strong>les</strong> nouveau-nés prématurés pour <strong>les</strong> réchauffer ; elle contribue ainsi au processus <strong>de</strong><br />
coction qui va conduire à leur achèvement. Solin, <strong>dans</strong> <strong>la</strong> lignée <strong>de</strong> ses prédécesseurs,<br />
attribue à <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue <strong>de</strong> <strong>la</strong> mère une action directement formative. Quant à <strong>la</strong> chaleur, elle<br />
n’est plus communiquée par <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue, mais par le contact du corps maternel, et c’est elle<br />
qui donne vie à l’ourson nouveau-né. Aussi l’ourson ne naît-il plus seulement informe et<br />
inarticulé, mais aussi inanimé. Les soins prodigués par l’ourse s’adressent désormais à un<br />
nouveau-né qui, en plus d’être prématuré, est également mort-né.<br />
Quoique étranger à <strong>la</strong> tradition aristotélicienne, le motif <strong>de</strong> l’ourse façonnant ses petits<br />
a connu un <strong>la</strong>rge succès tout au long <strong>de</strong> l’époque impériale. Dans <strong>les</strong> Étymologies d’Isidore<br />
<strong>de</strong> Séville, rédigées au début du VIIe siècle <strong>de</strong> notre ère, il fournira même son nom à l’ours,<br />
puisque le substantif ursus, transformé en orsus pour <strong>les</strong> besoins <strong>de</strong> <strong>la</strong> démonstration, est<br />
censé dériver <strong>de</strong> ore suo, <strong>«</strong> avec sa gueule <strong>»</strong> et donc renvoyer au motif du léchage post partum<br />
111 . Pour rendre compte <strong>de</strong> ce succès, il convient <strong>de</strong> répondre à <strong>de</strong>ux questions : pourquoi<br />
le motif du façonnement post partum s’est-il fixé sur l’ourse <strong>de</strong> préférence à d’autres<br />
animaux multipares, comme <strong>la</strong> chienne, <strong>la</strong> renar<strong>de</strong> ou <strong>la</strong> lionne ? en quoi ce façonnement<br />
post partum était-il bon à penser ?<br />
L’ourse façonnant ses petits : une figure maternelle ambiguë.<br />
De tous <strong>les</strong> animaux vivipares qui mettent au mon<strong>de</strong> <strong>de</strong>s petits inachevés, <strong>la</strong> tradition<br />
antique a retenu <strong>de</strong> préférence l’espèce ursine. Des considérations diverses peuvent expliquer<br />
ce choix. La durée <strong>de</strong> trente jours assignée à <strong>la</strong> gestation <strong>de</strong> l’ourse fait <strong>de</strong> celle-ci un<br />
cas extrême au sein <strong>de</strong>s animaux multipares à <strong>la</strong> gestation écourtée ; il s’agit d’une gestation<br />
particulièrement hâtive, qui fait <strong>de</strong> l’ourson nouveau-né le champion <strong>de</strong> <strong>la</strong> prématurité 112 .<br />
108. Ov., met., XV, 380, cité supra. Pour <strong>mal</strong>e + adjectif comme quasi-négation, voir <strong>les</strong> exemp<strong>les</strong> réunis par<br />
BÖMER 1986, 352-353.<br />
109. Sur <strong>la</strong> date <strong>de</strong>s Collectanea rerum memorabilium <strong>de</strong> Solin, voir SOLIN (Fernán<strong>de</strong>z Nieto 2001), 13-27.<br />
110. Sol., XXVI, 4, p. 129 Mommsen.<br />
111. Isid., orig., XII, 2, 22.<br />
112. Pour Aristote (HA, VI, 34, 580 a 6-7), cependant, ce n’est pas l’ourse, mais <strong>la</strong> renar<strong>de</strong>, qui met au mon<strong>de</strong><br />
<strong>les</strong> petits <strong>les</strong> plus inachevés, une information qui n’est reprise par Pline que <strong>dans</strong> le livre X (X, 176).<br />
Schedae, 2009, prépublication n°20, (fascicule n°2, p.153-188).<br />
http://www.unicaen.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint0202009.pdf<br />
171
172<br />
Dans ces conditions, il n’est pas étonnant que l’ourse ait été retenue en priorité pour illustrer<br />
<strong>la</strong> catégorie <strong>de</strong>s femel<strong>les</strong> mettant bas précocément 113 . Il était en outre facile d’exagérer<br />
l’inachèvement <strong>de</strong>s oursons nouveau-nés, tant il était difficile <strong>de</strong> <strong>les</strong> approcher au creux<br />
<strong>de</strong> leur tanière hivernale.<br />
Le choix <strong>de</strong> l’ours peut cependant avoir obéi à <strong>de</strong>s raisons plus subti<strong>les</strong>. Ani<strong>mal</strong> corpulent,<br />
<strong>de</strong> couleur sombre, pourvu d’un appendice caudal extrêmement réduit 114 , l’ours<br />
possè<strong>de</strong> une silhouette plus indistincte et moins déliée que celle du lion ou du chien, par<br />
exemple, qui peut le faire passer pour un ani<strong>mal</strong> informe. L’adjectif informis est du reste<br />
l’un <strong>de</strong>s qualificatifs que l’ours reçoit <strong>dans</strong> <strong>la</strong> poésie <strong>la</strong>tine 115 . Dans son Commentaire aux<br />
Géorgiques, Servius se <strong>de</strong>man<strong>de</strong> si ce qualificatif s’explique par <strong>la</strong> gran<strong>de</strong> taille <strong>de</strong> l’ours 116<br />
ou par le caractère informe <strong>de</strong>s oursons nouveau-nés 117 . L’hésitation <strong>de</strong> Servius montre<br />
que l’aspect <strong>de</strong> l’ours adulte comme le caractère inachevé prêté aux oursons nouveau-nés<br />
concouraient à faire <strong>de</strong> l’ours l’ani<strong>mal</strong> informe par excellence. La silhouette épaisse <strong>de</strong> l’ours<br />
adulte invitait ainsi à choisir en priorité l’ourson comme exemple emblématique d’inachèvement<br />
post partum 118 .<br />
Quelque difforme qu’il puisse paraître et bien qu’il soit aussi plus massif, l’ours n’en<br />
rappelle pas moins l’homme tant par sa stature que par sa silhouette. Cette ressemb<strong>la</strong>nce<br />
a frappé <strong>les</strong> Anciens, qui se sont plu, <strong>dans</strong> leurs <strong>de</strong>scriptions, à accentuer l’anthropomorphisme<br />
<strong>de</strong> l’espèce 119 . Pline fait ainsi s’accoupler <strong>les</strong> ours <strong>dans</strong> une position tout humaine<br />
et montre l’ourse en train <strong>de</strong> serrer ses petits contre sa poitrine, comme le ferait une mère<br />
humaine 120 . À ces caractéristiques, qui touchent à <strong>la</strong> <strong>reproduction</strong>, il convient d’ajouter <strong>la</strong><br />
113. On notera par exemple que d’après <strong>les</strong> scholies <strong>de</strong>s Aratea <strong>de</strong> Germanicus (Scholia Strozziana et Sangermanensia,<br />
p. 112-113 Breysig), <strong>la</strong> métamorphose <strong>de</strong> Callisto en ourse aurait eu à <strong>la</strong> fois pour effet et pour<br />
but <strong>de</strong> hâter <strong>la</strong> fin <strong>de</strong> sa grossesse.<br />
114. Voir à ce sujet <strong>les</strong> réflexions d’Arist., PA, II, 14, 658 a 35-b 2 : Pantacou` ga;r ajpodivdwsi <strong>la</strong>bou`sa eJtevrwqen<br />
pro;" a[llo movrion. ”Osoi" <strong>de</strong>; to; sw`ma dasu; livan pepoivhke, touvtoi" ejn<strong>de</strong>w`" e[cei ta; peri; th;n kevrkon, oiJ~on<br />
ejpi; tw`n a[rktwn sumbevbhken, <strong>«</strong> Car en tout <strong>la</strong> nature ôte d’un côté ce qu’elle donne <strong>de</strong> l’autre. Chez <strong>les</strong><br />
animaux à qui elle a fait un corps trop velu, <strong>la</strong> queue se trouve diminuée comme c’est le cas chez l’ours <strong>»</strong><br />
(P. Louis (trad.), Paris, Les Bel<strong>les</strong> Lettres (CUF), 1956). Cf. Plin., nat., XI, 264, avec le commentaire <strong>de</strong> CAP-<br />
PONI 1995, 238-240. Cette atrophie <strong>de</strong> <strong>la</strong> queue rapproche l’ours <strong>de</strong> l’homme, dont Aristote rappelle qu’il<br />
est le seul ani<strong>mal</strong> avec le singe à être dépourvu <strong>de</strong> queue : PA, IV, 10, 689 b 1-34 ; cf. Plin., nat., XI, 264.<br />
115. Verg., georg., III, 247. Cf. C<strong>la</strong>ud., carm., XXIV, 310 et Drac., <strong>la</strong>ud. <strong>de</strong>i, II, 265.<br />
116. Ce passage du sème <strong>de</strong> l’absence <strong>de</strong> forme au sème <strong>de</strong> <strong>la</strong> gran<strong>de</strong>ur peut étonner, mais <strong>la</strong> conjonction <strong>de</strong><br />
ces <strong>de</strong>ux sèmes est attestée par ailleurs, <strong>la</strong> taille considérable <strong>de</strong> certains animaux étant volontiers perçue<br />
comme une sorte <strong>de</strong> difformité. Voir, par exemple, certains emplois <strong>de</strong> l’adjectif uastus chez Cicéron : Cic.,<br />
nat. <strong>de</strong>or., I, 98 ; rep., II, 67 ; div., I, 49.<br />
117. Serv., ad georg., III, 247 : uel magni, uel qui tempore quo nascuntur forma carent.<br />
118. Cette explication, du reste, est déjà celle avancée par Buffon (BUFFON 1760, 256) : <strong>«</strong> si le fœtus ou <strong>les</strong> jeunes<br />
oursons ont paru informes au premier coup d’œil, c’est que l’ours adulte l’est lui-même par <strong>la</strong> masse,<br />
<strong>la</strong> grosseur et <strong>la</strong> disproportion du corps et <strong>de</strong>s membres ; le fœtus ou le petit nouveau-né est plus disproportionné<br />
que l’ani<strong>mal</strong> adulte. <strong>»</strong> Buffon est plus qu’un autre convaincu <strong>de</strong> <strong>la</strong> difformité <strong>de</strong> l’ours ; s’il reconnaît<br />
l’existence <strong>de</strong> similitu<strong>de</strong>s anatomiques entre l’ours et l’homme, il n’en conclut pas moins que <strong>«</strong> ces<br />
ressemb<strong>la</strong>nces grossières ne le ren<strong>de</strong>nt que plus difforme et ne lui donnent aucune supériorité sur <strong>les</strong><br />
autres animaux <strong>»</strong>.<br />
119. L’expression <strong>la</strong> plus achevée <strong>de</strong> cette anthropomorphisation <strong>de</strong> l’ours se trouve <strong>dans</strong> le livre II <strong>de</strong>s Cyrani<strong>de</strong>s,<br />
recueil <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine magique daté <strong>de</strong> <strong>la</strong> fin <strong>de</strong> l’Antiquité (Cyran., II, 1, KAIMAKIS 1976, 112) :“Arkto"<br />
qhrivon ejstiv, zw`/on<br />
dasu; kai; nwqrovn, kata; pavnta ejoiko;" tw`/<br />
ajnqrwvpw/, suneto;n kai; ojrqa; badivzein qevlwn.<br />
Touvtou tou` zwv /ou e{kaston mevlo" pepoivhtai pro;" e{kaston mevlo" tou` ajnqrwvpou. ΔWfelei` ouj ~n eij" qerapeivan,<br />
<strong>«</strong> L’ours est une bête sauvage, un ani<strong>mal</strong> velu et paresseux, qui ressemble en tout à l’homme, qui est avisé<br />
et qui aime à marcher <strong>de</strong>bout. Chaque partie <strong>de</strong> cet ani<strong>mal</strong> est faite pour <strong>la</strong> partie correspondante <strong>de</strong><br />
l’homme. Il est donc d’un grand secours pour <strong>la</strong> thérapeutique <strong>»</strong>. Pour un autre exemple, voir Plin., nat.,<br />
XI, 249 : seuls <strong>les</strong> hommes, <strong>les</strong> ours et <strong>les</strong> singes ont <strong>les</strong> genoux et <strong>les</strong> cou<strong>de</strong>s qui se plient en sens contraire.<br />
120. L’ourse possè<strong>de</strong> <strong>de</strong> fait, outre ses quatre mamel<strong>les</strong> abdomina<strong>les</strong>, <strong>de</strong>ux mamel<strong>les</strong> pectora<strong>les</strong>, qui sont pratiquement<br />
<strong>les</strong> seu<strong>les</strong> à sécréter du <strong>la</strong>it : voir COUTURIER 1954, 72. La silhouette d’une ourse en position<br />
adossée ou allongée en train d’al<strong>la</strong>iter <strong>de</strong>ux oursons suspendus à ses mamel<strong>les</strong> pectora<strong>les</strong> évoque irrésistiblement<br />
celle d’une mère humaine. Pline ne dit cependant pas que l’ourse qui serre ses petits contre<br />
Schedae, 2009, prépublication n°20, (fascicule n°2, p. 153-188).<br />
http://www.unicaen.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint0202009.pdf
ipédie occasionnelle <strong>de</strong> l’ours, son aptitu<strong>de</strong> à se servir <strong>de</strong> ses pattes antérieures pour toutes<br />
sortes <strong>de</strong> tâches, ainsi que son régime alimentaire, qui est omnivore comme celui <strong>de</strong><br />
l’homme 121 . Cette série <strong>de</strong> ressemb<strong>la</strong>nces fait <strong>de</strong> l’ourse qui s’occupe <strong>de</strong> ses petits une<br />
sorte <strong>de</strong> mère en fourrure, presque humaine. Aussi l’anthropomorphisme <strong>de</strong> l’espèce permet-il<br />
<strong>de</strong> mieux comprendre pourquoi <strong>les</strong> Anciens ont été si enclins à faire <strong>de</strong> l’ourse une<br />
figure éminemment maternelle et pourquoi ils l’ont préférée <strong>dans</strong> ce rôle à <strong>la</strong> chienne ou<br />
à une autre femelle multipare 122 . Il faut également compter avec <strong>la</strong> nette po<strong>la</strong>rité féminine<br />
<strong>de</strong> l’espèce ursine <strong>dans</strong> <strong>la</strong> culture antique, et plus particulièrement <strong>dans</strong> <strong>la</strong> culture grecque,<br />
où l’ours femelle éclipse souvent l’ours mâle. Un indice en ce sens est fourni par le genre<br />
grammatical du nom <strong>de</strong> l’ours en grec ancien, hJ a[rkto", qui est comme on sait un substan-<br />
tif épicène féminin 123 .<br />
Ce <strong>de</strong>rnier point nous amène à notre secon<strong>de</strong> question, qui concerne le succès rencontré<br />
par le motif du léchage post partum <strong>de</strong> l’ourson nouveau-né. L’ours femelle, figure<br />
prégnante et maternelle, entoure <strong>de</strong> sa sollicitu<strong>de</strong> l’ourson nouveau-né et s’emploie à lui<br />
donner forme. Si l’ourson est un exemple extrême d’inachèvement, il partage ce trait avec<br />
<strong>de</strong> nombreux nouveau-nés, y compris avec le petit <strong>de</strong> l’homme, qui était lui aussi pensé<br />
<strong>dans</strong> l’Antiquité comme un être fondamentalement inachevé. Certes, le petit homme n’est<br />
pas inachevé au même titre que l’ourson nouveau-né. Il suffit, pour s’en convaincre, <strong>de</strong><br />
reprendre <strong>la</strong> distinction aristotélicienne entre l’inachèvement selon <strong>la</strong> qualité et l’inachèvement<br />
selon <strong>la</strong> quantité 124 . Selon <strong>la</strong> quantité, explique Aristote, tout nouveau-né est inachevé<br />
par définition. L’inachèvement selon <strong>la</strong> qualité renvoie pour sa part à un état où <strong>les</strong><br />
parties <strong>de</strong> l’embryon ne se sont pas encore totalement différenciées. À <strong>la</strong> différence <strong>de</strong><br />
l’ourson, le nouveau-né humain n’est pas inachevé selon <strong>la</strong> qualité, même s’il constitue, au<br />
dire d’Aristote, le plus imparfait <strong>de</strong>s petits qui naissent achevés 125 . Cette distinction entre<br />
l’inachèvement selon <strong>la</strong> quantité ou <strong>la</strong> qualité était cependant <strong>de</strong> peu <strong>de</strong> poids face aux discours<br />
qui dénonçaient le dénuement originaire <strong>de</strong> l’espèce humaine en mettant sous <strong>les</strong> yeux<br />
du lecteur le spectacle déplorable d’un nouveau-né nu, ensang<strong>la</strong>nté et hur<strong>la</strong>nt, tributaire<br />
121. sa poitrine est en train <strong>de</strong> <strong>les</strong> al<strong>la</strong>iter. La tradition antique ne semble, en effet, connaître que <strong>les</strong> mamel<strong>les</strong><br />
abdomina<strong>les</strong> <strong>de</strong> l’ourse. Aristote attribue quatre mamel<strong>les</strong> à l’ourse (HA, II, 1, 500 a 22-23) ; comme il a<br />
auparavant affirmé que l’homme est le seul ani<strong>mal</strong> à avoir <strong>de</strong>s mamel<strong>les</strong> sur le <strong>de</strong>vant <strong>de</strong> <strong>la</strong> poitrine (HA,<br />
II, 1, 497 b 34-35), il doit s’agir <strong>de</strong>s mamel<strong>les</strong> abdomina<strong>les</strong> <strong>de</strong> l’ani<strong>mal</strong>. Cette interprétation est confirmée<br />
par l’indication explicite d’Aristophane <strong>de</strong> Byzance (Epit., II, 326), qui provient probablement <strong>de</strong> l’ouvrage<br />
perdu d’Aristote intitulé <strong>les</strong> Dissections, même si l’indication ejn toi`" mhroi`" est une approximation qui<br />
contrevient à l’idée exprimée <strong>dans</strong> <strong>les</strong> Parties <strong>de</strong>s animaux, selon <strong>la</strong>quelle aucun fissipè<strong>de</strong> n’a <strong>les</strong> mamel<strong>les</strong><br />
p<strong>la</strong>cées entre <strong>les</strong> cuisses (IV, 10, 688 b 7-8) : ÔH a[rkto" e[cei […] mastou;" tevssara", duvo pro;" th/<br />
`koiliva/<br />
kai; duvo ejn toi`" mhroi`", <strong>«</strong> l’ours possè<strong>de</strong> quatre mamel<strong>les</strong>, <strong>de</strong>ux situées <strong>dans</strong> <strong>la</strong> région <strong>de</strong> l’estomac, et<br />
<strong>de</strong>ux <strong>dans</strong> <strong>la</strong> région <strong>de</strong>s cuisse <strong>»</strong>. Cf. Plin., XI, 235. C’est sans doute précisément parce qu’el<strong>les</strong> rapprochaient<br />
l’ours <strong>de</strong> l’homme que <strong>les</strong> mamel<strong>les</strong> pectora<strong>les</strong> ont été refusées à l’ourse <strong>dans</strong> <strong>la</strong> tradition péripatéticienne.<br />
Sur l’importance <strong>de</strong> <strong>la</strong> position <strong>de</strong>s mamel<strong>les</strong> pour <strong>la</strong> définition <strong>de</strong> l’humain, voir par exemple<br />
Plu., De l’amour <strong>de</strong> <strong>la</strong> progéniture, III = Mor. 496 b-c : <strong>«</strong> Voilà pourquoi si <strong>les</strong> mamel<strong>les</strong> <strong>de</strong>s autres animaux<br />
pen<strong>de</strong>nt sous le ventre, el<strong>les</strong> sont p<strong>la</strong>cées chez <strong>les</strong> femmes en haut, sur <strong>la</strong> poitrine, en un endroit qui permet<br />
<strong>de</strong> câliner, <strong>de</strong> donner <strong>de</strong>s baisers et <strong>de</strong>s caresses au tout petit, montrant que, en le mettant au mon<strong>de</strong><br />
et en le nourrissant, on n’a pas pour fin l’utilité, mais l’affection <strong>»</strong> (J. Dumortier et J. Defradas (trad.), Paris,<br />
Les Bel<strong>les</strong> Lettres (CUF), 1975). Cf. Gell., XII, 1, 7. L’ourse est cependant souvent créditée d’une telle affection<br />
maternelle.<br />
121. Sur l’anthropomorphisme <strong>de</strong> l’ours, voir <strong>les</strong> remarques <strong>de</strong> PASTOUREAU 2007, 89-92.<br />
122. Sur l’ourse comme figure maternelle, on se reportera aux analyses <strong>de</strong> BACHOFEN 1863, qui gar<strong>de</strong>nt sur ce<br />
point toute leur validité.<br />
123. Si l’on pressent qu’il existe un rapport entre le genre grammatical <strong>de</strong> l’ani<strong>mal</strong> et sa représentation culturelle,<br />
ce rapport n’en est pas moins difficile à cerner, car il a pu jouer <strong>dans</strong> <strong>les</strong> <strong>de</strong>ux sens : le genre grammatical<br />
a pu contribuer à féminiser l’image <strong>de</strong> l’ours comme l’image culturelle <strong>de</strong> l’ani<strong>mal</strong>, qui incline vers<br />
une po<strong>la</strong>rité féminine, a pu favoriser <strong>la</strong> féminisation du genre. Sur cette difficile question, voir LAZZERONI<br />
1993 ; FRANCO 2003, 292-300 ; 2006, 28-31.<br />
124. GA, II, 1, 733 b 2-3.<br />
125. Ibid., V, 1, 779 a 24-26.<br />
Schedae, 2009, prépublication n°20, (fascicule n°2, p.153-188).<br />
http://www.unicaen.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint0202009.pdf<br />
173
174<br />
pour sa survie <strong>de</strong>s soins incessants prodigués par autrui 126 . Cette représentation exprime<br />
sans doute <strong>les</strong> angoisses que suscitaient tant l’apparente vulnérabilité du nouveau-né que<br />
le niveau extrêmement élevé <strong>de</strong> <strong>la</strong> mortalité infantile. Elle était re<strong>la</strong>yée par le discours<br />
médical, qui mettait l’accent, comme l’a bien montré D. Gourevitch, sur l’inachèvement<br />
foncier du nouveau-né, lequel <strong>de</strong>vait par conséquent être soumis à une intense activité <strong>de</strong><br />
mo<strong>de</strong><strong>la</strong>ge et <strong>de</strong> façonnage 127 . Telle était notamment <strong>la</strong> justification avancée pour l’habitu<strong>de</strong><br />
d’emmailloter <strong>les</strong> nouveau-nés. En d’autres termes, l’ourson informe <strong>léché</strong> par sa<br />
mère servait à penser le <strong>«</strong> petit monstre humain <strong>»</strong>, pour reprendre l’heureuse expression <strong>de</strong><br />
D. Gourevitch 128 . Cette analyse est confortée, me semble-t-il, par <strong>la</strong> présentation que font<br />
Virgile et Ovi<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’al<strong>la</strong>itement miraculeux <strong>de</strong> Rémus et <strong>de</strong> Romulus par une louve. Virgile<br />
fait figurer cette scène fondatrice <strong>de</strong> <strong>la</strong> romanité sur le bouclier d’Énée 129 :<br />
Fecerat et uiridi fetam Mauortis in antro<br />
procubuisse lupam, geminos huic ubera circum<br />
lu<strong>de</strong>re pen<strong>de</strong>ntis pueros et <strong>la</strong>mbere matrem<br />
impauidos, il<strong>la</strong>m tereti ceruice reflexa<br />
mulcere alternos et corpora fingere lingua.<br />
Il montrait aussi <strong>dans</strong> l’antre vert <strong>de</strong> Mars <strong>la</strong> louve couchée à terre ; elle venait <strong>de</strong> mettre bas ;<br />
à ses mamel<strong>les</strong> <strong>de</strong>ux enfants suspendus jouaient, tétaient leur mère sans effroi ; elle, tournant<br />
vers eux son cou arrondi, <strong>les</strong> caressait tour à tour et façonnait leurs corps <strong>de</strong> sa <strong>la</strong>ngue.<br />
Le mot qui m’intéresse ici est fingere, qui renvoie à une activité <strong>de</strong> façonnage. On retrouve<br />
le même verbe <strong>dans</strong> le traitement ovidien du motif, au livre II <strong>de</strong>s Fastes 130 . Comme l’ourson<br />
nouveau-né, le petit homme, fût-il le futur fondateur <strong>de</strong> Rome, a lui aussi besoin d’être<br />
énergiquement façonné.<br />
Le succès du motif du léchage post partum <strong>de</strong> l’ourson et l’aura maternelle dont jouissait<br />
l’ourse auraient pu valoir à l’espèce ursine une p<strong>la</strong>ce d’honneur <strong>dans</strong> le bestiaire <strong>de</strong>s<br />
Anciens. Or il n’en a rien été, notamment <strong>dans</strong> <strong>la</strong> culture romaine, où l’ours ne jouit pas<br />
d’une immense considération. Voisin gênant, vorace et gourmand, l’ours occupe une p<strong>la</strong>ce<br />
subordonnée <strong>dans</strong> le bestiaire romain, où il est supp<strong>la</strong>nté suivant <strong>les</strong> cas par le lion, par le<br />
loup et par le sanglier. L’ours est surtout bon, <strong>dans</strong> le mon<strong>de</strong> romain, à agrémenter <strong>les</strong><br />
spectac<strong>les</strong> <strong>de</strong> l’arène par <strong>la</strong> démonstration <strong>de</strong> sa force brutale 131 . Le verdict <strong>de</strong> Pline, à <strong>la</strong><br />
fin <strong>de</strong> sa notice, est sans appel : Nec alteri ani<strong>mal</strong>ium in <strong>mal</strong>eficio stultitia sollertior, <strong>«</strong> <strong>dans</strong><br />
sa sottise, il n’y a pas d’ani<strong>mal</strong> plus habile à faire le <strong>mal</strong> <strong>»</strong> 132 . Comment concilier cette image<br />
globalement négative <strong>de</strong> l’espèce avec l’image <strong>de</strong> l’ourse emplie <strong>de</strong> sollicitu<strong>de</strong> pour ses<br />
petits ? On peut invoquer l’ambivalence <strong>de</strong> l’ani<strong>mal</strong>, qui conjugue traits positifs et caractéristiques<br />
peu recommandab<strong>les</strong>, ou encore faire valoir qu’il y a p<strong>la</strong>ce, à côté du mauvais<br />
ours, pour un bon ours qui serait plutôt l’ours femelle 133 . Une autre voie, peut-être plus<br />
prometteuse, conduit à s’interroger sur <strong>les</strong> limites <strong>de</strong> cette figure maternelle incarnée par<br />
126. Voir CORDIER 2005, 34-41.<br />
127. NÉRAUDAU 1984, 74-75 ; GOUREVITCH 1995 ; HOLMAN 1997 ; GOUREVITCH et RAEPSAET-CHARLIER 2001, 120-121.<br />
128. GOUREVITCH 1995.<br />
129. Verg., Aen., VIII, 630-634 (J. Perret (trad.), Paris, Les Bel<strong>les</strong> Lettres (CUF), 1978).<br />
130. Ov., fast., II, 418.<br />
131. Je compte revenir sur tous ces points <strong>dans</strong> une étu<strong>de</strong> à venir. Sur l’image culturelle <strong>de</strong> l’ours <strong>dans</strong> le<br />
mon<strong>de</strong> romain, voir <strong>les</strong> remarques d’ANDREOLLI 1988 et MONTANARI 1988. L’ouvrage passionnant <strong>de</strong><br />
M. Pastoureau, L’Ours. Histoire d’un roi déchu (PASTOUREAU 2007), réserve fort peu <strong>de</strong> p<strong>la</strong>ce à l’époque<br />
romaine et s’en tient, pour le mon<strong>de</strong> grec, à <strong>la</strong> mention <strong>de</strong> quelques mythes, légen<strong>de</strong>s ou rites.<br />
132. Plin., nat., VIII, 131.<br />
133. Voir supra, p. 171.<br />
Schedae, 2009, prépublication n°20, (fascicule n°2, p. 153-188).<br />
http://www.unicaen.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint0202009.pdf
l’ourse. L’ourse prodigue ses soins à ses petits et <strong>les</strong> modèle avec patience jusqu’à leur<br />
donner forme ursine. Cette activité, qui s’exerce au profit du nouveau-né, fait <strong>de</strong> l’ourse<br />
non seulement une mère attentive, mais aussi et peut-être surtout une nourrice diligente.<br />
La louve <strong>de</strong> Rémus et <strong>de</strong> Romulus remplit <strong>de</strong> <strong>la</strong> même façon le rôle d’une nourrice, avant<br />
que n’intervienne une autre nourrice, humaine cette fois, en <strong>la</strong> personne <strong>de</strong> Larentia.<br />
L’ourse conjoint donc le rôle <strong>de</strong> <strong>la</strong> mère et celui <strong>de</strong> <strong>la</strong> nourrice. Or ces <strong>de</strong>ux rô<strong>les</strong> se trouvaient<br />
souvent disjoints <strong>dans</strong> <strong>la</strong> société romaine tardo-républicaine puis impériale. Il n’était<br />
pas d’usage, en effet, qu’une dame <strong>de</strong> qualité al<strong>la</strong>ite elle-même son enfant, même s’il existait<br />
bien sûr <strong>de</strong>s contre-exemp<strong>les</strong> célèbres. Plus <strong>la</strong>rgement, ce sont tous <strong>les</strong> soins <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
petite enfance, y compris le mo<strong>de</strong><strong>la</strong>ge déjà mentionné du nouveau-né, qui étaient volontiers<br />
délégués à <strong>de</strong>s tiers 134 . La norme était bien le recours à <strong>de</strong>s nourrices, non seulement<br />
<strong>dans</strong> l’aristocratie, mais aussi <strong>dans</strong> <strong>de</strong>s c<strong>la</strong>sses moins favorisées, et le discours médical –<br />
d’ailleurs fort mesuré – sur <strong>les</strong> bienfaits <strong>de</strong> l’al<strong>la</strong>itement maternel 135 comme <strong>les</strong> critiques<br />
acerbes <strong>de</strong>s philosophes <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux premiers sièc<strong>les</strong> <strong>de</strong> notre ère dirigées contre le recours<br />
à <strong>de</strong>s nourrices mercenaires 136 ne changèrent pas grand-chose au fait que l’al<strong>la</strong>itement du<br />
nouveau-né et <strong>les</strong> soins portés à sa toilette n’étaient plus comptés au nombre <strong>de</strong>s <strong>de</strong>voirs<br />
impératifs <strong>de</strong>s matrones romaines et ne constituaient sans doute pas aux yeux <strong>de</strong> cel<strong>les</strong>-ci<br />
le versant le plus attirant <strong>de</strong> <strong>la</strong> maternité 137 . Or <strong>les</strong> nourrices suscitaient <strong>de</strong>s sentiments<br />
mêlés. D’un côté, <strong>les</strong> textes comme <strong>les</strong> inscriptions livrent <strong>de</strong> nombreux témoignages<br />
d’affection unissant <strong>les</strong> <strong>«</strong> mères <strong>»</strong> nourricières à leurs <strong>«</strong> nourris <strong>»</strong> ; il y avait ainsi p<strong>la</strong>ce, à côté<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> parenté fondée sur <strong>la</strong> filiation naturelle ou adoptive, pour une parenté affective, fondée<br />
sur le <strong>la</strong>it et sur <strong>la</strong> fonction nourricière 138 . Les nourrices, d’un autre côté, éveil<strong>la</strong>ient<br />
aussi <strong>de</strong> fortes préventions, qui s’exprimaient notamment à travers l’image <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>«</strong> mauvaise<br />
nourrice <strong>»</strong> <strong>de</strong>ssinée par <strong>de</strong> nombreux textes 139 . Les nourrices, en outre, étaient toujours<br />
d’humble condition, qu’el<strong>les</strong> fussent esc<strong>la</strong>ves, affranchies ou <strong>de</strong> naissance libre 140 , et cette<br />
distance sociale n’était pas abolie par l’affranchissement souvent précoce <strong>de</strong>s nourrices <strong>de</strong><br />
134. Sur <strong>les</strong> soins donnés à <strong>la</strong> petite enfance et sur <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong>s nourrices <strong>dans</strong> le mon<strong>de</strong> romain, voir GOUREVITCH<br />
1984b, 233-259 ; NÉRAUDAU 1984, 281-287 ; DIXON 1992, 120-129 et 141-167 ; BRADLEY 1986, 13-36 ; CORBIER<br />
1999 ; GOUREVITCH et RAEPSAET-CHARLIER 2001, 122-125 ; RAWSON 2003, 122-125.<br />
135. Sor., Ma<strong>la</strong>dies <strong>de</strong>s femmes, II, 7, 87-92 ; Gal., De sanitate tuenda, I, 7 = VI, p. 35-36 Kühn ; cf. Plin., nat.,<br />
XXVIII, 123. Le <strong>la</strong>it maternel a <strong>la</strong> préférence <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins, mais <strong>les</strong> mé<strong>de</strong>cins prennent acte du succès rencontré<br />
par <strong>la</strong> mise en nourrice et se montrent compréhensifs pour <strong>les</strong> mères qui refusent d’al<strong>la</strong>iter par<br />
peur d’un vieillissement prématuré (cf. Sor., Ma<strong>la</strong>dies <strong>de</strong>s femmes, II, 7, 92-110). Voir GOUREVITCH 1984b,<br />
233-255 et NÉRAUDAU 1984, 77-78.<br />
136. Sur <strong>les</strong> critiques adressées à <strong>la</strong> mise en nourrice <strong>de</strong>s petits enfants, dénoncée comme le symptôme d’une<br />
dégradation <strong>de</strong> l’affection naturelle unissant <strong>les</strong> parents à leur progéniture, et sur le thème <strong>de</strong> l’al<strong>la</strong>itement<br />
maternel, voir Plu., De l’amour <strong>de</strong> sa progéniture, 3 = Mor. 495d-496a ; [Plu.], De l’éducation <strong>de</strong>s<br />
enfants, V = Mor., 3 c-d ; Tac., dial., XXVIII, 4 ; Germ., XX, 2 ; Gell., XII, 1 (opinion du philosophe Favorinus<br />
d’Ar<strong>les</strong>). Le terreau philosophique <strong>de</strong> ces critiques est constitué par <strong>les</strong> réflexions stoïciennes sur le premier<br />
cercle <strong>de</strong> l’oikeiôsis et par <strong>la</strong> polémique qui <strong>les</strong> a opposés sur ce point aux épicuriens : voir NÉRAUDAU<br />
1984, 338 ; RADICE 2000, 222-229. Sur ces débats re<strong>la</strong>tifs à l’al<strong>la</strong>itement et au traitement <strong>de</strong> <strong>la</strong> petite<br />
enfance, qui sont caractéristiques <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux premiers sièc<strong>les</strong> <strong>de</strong> notre ère, voir GOUREVITCH 1984b, 234 ;<br />
NÉRAUDAU 1984, 337-341.<br />
137. Cf. Artem., I, 15, p. 23 Pack : <strong>«</strong> Rêve-t-on qu’on tient ou qu’on voit <strong>de</strong>s enfants tout nouveau-nés, si ce sont<br />
<strong>de</strong>s enfants à soi, c’est mauvais et pour l’homme et pour <strong>la</strong> femme ; car ce<strong>la</strong> annonce soucis et chagrins<br />
et préoccupations à cause <strong>de</strong> certaines nécessités inévitab<strong>les</strong>, étant donné qu’il n’est pas non plus possible<br />
d’élever <strong>de</strong>s tout petits sans <strong>de</strong> tel<strong>les</strong> sollicitu<strong>de</strong>s <strong>»</strong> (A. J. Festugière (trad.), Paris, Vrin (Bibliothèque<br />
<strong>de</strong>s textes philosophiques), 1975), Paidiva dovxai e[cein h] ij<strong>de</strong>i`n pantelw`" brevfh, i[dia me;n tevkna kai; ajndri;<br />
kai; gunaiki; mocqhrovn: frontivda" ga;r kai; luvpa" shmaivnei kai; merivmna" pragmavtwn ajnagkaivwn tinw`n<br />
e{neken, ejpeidh; ouj<strong>de</strong>; ta; brevfh a[neu touvtwn e[stin ajnaqrevyai. Sur <strong>les</strong> formes que prenait le sentiment<br />
maternel <strong>dans</strong> <strong>la</strong> société romaine et sur <strong>les</strong> re<strong>la</strong>tions qui pouvaient unir <strong>les</strong> mères romaines à leurs enfants,<br />
voir <strong>les</strong> réflexions nuancées <strong>de</strong> DIXON 1992, 104-140 et <strong>de</strong> RAWSON 2003, 220-239.<br />
138. NÉRAUDAU 1984, 284-287 ; CORBIER 1999, 1280-1284.<br />
139. Sur <strong>les</strong> préventions éveillées par <strong>les</strong> nourrices, voir NÉRAUDAU 1984, 281-283 et surtout MENCACCI 1995.<br />
140. Sur <strong>la</strong> condition sociale <strong>de</strong>s nourrices, voir GOUREVITCH 1984b, 255-258 ; BRADLEY 1986, 202-206 et 213-214 ;<br />
SCHULZE 1998, 13-19 ; CORBIER 1999, 1274 et 1276-1277 ; GOUREVITCH et RAEPSAET-CHARLIER 2001, 122-125.<br />
Schedae, 2009, prépublication n°20, (fascicule n°2, p.153-188).<br />
http://www.unicaen.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint0202009.pdf<br />
175
176<br />
condition servile 141 . Aussi l’infériorité sociale <strong>de</strong>s nourrices contribue-t-elle sans doute à<br />
expliquer que <strong>les</strong> éminentes qualités maternel<strong>les</strong> reconnues à l’ours femelle n’aient pas<br />
suffi à faire <strong>de</strong> cet ani<strong>mal</strong> décrié un modèle positif. Modèle <strong>de</strong> <strong>la</strong> bonne nourrice, l’ours<br />
femelle ne suffisait pas à tirer l’espèce <strong>de</strong> <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ce subordonnée qui était <strong>la</strong> sienne <strong>dans</strong> le<br />
bestiaire <strong>de</strong>s Romains.<br />
L’ourse y parvenait d’autant moins qu’on lui reconnaissait aussi une part d’ombre. Passons<br />
sur l’inquiétante agressivité qu’elle développe au bénéfice <strong>de</strong> ses petits et qui en fait<br />
un fauve plus redoutable encore que le mâle 142 et venons-en au portrait qu’en dresse<br />
Oppien d’Apamée <strong>dans</strong> le long poème cynégétique en quatre chants qu’il dédia à l’empereur<br />
Caracal<strong>la</strong> <strong>dans</strong> <strong>la</strong> secon<strong>de</strong> décennie du III e siècle <strong>de</strong> notre ère 143 :<br />
kai; pollh; Kuqevreia kai; ouj kata; kovsmon ijou`sa:<br />
h[mata ga;r kai; nuvkta" ejeldovmenai filovthto"<br />
aujtai; qhluvterai mavlΔ ejpΔ a[rsesin oJrmaivnousi,<br />
pau`ra meqievmenai gamivh" panterpevo" eujnh`",<br />
tevkna kui > skovmenai nhdu;n d v o{te kumaivnousin.<br />
Ouj ga;r toi qhvressi novmo", gasth;r o{te plhvqei,<br />
ej" levco" ejrcomevnoi" televein filothvsion e[rgon,<br />
novsfi movnwn luggw`n ojligodranevwn te <strong>la</strong>gww`n.<br />
“Arkto" dΔ iJmeivrousa gavmou stugevousav te levktron<br />
ch`ron e[cein, tovsa paisi; ta<strong>la</strong>vsseto mhtivsasqai,<br />
pri;n toketoiò molei`n w{rhn, pri;n kuvrion hj~mar:<br />
nhdu;n ejxevqliye, biavssato dΔ Eijleiquiva".<br />
Tovssh maclosuvnh, tovsso" drovmo" eij" ΔAfrodivthn.<br />
Tivktei dΔ hJmitev<strong>les</strong>ta kai; ouj memelismevna tevkna,<br />
savrka dΔ a[shmon, a[narqron, ajeiv<strong>de</strong>lon wjphvsasqai,<br />
ajmfovteron <strong>de</strong>; gavmw/paidotrofivh/te mevmhlen:<br />
ajrtitovko" dΔ e[tΔejou`sa metΔ a[rseno" ijqu;" ijauvei.<br />
Licma`tai glwvssh/<strong>de</strong>; fivlon govnon, oiJ~av<br />
te movscoi<br />
licmw`ntai glwvssh/sin ajmoibadi;" ajllhvloisi<br />
terpovmenoi: gavnutai <strong>de</strong>; boov" croi < kallivkerw" bou`":<br />
oujdΔ ajpop<strong>la</strong>vzontai, pri;n ajpo; gluku;n i{meron eij~nai:<br />
qumo;n dΔ eJspomevnoio suniaivnousi nomhò".<br />
}W" a[rkto" licmw`sa fivlou" ajnep<strong>la</strong>vssato pai`da",<br />
eijsovke knuzhqmoi`sin ajnai<strong>de</strong>va tonqruvzousi.<br />
… ils sont très portés aux choses <strong>de</strong> l’amour, mais <strong>de</strong> façon désordonnée. Car <strong>les</strong> femel<strong>les</strong>,<br />
éprouvant jour et nuit le désir <strong>de</strong> s’accoupler, se précipitent d’el<strong>les</strong>-mêmes sur <strong>les</strong> mâ<strong>les</strong> avec<br />
beaucoup d’ar<strong>de</strong>ur et ne font trêve aux p<strong>la</strong>isirs <strong>de</strong> <strong>la</strong> couche nuptiale que rarement, lorsqu’el<strong>les</strong><br />
ont conçu et que leur ventre s’alourdit. Car <strong>les</strong> bêtes sauvages n’ont pas coutume, lorsqu’el<strong>les</strong><br />
sont pleines, <strong>de</strong> rechercher l’accouplement et d’accomplir l’œuvre du désir, à <strong>la</strong> seule exception<br />
<strong>de</strong>s lynx et <strong>de</strong>s lièvres sans force. L’ourse, cependant, prise du désir <strong>de</strong> s’unir et ayant en<br />
horreur sa couche vi<strong>de</strong>, ose contre ses petits cette action inouïe, avant que n’arrive le moment<br />
<strong>de</strong> l’accouchement, avant le terme fixé : elle comprime sa matrice et fait violence à Éléithye. Si<br />
gran<strong>de</strong> est sa lubricité, si gran<strong>de</strong> <strong>la</strong> hâte qui <strong>la</strong> porte vers Aphrodite. Elle met au mon<strong>de</strong> <strong>de</strong>s<br />
rejetons à moitié formés, aux membres indistincts, chair informe, dépourvue d’articu<strong>la</strong>tions,<br />
dont <strong>la</strong> vue même est pénible ; un double souci <strong>la</strong> tient, s’accoupler et nourrir ses enfants. À<br />
141. Il était ainsi permis, en cas <strong>de</strong> <strong>«</strong> légitime affection <strong>»</strong> – iustae affectiones –, d’affranchir une nourrice ou un<br />
autre membre <strong>de</strong> cette parenté par le <strong>la</strong>it avant l’âge limite stipulé par <strong>la</strong> lex Aelia Sentia : Vlp., Dig., XL,<br />
2, 11-13. Voir à ce sujet CORBIER 1999, 1280-1284 et RAWSON 2003, 219-220, avec <strong>les</strong> références données<br />
note 25, 220.<br />
142. Arist., HA, VIII / IX, 1, 608 a 34 ; Ar. Byz., Epit., II, 332 (LAMBROS 1885, 102) ; Plin., nat., XI, 263.<br />
143. Opp., C., III, 146-169.<br />
Schedae, 2009, prépublication n°20, (fascicule n°2, p. 153-188).<br />
http://www.unicaen.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint0202009.pdf
peine a-t-elle mis bas qu’elle court s’unir au mâle. De sa <strong>la</strong>ngue, elle lèche sa portée, comme<br />
<strong>de</strong> jeunes bovins se lèchent à coups <strong>de</strong> <strong>la</strong>ngue, prenant p<strong>la</strong>isir l’un à l’autre ; l’ani<strong>mal</strong> aux bel<strong>les</strong><br />
cornes exulte en se frottant à sa partenaire et ils ne se séparent pas avant d’avoir épuisé le<br />
doux désir, réjouissant le cœur du gardien qui <strong>les</strong> suit. L’ourse, <strong>de</strong> <strong>la</strong> même façon, façonne ses<br />
petits en <strong>les</strong> léchant, aussi longtemps qu’ils geignent et grognent sans retenue.<br />
Oppien reprend le motif désormais traditionnel <strong>de</strong> l’immaturité <strong>de</strong>s oursons nouveaunés,<br />
que leur mère façonne à grands coups <strong>de</strong> <strong>la</strong>ngue. Son originalité rési<strong>de</strong> <strong>dans</strong> l’explication<br />
qu’il donne <strong>de</strong> <strong>la</strong> brièveté <strong>de</strong> <strong>la</strong> gestation chez l’ourse. Cette brièveté, à ses yeux,<br />
est <strong>la</strong> conséquence <strong>de</strong>s désirs immodérés <strong>de</strong> <strong>la</strong> femelle, qui recherche le mâle avec ar<strong>de</strong>ur<br />
en toute saison et ne souffre pas <strong>de</strong> voir sa vie sexuelle durablement interrompue par le<br />
far<strong>de</strong>au <strong>de</strong> <strong>la</strong> grossesse. Par conséquent, elle hâte elle-même <strong>la</strong> fin <strong>de</strong> sa grossesse en<br />
comprimant sa matrice pour en faire prématurément sortir l’ourson à peine formé. Cette<br />
explication rompt avec l’explication aristotélicienne par <strong>la</strong> multiparité. De fait, Oppien emploie<br />
tantôt le singulier, tantôt le pluriel pour évoquer <strong>les</strong> petits oursons, sans jamais mettre<br />
l’accent sur leur nombre. L’explication proposée par Oppien ne correspond pas à un comportement<br />
observable <strong>de</strong> l’espèce. Il est même piquant <strong>de</strong> remarquer que, selon <strong>les</strong> observations<br />
<strong>de</strong>s naturalistes mo<strong>de</strong>rnes, ce sont <strong>les</strong> ours mâ<strong>les</strong> qui mettent parfois à mort <strong>les</strong><br />
oursons, <strong>dans</strong> le but justement <strong>de</strong> rendre <strong>les</strong> femel<strong>les</strong> à nouveau sexuellement disponib<strong>les</strong><br />
144 . L’explication avancée n’est pas non plus conforme à ce que <strong>les</strong> Anciens connaissaient<br />
<strong>de</strong>s habitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> l’ours. Dans <strong>la</strong> vie sexuelle débridée qu’Oppien prête à l’ourse, il<br />
n’y a pas p<strong>la</strong>ce pour l’hibernation. Comment <strong>la</strong> femelle pourrait-elle courir sus au mâle si<br />
ce <strong>de</strong>rnier est paisiblement endormi au creux <strong>de</strong> sa tanière hivernale ? De fait, Oppien est<br />
contraint <strong>de</strong> disjoindre <strong>les</strong> informations re<strong>la</strong>tives à <strong>la</strong> <strong>reproduction</strong> <strong>de</strong> l’ours <strong>de</strong> cel<strong>les</strong> concernant<br />
son hibernation 145 , alors que tous ses <strong>de</strong>vanciers avaient noté <strong>la</strong> coïnci<strong>de</strong>nce entre<br />
<strong>la</strong> pério<strong>de</strong> d’hibernation et <strong>la</strong> mise bas <strong>de</strong> l’ourse, au point d’organiser leur propre notice<br />
en fonction du rythme saisonnier qui caractérise <strong>la</strong> biologie <strong>de</strong> l’espèce. Le comportement<br />
prêté à <strong>la</strong> femelle apparaît également quelque peu en contradiction avec <strong>la</strong> sollicitu<strong>de</strong><br />
qu’elle manifeste à sa progéniture. Dans <strong>les</strong> griefs adressés aux femmes par <strong>les</strong> auteurs<br />
anciens, l’intempérance sexuelle et <strong>la</strong> négligence vis-à-vis <strong>de</strong>s tout petits constituent souvent<br />
<strong>les</strong> <strong>de</strong>ux versants d’une même inconduite féminine 146 .<br />
Cette interruption volontaire <strong>de</strong> grossesse pratiquée par l’ourse sur elle-même n’est<br />
pas attestée <strong>dans</strong> <strong>la</strong> culture antique avant Oppien. Elle n’est cependant pas sans précé<strong>de</strong>nt,<br />
à condition <strong>de</strong> se tourner vers d’autres espèces que l’ours. Le parallèle le plus net est offert<br />
par <strong>la</strong> chienne, à qui l’on reprochait sa mise bas précoce. Un proverbe mettait ainsi en rapport<br />
<strong>la</strong> cécité <strong>de</strong>s chiots nouveau-nés avec <strong>la</strong> hâte coupable <strong>de</strong> <strong>la</strong> chienne, trop pressée <strong>de</strong><br />
mettre bas 147 . Ce proverbe est d’une antiquité vénérable, puisqu’il se rencontre <strong>dans</strong> le<br />
domaine mésopotamien dès <strong>les</strong> époques sumérienne et accadienne et qu’il est attesté en<br />
Grèce aussi tôt que le VII e siècle avant notre ère <strong>dans</strong> <strong>les</strong> Épo<strong>de</strong>s d’Archiloque 148 . Il fournit<br />
aussi l’argument d’une fable du corpus ésopique, <strong>«</strong> La truie et <strong>la</strong> chienne <strong>»</strong> : <strong>dans</strong> <strong>la</strong> dispute<br />
qui l’oppose à <strong>la</strong> truie au sujet <strong>de</strong> leur fécondité respective, <strong>la</strong> chienne se vante impru<strong>de</strong>mment<br />
d’être <strong>la</strong> seule <strong>de</strong> tous <strong>les</strong> quadrupè<strong>de</strong>s à avoir une gestation courte, s’attirant cette<br />
144. Sur <strong>les</strong> prédations <strong>de</strong>s mâ<strong>les</strong> adultes sur <strong>les</strong> oursons, voir PARDE et CAMARRA 1992, 26. Selon ces mêmes<br />
auteurs, il arriverait également qu’une portée se réduisant à un seul petit soit abandonnée au printemps<br />
par <strong>la</strong> mère, qui peut alors s’accoupler à nouveau <strong>dans</strong> l’année.<br />
145. Les informations sur l’hibernation <strong>de</strong> l’ours forment un développement distinct (III, 170-182), qui est juxtaposé<br />
à ce qui précè<strong>de</strong> par un simple nai; mhvn.<br />
146. Voir NÉRAUDAU 1984, 188-189, 204-205 et 283.<br />
147. TOSI 1991, 706, n° 1580. Sur ce proverbe, voir FRANCO 2003, 209.<br />
148. WEST 1997, 500 (pour <strong>les</strong> attestations orienta<strong>les</strong>) ; Archil., fr. 196a, 39-41 West 2 .<br />
Schedae, 2009, prépublication n°20, (fascicule n°2, p.153-188).<br />
http://www.unicaen.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint0202009.pdf<br />
177
178<br />
réplique cing<strong>la</strong>nte <strong>de</strong> <strong>la</strong> truie : <strong>«</strong> Eh bien, quand tu dis ce<strong>la</strong>, reconnais que tu n’enfantes que<br />
<strong>de</strong>s êtres aveug<strong>les</strong> <strong>»</strong>, ΔAllΔ, o{tan tou`to fravzh/, givnwske o{ti tuf<strong>la</strong>; tivktei" 149 . Dans <strong>les</strong><br />
Cynégétiques d’Oppien, le motif a été transféré <strong>de</strong> <strong>la</strong> chienne à l’ourse. Il a <strong>dans</strong> le même<br />
temps changé <strong>de</strong> signification. En effet, il ne semble pas que <strong>la</strong> hâte suspecte avec <strong>la</strong>quelle<br />
<strong>la</strong> chienne met fin à sa grossesse ait été mise au compte <strong>de</strong> son incapacité à maîtriser sa<br />
sexualité et <strong>de</strong> son désir <strong>de</strong> connaître à nouveau <strong>les</strong> p<strong>la</strong>isirs <strong>de</strong> l’accouplement 150 . Pour<br />
trouver <strong>dans</strong> <strong>la</strong> tradition antique une semb<strong>la</strong>ble impatience à s’accommo<strong>de</strong>r <strong>de</strong> l’abstinence<br />
liée à <strong>la</strong> grossesse, il faut se tourner vers d’autres espèces ani<strong>mal</strong>es. On remarquera que le<br />
motif est d’ordinaire appliqué non à <strong>la</strong> femelle, mais au mâle. Certes, <strong>les</strong> femel<strong>les</strong> peuvent<br />
être présentées comme <strong>la</strong>scives, mais cette <strong>la</strong>scivité se manifeste seulement par <strong>de</strong>s comportements<br />
racoleurs 151 . Loin <strong>de</strong> conduire à l’infantici<strong>de</strong>, l’hypersexualité a plutôt pour<br />
corol<strong>la</strong>ire l’hyperfécondité 152 . De tels infantici<strong>de</strong>s sont en revanche attribués au chat mâle<br />
par <strong>de</strong>s auteurs comme Hérodote et Élien ; <strong>les</strong> matous, selon eux, s’en prendraient aux portées<br />
pour rendre <strong>les</strong> femel<strong>les</strong> à nouveau réceptives 153 . Oppien transpose le motif du mâle à<br />
<strong>la</strong> femelle ; c’est désormais <strong>la</strong> femelle qui supporte avec impatience <strong>les</strong> dé<strong>la</strong>is imposés par<br />
<strong>la</strong> maternité, sans aller cependant jusqu’à l’infantici<strong>de</strong>. Quel bi<strong>la</strong>n peut-on tracer <strong>de</strong> cet<br />
examen <strong>de</strong> <strong>la</strong> tradition ? On a <strong>de</strong>s femel<strong>les</strong> <strong>la</strong>scives, mais qui ne s’en prennent pas à leurs<br />
petits ; <strong>de</strong>s mâ<strong>les</strong> lubriques qui mettent occasionnellement à mort <strong>les</strong> portées ; <strong>de</strong>s chiennes<br />
qui abrègent leur grossesse, mais sans être mues, semble-t-il, par <strong>la</strong> lubricité. Dans le<br />
développement d’Oppien, le motif <strong>de</strong> l’interruption volontaire <strong>de</strong> grossesse a été transféré<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> chienne à l’ourse, celui <strong>de</strong> <strong>la</strong> lubricité <strong>de</strong> <strong>la</strong> chatte à l’ourse, tandis que l’impatience à<br />
supporter <strong>les</strong> dé<strong>la</strong>is imposés à l’appétit sexuel par <strong>la</strong> gestation n’est plus le fait du mâle,<br />
mais <strong>de</strong> <strong>la</strong> femelle, qui va jusqu’à écourter sa grossesse. L’ourse d’Oppien apparaît ainsi<br />
comme un curieux croisement <strong>de</strong> chienne, <strong>de</strong> chatte et même <strong>de</strong> matou.<br />
La question se pose <strong>de</strong> savoir pourquoi le choix d’Oppien s’est porté sur l’ourse plutôt<br />
que sur un autre ani<strong>mal</strong>. Même si cette question ne peut recevoir <strong>de</strong> réponse que conjecturale,<br />
on peut avancer plusieurs raisons. Dans <strong>la</strong> mesure où <strong>les</strong> Cynégétiques d’Oppien<br />
s’intéressent avant tout aux mœurs et aux conduites <strong>de</strong>s animaux sauvages, il était naturel<br />
que le motif fût transféré d’un ani<strong>mal</strong> domestique comme <strong>la</strong> chienne à un ani<strong>mal</strong> sauvage<br />
comme l’ourse. Oppien, nous l’avons dit, combine <strong>de</strong>ux traits : <strong>la</strong> mise bas prématurée et<br />
le désir <strong>de</strong> s’accoupler <strong>mal</strong>gré <strong>la</strong> grossesse. De nombreuses espèces ont en partage le premier<br />
trait, mais c’est l’ourse qui se distingue. Quant au second trait, il appartient en propre<br />
à trois espèces, si l’on en croit <strong>la</strong> brève série esquissée par Oppien : l’ourse d’une part, le<br />
lynx femelle et <strong>la</strong> hase d’autre part 154 . La différence entre l’ours et <strong>les</strong> <strong>de</strong>ux autres espèces<br />
citées tient au fait que l’ourse doit mettre fin à sa grossesse pour pouvoir à nouveau s’unir<br />
au mâle, tandis que <strong>les</strong> lynx femel<strong>les</strong> et <strong>les</strong> hases ignorent cette contrainte, échappant par<br />
là à une mise bas prématurée 155 . À l’intersection <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux séries, il ne reste donc plus que<br />
149. Aesop., 223 Perry = 251 Hausrath = 342 Chambry.<br />
150. Lorsque le chien est présenté comme un ani<strong>mal</strong> lubrique, l’accusation vise tantôt l’espèce en général,<br />
tantôt <strong>les</strong> seuls mâ<strong>les</strong>, mais jamais <strong>la</strong> chienne en particulier : Plu., Préceptes conjugaux, VII = Mor., 139 b ;<br />
Ael., NA, VII, 19. Voir FRANCO 2003, 242, note 130.<br />
151. Les femel<strong>les</strong> tenues pour particulièrement portées à <strong>la</strong> copu<strong>la</strong>tion sont <strong>la</strong> chatte (Arist., HA, V, 2, 540 a 10-<br />
13), <strong>la</strong> biche (Ar. Byz., Epit., II, 485, LAMBROS 1885, 127), <strong>la</strong> jument (Arist., HA, VI, 18, 572 a 8-12 ; VI, 22, 575<br />
b 30-31 ; VII, 4, 585 a 3-7 ; GA, IV, 5, 773 b 25-32 ; Ael., NA, IV, 11) et, <strong>dans</strong> une moindre mesure, <strong>la</strong> vache (Arist.,<br />
HA, VI, 18, 572 b 3-4). Pour Aristote (GA, IV, 5, 773 b 33-35), une telle <strong>la</strong>scivité est le propre <strong>de</strong>s femel<strong>les</strong> aux<br />
tissus fermes. À cette liste, il convient d’ajouter <strong>la</strong> lionne adultère évoquée par Pline (nat., VIII, 42-43).<br />
152. Voir à ce sujet DASEN 2005, 35.<br />
153. Hdt., II, 66 ; Ael., NA, VI, 27.<br />
154. Opp., C., III, 153. Aristote propose une autre série, qui ne comprend que <strong>la</strong> femme et <strong>la</strong> jument : GA, IV,<br />
5, 773 b 25. Sur <strong>la</strong> <strong>la</strong>scivité <strong>de</strong>s juments, voir supra, note 151.<br />
155. Pour le lièvre, l’explication rési<strong>de</strong> <strong>dans</strong> le mécanisme <strong>de</strong> <strong>la</strong> superfétation : voir à ce sujet Hdt., III, 108 ;<br />
Arist., HA, VI, 33, 579 b 30-580 a 5 ; GA, IV, 5, 774 a 31-774 b 4 ; Plin., nat., VIII, 219. Aristote note bien qu’en<br />
Schedae, 2009, prépublication n°20, (fascicule n°2, p. 153-188).<br />
http://www.unicaen.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint0202009.pdf
l’ourse. L’anthropomorphisme <strong>de</strong> l’espèce ursine, doublé <strong>de</strong> sa forte po<strong>la</strong>rité féminine, a<br />
dû là encore jouer un rôle, l’ourse pouvant incarner aussi bien <strong>les</strong> excès <strong>de</strong> <strong>la</strong> sexualité<br />
féminine que <strong>les</strong> vertus d’une mère exemp<strong>la</strong>ire. Sans doute faut-il également faire <strong>la</strong> part<br />
du parti-pris sour<strong>de</strong>ment hostile à l’ours qu’Oppien adopte <strong>dans</strong> son poème cynégétique.<br />
L’ours est en effet constamment dévalorisé <strong>dans</strong> <strong>les</strong> vers qui lui sont consacrés. Il y est présenté<br />
comme un type d’ani<strong>mal</strong> féroce et dép<strong>la</strong>isant. Le trait incontestablement positif <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> sollicitu<strong>de</strong> maternelle, à défaut d’être supprimé, est présenté comme <strong>la</strong> conséquence<br />
d’un comportement marqué par <strong>la</strong> dénaturation du sentiment maternel : l’ourse est femelle<br />
avant d’être mère et ne veut pas cesser d’être <strong>la</strong> première pour <strong>de</strong>venir <strong>la</strong> secon<strong>de</strong> ; elle<br />
s’occupe certes <strong>de</strong> sa progéniture, mais c’est entre <strong>de</strong>ux accouplements. Sauvage et repoussante,<br />
l’ourse est pour Oppien une grosse bête lubrique, dont <strong>les</strong> sentiments maternels sont<br />
dévoyés par un comportement sexuel débridé.<br />
Il n’est pas possible <strong>de</strong> déterminer si Oppien est l’inventeur <strong>de</strong> cette fable <strong>de</strong> l’ourse<br />
comprimant sa matrice pour en chasser le fœtus ou s’il l’a empruntée à une source antérieure,<br />
aujourd’hui perdue. J’inclinerais pour ma part pour <strong>la</strong> première solution, tant <strong>les</strong> Cynégétiques<br />
apparaissent dominés <strong>dans</strong> leur ensemble par <strong>«</strong> une imagination guidée par <strong>la</strong><br />
sensualité <strong>»</strong> 156 . Le développement consacré à l’ours en offre un bon exemple, puisque<br />
l’érotisme cru qui gouverne le reste du passage contamine jusqu’au motif du léchage post<br />
partum <strong>de</strong>s oursons nouveau-nés à <strong>la</strong> faveur <strong>de</strong> <strong>la</strong> curieuse comparaison finale, où <strong>de</strong>ux<br />
jeunes bovins se lèchent avant <strong>de</strong> s’accoupler. Le prélu<strong>de</strong> à une scène d’accouplement sert<br />
ainsi <strong>de</strong> comparant à <strong>la</strong> sollicitu<strong>de</strong> maternelle d’une femelle elle-même habitée par le désir<br />
<strong>de</strong> s’accoupler.<br />
Avec Oppien, l’ourse <strong>de</strong>vient une femelle dévergondée, qui refuse <strong>de</strong> faire trêve aux<br />
p<strong>la</strong>isirs <strong>de</strong> l’accouplement le temps <strong>de</strong> porter à terme <strong>les</strong> fœtus qu’elle a conçus. Ce faisant,<br />
Oppien réactive l’image archaïque <strong>de</strong> <strong>la</strong> femme gasthvr, au désir insatiable, alliant goinfrerie<br />
et intempérance sexuelle, illustrée notamment par Hésio<strong>de</strong> et par Sémoni<strong>de</strong> 157 . Le<br />
motif <strong>de</strong> l’ourse mettant fin prématurément à sa grossesse témoigne sans doute aussi <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> réprobation grandissante que <strong>la</strong> pratique <strong>de</strong> l’avortement semble avoir rencontrée <strong>dans</strong><br />
<strong>la</strong> société impériale 158 . On notera à ce propos que <strong>les</strong> premières lois réprimant l’avortement<br />
datent du règne <strong>de</strong> Caracal<strong>la</strong>, qui est précisément le dédicataire <strong>de</strong>s Cynégétiques<br />
d’Oppien 159 . Certes, <strong>les</strong> <strong>de</strong>ux figures, celle <strong>de</strong> l’ourse pressant sa matrice et celle <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
femme fuyant <strong>la</strong> maternité, ne sont pas parfaitement superposab<strong>les</strong>. L’ourse, d’une part,<br />
ne tue pas le fruit <strong>de</strong> ses entrail<strong>les</strong>, mais se contente d’en déclencher précocément l’expulsion.<br />
D’autre part, <strong>la</strong> motivation prêtée aux femmes qui font le choix d’avorter n’est pas,<br />
sauf exception, une hâte suspecte <strong>de</strong> connaître à nouveau <strong>les</strong> p<strong>la</strong>isirs <strong>de</strong> l’amour, pour <strong>la</strong><br />
raison très simple qu’il n’y a pas d’interdit, <strong>dans</strong> l’Antiquité, pesant sur <strong>les</strong> re<strong>la</strong>tions sexuel<strong>les</strong><br />
156. général <strong>les</strong> petits levrauts viennent au mon<strong>de</strong> parfaitement formés. Sur <strong>les</strong> vues <strong>de</strong>s Anciens sur le phénomène<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> superfétation, voir LIENAU 1971 ; MENCACCI 1996, 14-21 ; DASEN 2005, 32-35. En revanche,<br />
Oppien est à ma connaissance le seul auteur antique à prêter un tel comportement au lynx ; sur le lynx<br />
<strong>dans</strong> l’Antiquité, voir KELLER 1909, 82-85.<br />
156. DUMONT 2001, 414-415.<br />
157. Hes., Th., 590-599 ; Op., 586-588 ; Semon., fr. 7 West. Sur l’image archaïque <strong>de</strong> <strong>la</strong> femme gasthvr, voir<br />
DETIENNE 1972, 222-226 ; LORAUX 1978 ; VERNANT 1978, 96 et 104-107 ; SISSA 1987, 76-93. Pour <strong>la</strong> postérité<br />
<strong>de</strong> ce thème, voir SISSA 2003, 94-115.<br />
158. Sur l’avortement, qui était <strong>la</strong>rgement pratiqué <strong>dans</strong> l’Antiquité, notamment sous l’Empire, voir NARDI<br />
1971 ; NÉRAUDAU 1984, 187-190 ; GOUREVITCH 1984a, 281 ; GOUREVITCH 1984b, 206-216 ; GOUREVITCH et<br />
RAEPSAET-CHARLIER 2001, 138-139 ; RAWSON 2003, 114-116 ; KAPPARIS 2002. Il ne faut pas confondre à ce<br />
propos réprobation et répression. Si l’avortement fait apparemment l’objet d’une réprobation grandissante,<br />
il n’est que tardivement réprimé par <strong>la</strong> loi, qui ne considère en outre que le tort fait au mari (voir<br />
note suivante).<br />
159. Dig., XLVII, 11, 4. Sur <strong>la</strong> légis<strong>la</strong>tion réprimant l’avortement, dont <strong>la</strong> portée exacte reste discutée, voir en<br />
particulier NARDI 1971, 413-458 et KAPPARIS 2002, 174-185.<br />
Schedae, 2009, prépublication n°20, (fascicule n°2, p.153-188).<br />
http://www.unicaen.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint0202009.pdf<br />
179
180<br />
pendant <strong>la</strong> grossesse 160 . Ceux qui s’en prenaient à <strong>la</strong> pratique <strong>de</strong> l’avortement reprochaient<br />
plutôt aux femmes leur égoïsme, leur coquetterie et leur rouerie : <strong>les</strong> femmes étaient censées<br />
faire preuve d’égoïsme en refusant <strong>les</strong> soins contraignants requis par <strong>la</strong> petite enfance,<br />
<strong>de</strong> coquetterie en fuyant <strong>les</strong> grossesses pour préserver <strong>la</strong> beauté <strong>de</strong> leur corps, <strong>de</strong> rouerie<br />
enfin en s’acharnant à faire disparaître <strong>de</strong>s rejetons que leurs traits risquaient <strong>de</strong> dénoncer<br />
comme illégitimes 161 . L’accusation <strong>de</strong> dévergondage n’est cependant jamais loin : l’égoïsme,<br />
<strong>la</strong> coquetterie et <strong>la</strong> rouerie ne sont que <strong>les</strong> symptômes d’une sexualité tyrannique et<br />
excessive, qui p<strong>la</strong>ce <strong>la</strong> satisfaction du désir au-<strong>de</strong>ssus <strong>de</strong>s <strong>de</strong>voirs <strong>de</strong> <strong>la</strong> maternité. Le portrait<br />
que dressent <strong>les</strong> satiristes <strong>de</strong> <strong>la</strong> femme mettant volontairement fin à sa grossesse n’est<br />
donc pas si éloigné <strong>de</strong> celui qu’Oppien <strong>de</strong>ssine <strong>de</strong> l’ourse. Un passage, il est vrai isolé, <strong>de</strong>s<br />
Préceptes <strong>de</strong> santé <strong>de</strong> Plutarque permet <strong>de</strong> parfaire le rapprochement. Il s’agit d’une comparaison<br />
brutale, qui vise à dénoncer l’empressement excessif avec lequel le commun <strong>de</strong>s<br />
mortels fait appel aux mé<strong>de</strong>cins ; ceux qui sont victimes <strong>de</strong> ce travers, dit Plutarque, se<br />
conduisent <strong>«</strong> comme <strong>de</strong>s femmes sans retenue qui usent <strong>de</strong> drogues et <strong>de</strong> moyens abortifs<br />
en vue <strong>de</strong> se faire remplir <strong>de</strong> nouveau et satisfaire leur sensualité <strong>»</strong>, kaqavper ajkov<strong>la</strong>stoi<br />
gunai`ke" ejkbolivoi" crwvmenai kai; fqorivoi" uJpe;r tou` pavlin plhrou`sqai kai; hJdupaqei`n 162 .<br />
Étrange assertion, selon <strong>la</strong>quelle <strong>les</strong> femmes ne peuvent avoir <strong>de</strong> re<strong>la</strong>tions sexuel<strong>les</strong> pendant<br />
leur grossesse et surtout n’avortent que pour mieux retomber enceintes ! La clef du<br />
passage est sans doute fournie par l’équivalence symbolique, bien attestée <strong>dans</strong> <strong>la</strong> culture<br />
grecque, entre <strong>la</strong> bouche <strong>de</strong> <strong>la</strong> femme et son sexe, entre <strong>la</strong> panse et <strong>la</strong> matrice, entre l’alimentation<br />
et <strong>la</strong> sexualité, entre <strong>la</strong> goinfrerie et l’intempérance sexuelle 163 . Comme l’écrit<br />
G. Sissa, <strong>«</strong> <strong>la</strong> polysémie du mot gasthvr superpose ou du moins associe <strong>de</strong>ux images précises :<br />
manger et digérer par le haut, être pénétrée et concevoir par le bas <strong>»</strong> 164 . C’est par analogie<br />
avec le comportement du glouton que se comprend <strong>la</strong> comparaison <strong>de</strong> Plutarque : <strong>de</strong><br />
même que le goinfre se fait vomir pour pouvoir s’emplir à nouveau et continuer à goûter<br />
aux p<strong>la</strong>isirs <strong>de</strong> <strong>la</strong> bonne chère 165 , <strong>de</strong> <strong>la</strong> même façon <strong>la</strong> femme insatiable ne se vi<strong>de</strong> que<br />
pour mieux se remplir.<br />
Si le léchage post partum <strong>de</strong> l’ourson nouveau-né était bon à penser, c’est qu’il fournissait<br />
une illustration frappante <strong>de</strong> l’inachèvement <strong>de</strong> tout nouveau-né, et en particulier<br />
du petit humain, si vulnérable en apparence au moment où il voit pour <strong>la</strong> première fois <strong>la</strong><br />
lumière du jour. Il contribuait aussi à <strong>de</strong>ssiner le portrait <strong>de</strong> <strong>la</strong> nourrice idéale, attentionnée<br />
et dévouée, incarnée par <strong>la</strong> figure <strong>de</strong> l’ours femelle, cette mère en fourrure qui passait volontiers<br />
pour admirable, même si certains auteurs voulurent y voir une mère trop humaine,<br />
160. Qu’il suffise ici <strong>de</strong> rappeler <strong>la</strong> répartie célèbre prêtée à Julie, <strong>la</strong> fille d’Auguste, qui aurait <strong>la</strong>ncé à ceux qui<br />
s’étonnaient <strong>de</strong> <strong>la</strong> ressemb<strong>la</strong>nce <strong>de</strong> ses enfants avec Agrippa, son mari légitime : <strong>«</strong> C’est que je ne prends<br />
un passager que lorsque le navire est plein <strong>»</strong> (Macr., sat., II, 5, 9). Voir aussi Arist., GA, IV, 5, 773 b 25. On<br />
ne tirera pas argument du fait que <strong>les</strong> mé<strong>de</strong>cins déconseil<strong>la</strong>ient <strong>les</strong> re<strong>la</strong>tions sexuel<strong>les</strong> pendant <strong>la</strong> grossesse<br />
<strong>dans</strong> l’idée que cel<strong>les</strong>-ci risquaient <strong>de</strong> secouer dangereusement le fœtus (voir à ce sujet GOUREVITCH<br />
1984b, 157-158), car ces prescriptions, loin <strong>de</strong> prouver l’existence d’un quelconque interdit, montrent au<br />
contraire qu’il s’agissait d’une pratique dont <strong>la</strong> diffusion justifiait <strong>les</strong> mises en gar<strong>de</strong> <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins.<br />
161. Pour ne prendre que <strong>de</strong>ux exemp<strong>les</strong>, parmi <strong>les</strong> plus significatifs, voir Ov., am., II, 14, 9-22 et Juv., VI, 592-<br />
601. Pour une discussion <strong>de</strong>s différents témoignages, voir NÉRAUDAU 1984, 187-190, 204-208 et<br />
283 ; DIXON 1992, 92-94 ; KAPPARIS 2002, 113-120.<br />
162. Plu., Préceptes <strong>de</strong> santé, XXII = Mor., 134 f (J. Defradas, J. Hani et R. K<strong>la</strong>err (trad.), Paris, Les Bel<strong>les</strong> Lettres<br />
(CUF), 1985).<br />
163. Voir à ce sujet <strong>les</strong> analyses détaillées <strong>de</strong> SISSA 1987, 76-93.<br />
164. SISSA 1987, 89.<br />
165. La dénonciation <strong>de</strong> <strong>la</strong> pratique <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>«</strong> vomition <strong>»</strong> volontaire est à l’époque impériale un thème obligé <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> condamnation <strong>de</strong>s excès <strong>de</strong> <strong>la</strong> table : voir, par exemple, Sen., dial., XI, 10, 3 : uomunt ut edant, edunt ut<br />
uomant, <strong>«</strong>ils vomissent pour manger, mangent pour vomir<strong>»</strong>. Voir, à ce propos, GOUREVITCH 1974, 327 et ANDRÉ<br />
2006, 265 et 648.<br />
Schedae, 2009, prépublication n°20, (fascicule n°2, p. 153-188).<br />
http://www.unicaen.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint0202009.pdf
contaminée par le dévergondage qu’ils n’étaient que trop prompts à prêter à <strong>la</strong> moitié<br />
féminine <strong>de</strong> l’humanité.<br />
La question <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>reproduction</strong> <strong>de</strong> l’ours et le motif du léchage post partum <strong>de</strong>s oursons<br />
permettent <strong>de</strong> suivre l’évolution <strong>de</strong>s savoirs zoologiques à partir du IV e siècle av. J.-C. et<br />
jusqu’à <strong>la</strong> fin <strong>de</strong> l’Antiquité. Aristote le premier a collecté un nombre conséquent <strong>de</strong> données<br />
et d’observations re<strong>la</strong>tives à <strong>la</strong> <strong>reproduction</strong> <strong>de</strong>s ours. Il a intégré l’ours <strong>dans</strong> une<br />
série, celle <strong>de</strong>s animaux fissipè<strong>de</strong>s multipares mettant au mon<strong>de</strong> <strong>de</strong>s petits inachevés, et<br />
s’est enquis <strong>de</strong>s causes <strong>de</strong> ces gestations en apparence écourtées. Les vues d’Aristote ont<br />
été reprises par ses successeurs, mais <strong>de</strong> manière tronquée. Ceux-ci doivent à Aristote une<br />
bonne partie <strong>de</strong> leurs informations, ainsi que l’attention portée à certaines questions physiologiques.<br />
La question <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>reproduction</strong> occupe ainsi une p<strong>la</strong>ce éminente <strong>dans</strong> l’Épitomé<br />
d’Aristophane <strong>de</strong> Byzance, puisque le premier livre lui est tout entier consacré et qu’elle<br />
est encore bien représentée <strong>dans</strong> <strong>les</strong> développements monographiques du livre suivant.<br />
Mais le cadre d’exposition a changé : ce sont désormais <strong>les</strong> espèces, et non plus <strong>les</strong> parties<br />
<strong>de</strong>s animaux ou <strong>les</strong> fonctions biologiques, qui sont au centre <strong>de</strong> l’attention. Dans le cadre<br />
restreint <strong>de</strong> cette contribution, je ne me <strong>de</strong>man<strong>de</strong>rai pas si ce changement <strong>de</strong> perspective<br />
constitue une trahison <strong>de</strong> <strong>la</strong> zoologie aristotélicienne ou au contraire l’un <strong>de</strong> ses prolongements<br />
légitimes, voire nécessaires. Il s’agit d’une question essentielle à l’intelligence <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
biologie aristotélicienne et <strong>de</strong> ses objectifs, qui est loin d’être aujourd’hui tranchée 166 . Le<br />
recentrement du discours zoologique sur <strong>les</strong> espèces a eu <strong>de</strong>s conséquences qui dépassent<br />
<strong>les</strong> simp<strong>les</strong> modalités d’exposition du savoir zoologique. L’adoption d’un ordre monographique<br />
a en effet conduit à défaire <strong>les</strong> séries instituées par Aristote et partant à privilégier<br />
ce qui fait <strong>la</strong> singu<strong>la</strong>rité <strong>de</strong> chaque espèce ani<strong>mal</strong>e. Certains traits partagés entre plusieurs<br />
espèces se sont ainsi fixés <strong>de</strong> préférence sur une seule, tandis que <strong>les</strong> différents animaux<br />
ont été <strong>de</strong> plus en plus définis comme une somme <strong>de</strong> particu<strong>la</strong>rités composant un portrait<br />
à chaque fois singulier. Ce qui s’est perdu avec ces orientations nouvel<strong>les</strong>, c’est <strong>la</strong> perspective<br />
biologique qui permettait d’opérer <strong>la</strong> synthèse du mon<strong>de</strong> vivant en donnant un sens<br />
aux caractéristiques variées <strong>de</strong>s espèces ani<strong>mal</strong>es. La zoologie, en particulier, a progressivement<br />
dé<strong>la</strong>issé l’anatomie et <strong>la</strong> physiologie, que <strong>les</strong> mé<strong>de</strong>cins se sont au contraire réappropriées<br />
avec succès 167 .<br />
Le motif <strong>de</strong> l’ourse façonnant ses petits offre un bon exemple <strong>de</strong> cette évolution, <strong>dans</strong><br />
<strong>la</strong> mesure où <strong>la</strong> fidélité apparente à <strong>la</strong> zoologie d’Aristote dissimule en fait une incompatibilité<br />
théorique. Dans le cas <strong>de</strong> l’ours aussi, <strong>les</strong> différentes rubriques parcourues <strong>dans</strong> <strong>les</strong><br />
développements monographiques consacrés à une espèce ani<strong>mal</strong>e donnée ont fourni un<br />
cadre souple, capable d’accueillir toutes sortes d’éléments nouveaux, <strong>de</strong> faits frappants ou<br />
édifiants propres à servir <strong>de</strong> supports à <strong>de</strong>s réflexions mora<strong>les</strong>, quelque incompatib<strong>les</strong> qu’ils<br />
aient pu être par ailleurs avec <strong>la</strong> zoologie aristotélicienne. De problème à résoudre posé à<br />
une biologie soucieuse <strong>de</strong> se confronter aux complexités du mon<strong>de</strong> vivant, l’ourse léchant<br />
ses oursons est <strong>de</strong>venue une figure exemp<strong>la</strong>ire, permettant tour à tour d’incarner une<br />
maternité idéale, <strong>de</strong> penser l’inachèvement du petit humain à sa naissance ou <strong>de</strong> nourrir<br />
une réflexion sur <strong>la</strong> création artistique 168 .<br />
166. Pour <strong>la</strong> thèse d’une rupture entre <strong>la</strong> zoologie d’Aristote et celle <strong>de</strong> ses successeurs, entraînant un déclin<br />
rapi<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> discipline, voir, par exemple, WELLMANN 1891a, 503 ; SCHNEIDER 1969, 378-380 ; FRASER 1972,<br />
I, 337-338. Toute <strong>la</strong> question est <strong>de</strong> savoir si une étu<strong>de</strong> particulière <strong>de</strong>s animaux peut entrer ou non <strong>dans</strong><br />
le cadre théorique <strong>de</strong> <strong>la</strong> zoologie aristotélicienne ou péripatéticienne. Pour une interprétation qui fait <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> moriologie l’objectif principal, sinon ultime, <strong>de</strong> <strong>la</strong> zoologie aristotélicienne, voir PELLEGRIN 1982, 142-146<br />
et 171-193 ; 1985 ; 1987 ; 1990, 40-47. La thèse inverse est défendue par LLOYD 1991 et par ZUCKER 2005a,<br />
233-238 et 322-329.<br />
167. VEGETTI 1980, 478-482 ; 1995, 70-72.<br />
168. Sur ce <strong>de</strong>rnier point, voir DEGL’INNOCENTI PIERINI 2006.<br />
Schedae, 2009, prépublication n°20, (fascicule n°2, p.153-188).<br />
http://www.unicaen.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint0202009.pdf<br />
181
182<br />
Cette évolution se poursuivra durant l’Antiquité tardive et le Moyen Âge, avec cette<br />
différence que ce seront <strong>les</strong> vérités <strong>de</strong> l’enseignement chrétien que l’on cherchera à retrouver<br />
<strong>dans</strong> <strong>les</strong> particu<strong>la</strong>rités <strong>de</strong>s animaux. Les petits inachevés <strong>de</strong> l’ours y poursuivent leur<br />
carrière, mais ils sont désormais concurrencés et même supp<strong>la</strong>ntés par <strong>les</strong> lionceaux. La<br />
raison en est double. D’une part, l’ours est absent <strong>de</strong> ce texte fondateur <strong>de</strong> <strong>la</strong> zoologie<br />
médiévale qu’est le Physiologus, une œuvre complexe et multiple qui naquit sans doute<br />
<strong>dans</strong> le courant du II e siècle à Alexandrie, <strong>dans</strong> une terre sans ours 169 . S’il passe l’ours sous<br />
silence, le Physiologus est beaucoup plus disert sur le lion. Il expose en particulier comment<br />
<strong>les</strong> lionceaux, qui naissent non seulement aveug<strong>les</strong>, mais aussi inanimés, sont veillés par<br />
leur mère jusqu’à ce que leur père, le troisième jour, vienne leur redonner vie par son souffle<br />
170 . Dans cette allégorie transparente <strong>de</strong> <strong>la</strong> Résurrection, le lion a remp<strong>la</strong>cé l’ours, le<br />
souffle du père a pris <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue maternelle, tandis que <strong>la</strong> lionne se voit attribuer<br />
le rôle <strong>de</strong> <strong>la</strong> mater dolorosa 171 . L’absence <strong>de</strong> l’ours <strong>dans</strong> le bestiaire décrit par le Physiologus<br />
ne suffit cependant pas à expliquer le peu <strong>de</strong> succès rencontré <strong>dans</strong> l’allégorèse chrétienne<br />
par le motif du léchage post partum <strong>de</strong>s oursons. Certaines <strong>de</strong>s caractéristiques<br />
prêtées à l’ours par une tradition constante, comme l’effacement <strong>de</strong> ses traces à l’entrée<br />
<strong>de</strong> sa tanière hivernale, <strong>la</strong> disparition hivernale suivie d’un retour à <strong>la</strong> lumière, ou encore le<br />
façonnage post partum <strong>de</strong>s oursons, se prêtaient particulièrement bien à une lecture christologique,<br />
et el<strong>les</strong> ont d’ailleurs été parfois interprétées en ce sens, notamment chez certains<br />
<strong>«</strong> encyclopédistes <strong>»</strong> du XIII e siècle 172 . Ces tentatives isolées n’ont cependant pas réussi<br />
à faire <strong>de</strong> l’ours une figure christique reconnue, et l’ours femelle a été durablement évincé,<br />
comme exemple <strong>de</strong> dévouement envers sa progéniture, par d’autres animaux comme le<br />
lion ou encore le pélican. Il faut faire intervenir ici une secon<strong>de</strong> raison, qui est l’hostilité persistante<br />
<strong>de</strong> l’Église et <strong>de</strong> ses clercs à l’encontre <strong>de</strong> l’ours, un ani<strong>mal</strong> qui entretenait <strong>de</strong>s liens<br />
privilégiés avec le paganisme, notamment en Europe du Nord. L’Église s’employa donc,<br />
pendant plusieurs sièc<strong>les</strong>, à diaboliser, puis à dompter, ridiculiser et humilier cet adversaire<br />
redoutable 173 . C’est ainsi que l’ours resta pour <strong>la</strong> tradition occi<strong>de</strong>ntale un ani<strong>mal</strong> fondamentalement<br />
<strong>«</strong> <strong>mal</strong> <strong>léché</strong> <strong>»</strong>, <strong>mal</strong>gré <strong>les</strong> efforts louab<strong>les</strong> déployés à grands coups <strong>de</strong> <strong>la</strong>ngue,<br />
hiver après hiver, par <strong>les</strong> ourses.<br />
Bibliographie<br />
Principa<strong>les</strong> éditions utilisées<br />
ALBERT LE GRAND (Stadler 1916), Albertus Magnus. De ani<strong>mal</strong>ibus libri XXVI nach <strong>de</strong>r Kölner Urschrift,<br />
H. STADLER (éd.), Munster, Aschendorffsche Ver<strong>la</strong>gsbuchhandlung (Beiträge zur Geschichte <strong>de</strong>r Philosophie<br />
<strong>de</strong>s Mitte<strong>la</strong>lters, Texte und Untersuchungen, 15-16), 2 vol.<br />
169. Sur <strong>la</strong> question controversée <strong>de</strong> <strong>la</strong> composition du Physiologos, voir ZUCKER 2004, 9-19.<br />
170. Physiologos, 1, p. 2-8 Sbordone = p. 14-20 Offermans = KAIMAKIS 1976, 6-9. Sur ce chapitre, voir HENKEL<br />
1976, 164-167 et ZUCKER 2004, 56-60. Il convient également <strong>de</strong> rapprocher <strong>la</strong> figure du lion <strong>de</strong> celle du<br />
pélican (Physiologos, 4, p. 16-19 Sbordone = p. 28-30 Offermans = KAIMAKIS 1976, 16-17) : comme pour<br />
l’espèce léonine, <strong>les</strong> parents prennent le <strong>de</strong>uil <strong>de</strong> leurs enfants mort-nés, mais c’est <strong>la</strong> mère qui <strong>les</strong><br />
ramène à <strong>la</strong> vie, en se frappant le f<strong>la</strong>nc et en faisant jaillir le sang salvateur. Cette légen<strong>de</strong> est probablement<br />
née <strong>de</strong> l’observation du nourrissage <strong>de</strong>s petits pélicans, qui fouillent <strong>dans</strong> le bec <strong>de</strong> l’adulte pour<br />
provoquer <strong>la</strong> régurgitation <strong>de</strong> sa nourriture. Derrière le pélican du Physiologos se profile également <strong>la</strong><br />
figure du vautour égyptien, qui, selon une croyance rapportée par Horapollon (Horap., I, 11), s’ouvrait <strong>les</strong><br />
cuisses pour nourrir <strong>de</strong> son sang ses petits affamés.<br />
171. Voir ALEXANDRE 1986, 123-124 ; ZUCKER 2004, 56-60.<br />
172. Voir à ce sujet BECK 1994. Pour <strong>les</strong> Pères <strong>de</strong> l’Église, voir PASTOUREAU 2007, 100-101.<br />
173. L’histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> longue guerre menée par l’Église contre l’ours a été retracée en détail par PASTOUREAU<br />
(2007, 121-207).<br />
Schedae, 2009, prépublication n°20, (fascicule n°2, p. 153-188).<br />
http://www.unicaen.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint0202009.pdf
ARISTOTE (Aubert et Wimmer 1868), Aristote<strong>les</strong> Tierkun<strong>de</strong>. Kritisch berichtigter Text, mit <strong>de</strong>utscher<br />
Übersetzung, sachl. u. sprachl. Erklärung u. vollst. In<strong>de</strong>x, H. AUBERT et F. WIMMER (éd.) Leipzig, Engelmann,<br />
2 vol.<br />
ARISTOTE (Dittmeyer 1907), Aristotelis <strong>de</strong> ani<strong>mal</strong>ibus historia, L. DITTMEYER (éd.), Leipzig, Teubner.<br />
ARISTOTE (Louis 1961), Aristote. De <strong>la</strong> génération <strong>de</strong>s animaux, P. LOUIS (éd.), Paris, Les Bel<strong>les</strong> Lettres<br />
(CUF).<br />
ARISTOTE (Louis 1964-1969), Aristote. Histoire <strong>de</strong>s animaux, P. LOUIS (éd.), Paris, Les Bel<strong>les</strong> Lettres (CUF),<br />
3 vol.<br />
ARISTOTE (Peck 1970), Aristotle. Historia Ani<strong>mal</strong>ium, II, A. L. PECK (éd.), Londres – Cambridge (Mass.),<br />
Heinemann, Harvard University Press (Loeb).<br />
ARISTOTE (Lanza et Vegetti 1971), Aristotele. Opere biologiche, D. LANZA et M. VEGETTI (éd.), Turin, Unione<br />
tipografico-editrice torinese (C<strong>la</strong>ssici <strong>de</strong>l<strong>la</strong> scienza).<br />
ARISTOTE (Balme 2002), Aristotle, Historia Ani<strong>mal</strong>ium. Vol. I. Books I-X : Texte, D. M. BALME (éd.), avec <strong>la</strong><br />
col<strong>la</strong>boration d’A. GOTTHELF, Cambridge – New York – Melbourne – Madrid – Le Cap, Cambridge University<br />
Press (Cambridge C<strong>la</strong>ssical Texts and Commentaries, 38).<br />
GOW A. S. F. et PAGE D. L. (éd.) (1965), The Greek Anthology – Hellenistic Epigrams. II. Commentary and<br />
In<strong>de</strong>xes, Cambridge, Cambridge University Press.<br />
KAIMAKIS D. (éd.) (1976), Die Kyrani<strong>de</strong>n, Meisenheim – G<strong>la</strong>n, Ver<strong>la</strong>g Anton Hain (Beiträge zur k<strong>la</strong>ssischen<br />
Philologie, 76).<br />
LAMBROS S. P. (éd.) (1885), Excerptorum Constantini De natura ani<strong>mal</strong>ium libri duo, Aristophanis Historiae<br />
ani<strong>mal</strong>ium Epitome subiunctis Aeliani, Timothei aliorumque eclogis, Berlin, G. Reimer (Supplementum<br />
Aristotelicum, I-1).<br />
NAUCK A. (éd.) (1848), Aristophanis Byzantii grammatici Alexandrini fragmenta collegit et disposuit A. N.,<br />
Halle, sumptibus Lipperti et Schmidtii.<br />
SLATER W. J. (éd.) (1986), Aristophanis Byzantii Fragmenta, post A. Nauck collegit, testimoniis ornauit, breui<br />
commentario instruxit W.J. S., Berlin, W. <strong>de</strong> Gruyter (Sammlung griechischer und <strong>la</strong>teinischer Grammatiker, 6).<br />
SOLIN (Fernán<strong>de</strong>z Nieto 2001), Solino. Colección <strong>de</strong> hechos memorab<strong>les</strong> o el erudito, F. J. FERNÁNDEZ<br />
NIETO (éd.), Madrid, Editorial Gredos (Biblioteca clásica gredos, 291).<br />
THISSEN H. J. (éd.) (2001), Des Niloten Horapollon Hieroglyphenbuch. I. Text und Übersetzung, Munich<br />
– Leipzig, K. G. Saur.<br />
ZUCKER A. (éd.) (2004), Physiologos. Le bestiaire <strong>de</strong>s bestiaires, Grenoble, Jérôme Million.<br />
Étu<strong>de</strong>s<br />
ALDROVANDI U. (1637), De quadrupedibus digitatis viviparis libri III, Bologne, Tebaldini.<br />
ALDROVANDI U. et AMBROSINUS B. (1642), Monstrorum historia cum paralipomenis accuratissimis<br />
Historiae omnium ani<strong>mal</strong>ium, quae in voluminibus Aldrovandi <strong>de</strong>si<strong>de</strong>rantur, Bologne, Tebaldini.<br />
ALEXANDRE M. (1986), <strong>«</strong> Bestiaire chrétien : mort, rénovation, résurrection <strong>dans</strong> le Physiologus <strong>»</strong>, in Mort<br />
et Fécondité <strong>dans</strong> <strong>les</strong> mythologies, Actes du colloque <strong>de</strong> Poitiers (13-14 mars 1983), F. JOUAN (éd.), Paris,<br />
Les Bel<strong>les</strong> Lettres (Travaux et Mémoires, Centre <strong>de</strong> recherches mythologiques <strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> Paris X),<br />
p. 119-137.<br />
ALTHOFF J. (1992a), <strong>«</strong> Das Konzept <strong>de</strong>r generativen Wärme bei Aristote<strong>les</strong> <strong>»</strong>, Hermes, 120, p. 181-193.<br />
ALTHOFF J. (1992b), Warm, kalt, flüssig und fest bei Aristote<strong>les</strong>. Die Elementarqualitäten in <strong>de</strong>n zoologischen<br />
Schriften, Stuttgart, Franz Steiner Ver<strong>la</strong>g (Hermes Einzelschriften, 57).<br />
ANDRÉ J.-M. (2006), La Mé<strong>de</strong>cine à Rome, Paris, Tal<strong>la</strong>ndier.<br />
ANDREOLLI B. (1988), <strong>«</strong> L’orso nel<strong>la</strong> cultura nobiliare dall’Historia Augusta a Chrétien <strong>de</strong> Troyes <strong>»</strong>, in Il bosco<br />
nel medioevo, B. ANDREOLLI et M. MONTANARI (éd.), Bologne (Biblioteca di storia agraria medievale, 4),<br />
p. 35-54.<br />
ANDREOLLI B. et MONTANARI M. (éd.) (1988), Il bosco nel medioevo, Bologne (Biblioteca di storia agraria<br />
medievale, 4).<br />
ARGOUD G. et GUILLAUMIN J.-Y. (éd.) (1998), Sciences exactes et sciences appliquées à Alexandrie (IIIe siècle<br />
av. J.-C.-Ier siècle ap. J.-C.), Actes du colloque international <strong>de</strong> Saint-Étienne (6-8 juin 1996), Saint-Étienne,<br />
Publications <strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> Saint-Étienne (Mémoires du Centre Jean-Palerne, 16).<br />
BACHOFEN J. J. (1863), Der Bär in <strong>de</strong>r Religion <strong>de</strong>s Althertums, Bâle, Meyri.<br />
Schedae, 2009, prépublication n°20, (fascicule n°2, p.153-188).<br />
http://www.unicaen.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint0202009.pdf<br />
183
184<br />
BECK C. (1994), <strong>«</strong> Approches du traitement <strong>de</strong> l’ani<strong>mal</strong> chez <strong>les</strong> encyclopédistes du XIIIe siècle. L’exemple<br />
<strong>de</strong> l’ours <strong>»</strong>, in L’enciclopedismo medievale, Atti <strong>de</strong>l convegno, San Gimignano (8-10 octobre 1992),<br />
M. PICONE (éd.), Ravenne, Longo editore, p. 163-178.<br />
BESNIER B. (1997), <strong>«</strong> L’âme végétative selon Aristote <strong>»</strong>, Kairos, 9, p. 33-56.<br />
BLUM R. (1977), Kallimachos und die Literaturverzeichnung bei <strong>de</strong>n Griechen. Untersuchungen zur<br />
Geschichte <strong>de</strong>r Bibliographie, Francfort-sur-le-Main, Buchhändler-Vereinigung (Archiv für Geschichte<br />
<strong>de</strong>s Buchwesens, 18).<br />
BLUM R. (1983), Die Literaturverzeichnung im Altertum und Mitte<strong>la</strong>lter. Versuch einer Geschichte <strong>de</strong>r<br />
Biobibliographie von <strong>de</strong>n Anfängen bis zum Beginn <strong>de</strong>r Neuzeit, Francfort-sur-le-Main, Buchhändler-<br />
Vereinigung (Archiv für Geschichte <strong>de</strong>s Buchwesens, 24).<br />
BOBIS L. (2000), Le Chat. Histoire et légen<strong>de</strong>s, Paris, Fayard.<br />
BODSON L. (1986a), <strong>«</strong>Aspects of Pliny’s zoology<strong>»</strong>, in Pliny the El<strong>de</strong>r and his Influence, R. FRENCH et F. GREENWAY<br />
(éd.), Londres – Sydney, Croom Helm, p. 98-110.<br />
BODSON L. (1986b), <strong>«</strong> Caractères et tendances <strong>de</strong> <strong>la</strong> zoologie <strong>la</strong>tine <strong>»</strong>, EL, p. 19-32.<br />
BODSON L. (1987), <strong>«</strong> La zoologie romaine d’après l’Histoire naturelle <strong>de</strong> Pline l’Ancien <strong>»</strong>, in Pline l’Ancien<br />
témoin <strong>de</strong> son temps, Actes du colloque <strong>de</strong> Nantes (23-26 octobre 1985), J. PIGEAUD et J. OROZ (éd.),<br />
Sa<strong>la</strong>manques – Nantes, Universidad Pontificia <strong>de</strong> Sa<strong>la</strong>manca, p. 107-166.<br />
BODSON L. (1997), <strong>«</strong> Le témoignage <strong>de</strong> Pline l’Ancien sur <strong>la</strong> conception romaine <strong>de</strong> l’ani<strong>mal</strong> <strong>»</strong>, in L’Ani<strong>mal</strong><br />
<strong>dans</strong> l’Antiquité, B. CASSIN et J.-L. LABARRIÈRE (éd.), Paris, Vrin, p. 325-354.<br />
BÖMER F. (1986), P. Ovidius Naso. Metamorphosen. Kommentar. Buch XIV-XV, Hei<strong>de</strong>lberg, Carl Winter-<br />
Universitätsver<strong>la</strong>g.<br />
BONA I. (1991), Natura terrestrium (Plin. nat. hist. VIII), Gênes, Università di Genova, Facoltà di lettere (D.<br />
AR. FI. CL. ET ; n. s. 138).<br />
BOUDON V. (2001), <strong>«</strong> Galien et <strong>les</strong> arts figurés : un mé<strong>de</strong>cin amateur d’art <strong>»</strong>, in La Littérature et <strong>les</strong> arts<br />
figurés <strong>de</strong> l’Antiquité à nos jours, Actes du XIVe congrès international <strong>de</strong> l’Association Guil<strong>la</strong>ume Budé,<br />
Limoges (25-28 août 1998), Paris, Les Bel<strong>les</strong> Lettres, p. 209-217.<br />
BOUDON V. (2003), <strong>«</strong> Nature <strong>de</strong> <strong>la</strong> beauté et beauté <strong>de</strong> <strong>la</strong> nature chez Galien <strong>»</strong>, BAGB, 2, p. 77-91.<br />
BOUFFARTIGUE J. (2003), <strong>«</strong> Problématiques <strong>de</strong> l’ani<strong>mal</strong> <strong>dans</strong> l’Antiquité grecque <strong>»</strong>, Lalies, 23, p. 132-167.<br />
BRADLEY K. (1986), <strong>«</strong> Wet-nursing at Rome : a study in social re<strong>la</strong>tions <strong>»</strong>, in The Family in Ancient Rome.<br />
New Perspectives, B. RAWSON (éd.), Londres – Sydney, Croom Helm, p. 201-229.<br />
BRULÉ P. (1987), La Fille d’Athènes. La religion <strong>de</strong>s fil<strong>les</strong> à Athènes à l’époque c<strong>la</strong>ssique. Mythes, cultes<br />
et société, Paris, Les Bel<strong>les</strong> Lettres (Centre <strong>de</strong> recherches d’histoire ancienne, 76 – Anna<strong>les</strong> littéraires <strong>de</strong><br />
l’université <strong>de</strong> Besançon, 363).<br />
BRULÉ P. (1990), <strong>«</strong> De Brauron aux Pyrénées et retour : <strong>dans</strong> <strong>les</strong> pattes <strong>de</strong> l’ours <strong>»</strong>, DHA, 16-2, p. 9-27.<br />
BUFFON G. L. Leclerc, comte <strong>de</strong> (1760), Histoire naturelle générale et particulière. Livre VI, Paris, Imprimerie<br />
royale.<br />
BYL S. (1980), Recherches sur <strong>les</strong> grands traités biologiques d’Aristote: <strong>sources</strong> écrites et préjugés, Bruxel<strong>les</strong>,<br />
Pa<strong>la</strong>is <strong>de</strong>s Académies (Mémoires <strong>de</strong> <strong>la</strong> c<strong>la</strong>sse <strong>de</strong>s lettres <strong>de</strong> l’Académie royale <strong>de</strong> Belgique, 64-3).<br />
CAPPONI F. (1995), L’anatomia e <strong>la</strong> fisiologia di Plinio, Gênes, Università di Genova, Facoltà di lettere (D.<br />
AR. FI. CLET ; n. s. 158).<br />
COHN L. (1895), <strong>«</strong> Aristophanes 14 <strong>»</strong>, RE, II 1, col. 994-1005.<br />
CORBIER M. (1999), <strong>«</strong>La petite enfance à Rome: lois, normes, pratiques individuel<strong>les</strong> et collectives<strong>»</strong>, Anna<strong>les</strong><br />
(HSS), 54-6, p. 1257-1290.<br />
CORDIER P. (2005), Nudités romaines. Un problème d’histoire et d’anthropologie, Paris, Les Bel<strong>les</strong> Lettres.<br />
COURTNEY E. (1991), The Poems of Petronius, At<strong>la</strong>nta, Scho<strong>la</strong>rs Press (American C<strong>la</strong>ssical Studies, 25).<br />
COUTURIER M. A. (1954), L’Ours brun, Grenoble, Ursus arctos L.<br />
DASEN V. (2005), Jumeaux, jumel<strong>les</strong> <strong>dans</strong> l’Antiquité grecque et romaine, Zurich, Akanthus.<br />
DASEN V. et DUCATE-PAARMANN S. (2004), <strong>«</strong> La naissance et <strong>la</strong> petite enfance <strong>dans</strong> l’Antiquité.<br />
Bibliographie sélective (à partir <strong>de</strong> 1990, à l’exception <strong>de</strong>s ouvrages et artic<strong>les</strong> <strong>de</strong> référence) <strong>»</strong>, in Naissance<br />
et petite enfance <strong>dans</strong> l’Antiquité, Actes du colloque <strong>de</strong> Fribourg (28 novembre-1er décembre 2001),<br />
V. DASEN (éd.), Fribourg (Suisse) – Göttingen, Aca<strong>de</strong>mic Press Fribourg-Van<strong>de</strong>nhoeck & Ruprecht (Orbis<br />
Biblicus et Orientalis, 203), p. 377-405.<br />
DE STEFANI E. L. (1904), <strong>«</strong> Per l’“epitome Aristotelis <strong>de</strong> ani<strong>mal</strong>ibus” di Aristofane di Bizanzio <strong>»</strong>, SIFC, 12,<br />
p. 421-445.<br />
Schedae, 2009, prépublication n°20, (fascicule n°2, p. 153-188).<br />
http://www.unicaen.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint0202009.pdf
DEGL’INNOCENTI PIERINI R. (2006), <strong>«</strong> Il “parto <strong>de</strong>ll’orsa”, ovvero divagazioni sul<strong>la</strong> ‘maternità letteraria’fra<br />
Virgilio e Ovidio <strong>»</strong>, SFIC, 89, p. 210-228.<br />
DETIENNE M. (1972), Les Jardins d’Adonis, Paris, Gallimard (Bibliothèque <strong>de</strong>s histoires).<br />
DEVEREUX D. et PELLEGRIN P. (éd.) (1990), Biologie, logique et métaphysique chez Aristote, Actes du<br />
séminaire CNRS-NSF, Oléron (28 juin-3 juillet 1987), Paris, Éditions du CNRS.<br />
DIXON S. (1992), The Roman Family, Baltimore – Londres, The Johns Hopkins University Press.<br />
DUMONT J. (2001), Les Animaux <strong>dans</strong> l’Antiquité grecque, Paris, L’Harmattan.<br />
DÜRING I. (1966), Aristote<strong>les</strong>. Darstellung und Interpretation seines Denkens, Hei<strong>de</strong>lberg, C. Winter<br />
(Bibliothek <strong>de</strong>r k<strong>la</strong>ssischen Altertumswissenschaften, 1).<br />
ELZE C. (1913), <strong>«</strong> Vom “ungeleckten Bären” <strong>»</strong>, Archiv für die Geschichte <strong>de</strong>r Naturwissenschaften und <strong>de</strong>r<br />
Technik, 5-1, p. 36-48.<br />
FRANCO C. (2003), Senza ritegno. Il cane e <strong>la</strong> donna nell’immaginario <strong>de</strong>l<strong>la</strong> Grecia antica, Bologne, Il Mulino<br />
(Anthropologia <strong>de</strong>l mondo antico, 1).<br />
FRANCO C. (2006), <strong>«</strong> Il verro e il conghiale. Immagini di caccia e di virilità nel mondo greco <strong>»</strong>, SIFC, 99, 4<br />
s., 4-1, p. 5-31.<br />
FRASER P. M. (1972), Ptolemaic Alexandria, Oxford, C<strong>la</strong>rendon Press, 3 vol.<br />
FREUDENTHAL G. (1995), Aristotle’s Theory of Material Substance. Heat and Pneuma, Form and Soul, Oxford,<br />
C<strong>la</strong>rendon Press.<br />
GENTILI B. et PERUSINO F. (éd.) (2002), Le orse di Brauron. Un rituale di iniziazione femminile nel santuario<br />
di Artemi<strong>de</strong>, Pise, Edizioni ETS.<br />
GEORGE W. et YAPP B. (1991), The Naming of the Beasts. Natural History in Medieval Bestiary, Londres,<br />
Duckworth.<br />
GESNER C. (1551), Historiae ani<strong>mal</strong>ium liber primus <strong>de</strong> quadrupedibus viviparis, Zurich, apud C. Froschoverum.<br />
GIUMAN M. (1999), La <strong>de</strong>a, <strong>la</strong> vergine, il sangue. Archeologia di un culto femminile, Mi<strong>la</strong>n, Longanesi<br />
(Biblioteca di archeologia, 28).<br />
GOSSEN J. (1927), <strong>«</strong> Sostratos <strong>»</strong>, RE, III-A 1, col. 1203-1204.<br />
GOULET R. (1989), <strong>«</strong> Aristophane <strong>de</strong> Byzance <strong>»</strong>, in Dictionnaire <strong>de</strong>s philosophes antiques. I. Abam(m)on à<br />
Axiothéa, R. GOULET (éd.), Paris, Éditions du CNRS, p. 406-408.<br />
GOURÉVITCH D. (1974), <strong>«</strong> Le menu <strong>de</strong> l’homme libre. Recherches sur l’alimentation et <strong>la</strong> digestion <strong>dans</strong><br />
<strong>les</strong> œuvres en prose <strong>de</strong> Sénèque le philosophe <strong>»</strong>, in Mé<strong>la</strong>nges <strong>de</strong> philosophie, <strong>de</strong> littérature, d’histoire<br />
ancienne offerts à P. Boyancé, Rome, École française <strong>de</strong> Rome (EFR, 22), p. 311-344.<br />
GOUREVITCH D. (1984a), Le Triangle hippocratique <strong>dans</strong> le mon<strong>de</strong> gréco-romain. Le <strong>mal</strong>a<strong>de</strong>, sa <strong>mal</strong>adie<br />
et son mé<strong>de</strong>cin, Rome, École française <strong>de</strong> Rome (BEFAR, 251).<br />
GOUREVITCH D. (1984b), Le Mal d’être femme. La femme et <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>dans</strong> <strong>la</strong> Rome antique, Paris,<br />
Les Bel<strong>les</strong> Lettres (Realia).<br />
GOUREVITCH D. (1987), <strong>«</strong> Se mettre à trois pour faire un bel enfant, ou l’imprégnation par le regard <strong>»</strong>,<br />
L’Évolution psychiatrique, 52, p. 559-563.<br />
GOUREVITCH D. (1995), <strong>«</strong> Comment rendre à sa véritable nature le petit monstre humain ? <strong>»</strong>, in Ancient<br />
Medicine in its Socio-Cultural Context, P. J. VAN DER EIJK et al. (éd.), Ley<strong>de</strong>, Brill (Clio Medica), p. 239-260.<br />
GOUREVITCH D. et RAEPSAET-CHARLIER M.-T. (2001), La Femme <strong>dans</strong> <strong>la</strong> Rome antique, Paris, Hachette (La<br />
Vie quotidienne).<br />
GRMEK M. D. (1997), Le Chaudron <strong>de</strong> Médée. L’expérimentation sur le vivant <strong>dans</strong> l’Antiquité, Le P<strong>les</strong>sis-<br />
Robinson, Institut Synthé<strong>la</strong>bo.<br />
HENKEL N. (1976), Studien zum Physiologus im Mitte<strong>la</strong>lter, Tübingen, Niemeyer.<br />
HOLMAN S. R. (1997), <strong>«</strong> Mol<strong>de</strong>d as Wax : Formation and Feeding of the Ancient Newborn <strong>»</strong>, Helios, 24-1,<br />
p. 77-95.<br />
IRIGOIN J. (1998), <strong>«</strong> Les éditions <strong>de</strong> poètes à Alexandrie <strong>»</strong>, in Sciences exactes et sciences appliquées à<br />
Alexandrie (IIIe siècle av. J.-C.-Ier siècle ap. J.-C.), Actes du colloque international <strong>de</strong> Saint-Étienne (6-<br />
8 juin 1996), G. ARGOUD et J.-Y. GUILLAUMIN (éd.), Saint-Étienne, Publications <strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> Saint-Étienne<br />
(Mémoires du Centre Jean-Palerne, 16), p. 405-413.<br />
JACOB C. (1992), <strong>«</strong> Callimaque : un poète <strong>dans</strong> le <strong>la</strong>byrinthe <strong>»</strong>, in Alexandrie IIIe siècle av. J.-C. Tous <strong>les</strong><br />
savoirs du mon<strong>de</strong> ou le rêve d’universalité <strong>de</strong>s Ptolémées, C. JACOB et F. DE POLIGNAC (éd.), Paris, Éditions<br />
Autrement (Série Mémoires, 19), p. 100-112.<br />
JACOB C. (1998), <strong>«</strong>La bibliothèque, <strong>la</strong> carte et le traité. Les formes <strong>de</strong> l’accumu<strong>la</strong>tion du savoir à Alexandrie<strong>»</strong>,<br />
in Sciences exactes et sciences appliquées à Alexandrie (IIIe siècle av. J.-C.-Ier siècle ap. J.-C.), Actes du<br />
Schedae, 2009, prépublication n°20, (fascicule n°2, p.153-188).<br />
http://www.unicaen.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint0202009.pdf<br />
185
186<br />
colloque international <strong>de</strong> Saint-Étienne (6-8 juin 1996), G. ARGOUD et J.-Y. GUILLAUMIN (éd.), Saint-Étienne,<br />
Publications <strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> Saint-Étienne (Mémoires du Centre Jean-Palerne, 16), p. 19-37.<br />
JONSTON J. (1652), Historiae naturalis <strong>de</strong> quadrupedibus libri, Francfort-sur-le-Main, Merian.<br />
JOST M. (1985), Sanctuaires et cultes d’Arcadie, Paris, Vrin (Étu<strong>de</strong>s péloponnésiennes, 9).<br />
JOUANNA J. (1992), Hippocrate, Paris, Fayard.<br />
KAPPARIS K. (2002), Abortion in the Ancient World, Londres, Duckworth Aca<strong>de</strong>mic.<br />
KELLER O. (1887), Thiere <strong>de</strong>s c<strong>la</strong>ssischen Alterthums in Kulturgeschichtlicher Beziehung, Innsbruck,<br />
Ver<strong>la</strong>g <strong>de</strong>r Wagner’schen Universitäts-Buchhandlung.<br />
KELLER O. (1909-1913), Die antike Tierwelt, Leipzig, W. Engelmann, 2 vol.<br />
KROLL W. (1940), Zur Geschichte <strong>de</strong>r aristotelischen Zoologie, Vienne – Leipzig, Höl<strong>de</strong>r-Pichler-Tempsky<br />
A. G. (Sitzungsberichte <strong>de</strong>r Aka<strong>de</strong>mie <strong>de</strong>r Wissenschaften in Wien, Philosophisch-historische K<strong>la</strong>sse, 218-<br />
2).<br />
KROLL W. (1951), <strong>«</strong> Plinius 5 <strong>»</strong>, RE, XXI-1, col. 271-439.<br />
KULLMANN W. (1998-1999), <strong>«</strong> Zoologische Sammelwerke in <strong>de</strong>r Antike <strong>»</strong>, in Gattungen wissenschaftlicher<br />
Literatur in <strong>de</strong>r Antike, W. KULLMANN et al. (éd.), Tübingen, Gunter Narr Ver<strong>la</strong>g (ScriptOralia, 95), p. 121-<br />
139 [repris <strong>dans</strong> Geschichte <strong>de</strong>r Mathematik und <strong>de</strong>r Naturwissenschaften in <strong>de</strong>r Antike. I. Biologie,<br />
G. WÖHRLE (éd.), Stuttgart, Franz Steiner Ver<strong>la</strong>g, p. 181-198.<br />
LACÉPÈDE B., CUVIER G. et GEOFFROY E. (1804), La Ménagerie du Muséum national d’Histoire naturelle ou<br />
<strong>de</strong>scription <strong>de</strong>s animaux qui y vivent ou qui y ont vécu, Paris, Miger, 2 vol.<br />
LAZZERONI R. (1993), <strong>«</strong>Il genere indoeuropeo. Una categoria naturale ?<strong>»</strong>, in Maschile e femminile, M. BETTINI<br />
(éd.), Rome – Bari, Laterza, p. 3-16.<br />
LEFEBVRE R. (1993), <strong>«</strong> La théorie aristotélicienne <strong>de</strong> <strong>la</strong> génération <strong>de</strong>s animaux : un certain désordre<br />
étiologique <strong>»</strong>, Elenchos, 14, p. 257-276.<br />
LEMERLE P. (1971), Le Premier Humanisme byzantin, Paris, PUF (Bibliothèque byzantine, Étu<strong>de</strong>s, 6).<br />
LESKY E. (1951), Die Zeugungs- und Vererbungslehren <strong>de</strong>r Antike und ihr Nachwirken, Wiesba<strong>de</strong>n, Franz<br />
Steiner.<br />
LIENAU C. (1971), <strong>«</strong>Die Behandlung und Erwähnung von Superfetation in <strong>de</strong>r Antike<strong>»</strong>, Clio medica, 6, p. 275-<br />
285.<br />
LLOYD G. E. R. (1961), <strong>«</strong> The <strong>de</strong>velopment of Aristotle’s theory of the c<strong>la</strong>ssification of ani<strong>mal</strong>s <strong>»</strong>, Phronesis,<br />
p. 59-80.<br />
LLOYD G. E. R. (1983), Science, Folklore and I<strong>de</strong>ology. Studies in the Life Science in Ancient Greece,<br />
Cambridge – New York – New Rochelle – Melbourne – Sydney, Cambridge University Press.<br />
LLOYD G. E. R. (1991), Methods and Problems in Greek Science, Cambridge – New York – Port Chester –<br />
Melbourne – Sydney, Cambridge University Press [in Biologie, logique et métaphysique chez Aristote,<br />
Actes du séminaire CNRS-NSF, Oléron (28 juin-3 juillet 1987), D. DEVEREUX et P. PELLEGRIN (éd.), Paris,<br />
Éditions du CNRS, 1990, p. 7-35].<br />
LORAUX N. (1978), <strong>«</strong> Sur <strong>la</strong> race <strong>de</strong>s femmes et quelques-unes <strong>de</strong> ses tribus <strong>»</strong>, Arethusa, 11, 1-2, p. 43-87<br />
[repris <strong>dans</strong> N. LORAUX (1981), Les Enfants d’Athéna. Idées athéniennes sur <strong>la</strong> citoyenneté et <strong>la</strong> division <strong>de</strong>s<br />
sexes, Paris, Éditions La Découverte (Textes à l’appui), p. 75-117].<br />
MAIRE B. (2004), <strong>«</strong> L’imprégnation par le regard ou l’influence <strong>de</strong>s “simu<strong>la</strong>cres” sur l’embryon <strong>»</strong>, in<br />
Conceptions et représentations <strong>de</strong> l’extraordinaire <strong>dans</strong> le mon<strong>de</strong> antique, Actes du colloque international,<br />
Lausanne (mars 2003), O. BIANCHI, P. MUDRY et O. THÉVENAZ (éd.), Berne – Francfort-sur-le-Main, Lang, p. 279-<br />
294.<br />
MANQUAT M. (1932), Aristote naturaliste, Paris, Vrin.<br />
MANSON M. (1978), <strong>«</strong> Puer bimulus (Catulle, 17, 12-13) et l’image du petit enfant chez Catulle et ses<br />
prédécesseurs <strong>»</strong>, MEFRA, 90-1, p. 247-291.<br />
MANSON M. (1983), <strong>«</strong> The Emergence of the S<strong>mal</strong>l Child at Rome <strong>»</strong>, History of Education, 12, p. 149-159.<br />
MARASCO G. (1995), <strong>«</strong> Cleopatra e gli esperimenti su cavie umane <strong>»</strong>, Historia, 44, p. 317-325.<br />
MARASCO G. (1998), <strong>«</strong>Cléopâtre et <strong>les</strong> sciences <strong>de</strong> son temps<strong>»</strong>, in Sciences exactes et sciences appliquées à<br />
Alexandrie (IIIe siècle av. J.-C.-Ier siècle ap. J.-C.), Actes du colloque international <strong>de</strong> Saint-Étienne (6-<br />
8 juin 1996), G. ARGOUD et J.-Y. GUILLAUMIN (éd.), Saint-Étienne, Publications <strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> Saint-Étienne<br />
(Mémoires du Centre Jean-Palerne, 16), p. 39-53.<br />
MATTHIOLI P. J. (1554), Commentarii in VI libros Pedacii Diosciridis Anazarbei <strong>de</strong> materia medica, Venise,<br />
Vincenzo Valgrisio [1re édition : 1544].<br />
Schedae, 2009, prépublication n°20, (fascicule n°2, p. 153-188).<br />
http://www.unicaen.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint0202009.pdf
MENCACCI F. (1995), <strong>«</strong> La balia cattiva : alcune osservazioni sul ruolo <strong>de</strong>l<strong>la</strong> nutrice nel mondo antico <strong>»</strong>, in<br />
Vicen<strong>de</strong> e figure fzmminili in Grecia e a Roma, Atti <strong>de</strong>l convegno Pesaro (28-30 avril 1994), R. RAFFAELLI<br />
(éd.), Ancône, Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna <strong>de</strong>l<strong>la</strong> Regione Marche, p. 227-237.<br />
MENCACCI F. (1996), I fratelli amici. La rappresentazione <strong>de</strong>i gemelli nel<strong>la</strong> cultura romana, Venise, Marsilio.<br />
MESSINA G. (1994), <strong>«</strong> Callimaco e <strong>la</strong> biblioteca di A<strong>les</strong>sandria <strong>»</strong>, in Il linguaggio <strong>de</strong>l<strong>la</strong> biblioteca. Scritti in<br />
onore di Diego Maltese, M. GUERRINI (éd.), II, Florence, Beni librari, p. 485-504.<br />
MICHLER M. (1968), Die alexandrinischen Chirurgen, Wiesba<strong>de</strong>n, F. Steiner.<br />
MONTANARI M. (1988), <strong>«</strong>Uomini e orsi nelle fonti agiografiche <strong>de</strong>ll’alto Medioevo<strong>»</strong>, in Il bosco nel medioevo,<br />
B. ANDREOLLI et M. MONTANARI (éd.), Bologne (Biblioteca di storia agraria medievale, 4), p. 55-72.<br />
MORAUX P. (1955), <strong>«</strong> À propos du nou`" quvraqen chez Aristote <strong>»</strong>, in Autour d’Aristote. Recueil d’étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
philosophie ancienne et médiévale offert à Monseigneur A. Mansion, Louvain, Publications universitaires<br />
<strong>de</strong> Louvains (Bibliothèque philosophique <strong>de</strong> Louvain, 16), p. 255-295.<br />
NAAS V. (2002), Le Projet encyclopédique <strong>de</strong> Pline l’Ancien, Rome, École française <strong>de</strong> Rome (EFR, 303).<br />
NARDI E. (1971), Procurato aborto nel mondo greco romano, Mi<strong>la</strong>n, Giuffrè.<br />
NEEDHAM J. (1959), A History of Embryology, Cambridge, Cambridge University Press.<br />
NÉRAUDAU J.-P. (1984), Être enfant à Rome, Paris, Les Bel<strong>les</strong> Lettres (Realia).<br />
ODORICO P. (1990), <strong>«</strong> La cultura <strong>de</strong>l<strong>la</strong> SULLOGH. 1) Il cosi<strong>de</strong>tto enciclopedismo bizantino 2) Le tavole <strong>de</strong>l<br />
sapere di Giovanni Damasceno <strong>»</strong>, ByzZ, 83, p. 1-21.<br />
PARDE J.-M. et CAMARRA J.-J. (1992), L’Ours <strong>de</strong>s Pyrénées (Ursus arctos, Linnaeus, 1758), Nort-sur-Erche,<br />
SFEPM (Encyclopédie <strong>de</strong>s carnivores <strong>de</strong> France, 5).<br />
PASTOUREAU M. (2004), Une Histoire symbolique du Moyen Âge occi<strong>de</strong>ntal, Paris, Seuil (La Librairie du<br />
XXIe siècle).<br />
PASTOUREAU M. (2007), L’Ours. Histoire d’un roi déchu, Paris, Seuil (La Librairie du XXIe siècle).<br />
PELLEGRIN P. (1982), La C<strong>la</strong>ssification <strong>de</strong>s animaux chez Aristote. Statut <strong>de</strong> <strong>la</strong> biologie et unité <strong>de</strong> l’aristotélisme,<br />
Paris, Les Bel<strong>les</strong> Lettres (Collection d’étu<strong>de</strong>s anciennes).<br />
PELLEGRIN P. (1985), <strong>«</strong> Aristotle : a Zoology without Species <strong>»</strong>, in Aristotle on Nature and Living Things.<br />
Philosophical and Historical Studies Presented to D. M. Balme on his seventieth birthday, A. GOTTHELF<br />
(éd.), Pittsburgh – Bristol, Mathesis Publications, Bristol C<strong>la</strong>ssical Press, p. 95-115.<br />
PELLEGRIN P. (1987), <strong>«</strong> Logical difference and biological difference : the unity of Aristotle’s thought <strong>»</strong>, in<br />
Philosophical Issues in Aristotle’s Biology, A. GOTTHELF et J. G. LENNOX (éd.), Cambridge – New York –<br />
Melbourne, Cambridge University Press, p. 313-338.<br />
PELLEGRIN P. (1990), <strong>«</strong> Taxinomie, moriologie, division. Réponses à G. E. R. Lloyd <strong>»</strong>, in Biologie, logique<br />
et métaphysique chez Aristote, Actes du séminaire CNRS-NSF, Oléron (28 juin-3 juillet 1987), D. DEVEREUX<br />
et P. PELLEGRIN (éd.), Paris, Éditions du CNRS, 1990, p. 37-47.<br />
PFEIFFER R. (1968), A History of C<strong>la</strong>ssical Scho<strong>la</strong>rship. I. From the Beginnings to the End of the Hellenistic<br />
Age, Oxford, C<strong>la</strong>rendon Press.<br />
PREUS A. (1975), Science and Philosophy in Aristotle’s Biological Works, Hil<strong>de</strong>sheim – New York, Georg<br />
Olms (Studien und Materialien zur Geschichte <strong>de</strong>r Philosophie, 1).<br />
RADICE R. (2000), <strong>«</strong> Oikeiosis <strong>»</strong>. Ricerche sul fondamento <strong>de</strong>l pensiero stoico e sul<strong>la</strong> sua genesi, Mi<strong>la</strong>n, Vita e<br />
pensiero (Col<strong>la</strong>na Temi metafisici e problemi <strong>de</strong>l pensiero antico. Studi e testi, 77).<br />
RAWSON B. (2003), Children and Childhood in Roman Italy, Oxford – New York, Oxford University Press.<br />
REY A. et CHANTREAU S. (1997), Dictionnaire <strong>de</strong>s expressions et locutions, Paris, Le Robert.<br />
ROSCHER W. H. (1906), Die Hebdoma<strong>de</strong>nlehren <strong>de</strong>r griechischen Philosophen und Ärzte. Ein Beitrag zur<br />
Geschichte <strong>de</strong>r griechischen Philosophie und Medizin, Leipzig, Teubner (Abhandlungen <strong>de</strong>r königl.-<br />
Sächsischen Gesellschaft <strong>de</strong>r Wissenschaften, Philol.-Hist. K<strong>la</strong>sse, 24-6).<br />
ROSE V. (1863), Aristote<strong>les</strong> pseu<strong>de</strong>pigraphus, Leipzig, Teubner.<br />
SALLMANN K. (éd.) (2000), Nouvelle histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> littérature <strong>la</strong>tine. IV. L’âge <strong>de</strong> transition. De <strong>la</strong> littérature<br />
romaine à <strong>la</strong> littérature chrétienne <strong>de</strong> 117 à 284 ap. J.-C. [Munich, 1997], F. HEIM (dir.) pour <strong>la</strong> version<br />
française, Turnhout, Brepols.<br />
SAMUEL A. E. (1972), Greek and Roman Chronology. Calendars and Years in C<strong>la</strong>ssical Antiquity, Munich,<br />
C. H. Beck (Handbuch <strong>de</strong>r Altertumswissenschaft, I-7).<br />
SCHNEIDER C. (1969), Kulturgeschichte <strong>de</strong>s Hellenismus, Munich, C. H. Beck, 2 vol.<br />
SCHULZE H. (1998), Ammen und Pädagogen. Sk<strong>la</strong>verinnen und Sk<strong>la</strong>ven als Erzieher in <strong>de</strong>r antiken Kunst<br />
und Gesellschaft, Mayence, Philipp von Zabern.<br />
Schedae, 2009, prépublication n°20, (fascicule n°2, p.153-188).<br />
http://www.unicaen.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint0202009.pdf<br />
187
188<br />
SISSA G. (1983), <strong>«</strong> Il corpo <strong>de</strong>l<strong>la</strong> donna. Lineamenti di une ginecologia filosofica <strong>»</strong>, in Madre materia.<br />
Sociologia e biologia <strong>de</strong>l<strong>la</strong> donna greca, S. CAMPESE, P. MANULI et G. SISSA (éd.), Turin, Boringhieri (Società<br />
antiche), p. 81-145.<br />
SISSA G. (1987), Le Corps virginal. La virginité féminine en Grèce ancienne, Paris, Vrin.<br />
SISSA G. (2003), Eros tiranno. Sessualità e sensualità nel mondo antico, Rome – Bari, Laterza.<br />
STEIER A. (1913), Aristote<strong>les</strong> und Plinius. Studien zur Geschichte <strong>de</strong>r Zoologie, Wurzbourg, C. Kabitzsch.<br />
SUSEMIHL F. (1891-1892), Geschichte <strong>de</strong>r grieschichen Literatur in <strong>de</strong>r Alexandrinerzeit, Leipzig, Teubner,<br />
2 vol.<br />
TOSI R. (1991), Dizionario <strong>de</strong>lle sentenze <strong>la</strong>tine e greche, Mi<strong>la</strong>n, BUR.<br />
VAN-PRAËT M. (1988), <strong>«</strong> L’arrivée <strong>de</strong> l’ours b<strong>la</strong>nc <strong>de</strong>s rues <strong>de</strong> Paris à <strong>la</strong> Ménagerie du Muséum d’histoire<br />
naturelle <strong>»</strong>, in D’ours en ours, Paris, Éditions du Muséum (Muséologie), p. 24-27.<br />
VEGETTI M. (1980), <strong>«</strong> Anatomia e c<strong>la</strong>ssificazione <strong>de</strong>gli ani<strong>mal</strong>i nel<strong>la</strong> biologia antica <strong>»</strong>, in Hippocratica,<br />
Actes du colloque hippocratique <strong>de</strong> Paris (4-9 septembre 1978), M. D. GRMEK (éd.), Paris, Éditions du CNRS<br />
(Colloques internationaux du CNRS, 583), p. 469-483.<br />
VEGETTI M. (1992), <strong>«</strong> Aristotele, il Liceo e l’enciclopedia <strong>de</strong>l sapere <strong>»</strong>, in La spazio letterario <strong>de</strong>l<strong>la</strong> Grecia<br />
antica. I. La produzione e <strong>la</strong> circo<strong>la</strong>zione <strong>de</strong>l testo, 1. La Polis, G. CAMBIANO et al. (éd.), Rome, Salerno,<br />
p. 587-611.<br />
VEGETTI M. (1995), <strong>«</strong> Entre le savoir et <strong>la</strong> pratique : <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine hellénistique <strong>»</strong>, in Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> pensée<br />
médicale en Occi<strong>de</strong>nt. I. Antiquité et Moyen Âge, M. D. GRMEK (éd.), Paris, Seuil, p. 67-94.<br />
VERNANT J.-P. (1978), <strong>«</strong> À <strong>la</strong> table <strong>de</strong>s hommes <strong>»</strong>, in La Cuisine du sacrifice en pays grec, J.-P. VERNANT et<br />
M. DETIENNE (éd.), Paris, Gallimard (Bibliothèque <strong>de</strong>s histoires), p. 37-132.<br />
VILATTE S. (1991), <strong>«</strong> La nourrice grecque. Une question d’histoire sociale et religieuse <strong>»</strong>, AC, 60, p. 5-28.<br />
VOISENET J. (2000), Bêtes et hommes <strong>dans</strong> le mon<strong>de</strong> médiéval : le bestiaire <strong>de</strong>s clercs du Ve au XIIe siècle,<br />
Turnhout, Brepols.<br />
WELLMANN M. (1891a), <strong>«</strong> Alexan<strong>de</strong>r von Myndos <strong>»</strong>, Hermes, 26, p. 481-566.<br />
WELLMANN M. (1891b), <strong>«</strong> Sostratos. Ein Beitrag zur Quellenanalyse <strong>de</strong>s Aelian <strong>»</strong>, Hermes, 26, p. 321-350.<br />
WELLMANN M. (1916), <strong>«</strong> Pamphilos <strong>»</strong>, Hermes, 51, p. 1-64.<br />
WENSKUS O. (1990), Astronomische Zeitangaben von Homer bis Theophrast, Stuttgart, Franz Steiner Ver<strong>la</strong>g<br />
(Hermes, Einzelschriften, 55).<br />
WEST M. L. (1997), The East Face of Helicon. West Asiatic Elements in Greek Poetry and Myth, Oxford,<br />
C<strong>la</strong>rendon Press.<br />
ZERUBAVEL E. (1985), The Seven Day Circle. The History and Meaning of the Week, Londres – New York,<br />
The Free Press.<br />
ZUCKER A. (2005a), Aristote et <strong>les</strong> c<strong>la</strong>ssifications zoologiques, Louvain-<strong>la</strong>-Neuve, Peeters.<br />
ZUCKER A. (2005b), Les C<strong>la</strong>sses zoologiques en Grèce ancienne d’Homère à Élien (VIIIe av.-IIIe siècle ap. J.-<br />
C.), Aix-en-Provence, Publications <strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> Provence.<br />
Schedae, 2009, prépublication n°20, (fascicule n°2, p. 153-188).<br />
http://www.unicaen.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint0202009.pdf