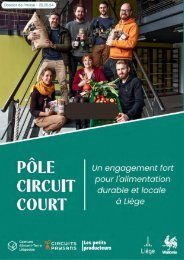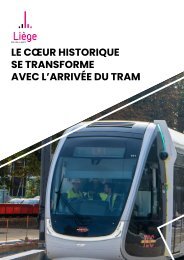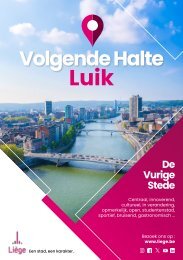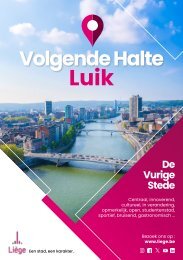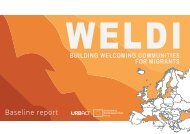Ry-Ponet - rapport phase 1 : Quel avenir pour le "Ry-Ponet" ? Diagnostic
Sous l’impulsion des communes de Beyne-Heusay, Chaudfontaine, Fléron et Liège, désireuses de définir un avenir souhaité et partagé pour ce site d’environ 400 hectares, Liège Métropole* a confié une mission d’étude à l’Atelier Caneva-s. Les objectifs de la mission sont les suivants : 1ère étape : poser un diagnostic pour approfondir les connaissances des caractéristiques intrinsèques du site 2e étape : proposer un schéma d’intentions qui mise sur la préservation des valeurs du site, donne une identité et précise les usages des lieux 3e étape : définir un plan d’actions à mettre en œuvre à court terme (3 et 5 ans), moyen terme (10-15 ans) et à long terme (30 ans soit « horizon 2050 »).
Sous l’impulsion des communes de Beyne-Heusay, Chaudfontaine, Fléron et Liège, désireuses de définir un avenir souhaité et partagé pour ce site d’environ 400 hectares, Liège Métropole* a confié une mission d’étude à l’Atelier Caneva-s. Les objectifs de la mission sont les suivants :
1ère étape : poser un diagnostic pour approfondir les connaissances des caractéristiques intrinsèques du site
2e étape : proposer un schéma d’intentions qui mise sur la préservation des valeurs du site, donne une identité et précise les usages des lieux
3e étape : définir un plan d’actions à mettre en œuvre à court terme (3 et 5 ans), moyen terme (10-15 ans) et à long terme (30 ans soit « horizon 2050 »).
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Comme énoncé dans <strong>le</strong> propos<br />
méthodologique, plutôt que d’analyser <strong>le</strong>s<br />
résultats de différentes approches de manière<br />
séparée, <strong>le</strong> choix méthodologique s’est orienté<br />
vers <strong>le</strong> croisement des quatre approches.<br />
Dans cette perspective, c’est la gril<strong>le</strong> de <strong>le</strong>cture<br />
des services écosystémiques qui servira de<br />
canevas <strong>pour</strong> principal support du processus<br />
analytique. Les services sont classés selon <strong>le</strong>s<br />
trois famil<strong>le</strong>s de représentations des services<br />
écosystémique généra<strong>le</strong>ment utilisées, à savoir<br />
:<br />
- Les services de production (treize services<br />
identifiés) / code cou<strong>le</strong>ur mauve ;<br />
- Les services de régulation (sept services<br />
identifiés) / code cou<strong>le</strong>ur jaune ;<br />
- Les services culturels (28 services identifiés) /<br />
code cou<strong>le</strong>ur vert.<br />
Dans <strong>le</strong> cadre du traitement du diagnostic, ce<br />
choix est apparu d’autant plus évident que<br />
<strong>le</strong>s quarante-huit services écosystémiques<br />
identifiés en préalab<strong>le</strong> ont l’avantage de<br />
représenter d’une part, toute la diversité<br />
écosystémique du territoire analysé et d’autre<br />
part, de couvrir l’ensemb<strong>le</strong> du périmètre de<br />
projet tout comme d’intégrer ses franges<br />
urbaines.<br />
La cartographie qui accompagne la plupart des<br />
services écosystémiques est majoritairement<br />
issue d’une production «sur mesure». Ceci<br />
<strong>pour</strong> se rapprocher au plus près d’une<br />
représentation spatia<strong>le</strong> de chacun des services<br />
écosystémiques analysés, adaptées aux<br />
singularités du site.<br />
Chaque service écosystémique est développé<br />
sur une doub<strong>le</strong> page (voir principe ci-contre) et<br />
expose :<br />
- Le titre retenu <strong>pour</strong> l’appellation du service<br />
écosystémique ainsi que <strong>le</strong> code donné à<br />
ce dernier <strong>pour</strong> faciliter <strong>le</strong>s manipulations et<br />
classements ;<br />
- La carte illustrant la spatialisation du service<br />
écosystémique, son orientation et sa légende ;<br />
- Un texte d’accompagnant de la carte,<br />
expliquant son contenu mais surtout y<br />
développant <strong>le</strong>s aspects analytiques ;<br />
- Un bloc texte «Retour des ateliers» relatant<br />
des échanges marquants qui sont apparus<br />
dans <strong>le</strong> cadre de l’atelier collaboratif ;<br />
- Un bloc texte «Paro<strong>le</strong>s d’acteurs» reprenant<br />
des extraits re<strong>le</strong>vant de la petite vingtaine<br />
d’entretiens réalisés avec des acteurs locaux,<br />
économiques, associatifs, … (voir liste en<br />
annexe) ;<br />
- Une première <strong>le</strong>cture graphique des résultats<br />
exprimés par chacun des groupes formés dans<br />
<strong>le</strong> cadre de l’atelier collaboratif, soit quatre<br />
groupes exprimant <strong>le</strong> degré de désirabilité<br />
de voir ou non <strong>le</strong> service se «développer<br />
prioritairement» dans <strong>le</strong> site ou encore, à<br />
l’opposé, de <strong>le</strong> voir «éviter absolument». Entre<br />
ces deux extrêmes trois autres niveaux de<br />
réponse étaient proposés. Un code cou<strong>le</strong>ur<br />
facilite la <strong>le</strong>cture des résultats ;<br />
- Une deuxième <strong>le</strong>cture graphique des<br />
résultats, cette fois exprimés individuel<strong>le</strong>ment<br />
par chacune des parties prenantes ayant<br />
participé à l’atelier collaboratif, soit une petite<br />
trentaine de résultats exprimés selon <strong>le</strong>s même<br />
critères et codes cou<strong>le</strong>urs que ceux utilisés par<br />
<strong>le</strong>s groupes.<br />
à éviter<br />
absolument<br />
à minimiser<br />
Intégration de trois approches <strong>pour</strong> l’analyse des services écosystémiques.<br />
Réponses des participants à l’atelier (individuel<strong>le</strong> et par groupe) à la question<br />
: «Est-ce que la thématique a sa place <strong>pour</strong> l’<strong>avenir</strong> du <strong>Ry</strong>-<strong>Ponet</strong> ?»<br />
sans objet<br />
à développer<br />
à développer<br />
prioritairement<br />
Permettant de faire <strong>le</strong> lien entre la spécificité<br />
des services écosystémique et <strong>le</strong> lieu qu’il<br />
mobilise, chaque carte cherche à localiser<br />
<strong>le</strong> plus précisément possib<strong>le</strong> <strong>le</strong> degré de<br />
présence ou non du service sur <strong>le</strong> site.<br />
Plus précisément, la cartographie repose sur<br />
plusieurs typologies de données, à savoir :<br />
- Des re<strong>le</strong>vés réalisés sur site ;<br />
- Des données spatialisées et relatées lors des<br />
entretiens avec <strong>le</strong>s acteurs ;<br />
- Des compilations de données provenant des<br />
données rendues accessib<strong>le</strong>s par différents<br />
services de la région wallonne.<br />
34 Atelier Caneva-s <strong>pour</strong> Liège Métropo<strong>le</strong> <strong>Quel</strong> <strong>avenir</strong> <strong>pour</strong> <strong>le</strong> «<strong>Ry</strong>-<strong>Ponet</strong>» ? diagnostic Atelier Caneva-s <strong>pour</strong> Liège Métropo<strong>le</strong> <strong>Quel</strong> <strong>avenir</strong> <strong>pour</strong> <strong>le</strong> «<strong>Ry</strong>-<strong>Ponet</strong>» ? diagnostic 35