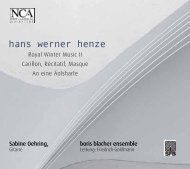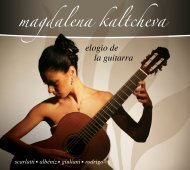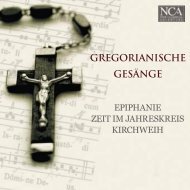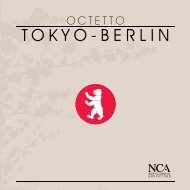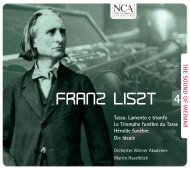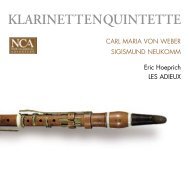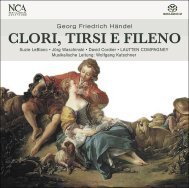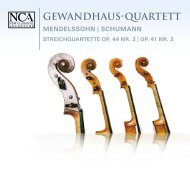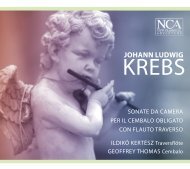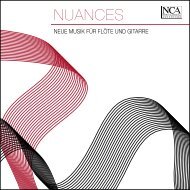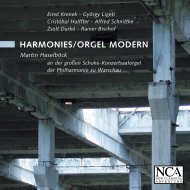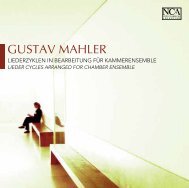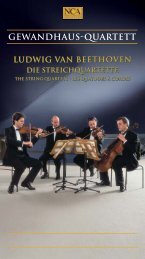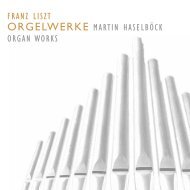georg philipp telemann (1681-1767) - nca - new classical adventure
georg philipp telemann (1681-1767) - nca - new classical adventure
georg philipp telemann (1681-1767) - nca - new classical adventure
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
dans le présent enregistrement, les musiciens tiennent compte de ce fait en réalisant la<br />
partie de basse dans de différentes formations. Telemann s’en remet à l’interprète pour<br />
décider lesquelles des douze sonates seront exécutées au violon ou à la flûte traversière.<br />
Ayant renoncé à tout élément d’écriture spécifique pour l’un ou l’autre des instruments<br />
(comme par exemple les doubles cordes caractéristiques) et s’étant assuré, par le choix<br />
des tonalités et de l’ambitus de la voix soliste, que chaque sonate puisse être réalisée<br />
aussi bien au violon qu’à la flûte traversière, il ne lui facilite pas la décision. Mary Utiger<br />
et Michael Schmidt-Casdorff ont simplement adopté pour leur enregistrement le principe<br />
de la distribution alternante : Solo I est joué au violon, Solo II à la flûte traversière, Solo<br />
III au violon, et ainsi de suite.<br />
POUR COMPLÉTER L’AUDITION, VOICI QUELQUES REMARQUES AU SUJET DE LA<br />
DISPOSITION, DU STYLE ET DE L’EXPRESSION DES DOUZE SONATES:<br />
Avec ses gestes de grande envergure et ses accords brisés dans la voix supérieure, le<br />
mouvement initial du SOLO I EN FA MAJEUR, Andante, prend le caractère du sublime et<br />
pourrait très bien porter l’indication « Nobile ». Il est suivi d’un Vivace dont le début<br />
syncopé montre des traits folkloriques. Par la suite, Telemann présente dans les deux voix<br />
une prolifération de figurations, donnant lieu à un dialogue élaboré et divertissant entre<br />
la mélodie et la basse. Dans le mouvement Grave qui suit, les deux voix sont là aussi<br />
traitées sur un pied d’égalité. Le motif initial d’une petite sixte ascendante détermine le<br />
caractère du mouvement entier, fondé sur la plainte et la déception. En comparaison, le<br />
mouvement final écrit à la manière d’une gigue se montre d’autant plus exubérant et<br />
turbulent.<br />
34 35<br />
LE SOLO II EN MI MINEUR évoque l’image d’une idylle pastorale. Le premier<br />
mouvement, indiqué Cantabile, est écrit en 6/8 dans une allure modérée. Il rappelle le<br />
Siciliano conçu sur le modèle d’une danse de berger, comme le rapporte Johann<br />
Joachim Quantz dans son livre « Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu<br />
spielen » (Essai d’une méthode pour apprendre à jouer de la flûte traversière). Le<br />
caractère capricieux de la musique correspond très bien à cette ambiance bucolique,<br />
surtout quand on se souvient du sens littéral du mot « capricieux » – à la manière d’un<br />
cabri bondissant. En ce sens, les deux mouvements vifs de cette sonate se présentent<br />
vraiment comme un Capriccio où la musique, avec ses syncopes, ses notes obstinément<br />
répétées et ses grands sauts d’intervalle, se fait entêtée, récalcitrante et rebelle comme<br />
un bouc. Lent, le troisième mouvement forme le plus grand contraste imaginable avec les<br />
deux premiers – là, le motif des notes répétées prend plutôt le caractère de l’indécision,<br />
voire d’une question hésitante.<br />
LE SOLO III EN LA MAJEUR s’oriente plutôt vers le style galant et « sentimental ».<br />
Favorisant l’expression des émotions, celui-ci se démarque volontairement de la facture<br />
contrapuntique complexe et élaborée des œuvres de la génération précédente. Les<br />
indications dynamiques différenciées de Telemann dans les deux mouvements lents, les<br />
appoggiatures et les ornements élaborés dans le Largo initial ainsi que la dénomination<br />
de mouvement « Andante e semplicemente » (!) en tête du troisième mouvement<br />
représentent les exemples qui démontrent comment cet idéal stylistique – « noble<br />
simplicité et grandeur sereine » (« edle Einfalt und stille Größe ») – peut être réalisé avec<br />
des moyens simples. Émaillés de trilles et de nombreux « passages mixtes » (gammes,<br />
sauts d’intervalle, triple accords, etc.), les deux mouvements vifs donnent l’occasion aux<br />
interprètes de déployer toute leur virtuosité à la voix supérieure comme à la basse<br />
accompagnante.<br />
Le SOLO IV EN UT MAJEUR poursuit la même ligne stylistique que la composition<br />
précédente, les mouvements déployant ici une richesse harmonique remarquable. Dans le<br />
Largo d’introduction, la voix supérieure qui présente d’abord une mélodie simple est<br />
ensuite forcée par la basse qui procède à pas chromatiques à se tourner à plusieurs<br />
reprises vers des tonalités éloignées, pour rejoindre vers la fin du mouvement, pourtant<br />
sensiblement « épuisée », la tonalité de base d’ut majeur. Le deuxième mouvement lent,<br />
Andante, débute en ré mineur – ce qui est assez insolite pour une sonate en ut ! – pour